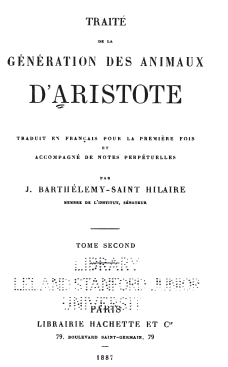
ARISTOTE
TRAITÉ DE LA GÉNÉRATION DES ANIMAUX
PREFACE.
Sommaire
TRAITÉ DE LA GÉNÉRATION DES ANIMAUX
PRÉFACE
|
TRAITÉ DE LA GÉNÉRATION DES ANIMAUX
D'ARISTOTE
TRADUIT EN FRANÇAIS POUR LA PREMIÈRE FOIS ET ACCOMPAGNÉ DE NOTES PERPÉTUELLES PAR J. BARTHÉLEMY-SAINT HILAIRE MEMBRE DE L'INSTITUT, SENATEUR TOME PREMIER PARIS LIBRAIRIE HACHETTE ET Cie 79, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 79 1887
A LA MÉMOIRE DE MONSIEUR MIGNET
A HONORÉ ET CHARMÉ MA VIE PENDANT QUARANTE ANS BARTHELEMY-SAINT HILAIRE.
I PRÉFACE Caractère général du Traité de la Génération des Animaux; méthode de recherches et d'exposition pratiquée par Aristote; système d'embryologie aristotélique; prédécesseurs et successeurs principaux d'Aristote, Hippocrate, Platon, Hérophile, Galien, Averroès, Albert le Grand, Rédi, Van Horne, de Graaf, Swammerdam, Malpighi, Leuwenhoeck, Vallisneri, Buffon, Spallanzani, Cuvier, Prévost et Dumas, Ernest de Baër, Coste, Longet, Velpeau, Pouchet, Grimaud de Caux et Martin-Saint Ange, H. Milne Edwards, etc., etc.; considérations sur les rapports de la science moderne et de la science dans l'Antiquité ; nécessité constante de la méthode d'observation ; loi du progrès des sciences tirée de leur histoire, depuis la Grèce jusqu'à nous; l'homme en présence de l'infini; questions supérieures; métaphysique de la génération, fondée sur la constatation des phénomènes ; admiration d'Aristote pour la Nature; conclusion. Le Traité de la Génération des Animaux passe pour le chef-d'œuvre zoologique d'Aristote ; tout le monde en convient, et les adversaires du péripatétisme sont forcés de l'avouer, comme s'ils étaient ses partisans. M. Lewes, si sévère pour l'Histoire des Animaux, et même pour le Traité des Parties, n'a pas assez d'éloges pour le Traité de la Génération ; Il II n'hésite pas à déclarer qu'il est bien souvent au niveau de la science la plus avancée de notre siècle. Cette appréciation, quelque favorable qu'elle soit, n'a rien d'excessif, pour qui rapproche plusieurs théories du philosophe grec des théories modernes. Parmi les admirateurs d'Aristote, MM. Aubert et Wimmer, qui se sont rendus célèbres par leur édition et leur traduction du Traité de la Génération et de l'Histoire des Animaux, il y a vingt-cinq ans, s'exprimaient ainsi : « En « donnant une édition et une traduction nouvelles du Traité de la Génération, nous avons cru rendre service à ceux des naturalistes qui ne dédaignent pas de remonter aux sources de la science qu'ils cultivent. Voici, concernant le développement des animaux, le premier travail scientifique, qui soit fondé sur les vrais principes de la physiologie, c'est-à-dire, sur l'observation des phénomènes. Quelque jugement qu'on prononce sur la valeur de cette zoologie, afin d'exalter le mérite des physiologistes contemporains, on devra toutefois reconnaître qu'Aristote a soulevé et discuté bien des III questions qui, aujourd'hui même, ne sont pas résolues; et que, grâce à l'étonnante pénétration de son coup d'œil, il a deviné une foule de vérités que les siècles postérieurs n'ont fait que confirmer, après une longue série d'observations. On devra aussi toujours reconnaître qu'on trouve dans ses œuvres bien des faits incontestables, dont l'abondance n'est en aucune proportion avec les ressources insuffisantes dont il disposait. En un mot, personne ne pourra refuser son admiration à ce génie fécond, qui, après avoir approfondi tous les secrets de l'esprit humain et ses rapports avec le monde extérieur, a montré la même sagacité et la même puissance pour décrire la constitution, le développement et la coordination systématique du règne animal. » N'ajoutons rien à une louange aussi juste, rendue en excellents termes, quoique nous puissions l'appuyer par bien d'autres autorités ; mais nous espérons que tous ceux qui s'occuperont de cette étude avec quelque impartialité, seront du même avis. Nous nous bornons à recommander aux esprits attentifs IV la lecture de l'original, si ce n'est dans le texte grec, au moins dans la traduction. Ce qui doit nous frapper, tout d'abord, c'est la conception même d'un tel ouvrage, à l'époque où il a été entrepris et réalisé. Aujourd'hui, rien ne nous paraît plus simple. Pour nous, la théorie de la génération fait essentiellement partie de l'histoire des êtres organisés. S'il est intéressant de savoir ce qu'ils sont, le mystère de leur reproduction l'est encore bien davantage. L'esprit humain, pour satisfaire autant qu'il le peut sa légitime curiosité, en est arrivé, après vingt siècles, à créer une science exclusivement consacrée à cette grande question ; et les peuples les plus éclairés ont établi des chaires publiques pour l'enseigner. Mais, si le mot d'embryologie est nouveau, la science même ne l'est pas; et on la peut voir tout au long dans l'œuvre aristotélique, trois cents ans et plus avant l'ère chrétienne. Pas un des philosophes précédents n'y avait songé. Pourtant, ils étaient, comme Aristote, les témoins intelligents des faits que présentent sans cesse à nos regards les animaux domestiques; mais, de ces faits particu- V liers, personne ne s'était élevé à l'idée d'un système qui embrassât l'ensemble du phénomène, dans toutes les espèces d'animaux, et qui en généralisât l'explication. C'est Aristote qui a créé cette science, comme il en a créé tant d'autres. Quelques progrès que l'embryologie ait accomplis depuis lui, il est toujours fort utile de le consulter, pour peu qu'on veuille s'enquérir de la tradition et savoir d'où l'on vient, ne fût-ce que par reconnaissance. Non seulement Aristote a eu la gloire de cette difficile initiative; mais, en outre, il a, du premier coup, compris la science qu'il inaugurait, avec toute l'étendue qu'elle doit avoir. Hippocrate, ou plutôt son école, ne s'était occupé de la génération que pour l'espèce humaine, et encore dans des limites étroites; la médecine, chargée avant tout du soin de guérir, n'avait pensé qu'à la pathologie. Le recueil plus ou moins authentique des œuvres attribuées à l'école hippocratique, contient des recherches sur les maladies des femmes et des jeunes filles, sur la nature de la femme et de l'enfant, sur le fœtus de sept VI mois, sur la superfétation, etc. ; ce sont là certainement des études curieuses et pratiques, dont quelques-unes font beaucoup d'honneur aux disciples d'Hippocrate. Mais la génération de l'homme, considérée même physiologiquement, est bien loin d'être toute la génération. C'est une partie fort importante du problème, puisque l'homme est, à cet égard comme à tant d'autres, l'animal le plus parfait ; mais, à côté de l'homme, il reste l'animalité tout entière, depuis les insectes les plus ténus, jusqu'aux quadrupèdes et aux cétacés les plus colossaux. Tous ces êtres se reproduisent par les moyens les plus divers ; mais quelques différences que présentent leurs organes, la fonction reste identique ; tous sans exception transmettent la vie qu'ils ont reçue. La Nature a donc une unité de but, malgré l'infinie variété des procédés qu'elle emploie. Quels sont ces procédés toujours efficaces, et toujours admirables? C'est ce qu'Aristote a essayé de nous apprendre scientifiquement; on verra avec quel succès, par l'exposé que nous ferons tout à l'heure de son embryologie. Pour le moment, nous n'avons qu'à rappeler que c'est VII lui qui a déterminé le cadre réel de la science, et qu'il l'a parcouru aussi complètement qu'on pouvait le parcourir à son époque. Au-dessous des insectes que nous pouvons apercevoir à l'œil nu, le microscope nous a révélé et nous révèle chaque jour, dans le monde des imperceptibles, une multitude d'êtres nouveaux et d'organismes inconnus. Mais, si la science a multiplié ses observations, si elle a poursuivi le domaine de la vie jusque dans les profondeurs les moins accessibles de la mer, elle n'a rien innové pour les bases qu'Aristote lui avait assignées et qui sont immuables. Aujourd'hui, comme il y a deux mille ans, la science se meut dans le cercle qu'il lui a tracé, et d'où elle ne peut sortir. L'unique progrès que nous puissions faire encore, c'est d'accroître de plus en plus le nombre des faits observés et de les analyser plus exactement; mais le nombre ne fait rien aux principes, qui restent à jamais ceux dont nous sommes redevables au philosophe. Aristote est même allé plus loin : il ne s'est pas arrêté aux animaux proprement dits ; il a pressenti cette autre science, qui est à peine VIII née d'hier parmi nous, et que nous nommons la biologie, dont l'objet est d'étudier la vie dans tous les êtres organisés, depuis les plantes jusqu'aux animaux supérieurs, l'homme compris. Aristote compare très fréquemment les deux règnes, pour en montrer les ressemblances, beaucoup plus nombreuses qu'on ne le croit généralement. Il insiste, comme pourrait le faire un biologiste de notre temps, sur l'impossibilité presque absolue de fixer le point où l'un des deux règnes commence et où l'autre finit. Il décrit, aussi bien que personne, les degrés insensibles par lesquels la Nature passe d'une organisation à une autre, et il signale, entre autres preuves, ces êtres singuliers qu'on appelle zoophytes, et qui ne sont tout à fait ni des animaux ni des plantes. Ne nous attardons pas à ces considérations, puisque les ouvrages d'Aristote sur la Botanique ne nous sont pas parvenus ; nous aurons l'occasion de revenir sur cette extension de l'embryologie et de la physiologie comparées, d'où naîtra certainement une science encore plus vaste que l'une et l'autre. XI Mais avant d'exposer l'embryologie aristotélique, nous avons à traiter une question préliminaire; c'est celle de la méthode, que le philosophe a conseillée et imposée à la science. Parmi nous, on s'est trop habitué à admettre que les Anciens n'ont pas observé du tout, ou, du moins, qu'ils ont observé très mal. C'est là une erreur qui exigerait, dans l'intérêt de la vérité historique, une réfutation en forme; nous nous contenterons ici, et sans sortir de l'histoire naturelle, de montrer combien on se trompe dans ce préjugé, qui ne s'appuie sur aucun fondement. Tout ce qu'il atteste, c'est la vanité passablement aveugle de quelques Modernes, qui ne s'aperçoivent pas que, en tenant si peu de compte des monuments scientifiques de l'Antiquité, ils manquent évidemment à la méthode d'observation tant prônée par eux. Ne parlons pas, si l'on veut, des œuvres d'Hippocrate, d'Hérodote, de Thucydide, résultat d'observations certaines ; mais demandons-nous si l'on peut lire, même très superficiellement, l'histoire naturelle d'Aristote, sans être émerveillé de la multitude d'observations qui y sont recueillies à profu- X sion. Est-il une seule page de ces prodigieux écrits où n'éclate, de la manière la plus évidente, l'emploi perpétuel de l'observation la plus exacte et la plus réfléchie ? Est-il un seul des faits consignés par l'auteur qui ne suppose une attention aussi sagace qu'infatigable, donnée à tous les détails des phénomènes. Mais Aristote ne se borne pas à bien observer les choses, telles que la Nature les présente aux yeux de l'homme. Il s'applique en outre à les scruter dans ce qu'elles ont de plus intime; il dissèque les animaux avec une persévérance que rien ne lasse, malgré tout ce que ces investigations peuvent avoir de répugnant, comme il l'avoue lui-même en termes éloquents. Mais les préparations anatomiques ne lui suffisent pas encore, parce qu'en effet elles ne peuvent pas subsister bien longtemps, dans l'état où le scalpel nous les procure. Pour les fixer, il y substitue des dessins copiés sur elles; il fait de ces dessins des collections, qui malheureusement ont péri avec les ouvrages qu'elles élucidaient, et, comme nous dirions, qu'elles illustraient; il cite vingt fois ces collections précieuses. XI C'est déjà beaucoup, ce semble. Mais, dira-t-on peut-être, si Aristote a tant observé et observé si bien, c'est par le pur instinct du génie, obéissant spontanément à une sorte d'inspiration, dont il n'est pas plus maître que le poète ne l'est de son enthousiasme. Cette seconde critique ne serait pas plus juste que l'autre. Observer même très exactement, sans savoir pourquoi l'on doit observer, serait peu philosophique et peu digne d'un logicien. Aristote ne commet pas cette inadvertance. D'un bout à l'autre de son histoire naturelle, il ne cesse pas de préconiser, avant tout, l'observation des faits, et d'en faire la condition primordiale de la science; il revient à chaque instant sur cette règle fondamentale. Il ne s'en dissimule pas d'ailleurs les difficultés ; mais il affirme que c'est le seul chemin pour atteindre la vérité, le seul moyen de comprendre la Nature, qui ne fait jamais rien en vain. Comme il admire passionnément la Nature, et qu'il y voit, ainsi qu'il l'a redit à plusieurs reprises, l'empreinte du divin, il est bien sûr, en l'étudiant, de ne pas perdre le fruit de ses peines ; il ne les épargne donc pas, et il engage les amis de XII la science et de la sagesse, à ne pas épargner davantage les leurs. Aussi, quand il réfute les théories de ses devanciers ou les préjugés populaires, c'est uniquement aux faits qu'il veut avoir recours. C'est à l'autorité des faits qu'il en appelle pour corriger les erreurs qu'il combat; c'est eux seuls qu'il oppose aux opinions fausses, que Démocrite, Empédocle et bien d'autres ont soutenues, pour n'avoir pas examiné les choses de plus près que le vulgaire. Guidé par la grande parole d'Anaxagore, qu'il a glorifié si magnifiquement, il croit a l'intelligence, qui régit le monde après l'avoir formé ; il se fie à cette intelligence infinie, dont les moindres productions lui semblent tout aussi merveilleuses que les plus sublimes. Mais, à côté des faits, à leur suite et même au-dessus d'eux, du moins à un certain point de vue, Aristote place l'esprit de l'homme, qui produit la vraie science, en interprétant les faits préalablement observés. A eux seuls, les faits n'ont rien de scientifique ; il faut que le raisonnement les féconde, sans d'ailleurs se passer jamais de cet appui. Sans la lumière XIII apportée par l'entendement, les faits restent obscurs, ou plutôt ils restent incompris, comme ils le sont pour les brutes, qui les voient ainsi que nous, mais qui n'y attachent aucun sens. Pour se conduire dans cette voie, où il est si facile et si ordinaire de s'égarer, notre esprit a deux principes souverains : ou les faits sont nécessaires, ou ils sont soumis à la loi universelle du mieux. La nécessité telle qu'Aristote l'admet ne tient rien du hasard, qu'il a toujours nié énergiquement, mais auquel des philosophes trop peu observateurs livrent l'univers. Selon lui, la nécessité ne peut être qu'hypothétique, c'est-à-dire, qu'un but étant donné, il y a des moyens qui sont absolument nécessaires pour atteindre ce but. Par exemple, l'oiseau devant voler, il est nécessaire qu'il ait des ailes; mais l'oiseau lui-même n'est pas nécessaire ; il pouvait fort bien ne pas exister; s'il existe, c'est qu'il était mieux qu'il existât. La Nature fait toujours ce qu'elle fait le mieux possible; quand nous cherchons à savoir ce qu'elle veut, nous n'avons qu'à nous demander, dans chaque cas, comment les choses doivent être pour être aussi parfaites que nous pou- XIV vons les imaginer. Aristote est donc un défenseur inébranlable des causes finales; et, pour notre part, nous croyons avec lui que la Nature n'est intelligible qu'à cette condition. Mais nous réservant de discuter plus tard ce problème, qui posera devant nos successeurs comme il a posé devant les Anciens, nous passons, et nous achevons ce que nous avons à dire de la méthode. Si, après la puissance décisive des faits, Aristote reconnaît celle du raisonnement, il est trop prudent pour ne pas se défier des écarts de l'esprit. En cas de conflit, c'est le raisonnement qui doit céder devant le fait avéré ; il n'a de valeur que s'il est absolument conforme aux phénomènes. C'est que les phénomènes sont immuables ; ils restent ce qu'ils sont, toujours les mêmes. Rien, au contraire, n'est plus mobile que le raisonnement de l'homme, puisqu'il lui est permis de faire des hypothèses. Néanmoins, Aristote ne repousse pas absolument l'hypothèse, quelque périlleuse qu'elle soit ; mais il la redoute, il en craint l'abus. S'il s'en sert quelquefois, c'est presque malgré lui, et il l'entoure de toutes les garan- XV ties qui peuvent en prévenir les dangers, comme il le fait dans sa discussion sur la génération des abeilles, question qui n'est guère moins obscure pour nous qu'elle ne l'était pour l'Antiquité. Il trouve que le plus souvent les hypothèses qu'on risque sont beaucoup trop générales, trop logiques, et qu'elles dégénèrent bien vite en pures rêveries. II ne traite pas mieux les siennes que celles des autres. Les hypothèses sont à éviter surtout en histoire naturelle, où il ne faut juger des choses que d'après leurs principes propres, et non d'après les idées qu'on s'en fait. La plupart du temps, le tort de l'hypothèse vient de ce qu'on généralise beaucoup trop vite, et sans un examen assez prolongé. Le cas particulier a été peut-être bien observé; mais il ne fallait pas en tirer hâtivement des conséquences qui le dépassent. Il suffit bien souvent d'un seul fait nouveau pour détruire de fond en comble la théorie la mieux construite, et pour renverser tout un système. Il ne faut pas non plus s'en fier aux apparences, qui sont parfois bien trompeuses. Si dans l'impossibilité d'observer soi-même, on se décide sur de simples témoi- XVI gnages, on doit en peser scrupuleusement la valeur, et voir avant tout s'ils sont dignes de foi. Voilà de bien sages conseils, qu'Aristote n'a pas cessé de mettre en pratique. Aujourd'hui même, nous serions fort embarrassés, ou d'y ajouter quoi que ce soit, ou de les critiquer. Mais, à d'autres égards encore, Aristote est un modèle également autorisé. Le mode d'exposition qu'il a suivi pour rendre ses pensées n'est pas moins remarquable, ni moins digne d'imitation, que sa méthode. Il énumère toujours, en débutant, les questions qu'il compte étudier tour à tour, et qui forment l'ensemble du sujet qu'il traite; par là, il affermit ses pas, quelque sûr qu'il puisse être de son incomparable génie. Dans le cours de ses exposés, il jette souvent un coup d'œil en arrière, pour résumer ce qu'il a dit. Il annonce non moins souvent ce qu'il va dire. Ces souvenirs et ces précautions sont toujours utiles à prendre ; ce sont des moyens de clarté pour l'auteur et pour ceux qui le lisent; de part et d'autre, on ne peut que s'en bien trouver. C'est là, nous en convenons, de la rhétorique; XVII mais la rhétorique est de mise partout; elle est bien placée, elle est même indispensable, quand elle ne sert qu'à se mieux entendre soi-même, et à se faire mieux entendre d'autrui. C'est ainsi que la discussion engagée par Aristote, contre la théorie qui fait venir la liqueur séminale de toutes les parties du corps, est un morceau achevé, où la force de la conclusion ne perd rien aux procédés habiles qui l'ont préparée. Un autre soin non moins louable d'Aristote, c'est de préciser le sens des mots dont il se sert. Dans notre xviiie siècle, on attachait une importance extrême au langage, et l'on allait jusqu'à déclarer que la science n'était, après tout, qu'une langue bien faite. C'était dépasser la mesure; et le philosophe de l'Antiquité avait été plus réservé que les nôtres. Mais on voit que cette préoccupation n'était pas neuve ; Aristote l'avait dès longtemps éprouvée. Aussi, soit en métaphysique, soit en histoire naturelle, il s'était appliqué à bien définir les mots, comme du reste Socrate et Platon s'y étaient appliqués avant lui. C'est qu'il n'est pas besoin de discuter longuement pour sentir que sou- XVIII vent le dissentiment tient plutôt aux expressions dont on use qu'au fond même des choses qu'on discute. Telle est l'infaillible méthode avec laquelle Aristote veut aborder l'histoire naturelle, et spécialement ce grand fait de la génération ; tel est son amour de la vérité, et sa circonspection contre toute chance d'erreur. Dans sa pensée, le traité qu'il consacre à la reproduction des animaux vient, parmi ses œuvres, après le Traité des Parties, comme le Traité des Parties vient après l'Histoire des Animaux. C'est l'auteur lui-même qui a fixé cet ordre, lequel, du reste, ressort clairement de la nature des choses. L'acte de la génération est le terme dernier auquel aboutissent tous les autres actes de la vie animale. Les animaux naissent chétifs pour la plupart, souvent même ils naissent informes ; ils ne se développent et ne se perfectionnent que pour arriver, après un temps plus ou moins long, à pouvoir se reproduire, dans des êtres qui leur ressemblent. L'animal n'est achevé que quand il possède enfin cette suprême énergie. La fonction génératrice est donc régulièrement la XIX dernière que la physiologie doive approfondir. Aristote ne s'y est pas trompé ; et sur ses pas, tous les physiologistes ont laissé la question de la génération à la place qu'il lui avait assignée. C'est par cette question définitive que Cuvier termine son Anatomie comparée, un des plus beaux titres de la science moderne. Aristote a exposé son embryologie à deux reprises : une première fois dans l'Histoire des Animaux, où elle tient près de trois livres sur neuf; et une seconde fois, dans le traité spécial qui nous occupe. Nous pouvons donc, pour connaître sa pensée complète, puiser indifféremment à ces deux ouvrages. Il les a lui-même confondus, en renvoyant plus d'une fois de l'un à l'autre. D'ailleurs, en analysant ses théories, nous nous garderons bien de lui en prêter qui ne seraient plus les siennes, et qui appartiendraient à des temps plus instruits. Nous nous efforcerons même de reproduire fidèlement ses propres expressions, toutes les fois que nous pourrons les lui emprunter; et nous ne tenterons, du moins pour le moment, ni de combler ses lacunes, ni de pallier ses erreurs, d'ailleurs bien rares et bien excusables. XX Nous nous contenterons de mettre ses idées dans un ordre un peu plus régulier et plus systématique. La plus haute question, et une des premières, qui s'impose à la raison du philosophe, c'est de rechercher pourquoi il y a des animaux. Nous voyons bien que c'est l'union de deux sexes qui généralement produit l'animal ; mais comment a-t-il pu se faire jamais qu'il y eût des femelles et des mules ? A celte question deux seules réponses sont possibles : ou il faut supposer que le premier moteur, entendez le créateur, n'a fait qu'obéir à une nécessité invincible, en formant les êtres d'une certaine façon ; ou bien, il faut penser que, si celte création n'était pas nécessaire, il valait mieux cependant qu'elle eût lieu, pour réaliser une pensée supérieure. Entre les choses, les unes sont éternelles et divines; les autres sont purement contingentes, et elles peuvent également être ou n'être point. Même pour celles-là, tout inférieures qu'elles sont, le bien et le divin produisent toujours, conformément à leur nature, ce qu'il y a de mieux; car ces choses peuvent, quoique périssables, être plus XXI ou moins bien durant leur existence passagère. Comme l'âme vaut mieux que le corps, comme l'être animé vaut mieux, à cause de son âme, que l'être inanimé, comme être vaut mieux que ne pas être, et que vivre vaut mieux que ne pas vivre, voilà l'unique cause qui a créé des animaux. La perpétuité a été refusée aux individus; car, autrement, ils seraient éternels. Mais si l'éternité ne peut leur appartenir, elle est, en une certaine mesure, accordée à l'espèce dont ils font partie. Les hommes, les animaux, les plantes se perpétuent sans cesse, et cette éternité relative leur est assurée par la génération. L'individu meurt; l'espèce ne meurt pas. La nature attache une telle importance à cette fonction essentielle qu'elle pousse, par une violence irrésistible, tous les êtres animés à l'accomplir. L'accouplement des sexes provoque en eux les désirs les plus ardents, et un plaisir non moins vif quand ils s'y livrent. Les femelles des animaux sont surtout terribles à leur première portée ; les mâles le sont toujours vers l'époque de l'accouplement. Les chevaux, les taureaux, les sangliers, les béliers, les boucs et tant d'autres animaux do- XXII mestiques sont agités alors de fureurs implacables; ils se battent entre eux, avec tant de rage que souvent les deux rivaux succombent à la fois sous des coups acharnés. Les bêtes sauvages subissent les mêmes influences; les ours, les loups, les lions, ne sont jamais plus redoutables. Le paisible chameau devient intraitable, et il ne souffre plus l'approche de l'homme. L'éléphant, dans l'Inde, cesse d'être doux et sociable; il devient extrêmement dangereux. Les animaux qui vivent avec l'homme sont moins sujets à ces transports, parce qu'ils peuvent s'accoupler plus fréquemment et presque en toute saison. Cependant, les juments, les vaches, les truies sont atteintes d'une vraie folie quand elles sont en rut. Le printemps est la saison où presque tous les animaux ressentent ces émotions naturelles et inévitables. Mais il y a des exceptions à cette règle, et la gestation, suite de l'accouplement, est calculée par la Nature, de manière que les petits naissent dans la saison qui leur est le plus favorable. Selon les espèces, tantôt un seul accouplement suffit, tantôt il en faut plusieurs. L'homme n'a de temps marqué précisément, XXIII ni pour l'union des sexes, ni pour la durée de la gestation, ni pour le moment de la naissance; mais l'homme est un être à part, qui exige une étude pour lui seul. Un autre sentiment que la Nature a inculqué aux animaux et qui est presque aussi vif que l'instinct de la génération, c'est la tendresse des parents pour leurs petits. La femelle soigne et nourrit les jeunes, avec une sollicitude destinée à compléter l'œuvre de la parturition, en assurant la vie au fœtus qui a vu le jour. Il semble que la Nature a voulu que ce sentiment s'accrût dans les animaux à mesure que leur organisme est plus parfait. Les animaux inférieurs ne font d'ordinaire que produire simplement des petits, sans les nourrir ; ceux qui parmi eux sont un peu plus intelligents les élèvent et les nourrissent quelque temps. Mais les animaux supérieurs, qui sont doués de plus de raison, contractent avec leurs petits des liens d'affection et d'habitude qui finissent par former une famille plus ou moins durable, comme on le voit chez quelques espèces de quadrupèdes et d'insectes, et éminemment chez le genre humain. XXIV Sous le rapport de la génération, on peut diviser les animaux en trois classes principales : les vivipares, les ovipares, et, en dernier lieu, ceux qui naissent spontanément de matières en putréfaction, ou plutôt de la chaleur que la putridité développe toujours. Dans chacune de ces classes, on peut remarquer des variétés. Ainsi, parmi les vivipares, les uns produisent des petits tout vivants, comme l'homme, le cheval, le phoque, le dauphin ; mais il y a des vivipares qui produisent d'abord des œufs dans leur intérieur, et dont les petits sont vivants quand ils sortent du sein de la mère; tels sont les sélaciens, parmi les animaux marins. Mêmes nuances dans les ovipares. Les uns produisent des œufs complets, c'est-à-dire, contenant deux parties : Tune qui est le germe du futur animal ; l'autre, qui doit servir à le nourrir, jusqu'à ce qu'il brise sa coquille. Chez d'autres ovipares, comme les poissons, les œufs pondus sont incomplets ; il faut que le mâle les féconde par une action qui lui est particulière, et sans laquelle les œufs demeurent stériles. D'autres ovipares encore produisent des larves, d'où sort le XXV jeune animal complètement fait, sans que rien ait concouru à le nourrir et à le développer. Cette dernière nuance d'ovipares ne comprend que des animaux qui n'ont pas de sang. Quant aux animaux qui naissent spontanément, comme on le voit pour une foule d'insectes, ils offrent également des nuances. Si les uns viennent de la terre putréfiée ou de plantes pourries, d'autres se produisent dans le corps même des animaux, et ils y proviennent d'excrétions restées dans les organes. Tous les êtres inférieurs méritent moins d'attention, et ils sont moins bien connus, quoique, parmi les poissons, animaux d'un ordre plus relevé, il y en ait aussi quelques-uns qui naissent spontanément du sable et du limon. On peut donc, d'une manière générale, dire que les animaux viennent d'accouplement, de l'union des deux sexes. Là où il y a des sexes, ce sont des organes différents qui les constituent et qui les distinguent. Pour les mâles, ces organes sont les testicules; pour les femelles, ce sont les matrices. Les testicules, avec les autres parties de l'appareil générateur, peuvent être à l'intérieur ou au dehors ; XXVI au contraire, les matrices sont toujours intérieures, sans aucune exception, afin que le fœtus soit mieux protégé. Parmi les animaux qui ont du sang, il en est chez lesquels il n'y a pas de testicules proprement dits, mais seulement deux conduits, qui sont placés au-dessous du diaphragme, le long du rachis, et qui se réunissent en un seul, un peu au-dessus du point de sortie des excréments. La disposition est à peu près la même chez certains ovipares qui ont des testicules dans le bassin. Dans les vivipares qui ont des pieds, l'organisation des testicules est plus compliquée ; ils sont formés de circonvolutions nombreuses, destinées à amortir la violence des désirs sensuels, et à rendre l'élaboration de la semence plus parfaite. Ils tiennent à plusieurs autres organes du bassin, par des veines et des canaux, qui vont de ces organes aux testicules, et des testicules à ces organes. L'anatomie nous apprend tous ces détails, et les naturalistes qui ne se livrent pas directement à des travaux de dissection, peuvent s'instruire par les dessins joints aux descriptions anatomiques. Quant aux matrices, elles n'offrent pas moins XXVII de diversités. Chez les ovipares, elles sont tout autres que chez les vivipares. Dans ces derniers, bipèdes ou quadrupèdes, la matrice est placée au-dessous du diaphragme. Le plus souvent, à l'extrémité qu'on appelle ses petites cornes, elle a un conduit qui s'enroule en spirale. Chez les ovipares, elle est située différemment pour les oiseaux et pour les poissons. Les oiseaux l'ont près du diaphragme ; les poissons l'ont bien au-dessous, et elle est membraneuse et large. Celle des oiseaux a une tige charnue et ferme; mais la partie qui touche au diaphragme est revêtue d'une membrane si mince que les œufs semblent être libres et dehors. Chez les sélaciens, qui produisent d'abord un œuf à l'intérieur, avant de produire leurs petits vivants, la matrice est divisée en deux parties, qui répondent sans doute à cette double opération. Parmi les reptiles, la vipère produit d'abord un œuf en elle-même, et ensuite elle est vivipare ; son organisation est à peu près celle des sélaciens. Les autres serpents ont une matrice allongée, comme leur corps; les œufs y sont rangés d'une manière régulière; et, quand la bête XXVIII pond, au lieu de sortir un à un, ils sortent tous ensemble et d'un seul coup. Enfin, il y a des animaux, notamment les ruminants à cornes, qui ont dans la matrice des cotylédons, ou tubercules charnus, auxquels tient l'embryon. D'autres animaux n'ont pas ces cotylédons ; mais ils ont des parties qui en tiennent lieu (des placentas). Après ces généralités sur la reproduction sexuelle des animaux, il faut suivre Aristote dans l'étude de chacune des classes qu'il a fixées le premier, et qui sont encore, en grande partie, celles qu'adopte notre science contemporaine. Il indique avec soin l'ordre dans lequel il compte les décrire successivement ; et nous n'avons rien à changer dans cette classification, qui est très acceptable, quoiqu'elle soit incomplète. Il étudiera donc d'abord les testacés; il continuera par les crustacés, les mollusques, les insectes, les poissons, les oiseaux, les quadrupèdes, et il finira par l'homme, en montrant les moyens diversifiés que la Nature emploie pour que les animaux se reproduisent tels qu'ils sont, dans les êtres qui leur succèdent. « Pour cette nouvelle exposi- XXIX tion, dit Aristote, nous resterons fidèle à notre méthode habituelle, et nous adopterons la même marche. Nous y mettrons cependant une différence : antérieurement, nous partions de l'homme pour connaître et décrire l'organisme des autres animaux ; maintenant, au contraire, nous ne parlerons de l'homme qu'en dernier lieu, parce qu'il demande infiniment plus de détails. » Quant à nous, commençons notre analyse comme l'auteur le veut si judicieusement; et en étant aussi brefs que nous le pourrons, ac-compagnons-le dans son embryologie comparée. Sans doute, il ne sait pas tout ce que nous savons à cette heure; mais, nous aussi, nous procédons absolument comme il a procédé. Nous descendons à des degrés beaucoup plus bas de l'échelle, restés invisibles pour ses regards; mais ce n'en est pas moins la même carrière que nous parcourons sur ses pas. Les testacés n'ont pas de sexes ; on n'y distingue pas les mâles et les femelles, pas plus qu'on ne les distingue, soit dans les êtres exsangues et immobiles comme eux, soit dans les plantes, avec lesquelles on pourrait comparer XXX les testacés, sous bien des rapports; ou ils naissent spontanément, ou ils s'engendrent eux-mêmes (hermaphrodites), ainsi qu'elles. Quelquefois, on peut voir chez eux un être qui produit; mais on n'en voit pas qui couvre et qui féconde. Le seul testacé dont on ait pu constater l'accouplement est le colimaçon. Dans tout le reste du genre, qui est fort nombreux, on n'a jamais observé rien de pareil. Les pourpres, les buccins, les moules, les huîtres, les conques, les peignes, les solénes ou manches de couteau, les thétyes, les glands, les écuelles, les nérites, les étoiles, les poumons de mer (pulmonés), naissent de la vase et du sable, sous l'action de la chaleur vitale, qui remplit le monde, et qui agit dans l'air et dans l'eau, avec une fécondité incessante. La plupart des testacés sont aquatiques et marins, et c'est un obstacle de plus à les bien observer; il en est très peu qui vivent sur terre. Dans presque tous ceux qui font ce qu'on appelle de la cire, c'est une liqueur muqueuse qu'ils émettent, à certaine époque de l'année, et qui pourrait bien être de nature spermatique. Les testacés bourgeonnent souvent XXXI comme les plantes; il suffit qu'un seul individu ait été formé pour que d'au très, se greffant sur lui, s'y amoncellent en masses de plus en plus considérables. Lorsque le limon qui s'attache aux flancs des navires vient à se dessécher, il naît de ce limon des coquillages de toute espèce. Quand les eaux se retirent, en laissant le sol à sec, on voit apparaître des moules là où jusqu'alors on n'en avait pas vu ; c'est de la vase qu'elles sortent. A Rhodes, les matelots d'un navire amarré dans le port avaient jeté à l'eau quelques tessons d'argile ; assez peu de temps après, on trouva des huîtres attachées sur ces poteries, où le limon les avait déposées. Des habitants de Chios ont même essayé de propager les huîtres ; mais ils n'y ont pas réussi. Ils en avaient apporté de Lesbos, et ils avaient eu le soin de les mettre dans des anfractuosités de rochers, et dans des conditions tout à fait pareilles à celles où ils les avaient prises. Ces huîtres, ainsi transportées, grossirent et engraissèrent; mais elles ne se multiplièrent pas. Tous ces faits démontrent que les testacés ne se reproduisent pas par accouplement. XXXII On a pu croire que les testacés ont des œufs ; mais on s'est trompé; ces œufs prétendus ne sont que de la graisse, signe de la santé de l'animal. C'est au printemps et à l'automne que ces excroissances sont les plus apparentes, quoiqu'elles subsistent en toutes saisons. Durant les journées chaudes et dans les pleines lunes, les œufs sont plus abondants; on les prendrait pour une sorte de gestation, quoique aucun fait ne confirme cette conjecture. C'est à ce moment que les testacés comestibles ont le goût le plus délicat, et qu'on les prise le plus. Les crustacés sont exsangues comme les testacés; mais ils ont des sexes, et l'on peut citer, dans cette classe d'animaux, les crabes, les langoustes, les homards, les écrevisses, les squilles, etc., etc., qui présentent de nombreuses espèces. Comme leur accouplement dure longtemps, on peut l'observer sans trop de peine ; et, si quelques naturalistes ont pu en douter, c'est qu'ils n'ont pas su y mettre une attention suffisante. Tous les animaux de ce genre s'accouplent à la façon des quadrupèdes qui urinent par derrière. L'un présente le des- XXXIII sous de la queue ; l'autre met la sienne dessus ; et les queues s'unissent en sens contraire. Il n'y a pas d'intromission. Quand, après l'accouplement, les langoustes sont pleines, elles conçoivent leurs œufs, et elles les gardent à peu près trois mois, qui sont les mois les plus chauds de l'année. Après ce temps, elles font une ponte préliminaire, en amenant leurs œufs sous le ventre, dans des poches où ils se développent. A chacun des opercules de la queue, qui sont attachés sur le côté, il y a un cartilage auquel les œufs adhèrent; et la masse totale produit l'effet d'une grappe. Au premier coup d'œil, on ne voit qu'une masse confuse; mais chacun des cartilages est divisé lui-même en plusieurs portions, qu'on distingue nettement en les séparant. Les œufs ne sont pas plus gros qu'un grain de figue ; et si quelques-uns sont un peu plus forts, ce sont ceux du milieu. Comme les parties latérales de la queue ne pourraient les couvrir tous, la langouste ramène l'extrémité de sa queue pour les placer sous un vrai couvercle. Aussi, cette queue est-elle beaucoup plus longue chez la femelle que chez le mâle. Après avoir mûri ses œufs dans XXXIV cet organe pendant une vingtaine de jours, elle les jette en niasse ; et quinze jours après, il en sort de petites langoustes, qui sont grosses tout au plus comme le doigt. C'est surtout dans les endroits inégaux et pierreux qu'on les trouve; les homards préfèrent des lieux bien unis, et ils évitent la vase, comme la langouste l'évite aussi. Les pécheurs le savent bien. Dans les crustacés, les canaux spermatiques des maies sont très minces; et les matrices des femelles sont membraneuses et placées près de l'intestin. Elles sont divisées en deux parts; et c'est là que tout d'abord les œufs se forment et se logent. Il n'y a d'ailleurs qu'un seul canal pour l'émission de la semence et pour la sortie des excréments, dans le mule et dans la femelle. Pour les mollusques, tels que les polypes, les seiches, les calmars, etc., il y a encore moins de doute que pour les crustacés; ils ont certainement des sexes séparés. Ils s'accouplent tous de la même manière, en se joignant bouche à bouche, et en entrelaçant régulièrement tentacules à tentacules. Ainsi, le polype appuie contre terre la partie de son XXXV corps qu'on prend pour sa tête, et il étend ses bras; l'autre polype se déploie symétriquement sur l'envergure des bras du premier ; et de cette façon, les parties concaves de leurs corps correspondent les unes aux autres. Quelques naturalistes prétendent que le mâle a une espèce de verge logée dans un de ses bras. Cette verge, qui est assez forte, est attachée vers le milieu du membre ; et le mâle l'introduit dans la trompe de la femelle, ou, du moins, dans l'organe qu'on appelle de ce nom. On voit souvent des seiches et des calmars arrangeant leurs bouches et leurs bras à l'opposé les uns des autres, et nageant réciproquement en sens inverse, de telle sorte que l'un nage en arrière, tandis que l'autre nage dans le sens de la bouche. Les femelles produisent leurs œufs par l'organe qu'on nomme leur évent, et qui, selon quelques personnes, leur sert aussi à être fécondées par le mâle. Un autre mode d'accouplement des mollusques est surtout connu par les récits de quelques pêcheurs; mais on conteste leur explication, et l'on nie que ce soit par les tentacules, comme ils le prétendent, que ces animaux XXXVI s'accouplent. Ils se touchent bien ainsi; mais ce peut être pour une fonction tout autre que celle de la génération. Ce qui est de toute nécessité, c'est que le maie puisse s'approcher de l'organe de la matrice pour que la femelle soit fécondée; et ce n'est pas un tentacule qui peut remplir cet office. Ce qui a pu donner naissance à ces dissentiments sur l'accouplement des mollusques, c'est leur singulière conformation. Chez eux, la bouche et l'orifice ex-crémentitiel se confondent, et il n'y a qu'une issue pour l'entrée et pour la sortie des aliments. D'une manière générale, on peut dans toutes les espèces d'animaux assimiler l'être, quel qu'il soit, à un tube ouvert par les deux extrémités; ce tube est tout droit; mais, chez les mollusques, on dirait que la Nature l'a recourbé de manière qu'un des bouts touche l'autre. Dès lors, on conçoit que la verge ait dû être placée ailleurs que là où elle l'est chez les animaux qui sont constitués tout autrement. Quoi qu'il en soit, le polype répand sur sa femelle une liqueur visqueuse qui féconde l'œuf qu'elle porte. D'abord, cet œuf semble unique, et il est de couleur blanche; mais XXXVII bientôt, il devient granuleux, comme celui des crustacés. La femelle le dépose dans les trous qui lui servent de retraite, dans des tessons, si elle en trouve, et dans les endroits creux. Le paquet de ces œufs ressemble alors à des touffes de vigne vierge, ou à l'efflorescence du peuplier blanc. Après une cinquantaine de jours environ, il sort de chacun de ces grains de petits polypes, qui ressemblent à des araignées ; ils sont très faibles, et beaucoup d'entre eux meurent presque sur-le-champ. Quant à la seiche, ses œufs sont noirs et gros, comme des baies de myrte. Ils sont reliés et collés les uns aux autres par une matière qui les unit en une masse ; c'est l'effet de la viscosité gluante que le mâle a jetée dessus. L'œuf est composé de deux parties ; celle qui est blanche nourrit la petite seiche, comme le jaune nourrit le poussin des oiseaux. Au bout de quinze jours, les œufs ont la grosseur d'un grain de raisin. La petite seiche doit briser l'enveloppe pour en sortir. C'est presque toujours au printemps que les mollusques frayent, comme la plupart des autres poissons. La seiche est la première à frayer, et elle fraye XXXVIII non seulement au printemps, mais en toute saison ; elle y met une quinzaine de jours, à peu près. Les polypes doivent s'accoupler en hiver, pour produire au printemps. La seiche et le polype couvent leurs œufs à l'endroit même où ils les ont déposés; ou bien, ils se mettent à l'entrée du trou dans lequel ils les cachent, et ils étendent un de leurs bras devant l'ouverture, pour la fermer. On voit fréquemment la seiche, le corps à demi sorti de l'eau, posée sur ses œufs. Gomme elle recherche à ce moment les algues, les roseaux, les brins de paille, et autres débris de la laisse de mer, les pêcheurs ont le soin de placer en lieu convenable, des baguettes sur lesquelles la seiche pelotonne et enroule son frai. On a moins de renseignements sur les calmars, parce qu'ils pondent en haute mer ; leur frai ressemble à celui de la seiche, et forme aussi une masse continue. La femelle a dans son intérieur deux corps rouges en forme de mamelons ; ces organes se rapportent sans doute à la génération, puisque le maie ne les a pas. La génération des insectes est beaucoup mieux connue, parce que beaucoup d'insectes XXXIX vivent sous nos yeux et qu'il est facile de les observer, quoique nous en ignorions toujours bien des choses. Voici leur mode d'accouplement le plus commun. Le mâle, qui est plus petit, monte sur la femelle, qui est plus grosse que lui, et ils se joignent par derrière. Contrairement à ce qui se passe dans les autres animaux, la femelle, qui est dessous, introduit son canal dans le mâle, qui est dessus. Cet organe de la femelle paraît plus grand qu'il ne devrait l'être proportionnellement à son corps. On peut voir ceci très nettement en séparant des mouches accouplées ; on ne les détache qu'avec un petit effort, et elles se tiennent si étroitement unies parce que leur accouplement doit durer longtemps. Les araignées s'accouplent de cette même façon, après que le mâle et la femelle ont tiré, à tour de rôle et en sens opposé, sur un des fils qui forment le tissu de la toile. En général, les insectes naissent au printemps, comme presque tous les animaux ; ils peuvent naître aussi en hiver, lorsque, pendant un temps plus long qu'à l'ordinaire, il fait de beaux jours et que le vent est au sud. Cepen- XL dant, c'est une exception, et on ne la remarque que chez ceux des insectes qui ne se cachent pas, comme le font les mouches et les fourmis, durant la saison froide. Les insectes pondent presque aussitôt après l'accouplement. De la ponte, vers ou larves, il sort des êtres congénères à ceux qui les ont produits. Mais il est des insectes qui naissent spontanément, dans des matières putrides, et encore dans d'autres conditions, par exemple, soit à la suite d'une pluie ou d'une rosée, soit dans les eaux, dans les bois verts ou secs, et même dans les lainages de nos vêtements. Quant aux larves pondues par les insectes, il se passe en elles un travail dont il est difficile de se rendre compte ; et à un moment donné, il en sort tout à coup un animal entièrement formé, dont on n'a pu voir la croissance successive, comme on le voit pour les vers et pour la plupart des animaux. Il est des larves qui, avant de produire l'être complet, subissent plusieurs métamorphoses, ainsi qu'on peut l'observer sur les papillons. On a étudié la génération de beaucoup d'insectes, et on la comprend assez bien ; par XLI exemple, les frelons, les guêpes, les araignées, les sauterelles, les cigales, les poux, et bon nombre d'animalcules. Mais, bien qu'on se soit occupé plus particulièrement encore des abeilles, on ne sait rien de précis sur la manière dont elles se reproduisent. Leur travail de miel et de cire, la construction géométrique de leurs alvéoles, leurs mœurs et l'organisation de leur vie en commun, tout cela a quelque chose de divin, que nul insecte n'offre au même degré. Mais, en dépit de tant de motifs de sérieux examen, on ignore complètement comment les abeilles s'engendrent. On voit bien la reine des abeilles pondre des larves en abondance ; mais on ne sait pas comment elle est fécondée. On suppose que ce doit être par les bourdons ; mais rien ne le prouve. Du reste, les systèmes n'ont pas manqué pour expliquer ce fait toujours mystérieux; mais aucune de ces théories fort ingénieuses ne s'appuie sur des faits constants ; on ne saurait les admettre. Ce qui est certain, c'est qu'on n'a jamais vu l'accouplement des abeilles, ni entre elles, ni avec les rois, ni avec les bourdons. On peut réfuter victorieusement toutes les XLII explications proposées; mais on ne saurait en fournir une meilleure. Il faut donc se résigner au doute, quoique, selon toute apparence, ce soient les bourdons qui doivent être les mâles, bien que dépourvus du dard qu'ont les abeilles. En résumé, de même que les abeilles sont des insectes à part et uniques en leur genre, de même leur génération paraît n'être pas moins singulière, ni moins remarquable. Des insectes nous passons à la classe des poissons. On peut affirmer que toute cette classe sans exception est ovipare, attendu que ceux même des poissons, en petit nombre, qui sont vivipares, font d'abord un œuf en eux-mêmes, d'où sort ensuite leur petit tout vivant, comme on le voit chez les cétacés et les sélaciens. Les poissons vivipares ont du lait et des mamelles, ainsi que les quadrupèdes. Le dauphin, par exemple, qui est vivipare, a des mamelons, qui, sans être aussi apparents que chez d'autres animaux, sont des espèces d'orifices, un de chaque côté sur les flancs. De ces orifices suinte le lait, tété par les petits, qui suivent la mère. Le fait a été attesté par quelques XLIII personnes qui l'ont parfaitement vu. Sauf cette exception, qui ne s'étend pas très loin, la plupart des poissons naissent d'œufs pondus extérieurement par les femelles. On distingue donc des sexes parmi les poissons. Mais il en est quelques-uns, comme l'anguille, où l'on n'a pu découvrir de sexes distincts, du moins jusqu'à présent. L'anguille n'est ni mâle ni femelle; elle ne produit, ni n'engendre, absolument rien d'elle-même. L'anatomie n'a jamais fait découvrir en elle, ni canaux spermatiques, ni matrice. On prétend bien que l'on a trouvé dans certaines anguilles des appendices en forme de filaments et de vers, qu'on prend pour des organes génitaux; mais on n'a pas pu préciser dans quelle partie du corps ces appendices se manifestent; et la science ne peut recevoir pour vraie une assertion aussi vague. Jamais personne n'a vu des œufs d'anguille. Quant à la distinction du mâle et de la femelle, qu'on veut établir, parce que le mâle aurait, dit-on, la tête forte et plus longue, et que la femelle l'aurait plus petite et plus aplatie, ce n'est pas là du tout une différence de sexe; c'est une simple différence d'espèce. XLIV II y a aussi des poissons qui naissent spontanément, comme certains insectes, dans la vase et le sable. Ce qu'il y a de singulier, c'est que les poissons nés de cette manière sont de mêmes espèces que ceux qui viennent d'œufs et d'accouplements. Ainsi, l'on rapporte que, dans des marais qui avoisinent Cnide, et où le limon avait été complètement desséché par la chaleur de la canicule, on a vu de petits poissons se montrer dès que l'eau revenait dans les bas fonds. On ajoute que ces poissons étaient du genre des muges, chez lesquels certaines espèces ne se reproduisent pas par accouplement. D'autres poissons naissent de même spontanément dans l'écume de mer qu'on appelle l'aphye ; c'est une sorte de pourriture provenant des rivages sablonneux. L'aphye se forme en toute saison, mais plus abondamment dans les beaux jours, lorsque la terre s'échauffe; elle s'amasse alors dans les endroits ombragés et marécageux. On en trouve beaucoup sur les côtes de Salami ne, dans le voisinage d'Athènes et de Marathon. Quand le temps est calme, elle est ballottée à la surface de la mer; et l'on XLV y voit flotter de petites larves, comme celles qu'on découvre dans le fumier. Elle est surtout abondante quand la chaleur est humide. L'aphye de Phalère et du Pirée donne nais-sauce à de petits poissons excellents, qui se rapprochent des sardines. Les pêcheurs savent tirer parti de cette aphye, qu'ils salent, pour la conserver plus longtemps, et la transporter commodément. Les poissons n'ont pas de testicules, ni en dehors, ni en dedans. C'est sans doute à cause de la conformation allongée de leur corps; on verra que les serpents sont dans le même cas, ainsi que les animaux à branchies. Mais pour remplir la fonction des testicules, il y a deux conduits suspendus des deux côtés du rachis ; ils se réunissent en un seul pour l'émission. Dans la saison de l'accouplement, ces canaux se remplissent de liqueur séminale ; et ils en sont tellement gonflés que la plus légère pression en fait sortir de la semence de couleur blanche, qui ressemble à du lait. C'est ce qu'on appelle la laite des poissons. L'organisation de ces conduits spermatiques diffère selon les espèces; et c'est l'anatomie, qui, pour chacune, XLVI nous apprend ce qu'ils sont. Peut-être, on expliquerait cette absence de testicules chez les poissons, en disant que, pour eux, l'accouplement doit être très rapide, et que la semence n'a pas besoin de cette longue élaboration qu'elle présente chez les quadrupèdes. Les conduits sont simples et tout droits; ils n'ont pas ces circonvolutions multipliées et ces redoublements qu'ont les testicules humains. Ces vaisseaux se distinguent aisément dans les maies, de la matrice des femelles, à l'époque de l'accouplement ; passé cette époque, les vaisseaux ne sont plus aussi distincts, si ce n'est pour les gens qui ont l'habitude de les observer. Il y a même des poissons chez qui les conduits spermatiques s'effacent entièrement, ainsi qu'il arrive aussi chez les oiseaux, en dehors du temps de l'accouplement. Comme, en général, les sexes sont nettement séparés chez les poissons, la fécondation y est aussi de toute évidence. La femelle pond ses œufs, qu'elle abandonne; le mâle, qui la suit, vient verser sa laite sur les œufs. Il n'y a de féconds que ceux qui en ont été arrosés. Les autres sont perdus, et ils deviennent ce que XLVII veut le hasard. Mais la Nature a prévu cette chance défavorable; les œufs que produit la femelle sont en nombre prodigieux, et la perte se trouve compensée. Ces œufs sont ordinairement très petits et pareils à des graines de la plus mince dimension ; s'ils étaient plus gros, la matrice ne pourrait les contenir, et la gestation deviendrait impossible. Le poisson qu'on nomme l'aiguille a des œufs qui sont très gros, relativement aux autres ; il en a peu ; et cependant, il crève souvent par la distension excessive qu'ils lui causent. La fécondation des poissons a donné lieu à bien des erreurs. C'est ainsi que l'on croit que les femelles sont fécondées en avalant la semence des mâles ; bien des gens soutiennent avoir vu le fait. Cependant, il est faux. Ce qui a pu causer cette illusion, c'est qu'à l'époque de l'accouplement, les femelles, dans plusieurs espèces de poissons, viennent, avec leur bouche, frapper le mâle sous le ventre ; et alors, les mâles émettent leur semence plus vite et en plus grande quantité. Au contraire, après la ponte, ce sont les mâles qui poursuivent les femelles, et ils dévorent en partie les œufs XLVIII qu'elles produisent. En observant les choses un peu mieux, et en y réfléchissant davantage, on aurait pu aisément s'apercevoir de l'erreur où l'on tombait. D'abord, c'est à la même époque de l'année que les mules ont leur laite et que les femelles ont leurs œufs. Plus la femelle est près de pondre, plus aussi la laite s'accumule dans le mâle et se liquéfie ; et de même que l'accumulation de plus en plus grande de la laite dans le mâle coïncide avec l'ovulation dans la femelle, de même l'émission a lieu également à la même époque. Les femelles ne pondent pas d'un seul coup, mais petit à petit; et les mâles ne répandent pas davantage leur-laite en une seule fois. Les deux fonctions sont donc faites pour se correspondre. En second lieu, on aurait bien dû se dire que, si ces femelles avalaient la semence, elles la digéreraient. L'estomac est fait pour digérer les aliments qu'il reçoit. Et, comment supposer que la liqueur séminale puisse le traverser pour aller jusqu'à la matrice, sans être altérée et sans perdre sa faculté génératrice ? Mais ces erreurs sur les poissons ne doivent pas plus nous étonner que tant d'autres erreurs XLIX populaires sur la fécondation de certains oiseaux, et même de certains quadrupèdes. C'est toujours par défaut d'observation, et par des généralisations irréfléchies, qu'on commet ces méprises. Des naturalistes s'y sont laissé prendre, tout aussi bien que des historiens. Presque tous les poissons ne produisent qu'une seule fois l'an ; néanmoins, il en est quelques-uns qui frayent deux fois, et même jusqu'à trois fois, comme le surmulet, qui fraye dans la vase. Parmi les sélaciens, la raie est la seule à pondre deux fois. L'époque la plus ordinaire pour le frai est le printemps, jusqu'au solstice d'été. Les espèces qui frayent deux fois pondent au printemps et à l'automne. Il en est qui frayent en toutes saisons, comme la murène, dont les œufs sont très abondants et se développent très vite. Quelques poissons ne frayent qu'en certains lieux à l'exclusion de tous les autres. Ainsi, les thons frayent dans le Pont-Euxin et ne frayent pas ailleurs. D'autres poissons préfèrent l'embouchure des fleuves, et d'autres encore frayent en haute mer. Une chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que, si, pour les plantes et même pour L les animaux, les contrées diverses amènent de la différence, non seulement pour la santé générale des individus, mais aussi pour le nombre de leurs accouplements et pour leur fécondation, de même les lieux ont une grande influence sur les poissons, non seulement pour leur grosseur et leur engraissement, mais aussi pour leurs portées et leurs accouplements, de telle sorte que les mêmes animaux produisent davantage dans tel lieu et produisent moins dans tel autre. La durée de la gestation chez les poissons varie tout autant. Les uns portent trente jours, d'autres portent encore moins. Tous les poissons souffrent de la gestation ; et c'est surtout à ce moment qu'ils sortent hors de l'eau ; on les voit se précipiter furieusement vers la terre; et durant tout ce temps, ils sont dans une agitation continuelle; ils ne se calment que quand ils ont jeté leur frai. On a bien souvent essayé de faire des rapprochements entre l'œuf des oiseaux et l'œuf des poissons ; mais entre ces œufs, il n'y a guère que des dissemblances . L'œuf des oiseaux est de deux couleurs : le blanc, qui constitue le poussin, et le jaune, LI qui le nourrit. L'œuf des poissons est d'une seule couleur, et l'on n'y distingue pas deux parties. Il n'a pas de coquille, tandis que l'œuf des oiseaux en a une, qui est assez dure. D'autres analogies encore plus lointaines ont été indiquées; et c'est ainsi qu'on a pu dire que l'écaillé, chez les poissons, remplissait la fonction des plumes chez les oiseaux. Enfin, on n'a jamais vu chez les poissons des espèces différentes s'accoupler et produire des hybrides ; ce qu'on observe souvent entre plusieurs espèces de quadrupèdes et même d'oiseaux, où les croisements réussissent, bien que leur effet ne se prolonge pas dans des générations successives. Tous les oiseaux, sans aucune exception, ont des sexes séparés; il n'est pas une de leurs espèces qui ne vienne d'accouplement. Tous aussi sont ovipares. Le mode de l'accouplement est unique : le mâle monte toujours sur la femelle. La seule différence, d'ailleurs bien légère, c'est que tantôt la femelle s'accroupit, et c'est le cas le plus ordinaire, et que tantôt elle reste debout, comme chez les grues, où le mâle grimpe sur la femelle, qui demeure toute LII droite. Il y a des oiseaux, comme les pigeons et les tourterelles, qui se baisent bec à bec avant l'accouplement. Chez tous les oiseaux, la copulation est extrêmement rapide. Le plus habituellement, la fécondation se fait en une fois. Les oiseaux ont des testicules, qui sont placés à l'intérieur près des lombes, disposition qui se retrouve chez les quadrupèdes ovipares, tels que la tortue, le lézard, le crocodile, et même chez quelques vivipares, tels que le hérisson. De l'un et de l'autre testicule, sortent des conduits qui, pour l'émission, se réunissent en un seul, comme dans les animaux qui n'ont pas de testicules. Ceux des oiseaux et des quadrupèdes ovipares sont, tantôt de couleur plus blanche, tantôt de couleur plus jaunâtre. La liqueur séminale se montre dans ces conduits, qu'elle remplit au temps de l'accouplement; mais la saison une fois passée, les canaux deviennent presque imperceptibles; au contraire, quand l'animal s'accouple, ils sont énormes. On en peut dire autant de la verge, qu'on distingue à peine dans les petits oiseaux, mais qui se voit bien mieux chez de plus grands, l'oie, par exemple, et les animaux de cette LIII grosseur, quand l'accouplement va se faire.
La matrice des oiseaux a, comme on l'a
déjà dit, une tige ferme et charnue. Elle est revêtue d'une membrane
très mince, qui renferme les œufs. Sur les petits oiseaux, cette
membrane n'est presque pas apparente ; elle l'est davantage sur les
gros oiseaux ; et l'on n'a qu'à l'insuffler, par la tige de la
matrice, pour qu'elle s'élève et se gonfle. La particularité essentielle qui distingue les oiseaux, c'est leur œuf, qui se forme à l'intérieur, et qui sort ensuite, recouvert d'une coquille contenant le poussin. Tout d'abord, l'œuf se montre très petit et de couleur blanche ; puis, il devient rouge et couleur de sang ; en grossissant, il passe au jaunâtre et au roux. A LIV mesure qu'il se développe de plus en plus, il se divise à l'intérieur en deux parties, séparées par une membrane ; le jaune se place au centre, et le blanc l'entoure. Quand enfin l'œuf est complet, il se détache, et il sort. De mou qu'il était, il devient assez dur; mais au moment même de la sortie, la coquille n'a pas encore toute sa consistance, de peur que l'animal ne soit blessé ; elle l'acquiert presque sur-le-champ ; et elle a dès lors toute la fermeté qu'on lui connaît, afin de protéger le poussin contre tous les accidents extérieurs. Quelquefois, la coquille reste molle; mais c'est une preuve que la bête était malade. Dans les œufs des oiseaux aquatiques, la proportion du jaune est beaucoup plus forte. La couleur extérieure des œufs varie selon les espèces. Beaucoup d'œufs sont blancs, comme ceux des poules ; tantôt, ils sont jaunes comme ceux des oiseaux de marais ; tantôt ils sont mouchetés de points, comme ceux des pintades et des faisans. Les œufs de la cres-serelle sont d'un rouge de vermillon. L'œuf est toujours plus pointu par un de ses bouts, plus gros et plus arrondi par l'autre. On pré- LV tend que les œufs longs et pointus donnent des mâles, et que ceux qui sont arrondis et qui ont un cercle vers la pointe, donnent des femelles; mais c'est un fait à vérifier. L'époque et le nombre des pontes ne varient pas moins que la couleur des œufs. Les oiseaux sauvages ne s'accouplent et ne pondent qu'une seule fois par an. L'hirondelle et le merle pondent deux fois. Le merle est peut-être de tous les oiseaux celui qui pond le plus tôt; mais bien souvent, sa première couvée périt par le froid de l'hiver ; et il n'amène à bien que la seconde. Les oiseaux domestiques et ceux qui peuvent devenir domestiques, font plusieurs pontes, parce que, vivant avec l'homme et ayant une nourriture abondante, ils peuvent s'accoupler aussi en toute saison. Témoins les pigeons, qui élèvent des petits pendant toute l'année, quand ils sont dans un lieu chaud et qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin. Les poules, si on les soigne bien, pondent pendant dix mois à peu près sur douze, ne cessant de produire que pendant les mois qui précèdent, ou qui suivent, le solstice d'hiver. Mais le plus généralement, les oiseaux LVi s'accouplent et font leurs couvées aux environs du printemps et au début de l'été. Il faut en excepter l'halcyon, qui pond vers le solstice d'hiver, donnant son nom aux beaux jours qu'on a quelquefois à cette époque de l'année. On a cherché à savoir combien de temps l'œuf mettait à se former après l'accouplement; et l'on a trouvé que cet intervalle varie avec la grosseur des parents. L'œuf de poule met approximativement dix jours à se former et à être parfaitement fait ; il faut un peu moins de temps pour l'œuf de pigeon. Une singularité dans cette dernière espèce, c'est que la femelle, au moment même du travail, peut retenir son œuf, si quelque chose vient à la troubler; et alors elle bouleverse son nid. Le nombre des œufs est très variable suivant les espèces. Certains oiseaux ne font qu'un seul œuf; d'autres en font une masse. Les oiseaux de proie sont très peu féconds, parce qu'ils ont trop de peine à se nourrir et à nourrir leurs petits. L'aigle ne fait jamais que trois œufs; et selon la remarque de Musée, elle n'en fait éclore que deux. Dès qu'un des deux aiglons est assez grand, elle le chasse, LVII parce qu'elle aurait trop de peine à l'élever, et aussi, dit-on, parce qu'elle en est jalouse. Le milan a deux ou trois œufs ; rarement, il en a quatre. Le vautour en a un ou deux; la grue en a deux aussi. Le verdier en pond quatre ou cinq; l'halcyon de même. Une espèce de mésange, appelée la mérope, en a six, qu'elle dépose à l'automne dans les lieux les plus escarpés, et dans des trous profonds. Les œufs de la pie sont au nombre de neuf; ceux de la perdrix, au nombre de dix et jusqu'à seize. La mésange ordinaire passe pour être l'oiseau qui a le plus d'œufs; elle en a jusqu'à dix-sept, quelquefois même plus de vingt ; et chose bizarre, ses œufs sont toujours en nombre impair. Parmi les oiseaux domestiques, le pigeon ne fait d'ordinaire que deux œufs ; mais il pond très fréquemment. Si par hasard il a trois œufs, il n'élève pourtant que deux petits ; souvent même il n'en élève qu'un seul, détruisant le troisième œuf, qui presque toujours est clair. Il y a des poules de belle race qui accumulent leurs œufs jusqu'au nombre de soixante, avant de les couver. D'autres poules pondent jusqu'à deux fois par jour; mais cet LVIII excès de fécondité les épuise, et elles peuvent en mourir. Les petites poules dites d'Adria pondent tous les jours, sans se fatiguer. En général, les oiseaux pondent dans des nids. Mais ceux dont le vol est pesant ne font pas de nids, par exemple, les perdrix et les cailles, qui pondent sur la terre, recouvrant leurs œufs avec des branchages. Il en est qui cachent les leurs dans des trous. Les grives font leurs nids avec de la boue, comme les hirondelles, mais sur le haut des arbres ; elles les placent à la suite les uns des autres, dans un ordre assez régulier. La huppe se donne moins de peine; elle se fourre dans les vieux troncs d'arbre, où elle dépose ses œufs sans y rien apporter. L'épervier et le vautour nichent dans des lieux inaccessibles, au sommet des roches les plus abruptes. L'aigle, dont le nid est énorme, fait de même ; il garde son aire fort longtemps, sans y rien changer; une fois qu'il l'a construite de bois mort, il la défend avec fureur, si on l'attaque. Le nid le plus curieux et le mieux fait est celui de l'hirondelle; elle le construit de paille et de boue, en y entrelaçant des brindilles de bois. Si la boue lui LIX manque, elle se baigne dans l'eau et va rouler ses ailes dans la poussière. Elle édifie ce nid absolument d'après les règles que nous suivrions nous-mêmes, mettant d'abord en dessous les matériaux les plus durs. Elle proportionne parfaitement la grandeur de son logement à la sienne. Le mâle et la femelle prennent le même soin des petits; la mère distribue à chacun d'eux leur pâture, distinguant, comme si elle en avait l'habitude, celui qui en a reçu le premier, afin de ne pas lui en donner deux fois. Dans les premiers temps, elle prend le soin de rejeter leur fiente hors du nid, qu'elle tient très propre; et quand ils sont plus grands, elle leur apprend à se tourner dehors pour se satisfaire. Il y a, tout au contraire des oiseaux qui ne font pas de nid, et qui ne s'occupent point de leur progéniture. Le coucou va le plus souvent pondre dans les nids d'autres oiseaux, et il y abandonne ses œufs, sans la moindre sollicitude pour ce qui doit en sortir. Une fois les œufs pondus et abrités dans le nid, les oiseaux les couvent, pour les amener à maturité et à éclosion. L'incubation dure LX plus ou moins longtemps, selon les espèces, qui y sont plus ou moins aptes, et selon la grosseur de l'animal. Elle est destinée à maintenir sur les œufs une chaleur constante; et c'est si bien la chaleur qui est nécessaire qu'on peut même se passer de l'oiseau pour l'obtenir. Ainsi, en Egypte, on met les œufs dans le fumier, et ils y éclosent très bien sous les ardeurs du soleil. On a placé aussi des œufs dans des vases qu'on chauffait ; ils y étaient couvés, et les petits en sortaient spontanément. Quand c'est la femelle qui couve, les poussins sortent dans les temps chauds plus vite que dans les temps froids; ainsi, les poussins de la poule éclosent en dix-huit jours dans l'été; et il faut quelquefois vingt-cinq jours en hiver. L'aigle couve trente jours, comme le font aussi les gros oiseaux, l'oie et l'outarde. En général, les oiseaux n'ont aucune attention pour les petits quand ils sont élevés. On excepte pourtant la corneille, qui reste encore quelque temps avec eux pour les nourrir, même quand ils volent déjà tout seuls, et qui vole à côté d'eux. Les femelles des corneilles restent seules à couver sans interruption, et c'est le mâle LXI qui leur apporte soigneusement à manger. Dans d'autres espèces, celles des pigeons et beaucoup d'autres, les mâles couvent alternativement et relayent la femelle, pendant tout le temps qu'elle met à se procurer sa nourriture. L'incubation alors ne cesse pas un seul instant; et c'est ainsi qu'elle arrive sûrement à terme, comme le veut la Nature. Les œufs des oiseaux sont sujets à des accidents de diverses sortes. Bien que provenant d'un accouplement régulier, il se peut qu'ils ne produisent rien et qu'ils restent clairs. D'autres fois, ils ont deux jaunes, et il en sort deux jumeaux. En ce cas, les deux jaunes sont séparés par une couche de blanc, qui s'interpose. Souvent aussi, cette couche intermédiaire vient à manquer, et les deux jaunes se mêlent et se confondent. On a vu des poules ne pondre que des œufs doubles ; on en a même observé une qui avait pondu jusqu'à dix-huit œufs, tous doubles et féconds. Seulement, des doubles jaunes, l'un était plus grand, et l'autre plus petit. L'accident le plus fréquent est celui des œufs clairs pondus par la femelle, sans accouplement, c'est-à-dire, d'œufs qui ne produisent LXII pas de poussins, bien qu'en apparence ils soient aussi bien conformés que les autres. Ils sont plus nombreux et plus petits que les œufs féconds. Quelques naturalistes ont prétendu que les œufs clairs sont des restes et des débris d'œufs, venus d'un accouplement antérieur, et avortés dans le sein de la bête. Ce n'est pas exact, puisqu'on trouve de ces œufs clairs dans de jeunes femelles qui n'ont pas été cochées. Ceci prouve bien que la femelle a des œufs sans l'intervention du mille, et que c'est le maie seul qui peut les féconder et leur donner la vie. Quand on met des œufs clairs à couver sous l'oiseau, il ne se passe dans ces œufs aucun changement sous l'action de la chaleur ; le blanc et le jaune restent identiquement ce qu'ils étaient. Au contraire, dans les œufs féconds, d'où le poussin doit sortir, il se produit, presque dès le premier jour après l'accouplement, des modifications, qui ne font que s'accroître à mesure que l'incubation s'avance dans sa durée régulière. Les phénomènes qui s'accomplissent alors dans l'œuf sont excessivement curieux, et font très bien comprendre comment se for- LXIII ment les fœtus, depuis la conception jusqu'à la naissance. Cette étude importante sera abordée un peu plus loin, quand nous aurons à traiter de la génération de l'homme. A la suite des oiseaux, il faut dire quelques mots des reptiles ; et comme, parmi eux, il y a des quadrupèdes, ce sera une transition facile pour arriver à la génération des animaux de cette dernière classe. Les serpents n'ont pas de testicules, non plus que les poissons ; mais à la place de cet organe, qui leur manque, ils ont aussi deux conduits suspendus au-dessous du diaphragme, des deux côtés du rachis. Ces conduits s'emplissent de liqueur séminale, à l'époque de l'accouplement. Ils se réunissent en un seul, un peu au-dessus du point de sortie des excréments, ainsi que chez les poissons. La matrice des reptiles diffère beaucoup de celle des autres animaux, et elle diffère, même dans la classe des serpents, d'une espèce à une autre. Elle est allongée suivant la conformation du corps de l'animal, et elle s'étend jusqu'au diaphragme. Les œufs y sont rangés en ordre très régulier; on dirait les joyaux d'un collier de femme. Ils sont pondus tous à LXIV la fois. La vipère pond ainsi plus de vingt petits en un seul jour ; mais la vipère est d'abord ovipare en elle-même, et sa matrice se rapproche de celle des sélaciens ; ses petits restent trois jours dans la membrane qui les enveloppe, et ils doivent la rompre pour paraître au jour tout vivants. L'œuf intérieur de la vipère est mou, et il n'est que d'une seule couleur. Souvent, les petites vipères se dévorent entre elles. Les serpents ont un accouplement étrange, qui n'est qu'à eux. Le mâle ne pouvant monter sur la femelle, ils s'entrelacent l'un à l'autre ventre contre ventre; et ils se serrent si fort, dans cet enroulement, qu'ils semblent ne former qu'un seul serpent à deux têtes. L'accouplement se fait de la même manière chez les lézards. Mais il est très rapide pour tous ces animaux. En Libye, il y a des serpents d'une grosseur monstrueuse; ils nagent aussi bien qu'ils rampent ; et à en croire les récits des navigateurs, ils seraient de force à faire chavirer une barque, quand ils la poursuivent sur les eaux. Quelques espèces de quadrupèdes sont ovipares ; mais presque tous sont vivipares. Les LXV quadrupèdes ovipares ont des testicules intérieurs, au-dessous du diaphragme dans le bassin, disposés à peu près comme ceux des oiseaux et des poissons. Leurs matrices aussi sont semblables à celles de ces derniers animaux. Ils s'accouplent comme les quadrupèdes vivipares, le mâle montant sur la femelle ; mais les saisons de l'accouplement sont variables. Pour les uns, c'est au printemps; pour les autres, c'est en été; pour quelques-uns même, c'est à l'automne; mais toujours, à l'époque la plus favorable pour les petits qui doivent en naître. La tortue de terre pond des œufs à tégument dur et de deux couleurs, comme ceux de l'oiseau. Une fois qu'elle les a pondus, elle les enfouit en terre dans un trou qu'elle creuse, et elle égalise le sol par dessus. Gela fait, elle les couve, et les œufs n'éclosent que l'année suivante. La tortue d'eau douce sort de l'eau pour pondre ; elle fait également un trou rond, en terre, où elle dépose ses œufs; elle les y laisse une trentaine de jours. Alors, elle les déterre, et elle en fait sortir les petits, qu'elle mène immédiatement à l'eau. La tortue de mer vient de même à terre pondre des œufs LXVI qui ressemblent beaucoup à ceux des oiseaux domestiques ; elle les enterre, et les couve pendant les nuits. Elle en fait un nombre considérable, qui se monte parfois jusqu'à cent. Le crocodile en pond un peu moins, une soixantaine environ. Il les couve deux mois à peu près. Ces œufs sont blancs, et très petits, comparativement à l'animal énorme qui en sortira. L'œuf n'est pas plus gros que celui d'une oie; et l'on a vu des crocodiles avoir dix-sept coudées de long. Quant aux quadrupèdes vivipares, ils ont tous des organes sexuels fort apparents, testicules, verge et matrices. Tantôt, les testicules sont suspendus et détachés, comme chez l'homme et bien d'autres animaux; tantôt, ils sont contigus à la partie postérieure du ventre et n'en sont pas détachés ; c'est la conformation des porcs. De même pour la verge, elle est, ou suspendue sous le ventre et adhérente, ou elle est libre. Cette diversité d'attache vient de ce que tels animaux urinent en avant, et tels autres urinent en arrière. Les matrices ne diffèrent pas moins, bien que leur position générale soit toujours en bas du diaphragme. On LXVII y distingue deux parties : la matrice proprement dite, et l'utérus, où le fœtus doit être nourri. Tous les animaux à cornes ont, pour leur matrice, une organisation pareille à celle de la femme. Dans les animaux à cornes qui n'ont pas les deux rangées de dents, et qui en manquent à la mâchoire supérieure, la matrice a des cotylédons, ou protubérances charnues, auxquels se rend le cordon ombilical destiné à nourrir le fœtus, et auxquels il s'attache. Les cotylédons ont une partie convexe qui touche la matrice, et une partie concave, qui touche l'embryon. Ils deviennent de plus en plus petits à mesure que le fœtus prend de la croissance, et ils disparaissent complètement quand il est tout à fait formé. Les animaux à double rangée de dents aux deux mâchoires n'ont pas de cotylédons dans la matrice. Du reste, tous ces détails doivent être étudiés sur les dessins anatomiques joints aux descriptions. Les mamelles sont un organe spécial des quadrupèdes. Ils sont, avec l'homme, les seuls à en posséder. Les mamelles varient de position et de nombre, selon les espèces. Aussi, LXVIII l'homme a deux mamelles placées sur le devant de la poitrine. Nul autre animal n'a cette conformation. L'éléphant, qui n'a aussi que deux mamelles, les a au-dessous de la poitrine, et presque sous les aisselles; elles sont très petites, proportionnellement au volume de son corps, et on les voit à peine quand on les regarde de côté. Les mâles en ont comme les femelles, bien qu'elles leur soient inutiles. La brebis n'en a que deux, comme l'éléphant ; et elles sont placées entre les cuisses. L'ourse a quatre mamelles, ainsi que la vache. La chienne, la truie, ont des mamelles inégales et en grand nombre, non plus sur la poitrine ni près des cuisses, mais sous le ventre. La panthère et la lionne les ont sous le ventre également; mais la panthère en a quatre, et la lionne en a deux. La chamelle non plus n'a que deux mamelles; mais elle a quatre mamelons ou tétins, ainsi que la vache. Dans les solipèdes, les maies n'ont pas trace de mamelles ; cependant, quelques chevaux font parfois exception. Les mamelles élaborent et contiennent le lait, qui doit alimenter le jeune aussitôt après sa naissance. Voilà pourquoi les vivipares sont les LXIX seuls à en avoir, soit qu'ils vivent sur terre, soit qu'ils vivent dans l'eau, comme les cétacés. La gestation et la parturition varient beaucoup chez les quadrupèdes ; la gestation dure plus ou moins longtemps, et les petits sont en plus ou moins grand nombre. Ces différences se remarquent pour les animaux sauvages, aussi bien que pour les animaux domestiques. Les truies portent quatre mois; elles font jusqu'à vingt petits ; mais ce nombre est trop fort, et elles ne peuvent les nourrir tous. La vieillesse n'ôte rien à cette fécondité ; seulement, la bête fait plus de difficulté pour se laisser couvrir. Bien qu'elles conçoivent par un seul accouplement, on doit pourtant les faire monter plus d'une fois, parce qu'après l'accouplement elles rejettent un liquide, qu'on appelle la caprée, et que ce liquide peut entraîner la liqueur séminale. Lorsque la truie a mis bas, elle donne la première mamelle au petit qui est venu le premier, et ainsi de suite. Quand elle est en chaleur, on ne lui donne pas le mâle immédiatement; on attend qu'elle ait les oreilles pendantes. Si les oreilles ne pen- LXX dent point, c'est que la bête doit être en chaleur de nouveau. Il faut avoir soin de la bien nourrir quand elle a mis bas. Le porc, mâle et femelle, peut s'accoupler à huit mois et même plus tôt; mais il vaut mieux attendre que la première année soit révolue, parce qu'autrement les produits sont plus faibles. La femelle portant quatre mois, elle peut mettre bas à un an. La brebis n'est fécondée qu'après trois ou quatre accouplements. Elle avorte très facilement ; il suffit d'une pluie ou d'un coup de tonnerre pour que l'avortement ait lieu. La portée ordinaire est de deux petits ; rarement il y en a trois, et encore plus rarement, quatre. La gestation est de cinq mois; et dans les climats chauds, où la nourriture est abondante, les brebis peuvent avoir deux portées par an. Elles vivent jusqu'à dix ans, et, dans l'Ethiopie, jusqu'à douze ou treize. Dans cette espèce, l'animal couvre et est couvert tant qu'il vit. A en croire les bergers, la nature des eaux qui servent de boisson aux brebis et qui sont plus ou moins froides, déterminerait le sexe des petits ; il y a des béliers qui ne font que des LXXI mâles; d'autres qui ne font que des femelles. Le vent, selon qu'il est du nord ou du sud, n'aurait pas moins d'action que les eaux, à ce qu'on prétend. Les petits sont blancs ou noirs, suivant que les veines que le bélier a sous la langue, sont blanches ou noires. Quand on fait boire de l'eau salée aux brebis, elles sont en état d'être fécondées plus tôt. Si les vieilles brebis se montrent les plus ardentes à l'accouplement, dans la saison régulière, les bergers y trouvent le signe d'une bonne année pour le croît; si ce sont les jeunes, ils augurent que l'année sera mauvaise. Tout ce que l'on vient de dire pour les brebis s'applique presque aussi bien aux chèvres, qui avortent aussi facilement, qui portent le même temps à peu près, qui vivent autant, et qui produisent toute leur vie. Cependant, le caractère des chèvres est aussi pétulant que celui des brebis est tranquille. Les chiens peuvent couvrir, et les femelles peuvent être couvertes, à huit mois, époque à laquelle les mâles lèvent déjà la patte pour uriner. La chienne est fécondée par un seul accouplement. La gestation est de deux mois LXXII environ, à quelques jours près; la femelle, après qu'elle a mis bas, reste six mois sans recevoir le maie. Il y a des chiennes qui portent trois mois entiers. Les flux menstruels durent une semaine, et pendant tout ce temps les parties génitales sont gonflées. Les femelles n'acceptent l'accouplement que dans les sept jours suivants. Leur accès de chaleur dure quatorze ou seize jours. Elles ont du lait quatre, cinq ou six jours, avant de mettre bas ; ce lait est d'abord épais, bien qu'il le soit moins que celui des porcs el des lièvres, et il s'éclaircit ensuite peu à peu. Lorsque la puberté des femelles se forme et se complète, leurs mamelles prennent, comme dan l'espèce humaine, un certain gonflement et une certaine élasticité; mais celte modification étant très légère, il faut l'observer avec soin pour la découvrir. La portée est ordinairement de cinq ou six petits ; elle va quelquefois jusqu'à douze. Les chiennes de Laconie en ont habituellement huit. Les petits chiens ont en naissant les yeux fermés, comme les petits chats.
Le taureau est, dans la monte, d'une
violence inouïe ; sous son assaut, la femelle fléchit de
LXXIII tout son corps. Si
le premier assaut ne réussit pas, la vache reste vingt jours sans
s'offrir à un second accouplement. A un an, les mâles peuvent
couvrir, et les femelles être couvertes ; on a même vu des saillies
plus précoces ; mais il est préférable d'attendre dix-huit mois et
même deux ans; les produits n'en sont que plus beaux. La vache porte
dix mois; si le petit vient par hasard quelques jours plus tôt, il
ne vit pas, parce que les cornes de ses pieds sont trop molles et
trop peu formées. La portée est d'un seul petit; il est très rare
qu'il y en ait deux. La fécondité du maie et de la femelle dure
toute leur vie, qui est de quinze à vingt ans. Le temps de
l'accouplement est un peu avant le solstice d'été, et un peu après.
Il n'a pas lieu dans le reste de l'année. Après l'homme, c'est le cheval, mâle et femelle, qui passe pour le plus lascif des animaux; et chose assez remarquable, ce sont les chevaux les plus vieux qui sont les plus féconds, Ceci n'est pas moins vrai des femelles. Les chevaux montent indifféremment leurs mères et leurs filles ; et le haras est regardé comme plus complet, quand ils saillissent leurs propres produits. Les hybrides issus du croisement d'un cheval et d'une ânesse, ou d'un âne et d'une jument, sont stériles ; généralement, ils ne peuvent pas se reproduire. Dans les autres espèces, ce sont des individus qui sont atteints de cette infirmité; mais pour les mulets, c'est l'espèce tout entière quien.est frappée. Cependant, on cite quelques cas de fécondité, soit du mulet, soit surtout de la mule. Démocrite LXXVI et Empédocle ont essayé d'expliquer la stérilité du mulet; mais leurs théories sont inacceptables, et Ton ne saurait après eux risquer des hypothèses, qui ne seraient pas mieux fondées que les leurs. Il y a dans la Syrie des animaux qu'on appelle des mulets, et qui se reproduisent très bien entre eux. C'est un satrape qui les avait fait venir de Perse; mais, quoique ces animaux ressemblent à des mulets, c'est une espèce différente, et ce sont plutôt des ânes. Quant à l'âne proprement dit et a l'ânesse, ils peuvent s'accoupler à trente mois, après la chute des premières dents. On cite toutefois une ânesse qui a été pleine à un an et dont le petit a pu vivre; mais c'était un cas fort extraordinaire. L'ânesse rejette la semence aussitôt qu'elle a été saillie ; aussi prend-on des précautions pour l'en empêcher. Immédiatement après l'accouplement, on la force de courir, en la fustigeant à coups redoublés. L'ânesse porte douze mois, autant que la jument. Elle a du lait dès le dixième mois de la gestation. Le plus souvent, elle n'a qu'un ânon ; quelquefois elle en fait deux. Après qu'elle a mis bas, LXXVII elle peut être couverte de nouveau dès le septième jour; et Ton croit avoir remarqué que c'est ce jour-là qu'elle conçoit le plus sûrement, quoiqu'elle conçoive aussi plus tard. Si elle n'a pas eu de poulain avant de perdre les quatrièmes dents, qu'on appelle les marques, il n'y a plus de chance qu'elle devienne pleine, ni qu'elle porte durant le reste de sa vie. Quand elle est sur le point de mettre bas, elle aime à se cacher ; et l'on a soin de l'isoler dans l'obscurité, pour qu'elle s'y délivre loin des regards. Elle peut produire durant sa vie entière, qui est de trente ans et plus; le mâle vit à peu près aussi longtemps. Il y a plus d'avortements dans les croisements de cheval et d'âne que dans les accouplements réguliers d'individus de même espèce. Quand l'âne et le cheval se croisent, le temps de la gestation se règle sur le mâle; et elle dure tout ce qu'elle aurait duré si le jeune venait de parents congénères. Pour la grandeur, l'aspect et la force, le produit ressemble davantage à la mère. Les gens qui s'occupent de faire ces croisements affirment que la jument ne reçoit l'âne que s'il a tété une jument ; on fait donc téter les juments LXXVlIl par des ânons qu'on appelle nourrissons de juments; et ces ânes-là, au pâturage, couvrent les juments et les forcent à les recevoir, tout comme le font les étalons. La chamelle porte dix mois, ou, selon d'autres, douze mois ; elle n'a jamais qu'un seul petit; elle le nourrit pendant un an. Elle met bas au printemps, et elle a du lait jusqu'à une nouvelle gestation. Son lait est d'un goût excellent et passe pour le plus léger de tous. Le chameau est un des rares animaux qui urinent par derrière ; mais sa verge, qui est très nerveuse, n'en est pas moins en avant, comme celle des autres quadrupèdes. On en fait des cordes pour les arcs. Dans l'accouplement, la femelle fléchit les jambes; le mule monte sur elle et la couvre. Ils restent accouplés un jour entier, dit-on ; mais ils se retirent dans un lieu désert, où ils ne se laissent approcher que par leur gardien. En Arabie, l'accouplement a lieu à trois ans pour le nulle et la femelle. Après que la femelle a mis bas, elle reste un an sans recevoir le maie de nouveau. Il y a peu de quadrupèdes dont le rut soit aussi violent que celui du chameau, si doux à toute autre époque. LXXIX L'éléphant peut couvrir, et la femelle être couverte, à vingt ans pour la première fois. La verge ressemble à celle du cheval ; mais elle est plus petite ; et elle ne semble pas en proportion avec la masse du corps. Les testicules de l'éléphant ne paraissent pas au dehors ; ils sont renfermés à l'intérieur, près des reins ; et c'est peut-être pour cela que son accouplement est si rapide. La femelle a le vagin placé sur le ventre, de même que la brebis y a ses mamelles; et quand elle désire l'accouplement, elle relève cet organe en haut et le tourne vers le dehors, afin que l'accouplement soit plus facile pour le mâle qui monte sur elle. On ne sait pas au juste quelle est la durée de la gestation ; les uns la font de dix-huit mois ; d'autres la prolongent jusqu'à trois ans. Ce qui cause ce désaccord, c'est qu'il est très difficile de voir l'accouplement. Il a toujours lieu dans des endroits écartés, sur le bord des rivières, et dans des localités qui sont familières aux deux bêtes. Quand la femelle est pleine, le mâle ne la touche plus. Pour mettre bas, la femelle s'accroupit sur ses jambes de derrière; et il est évident qu'elle souffre alors LXXX très vivement; elle n'a jamais qu'un petit. Dès que le petit est né, il tette avec sa bouche, et non point avec sa trompe, comme on le suppose quelquefois. La verge du cerf est dans le genre de celle du chameau, et tout aussi nerveuse. L'assaut du maie au moment du rut effraie les biches, qui essayent de s'y soustraire, et qui ne peuvent le supporter que quelques instants. Les biches en chaleur s'évitent les unes les autres. Le maie aime à changer; il ne reste pas avec une seule femelle; et, à très peu d'intervalle, il couvre de nouvelles compagnes. L'accouplement a lieu vers l'équinoxe d'automne, ou dans les deux mois suivants. La biche porte huit mois ; ordinairement, elle n'a qu'un seul faon ; il est très rare qu'elle en produise deux. Elle dépose ses petits non loin des sentiers tracés dans les bois, parce qu'elle craint les bêtes fauves. Elle sait choisir ces asiles de façon qu'elle puisse y fuir et s'y réfugier, pour dépister les chasseurs; c'est le plus souvent un roc à pic, qui n'est abordable que d'un seul côté. Les biches ont quatre tettes, ainsi que les vaches. Dès qu'elles sont pleines, les mâles LXXXI s'en vont à part et restent entre eux. L'ardeur qui les pousse à s'accoupler fait que chacun d'eux, lorsqu'il est solitaire, creuse des trous dans le sol, et leurs fronts sont souillés de terre. La cause de ces transports, c'est que cet animal est très lascif. Au moment de la saillie, leur chair devient mauvaise ; elle a une odeur repoussante, dans le genre de celle des boucs. Dans l'été, temps où ils ne saillissent pas, ils deviennent très gras, et tellement lourds que des chasseurs à pied peuvent les prendre, s'ils les poursuivent avec un peu de persévérance. Le renard couvre sa femelle à la façon de tous les quadrupèdes; mais ses petits, qui sont aveugles en naissant, sont encore plus difformes que ceux de l'ourse; la mère les lèche pour les réchauffer, et pour les former petit à petit. Quand elle est près de mettre bas, elle change si fréquemment de place qu'il est très difficile d'en prendre une qui soit pleine. Elle a tout au plus quatre petits. La louve porte et produit dans les mêmes conditions que la chienne, pour le temps de sa gestation et pour le nombre de ses petits, qui ne voient pas clair LXXXII non plus en naissant. Le maie et la femelle n'ont qu'une saison pour s'accoupler, et la parturition a lieu au début de l'été. On débite sur la génération du loup bien des contes, qui se rapportent au voyage de Latone à Délos, et qu'il faut laisser à la mythologie populaire. Il est faux que toutes les louves mettent bas chaque année, et que la gestation ne soit que de douze jours, de même qu'il est faux que la louve ne porte qu'une seule fois dans sa vie. II faut noter, en passant, l'espèce des rats, dont la fécondité est vraiment prodigieuse, entre tous les quadrupèdes. Une femelle pleine avait été laissée par hasard dans un tonneau de millet. Peu de temps après, quand on rouvrit le tonneau, il s'y trouvait cent vingt rats. On se ferait difficilement une idée de la reproduction des rats qui parcourent les champs et qui les ravagent. Ils y détruisent des récoltes entières, souvent en une seule nuit. S'ils arrivent si soudainement et en si grand nombre, leur disparition ne se comprend pas mieux. En quelques jours, il n'en reste plus un seul, tandis que peu de jours auparavant on ne savait com- LXXXlll ment s'en défaire, en enfumant leurs trous, en les bouleversant, en lâchant des porcs qui fouillent leurs nids. Les renards et les belettes en détruisent aussi beaucoup; mais rien ne peut triompher de leur fécondité, et de la rapidité avec laquelle ils se reproduisent. Parmi les animaux féroces, l'ours a une façon de s'accoupler toute particulière. Le mâle ne monte pas sur la femelle, qui le reçoit en restant couchée à terre ; mais le ventre du mâle n'en est pas moins sur le dos de la femelle. La gestation est assez courte. Les petits sont au nombre de cinq au plus ; parfois, il n'y en a qu'un ou deux. L'ourson naît très petit en comparaison du corps de sa mère ; il est plus petit qu'une belette et gros comme un rat ; il ne voit pas clair; ses membres sont à peine formés. L'accouplement des ours a lieu dans le mois d'Elaphébolion, c'est-à-dire, vers l'équinoxe du printemps ; la femelle met bas à l'époque où les animaux se cachent et s'enfouissent pour hiberner. Les petits élevés par la mère ne se montrent guère qu'au début de l'été. Il est très difficile de prendre une ourse qui soit pleine. LXXXIV Le lion urine par derrière; mais il s'accouple comme les autres quadrupèdes, en montant sur sa femelle. C'est au printemps, et chaque année, que la lionne met bas. Le plus souvent elle n'a que deux lionceaux; parfois, elle n'en a qu'un seul; parfois aussi, elle en a jusqu'à six. Les petits naissent si faibles que c'est à peine si, à deux mois, ils peuvent marcher. On prétend qu'en Syrie les lionnes ne portent que cinq fois. La première portée est de cinq, et les autres portées diminuent d'un successivement; de telle sorte que les lionnes finissent par devenir stériles. De là vient sans doute qu'on croit vulgairement que la lionne perd sa matrice. C'est un conte puéril, quoique fréquemment répété. Les lions sont fort rares en Europe, où il n'y en a que dans les contrées arrosées par l'Achélous et le Nessus, et cette rareté empêche des observations bien exactes. On commet également sur le sexe des hyènes une erreur non moins forte. On prétend qu'elles ont les organes des deux sexes à la fois; mais c'est observer très mal. Ce qu'on prend pour une vulve de femelle n'est qu'une tache placée sous la queue, et sans aucune ouverture. Au- LXXXV dessous de cet organe prétendu, il y a l'issue pour les excréments, et plus bas encore les parties génitales, fort bien conformées dans le mâle et dans la femelle. Ce qui prouve qu'on se trompe, c'est que la femelle a tout aussi bien que le mille cette tache, qui do loin peut faire illusion. D'ailleurs, il est presque impossible de prendre une hyène femelle; et, sur onze hyènes qu'un chasseur avait tuées, il n'y avait qu'une seule femelle. La verge du mâle ressemble à celle du loup et du chien. Il y a quelques animaux qui changent de forme et de naturel, non pas seulement par l'effet de l'âge et des saisons, mais aussi parce qu'on les coupe. On ne peut couper que ceux qui ont des testicules. Pour les oiseaux qui ont les leurs en dedans, on les châtre en les touchant fortement à la partie qui est sous la queue, ou en brûlant, avec un fer chaud, la partie du croupion par laquelle les botes se joignent. L'oiseau, dès lors, ne chante plus; il ne cherche plus à cocher ; s'il a une crête, elle devient toute pâle ; et si l'animal est jeune, il peut croître sans qu'aucune de ces facultés reparaisse. Dans les quadrupèdes châtrés, la LXXXVI voix se modifie et se rapproche de la voix de la femelle. Coupés en bas âge, les animaux engraissent plus que ceux qu'on ne coupe pas. S'ils sont complètement constitués, ils ne grossissent plus après celte opération, qui est toujours douloureuse, et quelquefois mortelle, si ce n'est sur les porcs. Quand on coupe des cerfs qui, à cause de leur âge, n'ont pas de bois, il ne peut plus leur en pousser. S'ils en ont déjà, la dimension des bois reste la même sans croissance, et la bête ne les perd plus. On coupe les veaux à un an ; autrement, ils sont moins beaux et plus petits. Voici comment on procède. On met le jeune taureau sur le dos; on lui ouvre les bourses par le bas, et l'on froisse fortement le testicule ; on en relève les racines le plus possible, et l'on met dans la plaie une poignée de poils, pour que la suppuration se fasse extérieurement. Si la plaie s'enflamme, on cautérise la bourse ; et on la saupoudre de terre. On châtre aussi les femelles des porcs et des chameaux. On fait jeûner la truie pendant deux jours avant de l'opérer; on la suspend par les pieds de derrière, pour lui ouvrir le ventre; et l'on coupe la caprée, qui correspond LXXXVII aux testicules du mâle; on recoud ensuite la plaie ; la truie ne sent plus le besoin de l'accouplement, et elle engraisse très vite. Quant aux chamelles, on châtre celles qu'on veut employer à la guerre, afin qu'elles ne puissent pas devenir pleines. Tous les changements que la castration amène dans les animaux, ne sont pas moins manifestes chez les hommes qu'on inutile de cette affreuse manière. Leur caractère, leur voix et la forme de leur corps sont modifiés profondément. Après avoir étudié la génération chez tous les animaux, nous arrivons enfin à celle de l'homme; elle mérite une étude toute spéciale. Bien que l'homme, au début de sa vie, soit un animal, il a des facultés qui lui sont propres, et que les autres animaux ne reproduisent qu'à un degré très inférieur. Avec sa station droite, qui n'appartient pleinement qu'à lui, et qui correspond à la direction même de l'univers ; avec le privilège de penser et de réfléchir; avec la constitution si harmonieuse de son corps, depuis ses pieds et ses mains jusqu'à sa poitrine et à sa tête; avec l'heureux LXXXVIII équilibre de ses facultés, l'homme est le seul être qui participe du divin, ou, pour mieux dire, il participe du divin plus que tous les autres ; car il est le plus intelligent de tous. Dans l'homme, les signes de la puberté sont de toute évidence. Il commence à avoir de la liqueur séminale vers l'Age de deux fois sept ans. C'est à ce moment aussi que fleurit le poil de la jeunesse, de même que les plantes fleurissent avant de porter leur graine, comme l'a dit Alcméon de Crotone. Vers cette époque, la voix commence également à muer; elle devient plus rauque et plus inégale; elle cesse d'être aiguë, et elle n'est pas encore vraiment grave. Elle n'est pas non plus uniforme, et l'on dirait qu'elle est alors ce que sont des cordes d'instruments détendues et durcies ; c'est ce qu'on appelle chevroter. Cette altération est plus marquée chez les jeunes gens qui essayent des plaisirs de l'amour. Ceux qui s'y livrent par anticipation prennent la voix d'hommes faits. C'est le contraire pour ceux qui savent s'abstenir; et si l'on facilite leur résistance, par certains soins que prennent quelques musiciens fort occupés de leur art, la voix reste LXXXIX assez tard telle qu'elle est, et le changement est à peu près nul. D'ailleurs, ce n'est pas la voix seule qui change; les mamelles se gonflent, ainsi que les parties génitales, qui non seulement se développent, mais qui ont une autre forme. Voilà pour les garçons. Chez les filles, c'est vers le même temps que les mamelles se gonflent encore davantage, et que les menstrues font éruption. Le sang qui sort à ce moment, ressemble à celui d'un animal qui vient d'être tué. Parfois, des menstrues de couleur blanche se produisent chez des filles encore tout enfants. Ces pertes les maigrissent beaucoup et les empêchent de grandir. Pour la plupart des filles, les menstrues se montrent quand déjà les mamelles se sont élevées de plusieurs doigts. À cette même époque, la voix prend un peu plus de gravité, quoique, en général, elle soit plus aiguë chez la femme que chez l'homme. C'est surtout à ce moment qu'il convient de veiller sur les jeunes filles avec sollicitude ; car c'est au moment où elles se forment que les désirs sexuels sont les plus vifs. Si l'on ne prend pas bien soin d'empêcher qu'il XC ne se passe alors rien d'autre que le développement régulier du corps, le reste de l'existence s'en ressent. C'est là l'origine de Tin-continence chez les femmes et chez les hommes, qui ont cédé trop tôt à l'attrait de l'amour et du plaisir. Les organes de la génération sont chez le mâle les testicules et la verge ; c'est la matrice et ses diverses parties chez la femme. Les testicules et la verge sont détachés dans l'espèce humaine plus que dans toute autre espèce. Ces organes sont placés sur la partie antérieure du corps et à la partie inférieure de l'abdomen; la matrice est située de même. Ce n'est pas tout d'abord que la faculté d'engendrer coïncide avec la sécrétion de la semence; la faculté génératrice est plus tardive. Pour l'hom me comme pour le reste des animaux, la première semence des jeunes sujets est stérile; quand, par hasard, ils engendrent, leurs rejetons sont plus faibles et plus petits. Les hommes ne sont définitivement féconds qu'à l'âge de trois fois sept ans. C'est à cet âge aussi qu'il convient que les filles se marient. Plus jeunes, elles conçoivent plus aisément; mais leurs XCI couches sont plus laborieuses ; au contraire, à trois fois sept ans, elles ont toute la force nécessaire pour avoir des enfants vigoureux. A ce même âge, les hommes ont encore à gagner, et ils doivent retarder le mariage de quelques années. L'homme peut engendrer jusqu'à soixante-cinq ans, soixante et dix, au plus tard ; la femme peut concevoir jusqu'à quarante-cinq ou cinquante. Hors de ces limites extrêmes, les cas de fécondité sont très rares. C'est en se réglant sur ces données naturelles que les législateurs doivent fixer les âges où peut commencer l'union conjugale. La liqueur séminale a été l'objet de bien des observations et de bien des théories. Dans son état sain, elle est épaisse et de couleur blanche, au moment où elle sort ; une fois émise, elle devient claire et change de couleur. Les grands froids ne la font pas geler ; ils la rendent fluide, comme de l'eau; la chaleur la coagule et l'épaissit. Quand la semence a toutes ses qualités prolifiques, elle est plus lourde que l'eau et va au fond ; celle qui ne les a pas se mêle au liquide. L'homme est de tous les XCII animaux celui qui, proportionnellement à son corps, a le plus de sperme, de même que les menstrues de la femme sont aussi les plus abondantes.
On s'est demandé si la liqueur
séminale vient de toutes les parties du corps ; et plusieurs
naturalistes ont soutenu l'affirmative, en s'appuyant surtout sur la
ressemblance très fréquente des enfants à leurs parents. Ces
ressemblances sans doute sont réelles, et parfois même elles
reproduisent des accidents qui, chez les pères, n'avaient rien de
congénial, par exemple, la marque d'une cicatrice, ou telle autre
incision, qu'on se serait faite volontairement. Mais les
ressemblances sont très loin d'être constantes ; et elles devraient
l'être toujours, si la théorie était vraie. Ce qui est plus exact,
c'est qu'en effet rémission de la liqueur séminale, même en très
petite quantité, est toujours accompagnée d'un affaiblissement et
d'une sorte de relâchement dans le corps entier. Mais c'est
exclusivement dans les testicules que se fait l'élaboration du
sperme, et que de là il se répand dans le corps entier ; il est la
sécrétion dernière de la partie utile de la nour-
XCIII riture, qui s'est
d'abord convertie en sang. C'est du sang que vient en définitive la
liqueur séminale ; elle est indispensable à la génération, ainsi
que les menstrues, qui le sont au même degré, quoique dans des
conditions différentes. On essaiera plus loin d'expliquer la part respective qu'ont le maie et la femelle dans l'acte commun de la génération, soit pour l'espèce humaine, soit pour toutes les autres espèces. On croit reconnaître que la conception a eu lieu à la disposition que prennent les organes XCV sexuels ; mais ce s.ont là des symptômes fort douteux. Ce qui ne Test pas, c'est la cessation des menstrues, dans le mois qui suit le rapprochement, ou même quelquefois au bout de six semaines, à partir de la copulation. La nature ne se soulage plus régulièrement, et tout ce sang remonte et s'accumule dans les mamelles, pour s'y convertir en lait, lorsque le moment sera venu. Quand la grossesse est certaine, le premier indice que la femme en ait se manifeste dans les flancs, qui se gonflent et paraissent s'emplir. L'enflure chez les femmes maigres se fait sentir surtout dans les aines. Le premier mouvement du fœtus a lieu du quarantième jour au quatre-vingt-dixième; on ne peut pas, dans des indications de ce genre, exiger d'exactitude. C'est aussi vers la même époque que le fœtus commence à se diviser ; ses parties deviennent de plus en plus distinctes, tandis que jusque-là il n'a été qu'une masse de chair, où aucun membre n'est marqué. Après la conception, les femmes sentent des lourdeurs dans tout le corps; leur vue s'obscurcit, et elles éprouvent des maux de tête. La plupart sont prises de nausées et de XCVI vomissements. Certaines femmes souffrent davantage au début; d'autres ne souffrent que plus tard, quand déjà le fœtus a pu prendre plus de développement. On prétend que la grossesse est moins pénible quand c'est un garçon ; alors les femmes gardent mieux leurs couleurs de santé; elles sont au contraire plus pâles quand c'est une fille. Les femmes grosses ont toutes sortes d'envies singulières, et elles en changent à tout instant ; elles ont souvent des tumeurs aux jambes et dans les chairs. Il y a peu de femmes pour qui la grossesse amène une santé meilleure. En général, le garçon a plus de mouvement dans le sein de la mère que n'en a la fille ; il en sort plus vite. Les filles en sortent plus lentement. Le travail pour la naissance des filles est continu et plus sourd ; pour la naissance des garçons, il est plus vif et plus rapide, mais beaucoup plus douloureux. Quelquefois, la mère croit ressentir les douleurs de l'accouchement, sans que ce soit précisément les douleurs véritables; c'est le fœtus qui, en retournant sa tête, donne à croire que le moment décisif est arrivé. XCVII Tous les autres animaux n'ont qu'une seule et unique manière de commencer et d'accomplir la génération de leur fruit ; il y a des temps fixes, à la fois, pour l'accouplement et surtout pour la durée de la gestation. L'homme fait exception à ces règles générales et immuables. Il n'a pas de saison pour le rapprochement. Il n'a pas davantage de temps parfaitement déterminés pour la parturition. Les enfants naissent à sept mois, à huit mois, à neuf mois, et, comme terme extrême, à dix mois. Avant sept mois révolus, ils ne peuvent jamais vivre, quoi qu'on fasse. Ceux de sept mois peuvent vivre ; mais il faut les entourer de précautions minutieuses, et ils restent longtemps très languissants. En Egypte et dans quelques pays où les femmes accouchent plus aisément et font fréquemment des jumeaux, les enfants venus à huit mois sont viables, et on les sauve presque tous. Sous le climat de la Grèce, le plus grand nombre des enfants de huit mois périt. Comme on a cette opinion préconçue, on suppose toujours, quand on sauve par hasard un de ces enfants, qu'il n'est pas réellement venu à huit mois, et que la mère s'est trompée sur le moment de la conception. XCVIII Il est bien probable que c'est aussi une erreur de ce genre qui donne à croire quelquefois que l'enfant est venu à dix mois. La durée régulière de la gestation est de neuf mois. Les mois où les femmes souffrent le plus dans leur grossesse, c'est le quatrième et le huitième. Si le fœtus vient à périr dans l'un de ces deux mois, la mère risque bien de mourir aussi ; de telle sorte, que non seulement les enfants ne vivent pas à huit mois, mais que les mères courent les plus grands dangers. Dans la plupart des pays et le plus ordinairement, les femmes n'ont qu'un enfant; mais assez souvent aussi et dans plus d'une contrée, on voit naître des jumeaux, par exemple en Egypte. Parfois, il y a jusqu'à trois enfants et même quatre, dans certains pays où ces faits sont plus fréquents que dans d'autres. Le plus qu'on ait jamais vu, c'est cinq enfants à la fois; et ces accouchements extraordinaires se sont répétés à plusieurs reprises. On cite une femme qui en quatre couches eut vingt enfants, cinq à chaque fois, et qui les éleva presque tous. Chez les autres animaux, les jumeaux, mâle et femelle, n'en viennent pas moins régulière- XCIX ment, et ils vivent aussi bien que quand tous les deux sont mâles, ou tous les deux femelles. Chez l'homme il n'en est pas ainsi, et les jumeaux vivent bien rarement si l'un est une fille, et l'autre un garçon. Les superfétations, qui sont rares chez presque tous les animaux, le sont également dans l'espèce humaine. Cependant, elles s'y produisent quelquefois, quand des embryons sont conçus longtemps après d'autres; alors ils ne viennent jamais à terme; et, en même temps qu'ils causent de grandes douleurs, ils font périr avec eux le fœtus antérieur. On a pu observer, dans une fausse couche, douze fœtus sortir les uns sur les autres. Si la seconde conception est venue peu de temps après, c'est alors comme si les enfants étaient jumeaux, et les mères accouchent du second après le premier. La mythologie raconte une naissance de ce genre pour Iphiclès et Hercule. Parfois, le phénomène est d'une parfaite clarté. Telle femme mariée, qui avait un amant, mit au monde deux enfants, dont l'un ressemblait au mari, et l'autre à l'amant adultère. On a vu encore une femme, qui portait déjà deux jumeaux, avoir un troisième C enfant outre ceux-là. Le troisième vint à cinq mois et mourut sur-le-champ ; les deux autres vinrent au temps voulu. Une autre femme accoucha d'abord d'un enfant de sept mois, et de deux autres venus à terme; le premier mourut, et les jumeaux vécurent. Quelques femmes qui ont deux enfants avortent du premier, et accouchent du second sans souffrir. Un autre accident beaucoup plus rare encore que la superfétation, c'est la môle, qui atteint quelquefois des femmes enceintes. D'abord, les choses paraissent se passer en effet de la façon la plus régulière; après la conception, la grossesse suit son cours ordinaire; mais à terme, la femme n'accouche pas, et la dimension de son ventre ne diminue point. Cet état fort gênant peut subsister pendant trois ou quatre ans de suite, ou même davantage, et la malade, quand elle accouche, met au monde une masse de chair qui a reçu le nom de môle. On a observé des cas où la môle persistait jusque dans la vieillesse de la femme et jusqu'à sa mort. Cette chair, gardée si longtemps dans le corps, finit par devenir extrêmement dure, et l'on a peine à la couper. Les naturalistes ne CI sont pas d'accord sur les causes de la môle. Quelques-uns croient qu'elle se forme par un excès de chaleur; nous y verrions un défaut de chaleur plutôt qu'un excès. On dirait que la Nature a manqué de force et n'a pu mener à bout la génération complète. Le produit met si longtemps à sortir, parce qu'il n'a pas reçu une coction suffisante. Il reste cru en quelque sorte et inachevé, sans être cependant tout à fait un corps étranger. Il paraît certain que la môle ne se forme que dans notre espèce, et que les autres animaux n'y sont jamais sujets; du moins, on n'a rien observé jusqu'ici qui pût le faire supposer. Il est assez probable que, si la femme seule peut avoir la môle, c'est à cause de l'abondance du flux menstruel. Ce serait ici le moment de dire quelques mots des monstruosités, qui ont fourni matière à bien des exagérations. lia suffi parfois d'une simple laideur dans le visage, pour qu'on assimilât des êtres humains à des animaux, avec lesquels ils n'avaient que des rapports de physionomie fort éloignés. On a prêté à des enfants des têtes de veau et à des moutons des tètes de bœuf. Tout cela est faux, bien qu'à CII force de le répéter, on ait pu persuader des gens crédules. Mais il y a des monstres plus réels, en ce qu'ils ont des membres en surnombre, ou des membres de moins. Des enfants naissent avec six doigts aux mains ou aux pieds ; d'autres n'en ont qu'un seul. Il y en a encore qui sont hermaphrodites, ou qui, du moins, le paraissent. Ce dernier phénomène se présente aussi chez les chèvres. Il y a des difformités intérieures comme il y en a d'extérieures. Certains viscères sont déplacés ou difformes; ou même ils manquent absolument. Mais, si l'on a vu des animaux n'avoir pas de rate, ou en avoir deux, ou avoir un seul rognon, jamais le cœur ne manque, non plus que le foie, qui d'ailleurs peut être incomplet. On a observé le foie à gauche, et la rate à droite. Ces anomalies peuvent se rencontrer chez des animaux bien constitués du reste. Mais elles sont plus fréquentes chez ceux qui font plusieurs petits à la fois, que chez ceux qui naturellement n'en font qu'un seul. Elles sont fréquentes aussi chez les oiseaux, quand il ya deux jaunes qui se confondent au lieu d'un, par exemple, chez les gallinacés. On a essayé de faire la théorie de ces CIII phénomènes; mais on a grand-peine à les expliquer, et Démocrite lui même n'y a point réussi. Tous les vivipares ont du lait, soit qu'ils vivent sur terre, soit qu'ils habitent les eaux. Le lait est destiné par la Nature à nourrir le jeune, dès qu'il a quitté le sein de sa mère, et qu'il n'a plus à recourir à la nutrition utérine. L'apparition du lait coïncide toujours avec la naissance du petit, et l'époque où le lait se montre est absolument fixe pour toutes les espèces. Mais, dans la nôtre, comme il y a plusieurs époques possibles pour l'accouchement, il faut que le lait soit formé dès la première époque où la parturition peut se produire, c'est-à-dire, dès le septième mois. Le lait est toujours contenu dans un organe spécial, les mamelles, qui sont généralement terminées par un mamelon. Bien que les mâles aient aussi des mamelles plus ou moins marquées, ils n'ont pas de lait. On cite cependant des exemples en sens contraire. On a vu, dit-on, à Lemnos, un bouc avoir du lait, comme s'il eût été une chèvre. On a vu même quelques hommes avoir du lait, mais en très petite quantité, après le moment où ils devenaient pubères. CIV Le lait est plus ou moins abondant, selon la grosseur de l'animal et selon la nature de ses aliments. Les espèces qui ont plus de deux mamelles ont en général peu de lait, et seulement ce qu'il leur en faut pour nourrir les petits. On a fait des comparaisons sur le lait des animaux domestiques, chèvres, chiennes, vaches, ânesses, chamelles, etc., en vue de la fabrication des fromages. Le lait le plus léger et un des plus agréables est celui du chameau. Le lait est toujours composé de deux parties, le sérum et le caséum : le premier plus liquide, le second plus solide et plus apte à se coaguler. Ces deux éléments se combinent en proportions diverses; mais pour les enfants, c'est le lait qui a le moins de caséum qui leur est le plus salutaire. Dans notre espèce, le lait qui paraît avant sept mois est peu nutritif; à ce premier moment, il est peu salé, et Ton dirait qu'il n'est pas assez fait, ni assez cuit. Il s'améliore après les sept mois, et il devient plus nourrissant à mesure que l'embryon a de plus en plus chance de vivre. Il ne faut pas néanmoins qu'il le soit trop, parce qu'alors il pourrait causer des convulsions à l'enfant. Au mo- CV ment où la femme accouche, d'une façon naturelle après une gestation de neuf mois, le lait a toutes les qualités requises. Il s'accroît en quantité après l'accouchement ; et parfois il est si abondant qu'il sort spontanément par le mamelon, et même qu'il suinte par toutes les parties du sein, et jusque sous les aisselles. Le lait qui a une couleur un peu bleuâtre passe pour le meilleur, de même que celui des femmes brunes vaut mieux, dit-on, que celui des blondes. Gomme les menstrues disparaissent après la conception, on doit croire que, restant à l'intérieur, elles servent à y nourrir l'embryon. Mais, lorsque l'embryon, vers sept mois, est en très grande partie formé, il n'a plus autant besoin de l'élément sanguin qui le développait ; et une partie de cette sécrétion se transforme en lait, qui arrive à point pour être utile après la parturition. Le lait vient donc du sang, comme toutes les autres excrétions. Ce rapport du lait et des menstrues est si vrai que les nourrices n'ont pas leurs mois, tout le temps qu'elles ont k donner le sein. Si elles viennent à concevoir pendant ce temps, le lait cesse, CVI de même que cessent les menstrues après la conception. Les cas exceptionnels sont fort rares. On doit donc en conclure que la Nature ne peut suffire aux deux sécrétions à la fois, celle des menstrues et celle du lait. Si les évacuations mensuelles continuent pendant la grossesse, l'embryon que porte la femme en souffre beaucoup, et l'enfant qui naît dans ces conditions contre nature est faible et maladif. Quand la liqueur séminale a été introduite dans la matrice, elle y est revêtue en très peu de temps d'une membrane qui l'entoure; et l'on a pu constater ce fait sur des fœtus sortis avant d'avoir pris encore aucune forme. On dirait d'un œuf dépouillé de sa coquille. Cette membrane est remplie de veines. Ce n'est pas l'homme seul qui présente ce phénomène. Tous les animaux sans exception, aquatiques, terrestres, volatiles, se forment absolument de même, malgré toutes les autres différences qui les distinguent. A la suite de cette première membrane, qui s'appelle chorion, il s'en produit une autre, qui contient de l'eau. C'est vers la sixième semaine que le fœtus commence à avoir des divisions distinctes; jusque-là, il n'a CVII guère été qu'une masse de chair presque informe. Si, après une fausse couche, on observe un fœtus mâle, sorti à quarante jours, et qu'on le mette dans de l'eau froide], il y subsiste comme dans une membrane ; en ouvrant cette membrane, on y voit le fœtus, qui a la grosseur des plus grandes fourmis. On discerne déjà ses membres, tous ses autres organes, et même les parties génitales. Les yeux sont proportionnellement énormes, comme sur tous les autres animaux. Le fœtus femelle est beaucoup moins vite formé ; et il faut trois ou quatre mois pour qu'il ait l'aspect qu'a le fœtus mâle à six semaines. Mais si le fœtus mâle se développe plus rapidement dans la vie utérine, c'est au contraire la femelle qui croît le plus rapidement une fois qu'elle a vu le jour. Quelle est précisément la vie du fœtus dans ces premiers moments ; car il a certainement une vie ? Il serait bien difficile de le dire; mais on doit croire que, dès l'instant où il paraît, il a en lui la faculté de se nourrir. Il a donc l'âme nutritive, s'il doit n'avoir que plus tard l'âme sensitive, et plus tard encore, l'entendement, qui est en nous une parcelle divine, et CVIII qui nous vient du dehors. Le fœtus se nourrit par le cordon ombilical rattaché à la matrice, de même que la racine rattache la plante à la terre. Cela est si vrai qu'il ne cesse de se développer du centre a la périphérie, et non pas de la périphérie au centre, ainsi que le soutient Démocrite, qui suppose aussi que les membres de l'enfant se moulent sur les membres de sa mère. Les viscères intérieurs se développent avant les organes extérieurs; et les parties supérieures, avant les parties inférieures. Le cœur est le premier à paraître, de même qu'il est aussi le dernier à agir, à la fin de la vie, en résistant aux approches de la mort. Et cela se conçoit sans peine, puisque c'est le sang issu du cœur qui doit pourvoir à la nutrition générale. Le viscère qui se montre et s'organise après le cœur, c'est le cerveau; le cœur est le foyer de la chaleur dans l'animal, tandis que le cerveau est destiné à produire le refroidissement, si nécessaire pour l'action de la pensée. L'intermittence du chaud et du froid produit, dans le corps, les parties plus ou moins liquides, ou les parties solides qu'il contient. Les os, les tendons, les cartilages, etc., sont CIX solidifiés par le froid. On dirait que la Nature, dans cette évolution du fœtus, procède à la façon des artistes, qui d'abord tracent des esquisses, avant d'arrêter définitivement les traits de leur dessin, et d'y ajouter la couleur des objets. D'ailleurs, la Nature met des bornes infranchissables à cet accroissement, soit dans la vie utérine, soit dans l'existence ultérieure. Les os ne croissent pas toujours, et ils s'arrêtent à un certain point que la Nature a fixé pour eux, et pour toutes les autres parties du corps. Si quelques-unes des parties du fœtus sont d'abord trop fortes, elles diminuent ensuite ; et la Nature répartit peu à peu les développements divers, comme un sage économe sait, dans la maison qu'il gouverne, distribuer les aliments selon les personnes qui la composent, sans oublier même les animaux domestiques. Il y a des naturalistes qui ont supposé que les enfants tètent déjà dans la matrice, les cotylédons jouant, selon eux, le rôle de mamelles. C'est une erreur qui mérite à peine qu'on s'y arrête. Chez tous les quadrupèdes, le fœtus dans la matrice est étendu tout de son long; dans les CX poissons, il est placé de côte; dans les oiseaux, il est replié sur lui-même. Dans l'homme, il est replié aussi, le nez touchant les genoux. Ainsi que les yeux, les oreilles saillissent beaucoup. D'abord, il a la tête en haut comme le fœtus de toutes les autres espèces; mais quand il s'est développé, et qu'il tend à sortir, il se retourne la tête en bas. Dans l'ordre naturel des choses, c'est la tête qui doit sortir la première; il est contre nature que l'enfant sorte par les pieds; ceci s'applique à tous les animaux. Gela tient à ce que la partie du corps supérieure au nombril, est plus grande que la partie inférieure; et alors, il se passe quelque chose d'analogue à ce qu'on voit dans les balances ; c'est le poids le plus lourd qui l'emporte et qui baisse. Une fois arrivé à toute sa croissance, le fœtus descend dans le bas du ventre, où son mouvement devient très sensible. Quand les douleurs se font sentir vers le ventre, l'accouchement est plus rapide; quand elles se portent vers les reins, il est plus laborieux. Si c'est un garçon, les humeurs qui sortent en même temps que lui sont aqueuses et pâles; si c'est une fille, elles sont plutôt sanguinolentes. C'est d'abord CXI de l'eau qui s'écoule, quand le fœtus se remue, et que les membranes qui l'enveloppent se déchirent. L'enfant sort en entraînant après lui toutes les membranes qui l'entouraient dans le sein maternel. Savoir lier le cordon ombilical et le couper est une partie de l'art de l'habile accoucheuse. A l'endroit où la ligature est faite, la cicatrice a lieu; et le reste, ou l'arrière-faix, resté à l'intérieur, n'a plus qu'à tomber. Si la ligature vient à se défaire, l'enfant meurt par la perte de son sang. Si l'arrière-faix ne sort pas immédiatement avec l'enfant, on se contente de lier le cordon, et on ne le coupe qu'un peu plus tard. Il faut d'ailleurs bien prendre garde à cette opération ; car il arrive souvent que le nouveau-né semble être mort, tandis qu'il n'est qu'affaibli par le sang qu'il perd, avant que la ligature ne soit pratiquée. L'ac-coucfieuse refoule alors le sang qui coule par l'ombilic, et l'enfant revient à la vie sur-le-champ.
Il a les bras étendus sur les côtés ;
et, à peine sorti, il se met à vagir. Tant qu'il n'est pas sorti du
sein de sa mère, il ne crie pas,
CXII même lorsque, dans un accouchement difficile, la
tète est déjà dehors, et que le reste du corps est toujours en
dedans. Aussitôt nés, les enfants portent les mains à leur bouche;
ils rejettent des excréments, ou immédiatement, ou peu de temps
après la naissance, et toujours dans la journée. Cette excrétion,
qui est plus abondante que ne le ferait supposer la dimension de
l'enfant, est ce que les femmes appellent le méconium. Cette matière
est noire et aussi épaisse que de la poix, bien qu'elle ait la
couleur du sang. Plus lard, quand l'enfant a pris la mamelle, ses
excréments se rapprochent du lait. Les nouveau-nés ne rient et ne
pleurent qu'après le quarantième jour, du moins pendant la veille;
car ces deux phénomènes sont plus précoces durant la nuit. La
plupart des enfants ne sentent rien quand on les chatouille, sans
doute parce qu'ils dorment presque constamment. Ils ont
manifestement des rêves; mais il s'écoule bien des années avant
qu'ils n'acquièrent la faculté de se les rappeler. Enfin,
contrairement à ce qui se voit chez les animaux, les os de l'enfant
ne sont pas tous bien formés, à sa naissance; la fonta-
CXII nelle, au sommet de
la tête, est d'abord molle et ne se solidifie que plus tard. A ce même temps, les viscères intérieurs sont déjà très visibles, et l'on discerne l'es- CXV tomac et les intestins. Les veines partant du cœur pour se rendre à l'ombilic, sont également très marquées. De l'ombilic, sortent deux veines, allant l'une à la membrane dont le jaune est entouré, l'autre à la membrane commune qui entoure le poussin. A mesure qu'il grossit, une partie du jaune va en haut; l'autre partie va en bas. Entre elles deux, se trouve le liquide blanc, qui est aussi au-dessous du jaune. Au dixième jour, le blanc est au plus bas de l'œuf, en petite quantité, gluant et épais. L'embryon est enveloppé d'une membrane, qui l'empêche d'être noyé dans le liquide du blanc, ou dans le liquide du jaune. Il continue à croître chaque jour; au vingtième, on peut entendre le poussin piauler au dedans de l'œuf, et il se meut pour sortir. Si Ton enlève une partie de la coquille, on le voit déjà tout couvert de duvet. Il a la tête posée sur la cuisse droite, vers son flanc; et sa tête est placée sous son aile. Un peu auparavant, il s'est débarrassé des membranes, dont l'une l'enveloppait et dont l'autre servait à le nourrir. Cependant, le jaune a diminué de plus en plus jusqu'à complet épuisement; et ce CXVI qui prouve bien qu'il a servi à la nourriture du poussin, c'est que, si l'on ouvre un poulet, dix jours après sa naissance, on trouve encore quelque reste de jaune dans son intestin. Malgré toutes les différences, qui sont évidentes, on peut cependant remarquer qu'il y a plus d'un rapport entre le développement du fœtus des ovipares et de celui des vivipares. Les embryons des ovipares ne sont pas nourris dans la mère, sans doute; mais ils lui prennent aussi une partie de sa substance ; et, grâce au cordon extérieur et sanguinolent, ils sont avec la mère à peu près dans la même relation que les embryons des vivipares sont avec la matrice. Après tout ce qui précède, sur les moyens qu'emploie la Nature pour la reproduction des individus et pour la perpétuité des espèces, il reste une dernière question, la plus importante de toutes, et peut-être aussi la plus obscure, parce qu'on ne peut plus y appliquer la méthode d'observation, et qu'il faut s'y contenter de l'hypothèse. Quelle est, dans l'acte de la génération, la part du mâle et quelle est la part de la femelle ? Leur concours est in- CXVII dispensable ; mais quelle est précisément la nature de ce concours pour l'un et pour l'autre ? Entre les deux, la distinction la plus frappante, c'est que le mâle est l'être qui engendre dans un autre être, et que la femelle est l'être qui engendre en lui-même. A cette première différence, qui est essentielle, on pourrait en joindre plusieurs autres tirées de la force musculaire, de la conformation du corps et des parties génitales, delà voix, du caractère, des armes servant à la défense ; sous tous ces rapports la femelle paraît être inférieure. Il est vrai que, des deux côtés, il y a une émission : ici les menstrues; là le sperme ou liqueur séminale. Mais d'abord, ces émissions ne sont point simultanées; et, en outre, leur composition n'est pas la même. Nous avons déjà dit qu'il ne faut pas confondre les évacuations féminines avec la semence venue de l'homme. Si l'on veut les assimiler, comme l'ont fait quelques naturalistes, il faut du moins convenir que le sperme est la dernière et la plus parfaite élaboration du sang, tandis que l'élaboration sanguine des menstrues est tout à fait incomplète. D'ailleurs, en se rappelant que jamais CXVIII la sagesse de la Nature ne fait rien en vain, on ne comprendrait pas qu'il y eût deux émissions pareilles au lieu d'une; la seconde ne servirait à rien, et elle détruirait plutôt l'effet delà première; elle compromettrait le résultat commun. La raison nous dit non moins clairement (pie, quand un être doit résulter de l'association de deux autres, patient et agent, il n'est pas du tout nécessaire que quelque chose de matériel sorte de l'agent, pour passer dans l'être qui doit résulter de l'action. Ainsi, quand l'artiste travaille le bois ou la cire, il ne met aucune matière venant de lui dans la matière qu'il façonne, et qui lui est préalablement donnée; il n'y met que son art, c'est-à-dire, la forme, qui, sans lui, ne se produirait jamais, dans les éléments matériels que transforme son habileté. Le mâle peut être regardé comme l'agent; la femelle est passive en tant que femelle; le mâle représente la forme spécifique; et la femelle, dans son rôle subordonné, ne représente que la matière où la forme s'incarne. On peut découvrir un phénomène d'un genre CXIX fort analogue dans la fécondation des poissons, qu'on a déjà citée plus haut. Nous avons dit que la femelle pond ses œufs en un nombre énorme ; mais ce sont des œufs imparfaits ; et il n'en sortirait rien de vivant si le mâle ne venait, après la femelle, répandre sa laite sur les œufs qu'elle a pondus. Il n'y a de sauvés et de productifs que ceux que la laite a touchés et aspergés. C'est là un fait de toute évidence et mille fois constaté. Il prouve de la manière la plus manifeste que le mâle n'apporte rien en quantité à l'être nouveau ; il n'apporte que la qualité, c'est-à-dire, la vie, le mouvement, l'espèce ou la forme. Un autre fait non moins décisif, c'est que l'intromission, qui semble déposer quelque chose du mâle dans la femelle, n'est pas nécessaire non plus pour que la reproduction ait lieu. On peut l'observer sur bien des insectes : loin que ce soit le mâle qui introduise son organe dans celui de la femelle, c'est au contraire la femelle qui introduit le sien dans le mâle. En ce cas, l'accouplement dure assez longtemps; mais la fécondation a lieu de même par ce moyen, qui est l'inverse du CXX procédé le plus ordinaire. C'est si peu le mâle qui apporte ici quelque matière, qu'on peut dire, tout au contraire, que la matière lui est apportée, afin qu'il y détermine la modification qui ne peut venir que de lui seul. Dans les animaux supérieurs, où le rapprochement se fait de la manière que l'on sait, on dirait que la liqueur mâle produit, dans le sang menstruel, l'effet que la présure produit sur le lait; elle le coagule et lui donne une consistance qu'il n'aurait pas sans elle. Dans les êtres animés il doit se passer quelque chose d'assez semblable entre les deux liqueurs dont le contact amène et détermine la conception. On peut donc affirmer, au nom de la raison et des faits, que, si le mâle et la femelle sont, au même titre, causes et auteurs de la génération, en tant qu'indispensables l'un et l'autre, il y a cependant entre eux cette différence essentielle que l'être engendré par les deux n'emprunte de la liqueur séminale du mâle que l'action puissante de cette liqueur et le mouvement qu'elle provoque ; mais que le nouvel être qui reçoit la forme spécifique, est CXXI uniquement le résidu matériel de l'excrétion qui est dans la femelle. Le sperme est le moteur et le vrai générateur. L'être engendré tient de lui la forme et le mouvement, en d'autres termes, la vie. Il en est absolument en ceci comme pour les poissons ; ici aussi, le mâle ne fournit que la qualité, la quantité ne devant se développer que plus tard ; et la femelle fournit la matière. D'ailleurs, elle ne fournit pas seulement la place à l'embryon, ainsi que l'ont cru quelques naturalistes ; car, sans elle, l'embryon manquerait des éléments nécessaires à son corps. Mais c'est le mâle qui apporte la sensibilité; c'est la sensibilité qui constitue vraiment l'animal et le distingue de la plante. Le mâle apporte l'âme, sans laquelle il n'y a de corps que par une vaine homonymie. Les matériaux qui sont dans la femelle n'ont l'âme nutritive et l'âme sensitive qu'en puissance; c'est le mâle qui leur donne les deux âmes en acte et en pleine réalité. Les œufs clairs que pondent quelquefois les oiseaux, sont une nouvelle preuve de ce qui se passe dans le phénomène de la génération, chez d'autres animaux; les œufs clairs ren- CXXII ferment bien le blanc et le jaune, qui doivent servir de corps et d'aliment au futur poussin; néanmoins, il n'en sort rien, parce qu'ils n'ont pas subi l'influence vivifiante du mâle ; ils ne sont, ni tout à fait vivants, ni tout à fait inertes. La femelle les produit à elle seule; mais, au fond, elle ne produit rien, puisque ses œufs restent sans vie. On a pu comparer, non sans vraisemblance, l'action du maie au mécanisme des automates; il suffit, dans les automates, qu'un premier ressort imprime le mouvement initial ; l'impulsion donnée se communique d'une pièce à une autre, sans que la première de ces pièces touche directement aux pièces suivantes. De même, l'action de la liqueur séminale se fait sentir bien longtemps après le rapprochement des deux parents. La force nutritive qu'a reçue l'embryon, se manifeste sur-le-champ en lui ; il commence aussitôt à se développer, en puisant dans sa mère la nourriture dont il a besoin, et qu'il lui emprunte par des moyens divers selon les espèces. Ensuite, il se donne par lui-même, et par son énergie intrinsèque, ses organes et ses membres ; il ne les reçoit CXXIII pas du dehors et par juxtaposition, comme Ta cru Démocrite. Voilà comment l'organe qui s'annonce le premier, et qui se détache de cette masse confuse, est le cœur, principe de la chaleur et de la sensibilité, destiné, ainsi qu'on l'a dit, à nourrir tout le reste, au fur et à mesure de la croissance, et durant la vie entière. L'embryon, muni de son ombilic, se sert de l'utérus comme la plante se sert de la terre ; et son existence, dans cette époque de transition, est toute végétative, en attendant qu'elle devienne intelligente et raisonnable. L'embryon se divise alors, attaché à la matrice, comme le germe de la plante pousse sa racine et sa tige. Mais l'embryon humain s'entoure de membranes et de chorions, pour s'isoler de tout ce qui l'environne, tandis que le germe végétal n'a pas besoin de tant de protection. C'est que le fœtus doit se suffire à lui-même, comme un enfant que le père de famille aurait mis hors de la maison, et qui se séparerait de ses parents. Voilà donc, autant qu'on peut le conjecturer, le rôle du mâle et de la femelle dans la génération. Evidemment, le mâle est supé- CXXIV rieur, puisque le principe qu'il apporte est l'Ame, et que le principe fourni par la femelle n'est que la matière. Ceci doit nous aider à comprendre pourquoi les sexes sont séparés dans les animaux les plus parfaits, et notamment dans l'espèce humaine. L'esprit vaut mieux que la matière, et le meilleur doit être séparé du moins bon. On pourrait dire aussi que le maie, qui est le dépositaire de l'espèce et de l'essence, a quelque chose de plus divin et de moins matériel que la femelle. Néanmoins, pour accomplir l'œuvre génératrice, le maie ne peut pas plus se passer du concours de la femelle que la femelle ne peut se passer du sien. Si l'un des deux vient à manquer, la transmission de la vie est impossible. De là, leur union inévitable, puisqu'ils sont nécessaires l'un à l'autre, pour leur œuvre commune. Mais d'où viennent les sexes ? Et à quel moment apparaissent-ils dans le fœtus ? Ce sont là des questions fort complexes, dans lesquelles Anaxagore, Démocrite, Empédocle se sont égarés, en attribuant l'origine de cette diversité, soit à la position du fœtus dans la matrice, soit à l'action de la chaleur et du CXXV froid. Il serait bien hasardeux de se prononcer dans de telles obscurités ; mais on peut observer que la complexion et l'âge des parents influe beaucoup sur la production des différents sexes. On peut même croire que la saison, l'air ambiant, et le climat n'y sont pas non plus tout à fait étrangers. Nous venons d'exposer les traits principaux de la théorie d'Aristote sur le grand fait de la génération, dans toute la série animale. Nous avons dû laisser de côté une foule de détails, par lesquels il la complète et la fortifie. Mais nous sommes resté fidèle à sa pensée, que nous avons reproduite dans son ensemble, en lui donnant seulement un peu plus de régularité et d'ordre systématique. Avant de poursuivre et de rechercher historiquement ce qu'est devenue cette belle doctrine, récapitulons les résultats qui ressortent de tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Un point absolument incontestable, c'est que voilà l'embryologie créée de toutes pièces, par la méthode d'observation, c'est-à-dire, par le seul procédé que la raison approuve, et le CXXVI seul qui puisse produire la véritable science ; la voilà, avec son objet propre, dans ses limites déjà fort étendues et infranchissables ; la voilà, dans toute sa profondeur et sa portée ; scrutant, par l'anatomie assidûment pratiquée, un des phénomènes les plus mystérieux de la Nature ; éclairant les problèmes d'une lumière qui, après plus de vingt siècles, n'a rien perdu de son éclat; la voilà, presque aussi avancée à bien des égards que notre science contemporaine ; se servant nécessairement de moyens beaucoup moins perfectionnés, mais employant les ressources dont elle dispose, avec une sagacité, une précision, une exactitude, qui ne peuvent jamais être dépassées ; avec une attention constante que rien ne lasse, ni ne rebute ; avec une passion ardente et réfléchie ; contemplant, dans un sentiment d'austère admiration, le spectacle sublime que la réalité offre aux méditations de l'homme, et rendant à la création une justice que, même, de nos jours, on ne sait pas toujours lui rendre. En un mot, Aristote est le père de l'embryologie, bien qu'il ne l'ait pas appelée de son nom ; il est le premier en date; et l'on ne CXXVII peut faire désormais que suivre ses traces et ses exemples, quelque long que soit l'avenir, de même qu'on les a suivis dans le passé, d'où la science actuelle est sortie, sans connaître, le plus souvent, son origine, et sans savoir à qui elle doit les principes qu'elle ne cesse d'admettre et de développer. Nous essaierons bientôt d'esquisser l'histoire de l'embryologie ; mais, avant de voir ce qu'elle est devenue après Aristote, il est bon de jeter un rapide coup d'œil sur ce qu'elle pouvait être avant lui. Il est démontré, par son propre témoignage, qu'Anaxagore, Démocrite, Empédocle et quelques autres avaient discuté plusieurs points de détail relatifs à la génération; mais aucun d'eux n'avait visé à une théorie complète, et c'est à Aristote lui-même qu'il faut demander ce qu'il pense de ses trois devanciers. Il n'a rien dit d'Hippocrate ni de Platon, bien que les doctrines de l'un et les leçons de l'autre aient pu avoir de l'influence sur ses études. Mais cette influence n'a pas dû aller fort loin, si l'on en juge par les œuvres qui nous restent de ces nobles personnages. CXXVIII Pour savoir ce qu'Hippocrate a pensé de la génération, l'embarras ne laisse pas que d'être assez grand, parce qu'il est très difficile de discerner ce qui lui appartient dans la vaste collection à laquelle son nom est attaché, et ce qui appartient à son école de diverses époques. On trouve bien dans cette collection des traités, sur la nature de la femme, sur le fœtus de sept mois, sur la génération et la nature de l'enfant, sur les maladies des femmes, sur les femmes stériles, sur les maladies des jeunes filles, sur la su-perfélation, etc. (Edition et traduction E. Lit-tré, t. Vil et VIII.) Mais, ou ces morceaux ne sont que des fragments et de simples notes; ou ils sont presque entièrement pathologiques, comme il convient à la médecine. Il n'y a pas là d'embryologie au sens où Aristote l'entendait, et où nous l'entendons avec lui. Il serait même très hasardeux d'y recueillir quelques données qui pourraient être prises pour une théorie de la génération. Récemment, des physiologistes ont tenté cette espèce de restitution, qui ne pouvait pas être fort heureuse, risquant ainsi de prêter à Hippocrate un sys- CXXIX tème qui n'est pas le sien, et de lui imposer des erreurs qu'Aristote a réfutées. Dans les Aphorismes, dont l'authenticité ne peut être révoquée en doute, on en peut trouver plusieurs qui se rapportent à la génération. Ils sont, dans la cinquième section, au nombre de 35, paragraphes 28 à 63. (Édition et traduction É. Littré, in-18, pp. 171-185.) Ceux-là sont encore presque uniquement médicaux, et très peu physiologiques. Ils recommandent certains remèdes pour faciliter le flux menstruel ; ils ne permettent les purgatifs pendant la grossesse que du quatrième au septième mois. Ils interdissent les saignées, qui causeraient l'avortement, comme le causent les dérangements prolongés des intestins. Il y a bien aussi quelques remarques qui tiennent de plus près à l'embryologie : par exemple, sur la maigreur excessive des femmes, qui provoque leur avortement, sur l'embonpoint extraordinaire, qui empêche la conception, sur les évacuations menstruelles, qui épuisent le fœtus, si elles continuent durant la grossesse, sur la suppression de ces évacuations, quand la grossesse se prononce et CXX quand le lait se forme, sur la position des fœtus, les milles à droite, les femelles à gauche, sur le teint des femmes enceintes, selon qu'elles portent un garçon ou une fille, etc. Toutes ces sentences concises et brèves sont fort intéressantes ; mais on y chercherait vainement un système sur la génération, dans l'homme ou dans les animaux. On en peut dire autant de Platon, et même à plus forte raison. Il n'aborde celte question que dans le Timée. Mais, si, dans cette œuvre solennelle, il s'élève jusqu'à l'idée d'un Dieu créateur, père du monde et auteur de l'ordre merveilleux qui règne dans l'univers, il ne s'occupe de la génération que pour signaler les emportements et les dangers que causent les désirs sexuels, et pour exposer les métamorphoses dégradantes que subissent les mortels livrés à leurs passions brutales. Les hommes lâches sont changés en femmes dans une seconde naissance ; les hommes d'esprit léger et bavards sont changés en oiseaux ; ceux qui ne se sont jamais occupés de philosophie deviennent des quadrupèdes et des bêtes sauvages. Les moins intelligents deviennent des CXXXI reptiles et rampent sur la terre. Enfin, ceux qui sont le plus dépourvus de raison deviennent des poissons, indignes de respirer un air pur, et condamnés à ne respirer qu'une eau trouble et pesante. Ainsi, tous les animaux se changent les uns dans les autres, selon qu'ils perdent de l'intelligence ou qu'ils en acquièrent. On peut donc affirmer que, ni dans Hippocrate, ni dans Platon, Aristote n'a trouvé de matériaux pour la science nouvelle qu'il allait créer. Après lui, la stérilité reste la même, et il se produit alors pour l'embryologie le phénomène que nous avons dû reconnaître, non sans étonnement et regret, pour l'Histoire des Animaux et pour le Traité des Parties. Après Aristote, l'esprit humain semble s'être désintéressé de ces questions, qui nous touchent cependant de bien près ; le silence est universel, et il n'est rompu qu'à la fin du xviie siècle de notre ère. Que le Moyen-âge, après la ruine de l'Empire, n'ait rien produit, absorbé par des problèmes bien autrement urgents et bien autrement pratiques, nous n'avons pas à en être surpris. Toutes choses alors sont CXXXII plongées dans le chaos ; les plus lourdes ténèbres pèsent sur les esprits, en toutes choses, si ce n'est peut-être en théologie ; l'histoire naturelle ne peut pas renaître, plus que les autres sciences, au milieu de ces débris et de ces agitations. Mais, comment s'est-il fait que la Grèce, dans les cinq siècles qui s'écoulent d'Aristote à Galien, ait été inféconde et muette presque autant que le Moyen-âge ? Comment cette question de la génération a-t-elle été oubliée ? Comment l'embryologie, si solidement inaugurée, a-t-elle disparu ? Comment une telle science a-t-elle été négligée, soit à Alexandrie, soit à Rome, comme elle l'était par Athènes elle-même ? C'est là ce que nous avons peine à concevoir. Mais le fait est indéniable. Il ne s'explique que d'une seule façon : Aristote, grâce à son incomparable génie, a été tellement en avant de ses successeurs, même d'Erasistrate et d'Hérophile, que personne n'a pu suivre ce pas gigantesque, et que la carrière, si largement et si glorieusement ouverte, est restée fermée. L'esprit humain n'a repris sa marche, et n'a pu l'assurer, que deux cents ans environ après la Renais- CXXXIII sance du xvie siècle. Chez les Anciens, ni l'École péripatéticienne, dans les divers pays où elle a régné, ni les autres écoles philosophiques, ni Varron, Cicéron, Celse, Sénèque, Pline lui-même, compilateur laborieux d'Aristote et de tant de naturalistes, n'ont rien dit. Il faut arriver jusqu'à Galien, à la fin du second siècle de notre ère, pour retrouver quelques traces d'une science déjà perdue. Encore, le traité du médecin de Pergame sur la semence (De Semine, édition de Kûhn, tome IV, pp. 512 et suiv.) n'est-il qu'une petite partie de la question ; elle semble échapper à Galien comme à bien d'autres, quoiqu'il fût capable de l'embrasser tout entière mieux que personne. Le traité de Semine est en deux livres ; il a tous les mérites et tous les défauts habituels de Galien. Son but est de concilier Hippocrate et Aristote, qui ont soutenu sur l'action de la semence des opinions opposées. Hippocrate croit que le sperme est tout à la fois matière et cause de la génération ; Aristote croit que la semence est simplement cause, et qu'elle n'apporte rien de matériel dans la conception. CXXXIV Admirateur sincère d'Hippocrate et d'Aristote, Galien voudrait résoudre le dissentiment qui les sépare, et c'est dans cette intention qu'il écrit. Pour atteindre ce but fort louable, il emploie les procédés qui sont toujours à l'usage de nos physiologistes les plus sagaces et les plus adroits. Dans ses investigations, il interroge d'abord les femmes, et il leur demande les observations qu'elles ont pu faire personnellement sur leur conception. Il observe lui-même minutieusement ce qui se passe dans l'accouplement des animaux domestiques, juments, finesses, chien nés, vaches ; il dissèque des femelles qui sont pleines ou qui viennent d'être couvertes, pour surprendre les changements immédiats que la liqueur séminale peut causer dans l'organe qui l'a reçue. Il croit que la semence femelle se mêle à la semence mâle dans les cornes de la matrice ; il parle même de bulles qui se rompent dans la semence de la femme ; car il admet que la femme a de la semence, malgré la réfutation qu'Aristote avait faite de cette théorie. Il insiste sur les fonctions des testicules, qui élaborent le sperme; mais, plus avancé qu'Aris- CXXXV tote en anatomie, il parle des testicules de la femme, qui sont placés des deux côtés de l'utérus. Evidemment, c'est des ovaires qu'il s'agit dans ce passage de Galien ; mais, d'après son propre témoignage, le mérite de cette découverte anatomique revient à Hérophile, dans le troisième livre de son Anatomie, dont Galien reproduit un long et très curieux extrait. Il parle encore avec grands éloges d'un médecin qu'il appelle Athénée, et qui avait composé aussi un ouvrage spécial sur le sperme, en sept livres. Ce médecin, qu'on connaît fort peu et qui vivait peut-être en Cilicie, vers le début de notre ère, était de l'avis d'Aristote; et, comme lui, il n'attribuait à l'action du mâle que la transmission du mouvement et de la vie, laissant à la femelle la fonction de fournir la matière de l'embryon. Sur ce point, Galien n'hésite pas à blâmer Athénée, en compagnie d'Aristote ; il soutient, contre les deux, que les femelles ont de la liqueur séminale tout aussi bien que les mâles, et que le concours d'une de ces liqueurs n'est pas moins indispensable que le concours de CXXXVI l'autre pour réaliser la génération. Il croit toujours avec Hippocrate, dit-il, que dans l'utérus les fœtus maies sont à droite, et les fœtus femelles à gauche. D'ailleurs, s'il s'éloigne en cela d'Aristote, il suit ses opinions sur d'autres points : la formation successive du fœtus, la ressemblance des enfants aux parents, les effets de la castration, les œufs clairs des oiseaux, etc. ; bien qu'il ne veuille pas (que le cœur soit le premier organe à se montrer dans le fœtus, comme le dit Aristote, et qu'il suppose que le cerveau est formé avant tout autre viscère. A côté des citations d'Hippocrate, d'Hérophile, d'Athénée, et d'autres médecins, comme Eudème et Marinus, connus uniquement parce qu'il les nomme, Galien est amené à faire encore des citations plus fréquentes d'Aristote. Il a le Traité de la Génération sous les yeux, et il lui emprunte de nombreux passages, soit pour y contredire, soit pour l'approuver. Il parle du cinquième livre de ce traité, qu'il regarde comme aussi authentique que les autres, et il semble le trouver à sa vraie place, après les quatre précédents. Tout en étant CXXXVII fort savant, il adopte parfois un style de rhéteur, qui n'est pas très scientifique. A tout instant, il apostrophe Aristote pour le combattre, et plus rarement pour le louer : « Mais, mon cher Aristote,... mais, très cher Aristote, tu dis ceci... tu dis cela!...que dirais- tu ?.... que répondrais-tu, si.... etc. » Ces formules sont bizarres ; mais elles n'ont rien d'irrespectueux; tout au contraire, Galien admire Aristote presque autant qu'Hippocrate, son maître et le père de la médecine : Aristotelem virum naturœ doctum. » Mais il n'est pas toujours fort juste avec lui : par exemple, quand il lui reproche de n'avoir pas assez vu quels sont les rapports de l'animal et de la plante, tandis qu'Aristote est revenu à satiété sur ces rapports, qu'il avait observés et signalés le premier, pour montrer combien les frontières des deux règnes sont incertaines. Du reste, Galien s'est borné à la question particulière qu'il voulait éclaircir, de la semence ; il n'est pas entré dans le vaste domaine de l'embryologie comparée, bien que l'exemple d'Aristote, et peut-être aussi celui d'Hérophile, l'y conviassent. Mais il n'est point à blâ- CXXXVIII mer d'être demeuré sur le terrain de la médecine, qui était le sien, et où ses travaux pouvaient être plus utiles que sur tout autre. Un sentiment qu'il a de commun avec Aristote et qu'il exprime très vivement en toute occasion, c'est une admiration sans bornes pour la Nature. Plus profond que les médecins de son temps, et que bien des médecins des temps postérieurs, il célèbre, avec un enthousiasme réfléchi, « la sagesse et la puissance de Celui qui a a fabriqué le corps humain. » Il repousse dédaigneusement Je système du hasard préconisé par Epicure, et il proclame l'évidence d'un art consommé et infini qui éclate dans la prodigieuse organisation de l'animal. Après Galien, tout se tait dans l'Antiquité. C'est quatre cents ans plus tard que Philopon commente le Traité de la Génération ; mais ses explications n'ajoutent quoi que ce soit au texte, qu'il veut élucider, pour les rares élèves qui suivent ses leçons. C'est la dernière lueur, et la nuit la plus obscure va se faire, pour six ou sept siècles de suite. La lumière ne reparaît, bien faible encore, qu'avec Averroès [ 1120-1198) chez les Arabes, et avec Albert- CXXXIX le-Grand, à Cologne et à Paris (1193-1280). Averroès, qui habite tantôt Cordoue, tantôt Séville, semble peu satisfait du texte original sur lequel il travaille, et qui fourmille de fautes ; mais il doit réviser sa traduction, « si Dieu le lui permet ». Les Arabes ne sont pas allés plus loin qu'Aristote; mais, si, entre leurs mains, la science n'a pas fait le moindre progrès, ils ont conservé la tradition ; c'est déjà un immense service. Ils ont préparé et facilité les labeurs de notre Moyen-âge; et notamment ceux d'Albert-le-Grand et de saint Thomas, qui, sans eux, n'auraient pu faire rien de tout ce qu'ils ont fait. Grâce aux Arabes, Albert-le-Grand non seulement reproduit tout Aristote, mais il a pu consacrer quatre livres de son ouvrage, De Animalibus, à la question de la génération, du xve au xvme livre. Il a même joint des observations personnelles à toutes celles qu'il empruntait au philosophe grec, à travers deux translations, du grec en arabe et de l'arabe en latin. Les commentaires d'Averroès et d'Albert-le-Grand, quelque peu novateurs qu'ils soient, prouvent que l'intérêt se réveillait dans les esprits pour les études phy- CXL siologiques ; et cette heureuse influence a été pour quelque chose dans la résurrection définitive au xve et au xvie siècles. L'ouvrage d'Al-bert-le-Grand était imprimé à Mantoue dès 1479. Mais, deux siècles vont s'écouler encore avant que la chaîne ne soit vraiment renouée, et qu'enfin la science, après cette longue interruption, se remette régulièrement en marche, sous la conduite et sur les pas de la Grèce. Parmi les théories d'Aristote, il en était une qui avait été généralement admise, bien qu'il y eut insisté fort peu : c'était celle de la génération spontanée. Outre les vivipares et les ovipares, dont la reproduction était évidente, on supposait que d'autres animaux, et surtout les insectes, dont on ne pouvait observer la reproduction, naissaient de la pourriture de certaines matières, soit dans la terre, soit dans les eaux; quelques poissons aussi étaient rangés dans cette classe. Cependant, Aristote avait lui-même élevé quelques doutes, et il avait dit que c'était la chaleur, plutôt que la putréfaction, qui était cause de la production de ces êtres. Mais on ne s'était pas arrêté à cette réserve; on s'en tenait à une division CXLI commode du règne animal, et l'on croyait aussi fermement à la génération spontanée qu'aux deux autres. Ce fut Redi d'Arezzo(1626-1694.) qui attaqua le premier cette erreur, et qui la combattit, à la satisfaction de tous les esprits sensés. Redi est médecin ; mais il est en outre naturaliste et poète. En même temps qu'il est accrédité à la cour des Grands-Ducs de Toscane, il est un des écrivains qui travaillent au dictionnaire de la Crusca; il a rang parmi les modèles du style italien. Ce qui doit le distinguer principalement à nos yeux, c'est l'excellence de sa méthode ; il la suit en s'en rendant parfaitement compte. Elle n'est pas autre que la méthode d'observation, telle qu'Aristote l'avait appliquée et recommandée. Sous ce rapport, Redi n'ignore rien ; mais ces principes essentiels avaient été si souvent méconnus et le sont encore si souvent, qu'il faut savoir gré à ceux qui y restent fidèles, soit qu'ils les découvrent par leur bon sens personnel, soit qu'il les reçoivent de sages prédécesseurs. L'ouvrage de Redi est sous forme de lettre adressée à un de ses amis, capable sans doute CXLII de juger de ces questions. L'auteur s'excuse de la longueur de son épître ; mais il est trop modeste ; sa lettre n'a rien de prolixe pour le résultat important qu'elle contient, et qu'elle annonce au monde savant, en 228 pages. Comme il est érudit, il connaît tout ce que l'Antiquité a légué aux Modernes ; il critique Empédocle, et parfois même Aristote, tout en le vénérant. L'indépendance de son esprit ne lui permet pas de s'en rapporter uniquement à l'autorité, quelque respectable qu'elle soit ; il ne s'en fie qu'aux sens, accordés à l'homme « par le suprême architecte », pour instruire sa raison. Il doute que la putréfaction puisse donner naissance à des êtres vivants ; et pour vérifier le phénomène, il observe des cadavres d'animaux qu'il dépose dans des vases clos, ou dans des vases ouverts. En examinant les choses avec attention, et en portant ses expériences à un degré d'exactitude dont il est un des premiers à fournir le modèle, il constate bien vite que, dans les vases hermétiquement fermés et soustraits au milieu ambiant, il ne se produit jamais d'êtres vivants, tandis qu'il s'en produit toujours dans les vases ouverts. CXLIII Il en conclut nécessairement que les vers ne s'engendrent de putréfaction que si la semence en a été apportée du dehors, par d'autres êtres doués dévie. Il retrouve des insectes venus de la même manière dans les galles des plantes, où l'on voyait aussi une génération spontanée. Il étend sa théorie jusqu'aux vers que les cerfs ont quelquefois dans la tête. « Je suis « porté à croire, dit-il en résumant sa pensée, « que tous les vers nés dans des putréfactions s'engendrent de semence paternelle, et que les chairs, les herbes, et les ordures de toute espèce ne font que préparer la génération des insectes, et leur apprêter un lieu et un nid, où tous ces animaux sont portés à déposer leurs œufs, ou autre semence de vers, qui, une fois nés, trouvent dans ce nid un élément suffisant pour se nourrir. Mais, si la mère n'y porte rien, rien n'y peut naître. » Ainsi, Redi, par la justesse de ses conclusions, et par la précision de ses expériences, devançait notre siècle, qui a vu se renouveler le débat sur la génération spontanée, et qui semble l'avoir définitivement tranché. Déjà, CXLIV la question avait été reprise avec assez d'éclat dans le xviie siècle par le jésuite Needham, dont Voltaire s'est un peu trop moqué. Mais les théories de Needham, bien que réfutées d'avance par les travaux de Redi, avaient été accueillies par deux grandes académies, celle de Paris et celle de Londres, et surtout par Buffon. Spallanzani avait contredit Needham, avec une vigueur égale à la politesse qu'il apportait dans la discussion. Entre ces jugements contraires, qui étaient tous fort considérables, la solution paraissait indécise, et bien des savants inclinaient au système de l'hétérogénie. De notre temps, ce système était encore soutenu avec ardeur par M. F. Pouchet, professeur d'histoire naturelle au Muséum de Rouen ; et ses opinions, qu'il défendait avec autant de conviction que de talent, comptaient des partisans jusque dans les rangs les plus élevés du monde scientifique. L'Académie des Sciences de l'Institut de France s'en émut, et comme M. Pouchet était un de ses lauréats, elle crut, en 1858, devoir mettre au concours le sujet suivant : « Essayer par dos expériences bien faites de jeter un jour CXLV nouveau sur la question des générations spontanées. » Ces expériences furent entreprises, en dehors du concours, par M. Pouchet, représentant de l'hétérogénie, et par M. Pasteur, chimiste et directeur des études scientifiques a l'École normale, adversaire déclaré de cette théorie fausse. M. Pasteur parvint à réduire pour jamais l'erreur à néant. Il préludait alors à l'illustration qui devait bientôt entourer son nom. M. F. Pouchet avait présenté à l'Académie des sciences (20 décembre 1858) une note où il affirmait que « les protoorganismes végétaux et animaux » naissent spontanément dans de l'air artificiel et dans le gaz oxygène. Se fiant à des expériences prolongées, il soutenait que des animalcules peuvent se développer dans un milieu absolument privé d'air atmosphérique. Les membres principaux de l'Académie s'étaient prononcés contre M. F. Pouchet. Payen, Claude Bernard, H. Milne Edwards et J.-B. Dumas ne croyaient pas à la génération spontanée. Mais la réfutation publique et victorieuse fut celle de M. Pasteur. Dans un grand mémoire, soumis à l'Institut et inséré dans CXLVI les Annales des sciences naturelles (1861, tome XVI, pp. 5 et suiv.), il reprit la question, en remontant à l'Antiquité, et en rappelant les aberrations de Van llelmont, qui enseignait la manière de faire naître des souris, et de Leewenhoeck lui-même, qui se flattait, non moins sûrement, de produire des grenouilles. Il démontra, par des analyses irréfutables, que l'air atmosphérique contient une énorme quantité de particules solides et de germes de toute espèce; que ce sont des germes et des corpuscules disséminés, et en suspension dans l'air, qui produisent tous les organismes des infusoires; et qu'excités par l'oxygène, ils composent les ferments qui ne sont au fond que des êtres organisés. Les expériences de M. Pasteur étaient si bien faites et si décisives, la méthode employée par lui était si puissante et si claire, qu'il n'y avait pas d'objection possible, et qu'il ne pouvait plus être question d'hétérogénie. Il était irrévocablement prouvé que tous les êtres vivants viennent de parents, animés eux-mêmes de la vie qu'ils ne font que transmettre. La génération spontanée était enfin reléguée parmi les CXLVII chimères ; et rien ne pourrait réveiller encore cette controverse éteinte que des passions antireligieuses, qui viendraient s'y mêler, tout en se cachant sous le manteau de la science. Nous nous excusons de cette digression à laquelle nous nous sommes laissés aller, afin d'en finir avec une question qui n'en est plus une, mais qui était née à propos d'une théorie d'Aristote. Nous revenons à l'histoire de l'embryologie comparée. En même temps que Redi portait la lumière sur un point particulier, un jeune médecin hollandais, Régnier de Graaf (1644-1673) faisait faire à la science un très grand pas ; il la mettait sur une voie où depuis deux siècles elle n'a pas cessé de le suivre, tout en poussant plus loin que lui les ingénieuses découvertes qu'il a commencées. Élève de Van Horne, son professeur d'anatomie à l'Université de Leyde, docteur en médecine d'Angers et de Paris, de Graaf s'était signalé, dès l'âge de 21 ans, par un traité remarquable sur le suc pancréatique. Quelques années après, il avait publié une étude sur les organes génitaux de l'homme, et il annonçait une étude semblable sur les or- CXLVIII ganes de la femme, Ce dernier livre parut en 1672, un an tout au plus avant la mort du jeune savant, qui eut à peine le temps de laisser ce monument à la postérité. L'ouvrage est intitulé : « De mulierum organis generationi inservientibus, tractatus novus demonstrans tum homines et animalia caetera omnia quae vivipara dicuntur, haud minas qumt ovipara ab ovo originem ducere. » Ce traité a été réimprimé cinq ans après la mort de l'auteur, dans ses œuvres complètes, à Leyde. De Graaf dédie son ouvrage, écrit en très bon latin, à Cosme IlI Grand-Duc de Toscane, par reconnaissance pour la faveur que les Médicis ont toujours assurée à la médecine; il espère que cette œuvre d'un jeune homme sera digne de Cosme, aussi bien que les hommages si souvent rendus à sa famille par les astronomes. Dans une Epitre au lecteur, il rappelle ses recherches antérieures, et il expose le dessein qu'il poursuit dans celle-ci. Il veut prouver que les animaux, y compris l'homme, ne viennent pas d'un œuf formé dans l'utérus par la liqueur séminale du mâle, ou par son action, comme le grand Harwey l'avait cru, CXLIX mais que l'œuf existe dans les organes de la femme avant tout rapprochement sexuel. De Graaf avoue que c'est là un paradoxe ; mais il demande qu'on veuille bien le lire avant de le condamner. Il soutient que l'espèce humaine n'est pas la seule à présenter cette organisation, et que tous les vivipares sans exception ont des ovaires, comme les oiseaux. Si l'oviducte chez les oiseaux a une extension membraneuse, les trompes de Fallope chez les quadrupèdes remplissent le même office. Elles reçoivent les œufs expulsés des follicules ; sans elles, les œufs tomberaient dans l'abdomen, où ils causeraient les désordres des grossesses extra-utérines. Le jeune anatomiste avait fait surtout ses dissections sur les animaux ; mais il ne doute pas que les résultats qu'il a obtenus ne soient également applicables à l'organisation féminine. En décrivant cette organisation merveilleuse, avec beaucoup plus de soin qu'on ne l'avait fait jusqu'à lui, il prie ses lecteurs d'écarter toute pensée qui serait étrangère à la science. Pour s'excuser de traiter ce sujet délicat, il s'appuie sur l'autorité médicale de Celse et CL sur l'autorité théologique de saint Augustin. Depuis de Graaf, plus d'un anatomiste a formulé de semblables réserves, qui sont toujours sous-entendues pour une science sérieuse, même quand on ne les exprime pas formellement. Comme le dit laconiquement Terlul-lien, que d'autres anatomistes ont invoqué : « Natura veneranda est, non erubescenda. » Sur seize chapitres formant l'ouvrage de de Graaf, qui n'est guère plus long que celui dé Redi, onze sont consacrés à la description de tout l'appareil génital, depuis les parties les plus extérieures jusqu'aux plus profondes. Les planches qui accompagnent la description sont assez médiocres. Le chapitre xii traite spécialement des ovaires, que Vésale, le plus grand des anatomistes, selon de Graaf, et après Vésale, Laurent, Fallope, Coïter, Spigel, Van Horne, avaient observés, sans en bien comprendre le rôle. De Graaf reprend donc minutieusement cette analyse, et il constate que la substance membraneuse des ovaires renferme toujours des vésicules pleines de liqueur, et aussi des globules, des nerfs et des vaisseaux. C'est pour les vésicules que tout le CLI reste est fait. Van Home, qui s'en était beaucoup occupé, les appelle des œufs, et de Graaf adopte ce nom. La femme contribue à la génération par ces vésicules. La liqueur séminale du mâle arrive par l'oviducte, c'est-à-dire, par les trompes de Fallope, à ces œufs contenus dans l'ovaire, et elle les féconde, en les irriguant. Fallope avait eu le tort de croire que les trompes, découvertes par lui, étaient fermées; mais il avait reconnu son erreur, qui est manifeste en effet. Les œufs fécondés dans les ovaires sont reçus par l'extrémité des trompes, et ils descendent dans l'utérus, où l'embryon doit se nourrir et se développer, en plus ou moins de temps, selon les espèces et selon la durée de la gestation. Les trompes sont dans les femelles de vrais canaux déférents et des oviductes. De Graaf termine son ouvrage en décrivant minutieusement tous les développements successifs que l'œuf prend dans l'utérus, où il séjourne. C'est surtout sur des lapins qu'il faisait ses observations. On verra, par ce qui va suivre, combien le jeune médecin hollandais, mort à 32 ans, était près d'avoir vu la vérité tout entière; il en a CLII conquis du moins la partie essentielle. Il n'y a qu'un seul point, à ce qu'il semble, où il ait commis une faute d'observation, sur les traces de Van Horne. La vésicule n'est pas l'œuf; mais elle contient l'œuf, qu'elle enveloppe et qu'elle doit laisser sortir, au prix d'une cicatrice qui demeure empreinte sur l'intérieur de l'ovaire. A part cette restriction, le nom de do Graaf demeure attaché à la découverte de la vésicule, et selon toute justice, malgré les réclamations de l'envie. L'ouvrage de de Graaf avait paru en février 1672 à Delft. Swammerdam, médecin aussi, et, comme de Graaf, élève de Van Horne, se hâta de revendiquer la gloire de la découverte, pour leur maître commun et surtout pour lui-même. Il s'adresse au mois de mai 1672 à l'Académie royale de Londres, et il cherche à établir que ses travaux personnels remontent à quatre ou cinq ans plus haut. II a été, dit-il, le collaborateur de Van Horne, en ce sens que Van Horne faisait tous les frais des expériences, mais que c'était lui seul, Swammerdam, qui exécutait les travaux imaginés par lui personnellement. Pour prouver ses CLIII assertions, il reprend le programme du cours que faisait Van Horne, en 1668, sur les organes génitaux des deux sexes ; il commente chacun des articles de ce programme ; et, se défendant lui-même d'avoir été le plagiaire de Van Horne, il en accuse violemment de Graaf (de Graeff). De Graaf répondit non moins énergiquement, et il adressa sa défense à la Société royale de Londres, très peu de temps avant sa mort. (Partium genitalium defensio, societati regiœ dicata. La Haye, 1673). Ces revendications opposées auraient pu être décidées par l'intervention et le témoignage de Van Horne ; mais il était mort en 1670. Dans cette polémique, le dernier mot a été pour de Graaf, et l'histoire de la science ne connaît que lui. Swammerdam, mort lui-même assez jeune, s'est rendu célèbre à d'autres titres, et Boerhaave lui a fait l'honneur d'éditer sa « Biblia naturœ seu historia insectorum ». Son ouvrage sur la génération intitulé : « Miraculum naturae,sive uteri muliebris fabrica », a eu de nombreuses éditions. On peut dire encore, à la louange de Swammerdam , qu'il a inventé le procédé des CLIV injections, si utile dans les investigations anatomiques. Malpighi, médecin et naturaliste (1628-1694), professeur illustre aux Universités de Bologne, de Pise, de Messine et de Rome, a fait faire des progrès à la théorie de la génération, en étudiant, a l'aide du microscope, mieux qu'on ne l'avait fait avant lui, les évolutions du poussin dans l'œuf. Ses a Dissertationes de ovo incubato et de formation?, qu'il in ovo » sont de 1666 et de 1672. II y avait plus de trente ans qu'Harvey s'était appliqué au même sujet et dans la même intention, parce que les observations sur les œufs des oiseaux sont plus faciles que sur les ovaires humains. Malpighi note soigneusement, de six heures en six heures, tout ce qui se passe dans l'œuf, depuis qu'il est produit au dehors jusqu'à la naissance du poussin. Ce genre d'observations a été repris par la plupart des naturalistes, jusque de nos jours. Le procédé est excellent ; mais il faut toujours se rappeler que c'est Aristote, et peut-être Hippocrate, qui y a songé le premier. Nous ne voudrions pas exagérer le mérite de celte invention, qui se pré- CLV sentait tout naturellement à l'esprit des observateurs ; mais nous tenons à en laisser la gloire à qui elle appartient, c'est-à-dire, à l'Antiquité grecque, et au génie scientifique qu'elle a montré en ceci comme dans tout le reste. Malpighi s'est occupé de l'anatomie des plantes plus encore que de celle des animaux, et il a contribué à la découverte du sexe des végétaux. Descartes a composé un traité De la formation du fœtus (tome IV de ses Œuvres, édition Victor Cousin) ; mais, soit que, pressé par le temps, il n'ait pas pu y mettre la dernière main, soit que ces études ne fussent pas de celles qui l'intéressaient le plus, il n'a pas laissé de traces profondes en embryologie. Il accorde de la semence aux deux sexes ; et « les semences se mêlant l'une à l'autre se servent réciproquement de levain. » Il est persuadé que, « si l'on connaissait bien quelles sont toutes les parties de la semence de quelque espèce d'animal en particulier, par exemple, de l'homme, on pourrait déduire de cela seul, par des raisons entièrement mathématiques et certaines, toute la CLVI figure et conformation de chacun de ses membres; comme aussi réciproquement, en connaissant plusieurs particularités de cette conformation, on en peut déduire quelle est la semence. » Sur cette pente de la logique des mathématiciens, Descartes glisse aisément, sans paraître se douter qu'il manque à toutes les règles de sa propre méthode ; il donne au pur raisonnement beaucoup plus de place qu'il ne faut, dans une question qui doit surtout se résoudre par l'observation des faits. Il est bien probable que, si Descartes avait pu appliquer sa puissante intelligence à ce problème et y donner toute l'attention nécessaire, il aurait dépassé ses contemporains ; mais sa gloire impérissable est ailleurs. L'année 1677 est marquée par une découverte considérable et inattendue, celle des spermatozoïdes, dans la semence de tous les animaux mâles, et particulièrement dans la semence humaine. Qui a découvert les spermatozoïdes ? Est-ce Hartsoeker, le physicien hollandais? Est-ce Ham, élève de Leewenhoeck? Est-ce Leewenhoeck lui-même ? C'est à ce dernier que la découverte reste attribuée. Sauf les CLVII prétentions des amours-propres individuels, il importe assez peu de savoir à qui elle est due réellement. Quel qu'en soit l'auteur, c'est une des plus belles conquêtes de la science. Lee-wenhoeck (1632-1723), naturaliste et anatomiste, avait su se fabriquer personnellement des microscopes que sa dextérité avait rendus les meilleurs du monde. Un hasard, plutôt encore qu'une intention réfléchie, lui fit voir, un jour, dans la liqueur séminale, des êtres qui étaient doués, durant quelque temps du moins, d'un mouvement extraordinaire ; il les prit pour des animalcules, et il crut qu'ils étaient l'élément indispensable et essentiel de la génération. C'étaient, selon lui, les embryons apportés par le mâle, qui se développaient plus tard dans l'utérus. Ses lettres à la Société royale de Londres, dont il était membre, en font foi. Malgré les indications formelles que fournissaient déjà les travaux de de Graaf, il soutint que l'homme ne vient pas d'un œuf, ainsi que tant d'autres animaux, mais qu'il vient d'un animalcule. Par suite de cette première méprise, il fut entraîné à d'autres erreurs qui n'étaient pas moins graves. A l'en CLVIII croire, les ovaires n'étaient pas nécessaires k la génération; ils ne contenaient pas les œufs que l'imagination de quelques anatomistes prétendait y trouver ; et dans sa trentième lettre, qui est sa conclusion définitive, il résumait sa pensée en quelques mots: « Conceptio non fit per ovum. » Ainsi, la découverte ne servait aucunement à celui qui l'avait faite ; il ne la comprenait pas. Le phénomène était vrai, le fait était exact; mais le raisonnement était faux. On conçoit du reste d'où l'erreur était venue; elle était à peu près inévitable. Dès qu'on reconnaissait de véritables animalcules dans la semence, il était tout simple d'en conclure que l'être animé était introduit par le mille dans la femelle, et que la femelle n'avait plus qu'à nourrir le germe qu'elle recevait. [Opéra onmia, seu arcana naturœ détecta, édition de Leyde, 1721, quatre volumes in 4°, t. II et t. IV.) Un élève de Malpighi, Vallisneri, combattit les idées de Leewenhoeck et revint a celles de de Graaf, pour essayer de les porter encore plus loin. Professeur de médecine théorique CLIX a l'Université de Padoue, il avait débuté dans la science en reprenant les observations de Redi sur les insectes, et il s'était prononcé, non moins résolument que lui, contre la génération spontanée, bien qu'il fût aussi un grand partisan d'Aristote. Son principal ouvrage est l'Histoire de la génération de l'homme et des animaux, en italien. (Venise, 1721 et 1723, f° pp. 97 à 245.) Vallisneri examine les deux solutions données au problème : les animalcules de Leewenhoeck, dont il attribue la découverte à Hartsoeker, et même à Sténon, le médecin danois (1638-1687), et les œufs ou vésicules de de Graaf. Gomme on doutait encore à cette époque de la réalité des spermatozoïdes, il recommence toutes les observations antérieures, et il les confirme par son témoignage personnel. Les insectes spermatiques, ainsi qu'il les appelle, existent sans aucun doute ; mais quelle est leur véritable fonction ? Après de très longues discussions, qui ne sont pas toujours très régulières, Vallisneri conclut que le ver spermatique entre dans l'œuf de la femme et qu'il le féconde. Par l'œuf, il comprend toujours la vésicule de de Graaf, CLX et malgré les plus habiles dissections, il n'a jamais trouvé l'œuf proprement dit. Il en supposait l'existence, sans pouvoir la démontrer d'une manière irréfutable. Ce sont ces incertitudes qui ont donné à Buffon, l'occasion de railler Vallisneri, sur ces œufs prétendus, qu'il cherchait toujours et qu'il ne rencontrait jamais. La critique était assez juste; mais les hypothèses de Buffon,, égaré par l'esprit de système, ne valaient pas les conjectures de Vallisneri, qu'il n'estimait pas assez haut. Buffon, (1707-1788) s'est beaucoup occupé de la génération des animaux, et surtout de la génération de l'homme. Deux volumes de son histoire naturelle en sont remplis (tomes X et XI de l'édition de 1830). Il y combat tous les systèmes antérieurs, pour y substituer le sien. Jusqu'à quel point a-t-il réussi ? Ou plutôt, jusqu'à quel point a-t-il échoué? Nous le demanderons à un juge que personne ne récusera, à Cuvier, qui est le plus grand des naturalistes modernes, et qui a le droit de prononcer sur Buffon. Après avoir parlé avec éloge de la Théorie de la terre, Cuvier ajoute : « Le système de Buffon, sur les molécules or- CLXI ganiques et sur le moule intérieur pour expliquer la génération, outre l'obscurité et l'espèce de contradiction dans les termes qu'il présente, paraît directement réfuté par les observations modernes, et surtout par celles de Haller et de Spallanzani. Mais, son éloquent tableau du développement physique et moral de l'homme n'en est pas moins un très beau morceau de philosophie, digne d'être mis à côté de ce qu'on estime le plus dans le livre de Locke. » (Biographie universelle, article Buffon.) Pour apprécier Buffon, nous nous mettrons sous l'abri d'un jugement aussi compétent et aussi impartial. Avant d'en arriver à la génération des animaux, Buffon compare d'abord les végétaux et les animaux, comme Aristote l'avait fait souvent; puis, il traite de la reproduction en général, de la nutrition et du développement. Pour lui, les végétaux et les animaux sont des êtres de même ordre ; et la Nature semble avoir passé des uns aux autres par des nuances insensibles, descendant d'un animal qui nous paraît le plus parfait à celui qui l'est le moins ; et de celui-ci, au végétal. Les végétaux et les CLXII animaux ont une ressemblance qui est très essentielle, c'est la faculté de se reproduire. « Quelque admirable que soit l'organisation de l'animal et de la plante, ce n'est pas dans l'individu qu'est la plus grande merveille; c'est dans la succession, dans le renouvellement et dans la durée des espèces, où la Nature paraît tout à fait inconcevable. » Comme il y a des plantes et des animaux qui peuvent se reproduire par une simple division, et que chacune de leurs parties contient un tout qui, par le seul développement, peut devenir un animal ou une plante, Buffon en conclut que l'individu n'est qu'un assemblage de germes et d'individus de même espèce, lesquels peuvent tous se développer de la même façon et former de nouveaux touts constitués comme le premier. Les corps organisés sont composés d'autres corps organiques semblables, « Les parties primitives de ces corps sont organiques et semblables aussi. Nous discernons bien à l'œil leur quantité accumulée; mais nous ne pouvons apercevoir les parties primitives isolées que par le raisonnement et par l'analogie. » Il existe dans la Nature une CLXIII infinité de petits êtres organisés, semblables en tout aux grands êtres organisés qui figurent dans le monde ; et ces petits êtres sont « des particules organiques vivantes, qui sont communes aux végétaux et aux animaux ». La génération n'est donc qu'un changement de forme, qui se fait et s'opère par la seule réunion de ces molécules, de même que la destruction se fait par leur division. A ce premier principe des molécules organiques vivantes, Buffon enjoint un second. Ces molécules, indépendantes les unes des autres, se groupent cependant pour donner au corps des animaux des formes différentes, selon leurs espèces. La force qui les contraint à se grouper, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, c'est ce que Buffon appelle le moule intérieur, « dans lequel la matière qui sert à l'accroissement de l'animal se modèle et s'assimile au total. » Mais, ce n'est pas seulement le corps entier de l'animal qui est un moule; c'est chacune de ses parties intérieures, qui reçoivent la matière de leur développement particulier, dans l'ordre de leur position respective. La matière organique pénètre chacun de ces moules CLXIV intérieurs et s'incorpore intimement avec eux. C'est a l'aide de ces deux principes, molécules organiques et moule intérieur, que Buffon prétend dévoiler le mystère de la génération. D'ailleurs, il convient que ces deux forces, qu'il suppose il l'intérieur des corps, ne peuvent pas être accessibles à nos sens, et qu'elles échappent à toute observation. Mais, il se rassure en pensant à la force de la pesanteur, qui pénètre aussi l'intérieur de toute matière, et que nous n'apercevons pas davantage par l'observation sensible, bien que nous y croyions sans la moindre hésitation. C'est la nourriture qui apporte dans le corps les molécules organiques; et ces molécules se séparent de celles qui, n'étant pas organiques comme elles, sont rejetées par toutes les voies excrétoires. Au nom de ses deux principes, Buffon, n'hésite pas a blâmer Descartes, qui a voulu réduire l'explication de tous les phénomènes de la Nature à des principes purement mécaniques, et Aristote, « dont le défaut, dit-il, a été d'employer comme causes tous les effets particuliers ». Buffon, se flatte d'avoir, pour sa part, évité les CLXV écueils où ces deux grands hommes avaient échoué ; et sans le dire précisément, il semble bien croire que sa propre philosophie est « sans défaut », parce qu'aux principes reçus de la mécanique, il a joint d'autres forces pénétrantes qui s'exercent dans les corps organisés. Il va même jusqu'à affirmer que c'est l'expérience qui nous assure qu'il existe un nombre infini de particules organiques, et il s'imagine l'avoir démontré par des faits, bien plus encore que par le raisonnement. Cependant, Buffon, parti de la génération scissipare, se heurte à une difficulté. Il sent bien que sa théorie ne suffit plus, même avec ses deux principes, à expliquer la génération sexuelle, celle qui, cependant, nous intéresse le plus. Grâce à l'hypothèse des molécules organiques, chaque individu peut produire son semblable par une sorte de bouture ; cela se conçoit assez bien. Mais, comment deux individus, l'un mâle et l'autre femelle, en pro-duisent-ils un troisième, qui a constamment l'un ou l'autre de ces sexes, dont un au moins est opposé à celui des parents ? Au lieu de répondre à cette question embarrassante, Buffon CLXVI blâme les naturalistes, ses devanciers, de s'être occupés uniquement de la génération de l'homme et des animaux, sans faire attention aux autres modes de génération ; et par une contradiction flagrante, quoiqu'il ne semble pas s'en apercevoir, il s'attache lui-même exclusivement à la génération humaine, pour prouver que les molécules organiques, renvoyées de toutes les parties du corps, forment dans les deux sexes des liqueurs séminales, et que ces liqueurs ont besoin l'une de l'autre pour que les molécules organiques qu'elles contiennent puissent se réunir et former un animal. Les petits corps mouvants, dit-il, auxquels on a donné le nom d'animaux spermatiques, sont des corps organisés, provenant de l'individu qui les contient ; mais/d'eux-mêmes ils ne peuvent, ni se développer, ni rien produire. Quoique ceci soit vrai, Buffon, poussé par les exigences de son système, avance qu'il y a des animaux pareils, c'est-à-dire des animaux spermatiques, dans les femelles; ce qui est absolument contraire à l'observation. Par une autre nécessité non moins logique et non moins impérieuse, il ne voit dans les animaux CLXVII spermatiques que les molécules organiques vivantes dont il a parlé, et qui, selon lui, sont communes aux animaux et aux végétaux. Ce qu'il concéderait tout au plus, c'est que les animaux spermatiques sont « la première réunion des parties organiques vivantes ». Entre ces molécules, celles qui se conviennent le mieux dans l'un et l'autre sexe se confondent, et elles forment un nouveau petit corps organisé semblable à l'un et à l'autre des individus. Il ne manque plus à ce petit corps, ainsi formé, que le développement qui se fait ensuite dans la matrice de la femelle. Par une autre conséquence inévitable, Buffon est amené à soutenir que la femelle a de la liqueur séminale, tout aussi bien que le mâle ; et, s'appuyant sur un passage d'Aristote, qu'il n'interprète pas exactement, il critique les « physiciens » modernes qui, voulant expliquer la génération par les œufs ou par les animaux spermatiques, ont, avec les Anciens, refusé la liqueur séminale à la femelle. Il termine cette première partie de son exposition en s'efforçant de trouver, à l'appui de son système, de nombreuses raisons, tirées CLXVIII des analogies du développement et de la nutrition avec la reproduction, de l'engraissement des animaux coupés, de la ressemblance des enfants avec les parents, de la nature de la liqueur séminale selon les âges et selon les tempéraments, de l'époque du rut ou du frai dans les animaux, du nombre des maies plus grand que celui des femelles dans l'espèce humaine, etc. Trop satisfait de son système personnel, Buffon juge ensuite les autres systèmes ; et il passe successivement en revue les opinions de Platon, qu'il réprouve, celles d'Aristote, auxquelles il accorde un long examen, tout en les traitant d'absurdes, celles d'Hippocrate, qu'il place fort au-dessus, celles de Fabrice d'Aquapendente, auquel il attribue à tort d'avoir, le premier, fait des observations suivies sur les œufs de poule. Il passe légèrement sur Aldrovande, Coïter, Parisanus, médecin de Venise, et il s'arrête à Harvey, partisan de l'ovarisme et imitateur d'Aristote, à Malpiglii, qu'il appelle un excellent observateur et qu'il exalte aux dépens d'Harvey, à de Graaf, dont il semble faire beaucoup de cas, CLXIX tout en rapportant à Sténon la découverte des œufs dans les ovaires , à Vallisneri, qu'il étudie en détail, mais qui, tout habile qu'il était, a vainement cherché l'œuf auquel il croyait et qu'il n'a jamais pu voir. Bufîon, qui traite assez dédaigneusement tous ces systèmes sur les œufs, n'est pas plus favorable à celui des animaux spermatiques, découverts par Leewenhoeck, Hartsœker et Andry; il trouve que cette théorie n'est appuyée que sur des hypothèses dénuées de toute vraisemblance, « attendu qu'elle suppose le progrès à l'infini, lequel n'est qu'une illusion de l'esprit ». Buffon condamne donc les animaux spermatiques, comme il a condamné les œufs de de Graaf, et il donne la préférence à l'auteur inconnu de « la Vénus physique », à Méry, de l'Académie des sciences de Paris. «Voilà, à très peu près, dit-il en terminant sa critique, où en sont demeurés les anatomistes et les physiciens au sujet de la génération. Il me reste à exposer ce que mes propres recherches et mes expériences m'ont appris de nouveau ; on jugera si le CLXX système que j'ai donné n'approche pas infiniment plus de celui de la Nature qu'aucun de ceux dont je viens de rendre compte. » II faut reconnaître que Buffon s'est livré aux observations les plus attentives et les plus nombreuses ; mais, prévenu de ses propres idées, il ne pouvait tirer des expériences que ce qu'il y cherchait, c'est-à-dire, la confirmation de sa théorie sur les molécules organiques vivantes. D'accord avec Needham, qui l'aidait, il ne voit dans la semence du mule que des parties qui tendent à s'organiser, et il déclare que les prétendus animaux spermatiques ne sont pas des corps organisés semblables à l'individu qui les produit; « ce sont plutôt des espèces d'instruments qui servent à perfectionner la liqueur maie et a la pousser avec force, pour qu'elle pénètre plus intimement la liqueur de la femelle ». Enfin, après une comparaison étendue entre ses expériences et celles de Leewenhoeck, il conclut que presque tous les animaux microscopiques, infusoires, de diverses origines, anguilles de la farine, anguilles du blé ergoté, anguilles du vinaigre, anguilles de l'eau cor- CLIXI rompue, etc., sont de la même nature que les êtres organisés qui se meuvent dans les liqueurs séminales. Il va même au delà de ces assertions, déjà bien étranges, et ne croyant, ni à la préexistence des germes, ni à leur emboîtement, il finit par admettre une matière organique, universellement répandue dans toutes les substances végétales et animales, toujours active, toujours prête à se mouler, à s'assimiler et à produire des êtres semblables à ceux qui la reçoivent. Les espèces d'animaux et de végétaux ne peuvent donc jamais s'épuiser d'elles-mêmes; tant qu'il subsistera des individus, l'espèce sera toujours toute neuve; elle l'est autant aujourd'hui qu'elle l'était il y a trois mille ans ; elle continuera tant qu'elle ne sera pas anéantie par la volonté du créateur. Buffon a toute raison de se fier imperturbablement à la perpétuité des espèces ; mais, sur la manière d'expliquer cette perpétuité, proclamée dès longtemps par Aristote, il a com-misdes erreurs qu'on peut qualifier d'énormes, sans parler de la génération spontanée, à laquelle il croit toujours avec Needham, malgré CLXXII les démonstrations de Redi et de Malpighi. D'où peuvent venir ces aberrations d'un si grand esprit ? D'une seule cause, l'abus du raisonnement substitué à l'observation. Ce n'est pas que Buffon s'abstienne d'observer les phénomènes; loin de là, il s'y adonne avec une persévérance et une circonspection dignes de résultats meilleurs. Mais malheureusement, il a un système préconçu ; et l'amour-propre inconscient, auquel chacun de nous peut céder ainsi que lui, l'emporte sur tout le reste. En dépit des précédents les plus manifestes, il tourne le dosa la vérité, bien qu'il la cherche aussi sincèrement que qui que ce soit. Ses molécules organiques vivantes ne sont pas moins chimériques que les monades de Leibniz, dont elles semblent se rapprocher beaucoup. Buffon, d'ailleurs compense amplement cette faute par des considérations fort exactes sur les variétés dans la génération des animaux, sur la formation du fœtus, sur l'accouchement, sur l'embryon, sur les naissances tardives ou précoces, tous sujets déjà traités par Aristote ; et il couronne toutes ces théories par l'histoire naturelle de l'homme, à laquelle CLXXIII le grand Cuvier n'a pas ménagé son estime et son admiration. Avec Cuvier (1769-1832), qui s'est toujours gardé prudemment des conceptions à priori, nous revenons à la science véritable. Il n'a pas fait précisément d'embryologie, et il n'a pas de système sur la génération. Mais, mieux que personne, il a fait l'anatomie comparée des organes servant à cette fonction, dont l'objet est d'entretenir l'espèce et d'employer une portion de la vie de chaque individu, pendant qu'elle est à son plus haut période, pour développer d'autres individus qui le remplaceront un jour. La génération est le plus grand mystère que nous offre l'économie des corps vivants ; et Cuvier n'hésite pas à déclarer que la nature intime de la génération est encore couverte des ténèbres les plus absolues. Il se refuse à admettre que les corps vivants puissent se former de toutes pièces comme les cristaux, par la réunion des molécules rapprochées subitement, « en se collant les unes aux autres ». Dès que les corps vivants existent, ils ont déjà toutes leurs parties, quelque petits qu'ils soient; ils ne croissent CLXXIV point par l'addition de nouvelles couches, mais par un développement interne des parties, qui préexistent à toute croissance sensible. Une circonstance commune à toute génération, et la seule essentielle, c'est que chaque corps vivant tient, dès les premiers instants où il commence à être visible, à un corps plus grand de même espèce que lui, dont il fait partie, et par les sucs duquel il se nourrit pendant un certain temps. C'est sa séparation de ce corps plus grand qui constitue sa naissance. Ainsi réduite à sa simplicité essentielle, la génération est gemmipare, comme on le voit sur les plantes reproduites par bouture, et sur certains animaux inférieurs, les polypes et les actinies. Il n'y a dans ce mode de génération, ni sexe, ni accouplement, ni même aucun organe particulier. Au contraire, les autres modes de génération s'opèrent dans des organes spéciaux; et il faut le concours de certaines opérations des organes pour déterminer le développement ultérieur. Ces opérations constituent la fécondation, qui ne peut se faire que par des sexes, qui sont ou réunis ou séparés. Le sexe fécon- CLXXV dable, dans lequel le germe se manifeste, est le sexe femelle ; le sexe fécondant, dont le concours est nécessaire pour que le germe se développe complètement, est le sexe mâle. Le concours du sexe mâle se fait par une liqueur qui se nomme fécondante ou séminale. Cuvier laisse aux disputes des physiologistes le soin de chercher comment la liqueur séminale du mâle concourt au développement des germes, soit que les germes préexistent dans la femelle, soit que la liqueur mâle les y apporte, soit que cette liqueur ne fasse que les réveiller, en quelque sorte, de la léthargie dans laquelle ils seraient toujours restés sans elle. Ce sont là pour Cuvier autant de questions insolubles dans l'état actuel de nos connaissances ; et il conseille d'en abandonner la discussion, qui serait peu utile à la science. Pour lui, il s'attache à l'étude des quatre fonctions partielles et subordonnées dont la génération se compose : production du germe, qui a toujours lieu ; fécondation, qui n'a lieu que dans les générations sexuelles; accouplement, qui n'a lieu que dans les générations sexuelles où la fécondation se fait dans le CLXXVI corps; et enfin la grossesse ou gestation, qui n'a lieu que dans les générations vivipares. Pour ces quatre fonctions, il y a des organes producteurs et conservateurs, des organes d'accouplement et des organes éducateurs. Cuvier décrit successivement, avec les détails les plus précis, ces quatre espèces d'organes. L'appareil préparateur et conservateur est le plus compliqué; il se compose dans les maies des testicules, des vésicules séminales, des prostates et des glandes dites de Cowper. Ces organes sont considérés par Cuvier tour à tour dans l'homme, dans les mammifères, dans les oiseaux, dans les reptiles, dans les poissons. Les organes préparateurs et conservateurs des femelles sont les ovaires, tantôt doubles comme dans l'espèce humaine et les reptiles, tantôt simples comme dans les oiseaux. L'organe maie de l'accouplement est la verge simple, ou double aussi, avec ses nerfs, ses muscles et ses vaisseaux; l'organe femelle est le vagin, ou, dans certaines espèces, le cloaque. Les organes éducateurs, qui reçoivent le germe détaché de l'ovaire, sont, à l'intérieur, les trompes de l'utérus CLXXVII dites de Fallope dans les mammifères, les oviductes simples, ou doubles encore, dans les trois autres classes des vertébrés ; et l'utérus, qui, dans les mammifères, peut être unique, double, simple, ou même quadruple. A l'extérieur, les organes éducateurs sont les mamelles, en nombre variable pour la plupart des mammifères, et les poches pour quelques-uns d'entre eux. Après les vertébrés, Cuvier passe aux animaux sans vertèbres : les mollusques, où Ton trouve quatre combinaisons différentes d'organes; les vers, qui présentent à peu près les mêmes combinaisons ; les crustacés, où les organes intérieurs, ovaires et testicules, qui sont doubles ailleurs, sont quelquefois réunis en un seul ; les insectes, où les organes sont extérieurs et simples en général, placés à l'extrémité du corps; enfin, les échinodermes, qui sont hermaphrodites. Les zoophytes se multiplient par bourgeons et boutures. Ici s'arrête l'analyse de Cuvier, et il termine un peu brusquement ses recherches, par une trentième et dernière leçon, consacrée à l'histoire des sécrétions et des excrétions. Il s'ex- CLXXVIII cuse de ne pas suivre l'ordre naturel de ses idées, qui aurait du amener, après les organes de la génération, ceux qui appartiennent à l'embryon, au fœtus, à l'animal nouveau-né, et qui distinguent chacun de ces états de celui de l'adulte. Mais diverses circonstances l'ont déterminé, dit-il, à réserver ce travail pour un autre moment. Ces circonstances regrettables, que Cuvier ne nous indique pas plus précisément, nous ont privés de l'ouvrage complémentaire qu'il promettait, et qui n'a jamais paru. En 1824, M. J.-B. Dumas ;1800-1885), l'illustre chimiste, publia, dans le premier volume des Annales des sciences naturelles, le commencement d'un travail extrêmement remarquable qu'il intitulait: « Nouvelle théorie de la génération. » Il avait pour collaborateur J.-L. Prévost, médecin de Genève, déjà fort connu, et un peu plus âgé que lui. C'était une entreprise courageuse et très méritante, quoique le succès n'ait pas complètement répondu à la promesse que les deux savants faisaient au public. Ils n'ont pas découvert une théorie nouvelle de la génération ; mais, du moins, ils CLXXIX sont allés plus loin que leurs devanciers, et ils ont préparé, et peut-être même devancé, la grande et définitive découverte d'Ernest de Baër. Dumas ne se dissimule pas la difficulté de son entreprise ; et pour indiquer tout d'abord le résultat général qu'auront ses investigations, il ne balance pas à déclarer qu'Aristote est probablement le seul qui se soit jamais fait une notion judicieuse de la nature du phénomène de la génération. Dans la bouche d'un homme tel que J.-B. Dumas, au xixe siècle, c'est là une louange magnifique. Nous essaierons plus tard de faire voir qu'elle n'a rien d'excessif et qu'elle est parfaitement juste, sans doute même encore plus méritée que ne le supposait celui qui la décernait. Attaché, dès ses débuts, à des croyances qui sont restées celles de toute sa vie, Dumas distingue dans l'animal deux principes, l'un immatériel et l'autre corporel. Il n'est pas trop sévère pour la théorie de l'emboîtement des germes de Bonnet ; et, tout en n'y voyant qu'une hypothèse gratuite, il comprend l'approbation qu'elle a souvent reçue, parce que, « dans un phéno- CLXXX mène enveloppé du voile le plus épais, l'esprit humain conçoit une création d'un seul coup et faite une fois pour toutes, plus aisément qu'une activité continuelle, qui répugne à notre faiblesse. » Pour lui, il se propose uniquement d'observer les faits, sans risquer des conjectures périlleuses. La génération, réduite à sa plus simple expression, est le rapprochement d'un mâle et d'une femelle, et le contact de l'œuf et de la semence, comme l'a si bien établi Spallanzani. Il va donc étudier, d'abord la liqueur séminale, puis ensuite l'œuf, et définitivement leur rapport. Ses recherches embrasseront toute la série animale, mammifères, oiseaux, batraciens, reptiles, poissons, mollusques, insectes et zoophytes. En premier lieu, Dumas analyse les liquides renfermés dans les diverses glandes de l'appareil générateur, testicules, épididyme, canal déférent, vésicule séminale et prostate, questions éclaircies déjà par les beaux travaux de Cuvier. Il constate dans le testicule l'existence de certains êtres agités de mouvements spontanés, qui sont les animalcules sperma- CLXXXI tiques, découverts par Ham, Leewenhoeck et Hartsoeker. Ces animalcules sont le produit d'une véritable sécrétion. Tous les animaux pubères en possèdent; trop jeunes, ils n'en ont pas encore ; trop vieux, ils n'en ont plus. Les vésicules séminales et les vésicules accessoires ne fournissent jamais d'animaux spermatiques, parce que le testicule est le seul à pouvoir les sécréter. Le mouvement spontané des animalcules spermatiques tient à l'état physiologique de l'animal qui les fournit ; et ce caractère les distingue essentiellement des infusoires. Par des observations sur les batraciens, Dumas se convainc que la fécondation des œufs par la liqueur mâle ne peut avoir lieu tant qu'ils sont dans l'ovaire. C'est là un résultat fort important, pour expliquer la fécondation chez les mammifères; chez eux, le moment de la fécondation est toujours postérieur à celui de l'accouplement. Ici, Dumas remarque une circonstance qui avait échappé à presque tous les observateurs avant lui; c'est que les ovules trouvés dans les cornes de l'utérus, ou trompes de Fallope, sont toujours beaucoup plus petits que les vé- CLXXXII sicules de de Graaf dans l'utérus ; ils ont un ou deux millimètres au plus, tandis que les vésicules en ont sept ou huit. Puis, Dumas ajoute la phrase suivante, d'où l'on a pu conclure qu'il avait découvert le véritable œuf des mammifères, quelques années avant Ernest de Baër : « Il nous est arrivé deux fois, dit-il, en ouvrant des vésicules très avancées, de rencontrer dans leur intérieur un petit corps sphérique d'un millimètre de diamètre, moins transparent que les ovules a des cornes. » Dumas ne reconnaît pas que ce petit corps est l'œuf proprement dit des mammifères, et il se demande seulement quel rapport il existe entre les vésicules de l'ovaire et les ovules des cornes. On voit donc qu'il a été aussi près que possible de la découverte ; mais on ne peut pas dire qu'elle lui soit due. (Annales des Sciences naturelles, tome Il 1, p. 135.) Trois ans plus tard, en 1827, Dumas continuait encore ses investigations embryologiques, et le tome XII des Annales des Sciences naturelles contient ses longues expériences sur les œufs de poule. Il suit minutieusement CLXXXIII les évolutions de l'œuf de trois heures en trois heures, pendant toute l'incubation ; et il décrit les phénomènes successifs avec une exactitude qui surpasse encore celle de Mal-pighi, dont il fait le plus bel éloge. « Le cadre qu'a tracé Malpighi, dit-il, restera comme un monument glorieux de son génie observateur. » On peut renvoyer cette louange à Dumas lui-même; lui aussi a donné sans contredit « le tableau le plus élégant et le plus complet de l'incubation ». Il est regrettable que Dumas se soit arrêté dans cette voie ; s'il y eût persévéré, il s'y serait montré égal, et peut-être supérieur, à tous ses prédécesseurs. Il a plus tard consacré ses puissantes facultés à la chimie, à laquelle même il n'a pas toujours été fidèle. On ne saurait l'en blâmer, puisqu'il obéissait à sa vocation ; mais il a été perdu pour l'embryologie. Il est possible que la dissidence survenue entre lui et Prévost ait hâté sa décision, en séparant leurs travaux. Dumas lui-même a rendu compte de ce dissentiment, qui portait sur une théorie physiologique (Annales des Sciences naturelles, tome XII, pp. 443 et suiv., CLXXXIV 1827). Prévost combattait l'emboîtement des germes, auquel Dumas inclinait ; et il pensait que « le fœtus est le résultat de l'action que l'animalcule spermatique exerce sur le corps opaque de l'aire transparente (l'œuf dans la vésicule de de Graaf), ni l'un ni l'autre de ces agents ne formant une partie de l'être qui se crée; ils donnent seulement naissance au premier des actes successifs en vertu desquels cet être se produit. » Contre cette opinion, Dumas prétendait « que l'animalcule spermatique est le rudiment du système nerveux et que la lame membraneuse sur laquelle il s'implante (le placenta), fournit par les modifications qu'elle éprouve tous les autres organes du fœtus. » Ce dissentiment fit cesser la collaboration, qui cependant pouvait être encore bien féconde ; et Dumas abandonna l'histoire naturelle. On peut soupçonner aussi qu'en face des problèmes insolubles qu'elle présente à certains égards, son esprit s'était découragé ; car, dans cette même note où il réfute son ami, il ne cache pas que le doute s'est emparé de son intelligence, et il avoue, non sans quelque CLXXIV tristesse, que « le point fondamental de chaque chose nous échappe, et que, quand nous arrivons au nœud principal de la question, la vérité se dérobe tout d'un coup à nos efforts, qui ne servent plus qu'à attester notre impuissance. » Dans la controverse qui s'était élevée entre Dumas et Prévost, l'un et l'autre se trompaient, du moins en partie ; mais Prévost était plus près de la vérité, sans la posséder encore tout à fait. Le naturaliste qui la découvrit enfin, à peu près à la même époque où Prévost et Dumas travaillaient de concert, ce fut Ernest de Baër (1792-1876). Né sujet russe en Estonie, élève de Burdach, à Kœnigsberg, et professeur à cette université dès 1819, Baër, nommé membre de l'Académie de Saint-Pétersbourg, reconnut l'honneur qui lui était fait par une lettre assez concise qui avait pour sujet : « De ovi mammalium et hominis genesi. » Publiée à Leipsick et à Kœnisgberg, en 1827, elle fut traduite immédiatement du latin en français par G. Buschet, chef des travaux anatomiques à la Faculté de médecine de Paris. Ernest de Baër a composé encore d'autres CLXXXVI ouvrages d'histoire naturelle sur le développement des animaux en général, sur le développement particulier des poissons, sur les monstres à double corps, etc. Il a fait aussi plusieurs voyages scientifiques en Russie ; mais c'est sa lettre qui a fait seule sa renommée, et qui lui a valu, sur la fin de sa vie, l'honneur de devenir Associé étranger de notre académie des sciences. Après son remerciement à l'académie de Saint-Pétersbourg, de Baër lui communique sa découverte. « J'ai eu le bonheur, dit-il, de « trouver dans l'ovule les premiers rudiments « de l'œuf des mammifères et de l'homme, rudiments que l'on avait cherchés en vain, depuis tant de siècles. » De Baër cite Régnier de Graaf, qui a découvert les vésicules dans l'ovaire; Cruishank, qui a nié que les vésicules fussent des œufs, et Prévost et Dumas, qui ont pensé comme Cruishank. Dans le xviiie et le xixe siècles, personne n'a vu les ovules, si ce n'est peut-être un seul observateur, que Baër ne nomme pas. Pour lui, il a surtout opéré sur les ovules de chiennes ; et un jour, en ouvrant une vésicule, il y trouva CLXXXVII un point blanc-jaunâtre, qu'il mit sous le microscope : « Quelle ne fut pas ma surprise, dit Ernest de Baër, d'apercevoir que cet ovule était exactement semblable à ceux que j'avais t trouvés dans les trompes. » Il revit les ovules à l'œil nu, brillants à travers l'enveloppe de l'ovaire ; ces ovules de chiennes avaient de 1/20e à 1/50e de millimètre. La découverte était faite, il ne restait plus qu'à la justifier par quelques détails. De Baër reprend l'étude de la vésicule de de Graaf, et il montre qu'elle est composée de deux parties, qu'on peut appeler sa coquille et son noyau, c'est-à-dire, le tégument et la capsule intérieure. La capsule elle-même, c'est-à-dire l'œuf, a deux couches, l'une interne, l'autre externe. Le noyau est expulsé de la vésicule, et c'est alors une sorte de membrane granuleuse. De Baër se pose la question de savoir si c'est l'ovule qui existe avant la vésicule, ou si c'est la vésicule qui précède. Il croit pouvoir se prononcer pour l'antériorité des ovules, admise aujourd'hui par tous les naturalistes. Puis, il cherche à expliquer les corps jaunes de l'utérus ; mais il se trompe, CLXXXVIII comme on le verra, en supposant qu'ils viennent de l'accroissement pris par la couche interne de la capsule. L'œuf expulsé de l'ovaire est reçu par le pavillon de la trompe, et en y passant, il s'imbibe d'un mucus albumino-gé-latineux; mais c'est quand il est arrivé dans l'utérus qu'il s'accroît. Il y est entouré par des villosités, dont la matrice se garnit et qui le nourrissent. Ces faits étant bien établis, de Baër compare les œufs des mammifères à ceux des oiseaux, bien que les uns et les autres aient une conformation assez différente. Il attache une très haute importance à la thèse de Purkinjé, offerte à Blumenbach en 1825 pour son cinquantenaire (Symbolœ ad ovium historiam ante incubationem). Dans cette thèse, Purkinjé démontrait que, sous la membrane du vitellus dans l'ovaire des oiseaux, il y a une couche très mince de granules vitellines, formant cumulus ; et que c'est ce cumulus qui contient les rudiments de l'œuf ; il en est la première trace et c'est ce qu'on appelle la vésicule germinative des oiseaux. Le vitellus s'amasse tout autour. Cette vésicule germi- CLXXXIX native est détruite entre le vitellus et sa membrane, avant la fécondation. Elle remplit chez la femelle une fonction correspondante à celle de la liqueur séminale du mâle. Elle est le produit essentiel de l'organe générateur des femelles. De Baèr applique ces observations sur les oiseaux à l'ovulation des mammifères, et il prouve que la vésicule de de Graaf contient une autre vésicule plus petite, qui est le véritable rudiment de l'embryon fœtal. C'est un œuf dans un œuf; et de ce principe, il tire des conclusions très graves, au nombre de quatre. Tout animal venu du rapprochement d'un mâle et d'une femelle, sort d'un œuf et nullement d'une simple humeur plastique ; la liqueur mâle agit sur l'œuf à travers la cuticule dont il est revêtu, et qui n'est percée d'aucun trou ; les parties centrales de l'embryon se forment avant les parties périphériques ; enfin', le mode de l'évolution est le même pour tous les vertébrés, et elle commence par le rachis. Dans un commentaire qu'Ernest de Baër a joint à sa lettre, il est encore plus clair, s'il est possible ; il précise ses explications en les CXC développant. L'œuf des mammifères se forme dans la vésicule de de Graaf longtemps avant la fécondation ; c'est un globe vitellin avec une petite cavité. Il est entouré d'une membrane mince, qui prend plus tard une consistance analogue à la membrane de l'œuf des oiseaux. Après la fécondation, une membrane interne enveloppe l'œuf de toutes parts; mais la partie externe de cette membrane est plutôt corticale que testacée. Telle est la découverte d'Ernest de Baër, dans toute sa simplicité et dans toute sa grandeur. Elle lui a été contestée comme on pouvait s'y attendre; et Goste (1807-1873) a essayé d'en rapporter le mérite h Dumas et à Prévost. Dès 1824, il est vrai, ces deux savants avaient aperçu l'œuf, ainsi qu'on l'a dit un peu plus haut ; mais tout en le voyant, ils ne l'avaient pas reconnu, non plus que quelques autres observateurs, qui, avant eux, avaient été favorisés par un même hasard, sans en profiter davantage. Goste, en 1834-, publiait des Recherches sur la génération des mammifères et la formation des embryons; et en 1837, un traité d'em- CXCl bryogénie comparée. C'étaient ses leçons au Muséum d'histoire naturelle, recueillies par MM. Gabeet V. Meunier. Reprenant tous les travaux antérieurs, Coste crut qu'il fondait la science, comme si la science n'était pas fondée depuis Aristote. 11 attaque fréquemment Ernest de Baër, tout en lui empruntant ses principes; car il est obligé de se défendre lui-même contre des accusations de plagiat, qui ne lui furent pas épargnées. Elles étaient injustes ; mais Coste les provoquait par des prétentions démesurées. Il ne pillait pas ses devanciers ; mais il se servait de leurs labeurs pour faciliter les siens, chose toujours permise. Ce qui l'était moins, c'était de les dédaigner et de les critiquer trop vivement. Une chaire d'embryogénie comparée, la première de ce genre dans notre pays, était instituée pour Coste au Collège de France en 1835 ; et douze ans plus tard, il faisait paraître en deux volumes in-4° l'Histoire générale et particulière du développement des corps organisés. Les ouvrages de Coste n'ont rien ajouté à ce qu'on savait déjà, si ce n'est la présence de la vésicule germinative chez les mammifères, CXCII tout a fait analogue à celle que Purkinjé avait signalée chez les oiseaux ; mais ils ont contribué à vulgariser la science, et ils ont même éclairci quelques points encore douteux de la théorie. Sur la fin de sa vie, Goste s'est livré presque entièrement à la pisciculture, dont il a rendu la pratique assez populaire, sans l'avoir inventée non plus que l'embryogénie. Les travaux de M. F. A. Pouchet (1800-1872) ont été bien autrement sérieux. Professeur au Muséum d'histoire naturelle de Rouen, il obtenait en 1842 le grand prix de physiologie expérimentale de notre Académie des sciences; et deux ans après, il publiait le mémoire couronné : « Théorie positive de l'ovulation spontanée et de la fécondation des mammifères et de l'espèce humaine, basée sur l'organisation de toute la série animale. » Nous nous arrêtons à cet ouvrage, et nous laissons de côté la célèbre controverse que M. F. A. Pouchet engagea avec M. Pasteur sur la génération spontanée, nous en tenant à ce que nous en avons dit plus haut. Pouchet fait remonter ses études et ses découvertes à CXCIII 1835 ; et s'appuyant, dit-il, sur l'observation, l'expérience et la logique, il veut démontrer les trois lois suivantes : Les ovules, dans les mammifères et dans l'espèce humaine, sont engendrés et expulsés spontanément et indépendamment du rapprochement sexuel ; l'ovulation spontanée se produit à des époques déterminées ; la fécondation n'a lieu que par la présence du fluide séminal. A ces trois axiomes, M. F. A. Pouchet joint dix lois physiologiques qui en sont la suite, et qui sont également positives : L'espèce humaine et les mammifères sont soumis aux mêmes lois que tous les autres animaux ; La fécondation a lieu sur des œufs préexistants ; Le fluide séminal ne peut toucher les ovules qui sont dans les vésicules de de Graaf. Les ovules se développent dans l'ovaire et s'en détachent ; L'ovaire dans toute la série animale émet les ovules ; L'émission des ovules a lieu à certaines époques fixes ; CXCIV Celte émission des ovules doit coïncider avec l'émission du fluide séminal ; La menstruation est une sorte de rut; La fécondation est en un rapport constant avec la menstruation ; Enfin, l'ovule et le fluide séminal qui le féconde, se rencontrent dans l'utérus, ou dans la région des trompes qui l'avoisine. Chacune de ces dix lois secondaires sont discutées dans leur ordre ; l'auteur les expose en détail ; et il les appuie, comme il le dit, de preuves directes et de preuves rationnelles, fidèle en cela, sans le savoir, à la méthode qu'Aristote avait tant recommandée : observer d'abord les faits, et les expliquer par le raisonnement réfléchi et prudent, loin de toute hypothèse. Le seul tort des formules de F.-A. Pouchet, c'est une symétrie un peu trop rigoureuse, qui touche au pédantisme. La Nature n'est pas uniforme à ce point ; elle a des allures plus libres, et l'on ne peut pas la décrire en la soumettant à celles des mathématiques. Cette recherche de la précision géométrique n'a pas môme produit, entre les mains de l'auteur, tous les résultats qu'il en attendait. CXCV Son livre, quoique bien composé, est prolixe ; et la personnalité de celui qui l'écrit y tient trop de place. Du reste, Pouchet s'est occupé des spermatozoïdes plus qu'on ne l'avait fait avant lui. Il croit pouvoir en rapporter la découverte à Louis Gardin, médecin de l'université de Douai en 1623 ; Ham et Leewenhoeck n'auraient fait, en 1677, que les retrouver. Il soutient avec énergie que ce sont des animaux véritables, qui s'engendrent d'une manière toute spéciale; et il va jusqu'à leur accorder « une volonté non douteuse ». Ce que peut être une volonté dans ces êtres microscopiques, il serait bien difficile de le prouver; et Pouchet devait d'autant moins insister que plusieurs naturalistes, tels que Dumas, Lallemand, le célèbre professeur de Montpellier, avaient contesté victorieusement qu'il y eût là les signes essentiels et ordinaires de l'animalité. Duvernoy, un des collaborateurs de Cuvier et le rédacteur de la seconde édition de l'Anatomie comparée, avait proposé le nom de Spermatozoïdes, qui, du moins, ne tranche pas la question, et qui répond bien mieux à la réa- CXCVI lité. Les spermatozoïdes sont des apparences d'animaux, ce ne sont pas des animaux proprement dits. (Anatomie comparée de Cuvier, 2e édition, tome VIII, p. ix de la préface et p. 143.) Le mot de Spermatozoïdes est aujourd'hui adopté généralement, quoique Pouchet ait soutenu que « le sens intime, l'observation, l'expérience et le raisonnement nous crient à la fois que ce ne peuvent être que des animaux ». M. Longet (1811-1871) a étudié profondément la génération dans son Traité de physiologie (2e édition, tome II, pp. 688 et suiv. 1860); et s'il n'a pas fait de découvertes, il a exposé les faits déjà connus avec une lucidité rare. Il a essayé aussi de retracer l'histoire du passé; mais il ne possédait pas une érudition suffisante, et il s'est trompé en déclarant que les théories d'Hippocrate et d'Aristote ne méritent aucun intérêt. Pour Hippocrate, c'est déjà un jugement par trop sommaire; mais pour Aristote, la condamnation est d'une frappante injustice, bien que M. Longet le loue aussi quelquefois, sans crainte de se contredire. L'analyse que nous avons CXCVII faite plus haut du système d'Aristote prouve jusqu'à la dernière évidence qu'il offre au contraire un intérêt incomparable, à la fois parce qu'il est chronologiquement le premier, et, en outre, parce que le nombre des observations exactes y est déjà énorme. La science y trouve son solide fondement. Longet est plus équitable pour Ernest de Baër, Purkinjé, Coste, qu'il connaît davantage. Il fait à chacun d'eux une part légitime, de même qu'il en fait une très belle à de Graaf. Il le loue surtout d'avoir observé les corps jaunes, qu'on a reconnus, plus tard, pour la marque des cicatrices que les vésicules ont laissées sur l'ovaire, en s'ouvrant pour donner passage à l'œuf. Baër a démontré que les œufs préexistent dans l'ovaire avant la conception, et Coste a démontré qu'à l'époque du rut les œufs tombent de l'ovaire spontanément. Négrier, Pouchet, Bischoff ont fait aussi avancer la question en constatant que, dans l'espèce humaine, les œufs tombent à chaque menstruation. Ils se détachent alors d'eux-mêmes, et n'ont pas besoin pour accomplir cette évolution du rapprochement sexuel. CXCVIII Le phénomène auquel Longet a donné le plus d'attention, c'est la liqueur séminale, c'est-à-dire, l'élément mâle delà reproduction. Cette liqueur est formée exclusivement dans le testicule. Les vésicules séminales, la prostate, les glandes de Cowper ont des sécrétions qui existent aussi dans celle de l'éjaculation; mais le seul fluide fécondant est celui que les testicules produisent, et les corpuscules mouvants qu'ils renferment sont la cause réelle de la fécondation. Aussi, Longet adopte-t-il le mot de Spermatozoïdes, proposé par Duvernoy; et ainsi que lui, il pense que les corpuscules mouvants, n'ayant ni organisation, ni nutrition, ni reproduction, ne peuvent pas être de véritables animaux, et que, sur ce point, Leewenhoeck, Hartsoeker, Haller ne se sont pas moins trompés que Bufîon, qui croyait y trouver ses molécules organiques. Quand les spermatozoïdes ont perdu leur mouvement, ils ne sont plus fécondants; mais pour l'être, il faut qu'ils entrent en contact avec l'œuf. Jusqu'où va précisément ce contact? Est-il purement extérieur à l'œuf? Les spermatozoïdes entrent-ils dans l'intérieur de CLCIX l'œuf? Ou s'arrêtent-ils à l'enveloppe immédiate de l'ovule ? Ce sont là des questions que Longet se pose plutôt qu'il ne les résout, parce qu'elles sont en effet presque insolubles. Ce qui est certain, c'est que la fécondation résulte nécessairement de la fusion intime de l'élément mâle avec l'élément femelle. Il paraît certain également que le sexe réside déjà dans l'œuf fécondé, et que l'influence des parents, auteurs d'une première fécondation, se fait sentir sur les produits ultérieurs dus à d'autres pères, et spécialement par la ressemblance. Autre question non moins obscure et non moins importante. Dans quel lieu la fécondation s'opère-t-elle ? Est-ce dans l'ovaire lui-même, ainsi que Coste l'affirme? Est-ce à l'extrémité du pavillon ? Ou dans une portion des trompes, par exemple, dans leur quart supérieur? Longet n'ose pas se prononcer; mais si l'on ne sait pas exactement comment la liqueur mâle arrive à l'intérieur de l'œuf, malgré sa paroi résistante, Longet regarde comme incontestable la présence des spermatozoïdes dans l'ovule. Les embryologistes les plus éclairés ne sont pas d'accord sur ce point ca- CC pital. L'auteur n'y insiste pas non plus; et il s'attache de préférence à marquer minutieusement toutes les phases du développement de l'embryon ; il les suit avec la plus vive attention ; et comme il est impossible d'en observer les premiers indices sur l'espèce humaine, c'est surtout l'œuf des oiseaux et celui des mammifères quadrupèdes qu'il étudie. Dans l'œuf sorti de la vésicule de de Graaf, on peut distinguer trois parties, la membrane vitelline, le vitellus et la tache germinative, qui s'efface quand l'œuf a quitté l'ovaire. Le premier phénomène qu'on observe, c'est la segmentation du vitellus, se divisant d'abord en deux parties presque égales. Ces deux segmentations initiales se subdivisent elles-mêmes en plusieurs sphères granuleuses et organiques. Dans les oiseaux, la cicatricule est la partie germinative de l'œuf; mais dans les mammifères, l'œuf tout entier est en quelque sorte cicatricule ; il n'a pas de jaune qui lui serve d'aliment, et il doit se nourrir aux dépens d'un autre, c'est-à-dire, de la mère. Le blastoderme, qui est destiné a former l'embryon, se produit dans la partie interne de la CCI membrane vitelline; c'est la tache embryonnaire de Coste. Les huit premiers jours du développement dans l'utérus échappent à peu près entièrement à l'observation. Mais, passé ce temps, on voit le blastoderme se diviser par une ligne longitudinale, autour de laquelle viendront se grouper tous les développements ultérieurs. L'œuf se fixe à la muqueuse utérine par les ramifications de la membrane vitelline; et les deux feuillets interne et externe du blastoderme, se rejoignant, font la poche nommée amnios, qui est destinée à protéger l'embryon par le liquide accumulé dans sa cavité. Longet décrit successivement la vésicule ombilicale, organe transitoire qui ne dure pas plus de six semaines, l'allantoïde, autre vésicule qui sert à l'absorption des sucs nutritifs, les chorions, qui sont la membrane la plus extérieure de l'œuf, et dont le troisième subsiste jusqu'à la fin de la gestation, le placenta, le cordon ombilical, la membrane caduque, qui est la membrane hypertrophiée de l'utérus et qui disparaît vers le quatrième mois, etc., etc. Suivant Longet, c'est le sys- CCII tème nerveux central qui se forme le premier dans l'embryon. Le cerveau paraît d'abord avec les méninges, la moelle épinière, et les nerfs provenant de l'axe cérébro-spinal. Puis, viennent les organes des sens, l'œil, l'oreille interne, les systèmes osseux, musculaire et tégumentaire, le crâne, la bouche et la face, le pharynx, l'hyoïde, le poumon, les membres, la peau avec les poils, les parties génitales externes et internes, la vessie, la muqueuse intestinale, le tube digestif, le foie, le pancréas, la rate, le mésentère, le système vasculaire, les trois phases de la circulation fœtale, phases si bien décrites plus tard par M. le docteur Martin-Saint Ange, qui a été plusieurs fois lauréat de l'Académie des sciences. Après avoir accompagné le fœtus jusqu'à sa naissance, et l'homme une fois né, jusqu'à sa mort, à travers la jeunesse, la virilité et la vieillesse, Longet se résume; et entre les théories sur la génération, dont le nombre, suivant son calcul, est au moins de 300, il se prononce contre l'emboîtement des germes, et pour l'épigénèse, c'est-à-dire, pour le développement postérieur du germe. Frappé du CCIII spectacle que l'anatomie la plus avancée et la plus habile a mis sous ses yeux, Longet, en finissant son étude, est saisi d'un enthousiasme semblable à celui d'Aristote ; et il n'hésite pas à voir dans cette succession de phénomènes si régulièrement enchaînés les uns aux autres, « une prévision aussi admirable que mystérieuse ». Il y reconnaît une merveilleuse unité de plan, et « l'homme à l'âge viril lui semble l'œuvre accomplie du Créateur ». Il est bon de signaler ces opinions de Longet; ce sont les vraies ; elles sont le résultat le plus général et la conclusion manifeste que la raison impose à la science ; mais par bien des motifs plus ou moins puissants, la science se révolte souvent contre la raison, qui n'est pourtant que la confirmation réfléchie de tous les instincts de l'esprit humain. Ce sont là aussi les convictions bien arrêtées de Grimaud de Gaux (1799-1884) qui, en 1837, publiait un ouvrage étendu sur l'anatomie et la physiologie de la génération. Grimaud de Gaux n'apportait pas de faits nouveaux ; mais il contribuait, après bien d'autres, à vulgariser la science. Les planches qui étaient jointes à CCIV son ouvrage étaient dessinées d'après nature avec un talent supérieur et la plus parfaite exactitude par M. le docteur Martin-St Ange, qui, tout récemment encore (1885>), vient de publier une Iconographie pathologique de l'œuf humain fécondé, composée de planches excellentes, et précédée d'une très savante introduction sur l'évolution physiologique de l'œuf humain, avant et après la fécondation. Nous terminerons cette revue rapide des travaux modernes par ceux de M. Henri Milne Edwards. Nous ne voulons parler ici que des auteurs qui sont morts, quoique nous pussions nommer parmi les contemporains bien des représentants très autorisés de l'embryologie. Mais nous devons nous borner, parce qu'il est toujours plus sur de juger les ouvrages définitifs d'auteurs qui sont entrés dans l'histoire, après une vie laborieuse. M. Henri Milne Edwards (1800-1885), mort l'année dernière, a travaillé trente ans à son grand ouvrage, qui n'a pas moins de quatorze volumes in-8, et qui traite de l'Anatomie et de la physiologie comparée de l'homme et des animaux. C'est le résumé de ses leçons, CCV toutes rédigées par lui-même. Commencé en 1855, l'ouvrage était achevé peu de temps avant que l'auteur ne cessât de vivre. Rien de plus complet n'a jamais été fait sur ce vaste sujet; jamais on n'y a porté plus d'ordre ni plus de clarté. Non seulement toutes les parties de la science y sont exposées avec une haute compétence; mais en outre, l'histoire de chacune des théories y est rappelée, dans des notes étendues, où l'exactitude de l'érudition est égale à l'impartialité des jugements. On peut dire de cet ouvrage, parfaitement bien composé, que c'est l'encyclopédie physiologique du xixe siècle. Pour le moment, il est le dernier mot de la science, et l'ensemble lumineux de tout ce que nous savons sur l'organisation de l'homme et des êtres animés. L'avenir portera ses connaissances plus loin ; mais les nôtres aujourd'hui ne vont que jusque-là. Henri Milne Edwards reprend d'abord la question delà génération spontanée (71eleçon, tome VIII, pp. 237 et suiv.), et il se prononce contre cette théorie, dont la fausseté avait été démontrée de nouveau par la discussion qui CCVI s'était élevée entre Pouchet et M. Pasteur. Mais H. Milne Edwards, tout en condamnant l'erreur, conçoit très bien qu'elle avait dû se produire dans l'Antiquité. En face de faits, qui étaient alors inexplicables, faute d'instruments pour aider notre infirmité naturelle, on s'était dit que certains animaux naissaient sans parents. C'était le moindre nombre; mais cette lacune suffisait pour qu'à côté des animaux venant d'homogénie, on en supposât d'autres dont la naissance ignorée était due à la rencontre fortuite de circonstances diverses, entre autres, la putréfaction et la chaleur. Il est vrai qu'après Redi, Vallisneri, Swammerdam, Leewenhoeck, et Spallanzani, la méprise était moins excusable. Cependant les infusoires des ferments pouvaient donner occasion de reprendre la vieille théorie avec quelque apparence de raison ; et c'est sans doute une secrète influence de ce genre qui avait poussé Buffon à imaginer ses molécules organiques vivantes; ce système était bien près de l'hétérogénie des Anciens. Henri Milne Edwards le détruit définitivement, et il regarde comme indiscutable désormais cette loi gêné- CCVII rale : « C'est le vivant qui produit le vivant » ; la perpétuité de l'espèce se maintient par la reproduction des individus. Quelle est l'origine de la vie ? Comment a-t-elle commencé ? Henri Milne Edwards est trop prudent pour rien hasarder sur ce problème ardu, qui en effet n'est plus scientifique, et qui regarde plus spécialement la philosophie. La science n'a pas à rechercher d'où vient la vie; elle n'a qu'à s'enquérir des moyens qui l'entretiennent et qui la transmettent. Le mode de la génération dans la totalité des êtres vivants est triple : scissiparité, ou fractionnement du corps de l'individu-souche, comme sont les vers et aussi les polypes d'eau-douce; gemmiparité, ou bourgeonnement devenant tout pareil au corps sur lequel il se forme ; en troisième et dernier lieu, oviparité, qui peut s'appliquer à la graine des plantes, tout autant qu'à l'œuf des animaux. Il y a des animaux, tels que les spongiaires et les hydres, qui ont des œufs dans toutes les parties de leur corps ; mais dans la majorité des cas, il y a pour les vésicules reproductives un organe spécial, qui est l'ovaire. L'œuf a toujours be- CCVIII soin d'un excitateur qui le féconde ; et cet excitateur est la liqueur séminale, qui vient le plus généralement d'un être de sexe différent; parfois, les deux sexes sont réunis dans un même individu, qui est hermaphrodite ; mais c'est le cas le moins fréquent. La génération sexuelle a lieu dans presque toutes les espèces, et elle est de beaucoup la plus intéressante, puisque c'est la nôtre. H. Milne Edwards remarque avec raison que l'exemple des oiseaux et des poissons est frappant ; et qu'il aurait dû servir dès longtemps à faire comprendre nettement les rapports des deux sexes dans l'acte de la reproduction. Dans les poissons et dans les oiseaux, la semence n'a besoin que d'entourer l'œuf pour le féconder; elle n'y entre pas. Cette réflexion est très juste; mais on a pu voir, un peu plus haut, qu'elle n'avait pas échappé tout à fait à Aristote, et que lui aussi avait pensé que tous les animaux pouvaient bien se féconder, dans la réunion des deux sexes, de la même manière que les poissons fécondent leurs œufs, en répandant leur laite, dont le simple contact suffît pour la transmission de CCIX la vie. H. Milne Edwards ajoute que la fécon-dation artificielle des poissons, qui a été renouvelée de notre temps, avait été pratiquée dès 1763, et que Spallanzani l'avait amplement décrite dans plusieurs de ses ouvrages, en 1777,1780 et 1786.Il est même assez probable que l'Antiquité a connu ce procédé. On peut donc généraliser la formule du phénomène, et affirmer que la reproduction n'est possible, que si la semence du mâle touche les œufs de la femelle. La partie essentielle et exclusivement fécondante de la liqueur séminale, ce sont les spermatozoïdes, dont H. Milne Edwards rapporte la première découverte à Ham, l'élève de Leeuwenhoeck (1677j. 11 y a des spermatozoïdes dans le règne animal tout entier, et ils se ressemblent dans toute la série, vertébrés et invertébrés ; les vers eux-mêmes et les zoophytes en ont, tout aussi bien" que les quadrupèdes et l'homme. En 1846, Kœlliker prouvait qu'ils sont issus de vésicules, ou cellules, qui les contiennent. Mais malgré les études les plus scrupuleuses, on ne sait encore rien de la structure intérieure des spermatozoïdes; CCX on ne connaît que leurs formes et leurs mouvements, qui sont toujours dirigés en avant. Gomme c'est en eux que réside la puissance de fécondation, à certaines époques de la vie et même à certaines saisons de l'année, ils manquent dans l'enfance et dans la vieillesse ; ils manquent également chez les hybrides, et notamment chez le mulet. Il faut plusieurs spermatozoïdes sur chaque œuf pour que la fécondation se produise. Il est démontré qu'ils pénètrent jusqu'à la masse vitelline et jusqu'au vitellus, peut-être encore plus loin, sans qu'il soit certain qu'ils entrent dans l'œuf lui-même. A ces généralités applicables h toutes les espèces, H. Milne Edwards fait succéder la description détaillée de l'appareil reproducteur, qui, aux divers échelons de l'animalité, se perfectionne sans cesse, depuis les hydres, où il est le plus informe, jusqu'à l'homme, où il est aussi complet que possible : ovaires et testicules, avec l'oviducte et le canal déférent. Au plus bas degré, on trouve l'hermaphrodisme, soit simple comme chez les échinodermes, les holothuries synaptes, soit double CCXI comme chez les colimaçons. L'appareil femelle est tout aussi diversifié que l'appareil mâle ; il est exclusivement destiné à nourrir l'œuf. Les abeilles et les fourmis, les pucerons du rosier et d'autres insectes offrent les phénomènes les plus étranges ; mais quelques différences qu'on puisse surprendre dans l'espèce de la reproduction, le tout se réduit uniformément à des corpuscules spermatiques d'une part, et, d'autre part, à une matière germinative. D'ailleurs, H. Milne-Edwards repousse la théorie de l'évolution, qui suppose que le germe a déjà toutes les parties intégrantes de l'animal, et il adopte la théorie de l'épigénèse, qui n'admet le développement ultérieur que grâce aux éléments nutritifs fournis par la mère. Ce sont des couches successives de matière plastique, qui forment peu à peu tous les membres de l'embryon, dont le premier vestige se montre dans le cumulus du globe vitellin. L'auteur parcourt donc toutes les variétés de l'appareil générateur chez les vertébrés ; il commence par l'amphioxus, qui est le moins CCXII perfectionné des poissons et qui est à peine un vertébré. De l'amphioxus, il passe aux lamproies et aux anguilles, aux poissons osseux, aux plagiostomes, aux lophobranches, aux batraciens, aux reptiles, ophidiens et sauriens, aux oiseaux dont l'appareil ressemble à celui des reptiles ; et il en arrive aux mammifères, auxquels il s'arrête longuement, parce que chez eux les organes de la reproduction sont les plus perfectionnés. Appareil mâle, appareil femelle, avec toutes les variétés que l'analyse anatomique y a constatées, et avec les explications qu'exige la fonction spéciale de chacune des parties, l'auteur n'a rien omis. En jugeant les travaux d'Harvey, de de Graaf, de Prévost et Dumas, d'Ernest de Baër, il y ajoute les siens, qui les résument et les complètent. Il applique la même méthode à l'alimentation des nouveau-nés, aux glandes mammaires, qui vont se perfectionnant aussi depuis l'échidné et les cétacés jusqu'aux mammifères supérieurs. Les mamelles, toujours en nombre pair, sont au moins deux; les ruminants en ont quatre ; de plus petits mammifères en ont de six à quatorze. Le lait, que sécrètent CCXIII les mamelles, et qui chimiquement ressemble au jaune de l'œuf, est l'aliment parfait, contenant de la caséine, qui est azotée, du sucre, de la matière grasse analogue au beurre. Le lait le plus riche est celui de la brebis. Le lait subit toutes les influences de l'alimentation de la mère, de sa santé et du climat où elle vit. Après les vertébrés, H. Milne Edwards étudie les invertébrés, les annelés d'abord ; de là, il passe aux insectes, en s'arrêtant aux abeilles, chez lesquelles la reine seule est apte à la reproduction. Les faux bourdons sont les mâles, et les abeilles ouvrières sont neutres. Il y a des espèces d'insectes où la femelle ne s'accouple qu'une fois dans sa vie ; elle emmagasine la liqueur séminale qu'elle reçoit, et elle en arrose successivement les œufs qu'elle pond, pendant des mois et même pendant des années, sans interruption. Aux abeilles et aux guêpes, succèdent les myriapodes, les chilo-gnathes, les arachnides, les crustacés, les lombrics de terre, les hirudinés, puis les mollusques, dont beaucoup sont hermaphrodites, et enfin les zoophytes, échinodermes, oursins, astéries, holothuries, qui ont des sexes CCXIV séparés avec des organes très ressemblants ; coralliaires qui sont fissipares et gemmipares ; enfin, les infusoires, qui ont aussi des organes sexuels, et les spongiaires, qui n'en ont pas, et qui produisent dans leur tissu sar-codique des embryons ciliés. L'embryon une fois produit, combien de temps met-il à se développer selon les différentes espèces ? S'attachant surtout à l'œuf des oiseaux, observé depuis Fabrice d'Aquapen-dente, on devrait dire depuis Aristote, jusqu'à Prévost et Dumas et Ernest de Baër, Milne Edwards répond que l'incubation est de douze jours chez les oiseaux-mouches, et de soixante-cinq chez le casoar. Dans les vertébrés quadrupèdes, la gestation est de trois semaines pour la souris, et de deux années pour l'éléphant. Pour l'espèce humaine, la gestation ordinaire est de quarante semaines. Reprenant toutes les recherches antérieures, H. Milne Edwards expose, avec la dernière précision, le développement progressif de l'embryon, dans l'œuf de la poule et dans l'œuf des vertébrés, où ce développement est très différent de ce qu'il est chez les invertébrés et chez les in- CCXV sectes. En ceci, il n'y a rien de cette unité de plan que plusieurs naturalistes ont voulu imposer à la Nature. Pour les vertébrés, c'est le cœur qui est le premier organe à se montrer ; dans le poulet, il bat dès le second jour. Le cordon ombilical dans le fœtus humain est constitué vers la fin du premier mois, pour servir d'intermédiaire entre le fœtus et le placenta, organe tout à la fois de nutrition et de respiration. Les poumons se développent presque en même temps que le foie; l'appareil circulatoire et l'appareil urinaire, avec les organes génitaux, ne se forment qu'à la suite. Tout le mécanisme intérieur étant constitué, la Nature le revêt de parties qui le protègent au dehors. C'est le système cutané, derme, épiderme, peau, poils, pigments, ongles, plaques osseuses, plumes des oiseaux, téguments des reptiles, écaille des poissons, écussons osseux chez quelques vertébrés. Chez les invertébrés, ce sont les téguments divers des infusoires, des corailliaires, des spongiaires, des échinodermes, des mollusques, des coquilles, des vers, des annelés, des crustacés, etc., etc. CCXVI Ici, se termine l'ouvrage de Henri Milne Ed-wards. Nous ne pousserons pas plus loin la revue des travaux contemporains. Parvenus à la limite extrême de la science actuelle, nous pourrons mieux comparer ce que nous savons à cette heure avec ce que savait Aristote. Par là, nous irons du point de départ au point d'arrivée, embrassant d'un coup d'œil ce qui a été fait, et concevant pour l'avenir des espérances plus justifiées. Nous l'avons déjà dit ; mais nous croyons devoir le répéter : Aristote est le fondateur de l'embryologie. Si notre siècle est plus savant que lui, essentiellement la différence est fort petite. Le domaine qu'Aristote assignait à l'étude de la génération n'a point changé. Il s'agit toujours pour nous, comme pour lui, de connaître les moyens que la Nature emploie presque indéfiniment pour atteindre le but unique qu'elle poursuit, dans toute l'animalité : à savoir, la perpétuité indéfectible de l'espèce, par la reproduction des individus. Les faits brillamment accumulés depuis trois siècles, de Vésale à H. Milne Edwards, sont excessivement nombreux, et ils tendent à se multiplier CCXVII encore; mais ils rentrent tous, sans aucune exception, dans le cadre fixé depuis plus de deux mille ans. L'observation découvre sans cesse des faits nouveaux, qui s'ajoutent aux précédents et accroissent le trésor commun. Mais les faits observés déjà par Aristote, quoique moins abondants, sont exacts, et ils sont acquis définitivement à la curiosité de la raison humaine. Nous avons enrichi le patrimoine reçu de nos prédécesseurs ; nous n'en avons pas modifié la nature. Si nous voulons même être impartiaux et reconnaissants, nous devons avouer que la quantité des faits constatés par le naturaliste grec est prodigieuse, et notre étonnement doit au moins égaler notre gratitude. Un second aveu, qui ne doit pas nous coûter plus que celui-là, c'est que la méthode d'observation est, comme on peut le voir, pratiquée par Aristote tout aussi régulièrement qu'elle peut l'être par nous, bien qu'elle ne puisse pas avoir entre ses mains la même efficacité et la même étendue. Mais, si quelques erreurs nous choquent en lui, nous devons toujours nous dire qu'une première étude est CCXVIII nécessairement exposée à laisser de côté bien des phénomènes, quelque pénétrante qu'elle soit. On ne peut pas parcourir toute la carrière d'un seul pas, même lorsqu'en l'ouvrant, on ne s'est pas trompé, et qu'on a tracé aux autres une voie parfaitement sûre. Ne soyons point surpris qu'Aristote n'ait pas tout su, même en usant, aussi bien que qui que ce soit des vrais procédés de la science. Nous-mêmes pourrions-nous nous flatter de savoir tout, et de n'avoir plus rien à apprendre ? Qui aurait cet excès d'orgueil ? En enregistrant les progrès qui chaque jour se réalisent sous nos yeux, pouvons-nous supposer un instant que ces progrès doivent s'arrêter à nous ? Pourquoi les siècles à venir seraient-ils plus déshérités que le nôtre et que le passé ? Tout récemment, les explorations de la profondeur des mers ne nous ont-elles pas démontré une fois de plus que la Nature est inépuisable? Ne pensons-nous plus avec Pascal que « notre imagination se lassera plutôt de concevoir que la Nature de fournir» ? Soyons donc indulgents pour nos ancêtres, afin que nos successeurs le soient pour nous ; respectons-les pour être respectés à notre tour. CCXIX Nous ayons cité, un peu plus haut, une bien forte parole de J.-B. Dumas, affirmant qu' « Aristote est peut-être le seul naturaliste qui se soit fait une notion judicieuse du phénomène de la génération ». C'était en 1824. que Dumas parlait ainsi, quelques années ayant la lettre fameuse d'Ernest de Baër. Dumas n'a pas expliqué sa pensée davantage ; mais comme nous la partageons, dans une certaine mesure, nous essaierons de la développer, afin d'en faire sentir toute la justesse. Quelle est aujourd'hui la théorie de la génération, unanimement reçue? Réduite à son élément essentiel, cette théorie admet que les spermatozoïdes, en touchant l'œuf extérieurement, le fécondent, et que, quand le contact n'a pas lieu, l'œuf, fourni spontanément par l'ovaire, reste stérile. C'est donc la liqueur séminale, formée dans le mâle, qui produit et transmet la vie ; la femelle ne saurait la donner à elle seule, pas plus que le mâle ne le pourrait, s'il demeurait dans l'isolement. On peut ajouter, avec H. Milne Edwards, que le mode de fécondation chez les poissons est un exemple décisif. CCXX Que dit Aristote ? Lui aussi, il dit en propres termes que le maie n'apporte rien de matériel dans la génération, et qu'il apporte uniquement la vie caractérisée par la sensibilité ; il dit que la femelle fournit, pour sa part, la matière, qui, sans l'acte fécondant, resterait inerte et informe. En présence de cette presqu'identité de théorie, nous ne pouvons nous empêcher de déclarer qu'Aristote, par une intuition de génie, a été dans le vrai presque aussi bien que nous pouvons y être. Sans aucun aveuglement d'enthousiasme pour le naturaliste antique, reconnaissons qu'il avait deviné ce que nous savons à cette heure pertinemment. Il lui manquait les intermédiaires que nous possédons, et notamment il ignorait l'existence des spermatozoïdes, et leur trajet depuis le testicule, qui les produit, jusqu'à l'utérus et jusqu'aux trompes, où ils rencontrent l'ovule. Mais, tout en étant privé de ces ressources, Aristote ne se trompe pas, et comme l'affirme J.-B. Dumas, sa notion de la nature de l'acte générateur est parfaitement judicieuse. Il semble qu'il suffit d'une pareille vue, fût- CCXXI elle seule, pour recommander à jamais Aristote à l'estime et à la sérieuse étude des physiologistes les plus instruits et les plus exigeants. Mais, à cette vue, on pourrait en joindre plusieurs autres, qui, sans être aussi profondes, ne sont pas moins originales et pratiques. Ne parlons pas de sa méthode, qui est la vraie, et qui, par delà l'embryologie, s'étend à toutes les sciences ; n'en parlons pas, bien que ce soit là un titre de gloire impérissable. Ne parlons pas non plus de ses Recueils d'anatomie, ni de ses Dessins anatomiques, ingénieux procédé trouvé par lui. Mais, nous ne pouvons pas oublier ses observations sur le développement du poussin dans l'œuf. Harvey, Malpighi, J.-B. Dumas se sont illustrés en reprenant ces observations, qui sont d'une immense utilité, et qui seront reprises encore bien souvent par les physiologistes de l'avenir. Pourquoi n'en louerait-on pas Aristote, comme on en loue ses successeurs, bien qu'il soit allé moins loin qu'eux ? Plus haut, nous avons dit que nous ne voulions pas tenir plus de compte qu'il ne convient de cette invention sagace, qui ressortait si aisé- CCXXII ment de la nature des choses ; mais il ne serait pas juste de l'omettre entièrement, et de ne pas la faire figurer parmi les mérites scientifiques du philosophe naturaliste. Mais voici une autre vue d'Aristote, analogue à celle qui lui a révélé une partie de la vérité sur le mystère de la génération : c'est sa théorie de la liqueur séminale. De son temps, la question était déjà fort débattue, et il était généralement admis que le sperme vient de toutes les parties du corps. Cette théorie s'appuyait sur des arguments nombreux qui paraissaient décisifs. Aristote contredit cette opinion commune; et, dans une réfutation aussi vigoureuse que régulière, il soutient, comme on l'a vu, que le sperme ne peut venir du corps entier. Les analyses physiologiques ne sont pas encore poussées assez loin pour qu'il rapporte au testicule seul l'élaboration du sperme. Encore moins sait-il que la partie vraiment fécondante du sperme tient exclusivement aux spermatozoïdes. Mais s'il n'a pas pu pénétrer jusqu'à ces explications essentielles, et jusqu'à ces détails, il a compris que c'était une erreur d'attribuer au corps CCXXIII entier une fonction qui ne lui appartient pas. A cet égard, Aristote est d'autant plus louable que Terreur réfutée par lui a subsisté jusqu'à nos jours, et que Buffon lui-même l'a commise encore. Aujourd'hui, la physiologie n'a plus le moindre doute ; et, comme les spermatozoïdes sont la partie essentielle de la liqueur séminale et qu'ils ne sont produits que dans l'organe spécial, il est démontré, par cela même, que le sperme ne vient pas de tout le corps, bien que, comme les autres sécrétions, il vienne primitivement du sang, fluide nourricier de l'organisme entier. Voilà, ce semble, des titres bien solides pour que la science actuelle reçoive Aristote au nombre des observateurs les plus attentifs et les plus perspicaces, qui aient fait honneur à l'esprit humain, dans l'étude de l'histoire naturelle. Nous le disons hautement : Il y a toujours profit à le consulter, si ce n'est à le suivre. Nous convenons sans peine qu'à l'heure où nous sommes, le premier venu de nos jeunes étudiants en sait plus que lui, et que le moindre de nos manuels est beaucoup plus complet que l'Histoire des Animaux ou le CCXXIV Traité de la Génération. Pourtant, qui oserait comparer à ces monuments inappréciables les ouvrages, d'ailleurs fort utiles, où vient se condenser l'état présent de notre science? « Tout « cela, comme le dit très bien le Marquis de « l'Hôpital, comparant les travaux mathéma-« tiques des Anciens et des Modernes, tout « cela est une suite de l'égalité naturelle des « esprits et de la succession nécessaire des « découvertes ». (Analyse des infiniment petits, 1696, pp. 3 et 4.) Une autre leçon que nous offre l'exemple d'Aristote et que nous ferions bien d'écouter, c'est son admiration sans bornes pour la Nature. Il ne cesse d'en louer la sagesse et la prévoyance; il n'hésite pas à l'appeler « divine » ; et sans y voir aussi nettement que nous pouvons le faire aujourd'hui, avec mille fois plus de motifs, la main et l'empreinte de Dieu, il en sent, aussi vivement que les plus spiritualistes d'entre nous, la puissance et la bonté infinies. Il proclame à tout instant que la Nature ne fait rien en vain, que sa prudence infaillible se propose toujours un but intelligible a l'esprit de l'homme; et il se porte pour CCXXV fidèle interprète, en croyant imperturbablement aux causes finales. Aujourd'hui, la théorie des causes finales est fort décriée dans une partie du monde savant ; il est vrai qu'on en a souvent abusé, et qu'on a provoqué, par cet excès, une réaction, qui, au fond, est encore moins raisonnable. Sans doute, on doit se garder de la superstition ; mais ne voir dans la Nature que des lois sans législateur, des phénomènes sans cause et sans but, c'est descendre plus bas que la superstition elle-même. Sous prétexte de science scrupuleuse et positive, c'est abdiquer les plus nobles et les plus nécessaires facultés de l'esprit humain. Qu'on soit très sobre de recourir à l'intervention divine dans l'explication des faits que l'on constate, rien de mieux. Mais méconnaître l'action de l'intelligence dans l'ensemble de l'univers, c'est reculer au delà d'Anaxagore; c'est remonter à quelques milliers d'années en arrière. On se flatte d'être en progrès ; mais, au vrai, on succombe simplement à une défaillance, ou l'on cède à des passions antireligieuses, non moins aveugles que les préjugés les plus vulgaires. Ailleurs, nous avons déjà réfuté ce fa- CCXXVI natisme d'un nouveau genre, qui ne vaut pas mieux que l'autre; mais, pour y répondre victorieusement, nous nous bornerons à rappeler une page de Voltaire, une des plus sensées et des plus fortes sans contredit qu'il ait jamais écrites. « Si une horloge prouve un horloger, si un palais annonce un architecte, comment en effet l'univers ne démontre-t-il pas une intelligence suprême? Quelle plante, quel animal, quel élément, quel astre ne porte pas l'empreinte de celui que Platon appelle l'éternel géomètre ? Il me semble que le corps du moindre animal démontre une profondeur et une unité de dessein, qui doivent à la fois nous ravir en admiration et atterrer notre esprit. Non seulement ce chétif insecte est une machine dont tous les ressorts sont faits exactement l'un pour l'autre ; non seulement il est né, mais il vit, par un art que nous ne pouvons ni imiter ni comprendre; mais sa vie a un rapport immédiat avec la Nature entière, avec tous les éléments, avec tous les astres dont la lumière se fait sentir à lui. Le soleil le ré- CCXXVII chauffe, et les rayons qui partent de Sirius, à quatre cent millions de lieues au delà du soleil, pénètrent dans ses petits yeux, selon toutes les règles de l'optique. S'il n'y a pas là immensité et unité de dessein, qui démontrent un fabricateur intelligent, immense, unique, incompréhensible, qu'on nous démontre donc le contraire. Mais, c'est ce qu'on n'a jamais fait. Platon, Newton, Locke ont été frappés également de cette grande vérité. Ils étaient théistes, dans le sens le plus rigoureux et le plus respectable. « Des objections I On nous en fait sans nombre. Des ridicules ! On croit nous en donner en nous appelant cause-finales ; mais des preuves contre l'existence d'une intelligence suprême, on n'en a jamais apporté aucune. » (Les Cabales, édition Beuchot, tome XIV, p. 262.) Voltaire écrivait ceci sur la fin de sa carrière, en 1772, six ans avant sa mort, afin de tempérer l'outrecuidance des athées de son temps, comme il essaierait encore de tempérer nos athées contemporains. Le bon sens a-t-il jamais tenu un langage plus naturel, CCXXVIII plus lumineux et plus irrésistible ? A côté des grands esprits qui viennent d'être cités, à côté de Spinoza, de Virgile, de Clarke surtout, que Voltaire invoque après eux, il aurait dû ajouter Aristote, qui, le premier de tous, a pensé et parlé comme lui. C'est une omission contre laquelle réclame toute l'histoire naturelle d'Aristote, que Voltaire admirait beaucoup, mais qu'il ne connaissait pas assez. Aristote et Voltaire, d'accord entre eux et avec la foi spontanée du genre humain, quels témoignages pourrait-on demander encore ? S'il est une vérité démontrée dans ces hautes questions, c'est bien celle-là. Tenons-nous-y avec une inébranlable constance, soit que nous la confirmions par notre propre examen, soit que nous l'admettions sur l'affirmation du génie, antique et moderne, scientifique et littéraire. En parcourant l'histoire de l'embryologie dans ses traits principaux, nous venons d'assister a un beau spectacle, d'où nous pouvons tirer plus d'un enseignement. Nous avons vu comment la science est née, et ce qu'elle est devenue par le concours de puis- CCXXIX sants esprits, se succédant à travers les âges, pour avancer toujours dans la même voie, et s'y diriger par la même règle. La méthode d'observation est tout aussi entière dans Aristote que dans Buffon, dans Cuvier, dans Dumas ; elle y est par une nécessité semblable, et elle y produit un résultat analogue. L'esprit humain ne peut pas plus se soustraire à cette loi dans l'Antiquité qu'il ne s'y soustrait de nos jours, parce qu'elle est dans la nature intime des choses, inéluctable, à toutes les époques et dans tous les lieux. Redisons-le encore une fois : la réalité ne change pas ; elle est là sous nos yeux comme elle était sous les yeux de nos devanciers ; elle restera pour nos successeurs ce qu'elle est pour nous. D'une autre part, quoi qu'en ait dit Bacon, il n'y a pas pour l'esprit de Novum Organum. De tout temps, l'homme a eu les facultés dont Dieu l'a doué, pour qu'il pût le comprendre, et l'adorer dans la contemplation de ses œuvres ; il n'aura jamais de facultés nouvelles. Il n'y a pas à refaire, ni à compléter son intelligence ; il n'y a qu'à l'employer de mieux en mieux. La main de l'ouvrier n'a pas une organisation CCXXX autre, parce qu'elle devient plus habile, ou parce qu'elle s'applique à des usages nouveaux. Quelle est donc la différence entre le passé et le présent? En quoi se distinguent-ils l'un de l'autre? La différence consiste en un seul point : à des faits antérieurement connus et constatés, on a joint des faits observés plus exactement, ou des faits qui n'avaient pas été remarqués jusque-là. La science s'est ainsi édifiée peu à peu, parce qu'elle n'est qu'une accumulation et qu'elle ne peut pas être autre chose. Prise dans son ensemble, elle est l'étude perpétuelle de l'univers. Mais les deux termes qui la] constituent sont immuables. L'esprit humain, qui cherche à comprendre l'ordre universel des choses, par cette passion de connaître qu'Aristote signale au début de sa Métaphysique, ne se transforme pas plus que la réalité extérieure. Seulement, il sait davantage, parce qu'il apporte à ses actes intelligents plus d'attention et plus de persévérance. De nouveaux observateurs accroissent l'héritage de siècles en siècles ; et la science, dans sa totalité, comme chacune des sciences CCXXXI partielles dans sa spécialité, se compose de cet amoncellement de phénomènes et d'observations de tous genres. La théorie de la constitution et des progrès de la science, ainsi comprise, est plus exacte que celle qui met entre le passé et le présent une sorte d'hiatus, et qui n'hésite pas à scinder l'histoire de l'esprit humain en plusieurs périodes, qui n'ont plus rien de commun. A notre avis, cette division des esprits et des temps est une grave erreur ; c'est méconnaître tout à la fois ce qui a été et ce qui est. L'embryologie nous offre un frappant exemple de la solidarité étroite qui unit les époques entre elles, quelque éloignées qu'elles soient. D'Aristote à H. Milne Edwards, il y a parfaite identité de sujet, et parfaite identité de méthode. Certainement notre siècle est plus riche que ne l'était le ive siècle avant notre ère ; mais il n'est qu'un héritier. Ainsi que nous l'avons dit ailleurs, c'est à la Grèce que nous remontons directement; nous étudions le monde, comme les Anciens nous ont appris à l'étudier. Pour savoir d'où nous venons, nous n'avons pas besoin d'étendre nos regards plus CCXXXII loin que l'Antiquité grecque, de qui nous sommes les fils. Nous laissons l'esprit asiatique dans les limbes où il est toujours resté, et d'où sans doute il ne sortira jamais. Soyons fiers, si nous le voulons, de nos lumières et de nos conquêtes ; mais aussi, sachons être modestes, non pas seulement pour nous faire une part équitable, mais encore pour nous rendre exactement compte de ce qu'est la science. Sachons dans quelles limites infranchissables elle se meut, bien que son domaine s'étende chaque jour, et qu'elle se flatte quelquefois de n'avoir pas de bornes. Elle en a cependant; et avec un peu de réflexion, il est facile de les apercevoir. Pascal, dans un langage dont la grandeur et la simplicité ne seront jamais dépassées, a montré la vraie place de l'homme entre les deux infinis, dont il est en quelque sorte le point de rencontre, parce qu'il est capable de les comprendre tous les deux, du moins en partie. Laissons à l'astronomie les espaces insondables des cieux et l'infini qui se perd dans ces abîmes ; mais l'infini de petitesse, que nous croyons pouvoir embrasser mieux, ne CCXXXIII nous échappe pas moins. Sous nos instruments ingénieux, les êtres microscopiques se multiplient pour nous, comme les soleils se multiplient dans le firmament ; il n'y a pas plus de fin d'un côté que de l'autre; les découvertes qui nous attendent dans le monde des atomes ne sont pas moins étonnantes que celles qui s'adressent aux grands corps dont le ciel est peuplé. L'ovule tant cherché par l'embryologie, et trouvé enfin par Ernest de Baër, n'est pas le dernier terme peut-être ; et des procédés encore plus perfectionnés nous révéleront des merveilles, que nous ne soupçonnons pas. Mais il y a plus. La diversité des moyens employés par la Nature pour la reproduction des êtres n'est pas moins infinie que la dimension des choses; ses combinaisons sont innombrables, comme les individus et les espèces. Aristote en a connu quelques-unes ; nous en connaissons bien davantage. Mais sommes-nous au bout ? Et la fécondité de la Nature ne dépassera-t-elle pas toujours immensément, en ceci comme en tout, la fécondité de notre imagination ? De quelque côté que se tourne la science CCXXXIV humaine, elle se trouve donc inévitablement en face de l'infini, qu'elle ne peut épuiser en aucun sens. En se comparant à elle-même, pour voir de quel germe elle sort et quels développements ses labeurs ont obtenus, elle peut ressentir un légitime orgueil ; mais comparée à l'infini, qui demeure éternellement incommensurable, notre science peut sembler un néant, parce que, devant l'infini, toute quantité s'efface et se réduit à zéro. Cependant, grâce à Dieu, nous pouvons nous dire que nous n'en sommes pas réduits tout à fait à cette nullité, et que, si noire savoir est borné, il est néanmoins bien réel ; les vérités acquises par nous ne nous fuient plus, quelle que soit notre infirmité. Selon la grande maxime d'Aristote, une vérité démontrée est une vérité éternelle. Il nous est donné d'empiéter pas à pas sur le domaine de l'infini, quoique jamais nous ne puissions le parcourir en son entier. C'en est assez pour la gloire de l'homme ; et il n'a qu'à remercier son créateur de lui avoir permis, pour quelques instants passagers, la vue, même incomplète, de ce spectacle éblouissant et sublime. Tous les grands esprits ont CCXXXV éprouvé ce sentiment et l'ont exprimé, chacun à leur manière, depuis Anaxagore, Socrate, Platon, Aristote jusqu'à Descartes, Newton, Leibniz, Buffon, Cuvier, Agassiz, et tant d'autres avec eux. Nous aussi, après de tels guides, laissons-nous aller à la reconnaissance et à l'admiration, avec d'autant plus de raison que nous les voyons chaque jour de plus en plus justifiées. Les conquêtes successives de notre science ne font que confirmer l'enthousiasme instinctif des premiers temps ; et la Mécanique Céleste d'un Laplace n'est après tout que l'écho agrandi du Caeli enarrant d'un David. Ce qui désespère quelquefois l'esprit humain, et l'humilie, c'est de sentir, au delà de ce qu'il sait, des mystères qui sont impénétrables à ses plus généreux efforts. L'embryologie renferme plus d'un de ces secrets qui nous resteront à jamais fermés. L'action essentielle des spermatozoïdes sur l'ovule, ou l'action de la liqueur séminale telle qu'Aristote l'a comprise, ne s'explique que jusqu'à un certain point, passé lequel il n'y a plus que ténèbres invincibles. Après bien des essais CCXXXVI infructueux, nous tenons et nous suivons enfin le cours du phénomène depuis son origine dans les organes destinés à l'accomplir. Mais, parvenus à l'ovule, nous ne pouvons pas aller plus avant ; tout ce que nous voyons, c'est que la vie se transmet des parents au fruit que leur union doit procréer. Mais, que d'un simple contact matériel, il puisse sortir une intelligence avec toutes ses facultés, une âme avec tous ses dons de moralité et de vertu, une volonté avec toutes ses énergies et ses héroïsmes, une personne en un mot, c'est là ce qui dépasse tellement notre compréhension qu'il nous faut recourir à l'intervention d'une puissance supérieure, qui a décrété qu'il en soit ainsi. Notre raison ne peut que se confondre dans son incurable impuissance. Et pourtant, c'est l'honneur suprême de l'esprit humain d'agiter ces questions insolubles, et de recommencer perpétuellement des efforts perpétuellement déçus. Aristote n'a pas ignoré plus que nous ce tourment de la pensée, et il s'est demandé, lui aussi, à quel moment l'Ame arrive dans le fœtus, et d'où vient l'entendement, dont l'homme a le privilège exclusif. CCXXXVII Le destin n'a pas permis au philosophe d'approfondir autant qu'il l'eût voulu ces graves études ; il s'est arrêté dans une route qui est la plus digne du génie de l'homme, et où le sien se serait. signalé autant que dans bien d'autres routes non moins ardues. Ce n'est plus là, il est vrai, le terrain de l'histoire naturelle; c'est le terrain de la métaphysique, que la science vulgaire redoute, parce qu'elle ne la comprend pas, et qu'elle ne sait pas s'en servir. Mais, croire que l'esprit humain se désintéressera quelque jour de ces hautes questions, que soulève l'organisation de l'animal le plus infime, aussi bien que le système de l'univers, c'est se leurrer d'un espoir chimérique. Sous prétexte de rigueur scientifique, on abdique la science même ; se borner à une simple collection de faits, dont on ne rechercherait ni l'explication ni la cause, ce n'est pas un signe de force et de sagesse ; c'est un aveu détourné d'indifférence ou de faiblesse. Napoléon avait, selon le rapport des contemporains, coutume de dire, que « le pourquoi et le comment sont des questions si utiles qu'on ne saurait trop se les faire ». En cela, CCXXXVIII le grand empereur était d'accord avec le genre humain ; et s'il ne fait pas autorité en zoologie, dans une question de sens commun et de pratique, on peut en croire son témoignage plus encore que celui d'aucun savant. Nous nous garderons bien de blâmer Aristote d'avoir cherché de son mieux le pourquoi et le comment des choses. Dans bien des cas, il a réussi à les découvrir; assez souvent, il y a échoué, nous en convenons. Mais ces faux pas étaient inévitables dans une carrière toute neuve. La méthode d'observation, qu'il a si bien exposée le premier, aurait dû le préserver lui-même de quelques chutes. Mais, on ne peut pas être bien sévère, quand on voit que, de nos jours encore, l'esprit de système égare tant d'esprits. Si l'on se rappelle de mémorables naufrages, les tourbillons de Descartes, les monades de Leibniz, les molécules vivantes de Buffon, la cellule de Darwin, il n'y a pas à s'étonner que l'Antiquité grecque ait glissé sur la même pente. L'esprit humain sent un tel besoin d'explications qu'il n'hésite jamais à adopter celles qui lui semblent les plus plausibles. Cette passion est aujourd'hui aussi CCXXXIX vivace que jamais; elle semble même s'accroître à mesure que notre connaissance des choses s'étend et s'affermit. Pardonnons à Aristote d'y avoir obéi comme nous y obéissons ; et disons-nous que, s'il eût été moins curieux, il en aurait beaucoup moins su, et nous en aurait beaucoup moins appris. Il est peut-être encore un des philosophes qui ont risqué le moins d'hypothèses ; il s'en est défendu autant qu'il l'a pu, et c'est là certainement une des causes qui en ont fait, pendant plusieurs siècles, et à l'aurore des temps modernes, l'instituteur vénéré et souverainement utile de l'esprit humain. Son histoire naturelle tout entière, Histoire des Animaux, Traité des Parties, Traité de la Génération, doit attester combien il était digne d'exercer cet empire bienfaisant, et combien le Moyen-âge a été heureux de pouvoir se mettre à son école. Le despotisme insupportable n'est venu que plus tard ; et quand la Renaissance a si justement secoué le joug, l'indépendance n'a été reconquise qu'en revenant à la méthode qu'Aristote avait établie, et que des sectateurs aveugles ou intolérants avaient défigurée. L'observa- CCXL tion des faits, exacte et patiente, a ressuscité la science après une longue léthargie, de même qu'elle lui avait donné naissance vingt siècles auparavant, et que, dès lors, elle eût fondé quelques-uns de ses plus solides monuments. En terminant cette esquisse de l'embryologie, considérée dans son histoire, son berceau et sa pleine virilité, insistons encore une dernière fois sur le sentiment qui domine et inspire toute la zoologie Aristotélique, l'admiration de la Nature. On dirait qu'aujourd'hui l'habitude a émoussé les âmes, et que, devant les tableaux étalés à nos regards, nous ne sentons plus, comme dit le poète, « ni charme ni transports». Aristole, tout austère qu'il est, n'a rien de celte indifférence et de cette insensibilité pour ce spectacle prodigieux. Nous vivons et nous sommes plongés dans un milieu rempli de merveilles ; et il faut que l'esprit de l'homme soit bien inattentif et bien mobile pour aller demander à un surnaturel imaginaire plus et mieux que ce qu'il a sous les yeux. Rien n'est plus étonnant que la Nature, telle qu'elle se montre à nous. CCXLI Ainsi que Ta dit un des naturalistes les plus grands du xixe siècle, membre de notre Institut, dont il était l'associé étranger, Agassiz : l'univers représente la pensée du Créateur ; et le monde animé la reflète plus manifestement encore que tout le reste. C'est un livre que nous n'avons pas fait, mais que nous pouvons déchiffrer. Aristote n'a pas travaillé à d'autre intention ; et se fiant à la sagesse de la Nature, il a essayé, le premier dans l'humanité, d'épeler scientifiquement le livre de l'œuvre divine ; il en a tourné quelques feuillets, nous enseignant à en tourner d'autres aussi bien que lui, et, si nous le pouvons, mieux que lui.
Paris, décembre 1886. |