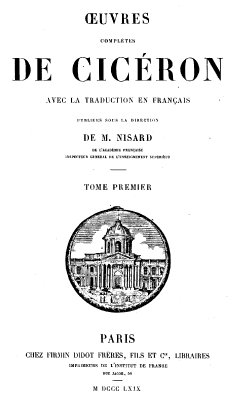|
ALLER A LA TABLE DES MATIÈRES DE CICÉRON
Cicéron
DE L'ORATEUR
LIVRE SECOND
LIVRE SECOND.
ARGUMENT. A la place de Scévola qui a pris part au premier Dialogue, paraissent deux nouveaux interlocuteurs, Q. Calulus et C. Julius César, distingués, l'un par la douceur et l'élégance de la diction, l'autre, par le talent de la plaisanterie.
Ce Livre est
consacré tout entier à l'invention et à la disposition.
Comme Antoine excellait surtout dans cette partie de l'art aratoire,
c'est lui qui est chargé d'en développer les principes. Après un
brillant éloge de l'éloquence il examine, depuis le chapitre X jusqu'au
chapitre XVIII, les différents I. Dans notre jeunesse, mon cher Quintus, c'était, si vous vous en souvenez, une opinion généralement répandue que L. Crassus n'avait d'autre instruction que celle que peut donner l'éducation du premier âge, et que M. Antoine n'en avait aucune. Beaucoup de personnes même, qui ne partageaient pas cette idée, se plaisaient à nous tenir le mème langage, espérant par là modérer l'ardeur de notre zèle pour l'étude : on voulait nous faire entendre que si ces deux grands orateurs étaient parvenus, presque sans avoir rien appris, au plus haut degré d'habileté et d'éloquence, nous nous donnions une peine inutile, et que notre père, cet homme si sage et si bon, prenait, pour nous faire instruire, des soins bien superflus. Nous réfutions cette assertion, comme pouvaient le faire des enfants, par des témoignages domestiques ; nous citions notre père, C. Aculéon, notre allié, et L. Cicéron, notre oncle. En effet, Aculéon, qui avait épousé notre tante maternelle, et pour qui Crassus eut toujours une affection particulière, et L. Cicéron, qui mourut en Cilicie, où il était allé avec Antoine, nous parlaient souvent, ainsi que notre père, des études et des connaissances de Crassus ; et comme on nous enseignait, aux fils d'Aculéon, nos cosins, et à nous, des choses qui étaient du goût de Crassus, et qu'il était lié avec nos maîtres, nous avons pu reconnaître (car notre grande jeunesse ne nous empêchait pas de l'apprécier) qu'il parlait le grec comme s'il n'eût pas connu d'autre langue; nous avons pu voir aussi, par les questions qu'il leur proposait, ou qu'il discutait lui-même dans ses entretiens, qu'aucun sujet ne lui était étranger. Pour ce qui est d'Antoine, nous tenions de notre oncle, homme fort éclairé, qu'à Athènes et à Rhodes, il allait fréquemment entendre les savants les plus distingués; et moi-même, dans mes premières années, autant que la timidité de mon âge me le permettait, j'ai souvent fait appel à ses lumières. Ce que j'avance ici ne sera pas nouveau pour vous, mon frère; car dès ce temps-là je vous disais que, d'après tout ce que j'avais recueilli de la bouche d'Antoine, il n'était pas de matière, de celle du moins dont je pouvais juger moi-même, où il ne me parût versé. Mais l'un et l'autre s'étaient fait un système. Crassus cherchait à faire dire de lui non pas que l'instruction lui manquait, mais qu'il la dédaignait; en même temps il voulait élever en tout les Romains au-dessus des Grecs. Antoine pensait que ses discours produiraient plus d'impression sur le peuple, s'il faisait croire que l'art était entièrement étranger à son éloquence. Ils espéraient tous deux avoir plus d'autorité, en paraissant, l'un mépriser les Grecs, l'autre ne pas même les connaître. Ce n'est pas ici le lieu d'examiner ce qu'il faut penser de cette idée ; mais ce qui nous importe en ce moment, ce qui fait le but de cet ouvrage, c'est de montrer que jamais personne n'excella dans l'éloquence, sans en avoir étudié les règles, et même sans avoir orné son esprit de connaissances presque universelles. II. Les autres arts se suffisent, pour ainsi dire, et se soutiennent par eux-mêmes; l'art de bien dire, qui comprend à la fois et la science, et l'habileté, et l'élégance, n'a pas de bornes fixes dans lesquelles on puisse le circonscrire. Celui qui ambitionne le titre d'orateur doit pouvoir discourir avec succès sur tout ce qui peut faire la matière d'une discussion, ou renoncer à la gloire de l'éloquence. J'avoue qu'à Rome et dans la Grèce, où ce talent fut toujours en honneur, plusieurs orateurs se sont fait un grand nom, sans avoir des lumières si étendues; mais qu'on ait jamais pu atteindre à l'éloquence de Crassus et d'Antoine, à moins de posséder toutes les connaissances nécessaires à la perfection d'un talent aussi complet et aussi riche que le leur, c'est ce que je nie formellement. En me déterminant à écrire l'entretien qu'ils eurent autrefois sur cette matière, j'ai voulu détruire l'opinion généralement répandue que le premier avait peu de connaissances, et que le second était tout à fait ignorant; reproduire et conserver les belles choses que je pense que ces grands orateurs ont dites sur l'éloquence, si toutefois je suis capable de les exprimer dignement; enfin sauver, autant qu'il était en moi, d'un injurieux oubli le souvenir de leur gloire, qui semble s'effacer de la mémoire des hommes. Si l'on pouvait les connaître d'après leurs propres ouvrages, je me serais peut-être dispensé d'entreprendre ce travail; mais il ne nous reste de l'un que quelques pages écrites dans sa jeunesse, et nous n'avons absolument rien de l'autre. J'ai cru devoir à de si beaux génies, tandis que leur mémoire est encore vivante au milieu de nous, de la rendre, si je puis, immortelle. J'espère que mon récit obtiendra toute confiance; car je ne parle pas de l'éloquence d'un Serv. Galba ou d'un Caïus Carbon, dont je pourrais dire tout ce que je voudrais sans craindre que les souvenirs de leurs contemporains démentissent mes discours : un grand nombre de ceux qui liront cet écrit ont souvent entendu les deux illustres orateurs ; et leur témoignage sera pour moi comme une autorité vivante et animée, qui m'aidera à convaincre ceux qui n'ont pu les connaître. III. Ne croyez pas, mon cher Quintus, que je vienne vous poursuivre avec un de ces traités de rhétorique qui vous semblent barbares, et dont vous n'avez pas besoin. Rien, en effet, n'est plus délicat ni plus élégant que votre diction. Mais soit raison, comme votre modestie aime à le dire; soit cette pudeur réservée et timide, qui retenait le père de l'éloquence, Isocrate, ainsi qu'il le rapporte lui-même; soit enfin que vous ayez pensé, comme vous le dites quelquefois en badinant, que c'était assez d'un beau parleur dans une famille, et peut-être même dans une cité tout entière; vous avez toujours reculé devant le rôle d'orateur. Je me flatte toutefois que vous ne rangerez pas l'écrit que je vous adresse dans la classe de ces ouvrages de rhétorique, justement décriés, à cause de l'absence de toute instruction grave et solide dans ceux qui les composent. Il me semble que dans cet entretien de Crassus et d'Antoine, rien n'a été omis de tout ce qu'on peut acquérir par un profond génie, un travail opiniâtre, une solide instruction et un long usage. Vous en jugerez facilement, mon frère, vous qui avez voulu apprendre par vous-même la théorie et les principes de l'éloquence, et qui vous en rapportez à mon expérience pour ce qui regarde la pratique. Je ne prolongerai pas davantage cet avant-propos; et, afin d'achever plus tôt la tâche difficile que je me suis imposée, je vais laisser parler mes interlocuteurs. Le lendemain de leur première conversation, vers la seconde heure du jour, lorsque Crassus était encore au lit, Sulpicius assis à son chevet, et qu'Antoine se promenait avec Cotta sous le portique, on vit arriver le vieux Q. Catulus et C. Julius, son frère. Dès que Crassus en fut instruit il se hâta de se lever; et tous, étonnés de cette visite inattendue, l'attribuaient à quelque motif important. Après qu'ils eurent échangé, selon leur usage, des compliments affectueux, Qui peut, dit Crassus, vous amener si matin? Y a-t-il quelque chose de nouveau? - Rien, répondit Catulus, vous savez qu'on célèbre les jeux publics : mais (appelez-nous indiscrets, importuns, ou comme il vous plaira) César, étant venu me voir hier soir à ma maison de Tusculum, de la campagne qu'il y possède aussi, me dit qu'il avait rencontré Scévola sortant de chez vous, et que celui-ci lui avait raconté des merveilles d'un entretien, où, comme dans une école, et presque à la mode des Grecs, vous aviez longuement disserté sur l'éloquence avec Antoine, vous que j'ai essayé vainement par tous les moyens possibles d'amener à une pareille discussion. J'avais bonne envie de vous entendre; mais je craignais que notre visite ne vous gênât. Mon frère m'a conjuré de l'accompagner chez vous. Il tenait de Scévola, m'a-t-il dit, qu'une bonne partie de votre entretien avait été remise à aujourd'hui. Si vous trouvez dans notre démarche un empressement indiscret, prenez-vous en à César; si vous n'y voyez qu'une preuve d'amitié, tenez-nous en compte à tous deux. Quant à nous, pourvu que notre présence ne vous déplaise pas trop, nous sommes fort aises d'être venus. IV. - Quel que soit, dit Crassus, le motif qui vous amène, c'est toujours un bonheur pour moi de recevoir des amis aussi chers; mais, à dire vrai, j'aimerais mieux qu'en venant ici vous eussiez eu tout autre motif. Jamais, je vous le dis sincèrement, je ne fus plus mécontent de moi qu'hier : je me suis laissé aller à un excès de faiblesse; et voilà le tort que je me reproche. En cédant aux voeux de ces jeunes gens, j'ai oublié que j'étais vieux, et j'ai fait ce qui ne m'était jamais arrivé, même dans ma jeunesse, je me suis mis à discourir sur les principes et la théorie d'un art; mais, heureusement pour moi, mon rôle est fini, et c'est Antoine que vous allez entendre. - Assurément, dit César, j'ai un extrême désir de vous entendre poursuivre une dissertation longue et soutenue, comme celle dont on m'a parlé; mais si je ne puis avoir ce bonheur, je me contenterai encore du charme de votre conversation habituelle. Pourtant je veux essayer si j'aurai moins de pouvoir sur votre esprit que Cotta et mon ami Sulpicius; et peut-être mes instances obtiendront-elles la même complaisance de votre part pour Catulus et moi; mais si notre proposition vous déplaît, je n'insisterai pas davantage, de peur d'encourir aussi ce reproche d'ineptie que vous redoutez si fort. - J'ai toujours regardé ce mot d'ineptus, reprit Crassus, comme un des plus énergiques de notre langue : on l'emploie pour caractériser toute espèce d'inconvenance, et le sens en est extrêmement étendu. Il s'applique à l'homme qui ne sait pas choisir l'à-propos, qui parle plus qu'il ne faut, qui affiche la haute opinion qu'il a de lui-même, qui n'a aucun égard aux intérêts et à la dignité des personnes avec lesquelles il se trouve; enfin, qui ne connaît aucune bienséance, ne garde aucune mesure. Ce défaut est très commun chez les Grecs, nation d'ailleurs si éclairée. Aussi, comme ils ne sentent pas tout ce qu'il a de désagréable, ils n'ont pas même de mot pour l'exprimer : vous aurez beau chercher, vous ne trouverez pas chez eux d'expression qui réponde à celle d'ineptus. Or de toutes les inepties, et le nombre en est infini, la plus grande, je crois, est d'aller, sans aucune nécessité, disputer et subtiliser comme ils font, en tous lieux et devant toutes sortes de personnes, sur les matières les plus difficiles. C'est à quoi pourtant ces jeunes gens nous ont forcés hier, malgré notre répugnance et nos refus. V. - Mais les Grecs, répondit Catulus, qui ont acquis dans leur patrie l'illustration et la gloire dont vous jouissez dans la vôtre, Crassus, et où nous désirons tous parvenir, ne ressemblaient pas à ces Grecs dont le babil fatigue continuellement nos oreilles. Cependant, lorsqu'ils étaient de loisir, ils ne se refusaient pas à ces sortes d'entretiens. Vous avez raison d'appeler ineptes ceux qui n'ont égard ni aux temps, ni aux lieux, ni aux personnes ; mais le lieu où nous sommes vous semble-t-il mal choisi? ce portique où nous nous promenons, cette salle d'exercices, ces sièges nombreux qui nous entourent, ne rappellent-ils pas les gymnases des Grecs, et leurs conversations savantes? Direz-vous que le moment n'est pas favorable, au milieu du loisir si doux et si rare dont nous jouissons aujourd'hui? ou craignez-vous enfin qu'un semblable entretien ne convienne pas à des auditeurs comme nous, pour qui ces études font le plus grand charme de la vie? - Pour moi, reprit Crassus, je me fais une autre idée de tous ces objets : ces palestres, ces sièges, ces portiques, les Grecs, mon cher Catulus, les ont établis pour s'y promener et s'y divertir, et non pour y discuter. Il y avait des gymnases bien des siècles avant que les philosophes y fissent entendre leur babil; et aujourd'hui même, que tous les gymnases sont envahis par eux, leurs auditeurs préfèrent le bruit d'un disque à la plus belle leçon de philosophie. Si ce bruit vient à frapper leurs oreilles , en vain le philosophe les entretiendrait-il des sujets les plus sublimes, ils l'abandonnent au milieu de son discours, pour courir où les appellent les exercices de la palestre. Ainsi, de leur propre aveu, ils préfèrent le plus frivole plaisir à l'instruction la plus précieuse. Nous avons du loisir, dites-vous; j'en conviens; mais l'avantage du loisir, c'est de reposer son esprit, et non de le fatiguer. VI. J'ai souvent entendu dire à mon beau-père que Lélius, dont il était gendre, accompagnait presque toujours Scipion à la campagne, et que là ils redevenaient tous deux enfants à un point incroyable, lorsqu'ils avaient pu s'échapper de Rome, comme des captifs qui rompraient leurs fers. J'ose à peine le dire de si grands personnages ; mais Scévola m'a raconté plus d'une fois qu'ils ramassaient des coquillages et des cailloux sur les rivages de Caiète et de Laurente, et qu'ils s'amusaient aux jeux les plus puérils. Il en est de nous comme des oiseaux : nous les voyons travailler à se construire des nids, et se donner des soins pour eux et leur famille; puis, lorsque l'ouvrage est terminé, ils voltigent çà et là, et s'égayent en liberté, pour se délasser de leurs fatigues. Ainsi, épuisés par les travaux du forum et les occupations de la ville, nous aimons à égarer librement nos pensées, sans aucun soin qui nous occupe. Je ne faisais donc qu'exprimer mes vrais sentiments, lorsqu'en défendant la cause de Curius, je disais à Scévola : «Si aucun testament ne peut être bien fait qu'autant que vous l'aurez dicté, nous irons tous vous prier de dicter les nôtres; vous seul, vous rédigerez tous les testaments; et alors quel temps vous restera-t-il pour vous occuper des affaires de la république, pour vaquer à celles de vos amis et aux vôtres, enfin, pour ne rien faire?» Et j'ajoutai : «Ce n'est point être libre, que de n'avoir pas quelquefois la faculté de ne rien faire. " Je persiste, Catulus, dans cette opinion, et dès que je suis à la campagne, mon bonheur est de n'avoir rien à faire, et de m'abandonner à une entière inaction. Ce que vous avez ajouté en troisième lieu, que, sans ces études, la vie n'aurait plus de charme pour vous, est moins propre à me faire entrer dans la discussion qu'à m'en éloigner. Lucilius, si connu par ses talents et par les grâces de son esprit, disait souvent qu'il désirait que ses ouvrages ne fussent lus ni par des hommes trop éclairés, ni par des ignorants, parce que ceux-ci n'y verraient rien, et que les autres y verraient peut-être plus que lui-même. C'est ce qui lui fait dire : Je ne me soucie pas d'avoir Persius pour lecteur; j'aime mieux Décimus. Le premier passait pour le plus docte et le plus éclairé des Romains; nous avons connu dans l'autre un homme de bien, et qui ne manquait pas de connaissances; mais il n'approchait pas de Persius. Je pense de même. Si j'avais à discourir sur cet art qui fait l'objet de nos études, je ne voudrais pas que ce fût en présence d'ignorants, mais encore moins devant vous; car j'aime mieux n'être pas entendu que d'être critiqué. VII. - Il me semble, mon cher Catulus, dit alors César, que nous avons déjà assez bien employé notre temps, en venant ici; car tout en s'excusant de discourir, Crassus a discouru d'une manière infiniment agréable. Mais puisque le tour d'Antoine est venu, pourquoi l'empêchons-nous de nous développer ses idées sur l'éloquence ? Cotta et Sulpicius attendent avec impatience qu'il prenne la parole. - Un moment, s'écria Crassus; je ne souffrirai pas qu'Antoine dise un mot, et moi-même je n'ouvrirai pas la bouche, si auparavant je n'obtiens de vous.... - Quoi donc? dit Catulus. - Que vous passiez la journée avec nous. - Comme Catulus hésitait, parce qu'il avait promis à son frère : Je réponds pour tous deux, dit César; nous obéirons, et lors même que vous me condamneriez à ne vous point entendre, je resterais encore. - Catulus ajouta en souriant : Il n'y a plus moyen de balancer, puisque je n'ai pas dit chez moi qu'on m'attende, et que César, chez qui je devais aller, s'est engagé si facilement, sans me demander mon avis. Alors, comme tous les deux se portaient sur Antoine, il commença ainsi : - Écoutez donc, écoutez avez attention; vous allez entendre un homme qui a fréquenté les maîtres et les écoles, et qui est versé dans les principes des Grecs; je parlerai avec d'autant plus de confiance, que j'ai Catulus parmi mes auditeurs, Catulus, qui, de l'aveu des Grecs, comme de celui des Romains, parle les deux langues avec la même élégance et la même pureté. Mais puisque le talent de la parole, qu'il soit l'ouvrage de l'art, ou un don de la nature, ne saurait exister sans un peu d'effronterie, je vous déclare, mes chers disciples, que je vais vous enseigner ce que je n'ai jamais appris, en vous exposant mes idées sur l'éloquence. - Ce début fit sourire l'auditoire. Antoine poursuivit : Il me semble que dans l'éloquence le génie est tout, et l'art bien peu de chose. L'art, en effet, porte sur des choses que l'on connaît avec certitude, au lieu que l'orateur s'adresse à des opinions, et non à des connaissances positives. Nos auditeurs n'entendent rien aux matières dont nous les entretenons, et nous-mêmes n'en avons qu'une connaissance imparfaite. Aussi ils portent souvent des jugements opposés sur les mêmes faits; et nous-mêmes il nous arrive de soutenir alternativement des causes toutes contraires. Ainsi, non seulement Crassus parlera contre moi, ou moi contre Crassus, quoique l'un de nous deux doive nécessairement avoir tort; mais quelquefois même l'un de nous deux, après avoir soutenu un parti dans une cause, soutiendra le parti contraire dans une cause pareille; et cependant la vérité est toujours une. J'ai donc à vous entretenir d'une chose qui est appuyée sur le mensonge, qui conduit rarement à la vérité; qui s'adresse aux passions, et souvent même aux erreurs des hommes; je le ferai néanmoins, si vous croyez que mon sentiment vaille la peine d'être écouté. VIII. - Nous le croyons, dit Catulus, et nous désirons d'autant plus de l'entendre, que vous ne cherchez pas à nous séduire. Votre début sans prétention nous charme surtout par cette franchise que vous aimez, et qui ne cherche pas à se faire valoir. J'ai établi en général, reprit Antoine, que l'art était pour peu de chose dans l'éloquence; mais je conviens aussi qu'on peut donner quelques préceptes ingénieux sur les moyens de manier les esprits des hommes, et de se rendre maître de leurs volontés. Si l'on veut donner le nom d'art à cette science, j'y consens. Puisque parmi ceux qui plaident des causes au barreau, le plus grand nombre ne suit ni principes, ni méthode, tandis que d'autres, mieux guidés par le travail ou l'habitude, savent mettre plus d'habileté dans leurs discours : il est évident qu'en cherchant pourquoi les uns réussissent mieux que les autres, et si l'on veut généraliser ces observations, on trouvera un art, ou quelque chose d'assez semblable à un art. Que n'ai-je le pouvoir de dévoiler en ce moment devant vous le secret de cette théorie, aussi bien que j'en aperçois tous les jours les éléments lorsque j'entends plaider au forum! Si cette tâche est au-dessus de mes forces, je puis toujours dire ce dont je suis bien convaincu, que, quoique l'éloquence ne soit pas un art, il n'est rien de comparable à un orateur parfait: car sans parler ici de l'influence que le talent de la parole à toujours exercée dans les États libres et bien réglés, ce talent par lui-même a tant de charmes, qu'il n'est rien dont l'oreille ou l'âme des hommes puisse être plus agréablement flattée. Quelle musique plus douce qu'un discours harmonieux et débité avec grâce ! quelle poésie plus mélodieuse qu'une période habilement cadencée ! L'acteur le plus parfait charme-t-il autant par l'imitation, que l'orateur par la vérité elle-même? Quoi de plus délicat que des pensées vives et pressées, de plus admirable que des idées embellies de toute la pompe de l'expression, de plus achevé qu'une harangue où brillent tous les genres de beauté? Car il n'est aucune matière, susceptible d'être traitée avec grandeur ou avec élégance, qui ne soit du domaine de l'orateur. IX. C'est à lui d'exprimer noblement son avis dans le sénat sur les intérêts les plus graves; c'est à lui de réveiller le peuple de sa langueur, ou de calmer la fougue de ses emportements; c'est l'éloquence qui confond le crime, c'est elle qui fait triompher l'innocence. Qui peut exhorter plus vivement au bien, détourner plus fortement du mal, flétrir le vice avec plus d'énergie, louer la vertu avec plus de magnificence, terrasser les passions par des coups plus violents, soulager la douleur par des consolations plus douces? Enfin, l'histoire elle-même, le témoin des siècles, le flambeau de la vérité, l'âme du souvenir, l'oracle de la vie, l'interprète des temps passés, quelle autre voix que celle de l'orateur peut la rendre immortelle? car s'il est quelque autre art qui donne des règles sur l'invention et le choix des mots; si l'on dit d'un autre que de l'orateur qu'il sait donner un corps, une forme au discours et l'embellir par l'éclat des pensées et les grâces de l'expression; si, hors l'éloquence, il est un art qui apprenne à trouver les raisonnements et les idées, la disposition et la méthode, il faut avouer ou qu'on étend cet art au delà de ses limites, ou que ce qu'on lui attribue lui est commun avec un autre art. Si à l'éloquence seule appartiennent ces secrets, quand même des hommes qui cultivent d'autres arts se seraient exprimés avec talent, ce n'en serait pas moins à elle qu'il faudrait en rapporter la gloire. L'orateur, nous disait hier Crassus, peut parler très bien des autres arts, pour peu qu'il les ait étudiés : de même ceux qui les professent pourront en parler avec élégance, s'ils se sont formés à celui de bien dire. Qu'un agriculteur, qu'un médecin, comme on l'a vu souvent, qu'un peintre, aient été éloquents, en parlant ou en écrivant sur l'agriculture, la médecine ou la peinture, il ne s'ensuit pas que l'éloquence appartienne à aucune de ces trois professions; mais telle est l'étendue de l'esprit humain, que souvent les hommes se forment d'eux-mêmes des notions sur tous les arts, sans les avoir étudiés. En général, on peut juger de ce qui est propre à chaque genre par les règles qui en dérivent; mais ce qui est encore plus certain, c'est que tous les autres arts peuvent, sans le secours de l'éloquence, atteindre le but qu'ils se proposent, au lieu que sans elle on ne saurait mériter le nom d'orateur. Ainsi les autres, s'ils sont éloquents, le doivent à un art étranger : l'orateur, au contraire, s'il n'a soin de s'assurer les moyens qui lui sont propres, ne peut pas aller chercher ailleurs le talent de la parole. X. Je ne devrais pas, Antoine, dit Catulus, arrêter la marche de votre discours : mais vous me pardonnerez de vous interrompre, car je ne puis m'empêcher de m'écrier, comme dit ce personnage du Trinummus; tant vous m'avez paru caractériser avec justesse et louer avec magnificence la puissance de la parole. C'est à l'homme éloquent à célébrer l'éloquence, puisque, pour en faire l'éloge, c'est à elle-même qu'il doit avoir recours. Mais continuez; je conviens avec vous que l'éloquence est votre domaine, et que ceux qui se montrent éloquents dans un autre art usent d'une faculté d'emprunt, et qui leur est tout à fait étrangère. - Il faut avouer, Antoine, dit à son tour Crassus, que la nuit vous a bien radouci : vous voilà devenu d'humeur traitable. Hier vous faisiez de l'orateur une espèce de forçat ou de manoeuvre, borné à son métier, comme dit Cécilius, et dépourvu d'instruction et de culture. - Hier, reprit Antoine, je m'attachais uniquement à vous réfuter, pour vous enlever vos disciples; mais aujourd'hui que je parle devant Catulus et César, je dois moins songer à lutter contre vous, qu'à exposer ma véritable opinion. Puisque nous destinons l'orateur à paraître au barreau et en présence de ses concitoyens, voyons d'abord quels sont ses devoirs et ses fonctions. Dans l'entretien d'hier, que Catulus et César n'ont point entendu, Crassus nous a expliqué en peu de mots les règles adoptées par la plupart des rhéteurs grecs, et il nous a plutôt fait connaître leur doctrine que son propre sentiment. Il a reconnu d'abord que les questions sur lesquelles l'éloquence peut s'exercer sont de deux espèces : les unes indéfinies, les autres déterminées. Il m'a paru qu'il entendait par indéfinies celles qui sont proposées d'une manière générale, comme quand on demande si l'éloquence, si les honneurs sont une chose désirable; par déterminées, celles où l'on spécifie les personnes, et qui roulent sur des faits positifs et précis. Telles sont les causes civiles et les contestations débattues au forum. Cette classe comprend surtout les procès plaidés devant les tribunaux, et les délibérations publiques. Quant au troisième genre de questions indiqué par Crassus, et reconnu, à ce que j'entends dire, par Aristote lui-même, qui a traité ces matières d'une manière si lumineuse, il peut être utile sans doute; mais je ne le crois pas d'une nécessité aussi indispensable. - De quoi voulez-vous parler? dit Catulus: n'est-ce pas du panégyrique? c'est là le troisième genre qu'on reconnaît ordinairement. XI. - Oui, poursuivit Antoine, et je me rappelle le plaisir extrême que me causa un tel discours, ainsi qu'à tous ceux qui l'entendirent : ce fut lorsque vous prononçâtes l'éloge de votre mère Popillia, la première femme, je crois, à qui l'on ait décerné dans Rome un pareil honneur. Mais il ne me semble pas nécessaire d'assigner des règles et des préceptes pour tout ce qui peut faire le sujet d'un discours; car les principes qui s'appliquent à tous les genres d'éloquence peuvent aussi convenir au panégyrique, sans qu'on ait besoin d'en imaginer d'autres; et à défaut de préceptes, personne ignore-t-il ce qui est réellement louable chez les hommes? Il n'y a qu'à prendre pour base ce que dit Crassus au commencement de la harangue qu'il prononça pendant sa censure contre son collègue : Je puis voir sans peine qu'on me surpasse dans tout ce qui dépend de la nature ou de la fortune; je ne puis souffrir qu'on l'emporte sur moi dans ce que les hommes peuvent acquérir par eux-mêmes. Ainsi, lorsqu'on aura quelqu'un à louer, on sentira qu'il faut parler des dons de la fortune, comme la naissance, les richesses, les parents, les amis, la puissance, la santé, la beauté, la force, le génie, et les autres avantages, qui sont ou corporels ou étrangers à notre personne. Si celui dont nous faisons l'éloge les a possédés, nous le louerons d'en avoir fait un bon usage; s'il en a été privé, nous dirons qu'il a su s'en passer; s'il les a perdus, qu'il en a souffert la perte avec constance. Nous rapporterons ensuite les actes de générosité, de courage, de justice, de grandeur, de piété, de reconnaissance, d'humanité, enfin tout ce qu'il a fait ou supporté avec vertu. Celui qui veut louer saura bien apercevoir tous les traits semblables, ou en choisir d'opposés, si son but est de blâmer. - Pourquoi donc, dit Catulus, refusez-vous d'admettre ce troisième genre, puisqu'il est dans la nature des choses? De ce que les règles en sont plus faciles, ce n'est pas une raison pour le supprimer. - Parce que je ne veux pas, répondit Antoine, m'arrêter à tous les genres de discours, même les moins importants, que l'orateur peut avoir à traiter, et faire supposer qu'il ne peut ouvrir la bouche, sans tout cet attirail de préceptes. Par exemple, on est souvent obligé de rendre témoignage, et quelquefois avec étendue, comme je le fis quand je déposai contre Sex. Titius, citoyen turbulent et séditieux. Je rappelai la conduite que j'avais tenue pendant mon consulat, la lutte que j'avais soutenue pour l'intérêt de la république contre ce tribun factieux, tout ce qu'il avait fait lui-même de contraire au bien de l'État. Cette affaire dura longtemps; j'eus beaucoup à entendre, beaucoup à répondre. Croyez-vous pour cela qu'en traitant de l'éloquence, il faille donner des règles et une méthode sur la manière de déposer en justice? - Non, sans doute. XII. - Si, comme il arrive sauvent aux personnages du premier rang, on est chargé par un général de quelque message auprès du sénat; si le sénat vous envoie transmettre ses ordres à un général, à un roi, à une nation, il faudra, dans une circonstance semblable, employer une élocution plus soignée; mais irons-nous pour cela établir un genre et donner des préceptes particuliers? - Nullement. En pareil cas, l'habitude de la parole et la connaissance générale de l'art oratoire seront des ressources suffisantes. - Il en est de même de tous les sujets qui exigent le talent de la parole, et qui, comme je le disais tout à l'heure, en faisant l'éloge de l'éloquence, rentrent dans le domaine de l'orateur : ils n'ont pas de place, dans la division des genres, ils ne sont pas soumis à des préceptes déterminés; cependant ils demandent autant de soin que les plaidoyers. Tels sont les reproches, les exhortations, les consolations : ces différentes matières exigent tous les ornements de l'élocution; mais elles n'ont pas besoin des préceptes de l'art. - Je suis tout à fait de votre avis. - Ne croyez-vous pas aussi, reprit Antoine, que pour écrire l'histoire il faut être orateur, et posséder un grand talent? - Oui, sans doute, pour l'écrire comme l'ont fait les Grecs; mais pour l'écrire comme nos Romains, il n'est pas besoin d'être éloquent ; il suffit de ne pas mentir. - Ne méprisez pas nos compatriotes; les historiens grecs ont commencé eux-mêmes par ressembler à notre Caton à Fabius Pictor, à Pison. Écrire l'histoire, ce n'était d'abord que faire des annales. C'est pour cet objet, c'est pour conserver les souvenirs publics, que, dès les premiers temps de Rome, jusqu'au grand pontife P. Mucius, le grand pontife recueillait tous les événements de chaque année, et les écrivait sur une table blanchie qu'il exposait dans sa maison, afin que le peuple pût la consulter. Voilà ce qu'on nomme encore aujourd'hui les grandes Annales. Plusieurs historiens ont suivi cette manière : ils se contentaient de consigner les époques, les noms des personnages et des lieux, la mémoire des faits, sans y joindre aucun ornement. Tels avaient été parmi les Grecs Phérécyde, Hellanicus, Acusilas et beaucoup, d'autres; tels furent à Rome Caton, Pison et Fabius Pictor. Ils ignorent le secret d'embellir le discours, et ce secret, en effet, n'a été importé que depuis peu de temps parmi nous; uniquement jaloux de se faire comprendre, ils ne connaissent d'autre mérite que celui de la précision. Antipater, cet estimable ami de Crassus, a pris un ton plus élevé, et donné plus de dignité à l'histoire: les autres ne songent pas à orner les faits, ils se contentent de les rapporter. XIII. - Vous avez raison, dit Catulus; toutefois ce même Antipater n'a pas su donner de l'intérêt à l'histoire par la variété des couleurs, ni par l'arrangement des mots, ni par le charme d'un style doux et coulant; peu versé dans la littérature, peu éloquent, il ne prêta à l'histoire que quelques ornements grossiers : il n'en est pas moins, comme vous le dites, supérieur à ceux qui l'ont précédé. - Ne nous étonnons pas si, dans notre langue, ce genre ne s'est pas encore élevé à un plus haut degré de perfection. A Rome, on n'étudie l'éloquence que pour briller à la tribune et au barreau; chez les Grecs, au contraire, les hommes les plus éloquents, libres de cette ambition, cherchèrent à s'illustrer par d'autres travaux, et s'adonnèrent surtout à écrire l'histoire. Hérodote, qui le premier y porta les ornements de la diction, ne fut jamais orateur; cependant son éloquence me frappe, et autant que je puis sentir le mérite d'un ouvrage grec, j'éprouve à le lire un plaisir extrême. Thucydide, qui vint après lui, surpassa tous les autres, à mon avis, par l'art de sa composition. Chez lui la pensée est tellement abondante, qu'il présente presque autant d'idées que de mots; il y a tant de justesse et de précision dans son style, qu'on ne sait si l'expression ajoute à la pensée, ou si c'est de la pensée qu'elle tire son éclat. Mais quoiqu'il ait pris part aux affaires publiques, on ne voit pas qu'il ait jamais plaidé, et il ne composa son ouvrage qu'après sa retraite, et lorsque, subissant le sort commun de tous les grands d'Athènes , il eut été comme tant d'autres condamné à l'exil. Après lui parut Philistus de Syracuse, qui fut intimement lié avec Denys le tyran. Il consacra tous ses loisirs à écrire l'histoire, et parait avoir surtout pris Thucydide pour modèle. Ensuite deux hommes d'un talent supérieur, Éphore et Théopompe, sortis de l'école féconde d'Isocrate, s'adonnèrent à ce genre, encouragés par les leçons de leur maître; mais ils ne plaidèrent ni l'un ni l'autre. XIV. La philosophie produisit encore deux historiens, Xénophon, cet illustre élève de Socrate, et Callisthène, disciple d'Aristote, et compagnon d'Alexandre. La manière de Callisthène est presque oratoire; le ton de Xénophon est plus simple; il n'a pas l'entraînement de l'orateur; mais s'il est moins véhément, il me semble aussi que son style a plus de charme et de douceur. Timée, qui parut après eux tous, eut, autant que j'en puis juger, une érudition beaucoup plus étendue; son fonds est plus riche, ses pensées plus abondantes; son style même ne manque pas d'art; mais écrivain très éloquent, il ne parut jamais au barreau. Lorsque Antoine eut ainsi parlé . - Eh bien ! dit César, que vous en semble, Catulus, où sont ceux qui prétendent qu'Antoine ne sait pas le grec ? que d'historiens il vient de nous citer! avec quelle vérité, avec quelle justesse il a caractérisé chacun d'eux! - J'en suis surpris comme vous, dit Catulus; mais je l'étais bien plus, qu'un homme dépourvu de ces connaissances eût pu être aussi éloquent; et, a cet égard, mon étonnement vient de cesser. - Il est vrai, mon cher Catulus, reprit Antoine, que je lis quelquefois ces auteurs et d'autres de la même nation ; mais ce n'est pas pour me perfectionner dans l'art de la parole; c'est uniquement pour charmer mes loisirs. Me sont-ils donc inutiles? Non; de même qu'en me promenant au soleil, je vois bientôt mon teint se hâler, quoiqu'en sortant de chez moi telle ne fût pas mon intention; ainsi quand je lis attentivement ces ouvrages, à Misène (car à Rome je n'en ai pas le temps), je m'aperçois que leur style donne de la couleur au mien. Mais pour que vous n'ayez pas une trop grande idée de mon savoir, je vous dirai que mon intelligence des auteurs grecs se borne à ce qu'ils ont bien voulu mettre à la portée du vulgaire. Lorsque je veux entreprendre de lire vos philosophes, séduit par les titres de leurs livres, qui annoncent ordinairement des sujets clairs et bien connus, tels que la vertu, la justice, l'honnêteté, le plaisir, je n'y comprends absolument rien, tant ils sont hérissés de discussions sèches et subtiles. Quant aux poètes, ils ont pour ainsi dire un langage à part, et je ne cherche pas à m'élever jusqu'à eux. Je m'amuse, comme je vous l'ai dit, avec ceux qui nous ont transmis l'histoire des temps passés, ou qui ont laissé par écrit les discours qu'ils avaient prononcés, enfin avec les auteurs qui, en s'exprimant clairement, semblent avoir voulu s'accommoder à l'intelligence d'hommes aussi peu savants que moi. Mais je reviens à mon sujet. XV. Ne voyez-vous pas que l'histoire exige tous les talents de l'orateur? Je ne sais si aucun autre ouvrage a besoin d'un style plus rapide et plus varié. Cependant je ne trouve point dans les rhéteurs de préceptes particuliers sur ce genre.; c'est qu'en effet les règles en sont évidentes. Qui ne voit que les principales lois de l'histoire sont de ne jamais rien dire de faux, d'avoir le courage de ne rien taire de vrai, d'éviter, jusqu'au soupçon de la faveur ou de la haine? Tels sont les premiers fondements de l'édifice, et il n'est personne qui ne les connaisse : les matériaux sont les faits et les mots. L'exposition des faits exige l'ordre exact des temps, la description des lieux; et comme dans les événements importants qui méritent d'être transmis à la postérité, on veut connaître la pensée qui les a préparés, puis l'exécution, et enfin le résultat, l'écrivain doit d'abord énoncer son opinion sur l'entreprise elle-même; ensuite faire connaître non seulement tout ce qui s'est dit et fait, mais encore de quelle manière; et quant au résultat, en indiquer fidèlement les causes, en faisant la part du hasard, de la prudence ou de la témérité. Il ne se contentera pas non plus de rapporter les actions des personnages célèbres; il s'attachera aussi à peindre leurs moeurs et leur caractère. Le ton du discours doit être doux et facile, le style coulant et soutenu, sans cette âpreté qui convient au barreau, sans ces traits énergiques dont l'orateur anime son discours à la tribune. Sur tous ces points si importants, trouve-t-on un seul précepte dans les livres des rhéteurs? Ils ont gardé le même silence sur plusieurs autres parties de l'art oratoire, comme les exhortations, les consolations, les instructions, les avertissements. Tous ces genres demandent beaucoup d'éloquence; mais les rhéteurs ne les font pas figurer dans leurs traités. Toutefois ils nous ouvrent une carrière immense, en divisant, comme le disait Crassus, l'art oratoire en deux genres, l'un qui renferme les questions particulières et déterminées, comme les discussions judiciaires, ou les délibérations publiques, auxquelles on peut ajouter, si l'on veut, les panégyriques; l'autre, reconnu par tous les rhéteurs, sans qu'aucun l'explique, a pour objet les questions où l'on ne détermine ni le temps, ni les personnes; et les auteurs qui l'admettent ne paraissent pas en connaître la nature et l'étendue. Si toutes les questions indéfinies sont du domaine de l'orateur, il faudra donc pour prétendre à ce titre, discourir sur la grandeur du soleil et, la figure de la terre; on ne pourra se dispenser de traiter ce qui concerne les mathématiques et la musique; enfin, celui qui se croit obligé d'embrasser, non seulement tous les objets de discussion où les temps et les personnes sont spécifiés, comme les causes judiciaires, mais encore les questions dont la nature est indéterminée, celui-là trouvera qu'il n'est aucun sujet qui ne rentre dans ses attributions. XVI. Si nous assignons à l'orateur un domaine si vaste, des fonctions si vagues et si étendues; si nous lui imposons l'obligation de parler sur le bien et le mal, sur ce qu'il faut désirer ou fuir, sur ce qui est honnête ou déshonnête, utile ou inutile, sur la vertu, la justice, la continence, la prudence, la grandeur d'âme, la générosité, le piété, l'amitié, la bonne foi, les devoirs, enfin, sur toutes les vertus et tous les vices; si nousvoulons qu'il y joigne encore tout ce qui a rapport à la politique, au gouvernement, à la guerre, à l'administration, aux moeurs des hommes, j'y consens, pourvu qu'il se renferme dans de justes bornes. A la vérité, rien de ce qui regarde les actions et la conduite des citoyens, les habitudes de la vie, les intérêts de la république, la société civile, le sentiment commun des hommes, les mœurs, la nature, n'est, selon moi, étranger à l'orateur: non pas qu'il doive développer chacun de ces sujets à la manière des philosophes; mais il faut qu'il sache les faire entrer habilement dans une cause, et qu'il soit en état d'en parler comme ceux qui ont fondé le droit, les lois, les cités, c'est-à-dire, d'une manière simple et claire, sans y mêler la sécheresse de l'analyse, et l'ennui des discussions. Mais, pour qu'on ne s'étonne pas si je n'établis aucun précepte pour tant d'objets importants, je dirai qu'il en est ici comme dans les autres arts, où, lorsqu'on a donné des règles sur les parties les plus difficiles, il est inutile d'en donner sur celles qui sont plus aisées, ou qui rentrent dans les premières. Ainsi, dans la peinture, l'élève qui aura bien appris à représenter la figure de l'homme, pourra lui donner l'âge et les traits qu'on voudra, sans avoir besoin d'autres leçons; et il n'est pas à craindre que celui qui saura bien rendre un lion ou un taureau, ne puisse réussir à peindre tout autre quadrupède. Il n'y a point d'art où les préceptes puissent s'étendre à tous les détails; mais quand une fois on possède les principes généraux, on n'a point de peine à descendre aux applications particulières. Il en est de même dans l'éloquence: lorsque par l'étude ou l'expérience on s'est mis en état de discuter les affaires de la république, de défendre ses propres intérêts ou ceux de ses clients, et de combattre ses adversaires avec un talent capable d'émouvoir, d'entraîner à son gré ceux de qui la décision pourra dépendre, on n'est pas plus embarrassé pour exprimer tout ce qu'on veut dire, que ne le fut Polyclète, en travaillant à son Hercule, pour rendre l'hydre ou la peau de lion, quoiqu'il n'eût jamais fait un étude particulière de ces détails. XVII. - Il me semble, Antoine, dit alors Catulus, que vous avez parfaitement établi quelles sont les choses dont l'orateur doit s'instruire; quelles sont celles que les connaissances antérieurement acquises le dispenseront d'étudier spécialement : vous réduisez sa carrière à deux genres seuls; et pour les autres, qui sont innombrables, vous le renvoyez à l'expérience et à l'analogie. Mais prenez garde que ces deux genres ne soient l'hydre et la peau de lion, et que l'Hercule et la partie la plus difficile du travail ne se trouvent justement dans ce que vous dédaignez d'enseigner. Il n'est pas plus aisé, je crois, de traiter des questions générales que des causes particulières; et il me semble même qu'il est beaucoup plus difficile de discourir sur la nature des dieuxque sur les querelles des hommes. - Je suis persuadé du contraire, répondit Antoine, et ce que je vais dire n'est pas seulement le résultat de mes études, mais ce qui est plus décisif, celui de mon expérience. Toutes les autres sortes de discours, croyez-moi, sont un jeu pour l'homme qui a quelque talent naturel, l'habitude de la parole, un degré d'instruction ordinaire, et une certaine teinture des lettres. Mais venir disputer le prix dans la lutte périlleuse du barreau, c'est une grande entreprise et peut-être le plus noble effort de l'esprit humain. Là, une multitude ignorante juge le plus souvent du talent de l'orateur par le succès qu'il obtient; là, se présente un adversaire armé, qu'il faut frapper et repousser; là, votre sort est dans les mains d'un juge irrité ou prévenu, votre ennemi, ou l'ami de votre partie adverse : il faut l'instruire ou le détromper, l'exciter ou le retenir, le gouverner par la parole, en variant vos moyens selon la circonstance et la nature de la cause; le ramener de la bienveillance à la haine, et de la haine à la bienveillance; enfin, le remuer comme par des ressorts, et le faire passer tour à tour de la joie à la tristesse, de la sévérité à l'indulgence. Il faut employer ce que les pensées ont de plus élevé, les expressions de plus fort, et joindre à tout cela une action variée, véhémente, pleine de chaleur, de pathétique et de naturel. L'orateur assez habile pour atteindre à de pareils effets, et qui, comme Phidias, aura pu faire une Minerve, n'aura pas besoin de leçon pour les parties moins relevées de son art, pas plus que n'en eut besoin ce grand artiste pour ciseler le bouclier de la déesse. XVIII. - Plus vous exaltez l'éloquence et ses merveilles, dit Catulus, plus je suis curieux de connaître par quels moyens on peut parvenir à cette hauteur. Ce n'est pas que je veuille faire usage de vos préceptes : mon âge ne me permet plus d'y songer; et d'ailleurs j'ai toujours suivi une méthode différente. Je n'ai jamais arraché aux juges, par la véhémence de mes paroles, une sentence favorable; mais sans faire violence à leurs âmes, je me suis contenté de les laisser prononcer dans la calme de leur conscience. Si je vous interroge en ce moment, ce n'est donc pas pour mettre à profit vos leçons, mais uniquement pour satisfaire ma curiosité. Je me garderai bien de m'adresser à quelque docteur grec, qui viendrait m'étourdir de préceptes rebattus, sans avoir jamais vu le barreau, ni assisté à une plaidoirie, semblable au péripatéticien Phormion. Annibal, exilé de Carthage, s'étant retiré à Éphèse, auprès d'Antiochus, on le pressa d'aller entendre ce philosophe, dont on lui vanta beaucoup le talent : il y consentit. L'infatigable orateur disserta pendant plusieurs heures sur les devoirs du général, et sur toutes les parties de l'art militaire. Les auditeurs, enchantés, demandèrent au Carthaginois ce qu'il en pensait : Annibal répondit, sinon avec l'urbanité grecque, du moins avec franchise, qu'il avait vu bien des vieillards radoteurs, mais qu'il n'en avait jamais rencontré d'aussi extravagant que Phormion. Assurément il avait raison; car, je le demande, n'était-ce pas le comble de l'impudence et du ridicule, à ce Grec bavard, qui de sa vie n'avait vu ni camp, ni ennemi, qui n'avait jamais exercé le moindre emploi public, d'oser donner des leçons sur l'art militaire à un général qui avait disputé si longtemps l'empire du monde au peuple vainqueur de toutes les nations? Il me semble que c'est là l'histoire de tous ceux qui se mêlent d'enseigner l'éloquence, et d'apprendre aux autres ce qu'ils n'ont pas eux-mêmes pratiqué. S'ils sont moins ridicules, c'est qu'ils entreprennent seulement d'instruire la jeunesse, et qu'ils ne s'avisent pas de faire des leçons à un Antoine, comme Phormion à un Annibal. XIX. - Vous êtes dans l'erreur, Catulus : j'ai déjà rencontré plus d'un Phormion. Est-il un seul de ces docteurs grecs, qui s'imagine que nous autres Romains nous entendions quelque chose à l'éloquence? Cependant j'ai pour eux de l'indulgence; je les souffre sans me fâcher, et les écoute patiemment. Si ce qu'ils disent est utile, je suis bien aise de les entendre, et dans le cas contraire, je regrette moins mon ignorance. Je ne les traite pas avec autant de dureté qu'Annibal traita le péripatéticien : aussi ai-je plus de peine à m'en débarrasser; mais j'avoue qu'autant que j'en puis juger, leurs théories me paraissent fort ridicules. Ils divisent les matières traitées par l'orateur en deux genres, auxquels ils donnent les noms de cause et question. Ils entendent par cause une discussion particulière, et qui tombe sur des faits; et par question, une discussion générale et indéfinie. Ils établissent des préceptes sur le premier de ces genres, et ne disent pas un mot du second. Ils assignent ensuite cinq parties à l'éloquence : trouver les idées, les mettre en ordre, les revêtir de l'expression, les graver dans la mémoire, enfin les faire valoir par un débit convenable. Voilà certes un grand mystère. Est-il donc quelqu'un qui ne voie par lui-même qu'on ne peut parler avec succès, si l'on ne sait d'avance ce qu'on veut dire, en quels termes et dans quel ordre il faut le dire, et si les idées ne sont bien rangées dans la mémoire? Je ne blâme pas ces divisions; mais je prétends qu'elles sautent aux yeux, ainsi que les quatre, cinq, six ou même sept parties qu'ils admettent dans le discours; car les rhéteurs ne sont pas d'accord sur le nombre. Il faut, disent-ils, vous concilier en commençant la bienveillance de l'auditeur, le rendre docile et attentif; ensuite exposer les faits dans une narration vraisemblable, claire et précise; diviser la question et la présenter sous son véritable jour; appuyer la cause par des preuves, renverser les raisonnements de l'adversaire. Quelques rhéteurs placent ensuite la conclusion ou péroraison; selon d'autres, avant de conclure, il est à propos d'insérer une digression, destinée à donner plus de force et d'ornement à la cause, et de ne passer qu'après à la péroraison. Je ne désapprouve pas non plus cette distribution : elle paraît bien ordonnée; mais au fond elle manque d'exactitude, comme on doit s'y attendre de la part de ces hommes sans expérience. Les règles qu'ils approprient à l'exorde et à la narration s'appliquent également à toutes les parties du discours. En effet, dans le cours du plaidoyer, je trouve plus naturellement le moyen de me concilier la bienveillance du juge, que lorsqu'il ne connaît encore rien à la cause; si je puis espérer de le rendre docile, ce n'est pas en lui promettant de l'instruire des faits, mais en les exposant, en les mettant sous ses yeux; et quant à l'attention, les premières phrases seraient insuffisantes pour la captiver : il faut la tenir sans cesse en haleine. Ils disent que la narration doit être vraisemblable, claire et précise, et ils n'ont pas tort; mais ils se trompent quand ils veulent que ces trois qualités conviennent plus à cette partie du discours qu'à toutes les autres. Leur erreur vient de ce qu'ils confondent la rhétorique avec les autres sciences, telles que le droit civil, par exemple. Là, comme Crassus l'observait hier, on divise d'abord par genres, ensuite par espèces, et on ne saurait sans un grand inconvénient rien oublier, ou rien mettre de superflu dans la division, enfin, on donne des définitions si exactes, qu'on ne peut ajouter ni retrancher un seul mot. Mais si dans le droit civil, et dans d'autres sciences d'une moindre importance, les plus habiles peuvent atteindre à cette précision rigoureuse, il n'en est pas de même, suivant moi, de l'art oratoire, dont le champ est si vaste. Ceux qui ne partagent pas cette opinion peuvent s'adresser aux rhéteurs de profession; ils trouveront tous ces objets expliqués et traités dans leurs détails; car nous avons sur ces matières une multitude de livres qui n'ont rien d'obscur et sont à la portée de tout le monde. Mais qu'ils y prennent bien garde : est-ce pour la parade ou pour le combat qu'ils demandent des armes? Autre chose est une bataille réelle, autre chose les exercices de la palestre et du champ de Mars. Cependant l'art de l'escrime sert au soldat, ainsi qu'au gladiateur; mais ce qui rend l'homme invincible, c'est la vivacité, la présence d'esprit, la pénétration, la souplesse, et l'art s'y joint aisément. XX. Pour moi, si j'avais à former un orateur, j'examinerais d'abord de quoi il est capable. Je veux qu'il ait quelque teinture des lettres, qu'il ait suffisamment écouté, suffisamment lu, qu'il ait même appris toutes les règles dont je viens de parier. Je le mettrai à l'épreuve, pour juger de l'effet de ses traits et de son extérieur, de sa voix, de sa prononciation, de la force de ses poumons. Si je crois qu'il puisse s'élever aux premiers rangs, je l'engagerai à entrer dans la carrière ; je l'en conjurerai même, si de plus il me paraît homme de bien, tant je suis persuadé qu'un orateur éloquent et vertueux peut contribuer à la gloire de tout un État. Si je reconnais qu'avec beaucoup d'efforts il n'atteindra qu'à la médiocrité, je lui laisserai suivre son inclination sans chercher à le contrarier. Enfln, si la nature lui a refusé toutes les dispositions pour l'éloquence, je lui conseillerai de renoncer à ses projets, et de s'attacher à quelque autre profession. Nous devons, en effet, exciter, animer par tous les moyens les hommes dont nous espérons d'éclatants succès, et ne point décourager ceux qui n'en promettent que de médiocres : les premiers, par leur génie, semblent s'approcher de la divinité; les seconds peuvent, ou renoncer à ce qu'ils ne font pas absolument bien, ou faire ce qu'ils ne font pas absolument mal, et cette médiocrité est dans la nature humaine; mais se livrer à un vain babil, en dépit de sa faiblesse et de son impuissance, c'est faire ce que vous disiez, Catulus, d'un impertinent déclamateur, c'est assembler la multitude à son de trompe, pour avoir le plus de témoins possible de sa sottise. Je vais donc m'adresser à celui qui mérite d'être encouragé; je vais lui apprendre, puisque je n'en sais pas davantage, ce que m'a enseigné l'expérience, afin de le guider, si je puis, jusqu'au terme où je suis moi-même arrivé sans guide. XXI. Et pour commencer par notre ami Sulpicius, que vous voyez ici, la première fois, Catulus, que je l'entendis, il était très jeune encore, et plaidait dans une cause peu importante : sa voix, ses traits, son maintien, tout en lui annonçait un homme né pour l'éloquence; son discours était impétueux et animé, ce qui venait de son naturel; son style avait trop d'abondance et de luxe, ce qui tenait à son àge : je conçus de lui un heureux augure. J'aime à voir dans la jeunesse cet excès de fécondité : on peut émonder facilenient les ceps qui poussent avec trop de vigueur; mais il n'est pas de culture qui puisse ranimer une vigne ingrate et stérile. De même je veux trouver dans un jeune talent quelque chose à retrancher. Les fruits qui parviennent trop vite à leur maturité ne conservent pas longtemps leur saveur. Je devinai aussitôt ce beau talent; je l'exhortai à prendre le barreau pour son école, à choisir le modèle qu'il voudrait, en ajoutant que, s'il m'en croyait, ce serait Crassus. Il saisit cette idée, m'assura qu'il suivrait mon avis, et ajouta, par politesse sans doute, que je serais aussi un de ses maîtres. Un an s'était à peine écoulé depuis cet entretien : il accusa C. Norbanus dont je fus le défenseur, et vous n'imagineriez pas combien il s'était perfectionné dans ce court espace de temps. La nature toute seule le portait déjà à la manière noble et grande de Crassus; mais ses heureuses dispositions eussent été insuffisantes, si uniquement occupé d'étudier, de contempler, de reproduire son modèle, il ne l'eût pas eu sans cesse présent à l'esprit et à la pensée. XXII. Voici donc le premier point de ma méthode : j'indique à mon élève le modèle qu'il doit choisir; je veux qu'il étudie avec soin ses bonnes qualités; qu'il s'exerce ensuite à les imiter, à les reproduire, mais non à la manière de ces malheureux copistes, comme j'en ai vu beaucoup, qui ne s'attachent qu'à ce qu'il y a de plus facile à saisir, souvent même aux bizarreries et aux défauts. Rien n'est plus aisé que de copier quelqu'un dans son maintien, dans ses gestes, dans l'arrangement des plis de sa toge; ce n'est pas un grand mérite que de s'approprier ce qu'il a de vicieux et d'imiter ses imperfections. Ce Furius, par exemple, qui même après qu'il a perdu la voix, trouble encore la république par ses fureurs, ne pouvant atteindre à la vigueur de Fimbria, ne lui ressemble que par les contorsions de son visage, et la pesanteur de sa prononciation. IL a choisi un mauvais modèle; encore n'en a-t-il pris que les défauts. Je le répète donc : si l'on veut réussir, il faut d'abord être très sévère dans le choix de son modèle; et quand une fois on en a pris un, s'étudier à imiter ce qu'il y a de plus parfait en lui. Pourquoi, en effet, remarquons-nous à chaque génération d'hommes, pour ainsi dire, un genre particulier d'éloquence? Il est moins aisé de vérifier cette observation chez nos orateurs, qui nous ont laissé trop peu d'écrits pour qu'on puisse en faire la comparaison; mais les ouvrages des Grecs indiquent le goût et l'esprit dominant de chaque siècle. Les plus anciens dont nous ayons les écrits, Périclès, Alcibiade, et Thucydide leur contemporain, ont de la précision, de la finesse, de la rapidité, et plus d'abondance dans les idées que dans l'expression. Il n'y aurait pas entre eux cette conformité, s'ils n'avaient pas suivi le même modèle. Après eux vinrent Critias, Théramène, Lysias : nous avons beaucoup d'ouvrages de ce dernier; Critias en a laissé quelques-uns; Théramène ne nous est connu que par ce qu'en disent les auteurs. Ils avaient tous conservé la vigueur de Périclès, mais avec une manière un peu plus large. Ensuite vous voyez paraître Isocrate , le maître de tous les orateurs grecs, et dont l'école, semblable au cheval de Troie, semble n'avoir enfanté que des héros; mais parmi ses disciples, les uns se distinguèrent dans l'éloquence d'apparat, les autres surent combattre. XXIII. Les premiers, comme Théopompe, Éphore, Philistus, Naucrate, et beaucoup d'autres, différents par le génie, se ressemblent tous par une manière commune, qui est celle de leur maître; les autres, qui se sont livrés à la plaidoirie, comme Démosthène, Hypéride, Lycurgue, Eschine, Dinarque, et une foule d'autres, n'ont pas, il est vrai, un égal mérite; mais ils se rapprochent tous par un point commun, le naturel et la vérité; et cette manière s'est conservée tant qu'ils ont eu des imitateurs. Après leur mort, le souvenir de leur talent s'effaça et disparut insensiblement; l'éloquence devint plus molle et plus faible. C'est l'époque où parurent Démocharès, qui fut, dit-on, fils d'une soeur de Démosthène; Démétrius de Phalère, à mon avis le plus brillant des orateurs de son temps, et beaucoup d'autres qui leur ressemblèrent. Si l'on veut descendre jusqu'à nos jours, on remarquera que Ménéclès d'Alabanda, et son frère Hiéroclès, que j'ai entendus tous deux, servent de type à toute l'Asie, et que dans tous les temps il y a toujours eu quelque modèle sur lequel presque tous les autres ont voulu se former. Pour parvenir à cette ressemblance, résultat de l'imitation, il faut un long et laborieux exercice; il faut surtout perfectionner son style en écrivant beaucoup. Si notre ami Sulpicius suivait cette méthode, ses discours en seraient plus nerveux. Maintenant on y remarque, comme dans les terrains trop fertiles, une certaine exubérance que la plume doit réprimer. - Vous me donnez, dit Sulpicius, un excellent conseil, et je le revois avec plaisir; mais vous-même, Antoine, je ne pense pas que vous ayez jamais pris la peine de beaucoup écrire. - Croyez-vous donc, reprit celui-ci, que je ne puisse recommander aux autres ce que je ne fais pas moi-mème? On m'accuse aussi de ne point tenir de registre pour mes affaires domestiques. L'état de ma maison répond à ce reproche, et quant à l'autre, mon style, quelque médiocre qu'il soit, peut faire voir si je le mérite. On voit à la vérité des hommes qui n'imitent personne, et qui, sans modèle, sans autre guide qu'un heureux naturel, s'ouvrent eux-mêmes une route glorieuse. Je puis, César et Cotta, vous citer tous deux pour exemple : l'un de vous a un enjouement piquant et plein de grâce, qu'on ne trouve chez aucun de nos orateurs; l'autre s'est formé une manière délicate et ingénieuse. Curion, qui est de votre âge, ne paraît pas non plus s'assujettir à suivre un modèle, quoique son père ait été, à mon avis, le plus éloquent de ses contemporains. Par le choix, l'abondance et la noblesse de ses expressions, il s'est fait un genre d'éloquence qui n'appartient qu'à lui. J'ai pu en juger lorsqu'il plaida contre moi devant les centumvirs la cause des frères Cossus : il déploya toutes les ressources d'un talent brillant, et toutes les qualités d'un orateur profond. XXIV. Mais produisons enfin notre jeune orateur dans des causes sérieuses, dans celles même qui présentent des complications et des difficultés, comme les procès et les débats judiciaires. On rira peut-être du conseil que je vais donner; en effet, il n'a guère d'autre mérite que celui de l'utilité , et il prouve plutôt le bon sens que le génie du maître : ce que je recommande d'abord à mon élève, c'est, quelque cause qu'il ait à traiter, de l'étudier avec soin et de la connaître à fond. On ne donne pas ce précepte dans les écoles, parce qu'on n'y propose aux jeunes gens que des causes faciles. La loi défend aux étrangers de monter sur les murs de la ville: "un étranger y monte, repousse les ennemis; on l'accuse." Le point de la question est bientôt saisi; et les maîtres peuvent se dispenser de faire un précepte particulier de l'étude des causes, puisque celles qu'ils imaginent sont toutes à peu près de ce genre. Mais au barreau, les actes, les témoignages, les conventions, les contrats, les stipulations, les degrés de parenté, d'affinité, les arrêts des tribunaux, les réponses des jurisconsultes, enfin les mœurs et la vie tout entière de ceux qui sont intéressés dans l'affaire; que de choses à approfondir! C'est pour avoir négligé ce soin que nous voyons perdre une multitude de causes, surtout les causes privées, qui sont ordinairement les plus obscures. Plusieurs avocats, dans le désir de se faire valoir, et afin de persuader qu'ils sont accablés d'affaires, et qu'ils volent, pour ainsi dire, de tribunaux en tribunaux, plaident leurs causes sans les étudier. Iis méritent par là d'être accusés ou de négligence, pour donner si peu de soin aux affaires dont ils se chargent, ou d'infidélité, pour répondre si mal à la confiance de leurs clients. Cette pratique leur est, sous un autre rapport, plus funeste qu'ils ne pensent; car on ne peut que fort mal parler de choses qu'on ne connaît pas. Ainsi, tandis qu'ils s'inquiètent peu du reproche de paresse, le plus grave pourtant selon moi, ils s'en attirent un autre, qu'ils redoutent davantage, celui de manquer de talent. Pour moi, j'ai soin que mon client m'instruise lui-même de sa cause : je lui parle sans témoins, pour qu'il puisse s'expliquer plus librement; je plaide la cause de sa partie adverse afin de le forcer à plaider la sienne, et à me communiquer toutes ses idées. Lorsqu'il s'est retiré, je me charge de trois rôles différents, et, avec la plus rigoureuse impartialité, je me mets successivement à la place du défenseur, de la partie adverse, du juge. S'il se présente quelque moyen favorable aux intérêts de mon client, je m'y arrête et m'en empare; j'écarte au contraire, et je rejette tous ceux qui seraient plus nuisibles qu'utiles. Ainsi, je ne plaide jamais une affaire qu'après l'avoir préalablement méditée. Beaucoup d'orateurs, se reposant sur leur génie, font ces deux choses à la fois; mais assurément ils parleraient un peu mieux s'ils prenaient un temps pour réfléchir sur leur cause, un autre temps pour la plaider. Lorsque je suis bien pénétré de l'affaire, je m'applique aussitôt à saisir le point à juger. En effet, dans tout ce qui peut faire la matière d'une contestation parmi les hommes, qu'il s'agisse d'une accusation et d'un délit, d'un procès sur un héritage, d'une délibération sur l'utilité ou les désavantages d'une guerre, qu'il soit question d'un éloge ou d'une discussion sur un point de morale, il faut examiner ce qui s'est fait, se fait, ou se fera; quelle est la nature de la chose débattue, et comment on doit la qualifier. XXV. Les causes criminelles se défendent ordinairement en niant les faits. Dans les accusations de concussion, qui sont très graves, il faut nier presque toujours ; dans celles de brigue, on cherche à distinguer (ce qui est rarement possible) les largesses faites par générosité et par bienveillance, de celles qui n'ont pour but que d'obtenir les suffrages; s'il s'agit d'assassinat, d'empoisonnement, de péculat, il est nécessaire de nier. Ces causes roulent sur l'existence de faits antérieurs, et forment le premier genre. Les délibérations ont ordinairement rapport à l'avenir; rarement elles s'appliquent à une chose présente ou passée. Souvent il s'agit de connaître, non pas la vérité d'un fait, mais sa nature. Je citerai pour exemple le consul C. Carbon, que j'entendis plaider devant le peuple la cause de L. Opimius. Il ne désavouait pas le meurtre de C. Gracchus, mais il soutenait que sa mort avait été juste et salutaire. Telle fut aussi la réponse de Scipion l'Africain à ce même Carbon, alors tribun du peuple, et qui jouant un rôle bien différent, l'interrogeait sur la mort de Tibérius Gracchus : Scipion déclara qu'elle lui paraissait légitime. On se justifie sur les faits de ce genre, en disant qu'ils étaient permis, utiles ou nécessaires, ou qu'ils sont arrivés par hasard ou par imprudence. On traite la question de dénomination, lorsqu'il s'agit de donner à un fait le nom qui lui convient. Ce fut sur ce point qu'il y eut une contestation si vive entre Sulpicius et moi, dans l'affaire de Norbanus. J'avouais la plupart des faits; mais je soutenais qu'il n'y avait point de crime lèse-majesté, et de ce nom seul dépendait toute la cause, d'après la loi Apuléia. Quelques rhéteurs veulent que dans ce genre de causes on commence par une définition claire et précise du mot qui forme la difficulté. Cette règle me semble puérile. Il n'est pas besoin ici de définitions aussi rigoureuses que celles qu'emploient les savants dans leurs discussions, lorsqu'ils recherchent, par exemple, ce que c'est qu'un art, ce que c'est qu'une loi, ce qui constitue une république. La méthode scientifique exige alors qu'on définisse d'une manière exacte et précise, sans rien omettre, et sans rien dire de trop. C'est ce que ni Sulpicius ni moi, nous n'essayâmes de faire dans cette cause. Nous eûmes soin, au contraire, de développer tous deux, avec toutes les ressources de l'amplification, ce qui constituait à nos yeux le crime de lèse-majesté. Nous savions, en effet, qu'il suffit de la plus légère erreur, d'un seul mot retranché ou ajouté dans une définition, pour la faire tourner contre nous; de plus, cette manière sent l'affectation et le pédantisme de l'école ; et elle ne pénètre pas dans l'esprit du juge, qui oublie votre définition, avant même de l'avoir saisie. XXVI. Dans les causes où il s'agit de qualifier un fait, il faut souvent interpréter un écrit, et la contestation alors ne roule que sur l'équivoque qui s'y peut présenter. Il y a équivoque, lorsque le sens littéral est en contradiction avec la pensée de celui qui a rédigé l'écrit : on l'éclaircit en suppléant à la lettre, et on établit ensuite que le sens n'est plus douteux. Si l'ambiguïté naît de la contradiction de deux écrits, ce n'est pas un nouveau genre de cause, mais comme une répétition du précédent; car, ou l'on ne pourra pas résoudre la difficulté, ou, si on peut le faire, on n'y parviendra qu'en suppléant les mots nécessaires pour compléter l'écrit que l'on défend. Ainsi toutes les causes qui roulent sur des écrits peuvent se réduire à un seul genre, les écrits équivoques. Parmi les différentes sortes d'équivoque, mieux connues des dialecticiens que des orateurs, qui ne devraient cependant pas les ignorer, la plus commune, dans les paroles ou dans les écrits, est celle qui naît de l'omission d'un ou de plusieurs mots. Les rhéteurs ont également tort de faire deux genres distincts des causes où il s'agit d'interpréter un écrit, et de celles où l'on recherche quelle est la qualité d'une chose; car si jamais on s'occupe de la qualification d'une chose, c'est quand il s'agit d'un écrit, question absolument indépendante de la question de fait. Toutes les causes peuvent donc se réduire à trois genres : la question de fait qui embrasse le présent, le passé ou l'avenir; la nature du fait, et enfin sa dénomination. Les causes où l'on discute si une chose est bien ou mal, et dont quelques rhéteurs grecs font un genre particulier, rentrent dans la seconde division. XXVII. Mais je reviens à ma méthode. Lorsque j'ai reconnu le genre de ma cause, et qu'il s'agit de la traiter, mon premier soin est de chercher quel est le but où doit tendre tout mon discours, et comment je dois l'approprier à la question actuelle. J'étudie ensuite deux choses avec attention : le moyen de prévenir les juges en ma faveur et en faveur de mon client, et celui de faire passer dans leurs âmes les sentiments que je veux leur inspirer. Ainsi les règles de l'art oratoire peuvent se réduire à trois points : prouver la vérité de l'opinion qu'on veut faire prévaloir, se concilier la bienveillance des auditeurs, faire naître en eux les impressions qui conviennent à l'intérêt de la cause. Quant aux preuves, elles sont de deux sortes : les unes ne sont pas imaginées par l'orateur; il les trouve dans le sujet, et les fait valoir par le raisonnement : tels sont les actes écrits, les dépositions des témoins, les conventions, les contrats, les interrogatoires, les lois, les sénatus-consultes, les arrêts des tribunaux, les ordonnances, les décisions des jurisconsultes, et autres choses semblables, que l'orateur n'invente pas, et qui lui sont fournies par la cause même, ou par son client. Les autres preuves consistent dans la discussion des moyens, et dans l'argumentation de l'orateur. Ainsi, dans le premier cas, il s'agit de mettre en oeuvre des matériaux tout prêts; dans le second, il faut faire plus, il faut les créer. Les rhéteurs qui divisent les causes en un plus grand nombre de genres, assignent à chacun des preuves particulières. Cette méthode peut être utile aux jeunes gens; elle met aussitôt des moyens à leur disposition pour toutes les causes qui pourront leur être présentées; elle leur fournit d'avance comme une provision d'arguments; mais c'est avoir l'esprit borné que de s'attacher aux ruisseaux sans remonter aux sources. A notre âge, et avec notre expérience, nous devons nous élever plus haut, et considérer les principes. Et d'abord, quant aux preuves qui sont fournies à l'orateur, nous devons, par nos méditations et nos études, nous être mis d'avance et pour toujours en état de nous en servir dans tous les cas analogues; car on a tous les jours à parler pour ou contre des actes écrits, pour ou contre des dépositions de témoins, pour ou contre des interrogatoires, etc., soit d'une manière générale, soit lorsque le temps, les personnes et les causes sont déterminés. Vous devez (je dis cela pour vous Sulpicius et Cotta) , vous devez faire de ces lieux une étude profonde, afin de les avoir à votre disposition et d'y recourir au besoin. Il serait trop long de développer ici les moyens d'affaiblir ou de fortifier les preuves tirées d'un témoignage, d'un acte, d'un interrogatoire. Tout cela demande peu de talent, mais beaucoup d'habitude du barreau. Les préceptes de l'art ne sont applicables à cette partie que lorsqu'on veut y introduire les ornements de l'élocution. Les preuves qu'invente l'orateur ne sont pas difficiles à trouver, mais elles ont besoin d'être présentées avec élégance et clarté. Dans toutes les causes, il faut d'abord chercher ce qu'on doit dire, et ensuite comment on le dira. De ces deux parties, la première, qui consiste à trouver le fonds des idées, et où il semble que l'art doive être pour beaucoup, a bien un peu besoin en effet du secours de l'art; mais elle n'exige cependant qu'une médiocre habileté: quant à la seconde, où il s'agit d'orner les pensées d'une diction riche et variée, c'est là que triomphe ce talent sublime que nous appelons éloquence. XXVIII. Puisque vous l'exigez, je consens à vous parler de la première partie : je la développerai le mieux qu'il me sera possible; avec quel succès, vous en jugerez. Je vous indiquerai les sources d'où l'orateur tire les idées propres à produire les trois effets dont la réunion seule persuade, plaît, instruit, touche. Quant à l'art d'embellir le discours par l'expression, nous voyons devant nous un homme qui peut l'enseigner à tous : c'est lui qui le premier l'a introduit dans l'éloquence romaine, qui l'a perfectionné, qui seul en a donné des modèles. Oui, Catulus, je puis parler ainsi, sans craindre d'être soupçonné de flatterie : je ne pense pas qu'il y ait de nos jours un seul orateur grec ou romain, un peu célèbre, que je n'aie entendu souvent et avec beaucoup d'attention; et si j'ai quelque talent (j'oserais le croire, puisque des hommes tels que vous mettent tant de complaisance à m'écouter), je le dois à ce que jamais un orateur n'a parlé devant moi, sans que son discours soit resté gravé dans ma mémoire : eh bien ! tel que je suis, et avec quelque droit peut-être de prononcer en pareille matière, après avoir entendu tous les orateurs, je déclare et j'affirme, sans hésiter, qu'aucun d'eux n'a possédé à un aussi haut degré que Crassus les richesses de l'élocution. Si donc vous pensez comme moi, vous trouverez bon que je fasse un partage égal, et qu'après avoir créé, pour ainsi dire, nourri, élevé l'orateur, tel que je m'en fais l'idée, je le remette aux mains de Crassus, pour qu'il prenne soin de le vêtir et de le parer. - Continuez, dit Crassus, comme vous avez commencé : est-il donc d'un père tendre et généreux de ne pas vêtir, de ne pas parer lui-même l'enfant qu'il a mis au monde, et qu'il a élevé, surtout lorsque, comme vous, il ne peut pas nier son opulence. Quel genre de beauté, de force, de pathétique, de dignité, peut-il manquer à l'orateur qui, à la fin d'un plaidoyer, osa faire lever du banc des accusés un vieillard consulaire, déchirer sa robe, et montrer aux juges les cicatrices glorieuses des blessures qu'il avait reçues en commandant les armées? qui, défendant un forcené, un séditieux contre les accusations de Sulpicius, osa faire l'apologie des séditions, et soutenir dans les termes les plus énergiques, que bien souvent les soulèvements du peuple ne sont pas injustes; qu'il en est dont personne ne peut répondre; que beaucoup de séditions même ont eu lieu dans l'intérêt de la république, comme celles qui amenèrent l'expulsion des rois, et l'établissement de la puissance tribunitienne; que cette sédition de Norbanus, produite par la douleur des citoyens, et la haine publique contre Cépion, qui avait perdu l'armée, était juste dans son principe, et qu'il n'avait pas été possible de la réprimer. Pour traiter une matière si délicate, si hardie, si difficile, si neuve, ne fallait-il pas une puissance de talent extraordinaire? n'avez-vous pas su exciter aussi la compassion en faveur de Cn. Manlius, et de Q. Rex? Enfin, dans mille autres circonstances, n'avez-vous pas fait briller, non seulement la merveilleuse étendue d'esprit que tout le monde vous accorde, mais ce talent même dont vous voulez me faire honneur, et que vous avez toujours possédé à un degré si éminent? XXIX. - Pour moi, dit Catulus, ce que je ne me lasse pas d'admirer en vous, c'est qu'ayant tous deux un genre d'éloquence si différent, votre talent soit néanmoins si parfait, que vous semblez réunir tous les dons de la nature à toutes ies ressources de l'art. Ne nous privez donc pas, Crassus, du charme de votre élocution, en refusant d'expliquer ce qu'Antoine aura oublié, ou omis à dessein; et vous, Antoine, si vous laissez quelque chose à dire, nous ne supposerons pas que ce soit insuffisance de votre part; nous croirons que vous avez mieux aimé nous le faire entendre de la bouche de Crassus. - Crassus reprit : Que ne laissez-vous de côté, Antoine, ce que vous nous annonciez tout à l'heure, je veux dire les lieux d'où se tirent les arguments des causes? Personne ici n'en a besoin. Vous traiteriez sans doute ce sujet d'une manière neuve et intéressante; mais c'est une chose facile, et les préceptes en sont communs. Découvrez-nous plutôt les sources où vous puisez ces ressources puissantes dont vous faites un si fréquent et si merveilleux usage. - J'y consens, dit Antoine, et je ne veux rien vous refuser, afin d'être plus en droit d'exiger à mon tour. Tout le secret de ma composition, et de ce talent de parole que tout à l'heure Crassus élevait si haut, consiste, comme je l'ai déjà dit, dans ces trois points : plaire, instruire, émouvoir. De ces trois points, le premier demande un ton doux et insinuant; le second, un esprit pénétrant; le troisième, des mouvements pathétiques. Pour que le juge soit amené à prononcer en notre faveur, il faut, ou que sa propre inclination l'y porte, ou que la force de nos arguments l'y détermine, ou que de profondes émotions l'y contraignent. Mais comme la partie du discours qui contient l'exposé et la défense du fait paraît comprendre tout ce qu'on peut dire à ce sujet, j'en parlerai d'abord en peu de mots; car les observations que mon expérience et ma mémoire me fournissent sur ce sujet ne sont pas en grand nombre. XXX. Je suivrai votre sage conseil, Crassus; je ne m'arrêterai pas à cette série d'applications particulières que les rhéteurs enseignent à leurs élèves; je remonterai aux préceptes généraux d'où se tirent les raisonnements pour tous les genres de causes et de discours. Si nous avons à tracer un mot, il n'est pas nécessaire que nous portions successivement notre pensée sur toutes les lettres qui le composent. De même, quand nous plaidons une cause, nous n'avons pas besoin de passer en revue tous les arguments qui peuvent s'y rapporter : il suffit d'avoir en réserve certains lieux communs, qui viennent nous aider à développer la cause, comme les lettres de l'alphabet se présentent à nous, lorsque nous voulons écrire. Mais l'orateur ne peut tirer parti de ces lieux communs, s'il n'a acquis la connaissance des affaires , soit par l'expérience, que l'âge seul peut donner, soit par les leçons et la méditation, qui, à l'aide du travail et de l'étude, suppléent à l'expérience. Supposez l'homme le plus instruit, qui, à un esprit vif et pénétrant, joigne la plus heureuse facilité; s'il est étranger à nos coutumes, à l'histoire, aux institutions, aux moeurs et aux goûts de ses concitoyens, ces lieux communs, où l'on puise les arguments, ne lui seront que d'une faible utilité. Mais donnez-moi un génie formé par la culture; semblable à un champ où la charrue a passé plusieurs fois, il produira les fruits les plus beaux et les plus abondants. L'usage du barreau, l'habitude des modèles, la lecture, la composition, voilà en quoi consiste la culture du génie. En premier lieu, l'orateur doit rechercher la nature de la cause : elle est facile à connaître, soit qu'il s'agisse d'examiner si un fait a eu lieu, d'en déterminer la qualité, ou la dénomination. Ensuite le simple bon sens indiquera, sans toutes les subtilités des rhéteurs , quel est le point principal de la cause, celui sans lequel il n'y aurait plus lieu à discussion; enfin sur quoi les juges ont à prononcer. Voici comment les rhéteurs vous enseignent à le chercher. Opimius a tué Gracchus. Où est le point de la cause; c'est qu'il a agi dans l'intérêt de la république, et après avoir appelé le peuple aux armes, en vertu d'un sénatus-consulte. Ôtez cette circonstance, il n'y a plus de procès. Mais Décius prétend que le meurtre n'était pas autorisé par les lois. Voici donc le point à décider : le sénatus-consulte, l'intérêt de la république, rendent-ils ce meurtre légitime? Cette question est facile et à la portée de tout le monde; mais il nous reste à chercher quels sont les arguments dont l'accusateur et le défenseur doivent faire usage pour débattre le point contesté. XXXI. C'est ici le lieu de relever l'erreur grossière de ces maîtres de rhétorique chez qui nous envoyons nos enfants : non que leur méprise ait au fond une grande influence sur l'éloquence; mais elle vous fera voir le peu de jugement et de lumières de ces hommes qui se croient si habiles. Ils reconnaissent deux genres de causes : l'un renferme les questions générales, et on n'y spécifie ni les temps, ni les personnes; dans l'autre, les temps et les personnes sont déterminés : et ils ne voient pas que toute discussion peut se ramener à une question générale. Ainsi, dans la cause dont je viens de parler, les arguments de l'orateur sont indépendants de la personne d'Opimius et de celle de Décius. La proposition est générale, indéfinie : "Doit-on être puni pour avoir tué un citoyen en vertu d'un sénatus-consulte, et en vue de sauver la république, bien que le meurtre soit défendu par les lois?" On peut dire qu'il n'est aucune cause où le point à juger dépende tellement de la personne de l'accusé, qu'elle ne puisse être envisagée sous un point de vue général. C'est ce qu'on voit même dans les questions de fait, comme dans celle-ci : P. Décius a-t-il reçu de l'argent contre les lois? Les moyens de l'accusation et de la défense se rapporteront nécessairement à des considérations générales : on traite de la profusion, si l'accusé est prodigue; de la cupidité, s'il est avide du bien d'autrui; des mauvais citoyens, des hommes turbulents, s'il est factieux; de la validité des témoignages, si les accusateurs sont nombreux. Dans la défense, il faudra pareillement ramener tous les raisonnements, de la considération des temps et des personnes, à des propositions d'un ordre commun et universel. L'homme qui n'a pas la vue assez étendue pour saisir d'un coup d'oeil la nature des choses, pourra croire que, dans l'examen d'un fait, les points litigieux sont nombreux et compliqués. Cependant si le nombre des sujets d'accusation est infini, il n'en est pas de même des lieux et des moyens de défense. XXXII. Lorsqu'il s'agit de qualifier un fait dont l'existence est admise, si le nombre des genres se calcule sur les différentes sortes d'accusés, ils sont compliqués et infinis; si on les compte d'après les choses en elles-mêmes, ils sont peu nombreux et faciles. Si nous réduisons la cause de Mancinus à la personne même de Mancinus, il y aura une cause nouvelle toutes les fois qu'un citoyen, livré par le chef des féciaux, n'aura pas été reçu par l'ennemi; mais si l'affaire est ramenée à cette question : Un citoyen, livré par le chef des féciaux, et qui n'aura pas été reçu, rentre-t-il à son retour dans ses droits? le nom de Mancinus ne fait plus rien, ni à la forme du discours, ni au choix des arguments. En outre les moyens qui peuvent se tirer des bonnes ou des mauvaises qualités de la personne, sont étrangers à la question ; mais cette partie même de la plaidoirie se rapporte encore nécessairement à une proposition générale. En parlant ainsi, mon dessein n'est pas d'attaquer le savoir des maîtres; mais je ne puis les approuver, lorsque dans leurs définitions ils réduisent ces sortes de causes à la considération des personnes et des temps. Sans doute il faut tenir compte des circonstances et des personnes; mais ce n'est pas là ce qui constitue la cause : elle est tout entière dans la question générale. Au surplus, peu m'importe : je ne dois rien avoir à débattre avec les rhéteurs. Il me suffit de faire voir que, malgré tout leur loisir, ils n'ont pas même réussi dans la seule chose où l'expérience du barreau n'était pas nécessaire, je veux dire à distinguer les genres, et à les exposer avec méthode; mais, encore une fois, peu m'importe. Ce qui m'intéresse davantage, et vous encore plus, Sulpicius et Cotta, c'est que si l'on admet la doctrine de ces rhéteurs, il nous faudra reculer devant la multitude des causes; car le nombre en est infini. Si on les fait consister dans les personnes, il y aura autant de genres que d'individus. Si au contraire on les rapporte à une proposition générale, elles se réduisent à un si petit nombre, qu'un orateur attentif, laborieux et doué d'une bonne mémoire, doit les avoir toutes présentes à l'esprit, et les savoir par coeur; car vous ne vous figurez pas sans doute que dans l'affaire de M. Curius, Crassus n'ait employé que des arguments personnels à son client, pour prouver que Curius n'en était pas moins l'héritier de Coponius, quoiqu'il ne fût pas né de fils posthume au testateur. Les noms de Curius et de Coponius n'influaient en rien sur la nature de la cause et la force des preuves. La question était générale, indépendante du temps et des personnes; et comme le testament portait : S'il me naît un fils, et qu'il meure avant, etc., un tel sera mon héritier; la question était de savoir si l'héritier, institué au cas que le fils mourût, restait encore l'héritier, quoiqu'il ne fût pas né de fils. Une question semblable, qui repose sur un droit invariable et sur une proposition générale, n'a pas besoin, pour être traitée, du nom des personnes, mais du talent de la parole et de la connaissance des preuves. XXXIII. Mais ici les jurisconsultes viennent à leur tour nous jeter dans l'embarras, et nous dégoûter de l'étude de leur art. Brutus et Caton ne manquent presque jamais de citer nominativement dans leurs livres tous ceux, hommes ou femmes, qui les ont consultés sur quelque point de droit. Ils voulaient, sans doute, nous faire croire que la difficulté consistait dans la personne et non dans la question, pour nous effrayer par cette multitude infinie de cas, et nous faire perdre le désir en même temps que l'espérance d'apprendre le droit. Mais Crassus nous débrouillera un jour ce chaos, en généralisant les préceptes; car vous saurez, Catulus, qu'il nous a promis hier de réduire en un corps de doctrine, et de renfermer dans des divisions plus précises les règles du droit qui, maintenant, sont éparses et confuses. - Ce ne sera pas, dit Catulus, une tâche difficile pour Crassus, qui a appris du droit tout ce qu'on peut en apprendre, et qui pourra suppléer à ce qui manquait à ses maîtres : il saura tout à la fois tracer l'exposé complet de la science et l'embellir des ornements du style. - Ainsi, reprit Antoine, nous irons apprendre le droit auprès de lui, lorsqu'il aura quitté, comme il en a fintention, le tumulte des affaires pour les douceurs de la retraite, et les bancs du barreau pour le siége du jurisconsulte. - Il est vrai, dit Catulus, que j'ai souvent entendu dire à Crassus qu'il était décidé à renoncer au barreau; mais je lui ai toujours répondu qu'il n'en aurait pas la liberté. Il ne pourra voir tant de bons citoyens implorer vainement son secours; Rome ne le souffrira pas : elle croirait perdre son plus bel ornement, si elle n'entendait plus cette voix éloquente. - Sur ma parole, répliqua Antoine, si Catulus dit vrai, vous et moi, mon cher Crassus, il nous faudra ramer éternellement sur la même galère, et laisser le repos et le sommeil à la science non-chalante des Scévola, et des autres heureux qui leur ressemblent. - Crassus dit en souriant : Achevez, Antoine, la tâche que vous avez commencée; quant à moi, je saurai bien, dans cette science nonchalante dont vous parlez, trouver quelque jour un asile et ma liberté. XXXIV. Antoine continua : J'ai achevé ce que je me proposais, puisqu'il est convenu que tous les points de discussion dépendent, non des personnes qui sont innombrables, ni des circonstances qui peuvent varier à l'infini, mais du genre et de la nature des causes, dont lé nombre est non seulement limité, mais même peu étendu, et que ceux qui s'adonnent à l'art oratoire peuvent embrasser tout d'un coup leur sujet, de quelque genre qu'il soit, avec toutes ses divisions, ses moyens, ses ornements, du moins quant au fond des choses et aux pensées. Les pensées amèneront naturellement les expressions, qui, à mon avis, seront toujours assez ornées, si elles semblent naître du fond même du sujet. A vous dire vrai, je pense (car je ne puis rien affirmer, si ce n'est que telle est mon opinion), je pense que nous devons toujours nous présenter au barreau armés de cette provision de causes et de questions générales, et ne pas attendre qu'on nous charge d'une affaire pour aller fouiller les lieux communs afin d'en tirer des arguments : avec du travail et de l'habitude, il suffira d'un peu de réflexion pour trouver toujours ces arguments sous sa main ; toutefois il faut d'abord reporter notre pensée à ces points généraux, à ces lieux, comme je les ai déjà souvent appelés, qui peuvent nous fournir des ressources infinies pour toute espèce de discours. Ainsi tout le secret, qu'on l'appelle art, observation ou pratique, consiste à bien connaître le pays où l'on vent chasser et aller à la découverte : lorsque par la pensée vous vous en serez rendu maître, pour peu que vous ayez de pratique et d'expérience, rien ne vous échappera, et tout ce qui tient au fond du sujet se présentera de soi-même, et viendra frapper vos yeux. XXXV. L'invention oratoire exige trois choses ; le génie, la méthode, que nous appellerons art, si nous voulons, et l'application. Sans doute, c'est au génie qu'appartient te premier rang ; mais lui-même il doit beaucoup à l'application, qui le soutient et l'anime. L'influence de l'application est toujours puissante; mais c'est au barreau qu'elle produit ses plus grands effets. Nous devons donc lui être surtout fidèles; c'est à elle qu'il faut sans cesse recourir; il n'est rien où elle ne puisse atteindre. Si nous parvenons, comme je l'ai dit plus haut, à approfondir notre cause, c'est à elle que nous le devons; si nous écoutons attentivement notre adversaire, si nous recueillons toutes ses pensées, et jusqu'à ses moindres paroles; si, à travers l'expression de son visage, nous pénétrons les sentiments cachés de son âme, c'est encore l'ouvrage de l'application; et ici la prudence nous avertit de dissimuler nous-mêmes nos observations, de peur de donner des armes contre nous. Enfin, c'est avec son secours que l'orateur parcourt ces lieux communs dont je parlerai bientôt, descend jusqu'au fond de sa cause, y concentre tous ses soins, toutes ses méditations; elle lui donne la mémoire pour le guider, comme un flambeau; elle anime sa voix, elle soutient ses forces; et ce sont là d'importants services. Entre le génie et l'application, il reste peu de place pour l'art. L'art nous montre seulement le point où nous devons diriger nos recherches; il nous mène à l'objet que nous voulons trouver : le reste dépend du soin, de l'attention, de la réflexion, de la vigilance, de l'assiduité, du travail, et pourtout renfermer dans le seul mot dont je me suis servi, de l'application; cette précieuse qualité comprend toutes les autres. Nous voyons, en effet, que la facilité de l'élocution ne manque pas aux philosophes, lesquels, je crois, et vous le savez mieux que moi, Catulus, ne donnent aucun précepte sur l'art oratoire, et pourtant s'engagent à parler avec fécondité et abondance sur tous les sujets qu'on peut leur proposer. XXXVI. - Vous avez raison, dit Catulus; la plupart des philosophes ne donnent aucun précepte sur l'éloquence, et ils sont toujours prêts à discourir sur quelque sujet que ce soit. Mais Aristote, celui que j'admire le plus, a établi certains lieux communs, où l'on peut puiser des arguments, non seulement pour les discussions philosophiques, mais même pour celles qui nous occupent au barreau. Il me semble que depuis quelque temps, Antoine, votre doctrine se rapproche de celle de ce grand homme, soit que la conformité de votre génie avec ce génie divin vous ait poussé dans la même route, ou bien, ce qui est plus probable, que vous ayez lu et étudié ses ouvrages; car je vois que vous vous êtes plus appliqué à la littérature grecque que nous ne l'avions cru jusqu'ici. - Je vous dirai la vérité, Catulus : j'ai toujours pensé qu'un orateur produirait plus d'effet sur le peuple, et s'en ferait entendre avec plus de plaisir, s'il montrait peu de connaissance de l'art en général, et surtout des lettres grecques. Mais en même temps il m'a semblé que de ne pas prêter l'oreille à ces Grecs, lorsqu'ils proclament de si belles théories et donnent de si éloquents préceptes; lorsqu'ils promettent d'enseigner aux hommes à pénétrer les matières les plus obscures, et leur donnent des règles pour bien vivre et pour bien dire, ce serait tenir de la brute plus que de l'homme; et que si l'on n'ose plus les écouter publiquement, afin de ne pas perdre son crédit auprès de ses concitoyens, il faut du moins suivre leurs leçons à la dérobée, et recueillir de loin leurs paroles. C'est ce que j'ai fait, Catulus, et, par ce moyen , j'ai pris une connaissance sommaire de leur doctrine, et des divisions de genre qu'ils ont établies. XXXVII. - Assurément, dit Catulus, vous avez été bien timide, Antoine, avec la philosophie. Vous l'avez abordée en tremblant, comme on s'approche d'un écueil dangereux pour la vertu. Cependant Rome ne l'a jamais méprisée. L'Italie était pleine de pythagoriciens, dans le temps où une partie de cette contrée s'appelait la grande Grèce; et quelques personnes ont cru même que notre ancien roi, Numa Pompilius, avait appartenu à la secte de ce philosophe, quoiqu'il lui soit de beaucoup antérieur. Nous devons l'en admirer davantage, puisqu'il posséda la science qui fonde les États près de deux siècles avant que les Grecs en connussent l'existence. Certes, jamais Rome n'a produit de citoyens plus illustres, plus recommandables par l'autorité de leur vertu, et par l'élégance de leurs manières, que Scipion l'Africain, C. Lélius, et L. Furius, qui eurent toujours auprès d'eux, sans en faire mystère, les hommes les plus éclairés d'entre les Grecs. Je leur ai souvent entendu dire qu'ils avaient vu avec une extrême plaisir, ainsi qu'un grand nombre des principaux personnages de la république, que les Athéniens, envoyant une députation pour défendre devant le sénat les plus graves intérêts de leur cité, eussent fait choix des trois plus célèbres philosophes de ce temps-là, Carnéade, Critolaüs et Diogène. Ils ajoutaient qu'eux-mêmes et beaucoup d'autres encore allaient fréquemment les entendre, tant que dura leur séjour à Rome; et je m'étonne, Antoine, qu'avec de pareilles autorités, vous ayez presque, comme le Zéthus de Pacuvius, déclaré la guerre à la philosophie.- Point du tout : je ressemble plutôt au Néoptolème d'Ennius, qui veut bien philosopher un peu, mais à qui trop de philosophie déplaît. Au surplus, voici mon opinion, que je croyais avoir suffisamment fait connaître - je ne désapprouve pas qu'on se livre à cette étude, pourvu que ce soit avec modération. Mais si l'orateur donne à penser qu'elle lui est familière et qu'il a recours à l'art, cette opinion lui nuit dans l'esprit des juges, elle diminue son autorité, elle rend ses paroles moins persuasives. XXXVIII. Mais pour en revenir au sujet qui nous occupait, vous savez que l'un de ces trois fameux philosophes dont vous rappeliez l'ambassade à Rome, Diogène, prétendait enseigner l'art de bien raisonner, et de distinguer le vrai du faux, art qu'en grec il appelait dialectique? Cet art, si c'en est un, ne donne pas de préceptes pour trouver la vérité, mais seulement des règles pour bien juger. Toute proposition est affirmative ou négative. Lorsqu'elle est simple, les dialecticiens entreprennent de juger si elle est vraie ou fausse, et quand elle est composée, de reconnaître si les propositions partielles sont justes et conséquentes, et si l'ensemble de chaque raisonnement est vrai. Puis, ils finissent par s'envelopper dans leurs propres subtilités; à force de chercher, ils rencontrent des difficultés que non seulement ils ne peuvent résoudre, mais qui renversent tout ce qu'ils avaient établi jusque-là. Votre stoïcien ne nous est donc d'aucun secours, puisqu'il ne nous apprend pas à trouver ce qu'il faut dire; il nous embarrasse même, en imaginant des difficultés, qui, de son propre aveu, sont insolubles. Son style, d'ailleurs, au lieu d'être clair, large et abondant, est sec, aride, maigre et coupé : on peut le goûter, mais on avouera du moins qu'il ne convient point à l'orateur. En effet, notre élocution, à nous, doit s'accommoder aux oreilles de la multitude; il faut qu'elle charme, il faut qu'elle entraîne ; et nos paroles ne sont pas faites pour être pesées au trébuchet du joaillier, mais dans la grande balance de l'opinion populaire. Laissons donc de côté cet art qui ne nous dit rien sur les moyens d'inventer, et qui ne tarit pas lorsqu'il s'agit de juger. Je crois que nous trouverons un meilleur guide dans Critolaüs, qui avait accompagné Diogène. Il appartenait à l'école d'Aristote, dont les idées vous semblent assez conformes aux miennes. J'ai lu l'ouvrage où ce grand homme examine tous les préceptes donnés avant lui; j'ai lu également ceux où il expose ses propres idées sur l'éloquence, et j'ai trouvé cette différence entre lui et les rhéteurs de profession : Aristote, avec ce génie pénétrant, qui lui avait fait découvrir les secrets de la nature, a approfondi les principes de l'art oratoire qu'il dédaignait; tandis que les rhéteurs, qui regardaient ce même art comme seul digne d'être cultivé, en y concentrant toute leur application, n'y ont pas apporté la même supériorité de vues, mais seulement des soins plus exclusifs, une étude plus longue et plus assidue. Quant à Carnéade, tous les orateurs devraient désirer sa merveilleuse puissance de parole, et son inépuisable variété. Dans les discussions auxquelles il se livrait, jamais il ne soutint une opinion sans l'établir victorieusement; jamais il n'en combattit une sans la renverser de fond en comble. Mais c'est là un talent fort au-dessus de ce qu'on est en droit d'exiger d'un simple rhéteur. XXXIX. Pour moi, si j'avais à former à l'éloquence un élève absolument neuf, je le mettrais de préférence entre les mains de ces ouvriers laborieux qui battent nuit et jour le fer sur la même enclume; je voudrais un maître qui lui coupât pour ainsi dire, la nourriture en petits morceaux, et la lui mît toute mâchée dans la bouche, comme font les nourrices aux petits enfants. Mais si mon élève a déjà recu de bons principes, s'il y joint quelque expérience, s'il annonce un esprit vif et pénétrant, je ne l'arrêterai pas à quelque obscur et faible ruisseau; je le conduirai à la source même d'où s'élance le grand fleuve; je veux qu'on lui montre le siège et comme le réservoir de tous les arguments; qu'on lui en donne une explication claire et précise. Peut-on être embarrassé sur le choix des moyens, lorsqu'on sait que, soit pour confirmer, soit pour réfuter, ils sont tous tirés, ou du fond et de la nature même du fait, ou des circonstances extérieures? Du fait, lorsqu'on l'examine dans son ensemble ou dans ses parties, dans sa qualification ou dans ses rapports; des circonstances extérieures, lorsque les preuves qu'on rassemble sont prises hors du sujet, et en sont indépendantes. Si l'on examine le sujet dans son ensemble, on en donne une définition générale; par exemple : «Si la majesté de l'État consiste dans la grandeur et la dignité, c'est se rendre coupable de lèse-majesté que de livrer une armée de la république aux ennemis, et non pas de remettre entre les mains du peuple romain un traître convaincu de ce crime.» Si l'on s'arrête aux parties du sujet, on en fait l'énumération; par exemple : «Il fallait, dans une affaire qui intéressait le salut de la république, ou obéir au sénat, ou former un autre conseil, ou agir de son propre mouvement : former un autre conseil, c'eùt été séditieuse prétention; n'écouter que soi, présomption arrogante : il fallait donc obéir au sénat.» Si l'on explique le sujet par l'étymologie, on dira comme Carbon : «Si celui-là est consul, qui consulte les intérêts de la patrie, Opimius a-t-il fait autre chose?» Lorsqu'on examine les rapports du sujet, on tire les arguments de plusieurs sources: car on cherche alors les rapprochements de même famille, les genres, les espèces, les analogies, les différences, les contraires, les antécédents, les concordances, les discordances, les causes, les effets , les rapports de supériorité, d'égalité, d'infériorité. XL. On emploie les mots de même famille, comme : «Si la piété mérite les plus grands éloges, peut-on n'être pas touché de la pieuse douleur de Q. Métellus ?» Le genre : "Si les magistrats doivent être soumis au peuple romain, pourquoi accusez-vous Norbanus, qui, pendant tout son tribunat, s'est conformé aux volontés de Rome?" L'espèce : «Si tous ceux qui rendent des services à la république doivent nous être chers, qui a plus de droits à notre amour que les généraux de nos armées, puisque c'est à leurs talents, à leur valeur, à leurs dangers que nous devons notre propre conservation, et la gloire de l'empire?» L'analogie : «Si les bêtes féroces aiment leurs petits, quelle ne doit pas être notre tendresse pour nos enfants?» La différence: «Si c'est le propre des barbares de vivre sans songer au lendemain, notre prévoyance doit embrasser l'avenir tout entier.» (Dans l'analogie, comme dans la différence, les exemples se tirent des actions des autres, de leurs paroles, des événements de leur vie; souvent même on a recours à des fictions.) Les contraires : «Si Gracchus était coupable, Opimius a fait une belle action.» Les conséquents : «Si cet homme a été tué d'un coup de poignard; si vous, son ennemi, vous avez été trouvé sur le lieu, un poignard sanglant à la main; si nul autre que vous n'a été vu dans le même endroit; si personne n'avait intérêt à commettre ce crime; si vous avez toujours donné des preuves d'audace, peut-on donner que vous ne soyez l'assassin?» Les concordances, les antécédents, les discordances, comme lorsque Crassus dit dans sa jeunesse : «Vous avez beau, Carbon, avoir défendu Opimius, on ne vous en croira pas pour cela meilleur citoyen. Vous feigniez alors; vous étiez guidé par quelque intérêt : nous n'en saurions douter, puisque dans vos harangues vous avez souvent déploré la mort de Tib. Gracchus; puisque vous avez été complice de celle de Scipion l'Africain; puisque pendant votre tribunat, vous avez porté la loi la plus séditieuse, et que vous avez toujours été en opposition avec les bons citoyens.» Les causes : «Si vous voulez détruire la cupidité, détruisez le luxe qui l'engendre.» Les effets : «Si le trésor public est le nerf de la guerre et l'ornement de la paix, occupons-nous d'assurer les revenus de l'État.» Les rapports de supériorité, d'égalité, d'infériorité. Exemple de supériorité : "Si la bonne renommée est préférable aux richesses, et si l'on recherche; les richesses avec tant d'empressement, de quelle ardeur ne doit-on pas être animé pour la gloire ?» Infériorité : Il est si affligé de la mort de cette femme, qu'il connaissait à peine : que serait-ce s'il l'eût aimée? que sera-ce quand il me perdra, moi, son père? Égalité: «Qu'on pille les trésors de l'État, qu'on fasse contre l'État de coupables largesses, le crime est le même. " Les arguments tirés des choses extérieures sont empruntés, non au fond de la cause, mais à des objets étrangers. Par exemple : «Cela est vrai, Q. Lutatius l'atteste.» - «Cela est faux; le résultat de l'enquête l'a prouvé.» - «Cette conséquence est nécessaire; je le démontre par la lecture des pièces.» J'ai traité plus haut de ce genre de preuves. XLI. Cette analyse rapide doit suffire. Si je voulais indiquer à quelqu'un de l'or enfoui en plusieurs endroits différents, il me suffirait de lui décrire les lieux avec les signes et les marques qui pourraient les lui faire reconnaître; ensuite, il n'aurait qu'à creuser le terrain pour y trouver sans peine et sans se tromper les trésors qu'il recèle. Ainsi, dès que je connais les signes distinctifs qui m'indiquent où sont les preuves dont j'ai besoin, l'étude et la réflexion font le reste. Il ne faut pas un grand effort de génie pour assigner à chaque genre de cause l'espèce de preuves qui lui convient, et l'esprit le plus médiocre saura faire ce discernement. D'ailleurs je ne prétends pas m'ériger ici en maître de rhétorique; j'ai voulu seulement développer devant des hommes instruits les observations que mon expérience m'a suggérées. Si donc l'orateur a imprimé ces lieux communs dans sa mémoire, s'il les a bien présents à l'esprit, de manière à pouvoir les mettre en oeuvre au premier besoin, il y trouvera un fonds inépuisable, soit pour les discussions du barreau, soit pour toute autre espèce de discours. Si de plus il parvient à ce résultat de paraître ce qu'il veut qu'on le croie, de remuer puissamment l'âme des auditeurs, de les conduire, de les entraîner à son gré, il ne lui manque rien de ce qui fait l'orateur. Nous savons qu'il ne suffit pas de trouver ce qu'on doit dire; il faut encore le traiter convenablement. La variété est ici nécessaire, pour cacher l'art aux auditeurs, et ne pas les rebuter par la monotonie. On énonce la proposition; ensuite on en donne la preuve; quelquefois on en tire les conséquences; d'autres fois on s'en dispense, pour passer à un autre objet; souvent, sans énoncer explicitement la proposition, on la fait sortir du développement même des preuves. Si vous voulez vous appuyer d'une comparaison, commencez par prouver la ressemblance; faites ensuite l'application à la question. En général, cachez le plus possible la division de vos preuves, afin qu'on ne puisse pas les compter : qu'elles soient distinctes au fond, mais qu'elles aient l'air d'être confondues dans le discours. XLII. J'ai traité cette matière en courant, et comme un homme médiocrement instruit, qui parle devant des auditeurs plus éclairés que lui j'avais hâte d'en venir à une partie plus essentielle. Le point le plus important pour l'orateur, c'est de s'attirer la faveur de ceux qui l'écoutent, c'est d'exciter en eux de fortes émotions, plutôt en jetant la passion et le trouble dans leurs âmes, qu'en s'adressant à leur raison; car les hommes, dans leurs décisions, cèdent bien plus souvent à l'influence de la haine ou de l'amour, du désir ou de la colère, de la douleur ou de la joie, de l'espérance ou de la crainte, de l'erreur ou de la passion, qu'à la vérité, à la raison, aux règles du droit, à l'autorité des arrêts, à la voix des lois. Je vais donc vous entretenir de ce sujet, à moins que vous n'en préfériez quelque autre. - Il me semble, dit Catulus, qu'il manque quelque chose à ce que vous venez d'exposer, et qu'il faudrait épuiser cette matière avant de passer à celle que vous avez en vue. - Et qu'est-ce donc? - C'est de nous apprendre quel est l'ordre que vous préférez dans la disposition des arguments; car j'ai toujours trouvé que dans cette partie vous aviez un talent divin. - Voyez, Catulus, comme mon talent est divin : je n'aurais jamais songé à ce point, si vous ne me l'eussiez rappelé. Ainsi vous pouvez croire que si j'y ai quelque succès, je le dois à l'habitude, à la pratique, ou plutôt au hasard. Ce n'est pas que cette partie, dont je n'ai point d'idée, et que j'oubliais, comme on passe devant un inconnu, ne soit d'une grande importance. Rien peut-être ne contribue davantage au succès de l'orateur. Mais il me semble que vous anticipez, et que ce n'est pas encore le moment d'en parler. Si j'avais fait consister toute la force de l'éloquence dans les arguments et les preuves, il faudrait maintenant nous occuper de l'ordre dans lequel on doit les ranger; mais puisque j'ai dit que l'éloquence a trois objets, et que je n'ai encore traité que de l'un des trois, quand j'aurai parlé des deux autres, j'en viendrai à l'ordre qui doit présider à la composition du discours. XLIII. C'est donc un puissant moyen de succès que de donner une idée avantageuse des mœurs, des principes, des actions, de la conduite de l'orateur et de son client; de faire prendre, sous les mêmes rapports, une opinion défavorable de l'adversaire; d'inspirer autant que possible à ses juges des sentiments de bienveillance et envers soi-même et envers celui dont on défend les intérêts. Or, ce qui inspire la bienveillance, c'est la dignité du caractère, ce sont les belles actions, c'est l'estime qu'inspire une vie irréprochable; toutes choses qu'il est plus facile d'embellir, lorsqu'elles existent, que de feindre si elles n'existent pas. L'orateur ajoute encore à leur effet par son ton, son air, sa réserve, la douceur de ses expressions : s'il se livre à une attaque un peu vive, il faut qu'il paraisse agir à regret et par devoir. Il faut que tout en lui annonce une humeur facile, la générosité, la douceur, la piété, la reconnaissance, jamais la passion ni la cupidité. Tout ce qui prouve une âme droite, un caractère modeste, sans aigreur, sans acharnement, ennemi des querelles et de la chicane, inspire de la bienveillance à l'auditeur, et l'indispose contre ceux qui ne possèdent pas ces qualités. Aussi ne faut-il pas manquer de faire ressortir dans l'adversaire les défauts opposés. Le ton que je recommande ici réussit surtout dans les causes où il n'y a pas lieu d'enflammer l'esprit des juges par des mouvements impétueux et passionnés. En effet, la véhémence ne convient pas toujours, et souvent un langage calme, doux et modéré, est ce qui sert le mieux les intérêts de notre client (reus) : j'appelle de ce nom, selon l'ancien usage, non seulement les accusés, mais tous ceux dont on a les droits à défendre. Si donc on représente son client comme un homme juste, intègre, religieux, paisible, souffrant patiemment les injures, on produit un effet merveilleux; et ce moyen, employé dans l'exorde, la narration ou la péroraison, et traité avec délicatesse, avec expression, est souvent plus puissant que la cause même : tel est l'effet d'un certain accent de sensibilité, d'un certain ton de langage, que le caractère de l'orateur se retrace dans ses paroles. Il est un choix de pensées et d'expressions qui, joint à une action douce, simple, naturelle, semble offrir l'image de la probité, des bonnes moeurs et de la vertu. XLIV. A côté de cette éloquence, il y en a une tout opposée, qui, en agissant sur l'esprit des juges par des ressorts différents, fait naître dans leur âme la haine ou l'amour, l'indignation ou l'intérêt, la crainte ou l'espérance, la sympathie ou l'éloignement, la joie ou la tristesse, la compassion ou la sévérité, en un mot tous les mouvements, toutes les impressions en rapport avec les diverses passions du coeur humain. Il est bien à souhaiter pour l'orateur, que les juges apportent spontanément à sa cause une disposition d'esprit conforme à ses intérêts; car, comme on dit, il est plus facile d'aiguillonner le coursier qui a pris son essor, que de mettre en mouvement celui qui est au repos. Mais si cette disposition n'est pas favorable, ou que je ne la connaisse pas encore, j'imite le médecin habile, qui, avant de prescrire aucun remède à son malade, s'informe avec soin, non seulement de la nature de sa maladie, mais encore de son tempérament et du régime qu'il suit en bonne santé. Ainsi, quand je suis chargé d'une cause douteuse, et dans laquelle je prévois que j'aurai de la peine à m'emparer de l'esprit des juges, j'emploie tous mes efforts, toutes mes pensées, toute ma pénétration à deviner leur opinion, leurs secrets sentiments, ce qu'ils désirent, ce qu'ils attendent de moi, et de quel côté l'orateur peut plus facilement les entraîner. S'ils s'abandonnent d'eux-mêmes, comme je le disais tout à l'heure, si leur inclination et leur penchant secondent l'impulsion que je leur donne, je profite de l'avantage qui m'est offert, et je m'empresse de présenter ma voile vers le côté où s'annonce un vent favorable. Si le juge est calme et sans passion, alors la tâche est plus difficile, et l'orateur ne pouvant plus compter sur le secours de la nature, est réduit à ses propres forces. Mais l'éloquence, qu'un poète distingué appelle avec raison la souveraine des coeurs et la reine de l'univers, a tant de force, qu'elle entraîne celui qui chancelle, ébranle celui qui se tient ferme, et, semblable à un capitaine habile et vaillant, se rend maîtresse de l'adversaire qui lutte et qui résiste. XLV. Tels sont les moyens que Crassus me pressait tout à l'heure d'exposer, lorsqu'il disait, en plaisantant sans doute, que je les maniais toujours avec un art divin, et quand il vantait si fort l'usage, admirable selon lui, que j'en ai fait dans la cause de M. Aquillius, dans celle de C. Norbanus, et dans plusieurs autres. Que dirai-je donc de vous, Crassus? quand vous faites agir ces mêmes ressorts dans vos plaidoyers, je ne puis vous entendre sans frémir : l'énergie, la véhémence, la douleur, éclatent si bien dans vos regards, dans vos traits, dans vos gestes, et jusque dans le mouvement de votre doigt; les expressions les plus nobles et les plus heureuses coulent de votre bouche à flots si abondants; vos pensées sont si justes, si vraies, si neuves, si naturelles, si exemptes de tout fard , de tout ornement puéril, que vous me semblez embrasé du même feu dont vous enflammez vos juges. Il est impossible que l'auditeur se livre à la douleur, à la haine, à l'indignation, à la crainte, à la compassion, aux larmes, si tous les sentiments que l'orateur veut communiquer aux juges, il n'en paraît d'abord lui-même rempli et profondément pénétré. S'il devait feindre la douleur, et si son discours n'exprimait rien que de faux et d'emprunté, il lui faudrait peut-être un art plus grand encore. Je ne sais point, Crassus, ce qui se passe en vous et dans les autres orateurs; pour moi, que nul motif ne porte à déguiser la vérité à des hommes si éclairés et qui me sont si chers, je le proteste, je n'ai jamais essayé d'inspirer aux juges la douleur, la pitié, l'indignation ou la haine, que je n'aie vivement ressenti les émotions que je voulais faire passer dans leur âme. Eh! comment le juge pourrait-il s'irriter contre votre adversaire, si vous êtes vous-même froid et indifférent; le haïr, s'il ne voit pas la haine dans vos regards; sentir de la compassion, si vos paroles, vos pensées, votre voix, vos traits, vos larmes enfin, ne font pas éclater votre douleur. Il n'est pas de matière si combustible qui s'enflamme si vous n'en approchez le feu; ainsi, les âmes, même les plus disposées à recevoir les impressions de l'orateur, ne s'animeront cependant du feu des passions, qu'autant que lui-même s'en montrera embrasé. XLVI. Et qu'on n'aille pas regarder comme un phénomène surprenant, que le même homme se livre si souvent aux transports de la haine ou de la douleur, et à tout autre mouvement de l'âme, surtout pour des intérêts qui lui sont étrangers. Telle est la force des pensées et des développements dont l'orateur fait usage, qu'il n'a pas besoin de feinte et d'artifice. La nature seule du discours destiné à remuer l'âme des autres agit plus fortement encore sur lui-même que sur aucun de ceux qui l'écoutent. Et qu'y a-t-il d'étonnant qu'on soit vivement ému lorsqu'on parle dans une cause solennelle, devant des juges assemblés, au milieu de ses amis en péril, d'un imposant auditoire, de ses concitoyens réunis, au grand jour du forum; lorsqu'il ne s'agit pas seulement de l'opinion qu'on prendra de notre talent (question secondaire sans doute, et qui cependant ne saurait être indifférente pour qui prétend à ce qui n'est qu'à la portée d'un petit nombre), mais quand d'autres intérêts bien plus puissants sont en jeu, l'honneur, le devoir, la conscience. Non, l'homme qui nous est le plus étranger, du moment que nous nous sommes chargés de sa cause, si nous voulons être tenus pour gens d'honneur, ne peut plus être un étranger pour nous. Mais pour revenir à ces émotions qui ne doivent pas nous surprendre dans l'orateur, y a-t-il rien qui ait moins de réalité que les vers, le théâtre, les fictions dramatiques? Et cependant, sur la scène, j'ai souvent vu les yeux de l'acteur étinceler à travers son masque, lorsqu'il prononçait ces paroles : As-tu bien osé l'abandonner, et revenir sans lui à Salamine? Quoi! tu n'as pas redouté les regards d'un père? Il ne prononçait jamais ce mot de regards, qu'il ne me semblât voir Télamon furieux de la mort de son fils, et égaré tout à la fois par la douleur et la colère. Et lorsqu'il reprenait d'un ton attendri : Tu as déchiré, désespéré, assassiné un père privé du soutien de sa vieillesse; tu as été insensible à la mort de ton frère, de son malheureux enfant, confié à tes soins; les larmes et les sanglots lui étouffaient la voix. Si un acteur qui représentait ce rôle tous les jours ne pouvait cependant le répéter sans être ému, pensez-vous que Pacuvius ait été calme et de sang-froid en l'écrivant? Non, sans doute. J'ai souvent entendu assurer (et cette opinion est énoncée, dit-on, dans les écrits de Démocrite et de Platon) qu'il n'y eut jamais de véritable poète sans enthousiasme et sans une inspiration qui tient du délire. XLVll. Pour moi, qui n'avais point à retracer les aventures fabuleuses et les malheurs imaginaires des héros de l'antiquité; moi qui n'empruntais point de masque, mais qui m'imposais un rôle bien réel; moi qui avais à sauver M. Aquillius de l'exil, croyez-le bien, j'étais sous l'impression d'une profonde douleur lorsque, dans la péroraison de mon discours, je fis ce qu'on me vit faire. En me rappelant que cet homme que je voyais abattu, plongé dans l'infortune et le désespoir, exposé au plus affreux péril, avait été consul, imperator, comblé d'honneurs par le sénat, et conduit en triomphe au Capitole, je ressentis le premier cette pitié dont je voulais pénétrer les autres. Je m'aperçus de l'impression profonde que je produisais sur les juges, lorsque, faisant lever de son siège ce vieillard triste et défait, la vive émotion de mon âme, bien plutôt que je ne sais quel art qui m'est inconnu, m'inspira ce mouvement que vous avez loué, Crassus, et que j'osai déchirer la robe de l'accusé, et montrer ses cicatrices. Quand Marius, qui siégeait parmi les juges, ajoutait encore par ses larmes au pathétique de mon discours; quand je ne cessais de l'interpeller pour lui recommander son collègue; quand j'implorais son appui pour soutenir une cause commune à tous les généraux; ce ne fut pas sans verser moi-même des larmes, sans éprouver une violente émotion, que j'exhalai mes plaintes, que j'invoquai les dieux et les hommes, les citoyens et les alliés; et si toutes mes paroles n'eussent été accompagnées d'une véritable douleur, loin de toucher des juges, mon discours n'eût excité que leurs risées. Ainsi donc, Sulpicius, voici le précepte que vous donne à vous autres jeunes gens, Antoine, ce profond, ce savant maître; c'est de pouvoir mêler à vos discours la colère, la douleur et les larmes. Mais avez-vous besoin même de ce précepte, vous qui, en accusant mon ami, mon questeur, avez su, non seulement par vos paroles, mais bien plus encore par votre véhémence, votre feu, votre pathétique, allumer dans l'auditoire un incendie tel que j'osais à peine m'avancer pour l'éteindre? Aussi tous les avantages étaient de votre côté dans cette cause : la violence faite à votre client, sa fuite, les pierres lancées contre lui, la cruauté dont le pouvoir tribunitien accablait son infortune, tout semblait appeler la vengeance publique. Il était constant que M. Émilius, le prince du sénat, le premier personnage de la république, avait été atteint d'une pierre, et personne ne pouvait nier que L. Cotta et T. Didius n'eussent été entraînés par force hors du temple, en voulant s'opposer à la loi. XLVIII. Vous aviez encore un autre avatage : c'était pour un jeune homme un rôle noble et glorieux de venir invoquer la justice au nom de la république, tandis que moi, après avoir été censeur, je pouvais à peine, sans manquer à toutes les bienséances, prendre la défense d'un séditieux coupable de cruauté envers un consulaire accablé par le malheur. Les citoyens les plus vertueux étaient nos juges; les gens de bien remplissaient le forum; il ne me restait qu'un léger motif d'excuse : l'homme que je défendais avait été mon questeur. Dirai-je que j'ai eu recours à l'art? Non; je raconterai comment je m'y suis pris, et vous serez libre de décider ensuite si l'on doit voir de l'art dans mon plaidoyer. Je rassemblai toutes les espèces de séditions, les excès, les dangers qu'elles entraînent; je traçai le tableau de toutes les révolutibns de notre république, et je conclus que si toutes les séditions avaient été fâcheuses, quelques-unes cependant furent légitimes et presque nécessaires. J'avançai ce que Crassus rappelait tout à l'heure, qu'on n'avait pu ni chasser les rois, ni instituer le tribunat, ni restreindre par tant de plébiscites la puissance consulaire, ni établir l'appel au peuple, cette sauvegarde de la république, ce palladium de la liberté, sans provoquer une vive résistance de la part des nobles ; que si ces séditions avaient fait le salut de Rome, il ne fallait pas, de ce qu'il avait pu s'élever un mouvement populaire, en faire un crime à Norbanus, et un crime capital. J'ajoutai que si quelquefois on avait reconnu au peuple le droit de se soulever, ce que je démontrai par des faits, jamais il n'en avait eu une cause plus légitime. Je donnai ensuite un autre tour à ma défense; je reprochai vivement à Cépion sa fuite honteuse; je déplorai le désastre de l'armée : par ce moyen, je ravivais la douleur de ceux qui avaient à pleurer la perte de quelques parents, et je réveillais dans le coeur des chevaliers romains, juges de cette cause, la haine dont ils étaient animés contre Cépion, qui avait voulu leur enlever le droit de juger. XLIX. Quand je sentis que je m'étais rendu maître de la cause et que le succès de mes moyens était assuré, que je m'étais concilié la bienveillance du peuple, en défendant ses droits, même jusqu'à celui de sédition; que j'avais tourné en ma faveur l'esprit des juges, en retraçant les malheurs de l'État, le deuil et les regrets de leurs pertes, et en rallumant leur haine personnelle contre Cépion, alors je fis succéder à la véhémence et au pathétique le ton doux et tranquille dont je vous ai parlé plus haut. Je représentai qu'il y allait pour moi du sort d'un ami, qui, selon les idées de nos ancêtres, devait m'être aussi cher que mes propres enfants; qu'il y allait de mon honneur et de ma fortune; que rien ne saurait être plus pénible à mon coeur, plus funeste à ma réputation, que si, après avoir défendu avec succès des accusés, mes concitoyens, il est vrai, mais qui souvent m'étaient entièrement étrangers, je ne pouvais être d'aucun secours à un ami; je priai les juges de me pardonner la juste et trop légitime douleur dont ils me voyaient pénétré, en considération de mon âge, de mes dignités, de mes services : ils avaient dû remarquer, ajoutais-je, que dans les autres causes, je les avais toujours implorés pour mes amis en péril, et jamais pour moi-même. Ainsi, dans tout le cours de ma défense, je traitai à peine, et ne fis qu'effleurer tout ce qui était du ressort de l'art, comme la loi Apuléia, la définition du crime de lèse-majesté; mais je m'attachai principalement à ces deux parties du discours, sur lesquelles l'art ne donne pas de préceptes, et dont l'une a pour objét d'entraîner l'esprit des juges, l'autre, de faire aimer et estimer l'orateur; autant je déployai d'énergie pour réveiller la haine contre Cépion, autant je montrai de douceur, de sensibilité, et de tendre affection pour mes amis. Ce fut ainsi, Sulpicius, que je triomphai de votre accusation, plutôt en excitant les passions des juges, qu'en portant la conviction dans les esprits. [2,50] L. - Votre récit, Antoine, est la vérité même, dit Sulpiclus. Jamais je n'ai rien vu s'échapper des mains comme cette cause s'échappa des miennes. Je vous avais donné, disiez-vous tout à l'heure, un incendie à éteindre, plutôt qu'un plaidoyer à combattre; mais, grands dieux! quel fut votre début! quelle timidité! quel embarras! quelle hésitation! comme vos paroles se succédaient lentement ! et quand vous eûtes bien établi, dès votre exorde, le seul point qui vous servait d'excuse, en disant que vous défendiez un ami, votre ancien questeur, comme vous sûtes vous préparer les voies pour commander l'attention ! Puis, quand je m'imaginais que tout ce que vous aviez gagné, c'était de vous faire pardonner d'avoir pris la défense d'un citoyen pervers, en faveur des liens qui vous unissaient à lui, vous vous insinuàtes peu à peu dans les esprits : on ne soupçonnait encore rien de vos desseins; moi je commençais à trembler. Enfin, vous en vîntes à prouver que cette sédition de Norbanus, ou plutôt cette colère du peuple romain, loin d'être injuste, était légitime et nécessaire. Comme alors vous vous fîtes des armes de tout contre Cépion! comme vous sûtes mêler, faire agir tout à tour la haine, la colère, la compassion, et cela non seulement pour défendre votre client, mais pour attaquer Scaurus et mes autres témoins, dont vous détruisîtes les dépositions, non en les réfutant, mais en vous appuyant encore sur l'effervescence populaire! Lorsque j'entendais ce que vous venez de nous développer; je ne songeais plus aux préceptes : cette exposition de votre méthode est, à mes yeux, la plus instructive de toutes les leçons. - Cependant, si vous le trouvez bon, reprit Antoine, je vous ferai connaître aussi les règles que je suis et les points principaux auxquels je m'attache dans mes plaidoiries. Une longue expérience et l'habitude des grandes affaires m'ont appris par quels ressorts on parvient à émouvoir les hommes. LI. J'examine d'abord si la cause comporte ces grands mouvements; car il ne faut pas employer les foudres de l'éloquence dans des sujets peu importants, ou devant des auditeurs tellement prévenus, qu'on ne saurait espérer de les fléchir. Ce serait se rendre ou ridicule ou odieux, que d'épuiser le pathétique sur des bagatelles, ou d'essayer d'emporter de vive force ce que nous ne pouvons pas même ébranler. Les sentiments qu'il nous importe le plus d'exciter dans l'âme des juges ou de nos auditeurs, quels qu'ils soient, sont l'amour, la haine, la colère; l'indignation, la pitié, l'espoir, la joie, la crainte, le déplaisir. Nous voyons que le moyen de nous concilier l'amour, c'est de paraître soutenir les intérêts de ceux devant qui nous parlons, et défendre des hommes honnêtes, ou du moins des hommes utiles et dévoués à nos juges. Dans ce dernier cas, nous nous faisons surtout aimer; dans le second, en prenant le parti de la vertu, nous inspirons l'estime et l'intérêt. On produit aussi plus d'effet, en faisant espérer un avantage à venir, qu'en rappelant un bienfait passé. Cherchez à faire voir dans votre cause de la grandeur ou de l'utilité; montrez que votre client n'a point eu en vue ses propres avantages et n'a rien fait pour lui-même. L'attachement à notre intérêt personnel choque et déplaît; on aime au contraire à trouver en nous cette disposition bienveillante qui s'empresse d'obliger. Toutefois, il y a ici un écueil à éviter; gardons-nous d'exalter outre mesure les services et la gloire de ceux que nous voulons faire aimer; par là on excite trop souvent l'envie. On se sert de moyens analogues pour attirer la haine sur sort adversaire, pour l'écarter de soi ou de son client; comme aussi pour enflammer ou apaiser la colère. En effet, on excite la haine des auditeurs, en faisant ressortir un fait qui leur est inutile ou pernicieux; et si l'on s'élève contre une action qui a blessé les gens de bien, ou les personnes qui méritaient le plus d'être respectées, ou enfin la république, on fait naître, sinon une haine violente, du moins une disposition qui en approche et un éloignement bien prononcé. Nous exciterons la crainte dans l'âme de ceux qui nous écoutent par le tableau de leurs dangers personnels ou des dangers publics. La crainte qui a nous-mêmes pour objet nous touche davantage; aussi faut-il s'appliquer à faire voir dans les périls communs des périls personnels. LII. Les mêmes moyens servent à faire naître l'espérance, la joie, le déplaisir; mais je ne sais si les impressions de l'envie ne sont pas les plus profondes de toutes; et il ne faut peut-être pas des ressorts moins puissants pour la détruire que pour l'exciter. C'est surtout à nos égaux et à nos inférieurs que nous portons envie, lorsque nous les voyons avec dépit s'élever tout d'un coup, et nous laisser loin d'eux. Mais souvent aussi ceux qui nous sont supérieurs font naître en nous le même sentiment, lorsqu'ils montrent de l'orgueil, et qu'ils se prévalent de leur rang et de leur fortune pour refuser de se soumettre au niveau commun de la loi. Voulez-vous exciter l'envie contre quelqu'un, dites que son élévation n'est pas la récompense de sa vertu ; qu'il la doit même à ses vices et à ses bassesses : ou si des qualités réelles lui donnent des droits à l'estime, dites que son orgueilleuse insolence est encore bien au-dessus de son mérite. S'agit-il au contraire de désarmer l'envie, dites que, si votre client a obtenu des richesses, des honneurs, c'est au prix de grands travaux, de grands périls; qu'il se sert de ces avantages pour le bien des autres et non pour son propre intérêt ; que s'il jouit de quelque gloire, bien qu'elle soit la juste récompense de son dévouement, elle n'a point de charmes pour lui; qu'il s'en dépouille, qu'il en fait le sacrifice. En général, les hommes sont enclins à l'envie; il n'est point de vice plus commun, plus universellement répandu. Elle s'attache surtout aux fortunes élevées et brillantes. Il faut donc s'attacher à rabattre de l'idée qu'on s'en forme, à montrer que ces fortunes dont on se fait une image si flatteuse, sont toujours accompagnées de peines et d'amertumes. Quant à la pitié, nous serons sûrs de l'inspirer, si l'auditeur retrouve dans l'infortune que nous lui retraçons la peinture des maux qu'il a soufferts ou de ceux qu'il redoute; s'il fait un retour sur lui-même en voyant les maux d'autrui. Les exemples particuliers des infortunes humaines excitent un vif intérêt, présentés d'une manière pathétique. Mais rien ne produit une plus profonde impression que le tableau de la vertu malheureuse et opprimée par le sort. Et si la partie du discours qui a pour objet de faire estimer dans l'orateur l'homme de bien, l'homme vertueux, demande, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, un ton doux et modeste; celle-ci, au contraire, où il s'agit de changer les dispositions des esprits et d'entraîner les cœurs, doit être énergique, véhémente, passionnée. LIII. Mais entre ces deux genres dont je veux que l'un soit doux et l'autre véhément, il exista des rapports intimes, qui tendent à se confondre. La douceur, qui gagne la bienveillance des juges, doit se faire encore sentir dans l'impétuosité qui remue leur âme; et réciproquement l'impétuosité doit quelquefois animer la douceur. L'éloquence, en général, n'a pas de plus heureuse combinaison que celle où la violence de la discussion est tempérée par l'aménité de l'orateur, et où la douceur, chez lui, se fortifie d'un certain mélange de fermeté et de vigueur. Soit qu'on emploie l'un ou l'autre de ces deux genres, celui qui demande de la chaleur et de l'énergie, ou celui qui a pour objet d'intéresser par la peinture des moeurs, il convient de l'aborder tard et avec lenteur, puis ensuite d'en multiplier, d'en prolonger les développements. On doit avoir soin de ne pas se jeter dès l'abord dans ces sortes de mouvements, parce qu'ils sont réellement étrangers à la cause, et que l'auditoire est avant tout pressé de connaître la question soumise à son jugement. Mais une fois que vous y êtes entré, ne vous pressez point d'en sortir. Aussitôt que vous avez mis une preuve en avant, l'auditeur la saisit, et il en attend une seconde, puis une troisième. Il n'en est pas de même des émotions de la pitié, de l'envie, de la colère; un instant ne suffit pas pour les faire naître. Le raisonnement vient appuyer la preuve. Aussitôt produit, il s'y attache, il s'y incorpore. Mais ici il ne s'agit plus d'éclairer le juge; il faut porter le trouble dans son âme; et l'on ne saurait y parvenir, à moins de déployer une éloquence riche, variée, abondante, soutenue d'un débit animé et en rapport avec le ton du discours. L'orateur qui parle avec concision, et dont le ton ne s'élève jamais, peut donc instruire les juges; mais il ne peut émouvoir leur âme, et tout est dans l'émotion. On voit donc clairement que les mêmes lieux communs offrent d'égales ressources pour et contre : les preuves, on les réfute, soit en démontrant qu'elles reposent sur de faux principes, ou que les conséquences en sont mal déduites et ne découlent pas des prémisses, soit en opposant aux preuves de l'adversaire des preuves contraires qui aient plus ou du moins autant de solidité. Quant aux moyens qu'il emploie pour se concilier la bienveillance par la douceur, ou pour émouvoir par la véhémence, on en détruit l'effet par des impressions contraires, en faisant succéder la haine à la bienveillance, la pitié à l'indignation. LIV. La raillerie et les bons mots sont d'un effet agréable, et quelquefois d'un grand secours dans les plaidoiries. Mais lors même qu'on pourrait réduire en théorie toutes les autres parties du talent oratoire, celle-ci échapperait toujours aux règles. C'est un don de la nature; l'art n'y peut rien. Vous y avez, selon moi, César, une supériorité incontestable. C'est donc à votre témoignage que j'en appelle : ou il n'y a point de règles pour la plaisanterie, ou, s'il y en a, à vous seul il appartient de nous en donner le secret. - Je pense, quant à moi, répondit César, qu'il n'est rien dont un homme de goût ne puisse parler d'une manière plus agréable et plus plaisante, que de la plaisanterie elle-même. J'ai eu entre les mains plusieurs ouvrages grecs ayant pour titre de l'Art de faire rire; j'espérais y apprendre quelque chose : j'y ai trouvé un grand nombre de ces traits ingénieux et piquants, si communs chez les Grecs; car les Siciliens, les Rhodiens, les Byzantins, et par-dessus tous, les Athéniens, excellent dans ce genre; mais tous ceux qui ont voulu donner la théorie de la plaisanterie, sont eux-mêmes si fades, et si insipides que, s'ils font rire, c'est de leur sottise. Je crois donc qu'on ne peut établir de règles en pareille matière. Il y a deux sortes de plaisanteries : l'une est répandue sur tout le discours, l'autre consiste en traits vifs et rapides. Nos pères ont donné à la première le nom de raillerie; à la seconde, celui de bons mots. Ces dénominations ont peu de gravité; c'est qu'en effet ce n'est pas quelque chose de bien sérieux que le secret d'exciter le rire. Toutefois vous avez raison, Antoine : j'ai vu que souvent la plaisanterie et les bons mots étaient d'un grand secours. Mais l'art n'est pour rien dans cet enjouement continu qui égaye le cours de la plaidoirie; la nature seule donne aux hommes le talent de contrefaire, de conter plaisamment, de faire rire par le jeu de la physionomie, les inflexions de la voix, l'originalité même de la diction; et pour ce qui est des bons mots, comment assigner une place à l'art dans un trait piquant, qui est lancé et qui frappe avant même qu'on y ait songé? Quel art aurait pu dicter la repartie heureuse de mon frère au consul Philippe, qui lui demandait ce qui le faisait ainsi aboyer - C'est que je vois un voleur, répliqua-t-il. J'en puis dire autant des deux plaidoyers de Crassus, l'un contre Scévola devant les centumvirs ; l'autre en faveur de Cn. Plancus, accusé par Brutus : car le talent dont vous me faites honneur, Antoine, appartient bien plus justement à Crassus, de l'aveu de tout le monde. Après lui, on ne trouverait peut-être pas un seul orateur qui excelle à la fois dans les deux genres de plaisanterie, celle qui se soutient dans tout l'ensemble du discours, et celle qui procède par saillies vives et imprévues. Son plaidoyer contre Scévola, en faveur de Curius, fut enjoué d'un bout à l'autre; mais on n'y trouve pas de mots piquants. Il ménageait en effet la dignité de son adversaire, et par là conservait la sienne. Il est cependant bien difficile aux hommes doués de ce genre d'esprit d'avoir égard aux circonstances et aux personnes, et de retenir un trait malin lorsqu'il se présente à leur pensée. Aussi quelques plaisants de profession donnent-ils une interprétation assez spirituelle à un passage d'Ennius, en se l'appliquant. Ils font dire à ce poète : Le sage éteindrait plutôt un charbon allumé dans sa bouche, que de retenir un bon mot; entendant par bon mot un mot plaisant; car c'est le sens qu'on lui donne aujourd'hui. LV. Mais si Crassus voulut bien se contenir en parlant contre Scévola, et s'il n'égaya son sujet que de ce genre de plaisanterie qui n'emploie pas les traits mordants du ridicule, il attaqua de l'une et de l'autre manière Brutus, qu'il n'aimait pas, et qu'il livrait sans scrupule à la risée publique. Que de railleries amères, à l'occasion de ces bains que Brutus venait de vendre, et du patrimoine qu'il avait dissipé ! et cette repartie, quand Brutus s'avisa de dire qu'il suait sans savoir pourquoi : Cela n'est pas surprenant, reprit Crassus, car vous sortez des bains. Il eut une foule de traits de ce genre , mais sans que la plaisanterie soutenue perdit rien de son agrément. Brutus s'était avisé de prendre deux lecteurs, et de faire lire au premier la harangue de Crassus pour la colonie de Narbonne; au second, le discours en faveur de la loi Servilia, et avait essayé d'y faire voir des contradictions politiques. La réponse de Crassus fut heureuse : il prit de son côté trois lecteurs, et les chargea de lire les trois Livres composés par le père de Brutus sur le droit civil. Dans le premier, on lut : COMME NOUS NOUS TROUVIONS DANS MA MAISON DE PRIVERNUM. Vous l'entendez, dit Crassus, votre père dépose qu'il vous a laissé un domaine à Privernum. Dans le second : NOUS ÉTIONS A MA MAISON D'ALBE, MON FILS ET MOI. Cet homme si distingué parmi ses concitoyens par sa sagesse, connaissait bien ce gouffre. Il craignait, que, lorsque le dissipateur aurait tout dévoré, on ne l'accusât lui-même de ne lui avoir rien laissé en héritage. Dans le troisième, le dernier qu'il ait écrit (car j'ai entendu dire à Scévola qu'il n'y a que ces trois Livres qui soient réellement de Brutus) : DANS MA MAISON DE TIBUR, NOUS NOUS ASSÎMES UN JOUR, MON FILS MARCUS ET MOI ... Où sont ces domaines que votre père vous a laissés, comme il l'a consigné lui-même dans des écrits publics ? Si vous n'aviez déjà été en âge de puberté, il aurait composé un quatrième Livre pour apprendre au monde qu'il s'était baigné avec vous dans ses bains. Qui ne sent que Brutus dut être aussi confondu par ces traits piquants et par ces plaisanteries, que par le mouvement pathétique auquel se livra Crassus en voyant le convoi de Junia passer, par hasard, au moment même qu'il plaidait? Dieux immortels! quelle force! quelle énergie! quels élans soudains, inattendus, lorsque foudroyant Brutus de son geste et de son regard, d'un ton aussi noble qu'impétueux il s'écria: «Eh bien, Brutus, que veux-tu que cette femme révérée aille annoncer à ton père, à tous ces hommes illustres dont tu vois porter les images? à tes ancêtres, â ce J. Brutus, qui affranchit le peuple romain de la domination des rois? Que rapportera-t-elle de ta vie? A quelle occupation, à quelle gloire, à quelle vertu dira-t-elle que tu te consacres? Dira-t-elle que tu songes à augmenter ton patrimoine? ce soin est peut-être au-dessous de ta naissance; mais qu'importe? cela même ne t'est plus possible il ne te reste rien ; tes débauches ont tout dévoré ! Dira-t-elle que tu t'occupes du droit civil ? ce serait marcher sur les traces de ton père; mais loin de là, elle sera forcée d'avouer qu'en vendant sa maison, tu ne t'es pas même réservé du mobilier paternel le siège du jurisconsulte. De la science militaire ? tu n'as jamais vu un camp. De l'éloquence? tu n'en as pas la moindre idée; et ce que tu avais de poumons et de babil, tu l'as honteusement prostitué à l'infâme métier de calomniateur. Et tu oses voir le jour ! tu oses regarder tes juges en face ! tu oses te montrer dans le forum, au milieu de cette ville, aux yeux de tes concitoyens ! tu ne frémis pas de honte et d'effroi à la vue de ce corps inanimé, de ces images sacrées de tes ancêtres! Hélas ! loin que tu puisses encore imiter leurs vertus, il ne te reste pas même un réduit pour placer leurs portraits!» LVI. Ce mouvement est pathétique et sublime. Quant aux traits ingénieux et plaisants, vous vous rappelez combien ils abondaient dans une seule harangue, celle que prononça Crassus devant le peuple contre son collègue dans la censure. Jamais on ne vit d'assemblée plus nombreuse; jamais il ne fut prononcé devant le peuple de discours à la fois plus fort et mieux assaisonné de finesse et d'enjouement. Je suis donc de votre avis, Antoine, sur vos deux propositions: ta plaisanterie est souvent utile, et on ne peut la soumettre à des règles; mais ce qui me surprend, c'est que vous ayez tant exalté mes talents en ce genre, au lieu de décerner la palme à Crassus, comme dans les autres parties de l'éloquence. - C'est ce que j'aurais fait, répondit Antoine, si à cet égard je n'étais un peu jaloux de Crassus : le talent de la plaisanterie n'est pas sans doute le plus digne d'envie; mais que, par un privilège qui n'appartient qu'à lui, l'orateur qui a le plus de grâce et d'urbanité soit en même temps le plus grave et le plus imposant, j'ai de la peine, je l'avoue, à lui pardonner cette double gloire. Crassus ne put s'empêcher de sourire. Antoine continua: Tout en établissant qu'il n'y a pas d'art de plaisanter, vous avez pourtant, César, indiqué un précepte à suivre en cette matière. Vous avez dit, en effet, qu'il faut avoir égard aux personnes, aux circonstances et au temps, de peur que le ton plaisant ne fasse perdre de l'autorité au discours; c'est une convenance dont Crassus a bien soin de ne pas s'écarter. Mais laissons là ce précepte : il ne s'applique qu'aux occasions peu favorables à la plaisanterie, et nous parlons de celles où elle peut être utile. Par exemple, s'il s'agit de s'égayer aux dépens d'un adversaire ridicule, ou de représenter un témoin comme un homme inconsidéré, avide, étourdi, on doit croire que les auditeurs seront disposés à nous écouter. Les reparties sont toujours mieux reçues que l'attaque, parce qu'elles annoncent plus de vivacité, et que la défense est de droit naturel : il semble que nous nous serions tenus tranquilles, si l'on ne nous avait provoqués. C'est ainsi que dans la harangue dont nous venons de parler, l'orateur ne se permit aucune raillerie, qui ne fût une réplique aux provocations de son adversaire. D'ailleurs, le caractère de Domitius donnait tant de poids, tant d'autorité à ses paroles, qu'on devait mieux réussir à affaiblir ses objections par la raillerie, qu'à les renverser par la force des arguments. LVII. - Quoi donc! dit Sulpicius, parce queCésar veut céder la palme à Crassus dans l'art de la plaisanterie, qui lui est pourtant beaucoup plus familier, sera-t-il dispensé de nous en expliquer la nature et l'origine, surtout quand il reconnaît que la raillerie et les bons mots peuvent être d'une si grande ressource? - Mais si je pense avec Antoine, répondit César, qu'il n'y a pas d'art de plaisanter? Sulpicius ne répliquait rien. - Est-ce qu'il y a, dit Crassus, un art qui enseigne toutes ces choses mêmes dont Antoine nous entretient depuis quelque temps? On a seulement, comme il nous l'a dit, recueilli des observations sur ce qui produit le plus d'effet dans un discours; et si ces observations suffisaient pour rendre éloquent, quel homme ne serait éloquent? qui ne parviendrait à se les rendre familières, sinon sans efforts, du moins après quelque travail? Voici, selon moi, en quoi consistent l'efficacité et l'avantage des préceptes: ils ne donnent pas le secret de trouver par des moyens artificiels ce qu'il faut dire; mais lorsque le génie, l'étude, ou l'exercice nous ont fourni des matériaux à mettre en oeuvre, les préceptes, en nous enseignant à quel but il faut les rapporter, nous rendent capables de distinguer ceux qu'on emploiera avec avantage, de ceux qu'il faudra écarter. Ainsi, César, je joins mes prières à celles de nos amis, et je vous demande en grâce de nous exposer votre opinion sur la plaisanterie. Il ne faut pas que dans une réunion comme la nôtre, et dans un entretien où vous avez désiré que la matière fût traitée complètement, il y ait une partie de l'art qui parût avoir été oubliée. - Eh bien, répondit César, puisque vous voulez que chaque convive paye son écot, je me garderai bien de me soustraire à l'obligation commune, de peur d'autoriser vos refus par les miens. Toutefois je m'étonne souvent de la hardiesse de ceux qui osent paraître sur la scène devant Rosclus : peuvent-ils faire un geste sans que ce grand acteur aperçoive leurs défauts? Aussi téméraire qu'eux, je vais parler de la plaisanterie devant Crassus, c'est-à-dire que l'écolier va donner des leçons à son maître; à cet orateur dont l'éloquence fit dire dernièrement à Catulus que tous les autres devraient manger du foin. - Assurément, dit Crassus, Catulus voulait rire, lui surtout dont l'éloquence est telle que c'est d'ambroisie qu'il faudrait le nourrir. Mais nous vous écoutons César; Antoine achèvera ensuite ce qui lui reste à nous dire. - Ce qui me reste, dit celui-ci, est bien peu de chose : cependant, un peu fatigué du chemin que la discussion m'a fait parcourir, je vais me délasser au discours de César comme un voyageur qui, après une longue route, est heureux de trouver une bonne hôtellerie. LVIII. - Vous n'aurez pas trop, reprit César, à vous louer de mon hospitalité; car à peine aurez-vous eu le temps de vous rafraîchir que je vous renverrai sans façon. Et pour ne pas vous arrêter trop longtemps, je vais vous exposer en peu de mots mon opinion sur le sujet qui nous occupe. Il offre cinq questions : Quelle est la nature du rire? qu'est-ce qui le produit? convient-il à l'orateur de l'exciter? jusqu'à quel point peut-il le faire? enfin, quels sont les différents genres de ridicule? Et d'abord, qu'est-ce que le rire; de quelle manière il se forme; où en est le siège; comment il se produit et éclate tout d'un coup, sans qu'on puisse le retenir; comment l'ébranlement qu'il produit se communique aux flancs, à la bouche, aux veines, aux yeux et à tous les traits : c'est ce que je laisse à expliquer à Démocrite. Ces questions sont étrangères à notre entretien; et quand même elles ne le seraient pas, je ne rougirais point d'avouer mon incompétence à les résoudre, puisque ceux qui en promettraient la solution n'en sauraient pas plus que moi. Le sujet, et pour ainsi dire le domaine du rire, second objet de nos recherches, est toujours quelque laideur, quelque difformité ; car l'unique moyen, ou du moins le moyen le plus puissant de l'exciter, c'est de signaler et de peindre quelque ridicule choquant, sans prêter soi-même au ridicule. Pour venir au troisième point, nul doute que de provoquer le rire ne soit une des ressources de l'orateur : la gaieté dispose à la bienveillance en faveur de celui qui la fait naître ; un trait spirituel, qui consiste souvent en un seul mot, principalement dans la réplique, quelquefois aussi dans l'attaque, ne manque jamais d'exciter une surprise agréable. La plaisanterie déconcerte un adversaire, l'embarrasse, l'affaiblit, l'intimide, le réfute ; elle fait regarder l'orateur comme un homme bien élevé, de bon goût et de bon ton; enfin, ce qui est plus important, elle dissipe la tristesse, fléchit la sévérité, et efface, avec une saillie, des impressions fâcheuses qu'il serait souvent difficile de détruire par le raisonnement. Mais quelle mesure l'orateur doit-il garder dans la plaisanterie - c'est la quatrième question, et elle mérite le plus sérieux examen. On n'est disposé à rire, ni de l'extrême perversité, qui va jusqu'au crime, ni de l'extrême misère : les scélérats doivent être poursuivis avec d'autres armes que celles du ridicule; et on n'aime pas a voir insulter les malheureux, à moins qu'ils ne conservent trop d'arrogance dans leur infortune. Il faut surtout respecter les affections des auditeurs, et ne pas aller attaquer maladroitement des personnes qui leur sont chères. LIX. Cette circonspection est le premier devoir de celui qui a recours à l'arme du ridicule. Les sujets qui se prêtent le plus à la plaisanterie, sont ceux qui n'excitent ni une grande horreur, ni une extrême pitié. L'orateur pourra donc s'égayer sur les vices des hommes, pourvu qu'il ne s'attaque ni à ceux qui ont pour eux la faveur publique ou l'intérêt du malheur, ni aux criminels que réclame la vengeance des lois : ces vices agréablement raillés ne manqueront pas de faire rire. Les difformités et les défauts corporels offrent aussi une matière assez riche à la raillerie ; mais n'oublions pas qu'ici, comme en toutes choses, il faut surtout ne point passer les bornes. Évitons de paraître fades et insipides, comme aussi d'aller trop loin, lors même que le sujet prête. L'orateur doit se tenir également éloigné de la plate plaisanterie du bouffon, et de la charge exagérée du mime. Nous nous ferons une idée plus juste de ces défauts, quand nous aurons examiné les divers genres de ridicules. Il y en a deux principaux : l'un consiste dans les choses, et l'autre dans les mots. Les contes faits à plaisir sont du premier genre. Ainsi, Crassus, dans votre plaidoyer contre Memmius, vous racontâtes que s'étant pris de querelle à Terracine avec Largius, au sujet d'une maîtresse, il mordit et dévora le bras de son rival. Cet épisode amusa beaucoup; mais il était tout entier de votre invention. Vous ajoutâtes une circonstance ; ce fut que, le lendemain toutes les murailles de Terracine étaient couvertes d'inscriptions, où l'on voyait trois LLL et deux MM, et qu'ayant demandé ce que cela pouvait signifier, un vieillard vous répondit : Lacerat lacertum Largii mordax Memmius. Vous sentez combien ce genre est original, piquant, avantageux à l'orateur, que le fond en soit vrai, ou qu'il soit imaginé à plaisir; et dans le premier cas, il ne faut pas se faire scrupule d'enchérir un peu sur la vérité. Le mérite de cette espèce de plaisanterie est de parodier si bien les habitudes, le caractère, le ton et la physionomie de son adversaire, que les auditeurs croient le voir et l'entendre lui-même. Elle admet aussi l'imitation comique qu'on fait des personnes. Ainsi lorsque Crassus s'écria, par ta noblesse, par votre famille, n'est-ce pas en contrefaisant la voix et le geste de son adversaire, qu'il égaya toute l'assemblée? et lorsqu'à ces mots, par vos statues, il étendit les bras en gesticulant comme lui, les rires redoublèrent. De même, quand Roscius dit, dans un rôle de vieillard. C'est pour vous, Antiphon, que je plante ces arbres, c'est la vieillesse personnifiée que je vois. Ce genre de plaisanterie demande beaucoup de précautions. Laissons aux mimes Éthologues l'imitation outrée, aussi bien que l'obscénité. L'orateur doit ne présenter qu'une copie éloignée, et laisser l'imagination de l'auditeur suppléer ce que ses yeux ne voient pas. Faisons preuve aussi de décence et de délicatesse, en évitant soigneusement les images et les expressions déshonnêtes. LX. Le ridicule qui porte sur les choses est donc de deux espèces, et ces deux espèces appartiennent à la plaisanterie soutenue, soit que, dans une anecdote, on représente au naturel le caractère de certains personnages, soit que, par une imitation rapide, on livre quelqu'un de leurs défauts à la risée publique. La plaisanterie d'expression est un trait piquant, caché sous un mot ou dans une pensée mais comme dans le genre dont nous venons de parler, celui du récit ou de l'imitation, l'orateur doit éviter de ressembler aux mimes Éthologues, de même, dans celui-ci, il doit s'interdire sévèrement les pointes triviales des bouffons. Quelle différence établirons-nous donc entre Crassus, Catulus et autres, et Granius votre ami, ou Vargula qui est le mien? En vérité, je n'en sais trop rien. Ils sont tous deux grands diseurs de bons mots, et personne ne l'est plus que Granius. La différence consiste peut-être d'abord à ne se pas croire obligé à dire un bon mot toutes les fois que l'occasion s'en présente. On produisit dans une cause un témoin de fort petite taille (pusillus). Peut-on lui adresser quelques questions ? dit Philippe. Oui, répond le rapporteur qui état pressé, pourvu que cela ne soit pas long. - Ne craignez rien, répondit Philippe, je serai court comme le témoin. Le mot fit rire; mais malheureusement. L. Aurifex, un des juges, était encore plus court que le témoin, et les rires retombèrent sur lui. Ce n'était plus qu'une bouffonnerie indécente. Rejetez donc comme déplacées les saillies même les plus piquantes lorsqu'elles peuvent tomber sur des personnes que vous ne voulez pas blesser. C'est le défaut d'Appius : il a la prétention d'être plaisant, et il l'est en effet; mais il tombe souvent dans la bouffonnerie. Il dit un jour à C. Sextius, mon ami (vous savez qu'il est borgne) : Je souperai ce soir chez vous, car je vois qu'il y a place pour un. Cette grossièreté bouffonne était d'autant plus déplacée que Sextius ne l'avait pas provoquée, et qu'elle pouvait s'appliquer à tous les borgnes. Ces mots ne font pas rire, parce qu'ils paraissent préparés d'avance. La repartie de Sextius vaut beaucoup mieux : Lavez vos mains, et vous viendrez souper avec moi. Saisir l'à-propos, modérer ses saillies, être maître de sa langue et sobre de bons mots, voilà donc les qualités qui doivent distinguer l'orateur du bouffon. N'oublions pas non plus que lorsque nous plaisantons, c'est moins pour faire rire, que dans l'intérêt de notre cause; au lieu que les bouffons raillent à tout propos et sans motif. Que revint-il à Vargula de sa bouffonnerie, lorsque Sempronius, qui sollicitait une magistrature, étant venu avec son frère se jeter à son cou, il dit à un esclave : Esclave, chasse les mouches. Vargula ne cherchait qu'à faire rire, et l'on ne saurait, selon moi, faire de son esprit un plus misérable usage. C'est au bon sens, c'est à notre propre dignité de nous faire juger de l'à-propos. Plût au ciel qu'il pût y avoir à cet égard un art et des règles ! Mais le seul maitre, c'est la nature. LXI. Exposons maintenant en peu de mots les moyens les plus propres à produire le rire. Toute plaisanterie consiste dans la pensée ou dans l'expression. Celle qui réunit ces deux mérites est sûre d'un plus grand succès. Mais ce qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que de ces mêmes sources du ridicule que je vais indiquer, peuvent presque toujours aussi se tirer des pensées graves. La seule différence, c'est que la pensée grave s'applique sérieusement à une qualité estimable, la plaisanterie, à une chose basse et laide. Ainsi les mêmes termes peuvent renfermer l'éloge d'un serviteur fidèle, ou une épigramme contre un esclave fripon. C'est un mot ancien et connu que celui de Néron sur un esclave qui le volait : C'est le seul dans la maison, pour lequel il n'y ait rien de scellé ni de fermé; ce mot est satirique; on l'applique tout aussi bien à un serviteur fidèle, sans y changer une seule syllabe. Je le répète, le sérieux et le plaisant ont la même origine. Sp. Carvilius boitait beaucoup des suites d'une blessure qu'il avait reçue en combattant pour Rome; il avait quelque honte de se montrer ainsi en public :- Pourquoi crains-tu de le montrer? lui dit sa mère; tu ne saurais faire un pas sans te rappeler la valeur. C'est une pensée sérieuse et noble. Glaucia disait en voyant Calvinus qui boîtait aussi : Où est le vieux proverbe qui dit : «Est-ce qu'il ne marche pas droit?» Non, il cloche. C'est une plaisanterie : les deux traits cependant portent sur la même infirmité. Quid hoc Nevio ignauius? ce mot de Scipion est sérieux. Cet autre de Philippe à quelqu'un qui avait l'haleine forte : Video me a te circumveniri (hircum veniri), n'est qu'une raillerie; et pourtant ces deux traits consistent également dans une légère altération des mots. Les mots à double entente ont aussi beaucoup de sel; mais ils ne sont pas toujours plaisants : quelquefois ils comportent un sens sérieux. Le premier Africain voulait, dans un festin, ajuster à sa tête une couronne de fleurs qui se défaisait souvent. Il n'est pas étonnant qu'elle n'aille pas bien, lui dit Licinius Varus ; la tête est trop grande. Le mot est beau et renferme un éloge délicat. Un trait bien différent, quoique appartenant au même genre, est celui-ci: Calvus parle peu, et il en dit toujours assez. En un mot, il n'est aucune sorte de plaisanterie qui ne se prête à un sens grave et sérieux. C'est encore une remarque à faire que ce qui fait rire n'est pas toujours d'un bon genre de plaisanterie. Qu'y a-t-il de plus risible que notre Sannion? Mais c'est sa bouche, son visage; ce sont ses imitations grotesques, sa voix, toute sa personne enfin, qui provoquent le rire. On peut dire de lui qu'il est divertissant, mais à la manière d'un mime, et non comme il convient à l'orateur. LXII. Ainsi ce premier genre de ridicule, celui qui fait le plus rire, n'est pas de notre ressort comme l'humeur difficile et bizarre, la superstition, la défiance, la vanité, l'extravagance. Ici ce sont les caractères mêmes qui sont tournés en ridicule. Nous les livrons à la raillerie, mais nous ne les jouons pas nous-mêmes. Le second genre, celui de la parodie, fait aussi beaucoup rire; mais l'orateur ne doit le hasarder qu'en passant, et comme à la dérobée; autrement il est ignoble. Les grimaces, qui forment le troisième genre, sont indignes de nous. Enfin, le quatrième, celui des plaisanteries obscènes, non seulement doit être banni du barreau, mais serait toujours déplacé entre honnêtes gens, même dans la liberté des festins. Après avoir retranché tant de sortes de plaisanteries du domaine de l'éloquence, il reste celles qui, suivant notre division, consistent, ou dans la chose même, ou dans l'expression. Les premières sont celles dont on peut changer les termes sans détruire la plaisanterie; au lieu que le sel des autres tient aux mots et disparaît avec eux. Les mots à double sens sont une plaisanterie d'expression et non de chose. Ils sont ingénieux, mais il est rare qu'ils fassent beaucoup rire. Ils plaisent plutôt comme une marque d'esprit et de finesse. Tel est le mot de Térentius Vespa sur Titius , qui aimait beaucoup la paume, et qu'on accusait de mutiler pendant la nuit les statues sacrées dont il emportait les débris. Ses camarades se plaignant de ce qu'il n'arrivait pas au Champ de Mars: Ce n'est pas sa faute, dit Vespa, il a un bras cassé. Tel est encore celui de Scipion l'Africain, dans Lucilius : Quoi! veux-tu, Décius, pourfendre Nucula? Tel est enfin , Crassus, celui de votre ami Granius : Non esse sextantis. C'est là, surtout, le genre des diseurs de bons mots; mais les autres plaisanteries excitent plus le rire. Un mot à double entente plaît, comme je l'ai dit, parce qu'il faut de l'esprit pour donner à un mot un sens différent de celui dans lequel il est pris ordinairement; mais il étonne plus qu'il ne fait rire, à moins qu'il ne rentre dans quelque autre genre de plaisanterie plus risible. LXIII. Je vais parcourir ces divers genres. Vous savez qu'un des plus ordinaires est de faire attendre une chose et d'en dire une autre. Alors nous rions nous-mêmes de notre méprise. S'il s'y joint un mot à double sens, la plaisanterie y gagne beaucoup. Par exemple, dans Névius, un homme voyant passer un débiteur qu'on livrait à son créancier, demande avec un air de compassion pour quelle somme on l'adjuge. Pour mille sesterces, lui dit-on. S'il se fût contenté de dire : Vous pouvez l'emmener, il aurait surpris, parce qu'on s'attendait à autre chose; mais il répond : «Je ne dis rien de plus. Vous pouvez l'emmener.» Ce mot à double sens rend, selon moi, le trait fort comique. C'est encore une plaisanterie heureuse que de s'emparer dans la dispute des propres paroles de l'adversaire; et, comme fit Catulus à l'égard de l'orateur Philippe, de lui renvoyer le trait même qu'il vous a lancé. Mais comme il y a plusieurs sortes d'équivoques, dont on a fait des analyses un peu subtiles, disons qu'il faudra se tenir soigneusement à l'affût des mots. En évitant tous ceux qui seraient froids (car malheur à celui dont les bons mots paraissent cherchés!), avec un peu de goût, on saura encore en trouver un assez grand nombre d'agréables. L'autre genre est celui qui consiste à faire éprouver à un mot une légère altération, quelquefois d'une seule lettre. Les Grecs l'appellent paronomase. Ainsi, Caton appelait M. Fuvilus, mobilior, au lieu de Nobilior. Une autre fois, comme il avait dit, Eamus deambulatum; Quid opus fuit DE? lui répondit-on : Quid opus fuit TE? répliqua-t-il. C'est lui qui dit encore : Vous êtes également impur, adversus et aversus. L'étymologie qu'on donne d'un nom propre pour le tourner en ridicule, a aussi quelque chose de piquant. Ainsi, je dis un jour que Nummius, le distributeur d'argent, avait pris son nom au Champ de Mars, comme jadis Néoptolème avait pris le sien sous les murs de Troie. Toutes ces équivoques roulent sur le mot. LXIV. Un vers cité textuellement ou avec quelque altération, ou même un simple hémistiche, sont quelquefois d'un effet agréable. Statius fit rire toute l'assemblée en appliquant à Scaurus, qui s'emportait, ces vers d'un poète comique (et ce fut, dit-on, Crassus, l'occasion de votre loi sur le droit de cité) : Paix donc! quel vacarme! pourquoi tant d'arrogance quand on n'a ni père ni mère? Soyez plus modestes ... Vous tirâtes avantage, Antoine, d'une plaisanterie semblable dans votre plaidoyer pour ce citoyen accusé par Célius, qui avait un fils fort débauché, d'avoir reçu de l'argent contre la loi; vous dites quand le témoin se retirait : Le bonhomme à coup sûr en est pour trente mines? Dans ce genre, on emploie aussi les proverbes tel est ce mot de Scipion contre Asellus, qui se vantait d'avoir parcouru, dans ses campagnes, toutes les provinces de la république, Agas Asellum, etc. Comme le sel de ces sortes de plaisanteries disparaît lorsqu'on en change l'expression, il faut les ranger parmi celles de mots et non de choses. Une autre du même genre, qui est encore assez agréable, c'est de s'attacher à la lettre et non à l'esprit d'un mot. C'est tout le mérite du Tuteur, ancien mime fort plaisant. Mais sans m'arrêter aux mimes, je veux seulement faire comprendre par quelques traits remarquables et connus ce dernier genre de plaisanterie. Quelqu'un vous dit dernièrement, Crassus, qu'il espérait ne pas être importun en allant vous voir au point du jour. Vous ne m'importunerez point, lui répondîtes-vous. Vous donnerez donc ordre qu'on vous éveille? - Mais je disais tout à l'heure que vous ne m'importuneriez point. Telle est encore la repartie de M. Scipion Maluginensis, lorsque le héraut, proclamant le nom d'Acidinus, proposé par sa centurie pour le consulat, vint à lui dire : Quelle est votre opinion sur L. Manlius? - Je crois, répondit Scipion, que c'est un honnête homme et un excellent citoyen. La réponse que L. Nasica fit à Caton le censeur, n'est pas moins plaisante. Avez-vous une femme à votre gré? lui demandait celui-ci : - Oui, répondit-il, mais non pas à mon gré. Ces sortes de reparties sont froides, si elles n'ont pas quelque chose d'inattendu. Nous rions alors de notre méprise, et ce mécompte de notre esprit se change en plaisir. LXV. Ce sont encore des plaisanteries de mots, que celles qui se tirent de l'allusion, de la métaphore, de l'antiphrase. Exemple de l'allusion : Pinasius Rusca proposait sa loi sur l'âge nécessaire pour l'exercice des magistratures. M. Servilius, qui s'opposait à la loi, lui dit : Me promettez-vous, si j'attaque votre loi, de ne pas me dire d'injures, comme vous avez fait aux autres? - Vous recueillerez, lui répliqua Pinarius, selon ce que vous aurez semé. De la métaphore: Les Corinthiens promettaient à Scipion de lui ériger une statue à côté de celles de leurs généraux : Je n'aime pas les escadrons, répondit-il. De l'antiphrase : Crassus plaidait un jour devant M. Perperna, pour Aculéon, contre Gratidianus; celui-ci avait pour défenseur Élius Lamia, qui était fort laid, comme vous savez, et qui interrompait Crassus à chaque phrase : Écoutons, s'écria-t-il, ce jeune et bel orateur. Tout le monde de rire. Je n'ai pu, dit Lamia, me former les traits du visage; j'ai pu me former l'esprit. - Écoutons donc cet éloquent orateur, reprit Crassus, et les ris redoublèrent. Ces diverses figures s'emploient avec un égal succès dans le genre grave et dans le genre plaisant; car, je l'ai déjà dit, le sujet des plaisanteries et des pensées nobles est différent, mais les mêmes formes servent à l'un et à l'autre. Un des plus grands ornements du discours est l'antithèse, et elle rend aussi la plaisanterie plus piquante. Servius Galba, accusé par le tribun L. Scribonius Libon, choisissait tous ses juges parmi ses amis et ses compagnons de table. Quand sortiras-tu de ta salle à manger? lui dit Libon. - Quand tu sortiras toi-même de la chambre à coucher d'autrui, répliqua-t-il. Ce que dit Glaucia à Metellus est à peu près du même genre Tu as ta campagne à Tibur, et ta basse-cours sur le mont Palatin. LXVI. Je crois avoir assez parlé des plaisanteries qui consistent dans les mots : celles qu'on tire des choses mêmes sont en plus grand nombre, et, comme je l'ai dit, elles font rire davantage. Un conte placé à propos est sûr de plaire; mais le pas est glissant: car il faut que rien dans les récits, rien dans les peintures, ne choque la vraisemblance, et qu'en même temps tout y soit assaisonné de cette pointe de ridicule qui caractérise la plaisanterie. Je ne puis en citer un exemple plus court et plus frappant que celui de Crassus plaidant contre Memmius : je vous en ai parlé plus haut. Les apologues sont du même genre. L'histoire fournit aussi des traits plaisants: Sextus Titius se comparait à Cassandre. - Oui, lui répondit Antoine, et je puis nommer vos Ajax. On en tire encore des similitudes, qui comprennent les comparaisons et les rapprochements par image. Voici un exemple de comparaisons : Gallus, déposant contre Pison, accusait Magius le préfet d'avoir reçu de très grandes sommes d'argent. Scaurus, pour repousser l'inculpation, objectait la pauvreté de Magius. Vous ne me comprenez pas, reprit Gallus; je ne dis pas que Magius ait gardé cet argent : il a fait comme un homme nu qui cueille des noix, et qui ne peut les emporter que dans son ventre. Le mot du vieux Marcus Cicéron, père de l'estimable Cicéron, notre ami, est du même genre : Nos Romains ressemblent aux esclaves de Syrie; celui qui sait le mieux le grec est le plus méchant. Les rapprochements par image apprêtent toujours beaucoup à rire, parce qu'ils portent le plus souvent sur quelque difformité, sur quelque défaut naturel, que l'on compare à un objet encore plus laid. Je dis un jour à Helvius Mancia : Je vais montrer votre portrait à l'assemblée. - Montrez-le, répondit-il, je vous en prie. Alors je montrai du doigt, dans le bouclier cimbre de Marius, près des boutiques neuves, un Gaulois tout contrefait, qui tirait une langue énorme, et avait les joues pendantes. Tout le monde éclata de rire, et on trouva la ressemblance parfaite. Une autre fois je dis à Titus Pinarius, qui tordait le menton en plaidant : Avant de parler, commencez par casser la noix que vous avez dans la bouche. Les hyperboles, soit qu'on exagère, soit qu'on atténue, peuvent, être poussées, jusqu'à un degré d'exagération extraordinaire. Ainsi, Crassus, vous disiez de Memmius : Il se croit si grand, qu'en venant au forum, il se baisse pour passer sous l'arc de Fabius. De même Scipion, sous les murs de Numance, s'emportant contre Metellus, s'écria: Si votre mère accouche une cinquième fois, à coup sûr ce sera d'un âne. Une plaisanterie qui a de la finesse, c'est lorsque, par une circonstance peu importante, souvent par un seul mot, on laisse percer une pensée cachée. P. Cornélius, à qui l'on reprochait son avarice et ses déprédations, passait en même temps pour un général brave et habile. Comme il remerciait C. Fabricius de lui avoir, malgré son inimitié, donné sa voix pour le consulat, dans un temps où Rome soutenait une guerre dangereuse : Vous ne me devez pas de reconnaissance, lui dit celui, j'ai mieux aimé être pillé que vendu. Asellus reprochant à Scipion les malheurs du dernier lustre : Ne vous en étonnez point, lui répondit Scipion; le censeur qui vous a réhabilité a fait la cérémonie lustrale et immolé le taureau; donnant à entendre que Memmius, en relevant Asellus de sa dégradation, avait exposé Rome à la colère des dieux. LXVII. Quelquefois, par une dissimulation ingénieuse, on dit, non pas le contraire de ce qu'on pense, comme dans le mot de Crassus à Lamia, mais autre chose que ce qu'on pense, en employant une piquante ironie, déguisée sous un ton sérieux. Je citerai pour exemple la réponse de notre ami Scévola à Septumuléius d'Anagni : ce dernier venait de recevoir la récompense promise à celui qui apporterait la tête de C. Gracchus, et il priait Scévola, nommé proconsul en Asie, de l'emmener comme préfet. Que demandez-vous là, insensé que vous êtes? lui dit Scévola, il y a tant de mauvais citoyens à Rome, qu'en y restant, vous y ferez, sur ma parole, une brillante fortune en peu d'années. Fannius rapporte dans ses Annales, que Scipion l'Africain avait beaucoup de goût pour ce genre de plaisanterie, qu'il appelle du nom grec d'ironie (εἶρωνα). Ceux qui connaissent l'antiquité mieux que moi, assurent, je crois, que Socrate excellait dans l'ironie, et qu'il y mettait plus de finesse et de grâce que personne. Ce genre est de bon goût; il admet la gravité sans rien perdre de son sel; il trouve aussi bien sa place dans les discours oratoires que dans la conversation familière. En général, tout ce que j'ai dit sur la plaisanterie ne convient pas moins aux entretiens particuliers qu'aux plaidoiries du barreau. Caton, qui rapporte une foule de traits de ce genre d'où j'ai tiré mes exemples, cite ce mot de C. Publicius, qui me paraît très juste: Mummius est un homme de tous les moments. En effet, il n'y a aucune circonstance de la vie où l'esprit et l'enjouement ne soient de mise. Mais je poursuis. Il est une espèce de plaisanterie qui se rapproche de l'ironie; elle consiste à donner un nom honnête à des actions blâmables. Scipion, pendant qu'il était censeur, fit descendre dans une tribu inférieure un centurion, qui ne s'était pas trouvé à la bataille livrée par Paul Émile : le centurion lui demanda la cause de cette sévérité, alléguant pour excuse qu'il était demeuré dans le camp pour le garder. Je n'aime pas, dit Scipion, les gens trop exacts. Il y a aussi de la finesse à tirer des paroles de son adversaire un sens qu'il ne leur donne pas. Livius Salinator, n'ayant pu empêcher l'ennemi de prendre Tarente, défendit la citadelle, et fit plusieurs sorties vigoureuses. Quelques années après, Fabius Maximus ayant repris Tarente, Salinator lui dit : Souvenez-vous que vous me devez l'honneur d'avoir repris Tarente. - Comment ne m'en souviendrais je pas? répondit Fabius. Si vous ne l'eussiez pas laissé prendre, je ne l'aurais jamais repris. D'autres plaisanteries un peu naïves, et par là même assez risibles, paraissent appartenir aux mimes; mais l'orateur peut aussi en faire usage; en voici des exemples : L'imbécile! à peine il a fait sa fortune, qu'il s'avise de mourir. Quelle est cette femme? - C'est mon épouse. - En effet, elle te ressemble. Tant qu'il a été aux eaux, il n'est pas mort. LXVIII. Ce genre est assez frivole et appartient, comme je l'ai dit, aux mimes; mais nous en faisons quelquefois usage, lorsqu'un homme d'esprit, par exemple, semble dire une niaiserie qui devient piquante dans sa bouche. Tel est, Antoine, le mot de Mancia, en apprenant que M. Duronius vous accusait de brigue, dans le cours de votre censure. Enfin, dit-il, vous allez pouvoir vous occuper de vos propres affaires. Ces mots, que les personnes spirituelles ont l'air de laisser échapper sans intention et avec naïveté, ne manquent jamais d'exciter le rire. J'en dis autant des réponses où l'on ne paraît pas mettre toute la finesse qu'on y met réellement. Que dites-vous, demandait-on à Pontidius, de celui qui est surpris en adultère? - Que c'est un maladroit, répondit-il. Métellus n'avait compris dans une levée de soldats ; comme, pour m'en exempter, j'alléguais la faiblesse de ma vue, et qu'il goûtait fort peu mon excuse: Vous ne voyez donc pas du tout? me dit-il. - Pardonnez-moi, lui répondis-je; de la porte Esquiline je vois votre maison de campagne. Scipion Nasica était venu pour voir le poète Ennius, et le demandait à sa porte. La servante répondit que son maître n'était pas au logis. Nasica comprit, qu'elle parlait ainsi parce qu'elle en avait reçu l'ordre, mais qu'Ennius était bien chez lui. Quelques jours après, le poète vint à son tour chez Nasica; et comme il le demandait aussi à la porte : Il est sorti, cria Nasica lui-même. - Vous vous moquez, dit Ennius; croyez-vous que je ne reconnais pas votre voix? - Vous êtes bien plaisant, réplique Nasica; lorsque je suis allé vous demander, j'ai cru votre servante, qui me disait que vous n'y étiez pas, et vous ne voulez pas me croire moi-même ? Il y a aussi beaucoup d'adresse à faire retomber sur un autre la raillerie qu'il lançait contre nous. Q. Opimius, consulaire, dont la jeunesse n'avait pas été irréprochable, disait à Égilius, homme enjoué, et qui paraissait un peu efféminé, quoiqu'il ne le fait pas. Ma petite Égilie, quand viendras-tu chez moi, avec ta quenouille et ton fuseau? - Je n'oserais, lui répondit Égilius; ma mère m'a défendu d'aller chez les femmes de mauvaise réputation. LXIX. Les reparties qui cachent une intention maligne ont aussi beaucoup de sel. Telle est celle de ce Sicilien, à qui un ami disait en pleurant que sa femme s'était pendue à un figuier : De grâce, lui répondit-il, donnez-moi des boutures de cet arbre, pour que je les plante chez moi. Un mauvais orateur, qui croyait avoir vivement ému l'auditoire dans sa péroraison, disait à Catulus en s'asseyant après son discours : Ne pensez-vous pas que j'ai su exciter la pitié? - Assurément, lui répondit-il, je ne crois pas qu'il y ait une âme si dure dont votre discours n'ait excité la pitié. Rien ne me paraît plus risible qu'un mot de dépit ou d'humeur, quand toutefois ce n'est pas un homme naturellement chagrin qui le prononce; car alors ce ne serait plus la repartie, mais le caractère qui me ferait rire; dans ce genre, les vers suivants de Névius me semblent fort comiques.
Mon père, vous pleurez? - La chose est surprenante!
Dans un sens inverse, la patience et le sang-froid peuvent aussi faire rire. Un crocheteur, qui portait une armoire, après avoir heurté Caton, cria : Gare.- Est-ce que tu portes encore autre chose? lui dit celui-ci. Il y a une manière détournée et plaisante de se moquer de la sottise. Scipion, préteur de Sicile, était logé chez un homme noble, mais des plus ignorants; il le donnait pour avocat à un Sicilien qui avait un procès. De grâce, préteur, lui dit celui-ci, nommez-le avocat de mon adversaire, et ne m'en donnez pas à moi-même. On fait rire encore en donnant sur un point contesté une explication imaginaire, mais spirituelle et gaie : Émilius Scaurus et Rutilius avaient demandé le consulat en même temps; le premier eut la préférence, et non content de son triomphe, il accusa Rutilius de brigue. Il alléguait pour preuve ces quatre lettres, A. F. P. R., trouvées sur les registres de son adversaire, et qu'il expliquait ainsi : ACTUM FIDE P. RUTILI. Rutilius soutenait qu'elles signifiaient : ANTE FACTUM, POST RELATUM. C. Canius, chevalier romain, défenseur de Rutilius, prétendit qu'aucune de ces explications n'était exacte. Donnez-en donc une autre, dit Scaurus. - La voici : AEMILIUS FECIT, PLECTITUR RUTILIUS. LXX. On rit aussi des contradictions: Que manque-t-il à cet homme, hors la fortune et la vertu? Un reproche fait avec un air de bonne foi, et comme pour tirer d'erreur celui à qui il s'adresse, n'est pas moins agréable. Tel est celui qu'Albius adressa à Granius, dont Albucius avait fait apporter les registres en témoignage contre Scévola, et qui se réjouissait fort de le voir acquitté, sans réfléchir qu'on avait jugé contre ses registres. Certains conseils donnés d'un air amical rentrent dans ce genre de plaisanterie. Ainsi un mauvais avocat s'étant enroué, Granius l'engageait à boire de l'eau miellée froide. Mais je perdrais ma voix, dit l'autre. - Il vaut mieux, reprit Granius, perdre votre voix que votre client. Une plaisanterie, appropriée au caractère de celui à qui on l'adresse, a encore beaucoup d'agrément. Scaurus, à qui l'on reprochait d'avoir pris possession des biens de Pompéius Phrygion, sans avoir de testament à produire, soutenait Bestia dans un procès : un convoi vint à passer devant le tribunal; l'accusateur Memmius dit : Voilà un mort qu'on porte en terre; voyez, Scaurus, s'il n'y aurait pas là un héritage pour vous. Mais, de toutes les plaisanteries, il n'y en a pas qui fassent plus rire que celles qui sont imprévues; j'en pourrais citer beaucoup d'exemples. On discutait dans le sénat sur les terres publiques et sur la loi Thoria, et l'on accusait Lucilius de faire paître ses troupeaux sur un terrain public : C'est une erreur, dit Appius, en feignant de le défendre, ce troupeau n'appartient pas à Lucilius; je pense, moi, que c'est un troupeau libre, et qui va paissant où bon lui semble. J'aime aussi beaucoup ce mot de Scipion Nasica, celui qui donna la mort à Tibérius Gracchus. Flaccus, après l'avoir chargé de beaucoup d'imputations outrageantes, lui proposa Mucius Scévola pour juge : Je le récuse, dit Scipion; ce n'est point un homme juste. Là-dessus quelques murmures s'étant fait entendre: Oui, pères conscrits, reprit-il, je le récuse comme un homme qui n'est point juste; je ne dis pas à mon égard, mais à l'égard de tous. Rien de plus agréable que le trait suivant de Crassus. Silus déposait, sur la foi d'autrui, de faits très désavantageux à Pison : Ne se pourrait-il pas, dit Crassus, que l'auteur de ces propos les eût tenus dans un moment de colère? Silus fit signe que cela pouvait être : Ne pourriez-vous pas avoir mal entendu? continua Crassus. Silus, par un second signe plus marqué, convint que cela se pourrait encore : Enfin, ajouta Crassus, n'est-il pas possible que tout ce que vous prétendez avoir entendu, vous n'en ayez rien entendu du tout? Cette dernière question, qu'on n'attendait pas, égaya toute l'assemblée aux dépens du témoin. Névius est plein de traits du même genre; en voici un entre mille : Vous avez beau être un sage; si vous avez froid, vous tremblerez. LXXI. Souvent aussi, on accorde plaisamment à son adversaire ce que lui-même nous refuse. Vous démentez vos ancêtres, disait à Lélius un homme d'une famille peu honorable. - Et vous, vous ne démentez pas les vôtres, lui répondit Lélius. On donne quelquefois à une plaisanterie le ton d'une sentence. Le jour que Cincius proposait sa loi qui défend aux avocats de recevoir ni présents ni salaire : Que proposez-vous là, mon petit Cincius, lui dit C. Cento d'un ton dédaigneux. - Le voici, mon cher Caïus; achetez, si vous voulez jouir. Il peut être plaisant d'exprimer un souhait qui implique contradiction; par exemple, Lépidus, pendant que les autres s'exerçaient dans le Champ de Mars, s'étendait mollement sur l'herbe, en disant: Que n'est-ce là travailler! On déconcerte un questionneur indiscret en lui répondant d'un ton calme et tranquille le contraire de ce qu'il désire. Le censeur Lépidus avait dégradé du rang de chevalier M. Antistius de Pyrges, et ses amis se plaignaient hautement de cette rigueur : Que répondra Antistius, s'écriaient-ils, lorsque son père lui demandera comment on a pu infliger un pareil traitement à un homme si honnête, si rangé, si sage, si tempérant? - Il dira, répliqua Lépidus, que je ne crois à rien de tout cela. Les Grecs ajoutent quelques autres genres, les imprécations, les exclamations, les menaces. Mais je crains d'en avoir déjà cité un trop grand nombre; car ceux dont le mérite est dans l'expression, sont bornés et circonscrits; et, comme je l'ai déjà dit, on les estime plus qu'on n'en rit. Au contraire, les plaisanteries qui roulent sur le fond de la pensée, offrent un petit nombre de genres, et une variété infinie d'espèces. Tromper l'attente des auditeurs, railler les défauts d'autrui, relever avec esprit les nôtres même, jeter du ridicule par une comparaison plaisante, déguiser nos pensées par l'ironie, laisser échapper à dessein des naïvetés, reprendre les sottises de nos adversaires; autant de moyens de faire rire. Pour plaisanter avec grâce, il faut donc se faire, pour ainsi dire, une nature qui se prête avec souplesse à tous ces modes différents; qui puisse saisir, rendre même, par l'expression des traits, tous les genres de ridicule; et plus on aura, comme vous, Crassus, une physionomie grave et sévère, plus les plaisanteries paraîtront piquantes. Mais il est temps, Antoine, que vous quittiez cette hôtellerie où mes propos vous retiennent, et dans laquelle vous vous étiez flatté de trouver un agréable repos. Prenez garde d'avoir fait comme ces voyageurs, qui respirent trop longtemps l'air insalubre des marais Pontins : croyez-moi, vous avez fait une halte assez longue; continuez maintenant votre route. - Loin de là, dit Antoine, je me félicite de l'aimable et gracieuse hospitalité que j'ai reçue : grâce à vos leçons, je connais mieux la nature de la plaisanterie, et j'en ferai plus hardiment usage. Je ne craindrai plus le reproche de frivolité, puisque je puis m'autoriser de l'exemple des Fabricius, des Scipion, des Fabius, des Caton, des Lépidus. Mais je vous ai donné sur l'éloquence tous les éclaircissements que vous avez exigés de moi, tous ceux au moins qui demandaient quelque réflexion et quelque soin : ce que je vais ajouter est plus facile, et n'est qu'une suite de mes premières observations. LXXII. Quand j'ai médité une cause avec toute l'attention dont je suis capable, que j'ai cherché à l'embrasser dans toutes ses parties, que j'ai choisi mes preuves et les lieux les plus propres, soit à me concilier la faveur des juges, soit à les émouvoir, j'examine quel en est le côté avantageux et le côté faible; car il n'y a presque aucun sujet susceptible de discussion, qui ne présente l'un et l'autre; mais c'est le plus ou le moins qu'il importe ici de bien saisir. Voici donc ma méthode ordinaire : je m'empare du côté avantageux, je l'embellis, je l'exagère; c'est là que je m'établis, que je m'attache, que je me fixe quant au côté faible, je le décline, sans avoir l'air de le fuir, mais en le dissimulant, en le faisant disparaître sous les ornements que je prodigue à l'autre. Est-ce une cause à défendre par des arguments, j'insiste sur les plus solides, soit qu'il y en ait plusieurs, soit que le sujet n'en offre qu'un. S'agit-il de gagner la bienveillance des juges et de toucher leur sensibilité, je m'occupe surtout de ce que la cause a de pathétique. Enfin, mon principe général est celui-ci : Si je me sens plus fort pour réfuter les preuves de mon adversaire que pour établir les miennes, c'est contre lui que je dirige tous mes traits; si au contraire il m'est plus facile de faire triompher mes raisons que de détruire celles qu'il avance, je travaille à détourner l'attention des juges de sa défense, et à la fixer sur la mienne. Enfin, je me suis fait deux règles qui paraissent d'une application fort simple; car celles qui présentent des difficultés seraient au-dessus de mes forces. D'abord, si l'adversaire emploie un argument, un moyen trop embarrassant, trop difficile à réfuter, je prends quelquefois le parti de n'y rien répondre du tout. On se moquera peut-être de cette ressource; car qui est-ce qui ne peut en faire autant? mais en ce moment je ne parle pas des autres; je ne parle que de moi et du peu que je puis; et j'avoue que si on me presse trop vivement, je fais retraite, sans jeter pour cela mon bouclier, sans cesser même de m'en couvrir par devant; plein de fierté et d'assurance, ma retraite est encore un combat; et en m'affermissant dans mes retranchements, j'ai moins l'air d'avoir voulu éviter l'ennemi, que prendre une meilleure position. Voici ma seconde règle; je la crois d'une haute importance pour l'orateur, et quant à moi, je m'attache à l'observer scrupuleusement : c'est de songer moins à assurer le succès de sa cause, qu'à ne rien dire qui puisse le compromettre. L'orateur doit, il est vrai, se proposer l'un et l'autre; mais il est bien plus humiliant de porter préjudice à son client que de ne l'avoir pas fait triompher. LXXIII. Mais que dites-vous tout bas à votre voisin, Catulus? Vous moquez-vous de mon observation? peut-être n'auriez-vous pas tort. - Nous en sommes bien éloignés, répondit Catulus ; mais César paraît avoir envie de vous dire quelque chose sur ce point. - Il me fera plaisir, dit Antoine, soit qu'il veuille me réfuter, ou me faire une question. - En vérité, dit alors César, je vous ai toujours rendu cette justice, que nul orateur ne laisse moins de prise que vous à son adversaire; et un mérite qu'on ne saurait vous contester, c'est de n'avoir jamais rien dit qui pût nuire à votre cause. Je me rappelle qu'un jour je m'entretenais de vous avec Crassus dans un cercle nombreux; il donnait de grands éloges à votre éloquence : je lui dis qu'entre tous vos talents, il y en avait un qui me semblait devoir passer encore avant les autres, c'est que vous dites toujours tout ce qu'il faut, et ne dites jamais que ce qu'il faut. Je me rappelle aussi la réponse de Crassus. Comme moi, il loua toutes vos éminentes qualités; mais il ajouta qu'il n'y avait qu'un homme malhonnête et déloyal qui pût, en disant des choses déplacées dans la cause, nuire à celui qu'il s'était chargé de défendre; qu'ainsi, selon lui, il n'y avait pas de talent à éviter cette faute, mais qu'il y avait perfidie à y tomber. Maintenant, veuillez nous apprendre, Antoine, comment cette attention à ne pas nuire soi-même à sa cause peut avoir tant d'importance à vos yeux, que vous en fassiez la première qualité de l'orateur? LXXIV. - Je vais expliquer ma pensée; mais je vous prie de vous rappeler, César, ainsi que tous ceux qui m'écoutent, que je ne parle point de la perfection absolue et idéale de l'orateur, mais du faible talent que je dois à l'exercice et à l'habitude. L'observation de Crassus est celle d'un homme supérieur, d'un esprit éminent: l'orateur capable de nuire à son client, et de parler contre ses intérêts, lui paraît une espèce de monstre impossible à trouver. Il en juge d'après lui-même ; l'élévation de son génie lui fait croire qu'on ne peut parler contre sa propre cause, à moins de le faire à dessein. Mais ce que je dis ici s'applique aux esprits ordinaires, et non aux talents hors de ligne. Chez les Grecs, Thémistocle, cet illustre Athénien, a laissé une grande réputation de prudence et de génie. Un homme d'un grand savoir se présente un jour chez lui, et veut lui apprendre le secret encore nouveau de la mémoire artificielle. Quelle est l'utilité de cet art? demande Thémistocle. - De se ressouvenir de tout, répond le maître. - Vous m'obligeriez bien davantage, si vous pouviez m'apprendre le moyen d'oublier quand je voudrais. Voyez quelle haute intelligence! quelle puissance, quelle étendue d'esprit! Sa réponse nous montre une âme forte, d'où rien ne peut plus s'échapper de ce qui y est entré une fois; et il eût attaché plus de prix au don d'oublier à son gré, qu'à la faculté de fixer à jamais dans sa mémoire ce qui avait une fois frappé ses yeux ou ses oreilles. Mais, malgré la réponse de Thémistocle, il n'en faut pas moins cultiver sa mémoire; et la supériorité du talent de Crassus ne doit pas faire dédaigner ma sage timidité et les précautions que je recommande : l'un et l'autre, en s'exprimant comme ils font fait, ont donné la mesure de leur capacité, mais ils n'ont rien ajouté à la mienne. Il y a en effet pour chaque cause, dans toutes les parties de la plaidoirie, des points délicats, qui demandent infiniment de prudence et de précautions, sans quoi on ira se heurter, se briser contre des écueils. Souvent un témoin ne nous attaque pas, ou du moins nous ménage, s'il n'est pas provoqué. Le client me conjure, son conseil me sollicite d'attaquer ce témoin, de le maltraiter, de le presser de questions. Je tiens ferme, je ne me laisse pas ébranler, je ne cède point à leurs instances. Cette réserve ne me vaut aucun éloge ; car il est plus aisé pour les ignorants de critiquer un mauvais discours, que d'apprécier un silence prudent. En pareil cas, si vous allez blesser un témoin mal disposé, qui ne soit pas un sot, et qui jouisse de quelque considération , quel mal n'en résultera-t-il pas? Sa mauvaise humeur lui inspirera le désir de nuire; son esprit lui en fournira les moyens, et sa position rendra ses coups plus dangereux. Si Crassus ne commet jamais de pareilles fautes, beaucoup d'autres y tombent, et cela tous les jours. Or, qu'y a-t-il de plus humiliant pour un orateur, que d'entendre dire après un mot, une repartie, une question : Il a porté un coup mortel. - A son adversaire ? - Non, à lui-même, à son client. LXXV. Crassus pense qu'on n'en vient là que par perfidie : pour moi, je vois tous les jours des orateurs, avec les intentions les plus droites, faire beaucoup de mal à leur cause. Je disais tout à l'heure qu'il m'arrive souvent de céder, de battre en retraite, et, pour trancher le mot, de fuir devant un ennemi qui me presse trop vivement : eh bien, ceux qui, au lieu de faire comme moi, abandonnent leurs retranchements pour se jeter dans le camp ennemi, ne portent-ils pas souvent des coups bien funestes à leur cause, en donnant de nouvelles forces à l'adversaire, ou en envenimant des plaies qu'ils ne peuvent guérir. Quoi! si l'on ne tient pas compte de ce qui est personnel à ceux qu'on défend, si, au lieu de calmer l'envie, en atténuant ce qui peut l'exciter, on la rend plus violente par des éloges outrés ou maladroits, ne fait-on pas soi-même le plus grand tort à sa cause? Si, sans aucune précaution oratoire, on s'emporte avec aigreur contre une personne qui a l'estime et l'affection des juges, ne s'aliène-t-on pas leur esprit? Est-ce encore une faute médiocre de ne pas sentir qu'en reprochant à son adversaire des défauts ou des imperfections qui se trouvent dans un ou plusieurs des juges, ce sont les juges eux-mêmes qu'on attaque? Si, en plaidant pour un autre, vous paraissez plaider pour vous; si, pour venger votre amour-propre blessé, vous n'écoutez que votre colère, et oubliez la cause de votre client, n'êtes-vous pas coupable envers lui? Je n'aime pas plus qu'un autre à entendre dire du mal de moi; mais je n'aime pas non plus à perdre de vue l'intérêt de la cause, et l'on m'accuse d'être trop patient et trop flegmatique. C'est ainsi que je vous reprochais, Sulpicius, d'attaquer, non pas l'accusé, mais son défenseur. Je tire encore cet avantage de ma modération, qu'on taxe de violence et de folie quiconque se livre à des invectives contre moi. Si dans votre argumentation, vous avancez quelque chose qui soit ou évidemment faux, ou en contradiction avec ce que vous avez dit ou direz, ou contraire aux usages du barreau, n'est-ce pas là nuire encore à votre cause? En un mot, voici, j'aime à le répéter, sur quoi portent tous mes soins : quand je défends un client, je tâche de lui faire le plus de bien possible, ou du moins, faute de mieux, de ne lui pas faire de mal. LXXVI. Je reviens maintenant à ce qui tout à l'heure, Catulus, m'attirait vos éloges; je veux dire, l'ordre dans lequel il faudra disposer le discours et les lieux dont il se compose. Il y a sur ce point deux méthodes à signaler : l'une est indiquée par la nature des causes, et l'autre est soumise au jugement et à la sagacité de l'orateur. Faire précéder la question d'un préambule, puis exposer le fait; développer ensuite nos preuves et réfuter celles de l'adversaire; conclure enfin par une péroraison : telle est la marche que la nature elle-même nous prescrit; mais quelle sera la manière la plus heureuse de disposer ce que nous avons à dire pour convaincre, instruire, persuader, voilà ce qui est surtout abandonné au bon sens de l'orateur. Il se présente en effet à notre esprit une foule d'arguments qui paraissent propres à servir notre cause; mais les uns sont si peu importants, qu'ils ne méritent pas d'attention; d'autres seraient de quelque utilité; mais ils offrent aussi des inconvénients, et l'avantage qu'on en peut tirer ne rachèterait pas le mal qu'ils peuvent produire. Si les arguments véritablement utiles et solides sont en grand nombre, comme il arrive souvent, je pense qu'il faut faire un choix, et négliger ceux qui ont le moins de poids, ou qui rentreraient dans d'autres plus importants. Pour moi, quand je rassemble les preuves d'une cause, j'ai pour habitude de les peser au lieu de les compter. LXXVII. Pour amener à notre sentiment ceux qui nous écoutent, il y a, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, trois moyens différents, instruire, plaire, émouvoir. Mais de ces trois moyens, il n'y en a qu'un seul qu'on puisse avouer hautement; il faut paraître n'avoir d'autre but que d'instruire; les deux autres devront être répandus dans tout l'ensemble d'un plaidoyer, comme le sang l'est dans le corps; car l'exorde et les autres parties du discours dont nous dirons tout à l'heure quelques mots, doivent agir par une influence douce et continue sur l'âme des auditeurs. Quant aux deux autres moyens, qui n'ont pas pour objet d'instruire par le raisonnement, mais qui peuvent être d'un puissant secours en touchant et en persuadant, quoique leur place véritable soit dans l'exorde et dans la péroraison, il est souvent utile, pour remuer les coeurs, de s'écarter de la marche qu'on s'est tracée. Ainsi, après l'exposition des faits, on peut placer une digression touchante. On le peut encore, soit après avoir établi ses preuves, soit après avoir réfuté celles de l'adversaire, ou même dans ces deux endroits, et dans toutes les parties du discours, lorsque la cause a de la grandeur et de l'intérêt. Les causes les plus susceptibles des ornements et de la pompe de l'éloquence, sont celles qui se prêtent le mieux à ces sortes de digressions, et où il est le plus permis de recourir à ces lieux au moyen desquels l'orateur excite ou calme à son gré les passions. Je n'approuve pas la méthode de commencer par les preuves les plus faibles; et de même si l'on emploie plusieurs défenseurs (usage qui m'a toujours déplu), je crois qu'on a tort de faire parler les premiers ceux dont le talent inspire le moins de confiance. Il me semble, au contraire, qu'il importe beaucoup de répondre le plus tôt possible à l'attente des auditeurs. Si vous ne les satisfaites pas d'abord, vous rendez la suite de votre tâche beaucoup plus difficile; et la cause est en danger, lorsque les juges n'en ont pas une bonne opinion dès le début. Produisez donc en premier lieu, et les orateurs les plus habiles, et les arguments les plus solides, pourvu toutefois qu'en fait d'arguments, comme en fait d'orateurs, vous réserviez pour la fin ce que vous avez de plus fort. Quant au médiocre (car le mauvais ne doit trouver place nulle part), il sera jeté dans la foule et se perdra dans le nombre. Quand j'ai bien pris ainsi toutes mes mesures, je me mets à chercher en dernier lieu ce qui doit pourtant commencer mon discours, c'est-à-dire, mon exorde; car toutes les fois que j'ai voulu commencer par m'en occuper, je n'ai rien trouvé que de faible, d'insignifiant, de commun et de vulgaire. LXXVIII. L'exorde doit toujours être soigné, piquant, nourri de pensées, orné d'expressions justes et heureuses, surtout bien approprié à la cause. Il est, en effet, comme chargé de donner une idée du reste du discours; il lui sert pour ainsi dire de recommandation; il doit donc charmer d'abord et attirer l'auditeur. Aussi vois-je avec étonnement, non pas ces hommes qui ne se sont jamais livrés à l'étude de l'éloquence, mais Philippe, cet orateur habile et éclairé, se lever pour parler sans savoir même le premier mot qu'il prononcera. Il n'en vient au combat, vous dit-il, qu'après s'être échauffé le bras; mais il ne fait pas attention que ceux même dont il emprunte cette comparaison, balancent légèrement leurs traits, pour déployer d'abord toute la grâce de leurs attitudes, et mieux ménager leurs forces. Il est des occasions, sans doute, où l'exorde demande de la véhémence et de l'âpreté; mais si des gladiateurs, dans un combat où le fer va décider de leur vie, préludent à l'attaque, plutôt en déployant la grâce de leurs mouvements, qu'en cherchant à se porter des coups mortels, à combien plus forte raison doit-on attendre des ménagements semblables de l'art de la parole, où l'agrément est encore plus nécessaire que la force? Enfin, il n'est rien dans la nature qui se répande à la fois d'un seul jet, ou qui prenne en un instant tout son essor; et les choses dont l'action doit être la plus impétueuse, sont préparées par des commencements lents et modérés. Il ne faut point chercher l'exorde dans des circonstances étrangères ou éloignées; mais le tirer des entrailles mêmes de la cause. Que l'on commence donc par sonder la cause, par l'examiner dans toute son étendue, par trouver et préparer tous les lieux qu'on veut mettre en oeuvre : on songera alors au choix d'un exorde, et il viendra s'offrir de lui-même. On le puisera dans les circonstances les plus fécondes que présentent les arguments ou les digressions dont j'ai plus haut recommandé l'usage. Ainsi tiré du fond même de la défense, il aura plus de valeur et d'effet: on verra que non seulement il n'est pas banal, et également applicable à toute autre cause, mais que celle qu'on traite est la source unique dont il découle. LXXIX. Tout exorde doit donner une idée générale de la cause tout entière, la préparer, en faciliter l'accès, ou bien encore la relever et l'ennoblir; mais il faut le proportionner au sujet, comme un vestibule et un portique aux palais et aux temples auxquels ils servent d'entrée. Dans les causes de peu d'importance, et qui n'attirent pas un nombreux auditoire, il vaut quelquefois mieux entrer sur-le-champ en matière. Mais si l'exorde est nécessaire, ce qui arrive le plus souvent, l'orateur pourra tirer ses idées, soit de la personne de l'intéressé, soit de celle de l'adversaire, soit de l'affaire elle-même, soit enfin de l'assemblée devant laquelle il porte la parole. Si c'est de l'intéressé (j'appelle ainsi celui dont il défend les intérêts), il met en avant tout ce qui peut faire voir en lui l'homme de bien, l'homme gênéreux que le malheur accable, et qui a droit à la compassion; enfin tout ce qui peut combattre avec avantage une accusation injuste. Si c'est de l'adversaire, il développe les mêmes idées en sens inverse. Dans l'exorde tiré de la nature de l'affaire, on examine ce qu'elle offre de cruel, d'inouï, d'imprévu, d'injuste, de malheureux, d'ingrat, d'indigne, de nouveau, d'irréparable, d'irrémédiable. Enfin le tire-t-on de la personne des auditeurs, on cherche à se concilier leur bienveillance et leur estime, ce qu'on obtient plutôt par un bon discours qu'en employant la prière. Sans doute cette attention à plaire doit s'étendre au discours tout entier, et sied surtout dans la péroraison, mais souvent aussi elle fournit les idées de l'exorde. Les rhéteurs grecs recommandent de rendre dans l'exorde l'auditeur attentif et docile : c'est là un soin utile, mais qui n'appartient pas à cette partie du discours plus qu'aux autres. Seulement on en tire plus facilement parti dans l'exorde, parce qu'alors l'auditeur, dont la curiosité est encore en suspens, apporte une plus grande attention à ce qu'on va dire, et est susceptible d'une plus grande docilité. En effet, ce qu'on place au commencement, frappe bien plus vivement que tout ce qui se dit au milieu du plaidoyer, dans la confirmation ou la réfutation. Les exordes où l'on veut captiver et émouvoir les juges se tirent presque toujours des lieux de la cause les plus propres à soulever les passions; mais ces lieux ne doivent pas être trop développés dès le début. On se contentera de donner au juge une impulsion légère. Une fois ébranlé, le reste du discours achèvera de l'entraîner. Il faut que l'exorde soit bien lié au discours qui va suivre, comme un membre l'est au reste du corps, et qu'il ne ressemble pas aux préludes détachés que fait entendre le musicien. Quelques orateurs, après avoir débité un exorde préparé d'avance, passent aux autres parties de manière à faire croire qu'ils ne veulent plus être écoutés. L'orateur ne doit pas faire comme les Samnites, qui, avant d'en venir aux mains, lancent des traits différents de ceux dont ils se servent dans l'action : il faut qu'il puisse se présenter au combat avec les mêmes armes qui lui auront servi à le préparer. LXXX. Quant à la narration, les rhéteurs y recommandent la brièveté. Si l'on appelle ainsi cette précision qui ne dit rien de trop, elle se trouve dans les discours de Crassus; si au contraire la brièveté consiste à n'employer que le nombre de mots strictement nécessaire, elle est quelquefois utile; elle nuit aussi quelquefois, surtout dans la narration : non seulement elle y répand de l'obscurité, mais elle fait disparaître le principal avantage de cette partie du discours, qui est de plaire et de persuader par les formes adroites sous lesquelles on la présente. Voyez le récit : Quand Pamphile mon fils, fut sorti de l'enfance. Il est fort long; le caractère du jeune homme, les questions adressées par le père aux esclaves, la mort de Chrysis, la beauté, la douleur, les larmes de sa soeur, et toutes les autres circonstances sont retracées avec autant d'agrément que de variété. Si le poète avait toujours cherché la même brièveté que dans ces mots,
On emporte le corps; nous marchons, on
arrive,
dix vers auraient suffi pour tout dire. Encore la concision de ces détails, On emporte le corps, nous marchons ... a-t-elle moins la brièveté que l'agrément pour objet. Quand il n'aurait rien ajouté à ces mots, on le met au bûcher, la chose était suffisamment expliquée. Mais une narration où l'on met en scène les personnages, où on les fait parler, présente plus d'intérêt. Vous donnerez aussi une plus grande vraisemblance au fait, en exposant comment il s'est passé; vous le ferez mieux comprendre, en vous arrêtant sur certains points, au lieu de tout dire en courant. La narration, en effet, ne doit pas être moins claire que le reste du discours; mais l'orateur doit apporter d'autant plus de soin à la rendre telle, qu'en exposant les faits, il est plus difficile d'éviter l'obscurité que dans l'exorde, la confirmation, la réfutation, la péroraison, et que l'obscurité a de plus graves conséquences dans la narration que partout ailleurs. Si dans une autre partie vous ne vous faites pas bien comprendre, il n'y a de perdu que le passage qui manque de clarté; mais une narration obscure répand son obscurité sur tout le reste. En outre, ce que vous n'avez pas bien fait comprendre dans un endroit, vous pouvez y revenir et l'expliquer dans un autre : mais la narration n'a qu'une place dans le discours. Elle sera claire, si l'on n'emploie que des termes reçus, si l'on y observe l'ordre des temps, et qu'on n'interrompe pas le fil des idées. LXXXI. Quand faudra-t-il, ou non, faire une narration? c'est au bon sens de l'orateur à en décider. Si le fait est connu, si l'on ne peut révoquer en doute la manière dont il s'est passé, il est inutile de le raconter. Il en sera de même si votre adversaire l'a déjà établi, à moins qu'il ne faille le réfuter. Lorsque la narration sera nécessaire, n'allons pas insister imprudemment sur les circonstances qui nous rendraient suspects ou coupables et seraient contre nous ; atténuons-les autant qu'il sera possible, et craignons de tomber dans ce tort que Crassus attribue moins à la maladresse qu'à la mauvaise foi, celui de nuire nous-mêmes à notre cause. Il importe beaucoup au succès que les faits soient présentés habilement ou non, puisque la narration est comme la base de tout le discours. On pose ensuite la question, en mettant tous ses soins à bien saisir le point en litige; puis on passe à la discussion, dans laquelle il faut tout à la fois établir ses preuves et renverser celles de l'adversaire; car il n'y à qu'un seul et même fond à toute cette partie consacrée à l'argumentation; elle comprend la confirmation et la réfutation tout ensemble. Mais comme il est impossible de combattre les preuves de l'adversaire sans y opposer les nôtres, et de soutenir nos propres arguments sans repousser ceux qu'on nous oppose, il s'ensuit que ces deux parties sont essentiellement unies par leur nature, par leur utilité, et par la manière de les présenter. On termine ordinairement en relevant ses moyens par l'amplification, et en cherchant à enflammer les juges, ou à les apaiser. Ici, plus que dans les autres parties du discours, l'orateur a besoin de déployer toutes les ressources de son art, pour exciter les plus fortes émotions, et pour les faire tourner au profit de sa cause. LXXXII. Il ne me semble pas nécessaire de donner séparément des règles sur les genres démonstratif et délibératif : presque toutes s'appliquent également à tous les genres. Mais si jamais l'orateur doit imposer par la dignité de son caractère, c'est lorsqu'il conseille une chose ou en dissuade. C'est à l'homme sage à exposer son opinion sur les intérêts les plus graves; c'est à l'homme de bien, doué du talent de la parole, à prévoir par sa raison, à convaincre par son autorité, à persuader par ses discours. On doit s'énoncer avec moins d'appareil dans les délibérations du sénat; car on parle devant une assemblée de sages, et il faut laisser à beaucoup d'autres le temps d'opiner à leur tour. Il faut aussi éviter de paraître vouloir faire parade de son talent. Les discours prononcés devant le peuple comportent toute la force, exigent toute la noblesse, toute la variété de l'éloquence. Dans une délibération publique, l'orateur doit faire passer avant tout le principe de l'honneur; et ceux qui veulent que ce soit celui de l'utilité, songent moins au but qu'il a essentiellement en vue, qu'à celui qu'il lui arrive souvent de poursuivre. Il n'est personne, en effet, surtout dans une cité aussi illustre que Rome, qui ne préfère à tout l'honneur de la république; cependant l'utilité l'emporte bien souvent, lorsqu'on peut craindre qu'en la négligeant, l'honneur même ne puisse plus être sauvé. Tout ce qui peut partager les opinions des hommes se réduit à ces questions : La chose est-elle utile? ou bien, quand on est d'accord sur ce point : Lequel faut-il préférer de l'honneur ou de l'intérêt? Comme ils semblent souvent incompatibles, l'orateur qui se range du côté de l'intérêt, mettra en avant les avantages qui peuvent résulter de la paix, des richesses, de la puissance, des impôts, des armées, de toutes les choses enfin dont la valeur s'apprécie par l'utilité; il exposera de même les inconvénients qui résulteraient du contraire. S'il soutient le parti de l'honneur, il rassemblera toutes les circonstances où nos ancêtres ont préféré le péril avec la gloire; il exaltera l'imposant et immortel souvenir de la postérité; il soutiendra que l'utilité naît souvent de la gloire même, et est toujours inséparable de l'honneur. Mais dans l'un et l'autre cas, il faut surtout examiner ce qui est possible ou impossible, ce qui est nécessaire ou non; car toute délibération cesse et tombe à l'instant devant l'impossibilité ou la nécessité; et l'orateur qui démontre ce point essentiel que les autres n'aperçoivent pas fait preuve d'une sagacité supérieure. Pour donner un avis sur les affaires de la république, il faut avant tout bien connaître sa situation et sa politique; pour parler de manière à persuader, il faut connaître les dispositions actuelles des citoyens; et comme elles changent souvent, on sera souvent obligé de changer le ton et le caractère de ses discours. Au fond, l'éloquence dans sa force est toujours une; mais la majesté souveraine du peuple, la grandeur des intérêts de l'État, la violence des mouvements de la multitude, tout semble exiger de l'orateur quelque chose de plus haut et de plus éclatant. Une grande partie du discours doit être employée à mettre en jeu les passions; il faut, par des exhortations, par des souvenirs, éveiller quelquefois dans les âmes l'espoir ou la crainte, l'ambition ou l'amour de la gloire; souvent aussi les détourner de la témérité, de la colère, de la présomption, de l'injustice, de l'envie, de la cruauté. LXXXIII. L'assemblée du peuple est le plus beau théâtre où puisse briller l'éloquence : aussi l'orateur est-il naturellement excité à y déployer toutes les richesses de son art. Tel est même le pouvoir d'une multitude assemblée, que l'orateur, sans un nombreux auditoire, est comme un musicien privé de son instrument; il a perdu toute son éloquence. Comme le peuple se laisse emporter à mille passions, à mille écarts, il ne faut pas s'exposer à soulever ces explosions de désapprobation, qui sont provoquées tantôt par quelque faute échappée à l'orateur, si dans ses paroles il laisse voir de la dureté, de l'arrogance, un sentiment vil et bas, ou tout autre vice de l'âme; tantôt par la haine ou l'envie dont son client est l'objet, soit qu'elles aient un motif légitime, ou qu'elles ne soient fondées que sur des bruits injurieux; tantôt par la défaveur de la cause; tantôt enfin par quelque mouvement subit de passion ou de crainte chez la multitude. A ces quatre dangers, l'orateur oppose un égal nombre de remèdes : la réprimande, si l'autorité de son caractère la lui permet; les remontrances, qui sont une réprimande adoucie; la promesse de faire approuver ce qu'il avance si l'on consent à l'écouter, et la prière, le moins noble de ces moyens, mais qui est souvent utile. C'est surtout dans de pareilles circonstances qu'on peut tirer parti d'une repartie fine et plaisante, d'un mot vif, ingénieux, et piquant avec dignité; car rien ne se laisse plus facilement que la multitude ramener du mécontentement, et même de la colère, par un à-propos heureux et fin, par un trait rapide et enjoué. LXXXIV. Pour les deux premiers genres de causes, je vous ai fait connaître, autant que je l'ai pu, les qualités que je recherche, les défauts que j'évite, les considérations qui me guident, enfin tout l'art et le secret de ma méthode. Le troisième genre, celui des éloges, que j'ai écarté dès le principe, sans en donner les règles, présente peu de difficultés. Comme il y a plusieurs sortes de discours d'une plus grande importance et d'un emploi plus général, sur lesquels personne n'a donné de préceptes, et comme nous faisons peu d'usage du panégyrique, j'avais cru devoir mettre à part tout ce qui se rattache à ce genre. Les Grecs eux-mêmes ne l'emploient pas à la tribune; ils ne l'ont traité que comme un objet de lecture et d'agrément, ou pour célébrer d'illustres personnages. Tels sont les panégyriques de Thémistocle, d'Aristide, d'Agésilas, d'Épaminondas, de Philippe, d'Alexandre et de plusieurs autres. Les éloges que nous prononçons dans le forum, dépouillés de tout ornement, ont la simplicité du témoignage, ou bien on les écrit pour une cérémonie funèbre qui s'accommode peu de la pompe de l'éloquence. Cependant, comme il faut quelquefois faire usage de ces sortes de discours, et quelquefois même en composer pour les autres, tels que l'éloge de Scipion l'Africain, prononcé par son neveu P. Tubéron, mais écrit par C. Lélius ; et comme nous pouvons désirer nous-mêmes de faire, à l'exemple des Grecs, l'éloge de quelques grands hommes, je dirai aussi quelque chose de cette branche de l'éloquence. Il est évident que parmi les avantages dont jouissent les hommes, il y en a qui ne sont que désirables, et d'autres qui sont dignes d'éloges. La naissance, la beauté, la force, la puissance, la richesse, et les autres biens que dispense la fortune, les qualités extérieures et physiques, ne méritent pas cette vraie gloire qui n'est due qu'à la vertu. Mais comme la vertu se montre surtout dans l'usage modéré qu'on fait de ces mêmes biens, il faut parler dans les panégyriques des dons de la nature et de ceux de la fortune; et sous ce rapport, le plus grand éloge est de n'avoir montré ni hauteur dans le pouvoir, ni fierté dans l'opulence; de ne s'être point prévalu de ses richesses; de n'avoir point fait servir les faveurs de la fortune à ses passions ni à son orgueil, mais de n'en avoir usé que pour mieux faire éclater sa bonté et sa modération. La vertu, qui est louable par elle-même, et sans laquelle rien n'est digne d'éloges, se partage en plusieurs espèces, dont les unes prêtent plus que les autres à l'éloge. Il en est qui consistent dans un heureux caractère, dans la douceur, la bienfaisance; d'autres, dans les facultés de l'esprit, la grandeur et la force de l'âme. On aime entendre louer dans les panégyriques la clémence, la justice, la bonté, la bonne foi, et le courage au milieu des dangers publics : toutes ces vertus sont plus utiles à la société qu'à ceux qui les possèdent. La sagesse, l'élévation de l'âme qui regarde en pitié toutes les choses de ce monde, les dons de l'imagination et du génie, l'éloquence elle-même, excitent également l'admiration, mais inspirent moins de sympathie : l'honneur et les avantages qu'elles procurent sont pour le héros; il n'en revient rien à l'auditeur. Cependant il ne faut par négliger d'en parler; car les hommes, tout en préférant l'éloge des vertus qui les charment, ne s'offensent pas d'entendre louer celles qui les étonnent. LXXXV. Comme chaque vertu a des devoirs et des obligations qui lui sont propres, et que chacune mérite un éloge particulier, si vous voulez louer la justice de votre héros, rappelez toutes les preuves qu'il a données de sa bonne foi, de son impartiale équité, enfin tout ce que lui aura inspiré le sentiment du devoir. De même, si vous célébrez en lui d'autres vertus, vous rapporterez toutes ses actions à la nature, au pouvoir, au nom même de chacune de ces vertus. On entend louer surtout avec plaisir les actions qui ne semblaient promettre aucun avantage, aucune récompense à leurs généreux auteurs. Celles qui ont été accompagnées de fatigues et de dangers présentent le sujet d'éloges le plus fécond, parce que c'est dans ce cas que la louange admet les plus abondants développements, et se fait entendre avec le plus de plaisir. En effet, la vertu qu'on regarde comme vraiment héroïque est celle qui se dévoue pour les autres, sans redouter les fatigues et les périls, et sans être guidée par l'intérêt. On admire encore la constance d'âme qui supporte l'adversité avec résignation, qui ne se laisse pas abattre par les coups du sort, et conserve sa dignité au milieu des revers. Les honneurs décernés avec éclat, les prix accordés au mérite, les suffrages des hommes venant s'attacher aux belles actions, donnent aussi beaucoup de lustre aux éloges : on peut encore y faire entrer le bonheur, juste récompense accordée par la bonté des dieux. Mais il ne faudra choisir que des circonstances extraordinaires, merveilleuses; car ce qui est petit, commun, vulgaire, ne donne lieu ni à l'admiration ni à la louange. Enfin le parallèle de celui qu'on veut louer avec quelque homme illustre, produira le plus brillant effet. Je me suis étendu sur ce genre plus longuement que je ne l'avais annoncé. Ce n'est pas qu'il soit du domaine de l'éloquence du barreau qui a fait la matière de tout cet entretien ; mais j'ai voulu vous prouver que si l'éloge est du ressort de l'orateur, ce que personne ne conteste, l'orateur est obligé de connaître toutes les vertus, sans quoi il n'y aura pas d'éloge possible. S'agit-il de blâmer, la méthode est évidemment la même: il faudra s'attacher à tous les vices contraires; et comme on ne peut louer les hommes de bien avec justesse et avec abondance, sans la connaissance des vertus, de même, sans celle des vices, on ne trouvera pas, pour flétrir les méchants, de traits assez saillants, assez énergiques, assez amers. D'ailleurs nous avons souvent à appliquer à tous les genres de cause ces lieux relatifs à l'éloge ou au blâme. Voilà quelles sont mes idées sur l'invention et la disposition du discours. J'ajouterai quelques mots sur la mémoire, afin d'alléger la tâche de Crassus, et de ne lui laisser à traiter que ce qui regarde l'élocution et les ornements du style. LXXXVI. - Continuez, dit Crassus; depuis longtemps vous étiez connu pour un maître de l'art: j'aime à vous voir déchirer enfin le voile de dissimulation derrière lequel se cachait votre science. Si vous ne me laissez rien, ou du moins peu de chose à dire, vous faites bien, et je vous en sais gré. - Il dépendra de vous, reprit Antoine, d'étendre ou de resserrer la part que je vous laisse. Elle embrasse tout, si vous voulez agir en conscience; mais si vous prétendez esquiver, voyez à vous tirer d'affaire avec vos jeunes auditeurs. Pour en revenir à notre objet, je n'ai pas le vaste génie de Thémistocle; je n'en suis pas comme lui à préférer l'art d'oublier à celui de se souvenir, et je rends grâce à Simonide de Céos, qui fut, dit-on, l'inventeur de la mémoire artificielle. On raconte que soupant un jour à Cranon, en Thessalie, chez Scopas, homme riche et noble, il récita une ode composée en l'honneur de son hôte, et dans laquelle, pour embellir son sujet, à la manière des poètes, il s'était longuement étendu sur Castor et Pollux. Scopas, n'écoutant que sa basse avarice, dit à Simonide qu'il ne lui donnerait que la moitié du prix convenu pour ses vers, ajoutant qu'il pouvait, si bon lui semblait, aller demander le reste aux deux fils de Tyndare, qui avaient eu une égale part à l'éloge. Quelques instants après, on vint prier Simonide de sortir : deux jeunes gens l'attendaient à la porte, et demandaient avec instance à lui parler. Il se leva, sortit, et ne trouva personne; mais pendant ce moment la salle où Scopas était à table s'écroula, et l'écrasa sous les ruines avec tous les convives. Les parents de ces infortunés voulurent les ensevelir; mais ils ne pouvaient reconnaître leurs cadavres au milieu des décombres, tant ils étaient défigurés. Simonide, en se rappelant la place que chacun avait occupée, parvint à faire retrouver à chaque famille les restes qu'elle cherchait. Ce fut, dit-on, cette circonstance qui lui fit juger que l'ordre est ce qui peut le plus sûrement guider la mémoire. Pour exercer cette faculté, il faut donc, selon Simonide, imaginer dans sa tête des emplacements distincts, et y attacher l'image des objets dont on veut garder le souvenir. L'ordre des emplacements conserve l'ordre des idées; les images rappellent les idées elles-mêmes : les emplacements sont la tablette de cire, et les images, les lettres qu'on y trace. LXXXVII. Qu'ai-je besoin de rappeler les avantages que la mémoire procure à l'orateur, son utilité et son pouvoir? N'est-ce point avec son secours que nous retenons tout ce que nous avons recueilli sur la cause en nous en chargeant, tout ce que nos propres réflexions nous ont suggéré? N'est-ce pas elle qui grave toutes les pensées dans notre esprit, qui reproduit dans un ordre régulier tous les termes qui les expriment? Grâce à elle, les renseignements utiles qui nous éclairent, les raisonnements auxquels il faut répondre, ne frappent pas seulement notre oreille, mais laissent dans notre esprit des traces profondes. Aussi n'y a-t-il que ceux dont la mémoire est vive et forte qui sachent ce qu'ils diront, dans quelle mesure et dans quels termes; qui se rappellent, et ce qu'ils ont réfuté, et ce qui leur reste à réfuter encore; qui se souviennent de tous les arguments dont ils se sont servis eux-mêmes dans d'autres causes, et de tous ceux qu'ils ont entendu développer à d'autres. J'avoue qu'il en est de la mémoire comme de toutes les autres facultés, dont j'ai parlé précédemment: c'est à la nature d'abord que nous en sommes redevables. Sans doute cet art de l'éloquence, ou si l'on veut, cette image, ce simulacre d'art, n'a pas le pouvoir de créer dans nos âmes des facultés que la nature n'y a pas mises; mais il peut du moins développer, et fortifier celles dont nous avons reçu le germe et le principe. Au surplus, s'il n'est pas de mémoire assez heureuse pour embrasser une longue suite d'expressions et de pensées à moins de s'aider d'un certain arrangement, de certains signes, il n'en est pas non plus d'assez ingrate pour ne tirer aucun avantage de cette habitude et de cet exercice. Simonide, ou l'inventeur, quel qu'il soit, de cet art, vit bien que les impressions qui nous sont communiquées par les sens, sont celles qui se gravent le plus profondément dans notre esprit, et que la vue est le plus pénétrant de tous les sens. Il en conclut qu'il nous serait facile de conserver le souvenir des idées que l'ouïe nous transmet, ou que l'imagination conçoit, si le secours de la vue venait rendre l'impression plus vive: qu'alors des objets invisibles, insaisissables à nos regards, sembleraient prendre un corps, une forme, une figure, et que ce que la pensée ne pourrait embrasser, la vue nous le ferait saisir. Ces formes, ces corps, ainsi que tous les objets qui tombent sous nos regards, avertissent la mémoire, et la tiennent en éveil. Mais il leur faut des places; car on ne peut se former l'idée d'un corps, sans y joindre celle de l'espace qu'il occupe. Pour ne pas m'étendre outre mesure sur une matière simple et connue de tout le monde, je me bornerai à dire qu'on doit se servir d'emplacements nombreux, remarquables, vastes, séparés par des intervalles peu considérables; employer des images frappantes, fortes, bien caractérisées, qui se présentent d'elles-mêmes et fassent une impression vive et prompte. C'est ce que vous apprendrez par l'exercice, qui amènera bientôt l'habitude. Attachez au mot que vous voulez retenir, l'image d'une chose dont le nom soit à peu près semblable, ou n'en diffère que par la terminaison; rappelez-vous le genre par l'espèce, une idée tout entière par l'image d'un seul mot, comme un peintre habile fait ressortir les objets par la variété des formes. LXXXVIII. La mémoire des mots, moins nécessaire à l'orateur, exige une plus grande variété d'images; car il y a une foule de mots, qui, semblables aux articulations, lient entre eux les membres du discours, et qu'on ne peut figurer par aucune forme sensible : il faut imaginer pour ces mots des figures particulières, pour s'en servir habituellement. L'orateur a surtout besoin de la mémoire des choses : nous pouvons la fixer par des tableaux bien faits, de manière que les pensées nous sont rappelées par les images, et leur ordre par l'emplacement que ces images occupent. Il n'est pas vrai, comme le prétendent des paresseux, que cette abondance d'images étouffe la mémoire, ni qu'elle répande de l'obscurité sur des choses dont nous aurions naturellement gardé le souvenir. J'ai vu des hommes d'un grand mérite, et d'une mémoire prodigieuse, Charmadas à Athènes, en Asie Métrodore de Scepsis, qu'on dit encore vivant; et tous deux m'ont assuré qu'ils gravaient par des images, dans des emplacements distincts, les objets dont ils voulaient conserver le souvenir, comme on trace des caractères sur des tablettes. Sans doute cet exercice ne produira pas en nous la mémoire, si la nature nous l'a refusée, mais si nous en avons le germe, il le dégagera de l'enveloppe qui le couvrait. Voilà un bien long discours, et si vous ne m'accusez pas d'arrogance et de présomption, vous me trouverez du moins bien peu modeste, d'avoir osé parler d'éloquence si longtemps devant vous, Catulus, et en présence même de Crassus. Car pour Sulpicius et Cotta, leur âge devait m'imposer moins. Cependant vous me pardonnerez, j'en suis sûr, quand vous saurez quel motif m'a entraîné à cette loquacité qui ne m'est pas ordinaire. LXXXIX. - Quant à nous, dit Catulus (je parle pour mon frère et pour moi), non seulement nous vous pardonnons, mais nous vous en aimons davantage, et nous vous remercions de tout notre coeur. Nous reconnaissons là votre aimable complaisance, et en même temps nous admirons l'étendue de votre savoir et votre étonnante facilité. Vous m'avez même rendu le service de me guérir d'une grande erreur, que je partageais avec beaucoup d'autres. Je ne concevais pas comment vous pouviez déployer au barreau un talent si extraordinaire, dans la persuasion où j'étais que vous n'aviez jamais étudié les règles. Maintenant je vois que vous les possédez à fond. Instruit par l'expérience, vous avez recueilli tous les préceptes, en confirmant ce qui était bon, et en corrigeant tout ce qui ne l'était pas. Sans admirer moins votre éloquence, je rends plus de justice à votre force d'âme et à votre zèle studieux, et en même temps, je me trouve avec plaisir affermi dans l'opinion où j'ai toujours été, qu'on ne peut acquérir la gloire de la sagesse et de l'éloquence qu'à force d'étude, de travail et de savoir. Mais quelle était votre pensée, quand vous nous disiez tout à l'heure que nous vous pardonnerions, si nous connaissions le motif qui vous avait déterminé? Quel autre motif aviez-vous que de satisfaire à notre empressement, et au désir de ces jeunes gens, qui vous ont écouté avec tant d'attention? - J'ai voulu, répliqua Antoine, ôter à Crassus tout moyen de manquer à sa promesse. Je savais que la modestie, une certaine répugnance, je n'ajouterai pas le défaut de complaisance, en parlant d'un homme aussi aimable, l'écartaient de ce genre d'entretien. Mais que pourrait-il prétexter maintenant qu'il a été consul et censeur? J'aurais pu en dire autant. Alléguera-t-il son âge? Il est plus jeune que moi de quatre ans. Son ignorance? Ce que je n'ai appris que fort tard, comme à la dérobée, et dans mes moments perdus, il s'y est appliqué dès son enfance, il l'a étudié avec soin et sous les maîtres les plus habiles. Je ne parle pas de son génie, qui est incomparable. Lorsque je prononce un discours, il n'est personne qui ait assez mauvaise opinion de soi, pour ne pas croire qu'il ferait mieux ou au moins aussi bien; mais dès que Crassus prend la parole, l'homme le plus présomptueux n'imagine pas pouvoir l'égaler. Ainsi, Crassus, il est temps que vous entriez en matière, si vous ne voulez pas que des amis d'un tel mérite se soient inutilement réunis. XC. - Quand je demeurerais d'accord, dit Crassus, que tous ces éloges sont mérités, et ils sont bien loin de l'être, que me reste-t-il, ou que resterait-il à tout autre, à dire après vous? Mes chers amis, je vous parle ici à coeur ouvert: j'ai entendu souvent, ou du moins plusieurs fois, d'habiles rhéteurs; car comment aurais-je pu en entendre bien souvent, moi qui, jeté dans le forum dès ma première jeunesse, ne m'en suis éloigné que durant le temps de ma questure! cependant j'ai entendu, comme je vous le disais hier, pendant mon séjour à Athènes, de très savants hommes, et en Asie, Métrodore de Scepsis, disputer sur la rhétorique; mais personne ne m'a paru traiter ce sujet avec plus d'abondance et de sagacité que vient de le faire Antoine. S'il en était autrement, si je croyais qu'il eût oublié quelque chose, je ne serais par assez incivil, assez peu complaisant, pour ne pas me rendre de bonne grâce à vos désirs. - Avez-vous donc oublié, Crassus, dit alors Sulpicius, qu'Antoine, en partageant avec vous, a pris le fond et comme le mécanisme de l'éloquence, et vous a laissé tout ce qui est relatif aux ornements et à la décoration? - D'abord, répondit Crassus, de quel droit Antoine a-t-il fait les parts, et choisi le premier? ensuite, si le plaisir que j'éprouvais à l'entendre ne m'a pas causé de distraction, il me semble qu'il a traité en même temps les deux sujets. - Il n'a point parlé, dit Cotta, des ornements et de cette intéressante partie dont l'éloquence tire son nom. - C'est-à-dire qu'il s'est réservé les choses, et ne m'a laissé que les mots. - Si la tâche qu'il vous a laissée, répondit César, est la plus difficile, c'est pour nous un motif de plus pour désirer de vous entendre; si c'est la plus facile, vous n'avez pas de prétexte pour nous refuser. - Vous avez dit, ajouta Catulus, que si nous restions aujourd'hui chez vous, vous consentiriez à nous satisfaire. Croyez-vous donc que votre parole, que votre honneur, ne soient pas engagés? - Cotta ajouta en riant : Je pourrais, Crassus, admettre vos excuses: mais prenez garde que Catulus ne fasse de ceci un cas de conscience. C'est une affaire qui est du ressort des censeurs, et voyez combien il serait honteux, pour un homme qui a été censeur lui-même, de donner un pareil exemple. - Eh bien! répondit Crassus, faites de moi ce que vous voudrez ; mais, à l'heure qu'il est, il vaut mieux nous retirer : nous avons besoin de repos. Nous reprendrons l'entretien après midi, à moins que vous n'aimiez mieux différer jusqu'à demain. Tout le monde s'écria qu'on désirait l'entendre à l'instant même, ou l'après-midi, s'il le préférait, mais du moins le plus tôt possible.
|