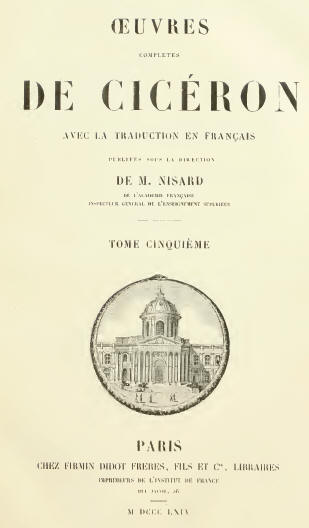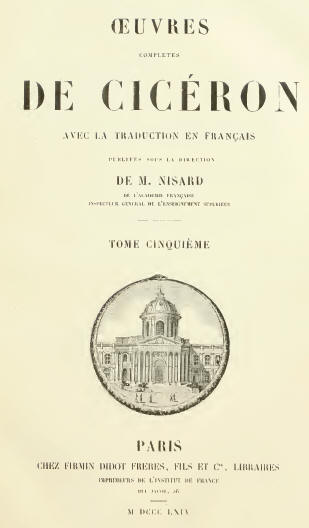|
400. — A TÉRENTIA. Brindes, juillet.
F. XIV, 21. Tâchez donc de vous
remettre, je vous en conjure. Décidez et ordonnez de tout, selon le
besoin, l'occasion et les circonstances ; et écrivez-moi le plus souvent
possible. Adieu.
401. — A TÉRENTIA. Brindes, 4 novembre.
F. XIV, 12. Vous vous réjouissez de
me savoir en Italie; veuillent les dieux que vous vous en réjouissiez
toujours! mais dans le trouble affreux de mes esprits, au milieu
d'assauts si cruels, je dois trembler d'une résolution dont la
justification sera difficile. Soyez-moi en aide en tout ce que vous
pourrez. Mais en quoi pourriez-vous me servir? je le cherche en vain. Ne
pensez pas à vous mettre en route par cette saison. Rien ne l'exige.
Puis la distance est longue, et les chemins ne sont pas sûrs. Je vous
répète que je ne vois pas ce que votre présence ici pourrait faire.
Adieu. — De Brindes, la veille des nones de novembre.
402. — A ATTICUS. Brindes, novembre.
A. XI, 5. Vous dire quel instinct
m'a poussé, quelles circonstances poignantes, cruel les, inouïes, ont
déterminé chez moi cette résolution ou plutôt ce coup de tète, serait un
effort trop douloureux. Jugez des choses par le résultat. J'en suis à ne
pas trouver un mot à écrire pour mon propre compte, à ne savoir que
désirer de vous; d'autant plus que les lettres que vous m'avez écrites,
ou que d'autres ont reçues de vous, ou qui ont été adressées en votre
nom, démontrent assez, comme je le pensais, que vous ne croyez plus
guère au succès de vos premières démarches, et que vous cherchez
d'autres voies pour me servir. Votre conseil de me rapprocher de Rome,
et de ne passer que de nuit dans les villes, n'est pas d'une exécution
commode. Trouverai-je partout des lieux de station convenables pour y
demeurer le jour? Et quelle différence voyez-vous d'ailleurs à ce que je
sois aperçu dans une ville ou sur un grand chemin? Cependant j'y
réfléchirai et ferai pour le mieux. Je me contente de répondre aux
lettres que je reçois. Veuillez écrire en mon
393
nom tant à Basilus qu'à tous autres pour qui vous le jugerez nécessaire,
et aussi à Servlius, s'il y a lieu. Si je garde un si long silence, il
est facile de voir, par ce mot même, que je n’ai rien à écrire, et que
ce n'est pas la bonne volonté qui me manque. — Vous voulez savoir
comment Vatlnius a été pour moi. Ni lui ni aucun autre n'aurait laissé
échapper une occasion de me rendre service. Quintus a été pour moi aussi
mal que possible à Patras, où son fils est venu le rejoindre de Corcyre.
Je crois qu'ils en sont repartis pour faire comme les autres.
403. — A TÉRENTIA. Brindes, novembre.
F. XIV, 19. Au milieu de mes
tourments, c'est la santé de Tullie qui fait mon plus cruel supplice. Je
n'ai rien à vous en dire. Vous en êtes aussi préoccupée que moi. Oui,
vous avez raison : il faut que je me rapproche. Je l'aurais déjà fait;
mais il y a eu des obstacles, et il y en a encore. — J'attends une
lettre d'Atticus. Veillez, je vous prie, à ce qu'on ne perde pas un
instant pour me l'envoyer. Je vous recommande votre santé.
404. — A ATTICUS. Brindes, 28 novembre.
A. XI, 6. Je vois combien vous êtes
tourmenté à la fois de votre position, de celle de la république, de la
mienne surtout, et de la douleur qui m'accable. Ma douleur, au lieu
d'être adoucie par la part que vous y preniez, ne fait que s'en irriter
encore. Que vous ayez de tact dans vos consolations, et que vous touchez
bien la corde sensible, quand vous me dites que j'ai bien fait, que je
ne pouvais agir autrement; et quand vous ajoutez (ce qui me touche moins
que votre jugement, mais ne laisse pas que de me toucher encore) que
cette opinion est dans tous les esprits, du moins dans tous ceux de
quelque poids ! Si j'en étais sur, je me plaindrais moins. Croyez en ma
parole, dites-vous. J'y crois : mais je sais que vous désirez surtout
alléger mes peines. Je me suis éloigné de l'armée, et ne m'en repens
point : c'étaient des projets atroces ; un pêle-mêle effroyable avec les
barbares ; la proscription déjà arrêtée, non par tête, mais en masse;
vos biens à tous enfin regardés comme un butin légitime. Je dis vos
biens, car ou se promettait contre vous personnellement d'en venir aux
derniers excès. Mes intentions ont toujours été excellentes. Je n'ai à
cet égard aucun reproche à me faire. Mais il fallait d'autres mesures.
J'aurais dû me tenir dans quelque ville d'Italie, et n'en pas bouger
jusqu'à ce qu'on me rappelât. J'eusse moins fait parler, moins souffert.
Je n'aurais pas du moins à gémir de cette faute. Rester misérablement à
Brindes me déplait de toutes façons. Me rapprocherai-je de Rome, suivant
votre conseil? Mais comment marcher sans mes licteurs? Le peuple me les
a donnés; on ne pourrait me les ôter qu'en me faisant violence. Ce n'est
pas qu'aux approches de la ville je n'aie cru devoir les disperser dans
la foule, avec leurs faisceaux, dans la crainte de quelques voies de
fait de la part des soldats. Il est des moments ou je me renferme
moi-même au logis. —Je suppose que vous ayez maintenant vu Oppius. Pour
peu qu'il leur convienne que je me rapproche, je le veux bien. J'en
serai plus à
384
portée de leurs directions. A les entendre, César veut non -seulement
nie garantir de toute atteinte, mais encore m'élever en crédit et en
dignité. Il n'est rien que je ne doive espérer et prétendre. J’aurais
néanmoins plus de foi à leurs protestations et à leurs serments si
j'étais demeuré. Mais point de retour sur le passé : ne nous occupons
que du présent. Veuillez en conférer avec eux. Ne jugeriez-vous pas à
propos, sauf leur avis, d'insinuer à César, pour ma justification, que
j’ai tout fait par leurs conseils? Joignez à eux Trébonius, Pansa,
d'autres encore; qu'ils lui écrivent positivement que je n'ai agi que
sous leurs inspirations. — La maladie de Tullle me fait mourir
d'inquiétude. Elle est si délicate! Je sais que vous lui prodiguez vos
soins, et j'en suis touché au fond de l’âme. — Pompée a fini comme il
devait finir : je n'en ai pas douté un seul instant. Lois et peuples,
tous les avaient si mal dans ses affaires, qu'en quelque lieu qu'il
abordait, son sort était inévitable. Je ne laisse pas de le déplorer. Il
était homme de bien, d'honneur et de mérite. — Moi, que je vous console
de la mort de Fannius? Il tenait sur vous des propos pleins de haine,
parce que vous étiez demeuré en Italie. L. Lentulus s'était adjugé, pour
sa part, la maison de la ville d'Hortensius, les jardins de César et sa
campagne de Baies. On fait à peu près de même dans l'autre parti. Mais
dans celui de Pompée on ne reculait, on ne s'arrêtait devant rien.
Quiconque était resté était ennemi. J'aurai bien des choses à vous dire,
mais en temps et lieu. — Mon frère Quintus est allé, dit-on, en Asie
faire sa soumission. Je ne sais rien de son fils. Informez-vous de lui
près de Diocharès, affranchi de César, que je n'ai pas vu ; mais c'est
lui qui a porté ces lettres d'Alexandrie. Il a vu, dit-on, mon neveu en
Asie, ou en route pour y arriver. J'attends vos lettres avec une
impatience que les circonstances n'expliquent que trop. Faites-les moi
attendre le moins possible.
405. — A TÉRENTIA. Brindes, décembre.
F. XIV, 9. Ce n'était pas donc assez
de toutes mes misères! il faut encore que j'aie le tourment de savoir
Dolabella et Tullle malades. Je ne sais que décider ni que faire. Ayez,
je vous en conjure, tous les soins possibles de votre santé et de celle
de Tullie. Adieu.
406. — A ATTICUS. Brindes, décembre.
A. XI, 7. Merci de votre bonne
lettre, où vous avez si bien parcouru le cercle de tout ce qui
m'intéresse. Je garderai donc mes licteurs, puisqu'on trouve bon que je
les garde. César ayant fait la même grâce à Sextius. Seulement il l'a
plutôt gratifié de licteurs qu'il ne lui a laissé les siens. Car on dit
qu'il regarde comme nuls tous les actes du sénat intervenus depuis que
les tribuns sont sortis de Rome. Quant aux miens, il peut me les laisser
sans se contredire. Mais il s'agit bien de licteurs, quand je viens de
me voir, peu s'en faut, expulsé d'Italie! Antoine m'avait notifié une
lettre de César, portant qu'il est informé du retour de Caton et de
Métellus en Italie, et de leur intention de se montrer à Rome; qu'il
n'entend pas cela; que leur présence pourrait y exciter de la
fermentation, et qu'il faut faire sortir d'Italie tous ceux qui n'auront
pas de lui permission d'y séjourner. C'est sous l'impression
385
d’une irritation très vive que cette lettre est écrite. Antoine
s'excusait d'ailleurs, et alléguait la nécessité de faire exécuter les
ordres de César. Je lui ai vite dépêché L. Lamia, pour lui dire que
c'est sur une invitation pressante de César à moi transmise par l'organe
de Dolabella que je me suis rendu en Italie. Là-dessus Antoine m'a
nommément excepté, ainsi que Lélius, dans son édit. C'est ce dont Je me
serais bien passé; il était si facile de me comprendre, sans mettre de
nom, dans une exception générale! Que d'humiliations! que d'injures!
Vous faites de votre mieux pour en affaiblir les coups, et vous n'y
perdez pas tout à fait vos peines. En voyant vos efforts pour adoucir
mes maux, le poids m'en semble plus léger, ne vous lassez pas de
m'écrire, je vous en conjure; cherchez à me convaincre que je n'ai pas
perdu tout droit à l'estime des honnêtes gens. Vous arriverez par là au
but que votre amitié se propose; mais le moyen de me le persuader? hélas
! il n'en est point. Les événements seuls peuvent ouvrir la voie :
malheureusement le vent n'y est pas. Mais que sait-on? des incidents
peuvent naître; n'y en a-t-il pas eu déjà? Par exemple, on m'accusait de
n'avoir pas suivi Pompée : et sa catastrophe est venue me justifier de
n'avoir pas poussé jusque-là le devoir. Mais. on se récrie de tous côtés
sur ce que je ne suis pas en Afrique. Que voulez-vous? j'ai pensé que ce
n'était point par des barbares, et la plus perfide de toutes les
nations, que la république devait être défendue, surtout contre une
armée tant de fois victorieuse. On dira peut-être que ce n'est qu'une
défaite. Il paraît en effet que beaucoup de gens de bien se rendent en
Afrique. D'autres y étaient déjà, je le sais. C'est donc là un point
vulnérable, et j'ai grand besoin que les événements viennent à mon
secours. Il faudrait au moins que je ne fusse pas seul, et que quelques
autres, si ce n'est tous, pensassent aussi à eux. Car s'ils persévèrent,
et s'ils ont la fortune de leur côté, que deviendrai-je, je vous le
demande? Vous me répondrez en me demandant ce qu'ils deviendront s'ils
sont vaincus. Ah! du moins, ils auront péri avec honneur. Ces réflexions
sont poignantes. — Vous ne me dites pas en quoi vous trouvez que
Sulpicius n'a pas fait mieux que moi. Il n'approche pas sans doute de la
gloire de Caton; mais il est à l'abri de la crainte et du remords. Reste
la condition de ceux qui sont demeurés en Achaïe. Ils ont encore cet
avantage qu'ils sont plusieurs ensemble, et qu'une fois de retour en
Italie, ils pourront rentrer chez eux. Allons! continuez-moi vos
consolations, et justifiez-moi de votre mieux. — Vous vous excusez de ne
pas venir : je connais vos motifs, et je conçois d'ailleurs qu'il est de
mon intérêt que vous restiez à Rome, pour agir et parler dans l'occasion
comme vous le faites. Voici surtout un point que je vous recommande. Il
ne manque pas de gens, je le suppose, qui disent ou qui diront à César
que je me repens de ce que j'ai fait, que je suis mécontent de ce qui se
passe. Cela n'est que trop vrai. Mais on l’affirme sans le savoir, et
dans une intention perfide. Il faut que Balbus et Oppius se chargent de
parer à cela, et qu'ils ne cessent d'écrire à César pour l'entretenir
dans ses bonnes dispositions pour moi. Vous y veillerez, n'est-ce pas?
Une autre raison pour moi de souhaiter que vous restiez à Rome, c'est
l'extrême désir qu'eu a Tullie. misère! Que vous dire? sais-je même ce
que je veux? Abré-
386
geons. Les pleurs m'inondent. Prenez tout sur vous. Avisez, songez
seulement an temps où nous vivons, et a ne rien faire qui puisse vous
nuire à vous-même. Mon angoisse et mes larmes m'empêchent de m'arrêter
sur ce sujet. Que je vous dise seulement ma vive gratitude pour les
preuves de tendresse que reçoit de vous ma fille. — Vous avez pris soin
d'écrire pour moi aux uns et aux autres : c'est à merveille. J'ai vu une
personne qui a rencontré Quintus le fils a Samos et son père a Sicyone.
Leur paix sera bientôt faite. Ils devraient bien, le voyant avant moi,
faire dans mon intérêt ce qu'a leur place je ne manquerais pas de faire
pour eux. Vous m'engagez à ne pas prendre mal les passages de vos
lettres qui me paraîtraient un peu vifs : il n'y a rien que je ne prenne
très bien, je vous assure. Continuez donc a me dire librement votre
pensée, et écrivez-moi le plus souvent possible.
407. — A TERENTIA. Brindes, décembre.
F. XIV, 17. Si j'avais quelque chose
à vous mander, mes lettres seraient et plus longues et moins rares. Vous
voyez quel est l'état des affaires. Lepta et Trébatius pourront vous
dire comment je les envisage. Ne négligez rien, je vous en conjure, pour
votre santé et celle de Tullie. Adieu.
408. — A ATTICUS. 27 décembre.
A. XI, 8. Vous avez beau vous
figurer ce que je souffre; vous le saurez mieux encore par Lepta et
Trébatius. Je paye cher un coup de tête que vous voulez absolument me
faire prendre pour un acte de prudence. Ne laissez pas de le soutenir
toutefois, et de me l'écrire aussi souvent que vous le pourrez ; ce
m'est un soulagement extrême que vos lettres. Il est nécessaire que vous
agissiez auprès de ceux qui me veulent du bien et qui ont du crédit
auprès de Balbus et d'Oppius surtout, et que vous les déterminiez à
écrire vivement pour moi. On cherche à me nuire, m'a-t-on assuré : il y
a eu des paroles dites et des lettres écrites. Tâchons de déjouer ces
attaques. Rien n'est plus grave. J'ai là-bas dans Fufius un ennemi juré.
Quintus a envoyé son fils intercéder pour lui d'abord, et eu second lieu
déclamer contre moi. Il dit à qui veut l'entendre que je l'ai accusé
près de César : en quoi César et ses amis le démentent formellement.
Mais il n'est pas moins partout répandant contre moi l'injure : c'est
vraiment incroyable, et de toutes mes peines voilà la plus sensible. On
m'a rapporté des propos par lui publiquement tenus à Sicyone, et qui
sont révoltants. Vous connaissez sa terrible humeur; il se peut même que
vous l'ayez essuyée. Il m'a pris pour point de mire. Mais ces détails
aigrissent ma douleur, et ne sont bons qu'à vous affliger aussi. J'en
reviens à ma prière. Décidez Balbus a envoyer un exprès à César, comme
nous en sommes convenus, et continuez d'écrire en mon nom a toutes les
personnes a qui il est utile de le faire, Adieu. Le 6 des kalendes de
janvier.
409. — A TÉRENTIA. 31 décembre.
F. XIV, 16. Dans la situation où nous sommes, il n'y a aucun motif pour
que vous m'écriviez, ni pour que je vous écrive. Il arrive pourtant, je
ne sais comment, que je m'attends toujours à recevoir de vos nouvelles,
et que je ne puis me défendre de vous donner des miennes quand une occa-
387
sion se présente. Je croyais à plus de dévouement pour vous de la part
de Volumnia. Comment n'a-t-elle pas mis au moins plus de soin, plus de
précaution dans le peu qu'elle a fait ? Mais j’ai bien d'autres sujets
de préoccupation et de douleur. Je suis bourrelé, et ceux qui m'ont
entraîné hors de ma voie doivent être contents. Voyez bien soin de votre
santé. La veille des kalendes de janvier.
AN DE R. 707. — AV. J. C. 46. — DE C. 61.
J. César dictateur; Marc Antoine, maître de la cavalerie.
410. — A ATTICUS. Brindes, janvier.
A. XI, 9. Oui, il n'est que trop
vrai que j'ai agi a la fois sans prudence et avec la plus déplorable
précipitation. Plus d'espoir, grâce à ces exceptions des édits qui
m'enchaînent. Si votre active et inquiète amitié ne s'y était pas
employée, je serais libre de fuir en quelque solitude; maintenant je ne
le puis plus. Que me sert-il d'être arrivé avant l'entrée des tribuns en
charge, s'il valait mieux encore ne pas venir? Que puis-je défendre d'un
homme qui n'a jamais été de mes amis (Antoine), quand je suis déjà sous
le coup de la loi? Les lettres de Balbus deviennent de jour en jour plus
froides. C'est à qui écrira à César, et contre moi peut-être. Je me suis
perdu par ma faute. Le hasard n'y est pour rien. Je n'en dois accuser
que moi. En voyant le caractère de la guerre, l'imprévoyance et la
faiblesse d'un côté, l'énergie et l'activité de l'autre, je pensais à
demeurer neutre ; car que faire? et ce parti, s'il n'était le plus
héroïque, était chez moi plus excusable que chez tout autre. Mais non,
je m'en laissai conseiller ou plutôt imposer un autre par les miens.
L'un d'eux (Quintus), celui-là même que vous me recommandez, vous allez
le connaître par les lettres qu'il vous écrit, à vous et à d'autres. Je
ne les aurais jamais ouvertes ni connues, sans les circonstances que
voici. On m'apporta le paquet : je le rompis pour voir s'il y en avait
pour moi. Il n'y en avait pas, mais j'en trouvai deux pour Vatinius et
Ligurius. Je les leur fis tenir, presque au même instant je les vis
accourir outres d'indignation et criant à l'infamie. Alors ils me lurent
des lettres pleines d'horreurs contre moi. Ligurius était hors de lui.
Il était, disait-il, à sa connaissance que César avait toujours eu de
l'éloignement pour sa personne ; que dans la faveur qu'il lui avait
montrée, dans les présents dont il l'avait comblé, il n'avait jamais eu
en vue que de me plaire. Une fois ce coup porté, je voulus savoir ce
qu'il écrivait aux autres. Je pensai au tort qu'il allait se faire pour
peu qu'un tel procède devînt public. Toutes les lettres étant du même
style, je vous les envoie. Si vous croyez de son intérêt qu'elles soient
remises, faites-les parvenir. Je suis au-dessus de pareilles atteintes.
Les lettres sont décachetées; mais Pomponia a son cachet, je pense. Sa
mauvaise humeur a éclaté dès le commencement de notre traversée, et ma
causé un abattement dont je n'ai pu me tirer. Son but est, dit-on, moins
de se faire du bien que de me nuire. Tout se réunit pour m'accabler. Je
résiste à peine ou plutôt je succombe à mes maux. Ils sont plus forts
que moi. Au milieu de mes douleurs, il en est une qui égale a elle seule
toutes les autres : c'est de laisser ma pauvre fille, abandonnée, sans
patrimoine, sans ressource quel-
388
conque. Voilà pourquoi je désire si fort de vous voir, comme vous me
l'avez promis. Je n'ai autre que vous à qui la recommander, puisque je
vois sa mère destinée aux mêmes épreuves que moi. Si je ne puis vous
voir, tenez la recommandation pour faite, et conjurez autant que
possible les fureurs de sou oncle. C'est aujourd'hui le jour de ma
naissance. Ah! pourquoi m'a-t-il été donné de naître? pourquoi du moins
faut-il que ma mère ait mis au monde un autre fils que moi? Mes larmes
ne me permettent pas de continuer.
411. — A ATTICUS. Brindes, 21 janvier.
A. XI, 10. Chaque jour ajoute à mes
inconcevables peines tout ce qu'on me rapporte de mon frère et de son
fils, ou de mes amis. P. Térentius a eu des opérations à suivre en Asie,
où il est vice-administrateur des fermes. Il a vu le jeune Quintus à
Éphèse le 6 des ides de décembre, et, après lui avoir fait par suite de
notre amitié toute sorte de politesses, il lui a demandé de mes
nouvelles; à quoi, suivant le dire de Térentius, l'autre a répondu qu'il
m'avait en horreur, et lui a montré un discours préparé qu'il veut
débiter à César contre moi. Térentius lui a demandé s'il était fou, et
lui a fait toutes sortes de représentations. Depuis, il a rencontré mon
frère lui-même à Patras. Mêmes abominations. Vous avez pu déjà juger de
leur animosité par les lettres que je vous ai communiquées. Je sais que
tout cela vous afflige. Pour moi, c'est un supplice, d'autant que je
n'aurai pas même la ressource de me plaindre. Les nouvelles d'Afrique
sont toutes différentes de ce que vous me mandez. On dit, qu'on y est en
force et parfaitement en mesure. De plus l'Espagne se déclare, l'Italie
se détache. Les légions ont perdu eu nombre, et n'ont plus le même
esprit. Rome est dans le chaos. Dites-moi, je vous prie, le moyen de
respirer au milieu de tout cela, si ce n'est en lisant vos lettres?
Elles seraient plus fréquentes, à coup sûr si vous aviez quelque chose
de consolant à me dire. Cependant ne cessez pas, je vous prie, de
m'instruire de tout. Et si vous ne pouvez haïr ceux qui se disent si
cruellement mes ennemis, condamnez-les du moins : non que par la
j'espère les ramener, mais afin qu'ils sachent que je n'ai pas cessé de
vous être cher. Je vous écrirai plus au long, quand j'aurai reçu votre
réponse à ma dernière lettre. Adieu. Le 12 des kalendes de février.
412. — A ATTICUS. Brindes, 8 mars.
A. XI, 11. Accablé sous le poids de
mes maux, c'est tout au plus si j'aurais la force de vous écrire, même
quand il serait indispensable de le faire ; à plus forte raison quand je
n'ai vraiment rien à vous apprendre, et surtout quand je ne vois aucune
chance pour moi. Déjà même je compte moins sur vos lettres, et pourtant
j'y trouve toujours quelque chose de doux. Continuez donc de m'écrire,
toutes les fois que vous trouverez à qui donner la commission. Je n'ai
rien à répondre à vos dernières lettres, qui datent déjà d'assez loin.
Je vois que dans l'intervalle la face des affaires a bien changé. La
force retourne où elle doit être, et mon imprudence pourra me coûter
cher. Il faut payer à P. Sallustius les trente mille sesterces que j'ai
reçus de son frère Cnéius. Veillez, je vous prie, à ce qu'il n'y ait pas
de retard, j'en ai écrit à Térentia. Cet argent est déjà presque mangé.
Vous verrez avec elle à m'en procurer. Une fois les fonds faits à Rome,
je trou-
389
verais ici la somme contre mes lettres de change : mais avant de puiser
dans aucune bourse, il me faut cette certitude. Vous voyez quelle est ma
situation sous tous les rapports ; il n'est point de maux que je ne
subisse ou n'attende, et par ma faute; ce qui me les rend plus pénibles.
Quintus est en Achaïe, et ne cesse de se déchaîner contre moi. Ainsi vos
lettres n'ont rien gagné sur son esprit. Adieu. Le 8 des ides de mars.
413. — A ATTICUS. Brindes, 8 mars.
A. XI, 12. Céphalion m'apporte une
lettre de vous ce soir, 8 des ides de mars. Je vous ai écrit ce matin
par mes messagers; mais d'après ce que je vois, vous êtes inquiet de
savoir comme j'entends présenter à César mon départ d'Italie, et c'est
sur quoi surtout j'ai quelques mots à vous dire. Je n'ai pas de
nouvelles explications à lui donner : je lui ai écrit cent fois, et j'ai
mandé à raille autres, que je n'avais pu en dépit de moi-même soutenir
le déchaînement de l'opinion : tel a été mon texte. Je ne désire
nullement lui donner à penser que j'ai recouru à des conseils étrangers
pour une affaire de cette importance. Depuis, Balbus Cornélius le jeune
m'a écrit, et suivant sa lettre César était persuadé que c'était Quintus
mon frère qui avait mené la marche, je répète son mot. Je ne savais pas
alors ce que déjà Quintus écrivait de moi aux uns et aux autres, bien
que déjà son langage et ses procédés me rendissent sa société
suffisamment pénible. Néanmoins, je ne laissai pas que d'écrire
littéralement ce qui suit à César par Nilus : « Je ne suis pas moins
préoccupé de Quintus mon frère que de moi-même. Mais je n'ose vous le
recommander dans la position que les circonstances m'ont faite. J'oserai
seulement vous adresser une prière : c'est de croire qu'il n'a jamais
cherché ni à agir près de moi contre vous, ni à me refroidir à votre
égard. Soyez au contraire bien persuadé que ses avis ont tendu
constamment à nous l'approcher; qu'enfin il n'a été que le compagnon
passif et nullement l'instigateur de ma fuite. Veuillez donc lui
conserver vos bontés, et suivre à son égard ce que l'amitié vous
inspire. Qu'il ne soit pas dit que mon frère ait quelque chose à
souffrir à cause de moi. Je vous le demande en grâce. — En cas
d'entrevue avec César, je serai pour mon frère le même que j'ai toujours
été. Mais je ne doute pas que César le reçoive bien; il s'en est
expliqué déjà. Il me semble que c'est du côté de l'Afrique que je dois
regarder maintenant avec inquiétude. On y lutte, dites- vous, beaucoup
moins pour vaincre que pour se mettre en état de composer. Puisse-t-il
en être ainsi! malheureusement je n'en crois rien, et je suis persuadé
que vous n'en croyez rien vous-même, au moment surtout ou l'Espagne
donne la main à l'Afrique. Vous ne voulez pas me tromper; mais vous
cherchez à me donner du courage. Vous m'engagez à écrire à Antoine et à
d'autres. Ayez la bonté de leur écrire pour moi, s'il est nécessaire,
ainsi que vous l'avez fait déjà. Je ne saurais vraiment quel langage
leur tenir. On vous a dit que j'étais plus abattu que jamais. Comment en
serait-il autrement"? ne voilà-t-il pas un surcroît à tous mes chagrins,
et ne voyez-vous pas les belles choses que fait mon gendre? Ne cessez de
m'é-
390
crire tant que vous le pourrez, je vous en conjure; et même n’ayant rien
à me dire, écrivez-moi toujours. Vos lettres ne sont jamais stériles.
J’ai pris possession de l'héritage de Galéon. Il n'a institué qu'un seul
héritier, je le suppose ; car on ne m'a notifié aucune autre disposition
de sa part. Le 8 des ides de mars.
414. — A ATTICUS. Brindes, mars.
A. XI, 13. Je n'ai pas encore reçu
la lettre dont vous avez chargé l'affranchi de Muréna. Je réponds à
celle que P. Siser m'a apportée. Il en est de ce que vous me racontez
des lettres de Servius le père, comme de ce qu'on vous a dit du voyage
de Quintus en Syrie : pure invention. Vous me demandez comment se
conduisent avec moi les gens d'ici et ceux qui y passent. Rien
d'hostile; mais en suis-je plus avancé? c'est ce que vous savez aussi
bien que moi. De tous les chagrins qui m'accablent, ce qu'il y a de plus
cruel est de me voir dans une position à souhaiter pour mes intérêts ce
que j'ai toujours le plus redouté. On dit que P. Lentulus le père est à
Rhodes, que son fds est a Alexandrie; et il est positif que C. Cassius
est en route de Rhodes pour Alexandrie. Quintus vient de m'adresser une
justification dont les termes sont beaucoup plus durs encore que tout ce
qu'il a pu dire dans sa plus grande animosité. Il a vu, dit-il, par vos
lettres que vous n'étiez pas content de la manière dont il avait parlé
de moi dans sa correspondance avec plusieurs personnes. Il regrette de
vous avoir causé de la peine ; mais il était tout à fait en droit, et il
entre dans un très injurieux détail de ses raisons. Aujourd'hui comme
avant il choisit pour montrer son aversion le moment ou la fortune
m'accable. Que ne suis-je maintenant près de vous, eussé-je passé des
nuits pour vous rejoindre, comme vous me le proposiez! Je ne sais plus
ni quand ni ou je vous verrai. — Vous pouviez vous dispenser de m'écrire
au sujet des cohéritiers de Fufidius. Leur demande est juste, et
j'aurais approuve tout ce que vous auriez fait. —J'ai toujours eu
l'intention de racheter le bien de Frusinum; il y a longtemps que je
vous l'ai dit. Il est vrai qu'alors mes affaires étaient meilleures et
celles de l'État moins désespérées; néanmoins je persiste. Soyez assez
bon pour aviser à ce qu'il y a à faire. Veuillez aussi, si vous en avez
le loisir, voir ou je dois puiser pour mes besoins journaliers. Tout ce
que je pouvais avoir d'argent comptant, je l'ai mis à la disposition de
Pompée dans un temps où je croyais faire ainsi preuve de sagesse. Puis,
je fus obligé de recourir à votre receveur et de faire ailleurs encore
des emprunts, parce que mon frère m'écrivit pour se plaindre de ce que
je ne lui avais rien donné. Notez qu'il ne m'avait fait aucune demande,
et que l'argent de Pompée n'avait pas même passé par mes mains. Voyez,
je vous prie, de quoi je puis faire ressource, et donnez-moi vos
conseils. Vous connaissez la cause de tout le mal. Je n'ai pas la force
de poursuivre. S'il y a à écrire à quelques personnes, veuillez le faire
encore pour moi, comme à l'ordinaire, et ne laissez passer aucune
occasion de m'écrire aussi.
415. — A ATTICUS. Brindes, mars.
A. XI, 14. Oui, vous avez raison. Je
vous sais
391
gré de supprimer les formules de consolation en présence des maux qui
nous accablent tous, et moi eu particulier, et de reconnaître que toute
consolation est désormais impossible. Ma position est bien changée. Je
ne me croyais pas seul de mon bord; mais voilà que tous ceux qui étaient
en Achaïe ou en Asie pour taire leur paix se rendent, dit-on, en
Afrique, sachant ou ne sachant pas ce qui s'y est passé. Ainsi, excepté
Lélius, il n'est personne qui partage ma faute : encore est-il plus
heureux que moi, puisque son accommodement est déjà conclu. Je ne doute
pas qu'on ait déjà (César) écrit à mon sujet a Balbus et à Oppius ; mais
s'il y avait de bonnes nouvelles, ils m'en auraient fait part et vous en
auraient parlé. Ayez, je vous en prie, un entretien avec eux, et
mandez-moi ce qu'ils vous auront appris. Ce n'est pas que je regarde des
paroles comme des garanties; mais cela me permettrait du moins de
respirer et de prendre mes mesures. Quoique je répugne à me montrer
surtout avec un tel gendre, je ne vois pourtant rien de mieux pour moi
dans l'extrémité où je suis. Quintus ne change point, à ce que
m'écrivent et Pansa et Hirtius, et l'on dit qu'il suivra le torrent en
Afrique. J'écrirai à Minucius, a Tarente, et lui enverrai votre lettre.
Je vous manderai s'il a fait ou non quelque chose. Je me demande comment
vous avez pu réunir trente mille sesterces, à moins d'avoir tiré
beaucoup des biens de Fufidius, ce qui est évident. Je vous attends,
mais combien n'aurais-je pas plus de joie encore de vous voir, si
c'était possible! La conjecture est si critique! Il vous sera facile de
juger quel est pour moi le moins mauvais parti. Adieu.
416. — A ATTICUS. Brindes, 14 mai.
A. XI, 15. Puisque de si justes
motifs vous retiennent en ce moment, que faut-il faire? Dites-le-moi. Le
héros ne sort pas d'Alexandrie, si bien qu'il ne se soucie pas qu'on
sache ce qui s'y passe. Et voilà l'armée d'Afrique qui va leur tomber
sur les bras, et ceux d'Achaïe et d'Asie qui sont tout prêts à les
rejoindre, ou qui vont s'arrêter dans quelque place neutre. Quel parti
prendre, je vous prie? Le conseil est embarrassant, je ne le vois que
trop. Je ne connais que moi, un seul excepté peut-être, à qui tout
retour soit fermé d'un côté, aussi bien que tout espoir de l'autre.
Cependant je veux savoir votre pensée, et c'est la le motif entre mille
autres qui me faisait tant souhaiter de vous voir. Minucius ne m'a payé
que douze mille sesterces, je vous l'ai déjà mandé. Occupez-vous, je
vous prie, de me faire toucher le reste. Bien loin de me témoigner le
moindre regret, Quintus m'a écrit une lettre abominable. Quant a son
fils, c'est une haine sans égale. Il n'est sorte de chagrin qui me soit
épargné. Mais que tout me serait léger sans le sentiment de ma faute qui
pèse si cruellement et à tous les instants du jour sur mon triste coeur
! Encore, si d'autres y étaient tombés comme moi, ce serait une ombre de
consolation. Prenez qui vous voudrez, vous trouvez une raison de
conduite chez tous; chez moi, point. Tels ont été pris ou coupes, mais
ce qu'ils voulaient est clair. Qu'on leur permette de s'échapper, de se
réunir, on le verra. Ceux qui d'eux-mêmes se sont rendus à Fufius ont eu
peur, et voilà tout. D'autres sont là qui attendent ; mais ils n'ont
qu'à se présenter : on les recevra toujours. Étonnez-
392
vous donc encore après cela de l'état cruel de mon esprit. Il n’y a que
ma position dont on ne puisse sortir; mettons celle de Lélius aussi. En
suis-je plus avance? On dit que C Cassius a changé d'avis, et ne va plus
à Alexandrie. Si je vous ouvre ainsi mon coeur, ce n'est pas que
j'attende de vous du soulagement: mais je suis curieux de savoir ce que
vous me direz, en voyant les maux qui m'accablent. Mon gendre se met
aussi de la partie, et il y a bien des choses dont mes larmes
m'empêchent de parler. N'est-ce pas un supplice encore que le fils d'Ésopus'?
Non, rien ne manque à mes maux, et je suis le plus malheureux des
hommes. Je reviens où j'en étais : (jue l'aire? faut-il me rapprocher
tout doucement? faut-il passer la mer? Rester plus longtemps ici est
impossible. —Comment donc n'eu a-t-on pas fini avec les biens de
Fulidius? Ces sortes d'affaires ne donnent jamais lieu à la moindre
difficulté : si l'une des parts semble trop faible, il est si facile par
voie de licitation de rétablir l'égalité! Ce n'est pas sans motif que je
vous adresse cette question. Je soupçonne que les héritiers voyant
l'incertitude de ma position cherchent à gagner du temps. Adieu. La
veille des ides de mai.
417. — A ATTICUS. Brindes, 3 juin.
A. XI, 16. Une autre fois j'ai pu me
tromper; mais aujourd'hui ce n'est pas ma faute si je ne vois rien de
rassurant dans cette lettre. Deux mots à peine, et que je soupçonne fort
n'être pas son ouvrage. Vous ne vous y êtes pas laissé prendre non plus,
j'en suis sur. Je n'irai pas au-devant de lui; je suivrai votre conseil.
Aussi bien rien n'est moins certain que son retour. Ceux qui arrivent
d’Asie assurent qu'il n'y est nullement question de paix. La paix, voilà
pourtant ce qui m'a entraîne dans ce mauvais pas. Je ne vois jour
d'aucun côté, surtout depuis cet échec en Asie, et à la façon dont les
choses ont tourne en Illyrie, avec Cassius, à Alexandrie même, dans Rome
et l'Italie. Pour moi, je suis convaincu, fût-il en route, lui qui,
dit-on, combat encore, que la question sera décidée avant son retour.
Vous avez la bonté de me dire qu'à la nouvelle de sa lettre, quelque
joie est revenue au bon parti. Vous relevez, je le vois, tout ce que
vous croyez capable de me procurer un peu de consolation. Mais on ne me
persuadera jamais qu'aucun bon citoyen me croie attaché a la vie au
point de la vouloir tenir de lui, d'autant que je serais le seul jusqu'à
présent dans ce cas. Ceux qui sont en Asie voient venir les événements;
ceux d'Achaïe annoncent toujours leur soumission à Fufius. D'abord ils
ont eu peur comme moi, et ils allaient prendre le même parti. Puis est
survenu le temps d'arrêt d'Alexandrie qui es sauve et qui me perd.
J'insiste donc sur ce que je vous ai déjà demandé : si vous voyez
quelque planche de salut pour un homme qui se noie, veuillez me la
montrer. En admettant qu'on veuille me recevoir (et comme vous voyez, ce
n'est pas chose faite), tant qu'il y aura guerre, que faire? où aller?
Si l'on me repousse, c'est encore pis. J'attends une lettre de vous, et
j'espère qu'elle me dira catégoriquement ce que vous pensez ; je vous le
demande en grâce. Vous me conseillez de faire part à mon frère de ma
lettre; je le ferais
393
si elle en valait la peine; d'ailleurs on m'écrit de Tatras ces propres
mots : « Je ne me trouve pas mal ici pour un temps si malheureux; j'y
serais mieu x encore si je n'avais le chagrin d'entendre votre frère
parler de vous tout autrement qu'il ne devrait. » Il se plaint,
dites-vous, de ce que je ne lui réponds point. Il ne m'a écrit qu'une
fois. Je lui ai répondu par Céphalion, mais voilà plusieurs mois que
Céphalion est retenu par les vents contraires. Je vous ai déjà dit que
le fils de Quintus m'avait écrit de la manière la plus insolente. — J'ai
réservé pour la lin une recommandation que j’ai à vous faire, en
supposant que vous la trouviez convenable et que vous vouliez
l'accepter. Pourriez-vous vous entendre avec Camille, afin de dire un
mot à Térentia pour son testament? Les circonstances lui fout un devoir
de mettre ordre à ses affaires et de payer ses dettes. A entendre
Philotime, ses intentions seraient indignes. J'ai peine à le croire;
mais s'il y a moyen d'y mettre ordre, ne vous en faites pas scrupule.
Écrivez-moi sur tout ce qui se passe; mais particulièrement sur ce
point. J'ai bien besoin de vos conseils. Si vous n'en avez pas à me
donner, dites-le-moi, je saurai du moins à quoi m'en tenir. Le 3 des
noues de juin.
418. — A ATTICUS. Brindes, 14 juin.
A. XI, 17. Je ne vous écris que deux
mots. Le porteur est pressé ; il n'est pas à moi, et j'aurai sous peu un
exprès à vous envoyer. Ma chère Tullie m'est arrivée la veille des ides
de juin. Elle ne tarit pas sur vos attentions et vos bontés, et m'a
remis vos trois lettres. Loin que mon cœur se soit ému d'une joie hélas!
bien naturelle, à la vue de ma fille, d'une fille si vertueuse, si
aimable, si tendre, j'ai ressenti au contraire une mortelle douleur en
songeant aux épreuves cruelles de cette femme admirable, et en
réfléchissant que ces épreuves sont mon ouvrage à moi seul, et qu'elle
n'a pas un reproche à se faire. Cessez donc de chercher pour moi des
consolations, je vois que vous faites effort pour en trouver; ou des
conseils, il n'en est plus de possible; et vous avez à cet égard, tout
épuisé, surtout dans vos dernières lettres. Je songe à envoyer Cicéron
avec Salluste au devant de César. Quant à Tullie, je ne vois pas de
raison pour la retenu- ici au milieu de toutes nos souffrances; et je la
renverrai à sa mère, aussitôt qu'elle voudra partir. Si je ne réponds
pas à la lettre que vous m'avez écrite en forme de consolation, c'est
qu'il vous est facile de deviner ma réponse, et qu'elle est toute faite
d'avance. — Ce que vous me rapportez des nouvelles d'Oppius s'accorde
assez avec mes présomptions. Mais je suis bien sur qu'ils ne se
persuaderont jamais que j'approuve rien de ce qu'ils font, quoi que je
puisse dire. Toutefois je veux m'observer, bien que je ne voie pas ce
que j'ai à perdre ou à gagner à leur haine. — Je ne sens que trop les
raisons qui vous empêchent du venir ; mais j'en suis mortifié. Rien
n'annonce encore le départ d'Alexandrie, et il est certain qu'il n'en
est arrivé personne depuis les ides de mars, et qu'on n'a pas reçu de
lettre de lui (de César) postérieurement aux ides de décembre; ce qui
montre clairement que cette lettre du 5 des ides de février, laquelle ne
prouverait rien quand même elle serait vraie, n'est qu'une lettre
apocryphe. Nous savonsque L. Terentius a quitté l'Afrique et qu'il a
abordé à Paestum. Qu'apporte-t-il? comment a-t-il pu partir? que se
passe-t-il en Afrique? c'est ce que je voudrais savoir. On dit
394
que c’est Nasidius qui l'a fait passer. Si vous en apprenez quelque
chose, soyez assez bon pour me le mander. Je ferai ce que vous désirez
pour les dix mille sesterces. Adieu. Le 12 des kalendes de juillet.
419. — A TERENTIA. Brindes,15 juin.
F. XIV, 11. Notre Tullie m'est
arrivée la veille des ides de juin. En voyant tant de vertu et de bonté,
je me suis reproché plus amèrement encore la triste fortune fine je lui
ai faite dans mon aveuglement, et que méritent si peu sa tendresse et
son beau caractère, .le songe à envoyer Cicéron à César, et avec Cicéron
Cn. Sallustius. S'il part, vous le saurez. Prenez grand soin de votre
santé. Adieu. Le 17 des kalendes de juillet.
420. — A ATTICUS. Brindes, 20 juin.
A. XI, 18. Il n'est pas encore
question de ce départ pour Alexandrie (de César). On lui croit au
contraire bien des affaires sur les bras. Aussi je renonce, quant à
présent, à envoyer Cicéron ; et vous, voyez à me tirer d'ici. Ce qu'il y
a de pis pour moi serait d'être condamné à y rester plus longtemps. Je
viens d'en écrire à Antoine, à Balbus et à Oppius. Soit qu'on se balte
en Italie, ou que la guerre se fasse sur mer, ce séjour ne peut me
convenir; et de ces deux hypothèses l'une ou l'autre arrivera, peut-être
les deux à la fois. — Je vois clairement, par ce que vous me rapportez
de la conversation d'Oppius, quelles sont leurs vues à tous; tâchez de
les en foire changer, je vous en conjure. Je n'entrevois que des
malheurs. Déjà, hélas! rien de plus abominable, je le répète, que la
position où je me trouve. Voilà pourquoi je voudrais que vous pussiez
vous en entendre avec Antoine et les autres. Faites pour le mieux et
écrivez-moi le plus tôt possible. Adieu. Le 12 des kalendes de juillet.
421. — A TÉRENTIA. Brindes, 20 juin.
F. XIV, 15. J'étais décidé, comme je
vous l'avais écrit, à envoyer Cicéron au devant de César; mais j'ai
changé d'avis, ne sachant quand il doit arriver. Rien de nouveau, du
reste; mais Sicca vous dira mes intentions, et ce que je crois
nécessaire dans les circonstances. Je garde encore Tullie auprès de moi.
Ayez soin de votre santé. Adieu. Le 12 des kalendes de juillet.
422 — A ATTICUS. Brindes, 5 juillet.
A. XI, 25. Je vois bien, hélas ! à
quoi se résume votre longue lettre, et je ne vais pas à rencontre : vous
n'avez plus de conseils, vous n'avez plus de consolations à me donner.
Oui, ma douleur est au-dessus de toute consolation. Le sort n'est pour
rien dans mon malheur. Cette idée me le rendrait supportable : tout
vient de mon aveuglement. J'étais malade de corps et d'esprit, et il a
fallu qu'aucun de mes proches ne voulût venir à mon aide ! Ainsi, plus
de conseils, plus de consolation à espérer de vous? Eh bien I je ne vous
en demanderai plus. Seulement, je vous en prie, ne cessez de m'écrire,
de m'écrire tout ce qui vous passera par la tête, chaque fois que vous
trouverez à qui confier une lettre. Vous n'aurez pas longtemps à m'en
adresser. César ne serait plus à Alexandrie, d'après une lettre de
Sulpicius. C'est un bruit assez vague, que confirment cependant toutes
les nouvelles postérieures. Vrai ou
395
faux, il ne m'importe guère, et je ne sais trop ce qu"il me faut en
souhaiter. — Quant au testament, je vous le répète, puissent-elles le
mettre en mains sûres ! Pensez-y, je vous prie. Et ma fille, pauvre
malheureuse, avec cet amour insensé! voila ce qui me ronge le coeur.
Jamais femme n'eut de semblables destins. Si vous connaissez un moyen de
les changer, de grâce indiquez-le-moi. Ici, je le crains, le conseil
n'est pas plus aisé que pour le reste. Mais le reste n'est rien en
comparaison. Payer le second terme de la dot! j'étais fou, j'étais
aveugle que n'est-ce à recommencer? Mais le mal est fait. Tenez, je vous
en conjure comme un homme qui se noie, cherchez, rassemblez chez moi
tout ce qui peut être de défaite, meubles ou vaisselle; et le peu qu'on
en tirera, mettez-le en sûreté. Nous touchons a la catastrophe. La paix
est impossible, et l'état de choses actuel va s'anéantir, fut-ce de
lui-même. Parlez à Térentia, si vous en trouvez le moment. Je ne puis
tout écrire. Adieu. Le 3 des nones de juillet.
423. — A ATTICUS. Brindes, juillet.
A. XI, 23. Camille m'écrit que vous
avez eu ensemble l'entretien que je désirais : j'attends votre réponse;
mais pour un changement quelconque, fût-il indispensable, je le regarde
comme impossible. Toutefois, puisqu'il m'écrit, je regrette que vous
n'en ayez pas fait autant. L'avis ne vous est-il pas venu? seriez-vous
malade? vous vous plaigniez de quelque indisposition dans votre dernière
lettre. Il est arrivé ici de Rhodes, le 12 des ides de juillet, un
certain Acusius qui m'a appris que Quintus était parti le 4 des kalendes,
pour se rendre auprès de César. Philotime était arrivé la veille à
Rhodes. Il avait des lettres pour moi. Vous entendrez Acusius lui-même :
mais il chemine à très-petites journées. Aussi vais-je charger de ce mot
un marcheur plus expéditif. Qu'y a-t-il dans ces lettres de Philotime?
je l'ignore. Mais Quintus me félicite beaucoup. Pour moi, j'ai fait tant
de fautes, que je n'imagine même rien de passable. — Songez à cette
infortunée, je vous en conjure. Il faut, ainsi que je vous l'ai mandé,
réaliser quelque chose, et la mettre à l'abri du besoin. Pensez aussi au
testament. Ah ! que ne me suis-je décidé plus tôt ! mais j'ai eu peur de
tout. En présence de faits aussi détestables, le divorce est ce qu'il y
a de mieux. Du moins, ce serait un signe de vie. Cette proposition
d'abolir les dettes, ces violations de domicile, cette intrigue avec
Métella, ces scandales de toute sorte, en voilà plus qu'il ne fallait.
La fortune alors n'aurait pas été engloutie, et j'aurais montre un cœur
et des sentiments d'homme. Je me souviens de vos conseils ; mais ce
moment si critique.... Hélas! à quoi tous ces ménagements ont-ils servi?
c'est lui (Dolabella) maintenant qui semble nous menacer du divorce. Où
en sommes-nous, grands dieux, si tout ce qu'on dit est vrai? Quoi ! sans
parler de ce qui me touche, c'est mon gendre qui propose une banqueroute
! Oui, il faut le divorce, je le veux, comme vous le voulez vous-même.
Il demandera peut-être le troisième quart de la dot. Dois-je voir venir?
vaut-il mieux que je prenne l'avance? que me conseillez-vous? Dussé-je
passer des nuits, s'il n'y a pas d'autres moyens, il faut que je vous
voie. Ecrivez-moi là-dessus et sur tout ce qui peut m'intéresser.
396
424. — A TÉRENTIA. Brindes, 9 juillet.
F. XIV, 10. J’ai écrit mes
intentions à Pomponius, mais un peu plus tard qu'il ne fallait. Lorsque
vous le. verrez, vous saurez ce qu'il l'aut faire. Il n'est pas
ncessaire que je vous en écrive plus ouvertement, puisque je me suis
expliqué avec lui. Donnez-moi le plus tôt possible des nouvelles de cela
et du reste. Prenez grand soin de votre santé. Adieu. Le 7 des ides de
juillet.
425. — A TERENTIUS. Brindes, 10 juillet.
F. XIV, 13. Si je vous ai priée,
dans ma dernière lettre, de me renvoyer le courrier, c'est que
j'ignorais les violences de cet homme et l'agitation de la multitude. Si
ses fureurs vous donnent lieu de craindre, ne m'écrivez pas. Peut-être
nous fera-t-il lui-même beau jeu. Jugez l'ensemble des choses. Nous
sommes dans un détestable temps. Prenez le moins détestable parti.
Adieu. Le 6 des ides de juillet.
426. — A ATTICUS. Brindes, 22 juillet.
A. XI, 19. Je n'ai pas manqué de
vous écrire toutes les fois que j'ai trouvé une voie sûre, même quand je
n'avais rien à vous apprendre. C'est vous dont les lettres sont devenues
plus rares et plus courtes, sans doute parce que vous pensez n'avoir
rien de bon à me dire. Cependant écrivez-moi toujours, si peu qu'il y
ait et quoi que ce soit. La seule bonne nouvelle pour moi serait qu'on
s'occupât de la paix. Je n'y crois pas le moins du monde, mais il suffit
que vous en jetiez un mot dans une lettre pour changer en espoir un
désir que j’ose à peine former. — On attend Philotime pour les ides
d'août. Voilà tout ce que je sais. Répondez-moi, je vous prie, sur ce
que je vous ai précédemment écrit. Je n'ai que le temps juste de prendre
telles précautions que permettent les circonstances, moi qui n'ai jamais
songé à en prendre aucune. Adieu. Le 1 des kalendes d'août.
427. — A ATTICUS. Brindes, 6 août.
A. XI, 24. Je reconnais la vérité de
ce que vous m'avez écrit à moi-même et mandé antérieurement par deux
fois à ma fille, sur mon propre compte. Quoique la mesure fût au comble,
je n'en suis que plus malheureux encore de recevoir un tel affront sans
laisser éclater mon ressentiment, ni même me permettre impunément la
plainte. Je me résigne : mais avec ma résignation, il n'en faudra pas
moins ensuite en venir à ce que vous me recommandez d'éviter. Je me suis
si bien enferré, qu'en tout état de cause, et quoi qu'il arrive de la
république, le résultat sera pour moi le même. — Je continue de ma main
; ce que j'ai maintenant à vous dire veut plus de mystère. Voyez un peu,
je vous prie, ce qui en est pour le testament qui était fait lorsqu'elle
(Térentia) a commencé à ne voir qu'elle et ses intérêts. Vous n'avez pas
été ému de ses réflexions, je pense, puisqu'elle ne vous avait pas
consulté, ni moi non plus. Cela étant, et puisque vous avez déjà abordé
la question avec elle, vous pourrez facilement, ce me semble, lui
insinuer de se confier à un tiers dont la fortune n'ait rien à craindre
de la guerre actuelle, à vous par exemple; ce qui serait le mieux, si ma
fille le voulait. La pauvre enfant! je lui cache mes
397
craintes sur ce sujet. Quant à l'autre affaire, je sais que rien ne se
vend aujourd'hui; mais il y a des valeurs qu'on peut mettre à part et
cacher, pour les sauver du naufrage dont nous sommes menacés. — Ma
fortune et la vôtre suffisent, dites-vous, pour moi et Tullie. La vôtre,
oui; mais la mienne, qui peut dire ce qu'elle sera? Quant a Térentia,
voici, entre mille, un de ses traits, auquel on ne peut rien ajouter.
Vous lui aviez écrit de m'envoyer douze mille sesterces, qui formaient
le reste de l'argent comptant. Elle ne m'en a envoyé que dix mille, qui
sont, dit-elle, tout ce qui reste. Si elle grappille ainsi sur une telle
misère, jugez ce qu'elle a pu détourner sur de grosses sommes. — Point
de Philotime. Il ne m'a rien écrit, rien fait dire. Les gens qui
viennent d'Éphèse prétendent l'y avoir vu occupé de procès; il est
vraisemblable que rien ne se réglera avant l'arrivée de César. J'en
conclus, ou que Philotime ne croit avoir aucun motif de se presser,
c'est-à-dire, qu'on n'aura eu que des mépris pour moi ; ou que s'il a
quelque chose d'intéressant à me dire, il ne se mettra en peine de venir
me l'annoncer que quand toutes ses affaires seront finies. Cela me
chagrine beaucoup, moins pourtant qu'on ne l'imaginerait; car en quoi
m'importent les nouvelles de là-bas? (de César, à Alexandrie) Vous savez
pourquoi je parle ainsi. — Il faut, dites-vous, accommoder mon visage et
mon langage aux nécessités du temps. C'est assez difficile. Pourtant je
saurais me contraindre, si j'y voyais un avantage. Vous pensez que les
négociations d'Afrique peuvent se suivre par correspondance. Je regrette
que vous ne me donniez pas les motifs qui vous le font croire. Je
cherche en vain ce qui peut vous le persuader. Ne manquez pas de
m'écrire pour peu que vous entrevoyiez quelque chose sur l'horizon ; et
quand même il n'y aurait rien, écrivez-moi toujours. De mon côté, si
j'apprends quelque nouvelle avant vous, je vous en ferai part. Adieu. Le
8 des ides d'août.
428. — A TÉRENTIA. Brindes, 11 août.
F. XIV, 24. Point de nouvelles
encore, ni de l'arrivée de César, ni des lettres dont on dit que
Philotime est chargé. Aussitôt qu'il y aura quelque chose, je vous en
ferai part. Ayez bien soin de votre santé. Adieu. Le 3 des ides d'août.
429. — A TÉRENTIA. Brindes, 12 août.
F. XIV, 23 . Enfin j'ai reçu une
lettre de César. Elle est bien. Il parait qu'il arrivera plus tôt qu'on
ne pensait. Irai-je à sa rencontre? ou l'attendrai-je ici? Quand ma
résolution sera prise, vous le saurez. Renvoyez-moi mes courriers
sur-le-champ, je vous prie. Je vous recommande votre santé. Adieu. La
veille des ides d'août.
430. — A C CASSIUS. Brindes, août.
F. XV, 15. Une commune tendance à la
paix, une égale horreur de l'effusion du sang romain, nous ont amenés
tous deux à en finir avec cette guerre. Mais j'ai donné l'exemple; et
par la, je me trouve engagé à votre égard plus que vous ne l'êtes au
mien. A dire vrai, vos raisons dans nos entretiens familiers n'ont pas
moins contribué que les miennes au parti que nous prîmes entre nous de
considérer la question comme décidée en fait, sinon en droit, par le
sort d'une seule bataille. Or, ceux-là seuls peuvent consciencieuse-
398
ment nous en blâmer, qui aiment mieux voir l’anéantissement de la
république que son affaiblissement et sa décadence. Je trouve qu'il n'y
a rien à espérer, une fois sa destruction accomplie; et j'attends
beaucoup, je le confesse, du peu de vie qui lui restera. Mais nous avons
vu depuis de si étranges choses, que s'il faut nous étonner, c'est d'en
avoir été témoins, et non de ne les avoir pas prévues ; n'ayant pas,
faibles mortels que nous sommes, le don de la divination. J'avais cru,
je l'avoue, qu'après un combat en quelque sorte fatal, les vainqueurs ne
penseraient qu'au salut commun, et les vaincus qu'à leur propre salut.
Mais je calculais que tout dépendrait de la diligence du vainqueur. S'il
n'avait sur ce point trompé mon attente, l'Afrique aurait été traitée
aussi doucement que l'Asie et même que l'Achaïe. Vous-même, j'en suis
convaincu, vous auriez été le premier à intervenir et à le demander. Le
moment qui a tant de prix, surtout dans les guerres civiles, a été
perdu, et l'intervalle d'une année a suffi pour rendre aux uns
l'espérance de la victoire, et pour habituer les autres à l'idée d'une
défaite. Il faut s'en prendre à la fortune de tous les mécomptes. Qui
pouvait prévoir en effet que les scènes d'Alexandrie arrêteraient si
longtemps la marche du drame principal ? qu'un je ne sais quel Pharnace
deviendrait l'épouvantail de l'Asie entière? Partis du même point, nous
avons tenu l'un et l'autre une route bien différente. Vous vous êtes
arrangé, vous, pour être de tous les conseils, et pour avoir ainsi une
vue sûre de l'avenir, ce qui vous a ôté du moins le tourment de
l'incertitude. Moi qui me suis tant pressé de gagner l'Italie, dans le
but de voir César, et qui ne me hâtais que pour l'exciter a la paix,
vers laquelle il courait en quelque sorte de lui-même, en sauvant tant
d'honnêtes gens ; j'ai cherché et je cherche encore vainement il me
rapprocher de lui. J'entends d'ici les gémissements de l'Italie et les
déchirantes lamentations de Rome. Peut-être aurions-nous été de quelque
secours à tant de malheureux, moi dans ma position, vous dans la vôtre,
chacun selon son pouvoir, si l'auteur du mal avait été présent. Je
demande une grâce à voire amitié, si fidèle et si constante : c'est de
me faire part de ce que vous voyez, de ce que vous pensez, et de me dire
ce qu'il faut, selon vous, espérer et faire. Vos lettres m importent au
dernier point. Hélas ! que n'ai-je suivi vos premiers conseils de
Lucérie! je serais demeuré intact, et pur de toute atteinte. Portez-vous
bien.
431. — A ATTICUS. Brindes, 17 août.
A. XI, 20. C. Trébonius est arrivé
ici le 17 des kalendes de septembre, venant de Séleucie-Piérie après
vingt-huit jours de marche. Il a vu le fils de Quintus chez César avec
Hirtius, à Antioche; ils ont tout obtenu sans difficulté pour Quintus.
Je m'en réjouirais davantage, si je pouvais espérer que ce qu'on a fait
pour lui servit de règle pour moi : il y a, au surplus, bien d'autres
craintes à avoir, et de bien d'autres côtés. Puis, ce qu'on accorde
comme maître, on peut toujours le reprendre. Il a fait grâce aussi à
Salluste. On dit positivement qu'il ne refuse rien à personne, et c'est
là ce qui me fait regarder tout comme sujet à révision. M. Gallius, fils
de Quintus, a rendu à Salluste ses esclaves. Gallius arrive pour faire
399
passer les légions en Sicile, où César doit incontinent se rendre de
Fatras. S'il en est ainsi, je suivrai ma première pensée, je me
rapprocherai. J'attends avec la plus vive impatience votre réponse à la
lettre par laquelle je vous demande vos conseils. Adieu. Le 16 des
kalendes de septembre.
432. — A ATTICUS. Brindes, août.
A. XI, 21. C'est le 6 des kalendes
que j'ai reçu votre missive datée du 12. J'avais depuis quelque temps
pris mon parti sur les indignités de Quintus. Ma plaie a saigné de
nouveau à la lecture de sa lettre. Vous ne pouviez absolument vous
dispenser de me la transmettre; mais j'aurais mieux aimé ne pas l'avoir
reçue. A l'égard du testament dont vous me parlez, décidez vous-même du
fond et de la forme. Quant à l'argent comptant, je vous ai déjà mandé
qu'elle m'en avait écrit. Si mes besoins l'exigent, j'en prendrai où
vous me dites. César ne sera vraisemblablement pas à Athènes pour les
kalendes de septembre. Il aura, dit-on, beaucoup à faire en Asie, avec
Pharnace notamment. On assure que la douzième légion à laquelle Sylla
s'est adressé d'abord, l'a reçu à coups de pierre ; et l'on doute fort
qu’il y en ait une seule qui veuille marcher. On croit que César ira
droit de Patras en Sicile : si cela est, il faudra qu'il vienne ici. Je
m'en passerais bien. J'aurais pu m'échapper, et je vais être obligé de
l'attendre (je le crains du moins), et de laisser par conséquent encore
cette pauvre petite sous un ciel dont la pesanteur ajoute a ses maux.
Vous m'engagez à m'accommoder au temps. Je le ferais, s'il y avait jour
et moyen; mais après tant de fautes de ma part, après tant d'affronts de
la part des miens, il ne m'est plus possible de prendre une attitude
digne, ou même de sauver les apparences. Vous parlez de Sylla; mais il
n'y aurait qu'à admirer dans sa conduite, s'il y eut mis un peu plus de
modération. Aujourd'hui, je dois m'oublier et n'avoir en vue que
l'intérêt de tous, qui est devenu le mien. Ecrivez-moi souvent, car il
n'y a que vous qui m'écriviez. Et quand j'aurais des lettres de tout le
monde, je m'attacherais surtout aux vôtres. Lui, dites-vous, plus
favorable à Quintus par considération pour moi ! Je vous ai déjà dit que
son fils avait tout obtenu au premier mot, et que mon nom n'avait pas
même été prononcé. Adieu.
433. — A ATTICUS. Brindes, septembre.
A. XI, 22. Le messager de Balbus m'a
remis très-exactement ses dépêches. D'après un mot de vous, l'inquiétude
vous aurait pris au sujet de la lettre dont il était chargé. Pourquoi
faut-il que je l'aie reçue? elle n'a fait qu'accroître mes douleurs; et
quand les dépêches seraient tombées en des mains étrangères, à qui
eussent-elles appris quelque chose? Quoi de plus connu que sa haine pour
moi et le style de ses lettres? César a communiqué celle-ci, non parce
que le procédé le révolte, mais parce qu'il n'est pas fâché de mettre
mes plaies au grand jour. Car quand vous venez me dire que Quintus peut
s'être fait tort, et qu'il faut aller au devant, vous oublier qu'on n'a
pas même voulu se faire prier pour lui ; ce dont je ne me fâche pas
assurément, mais je suis fâché de voir que mon intervention n'y ait été
pour rien. — Sylla sera, je pense, ici
400
demain avec Messalla. Chassés par les légions, ils retournent en courant
auprès de leur maître pour lui dire que les soldats veulent être payés
avant de marcher. Ainsi, il sera obligé de venir, contre l'opinion
générale. Seulement ce ne sera point de si tôt. Il s'arrête dans chaque
ville des jours entiers. Pharnace aussi va le retarder, quoi qu'il
fasse. Que me conseillez-vous? Ma santé résiste à peine aux influences
d'un ciel malsain. C'est un nouveau mal à joindre à tant de maux. Ne
pourrais-je me faire excuser de l'attendre par quelqu'un de ceux qui
vont le rejoindre, et me rapprocher un peu de Rome ? Réfléchissez bien
sur tout cela, je vous prie, et une fois au moins, après tant de prières
inutiles, donnez-moi un conseil. Ce n'est pas chose facile, je le sais ;
mais de deux maux on peut choisir le moindre. Votre présence surtout me
serait utile : ce serait un grand point de gagné. Oui, ayez l'oeil à ce
testament.
434. — A TÉRENTIA. Brindes, 1 septembre.
F. XIV, 22. J'attends de jour en
jour nos messagers. S'ils arrivaient, peut-être saurais-je le parti que
je dois prendre; je vous en ferais part à l'instant. Je vous recommande
votre santé. Adieu. Aux kalendes de septembre.
435. — A TÉRENTIA. Vénusium, 1 octobre.
F. XIV, 20. Je serai je pense, à
Tusculum le jour des nones ou le lendemain. Veillez à ce que tout soit
prêt pour me recevoir. Peut-être amènerai-je avec moi des amis, et
vraisemblablement nous y ferons quelque séjour. S'il n'y a pas de cuve
dans le bain, qu'on en mette une. Enfin qu'il ne manque rien de ce qui
est nécessaire pour bien vivre et se bien porter. Adieu. Aux kalendes
d'octobre. De Vénusium.
436. — A TRÉBONIUS. Rome, décembre.
F. XV, 21. Votre lettre m'a charmé,
votre livre plus encore; toutefois, je n'ai pas joui de mon bonheur sans
mélange : au moment ou vous me donnez si fort le désir de vous voir
souvent, (vous aimer davantage est impossible) voilà que vous partez,
que vous me donnez un chagrin mortel, et qu'il ne nous reste à l'un et à
l'autre que la ressource de nous écrire souvent et longuement, pour
adoucir les regrets de l'absence. C'est de quoi je puis répondre et pour
moi et pour vous ; car vous ne me laissez en partant aucun doute
possible sur votre affection. Et je n'entends point faire ici allusion
aux témoignages publics que vous m'avez donnés à la face de Rome, en
embrassant toutes mes querelles, en vous constituant mon défenseur a la
tribune, en prenant comme questeur parti pour les consuls dans la cause
de la république et dans la mienne, et en refusant en la même qualité au
tribun du peuple une obéissance qu'il trouvait dans votre collègue. Je
n'entends pas parler davantage de faits plus récents dont mon coeur ne
perdra jamais le souvenir, de votre sollicitude durant la guerre que
j'ai dirigée, de votre joie à mon retour, de vos tourments et de votre
affliction à la nouvelle dénies afflictions et de mes tourments, enfin
de cette résolution de me rejoindre à Brindes, qui n'a manqué son effet
que par l'ordre de votre départ soudain pour l'Espagne. Je laisse de
côté tous ces souvenirs, qui me sont toutefois plus pré-
401
cieux que la vie et la sûreté. Je ne veux pour preuve de votre affection
que le livre que je viens de recevoir. Quelle preuve, bons dieux!
D'abord vous trouvez de l'esprit à tout ce que je dis : les dieux savent
si tout le monde pense comme vous ! puis, que j'aie de l'esprit ou que
je n'en aie pas, il est certain que vous m'en prêtez beaucoup, et qu'il
n'y a rien de plus charmant au monde que le tour que vous savez donner
aux choses. Que dis-je? tout le charme est là; et c'est à peine s'il me
reste quelque chose, quand on perce plus loin et qu'on arrive à Cicéron.
— Enfin, quand je ne vous aurais d'autre obligation que de vous être si
longtemps occupé de moi en composant votre ouvrage, il faudrait être de
bronze pour ne pas vous aimer. C'est vraiment avec amour que vous avez
mis ces matériaux en oeuvre, et je suis sûr qu'on ne s'aime pas plus
soi-même que vous ne m'aimez. Que ne puis-je reconnaître tant de bontés!
Je les paye du moins de l'amitié la plus tendre, et je me flatte que
cela seul vous suffit. — J'arrive à votre lettre. Elle est pleine
d'effusion et de grâce. J'y répondrai en peu de mots : d'abord la lettre
que j'ai écrite à Calvus était aussi peu faite que celle-ci pour être
communiquée. Il y a une façon quand on croit n'écrire que pour une
personne; une autre quand une lettre doit être montrée. En second lieu,
j'ai loué, dites-vous, son mérite au delà de toute vérité. Il n'est
vraiment pas sans talent : c'est du moins mon avis. Il s'est fait un
genre, et tout en péchant contre le goût, dont il connaît les règles a
merveille, il a trouvé cependant le moyen déplaire. Il a un grand fonds
de connaissances ; seulement la force lui manque. C'est à donner de la
force à ses écrits que ma lettre le conviait. Or, il faut toujours mêler
un peu d'éloge à un conseil : c'est un stimulant. Voici en deux mots mon
jugement sur Calvus et ma justification. L'éloge faisait passer la
critique, et j'ai réellement bonne opinion de l'auteur. — Je finis en
vous répéta ut que mon amitié vous suivra, que je vis dans l'espérance
de vous revoir, qu'absent vous êtes là dans mon souvenir, et qu'en
attendant le retour ma consolation sera de vous écrire et de recevoir de
vos lettres. N'oubliez jamais, je vous prie, toutes les marques
d'attachement que vous m'avez données et tous les services que vous
m'avez rendus. Si vous y pensez quelquefois, moi je ne pourrais sans
crime en perdre la mémoire; vous en conclurez qu'il faut que je ne sois
pas un malhonnête homme, et vous croirez bien que je vous aime avec
passion. Adieu.
437. — A TITIUS.
F. V, 16. Personne au monde n'est
moins en état que moi de vous offrir des consolations. J'en aurais
besoin moi-même, tant je suis touché de vos peines! Cependant comme la
douleur que j'éprouve ne peut sous aucun rapport se comparer à
l'amertume infinie de la votre, je regarde comme un devoir de l'amitié
de rompre un silence que j'ai trop longtemps gardé. Je chercherai donc à
vous offrir quelques-unes de ces consolations qui soulagent du moins un
moment le coeur, si elles sont impuissantes à en guérir les blessures.
Voici, par exemple, des sentences bien vulgaires, bien rabattues, qu'il
faut avoir sans cesse à la bouche et présentes à la pensée. Nous ne
devons pas oublier que nous sommes hommes ; que la loi de notre
naissance est de vivre en butte à toutes les épreuves ; que nous n'avons
pas le droit de
402
refuser la condition sous laquelle nous naissons et vivons; que nous ne
devons pas surtout nous roidir contre ces coups de la fortune que nulle
prévoyance humaine ne peut conjurer; qu'en se rappelant ce qui est
arrivé à autrui, on se convainc qu'il n'y a rien que d'ordinaire dans ce
qui nous arrive à nous-mêmes. Ces maximes et d'autres du même genre ont
été respectées par les plus grands philosophes, et la tradition en est
dans tous les livres. Mais je les crois moins propres à agir sur vous
que l'état présent de la république, et la longue suite de mauvais jours
auxquels nous sommes condamnés. Qu'ils sont heureux ceux qui n'ont
jamais eu d'enfants! et combien le malheur de perdre les siens serait
plus affreux sous un gouvernement régulier; disons mieux, sous un
gouvernement quelconque ! Est-ce de votre propre chagrin que vous
gémissez, et dans vos afflictions ne considérez-vous que vous-même?
Alors il est moins facile de tarir vos larmes : mais si votre peine a sa
source dans un sentiment tendre, si vous pleurez seulement la destinée
de ceux que vous avez perdus, je ne vous dirai pas ce que j'ai si
souvent lu et si souvent entendu répéter, que la mort n'est point un
mal; que si le sentiment survit, la mort est l'immortalité; et que si le
sentiment périt avec elle, il n'y a point de mal, puisqu'on ne le sent
point. Mais je vous représenterai plutôt, parce que je parle ici avec la
force d'une conviction inébranlable, que les nuages menaçants qui
s'accumulent, que les tempêtes à chaque instant suspendues sur la
république, ne permettent pas de plaindre ceux qui la quittent, comme si
on leur faisait tort des jours qui leur sont dus. Où sont depuis
longtemps, je vous le demande, la pudeur, la probité, la vertu, les
droites pensées, les ambitions légitimes? Ou est la liberté? Ou est même
la garantie de l'existence? Oui, j'en jure par Hercule, je n'ai pas vu
mourir un seul jeune homme, un seul enfant dans cette année de désastres
et de malédiction, que je ne me sois dit : Encore un à qui la bonté des
dieux immortels épargne un avenir de misère, et l'amertume d'une
existence intolérable. Si vous parveniez à ôter de votre esprit l'idée
que ceux qui vous étaient chers sont malheureux, vous vous sentiriez à
l'instant soulagé d'un grand poids. Votre douleur, réduite à un simple
sentiment personnel, cesserait de se prendre à ceux qui ne sont plus, et
se concentrerait sur vous seul. Dans ce cas, serait-il conforme à
l'esprit de réflexion et de sagesse que vous montriez dès vos plus
jeunes années, de ne pas garder de mesure dans une disgrâce toute
personnelle, dans une disgrâce dégagée de toute idée de malheur et de
souffrance pour ceux que vous aimiez? Songez à ce que vous avez été
jusqu'ici comme homme privé et comme homme public. Vous ne devez ni
démentir votre caractère, qui est grave, ni devenir infidèle à votre
propre courage. S'il n'est point de douleur que le temps ne tarisse à la
longue, ne vaut-il pas mieux s'adresser à la réflexion et à la
philosophie? La femme, même la plus faible, qui a perdu ses enfants,
suspend quelquefois ses larmes; et, nous, nous ne saurions pas avancer
par la réflexion le bénéfice du temps! et nous, nous attendrions de la
succession des années le remède que nous pouvons demander à la raison !
Si ces observations ne sont pas sur vous sans quelque influence, j'aurai
atteint mon but,
403
et je le souhaite ardemment : si elles sont impuissantes, j'aurai rempli
le devoir de l'amitié; car vous avez en moi un ami, un ami tendre, et
qui le sera toujours.
438. — A CORNIFICIUS.
F. XII, 20. Votre lettre m'enchante, si ce n'est que vous avez dédaigné
mon pied à terre de Sinuesse, affront que cette pauvre petite villa ne
vous pardonnera jamais, à moins que Cumes et Pompéi ne reçoivent de vous
complète réparation, et j'y compte. Si vous m'aimez, vous serez le
premier à m'écrire. Je suis plus à l'aise quand je n'ai qu'à répondre.
Cependant, si la paresse vous tient comme a votre ordinaire, je romprai
la glace, et ne souffrirai pas que la contagion me gagne. Je causerai
plus longtemps quand je serai plus libre, car c'est a grand'peine et en
plein sénat que je vous broche ces deux mots.
AN DE R. 708 - AV . J.-C. 45. – AGE DE C. 61.
J. C. Caesar, pour la seconde fois et M. E. Léplde, consuls.
439. — A VARRON. Rome, janvier.
F. IX,1. Atticus m'a lu la lettre
que vous lui avez adressée. Elle dit bien comment vous vous portez et où
vous êtes; mais quand pouvons-nous espérer de vous revoir? c'est ce
qu'elle ne laisse pas même soupçonner. Je commence pourtant à espérer en
votre prochain retour. Puissé-je y trouver quelque consolation ! Les
choses vont si mal et de tant de cotés à la fois, qu'à moins d'être
insensé, on ne peut se flatter d'aucun remède; mais enfin vous pouvez me
prêter quelque secours, peut-être en recevoir de moi. Sachez qu'a mou
arrivée a la ville, je me suis réconcilié avec mes vieux amis, je veux
dire mes livres. Notre commerce avait cesse; non que j'eusse à m'en
plaindre, mais je ne pouvais les voir sans rougir. Je croyais avoir trop
méconnu leurs préceptes, lorsque je m'engageai, avec des compagnons sans
foi, dans d'épouvantables conflits. Ils me pardonnent et me rendent mes
droits d'ami, tout en vous proclamant plus sage que moi, de ne les avoir
jamais quittes. A présent que ma paix est faite, je crois que vous ayant
là, je supporterai mieux les maux qui nous pressent et ceux qui nous
menacent. Ainsi, à Tusculum ou à Cumes, si vous l'aimez mieux, ou à
Rome, ce qui me plairait beaucoup moins, réunissons-nous; c'est le
principal. Je me charge de faire en sorte que nous y trouvions notre
compte tous deux.
440 — A DOMITIUS. Rome.
F. VI, 22. Si je ne vous ai pas
écrit depuis votre retour en Italie, ce n'est point parce que vous ne
m'écrivez pas vous-même. Mais quel secours porter à autrui, quand on est
dans le dénûment? Quel conseil donner, quand on ne sait quel parti
prendre ? Quelle consolation offrir, quand on ne voit que des maux
autour de soi? Voila ou j'en suis toujours. Les choses vont même de mal
en pis. Cependant j'aime mieux vous adresser quelques mots vides de sens
que de ne pas vous écrire du tout. — Si je vous supposais le dessein de
tenter pour la république d'inutiles efforts, je vous dirais de préférer
plutôt la position qu'on nous laisse, et que la nécessité nous a faite.
Mais votre raison s'est résignée à l'arrêt de la fortune, en déposant
spontanément les armes le jour où a fini la lutte des deux partis. Je
puis donc librement m'autoriser de nos longs rapports
404
et des droits d'une vieille amitié; je puis sans scrupule vous conjurer,
par tout ce que nous nous portons d'intérêt l'un à l'autre, de vous
conserver pour moi, pour votre mère, pour votre femme, enfin pour tout
ce qui vous aime. Oui, songez maintenant à vous, à ceux dont l’existence
est attachée à la vôtre; faites aux circonstances l'application de vos
doctrines et des principes que vous avez étudiés dès l'enfance, et reçus
de la tradition des sages, des principes que votre raison comprenait si
bien; supportez, en un mot, avec modération {je ne vous dirai point avec
un farouche courage) la perte de tant d'hommes illustres, vos amis et
vos soutiens. J'ignore si je puis quelque chose, ou plutôt je sais que
je puis bien peu ; je vous promets néanmoins que dans tout ce qui pourra
toucher votre position et votre dignité, j'agirai pour vous avec la même
ardeur que je vous ai toujours vue pour moi; je m'en suis expliqué avec
votre mère, cette femme supérieure qui vous aime tant. Si vous m'écrivez
vos intentions, je m'efforcerai de les remplir. Si vous gardez le
silence, je n'en ferai pas moins avec zèle et dévouement tout ce que je
croirai pouvoir vous être utile. Adieu.
441. - A CN. PLANCUS. Rome.
F. IV, 15. J'ai reçu votre courte
lettre, où je n'ai pas trouvé ce que j'avais besoin de savoir, et où
vous m'apprenez ce que je sais parfaitement. J'ai vainement cherché à y
voir comment vous supportiez nos communes misères. Elle me prouve
seulement que vous m'aimez, ce dont je ne doutais pas. Si vous m'aviez
écrit d'une manière plus explicite, je vous répondrais en conséquence.
Quoique je vous aie déjà tout dit, je vous répéterai en peu de mots
qu'aucun danger particulier ne vous menace. Le péril est grand, mais le
péril est pour tous; et vous ne prétendez pas sans doute ni que la
fortune fasse une exception pour vous, ni qu'elle vous sépare du sort
commun. Soyons l'un pour l'autre ce que nous avons toujours été. Je
compte sur vous et je vous réponds de moi. Adieu.
442. — A L PLANCUS. Rome.
F. XIII, 29. De tous les amis que
vous a laissés votre père, vous n'en avez pas, je pense, qui vous tienne
de plus près que moi, non-seulement par ces rapports d'apparat qu'on
prend pour des liens d'affection, mais encore par les habitudes plus
fortes dune longue amitié. Entre votre père et moi, ces habitudes, vous
ne l'ignorez point, furent toujours les plus charmantes et les plus
intimes du monde. De là vint mon attachement pour vous; mes liens avec
votre père s'en resserrèrent, surtout quand je vous vis, dans l’âge où
l'on commence à comprendre la mesure de ce qui est dû à chacun, me
témoigner, de préférence à tout autre, des égards, du respect et de
l'affection. Il s'y joignait un autre lien, qui n'a pas peu de force,
outre la solidité qui lui est propre : c'est celui d'études communes, de
ces études surtout et de ces travaux de l'esprit qui unissent bien vite
par l'amitié ceux qui s'y livrent avec le même goût. Où donc en
voulez-vous venir, me
405
direz-vous, en allant remonter si loin? Non, ce n'est pas sans motif ni
sans intérêt que je rappelle tous ces souvenirs. — Je suis lié
intimement avec C. Atéius Capiton. Les phases diverses de ma vie si
mêlée vous sont connues. Dans mes jours brillants comme dans mes
disgrâces, C. Capiton était là avec son dévouement, son activité, son
crédit, sa popularité, sa bourse même. Proscrit ou honoré, je l'ai
toujours trouvé fidèle. Il est parent de T. Antistius, a qui la questure
en Macédoine était échue par le sort, et qui se trouvait encore en
exercice, faute de successeur, lorsque Pompée entra avec son armée dans
la province. T. Antistius n’était pas libre; s'il l'eût été, il n'aurait
rien eu de plus à coeur que de rejoindre Capiton, qu'il aimait comme un
père, surtout connaissant l'estime qu'il professait et avait toujours
professée pour César. Dans sa position forcée, il n'a pris à ce qui
s'est fait que la part qu'il n'a pu se dispenser d'y prendre. Lorsqu'on
frappa monnaie à Apollonie, presida-t-il à l'opération? c'est ce que je
ne saurais dire. Je ne puis nier qu'il n'ait été là; mais deux ou trois
mois, pas davantage. Depuis il n'a plus paru au camp, et ne s'est mêlé
de rien. Vous pouvez me croire; j'étais témoin. Il voyait le chagrin que
cette guerre me causait, et ne me cachait rien. Il alla se réfugier au
fond de la Macédoine, aussi loin que possible des armées, afin de
n'avoir dans tout cela ni initiative à prendre, ni action quelconque à
exercer. Après la bataille, il se retira près d'un ami intime, A.
Plautius, en Bithynie. César l'y rencontra, et ne lui fit entendre
aucune parole amère et dure. Il lui prescrivit seulement de se rendre à
Rome. Mais Antistius tomba malade, d'une maladie dont il ne s'est point
relevé, se lit transporter souffrant à Corcyre, et c'est la qu'il est
mort. D'après son testament fait à Rome, sous le consulat de Paullus et
de Marcellus, Capiton est son héritier pour moitié et un tiers. On
confisquerait le sixième restant, que pas un de ceux qui y ont droit ne
se plaindrait. C'est une affaire de trois cent mille sesterces. Mais
ceci regarde César. — Ce que je vous demande, moi, mon cher Plancus, au
nom de votre père et de notre propre amitié, en invoquant la conformité
de nos goûts, les rapports constants de nos positions et de notre vie
tout entière, ce que je vous demande avec plus d'instance, avec plus de
sollicitude que je ne puis le dire, c'est de vous charger des intérêts
de Capiton, de les considérer comme les miens, et de ne rien négliger
pour arriver à ce que, sur ma recommandation, par votre entremise et
grâce à la bonté de César, C. Capiton recueille le legs de son parent.
Dans le haut degré de faveur et de puissance où vous êtes, tout ce que
je pouvais prétendre de vous, vous l'aurez fait en une fois, si
j'obtiens de vous ce service. — II y a une circonstance qui vous
servira, j'espère, et que César peut apprécier mieux que personne :
c'est que Capiton l'a toujours vénéré et chéri. Lui-même eu rendra
témoignage. Je connais la fidélité de sa mémoire. Je n'insiste donc pas.
Mais vous, insistez pour Capiton, selon que vous verrez César conserver
pour lui des sentiments plus ou moins vifs. — Je vais aussi vous parler
de moi : vous jugerez si je puis peser dans la balance. Vous n'ignorez
point à quel parti et à quelle cause je suis attaché, quels sont les
hommes et les ordres qui ont aidé a mon élévation et qui m'ont toujours
appuyé : si dans cette
406
guerre il y a eu de ma part quelques actes qui ne furent pas entièrement
en harmonie avec les vues de César, croyez-moi, il faut s'en prendre a
des conseils étrangers, il un entraînement auquel j'ai cédé, et César,
je le sais, ne s'y méprend pas; mais, dans les rangs où j'étais, j'ai
montré peut-être plus de mesure et de modération que personne. Eh bien !
c'est surtout à l’influence de Capiton que je le dois. Si tous mes amis
lui avaient ressemblé, la république aurait pu y gagner quelque chose.
Moi, du moins je m'en serais mieux trouvé. — Obtenez ce que je vous
demande, mon cher Plancus, et montrez ainsi que vos sentiments pour moi
sont toujours les mêmes. Vous vous attacherez intimement par ce service
l'un des hommes les plus reconnaissants, les plus serviables et les
meilleurs que je connaisse, C. Atéius Capiton.
443. A ALLIÈNUS, proconsul. Rome.
F. XIII, 78. Démocrite de Sicyone
n'est pas seulement mon hôte, il est de plus mon ami, et c'est un titre
dont je suis peu prodigue, surtout pour les Grecs ; mais aussi c'est un
homme d'une haute probité, d'une rare vertu, rempli d'attentions et
d'égards pour ses hôtes; et de tous je suis celui qu'il respecte, qu'il
honore et qu’il aime le plus. Je vous le donne pour ce qu'il y a de
mieux dans sa ville, et je dirai presque dans toute l'Achaïe. Je ne veux
que lui ouvrir l'accès. Je vous connais : une fois que vous aurez causé
avec lui, votre coeur sera ému, et vous l'attirerez chez vous. Ayez donc
confiance en ma parole, et soyez en aide a mon protégé. Si, comme je
n'en fais aucun doute, vous le trouvez digne d'une place dans votre
coeur et a votre foyer, je vous demande de le choyer, de le chérir, et
de l'aimer comme un des vôtres. Je vous en saurai un gré infini. Adieu.
444. — A ALIENUS, PROCONSUL. Rome.
F. XIII, 79. Vous connaissez, je
crois, mes sentiments pour C. Avianus Flaccus, et je sais vos bons
procédés pour lui. Cet excellent homme me les a dits dans l'effusion de
son coeur. Les fils d'Avianus sont dignes de leur père. Je les connais,
je les aime, et je viens vous les recommander avec le plus vif intérêt.
C. Avianus est en Sicile, Marcus avec moi. Honorez, je vous prie, de
tous vos égards celui qui est près de vous, et prenez à cœur les
intérêts des deux frères. Vous ne pouvez rien faire dans votre province
dont je vous sache plus de gré. Je vous le demande avec instances.
Adieu.
445. — A BRUTUS. Rome.
F. XIII, 10. En voyant votre
questeur M. Varron partir pour vous rejoindre, je ne pensais pas qu'il
eût besoin de recommandation. Il me semblait suffisamment recommandé
près de vous par la tradition de nos ancêtres, qui a voulu que le lien
de la questure fût le plus fort de tous les liens après ceux qui
attachent les enfants à leurs pères; mais il s'est imaginé qu'une lettre
de moi écrite d'une certaine façon ferait grande impression sur vous, et
il m'a demandé avec instance de me piquer d'honneur. Il a bien fallu
céder, puisqu'un ami y attachait tant de prix. Jugez vous-même si j'ai
quelque chose à lui refuser : à peine entré au forum, M. Térentius
Varron a recherché mon amitié. Bientôt, il est devenu
407
homme, et j'eus deux raisons de plus pour l'aimer : d'abord son goût
pour les études, qui font encore aujourd'hui le plus grand charme de ma
vie, et où il a fait preuve, comme vous le savez, de grandes
dispositions et de quelque savoir-faire; puis les intérêts qu'il prit de
bonne heure dans les fermes publiques, et que j'aimerais bien mieux
qu'il n'eût pas, car il y a fait de grandes pertes ; mais enfin cette
communauté d'intérêt avec un ordre pour qui j'ai toujours fait
profession de tant d'égards, contribua puissamment à resserrer nos
liens. Plus tard, ayant donné sur l'un et l'autre siège une haute idée
de son caractère et de son mérite, il entra dans les candidatures, et ne
se proposa jamais que l'honneur, comme le plus digne fruit de ses
travaux. A Brindes, dans ces derniers temps, je l'ai chargé de lettres
et d'ordres pour César; mission délicate qu'il ne pouvait accepter que
par attachement pour moi, et qu'il a remplie jusqu'au bout avec une rare
fidélité. Je voulais entrer dans quelques détails à part sur ses
sentiments et son caractère; mais je m'aperçois qu'en vous disant
pourquoi je l'aimais tant, je vous ai dit assez déjà quels étaient ses
sentiments. Je puis du moins à part vous assurer et vous garantir que
vous trouverez en Varron charme et profit. Vous verrez en lui de la
modération, de la sagesse, un sévère désintéressement, et, avec cela,
une ardeur infatigable pour le travail et la plus remarquable capacité.
Je ne devrais pas ainsi vous mettre sur la voie des découvertes que vous
ne pouvez manquer de faire, à mesure que vous le connaîtrez. Mais dans
toute nouvelle relation, la manière dont on débute et les
recommandations qui nous eu ouvrent la porte ne sont pas choses
indifférentes. C'est dans ce but que je vous écris; l'intimité de la
questure doit naturellement produire son effet, mais ce que j'ajoute n'y
nuira pas. Si vous m'aimez autant que Varron se l'imagine et que je le
sens au fond de mon coeur, ne le trompez pas, je vous en conjure, dans
ce qu'il espère et eu ce que j'attends moi-même de cette recommandation.
446. — A L. MESCIMUS. Rome.
F. V, 21. Votre lettre me charme,
elle exprime bien votre empressement de me voir. Je n'en doutais point,
mais je n'y suis pas moins sensible, et vous prie de croire que mou
impatience ne le cède pas à la vôtre. Oui, aussi vrai que je soupire
après vous, puissent tous mes autres vœux s'accomplir! Dans le temps où
se pressaient autour de moi plus en foule qu'aujourd'hui les caractères
forts, les bons citoyens, les hommes aimables et les amis empressés de
me plaire, il n'y avait personne que je visse avec plus de plaisir que
vous, presque personne môme avec un plaisir égal. Les uns ont péri, les
autres se sont éloignés, d'autres ont changé pour moi ; et maintenant je
donnerais avec joie, pour un seul jour passé près de vous, tout le temps
que je passe au milieu de ceux avec qui je suis forcé de vivre. Ne
doutez pas que je ne trouvasse mille fois plus de charme dans la
solitude dont il ne m'est pas donné de jouir, que dans les entretiens
des hommes qui fréquentent ma demeure, un seul excepté, deux au plus. Je
me console par les lettres, nos bien-aimées, et aussi par le témoignage
de ma conscience, double refuge ou vous pouvez
408
recourir comme moi. .le puis dire (ce que vous croirez sans peine) que
je n'ai jamais fait passer mon intérêt avant celui de mes concitoyens,
et que si je n'eusse excité l'envie d'un homme (Pompée ou Caton?) que
vous n'aimâtes jamais, car vous m'aimiez, il serait heureux, lui et tous
les gens de bien. Je puis encore dire que je n'ai pas voulu que la
violence, de quelque part qu'elle vînt, prévalût sur le repos avec
l'honneur. Quand j'ai vu l'esprit de discorde et de guerre, que je
redoutais tant, devenir plus puissant que l'opinion des gens de bien,
dont l'accord était mon ouvrage, j'ai cherché à quelque prix que ce fût
la paix, plutôt que de m'exposer a un combat inégal. Sur tout cela, et
sur bien d'autres choses encore, nous causerons, j'espère, avant peu. —
Un seul motif me retient à Rome : je veux savoir ce qui se passera en
Afrique. La crise approche, et le dénouement peut ne m’être pas
indifférent, ce me semble. Je ne sais pas bien en quoi, il est vrai;
quoi qu'il en soit, je veux me tenir à portée des conseils de mes amis.
La situation est telle, en effet, que s'il y a une grande différence
entre les combattants, il n'y en aura pas une bien grande dans les
suites de la victoire, quel que soit le vainqueur. J'ai faibli peut-être
tant que le résultat a été douteux. Aujourd'hui que tout est désespéré,
je sens mon courage renaître. Je dois beaucoup sous ce rapport à votre
dernière lettre, et à la force avec laquelle vous souffrez l'injustice,
et je me fais une leçon du profit que je vous vois tirer de votre
caractère et de vos études. Je dirai la vérité: je ne vous croyais pas
d'une pareille trempe, ni vous ni aucun de ceux qui, comme vous, n'aviez
connu de la vie que ce qu'elle a de douceurs dans une patrie heureuse et
libre. Mais nous avons joui de la prospérité avec modération; supportons
avec fermeté, je ne dirai pas le changement, mais le renversement
complet de notre fortune. Même quand on est heureux, on doit mépriser la
mort, précisément parce que la mort est l'absence de tout sentiment.
Dans l'excès de nos maux, instruisons-nous non seulement à la mépriser,
mais encore à la désirer. Gardez-vous, croyez-moi, de renoncer à vos
doux loisirs, et soyez-en bien convaincu : hors le vice, hors le mal
dont vous êtes, dont vous serez toujours bien loin, il n'est rien sur la
terre qui doive inspirer a l'homme de l'horreur ou de l'effroi. Si je le
puis sans inconvénient, j'irai vous trouver bientôt; s'il survient
quelque incident qui m'en empêche, je vous le ferai savoir. Que votre
impatience de me voir ne vous porte pas surtout à risquer un déplacement
dans l'état de faiblesse où vous êtes. Écrivez-moi d'abord et
consultez-moi, je vous prie. Mon voeu est surtout que vous m'aimiez
toujours, et que vous ne négligiez rien pour garder votre santé et votre
repos.
447. - A VARRON. Rome, avril.
F. IX, 3. Je n'ai rien à vous mander
: mais Caninius va vous rejoindre, et je ne veux pas le laisser partir
sans lui donner un mot. Que vous dire ? Une chose que vous désirez,
j'imagine : j'irai bientôt vous retrouver. Voyez toutefois, je vous
prie, s'il est décent que je sois là-bas, quand tout est en feu ici.
C'est prêter aux propos de ceux qui ne savent pas que là-bas ou ici
notre
409
manière d’être et de penser est toujours la même. Qu'importe après tout?
Qu'on jase tant qu'on voudra. Devons-nous, je vous le demande, dans ce
débordement général de crimes et d'infamies, nous mettre en peine si on
blâme notre retraite et les loisirs que nous coûterions ensemble?
Arrière donc les barbares et leurs ignares propos ! Quant à moi, je
m'attache à vos pas. Quoiqu'il n'y ait rien de plus misérable que notre
misérable époque, je ne sais par quel prodige je trouve aujourd'hui dans
l'étude une mine plus riche et des dons plus abondants que jadis, soit
qu'on ne rencontre nulle part ailleurs maintenant le repos qu'elle
procure, soit que l'intensité du poison qui nous ronge rende l'antidote
plus nécessaire, et nous fasse apprécier davantage le remède dont la
vertu nous semblait indifférente quand nous étions en santé. Mais a quoi
bon ces réflexions? Ne vous viennent-elles pas aussi bien qu'a moi? Je
porte des hiboux à Athènes. Je n'avais qu'une chose à vous dire, c'est
de m'écrire et de m'attendre. Vous ferez l'un et l'autre.
448. — A VARRON. Rome, avril.
F. IX, 2. Caninius, votre ami et le
mien, vint me visiter l'autre jour fort tard ; il partait, me dit-il, le
lendemain de bonne heure, pour aller vous retrouver. Comme je voulais
lui donner une lettre pour vous, je le priai d'avoir la bonté de la
venir prendre le matin, et je passai une partie de la nuit à écrire.
Mais notre homme ne revint pas et je crus qu'il m'avait oublie. Je
n'aurais pas, manqué de vous envoyer ma lettre par mes gens, s'il ne
m'avait dit que vous partiez vous-même de Tusculum le lendemain de
très-bonne heure. Quelques jours se passent, et quand je m'y attends le
moins, voila un beau matin Caninius qui arrive. Il partait. Quoique ma
lettre fût du réchauffé, il y a eu de si grandes nouvelles depuis! je ne
voulus pas perdre ma peine, et la lui remis. J'ai causé avec lui : je
sais que c'est un homme grave et qui vous aime avec passion. Je suppose
qu'il vous rendra compte de notre entretien. Mais voici un conseil que
je vous donne, et que je me donne aussi à moi-même. Si nous ne pouvons
nous soustraire aux propos, tâchons du moins de nous soustraire aux
regards. Ils sont tellement insolents dans leur victoire qu'ils nous
regardent comme des vaincus. Or, l'aspect de ces vaincus les met mal a
l'aise, et ils souffrent de nous voir en vie. Les choses étant ainsi à
Rome, pourquoi donc, me direz-vous, n'avoir pas suivi mon exemple et ne
pas vous être éloigné? C'est, mon cher Varron, que vous êtes plus habile
que moi et que bien d'autres; c'est que vous avez, je crois, été devin,
et qu'aucune de vos prévisions ne vous a trompé. Mais tout le monde
a-t-il des yeux de lynx, pour ne pas se heurter et chopper dans de
pareilles ténèbres? — J'ai toutefois pensé souvent à sortir d'ici, pour
n'avoir point à voir ce qu'on y fait ni à entendre ce qu'on y dit. Mais
je me disais : On me rencontrera, et qu'on le pense ou non, on dira : «
il a eu peur, Il s'est sauvé; on bien il a un projet en tête; un navire
l'attend. » Ceux qui n'y entendraient pas malice, et qui au fond me
connaîtraient le mieux peut-être, auraient vu chez moi l'intention de
fuir des visages odieux. Voila ce qui m'a fait rester à Rome, ou
d'ailleurs le retour journalier des mêmes scènes a fini par
410
user ma sensibilité. — Vous savez maintenant mon histoire. Quant à vous,
vous ferez bien de rester encore a l'écart; attendez que l'enthousiasme
des premiers moments tombe et qu'on sache où nous en sommes; car je
crois que tout est fini maintenant. Il importe donc de connaître les
dispositions du vainqueur et la pente des affaires. Il ne m'est pas
difficile de m'en faire une idée, mais j'attends. Gardez-vous surtout du
séjour de Haies; tant du moins que ce tapage ne se sera pas assoupi un
peu. Il nous sera plus honorable, si nous quittons Rome pour Baïes, de
paraître y aller pour frémir, et non pour y prendre le plaisir des
bains. .le m'en rapporte à vous : que nous vivions ensemble au sein de
l'étude; je ne tiens qu'a cela. L'élude, qui n'était autrefois qu'un
charme pour nous, est aujourd'hui notre ancre de salut; au premier
appel, on nous verrait accourir, et nous nous porterions avec joie,
comme architectes ou comme manoeuvres, à la reconstruction de l'édifice
politique. Que si l'on ne veut pas de nos services, il nous sera permis
du moins de composer et de lire des traités de gouvernement; et si la
politique d'action nous est interdite à la curie et au forum, nous
ferons de la politique de théorie dans des livres, à l'exemple des plus
illustres sages de l'antiquité; et nous nous livrerons à une étude
approfondie des mœurs et des lois. Voilà mes rêves. Faites-moi la grâce
de me dire à votre tour vos vues et vos projets.
449. — A ATTICUS. Mars.
A. XII, 1. Voilà onze jours que je
vous ai quitté. Je pars de ma maison de campagne, et je vous broche ce
bout de lettre avant le Jour. Aujourd'hui je coucherai à Anagnie, demain
a Tusculum, ou je passerai un jour. Le 5 des kalendes je serai au
rendez-vous. Et puissé-je immédiatement courir me jeter dans les bras de
ma Tullie, et donner un baiser à la petite Attica ! Parlez-moi d'elle,
je vous en prie, avant que je ne quitte Tusculum. Que je sache un peu ce
qu'elle vous conte; si elle est à la campagne, ce qu'elle vous écrit.
Dans tous les cas, faites-lui ou envoyez-lui mes compliments, et que
Pitia en ait sa part. Nous allons nous revoir, mais ne laissez pas de
m'écrire pour peu qu'il y ait du nouveau. — Comme je pliais cette
lettre, la votre m'a été remise par le messager, qui a marché toute la
nuit. La pauvre Attica a eu un peu de fièvre. Ah! tant pis. Vous
m'apprenez du reste tout ce que je désirais savoir. Se chauffer le
matin, dites-vous, cela sent bien le vieillard. Oui ; mais quand la
mémoire branle, cela ne le sent-il pas davantage encore? C'est le 4
avant les kalendes que je vais chez Axius, chez vous le et 3, chez
Quintus le 5 ; c'est-à-dire, le jour même de mon arrivée. Bien riposté,
j'espère ! D'ailleurs rien à vous mander. Pourquoi donc écrire'? Eh! en
tête à tête, ne nous disons-nous pas tout ce qui nous vient à la bouche?
N'eût-on rien à se dire, c'est quelque chose que
de causer. |