![]()
DÉMOSTHÈNE
INTRODUCTION AUX PLAIDOYERS CIVILS.
| TOME I | I. Contre Aphobos (Premier plaidoyer) |
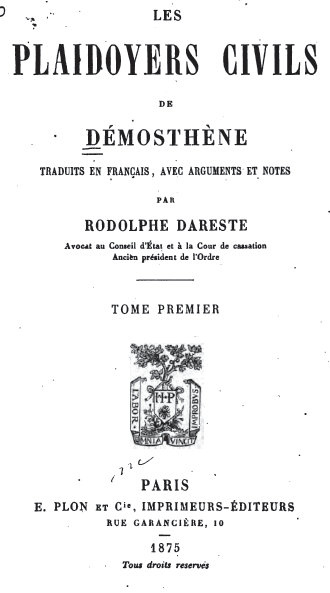
|
INTRODUCTION I
Le
recueil des œuvres attribuées a Démosthène contient, outre les
harangues prononcées dans l'assemblée du peuple, quarante-deux
plaidoyers ou discours judiciaires. Ces plaidoyers forment deux
groupes distincts. Les neuf premiers sont des accusations ou des
défenses en matière politique, et se rattachent ainsi aux harangues,
dont on ne peut guère les séparer. Les trente-trois autres
plaidoyers sont relatifs à des intérêts purement privés, à des
affaires civiles ou commerciales, parfois même criminelles, mais
sans aucun lien avec les événements politiques auxquels Démosthène
s'est trouvé mêlé. Nous avons essayé de traduire en français ces
trente-trois derniers discours, auxquels le voisinage des
Philippiques et du discours sur la couronne a fait tort, et qui
cependant méritent aussi d'être étudiés, soit comme œuvres Ce n'est pas notre intention d'insister ici sur le premier point de vue. Il suffit de l'indiquer en faisant appel au sentiment de tous ceux qui ont à discuter des affaires en public. Dès les premières pages, on reconnaît la véritable éloquence judiciaire. En peu de paroles l'orateur va droit au fait. Il regarde les juges en face, et leur suggère les raisons de décider. Tous ses efforts tendent a convaincre, à émouvoir au besoin ; il ne veut ni étonner ni éblouir. Si la logique est quelquefois poussée jusqu'à la subtilité, si l'apostrophe dégénère parfois en invective et en excès de langage, ces défauts, sensibles pour nous, ne l'étaient pas pour le public d'Athènes, et trouvent leur excuse ou tout au moins leur explication dans le caractère national et les mœurs du temps. L'Athénien était né logicien et raisonneur, ses premiers maîtres dans l'art de bien dire avaient été les Sophistes, les Gorgias, les Protagoras, tous ces personnages que Platon, dans ses dialogues, nous montre aux prises avec Socrate, et qui n'avaient pas de rivaux pour inventer ou disposer des arguments. D'autre part, Athènes était la Ville la plus commerçante et en même temps la plus démocratique de la Grèce. Il n'est pas étonnant qu'on y ait souvent parlé le langage des halles et des réunions populaires. Si ce langage ne pénètre pas dans nos audiences, c'est que chez nous la partie est obligée d'emprunter la voix d'un avocat, c'est-à-dire d'un tiers désintéressé. Au contraire, la loi de Solon obligeait les parties a se présenter en personne devant le tribunal et à s'expliquer elles-mêmes, sauf à réciter un discours préparé par un logographe. Tout au plus leur permettait-elle d'appeler à leur aide un parent ou un ami chargé de compléter leurs explications. La justice n'avait rien a gagner à cette pratique, mais l'auditoire composé de gens de mer, d'artisans, de petits marchands, y trouvait son compte. Le spectacle devenait plus émouvant, la lutte plus vive et plus dramatique. Comment, dans ces conditions, la diffamation et l'injure ne seraient-elles pas devenues une ressource habituelle des plaideurs? Notre admiration pour les chefs-d'œuvre de l'éloquence athénienne ne sera donc pas sans réserve; mais, cette réserve faite, où trouver de plus parfaits modèles? Où rencontrer un style plus ferme, une discussion plus serrée, un ton plus naturel et plus justes ? Supposons un de ces plaidoyers prononcé aujourd'hui devant un de nos tribunaux. A peine trouverait-on quelques mots a changer. Nos grands avocats pourraient se reconnaître. Ce ne sont pas les discours de Cicéron qui résisteraient a une semblable épreuve. Malgré l'abondance de sa parole et l'ingénieux artifice de son style, Cicéron est resté bien loin de ses maîtres. Qu'il plaide pour Roscius ou pour Milon, pour Flaccus ou pour Cécina, c'est toujours lui qui parle, avec la gravité d'un Romain et d'un sénateur. Le logographe athénien est obligé de faire parler les autres. Comme le poète qui écrit pour le théâtre, il doit prêter à ses personnages un langage conforme à leur caractère. De là ce naturel, cette simplicité, cette absence de toute déclamation qui sont le trait distinctif des plaidoyers athéniens et en même temps le comble de l'art chez l'orateur judiciaire. A la perfection de la forme se joint l'intérêt du fond. Il semblera peut-être, au premier abord, que de simples procès civils, des contestations entre voisins, des difficultés entre parents, des règlements de compte entre négociants, ne nous touchent guère, a vingt-deux siècles de distance. Ce sont là en effet de bien vulgaires événements, mais ils nous attachent par ce qu'ils ont de réel et de positif. En lisant les plaidoyers des orateurs on saisit en quelque sorte sur le fait la vie privée des Athéniens. On voit se dérouler, avec plus de réalité que sur la scène comique ou dans les écrits des moralistes, le caractère de ce peuple industrieux et entreprenant, âpre au gain, trop souvent enclin au mensonge, alliant des mœurs faciles et des croyances enracinées. On y trouve représentés tous les personnages de la société athénienne. On les accompagne chez eux et en public, aux champs et à la ville, sur les quais du Pirée, dans les boutiques des marchands et dans les bureaux des banquiers. Ce spectacle a déjà de quoi piquer notre curiosité, mais ce n'est pas tout. Appliquons-nous a suivre l'orateur dans ses raisonnements, écoutons la lecture des lois qu'il invoque et dont il discute le sens. Nous verrons apparaître tout l'édifice du droit attique. Les lois de Solon ne sont point parvenues jusqu'à nous. Le temps a fait disparaître les traités écrits sur la science du droit par des philosophes et des hommes d'État tels qu'Aristote, Theophraste, Démétrius de Phalère. Mais les plaidoyers athéniens peuvent nous consoler de ces pertes, et on est étonné de l'abondance des renseignements qu'ils nous fournissent, si nous savons les interroger. Sont-ils authentiques? Cette question si importante pour nous peut se poser de deux manières. On peut demander si les plaidoyers que nous avons sous les yeux sont bien réellement des plaidoyers prononcés à Athènes, devant des tribunaux, au quatrième siècle avant notre ère, ou si c'est l'œuvre de quelque rhéteur d'une époque plus récente, un pur exercice d'école. On peut aussi demander si, en admettant que ces discours sont de véritables plaidoyers, ils ont tous été composés par Démosthène, et ont été compris avec raison dans le recueil de ses œuvres. La première de ces deux questions nous paraît devoir être résolue par l'affirmative. Sur la seconde, nous n'hésitons pas à distinguer. Pour les traiter à fond, l'une et l'autre, avec tout l'appareil de l'érudition moderne, il faudrait un volume. On nous permettra d'indiquer sommairement nos raisons a propos de chaque discours. Dès à présent, il suffit de faire remarquer que pour les anciens eux-mêmes l'attribution de tels ou tels plaidoyers était douteuse. Denys d'Halicarnasse et Libanius hésitent a se prononcer en plus d'une occasion, et ne se croient pas liés par ce fait qu'une pièce a été insérée dans le recueil Démosthénique. Ce classement fait sous les Ptolémées par les savants d'Alexandrie n'a eu lieu qu'à titre de renseignements et sous toutes réserves. C'est ce qui explique comment on a pu y comprendre les plaidoyers d'Apollodore, qui n'a jamais été que l'ennemi et l'adversaire de Démosthène et n'a pu devenir son client. En revanche, il est difficile de supposer que l'antiquité tout entière ait pris pour de véritables plaidoyers quelques exercices d'école. Pour renverser une tradition constante, une possession d'état bien établie, il faudrait des preuves, et on n'a trouvé jusqu'ici que des objections plus ou moins spécieuses. Selon nous, aucune n'est décisive, et c'est ce que nous tâcherons d'établir a propos du troisième plaidoyer contre Aphobos, le plus contesté de tous. La question d'authenticité se pose encore, d'une façon plus restreinte, au sujet des textes de lois, des actes et pièces qui se trouvent fréquemment insérés dans nos plaidoyers. Ici encore la critique s'est donné carrière, et, après tout, les premiers éditeurs de ces plaidoyers, les savants d'Alexandrie, ou bien encore les rhéteurs qui sont venus depuis, auraient bien pu intercaler, dans le texte de l'orateur, des pièces fabriquées ou restituées par eux-mêmes pour faciliter l'intelligence de la discussion. Mais, si ces pièces soulèvent parfois des difficultés, rien ne serait plus téméraire que de les rejeter sans preuve, et en ce qui concerne les documents insérés dans les plaidoyers qu'on va lire, il n'y a pas de raison sérieuse pour les considérer comme suspects. Au contraire, de récentes découvertes épigraphiques sont vernies en confirmer l'authenticité de la manière la plus éclatante. C'est ce que nous verrons au sujet d'une loi de Dracon citée dans le plaidoyer contre Macartatos. Il existe déjà deux traductions de ces plaidoyers, celle d'Auger, membre de l'académie des inscriptions et belles-lettres (première édition, Paris 1777), et celle de Stiévenart, doyen de la faculté des lettres de Dijon (Paris, Didot 1842). Aucune des deux ne peut donner une idée de l'original. Auger fait parler à Démosthène et a ses clients un langage lourd et terne, qui n'a rien de commun avec l'énergique et lumineuse simplicité de l'original. Stiévenart, en voulant donner plus de relief et de couleur a son style, est tombé dans un excès contraire, et n'a réussi qu'à devenir forcé et trivial. Encore ces défauts seraient-ils pardonnables si le fond des choses était bien compris et exactement rendu; mais pour y parvenir, il aurait fallu être jurisconsulte, et on s'aperçoit trop qu'Auger et Stiévenart ne l'étaient pas. Aussi étrangers à la science du droit français qu'à celle du droit attique et en général à la langue des affaires, ils confondent tous les termes, et perdent à chaque instant le fil de la discussion. Par exemple, le demandeur et le défendeur deviennent pour eux l'accusateur et l'accusé. D'un procès civil, ils font une affaire criminelle, et on croit entendre un malheureux qui défend sa tête, tandis qu'en réalité le plaideur est un homme qui a fait des affaires et qui ne défend que sa bourse. Traduire les plaidoyers athéniens sans connaître le droit n'est pas plus raisonnable qu'il ne le serait de mettre en français les éléments d'Euclide sans savoir la géométrie. L'œuvre que nous avons entreprise est donc toute nouvelle. Nous nous sommes attaché avant tout à bien saisir le sens et l'argumentation de l'orateur, ce qui n'est pas toujours facile quand on veut aller au fond des choses et procéder comme un juge chargé de prononcer entre les parties. La difficulté serait moins grande si la discussion que nous avons sous les yeux était contradictoire; mais des deux plaidoyers que les juges d'Athènes avaient entendus, un seul nous reste dans chaque affaire, et nous n'avons pas d'autres éléments pour former notre conviction, soit sur les faits, soit sur les moyens proposés. Si l'on trouve que nous n'avons pas toujours réussi, on nous rendra du moins cette justice que ce n'est pas faute d'avoir étudié les pièces. Quant à la forme et au style, il nous a semblé que du moment où l'on fait parler en français les plaideurs athéniens, il faut leur prêter des paroles qui puissent être prononcées devant des juges français. Le style le plus convenable est celui de la plaidoirie sobre et nerveuse dont notre barreau a donné et donne encore de si parfaits modèles. Cette conviction nous a conduit a couper fréquemment les longues phrases, à tâcher d'être clairs avant tout, chose plus difficile et par la même plus nécessaire en français qu'en grec, mais surtout indispensable au barreau. Jusque-la, nous le pensons du moins, un traducteur est dans son droit, a la condition de garder toujours le ton et la mesure de l'original. Nous avons suivi presque partout le texte de Guillaume Dindorf (Demosthenis orationes, Lipsiae, Teubner, 1851), Nous l'avons toujours comparé avec celui de Vœmel (Demosthenis orationes, Paris, Didot, 1849). Enfin, nous avons eu constamment sous les yeux la seconde édition du grand travail de Reiske, donnée par Gottfried Henri Schœfer en neuf volumes in-8° (Londres, 1822-1827), avec un apparatius criticus et exegeticus contenant les notes de tous les commentateurs. Il existe aussi des éditions récentes de quelques discours isolés. Nous les avons toutes consultées, et nous les indiquerons en leur lieu. Dans l'édition de Vœmel, le texte est divisé en paragraphes numérotés. Nous nous sommes servis de cette division pour les citations et les renvois, mais nous ne l'avons pas reproduite dans notre traduction afin de ne pas gêner la lecture. Nous avons aussi cru devoir modifier l'ordre dans lequel se suivent les plaidoyers. Cet ordre n'est pas le même dans tous les manuscrits. Celui qu'adoptent toutes les éditions modernes n'est ni logique, ni chronologique. Les plaidoyers y sont rapprochés plutôt a raison du caractère de la procédure qu'à raison du fond. Nous pensons qu'il y a tout avantage à les classer par ordre de matières, en faisant un seul groupe des plaidoyers d'Apollodore. Nous joignons a chaque plaidoyer un argument et des notes. On verra, en les lisant, combien de questions de tout genre peuvent s'élever a propos de ces textes. Il a été déjà beaucoup fait pour les éclairer, et pourtant il reste encore bien des points obscurs. Avons-nous réussi à y jeter quelque lumière? Le public en jugera. Du moins nous avons lu tous les travaux de quelque importance qui ont paru jusqu'à ce jour sur ces matières, soit en France, soit dans les pays étrangers. S'il en est que nous ne citions pas, c'est que nous n'avons rien trouvé à leur emprunter. Parmi ces ouvrages, il en est quelques-uns que nous devons signaler plus particulièrement, parce que nous les avons eus constamment sous les yeux dans tout ce travail. En voici la liste : George GROTE, History of Greece; Londres, 1846-1852, 10 vol. in-8°. Arnold SCHAEFER, Demosthenes und seine Zeit;Leipzier, 1858, 3vol. in-8°. Georges PERROT, Essai sur le droit public d'Athènes; Paris, 1867, 1 vol. in-8°. — L'éloquence politique et judiciaire à Athènes; les Précurseurs de Démosthène; Paris, 1873, 1 vol. in-8°, et quatre articles publiés dans la Revue des Deux Mondes, 1er juin et 15 novembre 1872, 15 juin et 15 novembre 1873. August BOECKH, Die Slaatshaushattümer der Athener, 2e édition; Berlin, 1851, 2 vol. in-8°. (La première édition a été traduite en français en 1828.) K. F. HERMANN, Griechische Alterthümer, 3 vol. in-8°; Heidelberg. — 1er vol., Staatsaltenhümer, 4e édition, 1855; — 2e vol., Gottesdiensttiche Alterthilmer, 2e édition, 1858; — 3e vol., Privatalterthümer, 2e édition, 1870. SCHOEMANN, Griechische Alterthümer; Berlin, 1855-1859, 2vol. MEIER et SCHOEMANN, Der attische Process; Halle, 1824, in-8°. DAREMBERG et SAGLIO, Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines (Paris, 1873), non encore terminé. Nous avons surtout profité des excellents articles de MM. Gide et Caillemer. CAILLEMER, Études sur les Antiquités juridiques d'Athènes, dissertations publiées dans divers recueils (1865-1874). TÉLFY, Corpus juris attici (Pesth, 1868, 1 vol.) Nous devons aussi un témoignage de reconnaissance aux savants qui ont bien voulu s'intéresser à ce travail et nous aider de leurs conseils; nous nommerons seulement ici trois membres de l'Institut, MM. Charles Giraud, Egger et Georges Perrot. Ce dernier surtout, en se chargeant de relire les épreuves, a montré une fois de plus qu'il ne reculait devant aucune peine lorsqu'il s'agit de l'étude de l'antiquité. II On connaît maintenant l'objet et le plan de notre travail. Avant de laisser la parole a Démosthène, il est à propos de placer ici un aperçu sommaire de l'organisation judiciaire, de la procédure civile et du droit civil chez les Athéniens. Ce sont des notions qu'il faut toujours avoir présentes a l'esprit dans la lecture de ces plaidoyers, et qu'il est plus facile de saisir lorsqu'elles sont réunies en un seul faisceau. Il importe, d'ailleurs, de déterminer dès à présent, avec précision, le sens des expressions techniques que. nous rencontrerons tout a l'heure à chaque pas. Le jugement des affaires civiles à Athènes appartenait au jury. Avant Solon, et même après lui, jusqu'aux réformes de Clisthène, l'organisation judiciaire athénienne ressemblait beaucoup a celle de l'ancienne Rome. Les actions étaient portées devant les archontes, qui les jugeaient eux-mêmes ou les renvoyaient devant un arbitre public. L'appel au peuple n'était guère qu'une théorie. Le triomphe définitif de la démocratie amena l'organisation de la juridiction populaire, qui absorba aussitôt toutes les autres. Désormais l'archonte ne fut plus que le magistrat directeur du jury, et l'arbitre descendit au rang de commissaire instructeur chargé de recevoir les preuves, de faire les enquêtes et de mettre l'affaire en état. Sa décision n'était, à vrai dire, qu'un projet ou un rapport. A la vérité, les parties pouvaient s'en tenir à l'avis de l'arbitre public, ou constituer par compromis des arbitres privés avec pouvoir de décider sans recours; mais, en pareil cas, le litige trouvait sa solution moins dans la décision de l'arbitre que dans la convention des parties. Le peuple était le seul juge, comme il était le seul législateur. Comment exerçait-il ce pouvoir judiciaire? Nous le savons d'une façon assez précise. Tous les ans les neuf archontes tiraient au sort six mille citoyens, six cents de chaque tribu, âgés de plus de trente ans. Les citoyens ainsi désignés prêtaient serment devant les archontes. Ils s'engageaient a juger selon les lois, selon les décrets du peuple et du conseil, et, à défaut de lois, selon l'équité, à écouter impartialement les deux parties en cause, enfin a prononcer exactement sur l'objet de la demande, ni plus ni moins. La formule se terminait par des imprécations pour le cas de parjure, et par l'invocation des dieux nationaux, Apollon Patrôos, Déméter et Zeus roi.
Ces
héliastes, ces jurés, pour les appeler de leur vrai nom, formaient
dix sections ou tribunaux, δικαστήρια, dont chacun comprenait un peu
plus de cinq cents juges. Le surplus servait de suppléants. La
répartition se faisait par le sort, et pour chaque affaire, par les
soins des Thesmothètes. Chaque juré recevait, en arrivant, un bâton
indiquant par sa couleur et par un chiffre le tribunal dont il
devait faire partie, et, en entrant dans l'enceinte, un jeton qu'il
échangeait ensuite contre trois oboles (à peu près On ne conçoit guère un jury sans un magistrat directeur. Ce rôle était rempli a Athènes par les neuf archontes. L'un d'eux, suivant sa compétence, avait donné l'action au demandeur, et avait fait procéder à l'instruction de l'affaire, ἀνάκρισις. Après l'instruction terminée, c'est lui qui introduisait l'action devant le tribunal, εἰσάγειν τὴν δίκην, et qui prenait la présidence, ἡγεμονία δικαστηρίου. Mais ces deux dernières fonctions n'appartenaient pas exclusivement aux archontes. D'autres magistrats, tels que les onze, les consigner s'élevait au dixième de la valeur réclamée, et dans les revendications de biens confisqués, au cinquième. Elle prenait alors le nom de παρακαταβολή. L'instruction avait lieu devant l'arbitre. C'est là que les parties produisaient leurs moyens et faisaient leurs preuves. Bien que la plupart des conventions fussent rédigées par écrit, l'écriture ne paraît pas avoir été autre chose que le souvenir et le monument d'un témoignage. La preuve par excellence était la preuve testimoniale, μαρτυρίαι. Les témoins ne prêtaient pas serment, et ne manquaient jamais a qui voulait les payer. C'est la un des thèmes favoris de la comédie grecque, et certains traits qui nous font rire dans les Plaideurs de Racine sont empruntés au Pœnulus de Plante, qui n'est que la traduction d'une pièce de Ménandre. Le témoin devait déclarer ce qu'il avait vu, ce dont il avait une connaissance personnelle; il lui était interdit de rapporter des ouï -dire, ἀκοὴν μαρτυρεῖν. S'il ne pouvait se présenter en personne, on lui faisait faire sa déclaration devant des témoins, qui la rapportaient a l'arbitre, ἐκμαρτυρίαι. Il y avait toutefois deux moyens de preuve que les Athéniens considéraient comme bien plus certains que le témoignage : c'étaient la question donnée aux esclaves, et le serment prêté par l'une des parties. Les esclaves ne pouvaient pas être appelés comme témoins, surtout contre leurs maîtres: mais on les faisait parler en les appliquant a la question, qui sans doute n'était pas bien dure, d'autant que le maître avait droit à des dommages et intérêts si l'esclave ne lui était pas rendu en bon état. C'était une formalité exigée par la situation même de l'esclave, qui aurait pu craindre le ressentiment de son maître s'il avait parlé autrement que par force. Les esclaves avaient d'ailleurs beaucoup a dire, car bien des choses se passaient sous leurs yeux, et il eût été difficile de se priver d'un moyen d'information si précieux. On peut s'expliquer ainsi jusqu'à un certain point comment les Athéniens pouvaient attacher tant d'importance a une pratique aussi contraire à la raison. L'emploi de ce moyen était toujours précédé d'une sommation, πρόκλησις εἰς βάσανον. La partie offrait de livrer ses esclaves, ou mettait son adversaire en demeure de livrer les siens. Quant au serment, auquel les idées religieuses de l'antiquité donnaient une grande force, les parties y avaient souvent recours. Il était aussi précédé d'une sommation par laquelle l'adversaire était mis en demeure de le recevoir ou de le prêter. Tous ces éléments d'instruction étaient constatés par des procès-verbaux qui étaient placés dans une boîte, ἐχῖνος, sous scellé, pour être mis sous les yeux des juges au jour de l'audience. L'instruction ordinaire était longue, et pouvait durer une année et plus. Toutefois, il y avait des affaires sommaires pour lesquelles l'instruction devait être terminée dans le mois, à la diligence du demandeur; c'étaient les affaires concernant les recouvrements de prêts d'amitié, ἔρανοι, celles de commerce, de mines, et les actions dotales. On les appelait, pour cette raison, δίκαι ἔμμηνοι. L'instruction terminée, le rôle des juges commençait. Au jour fixé, le magistrat qui avait reçu l'action venait siéger comme président du jury tiré au sort par les thesmothètes, et introduisait l'affaire, εἰσάγειν. Si l'une des parties ne comparaissait pas, il était donné défaut contre elle. Toutefois, le défendeur pouvait obtenir une remise en se fondant sur de justes motifs. Après une prière prononcée par le héraut, le greffier donnait lecture de la demande et des moyens de défense. La parole était ensuite donnée aux parties, et celles-ci étaient en général tenues de s'expliquer elles-mêmes, sauf à réciter un discours préparé par un conseil, ou à se faire assister a l'audience par un parent ou un ami qui complétait la défense. Il n'y avait donc pas d'avocats, a proprement parler, a moins qu'on ne veuille donner ce nom au logographe qui écrivait des plaidoyers pour autrui. La réplique, δευτερολογία, n'était permise que dans certaines affaires. Le temps des juges était précieux, et des précautions efficaces avaient été prises pour limiter la durée des débats. Le temps accordé a chacune des parties, pour fournir ses explications, était mesuré par la clepsydre, sorte de vase dont le fond laissait écouler goutte à goutte une certaine quantité d'eau. Toutefois le greffier arrêtait l'eau pendant la lecture des pièces, lecture qu'il donnait pendant le plaidoyer sur l'ordre de la partie. Les témoignages étaient lus d'après le procès-verbal dressé dans l'instruction; mais les témoins étaient présents, et la partie pouvait demander qu'ils fussent entendus à l'audience. La durée prescrite aux plaidoyers n'était pas uniforme. Le minimum paraît avoir été d'une demi-heure. Mais parmi ceux qui nous restent, on en trouve quelques-uns dont l'étendue est double ou triple, ce qui permet de supposer que, suivant la nature de l'affaire, on accordait a la partie deux ou trois clepsydres. Après la clôture des débats, le président mettait immédiatement aux voix la question de savoir s'il y avait lieu de faire droit a la demande, sans jamais diviser, quelque complexe que la demande pût être. Les juges votaient au scrutin secret, sans délibéré, au moyen de boules blanches ou noires. En cas de condamnation, si l'affaire était sujette a estimation, il était procédé à un second scrutin sur le montant de la condamnation, dans les limites posées par la demande et la défense. Si le demandeur succombait et que la demande tendit au payement d'une somme d'argent, δίλαι χρηματικαί, il était condamné à payer au défendeur une indemnité d'une obole par drachme sur la somme réclamée, soit le sixième. C'est ce qu'on appelait l'épobélie, ἐπωβελία. Le défendeur pouvait accepter le débat et se défendre au fond, εὐθυδικία. Mais il pouvait aussi déplacer le terrain de la lutte, et la loi mettait alors à sa disposition deux procédures particulières, appelées paragraphè et diamartyria. La paragraphè était une sorte d'exception, au sens romain. Elle tendait à faire déclarer l'action non recevable, soit pour incompétence du juge saisi, soit pour défaut de qualité de la partie, soit pour manque de base légale à la prétention du demandeur. Le défendeur qui opposait la paragraphè devenait demandeur non pas seulement aux fins de son exception, mais pour tout le litige. Il parlait le premier sur la fin de non-recevoir d'abord , et ensuite sur le fond, car la question du fond n'était pas réservée, et il fallait toujours plaider à toutes fins. Les rôles des parties se trouvaient ainsi complètement renversés, a ce point que le rejet de la paragraphè entraînait contre celui qui l'avait opposée condamnation à l'épobélie. Quant à la diamartyria, elle servait à soulever une question préjudicielle. Le défendeur, au lieu de se renfermer dans des dénégations, alléguait un fait positif de nature à rendre inconcluants les faits allégués par le demandeur. Il fournissait immédiatement la preuve, et le demandeur était tenu de fournir la preuve contraire. Mais, a la différence de la paragraphè, la diamartyria ne renversait pas les rôles. L'exécution des jugements était abandonnée aux parties elles-mêmes. Celui qui avait gagné son procès procédait lui-même en présence de témoins amenés par lui, saisissait les meubles et se mettait en possession des immeubles. S'il rencontrait quelque résistance ou s'il craignait d'en rencontrer, il pouvait intenter contre son adversaire une action de dessaisine , δίκη ἐξούλης, à raison de l'obstacle apporté à sa mise en possession. Au moyen de cette action, celui qui refusait de s'exécuter était condamné envers l'État à une somme égale au montant de la condamnation principale ; il pouvait alors être poursuivi comme débiteur public et frappé, jusqu'à parfait payement, de l'incapacité légale appelée atimie, ἀτιμία. S'il était étranger ou commerçant, il pouvait être contraint par corps ou forcé de donner caution. Les jugements étaient définitifs et sans recours. Toutefois la partie condamnée par défaut, soit devant l'arbitre, soit devant le tribunal, pouvait former opposition et demander un jugement contradictoire, μὴ οὖσαν, ou τὴν ἐρήμην ἀντιλαγχάνειν. Le délai était de dix jours dans le premier cas et de deux mois dans le second. Elle pouvait encore demander la nullité de la citation et, par suite, du jugement, γραφὴ ψευδοκλητείας. Enfin, si une partie parvenait a prouver qu'elle avait été condamnée sur faux témoignages, δίκη ψευδομαρτυριῶν, elle pouvait obtenir des dommages et intérêts, soit contre les témoins, soit même, et par une action spéciale de dol, δίκη κακοτεχνιῶν, contre son adversaire primitif. Et lorsque le premier jugement touchait a l'état des personnes ou à l'ordre des successions, il était rescindé de plein droit et le procès recommencé, ἀναδικία. Aussi l'action en faux témoignage était-elle la ressource fréquemment employée par les plaideurs mécontents. Telle était la procédure. Voyons maintenant ce qu'était le droit civil. IV Toute l'organisation de la famille athénienne dérive d'une seule idée, celle de la maison, οἶκος; c'est l'ensemble des personnes qui vivent réunies sous le même toit, autour du même foyer, et qui après leur mort doivent reposer dans le même tombeau. Entre les membres de la maison il n'y a pas seulement communauté d'origine, il y a encore communauté de vie, et en quelque sorte identité d'existence ordinairement indiquée par la transmission régulière des noms de l'aïeul au petit-fils, enfin communauté de culte domestique et d'habitation jusque dans la dernière demeure. La parenté, dans le sens le plus étroit du mot, comprend ceux qui habitent la maison, οἰκεῖοι. L'esclave lui-même est avant tout un domestique, οἰκέτης. Si le fils de famille en se mariant va faire ménage à part, si l'esclave, du consentement de son maître, va demeurer ailleurs, χωρὶς οἰκεῖν, ils cessent de faire partie de la maison. Entre les diverses maisons il y a cependant un lien qui ne peut se rompre : c'est celui de la communauté d'origine. Cette communauté constitue la gens, γένος, et la parenté au sens large, συγγενεία, cognatio, comprend l'ensemble des individus qui font partie de la gens. Les membres de la gens ont encore entre eux des sacrifices communs, et même des droits de succession. Enfin, au-dessus de la gens, il existe encore un autre lien, celui de la phratrie, φρατρία. Le mot même, emprunté à la racine qui signifie frère dans toutes les langues aryennes, indique aussi l'idée de la communauté d'origine. Les membres de la phratrie ont encore entre eux des réunions périodiques, des sacrifices communs et des droits de succession. Après la phratrie, il n'y a plus de lien, car la division du peuple en dix tribus et en cent soixante-trois dèmes n'a qu'un caractère politique et administratif. L'étranger n'a pas de maison. Il habite auprès, à côté des citoyens, mais non avec eux, et c'est ce qu'indique son nom de métèque, μέτοικος. Il ne peut ni épouser une Athénienne, ni posséder un immeuble sur le territoire athénien, a moins qu'une loi particulière ne lui ait conféré l'un ou l'autre de ces deux droits, ἐπιγαμία, connubium; ἔγκτησις, commercium. Comme mari, comme père, comme tuteur, il n'a pas les pouvoirs que la loi accorde aux seuls citoyens, et qui sont comme une délégation de la puissance publique. Enfin, il est tenu d'avoir un Athénien pour patron ou répondant, προστάτης. Du reste, il peut exercer librement son industrie ou son commerce, à la seule condition de payer une capitation de douze drachmes par an. De tous les habitants de la maison, l'esclave est au dernier degré. Au point de vue économique, c'est une chose. C'est un barbare, un être inférieur, destiné par la nature a servir, comme le bœuf, le chien ou le cheval. Mais les mœurs lui font une situation meilleure. Lorsqu'il entre dans la maison pour la première fois, la maîtresse du logis répand sur sa tête une poignée de grains et de fruits pour fêter sa bienvenue. Il prend part à toutes les cérémonies du culte domestique. La loi le garantit contre les mauvais traitements, et lui donne même le droit de paraître en justice comme défendeur. Enfin, il peut arriver à la liberté soit en se rachetant, soit en recevant l'affranchissement. Celui-ci n'est d'ailleurs soumis à aucune forme. Il suffit que le maître ait exprimé sa volonté.
En
général, l'affranchi sort de la maison et va habiter ailleurs; mais
il reste sous le patronage de son ancien maître. Il est tenu envers
lui à certains devoirs; il ne peut se marier sans le consentement de
son patron, et s'il meurt sans enfants, c'est son patron On vient devoir qu'il ne pouvait y avoir de légitime mariage qu'entre Athéniens. De là l'institution d'une sorte de mariage civil, ἐγγύη; dans cet acte, la personne qui a autorité sur la future épouse, κύριος, se porte en quelque sorte caution pour elle, atteste qu'elle est bien Athénienne, et la donne au futur époux. A cet acte est joint une constitution de dot, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. Ainsi, la femme ne pouvait se marier qu'avec le consentement de son κύριος. Quant au mari, s'il̆ était majeur, aucune loi ne lui imposait l'obligation de rapporter le consentement de son père. La loi ne fixait pas non plus l'âge de la puberté. C'était une simple question de fait. Mais loin de repousser les mariages entre proches parents, la loi les favorisait. Elle allait jusqu'à permettre les mariages entre frère et sœur, pourvu qu'ils ne fussent pas de la même mère. Le mariage pouvait être dissous par le divorce. La faculté de divorcer appartenait non seulement au mari, ἀποπέμπειν, mais encore a la femme, ἀπολείπειν. Dans ce dernier cas, la femme devait se présenter en personne devant l'archonte, pour lui remettre l'acte de divorce. Le divorce entraînait, pour le mari, l'obligation de restituer la dot. Le premier effet du mariage était de soumettre la femme à l'autorité de son mari; mais cette autorité n'est pas, à proprement parler, une puissance, et ne ressemble nullement à la manus du droit romain. C'est une magistrature, et, comme dit Aristote, un pouvoir qui a un caractère politique. Le mari devient le κύριος de sa femme, parce que toute femme doit avoir un κύριος;, et que dans le mariage ce droit ne peut appartenir qu'au mari. Sans lui, la femme ne peut aliéner. Elle ne peut s'obliger que jusqu'à concurrence de la valeur d'un médimne (un demi-hectolitre) d'orge. Si la femme devient veuve, elle a pour κύριος son fils, ou, à défaut, son plus proche parent. Les enfants légitimes sont soumis à l'autorité de leur père jusqu'a leur majorité, qui commence deux ans après la puberté, ἐπι διετὲς ἡβῆσαι, c'est-à-dire à dix-huit ans, ou peut-être avec la dix-huitième année. De dix-huit à vingt ans, les jeunes hommes font un service militaire sur la frontière de l'Attique. A vingt ans, ils peuvent assister et prendre part aux assemblées publiques. La constatation de la filiation a lieu au moyen de la présentation faite par le père à la gens et a la phratrie, et approuvée par un vote conforme de tous les intéressés. Le souvenir en est conservé par l'inscription sur un registre, κοινὸν γραμματεῖον. Une cérémonie semblable a lieu au moment de la majorité; mais cette fois la présentation et l'inscription se font au dème, qui a aussi son registre, ληξιαρχινὸν γραμματεῖον. Ces registres sont analogues à ceux qui sont tenus dans nos paroisses et nos mairies avec cette différence toutefois que le κοινὸν ou ληξιαρχινὸν γραμματεῖον ne constitue pas par lui-même un titre. Il ne fait preuve, ni absolument ni même jusqu'à preuve contraire. C'est un simple renseignement. La preuve résulte du fait de la présentation suivie d'un vote favorable, et ce fait ne peut être établi que par témoins. La recherche de la paternité est permise aux enfants nés d'une mère athénienne, et la preuve résulte du serment de celle-ci. L'autorité paternelle n'a rien de comparable à la patria potestas des Romains. C'est un simple pouvoir de protection et de défense, et, comme dit Aristote, un pouvoir royal. A la mort du père, les enfants mineurs passent sous l'autorité d'un tuteur qui est désigné par le testament du père. A défaut de cette désignation, la tutelle passe au parent le plus proche, dans l'ordre suivi par la loi pour les successions ; et enfin, à défaut de parents, un tuteur est nommé par l'archonte. Le tuteur, ἐπίτροπος, est en réalité un intendant, un mandataire légal. Il a,la saisine des biens du mineur, et peut en disposer; mais la loi l'oblige à affermer ces biens devant l'archonte. Le preneur donne en garantie une hypothèque, ἀποτίμημα, sur ses biens personnels. S'il n'obéit pas a cette prescription de la loi, sans en avoir été dispensé par le défunt, l'archonte peut lui faire une injonction qui peut être provoquée par tout citoyen, φάσις;, et une action criminelle peut être intentée contre lui, γραφὴ ἐπιτροπῆς. Les ascendants, les descendants, les frères forment le premier cercle de la parenté. C'est à eux qu'appartiennent le droit de vengeance, la poursuite du meurtre et le prix du sang. Les parents plus éloignés ne font que prêter leur assistance. Les successions sont déférées d'abord aux descendants, c'est-à-dire aux fils d'abord, et, a défaut de fils, aux filles. La représentation en ligne directe a lieu à l'infini, et le partage se fait également. L'héritier en ligne directe se saisit lui-même des biens, ἐμβατεύειν, et n'a pas besoin de demander un envoi en possession. Sa situation est la même que celle de l'heres suus du droit romain. Les enfants adoptifs sont entièrement assimilés aux enfants nés du sang. Celui qui voit sa maison vide, οἶκος ἕρημος, et ne veut pas la laisser s'éteindre, adopte un enfant qui sort de la maison où il est né, pour entrer dans celle de son père adoptif. Devenu majeur, l'adopté peut retourner dans la première, mais à la condition de laisser dans la seconde un enfant né de lui, et ses descendants ont le même droit. L'adoption, υἱοῦ ποίησις, est tellement favorisée par la loi et tellement entrée dans les mœurs qu'elle peut avoir lieu même après la mort du père adoptif, et par une fiction posthume, qui s'opère comme l'adoption ordinaire par la présentation aux membres de la gens et de la phratrie. Quant aux enfants illégitimes, νόθοι, ils n'ont aucun droit de succession. La loi les exclut de la famille, et permet seulement de leur faire un legs jusqu'à concurrence de mille drachmes. Toutefois, la recherche de la paternité est permise aux enfants nés d'une mère athénienne, et s'ils font la preuve qui est a leur charge, le père peut les légitimer en les présentant à la gens et a la phratrie. Après les descendants, la loi appelle les collatéraux, sans s'arrêter aux ascendants. Faire remonter la succession eût été, pour les anciens, une idée contradictoire. D'ailleurs, le père était κύριος de ses enfants mineurs, et la mère avait sa dot, ou les aliments qui devaient lui être fournis par le détenteur de sa dot. Aussi la loi de Solon ne parlait-elle ni de l'un ni de l'autre, pas plus que la loi de Moïse; mais déjà au temps de Démosthène d'autres idées tendaient à se faire jour dans la jurisprudence, et on commençait à soutenir que la loi qui appelait à la succession les parents par la mère, à défaut de parents par le père, appelait à plus forte raison et implicitement la mère elle-même. La succession en ligne collatérale est déférée suivant le degré de parenté, ἀγχιστεία. Comme les Germains et comme le droit canonique, le droit athénien ne compte que les degrés qui séparent le défunt de l'auteur commun. En conséquence, il appelle d'abord la descendance du même père, c'est-à-dire les frères et leurs enfants, puis les sœurs et leurs enfants; en seconde ligne, il appelle la descendance de l'aïeul paternel, c'est-à-dire les cousins et les enfants de cousins, toujours en préférant le mâle. La vocation héréditaire s'arrête aux enfants de cousins. A défaut de parents dans la descendance du père ou de l'aïeul, viennent dans le même ordre les parents qui descendent de la mère, puis la descendance de l'aïeul maternel. On passe ensuite au plus proche parent du côté paternel, puis enfin à la 9ens et à la phratrie. La parenté ainsi constituée n'a rien de commun avec l'agnation du droit romain, qui se transmet uniquement par les mâles, et dérive de la puissance paternelle. Ainsi, en droit athénien, le fils de la sœur, qui en droit romain ne serait qu'un cognât, succède avant le fils du fils de l'aïeul, qui serait un agnat. A la différence des descendants en ligne directe, les collatéraux ne peuvent recueillir la succession qu'en demandant l'envoi en possession, λῆξις. Les uns et les autres peuvent s'abstenir, ἀπέχειν, ἀποστῆναι, du reste, on ne trouve aucune trace d'une institution analogue au bénéfice d'inventaire. Le partage des successions se fait comme dans notre droit français. Nul n'est tenu de rester dans l'indivision. Le communiste qui refuse de partager peut y être contraint par une action en justice, εἰς δατητῶν αἵρεσιν. Les femmes et les mineurs sont valablement représentés par leurs κύριοι. L'opération du partage comprend d'abord les comptes, qui sont réglés au moyen de prélèvements, ἀντιμοιρίας ἐξαιρεῖν, la formation de la masse, τὸ κοινὸν, les rapports, ἀναφέρειν, ἐπαναφέρειν, συμβάλλειν, enfin la composition et le tirage des lots. L'égalité est la règle; toutefois, il peut y avoir dispense de rapport au profit de l'un des successibles. On doit faire entrer dans chaque lot la même quantité de meubles et d'immeubles. Entre deux héritiers, l'un fait les lots et l'autre choisit. Nous venons d'exposer l'ordre légal des successions. Il peut y être dérogé par des dispositions à titre gratuit, c'est-à-dire .par des donations entre vifs ou à cause de mort, ou par des testaments. Soit qu'il s'agisse de donations, δωρεαὶ, ou de testaments, διαθῆκαι, aucune forme n'est prescrite. Il suffit que le donateur ou le testateur ait manifesté sa volonté d'une manière certaine. Tout se réduit a une question de preuve, et c'est pourquoi dans la pratique les testaments sont rédigés par écrit et remis par le testateur, en présence de témoins, à un ami qui est chargé du dépôt. Plus tard, ces usages ont été érigés en droit par les empereurs romains, et de la sont nés le testament mystique et le testament olographe dont le nom seul attesterait au besoin l'origine grecque. Du reste, les principes du droit romain sur l'institution d'héritier sont étrangers au droit attique. A Athènes, comme dans notre droit français, le testateur ne fait que des légataires ou, si l'on veut, des fidéicommissaires, car c'est au droit des gens que les Romains ont emprunté rasage des fidéicommis. Il ne peut faire un héritier qu'indirectement en conférant l'adoption, et il ne peut ni adopter, ni léguer a des tiers, au delà d'une certaine mesure, qu'à défaut d'enfants légitimes; mais il peut partager sa fortune entre ses enfants, et même faire les parts inégales. Il peut étendre ses prévisions jusqu'au cas où ses enfants viendront a décéder avant l'âge de dix-huit ans, et régler pour ce cas le sort des biens qu'il leur laisse. C'est ce que les Romains appelaient substitutio pupillaris. Enfin, il peut déshériter ses enfants pour cause d'ingratitude. Au surplus, la validité du testament pouvait être attaquée pour suggestion et captation et pour faiblesse d'esprit. Pour compléter ce tableau de la famille et des successions athéniennes, il nous reste à parler des droits des femmes. Nous avons dit qu'à degré égal elles étaient primées par les mâles. Alors même qu'elles recueillaient les biens, elles n'étaient pas, à proprement parler, héritières. Elles ne les recueillaient que pour, les transmettre à leurs enfants. C'est ce que la loi exprimait en les appelant épiclères, ἐπίκληροι. En général, le père disposait de ses filles par testament en faveur d'un de ses plus proches parents. A défaut de semblables dispositions, les parents étaient appelés par ta loi, dans un certain ordre, à se faire adjuger l'épiclère et la succession , ἐπιδικάζεσθαι. Toute femme à qui advenait une succession pouvait être ainsi revendiquée, et même contrainte au divorce si elle était mariée antérieurement. Lorsque des filles restaient sans fortune , les parents étaient appelés dans le même ordre à les épouser ou a les doter. En compensation de cette infériorité au point de vue héréditaire, les filles avaient droit a une dot. Du moins, c'était un usage constant de leur en donner une. La dot était constituée par le κύριος de la femme, c'est-à-dire par son père ou son plus proche parent du côté du père , au moment où il la donnait en mariage , ἔκδοσις, et par l'acte même qui constituait le lien civil du mariage, ἐγγύη. La propriété des biens dotaux appartenait toujours à la femme. Le mari en avait seulement la jouissance pendant la durée du mariage, et devait en employer les fruits a l'entretien de la femme et des enfants communs. Si la dot consistait en une somme d'argent, la femme devenait créancière de son mari pour cette somme, et cette créance était garantie par une hypothèque spéciale que le mari fournissait, ἀποτίμημα, et qui n'était pas dispensée description. Si le mariage était dissous par le divorce ou par la mort du mari, et qu'il y eût des enfants nés du mariage, la femme avait l'option ou de rester dans la maison de son défunt mari , ou de retourner chez son κύριος. Dans ce dernier cas, elle emportait sa dot. Dans le premier cas, la dot cessait d'exister. Les biens dotaux devenaient la propriété des enfants, à la charge de pourvoir aux besoins de leur mère. Si la femme mourait la première, la dot revenait à l'agnat qui l'avait constituée, ou, si elle laissait des enfants, à ceux-ci, même du vivant de leur père. La restitution de la dot pouvait être demandée par l'action de dot, δίκη προικός. Lorsqu'il s'agissait de réclamer tout ou partie des fruits à titre d'aliments, la femme ou ses représentants avaient l'action d'aliments, δίκη σίτου. Les biens dotaux ne pouvaient pas être aliénés par le mari, qui n'en était pas propriétaire. La femme aurait-elle pu les aliéner avec l'assistance de son κύριος ? Cela est probable, sans toutefois qu'il soit permis de l'affirmer. On ne voit pas non plus qu'aucune loi l'ait empêchée de renoncer à son hypothèque. Toutes les fois que le mari était tenu de restituer la dot, la créance portait intérêt de plein droit a neuf oboles par mine et par mois, ἐπ' ἐννέα ὀβόλοις, c'est-à-dire à 18 pour 100. Il nous reste à parler de la propriété et des obligations. A Athènes comme a Rome on distinguait les choses communes, κοινά, les choses sacrées, ἱερά, les choses publiques, δημόσια, et les choses privées, ἴδια. Mais une autre distinction plus pratique et d'une application plus journalière était celle des biens apparents et non apparents, οὐσία φανερά, ἀφανής, distinction qui au surplus était plutôt de fait que de droit. Les Athéniens concevaient la propriété, κτῆσις, comme les Romains. Ils la distinguaient très bien de la simple possession, κατυχή. Ils en analysaient les éléments de la même manière, et y reconnaissaient le droit aux fruits, καρπός, ἐπικαρπία, et le simple usage, χρῆσις. Ils connaissaient aussi les servitudes. Ainsi nous trouvons indiquées celles de pacage, ἐπινομή, celle de passage, βαδίζειν, celle d'aqueduc, χαράδρα, celle d'égout, χειμαρροῦς, et la servitude œdificandi, ἐπιτειχισμός. Enfin les droits de gage, d'hypothèque et d'antichrèse, sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure, constituaient aussi des droits réels. Mais en ce qui touche l'acquisition de la propriété et des droits réels, le droit athénien s'éloigne complètement des idées romaines. A Athènes, la propriété se transférait par l'effet des obligations, c'est-à-dire par le simple consentement des parties, ou bien encore par ra volonté de la loi, ou par une adjudication émanée de l'autorité publique. Ainsi nous ne trouvons a Athènes rien d'analogue à ce que les Romains appelaient modes solennels d'acquisition, tels que la mancipatio ou la cessio in jure. La tradition même, παράδοσις, n'était que l'exécution d'une obligation entre les parties, mais n'avait par elle-même aucune vertu translative. Quant à l'usucapion ou prescription acquisitive, nous n'en trouvons pas de trace. Ce qui était vrai, a Athènes, c'est que la possession prolongée faisait présumer le droit de propriété jusqu'à preuve contraire, et, d'autre part, l'action en revendication n'échappait pas à la règle générale, en vertu de laquelle toutes les actions se prescrivaient par cinq ans. C'est de la sans doute que les jurisconsultes romains ont tiré plus tard l'institution de la longi temporis prœscriptio, et lorsqu'ils ont admis la constitution des servitudes et des hypothèques par simples pactes, on est tenté de voir dans cette dérogation aux principes romains une influence hellénique. Mais tout en dépouillant de toute solennité la transmission de la propriété et la constitution des droits réels entre les parties, les Athéniens avaient compris la nécessité de créer des mesures de publicité dans l'intérêt des tiers. Ainsi les contrats de vente devaient être affichés pendant soixante jours au moins dans le lieu où siégeait l'archonte, ἀναγραφή et les hypothèques étaient réellement inscrites sur les immeubles au moyen d'une pierre, ὅρος, indiquant le nom du créancier et le montant de la créance, moyens imparfaits sans doute, si ou les compare à la transcription ou à l'inscription sur les registres hypothécaires, telles que nous les pratiquons aujourd'hui, mais pourtant efficaces, et révélant chez le peuple athénien une remarquable intelligence des conditions du crédit. Quant aux actions qui naissaient de la propriété et des droits réels, nous les connaissons mal. Du moment où la propriété se transférait par le seul consentement, il n'y avait pas le même intérêt qu'à Rome dans la distinction des droits réels et des simples droits de créance, et, dans la pratique, l'action réelle faisait souvent place à une simple action personnelle en dommages et intérêts. Il parait que le demandeur intentait d'abord une action en restitution de fruits, δίκη καρποῦ ou ἐνοικίου. La solution de cette question préjugeait la question de propriété du fonds, et dispensait ordinairement de l'aborder. Cependant, si les parties n'arrivaient pas à s'entendre, elles avaient recours à la revendication δίκη οὐσίας ou χωρίου, qui tendait non à la restitution de l'immeuble en nature, mais au payement de la valeur estimée par les juges. Enfin, si la partie condamnée ne satisfait pas à cette obligation, elle était contrainte a déguerpir par une troisième action appelée δίκη ἐξούλης. On ne voit pas que les Athéniens aient eu rien d'analogue a nos actions possessoires, et il n'est même pas bien certain que dans les actions réelles le fardeau de la preuve ait été exclusivement a la charge du demandeur. Du moins on serait tenté de croire, a certains indices, que la preuve était également à la charge des deux parties, et que la possession ne conférait, à ce point de vue, aucun avantage. Si la transmission de la propriété n'était assujettie à aucune forme, à plus forte raison devait-il en être ainsi des obligations, συναλλάγματα. Elles se divisent en volontaires et involontaires, ἐκουσία, ἀκουσία. Les premières dérivent du seul consentement des parties, sans aucune formalité extérieure, sans rien de comparable à ce que tes interprètes modernes du droit romain appellent causa civilis obligationum, ni aux contrats qui se forment re, verbis ou litteris. Les parties sont liées du moment qu'elles sont d'accord. Le reste n'est qu'une affaire de preuve. C'est en vue de la preuve que l'on constate généralement les obligations par écrit, συγγραφαί, συνθῆκαι, et plus tard χειρόγραφα, et que l'on dépose l'écrit entre les mains d'un tiers. C'est encore en vue de la preuve qu'on appelle des témoins, et quand le futur débiteur confirme son engagement par un serment, c'est une sûreté qu'il donne et non une formalité qu'il remplit. La loi n'exige qu'une chose, c'est que le consentement soit libre, et ne soit obtenu ni par la tromperie, ἀπατή, ni par la contrainte , ἀνάγκη. Il faut de plus que la convention ait un objet licite, non contraire a l'ordre public, aux lois, aux bonnes mœurs. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles peuvent être révoquées de leur consentement mutuel. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Ce sont là des dispositions de notre Code civil. Elles sont déjà écrites, avec la même généralité philosophique, dans les lois de Solon. La théorie générale des obligations n'était pas dans la loi; on en trouve des traces dans les ouvrages des moralistes, et surtout dans les plaidoyers des orateurs. Il serait sans intérêt de réunir ici ces fragments épars, mais il n'est pas inutile de signaler les principaux termes de la langue juridique et d'en marquer nettement la signification. Ainsi, nous rencontrons les dommages et intérêts pour inexécution des obligations, τὰ διάφορα; l'excuse résultant de la force majeure et des cas fortuits, θεοῦ βία, ἀπροσδόκητος; le terme, ἡμέρα; la demeure, ὑπερημερία ; l'option, αἵρεσις; la solidarité passive, κοινῇν ὀφείλειν, par opposition à ἰδίᾳ ou κατὰ μέρος ὀφείλειν; la clause pénale, τὰ ἐπιτίμια. En ce qui touche l'extinction des obligations, la langue juridique n'est pas moins riche. Nous voyons dans les textes le payement, διάλυσις, ἀπόδοσις; la sommation de recevoir, πρόκλησις , la remise de la dette, ἄφεσις. Le débiteur peut faire cession de biens, ἐκστῆναι τῶν ὄντων. Les parties ou le tribunal peuvent, en certains cas, annuler ou restreindre les obligations, ἄκυρα ποιεῖν, ἀναιρεῖν. En général, les payements, se font par l'entremise des banquiers, τραπεζίται , que nous retrouvons à Rome sous le nom d'argentarii. Les trapézites reçoivent les dépôts, tiennent les comptes courants et les règlent en employant la délégation et la compensation. La première s'opère par un virement sur les livres, une transcriptio a persona in personam, comme disaient les Romains, ἀντεγγράφειν, ἀντεπιγράφειν, mais avec cette différence que l'écriture n'est qu'un moyen de preuve et non le fait générateur de l'obligation. Quant à la compensation, elle était la conséquence nécessaire du règlement de compte. Les obligations involontaires qui résultent d'une faute naissent ou d'un fait caché ou d'un fait de violence ouverte, λαθραῖα, βίαια συναλλάγματα. La faute elle-même peut être volontaire ou involontaire, et cette distinction sert à mesurer l'étendue de. la réparation ou des dommages et intérêts, βλάβης τίμημα. Chacun répond non seulement de son fait personnel, mais encore du fait des personnes, ou des animaux qu'il a sous sa garde, sauf a se décharger de toute responsabilité en abandonnant l'esclave ou l'animal auteur du dommage. C'est la noxœ deditio du droit romain. Dans presque toutes les affaires, il est d'usage de donner des arrhes, ἀρραβών, qui sont à la fois le signe du consentement et un moyen de s'en dédire pour l'une des parties en perdant les arrhes, et pour l'autre en les rendant au double. Enfin, comme sûretés, viennent les contrats accessoires, le cautionnement, ἐγγύη, et le nantissement qui se produit soit sous la forme du contrat pignoratif, fiducia, soit sous la forme du gage mobilier ou de l'hypothèque. Celle-ci est toujours purement conventionnelle , et jamais dispensée d'inscription. L'hypothèque de la femme mariée et celle du mineur ont seulement un nom particulier, ἀποτίμημα. Ce n'est pas ici le lieu de parcourir les diverses espèces de contrats. Il nous suffit d'en indiquer les noms et de noter quelques dispositions particulières. La vente, ὠνὴ καὶ πρᾶσις, est translative de propriété; elle emporte pour le vendeur obligation de garantie, βαβαίωσις. Le recours de l'acheteur contre son garant s'appelle ἀναγωγή. Puis viennent le louage, μίσθωσις; le prêt de consommation, δαωεισμός; le prêt à usage, χρῆσις; la société, κοινωνία, qui pour les affaires de commerce n'est jamais qu'une société en participation; le dépôt, παρακαταθήκη ; le marché à livrer ou contrat d'entreprise, ἐργολαβεία. Quant au mandat, bien que pratiqué sous toutes les formes, il ne constituait pas, aux yeux des Athéniens, un contrat distinct ayant un nom générique produisant certains effets constants, et donnant naissance à une action spéciale. On ne faisait nulle difficulté d'admettre que le mandant était représenté par son mandataire et obligé par lui envers les tiers. Signalons encore la transaction, ἀπαλλαγή. Il faudrait encore parler des contrats commerciaux et maritimes. On a vu que la société se réduisait à une participation. Les contrats de ce genre les plus fréquents étaient le louage des navires, ναῦλον, et le prêt à la grosse aventure, ναυτικὸν δανεῖον. La lettre de change, considérée comme un mandat de payer à une personne déterminée, n'était pas ignorée des Athéniens; mais ils n'ont connu ni les effets a ordre, ni les assurances, et c'est bien vainement qu'on a voulu en chercher des traces dans les auteurs anciens. L'intérêt de l'argent était fixé par l'usage à un pour cent par mois, et, dans certains cas, à un et demi. Du reste, les conventions étaient libres. En matière de prêt maritime, notamment, le taux de l'intérêt n'avait aucune limite. Enfin, toutes les actions s'éteignaient par la prescription , προθεσμία. Celle-ci était en général de cinq ans. Toutefois, l'obligation des cautions ne durait qu'un an. En matière de succession, la prescription de l'action en pétition d'hérédité ne commençait à courir que du jour où s'ouvrait la succession de l'héritier en possession, disposition assez étrange et dont il est difficile de deviner les motifs.
Tels sont les
caractères dominants du droit athénien. Au point de vue
philosophique, la conception en est simple. Il est fondé sur une
analyse exacte des faits, et pose des principes généraux dont
l'application n'est plus qu'une affaire de tact. Le droit romain n'a
jamais atteint la même hauteur, et on est frappé de l'analogie que
présentent certains textes des lois de Solon avec certains articles
de notre Code civil. V Nous n'avons pas parlé de la procédure criminelle. Elle différait peu de la procédure civile. Les juges étaient les mêmes, excepté pour les cas de meurtre avec préméditation, dont le jugement appartenait au tribunal suprême de l'Aréopage. Les accusations, γραφαί, étaient publiques, δημοσίαι, ou privées, ἰδίαι. Les premières pouvaient être portées par tout citoyen, les secondes seulement par la partie intéressée. Les peines pécuniaires prononcées en matière criminelle profitaient en général à l'État. Enfin, si la partie poursuivante se désistait ou n'obtenait pas le cinquième des voix, elle encourait une amende de mille drachmes, et une atimie emportant incapacité d'intenter à l'avenir une autre poursuite du même genre. Dans les affaires privées , c'est-à-dire dans lesquelles la partie lésée pouvait seule poursuivre, ce qui comprenait les affaires de meurtre, la loi en certains cas engageait la partie lésée à transiger, en recevant le prix du sang, αἰδεῖσθαι. Les actions criminelles comme les actions, civiles étaient dénommées d'après leur objet. Elles s'engageaient de plusieurs façons, au moyen de certaines procédures particulières, telles que l'interdiction. πρόρρησις;, la délation, φάσις;, la dénonciation, ἔνδειξις, la prise de corps, ἀπαγωγή, la révélation, ἀπογραφή, et enfin la déclaration, εἰσαγγελία. Par laquelle l'action était préalablement soumise à l'assemblée du peuple ou au conseil des cinq cents. Nous nous contentons de signaler ici ces divers termes sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir. VI Un mot encore sur le système monétaire. L'unité monétaire à Athènes était la drachme, pièce d'argent à peu près équivalente a un franc (exactement 0,97 !). Cent drachmes faisaient une mine (97 francs), et soixante mines un talent (5820 francs). La drachme se divisait en six oboles valant chacune 16 centimes et une fraction (16,166). La monnaie de cuivre était le chalque, χαλκοῦς, dont 8 faisaient une obole. La monnaie d'or était le statère, valant 20 drachmes (19.40).
Pour se faire
une idée des valeurs énoncées dans les plaidoyers qu'on va lire, on
peut sans inconvénient prendre la drachme pour un franc et la mine
pour cent francs, en négligeant la différence. Tous les calculs
deviennent alors extrêmement simples.
|