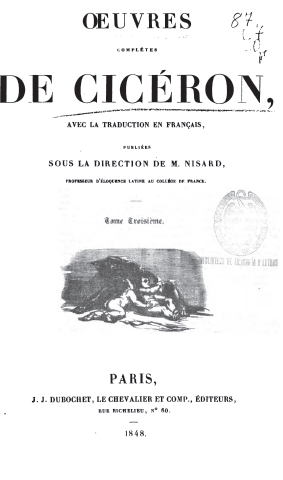|
DE PROVINCIIS CONSVLARIBVS IN SENATV ORATIO
I. Si quis vestrum, patres conscripti, exspectat
quas sim provincias decreturus, consideret ipse secum qui mihi homines ex
provinciis potissimum detrahendi sint: non dubitabit quid sentire me conveniat,
cum quid mihi sentire necesse sit cogitarit. Ac si princeps eam sententiam
dicerem, laudaretis profecto; si solus, certe ignosceretis; etiam si paulo minus
utilis vobis sententia videretur, veniam tamen aliquam dolori meo tribueretis.
Nunc vero, patres conscripti, non parva adficior voluptate, vel quod hoc maxime
rei publicae conducit, Syriam Macedoniamque decerni, ut dolor meus nihil a
communi utilitate dissentiat, vel quod habeo auctorem P.
Servilium, qui ante me sententiam dixit, virum clarissimum et cum in
universam rem publicam tum etiam erga meam salutem fide ac benivolentia
singulari. Quod si ille, et paulo ante et quotienscumque ei locus dicendi ac
potestas fuit, Gabinium et Pisonem, duo rei publicae portenta ac paene funera,
cum propter alias causas tum maxime propter illud insigne scelus eorum et
importunam in me crudelitatem, non solum sententia sua sed etiam verborum
gravitate esse notandos putavit, quonam me animo in eos esse oportet, cuius illi
salutem pro pignore tradiderunt ad explendas suas cupiditates? sed ego in hac
sententia dicenda non parebo dolori meo, non iracundiae serviam. quo animo unus
quisque vestrum debet esse in illos, hoc ero: praecipuum illum et proprium
sensum doloris mei, quem tamen vos communem semper vobis mecum esse duxistis, a
sententia dicenda amovebo, ad ulciscendi tempora reservabo.
II. Quattuor sunt provinciae, patres conscripti,
de quibus adhuc intellego sententias esse dictas, Galliae duae, quas hoc tempore
uno imperio videmus esse coniunctas, et Syria et
Macedonia, quas vobis invitis et oppressis pestiferi illi consules pro perversae
rei publicae praemiis occupaverunt. Decernendae nobis sunt lege Sempronia duae.
quid est quod possimus de Syria Macedoniaque dubitare? Mitto quod eas ita partas
habent ii qui nunc obtinent ut non ante attigerint quam hunc ordinem
condemnarint, quam auctoritatem vestram e civitate exterminarint, quam fidem
publicam, quam perpetuam populi Romani salutem, quam me ac meos omnis foedissime
crudelissimeque vexarint. Omnia domestica atque urbana mitto, quae tanta sunt ut
numquam Hannibal huic urbi tantum mali optarit quantum illi effecerint. Ad ipsas
venio provincias; quarum Macedonia, quae erat antea munita plurimorum
imperatorum non turribus sed tropaeis, quae multis victoriis erat iam diu
triumphisque pacata, sic a barbaris, quibus est propter avaritiam pax erepta,
vexatur ut Thessalonicenses positi in gremio imperi nostri relinquere oppidum et
arcem munire cogantur, ut via illa nostra quae per Macedoniam est usque ad
Hellespontum militaris non solum excursionibus barbarorum sit infesta, sed etiam
castris Thraeciis distincta ac notata. Ita gentes eae quae, ut pace uterentur,
vim argenti dederant praeclaro nostro imperatori, ut exhaustas domos replere
possent, pro empta pace bellum nobis prope iustum intulerunt.
III. Iam vero exercitus noster ille superbissimo
dilectu et durissima conquisitione conlectus omnis interiit. Magno hoc dico cum
dolore: miserandum in modum milites populi Romani capti necati deserti dissipati
sunt, incuria fame morbo vastitate consumpti, ut, quod est indignissimum, scelus
imperatoris in p<atri>am exercitum<que> exp<ia>tum esse videatur. Atque hanc
Macedoniam, domitis iam gentibus finitimis barbariaque compressa, pacatam ipsam
per se et quietam, tenui praesidio atque exigua manu etiam sine imperio per
legatos nomine ipso populi Romani tuebamur; quae nunc consulari imperio atque
exercitu ita vexata est vix ut se possit diuturna pace recreare; cum interea
quis vestrum hoc non audivit, quis ignorat, Achaeos ingentem pecuniam pendere L.
Pisoni quotannis, vectigal ac portorium Dyrrachinorum totum in huius unius
quaestum esse conversum, urbem Byzantiorum vobis atque huic imperio fidelissimam
hostilem in modum esse vexatam? quo ille, postea quam nihil exprimere ab
egentibus, nihil ulla vi a miseris extorquere potuit, cohortis in hiberna misit;
iis praeposuit quos putavit fore diligentissimos satellites scelerum, ministros
cupiditatum suarum. Omitto iuris dictionem in libera civitate contra leges
senatusque consulta, caedis relinquo, libidines praetereo, quarum acerbissimum
exstat indicium et ad insignem memoriam turpitudinis et paene ad iustum odium
imperi nostri, quod constat nobilissimas virgines se in puteos abiecisse et
morte voluntaria necessariam turpitudinem depulisse; nec haec idcirco omitto
quod non gravissima sint, sed quia nunc sine teste dico.
IV. Ipsam vero urbem Byzantiorum fuisse
refertissimam atque ornatissimam signis quis ignorat? quae illi exhausti
sumptibus bellisque maximis, cum omnis Mithridaticos impetus totumque Pontum
armatum, effervescentem in Asiam atque erumpentem ore, repulsum et cervicibus
interclusum suis sustinerent, tum, inquam, Byzantii et postea signa illa et
reliqua urbis ornamenta sanctissime custodita tenuerunt: Te imperatore
infelicissimo et taeterrimo, Caesonine calventi,
civitas libera, et pro eximiis suis beneficiis a senatu et a populo Romano
liberata, sic spoliata atque nudata est ut, nisi C. Vergilius legatus, vir
fortis et innocens, intervenisset, unum signum Byzantii ex maximo numero nullum
haberent. quod fanum in Achaia, qui locus aut lucus in Graecia tota tam sanctus
fuit in quo ullum simulacrum, ullum ornamentum reliquum sit? emisti a foedissimo
tribuno plebis tum in illo naufragio huius urbis, quam tu idem qui gubernare
debueras everteras, tum, inquam, emisti grandi pecunia ut tibi de pecuniis
creditis ius in liberos populos contra senatus consulta et contra legem generi
tui dicere liceret: id emptum ita vendidisti ut aut ius non diceres aut bonis
civis Romanos everteres.
Quorum ego nihil dico, patres conscripti, nunc in
hominem ipsum: de provincia disputo. Itaque omnia illa quae et saepe audistis et
tenetis animis, etiam si non audiatis, praetermitto. Nihil de hac eius urbana,
quam ille praesens in mentibus vestris oculisque defixit, audacia loquor; nihil
de superbia, nihil de contumacia, nihil de crudelitate disputo; lateant
libidines eius illae tenebricosae, quas fronte et supercilio, non pudore et
temperantia contegebat: de provincia quod agitur, id disputo. Huic vos non
submittetis? hunc diutius manere patiemini? cuius, ut provinciam tetigit, sic
fortuna cum improbitate certavit ut nemo posset utrum protervior an infelicior
esset iudicare.
An vero in Syria diutius est
Semiramis illa retinenda? cuius iter in provinciam
fuit eius modi ut rex Ariobarzanes consulem vestrum ad caedem faciendam tamquam
aliquem Thraecem conduceret; deinde adventus in Syriam primus equitatus habuit
interitum, post concisae sunt optimae cohortes. Igitur in Syria imperatore illo
nihil aliud <umquam> actum est nisi pactiones pecuniarum cum tyrannis,
decisiones, direptiones, latrocinia, caedes, cum palam populi Romani imperator,
instructo exercitu, dexteram tendens, non ad laudem milites hortaretur, sed
omnia sibi et empta et emenda esse clamaret.
V. Iam vero publicanos miseros—me etiam miserum
illorum ita de me meritorum miseriis ac dolore!—tradidit in servitutem Iudaeis
et Syris, nationibus natis servituti. Statuit ab initio, et in eo perseveravit,
ius publicano non dicere; pactiones sine ulla iniuria factas rescidit;
custodias sustulit; vectigalis multos ac
stipendiarios liberavit; quo in oppido ipse esset aut quo veniret, ibi
publicanum aut publicani servum esse vetuit. quid multa? crudelis haberetur si
in hostis animo fuisset eo quo fuit in civis Romanos, eius ordinis praesertim
qui est semper <pro> dignitate sua benignitate magistratuum sustentatus.
Itaque, patres conscripti, videtis non temeritate
redemptionis aut negoti gerendi inscitia, sed avaritia, superbia, crudelitate
Gabini paene adflictos iam atque eversos publicanos: quibus quidem vos in his
angustiis aerari tamen subveniatis necesse est, etsi iam multis non potestis,
qui propter illum hostem senatus, inimicissimum ordinis equestris bonorumque
omnium, non solum bona sed etiam honestatem miseri deperdiderunt, quos non
parsimonia, non continentia, non virtus, non labor, non splendor tueri potuit
contra illius helluonis et praedonis audaciam. Quid? qui se etiam nunc subsidiis
patrimoni aut amicorum liberalitate sustentant, hos perire patiemur? an si qui
frui publico non potuit per hostem, hic tegitur ipsa lege censoria: quem is frui
non sinit qui est, etiam si non appellatur, hostis, huic ferri auxilium non
oportet? retinete igitur in provincia diutius eum qui de sociis cum hostibus, de
civibus cum sociis faciat pactiones, qui hoc etiam se pluris esse quam conlegam
putet, quod ille vos tristitia vultuque deceperit, ipse numquam se minus quam
erat nequam esse simularit. Piso autem alio quodam modo gloriatur se brevi
tempore perfecisse ne C. Gabinius unus omnium nequissimus existimaretur.
VI. Hos vos de provinciis, si non aliquando
deducendi essent, deripiendos non putaretis? et has duplicis pestis sociorum,
militum cladis, publicanorum ruinas, provinciarum vastitates, imperi maculas
teneretis? at idem vos anno superiore hos eosdem revocabatis, cum in provincias
pervenissent: quo tempore si liberum vestrum iudicium fuisset nec totiens dilata
res nec ad extremum e manibus erepta, restituissetis, id quod cupiebatis,
vestram auctoritatem, iis per quos erat amissa revocatis, et iis ipsis praemiis
extortis quae erant pro scelere atque eversione patriae consecuti. Qua e poena
si tum aliorum opibus, non suis, invitissimis vobis evolarunt, at aliam multo
maiorem gravioremque subierunt. quae enim homini in quo aliqui, si non famae
pudor, at supplici timor est gravior poena accidere potuit quam non credi
litteris iis quae rem publicam bene gestam in bello nuntiarent? hoc statuit
senatus, cum frequens supplicationem Gabinio denegavit: primum homini sceleribus
flagitiis contaminatissimo nihil esse credendum, deinde a proditore, atque eo
quem praesentem hostem rei publicae cognosset, bene rem publicam geri non
potuisse, postremo ne deos quidem immortalis velle aperiri sua templa et sibi
supplicari hominis impurissimi et sceleratissimi nomine. Itaque ille alter aut
ipse est homo doctus et a suis Graecis subtilius eruditus, quibuscum iam in
exostra helluatur, antea post siparium solebat, aut
amicos habet prudentiores quam Gabinius, cuius nullae litterae proferuntur.
VII.. Hosce igitur imperatores habebimus? quorum
alter non audet nos certiores facere <qua re> imperator appelletur, alterum, si
tabellarii non cessarint, necesse est paucis diebus paeniteat audere: cuius
amici si qui sunt, aut si beluae tam immani tamque taetrae possunt ulli esse
amici, hac consolatione utuntur, etiam T. Albucio supplicationem hunc ordinem
denegasse. quod est primum dissimile, res in Sardinia cum mastrucatis
latrunculis a propraetore una cohorte auxiliaria gesta, et bellum cum maximis
Syriae gentibus <et> tyrannis consulari exercitu imperioque confectum. Deinde
Albucius, quod a senatu petebat, ipse sibi in
Sardinia ante decreverat; constabat enim Graecum hominem ac levem in ipsa
provincia quasi triumphasse, itaque hanc eius temeritatem senatus supplicatione
denegata notavit. Sed fruatur sane hoc solacio atque hanc insignem ignominiam
(quoniam uni praeter se inusta est), putet esse leviorem, dum modo, cuius
exemplo se consolatur, eius exitum exspectet, praesertim cum in Albucio nec
Pisonis libidines nec audacia Gabini fuerit ac tamen hac una plaga conciderit,
ignominia senatus.
Atqui duas Gallias qui decernit consulibus duobus,
hos retinet ambo; qui autem alteram Galliam et aut Syriam aut Macedoniam, tamen
alterum retinet <et> in utriusque pari scelere disparem condicionem facit.
'faciam,' inquit, 'illas praetorias, ut Pisoni et Gabinio succedatur statim.'
Si hic sinat! tum enim tribunus intercedere poterit,
nunc non potest. Itaque ego idem, qui nunc consulibus iis qui designati erunt
Syriam Macedoniamque decerno, decernam easdem praetorias, ut et praetores annuas
provincias habeant et eos quam primum videamus quos animo aequo videre non
possumus.
VIII. Sed, mihi credite, numquam succedetur illis,
nisi cum ea lege referetur qua intercedi de provinciis non licebit. Itaque hoc
tempore amisso annus est integer vobis exspectandus; quo interiecto civium
calamitas, sociorum aerumna, sceleratissimorum hominum impunitas propagatur.
Quod si essent illi optimi viri, tamen ego mea
sententia C. Caesari succedendum nondum putarem. qua de re dicam, patres
conscripti, quae sentio, atque illam interpellationem mei
familiarissimi, qua paulo ante interrupta est oratio mea, non pertimescam.
Negat me vir optimus inimiciorem Gabinio debere esse quam Caesari: omnem illam
tempestatem cui cesserim Caesare impulsore atque adiutore esse excitatam. Cui si
primum sic respondeam, me communis utilitatis habere rationem, non doloris mei,
possimne probare, cum id me facere dicam quod exemplo fortissimorum et
clarissimorum civium facere possim? an ti. Gracchus—patrem dico, cuius utinam
filii ne degenerassent a gravitate patria!—tantam laudem est adeptus, quos
tribunus plebis solus ex toto illo conlegio L. Scipioni auxilio fuit,
inimicissimus et ipsius et fratris eius Africani, iuravitque in contione se in
gratiam non redisse, sed alienum sibi videri dignitate imperi quo duces essent
hostium Scipione triumphante ducti, eodem ipsum duci qui triumphasset? Quis
plenior inimicorum fuit C. Mario? L. Crassus, M. Scaurus alieni, inimici
omnes Metelli: at ii non modo illum inimicum ex
Gallia sententiis suis non detrahebant, sed ei propter rationem Gallici belli
provinciam extra ordinem decernebant. Bellum in Gallia maximum gestum est;
domitae sunt a Caesare maximae nationes, sed nondum legibus, nondum iure certo,
nondum satis firma pace devinctae. Bellum adfectum videmus et, vere ut dicam,
paene confectum, sed ita ut, si idem extrema persequitur qui inchoavit, iam
omnia perfecta videamus, si succeditur, periculum sit ne instauratas maximi
belli reliquias ac renovatas audiamus. Ergo ego senator—inimicus, si ita vultis,
homini—amicus esse, sicut semper fui, rei publicae debeo. Quid? si ipsas
inimicitias depono rei publicae causa, quis me tandem iure reprehendet?
praesertim cum ego omnium meorum consiliorum atque factorum exempla semper ex
summorum hominum factis mihi censuerim petenda.
IX. An vero M. Ille Lepidus, qui bis consul et
pontifex maximus fuit, non solum memoriae testimonio, sed etiam annalium
litteris et summi poetae voce laudatus est quod cum
M. Fulvio conlega, quo die censor est factus, homine inimicissimo, in campo
statim rediit in gratiam, ut commune officium censurae communi animo ac
voluntate defenderent? Atque ut vetera, quae sunt innumerabilia, mittam, tuus
pater, Philippe, nonne uno tempore cum suis inimicissimis in gratiam rediit?
quibus eum omnibus eadem res publica reconciliavit quae alienarat. Multa
praetereo, quod intueor coram haec lumina atque ornamenta rei publicae, P.
Servilium et M. Lucullum. Vtinam etiam L. Lucullus illic adsideret! quae fuerunt
inimicitiae in civitate graviores quam Lucullorum atque Servili? quas in viris
fortissimis non solum exstinxit rei publicae <utilitas> dignitasque ipsorum, sed
etiam ad amicitiam consuetudinemque traduxit. quid? Q. Metellus Nepos nonne
consul in templo Iovis optimi maximi, permotus cum auctoritate vestra tum illius
P. Servili incredibili gravitate dicendi, absens mecum summo suo beneficio
rediit in gratiam? an ego possum huic esse inimicus cuius litteris fama nuntiis
celebrantur aures cotidie meae novis nominibus gentium nationum locorum? Ardeo,
mihi credite, patres conscripti,—id quod vosmet de me existimatis et facitis
ipsi,—incredibili quodam amore patriae, qui me amor et subvenire olim
impendentibus periculis maximis cum dimicatione capitis et rursum, cum omnia
tela undique esse intenta in patriam viderem, subire coegit atque excipere unum
pro universis. Hic me meus in rem publicam animus pristinus ac perennis cum C.
Caesare reducit, reconciliat, restituit in gratiam. Quod volent denique homines
existiment: nemini ego possum esse bene merenti de re publica non amicus.
X. Etenim si iis qui haec omnia flamma ac ferro
delere voluerunt non inimicitias solum sed etiam bellum indixi atque intuli, cum
partim mihi illorum familiares, partim etiam me defendente capitis iudiciis
essent liberati, cur eadem res publica quae me in amicos inflammare potuit
inimicis placare non possit? quod mihi odium cum P. Clodio fuit, nisi quod
perniciosum patriae civem fore putabam qui turpissima libidine incensus duas res
sanctissimas, religionem et pudicitiam, uno scelere violasset? num est igitur
dubium ex iis rebus quas is egit agitque cotidie quin ego in illo oppugnando rei
publicae plus quam otio meo, non nulli in eodem defendendo suo plus otio quam
communi prospexerint?
Ego me a C. Caesare in re publica dissensisse
fateor et sensisse vobiscum; sed nunc isdem vobis adsentior cum quibus antea
sentiebam. Vos enim, ad quos litteras L. Piso de suis rebus non audet mittere,
qui Gabini litteras insigni quadam nota atque ignominia nova condemnastis, C.
Caesari supplicationes decrevistis numero ut nemini uno ex bello, honore ut
omnino nemini. Cur igitur exspectem hominem aliquem qui me cum illo in gratiam
reducat? reduxit ordo amplissimus, et ordo is qui est et publici consili et
meorum omnium consiliorum auctor et princeps. Vos sequor, patres conscripti,
vobis obtempero, vobis adsentior, qui, quam diu C. Caesaris consilia in re
publica non maxime diligebatis, me quoque cum illo minus coniunctum videbatis:
postea quam rebus gestis mentis vestras voluntatesque mutastis, me non solum
comitem esse sententiae vestrae sed etiam laudatorem vidistis.
XI. Sed quid est quod in hac causa maxime homines
admirentur et reprehendant meum consilium, cum ego idem antea multa decrerim
quae magis ad hominis dignitatem quam ad rei publicae necessitatem pertinerent?
supplicationem quindecim dierum decrevi sententia mea. Rei publicae satis erat
tot dierum quot C. Mario; dis immortalibus non erat exigua eadem gratulatio quae
ex maximis bellis; ergo ille cumulus dierum hominis est dignitati tributus. In
quo ego, quo consule referente primum decem dierum est supplicatio decreta Cn.
Pompeio Mithridate interfecto et confecto Mithridatico bello, et cuius sententia
primum duplicata est supplicatio consularis,—mihi enim estis adsensi cum,
eiusdem Pompei litteris recitatis, confectis omnibus maritimis terrestribusque
bellis, supplicationem dierum decem decrevistis,— sum Cn. Pompei virtutem et
animi magnitudinem admiratus, quod, cum ipse ceteris omnibus esset omni honore
antelatus, ampliorem honorem alteri tribuebat quam ipse erat consecutus. Ergo in
illa supplicatione quam ego decrevi, res ipsa tributa est dis immortalibus et
maiorum institutis et utilitati rei publicae, sed dignitas verborum, honos et
novitas et numerus dierum Caesaris ipsius laudi gloriaeque concessus est.
Relatum est ad nos nuper de stipendio exercitus: non decrevi solum sed etiam ut
vos decerneretis laboravi, multa dissentientibus respondi, scribendo adfui. Tum
quoque homini plus tribui quam nescio cui necessitati. Illum enim arbitrabar
etiam sine hoc subsidio pecuniae retinere exercitum praeda ante parta et bellum
conficere posse; sed decus illud et ornamentum triumphi minuendum nostra
parsimonia non putavi. Actum est de decem legatis, quos alii omnino non dabant,
alii exempla quaerebant, alii tempus differebant, alii sine ullis verborum
ornamentis dabant: in ea quoque re sic sum locutus ut omnes intellegerent me id
quod rei publicae causa sentirem facere uberius propter ipsius Caesaris
dignitatem.
XII. At ego idem nunc in provinciis
decernendis, qui illas omnis res egi silentio, interpellor, cum in superioribus
causis hominis ornamenta <adiumento> fuerint, in hac me nihil aliud nisi ratio
belli, nisi summa utilitas rei publicae moveat. Nam ipse Caesar quid est cur in
provincia commorari velit, nisi ut ea quae per eum adfecta sunt perfecta rei
publicae tradat? amoenitas eum, credo, locorum, urbium pulchritudo, hominum
nationumque illarum humanitas et lepos, victoriae cupiditas, finium imperi
propagatio retinet. quid illis terris asperius, quid incultius oppidis, quid
nationibus immanius, quid porro tot victoriis praestabilius, quid Oceano longius
inveniri potest? an reditus in patriam habet aliquam offensionem? utrum apud
populum a quo missus, an apud senatum a quo ornatus est? an dies auget eius
desiderium, an magis oblivionem, ac laurea illa magnis periculis parta amittit
longo intervallo viriditatem? qua re, si qui hominem non diligunt, nihil est
quod eum de provincia devocent: ad gloriam devocant, ad triumphum, ad
gratulationem, ad summum honorem senatus, equestris ordinis gratiam, populi
caritatem. Sed si ille hac tam eximia fortuna propter utilitatem rei publicae
frui non properat, ut omnia illa conficiat, quid ego senator facere debeo, quem,
etiam si ille aliud vellet, rei publicae consulere oporteret?
Ego vero sic intellego, patres conscripti, nos hoc
tempore in provinciis decernendis perpetuae pacis habere oportere rationem. Nam
quis hoc non sentit, omnia alia esse nobis vacua ab omni periculo atque etiam
suspicione belli? Iam diu mare videmus illud immensum, cuius fervore
non solum maritimi cursus sed urbes etiam et viae
militares iam tenebantur, virtute Cn. Pompei sic a populo Romano ab Oceano usque
ad ultimum Pontum tamquam unum aliquem portum tutum et clausum teneri; nationes
eas, quae numero hominum ac multitudine ipsa poterant in provincias nostras
redundare, ita ab eodem esse partim recisas, partim repressas, ut Asia, quae
imperium antea nostrum terminabat, nunc tribus novis provinciis ipsa cingatur.
Possum de omni regione, de omni genere hostium dicere: nulla gens est quae non
aut ita sublata sit ut vix exstet, aut ita domita ut quiescat, aut ita pacata ut
victoria nostra imperioque laetetur.
XIII. Bellum Gallicum, patres conscripti, C.
Caesare imperatore gestum est, antea tantum modo repulsum. Semper illas nationes
nostri imperatores refutandas potius bello quam lacessendas putaverunt. Ipse
ille C. Marius, cuius divina atque eximia virtus magnis populi Romani luctibus
funeribusque subvenit, influentis in Italiam Gallorum maximas copias repressit,
non ipse ad eorum urbis sedisque penetravit. Modo ille meorum laborum
periculorum consiliorum socius, C. Pomptinus, fortissimus vir, ortum repente
bellum Allobrogum atque hac scelerata coniuratione excitatum proeliis fregit
eosque domuit qui lacessierant, et ea victoria contentus re publica metu
liberata quievit. C. Caesaris longe aliam video fuisse rationem; non enim sibi
solum cum iis quos iam armatos contra populum Romanum videbat bellandum esse
duxit, sed totam Galliam in nostram dicionem esse redigendam. Itaque cum
acerrimis nationibus et maximis Germanorum et Helvetiorum proeliis felicissime
decertavit, ceteras conterruit, compulit, domuit, imperio populi Romani parere
adsuefecit, et quas regiones quasque gentis nullae nobis antea litterae, nulla
vox, nulla fama notas fecerat, has noster imperator nosterque exercitus et
populi Romani arma peragrarunt. Semitam tantum Galliae
tenebamus antea, patres conscripti; ceterae partes a gentibus aut inimicis huic
imperio aut infidis aut incognitis aut certe immanibus et barbaris et bellicosis
tenebantur; quas nationes nemo umquam fuit quin frangi domarique cuperet. Nemo
sapienter de re publica nostra cogitavit, iam inde a principio huius imperi,
quin Galliam maxime timendam huic imperio putaret; sed propter vim ac
multitudinem gentium illarum numquam est antea cum omnibus dimicatum. Restitimus
semper lacessiti: nunc denique est perfectum ut imperi nostri terrarumque
illarum idem esset extremum.
XIV. Alpibus Italiam munierat antea natura non
sine aliquo divino numine; nam si ille aditus Gallorum immanitati multitudinique
patuisset, numquam haec urbs summo imperio domicilium ac sedem praebuisset. quae
iam licet considant! nihil est enim ultra illam altitudinem montium usque ad
Oceanum quod sit Italiae pertimescendum. Sed tamen una atque altera aestas vel
metu vel spe vel poena vel praemiis vel armis vel legibus potest totam Galliam
sempiternis vinculis adstringere: impolitae vero res et acerbae si erunt
relictae, quamquam sunt accisae, tamen efferent se aliquando et ad renovandum
bellum revirescent. Qua re sit in eius tutela Gallia cuius fidei virtuti
felicitati commendata est. qui si Fortunae muneribus amplissimis ornatus saepius
eius deae periculum facere nollet, si in patriam, si ad deos penatis, si ad eam
dignitatem quam in civitate sibi propositam videt, si
ad iucundissimos liberos, si ad clarissimum generum redire properaret, si in
Capitolium invehi victor cum illa insigni laurea gestiret, si denique timeret
casum aliquem, qui illi tantum addere iam non potest quantum auferre, nos tamen
oporteret ab eodem illa omnia a quo profligata sunt confici velle: cum vero ille
suae gloriae iam pridem rei publicae nondum satis fecerit, et malit tamen
tardius ad suorum laborum fructus pervenire quam non explere susceptum rei
publicae munus, nec imperatorem incensum ad rem publicam bene gerendam revocare
nec totam Gallici belli rationem prope iam explicatam perturbare atque impedire
debemus.
XV. Nam illae sententiae virorum clarissimorum
minime probandae sunt, quorum alter ulteriorem Galliam decernit cum Syria, alter
citeriorem. qui ulteriorem, omnia illa de quibus disserui paulo ante perturbat;
simul ostendit eam se tenere legem quam esse legem neget, et, quae pars
provinciae sit cui non possit intercedi, hanc se avellere, quae defensorem
habeat, non tangere; simul et illud facit, ut, quod illi a populo datum sit, id
non violet, quod senatus dederit, id senator properet auferre. Alter belli
Gallici rationem habet, fungitur officio boni senatoris, legem quam non putat,
eam quoque servat; praefinit enim successori diem. <quamquam> mihi nihil videtur
alienius a dignitate disciplinaque maiorum quam ut, qui consul Kalendis
Ianuariis habere provinciam debet, is ut eam desponsam non decretam habere
videatur. Fuerit toto in consulatu sine provincia cui fuerit, ante quam
designatus est, decreta provincia. Sortietur an non? nam et non sortiri absurdum
est, et quod sortitus sis non habere. Proficiscetur paludatus? quo? quo
pervenire ante certam diem non licebit. Ianuario, Februario provinciam non
habebit: Kalendis ei denique Martiis nascetur repente provincia. Ac tamen his
sententiis Piso in provincia permanebit. quae cum gravia sunt <tum> nihil
gravius illo, quod multari imperatorem deminutione provinciae contumeliosum est,
neque solum summo in viro sed etiam mediocri in homine ne accidat providendum.
XVI. Ego vos intellego, patres conscripti, multos
decrevisse eximios honores C. Caesari et prope singularis. <si> quod ita meritus
erat grati, sin etiam ut quam coniunctissimus huic ordini esset, sapientes ac
divini fuistis. Neminem umquam est hic ordo complexus honoribus et beneficiis
suis qui ullam dignitatem praestabiliorem ea quam per vos esset adeptus putarit.
Nemo umquam hic potuit esse princeps qui maluerit esse popularis. Sed homines
aut propter indignitatem suam diffisi ipsi sibi, aut propter reliquorum
obtrectationem ab huius ordinis coniunctione depulsi, saepe ex hoc portu se in
illos fluctus prope necessario contulerunt; qui si ex illa iactatione cursuque
populari bene gesta re publica referunt aspectum in curiam atque huic
amplissimae dignitati esse commendati volunt, non modo non repellendi sunt verum
etiam expetendi.
Monemur a fortissimo viro atque optimo post
hominum memoriam consule ut provideamus ne citerior Gallia nobis invitis alicui
decernatur post eos consules qui nunc erunt designati, perpetuoque posthac ab
iis qui hunc ordinem oppugnent populari ac turbulenta ratione teneatur. quam ego
plagam etsi non contemno, patres conscripti, praesertim monitus a sapientissimo
consule et diligentissimo custode pacis atque oti, tamen vehementius arbitror
pertimescendum si hominum clarissimorum ac potentissimorum aut honorem minuero
aut studium erga hunc ordinem repudiaro. Nam ut C. Iulius omnibus a senatu
eximiis aut novis rebus ornatus per manus hanc provinciam tradat ei cui minime
vos velitis, per quem ordinem ipse amplissimam sit gloriam consecutus, ei ne
libertatem quidem relinquat, adduci ad suspicandum nullo modo possum. Postremo
quo quisque animo futurus sit, nescio: quid sperem, video. Praestare hoc senator
debeo, quantum possum, ne quis vir clarus aut potens huic ordini iure irasci
posse videatur. Atque haec, si inimicissimus essem C. Caesari, sentirem tamen
rei publicae causa.
XVII. Sed non alienum esse arbitror, quo minus
saepe aut interpeller a non nullis aut tacitorum existimatione reprendar,
explicare breviter quae mihi sit ratio et causa cum Caesare. Ac primum illud
tempus familiaritatis et consuetudinis quae mihi cum illo, quae fratri meo, quae
C. Varroni, consobrino nostro, ab omnium nostrum
adulescentia fuit, praetermitto. Postea quam sum penitus in rem publicam
ingressus, ita dissensi ab illo ut in disiunctione sententiae coniuncti tamen
amicitia maneremus. Consul ille egit eas res quarum me participem esse voluit;
quibus ego si minus adsentiebar, tamen illius mihi iudicium gratum esse debebat.
Me ille ut quinqueviratum acciperem rogavit; me in tribus sibi coniunctissimis
consularibus esse voluit; mihi legationem quam vellem, quanto cum honore vellem,
detulit. quae ego omnia non ingrato animo, sed obstinatione quadam sententiae
repudiavi. quam sapienter, non disputo; multis enim non probabo; constanter
quidem et fortiter certe, qui cum me firmissimis opibus contra scelus inimicorum
munire et popularis impetus populari praesidio propulsare possem, quamvis
excipere fortunam, subire vim atque iniuriam malui quam aut a vestris
sanctissimis mentibus dissidere aut de meo statu declinare. Sed non is solum
gratus debet esse qui accepit beneficium, verum etiam is cui potestas accipiendi
fuit. Ego illa ornamenta quibus ille me ornabat decere me et convenire iis rebus
quas gesseram non putabam; illum quidem amico animo me habere eodem loco quo
principem civium, suum generum, sentiebam. Traduxit ad plebem inimicum meum sive
iratus mihi, quod me secum ne in beneficiis quidem videbat posse coniungi, sive
exoratus. Ne haec quidem fuit iniuria. Nam postea me ut sibi essem legatus non
solum suasit, verum etiam rogavit. Ne id quidem accepi; non quo alienum mea
dignitate arbitrarer, sed quod tantum rei publicae sceleris impendere a
consulibus proximis non suspicabar.
XVIII. Ergo adhuc magis est mihi verendum ne mea
superbia in illius liberalitate quam ne illius iniuria in nostra amicitia
reprendatur.
Ecce illa tempestas, caligo bonorum et subita
atque improvisa formido, tenebrae rei publicae, ruina atque incendium civitatis,
terror iniectus Caesari de eius actis, metus caedis bonis omnibus, consulum
scelus, cupiditas, egestas, audacia! si non sum adiutus, non debui; si desertus,
sibi fortasse providit; si etiam oppugnatus, ut quidam aut putant aut volunt,
violata amicitia est, accepi iniuriam, inimicus esse debui, non nego: sed si
idem ille tum me salvum esse voluit cum vos me ut carissimum filium
desiderabatis, et si vos idem pertinere ad causam illam putabatis voluntatem
Caesaris a salute mea non abhorrere, et si illius voluntatis generum eius habeo
testem, qui idem Italiam in municipiis, populum Romanum in contione, vos mei
semper cupidissimos in Capitolio ad meam salutem incitavit, si denique Cn.
Pompeius idem mihi testis de voluntate Caesaris et sponsor est illi de mea,
nonne vobis videor et ultimi temporis recordatione et proximi memoria medium
illud tristissimum tempus debere, si ex rerum natura non possim evellere, ex
animo quidem certe excidere? Ego vero, si mihi non licet per aliquos ita
gloriari, me dolorem atque inimicitias meas rei publicae concessisse, si hoc
magni cuiusdam hominis et persapientis videtur, utar hoc, quod non tam ad laudem
adipiscendam quam ad vitandam vituperationem valet, hominem me esse gratum, et
non modo tantis beneficiis, sed etiam mediocri hominum benivolentia commoveri.
XIX. A viris fortissimis et de me optime meritis
quibusdam peto ut, si ego illos meorum laborum atque incommodorum participes
esse nolui, ne illi me suarum inimicitiarum socium velint esse, praesertim cum
mihi idem illi concesserint ut etiam acta illa Caesaris, quae neque oppugnavi
antea neque defendi, meo iam iure possim defendere. Nam summi civitatis viri,
quorum ego consilio rem publicam conservavi, et quorum auctoritate illam
coniunctionem Caesaris defugi, Iulias leges et ceteras illo consule rogatas iure
latas negant: idem illam proscriptionem capitis mei contra salutem rei publicae,
sed salvis auspiciis rogatam esse dicebant. Itaque vir
summa auctoritate, summa eloquentia, dixit graviter casum illum meum funus
esse rei publicae, sed funus iustum et indictum. Mihi ipsi omnino perhonorificum
<est> discessum meum funus dici rei publicae: reliqua non reprendo, sed mihi ad
id quod sentio adsumo. Nam si illud iure rogatum dicere ausi sunt quod nullo
exemplo fieri potuit, nulla lege licuit, quia nemo de caelo servarat, oblitine
erant tum cum ille qui id egerat plebeius est lege
curiata factus dici de caelo esse servatum? qui si plebeius omnino esse non
potuit, qui tribunus plebis potuit esse? et cuius tribunatus si ratus est, nihil
est quod inritum ex actis Caesaris possit esse, eius non solum tribunatus
<ratus> sed etiam perniciosissimae res, auspiciorum religione conservata, iure
latae videbuntur? Qua re aut vobis statuendum est legem Aeliam manere, legem
Fufiam non esse abrogatam, non omnibus fastis legem ferri licere; cum lex
feratur, de caelo servari, obnuntiari, intercedi licere; censorium iudicium ac
notionem et illud morum severissimum magisterium non esse nefariis legibus de
civitate sublatum; si patricius tribunus plebis fuerit,
contra leges sacratas, si plebeius, contra auspicia fuisse; aut mihi
concedant homines oportet in rebus bonis non exquirere ea iura quae ipsi in
perditis non exquirant, praesertim cum ab illis aliquotiens condicio C. Caesari
lata sit ut easdem res alio modo ferret, qua condicione auspicia requirebant,
leges comprobabant, in Clodio auspiciorum ratio sit eadem, leges omnes sint
eversae ac perditae civitatis.
XX. Extremum illud est. Ego, si essent
[inimicitiae] mihi cum C. Caesare, tamen hoc tempore rei publicae consulere,
inimicitias in aliud tempus reservare deberem; possem etiam summorum virorum
exemplo inimicitias rei publicae causa deponere. Sed cum inimicitiae fuerint
numquam, opinio iniuriae beneficio sit exstincta, sententia mea, patres
conscripti, si dignitas agitur Caesaris, homini tribuam; si honos quidam,
senatus concordiae consulam; si auctoritas decretorum vestrorum, constantiam
ordinis in eodem ornando imperatore servabo; si perpetua ratio Gallici belli,
rei publicae providebo; si aliquod meum privatum officium, me non ingratum esse
praestabo. Atque hoc velim probare omnibus, patres conscripti; sed levissime
feram si forte aut iis minus probaro qui meum inimicum repugnante vestra
auctoritate texerunt, aut iis, si qui meum cum inimico suo reditum in gratiam
vituperabunt, cum ipsi et cum meo et cum suo inimico in gratiam non dubitarint
redire.
|
I. Si quelqu'un de vous, pères
conscrits, attend mon opinion sur le choix des provinces, qu'il
considère en lui-même de quels hommes je veux avant tout que nos
provinces soient délivrées : dès qu'il aura reconnu quels sont les
sentiments que doivent nécessairement m'inspirer ceux qui les
oppriment, il ne doutera plus de l'opinion qu'il me convient
d'adopter. Si j'étais le premier à proposer cette opinion,
assurément vous applaudiriez à mes paroles ; si j'étais le seul,
vous m'écouteriez du moins avec indulgence; et quand même ce que je
proposerais vous semblerait n'être pas utile, l'égarement d'une
juste colère me servirait d'excuse auprès de vous. Mais ici j'ai
tout lieu de me féliciter, pères conscrits : l'intérêt de la patrie
demande que la Syrie et la Macédoine soient provinces consulaires,
et le vœu de ma haine s'accorde avec le bien de l'État; ensuite je
ne fais qu'appuyer l'avis de P. Servilius, non moins respectable par
son zèle ardent pour la république qu'il n'est cher à mon cœur par
l'amitié dont il m'honore. Si dans la délibération présente, et
toutes les fois qu'il a 138
eu l'occasion et le droit de prendre la parole, justement indigné de
la scélératesse de Gabinius et de Pison, et de l'atroce cruauté
qu'ils ont exercée contre moi, ce vertueux citoyen a cru devoir
combattre, et flétrir même du sceau de la plus éclatante
réprobation, ces deux monstres dont les crimes ont failli perdre la
république, quels sentiments dois-je éprouver, moi, dont Ils ont
vendu le sang pour mieux assouvir un jour leur cupidité? Toutefois
je dirai mon avis sans prendre conseil de la colère; je saurai
commander à ma haine. Je ne serai pour eux que ce que chacun de vous
doit être ; et le sentiment personnel de mes peines, que cependant
vous avez regardées comme les vôtres, restera concentré dans mon
cœur : je le réserverai pour le jour des vengeances.
II. On n'a parlé jusqu'ici que de
quatre provinces : ce sont les deux Gaules, aujourd'hui réunies sous
une seule administration; la Syrie et la Macédoine, que, sans votre
aveu et malgré vos efforts, ces détestables consuls se sont fait
adjuger pour prix des maux qu'ils ont causés à la république. La loi
Sempronia ordonne que deux de ces quatre provinces soient décernées.
Pouvons-nous hésiter un instant à choisir la Syrie et la Macédoine?
Je ne rappellerai point que ceux qui les occupent n'y sont entrés
qu'après qu'ils ont eu condamné le sénat, anéanti votre autorité
dans Rome, violé la foi publique et les droits éternels du peuple
romain, épuisé sur moi et sur les miens les vexations les plus
indignes et les plus cruelles. Je passe sous silence les crimes
commis par eux dans l'enceinte de nos murs : ils sont tels que
jamais Annibal n'a souhaité autant de mal à Rome que Borne n'en a
souffert de leur consulat. Je ne parle que des provinces
elles-mêmes. L'une, la Macédoine, à qui jusqu'alors les trophées
d'une foule de généraux avaient service rempart ; la Macédoine, qui
depuis longtemps jouissait d'une paix assurée par tant de victoires
et de triomphes, est aujourd'hui dévastée par les barbares chez qui
l'avarice a porté la guerre; les habitants de Thessalonique, quoique
placés au centre de notre empire, ont été obligés de quitter la
ville et de se retrancher dans leur citadelle ; cette route
militaire, que nous avons conduite à travers la Macédoine jusqu'à
l'Hellespont, est infestée par les courses des barbares ; que
dis-je? elle est interrompue eu plusieurs endroits par les
campements des Thraces. Ainsi donc ces nations, qui pour jouir de la
paix avaient payé une somme énorme à notre excellent général,
renonçant elles-mêmes à une faveur si chèrement achetée, nous ont en
quelque sorte déclaré la guerre pour se défrayer d'une paix qui
avait épuisé leurs fortunes ; et notre brillante armée, composée
d'hommes choisis avec un soin, on pourrait dire avec une rigueur
extrême, notre armée a péri tout entière.
III. Ο douleur! les soldats du peuple
romain, pris, égorgés, dispersés, livrés à la faim, en proie aux
maladies et à tous les fléaux, ont subi le sort le plus déplorable :
l'armée semble avoir été choisie pour expier les forfaits du
général. Cette province, gouvernée par un lieutenant, même sans
pouvoir militaire, reposait tranquillement à l'ombre du nom romain ;
les nations voisines 139
avaient été subjuguées, les barbares, réprimés; une poignée de
soldats suffisait pour la défendre : aujourd'hui un général et une
armée consulaires ne l'ont point garantie des dévastations ; à peine
une paix longue et durable pourra-t-elle réparer ses maux. Et
cependant qui de vous ignore que chaque année les Achéens payent une
somme immense à L. Pison? que les droits de Dyrrhachium se
perçoivent tous au profit du seul Pison? que Byzance, si fidèle à
nos lois, a été traitée par lui comme ennemie? Et lorsqu'il ne lui a
plus été possible de rien ravir à l'indigence, de rien arracher à la
misère, il y a mis ses cohortes en quartiers d'hiver, en leur
donnant pour chefs les hommes qu'il croyait devoir être les agents
les plus impitoyables de ses crimes, et les plus ardents ministres
de ses violences. Je passe sous silence une juridiction établie dans
une ville libre, au mépris des lois et des sénatus-consuites ; je
tais les assassinats ; je ne révèle point les débauches : un fait
odieux en perpétuera le souvenir à la honte de Rome ; c'est que de
jeunes filles de la naissance la plus illustre se sont jetées dans
des puits, pour se soustraire à un déshonneur certain par une mort
volontaire. Je ne m'arrête point sur ces crimes; non que je n'en
sente l'énormité, mais je n'ai pas ici les témoins nécessaires.
IV. Qui ne sait que Byzance était
remplie de statues? Les habitants, épuisés par des guerres
ruineuses, les avaient gardées religieusement, lorsqu'ils
repoussaient les attaques de Mithridate et tous les efforts du Pont,
qui avait inondé Γ Asie de ses bataillons innombrables, et qui,
repoussé de leurs murs, menaçait encore leur tête ; depuis
cette époque ils avaient conservé avec le même respect ces statues
et les autres ornements de leur ville. Sous votre commandement,
Pison, c'est-à-dire, sous les auspices du plus incapable et du plus
pervers des généraux, une cité libre, et qui par des services
récents avait mérité du sénat et du peuple romain le maintien de
tous ses , droits, s'est vue dépouillée à un tel point, que si C.
Virgilius, qui sait allier le courage avec la probité, n'était venu
vous remplacer en qualité de lieutenant, les Byzantins ne
posséderaient plus un seul de tant de chefs-d'œuvre qui décoraient
leurs remparts. Qu'on cite un temple dans l'Achaïe, et dans la Grèce
entière un lieu saint, un bois sacré, où il soit resté une statue,
un seul ornement ! Dans ces jours de tempête, où vous avez brisé le
vaisseau de l'État que vous auriez dû sauver du naufrage, vous avez
acheté d'un infâme tribun l'autorisation de prononcer sur les dettes
chez des peuples que le sénat et les lois de votre gendre avaient
affranchis de toute juridiction étrangère; et ce privilège que vous
aviez acheté, vous l'avez vendu, soit en déniant la justice, soit en
ruinant les citoyens romains.
Mais je laisse, pères conscrits, la
personne de Pison, et je ne m'occupe que de la province. J'omets
donc toutes ces infamies, dont on vous a souvent entretenus, et que
vous vous rappelez sans qu'il soit besoin qu'on les redise; je ne
parle point de cette audace qui bravait ici vos regarda indignés, et
dont le souvenir s'est gravé si profondément dans vos âmes ; je ne
dis rien de son orgueil, rien de son opiniâtreté, rien de sa cruauté
; qu'elles ne soient point divulguées ces débauches ténébreuses
qu'il couvrait, non du 140
voile de la pudeur, mais du masque de l'austérité : encore une fois,
je ne veux voir que la province sur laquelle on délibère. N'enverretvous
pas un successeur à Pison? souffrirez-vous qu'il demeure plus
longtemps dans une contrée où, dès ses premiers pas, sa fortune et
ses vices semblent s'être défiés à qui montrerait en lui le plus
malheureux ou le plus méchant de tous les mortels?
Et Gabinius, cette nouvelle Sémiramis,
le laisserez-vous plus longtemps en Syrie? Dans sa route, votre
consul semblait courir au meurtre, comme un gladiateur gagé par le
roi Ariobarzane. À peine arrivé, il a perdu sa cavalerie ; bientôt
ses meilleures cohortes ont été taillées en pièces. Aussi n'a-t-on
rien fait en Syrie sous ce général, sinon des traités d'argent avec
des tyrans, des transactions, des pillages, des brigandages et des
meurtres. On a vu le général du peuple romain, à la tête de son
armée, lever la main, non pour exciter les soldats à la gloire, mais
pour déclarer qu'il avait tout acheté et qu'il achèterait tout.
V. Quel mal n'a-t-il pas causé aux
fermiers publics? Hélas ! ils ont trop bien mérité de moi pour que
leurs maux ne soient pas devenus les miens ! Il n'a pas rougi de les
asservir aux Juifs et aux Syriens, peuples nés pour la servitude; il
s'est fait un système dont il ne s'est jamais écarté, c'était de
refuser toute justice au fermier; il a annulé des transactions qui
n'avaient rien que de juste, supprimé tous les moyens de contrainte,
prodigué les exemptions, interdit aux fermiers, ou aux esclaves des
fermiers, le droit d'entrer dans les villes qu'il habitait, ou dans
lesquelles il devait se rendre; en un mot, on l'accuserait de
cruauté s'il avait traité un ennemi de l'État comme il a traité des
citoyens romains, et des citoyens d'un ordre qui jusqu'à lui s'est
toujours soutenu par sa considération personnelle et par la
bienveillance des magistrats.
Ainsi, pères conscrits, vous voyez les
fermiers de l'État ruinés, non par la témérité de leur bail, non par
l'impéritie de leur administration, mais par l'avarice, la tyrannie
et la cruauté de Gabinius. Quel que soit l'épuisement du trésor, il
est nécessaire que vous veniez à leur secours, et déjà il est trop
tard pour un grand nombre d'entre eux : grâce aux vexations de cet
ennemi du sénat, de ce persécuteur des chevaliers et de tous les
bons citoyens, les malheureux ont perdu non seulement leur opulence,
mais tous les moyens d'une subsistance honorable; économie,
désintéressement, vertu, travail, estime publique, rien n'a pu les
défendre contre l'audace de cet avide déprédateur. S'il en est
quelques-uns qui se soutiennent encore par les ressources de leur
patrimoine, ou par la générosité de leurs amis, souffrirez-vous que
leur ruine soit entièrement consommée? Lorsque les invasions de
l'ennemi empêchent qu'on ne perçoive les droits publics, le fermier
est mis à couvert par la loi censoriale ; et l'on ne viendrait pas à
son secours, lorsqu'il en a été empêché par un homme qui est
réellement ennemi, quoiqu'il n'en porte pas le nom! Maintenez-le
donc dans la province pour qu'il trafique des alliés avec les
ennemis, des citoyens avec les alliés, et qu'il se croie même
préférable à son collègue, parce que celui-ci vous a trompés par un
visage triste et austère, au lieu que lui ne s'est jamais feint
moins méchant qu'il ne l'était II est vrai que, de son côté, Pison
se glorifie d'un autre mérite : c'est d'avoir si bien fait en peu de
141 temps, que
Gabinius ne sera point réputé le plus détestable des hommes.
VI. Quand même la loi ne marquerait
pas un terme à leur séjour dans leurs provinces, ne vous
empresseriez-vous pas de les en arracher? y laisseriez-vous ce
double fléau des alliés, des soldats , des fermiers, ces
dévastateurs, la honte et l'opprobre de l'empire? Dès l'année
dernière, vous les rappeliez, lorsque déjà ils y étaient arrivés. Si
vos suffrages avaient été libres alors, et que l'affaire n'eût pas
été ajournée tant de fois, et enfin arrachée de vos mains, vous
auriez, au gré de vos désirs, rétabli votre autorité en révoquant
ceux par qui vous l'aviez perdue, et en les dépouillant de cette
récompense obtenue par le crime et le renversement de la patrie. Si,
malgré vos efforts, des protections puissantes les ont soustrait» à
cette punition, ils en ont subi une autre bien plus rigoureuse.
Est-il, en effet, un plus cruel châtiment pour un homme qui craint,
je ne dis pas la honte, mais le supplice, que de voir qu'une lettre
qui annonce ses succès à la guerre soit rejetée comme indigne de foi
? Eh bien ! le sénat, en refusant à Gabinius l'honneur des prières
publiques, a déclaré d'abord qu'il ne fallait pas s'en rapporter à
un homme souillé de crimes et d'infamies ; ensuite, qu'il n'était
pas possible qu'un traître, reconnu dans Rome pour ennemi de la
république, eût bien servi l'État à la tête des armées ; enfin, que
les immortels eux-mêmes ne voulaient pas que leurs temples fussent
ouverts, que des prières leur fussent adressées au nom du plus impur
et du plus scélérat des hommes. Pison est plus adroit, ou mieux
conseillé par ses Grecs, autrefois confidents secrets, aujourd'hui
compagnons effrontés de ses débauches; car on ne vous apporte point
de lettres de sa part.
VII. Et de tels chefs commanderaient
nos armées ! L'un n'ose pas nous informer si les troupes l'ont
proclamé imperator; l'autre ne l'ose que pour s'en repentir bientôt,
et maudire la diligence de ses courriers. Ses amis, s'il en a, si un
monstre tel que lui peut en avoir, lui disent pour le consoler que
T. Albucius essuya un pareil refus de la part du sénat. Mais
d'abord, quelle différence! c'étaient, d'une part, quelques
peuplades sauvages dispersées en Sardaigne par un propréteur à la
tête d'une cohorte auxiliaire; c'était, de l'autre, une guerre
contre les peuples et les rois de la Syrie terminée par un proconsul
conduisant une armée consulaire. Déplus, l'honneur qu'Albucius
demandait au sénat, il se l'était déjà décerné lui-même dans la
Sardaigne ; il était constaté que cet homme, vraiment Grec par sa
vanité, avait figuré dans la province même la cérémonie du triomphe;
et le sénat le punissait de sa folle présomption par le refus des
prières publiques. Mais que cet affront lui semble moins sanglant,
parce qu'un exemple atteste qu'il n'est pas le seul qui l'ait
éprouvé : ne lui envions pas cette triste consolation, pourvu qu'il
attende la même fin que celui dont l'exemple le console; il en est
d'autant plus digne qu'on ne reprochait à T. Albucius ni les
débauches de Pison, ni l'audace de Gabinius, et qu'on ne peut
attribuer son malheur qu'à l'arrêt dont le sénat l'avait flétri.
Assigner les deux Gaules aux consuls,
c'est 142
maintenir ces deux hommes dans leurs gouvernements ; décerner l'une
des Gaules avec la Syrie ou la Macédoine, c'est encore en maintenir
un, et faire un sort différent à des hommes qui sont également
coupables. Mais, a dit un sénateur, nous en ferons des provinces
prétoriennes, afin que Gabinius et Pison soient immédiatement
remplacés. Oui, si l'on veut bien le permettre; car alors le tribun
pourra user de son droit d'opposition : aujourd'hui, il ne le peut
pas. Quand je destine la Syrie et la Macédoine aux consuls qui
seront désignés, mon intention est aussi d'y envoyer des préteurs
pour qu'ils les gouvernent pendant une année, et nous reverrons
ainsi plus tôt ceux que nous ne pouvons voir sans indignation.
VIII. Mais, croyez-moi, vous ne
réussirez point à leur donner des successeurs, à moins que vous ne
prononciez d'après la loi, qui ne permet aucune opposition. Si vous
laissez échapper ce moment, il vous faut attendre une année entière;
et ce délai prolongera le malheur des citoyens, le tourment des
alliés et l'impunité des plus odieux scélérats.
Et fussent-ils irréprochables l'un et
l'autre, le tempe n'est pas encore venu de donner un successeur à
César. Ici, pères conscrits, je vais vous ouvrir mon âme tout
entière, et je ne craindrai pas les réflexions du vertueux ami qui
vient de m'interrompre. Il prétend que je ne dois pas moins de haine
à César qu'à Gabinius, parce que la tempête qui m'a jeté hors de ma
patrie avait été suscitée par César. Mais si je lui réponds que je
consulte ici le bien de l'Etat, et non l'intérêt de ma vengeance,
pourra-t-il trouver mauvais que je m'autorise de l'exemple des plus
illustres citoyens? Tib. Gracchus, je parle du père; plût au ciel
que les fils ne se fussent jamais écartés de ses principes I
Gracchus ne s'est-il pas couvert d'une gloire immortelle, lorsque,
seul de tous les tribuns, il vint au secours de L. Scipion, objet de
sa haine, ainsi que son frère, le vainqueur de l'Afrique? Il
déclara, dans l'assemblée, qu'il ne s'était pas réconcilié, mais
qu'il lui semblait honteux pour l'empire qu'un triomphateur fût
conduit dans la même prison où les généraux ennemis avaient été
renfermés le jour de son triomphe. Qui compta plus d'ennemis que
Marius? L. Crassus, M. Scaurus, en un mot, tous les Métellus étaient
acharnés contre lui. Toutefois ils n'opinaient point dans le sénat à
le rappeler de la Gaule; ils lui décernaient extraordinairement
cette province, à cause de la guerre contre les Gaulois. Nous avons
soutenu dans ces contrées une guerre redoutable ; les nations les
plus puissantes ont été domptées par César ; mais elles ne sont pas
encore attachées à notre empire par les lois, par des droits
certains, par une paix solide. Nous voyons la guerre avancée,
achevée même si nous laissons à celui qui la commença le soin de la
terminer; en lui nommant un successeur, nous avons à craindre que
des feux mal éteints ne se réveillent, et n'excitent un nouvel
incendie. Ainsi donc, sénateurs, je puis, si vous le voulez, ne pas
aimer César, mais je ne dois pas cesser d'être l'ami de la
république. Et si je sacrifie mes inimitiés au bien de l'État,
peut-on m'en blâmer, moi qui me fis toujours un devoir
143 de régler mes pensées
et mes actions sur l'exemple que les plus illustres citoyens nous
ont transmis?
IX. M. Lépidus, grand pontife et deux
fois consul, venait d'être nommé censeur ; à l'instant même, et sans
sortir du Champ de Mars, il se réconcilia avec son mortel ennemi, M.
Fulvius, devenu son collègue, afin qu'un même cœur et une même
volonté les réunissent dans l'exercice de la censure; et le souvenir
de la postérité, les suffrages des historiens, la voix d'un grand
poète, ont célébré cette action généreuse. Mais pour ne pas citer
ces exemples innombrables que nous offre l'antiquité, votre père, 6
Philippe I ne s'est-il pas réconcilié avec tous ses ennemis à la
fois? L'intérêt public les avait divisés, l'intérêt public les
réunit. Qu'ai-je besoin d'autres faits, quand je vois Ici les plus
recommandables des citoyens, P. Ser¬vilius et M. Lucullus? Plût au
ciel que L. Lucullus vécût encore! Vit-on jamais dans Rome des
inimitiés plus éclatantes que celles qui divisèrent les Lucullus et
les Servilius? La conscience de ce qu'ils devaient à eux-mêmes et à
la patrie non-seulement éteignit toutes ces haines, mais elle fit
naî¬tre dans leurs cœurs les doux sentiments de l'amitié la
plussincère. Enfin, n'a-t-on pas vu, dans le tem¬ple du plus grand
des immortels, le consul Q. Métellus Népos, cédant à votre autorité
imposante, et entraîné par l'éloquence énergique de P. Servilius, me
rendre généreusement son amitié, sans attendre mon retour à Rome ?
Et moi, je pourrais être ennemi d'un héros de qui les lettres et les
courriers font chaque jour retentir à mon oreille les noms inconnus
des peuples, des nations et des contrées que ses armes ont soumis!
Mon cœur, ô mes concitoyens! est embrasé de l'amour de la patrie ;
vous connaissez mes sentiments, et vous les partagez. Dans l'ardeur
de mon zèle, je n'ai pas craint autrefois d'exposer ma vie pour vous
sauver des plus affreux dangers ; et depuis j'ai présenté ma tête,
et détourné sur moi seul les traits que je voyais dirigés de toutes
parts contre la république. C'est encore ce sentiment profond et
inaltérable qui me ramène aujourd'hui vers César, qui me réunit à
lui, et qui lui rend toutes les affections de mon âme. Qu'on pense
ce qu'on voudra, il m'est impossible de n'être pas l'ami d'un homme
qui sert bien son pays.
X. En effet, si j'ai voué toute ma
haine à ceux qui ont voulu renverser Rome par le fer et la flamme,
si mon bras s'est armé contre eux, quoique les uns eussent vécu avec
moi dans une in¬time familiarité, et que ma voix eût fléchi pour les
autres la sévérité des tribunaux, pourquoi ce même intérêt public,
qui a pu me soulever contre mes amis, ne pourrait-il pas m'apaiser
en faveur de mes ennemis? Quel a été le principe de ma haine contre
Clodius, si ce n'est que, l'ayant vu, plein d'une flamme adultère,
violer par un seul attentat les deux choses les plus sacrées, la
religion et la sainteté de l'hymen, je pensais qu'il ne pouvait
jamais être qu'un citoyen pernicieux? Ce qu'il a fait, ce qu'il fait
tous les jours, ne prouve-t-il pas qu'en l'attaquant j'ai moins
songé à mon propre repos qu'au repos de l'État, et que d'autres, en
le défendant, ont plus cherché leur tranquillité personnelle que la
paix de la république?
J'avoue que mes opinions politiques
ont été contraires à celles de César, et conformes aux vôtres.
Aujourd'hui je ne suis pas moins d'accord
144 avec vous que je ne
l'ai toujours été. Vous-mêmes, en effet, vous à qui Pison n'ose
écrire pour rendre compte de ses exploits, vous qui avez imprimé à
la lettre de Gabinius une flétrissure aussi honteuse que nouvelle,
vous avez décerné en faveur de César des prières publiques pour plus
de jours qu'on ne l'a fait dans aucune guerre, et en des termes plus
honorables qu'on ne le fit jamais pour aucun autre général. Pourquoi
donc attendrais-je qu'on nous réconcilie ? L'ordre le plus auguste
de l'État, cet ordre, à la fois l'oracle de la sagesse publique et
la règle de toutes mes opinions, m'a réconcilié avec César. Oui,
pères conscrits, c'est votre exemple que j'imite; j'obéis à vos
conseils ; je cède à votre autorité. Tant que César a formé des
projets que vous n'approuviez pas, vous ne m'avez point vu me
concerter avec lui : depuis que ses exploits glorieux ont changé vos
idées et vos sentiments, vous m'avez vu non-seulement adopter vos
avis, mais même applaudir hautement à toutes vos décisions.
XI. En quoi donc aujourd'hui ma
conduite peut-elle vous étonner et m'attirer des reproches, lorsque
moi-même j'ai d^jà plusieurs fois appuyé des propositions qui
étaient plus honorables pour César que nécessaires pour l'État? J'ai
voté quinze jours de prières solennelles. Le nombre qui avait été
décerné pour Marius aurait suffi à la république, et les dieux se
seraient contentés des mêmes hommages qu'on leur avait adressés
après les plus mémorables victoires. Ce surcroît de jours n'a donc
eu pour objet que d'honorer César. Dix jours d'actions de grâces
furent décernés pour la première fois à Pompée, lorsque la guerre de
Mithridate eut été terminée par la mort de ce prince : j'étais
consul, et sur mon rapport le nombre d'usage pour les consulaires
fut doublé ; après que vous eûtes entendu la lettre de Pompée, et
reconnu que toutes les guerres étaient terminées sur terre et sur
mer, vous adoptâtes la proposition que je vous fis d'ordonner dix
jours de prières. Aujourd'hui j'ai admiré la magnanimité de Pompée
qui, comblé de plus d'honneurs qu'aucun de ses concitoyens, déférait
à un autre une distinction que lui-même n'avait pas reçue. Ainsi
donc ces prières, que j'ai votées avec vous en l'honneur du
vainqueur des Gaules, étaient accordées aux dieux immortels, aux
usages de nos ancêtres, aux besoins de l'État; mais les termes du
décret, cette distinction nouvelle, le nombre de jours
extraordinaires, étaient un hommage rendu à la gloire de César. On
nous a fait un rapport sur la paye de 1 armée. Non-seulement j'ai
voté pour César, mais je n'ai rien négligé pour que mon opinion fût
adoptée de tout le sénat; j'ai réfuté les objections; j'ai assisté à
la rédaction du décret. Et alors encore j'ai plus accordé à la
personne qu'à la nécessité; car je pensais que, sans qu'on lui
accordât aucun secours d'argent, le produit du butin pouvait suffire
pour entretenir l'armée et terminer la guerre; mais j'ai cru qu'Une
fallait point, par une étroite économie, affaiblir l'éclat et la
pompe de son triomphe. On a délibéré sur les dix lieutenants qu'il
demandait : plusieurs refusaient absolument; d'autres cherchaient
des exemples, ou renvoyaient à un autre temps, ou accordaient sans
aucun éloge. Mes paroles ont encore prouvé, dans cette occasion, que
je ne travaillais pas moins pour la gloire de César que pour le bien
de Rome.
XII. Quand j'ai traité ces questions,
on m'a toujours écouté en silence ; on m'interrompt à présent qu'il
s'agit de la distribution des provinces : et cependant je ne parlais
alors que dans l'intérêt d'un seul homme; en ce moment j'envisage
uniquement l'intérêt de la guerre et le bien de la patrie. Pourquoi,
en effet, César veut-il rester dans sa province, si ce n'est pour
achever son ouvrage, et le remettre parfait aux mains de la
république? Dira-t-on que les charmes du pays, la beauté des villes,
l'urbanité des peuples, l'ambition de vaincre, le désir d'étendre
nos frontières, le retiennent dans les Gaules? Mais quoi de plus
sauvage que ces régions, de plus agreste que les villes, de plus
grossier que les habitants, de plus admirable que tant de victoires,
de plus reculé que l'Océan ? Son retour dans la patrie ferait-il
quelque peine au peuple qui l'a envoyé, ou au sénat qui l'a comblé
d'honneurs? La durée de son absence irrite-t-elle le désir de le
revoir? ou plutôt une absence aussi prolongée ne peut-elle pas le
faire oublier lui-même, et faner ces lauriers, le prix de tant de
périls et d'efforts? Ceux donc qui n'aiment point César, s'abusent
dans leurs calculs : quand ils le rappellent de sa province, ils ne
font que le rappeler à la gloire, au triomphe, aux félicitations et
aux hommages du sénat, à la reconnaissance de l'ordre équestre, à
l'enthousiasme du peuple. Mais s'il ne se hâte pas de jouir d'une
fortune aussi brillante, s'il veut attendre, pour le bien de l'État,
qu'il ait accompli son ouvrage, que doifr-je faire, moi sénateur,
moi qui devrais, même en lui supposant d'autres désirs, envisager
l'utilité publique?
Je pense, pères conscrits, qu'en
assignant les provinces, nous devons avoir en vue la perpétuité de
la paix. Et n'est-il pas évident que toutes les autres parties de
l'empire sont exemptes de tout danger, et même de toute apparence de
guerre? Depuis longtemps nous voyons que cette mer immense, dont les
mouvements tumultueux avaient non-seulement interrompu les courses
de nos vaisseaux, mais arrêté toute communication entre nos villes
et nos armées ; nous voyons que cette mer, grâce à la valeur de
Pompée et des troupes romaines, depuis l'Océan jusqu'aux extrémités
du Pont, est sûre et tranquille comme un seul port au milieu de nos
possessions; que ces peuples, qui, par leur nombre et leur multitude
seule, pouvaient inonder nos provinces, ont été tellement resserrés
ou réprimés par le même général, que l'Asie, ,qui bornait autrefois
notre empire, est aujourd'hui environnée elle-même par trois
nouvelles provinces. Je le dirai sans excepter aucune contrée,
aucune espèce d'ennemis : toutes les nations, ou semblent effacées
de la liste des peuples, ou sont réduites à l'impuissance de nuire,
ou, jouissant par nous des douceurs de la paix, se félicitent de
notre victoire qui les soumet à nos lois.
XIII. César, pères conscrits, a porté
la guerre chez les Gaulois : jusqu'à lui, nous étions restés sur la
défensive. Nos généraux avaient toujours pensé qu'il suffisait de
résister aux agressions de ces peuples. Marins lui-même, Marius,
dont la valeur héroïque rendit l'espoir et la confiance au peuple
romain, abattu par la douleur, repoussa des troupes innombrables de
Gaulois qui se répandaient dans l'Italie ; mais il n'entra point
146 dans leur pays, il ne
pénétra point jusqu'à leurs villes. Dans des temps moins anciens,
les Allo-broges, soulevés par l'audacieux Catilina, commencèrent
brusquement la guerre : C. Pomtinius, qui s'associa généreusement à
mes travaux, à mes périls, à mes desseins, les défit en plusieurs
rencontres, et dompta ceux qui l'avaient attaqué ; mais content
d'avoir dissipé les craintes de la république, il ne poussa pas plus
loin sa victoire. César s'est fait un autre plan : il a cru devoir,
non-seulement combattre ceux qu'il voyait armés contre le peuple
romain, mais encore réduire la Gaule tout entière sous notre
domination. Il a remporté les plus heureuses victoires sur les
Germains et les Helvétiens, les plus redoutables de ces peuples par
leur courage et par leur nombre ; les autres ont été terrassés,
domptés, subjugués : il les a tous accoutumés à l'obéissance du
peuple romain; et ces contrées, ces nations, dont les noms même
n'étaient jamais parvenus jusqu'à nous, notre général, nos légions ,
nos armées, les ont parcourues. Oui, pères conscrits, nous ne
possédions encore qu'un sentier dans la Gaule : le reste du pays
était occupé par des nations ennemies, ou infidèles, ou inconnues,
ou du moins féroces, barbares et belliqueuses; il n'était personne
qui ne formât des vœux pour qu'elles fussent vaincues et soumises;
et, depuis que Rome existe, tous les sages politiques ont pensé
qu'elle n'avait point d'ennemis plus redoutables que les Gaulois.
Mais le nombre et la force de ces nations ne nous avaient pas permis
de les combattre toutes ; nous n'avions su encore que résister à
leurs attaques. Aujourd'hui enfin les limites de ces mêmes peuples
sont devenues les limites de notre empire.
XIV. Ce n'est pas sans un bienfait
signalé de la providence que la nature avait adossé l'Italie aux
Alpes. Si l'entrée en eût été ouverte à cette multitude de barbares,
jamais Rome n'aurait été le siège et le centre de l'empire du monde.
Qu'elles s'abaissent maintenant ces montagnes insurmontables :
depuis les Alpes jusqu'à l'Océan, il n'est plus rien qui soit à
redouter pour l'Italie. Encore une ou deux campagnes, et la crainte
ou l'espoir, les châtiments ou les récompenses, les armes ou les
lois pourront nous attacher la Gaule entière par des liens
indissolubles. Mais si l'ouvrage demeure imparfait, quelque avancé
qu'il soit, un jour ces peuples sentiront leurs forces renaître pour
renouveler la guerre. Que la Gaule soit donc sous la garde du
protecteur aux vertus et au bonheur duquel elle a été confiée. Si ce
grand général, comblé des plus brillantes faveurs de la fortune, ne
voulait plus s'exposer aux caprices de cette déesse; s'il était
impatient de revenir dans sa patrie, vers ses dieux pénates, vers
les honneurs que Rome lui prépare, vers sa fille si tendrement
chérie, vers son illustre gendre; s'il était pressé du désir de
monter au Capitale, la tête ceinte de cet immortel laurier; enfin,
s'il redoutait le hasard des événements, qui ne peuvent plus que
compromettre sa gloire sans rien ajouter à sa splendeur: ce serait
un devoir pour vous de vouloir que l'ouvrage fût conduit à sa
perfection par là même main qui l'a si bien commencé. Mais comme il
a depuis longtemps fait assez pour sa gloire, sans avoir encore
147 assez fait pour
la république, et qu'il aime mieux fouir plus tard du fruit de ses
travaux que de ne pas remplir entièrement la fonction que la patrie
lui a confiée, nous ne devons ni rappeler un gé¬néral plein d'ardeur
pour le service de l'État, ni troubler et interrompre la guerre des
Gaules au moment où elle va se terminer.
XV. Les avis des illustres préopinants
ne peuvent être adoptés : ils proposent avec la Syrie, l'un la Gaule
ultérieure, l'autre la Gaule citérieure. Le premier renverse tout le
plan que je viens de développer devant vous, et, de plus, il
sanctionne une loi qu'il refuse de reconnaître ; il détache la
partie de la province sur laquelle l'opposition ne peut rien, et il
ne touche pas à celle qui peut être défendue par un tribun ;
sénateur, il respecte le don du peuple, et s'empresse] de ravir
celui du sénat. L'autre ne perd pas de vue ce qu'exige la guerre
contre les Gaulois; il agit en digne sénateur ; mais il maintient
aussi une loi qui est nulle à ses yeux : car il fixe un jour pour le
successeur qui remplacera César. Or, rien à mon avis ne s'écarte
plus des |usages et des maximes de nos ancêtres, que de vouloir
qu'un consul qui doit jouir d'une province aux calendes de janvier,
ne semble l'avoir qu'en vertu d'une promesse éventuelle, et qu'il
passe l'année entière de son consulat sans avoir cette province,
quoiqu'elle lui ait été décernée avant qu'il ait été désigné consul.
La tirera-t-il au sort, ou non? Il est également contraire à nos
principes qu'il ne la tire pas au sort, ou qu'il n'ait pas celle que
le sort lui aura donnée. Partira-t-il de Rome en habit militaire?
pour quel endroit? Pour un pays ou il ne lui sera pas permis de se
rendre avant le jour marqué. Pendant les mois de janvier et de
février, il n'aura point de province. Enfin, tout à coup il lui en
surviendra une aux calendes de mars. Cependant, d'après tous ces
avis, Pison demeurera dans son gouvernement. Ce sont là de grands
inconvénients; mais le plus grand de tous, c'est qu'on outrage un
général en lui retranchant une partie de son gouvernement ; et l'on
doit épargner une telle injure, je ne dis pas seulement à un grand
homme, mais même à un homme ordinaire.
XVI. Je vois, pères conscrits, que
vous aves prodigué à César des honneurs éclatants et presque sans
exemple. Si vous l'avez fait en considération de ses services, c'est
un acte de reconnaissance ; et c'en est un d'une sagesse admirable,
si vous avez voulu en même temps l'attacher intimement à votre
ordre. Tous ceux que le sénat a comblés d'honneurs et de bienfaits
ont toujours préféré à toutes les autres distinctions celles qu'ils
avaient reçues de vous; et jamais on ne se fit chef du peuple quand
on put être chef du sénat. Mais souvent des hommes qui ne se fiaient
pas à leurs propres forces pour leur avancement, ou que
l'acharnement de leurs envieux avait détachés du sénat, se sont vus
contraints en quelque sorte de quitter le port pour se livrer aux
tempêtes. Si, du sein des flots et des agitations populaires, ces
hommes, après avoir bien servi la patrie, tournent leurs regards
vers le sénat, s'ils cherchent à se rendre agréables à ce corps
auguste, alors, loin de les repousser, il faut même aller au-devant
d'eux.
Le plus honnête homme, le meilleur de
tous les consuls, nous avertit de prendre garde qu'au
148 moment où nous aurons
à nommer des successeurs aux consuls qui vont être désignés, on ne
dispose malgré nous de la Gaule extérieure, et que, par des moyens
populaires et séditieux, on n'en perpétue la possession aux ennemie
du sénat Je ne méprise pas ce danger, surtout quand l'avis nous
vient d'un consul plein de sagesse, et qui veille avec tant de soin
à la paix et au repos de l'État; mais je crois qu'il faut craindre
encore plus d'outrager les citoyens illustres et puissants, et de
repousser le zèle qu'ils montrent pour cet ordre. Que César, après
avoir reçu du sénat tant d'honneurs éclatants et nouveaux,
transmette sa province malgré vous; qu'il ne laisse pas même la
liberté à un ordre qui l'a porté lui-même au comble de la gloire,
c'est un soupçon qui n'entrera jamais dans ma pensée. Enfin, je ne
puis lire au fond des cœurs; mais je vois ce que je puis espérer.
Comme sénateur, je dois faire tout ce qui est en moi pour ne pas
laisser à un citoyen illustre ou puissant le droit de s'irriter
contre le sénat. Et quand je serais le plus grand ennemi de César,
je penserais encore ainsi pour l'intérêt de la république.
XVII. Mais afin de répondre une fois
pour toutes à ceux qui me troublent par de fréquentes interruptions,
à ceux même qui me condamnent dans le secret de leurs pensées, il
n'est pas hors de propos d'entrer dans quelques détails sur mes
relations avec César. Je ne vous dirai point que mon frère, que C.
Varron, mon parent, et moi, nous avons, dès la plus tendre jeunesse,
contracté les liaisons les plus intimes avec lui : ce n'est pas sur
ces premiers temps que je dois arrêter vos regards. Depuis que je me
suis livré à l'administration publique, nous avons différé de
principes, sans que la diversité des opinions ait jamais altéré les
sentiments de l'amitié. Pendant son consulat, il a désiré que je
prisse part à quelques-unes de ses opérations. Sans les approuver,
je n'ai pas dû être insensible à cette marque de déférence. Il m'a
prié d'accepter le quinquévirat ; il a voulu que je fusse un des
trois consulaires le plus intimement liés avec lui ; il m'a proposé
une lieutenance à mon choix, avec tous les honneurs que je pourrais
désirer. J'ai refusé ces offres, non qu'elles me fussent
désagréables, mais par attachement à mes opinions. Je n'entreprends
pas ici de prouver la sagesse de ma conduite; il est bien des gens
que je ne persuaderais pas. On conviendra du moins qu'elle a été
conséquente et courageuse : je pouvais m'étayer d'un puissant appui
contre la scélératesse de mes ennemis; et, fort d'un secours
populaire, je pouvais les repousser avec leurs propres armes. J'ai
mieux aimé recevoir tous les coups de la fortune, et subir tous les
excès de la violence, que de m'écarter de vos sages principes et de
la route que je m'étais tracée. Mais on doit de la reconnaissance,
non seulement pour le bienfait qu'on a reçu, mais encore pour celui
qu'on a été maître de recevoir. Ces distinctions dont César voulait
me décorer, je ne croyais pas que la bienséance me permit de les
accepter, et qu'elles convinssent aux choses que j'avais faites;
mais je n'en sentais pas moins qua son amitié me plaçait dans son
cœur au même rang que son gendre, le premier de tous les citoyens de
Rome. Il a fait passer mon ennemi dans l'ordre plébéien : peut-être
était-il irrité de ne pouvoir, même par les bienfaits, m'attacher à
149 lui ;
peut-être a-t-il cédé aux importunités. Mais cette démarche même n'a
pas été celle d'un ennemi; car depuis cette époque il m'a conseillé,
que dis-je? il m'a prié d'être son lieutenant. Je l'ai encore
refusé, non que je crusse cet emploi au-dessous de ma dignité, mais
je ne soupçonnais pas que la république eût à redouter autant de
forfaits de la part des consuls désignés.
XVIII. Jusque-là il n'a point eu de
torts envers l'amitié; on pourrait plutôt me reprocher l'orgueil de
mes refus.
Tout à coup éclatèrent ces tempêtes
désastreuses : on vit les bons citoyens frappés d'une terreur
soudaine et imprévue ; la république, enveloppée de ténèbres; Rome,
menacée d'une destruction totale ; César, alarmé pour les actes de
son consulat ; les glaives, levés sur la tête de tous les gens de
bien; des consuls faméliques, se livrant aux excès de la
scélératesse et de l'audace. Si je n'ai pas été secouru par César,
César ne me devait rien. Si j'en ai été abandonné, peut-être
n'a-t-il songé qu'à lui. S'il s'est joint âmes oppresseurs, comme le
pensent ou le veulent quelques personnes, l'amitié a été violée,
j'ai souffert une injure, j'ai eu droit de le haïr; je ne le nie
pas. Cependant si ce même César s'est déclaré pour moi, lorsque vous
me redemandiez comme un père redemande le plus cher de ses fils ; si
vous pensiez vous-mêmes qu'il importait à ma cause que César ne me
fût pas contraire ; et si j'ai pour témoin de sa bonne volonté son
propre gendre, celui qui, dans les villes municipales, dans
l'assemblée du peuple, dans le Capitule, excitait en ma faveur
l'Italie, le peuple romain, et vous-mêmes qui toujours avez formé
pour moi les vœux les plus ardents; en un mot, si Pompée m'est
témoin de la volonté de César, comme il lui est garant de la mienne,
ne vous semble-t-il pas que le souvenir de nos anciennes liaisons,
que les preuves d'affection qu'il m'a données dans ces derniers
temps doivent effacer de mon cœur toutes les traces d'une
mésintelligence passagère? Pour moi, si Ton ne veut pas que je me
glorifie d'avoir sacrifié mes inimitiés au bien de l'État, et que je
m'honore d'un sentiment qui caractérise une âme noble et généreuse,
je dirai, non pour en faire vanité, puisque la reconnaissance n'est
qu'un devoir, je dirai que je suis sensible aux bienfaits, et qu'une
légère marque de bienveillance a des droits certains sur mon cœur.
XIX. Je parle à des hommes connus par
leur caractère, et qui m'ont rendu les plus grands services : je
n'ai pas voulu qu'ils partageassent mes travaux et mes peines ; je
leur demande qu'ils n'exigent pas que je m'associe à leurs
ressentiments, surtout après m'avoir eux-mêmes donné le droit de
soutenir les actes de César, que jusqu'à présent je n'ai jamais
attaqués ni défendus. Les premiers citoyens de Rome, ceux dont les
conseils m'ont aidé à sauver la république, et dont l'exemple m'a
empêché de me joindre à César, prétendent que les lois Julia et
toutes les autres lois de son consulat ont été portées illégalement;
et ces mêmes hommes disaient que la loi qui me proscrivait, toute
contraire qu'elle était au bien de l'État, avait été portée sans
blesser les auspices. Aussi un citoyen, également imposant par son
caractère et par son éloquence, a-t-il dit avec énergie que mon
malheur avait été une calamité publique, mais qu'enfin les formes
légales avaient été observées. 150
Il est bien honorable pour moi que mon exil ait été nommé un
désastre public ; je n'attaque point le reste de ses paroles, j'en
tire seulement une conséquence en ma faveur. En effet, s'ils ont osé
dire que ce qui n'était autorisé par aucun exemple, ni permis par
aucune loi, a été ordonné légalement, parce que personne alors
n'avait observé le ciel, ont-Ils donc oublié qu'il fut dit qu'on
observait le ciel au moment où l'auteur de cette loi atroce se
faisait recevoir plébéien dans une assemblée par curies? Or, s'il
n'a pu absolument être plébéien, comment a-t-il pu devenir tribun?
S'ils veulent légitimer son tribunal et tous ses forfaits, qu'ils
pensent que si le tribunat de Clodius est légal, il est impossible
que les actes de César ne le soient pas.
Il faut donc qu'il soit décidé par vous que la toi Élia subsiste,
que la loi Fuila n'a pas été abrogée ; qu'il n'est pas permis de
porter indistinctement une loi tous les jours qui ne sont pas
néfastes ; que lorsqu'on porte une loi, on a droit d'observer le
ciel, d'annoncer des auspices contraires, de former opposition; que
la censure, cette sévère magistrature des mœurs, n'a pas été
anéantie par des lois criminelles; que Clodius, patricien, n'a pu
être tribun sans violer les lois sacrées ; que plébéien, il n'a pu
l'être qu'en violant les auspices : ou il faut que mes adversaires
m'accordent de ne pas exiger dans des opérations utiles une
régularité de formes qu'ils n'exigent pas dans des actes funestes;
surtout quand ils ont eux-mêmes plusieurs fois proposé à César de
porter les mêmes lois d'une autre manière, protestant contre la
violation des formes, mais reconnaissant au moins la sagesse de ses
lois ; tandis que Clodius n'a pas moins violé les formes, et que ses
lois sont toutes au détriment de l'État.
XX. Je ne dis plus qu'un mot. S'il
existait quelque inimitié entre César et moi, je devrais n'envisager
en ce moment que le bien de la république, et ajourner les haines.
Je pourrais même, d'après de grands exemples, en faire le sacrifice
à la patrie. Mais comme rien n'a jamais altéré notre amitié, comme
le soupçon d'une offense a été effacé par la réalité d'un bienfait,
s'il s'agit aujourd'hui de récompenser son mérite, je serai juste
envers lui; s'il s'agit de lui accorder une faveur, je me joindrai
au sénat pour le bien de la paix; s'il faut maintenir vos décrets,
en prorogeant le commandement au même général, je tâcherai que cet
ordre ne soit pas en contradiction avec lui-même ; si l'on veut
continuer sans interruption la guerre contre les Gaulois, je
choisirai le moyen le plus utile à Rome; si enfin je dois
reconnaître quelque service personnel, je montrerai que je ne suis
pas ingrat. Je voudrais, pères conscrits, obtenir l'approbation de
tous ceux qui m'entendent : mais je me consolerai si j'ai le malheur
de déplaire, soit à ceux qui, sans égard pour votre volonté bien
connue, se sont montrés les protecteurs de mon ennemi, soit à ceux
qui blâmeront ma réconciliation avec César, quand ils n'ont pas
eux-mêmes hésité à se réconcilier avec un homme qui n'était pas
moins leur ennemi que le mien. |