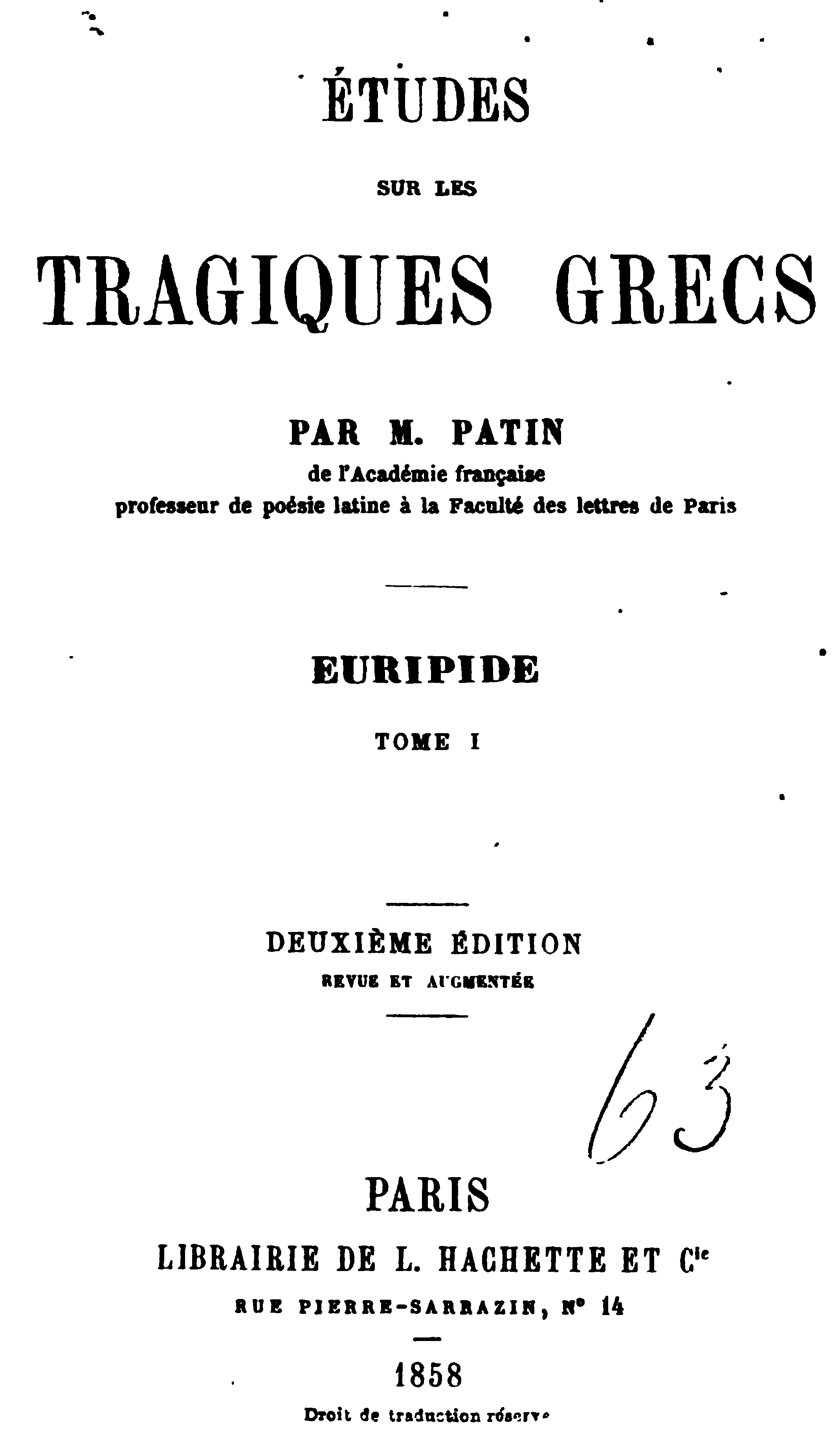
M. PATIN
ÉTUDES SUR LES TRAGIQUES GRECS
EURIPIDE. Tome I
CHAP. II. HIPPOLYTE
CHAPITRE DEUXIÈME.
Hippolyte
.
Occupé de rechercher d'abord , parmi les ouvrages d'Euripide, ceux qui nous montrent en lui le successeur de Sophocle et le précurseur de Racine , ceux qui nous permettent de saisir l'art de la tragédie dans son passage de la forme grecque à la forme française, il me paraît convenable de faire succéder ici, à l'Iphigénie en Aulide, l'Hippolyte, où se rencontre également ce double point de vue.
Ces deux pièces ont offert à l'imitation des modernes une complication d'intrigue, un développement de passion, qu'ils ont sans doute beaucoup surpassés, mais qui n'en furent pas moins, sur la scène grecque, un progrès sensible , une frappante nouveauté. En même temps, elles sont l'une et l'autre parfaitement conformes à l'esprit de la tragédie antique, telle que l'avait faite le génie d'Eschyle et de Sophocle. C'est avec moins de force et d'élévation, mais avec un ton plus doux et plus touchant, la même simplicité d'effets, la même vérité de sentiments, la même naïveté de mœurs et de langage. On y retrouve surtout, dans une proportion pareille, le concours de ces deux ressorts qui faisaient alors mouvoir le drame; les passions humaines qui l'animaient par le contraste des caractères, par l'intérêt des situations , par les émotions de la terreur et de la pitié ; la fatalité, qui ajoutait à cette variété et à ce mouvement, l'unité, la grandeur, quelque chose de religieux et de divin.
Ainsi, dans I'Iphigénie en Aulide, le combat où s'en gagent l'ambition, le fanatisme, la nature, un froid et cruel égoïsme, une héroïque générosité, ne fait qu'amener la victime, si longtemps disputée , jusque sur l'autel où l'attend la clémence des dieux. Ainsi dans l'Hippolyte, une fureur adultère et incestueuse, une pudeur virginale et une inviolable foi, une erreur involontaire, une irrésistible colère, ne sont que les instruments mortels qui travaillent de concert à la vengeance d'une divinité.
Ce mystère de la tragédie d'Hippolyte nous est expliqué dans le prologue qui la précède, espèce d'argument, dont Euripide n'a pas voulu laisser le soin à ses commentateurs.
Vénus paraît, et, après un éloge de son invincible puissance et de son universel empire, assez semblable à la fameuse invocation du poème de Lucrèce , elle annonce qu'elle veut punir Hippolyte, qui la méprise et préfère à son culte celui de Diane. Elle a, dans ce dessein, mis au cœur de Phèdre une passion criminelle pour le jeune prince, son beau-fils : ce funeste amour, longtemps renfermé, va bientôt éclater, et par un enchaînement de circonstances fatales qu'elle fera naître, amènera la perte de son ennemi. Sans doute l'innocente Phèdre sera enveloppée dans sa vengeance : mais que lui importe, pourvu qu'elle se venge?
On a blâmé, non sans raison, l'odieux aspect donné ici à la divinité. La mythologie grecque avait, il est vrai, exprimé sous une forme sensible ce penchant superstitieux qui nous fait attribuer à je ne sais quelles puissances ennemies les caprices injustes du hasard. Les poètes, qui s'étaient inspirés de ses fictions, avaient prêté au destin et à ses ministres des passions haineuses et cruelles. Mais dans ces peintures, si fausses quand on les rapproche des pures notions de la divinité, si vraies quand on les rapporte au sort de l'homme ici-bas et aux idées qu'il s'en forme dans les âges d'ignorance et de barbarie, dans ces peintures où l'erreur elle-même est une ressemblance historique, on avait presque toujours répandu à dessein une mystérieuse obscurité. L'homme y paraissait placé sous l'empire de lois irrévocables, contre lesquelles réclamait sourdement le sentiment moral, mais dont une crainte religieuse interdisait l'examen. Telle était l'impression des terribles et sombres drames de Prométhée et d'Œdipe. Quelque chose d'inexplicable, comme l'énigme de notre destinée mortelle, y commandait à la fois l'horreur et le respect. Il n'en est plus de même pour ce prologue d'Euripide, où le voile est tout à fait soulevé et découvre à la curiosité du spectateur, dans cette déesse qui déclare avec tant de franchise et de froideur le plan d'une atroce vengeance, une image trop évidemment mensongère de la divinité. Serait-il téméraire de prétendre qu'Euripide, qui, tout en usant, comme poète, des croyances de sa patrie et de son temps, ne s'interdisait pas de témoigner qu'elles répugnaient à sa raison, a voulu, lorsqu'il les a ainsi présentées aux regards dans toute leur nudité , protester indirectement contre elles?
Une telle préface peut être très philosophique , mais elle est certainement très peu conforme au génie du drame. Si Euripide se l'est permise pour quelques spectateurs de choix, peu dupes, ainsi que lui, des illusions du théâtre, et qui pouvaient à volonté les quitter et les reprendre , il a dû, pour le public, qui n'est jamais si flexible, s'attacher à détruire l'effet de sa sceptique préparation. C'est ce qu'il a fait, avec un art qui rappelle celui de Sophocle dans une tragédie que je citais tout à l'heure. Œdipe n'a point mérité ses malheurs ; mais, par les défauts de son caractère, il en est l'artisan. Hippolyte est de même pour quelque chose dans son infortune par une vertu, souvent orgueilleuse et farouche. La pitié trop douloureuse qu'exciteraient ces innocentes victimes du sort est ainsi tempérée et adoucie par les imperfections qui se mêlent à leur noble image. De plus, des larmes moins amères coulent au dénouement, lorsqu'Œdipe, incestueux et parricide, trouve dans les affections domestiques, au milieu des embrassements de ses jeunes filles, une consolation inattendue; lorsqu'Hippolyte expire entre les bras de son père, enfin désabusé, qui le pleure et le bénit. Chez Euripide, où une divinité a ouvert la scène, c'est aussi une divinité qui la ferme; mais Diane, par une pitié compatissante, une bonté secourable , par des attributs vraiment divins, nous réconcilie avec cette intervention merveilleuse que nous avions d'abord détestée. C'est comme une providence protectrice, qui vient prendre la place de l'oppressive fatalité (01).
J'ai déjà indiqué, dans des considérations générales sur le génie d'Euripide et le caractère de ses compositions (02), quel rôle nouveau il a fait jouer au destin, et quelle influence il a par là exercée sur le développement de l'art. C'est surtout à la pièce qui nous occupe en ce moment que s'applique cette observation. Jusqu'alors les événements seuls avaient été soumis à l'empire du destin ; pour la première fois nous le voyons disposer même des affections de l'âme. La fatalité est ainsi transportée du dehors au dedans ; c'est là que la trouveront, que la maintiendront les modernes, et déjà s'annonce de loin cette tragédie, où doit régner la passion, puissante comme le sort.
Faut-il, ainsi que l'a fait Brumoy, assez obscurément d'ailleurs , accuser Euripide et avec lui nos tragiques, dont la cause est pareille, d'avoir méconnu les droits de la liberté morale? il n'en est rien (03). Ce n'est point dans lasensibilité, ni même dans la raison, que réside la liberté ; nous ne sommes pas plus libres de nous soustraire aux suggestions de l'une, qu'aux avertissements de l'autre ; à la tentation du mal, qu'à la connaissance du bien ; à la passion, qu'au devoir. Entre ces deux forces, qui la sollicitent, est placée la volonté, dont les déterminations, vertueuses ou coupables, constituent également notre liberté. Phèdre, comme tous les humains, éprouve l'involontaire , l'inévitable, la fatale atteinte de la passion ; comme tous les humains aussi, elle entend involontairement, inévitablement, fatalement, la voix impérieuse du devoir. Qu'elle résiste, comme chez Euripide, à ses sens révoltés ; qu'elle fléchisse, comme chez Racine, elle est libre dans sa défaite aussi bien que dans sa victoire, par la conscience de son crime, par ses regrets, ses remords, son désespoir. C'est bien à tort que Geoffroy, après avoir, dans son commentaire, défendu Euripide de l'imputation de Brumoy, la reproduit contre Racine. Racine n'a pas fondé son drame, comme on le prétend, sur cette fausse et corruptrice doctrine, qu'il est des fautes dont notre volonté n'est point coupable et dont elle ne doit pas répondre ; ce n'est pas non plus, comme on le prétend encore, tout aussi vainement, ce qu'a voulu dire Boileau, lorsqu'il a loué la douleur vertueuse
De Phèdre malgré soi perfide, incestueuse (04).
Si Phèdre, en dépit de sa raison qui lui parle et qu'elle voudrait suivre, se laisse cependant insensiblement entraîner vers le crime, n'est-il pas permis de dire poétiquement, sans pour cela nier la liberté morale, que c'est contre son gré' qu'elle est coupable? Si elle déteste ses attentats et regrette amèrement la vertu qu'elle a quittée, ne pourra-t-on pas légitimement appeler sa douleur une douleur vertueuse? N'accusons pas si vite et si légèrement les grands poètes d'être infidèles à la vérité et à la morale. Et par où seraient-ils grands poètes, sinon par le don merveilleux de reproduire la nature humaine dans sa réalité, et de faire sortir de ces vivantes images, où se retrouvent également la science du philosophe et le sens intime du vulgaire, les graves leçons qu'elles renferment? Qu'ils nous peignent l'âme dans sa force, lorsqu'elle lutte victorieusement contre de criminelles séductions ; qu'ils nous dévoilent sa faiblesse, lorsqu'elle s'abandonne au cours irrésistible de ses penchants déréglés, et des conjonctures qui les favorisent, lorsque, complice d'une sensibilité pervertie, elle cherche elle-même à s'abuser et à se corrompre; qu'ils choisissent ainsi du noble ou du touchant, de l'admiration ou de la pitié; toujours arrivent-ils par des routes diverses à une conclusion semblable, à nous montrer, dans la sainte austérité du devoir, notre seul soutien ici-bas.
Après avoir exposé dans quel esprit différent, mais également vrai, également moral, le poète grec et le poète français ont conçu leur œuvre, je reviens au prologue de l'Hippolyte qui a été le point de départ de toute cette discussion.
Par une singularité que j'ai déjà remarquée plus d'une fois, et qui tient à la nature du théâtre antique, ce prologue , comme à peu près tous ceux du même genre, non seulement explique le sujet de la pièce, mais encore en annonce le dénouement. Un savant éditeur d'Euripide, Barnès, dit fort singulièrement à cette occasion que par là est excitée chez les auditeurs, une grande attente de ce qui doit arriver (05). C'est, je pense, le contraire. Il est visible que prévenir ainsi les événements, c'est désintéresser, à moitié du moins, la curiosité. Je dis à moitié , parce que le plaisir de la surprise ne manquait pas tout à lit à ces drames, comme l'a fait voir en particulier de celui-ci un judicieux critique (06), dont je ne puis mieux faire que de rappeler les paroles. « Vénus, dit-il, expose les causes premières, non les secondes, ou, si elle expose celles-ci, elle n'indique point la manière ni les moyens, deux choses qui suffisent pour opérer la surprise.... Il faut de plus distinguer entre la surprise des personnages qui agissent sur le théâtre, et celle des spectateurs. Ceux-ci ne sont pas tant faits pour être surpris, puisqu'ils ne le sont plus à la seconde représentation, que pour jouir de la surprise des acteurs. Hippolyte ne sait point que les portes de la mort s'ouvrent en ce moment pour lui ; le spectateur, qui le sait, le voit s'avancer le bandeau sur les yeux, le suit en frissonnant, et, quoique prévenu, il n'en sentira pas moins le contrecoup de la catastrophe. Il en est de même des surprises de Phèdre et de Thésée. » A ces raisons finement déduites j'ajouterai, ce que j'ai dû souvent répéter, que les Grecs cherchaient moins au théâtre ce plaisir inquiet de surprise directe ou réfléchie qui nous y attire, que la contemplation plus calme des situations et des caractères.
L'Hippolyte eût pu se passer de son prologue, et si, comme l'Iphigénie en Aulide, il l'eût perdu, soit par la correction d'un éditeur (07), soit par les ravages du temps, on ne se serait probablement pas aperçu de la mutilation. La pièce s'expose fort bien, sans ce secours ; la rivalité des deux déesses, qui se disputent la destinée du héros, y est d'abord rendue sensible au spectateur, et par la décoration même qui lui montre sous le péristyle du palais de Thésée les statues de Vénus et de Diane, et par la conduite d'Hippolyte, qui, arrivant de la chasse avec ses amis, passe dédaigneusement devant l'une, et offre à l'autre de tendres et respectueux hommages (08).
Ce rôle d'Hippolyte, avec sa fierté sauvage et pudique, est difficile à comprendre pour les modernes ; aussi les critiques l'ont-ils défiguré comme à plaisir. Brumoy (09) le représente comme un philosophe qui disserte et moralise ; La Harpe (10), comme une sorte d'Arnolphe et de Sganarelle, bourru et atrabilaire, toujours en garde contre les ruses du sexe : pour Geoffroy (11) c'est un gentilhomme campagnard, comme ceux d'Angleterre, qui s'en vient, au retour de la chasse, dîner avec quelques voisins. Ce sont là des caricatures grossières qui nous reportent bien loin du génie des Grecs. W. Schlegel (12) s'en est tenu plus près, dans ce passage, où, à l'exemple de 'Winckelmann, il explique et traduit l'une par l'autre la poésie et la statuaire antiques.
« Pour sentir dignement l'Hippolyte d'Euripide, il faut, dit-il, pour ainsi dire, être initié dans les mystères de la beauté, avoir respiré l'air de la Grèce. Rappelez-vous ce que l'antiquité nous a transmis de plus accompli parmi les images d'une jeunesse héroïque, les Dioscures de Monte-Cavallo, le Méléagre et l'Apollon du Vatican. Le caractère d'Hippolyte occupe dans la poésie à peu près la même place que ces statues dans la sculpture.... On peut remarquer, ajoute-t-il ingénieusement, dans plusieurs beautés idéales de l'antique, que les anciens, voulant créer une image perfectionnée de la nature humaine, ont fondu des nuances du caractère d'un sexe avec celui de l'autre ; que Junon, Pallas, Diane ont une majesté, une sévérité mâle; qu'Apollon, Mercure, Bacchus, au contraire, ont quelque chose de la grâce et de la douceur des femmes. De même, nous voyons, dans la beauté héroïque et vierge d'Hippolyte, l'image de sa mère l'Amazone, et le reflet de Diane dans un mortel (13). »
Qu'on se représente sous ces nobles traits, si bien décrits par le critique allemand, le personnage auquel Euripide a voulu surtout concilier l'intérêt et l'amour du spectateur ; et l'on comprendra mieux l'effet de cette première scène, où il paraît au milieu de ses nombreux compagnons, jouissant, dans une liberté sauvage, de sa jeunesse et de sa vigueur, et montrant une sécurité confiante qui contraste avec la destinée funeste dont nous le savons menacé.
Le commerce mystérieux qui l'unit à Diane est exprimé par des vers pleins de grâce. Il offre à la déesse une couronne (14) tressée par lui-même dans une prairie, que jamais le tranchant du fer et le pied des troupeaux n'ont osé violer, où l'abeille seule voltige, et dont l'enceinte sacrée, séjour de la pudeur, ne reçoit que les amis d'une vie innocente et pure (15). Cette offrande religieuse, ces chants d'allégresse qui la précèdent et qui la suivent, cet appareil de la chasse dont Hippolyte est environné, tout cela forme une ouverture animée et brillante, tout à fait dans le goût des Grecs, qui cherchaient dès le début à s'emparer de l'imagination, à frapper les sens en même temps que l'esprit.
Au moment où Hippolyte s'apprête à rentrer dans le palais, un de ses serviteurs, un vieillard, à ce que peuvent faire juger son ton paternel et sa familiarité, l'engage à honorer, avec la statue de Diane, celle de Vénus. Hippolyte sort, en rejetant ce conseil, et le vieil esclave, resté seul, conjure la déesse d'oublier les téméraires paroles qu'elle vient d'en tendre. Cette scène (16) nous explique comment, dans les idées des anciens, une confiance orgueilleuse en ses propres forces, et le mépris des mœurs ordinaires et communes, pouvaient paraître une faute digne du courroux des dieux ; en même temps elle prépare la catastrophe, et eût suffi, par la clarté qu'elle jette sur l'action, pour dispenser Euripide de son prologue.
Arrive le chœur, composé de femmes de Trézène, ville où, comme l'on sait, dans le grec et dans le français, est placée la scène de la tragédie. Ces femmes s'entretiennent (17) de la langueur secrète qui depuis quelque temps consume la reine, et dont on ignore la cause. Leurs chants offrent un mélange singulier de poésie hardie et d'images familières. Où ont-elles appris l'étrange nouvelle qui les préoccupe et dont elles viennent s'enquérir ? il faut bien l'avouer : c'est à la fontaine où elles puisent l'eau et lavent le linge, selon l'usage général au temps de Nausicaa, et à plus forte raison, au temps de Phèdre. Brumoy, qui, tout à l'heure, appelait le vieux conseiller d'Hippolyte, non pas, selon sa condition, un serviteur, un esclave, mais, magnifiquement, un officier, se montre quelque peu scandalisé de ces mœurs, et n'ose prétendre qu'elles soient aussi bonnes que les nôtres, poétiquement sans doute. Ce scrupule est bien du temps où La Motte regrettait qu'Homère eût dégradé son Achille en lui faisant de ses propres mains apprêter son repas, et ne lui eût pas donné, pour soutenir son rang de héros, un maître d'hôtel, ou, tout au moins, un cuisinier.
Pour comprendre l'effet de la scène suivante, et même de la plupart des autres, il faut se représenter le chœur, à la place qui lui était assignée dans l'ordonnance du théâtre grec, groupé sur les marches qui, du proscénium, communiquaient à l'orchestre. De ce lieu, où il observe attentivement, il voit paraître, sous le péristyle du palais, Phèdre accompagnée d'une femme que Brumoy, dans sa rage de tout ennoblir, appelle la confidente de la reine, mais qui est simplement sa nourrice. Phèdre reste près de la porte, étendue sur un lit que ses esclaves y ont dressé, et où elle a voulu, dans sa souffrance, dans l'inconstance de ses désirs, venir respirer l'air et voir le jour. Sa nourrice veille auprès d'elle, et lui parle ; mais quelquefois aussi elle s'en écarte, pour consulter avec elle-même sur sa situation et celle de sa maîtresse, ou pour répondre aux questions du chœur qui l'interroge avec curiosité. Cette disposition devait, je m'imagine, ajouter à l'effet d'une scène, d'ailleurs si frappante par la marche du dialogue, la vérité des sentiments, l'éloquence de la passion, et dont le sujet était entièrement nouveau sur le théâtre.
Pour la première fois on y entendait le langage de l'amour, que n'avaient jamais parlé ni la muse d'Eschyle ni même celle de Sophocle. Car, on l'a vu (18), si cette passion a part au dénouement de l'Antigone, elle n'est pour rien dans la pièce, ou du moins ne s'y produit point ; et quant à la jalousie, d'ailleurs si bien peinte, de Déjanire (19), c'est plutôt celle d'une épouse qui sent sa dignité et ses droits offensés par un odieux partage, que celle d'une amante. Pourquoi les tragiques grecs avaient-ils jusque-là banni de leurs compositions une passion qui, au contraire, a régné presque seule dans les nôtres ? Ce qu'on a dit là-dessus de plus raisonnable et de plus plausible (20), c'est que, dans les mœurs et d'après la constitution de la société antique, l'amour tenant moins à l'âme qu'aux sens et n'étant pas encore épuré par l'alliance de sentiments plus nobles, n'eût pas été digne d'un art qui se proposait surtout d'exprimer et de faire ressortir, dans ses peintures, la dignité morale. Pour s'élever à la tragédie, il fallait que, causé par une irrésistible fatalité, troublant le cours ordinaire des choses, luttant contre les obstacles de la nature et de la loi, entraînant à sa suite les conséquences les plus funestes, il présentât les caractères touchants et terribles que réunit précisément la passion adultère, incestueuse, homicide, envoyée à Phèdre par la colère de Vénus.
Est-il besoin de reproduire ici cette scène mémorable (21); et cet abattement du corps, ce délire des sens, ce trouble de l'âme, qui trahissent la lutte douloureuse où Phèdre se consume ; et cet aveu pénible, si ardemment sollicité, si difficilement obtenu, que l'infortunée refuse, diffère, prépare, qu'elle s'efforce de faire sortir de la bouche même qui l'interroge, afin de n'en pas souiller ses lèvres? Ne suffit-il pas de renvoyer à la plus fidèle des analyses, au plus éloquent des commentaires, à cette scène profondément gravée dans toutes les mémoires (22), où notre Racine, avec une précision élégante et une rapidité de mouvement qui appartenaient à la nature de son génie et aux habitudes de notre théâtre, a rendu si vivement la poésie d'Euripide, encore animée par un heureux mélange de Sapho, de Théocrite, de Catulle, de Virgile?
A la révélation inattendue que leur fait entendre Phèdre, la nourrice et le chœur éclatent en témoignages d'horreur et de pitié. La reine leur déclare que puisqu'elle a vainement combattu sa passion, elle veut mourir, pour s'y soustraire, et sauver son honneur avec celui de ses enfants. Alors, effrayée de sa résolution, la nourrice, changeant de langage, lui donne de coupables conseils que condamne sévèrement le chœur, à qui les traditions du théâtre commandaient d'être plus fidèle à la vertu.
On a blâmé ces conseils de la nourrice. Le vif attachement qu'elle a jusqu'ici témoigné pour celle qu'elle a nourrie, dont elle préfère à tout la conservation, les rendent vraisemblables, malgré leur perversité; s'ils paraissent arriver un peu brusquement après son premier emportement contre un penchant criminel, il faut songer pourtant qu'ils en sont séparés par un assez long silence pendant lequel elle se consulte et se décide. Quelques critiques (23) ont même pensé, quoiqu'à mon avis sans raison, qu'elle quitte un moment la scène et y rentre résolue à encourager Phèdre dans sa passion. On ne peut nier, du reste, que chez Racine, ces conseils, ou d'autres semblables, qu'à l'exemple d'Euripide il met dans la bouche d'Œnone, n'y soient mieux préparés par des circonstances qui l'enhardissent et peuvent l'excuser, par la fausse nouvelle de la mort de Thésée, celle de son retour, et, plus tard, par la fureur jalouse et le désespoir violent auxquels s'abandonne sa maîtresse, et dont elle veut la sauver (24).
La Phèdre d'Euripide persiste dans sa résistance, et la nourrice, qui désespère de la vaincre, se résout à se passer de son consentement et à la servir malgré elle. Elle lui propose, selon les superstitions de l'antiquité, d'essayer d'un philtre pour la guérir ; et, sur ce prétexte, elle s'éloigne malgré les instances de l'infortunée, qui la soupçonne avec raison de vouloir révéler son amour à Hippolyte, et qui décèle, par ce soupçon timidement exprimé, le désir caché de son cœur, peut-être une secrète connivence : trait de vérité tout à fait admirable, et qu'il me semble qu'on n'a pas encore remarqué (25).
Quelques moments après, Phèdre, qui est restée au fond du théâtre, sur son lit de douleur, dans un mortel accablement et un profond silence, interrompt tout à coup avec effroi les chants où le chœur célèbre la funeste puissance de l'amour. Elle a entendu retentir dans le palais la voix suppliante de sa nourrice et la voix irritée d'Hippolyte ; elle se voit déshonorée, perdue, sans autre ressource qu'un prompt trépas. Bientôt paraît Hippolyte, et la malheureuse, à qui il ne daigne pas parler, est condamnée à écouter ses discours insultants pour elle et pour son sexe. Enfin, il sort de cette demeure qui lui semble souillée, pour n'y reparaître qu'avec son père, dont il déplore la honte, et à qui il la révélerait, si un serment obtenu par surprise n'enchaînait sa langue (26). Phèdre n'hésite plus ; cette femme, naguère souffrante et abattue, étonne par la promptitude de sa résolution et l'énergie de son désespoir : elle chasse avec indignation sa nourrice, cause de sa perte ; elle annonce qu'elle pourvoira elle-même à son sort, qu'elle a trouvé le moyen de sauver sa gloire et l'honneur de ses enfants. Ce moyen terrible, le spectateur le devine ; Phèdre, vertueuse en dépit de ses sens révoltés, et malgré les dieux, Phèdre, jusque-là si digne d'estime et de pitié, deviendrait pour lui un objet d'horreur, si le mouvement impétueux et désespéré qui la pousse au crime, si l'abandon qu'elle fait de sa propre vie n'affaiblissaient ce sentiment. Toutefois le poète se hâte de la faire disparaître, et, par une disposition dont l'artifice paraît singulièrement ingénieux dans un plan si simple, l'intérêt qui s'éloigne d'elle se porte tout entier sur sa victime.
Un grand bruit se fait entendre dans l'intérieur du palais. La reine vient d'être trouvée suspendue de ses propres mains à un nœud fatal. Ce ne sont que voix confuses qui appellent, se répondent, et demandent du secours. Les femmes dont se compose le chœur, tout émues, tout accablées, hésitent si elles entreront (27), jeu de théâtre naïf, renouvelé d'une scène de l'Agamemnon d'Eschyle (28). Tout à coup, un esclave ordonne d'étendre et de voiler, le corps de Phèdre, et on apprend ainsi qu'elle vient d'expirer. C'est au milieu de cette agitation et de cette terreur que le poète amène Thésée. Il revient d'un voyage saint, entrepris pour aller consulter un oracle. Il a, comme c'était l'usage en pareille occasion, la tête couronnée de feuillage. Cet air de fête, cette sécurité devaient former, avec le tumulte et la consternation répandus sur la scène, un contraste frappant.
Thésée s'étonne, et s'informe avec anxiété, il parcourt rapidement par la pensée les divers malheurs dont il a pu être frappé, avant d'arriver au véritable que le chœur lui révèle enfin : marche ingénieuse et tout ensemble pleine de vérité. A son ordre, le palais s'ouvre et laisse voir le corps inanimé de Phèdre. Il jette loin de lui sa couronne, il s'abandonne aux mouvements d'une douleur pour laquelle le génie pathétique d'Euripide a su trouver les expressions les plus vives et les plus pénétrantes ; enfin, dans les mains de son épouse, glacées et roidies par la mort, il aperçoit des tablettes. Il s'en empare, et, supposant qu'elles contiennent la prière de rester fidèle à son hymen, de ne point donner une marâtre à ses enfants, il sanctionne d'avance les dernières volontés d'une épouse et d'une mère avec une sollicitude bien touchante, au moment même où cette femme si chérie et si regrettée va l'abuser par une atroce calomnie (29).
Quand on envisage dans leur ensemble les compositions des Grecs, on est frappé de leur excessive simplicité ; quand on entre dans le détail, on y admire une merveilleuse richesse d'invention. La tragédie que nous analysons n'a que quelques scènes ; mais dans ces scènes, quelle variété de situations et de sentiments !
Les tablettes que Thésée a saisies et qu'il s'empresse de lire, accusent Hippolyte d'avoir attenté au lit paternel. A cette affreuse accusation, que confirme comme un témoignage irrécusable la mort de l'accusatrice, le malheureux père, cédant à son indignation, réclame, comme dans notre tragédie, l'effet des promesses de Neptune, et dévoue son fils à ses coups.
Le chœur est présent à cette imprécation, dont les suites, dans la religion des anciens, étaient inévitables. Il cherche à fléchir Thésée ; mais il ne le détrompe point, engagé qu'il est par son serment (30). Une fidélité si funeste à l'innocence n'est pas moins surprenante que ne l'était plus haut la confiance de Phèdre. Sans reproduire ici les raisons ingénieuses, mais subtiles, qu'on en a données, il suffit, je pense, d'indiquer la véritable. Ce n'est autre chose que le caractère fictif attribué au chœur, souvent en dépit de la vraisemblance, mais qui était une indispensable condition de sa présence continuelle sur la scène. Il fallait ou renoncer à la plupart des sujets qui demandaient quelque mystère, ou conserver à cet inévitable témoin de l'action une discrétion conventionnelle, justifiée par les traditions de la scène, et qu'Horace a érigée en loi de l'art dramatique (31).
C'est une belle situation que celle qui met en présence, devant le cadavre de Phèdre, Thésée et Hippolyte (32). Elle se retrouve dans Racine (33), mais peut-être moins vive et moins frappante. Ici, le jeune prince n'a pas encore revu son père ; c'est au moment même où pour la première fois il accourt dans ses bras, que tombe sur lui, comme un coup de foudre, l'éclat de sa colère. Quelle attente cette terrible entrevue, si bien préparée, si bien amenée, entourée d'un appareil si funèbre, ne devait-elle pas exciter ?
Il serait long de comparer en détail la scène grecque et la scène française. Ce parallèle, d'ailleurs, nous amènerait toujours à reconnaître, comme nous l'avons fait souvent, le génie divers des deux poètes, et surtout des deux théâtres ; chez l'un et chez l'autre, sans doute, une égale vérité, une égale éloquence ; mais là plus de développement, et même de lenteur ; ici plus de rapidité et de mouvement ; là un chagrin plus contenu ; ici une colère plus véhémente.
Thésée, dans notre tragédie, débute arec violence, avec emportement ; il s'étonne que son fils ait osé paraître à ses yeux ; il menace de l'immoler de sa propre main, il l'exile, il le dévoue à l'infaillible vengeance qu'il attend de Neptune.
Dans la tragédie grecque, au contraire, il prolonge par d'obscures et menaçantes insinuations l'attente et l'inquiétude d'Hippolyte, il le raille avec une ironie amère sur sa fausse vertu, il lui reproche complaisamment son crime ; avant de prononcer l'arrêt de son bannissement, il réfute d'avance les raisons qu'il pourra produire pour sa défense.
Cette réfutation anticipée, qui se rencontre chez les deux poètes, et est bien dans la nature, a peut-être été mieux placée par Racine, après une première justification d'Hippolyte que, dans son impatiente fureur, Thésée se hâte d'interrompre.
Si de cette partie de la scène, remplie par la colère de Thésée, nous passons à la suivante, où se développe l'apologie d'Hippolyte, nous y serons frappés de la même diversité.
L'Hippolyte grec, qui a obtenu une plus facile audience du courroux plus calme de son père, en abuse peut-être un peu par des préparations étudiées, par des raisonnements déclamatoires, que l'Hippolyte français s'interdit judicieusement. Du reste, c'est, des deux parts, à peu près le même fonds d'idées : horreur du crime qu'on leur impute, appel à leur vertu connue, serments solennels, refus de déclarer l'affreuse vérité, ici par respect pour la sainteté du serment, là par un égard plus noble pour l'honneur paternel. En général, notre Hippolyte, dans son langage modeste, soumis, respectueux, montre une délicatesse plus raffinée que l'Hippolyte ancien, qui a la franchise et la rudesse d'une nature moins polie. Si ce contraste donne d'abord la supériorité à Racine, Euripide la reprend aussitôt que la froide mention d'Aricie est venue tout glacer sur notre scène par l'importun voisinage d'un intérêt subalterne. L'Hippolyte de Racine, qui s'entend reprocher, avec quelque vraisemblance, une excuse mensongère; qui, honteusement chassé, se retire presque sans répondre, avec une douleur et un respect trop tranquilles, devant les menaces de son père, ne se soutient plus à côté de cet autre Hippolyte qui mêle à ses vives protestations, à ses pathétiques regrets, les éclats d'une fierté blessée ; qui repousse du geste et de la voix l'audace des esclaves prêts à l'entraîner sur l'ordre de Thésée ; qui ne quitte la scène que le dernier, après une solennelle proclamation de son innocence, après de touchants adieux à sa terre natale, environné de ses amis qui le suivent en foule, et protestent par leur douleur en faveur de sa vertu opprimée ; qui se donne ainsi, sur son imitateur et son rival, un avantage que nous cédons rarement aux anciens, celui d'une sortie plus théâtrale.
Nous avons eu plus d'une occasion de remarquer que, si réguliers que soient les Grecs dans leurs compositions dramatiques, ils n'y calculent cependant pas la durée du temps avec une aussi rigoureuse exactitude qu'on le croit communément. Un intermède lyrique assez court, où est poétiquement célébré le sort funeste d'Hippolyte, sépare seul son départ de l'annonce de sa mort (34).
Notre tragédie ne diffère nulle part autant de la tragédie antique, que dans ces récits, où, sur les deux théâtres, s'explique presque toujours le dénouement.
Les Grecs, qui visent surtout à la vérité, ne manquent jamais d'y introduire quelque circonstance naïve où se peint la condition le plus souvent subalterne du narrateur, et la manière particulière dont ce qu'il raconte l'affecte. En outre, ils prodiguent complaisamment les détails, et se piquent avant toute chose d'être historiens fidèles. Le soin de l'effet ne vient qu'ensuite, et, s'il y a lieu, selon la nature de l'événement et l'émotion du témoin, la relation, généralement familière et simple, s'élève parfois à l'éloquence et à la poésie, unissant ainsi, ce que réclame l'illusion dramatique, le réel à l'idéal.
Il n'en est pas tout à fait de même chez nous. Cette vérité, qui se rapporte à la personne du narrateur, manque le plus souvent à nos récits. Les confidents que nous chargeons presque exclusivement de cet emploi, ont une existence trop peu individuelle, un caractère trop peu personnel, pour se montrer le moins du monde dans ce qu'ils disent. Quant à la vérité des détails, elle n'est jamais notre objet principal, et l'effet poétique est ce que nous recherchons d'abord.
De là il résulte que les récits sont, sur notre théâtre, des morceaux d'apparat qui appartiennent moins à la pièce qu'au poète ; qui s'en laissent volontiers détacher pour passer dans des recueils où se font admirer leur richesse et leur élégance ; bien différents en cela des récits grecs qui ne paraissent jamais mieux qu'à leur place, et qui perdent beaucoup à en être distraits.
Cette différence est sensible dans les deux récits dont la mort d'Hippolyte a fourni le sujet à Euripide (35) et à Racine (36).
Chez le premier, le narrateur, dont Brumoy a fait encore un officier, est un des esclaves, et même des derniers esclaves du héros (37). Il nous apprend, familièrement, qu'au moment du départ, il était sur le bord de la mer, occupé à panser ses chevaux. La condition de ce personnage se montre partout, dans ce qu'il retrace, par des détails relatifs à son service, qu'il a soin de ne pas omettre, et que tout autre passerait sous silence. Il dit comment Hippolyte s'est placé sur son char, comment il a pris les rênes et comment il tenait le fouet ; il entre dans beaucoup de détails sur ses efforts pour arrêter ses coursiers et prévenir sa chute. Les rapports qui l'unissent à Hippolyte sont marqués d'une manière touchante par l'expression de son attachement, de son dévouement empressé, par son attention à faire ressortir tout ce qui le rend plus intéressant, tout ce qui peut établir son innocence, dont il ne doute pas, et à laquelle il rend, en face de Thésée, ce naïf témoignage :
« Ô roi, je ne sais, il est vrai, qu'un des serviteurs de votre maison ; mais vous ne me persuaderez jamais que votre fils était un méchant. Non, quand toutes les femmes se pendraient pour l'accuser quand tous les arbres du mont Ida se changeraient en autant de tablettes qui déposeraient contre lui, je resterais convaincu de son innocence (38). »
Ce n'est pas tout ; ce narrateur, qui ne veut pas se faire admirer, mais qui tient beaucoup plus à retracer les choses comme elles se sont passées, entre par esprit de fidélité dans un grand nombre de circonstances minutieusement descriptives.
Cela n'empêche pas que, dans la peinture d'un événement si étrange et si douloureux, ce pauvre homme, soulevé par son émotion, n'atteigne aussi, comme je le disais tout à l'heure, à la poésie et à l'éloquence.
N'est-il pas visible que le récit de Théramène, composé à l'imitation de ce morceau, l'a été dans un esprit bien différent ? Il ne convient pas plus à Théramène qu'à tout autre narrateur, et ces circonstances techniques et locales, dont nous parlions, en ont toutes disparu, pour faire place à des détails plus généraux et plus nobles. C'est un morceau d'une admirable poésie, mais dont toutefois l'on a discuté et l'on discutera souvent encore la convenance dramatique (39).
J'abrège ces développements, qu'achève et que complète la mémoire de mes lecteurs, et je me hâte d'arriver au terme de cette analyse. La tragédie, finie pour Racine, ne l'est pas encore pour Euripide. Après avoir offert au spectateur le triste spectacle de l'innocence opprimée par le sort, il veut, comme nous l'avons annoncé, lui ménager une compensation morale. Il ramène donc sur la scène Hippolyte expirant pour le réconcilier avec son père enfin désabusé. Euripide a-t-il eu raison de finir ainsi sa tragédie? on ne le penserait pas, si l'on s'en rapportait à cette critique de Louis Racine (40) :
« .... Je trouve que Thésée est assez malheureux, pour ne pas le rendre encore témoin des regrets et des derniers soupirs de son fils, et que ce corps sanglant ne doit point être présenté aux yeux du spectateur, déjà assez attendri par le récit des maux qu'Hippolyte a soufferts ; »
à ce décret littéraire, où La Harpe (41) la répète en ces termes :
« On apporte sur la scène Hippolyte expirant, qui, pour achever de rendre son père plus odieux, lui pardonne sa mort ; c'est allonger inutilement la pièce, pour offrir une faute de plus. »
On jugeras! L. Racine et La Harpe ont bien saisi l'esprit de cette scène (42), par la traduction (43) à peu près littérale que j'en vais donner.
Diane, qui est venue reprocher à Thésée son aveugle colère et son empressement cruel, qui lui a révélé l'innocence de son fils, après quelques consolations accordées à ce malheureux père, s'adresse en ces termes à Hippolyte, apporté mourant sur la scène par ses esclaves :
Infortuné ! dans quelle calamité fatale as-tu été enveloppé! La noblesse de ton âme t'a perdu.
HIPPOLYTE.
Ô souffle divin ! quoiqu'en proie aux douleurs, je t'ai senti et je suis soulagé. Sachez tous qu'en ce lieu est la déesse Diane (44).
DIANE.
Elle-même, infortuné, ta divinité chérie.
HIPPOLYTE.
Vois-tu, ma souveraine, l'état déplorable où je suis?
DIANE.
Je le vois ; mais les larmes sont interdites à mes yeux.
HIPPOLYTE.
Tu n'as plus ton chasseur, ton serviteur fidèle....
DIANE.
Hélas! non ; tu péris, toi qui m'étais si cher.
HIPPOLYTE.
Ni le conducteur de tes coursiers, ni le gardien de tes images.
DIANE.
La perfide Vénus a ourdi cette trame.
HIPPOLYTE.
Malheureux ! je reconnais enfin la déesse qui m'opprime.
DIANE.
Elle était blessée de tes dédains ; elle haïssait ta sagesse.
HIPPOLYTE.
C'est elle seule, je le comprends, qui nous perd tous les trois.
DIANE.
Vous tous ; toi, ton père, son épouse.
HIPPOLYTE.
Ah! je gémis aussi sur l'infortune de mon père.
DIANE.
Il fut trompé par les desseins d'une divinité.
HIPPOLYTE.
Que tu es malheureux de cet événement, ô mon père !
Cette touchante apostrophe arrache Thésée au mortel accablement où l'a plongé la vue des maux d'Hippolyte et la révélation de son innocence. Il s'écrie douloureusement :
C'en est fait de moi, mon enfant. La vie ne m'est plus rien.
HIPPOLYTE.
C'est toi que je pleure, mon père, bien plus que moi; c'est ta funeste erreur.
THÉSÉE.
Que ne puis-je mourir à ta place, mon enfant I
HIPPOLYTE.
Ô dons amers de ton père Neptune !
THÉSÉE.
Ma bouche eût-elle dû jamais les réclamer?
HIPPOLYTE.
Que veux-tu? peut-être m'aurais-tu tué de ta main, dans ton courroux.
THÉSÉE.
Oui, les dieux avaient égaré ma raison.
HIPPOLYTE,
Hélas ! la race humaine est donc sous la malédiction des dieux (45).
Ici Diane reprend la parole, pour arrêter cet involontaire emportement du pieux Hippolyte. Remarquons, en passant, avec quel art ingénieux elle est ramenée dans le dialogue, comme tout à l'heure Thésée. Elle s'engage à le venger (46) sur un mortel favori de Vénus ; elle lui annonce les honneurs, qui, dans cette Trézène où il expire, consacreront sa mémoire. Le culte promis à Hippolyte par la déesse n'était point une invention du poète ; il se pratiquait à Trézène, et Pausanias en a parlé (47). Les Grecs, qui empruntaient leurs tragédies aux traditions fabuleuses de leur histoire, y introduisaient volontiers ces origines de coutumes locales. On comprend tout ce qu'un tel mélange de fictions et de réalités ajoutait de vraisemblance à leurs compositions.
Les paroles par lesquelles Diane console les derniers instants d'Hippolyte sont, dans le grec, d'une grâce et d'une harmonie ravissantes ; on croit véritablement y entendre le céleste accent d'une divinité :
Dans les siècles à venir, les jeunes vierges, avant leurs noces, couperont leur chevelure en ton honneur, et t'offriront le tribut de leur deuil et de leurs larmes. Tu seras l'éternel sujet de leurs plaintives chansons, et jamais l'amour que te porta Phèdre lie tombera dans le silence et dans l'oubli. Mais toi, fils du vieil Égée, prends ton enfant dans tes bras, et presse-le contre ton cœur. Ce n'est point ta volonté qui l'a perdu ; les hommes sont excusables de se laisser prendre à l'erreur que leur envoient les dieux. Pour toi, Hippolyte, je t'exhorte à ne point haïr ton père; car c'est ta destinée qui seule te fait périr. Adieu, reçois mon dernier salut. Il ne m'est point permis de voir les morts, ni de souiller mon regard par de funèbres exhalaisons (48), et déjà je te vois approcher du moment fatal (49) .
Cet adieu de la déesse est motivé par la même raison qui, dans l'Iliade (50), fait abandonner Hector par Apollon, quand la destinée l'a condamné, et qu'il va périr; qui, dans l'Énéide (51) ne permet pas à Junon d'assister à la lutte dernière, aux derniers moments de Turnus.
HIPPOLYTE.
Salut aussi à toi, vierge bienheureuse, et puisses-tu quitter sans trop de peine notre longue intimité. Je fais ma paix avec mon père; tu le veux, et j'ai toujours obéi à tes paroles. Mais, hélas! les ténèbres se répandent sur mes yeux. Prends-moi dans tes bras , mon père , et soutiens mes membres brisés.
THÉSÉE.
Ab. ! mon enfant ! que décides-tu de moi ?
HIPPOLYTE.
Malheureux ! déjà je vois les portes de l'enfer.
THÉSÉE.
Me laisseras-tu ainsi, l'âme souillée d'un crime?
HIPPOLYTE.
Non, non ; je t'acquitte de ce meurtre.
THÉSÉE.
Que dis- tu? Quoi! tu me décharges du sang versé!
HIPPOLYTE.
J'en atteste Diane, et son arc invincible.
THÉSÉE.
Enfant chéri ! Que tu te montres généreux envers ton père !
HIPPOLYTE.
Adieu, mon père ; mille fois, adieu !
THÉSÉE.
Oh ! que ton âme est bonne et pieuse !
H1PPOLYTΕ.
Demande aux dieux des fils qui me ressemblent.
THÉSÉE.
Ne m'abandonne point encore; fais quelque effort, mon enfant.
HIPPOLYTΕ.
Tous mes efforts sont vains ; je me meurs, ô mon père. Hâte-toi de voiler mon visage.
THÉSÉE.
Terre célèbre de l'Attique, royaume de Pallas, de quel homme vous allez être privés ! Malheureux ! que de fois je me souviendrai de tes coups, ô Cypris (52).
C'est par cette scène d'un pathétique admirable, que s'achève la pièce d'Euripide. Ainsi, dans la tragédie grecque, à l'horreur des catastrophes se mêlaient des émotions attendrissantes ; ainsi la Melpomène antique guérissait elle-même les blessures qu'avait faites son poignard. Si notre sensibilité s'est d'abord révoltée contre ces dures lois du sort, qui accablent et écrasent l'innocence, elle s'apaise par degrés à la vue de ce père qui s'accuse et demande grâce ; de ce fils qui s'oublie lui-même pour pleurer sur son oppresseur et pour lui pardonner; de cette divinité amie, qui préside à leur réconciliation. Sous quel noble et divin aspect le poète nous montre Diane ! Quelle tendre pitié, et, en même temps, quelle sérénité céleste ! Quel charme consolant dans ses paroles, qui calment les douleurs de l'âme, de même que sa seule présence soulage les souffrances du corps et suspend l'approche du trépas ! Ce n'est point là une de ces froides idoles qu'Euripide fit trop souvent descendre du ciel de son théâtre, et que séparait uniquement de la terre la science du machiniste. On y reconnaît d'abord une immortelle, une habitante de l'Olympe, et le spectateur s'écrierait volontiers comme Hippolyte : « O souffle divin ! » La divine inspiration de Sophocle anime encore la scène grecque.
Telle est cette tragédie, si belle, qu'on hésite à dire de celle qu'elle a produite, avec les expressions d'Horace : Ο matre pulchra filia pulchrior! Il me reste, ce sera le sujet du chapitre suivant, à discuter les critiques passionnées qu'on a successivement opposées au chef-d'œuvre d'Euripide et à celui de Racine ; à montrer que chacun de ces deux ouvrages, au nom duquel on a condamné l'autre, a son sujet particulier, son originalité ; que, s'ils diffèrent, comme on a pu en juger, dans les détails, par le caractère de la composition et le choix des mœurs, ils ne diffèrent pas moins par la conception principale ; que du fonds fourni par Euripide, et de quelques indications de Sénèque, Racine animé par le spectacle des mœurs de son temps, inspiré surtout par les idées du christianisme, a su tirer une production que ne peut revendiquer la Grèce, et qui appartient en propre à notre théâtre. Ces développements sur lesquels je dois surtout insister, je les ferai suivre d'une revue des pièces anciennes et modernes, où ont été traités, tant de fois, avec des succès divers, le sujet d'Hippolyte et quelques sujets analogues ; je les ferai précéder de quelques détails nécessaires, et qui n'ont point encore trouvé leur place, sur l'histoire de la composition et de la représentation de l'Hippolyte d'Euripide.
(01) On peut demander comment Diane se borne à venir consoler Hippolyte après l'événement, an lieu de le protéger, comme il serait naturel, avant que cet événement s'accomplisse. La déesse répond elle-même à cette objection en alléguant un principe du droit public de l'Olympe, inconnu, ce semble, à Homère, chez qui les dieux ne se font pas faute de se contrarier les uns les autres, et ne s'en abstiennent que par la crainte qu'ils s'inspirent mutuellement. C'est une loi parmi les dieux, dit-elle (v. 1319), que nul ne s'oppose aux desseins d'un autre. Cette loi, imaginée peut-être par Euripide, pour le besoin de sa fable, ou bien encore pour concourir à son dessein général d'amender par ses inventions le système théologique des Grecs (voy. la dissertation de M. F. Blanchet, de Aristophane Euripidis censore, 1855, p. 58), a été invoquée plus d'une fois par Ovide (Métam., III, 236; XIV, 784) ;
. . . Neque enim licet irrita
cuiquam
Facta dei fecisse deo.
... Nisi quod rescindcre nunquam
Dis licet acta deum.
Consultez à ce sujet le commentaire de Valckenaer sur l'Hippolyte, v. 1319.
(02) Voyez t. I, p. 42 sqq.
(03) Voyez comment l'établit, pour Euripide, Barthélemy. Anachars., LXXI.
(04) Épître VII.
(05) Unde excitatur magna auditorum de eventu exspectatio.
(06) Batteux, Mém. de l'Acad. des Inscript. et Belles-Lettres, t. XIII, p. 452.
(07) Voyez, plus haut, p. 8 sqq.
(08) V. 58 sqq.
(09) Théâtre des Grecs.
(10) Lycée; Commentaire sur Racine.
(11) Cours de Littérature dramatique.
(12) Comparaison entre la Phèdre de Racine et celle d'Euripide, Paris, 1807, réimprimée à Bonn, en 1842, dans les Essais littéraires et historiques de l'auteur, p. 85 et suiv.
(13) Scchiegel traduit ici Sénèque :
Tuœve Phœbes vultus, aut Phœbi mei....
Est gentlor in te totus : et torvae tamen
Pars aliqua matris miscet ex aequo decus.
Is ore graio scytbicus apparet rigor.
(Hippol., v. 654-660.)
(14) V. 72 sqq. Les observations des scoliastes ont donné lieu de penser, ce qui n'est guère probable (voyez les notes de Valckenaer et de Monck), que cette couronne était métaphorique et devait s'entendre soit de l'hommage qu'Hippolyte fait de sa personne même à la déesse, soit de l'hymne par lequel il la célèbre. C'est en adoptant ce dernier sens, qui pourrait s'autoriser de passages célèbres où est employée la même figure (Lucret., de Nat. rer., I, 725 sqq.; Horat., Carm., I, xxvi, 7 sqq., etc.), que Muret (Var. lect., viii, I) a traduit tout le passage dans ces vers élégants :
Tibi hanc corollam, diva, nexilem fero,
Aptam e virentis pratuli intonsa coma;
Quo neque protervum pastor unquam inigit pecus,
Neque falcis unquam venit acies improbae.
Apis una flores vere libati ntegros,
Puris honestus quos rigat lymphis pudor.
Illis, magistri quos sine opera, perpetem
Natura docuit ipsa temperantiam,
Fas carpere illinc; improbis autem nefas.
At tu aureœ regina vinculum comae
Amica suscipe, pia quod porgit manus.
(15) Voyez l'éloge senti de ces vers et de toute cette peinture dans le Cours de littérature française de M. Villemain, Tableau du XVIIIe siècle, XLIIIe leçon; dans le XXXIVe chapitre du Cours de Littérature dramatique de M. Saint-Marc Girardin, où il est traité ingénieusement et éloquemment de l'Amour dans l'Hippolyte d'Euripide, de la Pudeur antique, de la Virginité chrétienne. Plus récemment, M. E. Legouvé a loué indirectement ce beau passage, en l'imitant dans une pièce inspirée par un autre ouvrage d'Euripide, dans sa Médée. Au 1er acte, scène 3, la jeune Créuse, fiancée à Jason, et prête à déserter pour la maternelle Latone, la virginale cour de Diane, présente à la déesse, comme Hippolyte, une couronne du fleurs et accompagne son offrande de ces strophes gracieuses :
Déesse à la chaste ceinture,
Déesse au léger brodequin,
Reçois, avec ma chevelure,
Ces riants trésors du matin.
Ils croissaient dans une vallée
Que jamais encor n'a foulée
Le pied des troupeaux insultants;
La faux respecte ses corbeilles,
Et l'aile ardente des abeilles
Y voltige seule au printemps.
Semblable au vallon solitaire,
J'ai longtemps vécu sous les yeux,
De mes jours n'ouvrant le mystère
Qu'aux seuls rayons venus des cieux :
Mais la vallée ombreuse et sainte
A vu paraître en son enceinte
Le coursier aux brûlants naseaux. ;
Et soudain saluant son maître,
Sous les pieds se plut à lui mettre
Ses fleurs, ses tapis et ses eaux.
Pardonne, ô déesse, etc.
(16) V. 87sqq.
(17) V. 120 sqq.
(18) T. II, p. 278 sqq.
(19) Dans les Trachiniennes. Voy. t. II, p. 55 sqq.
(20) W. Schlegel, Comparaison, etc., déjà citée.
21) V. 197 sqq.
(22) Phèdre, acte I, sc. 3.
(23) W. Schlegel, entre autres.
(24) Acte I, sc. 5; III, 3; IV, 6.
(25) V. 521.
(26) V. 608. Sur la distinction faite à cet égard par Hippolyte et, depuis Aristophane( Thesmophor., 275; Ran., 102,1471) et Platon (Theet. Sympos.), tant reprochée à Euripide, voyez notre t. I, p. 58. Voyez aussi les notes des commentateurs de l'Hippolyte, une surtout fort étendue de Valckenaer. Ovide s'est souvenu du vers d'Euripide, lorsqu'il a fait dire à Cydippe (Heroid, XXI, 137)
Quae jurat mens est; nil conjuravimus illa ;
Illa fidem dictis addere sola potest.
(27) V. 776 sqq.
(28) V. 1320 sqq. Voyez t. I, p. 325.
(29) V. 788 sqq.
(30) V. 889 sq.
(31) Ille tegat commisse.... Hor, Ad Pison., v. 200.
(32) V. 900 sqq.
(33) Acte IV, sc. 2.
(34) V. 1100-1140.
(35) V. 1163 sqq.
(36) Acte V, sc. 6.
(37) M. L. Halévy qui, en 1846, a compris dans les remarquables imitations de sa Grèce tragique celle de l'Hippolyte, y joignant des notes instructives, et la faisant précéder d'une notice où les divers personnages mis en scène par Euripide sont ingénieusement comparés à ceux qui leur correspondent chez Racine, soupçonne, p. 352, que ce narrateur pourrait bien être le même esclave qui, an début, donnait à son jeune maître des conseils par lesquels eût pu être prévenue sa triste fin.
(38) V. 1239-1244.
(39) Voyez, à ce sujet, Fénelon, Lettre à l'Académie française; la. Motte, Discours sur la Poésie en général et sur l'Ode en particulier ; Boileau, XIe Réflexion critique sur Longin; L. Racine, Mémoires de l'Académie des Inscription et Belles-Lettres, t. VIII, p. 300, Comparaison de l'Hippolyte d'Euripide avec la tragédie de Racine sur le même sujet; d'Olivet, Remarques de grammaire sur Racine, etc., etc.; le résumé de cette discussion dans l'Histoire du Théâtre-Français, t. XII, p. 1 sqq.; le Dictionnaire philosophique de Voltaire, article Amplification; les observations des divers commentateurs de Racine et surtout de La Harpe, dans son Commentaire et dans son Lycée.
(40) Comparaison, etc., déjà citée.
(41). Lycée.
(42) Chose singulière, pendant qu'ils la condamnent comme ajoutant mal à propos aux émotions douloureuses de la tragédie, un illustre critique allemand, Bœckh (Grœc, trag. princip., XIX), la blâme au contraire comme offrant ce qu'il appelle un dénouement heureux, dans cette appréciation bien sévère d'un ouvrage si admiré : «... .Victoriam Athenis meruit, licet longe inferior multis aliis Euripidis fabulis; sed ipsa vitia, sententiœ imprimis immodice cumulatœ, et fortasse faustus Tabulae exitus judicum animos videntur movisse, nisi aemulorum Iophontis et lonis etiam minus bonœ tragœdiœ fuerunt. »
(43) Cette traduction est en grande partie empruntée à W. Schlegel, Comparaison, etc., déjà citée.
(44) Voyez sur ce passage et la question de savoir si les divinités que montrait la scène grecque étaient censées vues des autres personnages , comme elles l'étaient des spectateurs, la note 1 de la page 10 du t. II.
(45) V. 1380-1406.
(46) Elle fait, ou l'on fait en son nom , dans l'Énéide, XI, 845, la même promesse à Camille mourante :
Non tamen indecorem tua te regina reliquit
Extrema jam in morte : neque hoc sine nomine letum
Per gentis erit, aut famam patieris inultae.
L'idée de ce genre de consolation , réprouvé par nos idées chrétiennes, comme l'exprime si bien le Guzman de Voltaire à ses derniers moments, se rencontre sans cesse dans la poésie antique.
(47) Corinth., XXXII. Cf. Lucian., de Dea Syria, LXX.; Diod. Sic., IV, 62, etc.
(48) Cf. Euripid., Alcest., 22; Suid., v. Φιλήμων.
(49) V. 1416-1430.
(50) XXII, 213.
(51) XII, 151. Cf. ibid., Servius; Stat., Theb. VII, 789.
(52) V. 1431-1452.