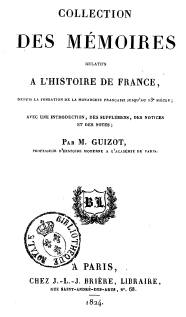
ÉGINHARD
NOTICE
RACE DES CAROLINGIENS - PÉPIN-LE-BREF (741-768) .
texte numérisé et mis en page par François-Dominique FOURNIER
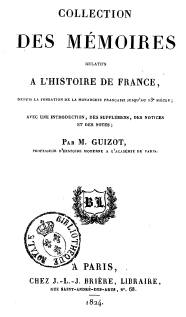
ÉGINHARD
NOTICE
RACE DES CAROLINGIENS - PÉPIN-LE-BREF (741-768) .
texte numérisé et mis en page par François-Dominique FOURNIER
COLLECTION
DES MÉMOIRES
RELATIFS
A L'HISTOIRE DE FRANCE,
depuis la fondation de la monarchie française jusqu'au 13e siècle
AVEC UNE INTRODUCTION DES SUPPLÉMENS, DES NOTICES ET DES NOTES;
Par M. GUIZOT,
PROFESSEUR D'HISTOIRE MODERNE A L’ACADÉMIE DE PARIS.

A PARIS,
CHEZ J.-L.-J. BRIÈRE, LIBRAIRE,
RUE SAINT-ANDRÉ-DES-ARTS, N°. 68.
1824.
.
Des écrivains du neuvième siècle, Éginhard est presque le seul dont le nom soit demeuré populaire. Malgré son importance comme ministre et historien de Charlemagne, c’est moins à des titres si graves qu’à une aventure romanesque et probablement fausse qu’il doit sa célébrité. Personne n’ignore ses amours et son mariage avec Emma ou Imma, fille, dit-on, de l’empereur. Des romans, des poèmes, des pièces de théâtre, ont reproduit sous mille formes cette agréable histoire. Voici en quels termes la raconte, sans lui assigner une date précise, la chronique du monastère de Lauresheim (1), le seul monument ancien qui en fasse mention.
Éginhard, archi-chapelain et secrétaire de l’empereur Charles, s’acquittant très honorablement de son office à la cour du roi, était bien venu de tous, et surtout aimé de très vive ardeur par la fille de l’empereur lui-même, nommée Imma, et promise au roi des Grecs. Un peu de temps s’était écoulé, et chaque jour croissait entre eux l’amour. La crainte les retenait, et de peur de la colère royale. Ils n’osaient courir le grave péril de se voir. Mais l’infatigable amour triomphe de tout. Enfin cet excellent homme, brûlant d’un feu sans remède, et n’osant s’adresser par un messager aux oreilles de la jeune fille, prit tout d’un coup confiance en lui-même, et, secrètement, au milieu de la nuit, se rendit là où elle habitait. Ayant frappé tout doucement, et comme pour parler à la jeune fille par ordre du roi, il obtint la permission d’entrer ; et alors, seul avec elle, et l’ayant charmée par de secrets entretiens, il donna et reçut de tendres embrassements, et son amour jouit du bien tant désiré. Mais lorsque, à l’approche de la lumière du jour, il voulut retourner, à travers les dernières ombres de la nuit, la d’où il était venu, il s’aperçut que soudainement il était tombé beaucoup de neige, et n’osa sortir de peur que la trace des pieds d’un homme ne trahît son secret. Tous deux pleins d’angoisse de ce qu’ils avaient fait, et saisis de crainte, ils demeuraient en dedans. Enfin comme, dans leur trouble, ils délibéraient sur ce qu’il y avait a faire, la charmante jeune fille, que l’amour rendait audacieuse, donna un conseil, et dit que, s’inclinant, elle le recevrait sur son dos, qu’elle le porterait avant le jour tout près de sa demeure, et que, l’ayant déposé là, elle reviendrait en suivant bien soigneusement les mêmes pas.
Or l’empereur, par la volonté divine, de ce qu’on croit, avait passé cette nuit sans sommeil, et se levant avant le jour, il regardait du haut de son palais. Il vit sa fille marchant lentement et d’un pas chancelant sous le fardeau qu’elle portait, et lorsqu’elle l’eut déposé au lieu convenu, reprenant bien vite la trace de ses pas. Après les avoir longtemps regardés, l’empereur, saisi à la fois d’admiration et de chagrin, mais pensant que cela n’arrivait pas ainsi sans une disposition d’en haut, se contint et garda le silence sur ce qu’il avait vu.
Cependant Éginhard, tourmenté de ce qu’il avait fait, et bien sûr que, de façon ou d’autre, la chose ne demeurerait pas longtemps ignorée du roi son seigneur, prit enfin une résolution dans son angoisse, alla trouver l’empereur, et lui demanda à genoux une mission, disant que ses services, déjà grands et nombreux, n’avaient pas reçu de convenable récompense. A ces paroles, le roi, ne lassant rien connaître de ce qu’il savait, se tut quelque temps, et puis assurant Éginhard qu’il répondrait bientôt à sa demande, il lui assigna un jour. Aussitôt il convoqua ses conseillers, les principaux de son royaume et ses autres familiers, leur ordonnant de se rendre près de lui. Cette magnifique assemblée de divers seigneurs ainsi réunie, il commença disant que la majesté impériale avait été insolemment outragée par le coupable amour de sa fille avec son secrétaire, et qu’il en était grandement troublé. Les assistants demeurant frappés de stupeur, et quelques-uns paraissant douter encore, tant la chose était hardie et inouïe, le roi la leur fit connaître avec évidence en leur racontant avec détail ce qu’il avait vu de ses yeux, et il leur demanda leur avis à ce sujet. Ils portèrent contre le présomptueux auteur du fait des sentences fort diverses, les uns voulant qu’il fût puni d’un châtiment jusque-là sans exemple, les autres qu’il fût exilé, d’autres enfin qu’il subît telle ou telle peine, chacun parlant selon le sentiment qui l’animait. Quelques-uns cependant, d’autant plus doux qu’ils étaient plus sages, après en avoir délibéré entre eux, supplièrent instamment le roi d’examiner lui-même cette affaire, et de décider selon la prudence qu’il avait reçue de Dieu. Lorsque le roi eut bien observé l’affection que lui portait chacun, et qu’entre les divers avis, il se fut arrêté à celui qu’il voulait suivre, il leur parla ainsi : Vous n’ignorez pas que les hommes sont sujets à de nombreux accidents, et que souvent il arrive que des choses qui commencent par un malheur ont une issue plus favorable. Il ne faut donc point se désoler ; mais bien plutôt, dans cette il affaire qui, par sa nouveauté et sa gravité, a surpassé notre prévoyance, il faut pieusement rechercher et respecter les intentions de la Providence qui ne se trompe jamais et sait faire tourner le mal à bien. Je ne ferai donc point subir à mon secrétaire, pour cette déplorable action, un châtiment qui accroîtrait le déshonneur de ma fille au lieu de l’effacer. Je crois qu’il est plus sage et qu’il convient mieux à la dignité de notre empire de pardonner à leur jeunesse, de les unir en légitime mariage, et de donner ainsi à leur honteuse faute une couleur d’honnêteté. Ayant ouï cet avis du roi, tous se réjouirent hautement et comblèrent de louanges la grandeur et la douceur de son âme. Éginhard eut ordre d’entrer. Le roi, le saluant comme il avait résolu, lui dit d’un visage tranquille : Vous avez fait parvenir à nos oreilles vos plaintes de ce que notre royale munificence n’avait pas encore dignement répondu à vos services. A vrai dire, c’est votre propre négligence qu’il faut en accuser, car malgré tant et de si grandes affaires dont je porte seul le poids, si j’avais connu quelque chose de votre désir, j’aurais accordé à vos services les honneurs qui leur sont dus. Pour ne pas vous retenir par de longs discours, je ferai maintenant cesser vos plaintes par un magnifique don ; comme je veux vous voir toujours fidèle à moi comme par le passé, et attaché à ma personne, je vais vous donner ma fille en mariage, votre porteuse, celle qui déjà, ceignant sa robe, s’est montrée si docile à vous porter. Aussitôt, d’après l’ordre du roi et au milieu d’une suite nombreuse, on fit entrer sa fille, le visage couvert d’une charmante rougeur, et le père la mit de sa main entre les mains d’Éginhard avec une riche dot, quelques domaines, beaucoup d’or et d’argent et d’autres meubles précieux. Après la mort de son père, le très pieux empereur Louis donna également à Éginhard le domaine de Michlenstadt et celui de Mühlenheim qui s’appelle maintenant Seligenstadt (2).
Il est difficile de prononcer sur l’authenticité de cette histoire. Quoique la chronique de Lauresheim ne soit pas contemporaine, elle n’est point sans autorité ; Éginhard eut, avec ce monastère, de fréquentes relations, puisqu’il lui donna le domaine de Michlenstadt, et les moines recueillirent sans doute avec soin les traditions qui intéressaient leur illustre bienfaiteur. Il est hors de doute qu’Éginhard eût réellement Imma pour femme, et Loup, abbé de Ferrières, élève et ami de notre historien, appelle Imma nobilissima femina, titre qui ne se donnait guères alors qu’aux personnes issues du sang royal (3). Enfin, dans une lettre à l’empereur Lothaire, petit-fils de Charlemagne, Éginhard lui-même semble l’appeler son neveu en lui disant : J’ai cru devoir avertir votre neptité (neptitatem vestram), et Mabillon a regardé cette preuve comme concluante. Mais d’autres savants ont remarqué qu’au neuvième siècle, le mot nobilissimus et même ceux d’oncle et neveu (patruus, avunculus, nepos), étaient pris dans un sens très vague et ne désignaient souvent qu’une extraction illustre, une sorte de tutelle et d’autorité morale. L’abbé Lebeuf est allé plus loin, et a soutenu, en étayant son opinion de quelques exemples, que les mots neptitas tua dont Éginhard se sert avec Lothaire, signifiaient toujours votre principauté, votre souveraineté ; ce qui détruirait absolument la conclusion qu’on voulu en tirer. S’il n’y avait cependant, contre l’aventure d’Éginhard, que ces arguments indirects et contestables, ils ne paraîtraient pas suffisants pour faire rejeter une tradition qui n’offre en soi rien d’absurde ni de contraire au caractère de Charlemagne ou aux mœurs du temps, et que rapporte, avec tant de détails, la chronique d’un monastère où la vie d’Éginhard devait être bien connue. C’est Éginhard lui-même qui fournit les raisons les plus fortes contre la réalité de ses tendres rapports avec la fille de son maître. Non seulement il garde à ce sujet le plus profond silence ; mais, dans sa Vie de Charlemagne, il énumère tous les enfants de ce prince, sept fils et huit filles, naturels ou légitimes, et le nom d’Imma ne s’y rencontre point, ni aucun nom analogue qui puisse s’être altéré sous la main des copistes. Enfin Louis le Débonnaire, dans un diplôme qui nous reste, donne un domaine à son fidèle Eginhard et à sa femme Imma sans que rien indique qu’Imma fut sa soeur. Dom Bouquet et la plupart des érudits, gardiens jaloux de la vertu des filles du roi, ont fait valoir ces preuves avec une sorte de triomphe, et je m’y rends aussi, non sans quelque regret, car l’aventure est gracieuse et douce. A leurs arguments, j’en ajouterai même un nouveau, plus puissant peut-être que tous les autres, quoiqu’il fasse à la réputation des filles de Charlemagne beaucoup plus de tort que la tradition qu’il faut abandonner ; ce sont les paroles d’Éginhard lui-même sur leur compte : L’empereur, dit-il, quoique heureux en toute autre chose, éprouva dans ses filles la malignité de la mauvaise fortune ; mais il dissimula ce chagrin, et se conduisit comme si jamais elles n’eussent fait naître de soupçons injurieux, et qu’aucun bruit ne s’en fût répandu (4). Pense-t-on qu’Eginhard eût tenu un tel langage si sa chère Imma en eût subi la première offense ?
Quoi qu’il en soit, et gendre ou non de Charlemagne, Éginhard posséda toute sa faveur. Il était né Franc, comme la plupart des hommes considérables de cette cour redevenue germaine : Le lecteur, dit-il, ne trouvera rien à admirer dans mon ouvrage, si ce n’est peut-être l’audace d’un barbare peu exercé dans la langue des Romains (5). Charles l’attira auprès de lui dès sa jeunesse, le fit élever avec soin, à l’école du célèbre Alcuin, et le donna pour compagnon à ses fils. Frappé bientôt des talents du jeune homme et de son heureuse ardeur pour l’étude des lettres, Charles le prit pour secrétaire et lui confia de plus la surveillance de tous les travaux de construction qu’il entreprit, églises, palais, routes, canaux ; ce qui était en quelque sorte, pour parler le langage de notre temps, le ministère de la civilisation. On s’est étonné de ne rencontrer qu’une seule fois le nom d’Éginhard dans les négociations ou missions extérieures de ce règne ; il paraît, en effet, qu’il ne s’éloigna de l’empereur qu’en 806 pour aller à Rome faire confirmer, par le pape Léon III, le premier testament de son maître. Charles ne se séparait probablement qu’à regret de l’homme à qui il portait le plus de confiance et qui le comprenait le mieux : les écrits d’Éginhard, surtout la préface de sa Vie de Charlemagne, annoncent entre eux un degré d’intimité, même d’affection, dont on ne trouve, à cette époque, aucun autre exemple ; et l’attachement de l’historien à la mémoire de l’empereur porte l’empreinte des sentiments d’une civilisation plus avancée. Issus l’un et l’autre de la Barbarie, ils avaient, pour ainsi dire, devancé l’un et l’autre leur temps du même pas. Peut-être n’est-il pas facile de comprendre aujourd’hui tourte la puissance d’un tel lieu.
Rien ne put le remplacer pour Éginhard après la mort de son patron. Louis le Débonnaire ne le traita pas avec moins d’estime que Charlemagne ; il le combla de présents et lui confia l’éducation, ou plutôt la tutelle de son fils Lothaire, qu’en 817 il associa à l’empire. Éginhard ne refusa point ses services à l’empereur et ses conseils à son fils ; mais il n’était plus attaché à ses fonctions par l’amitié d’un grand homme ; l’ambition ne subit point pour l’y retenir. Il voyait dépérir et se dissoudre cet empire de Charlemagne qu’il avait tant admiré et si bien servi. L’incapacité, la faiblesse, de misérables intrigues, des désordres sans cesse croissants succédaient à ce pouvoir glorieux et ferme, contemporain de sa jeunesse. Le dégoût s’empara de lui et il ne songea plus qu’à se retirer de ce monde en décadence, pour se vouer à une vie toute religieuse. Successivement abbé des monastères de Fontenelle, de Saint-Pierre et de Saint-Bavon à Gand, et enfin de celui de Seligenstadt qu’il fonda lui-même dans sa terre de Mühlenheim, l’administration de ces établissements et les œuvres de piété occupèrent seules sa pensée. La plupart des lettres que nous possédons de lui appartiennent à cette époque de sa vie, et c’est là qu’on peut voir quel triste ennui lui inspirait l’état des affaires publiques, et combien il lui coûtait de se rendre encore de temps en temps à la cour pour y faire acte de fidélité et de dévouement. Je ne te demande pas, écrit-il à un de ses amis, de me rien écrire sur l’état des affaires du palais, car rien de ce qui s’y fait ne me plaît à savoir. Je m’inquiète seulement d’apprendre où sont et ce que font mes amis, s’il en reste là quelque autre que toi (6). Ailleurs il conjure un des officiers du palais de l’excuser auprès de l’empereur s’il ne se rend pas à la cour : La reine, dit-il, quand elle a quitté Aix, m’a ordonné de la rejoindre à Compiègne, car je ne pouvais partir avec elle. Pour obéir à ses ordres, je me suis rendu, à grand’peine et en dix jours, à Valenciennes. De là, hors d’état de monter à cheval, je suis venu par eau jusqu’à Saint-Bavon. Mais je suis alternativement attaqué de douleurs de reins et d’un relâchement d’entrailles, tellement que, depuis mon départ d’Aix, je n’ai pas passé un seul jour sans souffrir de l’un ou de l’autre de ces maux. Je suis également atteint de ce qui m’a tant abattu l’an dernier, d’un engourdissement continuel de la cuisse droite cet d’une douleur de foie presque intolérable. Au milieu de ces souffrances, je mène une vie fort triste et à peu près dénuée de toute joie ; mais ce qui m’afflige le plus, c’est que je crains de ne pas mourir où je voudrais, et d’avoir à m’occuper d’autre chose que du service des saints martyrs du Christ (7).
Ces derniers soins étaient en effet les seuls qui lui inspirassent un vif intérêt ; en 827, il fit venir de Rome, par son secrétaire Ratlair, des reliques de saint Marcellin et de saint Pierre , et ce fut en leur honneur qu’il fonda le monastère de Seligenstadt. Ses lettres sont pleines de détails sur les peines qu’il se donne pour la construction, l’embellissement ou le service des églises. Les seules affaires temporelles dont il semble encore s’occuper sont celles d’anciens clients ou de quelques amis qu’il recommande à leurs nouveaux patrons, aux nouveaux ministres du pouvoir ; tantôt c’est un bénéfice qu’il sollicite de l’empereur pour un homme qui, lui dit-il, a fidèlement et courageusement servi votre aïeul et votre père (8) ; tantôt ce sont des malheureux, coupables de quelque crime, qui ont cherché un refuge dans quelque église voisine de lui, et dont il sollicite la grâce (9) ; ailleurs il intercède pour faire reconnaître l’union de pauvres esclaves qui se sont mariés sans le consentement de leur maître[x], ou pour obtenir à des colons l’exemption du service militaire (11). Ce patronage individuel et charitable est l’unique intérêt auquel il fasse servir encore les relations et les moyens d’influence qui lui restent de son ancienne grandeur.
Une seule fois, à en juger du moins par ses lettres et les rapports de ses contemporains, Éginhard intervint de nouveau dans la politique, et ce fut pour détourner Lothaire de ses projets de révolte contre son père. Il lui écrivit, à ce sujet, vers l’an 830, une lettre que je crois devoir insérer ici textuellement :
Éginhard à Lothaire.
Vie éternelle à mon très pieux seigneur empereur. Je ne saurais exprimer pleinement, par des paroles, de quels soins et de quelle sollicitude mon insuffisance se tourmente pour votre Grandeur. J’ai toujours chéri d’un amour égal et vous et mon très pieux maître votre père, et souhaite d’une même ardeur le salut de tous deux, depuis que, du consentement de tout son peuple, il vous a admis au partage de son titre et de son pouvoir, et a daigné ordonner à mon humble faiblesse de veiller sur vous, et de vous avertir assidûment, tant de ce qu’il pourrait y avoir à réformer dans vos moeurs que des voies honnêtes et utiles à suivre. Mais, quoique vous n’ayez pas trouvé en moi à cet égard tous les secours que je vous devais, cependant le zèle et la fidélité ne m’ont pas manqué. L’un et l’autre ne me manquent certes pas davantage aujourd’hui et ne me permettent pas de me faire. L’un et l’autre me forcent à vous presser d’ouvrir les yeux sur vos véritables intérêts, au moment où certains hommes, qui cherchent plutôt leurs propres avantages que les vôtres, tentent votre douceur naturelle, et veulent vous persuader de mépriser les avis de votre père, de vous écarter de l’obéissance que vous lui devez, de quitter le pays dont le très- pieux auteur de vos jours vous a confié le gouvernement et la garde, de venir le trouver malgré lui, sans qu’il le veuille et l’ordonne, et de rester auprès de lui, quelque déplaisir qu’il en témoigne. Rien de plus pervers et de plus indécent peut-il s’imaginer ? Songez à ce que sont de pareils conseils et à tout ce qu’ils ont de mauvais. En premier lieu, en effet, et suivant mes faibles lumières, on vous exhorte à fouler aux pieds le précepte par lequel Dieu enjoint d’honorer ses père et mère, et à compter pour rien la longue vie promise pour récompense à ceux qui garderont son commandement. On veut ensuite que, mettant de côté toute obéissance, vous la remplaciez par l’esprit de révolte, et vous éleviez dans un transport d’orgueil contre celui envers lequel vous devriez montrer dans toute votre conduite une humble soumission ; on travaille enfin, en étouffant toute tendresse par le mépris et la désobéissance, à augmenter si bien la désunion, dont jamais le nom n’aurait dû se prononcer quand il s’agit de vous et de votre père, que la haine s’élève entre ceux en qui tout devrait être amour. Empêcher qu’il n’en advienne ainsi, c’est à quoi il importe de donner tous vos soins. Votre sagesse, en effet, n’ignore pas, j’en suis convaincu, combien le fils désobéissant et rebelle envers ses parents est en abomination devant le Seigneur, et vous pouvez lire dans le Deutéronome comment Dieu a ordonné, par la voix de Moïse, qu’un tel fils fût lapidé par tout le peuple. J’ai donc cru de mon devoir de vous avertir, mon cher fils (12), d’employer la prudence que la Providence vous a départie à vous garantir du péril qui vous menace ; et ne pensez pas que, dans quelque rang qu’on soit, on puisse se jouer de la sentence que Dieu a portée. Quoiqu’elle ne soit écrite que dans l’ancienne loi, cette sentence est une de celles que les anciens et les docteurs, c’est-à-dire les Pères de l’Église, ont déclarées obligatoires pour les temps présents comme pour les temps passés, pour les Chrétiens aussi bien que pour les Juifs. Combien je vous aime, Dieu le sait, et c’est pour cela même que je suis si osé que de vous reprendre. Au surplus, ne regardez pas à la bassesse de ma condition, mais à l’utilité de mes conseils.
Je souhaite, etc.
Les conseils d’Éginhard furent sans fruit, comme il s’y était probablement attendu, et il n’en donna plus. Les soins de la piété et de sa santé l’occupèrent exclusivement. En se vouant à la vie religieuse, il s’était séparé, non seulement du monde, mais de sa famille. Sa chère Imma et Vussin, le seul fils qu’elle lui eut donné, étaient également entrés dans des monastères. Il avait continué à entretenir avec eux des relations pleines de tendresse. Dans une lettre adressée à son fils, il lui donne des conseils sur ses études et le consulte à son tour sur le sens d’un passage de Vitruve (13). Imma mourut en 836 et sa perte causa au solitaire Éginhard la plus vive douleur. Il écrit à Loup, depuis abbé de Ferrières, son disciple et son jeune ami : Tous mes travaux, tous mes soins, pour les affaires de mes amis ou pour les miennes, ne me sont plus de rien ; tout s’efface, tout s’abîme devant la cruelle douleur dont m’a frappé la mort de celle qui fut jadis ma fidèle femme, qui était encore ma sœur et ma compagne chérie. C’est un mal qui ne peut finir, car ses mérites sont si profondément enracinés dans ma mémoire que rien ne saurait l’en arracher. Ce qui redouble mon chagrin et aigrit chaque jour ma blessure, c’est devoir ainsi que tous mes vœux n’ont eu aucune puissance et que les espérances que j’avais mises dans l’intervention des saints martyrs sont déçues. Aussi les paroles de ceux qui essaient de me consoler, et qui souvent ont réussi auprès d’autres hommes, ne font-elles que rouvrir et envenimer cruellement la plaie de mon coeur, car ils veulent que je supporte avec courage des douleurs qu’ils ne sentent point, et me demandent de me féliciter d’une épreuve où ils sont incapables de me faire découvrir le moindre a sujet de contentement (14). Sa douleur fut aussi constante qu’amère ; car, aux approches de la mort, annonçant lui-même à un de ses amis qu’il touche à sa fin, il s’écrie en terminant sa lettre : Imma, ma soeur bien aimée, viens en ce jour et à mon aide ; c’est à toi que je recommande mon âme (15). Il mourut, en effet, en 839, près de trois ans après sa chère Imma, et fut enseveli dans l’église de son monastère de Seligenstadt, où son ami Raban, alors abbé de Fulde, fit graver sur son tombeau l’épitaphe suivante :
Ô toi qui entres dans ce temple, ne dédaigne pas, je t’en conjure, d’apprendre ce qui s’y trouve sous tes pas. Dans ce tombeau repose un noble homme à qui son père avait donné le nom d’Éginhard. Il fut d’un esprit sage et prudent, honnête dans ses actions, d’une bouche éloquente, et excellent en beaucoup de choses. Le prince Charles l’éleva dans sa propre cour, et accomplit, par son aide, de nombreux travaux. Il a rendu aux saints de convenables honneurs ; car c’est lui qui, de Rome, a fait amener ici leurs corps, afin que, touchés de ses prières et de ses soins, ils procurassent à son âme le royaume du ciel. Seigneur Christ, auteur, maître et sauveur des hommes, que ta bonté lui accorde, dans les cieux, le repos éternel !
Parmi les écrits douteux on authentiques d’Éginhard, les deux ouvrages historiques que nous publions ici, les Annales et la Vie de Charlemagne, conservent seuls aujourd’hui une véritable importance.
On a plus d’une fois contesté qu’Éginhard soit l’auteur des Annales ; leur premier éditeur, le comte Hermann de Nuenar, les trouva à la suite d’un manuscrit de la Vie de Charlemagne, et les publia en même temps à Cologne, en 1521, en les attribuant à quelque moine inconnu. Plusieurs éditeurs successifs essayèrent de deviner quel pouvait être ce moine, mais sans succès ; ils avaient seulement rencontré le nom d’Adhémarsous lequel, en s’étayant de quelques exemples de corruptions semblables, on croyait entrevoir celui d’Éginhard. Enfin Duchesne et Mabillon soutinrent formellement qu’elles étaient l’ouvrage de ce dernier, en appelant surtout au témoignage d’Odilon, moine de Saint-Médard de Soissons, qui écrivit au commencement du dixième siècle, un récit de la translation et des miracles de Saint-Sébastien, et cite, dans sa préface, les Annales d’Agenhard, comme racontant la translation des reliques de ce saint de Ronce à Soissons. Éginhard ne peut être méconnu dans Agenhard, et nos Annales parlent, en effet, sous l’année 826, de cette translation et des miracles qui l’accompagnèrent. Malgré cette preuve, quelques érudits, entre autres le père Lecointe, se sont obstinés à refuser de reconnaître Éginhard comme l’auteur des Annales ; mais leurs arguments sont de peu de poids ; ils allèguent surtout deux passages de cette chronique : dans l’un Éginhard est appelé le plus sage des hommes de son temps, ce que personne, disent-ils, n’a pu écrire en parlant de soi-même ; dans l’autre, l’écrivain donne au monastère de Lauresheim l’épithète de suum, ce qui ne saurait, à leur avis, s’appliquer à Éginhard qui ne fut jamais moine à Lauresheim. La première objection tombe devant l’inspection des manuscrits, car la plupart, et les meilleurs, ne contiennent point la phrase qui la fonde ; et dans celui où elle se trouve, elle a été évidemment ajoutée en marge par le copiste qui l’a empruntée à la Vie de Louis le Débonnaire par l’anonyme dit l’Astronome. Quant à la seconde objection, Éginhard a fort bien pu appeler sien un monastère qu’il visitait souvent, auquel il avait donné l’un de ses plus riches domaines, dont la chronique fournit, sur sa vie, plus de détails qu’aucune autre, et où rien ne prouve qu’il n’ait pas vécu quelque temps. L’autorité du moine Odilon nous paraît supérieure à de tels arguments ; et la composition même de ces Annales, leur mérite généralement avoué, les détails qu’elles renferment et qui offrent assez souvent les caractères d’un récit contemporain ; enfin l’opinion de Duchesne, de Mabillon et de dom Rivet, adoptée, bien que timidement, par dom Bouquet, nous portent à croire qu’Éginhard en est en effet l’auteur, sans qu’on puisse cependant prétendre ici à la certitude (16).
Quant à la Vie de Charlemagne, personne n’a songé à la disputer à son secrétaire, car elle porte en elle-même, et presque à chaque phrase, la preuve de son authenticité. Nous n’avons nul besoin d’insister sur son mérite ; c’est sans contredit le morceau d’histoire le plus curieux qui nous soit parvenu sur Charlemagne, le seul qui nous fasse bien connaître ce qui, après dix siècles, a plus d’intérêt que les grands événements, le grand homme qui les a faits. Publiée pour la première fois à Cologne en 1521 par le comte Hermann de Nuenar, la Vie de Charlemagne a été réimprimée depuis plus de vingt fois, soit en France, soit en Allemagne, et souvent avec des commentaires. Nous avons suivi, comme pour la plupart des ouvrages qui appartiennent aux premiers siècles de notre histoire, le texte de dom Bouquet. Sans parler de plusieurs paraphrases qui ne sont guères que des versions prolixes, elle a été traduite quatre fois en français ; par Elie Vinet (Poitiers, 1558 in-8°), par Léonard Pournas (Paris, 1614, in 12), par le président Cousin, dans son Histoire de l’Empire d’Occident, et par M. D. (Denis), Paris, 1812, in-12.
Outre ces deux ouvrages et quelques écrits théologiques de peu de valeur (17), il nous reste d’Éginhard un assez grand nombre de lettres qui abondent en renseignements curieux sur l’état social et les mœurs de cette époque. Nous en avons extrait quelques unes dans cette notice. Elles furent publiées d’abord dans la collection de Duchesne, d’après un manuscrit qui en contenait d’autres tellement effacées ou déchirées qu’il lui fut impossible de les lire. On les trouve dans le recueil des historiens des Gaules et de la France ; dom Bouquet en a seulement retranché la 62e faussement attribuée à Éginhard.
Le nom de l’historien de Charlemagne se rencontre défiguré de mille manières dans les manuscrits et les auteurs anciens ; il y est appelé Einard, Einhard, Heinard, Ænard, Ainard, Eiard, Enchard, Einchard, et même Hemar, Adelme, Adelin, Adhémar. Quelques-unes de ces variantes sont évidemment des erreurs de copiste ; d’autres ont pu tenir à l’incertitude de l’orthographe et de la prononciation.
1
Lauresheim ou Lerch, dans le diocèse de Worms, à quatre
lieues de Heidelberg. Cette chroniques s’étend de l’an 763
ou 764, époque de la fondation du monastère, à l’an 1179.
Elle fut publiée en 1600 par Marquard Freher, dans le
troisième volume de ses Scriptores rerum
Germanicarum. Duchesne et dom Bouquet en ont donné des
extraits, entre autres l’histoire d’Éginhard. Vers le milieu
du dix-huitième siècle, on en entreprit en Allemagne deux
nouvelles éditions, plus complètes que celle de Freher, et
accompagnées de toutes les chartes et diplômes du monastère.
La première, confiée aux soins de D. Magnus Klein, religieux
de l’abbaye de Gottwich, n’a point été terminée ; le premier
volume seul a paru. La seconde, dirigée par M. Lamey,
secrétaire perpétuel de l’académie de Manheim, est complète,
et forme trois volumes in-4°, sous le titre de
Codex principis olim Laureshamiensis abbatiæ diplomaticus,
1768. L’auteur de ce Codex écrivait à la fin du douzième
siècle ; mais il ne fit, à coup sûr, que rassembler et
mettre en ordre des chroniques et des traditions
antérieurement rédigées dans ce monastère, quoiqu’on ignore
et quelle époque les moines ont commencé à les recueillir.
Je n’ai pu parvenir à me procurer cette dernière édition.
2 Recueil des historiens des Gaules et
de la France, t. 5, p. 383.
3 Je trouve dans l’Histoire Littéraire
de la France par les bénédictins, et cette assertion a
été souvent répétée,
qu’Éginhard est qualifié gendre de Charlemagne dans des
manuscrits anciens (t. 4 , p. 550), et dom Rivet
renvoie, en preuve, à la 32e lettre d’Éginhard.
Cette lettre n’autorise rien de pareil, et je n’ai pu
découvrir aucun texte ancien qui donnât à Éginhard une telle
qualification.
4 Vie de Charlemagne.
5 Préface de la Vie de Charlemagne.
6 Lettre 47e dans le Recueil
des historiens Français, t. 6, page 382.
7 Lettre 41e ibid., page
380.
8 Lettre 58e ibid., page
383.
9 Lettres 18e et 25e
ibid., pages 373 et 374.
10 Lettres 15e et 16e
ibid., page 372.
11 Lettre 17e ibid., page
373.
12 C’est ainsi, je crois, qu’il faut traduire
cette phrase dont j’ai déjà parlé dans cette notice :
Quapropter admonendum
censui neptitatem vestra ; ces mots,
neptitas vestra,
me semblent une expression vague d’affection, un souvenir de
l’ancienne tutelle d’Éginhard sur Lothaire, plutôt qu’une
qualification précise, soit de parenté, soit de rang.
13 Lettre 30e dans le Recueil
des historiens Français, t. 6, page 375.
14 Lettre d’Éginhard à Loup, ibid.,
page 402.
15 Lettre 32e ibid., p.
376.
16 Dans une brochure récente (Paris, 1817, chez
le Normant) intitulée : Est-il vrai que Pépin ait
été autorisé par le pape Zacharie à s’emparer de la couronne
des Mérovingiens ? M. l’abbé Guillon a vivement nié
l’authenticité des Annales d’Éginhard ; mais il en avait
absolument besoin pour soutenir, sur l’intervention du pape
Zacharie dans la chute des Mérovingiens, une opinion qui
nous paraît fausse, et n’a rien ajouté d’ailleurs aux
arguments de ses prédécesseurs.
17 On en trouve l’indication détaillée dans l’Histoire
littéraire de la France par les bénédictins, t. 4, p.
563-567.