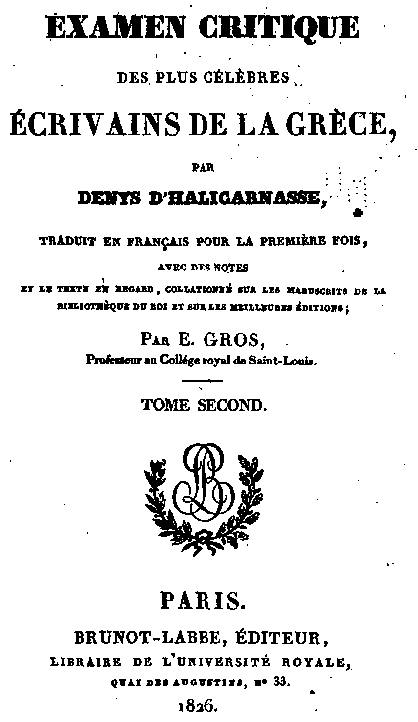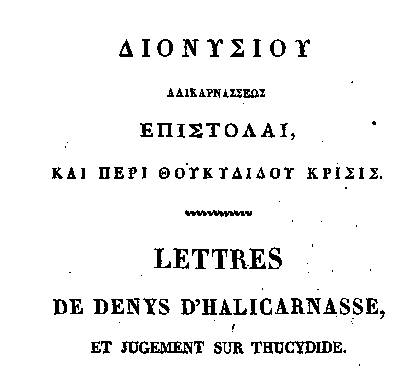|
ALLER A LA TABLE DES MATIERES DE DENYS D'HALICARNASSE
DENYS D'HALICARNASSE
EXAMEN CRITIQUE DES PLUS CÉLÈBRES ÉCRIVAINS DE LA GRÈCE
JUGEMENT DE DENYS D'HALICARNASSE, FILS D'ALEXANDRE, SUR THUCYDIDE ET SUR SES PRINCIPALES QUALITÉS. Pour avoir le texte grec d'un chapitre, cliquer sur le chapitre
JUGEMENT DE DENYS D'HALICARNASSE, FILS D'ALEXANDRE, SUR THUCYDIDE ET SUR SES PRINCIPALES QUALITÉS. SOMMAIRE. I-IV. But de ce Traité. — V. Sur les historiens plus anciens que Thucydide. — VI-VIII. En quoi Thucydide leur est supérieur. — IX-XII. Défauts de la division et du plan de son histoire. — XIII-XVIII. Il n'a pas bien traité les diverses parties. — XIX-XX. En quoi son introduction est défectueuse. — XXI-XXXIII. Caractères de son style .— XXXIV-LI. Examen de ses harangues. — LII-LV. Écrivains qui ont imité Thucydide. [I] DANS les Mémoires que j'ai publiés sur l'imitation, je me suis déjà occupé, Q. Aelius Tubéron, des poètes et des prosateurs les plus distingués ; j'ai exposé en peu de mots les qualités qui les caractérisent chacun en particulier, tant pour les pensées que pour le style : j'ai montré aussi comment ils sont quelquefois inférieurs à eux-mêmes, soit qu'ils n'aient pas su bien choisir les sujets, soit que leur talent ne se tienne pas toujours à la hauteur convenable. Mon but a été de donner aux hommes qui aspirent à s'illustrer dans l'art d'écrire ou de bien parler, une règle d'après laquelle ils puissent diriger leurs exercices, afin qu'au lieu de tout imiter dans ces écrivains, ils s'efforcent de copier leurs beautés et d'éviter leurs défauts. Lorsque je me suis occupé des historiens, j'ai dit quelque chose de Thucydide, en me renfermant dans d'étroites limites : ce n'était, de ma part, ni mépris ni paresse ; je ne manquais pas non plus de preuves à l'appui de mes assertions ; mais alors je ne voulais m'attacher qu'aux réflexions qui se rapportaient directement à mon plan : j'en ai fait autant pour les autres écrivains. Je ne de vais point rendre un compte exact et détaillé de chacun d'eux, puisque j'avais résolu de donner à ce traité le moins d'étendue possible. Mais du moment que vous m'engageâtes à composer sur Thucydide un ouvrage où toutes les questions importantes fussent discutées, j'abandonnai celui que j'avais entrepris sur Démosthène, et je promis de vous satisfaire. L'écrit que vous m'aviez demandé est fini, et je m'acquitte de ma parole. [II] Avant de vous faire connaître mon jugement sur Thucydide, je crois convenable de vous soumettre quelques observations préliminaires sur moi-même et sur la nature de ce traité : certes, ce n'est ni à cause de vous, ni à cause de ces esprits sages, d'un goût toujours infaillible, et pour qui rien n'est préférable à la vérité; mais à causé des hommes remplis d'admiration pour les anciens et de mépris pouf leur siècle : il n'en est que trop parmi nous. Je m'attends bien que plusieurs lecteurs me blâmeront d'avoir osé dire que Thucydide, le prince des historiens, n'est à l'abri du reproche, ni pour le choix du sujet ni pour la manière dont il l'a traité; mais je ne me laisse pas effrayer, parce qu'on m'accusera peut-être de soutenir seul un étrange paradoxe, si je ne crains pas de blâmer quelques pages dans ses écrits, ou de combattre une opinion tellement enracinée dans l'esprit de tous les hommes qu'il est difficile de l'en arracher; enfin, si je rejette le témoignage desorateurs et des philosophes les plus célèbres, qui regardent cet écrivain comme la règle de la composition historique et le parfait modèle de l'éloquence politique : ces assertions n'ont aucun fondement. Pour répondre à un reproche déclamatoire et qui ne peut imposer qu'à la multitude, il suffira de dire que ma vie ne fut jamais souillée par la passion de la calomnie, de la médisance et des attaques injustes : jusqu'à ce jour, je n'ai pris la plume contre personne, excepté dans mon traité sur la rhétorique, pour la défendre contre ceux qui la décrient. Ainsi, je ne viens pas attaquer aujourd'hui le plus célèbre des historiens, avec un acharnement indigne de tout homme d'honneur, et bien éloigné de mon caractère. J'aurais plusieurs observations à faire sur la nature de cet écrit ; mais je me borne à quelques-unes. Ma critique est-elle raisonnable ? Avais-je le droit de l'exercer? C'est une question que vous déciderez, vous et tous les amis de la littérature. [III] Mon but n'est ni de blâmer avec aigreur dans Thucydide le choix du sujet et le style, ni de recueillir toutes ses fautes, pour les tourner en ridicule ; ni enfin de composer un traité où, sans tenir compte de ses belles qualités, je ne m'attacherais qu'aux expressions qui laissent beaucoup à désirer : je veux plutôt rassembler les traits principaux de son caractère, ceux qui lui sont communs avec d'autres écrivains, et ceux qui lui appartiennent en propre. Pour arriver à ce but, je dois parler non seulement de ses bonnes qualités, mais aussi des défauts qui en sont presque inséparables. Telle est, en effet, la nature de l'homme, que la perfection ne peut se trouver ni dans ses paroles, ni dans ses actions : le plus estimable est celui qui en approche davantage et qui faillit le moins souvent. Voilà le principe auquel le lecteur doit rapporter les observations que je vais lui soumettre. Qu'il ne s'érige point en censeur; mais qu'il réfléchisse au but de cet écrit. Je ne suis pas le premier qui ait traité un semblable sujet. De nos jours, comme dans les siècles passés, plusieurs l'ont fait avant moi. Loin d'obéir à l'impulsion de la haine, ils ne cherchaient que la vérité. Je pourrais en citer un grand nombre ; mais je me contenterai d'Aristote et de Platon. L'un ne crut pas que tout fût parfait dans Platon, son maître ; témoin sa critique sur le système des idées, du bien et du gouvernement ; l'autre reprocha de nombreuses erreurs à Parménide, à Protagoras, à Zénon et à plusieurs philosophes. Personne jamais ne leur en a fait un crime ; parce qu'on sait que les spéculations philosophiques ont pour but la découverte de la vérité, qui seule peut conduire l'homme à l'accomplissement de sa destinée. Si on ne leur a point reproché de soutenir des opinions étranges, s'ils ont pu ne pas tout approuver dans les anciens, pourquoi blâmer un critique dont le but est de faite connaître le caractère de certains écrivains, à moins qu'il ne veuille trouver en eux toutes les qualités, même celles dont ils furent totalement privés ? [IV] Il me reste à prévenir une objection que l'envie peut seule dicter, et que le vulgaire s'empresse toujours d'accueillir; mais dont il est facile de montrer la futilité. Certes, parce qu'on n'a point le talent de Thucydide ou des écrivains les plus distingués, on ne doit pas perdre le droit de les juger. Des peintres, à qui la nature n'a pas donné le génie d'Apelles, de Zeuxis, de Protogène, et des grands hommes qui se sont illustrés dans la même carrière, prononcent sur leurs immortels chefs-d'œuvre. Phidias, Polyclète, Myron sont bien soumis à la critique de sculpteurs qui ne les égaleront jamais. Je n'ajouterai point que souvent un homme sans instruction juge aussi bien qu'un artiste des ouvrages qui sont du ressort de ce bon sens naturel, dont les arrêts infaillibles servent de fondement à tous les arts. Voilà un prologue assez étendu : je ne dois pas le pousser plus loin. [V] Au moment de m'occuper de Thucydide, je vais dire quelques mots des historiens qui vécurent avant lui, et de ceux qui florissaient dans le même siècle. Par ce moyen, on connaîtra mieux le caractère de son talent, et les qualités qui le placent au-dessus de ses prédécesseurs. Plusieurs historiens parurent sur divers points de la Grèce, longtemps avant la guerre du Péloponnèse. De ce nombre sont : Eugéon de Samos, Démoclès de Proconnèse, Eudème de Paros, Démoclès de Phigéla, Hécatée de Milet, Acusfiaüs d'Argos, Charonde Lampsaque, Amélésagoras de Chalcédoine. Immédiatement avant cette guerre, et jusqu'à l'époque de la naissance de Thucydide, florissaient Hèllanicus de Lesbos, Damaste de Sigée, Xénomède de Chio, Xanthus de Lydie et beaucoup d'autres. Leurs vues furent à-peu-près les mêmes dans le choix des sujets, et le caractère de leur esprit présente peu de différence. Les uns ont écrit l'histoire des Grecs ; les autres, l'histoire des Barbares. Les diverses parties de leurs ouvrages n'ont aucune liaison : ils n'établissent d'autre division que celle des nations et des villes, et racontent ce qui les concerne chacune en particulier. Ils se proposent tous un même but, celui de rassembler les traditions qui s'étaient conservées parmi chaque peuple et dans chaque contrée, soit dans les temples, soit dans les lieux publics, afin d'en perpétuer le souvenir : ils n'ajoutent, ils ne retranchent rien. Aussi, trouve-t-on chez eux un grand nombre de contes accrédités depuis longtemps, de catastrophes faites pour le théâtre et qui paraissent puériles aujourd'hui. Le style a les mêmes qualités dans tous ceux qui ont adopté le même dialecte : il est clair, sanctionné par l'usage, pur, concis, et proportionné au sujet ; jamais on n'y aperçoit la moindre affectation. Ils ont souvent des tours agréables, et plus ou moins de grâce : c'est ce qui les a fait vivre jusqu'à présent. Hérodote d'Halicarnasse, né peu de temps avant les guerres contre les Perses, et qui vécut jusqu'à la guerre du Péloponnèse, écrivit sur un plan plus vaste et plus majestueux. Son but ne fut pas de composer l'histoire d'un seul état ou d'un seul peuple ; mais celle de l'Europe et de l'Asie, en la renfermant dans un seul ouvrage. Il commence par l'empire des Lydiens, et s'étendant jusqu'aux guerres contre les Perses, il embrasse les événements les plus remarquables qui eurent lieu dans un espace de deux cent quarante ans. Il sut donner à son style les qualités qui manquèrent à ses prédécesseurs. [VI] Après eux parut Thucydide, qui ne voulut ni circonscrire son histoire dans un seul lieu, comme Hellanicus ; ni, comme Hérodote, embrasser dans un même ouvrage toutes les actions des Grecs et des Barbares. Il dédaigna la manière du premier, parce qu'elle lui paraissait commune et peu utile aux lecteurs ; et il ne suivit pas le plan du second, parce qu'il le regardait comme trop vaste, pour que l'esprit de l'homme put eu saisir toutes les parties à-la-fois. Il prit pour sujet la guerre des Athéniens contre le Péloponnèse, la traita avec le plus grand soin, et consacra à ce travail toutes ses forces physiques et intellectuelles. Comme il vécut jusqu'à la fin de cette guerre, ce n'est point d'un autre qu'il a appris les faits qu'il raconte : il en fut le témoin, il y prit part lui-même ; et lorsque l'exil l'eut éloigné du théâtre des événements, ils lui furent transmis par des hommes qui en avaient une parfaite connaissance. Le premier avantage de Thucydide sur les historiens qui l'ont précédé, est de n'avoir choisi ni un sujet composé d'une seule partie, ni un sujet divisé à l'infini ou formé de parties incohérentes. Le second consiste en ce qu'il n'a introduit dans son histoire aucun trait fabuleux, qu'il ne s'y permet rien pour séduire et tromper la multitude ; bien différent de ses devanciers, qui introduisent, au milieu des forêts et des bois, des lamies sortant du sein de la terre ; des naïades amphibies qui s'élancent du Tartare, voguent sur les mers, et s'entretiennent avec les hommes ; ou qui font naître d'un monstrueux commerce des êtres, dieux et hommes tout ensemble, et racontent d'autres merveilles auxquelles notre siècle n'ajoute aucune foi, ou qu'il regarde même comme l'œuvre de la folie. [VII] Mon but ici n'est pas de verser le blâme sur ces écrivains : je sais qu'ils sont dignes d'excuse, s'ils se jettent dans Je merveilleux, en traçant l'histoire particulière de quelques peuples et de quelques contrées. Chez toutes les nations, dans chaque ville, se conservaient les traditions dont je viens de parler. Les enfants les avaient reçues de leurs pères, ils étaient jaloux de les transmettre à leur postérité ; et les historiens qui entreprenaient de les publier, devaient les raconter telles qu'ils les avaient recueillies. Ils étaient donc dans la nécessité d'insérer dans leurs ouvrages ces épisodes mythologiques. Thucydide, qui avait choisi une guerre unique et à laquelle il avait pris part, ne devait ni mêler à sa narration ce merveilleux théâtral, ni tromper ses lecteurs par des fables que l'enfance de l'histoire peut seule excuser. Chez lui, tout devait tendre à l'utilité, comme il le dit lui-même dans son introduction : « Peut-être certains lecteurs ne trouveront-ils aucun agrément dans ces récits, dépouillés de merveilleux ; mais si les hommes jaloux de connaître le passé et de juger de l'avenir, qui, suivant toutes les probabilités humaines, doit ressembler au passé, reconnaissent l'utilité de mon travail, ce seul avantage me suffira : c'est un monument durable que j'ai voulu composer, et non pas un écrit d'apparat, destiné à n'amuser qu'un moment. » [VIII] Tous les philosophes, tous les critiques, ou du moins la plupart, avouent hautement que Thucydide a toujours en vue la vérité, dont l'histoire est la véritable prêtresse. Il n'ajoute, il ne retranche rien sans motif : il ne se permet jamais de licence et se montre toujours irréprochable, et également exempt d'envie et de flatterie, surtout dans ses jugements sur les grands hommes. Ainsi, dans le premier livre, en parlant de Thémistocle, il fait un pompeux tableau de ses bonnes qualités ; dans le second, à propos de l'administration de Périclès, il donne à ce grand homme des éloges dignes de son éclatante renommée. Conduit par son sujet à parler du général Démosthène, de Nicias, fils de Nicérate ; d'Alcibiade, fils de Clinias ; de plusieurs capitaines et d'une foule d'orateurs, son langage est proportionné à leur célébrité. Des exemples, à l'appui de mes assertions, ne paraîtront pas nécessaires à ceux qui ont lu son ouvrage. Telles sont, par rapport aux choses, les belles qualités qu'on doit imiter dans Thucydide. Mais son plus grand mérite, c'est que jamais il ne trompe volontairement, et que jamais il ne souille sa conscience. [IX] Les défauts que lui ont reprochés certains critiques, se rapportent au plan ; à cette partie importante qu'on recherche avant tout dans un écrivain, soit qu'il s'occupe de questions philosophiques, soit qu'il traite des sujets d'histoire. Ce qu'on trouve de défectueux en lui, c'est d'abord la division ; ensuite, la distribution des faits et la manière dont il les a traités. Je parlerai d'abord de sa division, en faisant observer qu'avant Thucydide tous les historiens avaient divisé leurs ouvrages d'après l'ordre des lieux et des temps, tandis qu'il n'a adopté aucune de ces divisions. Dans sa narration, il ne suit ni l'ordre des lieux où les faits se sont passés, comme Hérodote, Hellanicus et plusieurs autres ; ni l'ordre des temps, comme ceux qui écrivant une histoire locale, prirent pour division la succession des rois, des pontifes, des olympiades ou des archontes, dont les noms marquaient le commencement de chaque année. Thucydide voulut suivre une route que personne ne s'était frayée avant lui. Il prit pour division de son histoire les étés et les hivers ; mais le résultat de celte innovation a été contraire à son attente. Sa division, quoiqu'il l'ait faite d'après les saisons, loin d'avoir plus de clarté, est bien plus difficile à saisir. On doit s'étonner qu'il n'ait pas senti que plusieurs événements se passant à-la-fois dans des lieux différents, un récit coupé en une foule de subdivisions n'était pas propre à répandre une lumière vive et pure : les faits sont ici une preuve sans réplique. Dans le troisième livre, par exemple (pour ne parler que de celui-là), il commence le récit de ce qui se passa à Mitylène, et avant de l'achever, il entame les affaires de Lacédémone : il interrompt aussitôt cette nouvelle narration pour s'occuper du siège de Platée, le laisse de côté, et parle encore de la guerre de Mitylène, qu'il abandonne à l'instant pour raconter la sédition qui poussa les habitants de Corcyre à se déclarer, les uns pour Lacédémone et les autres pour Athènes. A peine a-t-il ébauché ce récit et dit quelques mots de la première expédition des Lacédémoniens en Sicile, de l'expédition navale des Athéniens contre Lacédémone, et de celle des Lacédémoniens contre la Doride, qu'il expose les exploits du général Démosthène auprès de Leucade, et durant la guerre contre les Étoliens. De là, il passe aux événements de Naupacte ; et bientôt interrompant le récit des guerres du continuent, avant de l'avoir achevé, il revient aux affaires de la Sicile. Il raconte la purification de Délos, et ne dit presque rien du siège d'Argos l'Amphilochien par les Ambraciotes. Qu'est-il besoin d'autrès citations ? Ce livre tout entier est morcelé de la même manière, et n'a rien de l'unité qui doit régner dans une histoire. L'esprit flotte dans le vague et a beaucoup de peine à suivre le fil de la narration ; parce qu'il est troublé par des faits mal exposés et sans ordre ; tandis que dans la composition historique, tout doit se lier et tendre à l'unité ; principalement, lorsqu'il s'agit de faits nombreux et difficiles à saisir. La preuve que cette division n'est ni bonne ni convenable, c'est qu'après Thucydide aucun historien n'a partagé son ouvrage par hivers et par étés : ils s'en tiennent tous à l'ancienne division, parce qu'elle jette plus de clarté. [X] On blâme aussi sa disposition : il n'a point commencé son histoire où il fallait, et il ne l'a pas terminée comme il l'aurait dû. Cependant, une des règles fondamentales de la disposition historique consiste à commencer sans omettre aucun fait antérieur, et à unir sans en laisser aucun à désirer. Thucydide parait avoir négligé cette règle. Ce qui donne lieu à ce reproche, c'est qu'après avoir dit, dès le début, que la guerre du Péloponnèse fut plus importante que toutes celles qui l'avaient précédée, tant par sa longueur qu'à cause des calamités dont elle fut marquée, il ne fait connaître qu'à la fin de son introduction les causes qui lui donnèrent naissance. Ces causes, il les réduit à deux : l'une véritable et qui n'était pas connue de tout le monde, l'accroissement de la puissance d'Athènes : l'autre qui ne fut qu'un prétexte allégué par les Lacédémoniens, les secours qu'Athènes avait fournis aux habitants de Corcyre contre Corinthe; néanmoins il parle d'abord, non pas de la cause qu'il regardait lui-même comme la véritable, mais de l'autre .Voici en quels termes il s'exprime : « Cette guerre éclata, parce que les Athéniens et les Lacédémoniens violèrent le traité de paix qu'ils avaient conclu pour trente ans, après la soumission d'Eubée. J'ai fait d'abord connaître les différends qui amenèrent l'infraction de ce traité, afin qu'on n'ait point à rechercher un jour d'où naquit une lutte si terrible au sein de la Grèce. La cause la plus certaine, mais en même temps la plus cachée, qui détermina les Lacédémoniens à celte guerre, ce fut l'accroissement de la puissance d'Athènes et les craintes qu'elle faisait naître ; quant au motif allégué pour la rupture des traités et la déclaration de guerre, le voici : la ville d'Epidamne se trouve à droite, en entrant dans la mer Adriatique. Près d'elle habitent les Taulantiens, peuple barbare de l'Illyrie, etc. » Immédiatement, il raconte ce qui se passa à Epidamne, à Corcyre, à Potidée, dans l'assemblée des Péloponnésiens à Sparte, et rapporte les discours prononcés contre Athènes. Ces détails remplissent environ deux mille lignes : c'est alors qu'il revient à la véritable cause de cette guerre, à celle qu'il juge telle lui-même. Il commence ainsi : « Les Lacédémoniens résolurent de rompre les traités et de déclarer la guerre à Athènes, entraînés bien moins par les paroles des alliés que par la crainte de voir tomber l'empire entre les mains des Athéniens, qui déjà tenaient sous leur domination la plus grande partie de la Grèce : voici par quels moyens ils avaient accru leur puissance.» Là, il parle des exploits de sa patrie depuis la guerre contre les Perses jusqu'à la guerre du Péloponnèse; ce récit abrégé et fait à la hâte a moins de cinq cents lignes. Il rappelle que ces événements sont antérieurs à ce qui eut lieu à Corcyre, et que ce n'est point de ces faits, mais de la jalousie de Lacédémone contre Athènes que cette guerre prit naissance. Il ajoute : « Quelques années après survinrent les événements que je viens de rapporter : on vit éclater entre Corcyre et Potidée les divisions qui servirent de prétexte à cette guerre. Tous ces événements, ainsi que les guerres civiles de la Grèce, et les expéditions contre les barbares, arrivèrent dans l'espace de cinquante ans, depuis la fuite de Xerxès jusques au commencement de cette guerre. Durant cette période, les Athéniens raffermirent leur puissance et lui donnèrent de grands accroissements. Les Lacédémoniens s'en aperçurent, mais ils s'y opposèrent faiblement : ils cherchaient le repos avant tout; d'abord, parce qu'ils n'étaient pas hommes à entreprendre la guerre en toute hâte, à moins qu'ils n'y fussent réduits par la nécessité ; et ensuite, parce qu'ils étaient occupés par des hostilités particulières. Mais lorsque la puissance d'Athènes se fut visiblement agrandie, et attaqua même les alliés de Sparte, les Lacédémoniens ne purent se contenir : ils crurent qu'il fallait tout tenter, et marcher aux combats, pour renverser leurs rivaux s'ils en avaient encore les moyens. » [XI] Thucydide, après avoir recherché les causes de cette guerre, aurait dû faire connaître d'abord celles qui lui paraissaient être les véritables. L'ordre naturel des choses exige qu'on expose ce qui a précédé avant ce qui a suivi, et le vrai avant le faux : cette digression, tracée sur ce plan, dès le commencement, eût été bien préférable; Les apologistes de Thucydide ne peuvent dire que c'étaient des choses futiles, peu dignes d'être racontées, triviales et si souvent traitées par ses prédécesseurs qu'il n'était pas nécessaire de commencer par là. Thucydide s'est occupé de ces faits, parce que les anciens historiens les avaient négligés : il ne les a pas jugés indignes de l'histoire. Il s'exprime ainsi à ce sujet : « Je me suis permis cette digression, et j'ai raconté ces événements, parce que les historiens, mes prédécesseurs, n'en ont rien dit : ils se sont bornés à écrire l'histoire de la Grèce avant les guerres contre les Perses, ou ces guerres mêmes ; Hellanicus, dans son histoire de l'Attique, n'a fait qu'en ébaucher le récit, et encore ne suit-il pas exactement l'ordre des temps. De plus, cette digression a pour but de faire connaître ce qu'était la puissance d'Athènes.» [XΙI] Cet exemple démontre suffisamment que Thucydide n'a pas adopté pour son récit une disposition sage et naturelle : il ne l'a pas fini non plus comme il le devait. En effet, après avoir choisi pour sujet une guerre qui dura vingt-sept ans, et quoiqu'il ait vécu jusqu'à la fin de cette guerre, il termine le dernier livre à la vingt-deuxième année, c'est-à-dire, à la bataille navale de Cynossème. Cependant, il avait dit dans son introduction qu'il rapporterait tous les événements. De même, dans le cinquième livre, après avoir rappelé, en peu de mots, les époques qu'il a parcourues depuis le commencement de son ouvrage jusqu'à l'endroit où il est parvenu, il ajoute : « Ceux qui veulent appuyer leur opinion sur les oracles verront que de toutes les prédictions, c'est la seule qui ait été confirmée par l'événement. Je me souviens que, depuis le commencement de la guerre jusqu'à la fin, on ne cessa de répéter partout qu'elle devait durer vingt-sept ans. Pendant cette période, j'ai conservé toute la force de ma raison, et je me suis appliqué à recueillir les détails les plus fidèles. Après avoir commandé l'armée à Amphipolis, j'ai vécu vingt ans en exil. Je me suis trouvé tour à tour chez les deux peuples rivaux, et j'ai pu, durant mon exil, connaître les affaires de Lacédémone et rassembler paisiblement les renseignements les plus exacts. Je vais exposer les différends qui s'élevèrent entre Athènes et Lacédémone, la dixième année de leur alliance, ainsi que l'infraction des traités et les événements de la guerre. » [XIII] Thucydide ne traite point les faits avec assez de soin : il développe trop ceux qui demanderaient de la concision, et il expose avec trop de concision ceux qui exigeraient des développements. Je pourrais justifier cette assertion par une foule d'exemples : je me bornerai à un petit nombre. A la fin du second livre, il fait un long récit d'un combat naval entre les Athéniens et les Lacédémoniens, dans lequel les Athéniens, avec une flotte de vingt vaisseaux, combattirent seuls contre une flotte ennemie, composée de quarante - sept vaisseaux. Dans le premier livre, au contraire, il raconte en peu de mots les combats des Athéniens contre des essaims de Barbares, et les batailles navales, dans lesquelles ils détruisirent ou prirent autant de vaisseaux tout équipés, qu'ils en avaient préparés eux-mêmes pour la guerre. Voici les paroles de Thucydide : « Bientôt après, les Athéniens et leurs alliés livrèrent contre les Perses un combat sur terre, près du fleuve Eurymédon dans la Pamphylie, et un combat sur mer. En un jour, ils remportèrent une double victoire, sous la conduite de Cimon, fils de Miltiade.Ils prirent ou détruisirent les trirèmes des Phéniciens, au nombre de deux cents. » De même, quand il parle des combats sur terre, il est ou prolixe ou concis outre mesure. Par exemple, il commence, dans le quatrième livre, à raconter les exploits des Athéniens aux environs de Pylos et de l'île de Sphactérie, où ils avaient enfermé les Lacédémoniens : en même temps, il entame divers événements de cette guerre, reprend sa première narration, expose avec les plus grands détails des combats peu importants que se livrèrent les deux peuples, consacre à ce récit plus de trois cents lignes, quoique le nombre des morts ou des soldats qui mirent bas les armes ne fût pas considérable ; et résumant ensuite tous les faits, il s'exprime en ces termes : « Voici le nombre des soldats tués ou faits prisonniers dans l'île. Ils y étaient venus au nombre de quatre cent vingt ; deux cent quatre-vingt-douze furent pris et transportés à Athènes ; les autres avaient été tués. Parmi les prisonniers, il se trouva cent vingt Spartiates environ. Les Athéniens ne perdirent que peu de soldats. » [XIV] Il dit, en parlant du généralat de Nicias, que parti d'Athènes avec soixante vaisseaux et deux mille hoplites, il fît voile vers le Péloponnèse, renferma les Péloponnésiens dans les places fortes, assiégea les habitants de Cythère, incendia une grande partie du Péloponnèse, et fit beaucoup de prisonniers qu'il conduisit lui-même à Athènes. Nous allons voir avec quelle rapidité il raconte ce qui se passa à Cythère : « Un combat s'engagea : les habitants de Cythère, après une courte résistance, prirent la fuite et se retirèrent dans la partie la plus élevée de leur ville : ensuite, ils entrèrent en négociations avec Nicias et les autres chefs de l'armée d'Athènes, et se mirent à leur discrétion, sous la condition qu'ils auraient la vie sauve. » Au sujet des Eginètes pris à Thyréa, il dit : « Les Athéniens abordent à Thyréa : ils font approcher toutes leurs forces, prennent la ville, la livrent aux flammes, et détruisent tout ce qu'elle renferme. Les Eginètes, qui avaient échappé au fer, furent faits prisonniers et conduits à Athènes. » Dès le commencement de la guerre, de grands malheurs étaient venus fondre sur les deux nations : réduites à désirer la paix, elles s'envoyèrent réciproquement des députa lions. Il dit qu'Athènes voyant son territoire dévasté, ses habitants moissonnés par la peste, et n'espérant plus de secours, envoya des ambassadeurs à Sparte, pour demander la paix ; mais il ne rapporte ni les noms de ces ambassadeurs, ni les discours qu'ils prononcèrent, ni les paroles des orateurs qui combattirent leur proposition, et déterminèrent les Lacédémoniens à la rejeter. Il expose les faits avec négligence, comme s'ils avaient été peu remarquables et sans importance : « Après la seconde invasion des peuples du Péloponnèse, dit-il, les Athéniens voyant leur territoire démembré, et tourmentés tout-à-la-fois par la peste et par la guerre, changèrent de sentiments. Ils accusaient Périclès, qui avait conseillé cette guerre, de les avoir précipités dans un abîme de maux. Résolus à faire des concessions aux Lacédémoniens, ils leur envoyèrent des ambassadeurs, et ne purent rien obtenir. » Au contraire, lorsqu'il parle de la députation envoyée par Lacédémone, et qui devait réclamer les trois cents soldats pris à Pylos, il rapporte les discours que prononça le chef de l'ambassade, et donne les raisons qui s'opposèrent à la conclusion du traité. [XV] Si, en rendant compte de l'ambassade des Athéniens, une exposition abrégée lui parut suffisante ; s'il ne trouva pas nécessaire de rapporter les discours et les moyens de persuasion qu'employèrent les ambassadeurs, ni les discours des Lacédémoniens qui soutenaient ou combattaient cette proposition; pourquoi n'a-t-il pas suivi la même marche à l'égard des ambassadeurs de Sparte qui vinrent à Athènes, puisqu'ils s'en retournèrent aussi, sans obtenir la paix? S'il s'est cru obligé à une exactitude scrupuleuse à l'égard de Lacédémone, pourquoi tant dé négligence pour les affaires d'Athènes ? Certes, on ne dira pas que le talent lui manquait pour trouver ou pour rendre les discours prononcés dans cette circonstance. Si quelque raison particulière l'empêcha de parler en détail de l'une ou de l'autre de ces députations, je ne peux deviner pourquoi il a choisi celle de Lacédémone qui, moins ancienne et amenée par de moindres calamités, concernait une ville étrangère, plutôt que celle de sa patrie, qui fut occasionnée par des malheurs plus considérables. Forcé de faire souvent mention de la prise et de la destruction des villes, de l'asservissement de leurs habitants, et d'autres malheurs aussi déplorables, il donne quelquefois à ses récits une couleur si sombre, si vive et si touchante, qu'aucun historien, qu'aucun poète n'y pourrait rien ajouter : d'autres fois, il les fait si négligemment et avec des traits si faibles, qu'ils ne laissent point de trace dans l'âme du lecteur. Ainsi, quand il parle des malheurs de Platée, de Mytilène et de Mélos, il déploie toute la force de son talent. Je ne crois pas nécessaire de le prouver par des exemples; mais dans d'autres endroits assez nombreux, il est négligé et semble chercher à diminuer la grandeur des désastres. En voici quelques-uns de ce genre : « Vers cette époque, les Athéniens prirent Scione d'assaut, firent périr toute la jeunesse, réduisirent à l'esclavage les femmes et les enfants, et donnèrent aux Platéens le territoire à cultiver. » Et ailleurs : «Les Athéniens entrèrent de nouveau dans l'Eubée, sous la conduite de Périclès, et la firent passer sous leur empire : une partie de cette île fut admise à faire sa soumission ; mais les habitants d'Hestiée furent bannis de leur ville, et les Athéniens s'emparèrent de leur territoire. » — « Dans le même temps, ils chassèrent les Eginètes de leur patrie, ainsi que leurs femmes et leurs enfants, les accusant d'être les principaux moteurs de cette guerre : ils croyaient qu'ils seraient plus sûrs d'Egine, qui touche au Péloponnèse, s'ils la peuplaient de leurs colonies. » [XVI] On rencontre dans son histoire un grand nombre de passages écrits avec un véritable talent, et dans lesquels on ne peut rien ajouter ni rien supprimer ; d'autres décèlent beaucoup de négligence et de précipitation : on n'y découvre aucune trace de cette véhémence qui le caractérise. Ceci doit surtout s'appliquer aux discours, aux dialogues et aux diverses harangues : Thucydide l'ayant senti, semble avoir laissé son histoire incomplète, comme l'écrit un auteur contemporain, Cratippe, qui a recueilli les faits omis par Thucydide. Il dit que chez lui les discours nuisent à l'action, fatiguent les lecteurs, et qu'il semble l'avoir compris lui-même ; car à la fin de son histoire, il n'insère aucun discours, quoique dans l'Ionie et à Athènes il se fût passé une foule d'événements qui durent donner lieu à des pourparlers et à des discours. En comparant le premier livre avec le huitième, on n'y voit ni la même manière ni le même talent. Dans l'un les faits sont peu nombreux, sans importance, et les discours abondent : l'autre, au contraire, renferme beaucoup de faits importants ; mais les discours y sont fort rares. [XVII] Un autre défaut que je trouve dans ses discours, c'est que sur le même sujet et dans les mêmes circonstances, il en emploie d'inutiles, et laisse de côté ceux qui seraient nécessaires. On le voit dans le troisième livre, au sujet des affaires de Mitylène. Après la prise de cette ville et l'arrivée des prisonniers envoyés par le général Pachès, deux assemblées furent tenues à Athènes. Thucydide n'a pas cru devoir rapporter les discours prononcés dans la première par les démagogues ; et cependant, le peuple décréta dans cette assemblée que les prisonniers et la jeunesse de Mitylène seraient mis à mort ; tandis que les femmes et les enfants seraient réduits à l'esclavage. Quant aux discours tenus, à la môme occasion, dans la seconde assemblée, lorsque déjà la plupart des Athéniens se repentaient de leur première résolution, il les rapporte tous, comme s'ils étaient d'une grande importance. [XVIII]. Et cet éloge funèbre si vanté, que nous trouvons dans le second livre, pour quelle raison l'a-t-il placé là plutôt que dans tout autre endroit ? Soit qu'au milieu des grandes calamités qui coûtaient la vie à tant de braves citoyens, un orateur dût déposer sur leur tombe l'hommage de la douleur publique j soit qu'après des succès mémorables, qui répandaient sur la patrie une grande gloire, tout en augmentant sa puissance, on eût coutume d'honorer par un éloge funèbre ceux qui les avaient achetés au prix de leurs jours, ce panégyrique trouverait mieux sa place partout ailleurs. Les Athéniens qui périrent dans la première invasion des Péloponnésiens étaient en petit nombre et ne se signalèrent par aucune action d'éclat, d'après Thucydide lui-même. Il commence par dire au sujet de Périclès : « Il défendit Athènes et y maintint la paix autant qu'il le put ; mais il ordonnait des sorties continuelles de cavalerie contre les ennemis, pour les empêcher de faire des incursions sur le territoire d'Athènes et de le ravager. » Puis il ajoute : « Un léger combat fut livré, aux environs de Phrygies, par un escadron de la cavalerie des Athéniens et des Thessaliens contre la cavalerie des Béotiens. Les premiers n'eurent point de désavantage, jusqu'au moment où des hoplites vinrent au secours des Béotiens : alors ils furent repoussés. La perte du côté des Athéniens et des Thessaliens fut peu considérable : le même jour, ils enlevèrent les restes de leurs concitoyens sans avoir traité. Le lendemain, les Péloponnésiens érigèrent un trophée. » Dans le quatrième livre, il parle des guerriers qui, sous la conduite de Démosthène, combattirent sur terre et sur mer, auprès de Pylos, contre des troupes nombreuses de Lacédémone, et par un double triomphe couvrirent leur patrie de gloire : ils étaient plus nombreux et plus braves que ceux qu'il a célébrés dans son panégyrique. Pourquoi, à propos d'une poignée de cavaliers qui ne procurèrent à leur patrie ni puissance ni éclat, l'historien ouvre-t-il les tombeaux publics et charge-t-il Périclès, le plus célèbre des orateurs, de prononcer une pompeuse et touchante oraison funèbre ; tandis que le trépas d'autres guerriers, bien supérieurs en nombre et en courage, et dont la valeur fit éprouver un échec à ceux qui avaient porté la guerre au sein de l'Attique, n'obtient pas une seule louange ? ils avaient pourtant bien mieux mérité un si grand honneur. Je ne rappellerai point tous les combats sur terre et sur mer, où périrent une foule de guerriers plus dignes d'un éloge funèbre que dix ou quinze éclaireurs ramassés au hasard ; mais les Athéniens et les alliés qui, au nombre de quarante mille, sous la conduite de Nicias et de Démosthène, trouvèrent la mort dans la Sicile, en combattant sur terre et sur mer, ou dans la fuite la plus malheureuse, sans que leurs restes aient pu être recueillis dans la tombe que les lois leur garantissaient, n'avaient-ils pas plus de droits à un tel hommage ? Thucydide traite ce qui a rapport à ces braves avec une telle négligence qu'il ne dit pas même si un deuil public fut ordonné ; si la patrie daigna payer à leur mémoire les honneurs qu'elle avait coutume de rendre aux citoyens morts sur une terre étrangère, tandis qu'il charge l'orateur le plus distingué de célébrer quelques soldats obscurs. Il n'était pas juste cependant qu'Athènes, après avoir pleuré la perte de quinze cavaliers, n'accordât aucun témoignage de sa douleur au trépas d'autres guerriers, dont le nombre, suivant les registres militaires, s'élevait au-delà de cinq mille. Je dirai toute ma pensée : l'historien a voulu faire figurer sur la scène un orateur tel que Périclès et mettre dans sa bouche un éloge funèbre ; mais comme Périclès était mort la seconde année de cette guerre, sans avoir été témoin des calamités qui, plus tard, accablèrent la république, Thucydide, à propos d'un fait peu important et qui ne méritait aucune attention, a composé cet éloge bien au-dessus d'un semblable événement. [XIX] Pour mieux sentir encore combien sa manière est vicieuse dans l'exposition des faits, il suffit de considérer que laissant de côté une foule d'événements d'une grande importance, il fait une introduction de plus de cinq cents lignes, pour montrer que les exploits des Grecs, avant cette guerre, furent peu remarquables et ne peuvent lui être comparés. Cette assertion n'est pas fondée : il serait facile de le prouver. D'ailleurs l'art n'indique point une semblable marche pour amplifier. Une action, pour être importante, ne doit pas seulement se distinguer des actions peu remarquables ; mais éclipser même les plus éclatantes. Son introduction expose si longuement le but de l'ouvrage, qu'elle forme une histoire à part ; tandis que les rhéteurs enseignent que l'exorde doit se borner à donner une idée du sujet, et à le faire connaître en général. C'est ce que Thucydide fait lui-même à la fin de son introduction, en moins de cinquante lignes, au moment de commencer son introduction : on voit par-là qu'il ne devait pas entrer dans d'aussi grands détails pour abaisser la grandeur de la Grèce ; ni dire par exemple, qu'à l'époque de la guerre de Troie, toute la contrée, qui dans la suite fut appelée Grèce, ne portait point le même nom, que le manque de nourriture forçait les habitants à naviguer le long des côtes, et qu'attaquant des villes qui n'avaient point de murs pour se défendre et dont les citoyens étaient dispersés dans des bourgades, ils les pillaient et le plus souvent se procuraient ainsi des subsistances. Pourquoi parler de l'ancien luxe des Athéniens ; pourquoi dire qu'ils liaient leurs cheveux sur leurs fronts avec des agrafes d'or, qui avaient la forme d'une cigale ; ou bien, que dans les premiers temps, les athlètes de Lacédémone se dépouillaient de leurs vêtements et répandaient de i'huile sur leurs membres, en présence des spectateurs, au moment de la lutte ? Pourquoi rappeler qu' Aménoclès de Corinthe fut le premier qui construisit quatre galères pour les Samiens ; que Polycrate, tyran de ce peuple, s'empara de Rhénia, et la consacra à Apollon, dieu de Délos ; que les Phocéens, fondateurs de Marseille, gagnèrent une bataille sur les Carthaginois ? Comment ces faits et d'autres ont-ils pu trouver leur place avant la narration ? [XX] S'il m'est permis de dire toute ma pensée, son introduction aurait été à l'abri de la critique, s'il avait placé la fin immédiatement après le début, et laissé de côté tous les faits intermédiaires ; s'il eût dit par exemple : « Thucydide d'Athènes a écrit la guerre qui eut lieu entre les Lacédémoniens et les Athéniens, ainsi que les divers exploits des deux peuples ; il en a rassemblé tous les événements, depuis son origine, parce qu'elle lui a paru plus importante que toutes celles qui l'ont précédée ; il a fondé ses conjectures sur ce que les nations belligérantes étaient dans la plus grande prospérité, et déployèrent toutes leurs forces. De plus, le reste de la Grèce se déclara pour un des deux peuples, dès le commencement, ou du moins en formait le projet. Ce fut la plus terrible des secousses non seulement pour la Grèce, mais encore pour les pays barbares, et pour la plupart des nations. Les événements qui l'ont immédiatement précédée et d'autres plus anciens encore ne peuvent être bien connus, à cause de l'éloigneraient des temps ; mais d'après toutes les probabilités, et autant qu'il m'est possible d'en juger avec quelque assurance, en portant mes regards vers les siècles passés, ils furent peu remarquables, tant dans la guerre que dans tout le reste. Je n'ajoute pas une grande confiance aux poètes, toujours portés à embellir, ni aux anciens historiens, qui s'attachèrent à charmer le lecteur, bien plus qu'à faire connaître la vérité. Le temps a relégué leurs récits dans le domaine de la fable : ils ne paraissent plus croyables aujourd'hui. J'espère avoir appuyé tous les faits sur des conjectures aussi certaines que le permettait la distance des temps. Quoique les hommes soient portés à regarder comme très importantes les entreprises auxquelles ils prennent part, tandis que, rendus au repos, ils admirent davantage les événements anciens, à en juger par les faits mêmes, cette guerre paraîtra toujours plus mémorable que celles qui l'avaient précédée. Rappeler avec exactitude tous les discours prononcés, lorsqu'on se préparait à la guerre ou pendant sa durée, c'était un travail difficile pour moi, quand je les avais entendus, et pour ceux qui m'en rendaient compte, quelle que fût la source où ils les avaient puisés. J'ai cherché à donner à chaque orateur le ton qu'exigeaient les circonstances, et je me suis tenu, pour le fond des pensées, le plus près qu'il était possible de ce qui avait dû être dit en effet. Quant aux faits, je n'ai pas cru devoir les raconter au hasard et tels qu'ils m'ont été transmis, ni m'en rapporter à moi seul ; j'ai pris auprès des autres les informations les plus exactes même sur ceux dont j'avais été le témoin. Il m'a été difficile de découvrir la vérité, parce que ceux qui avaient assisté aux événements les racontaient diversement, d'après leurs dispositions personnelles, ou la fidélité de leur mémoire. Mon ouvrage, dépouillé du merveilleux, aura peut-être moins d'agréments ; mais si les hommes jaloux de connaître le passé ou de lire dans l'avenir, qui, suivant toutes les probabilités, doit ressembler au passé, retirent quelque utilité de mon travail, tous mes vœux seront satisfaits. C'est un monument durable que j'ai voulu composer pour la postérité, et non pas un écrit d'apparat, destiné à n'amuser qu'un moment. Jusqu'à cette époque, l'événement le plus mémorable, dans la Grèce, fut l'expédition contre les Perses : cependant, deux combats sur mer et un combat sur terre la conduisirent bientôt à son terme. La guerre dont j'entreprends le récit fut d'une longue durée et attira sur la Grèce des désastres tels que jamais on n'en vit d'aussi grands dans le même espace de temps. Jamais autant de villes ne tombèrent au pouvoir des ennemis, ou ne furent détruites ; les unes par les barbares, les autres par les deux peuples rivaux : plusieurs même eurent de nouveaux maîtres et changèrent d'habitants. Jamais on ne vit tant de bannissements ni tant de massacres, nés de la guerre ou des divisions. Des événements connus par la tradition, mais rarement confirmés par les effets, ne doivent plus paraître incroyables, après les violents tremblements de terre qui, durant cette guerre, agitèrent une partie de l'Univers : il y eut aussi beaucoup plus d'éclipsés de soleil qu'on n'en compta dans tout autre temps ; de grandes sécheresses, et, avec elles, la famine et des maladies contagieuses qui firent des ravages horribles et dévorèrent une partie de la population; en un mot, tous les fléaux à la fois vinrent fondre sur la Grèce. Cette guerre éclata entre Athènes et le Péloponnèse, à la suite de la violation des traités qui avaient été conclus pour trente ans, après la prise d'Eubée. J'ai déjà fait connaître les divisions qui furent la source de cette rupture, afin qu'on n'ait pas à rechercher un jour l'origine de cette guerre. » [XXI] Tels sont, sous le rapport des choses, les défauts et les beautés de Thucydide. Je dois à présent m'occuper de son style : c'est là surtout que se montre son caractère. Avant de commencer cet examen, il ne sera pas inutile de rappeler en combien de parties se divise l'oraison ; quelles en sont les beautés ; quel fut le caractère du style historique, avant Thucydide ; ce qu'il gagna ou ce qu'il perdit entre ses mains : surtout, j'aurai soin de ne rien dissimuler. [XXII] Le style renferme deux parties bien distinctes : le choix des mots destinés à exprimer les choses, et l'arrangement des diverses parties de l'oraison, tant des principales que des secondaires. Chacune de ces divisions en contient d'autres : ainsi, le choix des mots embrasse ce qui a rapport aux éléments du discours, tels que les noms, les verbes, les conjonctions, le sens propre, le sens figuré ; et l'arrangement des mots, oc qui a rapport aux incises, aux membres, aux périodes. De plus, les mots simples et élémentaires, comme ceux qui en dérivent, sont soumis à certaines figures. Enfin, parmi les qualités du style, les unes sont indispensables et doivent exister dans toutes les compositions ; les autres sont accessoires et ne peuvent trouver leur place qu'autant que les premières existent déjà. Ailleurs, j'ai longuement traité cette matière : je n'ai pas besoin de m'occuper ici de cet objet, ni des règles qui s'y rapportent, ni des moyens d'acquérir les diverses qualités de l'élocution, qui sont très nombreuses : j'ai composé un traité particulier sur ce sujet. [XXIII] Je commencerai, comme je l'ai promis, par exposer en peu de mots quelles furent les qualités du style dans les devanciers de Thucydide, et quelles sont celles dont on aperçoit à peine la trace dans leurs écrits. Par-là, nous aurons une idée plus nette de son caractère. Malheureusement, il est difficile de dire au juste quel genre de style employèrent les historiens les plus anciens : on ne les connaît que de nom ; et l'on ne sait pas si leur diction était simple et sans art; si elle se permit le le superflu ou se borna au nécessaire et à l'utile; enfin, si elle fut pompeuse, noble, travaillée et embellie d'ornements empruntés. La plupart de leurs ouvrages ne nous sont point parvenus ; et ceux qui ont échappé au naufrage du temps ne sont pas tous regardés comme sortis de la plume des écrivains auxquels on les attribue. Tels sont, par exemple, les fragments de Cadmus de Milet, d'Aristéas de Proconnèse, et de plusieurs autres. Les historiens qui florissaient avant la guerre du Péloponnèse, et qui vécurent jusqu'au temps de Thucydide, adoptèrent presque tous le même style : les uns choisirent le dialecte Ionien, qui dominait alors ; les autres, l'ancien dialecte d'Athènes qui en différait très peu. Ils préférèrent, comme je l'ai déjà dit, les expressions propres aux expressions figurées : celles-ci ne furent pour eux qu'un simple assaisonnement. Chez tous ces écrivains, l'arrangement des mots est le même, c'est-à-dire, simple et sans art. Ils ne cherchaient point à présenter leurs pensées sous des tours figurés, propres à les distinguer des locutions usitées et vulgaires : aussi, leur style n'a-t-il que les qualités indispensables. Il est pur, clair, concis et assez conforme au caractère de chaque dialecte : quant à ces qualités accessoires qui font briller le talent de l'écrivain, ils ne les possèdent pas au suprême degré : à peine en trouve-t-on quelques-unes chez eux ; et encore sont-elles faiblement ébauchées : je veux parler de l'élévation, de l'élégance, de la noblesse, de la majesté : ils n'ont ni cette véhémence, ni cette force, ni ce pathétique, qui tiennent l'esprit en éveil ; ni cet impétueux essor, si propre aux violons débats et qui constitue la supériorité de l'éloquence. Hérodote seul en offre une image. Pour le choix et l'arrangement des mots, ainsi que pour la variété des figures, il éclipsa tous ses devanciers : il a donné à sa prose la physionomie de la poésie, par le naturel, la grâce et une douceur que rien ne saurait égaler. En lui brillent les qualités les plus heureuses et les plus séduisantes, à l'exception de celles que demandent les discussions animées ; soit que la nature les lui eût refusées, soit que son goût les lui fit regarder comme incompatibles avec le ton de l'histoire. Il emploie rarement des discours propres aux grands débats, ou des harangues d'un autre genre : jamais il ne cherche à remuer les passions, ni à agrandir les objets. [XXIV] Thucydide étudia le style d'Hérodote et des autres écrivains dont j'ai parlé : il observa les qualités de chacun d'eux, et il introduisit dans l'histoire un langage que ses prédécesseurs n'avaient pas soupçonné. Dans le choix des mots, il substitua les expressions figurées, obscures, surannées, étrangères, aux expressions simples et usitées de son temps ; dans l'arrangement des parties plus ou moins importantes de l'oraison, il préféra un arrangement pompeux, austère, énergique, ferme et propre à frapper par la rudesse des sons, à un arrangement gracieux, doux et coulant, sans jamais choquer l'oreille : il donna surtout ses soins au choix des figures ; car c'est par là qu'il voulait éclipser tous ses prédécesseurs. Depuis le commencement de la guerre jusqu'à la fin, il passa vingt-sept ans à composer les huit livres de son histoire, les seuls qu'il nous a laissés, les retouchant sans cesse, limant et polissant chaque phrase et chaque mot. Tantôt il fait la phrase avec un seul nom qu'il développe, et tantôt il resserre une phrase entière en un seul nom : ici, il change les verbes en noms ou les noms en verbes ;, là, par un abus étrange, il se sert d'un nom appellatif à la place du nom, ou de celui-ci à la place de l'autre : il emploie le passif pour l'actif, l'actif pour le passif ; le pluriel pour le singulier, le singulier pour le pluriel ; le masculin pour le féminin, le féminin pour le masculin ou le neutre, et s'écarte des règles naturelles de la concordance. Quant aux cas des noms et des participes, il les transporte tantôt du signe à la chose signifiée et de la chose signifiée au signe. Dans l'emploi des conjonctions et surtout des prépositions, qui augmentent la force des mots, il pousse la licence plus loin que les poètes. On trouve chez lui plusieurs figures qui, soit à cause «lu changement des personnes et des temps, soit parce qu'elles sont fondées sur dos rapports peu naturels, s'éloignent du langage ordinaire et sont voisines du solécisme. Combien de fois ne met-il pas les choses à la place des personnes, et les personnes à la place des choses ? Combien de fois, avant d'arriver à la conclusion, ne coupe-t-il pas ses raisonnements par de longues parenthèses, qui les rendent obscurs, entortillés, inextricables ? Quelle recherche, quelle affectation dans une foule de tours! Il multiplie les périodes à membres symétriques, les paronomases, les antithèses, et tous ces ornements puérils dont Gorgias de Léontium, Polus, Licymnius et d'autres sophistes contemporains se montrèrent si prodigues. Le trait le plus saillant du caractère de Thucydide, c'est qu'il s'efforce de dire beaucoup de choses en peu de mots, de renfermer plusieurs pensées en une et de laisser le lecteur sur sa faim : c'est pourquoi sa concision le rend obscur. Pour tout dire en deux mots, le style de Thucydide renferme quatre qualités qui en sont comme les organes : l'arrangement poétique des mots, la variété des figures, la rudesse des sons, la brièveté de l'expression. Les nuances qui le caractérisent consistent en ce qu'il est tour-à-tour âpre, serré, mordant, austère, grave, véhément, propre à inspirer la terreur, et surtout pathétique. Voilà en quoi Thucydide diffère des autres dans son style. Lorsqu'il se laisse aller à son élan et à sa puissance, les résultats sont remarquables et divins, lorsque cet élan se brise, le ton s'écroule. A cause de la vitesse du récit, le style devient obscur et alors il en devient difforme. La façon de raconter ce qui s'est passé et savoir arrêter au bon moment, beaux préceptes nécessaires dans toutes ses compositions, ne sont pas toujours respectés dans son ouvrage. [XXV] Après les observations que je viens à exposer sommairement, il est temps d'en venir aux preuves. Je n'examinerai pas toutes les qualités du style de Thucydide, en joignant à chaque observation des passages de cet historien : je m'attacherai à certaines parties et à certains passages. Je ferai quelques extraits de ses récits et de ses discours, et j'assignerai aux beautés et aux défauts qui s'y trouvent, tant par rapport au style que par rapport aux pensées, les causes qui les ont produits. Ici, je vous prie de nouveau, vous et les autres littérateurs qui pourront jeter les yeux sur ce traité, de ne pas perdre de vue que mon but est de faire connaître le caractère de Thucydide, d'embrasser tout ce qui doit fixer l'attention dans son ouvrage : je cherche à être utile à ceux qui voudront l'imiter. Au commencement de son introduction, pour montrer que la guerre du Péloponnèse fut plus considérable que celles qui l'avaient précédée, il s'exprime ainsi : « L'éloignement des temps ne permet pas de connaître avec certitude les événements antérieurs à cette guerre, ni d'autres plus anciens encore. Mais, d'après mes conjectures, et autant que j'ai pu reporter avec quelque confiance mes regards vers les siècles passés, je ne pense point que jusqu'à cette époque, il se soit rien passé d'important, soit dans la guerre, soit ailleurs. Les peuples du pays que nous appelons aujourd'hui la Grèce n'avaient pas autrefois des habitations fixes. Dans l'origine, il arrivait de perpétuelles émigrations, parce que souvent une peuplade, attaquée par une autre plus nombreuse, était forcée de quitter sa demeure. Il n'existait point de commerce, la terreur qu'ils s'inspiraient mutuellement empêchait toute communication, soit sur terre, soit sur mer. Ils ne cherchaient des ressources que pour vivre : ils n'avaient pas de richesses et n'ensemençaient pas les terres. Ignorant toujours si une peuplade voisine ne viendrait point piller leur habitation; sans remparts pour leur défense, et persuadés qu'ils pourraient trouver partout des subsistances, ils quittaient sans peine la contrée où ils s'étaient établis. » Dans ce passage : « τῶν δὲ Λακεδαιμονίων οὐκέτι ὀξέως ἐπεκθεῖν ἧι προσπίπτοιεν δυναμένων, γνόντες αὐτοὺς οἱ ψιλοὶ βραδυτέρους ἤδη ὄντας τῶι ἀμύνασθαι, καὶ αὐτοὶ τῆι τε ὄψει τοῦ θαρσεῖν τὸ πλεῖστον εἰληφότες πολλαπλάσιοι φαινόμενοι καὶ ξυνειθισμένοι μᾶλλον μηκέτι δεινοὺς αὐτοὺς ὁμοίως σφίσι φαίνεσθαι, ὅτι οὐκ εὐθὺς ἄξια τῆς προσδοκίας ἐπεπόνθεσαν, ὥσπερ ὅτε πρῶτον ἀπέβαινον τῆι γνώμηι δεδουλωμένοι ὡς ἐπὶ Λακεδαιμονίους, καταφρονήσαντες καὶ ἐμβοήσαντες ἁθρόοι ὥρμησαν ἐπ' αὐτοὺς » « Comme les Lacedémoniens ne pouvaient plus fondre brusquement sur nos rangs, les soldats armés à la légère, observant que les ennemis s'épuisaient pour se défendre, reprirent courage quand ils se virent plus nombreux. D'ailleurs, ils s'étaient accoutumés à les regarder comme moins redoutables, depuis qu'ils avaient eu moins à souffrir qu'ils ne l'avaient cru, au moment où ils s'avançaient contre eux, vaincus d'avance par la terreur qui remplissait leur âme, en marchant contre des Lacédémoniens. Ils finirent par les mépriser et se jetèrent tous ensemble sur eux, en poussant des cris. » : il valait mieux employer un autre tour plus usité, et plus facile ; par exemple, placer le dernier membre après le premier, et rejeter à la fin celui qui se trouve au milieu. Le tour adopté par Thucydide donne au style plus de vivacité et plus d'énergie; mais la phrase aurait plus de clarté et plus de grâce, s'il s'était exprimé de cette manière : «Τῶν δὲ Λακεδαιμονίων οὐκέτι ἐπεκθεῖν, ᾗ προσπίπτοιεν, δυναμένων, γνόντες αὐτοὺς οἱ ψιλοὶ βραδυτέρους ἤδη, συστραφέντες καὶ ἐμβοήσαντες, ὥρμησαν ἐπ´ αὐτοὺς ἀθρόοι· ἔκ τε τῆς ὄψεως τὸ θαρρεῖν προσειληφότες, ὅτι πολλαπλάσιοι ἦσαν, καὶ ἐκ τοῦ μηκέτι δεινοὺς αὐτοὺς ὁμοίως σφίσι φαίνεσθαι καταφρονήσαντες, ἐπειδὴ οὐκ εὐθὺς ἄξια τῆς προσδοκίας ἐπεπόνθεσαν, ἣν ἔσχον ὑπόληψιν, ὅτε πρῶτον ἀπέβαινον τῇ γνώμῃ δεδουλωμένοι ὡς ἐπὶ Λακεδαιμονίους. » [XXVI] A l'exception de ce passage, tout présente les expressions les plus naturelles et les figures les plus convenables. Thucydide ne laisse ici à désirer, tant pour le style que pour les pensées, aucune des qualités qu'il est inutile de rappeler en ce moment. Dans le septième livre, il raconte le dernier combat naval entre les Atbéniens et les Syracusains. Nous allons voir de quelles expressions et de quelles figures il s'est servi dans l'exposition des faits : « Démosthène, Ménandre et Euthydème avaient le commandement de la flotte Athénienne. Chacun partit de la station qu'occupait son escadre, se dirigea sur-le-champ vers l'entrée du port défendue par les Syracusains et tenta de s'ouvrir par la force un passage dans la haute mer. Les Syracusains et leurs alliés s'avancèrent contre eux avec un nombre de vaisseaux à peu-près égal : ils en destinèrent une partie à défendre le passage ; le reste fut rangé autour du port, pour fondre sur les Athéniens et recevoir les secours des troupes de terre, eu quelque endroit qu'abordassent les navires. Sicanus et Agatharque commandaient une aile de la flotte syracusaine : Pythen et les Corinthiens dirigeaient le centre. Les Athéniens arrivés à l'entrée du part eurent, dans l'impétuosité du premier choc, l'avantage sur les vaisseaux qui s'y trouvaient et s'efforcèrent de rompre les chaînes. Mais bientôt, les Syracusains et leurs alliés fondent sur eux, et non-seulement à l'entrée du port, mais encore dans son enceinte, s'engagea un combat plus terrible que tous ceux qui l'avaient précédé. Des deux côtés, les matelots pleins d'ardeur poussaient leurs vaisseaux contre l'ennemi, dès qu'ils en recevaient l'ordre, et les pilotes rivalisaient de zèle et d'habileté. Lorsqu'un vaisseau fondait sur un autre, c'était la même ardeur dans tout l'équipage : les soldats qui étaient sur le pont s'efforçaient d'égaler par leur courage l'adresse des matelots. Chacun, au poste qui lui était assigné, voulait être le premier. Un grand nombre de vaisseaux combattaient dans un espace fort étroit : on en comptait deux cents environ dans les deux flottes. Il y eut peu de chocs ; car on ne pouvait ni reculer ni s'ouvrir un passage à travers les lignes ; mais les mêlées furent fréquentes, parce que les vaisseaux se rencontraient, ou en fuyant ou en poursuivant. Tout le temps que deux vaisseaux cherchaient à s'aborder, une grêle de traits, de flèches et de pierres pleuvait du haut du pont : une fois que l'action était engagée, les soldats s'efforçaient, chacun de leur côté, de sauter sur le vaisseau ennemi. Souvent il arriva, tant était resserré le lieu du combat, que sur le même vaisseau on attaquait sur un point, tandis qu'on était attaqué sur un autre : deux bâtiments, et quelquefois davantage, étaient obligés de s'accrocher à un seul : les pilotes se défendaient sur un point et attaquaient sur un autre : ils n'avaient pas à ne s'occuper d'une chose qu'après une autre ; ils devaient faire face à tout, au même instant. Le bruit des nombreux vaisseaux qui s'entrechoquaient excitait la terreur et empêchait d'entendre les ordres des chefs. Des deux côtés, les chefs faisaient de tumultueuses exhortations : on les entendait pousser des cris, soit pour diriger la manœuvre, soit pour allumer dans tous les coeurs «ne vive émulation. Les Athéniens criaient à leurs soldats qu'ils devaient forcer le passage, et dans ce moment plus que jamais redoubler d'ardeur pour rentrer sains et saufs dans leur patrie ; les Syracusains et les alliés, qu'il était beau d'interdire toute fuite à l'ennemi et d'agrandir par la victoire la puissance de la patrie. Enfin, les généraux de chaque année, quand ils voyaient un vaisseau reculer sans nécessité, appelaient le triérarque par son nom et lui demandaient ; les Athéniens, si une terre ennemie lui paraissait offrir moins de dangers que la mer dont ils étaient depuis longtemps les maîtres ; les Syracusains, s'ils fuyaient les ennemis, lorsqu'ils savaient que les Athéniens cherchaient eux-mêmes tous les moyens de fuir. Tandis que les deux armées combattaient sur mer avec un égal avantage, les soldats qui étaient restés sur terre flottaient entre la crainte et l'espérance, les uns dans le désir d'acquérir une nouvelle gloire ; les autres par l'appréhension de maux encore plus grands. Comme toutes les ressources des Athéniens étaient dans leurs forces navales, rien ne peut égaler les craintes que leur causait l'avenir : placés sur des hauteurs, ils voyaient mieux combien le combat était terrible. Le lieu de l'action n'était pas éloigné : mais comme tous ne pouvaient pas regarder à la fois au même endroit, s'ils voyaient sur un point leurs concitoyens obtenir quelque avantage, ils reprenaient courage et suppliaient les dieux de ne pas les priver de leur salut; mais s'ils les voyaient battus sur un autre, ils poussaient des cris et des gémissements. A ce spectacle, ils étaient plus abattus que ceux même qui combattaient au plus fort de la mêlée. D'autres voyant la lutte se soutenir avec un égal avantage, exprimaient par les mouvements du corps les sentiments de crainte qui remplissaient leurs âmes : livrés aux plus dures anxiétés, ils étaient presque réduits à se sauver par la fuite ou à périr. Dans l'armée Athénienne, tant que la victoire fut incertaine, c'étaient des lamentations, des cris qui tour-à-tour annonçaient ou la victoire ou la défaite; et toutes les exclamations qu'une armée nombreuse devait faire entendre dans un grand danger. Sur les vaisseaux s'offrait le même spectacle, lorsqu'enfin les Syracusains et leurs alliés, après une lutte opiniâtre, mirent les Athéniens en fuite, les pressèrent vivement et les poursuivirent, à grands cris, jusqu'au rivage. Les soldats de la flotte, qui n'avaient pas été faits prisonniers en pleine mer, prirent terre où ils purent et se dirigèrent vers le camp. L'armée de terre n'était plus partagée en sentiments divers. Le désastre qu'on venait d'éprouver arrachait à tout le monde des larmes et des gémissements. Les uns allaient défendre leurs vaisseaux ; les autres ce qui restait de leurs retranchements : la plupart cherchaient les moyens d'assurer leur salut. Jamais armée ne fut frappée d'une plus grande consternation. Les Athéniens éprouvèrent des alarmes aussi vives que celles qu'ils avaient eux-mêmes causées à Pylos. Alors les Lacédémoniens perdirent avec leurs vaisseaux tous les soldats qui avaient fait une descente à Sphactérie. Les Athéniens, dans leur situation présente, ne pouvaient trouver de salut sur terre que par un événement imprévu. Dans ce mémorable combat, un grand nombre de vaisseaux et de soldats périrent des deux côtés. Les Syracusains et leurs alliés, maîtres de la victoire, recueillirent les morts elles débris des vaisseaux : ils retournèrent dans leur ville et érigèrent un trophée. » [XXVII] Ce passage et d'autres semblables me paraissent dignes d'être imités : la noblesse, l'élévation, la vigueur, toutes les qualités de l'écrivain y brillent dans le plus grand éclat. Je fonde mon jugement sur ce qu'une élocution de ce genre charme l'esprit, et n'a rien qui choque ni ce bon sens que la nature nous a donné pour juger des objets agréables, ni cette raison, éclairée par l'expérience, qui nous fait découvrir le beau dans tous les arts. Les hommes qui n'ont pas une grande connaissance des lettres n'y trouveront ni une expression, ni une figure dont ils doivent être blessés; et ceux dont l'esprit est éclairé et qui regardent avec dédain l'ignorance du vulgaire, n'ont rien à reprocher à une composition de ce genre. Les ignorants et les hommes instruits auront tous une même opinion : les uns ne seront pas frappés de ce qu'il peut y avoir de pénible, d'embarrassé et d'obscur dans la diction; et ces esprits rares qui ne sont point formés à l'école du vulgaire, ne blâmeront pas ce style sans élévation et sans art. Ainsi, le bon sens naturel et le jugement éclairé par l'étude s'accordent ici ; or, c'est toujours d'après cet accord qu'il faut juger : sans ce concours, il n'est pas possible d'avoir une juste idée de la beauté et de la perfection dans les arts. [XXVIII] Mais je ne sais comment louer d'autres endroits que certains critiques trouvent beaux, admirables; et qui cependant, loin d'avoir les qualités qu'on doit trouver dans tous les écrits, ne sont remarquables que par l'enflure ou la recherche, et n'offrent ni agrément ni intérêt. Je vais citer quelques exemples : j'aurai soin d'indiquer les causes qui ont porté Thucydide à abandonner la diction convenable pour les défauts contraires. Dans le troisième livre, en traçant le tableau des cruautés horribles auxquelles, dans sa révolte, le peuple de Corcyre se porta contre les grands, tant qu'il se renferme dans le langage ordinaire il est clair, concis, énergique ; mais aussitôt qu'il prend le ton de la tragédie, pour peindre les désastres publics de la Grèce ; aussitôt qu'il veut donner à sa pensée un tour extraordinaire, il tombe au-dessous de lui-même. Voici en quels termes il commence cette narration, où personne peut-être ne voudra voir des fautes : « Les habitants de Corcyre, informés que la flotte Athénienne approchait et que celle des ennemis allait s'éloigner, introduisirent les Messéniens dans l'enceinte de la ville, qui leur était auparavant fermée. Ils ordonnèrent aux vaisseaux qu'ils avaient équipés de faire voile vers le port Hyllaïcus et de massacrer les ennemis qu'ils trouveraient sur leur passage. Après avoir chassé de leurs navires tous ceux à qui ils avaient conseillé d'y entrer, ils s'éloignèrent. Arrivés dans le temple de Junon, ils persuadèrent à cinquante suppliants environ de se soumettre à un jugement, et les condamnèrent à la peine capitale. Un grand nombre de suppliants qui n'avaient pas voulu être jugés, instruits de cet événement, se donnèrent mutuellement la mort dans le temple. Quelques-uns se pendirent à des arbres : les autres se délivrèrent de la vie par tel moyen qui était en leur pouvoir. Pendant les sept jours que Eurymédon, venu à Corcyre avec soixante vaisseaux, resta dans l'île, les habitants firent périr tous ceux qu'ils regardaient comme leurs ennemis ; les accusant d'être les destructeurs de la démocratie. Mais dans le fait, parmi les grands, plusieurs périrent victimes des haines privées : d'autres furent mis à mort à cause de leurs richesses, par leurs propres débiteurs. On eut recours aux plus cruels supplices. Toutes les horreurs qu'on peut imaginer dans de semblables troubles, et de plus grandes encore, furent commises . Le père se baignait dans le sang de son fils ; les suppliants étaient arrachés de l'enceinte des temples pour se voir massacrer à la porte même : plusieurs périrent enfermés dans le temple de Bacchus . Cette sanglante sédition parut d'autant plus horrible que c'était la première. Plus tard, des commotions politiques ébranlèrent la Grèce entière. Des troubles naissaient sur tous les points, parce que les chefs du peuple voulaient déférer l'empire à Athènes, et les oligarques à Lacédémone. » [XXIX]. La suite est obscure, difficile à comprendre, hérissée de figures entortillées, qui se rapprochent du solécisme. Les tours qu'il emploie ne furent usités ni de son temps, ni après lui, lorsque l'éloquence eut atteint toute sa perfection. Par exemple, il dit : « ἐστασίαζέν τε οὖν τὰ τῶν πόλεων, καὶ τὰ ἐφυστερίζοντά που ἐπιπύστει τῶν προγενομένων πολὺ ἐπέφερε τὴν ὑπερβολὴν τοῦ καινοῦσθαι τὰς διανοίας τῶν τ´ ἐπιχειρήσεων περιτεχνήσει καὶ τῶν τιμωριῶν ἀτοπίᾳ. » « Les villes étaient agitées par des séditions : celles qui se révoilaient les dernières, instruites des excès déjà commis par les autres, semblaient jalouses de se signaler, soit par In nouveauté des attaques, soit par l'atrocité des vengeances. » Dans cette phrase, le premier membre est paraphrasé sans nécessité : « Ἐστασίαζέν τε οὖν τὰ τῶν πόλεων. » Il valait mieux dire « Ἐστασάζον αἱ πολεῖς;. » Ce qui suit « Καὶ τὰ ἐφυστερίζοντά που » est difficile à entendre. Thucydide aurait été clair, s'il avait dit : « Αἱ δ' ὑστεροῦσαι πόλεις. » II ajoute : « Ἐπὶ πύστει τῶν προγενομένων, πολλὴν ἐπέφερε τὴν ὑπερβολὴν ἐς τὸ καινοῦσθαι τὰς διανοίας » Sa pensée revient à celle-ci : « Οἱ δὲ ὑστερίζοντζες, ἐπινυνθανόμενοι τὰ γεγενημένα παρ' ἑτέρων, ἐλάμβανον ὑπερβολὴν ἐπὶ τὸ διανοεῖσθαί τι καινότερον. » Outre l'embarras de la construction, les tours ne présentent aucun agrément à l'oreille. Un peu plus loin, il prend le ton de la poésie et du dithyrambe plutôt que celui de l'histoire : « Τῶν τ´ ἐπιχειρήσεων ἐπιτεχνήσει καὶ τῶν τιμωριῶν ἀτοπίᾳ· καὶ τὴν εἰωθυῖαν τῶν ὀνομάτων ἀξίωσιν ἐς τὰ ἔργα ἀντήλλαξαν τῇ δικαιώσει. » II veut dire : « Elles mettaient toute leur industrie à se signaler par des attaques d'un nouveau genre ou par l'atrocité des vengeances : elles changeaient la signification des mots destinés à caractériser les actions, et leur en donnaient une autre.» Les expressions « Ἐπιτέχνησις - Τῶν τιμωριῶν ἀτοπία - Εἰωθυῖα τῶν ὀνομάτων ἀξίωσις - Εἰς τὰ ἔργα ἀντηλλαγμένη δικαίωσις » sont tout-à-fait poétiques. Les tours dont il se sert un peu plus loin ne sauraient convenir qu'au théâtre : « Τόλμα μὲν γὰρ ἀλόγιστος ἀνδρία φιλέταιρος ἐνομίσθη, μέλλησις δὲ προμηθὴς δειλία εὐπρεπής » « L'audace inconsidérée fut traité de courage intrépide pour ses amis ; la lenteur prévoyante de lâcheté décorée d'un beau nom. » On y trouve tout à-la-fois et la ressemblance des chutes et l'égalité des membres : les épithètes n'y figurent que pour l'ornement. Sans tour théâtral et dans sa forme simple, la phrase aurait été conçue ainsi : « Τὴν μὲν γὰρ τόλμαν ἀνδρίαν ἐκάλουν, τὴν δὲ μέλλησιν δειλίαν » II faut en dire autant de ce qui suit : « Τὸ δὲ σῶφρον τοῦ ἀνάνδρου πρόσχημα, καὶ τὸ πρὸς ἅπαν συνετὸν ἐπὶ πᾶν ἀργόν. » La construction eût été plus convenable de cette manière : « Οἱ δὲ σώφρονες ἄνανδροι, καὶ οἱ συνετοὶ πρὸς ἅπαντα ἐν ἅπασιν ἀργοί. » [XXX] Si Thucydide se fût arrêté là, s'il s'était borné à ces tours aflectés, à certaines constructions dures, il aurait été supportable. Mais il poursuit « Ἀσφάλεια δὲ τὸ ἐπιβουλεύσασθαι, ἀποτροπῆς πρόφασις εὔλογος. καὶ ὁ μὲν χαλεπαίνων πιστὸς ἀεί, ὁ δ´ ἀντιλέγων αὐτῷ ὕποπτος. » « La prudence fut regardée comme une pusillanimité, et une sage circonspection comme une lenteur incapable de rien entreprendre. » Délibérer mûrement pour ne rien abandonner au hasard, c'était un prétexte honnête pour ne pas s'engager. L'homme violent était un homme sûr ; celui qui le contrariait, un homme suspect. » Dans cette phrase, on ne sait à quoi se rapporte χαλεπαίνων, ni à qui Thucydide l'applique. Il en est de même de l'expression ἀντιλέγων . Il dit ensuite : « Ἐπιβουλεύσας δέ τι, τυχών τε, ξυνετός, καὶ ὑπονοήσας, ἔτι δεινότερος· προβουλεύσας δὲ, ὅπως μηδὲν αὑτῷ δεήσει, τῆς ἑταιρίας διαλυτὴς καὶ τοὺς ἐναντίους ἐκπεπληγμένος. » « Dresser des embûches et réussir, c'était avoir de l'esprit: les prévenir, c'était en avoir davantage. Prendre d'avance ses mesures pour n'avoir jamais besoin de tous ces artifices, c'était violer l'amitié et avoir peur des ennemis. » On ne voit pas quel est le sens de τυχών, ni même si les mots τυχών et ὑπονοήσας doivent s'entendre d'un seul individu ; ni enfin, si τυχών doit s'appliquer à un homme qui réussissait dans ses vues et arrivait à son but, et ὑπονοήσας à celui qui visait à un mal non accompli et encore incertain. La phrase aurait été correcte et claire, si Thucydide avait dit : « Οἵ τ´ ἐπιβουλεύοντες ἑτέροις, εἰ κατορθώσειαν, δεινοί· καὶ οἱ τὰς ἐπιβουλὰς προὑπονοοῦντες, εἰ φυλάξαιντο, ἔτι δεινότεροι· ὁ δὲ προἰδόμενος ὅπως μηδὲν αὑτῷ δεήσει μήτ´ ἐπιβουλῆς, μήτε φυλακῆς, τάς τε ἑταιρίας διαλύειν ἐδόκει, καὶ τοὺς ἐναντίους ἐκπεπλῆχθαι. » [XXXI] Il ajoute une période où la vivacité du tour est jointe à la force et à la clarté : « Ἁπλῶς δὲ ὁ φθάσας τὸν μέλλοντα κακόν τι δρᾶν ἐπῃνεῖτο καὶ ὁ ἐπικελεύσας τὸν μὴ διανοούμενον. » « Prévenir un adversaire prêt a nuire, ou pousser à mal faire un citoyen qui n'y pensait pas, c'était mériter des éloges. » Mais bientôt, il a recours à une métalepse poétique : « Καὶ μὴν καὶ τὸ συγγενὲς τοῦ ἑταιρικοῦ ἀλλοτριώτερον ἐγένετο διὰ τὸ ἑτοιμότερον εἶναι ἀπροφασίστως τολμᾶν. » « Les amitiés de parenté étaient moins recherchées que les amitiés de faction ; parce que celles-ci sont disposées à tout oser, sans alléguer d'excuse. » Les mots συγγενὲς et ἑταιρικὸν forment une métalepse. Quant à ceux-ci « Ἀπροφασίστως τολμᾶν », on ne voit point s'ils se rapportent aux amis ou aux pareils. Car, après avoir dit pourquoi on recherchait les amitiés de faction plutôt que les liaisons de la parenté, il ajoute que les premières étaient prêtes à tout oser, sans alléguer d'excuse. La phrase serait claire, s'il l'eût construite de cette manière, en donnant à chaque membre la forme convenable à la pensée : « Καὶ μὴν καὶ τὸ ἑταιρικὸν, οἰκειότερον ἐγένετο τοῦ συγγενοῦς, διὰ τὸ ἑτοιμότερον εἶναι ἀπροφασίστως τολμᾶν. » Nous trouvons une autre périphrase dans ce passage, qui manque de force et de clarté : « Οὐ γὰρ μετὰ τῶν κειμένων νόμων ὠφελείας αἱ τοιαῦται σύνοδοι, ἀλλὰ παρὰ τοὺς καθεστῶτας πλεονεξίᾳ. » Le sens est : « Ces associations ne se formaient point pour le maintien des lois établies, mais dans des vues de cupidité condamnées par les lois.» Un peu plus bas, il dit : « Καὶ ὅρκοι, εἴ που ἄρα ἐγίγνοντο συναλλαγῆς, ἐν τῷ αὐτίκα πρὸς τὸ ἄπορον ἑκατέρῳ διδόμενοι ἴσχυον, οὐκ ἐχόντων ἄλλοθεν δύναμιν. » « Si quelquefois on faisait dus serments de réconciliation, il n'étaient respectés pour le moment ; parce qu'on se trouvait dans une crise violente et qu'on (l'avait pas d'autre ressource. » II y à ici une hyperbatε et une circonlocution. Les mots « Οἱ μὲν γὰρ ὅρκοι τῆς συναλλαγῆς » reviennent à ceux-ci : « οἱ δὲ περὶ τῆς φιλίας ὅρκοι εἴ που ἄρα γένοιντο » ; et le mot ἴσχυον, qui devrait suivre αὐτίκα, car c'est comme s'il avait dit « ἐν τῷ παραυτίκα ἴσχυον », en est séparé par une hyperbate. Le reste de la phrase : « Πρὸς τὸ ἄπορον ἑκατέρῳ διδόμενοι, οὐκ ἐχόντων ἄλλοθεν δύναμιν», pour avoir de la clarté, devrait être présenté de cette manière : « Διὰ τὸ μηδεμίαν ἄλλην ἔχειν δύναμιν κατὰ τὸ ἄπορον ἑκατέρῳ διδόμενοι. » La pensée serait bien exprimée, si elle avait cette forme : « Οἱ δὲ περὶ τῆς φιλίας ὅρκοι εἴ που ἄρα γένοιντο, ἀπορίᾳ πίστεως ἄλλης, ἑκατέρῳ διδόμενοι ἐν τῷ παραχρῆμα ἴσχυον» [XXXII] Dans les passages suivants, la construction est plus embarrassée encore : « Ἐν δὲ τῷ παρατυχόντι ὁ φθάσας θαρρῆσαι εἰ ἴδοι ἄφρακτον, ἥδιον διὰ τὴν πίστιν ἐτιμωρεῖτο ἢ ἀπὸ τοῦ προφανοῦς· καὶ τό τε ἀσφαλὲς ἐλογίζετο, καὶ ὅτι ἀπάτῃ περιγενόμενος συνέσεως ἀγώνισμα προσελάμβανε » « Mais, a la première occasion, si l'ennemi ne paraissait pas être sur ses gardes, on se hâtait de l'attaquer. On trouvait plus de plaisir à se venger en violant la foi jurée, qu'à force ouverte : on comptait se mettre ainsi en sûreté, en même temps qu'on méritait, pour une vengeance obtenue par la fourberie, le prix de l'habileté. » Ici, παρατυχόν tient la place de παραχρῆμα ; et ἄφρακτον Celle d'ἀφυλάκτον. La locution « Ἥδιον διὰ τὴν πίστιν ἐτιμωρεῖτο ἢ ἀπὸ τοῦ προφανοῦς » forme une périphrase obscure, et dans laquelle il manque quelque chose pour le sens. Je pense que Thucydide a voulu dire : « Εἰ δέ που παρατύχοι τινὶ καιρὸς, καὶ μάθοι τὸν ἐχθρὸν ἀφύλακτον, ἥδιον ἐτιμωρεῖτο, ὅτι πιστεύσαντι ἐπέθετο μᾶλλον ἢ φυλαττομένῳ· καὶ συνέσεως δόξαν προσελάμβανε, τό τε ἀσφαλὲς λογιζόμενος καὶ ὅτι διὰ τὴν ἀπάτην αὐτοῦ περιεγένετο. » Dans cette phrase « Ῥᾷον δ´ οἱ πολλοὶ κακοῦργοι, φησίν, ὄντες δεξιοὶ κέκληνται, ἢ ἀμαθεῖς ἀγαθοί, καὶ τῷ μὲν αἰσχύνονται, ἐπὶ δὲ τῷ ἀγάλλονται. » « La plupart des hommes préfèrent qu'on les appelle méchants, mais adroits ; plutôt que bons, mais inhabiles. Cette dernière qualification les fait rougir : l'autre leur inspire une sorte d'orgueil. » le tour est vif et concis ; mais le sens se cache sous une obscurité profonde. On ne voit pas quels sont ceux qu'il appelle ἀμαθεῖς et κακοῦργοι. S'il a voulu opposer ἀμαθεῖς à κακοῦργοι, cette épithète ne saurait s'appliquer aux hommes de bien ; et d'un autre côté, si ἀμαθεῖς signifie des hommes qui n'ont ni raison ni sagesse, comment Thucydide peut-il leur donner la qualification d'ἀγαθοί? Et le mot αἰσχύνονται, à quoi se rapporte-t-il ? On ne voit pas si c'est aux divers individus dont il a parlé, ou seulement à ceux qu'il appelle ἀμαθεῖς. Il en est de même de ce membre de phrase « Ἐπὶ δὲ τῷ ἀγάλλονται. » : on ne sait à qui l'appliquer. Si c'est à tous les deux, le passage n'aurait point de sens ; car on ne peut pas dire des hommes de bien : « Ἐπὶ τοῖς κακούργοις ἀγάλλονται », ni des méchants ; « Ἐπὶ τοῖς ἀμαθέσιν αἰσχύνονται.. » [ΧΧΧΙII] Tel est le caractère de sa diction obscure, embarrassée, et dont la marche irrégulière obscurcit les pensées. Ces défauts se reproduisent dans plus de cent lignes de suite. Je vais citer le passage, sans le couper par mes observations : « La cause de toutes ces calamités fut le désir de dominer qu'inspirent la cupidité et l'ambition ; passions vives, qui entraînent dans les plus violentes querelles. Tous ceux qui avaient de l'autorité, sous le prétexte spécieux d'établir, les uns l'égalité politique des citoyens, les autres une aristocratie tempérée, affectaient également de n'être mus que par le bien public : mais dans le fait, ils ne cherchaient que leur avantage-, et pour se supplanter, ils se portaient aux derniers excès et aux vengeances les plus atroces. Jaloux d'anéantir leurs rivaux, tous les moyens leur paraissaient bons : ils ne prenaient pour règle de conduite ni la justice ni l'intérêt public, mais leurs capricieuses passions. Pour les satisfaire, ils ne craignaient pas de recourir à d'iniques décrets, revêtus de formes juridiques, ni de s'emparer du pouvoir par la violence. Ils n'avaient rien de sacré : les plus estimés étaient ceux qui arrivaient adroitement à leurs fins, en prenant des dehors honorables. Les citoyens modérés périssaient victimes des deux factions, parce qu'ils n'embrassaient la cause d'aucune, ou qu'elles étaient également jalouses de la tranquillité dont ils jouissaient. Ainsi, la discorde fit éclore tous les maux au sein de la Grèce. La simplicité, compagne ordinaire de la noblesse, avait disparu : être toujours en discorde et se tenir sur ses gardes paraissait le parti le plus sage. Rien ne pouvait apaiser les haines ; ni la parole, il n'y en avait plus d'inviolable ; ni les serments, ils n'inspiraient ni crainte ni respect. N'osant compter sur rien, tous songeaient aux moyens de prévenir une attaque, bien plus qu'ils ne pouvaient se livrer à un sentiment de confiance. Ceux qui étaient mal partagés du côté de l'esprit, avaient presque toujours le dessus. Comme ils connaissaient leur insuffisance et les talents de leurs adversaires ; craignant de succomber là où l'éloquence et le talent pourraient exercer leur influence, ils se portaient aux actions les plus audacieuses. Les autres, au contraire, pleins de mépris pour leur ennemi, dédaignaient de pressentir ses desseins : ils croyaient que les ressources de leur esprit les dispensaient de recourir à des voies de fait. Ils ne se tenaient point sur leurs gardes ; et le plus souvent, ils se perdaient. » Je pourrais prouver par une foule d'exemples que Thucydide, dans ses narrations, ne laisse rien à désirer, lorsqu'il se renferme dans les formes du langage ordinaire ; mais qu'il est plein de défauts, dès qu'il emploie les expressions étrangères et ces tours forcés dont plusieurs se rapprochent du solécisme. Je me bornerai à ceux que j'ai rapportés, afin que ce traité ne franchisse pas les bornes convenables . [XXXIV] J'ai promis de dire mon opinion sur les harangues, qui, au jugement de certains critiques, sont la partie où Thucydide a déployé toute la force de son talent. Je diviserai cet examen en deux parties : dans la première, je les analyserai sous le rapport des pensées ; et dans la seconde, sous le rapport du style. Je commencerai par les pensées. La première chose qu'on doit remarquer dans un écrivain, c'est l'invention des raisonnements et des pensées ; la seconde, l'usage qu'il en fait. L'une est un don de la nature; l'autre, l'ouvrage de l'art. La première, qui tire plutôt sa force des dispositions naturelles que des ressources de l'art, est admirable dans Thucydide : de son esprit, comme d'une source intarissable, jaillissent des pensées et des raisonnements frappants, extraordinaires, admirables. La seconde, qui doit beaucoup plus à l'art et fait briller les dispositions naturelles dans tout leur éclat, est souvent défectueuse chez lui. Les critiques dont l'admiration pour cet historien est telle qu'on les croirait agités d'une fureur divine, ont conçu un tel enthousiasme, à cause de l'abondance de ses pensées. Leur faire observer, en citant les paroles mêmes de l'écrivain, que plusieurs pensées n'occupent point la place convenable, qu'il les met dans la bouche des personnages qui ne devraient point en faire usage, que d'autres ne s'appliquent point au sujet ou sortent d'une juste mesure, c'est courir le risque de leur déplaire : je les compare à ces hommes dont l'âme transportée hors d'elle-même à l'aspect de la beauté, est enflammée d'un amour qui diffère peu de la folie. Tous les charmes imaginables leur paraissent réunis dans l'objet qui charme leur coeur. Essayez de faire ressortir les défauts qui s'y trouvent, ils vous traiteront d'envieux, de calomniateur. Ainsi, les admirateurs de Thucydide, trompés par sa supériorité en un point, lui attribuent toutes les qualités, même celles dont il n'offre aucun vestige ; car c'est un travers commun à tous les hommes, quand ils aiment et admirent une chose, de soutenir qu'elle a les qualités dont ils la croient ornée. Mais un esprit en garde contre toute opinion hasardée et qui veut assujettir ses jugements à une règle sûre, soit qu'il procède avec cette sagesse par un instinct naturel, soit que l'étude ait formé et mûri sa raison, ne loue pas tout, ne blâme pas tout indistinctement : il donne à ce qui est bien les éloges convenables ; mais s'il trouve des fautes, il est loin de les approuver. [XXXV] Ainsi, résolu à soumettre tous mes jugements à une règle invariable, je n'ai pas craint jusqu'ici de faire connaître mes opinions : je ne reculerai pas aujourd'hui. Je répète, comme je l'ai avancé, que Thucydide excelle dans l'invention ; dût-on soutenir une opinion contraire et lui reprocher certains défauts sous ce rapport, soit par jalousie, soit par ignorance. Mais je me garderai bien de le donner comme un modèle pour l'économie artificielle du plan, excepté dans quelques harangues. Le style aussi est souvent entaché de ces défauts dont j'ai déjà parlé et qui me paraissent très graves. Les mots obscurs, étrangers ou inventés s'y rencontrent en foule, ainsi que les tours embarrassés, entortillés et forcés. Cette opinion est-elle fondée ? Vous pourrez en juger, vous et tous ceux qui entreprendront l'examen des écrits de Thucydide. Je vais, d'après la marche que je me suis tracée, comparer les plus belles de ses harangues avec celles qui ne sont à l'abri du reproche ni pour la disposition, ni pour le style. [XXXVI] Dans le second livre, au moment de raconter la guerre des Lacédémoniens et de leurs alliés contre les Platéens, il parle de l'ambassade que ceux-ci envoyèrent à Archidamus, roi de Lacédémone, qui se disposait à dévaster leur territoire, et il rapporte les discours prononcés de part et d'autre. Ces discours conviennent aux personnes et aux choses : ils ne laissent rien à désirer et ne sortent pas d'une juste mesure. La diction en est pure, claire, concise ; en un mot, elle réunit toutes les qualités. Il y règne une harmonie si douce qu'on peut la comparer aux sons les plus agréables. « L'été suivant, les peuples du Péloponnèse marchèrent non pas contre l'Attique, mais contre Platée, sous la conduite de leur roi Archidamus, fils de Zeuxidame. Ce prince avait déjà établi son camp et se disposait à ravager le territoire des Platéens. Ceux-ci lui envoyèrent des ambassadeurs qui s'exprimèrent en ces termes : - « Archidamus, et vous peuple de Lacédémone, en faisant une invasion sur notre territoire, vous violez les lois de la justice, et vous ne vous montrez dignes ni de vous ni de vos ancêtres. Lacédémonien comme vous, Pausanias, fils de Cléombrote, après avoir éloigné de la Grèce le joug des Perses, offrit avec les Grecs qui voulurent s'engager dans la terrible lutte qu'il allait soutenir, Un sacrifice à Jupiter libérateur sur la place publique de Platée. En présence de tous les alliés, il rendit aux Platéens leurs terres, leur ville, leur indépendance ; et déclara que jamais on ne leur ferait une guerre injuste ou qui eût pour but de les asservir. Dans le cas contraire, les alliés, alors présents, devaient les secourir de toutes leurs forces. Telle fut la récompense dont vos pères payèrent notre courage et notre dévouement dans ce pressant danger. Mais vous, vous tenez une conduite tout-à-fait opposée, et vous marchez sous les drapeaux des Thébains, nos plus grands ennemis. Au nom des dieux qui ont reçu les serments les plus solennels ; au nom des dieux, protecteurs de votre pays et du nôtre, nous vous conjurons de respecter notre territoire, de ne pas fouler aux pieds la foi des traités, et de nous laisser vivre indépendants, comme nous le permit Pausanias. » A peine les Platéens eurent-ils achevé leur discours qu'Archidamus répondit : « Vos réclamations seraient justes, citoyens de Platée, si les faits s'accordaient avec vos paroles. Pausanias vous laissa votre indépendance : à son exemple, respectez la liberté des peuples qui bravèrent alors les mêmes dangers ; qui furent compris dans les mêmes traités, et gémissent aujourd'hui sous la puissance d'Athènes. C'est pour la liberté de ces peuples et de tous les autres que cet appareil de guerre est déployé. Vous jouissez de la liberté : soyez donc fidèles à vos serments; ou du moins, comme nous vous l'avons conseillé, vivez en paix, cultivez vos campagnes et n'embrassez aucun parti. Ne vous déclarez ni les amis des uns, ni les ennemis des autres. Voilà ce qui nous plaît. » Telles furent les paroles d'Archidamus. Après les avoir entendues, les ambassadeurs de Platée rentrèrent dans leur ville, les communiquèrent à leurs concitoyens assemblés, et répondirent au roi « qu'ils ne pouvaient faire ce qu'il demandait, sans le consentement des Athéniens, qui avaient pour otages leurs enfants et leurs épouses ; qu'ils craignaient que les Athéniens ne vinssent s'opposer à l'exécution de ces promesses, dès que les Lacédémoniens seraient partis, ou que les Thébains, engagés par serment à recevoir les deux peuples, ne tentassent une seconde fois de s'emparer de leur ville. » Archidamus leur dit; pour les rassurer: « Livrez-nous donc, à nous citoyens de Lacédémone, votre ville et vos maisons : montrez-nous les bornes de votre territoire, donnez-nous en compte vos arbres et tout ce qui peut être compté, et retirez-vous où vous le jugerez convenable, tant que durera cette guerre. Aussitôt qu'elle sera terminée, nous vous rendrons tout : jusqu'à ce moment, vos biens seront en dépôt entre nos mains. Nous ferons cultiver vos terres, et nous vous paierons une somme proportionnée à vos besoins. » A la suite de cet entretien, les députés rentrèrent encore dans leur ville, et après avoir délibéré avec leurs concitoyens, ils répondirent « que les Platéens voulaient faire part de toutes les propositions aux Athéniens, et que si elles avaient leur approbation, on s'empresserait d'y souscrire. » Ils prièrent les Lacédémoniens de leur promettre que jusqu'à cette époque, ils ne ravageraient point le territoire de Platée. Archidamus engagea sa foi pour autant de jours qu'il en fallait pour recevoir une réponse, et respecta leur territoire. Les députés de Platée se rendirent auprès des Athéniens, se concertèrent avec eux et rapportèrent cette réponse à leurs concitoyens : « Peuples de Platée, nous ont dit les Athéniens, depuis que nous avons fait alliance avec vous, jamais jusqu'à ce moment, nous ne vous avons refusé notre appui, quand on vous a fait une injure. Aujourd'hui même, loin de vous abandonner, les Athéniens sont prêts à vous secourir de tous leurs moyens et vous engagent, au nom des serments prêtés par vos pères, à ne point tenter une alliance nouvelle. » D'après ce rapport, les Platéens résolurent de ne point se séparer d'Athènes, de souffrir, s'il le fallait, que leur territoire fût dévasté sous leurs yeux, d'endurer même les dernières extrémités et de ne plus envoyer de députés, mais de répondre du haut des remparts « qu'il leur était impossible d'accéder aux conditions proposées par les Lacédémoniens. » A cette nouvelle, Archidamus se leva, en invoquant les dieux et les héros du pays : « Dieux, qui veillez sur le territoire de Platée, s'écria-t-il, et vous héros, je vous prends à témoin que les Platéens ont été les premiers à transgresser leurs serments. Ce n'est pas nous qui donnons l'exemple de l'injustice, en mettant le pied sur une terre où nos pères battirent les Perses, après vous avoir adressé des prières, et qui par votre bonté, devint le théâtre de la victoire. Aujourd'hui même, dans tout ce que nous allons entreprendre, on ne peut nous accuser d'injustice. Malgré nos remontrances si fréquentes et si raisonnables, nous n'avons rien obtenu. Que le peuple qui le premier a violé les traités reçoive un digne châtiment, et que celui qui demande une juste vengeance puisse enfin l'obtenir! » Après cette prière, il prépara ses troupes à commencer la guerre. [XXXVII] A ce dialogue écrit avec tant de charmes et de perfection, je vais en comparer un autre qui fait l'admiration des plus zélés partisans de Thucydide. Après avoir dit que les Athéniens firent marcher une armée contre les habitants de Mélos, colonie de Lacédémone, il ajoute : « Avant le commencement des hostilités, le général de cette armée entra en pourparlers avec les magistrats de Mélos, sur les moyens de mettre un terme à tous les différends. » Il commence par rendre compte lui-même des discours qui furent tenus de part et d'autre, suit la forme épique dans une réponse et donne au reste la forme dramatique. Le général d'Athènes parle le premier et s'exprime en ces mots : « Ἐπειδὴ οὐ πρὸς τὸ πλῆθος οἱ λόγοι γίγνονται, ὅπως δὴ μὴ συνεχεῖ ῥήσει οἱ λαοὶ ἐπαγωγὰ καὶ ἀνέλεγκτα ἐς ἅπαξ ἀκούσαντες ἡμῶν ἀπατηθῶσι (γινώσκομεν γὰρ ὅτι τοῦτο φρονεῖ ἡμῶν ἡ ἐς τοὺς ὀλίγους ἀγωγή), ὑμεῖς οἱ προκαθήμενοι ἔτι ἀσφαλέστερον ποιήσετε. καὶ μηδ´ ὑμεῖς ἐν ὀλίγῳ ἀλλὰ πρὸς τὸ μὴ δοκοῦν ἐπιτηδείως λέγεσθαι εὐθὺς ὑπολαμβάνοντες κρίνετε· καὶ πρῶτον, εἰ ἀρέσκει ὡς λέγομεν, εἴπατε » « On ne nous permet pas de parler devant le peuple assemblé ; sans doute, afin que la multitude ne se laisse point séduire, en écoutant de suite un discours insinuant et qui pourrait paraître sans réplique. Telle a dû être votre pensée, en ne nous permettant de traiter qu'avec les magistrats. Ainsi, vous qui êtes ici pour nous entendre, prenez des précautions plus sûres encore, ne faites pas usage d'un discours suivi ; mais relevez sur-le-champ tout ce qui ne vous paraîtra pas convenable. Si cette forme de délibération vous paraît admissible, répondez. » Les magistrats des Méliens répondent : « Ἡ μὲν ἐπιείκεια τοῦ διδάσκειν καθ´ ἡσυχίαν ἀλλήλους, οὐ ψέγεται· τὰ δὲ τοῦ πολέμου παρόντα ἤδη, καὶ οὐ μέλλοντα διαφέροντα αὐτοῦ φαίνεται. » «Cette manière honnête de s'éclairer paisiblement les unes les autres est loin d'exciter nos plaintes. Toutefois, les préparatifs de guerre qu'on ne diffère pas même de quelques jours, mais qui se font sous nos yeux, paraissent bien opposés à ce mode de délibération. » Si l'on croit pouvoir mettre cette phrase au nombre des figures, rien ne doit empêcher d'en dire autant de toutes les fautes contre la concordance des nombres et des cas. Thucydide dit d'abord « Ἡ μὲν ἐπιείκεια τοῦ διδάσκειν καθ´ ἡσυχίαν ἀλλήλους, οὐ ψέγεται », puis il lie à un singulier nominatif plusieurs pluriels « τὰ δὲ τοῦ πολέμου παρόντα ἤδη, καὶ οὐ μέλλοντα » auxquels il fait rapporter un mot au singulier et au génitif; et ce mot (αὐτοῦ) est un adjectif démonstratif ou un pronom, comme on voudra l'appeler : qu'on le fasse accorder avec un nom féminin au singulier et au nominatif, ou avec un nom pluriel neutre et au nominatif, la syntaxe n'est pas observée. Elle l'aurait été, si Thucydide avait donné cette forme à la phrase : « Ἡ μὲν ἐπιείκεια τοῦ διδάσκειν καθ´ ἡσυχίαν ἀλλήλους οὐ ψέγεται, τὰ δὲ τοῦ πολέμου παρόντα ἤδη καὶ οὐ μέλλοντα διαφέροντα αὐτῆς φαίνεται. » Il ajoute une pensée qui ne manque pas de finesse, mais dont il est difficile de saisir le sens « Εἰ μὲν τοίνυν ὑπονοίας τῶν μελλόντων λογιούμενοι ἢ ἄλλο τι ξυνήκετε, ἢ ἐκ τῶν παρόντων καὶ ὧν ὁρᾶτε περὶ σωτηρίας βουλεύσαντες τῇ πόλει, παυόμεθα· εἰ δ´ ἐπὶ τοῦτο, λέγοιμεν ἄν. » « Si vous êtes ici pour calculer les craintes que l'avenir vous inspire ou dans toute autre intention que pour délibérer sur le salut de votre patrie, d'après les circonstances qui frappent vos „yeux, nous n'avons qu'a garder le silence. Si le salut de la patrie vous occupe, nous parlerons. » [XXXVIII] Il quitte ensuite la forme épique pour la forme dramatique, et il introduit un Milésien, qui répond en ces tenues : « Εἰκὸς μὲν καὶ ξυγγνώμη, ἐν τῷ τοιῷδε καθεστῶτας ἐπὶ πολλὰ καὶ λέγοντας καὶ δοκοῦντας τραπέσθαι. » « Il est naturel et même pardonnable, dans la situation critique où nous nous trouvons, de nous abandonner à mille conjectures, a mille pensées diverses et de parler en conséquence. » La proposition qu'il ajoute est présentée sous une forme agréable : « Ἡ μέντοι ξύνοδος καὶ περὶ σωτηρίας ἤδη πάρεστι, καὶ ὁ λόγος, ᾧ προκαλεῖσθε τρόπῳ, εἰ δοκεῖ, γιγνέσθω » « Cependant, cette réunion n'a pour but que notre salut : si u vous l'approuvez, délibérons, en adoptant le mode que vous nous prescrivez. »; mais il emploie une pensée qui n'est ni digne d'Athènes, ni convenable dans la circonstance, lorsqu'il dit : « Ἡμεῖς τοίνυν οὔτε αὐτοὶ μετ´ ὀνομάτων καλῶν, ὡς ἢ δικαίως τὸν Μῆδον καταλύσαντες ἄρχομεν, ἢ ἀδικούμενοι νῦν ἐπεξερχόμεθα, λόγων μῆκος ἄπιστον παρέξομεν » « Nous n'irons point chercher des raisons spécieuses ; nous n'emploierons pas de longs discours, peu propres à persuader, pour démontrer que la défaite des Mèdes nous a mérité la possession de l'empire, et que si nous marchons contre vous, c'est parce que vous nous avez offensés. » C'est avouer que l'expédition était dirigée contre un peuple à qui on n'avait aucune injustice à reprocher, puisqu'on refuse de lui rendre compte. L'historien ajoute : « Oὔθ´ ὑμᾶς ἀξιοῦμεν ἢ ὅτι Λακεδαιμονίων ἄποικοι ὄντες οὐ ξυνεστρατεύσατε ἢ ὡς ἡμᾶς οὐδὲν ἠδικήκατε λέγοντας οἴεσθαι πείσειν, τὰ δυνατὰ δ´ ἐξ ὧν ἑκάτεροι ἀληθῶς φρονοῦμεν διαπράσσεσθαι » « Nous vous engageons à ne pas vous flatter de nous persuader, en disant que vous n'avez pas combattu avec nous, parce que vous étiez une colonie de Lacédémone, ou que vous n'avez aucun tort à vous reprocher à notre égard. Agissons, chacun de notre côté, d'après l'idée que nous devons avoir les uns des autres. » Ce passage revient à celui-ci: « Ὑμεῖς μὲν ἀληθῶς φρονοῦντες ὅτι ἀδικεῖσθε, τὴν ἀνάγκην φέρετε καὶ εἴκετε· ἡμεῖς δὲ οὐκ ἀγνοοῦντες, ὅτι ἀδικοῦμεν ὑμᾶς, τῆς ἀσθενείας ὑμῶν περιεσόμεθα τῇ βίᾳ· » « Certains que vous êtes victimes d'une injustice, sachez supporter la rigueur de votre condition et vous y soumettre. Quant à nous, nous n'ignorons pas que nous sommes injustes ; mais nous profiterons de tous les avantages que la puissance donne sur la faiblesse. » la phrase peut avoir ce sens. Enfin, quand il veut faire connaître les motifs, il dit : « Ὅτι δίκαια μὲν ἐν τῷ ἀνθρωπείῳ λόγῳ ἀπὸ τῆς ἴσης ἀνάγκης κρίνεται, δυνατὰ δὲ οἱ προὔχοντες πράσσουσι καὶ οἱ ἀσθενεῖς ξυγχωροῦσι. » « Les intérêts des peuples se règlent d'après les lois de la justice, lorsqu'une égale nécessité les oblige à s'y soumettre ; mais les plus puissants tirent parti des avantages que leur supériorité leur donne : les faibles doivent céder. » [XXXIX] Ce langage pouvait trouver sa place dans la bouche d'un roi barbare parlant contre les Grecs ; mais des Athéniens s'adressant à des Grecs qu ils avaient affranchi du joug des Perses, ne pouvaient dire que la justice ne saurait exister qu'entre des hommes égaux, tandis que la violence est permise aux plus puissants contre les faibles. Les Méliens répondirent en peu de mots que les Athéniens devraient respecter la justice, afin que si un jour, dépouillés de l'empire, ils tombaient entre les mains d'un maître, ils n'eussent pas à essuyer les mêmes injustices de la part des hommes plus puissants. Thucydide fait dire à un Athénien : « Quand même notre puissance toucherait à son terme, nous la verrions finir, sans nous livrer au désespoir. » La raison qu'il en donne, c'est que les Lacédémoniens ne conserveraient aucun ressentiment, s'ils parvenaient à abattre la puissance d'Athènes, puisque souvent ils ont eux-mêmes traité d'autres peuples avec indulgence. Voici ses propres paroles : « Un peuple qui en tient un autre sous sa domination, comme le peuple de Lacédémone, ne doit point inspirer des craintes aux vaincus. » C'est comme s'il avait dit que les tyrans ne haïssent point les tyrans. Il ajoute : « Qu'on nous laisse subir les conséquences de notre détermination. » Ce langage serait à peine supportable dans la bouche des pirates ou des voleurs qui, sans s'inquiéter du supplice réservé à leur crime, ne songent pour Je moment qu'à satisfaire leur cupidité. Après quelques questions de part et d'autre, les Méliens réclament des conditions raisonnables, et ils ajoutent : « Lorsque nous demandons de vivre en paix, d'être vos amis et non vos ennemis, sans embrasser aucun parti, n'accueillerez-vous pas notre prière ? » Thucydide fait répondre par un des envoyés d'Athènes : « Votre haine nous est moins préjudiciable que votre amitié : celle-ci, aux yeux des peuples qui nous sont soumis, serait une preuve de faiblesse, tandis que votre haine deviendra un témoignage public de notre puissance. » Cette pensée, outre qu'elle est blâmable pour le fond, est présentée sous une forme entortillée. Pour la rendre intelligible, il faut la ramener à celle-ci : « Votre amitié nous ferait paraître faibles aux yeux des peuples qui nous sont soumis ; votre haine, au contraire, nous fera regarder comme puissants. Nous ne cherchons point à commander par la bienveillance, mais par la crainte. » [XL] Il ajoute d'autres pensées pleines d'affectation et d'aigreur : il fait dire aux Méliens que la fortune des combats est incertaine ; que lorsqu'on abandonne soudain la victoire, on n'a rien à attendre, tandis que l'espérance reste toujours à celui qui agit. Il met dans la bouche de l'orateur athénien, sur les fausses espérances de l'homme, une réponse plus embarrassée que tous les détours d'un labyrinthe. La voici : « L'espérance, notre soutien dans le danger, peut nuire à l'homme qui s'y livre au sein de la prospérité ; mais elle ne l'entraîne point à sa ruine. Elle perd ceux qui abandonnent tout aux caprices de la fortune; car, de sa nature, l'espérance est prodigue. Ils ne la connaissent qu'après avoir été trompés, et lorsqu'ils n'ont plus le moyen de se mettre à l'abri de ses perfidies. Vous êtes faibles et votre Avenir dépend du moindre caprice du sort : prévenez donc le malheur, et ne ressemblez pas à ces hommes qui, ayant d'abord quelques moyens humains de se sauver, conçoivent, s'ils viennent à les perdre et à être réduits aux dernières extrémités, les espérances les plus équivoques, et ont recours aux devins, aux oracles, et à toutes ces puérilités qui perdent les hommes par de brillantes illusions. » Je ne conçois point qu'on puisse louer Thucydide d'avoir fait dire aux chefs d'Athènes que les hommes sont poussés à leur ruine par leur confiance dans les dieux, et que les oracles, les devins ne sont d'aucune utilité à ceux qui passent leur vie dans la pratique de la piété et de la justice. Si Athènes mérite quelque éloge, c'est parce que toujours, et surtout dans les conjonctures dont il s'agit, elle suivit les ordres des dieux et consulta les oracles et les devins, ayant de rien entreprendre. Les Méliens répondent qu'outre la protection des dieux, ils comptent sur les Lacédémoniens, qui devront, si ce n'est par d'autres considérations, du moins par une sorte de pudeur, les secourir et ne pas voir périr, d'un œil indifférent, un peuple sorti de la même tige. Thucydide met dans la bouche de l'orateur athénien ces paroles plus arrogantes encore : «Nous ne croyons pas avoir moins de droits que vous à la protection des dieux ; car nous ne désirons, nous ne faisons rien qui soit contraire au respect qu'on leur doit, ou à ce que les hommes veulent pour eux-mêmes. Nous pensons que les dieux et les hommes sont portés, comme par une loi de la nature, à dominer partout où ils ont la force. Ce sentiment est fondé, à l'égard des dieux, sur l'opinion générale, et à l'égard des hommes sur l'expérience. » Le sens de ce passage est difficile à saisir, même pour ceux qui connaissent à fond la manière de Thucydide. La pensée me paraît être celle-ci : Les hommes jugent des dieux d'après l'opinion, et de la justice d'après une loi générale de la nature ; et cette loi, c'est qu'on a le droit de commander à ceux qu'on a pu soumettre. Cette maxime ne se lie pas à ce qui précède : elle est déplacée dans la bouche des Athéniens et des Grecs. [XLI] Je pourrais citer encore une foule de passages dont le sens est obscur ; mais pour que ce traité ne sorte pas des bornes convenables, je n'en ajouterai qu'un. Ce sont les paroles de l'orateur athénien, au moment où il quitte l'assemblée. «Du reste, vos plus grandes ressources sont dans les espérances que l'avenir vous présente. Vos moyens actuels ne sauraient vous faire triompher de la crise où vous êtes. Vous ferez preuve d'une grande folie, si vous n'embrassez pas un parti plus sage, après nous avoir fait sortir pour délibérer encore. » Il ajoute : « Vous ne prendrez point conseil d'un faux point d'honneur : il précipite les hommes dans des dangers manifestes, qui les exposent à la honte. Souvent, les hommes prévoient le terme funeste où ils vont aboutir ; mais ce sentiment qu'on appelle la crainte du déshonneur, les entraîne par une force à laquelle ils ne sauraient résister; et d'eux-mêmes, ils tombent dans un abîme de maux. » Thucydide ne prit aucune part à la discussion, il n'assista pas à cette entrevue, il n'entendit point les discours qui furent prononcés par les Athéniens et par les Méliens : on peut s'en convaincre par ce qu'il dit lui-même dans le livre précédent. Banni de sa patrie, après avoir rempli à Amphipolis les fonctions de général, il resta dans la Thrace jusqu'à la fin de la guerre. Il faut donc examiner si ce dialogue convient aux circonstances ; s'il est digne des personnages qui composaient cette assemblée ; enfin, si Thucydide s'est tenu le plus près possible de la vérité pour le fond des pensées, comme il devait le faire, d'après son introduction. La harangue prononcée par les Méliens pour la défense de leur liberté est bien placée dans leur bouche : leur langage est plein de noblesse, lorsqu'ils exhortent les Athéniens à ne point réduire à la servitude une ville grecque dont ils n'ont pas à se plaindre ; mais peut-on en dire autant des discours que l'historien fait tenir aux généraux d'Athènes et dans lesquels ils interdisent tout examen et toute discussion sur les intérêts les plus légitimes ; imposent des conditions dictées par la violence et l'avarice, et ne rougissent pas de soutenir que la justice n'a d'autre mesure que la volonté du puissant à l'égard du faible ? Certes, les chefs d'une république sagement constituée ne devaient point professer de telles maximes dans les villes étrangères, où ils étaient envoyés. Je ne peux me persuader que les députés d'une cité qui ne s'était illustrée par aucune action d'éclat, les Méliens, se soient plus attachés aux lois de l'honneur qu'à leur propre sûreté ; qu'ils se soient montrés disposés à subir les plus cruelles extrémités plutôt que d'accepter des conditions honteuses; tandis que les Athéniens, qui, à l'époque de la guerre contre les Perses, aimèrent mieux abandonner leur pays et leur ville que souscrire à des traités contraires à l'honneur, aient traité S1 insensé un peuple jaloux d'imiter une si belle conduite. Je pense même que si un orateur eût tenu un pareil langage en présence de ces Athéniens, à qui la Grèce doit le bienfait de la civilisation, il aurait excité leur indignation. Tels sont les motifs qui me déterminent à ne pas approuver la harangue des Athéniens; surtout, quand je la compare au discours où Archidamus, roi de Lacédémone, rappelle les habitants de Platée aux lois de la justice. Sa diction est pure et claire ; elle ne présente aucune figure forcée ni rien d'incohérent. Dans les discours des Athéniens, au contraire, les hommes les plus sages de la Grèce émettent des principes dangereux, et les expriment dans le style le plus inconvenant. Sans doute, le souvenir de l'exil auquel il avait été condamné, inspirait à l'historien quelque ressentiment contre sa patrie et il voulut par là l'exposer à la haine de tous les hommes ; car les maximes que les chefs d'un état et tous ceux qui sont revêtus d'une grande dignité professent, au nom de leur patrie, dans les villes étrangères, sont regardées comme les maximes de l'état dont ils sont les représentants. Ces observations sur les dialogues de Thucydide me paraissent suffire. [XLII] Les discours que j'admire le plus sont, dans le premier livre, le discours dans lequel Périclès engage les Athéniens à ne point céder aux peuples du Péloponnèse. Il commence par ces mots : « Je persiste dans la même opinion, ô Athéniens ! vous ne devez point céder aux Péloponnésiens. » Les pensées y sont d'une beauté presque divine ; dans l'arrangement des mots, point de figures incohérentes ou forcées : rien n'y blesse l'oreille; on y trouve, au contraire, tous les ornements qui font le mérite d'une harangue. J'admire aussi le discours du général Nicias aux Athéniens, après l'expédition de Sicile ; la lettre dans laquelle il leur demandait du secours et un successeur pendant qu'il était malade ; sa harangue aux soldats avant la dernière bataille navale, pour ranimer leur courage; son discours pour les consoler, lorsque, après la perte des trirèmes, il fut réduit à ramener son armée par terre, enfin, toutes les harangues qui se distinguent par la pureté et la clarté du style, et qui conviennent aux véritables débats. Mais le discours que j'admire le plus dans les sept livres de son histoire, c'est l'apologie des Platéens. Rien n'y sent la gêne ou l'affectation : tout y est peint avec des couleurs simples et naturelles, les pensées sont pathétiques, la diction n'a rien qui choque l'oreille, l'arrangement des mots est agréable et les figures conviennent au sujet. Tels sont les passages de Thucydide qui me paraissent les plus dignes de servir de modèle aux historiens. [XLIII] Dans le second livre, je ne peux louer dans tout son ensemble le discours que Périclès prononça pour son apologie, au moment où les Athéniens irrités lui reprochaient de les avoir déterminés à entreprendre la guerre. Dans le troisième livre, je n'approuve ni le discours de Cléon et de Diodotus au sujet de Mitylène, ni celui d'Hermocrate de Syracuse aux habitants de Camarina, ni la réponse d'Euphemus, ambassadeur d'Athènes, ni d'autres harangues semblables. Il n'est pas nécessaire d'énumérer toutes celles qui sont composées sur le même plan. Il me serait facile de donner une foule d'exemples à l'appui de ces observations ; mais pour ne pas trop allonger ce traité, je me bornerai à deux harangues : l'apologie de Périclès et le discours d'Hermocrate aux habitans de Camarina contre Athènes. [XLIV] Périclès commence ainsi : « Je m'attendais au courroux dont vous êtes animés contre moi ; j'en connais les motifs. J'ai convoqué cette assemblée pour vous rappeler ma conduite et pour vous reprocher de me poursuivre par d'injustes ressentiments et de céder à l'adversité. » Les paroles que Thucydide met dans la bouche d'un tel citoyen ne sont pas indignes de la noblesse de l'histoire ; mais Périclès, parlant pour sa défense à une multitude irritée, ne devait point l'employer, surtout au commencement de son apologie, avant d'avoir adouci par d'autres paroles la colère d'un peuple justement aigri par ses malheurs ; qui avait vu son fertile territoire démembré par les Lacédémoniens, une foule de citoyens moissonnés par la peste, et qui regardait comme la source de toutes ces calamités la guerre entreprise par les conseils de Périclès. Le ton de la menace était déplacé, quand il devait recourir à la prière ; car l'orateur qui s'adresse à la multitude ne doit pas irriter les esprits, mais les calmer. Périclès ajoute une pensée vraie et présentée sous une forme énergique ; mais hors de saison : « Je suis persuadé que lorsqu'un état est florissant, le peuple est plus heureux que si les particuliers vivent dans la prospérité, tandis que l'état se trouve dans une situation cri tique. Et en effet, le particulier, quelle que soit sa prospérité, est enveloppé dans la ruine commune, quand l'état périt; au lieu que le citoyen malheureux dans un état prospère, peut aisément se relever. » Lorsqu'il dit : « Si quelques particuliers sont malheureux et que l'étât prospère », la pensée est juste ; elle ne l'est plus quand il ajoute : « Lorsque tous les citoyens sont réduits aux dernières extrémités. » Alors, l'espoir d'un meilleur avenir ne repose sur aucun fondement solide, puisque l'avenir est un mystère pour l'homme et que le présent détermine ses sentiments sur l'avenir, d'après la position où i il se trouve. [XLV] A ces pensées, il en ajoute une plus étrange encore et tout-à-fait déplacée : « Le citoyen en butte à votre haine croit connaître et discuter, aussi bien que tout autre, les intérêts de la patrie : il aime son pays, et l'or ne peut rien sur son âme. » Il est étonnant que Périclès, le plus grand orateur de son temps, ait ignoré ce principe connu des esprits les plus ordinaires, que tout homme qui se loue outre mesure indispose ceux qui l' écoutent ; surtout au barreau et dans les assemblées publiques, lorsqu'il s'agit non d'une récompense, mais d'un châtiment. Non seulement il choque son auditoire, mais il se nuit à lui-même en provoquant l'indignation de la multitude. Un orateur, qui a les mêmes hommes pour juges et pour accusateurs, doit employer les larmes et les gémissements, pour parvenir avant tout à se faire écouter avec bienveillance. Périclès ne se se contente pas des paroles que je viens de rapporter, il les paraphrase et emploie des formes affectées : « Avoir des connaissances sans le talent de les communiquer, ce n'est pas différer de l'homme qui ne pense pas : avec ces deux qualités, sans amour pour la patrie, on ne donnera jamais de bons conseils ; et si l'on a cet amour, sans être inaccessible à la cupidité, ce seul vice rendra tout vénal. » Je ne sais si ces paroles de Périclès contre les Athéniens irrités paraîtront bien placées dans sa bouche, quelque vraies qu'elles soient ; car l'invention des pensées et des raisonnements est peu de chose, s'ils ne conviennent aux personnes, aux circonstances et à tout ce que la composition exige. Mais, comme je l'ai déjà observé, Thucydide voulant faire connaître l'opinion qu'il avait de Périclès, amis dans sa bouche ce discours, qui est un véritable hors-d'œuvre. Il devait commencer par dire ce qu'il pensait de cet illustre citoyen, et lui prêter ensuite, dans la situation critiqué où il se trouvait, un langage modeste et propre à désarmer le courroux des Athéniens. Telle était la marche à suivre pour tout historien jaloux de copier la vérité. [XLVI] Je regarde comme désagréables et vraiment frivoles certains ornements de style et certaines formes de raisonnement qui embarrassent la pensée, par exemple : « Ἰέναι δὲ τοῖς ἐχθροῖς ὁμόσε, καὶ ἀμύνεσθαι μὴ φρονήματι μόνον, ἀλλὰ καὶ καταφρονήματι. Φρόνημα μὲν γὰρ καὶ ὑπὸ ἀμαθίας εὐτυχοῦς καὶ δειλῷ τινι ἐγγίγνεται· καταφρόνησις δέ, ὃς ἂν καὶ γνώμῃ πιστεύῃ τῶν ἐναντίων προέχειν· ὃ ἡμῖν ὑπάρχει. Καὶ τὴν τόλμαν ἀπὸ τῆς ὁμοίας τύχης ἡ σύνεσις ἐκ τοῦ ὑπέρφρονος ὀχυρωτέραν παρέχεται· ἐλπίδι τε ἧσσον πιστεύει, ἧς ἐν τῷ ἀπόρῳ ἡ ἰσχύς· γνώμῃ δὲ ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων, ἧς βεβαιοτέρα ἡ πρόνοια. » « Marchons contre l'ennemi, et soyons prêts à la combattre non seulement avec un juste sentiment d'orgueil, mais encore avec mépris. La présomption peut naître de l'ignorance heureuse, même dans le cœur d'un lâche; mais le mépris est toujours fondé sur la conviction d'une certaine supériorité ; et cette conviction, elle existe parmi nous. À égalité de fortune, l'habileté donne plus de fermeté au courage, par la fierté qu'elle inspire : elle compte non sur l'espérance dont l'accomplissement est toujours incertain ; mais sur la connaissance de ses avantages réels, qui sont un garant assuré des succès qu'elle prévoit. » Ces pensées sont froides et dignes de Gorgias : l'expression a un tour sophistique et manque tout-à-fait de grâce. Ce passage : « ἥ τε τόλμα ἣν ἀπὸ τῆς ὁμοίας τύχης ἡ σύνεσις ἐκ τοῦ ὑπέρφρονος ὀχυρωτέραν παρέχεται » est plus obscur que le style d'Heraclite. Dans celui-ci « Ἥ τε τῆς ἐλπίδος ἐν τῷ ἀπόρῳ ἰσχύς - ἡ τῆς γνώμης ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων βεβαιοτέρα πρόνοια », nous trouvons une périphrase poétique. L'historien veut dire qu'il faut s'attacher aux sentimenτs qui naissent des conjonctures présentes, bien plus qu'à l'espérance dont l'efficacité est toute dans l'avenir. [XLVII] J'ai remarqué aussi que pour calmer la colère qu'inspiraient aux Athéniens les calamités présentes dont la plupart étaient imprévues; que pour les exhorter à résister avec courage aux coups de la fortune, s'ils ne voulaient pas affaiblir la dignité de la république, et à mettre un terme à leurs plaintes sur leurs malheurs privés pour s'occuper du salut de la patrie, Périclès leur dit que leur puissance maritime est telle que ni le roi de Perse, ni les Lacédémoniens, ni aucun peuple ne pouvaient l'abattre. La preuve de ce qu'il avance ne se trouvait point dans le présent, mais dans l'avenir : elle reposait moins sur leur sagesse que sur l'espérance. Bientôt il oublie ce passage pour dire qu'ils ne doivent pas se fier à l'espérance dont l'accomplissement est toujours incertain : il y a ici une véritable contradiction. Le sentiment de leurs maux agissait, dans le moment, sur leurs âmes ; tandis que les avantages dont il parle étaient encore éloignés. Si je blâme dans ce passage le style et les pensées, j'admire ce qui suit, autant pour les pensées que pour la noblesse et la grâce de l'expression : « Un peuple qui, libre dans son choix et jouissant d'une grande prospérité, se décide pour la guerre, fait preuve de folie ; mais quand on est forcé de céder à ses voisins ou de braver tous les périls pour vaincre, le blâme est pour celui qui fuit le danger, et non pour ceux qui l'affrontent. Quant à moi, je suis toujours le même et je n'ai point changé de sentiment ; c'est vous qui êtes inconstants. Avant vos malheurs vous avez suivi mes conseils ; mais vous avez pris une résolution nouvelle, depuis que vous avez éprouvé des revers. » Le passage suivant me paraît aussi d'une grande beauté : « Les événements inattendus et qui arrivent contre toute probabilité, abattent l'orgueil. Vous ne l'avez pas moins prouvé, à l'occasion de la maladie contagieuse qui nous afflige, que dans toutes les circonstances ; et cependant, citoyens, d'une république puissante, élevés dans des principes dignes d'elle, vous deviez supporter avec courage les coups du sort et ne point ternir votre gloire. L'homme qui laisse perdre par faiblesse la renommée qu'il s'est acquise, mérite des reproches ; et celui qui aspire à une gloire dont il n'est pas digne, s'expose à la haine de ses concitoyens. » J'en dis autant du morceau où Périclès s'efforce d'exalter l'orgueil national des Athéniens : « Vous devez veiller à la conservation de cette splendeur que vous donne la puissance, et dont vous êtes si fiers. Résistez à tous les maux, ou renoncez à la gloire. Sachez que vous aurez à lutter, non seulement pour ne point tomber de la liberté dans l'esclavage, mais encore pour conserver votre puissance et triompher des haines qu'elle vous a suscitées ; et cette puissance vous ne pourriez vous en dessaisir, quand même, dans les conjonctures présentes, la crainte vous déterminerait à vivre dans le repos, sans vous mêler des affaires publiques. Entre vos mains, elle est regardée comme une tyrannie; et s'il fut injuste de s'en emparer, vous ne pouvez y renoncer sans danger. » J'admire encore tous les passages où les figures de mots et de pensées sont employées avec la même sagesse et ne présentent ni affectation ni obscurité. [XLVIII] Dans le discours d'Hermocrate, voici le passage où Thucydide me paraît mériter des éloges. « Nous ne venons point accuser la république d'Athènes : il nous serait trop facile de révéler ses injustices ; et d'ailleurs nous parlons à des hommes qui les connaissent. C'est plutôt nous que nous devons accuser : nous avons sous les yeux l'exemple de tant de Grecs réduits à l'esclavage, parce qu'ils ne s'étaient point secourus; nous voyons les mêmes ruses employées contre nous, le rétablissement des Léontins dans leur ville, en faveur de la communauté d'origine, les secours fournis aux Egestins, comme à des alliés ; et nous ne nous hâtons pas de nous liguer, pour prouver que nous ne sommes point de ces Ioniens, de ces habitants de l'Hellespont ou de ces insulaires toujours prêts à changer de maître, toujours esclaves, tantôt d'un Perse, tantôt d'un autre tyran ; mais de ces Dorions sortis du Péloponnèse, libres et indépendants, pour habiter la Sicile. Attendrons-nous que nos villes soient prises l'une après l'autre, lorsque nous savons que c'est le seul moyen de nous subjuguer. » Ce style est clair, pur, plein de vivacité, de grâce, de force, de noblesse, de véhémence et de ces mouvements rapides qui trouvent leur place au barreau, dans les assemblées publiques et dans les entretiens d'amis. Il en est de même de ce passage : « Si quelqu'un nous porte envie ou nous craint ( car la supériorité fait naître ces deux sentiments ) ; si, pour ce motif, il souhaite que Syracuse soit humiliée, afin que nous devenions plus modestes, et qu'en même temps elle soit conservée pour sa propre sûreté, il veut ce qui n'est pas dans la puissance de l'homme. Il n'est donné à personne de maîtriser, à son gré, et ses désirs et la fortune. » J'en dirai autant de la fin du discours : « Daignez écouter nos prières. Si nous ne parvenons point à vous persuader, nous protesterons contre vous ; car Doriens comme vous, attaqués par les Ioniens, nos éternels ennemis, c'est par vous que nous aurons été trahis. Si les Athéniens parviennent à nous asservir, ils en seront redevables à votre détermination : ils en recueilleront seuls toute la gloire, et le prix de la victoire sera de faire passer sous leur joug les auteurs de leur triomphe. » Voilà des passages d'une grande beauté et dignes d'être pris pour modèle. Mais je ne sais comment on peut louer ce qui suit : «Ils viennent en Sicile sous le prétexte qui vous est connu, mais avec les intentions que nous leur supposons tous : à mon avis, c'est moins pour rétablir les Léontins dans leur ville que pour nous chasser de la nôtre. » Cette paronomase est froide ; elle n'a rien de pathétique et décèle une grande affectation. lien est de même de ce passage où se trouvent des figures embarrassées, inextricables : « Les Athéniens ne résistèrent point au roi de Perse pour la liberté de la Grèce, ni les Grecs pour leur propre liberté. Les premiers voulaient que la Grèce fut soumise à leur joug et non à la Perse; les autres ne cherchaient qu'à changer de maître et à en avoir un moins faible et plus astucieux. » Dans un autre endroit, il passe du singulier au pluriel et du discours du personnage qu'il met en scène au personnage même : « Si quelqu'un s'imagine que ce n'est pas lui qu'Athènes regarde comme son ennemi, mais les Syracusains; s'il trouve pénible de s'exposer au danger pour notre patrie, il doit songer qu'il s'agit autant de sa patrie que de la nôtre. Il trouverait d'autant plus de sûreté à embrasser notre cause que nous ne sommes pas encore anéantis, qu'il nous aura pour alliés et ne combattra pas seul. Qu'il songe enfin que les Athéniens n'ont point pour but de se venger de notre haine. » Ces expressions sont puériles, recherchées et plus obscures que des énigmes. On peut en dire autant de ce passage : « Si l'événement est contraire à son attente, gémissant sur ses malheurs, peut-être alors verra-t-il d'un oeil d'envie notre prospérité ; ce qui ne sera plus permis à quiconque nous aura abandonnés pour ne point prendre part à des dangers communs, non seulement en apparence, mais en réalité. » Il ajoute cette épiphonème : « Il paraîtra sauver notre puissance ; mais dans le fait, il aura pourvu à son propre salut. » [XLIX] Cette harangue renferme d'autres défauts: il ne me paraît pas nécessaire de les exposer plus au long. Je crois avoir démontré, comme je l'avais avancé, que la diction de Thucydide est d'une grande beauté, quand il s'éloigne du style ordinaire avec une sage mesure et s'attache aux qualités fondamentales de l'élocution ; tandis qu'il tombe au-dessous du médiocre, dès qu'il abandonne les expressions ordinaires et usitées pour des expressions ou des figures étranges, forcées et incohérentes. Cette affectation l'empêche même de déployer toutes les richesses de son talent. Sa diction ne peut trouver place ni dans les assemblées délibérantes, où se discutent la paix et la guerre, les lois, les institutions politiques, en un mot, les plus grands intérêts d'un état ; ni au barreau, où il s'agit de la peine capitale, des fers, de la flétrissure, de la confiscation des biens, et où l'on s'adresse à des hommes qui ont le droit de prononcer sur ces grandes questions. Des discours de ce genre fatiguent la multitude peu accoutumée à les entendre. Ils ne sauraient non plus convenir aux réunions particulières, où l'on a coutume de discourir avec ses concitoyens, ses amis ou ses proches sur tout ce qui a rapport à la conduite de la vie ; de s'entretenir de ce qui leur est arrivé ; de donner ou de recevoir des conseils sur un objet important 5 de leur adresser des exhortations, de se réjouir de leur bonheur ou de s'affliger de leurs infortunes. Je ne dirai pas que nos pères et nos mères ne pourraient supporter de pareils discours à cause du dégoût qu'ils inspirent : ils ont besoin d'un interprète, comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Telle est l'opinion que j'ai conçue de cet historien-, j'ai tâché de l'exposer avec toute la franchise possible. [L] Je dois maintenant faire connaître le jugement qu'en ont porté certains critiques, pour ne rien négliger. Le style de Thucydide n'est propre ni aux discussions politiques, ni aux entretiens familiers : c'est une vérité reconnue par tous les bons esprits. Certains sophistes, qui ont quelque célébrité, s'efforcent de persuader que sa diction n'est convenable ni aux orateurs qui se préparent à parler dans les assemblées populaires, ni à ceux qui plaident au barreau ; mais ils prétendent qu'elle a naturellement sa place dans les compositions historiques, où l'on doit trouver cette grandeur, cette noblesse, ce sublime qui étonne, ces locutions étranges et surannées qui s'éloignent des tours usités et ont quelque chose d'extraordinaire et de pompeux. Ils soutiennent que ses écrits ne sont pas destinés aux hommes qui vivent dans les places publiques, ni à des artisans mercenaires qui n'ont aucune teinture des lettres; mais à des esprits initiés à tous les secrets de l'éloquence et de la philosophie ; capables, en un mot, de saisir toutes les finesses de la composition. Suivant d'autres, Thucydide en composant son ouvrage n'a pas songé à la postérité, mais à ses contemporains qui se servaient de ce genre d'élocution. Si nous voulons juger sans prévention, nous reconnaîtrons qu'elle ne doit être employée, ni dans les compositions historiques, ni dans les assemblées publiques, ni au barreau ; car ceux qui s'y réunissent pour délibérer ou pour juger ne sont jamais tels que le suppose Thucydide. [LI] Je répondrai à ceux qui pensent que les hommes instruits peuvent seuls lire et comprendre Thucydide, qu'ils détournent de l'utilité générale une science utile à tous les hommes (car il n'en est pas de plus importante et de plus nécessaire que la science historique), pour la restreindre à un très petit nombre d'individus, comme on le pratique dans les états oligarchiques ou despotiques. Il est facile de compter les hommes capables d'expliquer Thucydide; et cependant, pour beaucoup d'endroits, ils ne peuvent se passer de commentaire. Quant à ceux qui soutiennent que les formes du style de Thucydide étaient familières aux écrivains contemporains, il me sera facile de démontrer, en peu de mots, que parmi une foule d'orateurs et de philosophes qu'Athènes vit naître à l'époque de la guerre du Péloponnèse, aucun n'a employé ce genre de style, ni Andocide, ni Antiphon, ni Lysias, parmi les orateurs ; ni Critias, ni Antisthène, ni Xénophon parmi les disciples de Socrate. Toutes ces observations font voir que Thucydide est le premier qui l'employa, pour se distinguer des autres historiens. Tant qu'il se renferme dans une juste mesure, il est si admirable qu'aucun autre ne peut lui être comparé ; mais dès qu'il le prodigue jusqu'à la satiété sans avoir égard aux circonstances, sans fixer d'avance le terme où il doit s'arrêter, il mérite les plus grands reproches. Je suis loin de penser que le style historique doit être négligé et sans art. Qu'il ait quelque chose de poétique, mais sans viser à toutes les qualités de la poésie ; qu'en certains points seulement, il s'éloigne du langage ordinaire. Rien n'est, en effet, plus fade et plus désagréable que l'excès : en tout une juste mesure a de grands avantages. [LII] Pour remplir ma tâche, il me reste à parler des orateurs et des historiens qui ont imité Thucydide. Je dois ici me tenir sur mes gardes et craindre de fournir à certains hommes accoutumés à tout empoisonner, l'occasion de lancer contre moi une accusation contraire à la modération que j'ai prise pour règle dans mes écrits et dans ma conduite. Peut-être paraîtrais-je céder à l'impulsion de l'envie et de la malveillance, en désignant les écrivains qui n'ont pas heureusement imité Thucydide, et en critiquant sans détour les ouvrages dont ils s'enorgueillissent et par lesquels ils ont acquis de grandes richesses ou une brillante renommée. Pour ne pas donner lieu à de fâcheux soupçons, je laisserai à d'autres le soin de les blâmer et de rappeler leurs fautes. Je me bornerai à dire quelque chose des auteurs qui l'ont heureusement imité, et je terminerai ainsi ce traité. Parmi les historiens anciens, aucun, du moins à ma connaissance, n'a imité dans Thucydide ce qui le distingue des autres ; je veux dire ces expressions obscures, surannées, poétiques ou étrangères ; ces hyperbates, ces locutions embarrassées, ces tours où, par une concision affectée, il cherche à renfermer en quelques mots plusieurs pensées, dont les parties correspondantes sont séparées par un long intervalle ; ces figures énigmatiques et entortillées qui ne reposent sur aucune analogie naturelle ; qui trouvent à peine leur place dans la poésie, ternissent toutes les grâces et détruisent par l'obscurité les plus brillantes qualités du style. [LIII] Démosthène est le seul orateur qui, dans une foule d'endroits, a imité Thucydide et les écrivains les plus célèbres. Il a donné à l'éloquence certaines qualités empruntées à cet historien et qu'on ne trouve ni dans Antiphon, ni dans Lysias, ni dans Isocrate, qui furent les orateurs les plus distingués de cette époque ; je veux dire la vivacité, le nerf, la véhémence, ce ton mordant et austère, ce sublime qui remue le cœur. Quant à ces tours affectés, étranges et poétiques, il n'a pas cru qu'ils pussent convenir aux véritables débats; et il les a laissés de côté. Il n'imite pas non plus ces figures vagues qui ne sont point fondées sur des rapports naturels, ni ces locutions qui se rapprochent du solécisme. Il s'est renfermé dans les limites posées par l'usage : il orne sa diction par la variété des tours, et en ne présentant aucune pensée sous une forme simple et sans figure. Il imite ces locutions serrées qui renferment en peu de mots plusieurs pensées dont les parties correspondantes sont séparées par de longs intervalles et ont quelques chose d'extraordinaire : il les transporte dans les harangues politiques et judiciaires ; mais dans les discours qui concernent de simples particuliers, il en est plus sobre que dans les harangues politiques. [LIV] Je vais donner quelques exemples dans l'un et l'autre genre : ils suffiront à ceux qui ont lu Démosthène. D'abord, je citerai la harangue intitulée sur la guerre contre le Roi, dans laquelle il engage les Athéniens à ne pas entreprendre cette guerre témérairement, parce qu'ils n'ont ni des forces égales à celles de leur ennemi, ni des alliés assez dévoués ou assez fidèles pour partager tous les dangers. Il les exhorte, en outre, à faire leurs préparatifs pour prouver qu'ils sont prêts à supporter les plus grandes fatigues pour la liberté de la Grèce, si quelque ennemi vient l'attaquer. Mais il ne veut pas qu'avant ces préparatifs on envoie des députés aux autres peuples pour les pousser à la guerre, parce que ces députés ne seraient pas écoutés. Il s'arrête à cette pensée et la développe de cette manière : « Certes, parmi tous les peuples de la Grèce, il n'en est pas qui, en voyant vos mille cavaliers, vos hoplites aussi nombreux que vous le voudrez, et vos trois cents vaisseaux, ait assez de confiance dans ses forces pour ne pas recourir à votre protection, ou qui ne soit persuadé qu'elle assurera son salut. Les solliciter en ce moment, ce serait prier vous-mêmes et vous exposer à un refus ; mais si vous commencez par faire des préparatifs, vous pourrez tenir ferme et défendre ceux qui vous demanderont du secours. Sachez bien que tous les peuples viendront vous implorer. » Ces tours diffèrent du style commun et ordinaire ; ils sont bien au-dessus de la diction simple, mais ils n'offrent rien d'obscur et n'ont pas besoin de commentaire. Après avoir parlé des préparatifs, il ajoute : « Ainsi, Athéniens, le plus important pour vous, c'est d'être persuadés que vous devez faire avec ardeur ce que les circonstances exigent. Souvenez - vous que vos entreprises ont réussi, toutes les fois que chacun de vous a voulu faire ce qu'il devait; Mais lorsque vous avez compté les uns sur les autres, après avoir pris une résolution, comme si un autre devait agir pour vous et réparer votre négligence, vous avez échoué. » La pensée est compliquée : le langage usité a fait place à un tour extraordinaire ; cependant la clarté s'accorde ici avec la noblesse. La plus remarquable de ses harangues contre Philippe commence par ces mots : « Athéniens, dans presque toutes vos assemblées, on prononce de nombreux discours sur les injustices dont Philippe s'est rendu coupable, depuis la conclusion de la paix, soit envers vous, soit envers les autres peuples de la Grèce. Vous reconnaissez, je le sais, mais vous le reconnaissez sans rien faire, que nous devons tous parler et agir pour mettre enfin un terme à son insolence, et pour qu'il en soit puni. Aussi, notre position est telle que je dois craindre de passer pour un calomniateur, en avançant (quoique ce soit la vérité ), que si les orateurs qui m'ont précédé à cette tribune, vous avaient donné les conseils les plus funestes et si vous les aviez appuyés par vos suffrages, la république ne serait pas dans un plus triste état. » Il en est de même de ce passage : « Croyez-vous que Philippe, après avoir mieux aimé tromper que soumettre par la force des peuples qui ne pouvaient lui faire aucun mal, et ne cherchaient qu'à éviter ses attaques, vous avertira avant de vous déclarer la guerre ; surtout, lorsque vous paraissez vous complaire à être dupes. » Dans la meilleure de ses harangues judiciaires, intitulée sur la Couronne, en parlant des ruses employées par Philippe pour s'emparer de plusieurs villes, il rend ainsi sa pensée : « Je n'ajouterai rien sur la cruauté de Philippe envers les peuples qu'il avait vaincus, et que tant d'autres ont aussi éprouvée. Quant à cette humanité dont il se couvrait comme d'un masque, pour tout réduire sous sa puissance, vous en avez recueilli les fruits, et puissiez-vous toujours vous en féliciter ! » Il prouve ensuite que les traîtres qui livrèrent la république à Philippe furent les auteurs de toutes les calamités de la Grèce, et s'exprime en ces termes : « Oui, je le jure par Hercule et par tous les dieux, si, bannissant du milieu de nous le mensonge et la malveillance, nous voulons rechercher sans prévention les véritables auteurs des maux qui nous accablent, nous verrons que, dans chaque ville, ce sont les hommes qui ont imité la conduite d'Eschine plutôt que la mienne. A l'époque où la puissance de Philippe, faible encore, n'était d'aucun poids ; tandis que je vous indiquais le parti le plus utile; tandis que je vous pressais d'y souscrire, des traîtres, par la honteuse passion d'un gain illégitime, ont trahi les intérêts de la patrie : ils n'ont cessé de tromper et de corrompre leurs concitoyens qu'après en avoir fait, des esclaves. » [LV] Je pourrais citer une foule de passages tirés des discours politiques ou judiciaires de Démosthène, et dans lesquels il imite les formes du style de Thucydide, si éloignées du langage ordinaire. Mais afin que ce traité ne devienne pas trop long, je me contenterai de ces exemples : ils suffisent pour établir ce que j'avais avancé. Je ne craindrai pas de recommander aux écrivains qui se livrent à l'éloquence et conservent encore un goût sain, d'apprendre de Démosthène, le plus parfait des orateurs, à imiter dans Thucydide sa concision, sa force, sa vigueur, son nerf, sa noblesse et les qualités semblables que tout le monde reconnaît en lui ; à n'admirer et à n'imiter ni ces formes énigmatiques, difficiles à entendre et qui ont besoin do commentaire, ni ces tours forcés qui se rapprochent du solécisme. En effet, croire qu'on doit également imiter les endroits obscurs et ceux où la clarté s'unit à toutes les autres qualités, c'est manquer de bon sens. On doit avouer qu'il faut donner la préférence à un passage qui ne laisse rien à désirer plutôt passage négligé ; et à ce qui est clair plutôt qu'à ce qui est obscur. Pourquoi tout louer dans Thucydide ? Pourquoi soutenir qu'il a employé le style usité de son temps, sans porter ses regards vers la postérité ? Pour moi, je ne bannis pas tout-à-fait Thucydide des assemblées publiques et du barreau : je déclare, au contraire, que chez lui, la narration, à quelques exceptions près, est vraiment admirable et peut servir de modèle dans toutes les circonstances. Quant à la partie oratoire, elle doit être imitée seulement dans les endroits que tout le monde entend, mais dont tout le monde ne saurait approcher. J'aurais pu, mon cher Q. Elius Tubéron, vous écrire sur cet historien des choses plus agréables ; mais non pas de plus vraies.
|