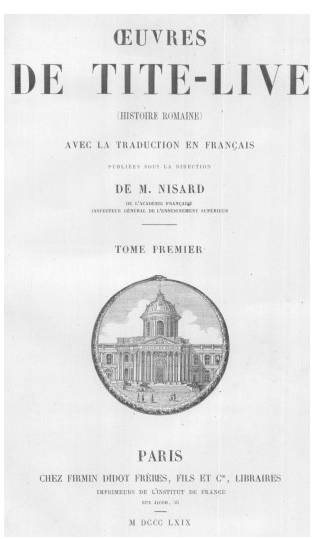|
ALLER A LA TABLE DES MATIERES DE TITE-LIVE TITE-LIVE Ab Urbe Condita, Livre VI
Oeuvres de Tite-Live, t. I, Paris, Firmin Didot, 1864
270. LIVRE SIXIÈME. SOMMAIRE. — Guerres et succès contre les Volsques, les Èques et les Prénestins. — Quatre nouvelles tribus sont établies, la Stellatine, la Sabbatine, la Tromentine et l'Arnienne. — M. Manlius, qui avait défendu le Capitole contre les Gaulois, libère les débiteurs, vient en aide aux détenus insolvables, et, accusé pour cela d'aspirer à la royauté, est condamné et précipité de la roche tarpéienne. — Pour flétrir sa mémoire, on interdit par un sénatus-consulte à la famille Manlia le surnom de Marcus. — C. Licinius et L. Sextius, tribuns du peuple, proposent une loi pour l'admission des plébéiens au consulat, jusque là réservé aux patriciens. Cette loi, apres de longs débats, et malgré l'opposition des patriciens, soutenus de ces mêmes tribuns du peuple, seuls magistrats pendant cinq ans, est adoptée. — L. Sextius, premier consul plébéien. — Promulgation d'une autre loi par laquelle il est défendu aux particuliers de posséder par tète plus de cinq cents arpents de terre. 1. J'ai exposé en cinq livres l'histoire des Romains, depuis la fondation de la ville de Rome jusqu'à la prise de la même ville, sous les rois d'abord, ensuite sous les consuls et les dictateurs, les décemvirs et les tribuns consulaires; les guerres étrangères, les dissensions domestiques : histoire obscure, et par son extrême antiquité, comme ces objets qu'on aperçoit à peine à cause de leur trop grand éloignement; et par l'insuffisance et la rareté, à ces mêmes époques, de l'écriture, seule gardienne fidèle du souvenir des actes du passé; enfin, par la destruction presque entière, dans l'incendie de la ville, des registres des pontifes, et des autres monuments publics et particuliers. C'est avec plus de clarté, comme avec plus de confiance, que j'exposerai désormais les événements qui vont suivre au dedans et au dehors; cette renaissance de Rome, repoussée pour ainsi dire de sa souche avec plus de sève et de vie. Et d'abord, relevée par le bras de M. Furius, la république s'appuya encore sur ce grand citoyen, pour se maintenir. On n'accepta point son abdicat non de la dictature, avant l'expiration de l'année. On ne jugea pas à propos de confier la tenue des comices pour l'année suivante, aux tribuns en charge lors de la prise de la ville, et on eut recours 'n des interrois. Pendant que les citoyens travaillaient avec un zèle et une ardeur infatigables à la reconstruction de la ville, Q. Fabius, à peine sorti de magistrature, fut assigné par C. Martius, tribun du peuple, parce que, envoyé vers les Gaulois avec une mission de paix, il s'était battu contre le droit des gens ; mais il fut soustrait à ce jugement par une mort qui arriva si à propos, que beaucoup la crurent volontaire. Le premier interroi fut P. Cornélius Scipion; après lui, M. Furius Camille. Celui-ci pour la seconde fois, crée des tribuns militaires avec puissance de consuls : L. Valérius Publicola pour la seconde fois; L. Virginius, P. Cornélius, A. Man- 271 lius, L. Émilius, L. Postumius. Étant entrés en charge aussitôt après l'interrègne, ils commencèrent par occuper le sénat d'intérêts tout religieux. Ils firent d'abord rechercher les traités et les lois qui subsistaient encore ( les douze tables et quelques lois royales); les unes furent répandues jusque parmi le peuple; mais celles qui avaient trait aux choses saintes furent supprimées, et cela principalement par les pontifes, qui voulaient se réserver le frein de la religion, au moyen duquel ils contiendraient la multitude. Ce fut également à cette époque que l'on commença à désigner les jours religieux : le quatorzième jour avant les calendes sextiles, marqué par un double désastre, le massacre des Fabius sur le Crémère, et sur l'Allia, par la honteuse défaite de l'armée, suivie de la ruine de Rome, fut appelé de ce dernier revers jour de l'Allia, et l'on établit que ni l'état, ni les particuliers n'entreprendraient rien ce jour-là. Comme c'était le lendemain des ides de juillet que Sulpicius, tribun militaire, avait sacrifié sans succès, et comme, sans avoir eu soin d'apaiser les dieux, il avait, trois jours après, livré l'armée romaine aux coups de l'ennemi, il fut pour cela, dit-on, ordonné de s'abstenir de tout acte sacré le lendemain des ides; et par la suite, selon quelques traditions, cette pieuse interdiction s'étendit au lendemain des calendes et des nones. II. On ne put pas longtemps s'occuper à loisir de relever la république d'une si grande chute. D'un côté, les Volsques, nos anciens ennemis, avaient pris les armes pour anéantir le nom romain ; d'un autre côté, au dire des marchands,les chefs de toutes les nations de l'Étrurie, réunis au temple de Voltumna, s'étaient conjurés pour la guerre; enfin, pour surcroît d'alarmes, on annonçait la défection des Latins et des Herniques, qui, depuis le combat du lac Régille, n'avaient jamais, pendant près de cent ans, trahi la foi qui les unissait au peuple romain. Comme, en présence de si nombreux et de si pressants dangers, chacun comprenait clairement que le nom romain était non seulement menacé par la haine de l'ennemi, mais encore par le mépris des alliés, on résolut de confier la défense de la république aux auspices qui l'avaient reconquise, et l'on nomma dictateur M. Furius Camille. Ce dictateur nomma C. Servilius Ahala maître de la cavalerie, et, après avoir proclamé le justitium, il fit une levée de jeunes soldats : les vieillards mêmes à qui il restait quelque vigueur prêtèrent serment et furent enrôlés par centuries. Ces troupes inscrites et armées, il les divisa en trois corps : le premier devait aller sur les terres de Véies, faire tête à l'Étrurie; un autre eut ordre de camper aux portes de la ville : ces dernières troupes étaient commandées par le tribun militaire A. Manlius; celles qu'il envoyait contre les Étrusques avaient pour chef L. Emilius. Lui-même, il mena le troisième corps contre les Volsques, les trouva campés non loin de Lavinium, au lieu dit près Mécius, et les attaqua. Les Volsques, qui portaient la guerre à Rome par mépris de sa faiblesse et parce qu'ils croyaient que les Gaulois avaient à peu près détruit la jeunesse romaine, furent, au seul nom de Camille, saisis d'une telle épouvante, qu'ils se couvrirent d'un retranchement, fortifié lui-même 272 d'un monceau d'arbres renversés pour fermer à l'ennemi l'accès des palissades. Voyant cela, Camille fit mettre le feu à ce rempart de branchages; secondée par le vent, qui par hasard soufflait avec violence du côté de l'ennemi, la flamme eut bientôt ouvert un chemin : l'incendie gagna le camp, et la vapeur, la fumée, le pétillement même de cette verte matière embrasée, effraya si fort l'ennemi, que les Romains eurent moins de peine à forcer le retranchement pour pénétrer dans le camp des Volsques, qu'ils n'en avaient eu à franchir les branchages dévorés par l'incendie. Après avoir mis en déroute et taillé en pièces l'ennemi, et s'être rendu maître du camp, le dictateur livra le butin aux soldats, ce qui leur fut d'autant plus agréable qu'ils s'y attendaient moins de la part d'un général peu porté à ces largesses. Ensuite, Camille poursuivit les fuyards, et, lorsqu'il eut entièrement ravagé le territoire des Volsques, ceux-ci se rendirent, domptés enfin après soixante-dix ans de guerres. Vainqueur des Volsques, il marcha contre les Èques, qui, eux aussi, préparaient la guerre; il écrasa leur armée à Botes, et ayant attaqué non seulement leur camp, mais leur ville, il s'en empara du premier coup. III. Tandis que du côté où Camille était à la tête des forces romaines, la fortune se prononçait pour nous, d'un autre côté, on éprouvait de vives alarmes. Presque toute l'Étrurie en armes assiégeait Sutrium, alliée du peuple romain : ses députés, s'étant adressés au sénat, en le priant de les assister dans leur détresse, obtinrent un décret qui ordonnait au dictateur de se porter sansdélai au secours des Sutriens. Mais la fortune des assiégés ne leur permit pas d'attendre l'accomplissement de cette promesse : peu nombreux, épuisés par les fatigues, les veilles et les blessures qui tombaient toujours sur les mêmes, les habitants avaient, par une capitulation, livré leur ville à l'ennemi, et, ayant quitté leurs pénates, les malheureux s'en allaient, sans armes, et n'ayant que le seul vêtement qu'ils portaient. En ce moment, par hasard, Camille arriva avec l'armée romaine; cette troupe désolée se roula à ses pieds ; il entendit un discours des principaux citoyens, où était exposée leur affreuse situation, et les gémissements des femmes et des enfants qui se traînaient pour les suivre en exil : il les accueillit, et les engagea à ne plus se désoler, leur disant qu'il allait porter aux Étrusques le deuil et les larmes. II fait déposer les bagages, laisse les Sutriens sous la protection d'un détachement peu considérable, et donne ordre au soldat de n'emporter que ses armes. Alors, avec ses troupes plus légères, il marche à Sutrium; il y trouve, comme il l'avait prévu et comme il arrive toujours après un succès, le désordre partout : pas un poste devant les remparts, les portes ouvertes, et le vainqueur dispersé dans les maisons ennemies pour en enlever le butin. Aussi, pour la seconde fois dans le même jour, Sutrium est pris; les Étrusques vainqueurs sont égorgés l'un après l'autre, par un ennemi qu'ils n'attendaient pas, et qui ne leur laisse pas le temps de se recueillir, de se rassembler, de prendre leurs armes. Plusieurs ayant couru aux portes avec l'intention de se jeter dans la campagne, trouvant 273 portes fermées; car c'était le premier ordre qu'avait donné le dictateur. Alors les uns prennent les armes; les autres qui, par hasard, étaient armés au moment de l'attaque, appellent leurs camarades pour les engager à se défendre, et leur désespoir eût allumé le combat, si des hérauts répandus par la ville n'eussent crié de mettre bas les armes ; que ceux qu'on verrait désarmés seraient épargnés, mais qu'on frapperait tout ce qui serait arme. Alors ceux-là mêmes qui ne s'étaient décidés au combat que parce qu'ils y entrevoyaient une dernière chance de salut, recouvrant l'espoir de conserver leur vie, jettent leurs armes de côté et d'autre, et, désarmés, prenant le seul parti le plus sûr que leur offrît la fortune, se mettent à la discrétion du vainqueur. Pour garder cette multitude, on la divisa; et, avant la nuit, la ville fut rendue aux Sutriens, entière et vierge de tout outrage de guerre; car elle n'avait pas été prise d'assaut, mais remise par capitulation. IV. Camille, vainqueur dans trois guerres, rentra dans Rome en triomphe. Il fit marcher devant son char une longue suite de prisonniers, la plupart étrusques. On les vendit à l'encan, et l'on en tira un si bon prix, qu'après avoir rendu aux matrones la valeur de l'or qu'elles avaient donné, on put encore, avec le surplus, faire trois coupes d'or qui furent marquées du nom de Camille, et déposées aux pieds de Junon, dans la chapelle de Jupiter, où elles se trouvaient encore, assure-t-on, au moment de l'incendie du Capitole. Cette année on admit au droit de cité les transfuges véiens, capénates et falisques, qui, durant ces guerres, avaient suivi l'armée romaine, et l'on assigna des terres à ces nouveaux citoyens. On rappela de Véies à Rome, par un sénatus-consulte, ceux qui, pour s'épargner la peine de rebâtir, s'y étaient transportés, et y avaient pris possession des maisons abandonnées : ils voulurent d'abord murmurer et mépriser l'ordre du sénat; mais un jour ayant été fixé, avec peine capitale contre tout émigré qui ne rentrerait pas dans Rome, ces mêmes hommes qui, réunis, se montraient si intraitables, isolément eurent peur chacun pour soi, et se soumirent. Ainsi s'accrut la population de Rome en même temps que se relevaient sur tous les points ses édifices. La république subvenait aux dépenses, les édiles surveillaient les travaux comme travaux publics, et les citoyens eux-mêmes, pressés d'en avoir le libre usage, se hâtaient de mener l'oeuvre à fin : en moins d'un an, la nouvelle ville fut debout. A l'expiration de l'année, on procéda aux élections des tribuns militaires avec puissance de consuls : on créa T. Quinctius Cincinnatus, Q. Servius Fidénas, pour la cinquième fois; L. Julius Julus, L. Aquilius Corvus, L. Lucrétius Tricipitinus, Ser. Sulpicius Rufus. Une armée fut dirigée coutre les Èques, non pour les combattre, car ils s'avouaient vaincus, mais pour assouvir la haine publique des citoyens par la dévastation de leurs plaines, et leur ôter le pouvoir de recommencer la guerre. Une autre armée fut envoyée sur le territoire des Tarquiniens. Là, les villes étrusques Cortuosa et Conténébra furent prises d'assaut et renversées. A Cortuosa, il n'y eut pas la moindre résistance : on attaqua la place à l'improviste, et au premier cri, au premier assaut, on la prit; 274 elle fut pillée et brûlée. Conténébra soutint un siége de quelques jours; des travaux continus, qu'on ne suspendit ni le jour ni la nuit, la réduisirent. L'armée romaine fut partagée en six divisions, qui se battaient chacune toutes les six heures, et les assiégés, peu nombreux, ne pouvaient opposer que les mêmes corps épuisés à des adversaires qui se renouvelaient sans cesse; ils succombèrent à la fin, et laissèrent les Romains pénétrer dans leur ville. Il paraissait convenable aux tribuns de réserver le butin pour la république; mais ils tardèrent plus à donner leurs ordres qu'à se décider : pendant qu'ils hésitaient, les soldats s'emparèrent du butin; or, à moins de braver leur haine, on n'eût pu le leur reprendre. La même année, outre les constructions particulières dont s'agrandit la ville, le Capitole fut reconstruit jusqu'en ses fondements sur une niasse de pierres équarries ; ouvrage qui, aujourd'hui même encore, attire les regards au milieu de la magnificence de notre ville. V. Tandis que les citoyens étaient occupés à ces travaux, déjà les tribuns du peuple s'efforçaient d'attirer, au moyen des lois agraires, la multitude à leurs assemblées. Ils lui montraient en espérance les terres de Pomptinum, dont Camille, par la ruine des Volsques, leur avait désormais assuré la possession. Ils se plaignaient « que ce territoire était plus infesté par les nobles qu'il ne l'avait jamais été par les Volsques : car ceux-ci, du moins, n'avaient pu étendre leurs incursions qu'en raison de leurs forces et de la puissance de leurs armes; mais les hommes nobles marchaient à l'entière possession du territoire de l'empire, et si on ne le partageait avant qu'ils n'eussent tout envahi, il n'en resterait rien au peuple. » Ils émurent faiblement la multitude que le soin de bâtir tenait éloignée du forum; épuisée d'ailleurs par les dépenses, elle songeait peu à ces terres qu'il ne lui serait pas possible de faire valoir. Dans cette cité pleine de religion, comme le dernier désastre avait rendu superstitieux les chefs eux-mêmes, on voulut renouveler les auspices, et on eut recours à un interrègne. Les interrois qui se succédèrent furent M. Manlius Capitolinus, Ser. Sulpicius Camérinus, L. Valérius Potitus. Ce dernier tint les comices dans lesquels on élut tribuns militaires avec puissance de consuls L. Papirius, C. Cornélius, C. Sergius, L. Emilius pour la seconde fois, L. Ménénius, L. Valérius Publicola pour la troisième. L'interrègne ayant cessé, ils entrèrent en charge. Cette année, le temple de Mars, voué pendant la guerre des Gaulois, fut dédié par T. Quinctius, duumvir commis aux cérémonies sacrées. On institua encore quatre tribus composées des nouveaux citoyens, la Stellatine, la Tromentine, la Sabatine, l'Arnienne, et avec ces tribus fut complété le nombre de vingt-cinq. VI. L. Sicinius, tribun du peuple, traita du partage des terres du Pomptinum devant une multitude déjà plus nombreuse, plus remuante et plus avide de terres qu'auparavant. On agita aussi dans le sénat la question de la guerre contre les Latins et les Berniques; mais comme l'Étrurie se montrait en armes, le souci d'une guerre plus importante fit ajourner ce projet. Le pouvoir revint à Camille, nommé tribun militaire avec puissance de consul : les cinq collègues qu'on lui adjoignit 275 furent Ser. Cornélius Maluginensis, Q. Servilius Fidénas pour la sixième fois, L. Quinctius Cincinnatus, L. Horatius Pulvillus, P. Valérius. Au commencement de l'année, les esprits furent distraits de la guerre d'Étrurie par des fugitifs du Pomptinum qui arrivèrent soudainement à Rome, annonçant que les Antiates avaient pris les armes, et que les peuples latins avaient sous main envoyé leur jeunesse à cette guerre. Ces peuples désavouaient toute participation publique, mais ils ne pouvaient, disaient-ils, empêcher leurs volontaires d'aller guerroyer où bon leur semblait. On avait appris désormais à ne mépriser aucun ennemi ; en conséquence, le sénat remercia les dieux de ce que Camille était en charge; car on aurait été obligé de le nommer dictateur, s'il se fût alors trouvé hors de fonctions. Ses collègues avouaient « que la conduite de toutes choses, en présence de la guerre et de ses alarmes, devait reposer sur un seul homme; ils ont l'intention de déférer le commandement à Camille, et ils ne croient rien perdre de leur majesté en faisant cette concession à la majesté d'un tel homme. » Les tribuns furent comblés de louanges par le sénat, et Camille lui-même, touché jusqu'à en être confus, leur rendit grâces. « Le peuple romain, dit-il ensuite, qui l'avait déjà crée quatre fois dictateur, lui avait imposé un pesant fardeau; le sénat un bien grand, par l'opinion si flatteuse que cet ordre avait conçue de lui; et ses collègues un plus grand encore, par une condescendance si glorieuse. Que s'il pouvait ajouter à ses travaux et à ses veilles, il s'efforcerait de se surpasser lui-même, afin que cette universelle estime de ses concitoyens, déjà si haute, pût être également durable. Quant à la guerre et aux Antiates, il y avait là plus de bruit que de danger; il pensait néanmoins que, s'il ne fallait rien craindre, il ne fallait non plus rien négliger. De tous côtés la ville de Rome était entourée de voisins haineux et jaloux; il fallait donc partager entre plusieurs chefs et plusieurs armées le service de la république. Toi, P. Valérius, dit-il, je t'associe à mon commandement et à mes conseils; tu conduiras avec moi les légions coutre nos ennemis d'Antiutn : toi, Q. Servilius, avec une autre armée équipée et toute prête, tu camperas dans Rome, et, d'ici, lu observeras si les Étrusques, comme naguère, se soulèvent, ou si les Latins et les Herniques profitent de nos embarras pour remuer. J'ai la certitude que tu te conduiras d'une manière digne de ton père, de ton aïeul, de toi-même, de tes six tribunats. Une troisième armée, formée par L. Quinctius des citoyens que leur âge ou d'autres causes éloignent du service, gardera la ville et les remparts. L. Horatius sera chargé de pourvoir aux approvisionnements d'armes, de traits, de blé; enfin à tous les besoins qui pourront survenir dans cette guerre. A toi, Ser. Cornélius, la présidence du conseil public, la surveillance de la religion, des comices, des lois, de tous les intérêts de la ville : c'est le voeu de tes collègues. » Tous ayant accepté et promis de remplir avec zèle l'emploi qui leur était assigné, Valérius, choisi pour partager le commandement, ajouta « qu'il regarderait M. Furius comme son dictateur, qu'il lui servirait seulement de maître de la cavalerie; et ainsi, le succès qu'on attendait de l'unité de commandement, 276 on pouvait l'espérer pour la guerre. » D'autre part les sénateurs disaient « qu'ils avaient bon espoir de la guerre comme de la paix, et de la chose publique tout entière; » et, transportés de joie, ils s'écriaient « que jamais la république ne senttirait le besoin d'un dictateur, tant qu'elle aurait de tels hommes aux magistratures, s'entendant si bien et si unis, également prêts à obéir et à commander, et plus disposés à mettre chacun leur gloire personnelle en commun, qu'à attirer à soi la gloire de tous. » VII. Le justitium proclamé et la levée achevée, Furius et Valérius marchent sur Satricum. Outre l'armée de Volsques, composée d'une jeunesse choisie, les Antiates avaient appelé là un nombre considérable de Latins et d'Herniques, peuples qui s'étaient conservés entiers dans une longue paix. Aussi la réunion de ces nouveaux ennemis aux anciens ébranla-t-elle le courage du soldat romain. Tandis que Camille était occupé à disposer son ordre de bataille, les centurions vinrent lui annoncer « que les soldats, l'esprit troublé, ne prenaient qu'à regret les armes, qu'ils hésitaient, qu'ils refusaient de sortir du camp; on avait même entendu quelques voix dire qu'on allait combattre un contre cent : si cette multitude était sans armes, à peine pourrait-on lui tenir tête; armée, comment lui résister? » Camille sauta à cheval, arriva devant les enseignes en face des légions, et se mit à parcourir les rangs : « Que signifie cette tristesse, soldats, et d'où vient cette étrange hésitation? Ne connaissez-vous plus l'ennemi, ni moi, ni vous-mêmes? L'ennemi, qu'est-ce autre chose pour vous qu'un sujet perpétuel de courage et de gloire? Vous, au contraire, et sous mes ordres ( sans rappeler la prise de Faléries et de Véies, et, dans notre patrie reconquise, le massacre des légions gauloises), n'avez-vous pas naguère, par une triple victoire, obtenu trois fois le triomphe sur ces mêmes Volsques, sur ces Èques, sur l'Étrurie? Est-ce donc parce que je vous ai donné le signal, non plus comme dictateur, mais comme tribun, que vous ne me reconnaissez plus pour votre chef? Moi, je ne regrette point de n'avoir pas sur vous une autorité plus grande; et vous, vous ne devez regarder en moi que moi-même ; car jamais la dictature n'a ajouté à mon courage, de même que l'exil ne m'en a rien ôté. Nous sommes donc tous ce que nous étions, et puisque nous apportons à cette guerre ce que nous avons apporté dans les autres, nous devons espérer le même succès. Une fois aux prises, chacun fera ce qu'il a appris, ce qu'il est accoutumé à faire : vous vaincrez, ils fuiront. » VIII. Puis, le signal donné, il saute de cheval, saisit par la main l'enseigne le plus proche, et l'entraîne vers l'ennemi : « Allons, soldat, lui crie-t-il, porte en avant ton enseigne ! » Dès qu'ils voient Camille, le corps affaibli par la vieillesse, marcher sur l'ennemi, tous se précipitent sur ses pas, en poussant le cri de guerre, et se répétant l'un à l'autre : « Suivons le général! » On rapporte que Camille fit jeter le drapeau da us les rangs ennemis, et que les soldats de l'avant-garde s'élancèrent pour le reprendre. Les Antiates furent d'abord culbutés, et des premiers rangs l'épouvante s'étendit jusqu'au milieu de la réserve. Ce qui frappait les Volsques de terreur, 277 c'était moins l'impétueuse ardeur du soldat, excité par la présence du chef, que la présence et la vue de Camille. Aussi partout où il se portait, il entraînait infailliblement avec lui la victoire : on en vit une preuve éclatante lorsqu'au moment où l'aile gauche allait être enfoncée, s'élançant sur un cheval, sans quitter son bouclier de fantassin, il accourut et rétablit le combat, montrant partout ailleurs l'armée victorieuse. Déjà le succès n'était plus douteux, mais le nombre même des ennemis les gênait pour fuir, et il fallait un long massacre pour exterminer toute cette multitude; le soldat était épuisé de fatigue : tout à coup un violent orage et des torrents de pluie vinrent interrompre la victoire plutôt que le combat. Alors on donna le signal de la retraite, et la nuit qui suivit termina la guerre, sans peine pour les Romains. En effet, les Latins et les Herniques, laissant là les Volsques, retournèrent chez eux, avec k succès que méritait leur perfidie. Les Volsques, se voyant abandonnés par ceux-là mêmes sur la foi desquels ils s'étaient soulevés, quittent leur camp, et s'enferment dans les murs de Satricum. Camille voulut d'abord les entourer d'un retranchement, élever des chaussées, faire un siége en règle; mais, voyant que nulle sortie de la place ne mettait empêchement à ces travaux, et que les Volsques avaient trop peu de coeur pour qu'il dût reculer si loin la victoire qu'il espérait, il exhorta ses troupes, leur disant de ne pas s'épuiser, comme au siége de Véies, en des travaux sans tin; que la victoire était dans leurs mains : le soldat, plein d'ardeur, attaqua la ville de toutes parts, l'escalada et la prit. Les Volsques jetèrent leurs armes et se rendirent. IX. Le général méditait en lui-même une conquête plus glorieuse encore, celle d'Antium, capitale des Volsques, où s'était formée la dernière guerre. Mais, comme on ne pouvait, sans un grand appareil de forces et de machines, réduire une ville aussi puissante, il laissa son collègue à l'armée, et retourna à Rome afin d'exhorter le sénat à détruire Antium. Comme il exposait son dessein (les dieux, j'imagine, avaient pris à coeur de prolonger la durée d'Antium), des envoyés de Népète et de Sutrium viennent demander aide contre les Étrusques, insistant sur la nécessité où ils sont d'avoir un prompt secours. Ce fut là, et non sur Antium, que la fortune dirigea les coups de Camille. En effet, ces deux places, qui faisaient face à l'Étrurie, étaient de ce côté comme les barrières et les portes de Rome, et les Étrusques ne manquant pas de s'en emparer à chaque nouvelle prise d'armes, il était de l'intérêt des Romains de les reprendre et de les conserver. Le sénat engagea donc Camille à laisser Antium et à porter la guerre en Étrurie. On lui donna par un décret les légions de la ville que commandait Quinctius; et, quoiqu'il eût préféré son armée des Volsques qu'il connaissait, et qui était habituée à son commandement, il ne refusa rien : il demanda seulement que Valérius lui fût associé. Quinctius et Horatius allèrent remplacer Valérius chez les Volsques. Arrivés de Rome à Sutrium, Furius et Valérius trouvèrent les Étrusques déjà maîtres d'un côté de la ville ; et de l'autre, les habitants, coupés de toutes parts, 278 ayant peine à repousser les assauts de l'ennemi. La venue d'auxiliaires romains, et le nom de Camille, si connu des ennemis et des alliés, soutinrent pour le moment les affaires chancelantes de Sutrium, et donnèrent le temps de lui porter secours. Camille, divise son armée ; il ordonne à son collègue de tourner la partie de la ville occupée par l'ennemi et d'attaquer les remparts, moins dans l'espoir qu'on pût escalader et prendre la ville, qu'afin d'occuper l'ennemi par une diversion qui laisserait respirer les habitants fatigués de la résistance, et lui permettrait à lui-même de pénétrer sans combat dans la ville. Ces deux manoeuvres, exécutées en même temps, mirent entre deux périls les Étrusques, qui étaient tout ensemble alarmés, et de la vive attaque des remparts et de la présence de l'ennemi dans la place; et comme par hasard une porte se trouvait encore libre, ils se précipitèrent en foule par cette issue. Il y eut, tant dans la ville que dans la campagne, un massacre considérable des fuyards; un plus grand nombre furent tués dans la place par les soldats de Furius; ceux de Valérius, plus agiles, les poursuivirent plus longtemps, et la nuit seule, en leur dérobant la vue de l'ennemi, put mettre fin au carnage. Sutrium reconquis et restitué aux alliés, l'armée marcha sur Népète, qui s'était rendue aux Étrusques, et que ceux-ci possédaient tout entière. X. La reprise de cette place semblait devoir donner plus de peine, d'abord parce qu'elle était entièrement occupée par l'ennemi, et ensuite parce qu'elle avait été livrée par la trahison d'une partie des Népésiens. On jugea cependant à propos d'envoyer dire à leurs chefs qu'ils eussent à se séparer des Étrusques, et à garder au moins eux-mêmes cette foi qu'ils avaient réclamée des Romains. Ils répondirent « Qu'ils n'y pouvaient rien, que les Étrusques étaient maîtres des remparts et avaient la garde des portes. » Sur cela, on commença par dévaster le territoire pour essayer d'effrayer les habitants; puis, comme la foi de leur reddition leur était plus sacrée que celle de leur alliance, l'armée s'approche des murs, apportant avec elle des sarments et des fascines tirés de la campagne, applique les échelles sur les fossés, qu'elle a comblés, et du premier cri, du premier assaut, la place est enlevée. Un édit ordonna aux Népésiens de mettre bas les armes; on promit de faire grâce à ceux qui seraient désarmés. Les Étrusques, armés ou sans armes, furent tous sans distinction taillés en pièces. Les Népésiens auteurs de la trahison périrent aussi par la hache. Quant à la multitude, qui n'était point coupable, on lui rendit ses biens et sa ville, où on laissa une garnison. Après avoir repris de la sorte sur l'ennemi deux cités alliées, les tribuns ramenèrent dans Rome, avec une grande gloire, l'armée victorieuse. La même année on adressa des réclamations aux Latins et aux Herniques; on leur demanda pourquoi, durant ces dernières années, ils n'avaient point fourni le nombre convenu de soldats. Il fut répondu par l'un et par l'autre peuple, dans une assemblée solennelle, « Que ce n'était ni par la faute ni par la volonté de la nation qu'une partie de leur jeunesse avait pris du service chez les Volsques ; que ces jeunes gens avaient d'ailleurs porté la peine de 279 celte conduite coupable, puisque pas un n'était revenu. Quant au contingent de soldats, ils n'avaient pu le fournir, arrêtés qu'ils étaient par la crainte continuelle où les tenaient les Volsques, cette pesté attachée à leurs flancs, et que tant de guerres l'une sur l'autre n'avaient pu extirper encore. » Cette réponse fut rapportée au sénat, qui jugea qu'on aurait bien le droit, mais que ce n'était pas le moment de leur faire la guerre. Xl. L'année suivante, A. Manlius, P. CornéIius, T. et L. Quinctius Capitolinus, L. Papirius Cursor et C. Sergius, étaient tribuns avec puissance de consuls, ces deux derniers pour la seconde fois, quand éclatèrent au dehors une guerre grave, et au dedans une sédition plus grave encore. La guerre venait des Volsques, appuyés par la défection des Latins et des Herniques; la sédition, d'un homme de qui l'on ne devait pas la craindre, d'un homme de race patricienne et d'une belle renommée, M. Manlius Capitolinus. Cet esprit altier, qui méprisait tous les principaux citoyens, portait envie à un seul, non moins distingué par ses dignités que par ses ver-tus, à M. Furius. Il ne voyait qu'avec dépit « Camille toujours dans les magistratures, toujours à la tête des armées. Déjà il est si fort au-dessus des autres, que les magistrats créés sous les mêmes auspices ne sont plus pour lui des collègues, mais des ministres. Et pourtant, à bien juger, M. Furius n'aurait pu délivrer la patrie assiégée, si lui-même n'eût sauvé auparavant le Capitule et la citadelle. Camille n'a attaqué les Gaulois qu'après que la vue de l'or et l'espoir de la paix avaient amolli les courages ; lui, il les a chassés alors qu'ils étaient tout ramés et qu'ils allaient prendre la citadelle : Camille doit une part de sa gloire à chacun des nombreux soldats qui vainquirent avec lui; lui, il n'est pas au monde un seul mortel qui ait le droit de s'associer à sa victoire. » Enflé de ces idées, disposé d'ailleurs par un mauvais penchant à l'emportement et à la violence, ne se trouvant pas parmi les patriciens aussi puissant qu'il se croyait le droit de l'être, Io premier des patriciens, il se livre au peuple, établit des intelligences avec les magistrats plébéiens ; décriant les sénateurs, caressant la multitude, suivant moins la raison que le vent populaire, et se cherchant une renommée plutôt grande que bonne. Non content des lois agraires, éternelle matière de séditions pour les tribuns du peuple, il travaille à détruire la foi publique. « Il n'y a pas, disait-il, de plus cruelles tortures que les dettes; car elles ne menacent pas seulement de misère et d'opprobre, mais elles font peser sur des hommes libres la terreur du fouet et des chaînes.» Or, les dettes étaient nombreuses, après tant de constructions, chose ruineuse même pour les riches. Aussi, la guerre des Volsques, déjà si lourde par elle-même, et qui le devenait plus encore par la défection des Latins et des Herniques, fut jetée en avant, comme un prétexte, pour recourir à une plus grande autorité. Mais ce furent surtout les nouveaux projets de Manlius qui poussèrent le sénat à créer un dictateur. On créa A. Cornélius Cossus, qui nomma maître de la cavalerie T. Quinctius Capitolinus. XII. Le dictateur prévoyait que la lutte serait plus grande au dedans qu'au dehors ; cependant, 280 soit que cette guerre exigeât de la célérité, soit qu'il espérât que la victoire et le triomphe ajouteraient des forces à sa dictature, il fit une levée et se porta dans le Pomptinum, où il avait appris que l'armée volsque devait se réunir. Outre l'ennui de lire, raconté en tant de livres, le détail de ces guerres continuelles avec les Volsques, je ne doute point qu'on ne se demande avec surprise (et je m'en suis moi-même étonné en parcourant les auteurs les plus rapprochés de ces événements) comment les Volsques et les Èques, tant de fois vaincus, pouvaient fournir à de nouvelles armées. Puisque les anciens gardent sur ce point un silence absolu, que puis-je avancer ici autre chose qu'une opinion personnelle, comme chacun serait libre de le faire d'après ses propres conjectures? II est vraisemblable, ou que dans l'intervalle d'une guerre à une autre, comme cela se fait aujourd'hui pour les levées romaines, on prenait une nouvelle classe de jeunes hommes, qui suffisait pour recommencer la guerre; ou que les armées ne se tiraient point toujours du sein des mêmes peuples, quoique ce fût toujours la même nation qui fit la guerre; ou enfin qu'il existait une innombrable multitude de têtes libres dans ces contrées, où maintenant on ne recueille qu'avec peine quelques soldats, et qui, sans nos esclaves, seraient une solitude. Au reste (et tous les auteurs sont d'accord sur ce point), malgré les derniers coups portés, sous la conduite et les auspices de Camille, à la puissance des Volsques, leur armée était immense; et aux Volsques s'étaient joints les Latins et les Herniques, des Circéiens, et même des Romains de la colonie de Vélitres. Le jour même de son arrivée, le dictateur forma son camp, et, le lendemain, après avoir consulté les auspices, immolé une victime, et imploré la faveur des dieux, il s'avança joyeux vers les soldats, qui, en voyant le signal, prenaient leurs armes au point du jour, suivant l'ordre qu'ils avaient reçu. « La victoire est à nous, soldats, leur dit-il, autant que les dieux et leurs devins connaissent l'avenir; ainsi, en hommes sûrs du succès, et qui vont se mesurer avec des ennemis indignes d'eux, laissons à nos pieds la javeline, et n'armons nos mains que du glaive. Je ne veux même pas qu'on marche eu avant; tenez-vous là serrés, et recevez de pied ferme le choc de l'ennemi. Dès qu'ils auront lancé leurs traits inutiles, et qu'ils se porteront en désordre contre votre masse immobile, qu'alors brillent les glaives, et que chacun de vous songe qu'il est des dieux qui protégent le soldat romain, des dieux qui nous ont envolés au combat sous d'heureux augures. Toi, T. Quinctius, retiens la cavalerie, en observant avec attention l'instant où la lutte commencera. Dès que tu verras les lignes aux prises l'une avec l'autre, pied contre pied, alors, avec ta cavalerie, viens jeter la terreur au milieu des ennemis occupés d'une autre crainte, et disperse par une charge les rangs des combattants. » Cavaliers et fantassins se battent ainsi qu'il le voulait; ni le général ne fit faute aux soldats, ni la fortune au général. XIII. La multitude des ennemis, ne comptant que sur le nombre, après avoir mesuré des yeux l'une et l'autre armée, engagea le combat imprudemment, et l'abandonna de même: après avoir poussé son cri de guerre, lancé ses traits, et chargé d'abord 281 avec quelque vigueur, elle ne put soutenir ni les glaives, ni la lutte corps à corps, ni les regards de l'ennemi dans lesquels brillait l'ardeur de son finie. Tandis que leur front de bataille, enfoncé, reculait sur l'arrière-garde et y portait le désordre, la cavalerie, se précipitant sur eux, vint encore les épouvanter; les rangs furent rompus çà et là, tout s'ébranlait; on eût dit une mer agitée. Enfin, les premiers rangs étant tombés, chacun voyant le carnage arriver jusqu'à lui, prend la fuite. Le Romain les presse. Tant qu'ils se retirèrent armés et serrés, l'infanterie fut seule chargée de les poursuivre; mais, quand on vit que les ennemis jetaient leurs armes et que leur foule se dispersait en désordre dans la plaine, alors, à un signal, s'élancèrent les escadrons de cavalerie, avec ordre de ne pas s'arrêter au massacre de quelques fuyards isolés, ce qui donnerait le loisir à la masse d'échapper, mais seulement de gêner toute cette foule en lui lançant des traits, en ne cessant de l'inquiéter, en la harcelant sur les flancs pour la tenir eu échec, jusqu'à ce que l'infanterie pût l'atteindre et en achever le massacre. La nuit seule mit un terme à cette déroute et à cette poursuite. Le même jour, le camp des Volsques fut pris et pillé, et tout le butin, moins les têtes libres, fut abandonné au soldat. La plupart des prisonniers étaient des Latins et des Herniques; et parmi eux se trouvaient, non seulement des hommes du peuple qu'on aurait pu croire avoir pris du service moyennant une paie, mais des jeunes gens des premières familles ; preuve manifeste que c'était bien la nation qui soutenait les Volsques ennemis. On reconnut aussi parmi les prisonniers quelques Circéiens et des colons de Vélitres. Envoyés tous à Rome, et interrogés par les principaux sénateurs, ils leur réitérèrent clairement, comme ils avaient fait à Camille, la défection de chacun des peuples auxquels ils appartenaient. XIV. Le dictateur tenait son armée dans les lignes, persuadé que le sénat lui ordonnerait d'aller porter la guerre à ces peuples; maison fut forcé, par un péril plus grave, de le rappeler à Rome, où grandissait chaque jour une sédition que son auteur rendait plus redoutable que jamais. En effet, Manlius ne se contentait plus de discourir: il agissait, et ses actes, qui avaient pour prétexte le bien du peuple, n'avaient, dans son esprit, d'autre but que de le soulever. Un centurion, qui s'était distingué par de beaux faits d'armes, avait été condamné comme insolvable, et on l'emmenait en prison : Manlius l'ayant vu, accourut au milieu du forum avec sa troupe et le délivra; puis, se mettant à déclamer sur l'orgueil des patriciens, la cruauté des usuriers, les misères du peuple, les mérites de cet homme et son infortune: « Ce serait bien inutilement, dit-il, que j'aurais de cette main sauvé le Capitole et la citadelle, si je souffrais qu'un de mes concitoyens, un de mes compagnons d'armes, fût, sous mes yeux, comme un prisonnier des Gaulois vainqueurs, mené en servitude et en prison. » Là-dessus il solde le créancier en présence du peuple, libère par le cuivre et la balance le débiteur, lequel se retire en attestant les dieux et les hommes, et en les priant « d'accorder à M. Manlius, son libérateur et le père du peuple romain, une digne récompense. » Accueilli aussitôt par 282 une foule tumultueuse, il augmente encore le tumulte en montrant les blessures qu'il a reçues à Véies, et contre les Gaulois, et dans toutes les autres guerres. « Pendant qu'il combattait, qu'il relevait ses pénates renversés, le capital de sa dette, déjà payée nombre de fois, avait été englouti par les intérêts, et l'usure avait fini par l'écraser : s'il voit le jour, le forum, ses concitoyens, il en est redevable à Manlius; tous les bienfaits d'un père, il les a reçus de lui; il lui dévoue tout ce qu'il lui reste de forces, de vie et de sang; tous les liens qui l'ont uni jusqu'alors à la patrie et à ses pénates publics et privés, l'attachent désormais uniquement à cet homme. » Comme le peuple, entraîné par ces paroles, appartenait déjà à ce seul homme, celui-ci eut recours à un nouveau moyen pour l'émouvoir et porter le trouble au comble. Il avait chez les Véiens une terre, la meilleure de son patrimoine; il la mit aux enchères : « Afin que pas un de vous, Romains, dit-il, tant qu'il me restera quelque chose, ne soit, à mes yeux, condamné et traîné dans les fers. » Par là il enflamma à tel point les esprits, qu'on les vit prêts à suivre par toutes les voies, bonnes ou mauvaises, le défenseur de leur liberté. En outre, quand il parlait dans sa maison, ses discours, comme ceux d'un tribun qui se serait adressé à la multitude, étaient remplis d'accusations contre le sénat. Ainsi, sans examiner s'il disait ou non la vérité, il prétendait « Que l'or,enlevé aux Gaulois avait été caché par les sénateurs; qu'il ne leur suffisait pas de posséder les terres de l'état ; qu'il fallait encore qu'ils détournassent l'argent de la république; que cet argent, si on le découvrait, pourrait acquitter les dettes du peuple. » Cet espoir séduisit le peuple, qui s'indignait qu'après avoir donné tout son or pour racheter la ville des Gaulois, par une contribution qu'on lui avait imposée, le même or, repris sur l'ennemi, fût devenu la proie de quelques hommes. Ils le pressaient donc de déclarer le lieu où était caché un larcin aussi considérable ; et, comme il promettait de leur révéler ce secret plus tard, dans un moment plus favorable, oubliant tout le reste, toutes les pensées se tournèrent de ce côté : il était clair que, de cette assertion, selon qu'elle serait vraie ou fausse, dépendait son crédit ou sa ruine. XV. Tandis que les choses étaient ainsi en suspens, le dictateur, rappelé de l'armée, arriva à Rome. Ayant le lendemain assemblé le sénat, lorsqu'il fut assez instruit des intentions des hommes, il défendit aux sénateurs de s'éloigner de lui; puis, escorté de cette multitude, il marcha au Comitium où son siége était dressé, et de là il envoya le viateur à M. Manlius. Appelé par cet ordre du dictateur, celui-ci, après avoir averti les siens que la lutte allait s'engager, vint, avec une troupe nombreuse, se présenter au tribunal. D'un côté, le sénat, de l'autre, le peuple, les yeux fixés chacun sur son chef, se tenaient là comme deux armées en présence. Alors, le dictateur ayant obtenu le silence : « Plaise aux dieux, dit-il, que moi et les patriciens romains nous puissions nous entendre avec le peuple sur tout le reste, comme nous nous entendrons, j'en ai presque l'assurance, sur ce qui te regarde et sur la question que j'ai à te faire I Je vois que tu as donné l'espoir à la cité que, sans porter atteinte au crédit, ou pourrait, 283 avec des trésors gaulois, cachés par les principaux patriciens, acquitter ses dettes. Tant s'en faut que je m'oppose à cela, M. Manlius, qu' au contraire je t'exhorte à délivrer de l'usure le peuple romain, à retirer de dessus leur proie clandestine ces misérables qui, selon toi, se tiennent accroupis sur les trésors publics. Si tu ne le fais, soit parce que tu es toi-même partie prenante au butin, soit parce que ton assertion est sans fondement, j'ordonnerai qu'on te mène en prison, et ne souffrirai pas plus longtemps que tu trompes la multitude pour la soulever. » A cela, Manlius : « Il ne s'est point trompé, répond-il ; ce n'est pas contre les Volsques, autant de fois ennemis qu'il convient au sénat, ce n'est pas non plus contre les Latins et les Herniques, que l'on pousse à prendre les armes en les inculpant sans motif, c'est contre lui et le peuple romain que le dictateur a été créé. Déjà, laissant de côté cette guerre, qui n'était qu'une feinte, on se jette sur lui; déjà le dictateur s'avoue hautement le patron des usuriers contre le peuple; déjà, pour le perdre, on lui reproche comme un crime la faveur de la multitude. Vous êtes blessés, dit-il, toi, A. Cornélius, et vous, Pères conscrits, de voir cette foule répandue à mes côtés? Que ne la détachez-vous de moi chacun par vos bienfaits, en intercédant, en arrachant au fouet vos concitoyens; en empêchant qu'ils ne soient par une condamnation adjugés et asservis, en employant le superflu de vos richesses à soulager les besoins des autres? Mais pourquoi vous exhorté-je à rien sacrifier du vôtre? Contentez-vous d'une somme fixe, retranchez du capital les intérêts qu'on a soldés à votre usure, et mon cortége n'aura pas plus d'éclat que celui d'aucun de vous. Mais, me demande-t-on, d'où vient que seul je m'occupe ainsi du sort des citoyens? Je n'ai rien de plus à répondre que si l'on me demandait pourquoi seul aussi j'ai sauvé le Capitole et la citadelle. Alors, autant que je l'ai pu, je suis venu en aide à tous les citoyens eu masse ; maintenant je viens en aide à chacun d'eux en particulier. Pour ce qui est des trésors gaulois, cette chose toute simple de sa nature est embrouillée par votre question. Pourquoi, en effet, demandez-vous ce que vous savez? Pourquoi ce que vous cachez dans un pli de votre robe, m'ordonnez-vous de l'en tirer, au lieu de le montrer de vous-mêmes, s'il n'y a point là-dessous quelque fraude? Plus vous me pressez pour que je dévoile vos adroits tours de main, plus je crains que vous n'ayez fermé les yeux, même aux plus clairvoyants. Ainsi, ce n'est pas à moi à vous indiquer vos larcins, c'est vous qu'on doit forcer à les mettre au jour.» XVI. Le dictateur lui commanda de laisser là les détours; il le pressa de prouver la vérité de sou assertion, ou d'avouer le trime dont il s'était rendu coupable, en accusant faussement le sénat, en le chargeant méchamment d'un larcin imaginaire ; et comme Manlius déclarait qu'un caprice de ses ennemis ne le ferait pas parler, le dictateur ordonna qu'on le conduisît en prison. Saisi par le viateur « Jupiter, très bon, très grand, s'écria-t-il, Junon reine; Minerve; vous tous, dieux et déesses, qui habitez le Capitole et la citadelle, est-ce ainsi que vous abandonnez votre soldat, votre défenseur, à la fureur de ses ennemis? Et cette main, qui a chassé les Gaulois de vos sanctuaires, serait chargée de fers 284 et de chaînes! » Il n'y avait là personne pouvant le voir ou l'entendre qui ne fût ému de cette indignité; mais la cité s'était fait un devoir invincible de l'obéissance au pouvoir légitime ; et, loin de s'opposer à cet acte du dictateur, les tribuns du peuple et le peuple lui-même n'osaient lever les yeux ni ouvrir la bouche. Manlius jeté en prison, une grande partie du peuple, à ce qu'on assure, changea de vêtements; la plupart des hommes laissèrent croître leurs cheveux et leur barbe, et devant la prison se promena longtemps une foule désolée. Le dictateur triompha des Volsques, et son triomphe lui valut plus de haine que de gloire. « Car, disait le peuple en murmurant, c'était dans la ville et non à l'armée qu'il l'avait gagné, contre un citoyen et non contre l'ennemi : il n'avait manqué à son orgueil qu'une chose, que de traîner Manlius devant son char.» Déjà même la sédition était près d'éclater : pour l'apaiser, devenu tout à coup libéral, le sénat, sans aucune sollicitation étrangère et de son propre mouvement, fit inscrire pour Satricum une colonie de deux mille citoyens romains; deux arpents et demi de terre furent assignés à chacun. En voyant ce don modique et restreint à quelques-uns, le peuple prétendit que c'était le prix dont on voulait acheter l'abandon de M. Manlius; la sédition fut irritée par le remède même; les amis de Manlius mirent chaque jour plus d'ostentation dans leur deuil et dans leur douleur d'accusés; et l'abdication du dictateur, qui suivit son triomphe, en éloignant la terreur, laissa à la multitude toute liberté de langage et de sentiments. XVII. Alors on entendit s'élever des voix qui reprochaient au peuple, « Que sa faveur portait toujours ses défenseurs au-dessus d'un abîme, et ensuite, le danger venu, les abandonnait. Ainsi Sp. Cassius, qui appelait le peuple au partage des terres ; ainsi Sp. Mélius, qui employait sa fortune à sauver ses concitoyens des horreurs de la faim, avaient succombé ; ainsi, M. Manlius, qui ramenait à la liberté et à la lumière une partie de la cité ensevelie, écrasée sous l'usure, était livré à ses ennemis. Le peuple engraisse ses partisans pour qu'on les égorge. Avait-il donc mérité ce traitement pour n'avoir pas répondu, lui, homme consulaire, à un signe de tête du dictateur? En supposant qu'il ait menti d'abord, et qu'ensuite il n'ait su que répondre, quel esclave jamais fut puni d'un mensonge par les fers? On ne s'est souvenu ni de cette nuit qui fut presque pour le nom romain une dernière et éternelle nuit, ni du spectacle de l'armée gauloise gravissant la roche Tarpéienne; ni enfin de Manlius, tel qu'on l'avait vu tout armé, plein de sueur et de sang, arrachant, pour ainsi dire, Jupiter lui-même des mains de l'ennemi. Croient-ils donc que leurs quelques onces de farine ont suffisamment récompensé le sauveur de la patrie? Et celui qu'ils ont presque fait dieu, ou, du moins, par son surnom, l'égal de Jupiter Capitolinus, le laisseront-ils enchaîné dans les ténèbres d'un cachot, traîner une vie qui dépendra du caprice d'un bourreau? Ainsi, un seul homme a suffi pour les défendre tous, et tous ensemble ne seront d'aucun secours à un seul homme! » Et déjà, même la nuit, la foule ne quittait plus ce lieu, menaçant d'enfoncer la prison, lorsque, lui accordant ce qu'elle aurait 285 pris de force, on rend, par un sénatus-consulte, la liberté à Manlius; ce qui, loin de mettre fin à la sédition, ne fait que lui donner un chef. Dans le même temps, les Latins et les Herniques, les colons de Circéia et de Vélitres, étant venus se justifier de toute participation à la guerre volsque, et redemander leurs prisonniers pour les punir selon leurs lois, on leur adressa de sévères réponses; de plus sévères aux colons, qui, citoyens romains, avaient formé le projet sacrilège d'attaquer leur patrie. On ne se contenta point de leur refuser leurs prisonniers; on leur infligea une humiliation qu'on avait épargnée aux alliés: il leur fut ordonné, de la part du sénat, qu'ils eussent à sortir au plus tôt de la ville, et à s'éloigner de la présence et de la vue du peuple romain, de peur que le droit des ambassadeurs, établi pour l'étranger, non pour le citoyen, ne pût les protéger. XVIII. La sédition de Manlius reprenant de nouvelles forces, sur la fin de l'année, on ouvrit les comices, et on créa tribuns militaires, avec puissance de consul, les patriciens Ser. Cornélius Maluginensis, pour la troisième fois; P. Valérius Politus, pour la seconde; C. Papirius Crassus, T. Quinctius Cincinnatus, pour la seconde fois. Au commencement de cette année, lapais extérieure ne vint pas moins à propos pour les patriciens que pour le peuple ; pour le peuple qui, n'étant point appelé pour la levée, conçut l'espoir, à l'aide de son puissant chef, d'anéantir l'usure; pour les patriciens qui, l'esprit libre de toute crainte du dehors, se flattèrent de pouvoir enfin guérir la cité de ses maux. Ainsi les deux partis s'étaient relevés avec plus d'ardeur que jamais, et Manlius se préparait, lui aussi, à une lutte prochaine. Ayant convoqué le peuple en sa maison, il discute jour et nuit avec les chefs ses projets de changement, plus rempli d'orgueil et de colère qu'il ne l'avait jamais été. L'affront qu'il venait d'éprouver, lui dont le coeur était peu fait aux outrages, avait enflammé son courroux; sa fierté s'exaltait de ce que le dictateur n'avait point osé le traiter comme Cincinnatus Quinctius avait traité Sp. Mélius, et de ce que la haine soulevée par son emprisonnement avait non seulement forcé le dictateur d'abdiquer, mais tenu en échec le sénat lui-même. Aigri et enflé tout à la fois par ces choses, il irritait encore l'esprit déjà si ardent de la multitude : « Jusques à quand, enfin, ignorerez-vous votre force, quand les brutes mêmes ont l'instinct de la leur? Comptez du moins combien vous êtes, et combien d'ennemis vous avez. Alors même que vous seriez un contre un dans cette lutte, vous combattriez, j'imagine, avec plus d'ardeur pour la liberté, que ceux-là pour la domination. Mais autant de clients vous étiez autrefois autour d'un seul patron, autant vous serez maintenant contre un seul ennemi. Montrez seulement la guerre, vous aurez la paix. Qu'ils vous voient prêts à soutenir vos droits, et d'eux-mêmes ils les reconnaîtront. Il faut que tous ensemble vous tentiez un coup d'audace, ou que chacun en particulier vous souffriez tous les affronts. Pourquoi sans cesse tenez-vous les yeux fixés sur moi? Certes, pour moi, je ne ferai faute à aucun de vous; vous, à votre tour, veillez à ce que la fortune ne me fasse point faute. Moi, votre vengeur, dès que nies ennemis personnels l'ont voulu, j'ai été aussitôt annulé; et tous ensemble vous avez 286 vu froidement traîner dans les fers celui qui avait éloigné les fers de chacun de vous. Que dois-je espérer, si mes ennemis osent davantage contre moi ? Attendrai-je le sort de Cassius et de Mélius? Vous faites bien d'en rejeter le présage; les dieux empêcheront cela; mais jamais, pour moi, ils ne descendront du ciel. Qu'ils vous donnent alors, il le faut, le courage de l'empêcher, comme ils m'ont donné, à moi, sous les armes et sous la toge, le courage de vous défendre contre des ennemis barbares et d'orgueilleux concitoyens. Ce grand peuple a-t-il donc le coeur si petit, qu'il lui suffise toujours d'avoir un recours contre ses ennemis, et que jamais, sinon pour fixer les limites de l'empire que vous leur accordez sur vous, vous n'ayez osé combattre les patriciens? Et en cela, ce n'est pas la nature qui vous inspire, c'est l'habitude qui vous domine. Pourquoi, en effet, montrez-vous tant de coeur contre l'étranger, qu'il vous semble juste que vous ayez sur lui l'empire? Parce que vous êtes accoutumés à lutter pour l'empire avec lui ; et contre eux à essayer plutôt qu'à défendre votre liberté. Cependant, quels qu'aient été vos chefs, quels que vous ayez été vous-mêmes, tout ce que vous avez demandé jusqu'ici, si important que ce fût, vous l'avez obtenu ou par la force, ou par votre fortune : il est temps de prétendre a de plus grandes conquêtes. Veuillez seulement éprouver et votre bonheur et moi, de qui, j'espère, vous avez déjà fait une épreuve assez heureuse; vous aurez moins de peine à imposer un maître aux patriciens, que vous n'en avez eu à leur imposer des hommes qui leur résistassent quand ils étaient les maîtres. Il faut jeter à terre dictatures et consulats, afin que le peuple romain puisse lever la tête. Enfin, montrez-vous, empêchez qu'on ne poursuive les débiteurs. Moi, je me proclame le patron du peuple; mon zèle et ma fidélité m'investissent de ce titre : vous, si vous donnez à votre chef un titre qui soit la marque d'un pouvoir ou d'un honneur plus grand, comptez qu'il n'en sera que plus puissant pour obtenir ce que vous voulez. » De ce jour, dit-on, il commença à tendre vers la royauté ; mais par qui il fut secondé et jusqu'où il parvint, c'est ce que la tradition ne nous apprend pas clairement. XIX. D'autre part, le sénat s'inquiète de ce rassemblement du peuple dans une maison particulière, placée par hasard dans la citadelle, masse menaçante pour la liberté. Le plus grand nombre s'écrie : « Qu'on aurait besoin d'un Servilius Ahala, qui, sans faire conduire en prison un ennemi public que cette mesure irriterait encore, saurait par la perte d'un seul homme terminer cette guerre intestine. » La décision qu'on adopta, plus douce dans la forme, avait la même force : « Les magistrats veilleront à ce que les pernicieux desseins de M. Manlius ne fassent éprouver aucun dommage à la république. » Alors les tribuns qui avaient puissance de consuls, et les tribuns du peuple eux-mêmes qui avaient senti que leur puissance finirait avec la liberté de tous, et s'étaient rangés à l'autorité du sénat, se concertent tous ensemble sur le parti à prendre. Comme on n'imaginait d'autre moyen que la violence et le meurtre, et que l'on prévoyait un conflit terrible, M. Ménius et Q. Publilius, tribuns du peuple, prenant la parole : « Pourquoi, disent-ils, ferions- 287 nous une guerre des patriciens contre le peuple de ce qui est simplement la lutte de la cité contre un Citoyen qui veut sa ruine? Pourquoi attaquer le peuple avec cet homme, qu'il est bien plus sûr d'attaquer par le peuple lui-même, afin qu'il succombe écrasé par ses propres forces? Notre intention est de l'assigner en jugement. Rien n'est moins populaire que la royauté. Une fois que cette multitude aura compris que ce n'est pas à elle qu'on en veut, que de défenseurs ils seront devenus juges, qu'ils verront des accusateurs plébéiens, un patricien accusé, et une inculpation de royauté au milieu, alors il n'y aura rien qu'ils préfèrent à la liberté. » XX. Tout le monde ayant approuvé ce plan, ils assignent Manlius. Le peuple s'émut d'abord en voyant l'accusé couvert de haillons, et près de lui pas un sénateur, pas même ses parents ou ses alliés, pas même enfin ses frères A. et T. Manlius : abandon sans exemple jusqu'à ce jour ; car jamais dans une si grande épreuve les proches de l'accusé n'avaient manqué de changer, eux aussi, de vêtement. « Lorsque Appius Claudius avait été jeté dans les fers, C. Claudius, son ennemi personnel, et la famille Claudia tout entière avaient pris le vêtement de deuil. Cette fois, on s'entendait pour opprimer un homme populaire, parce que c'était le premier des patriciens qui eût passé au peuple. » Au jour assigné, les accusateurs, outre les réunions du peuple, les discours séditieux, les largesses et la calomnie sur le trésor caché, durent présenter contre l'accusé des charges ayant un rapport direct à la tentative criminelle de royauté; je ne les trouve dans aucun auteur : elles durent cependant être assez graves, puisque l'hésitation du peuple tint non à la cause, mais au lieu. Remarquons ici, pour l'instruction des hommes, combien de nobles actions ont pu être rendues non pas seulement stériles, mais même odieuses par la honteuse passion de régner. Manlius produisit, dit-on, près de quatre cents citoyens dont il avait, sans intérêts, acquitté les dettes, empêché qu'on ne vendit les biens, ou qu'on n'adjugeât la personne. Après cela, ne se bornant pas à rappeler les honneurs qu'il avait obtenus à la guerre, il en apporta des preuves éclatantes : les dépouilles de trente ennemis tués par lui, et quarante récompenses reçues de ses généraux, parmi lesquelles on distinguait deux couronnes murales, huit civiques. Il produisit en outre les citoyens sauvés par lui des mains de l'ennemi ; entre autres C. Servilius, maître de la cavalerie, qui était absent, et qu'il nomma. On ajoute qu'après avoir rappelé ses exploits dans un langage qui s'élevait à la hauteur du sujet, parlant comme il avait agi, il mit à nu sa poitrine couverte de nobles cicatrices; qu'ensuite, les yeux tournés vers le Capitole, il supplia Jupiter et les autres dieux de le secourir dans son infortune, et d'inspirer au peuple romain, dans sa détresse, les sentiments dont ils l'avaient animé lui-même pour la défense du Capitole et le salut du peuple romain ; qu'enfin il conjura ses juges; ensemble et séparément, de contempler le Capitole et la citadelle, et de se tourner vers les dieux immortels en prononçant son jugement. 288 Comme c'était au Champ-de-Mars que le peuple s'assemblait pour les comices par centuries, et que l'accusé, les mains tendues vers le Capitole, avait cessé de prier les hommes pour invoquer les dieux, les tribuns jugèrent que s'ils ne détournaient les yeux mêmes des citoyens du souvenir de tant de gloire, jamais, dans ces esprits préoccupés du bienfait de Manlius, la reconnaissance ne laisserait pénétrer la conviction de son crime. On prorogea donc le jugement, et l'on convoqua le peuple dans le bois sacré de Pétélie, hors de la porte Nomentane, d'où l'on ne pouvait voir le Capitole. Là, prévalut l'accusation, et par ces hommes inflexibles fut prononcée une sentence fatale, odieuse même aux juges. Selon quelques auteurs, il fut condamné par des duumvirs institués pour juger les crimes contre l'état. Les tribuns le précipitèrent de la roche Tarpéienne, et le même lieu fut pour le même homme, un monument d'insigne gloire et de honteux châtiment. Après sa mort, il fut deux fois flétri; l'une par la république ; car, comme sa maison s'élevait au lieu où se trouvent aujourd'hui le temple et l'atelier de Monéta, le peuple décréta que nul patricien n'habiterait désormais dans la citadelle ou au Capitole; l'autre par sa famille ; la famille Manlia, ayant décidé, par un arrêté, « Que nul de ses membres, à l'avenir, ne pourrait s'appeler M. Manlius. » Telle fut la fin de cet homme qui, s'il ne fût né dans un état libre, eût été digne de mémoire. Bientôt le peuple, qui n'avait plus rien à craindre de lui et ne se rappelait que ses qualités, le regretta; et une peste étant survenue peu après, cette triste calamité, dont on n'apercevait point la cause, parut au plus grand nombre la conséquence du supplice de Manlius. « On avait souillé le Capitole du sang de son libérateur, et les dieux n'osaient souffert qu'à contre coeur qu'on immolât, pour ainsi dire, sous leurs yeux, l'homme qui avait arraché leurs temples aux mains de l'ennemi. » XXI. A cette peste succéda la disette, et, à la nouvelle de ces maux, l'année suivante, éclatèrent en même temps plusieurs guerres. Alors étaient tribuns militaires avec puissance de consuis, L. Valérius pour la quatrième fois, A. Manlius pour la troisième, Ser. Sulpicius pour la troisième, L. Lucrétius, L. Emilius pour la troisième, et M. Trébonius. Outre les Volsques, que le sort ramenait éternellement contre nous comme pour exercer le soldat romain; outre les colonies de Circéia et de Vélitres, qui, depuis longtemps, préparaient leur défection, et le Latium sur lequel on ne pouvait compter, de nouveaux ennemis, les Lanuviens eux-mêmes, peuple jusqu'alors si fidèle, surgirent tout à coup. Les sénateurs, persuadés que tant d'audace ne venait que de ce qu'ils avaient laissé si longtemps impunie la défection de leurs concitoyens, les Véliternes, décréta qu'à la première occasion il serait proposé au peuple de leur déclarer la guerre. Afin de le mieux disposer à cette campagne, on créa des quinquemvirs pour le partage des terres du Pomptinum, et des triumvirs pour l'établissement d'une colonie à Népète. Alors on proposa au peuple qu'il eût à ordonner la guerre, et, contre l'avis des tribuns du peuple, la guerre fut ordonnée par toutes les tribus. On fit, dès cette année, les préparatifs; nais la peste empêcha l'armée de se mettre en marche. 289 Ce délai donnait le temps aux colons de conjurer le sénat; et une grande partie des habitants aurait appuyé l'envoi d'une humble députation à Rome, si la peur de quelques particuliers n'eût, comme toujours, traversé l'intérêt public. Les auteurs de la défection, craignant qu'on ne les rendit responsables du crime, et qu'en expiation on ne les livrât au ressentiment des Romains, détournèrent les colonies des mesures de conciliation, et non contents de s'opposer, dans le sénat, à l'envoi de députés, ils portèrent une grande partie du peuple à aller ravager le territoire de Rome : nouvel outrage qui éloigna tout espoir de paix. Cette an-née aussi courut, pour la première fois, le bruit d'une défection des Prénestins. A la mollesse avec laquelle le sénat répondit aux dénonciations des Tusculans, de ceux de Gabies et du Lavicum, dont ce peuple avait ravagé les terres, on vit bien que s'il n'ajoutait pas foi entière à ces accusations, c'est qu'il eût voulu qu'elles fussent moins fondées. XXII. L'année suivante, Sp. et L. Papirius, nouveaux tribuns militaires avec puissance de consuls, menèrent les légions à Vélitres; leurs quatre collègues, Ser. Cornélius Maluginensis, tribun pour la quatrième fois, Q. Servilius, Ser. Sulpicius, L. Duilius, pour la quatrième fois, restèrent pour que la ville se trouvât gardée au cas où l'ou annoncerait quelque nouveau mouvement de l'Étrurie; car tout était suspect de ce côté. A Vélitres on combattit avec succès une armée auxiliaire do Prénestins, plus nombreuse en quelque sorte quo les troupes de la colonie; la proximité de la ville fut tout à la fois pour l'ennemi la cause d'une fuite plus prompte, et, dans cette fuite, son unique asile. Les tribuns renoncèrent à attaquer la place, parce que l'entreprise était douteuse, et qu'ils ne voulaient point combattre de manière à détruire la colonie. Les dépêches qu'ils envoyèrent 'n Rome au sénat pour annoncer leur victoire étaient plus sévères pour les Prénestins que pouf les Véliternes. En conséquence, par un sénatus-consulte et par l'ordre du peuple, on déclara la guerre aux Prénestins : ceux-ci, s'alliant aux Volsques, marchèrent, l'année suivante, sur Satricum, colonie du peuple romain, l'emportèrent d'assaut, malgré l'opiniâtreté avec laquelle les colons se défendirent, et abusèrent horriblement de la victoire. Indignés de cette conduite, les Romains créèrent M. Furius Camille, pour la septième fois, tribun militaire ; on lui donna pour collègues A. et L. Postumius Régillensis, et L. Furius, avec L. Lucrétius et M. Fabius Ambustus. A M. Furius fut décernée extraordinairement la guerre volsque. Le sort désigna pour l'assister le tribun L. Furius, ce qui fut moins heureux pour l'état que pour Camille, auquel ce choix fournit une matière à toute louange : car il releva, comme général, l'affaire presque perdue par la témérité de son collègue; et comme simple particulier, il chercha plutôt à se l'attacher par cette faute, qu'à s'en faire pour lui-même un titre de gloire. Déjà d'un âge avancé, Camille était prêt à prononcer, dans les comices, le serment usité pour excuse de santé; le peuple ne voulut pas y consentir : une âme pleine de sève vivifiait encore cette forte poitrine; il avait conservé l'entier usage de ses sens, 290 et si le soin des affaires civiles commençait à le fatiguer, la guerre le ranimait. Après avoir levé quatre légions de quatre mille hommes chacune, il convoque son armée pour le lendemain à la porte Esquiline, et marche sur Satricum. Les vainqueurs de la colonie, se confiant au nombre de leurs troupes, l'attendaient l'a sans le moindre effroi. A la nouvelle de l'arrivée des Romains, ils s'avancent aussitôt en bataille, voulant tenter sans retard un combat décisif, afin que les talents d'un chef unique, sur lesquels seuls l'ennemi comptait, ne lui fussent d'aucune aide. XXIII. Une ardeur semblable animait l'armée romaine et l'autre chef, et l'issue de cette lutte imminente n'était retardée que par la sagesse et l'empire d'un seul homme, qui, en traînant la guerre, cherchait à suppléer aux forces par la raison. L'ennemi n'en avait que plus d'audace; déjà même, non content de déployer ses lignes sur le front de son camp, il s'avance au milieu de la plaine, et, portant presque ses enseignes sous les palissades ennemies, il affecte une orgueilleuse confiance en ses forces. Le soldat romain ne supportait ces démonstrations qu'avec peine; avec plus de peine encore les supportait l'autre tribun militaire, L. Furius, qu'entraînaient sa fougue naturelle et celle de sou âge, et les espérances d'une multitude qui s'enhardissait par l'incertitude même de l'événement. Il excitait encore cette irritation des soldats, en attaquant sur le seul point où cela fût possible, c'est-à-dire sur son âge, l'autorité de son collègue : « La guerre, disait-il à chaque instant, est faite pour les jeunes hommes; le courage fleurit et se flétrit avec le corps; le guerrier le plus actif devient un temporiseur; et le même homme qui, à l'arrivée, avait coutume d'emporter les camps et les villes du premier choc, maintenant engourdi usait le temps derrière les palissades. Qu'espérait-il par là? accroître ses forces, ou diminuer celles de l'ennemi? Quelle occasion, quel moment, quel lieu demandait-il pour dresser des embûches? C'étaient bien l'a les froids et languissants projets d'un vieillard. Camille avait désormais assez de vie, assez de gloire : convient-il de laisser vieillir avec ce corps mortel les forces d'une cité qui doit être immortelle? » Ces discours lui avaient gagné l'armée entière; et comme de toutes parts on demandait le combat : « Nous ne pouvons, M. Furius, dit-il, contenir l'ardeur du soldat; et l'ennemi, dont nous avons, par nos lenteurs, augmenté l'audace, nous insulte avec un mépris intolérable. Seul contre tous, consens à céder, laisse-toi vaincre dans le conseil, et tu n'en seras que plus tôt vainqueur dans le combat.» A cela Camille : « Jamais, jusqu'à ce jour, dans les guerres qui ont été conduites uniquement sous ses auspices, ni lui ni le peuple romain n'ont eu à se plaindre de ses plans ni de la fortune ; aujourd'hui il sait qu'il a un collègue qui l'égale en pouvoir et en autorité, et qui a, de plus que lui, la vigueur de l'âge. Pour ce qui est de l'armée, il a l'habitude de la commander, non d'être commandé par elle; mais il ne peut s'opposer à la volonté de son collègue. Que celui-ci fasse donc, avec l'aide des dieux, ce qu'il croit avantageux à la république. Lui, il demande, comme une grâce due à son âge, à n'être point au premier rang ; il est prêt d'ailleurs à remplir tous les 291 devoirs d'un vieillard à la guerre. L'unique prière qu'il adresse aux dieux immortels, c'est qu'un revers ne vienne pas justifier la sagesse de son conseil. » Mais, ni les hommes n'écoutèrent un si salutaire avis, ni les dieux une si pieuse prière. Celui des deux chefs qui a voulu le combat range en bataille la première ligne; Camille fortifie la réserve, et dispose en avant du camp un vigoureux détachement. Du haut d'une éminence, spectateur attentif, il observe l'issue d'une mesure qu'un autre a conseillée. XXIV. A peine au premier choc les armes eurent-elles retenti, que par ruse, non par crainte, l'ennemi lâcha pied. Une colline, dont la pente était assez douce, se trouvait derrière lui, entre sa ligne et son camp; et, grâce au nombre de ses troupes, il avait pu laisser au camp quelques vaillantes cohortes armées et toutes prêtes, qui, la lutte une fois engagée, devaient, dès que l'ennemi approcherait du retranchement, fondre sur lui. Le Romain, poursuivant en désordre l'ennemi qui recule, se laisse attirer dans une position désavantageuse, et favorise ainsi la sortie. Alors l'effroi se met parmi les vainqueurs: le vue d'un second ennemi et le penchant de la vallée font plier l'armée romaine. On est pressé par les troupes fraîches des Volsques, et ceux qui avaient feint de fuir recommencent le combat. Déjà ce n'était plus une retraite; le soldat romain, oubliant son ardeur récente et sa vieille gloire, avait tourné le dos, fuyait à la course, et regagnait le camp en déroute. Alors, Camille, placé sur un cheval par ceux qui l'entourent, s'élance vers eux, et leur opposant son corps de réserve : « Voilà donc, soldats, dit-il, le combat que vous demandiez! Quel homme ou quel dieu pouvez-vous accuser? C'est votre faute, à vous, si imprudents naguère et maintenant si lâches! Après avoir suivi un autre chef, suivez à présent Camille; et, comme toujours sous ma conduite, sachez vaincre. Pourquoi regardez-vous les palissades et le camp? Nul de vous n'y rentrera que vainqueur. » La honte d'abord arrêta leur fuite; puis, voyant avancer les enseignes, l'armée se retourner contre l'ennemi, et leur chef, illustré par tant de triomphes et si vénérable par son âge, se jeter aux premiers rangs, où il y avait le plus de peine et de danger, ils s'adressent de mutuels reproches, ils s'encouragent les uns les autres avec un cri joyeux qui parcourt toute la ligne. L'autre tribun non plus ne manque pas à son devoir : envoyé vers les cavaliers par son collègue qui ralliait l'infanterie, il ne leur fait point de reproches (ayant partagé leur faute, il avait peu d'autorité pour les blâmer); mais renonçant au ton du commandement pour prendre celui de la prière, il les conjure, chacun en particulier et tous ensemble, « de le sauver de l'opprobre de cette journée, dont les malheurs retomberaient sur lui. Malgré le refus, la défense de mon collègue, j'ai mieux aimé, dit-il, m'associer à la témérité de tous qu'à la sagesse d'un seul. Camille, quelle que soit votre fortune, y trouvera sa gloire; moi, si le combat n'est rétabli (ce qui serait le plus affreux malheur), outre ma part de l'infortune générale, je subirai seul toute la honte. » Ils jugèrent convenable, au milieu de ces lignes flot- 292 tantes, du quitter leurs chevaux et d'attaquer à pied l'ennemi. Aussi remarquables par leur courage que par leur armure, ils vont partout où ils voient l'infanterie plus vivement pressée. Ni le coeur des chefs, ni celui des soldats ne faiblit un moment dans cette lutte décisive. Aussi l'événement se ressentit de cet effort de courage : une vraie déroute emporta les Volsques par le même chemin qui avait vu leur fuite simulée ; un grand nombre périrent dans le combat et dans la fuite; le reste dans le camp qui fut emporté du même choc; il y en eut cependant plus de pris que de tués. XXV. Comme dans le recensement des prisonniers on avait reconnu quelques Tusculans, on les sépara des autres, et ou les conduisit aux tribuns : interrogés, ils avouèrent que c'était de l'aveu de leur nation qu'ils avaient pris du service. Éprouvant une certaine crainte à la vue d'un ennemi si voisin, Camille annonça « Qu'il allait aussitôt mener lui-même ces prisonniers à Rome, afin que le sénat n'ignorât point que les Tusculans s'étaient détachés de son alliance. Pendant ce temps, son collègue, s'il y consentait, aurait seul le commandement du camp et de l'armée. » Un seul jour avait apprisà celui-ci à ne point préférer son opinion à un meilleur avis : toutefois, ni lui ni personne dans l'armée ne pouvait supposer que Camille montrât beaucoup d'indulgence pour une faute qui avait jeté la république en un si grand péril ; car, tant à Rome qu'à l'armée c'était une opinion généralement établie que, dans cette alternative du combat livré aux Volsques, le revers et la déroute devaient être imputés à L. Furius, et qu'à M. Furius appartenait tout l'honneur du succès, Les prisonniers introduits dans le sénat, il fut décrété qu'on ferait la guerre aux Tusculans, et que Camille en serait chargé : il demanda qu'on lui donnât un aide pour cette entreprise : autorisé à choisir parmi ses collègues, il choisit, contre l'attente de tous, L. Furius; modération par laquelle, tout en atténuant la honte de son collègue, il s'attira une immense gloire. On n'eut point à combattre les Tusculans : par une paix obstinée ils repoussèrent la vengeance de ]tome, ce qu'ils n'auraient pu faire par leurs armes. Lorsqu'ils virent les Romains entrer sur leurs terres, ils ne quittèrent point les lieux voisins de la route, et ne cessèrent point de cultiver leurs champs : des portes ouvertes de la ville, une foule d'habitants en toge s'avancèrent à la rencontre des généraux ; on apporta avec complaisance au camp, de la ville et des campagnes, des vivres pour l'armée. Camille posa son camp en avant des portes. Curieux de savoir s'il y avait dans la ville ces mêmes apparences de paix qu'on affectait dans les campagnes, il entra : il y trouva les maisons et les boutiques ouvertes, toutes les marchandises exposées, étalées comme à l'ordinaire, chaque ouvrier occupé à son travail ; dans les écoles retentissaient les voix des adolescents qui apprenaient leurs leçons; les rues étaient pleines de peuple, principalement d'enfants et de femmes allant de côté et d'autre, chacun où l'appelaient ses habitudes et ses affaires; nulle part, rien qui ressemblât à de la peur, ou même à de l'étonnement. Il regardait tout autour de lui, cherchant des eux quelques signes de guerre: pas la moindre trace d'un objet enlevé de sa place ou mis en vue 293 à dessein ; mais partout une si constante et si tranquille paix, qu'on eût pu croire que même un simple bruit de guerre n'était pas arrivé jusque là. XXVI. Vaincu par cette patience des ennemis, il fait convoquer leur sénat : « Seuls jusqu'ici, Tusculans, dit-il, vous avez trouvé les véritables armes, les véritables forces pour vous défendre contre la colère des Romains. Allez à Rome trouver le sénat; les sénateurs jugeront ce que vous avez mérité le plus, ou d'être punis d'abord, ou d'être pardonnés maintenant : pour moi je ne puis prévenir une faveur qui doit être un bienfait public; c'est assez que je vous laisse la liberté de la solliciter; le sénat fera à vos prières l'accueil qu'il jugera convenable. » Les Tusculans vinrent à Rome; et, quand on vit arriver tristement dans le vestibule de la curie le sénat d'un peuple naguère notre allié fidèle, les sénateurs romains s'attendrirent, et les firent appeler avec des paroles hospitalières plutôt qu'hostiles. Le dictateur tusculan parla en ces termes : « Vous nous avez déclaré et porté la guerre, Pères conscrits, et tels vous nous voyez paraître aujourd'hui dans le vestibule de votre curie, tels et avec ces armes et dans cet appareil nous sommes sortis à la rencontre de vos généraux et de vos légions. voilà quelle a été et quelle sera toujours notre conduite et celle de notre peuple, à moins qu'un jour nous ne recevions des armes de vous et pour vous. Nous rendons grâces à vos généraux et à vos armées de ce qu'ils en ont cru leurs yeux plutôt que leurs oreilles, et que, là où ils n'ont rien vu d'hostile, ils n'ont point commis d'hostilités. Nous implorons de vous la paix que nous avons observée et nous vous prions de reporter la guerre partout où on vous la fait. S'il nous faut éprouver douloureusement ce que peuvent contre nous vos armes, nous l'éprouverons désarmés. Telles sont nos intentions : fassent les dieux immortels qu'elles nous soient aussi heureuses qu'elles sont pures. Quant aux griefs qui vous ont poussés à déclarer la guerre, sans réfuter par des paroles ce qui est détruit par les faits, nous pensons, toutefois, que, fussent-ils réels, notre aveu, après un si éclatant repentir, serait sans (langer. On peut vous outrager tant que vous serez dignes de semblables satisfactions. » Tel fut ù peu près le langage des Tusculans. Ils obtinrent d'abord la paix, et peu de temps après, le droit de cité. Les légions furent ramenées de Tusculum. XXVII. Camille, qui s'était encore illustré par sa prudence et sa valeur dans la guerre volsque, par son bonheur dans l'expédition de Tusculum, et dans l'une et l'autre par sa patience et sa modération singulière envers son collègue, sortit de magistrature. On créa tribuns militaires, pour l'année suivante, L. et P. Valérius Lucius pour la cinquième fois, Publius pour la troisième, C. Sergius pour la troisième également, L. Hénénius pour la seconde, Sp. Papirius et Ser. Cornelius Maluginensis. Cette année eut aussi besoin de censeurs, à cause de bruits vagues qui couraient concernant les dettes, charge dont l'odieux était encore exagéré par les tribuns du peuple, et d'autre part, atténué par ceux qui avaient intérêt â attribuer les embarras des débiteurs à leur mauvaise foi plutôt qu'à l'état de leur fortune. On créa censeurs C. Sulpicius Camérinus, Sp. Postu- 294 mius Régillensis. Ils étaient déjà entrés en fonctions quand la mort de Postumius, que le scrupule religieux défendit de remplacer, vint interrompre leurs travaux. En conséquence, Sulpicius abdiqua sa magistrature, et d'autres censeurs furent créés; mais un vice dans leur élection les empêcha d'exercer. On n'osa point risquer une troisième élection; il semblait que les dieux ne voulussent point, cette année, la censure. Les tribuns protestaient que c'était là une véritable dérision. « Le sénat, disaient-ils, recule devant ces tables publiques, qui attesteraient le cens de chacun; il ne veut point laisser voir cette masse de dettes qui prouverait qu'une partie des citoyens dévore l'autre ; et en attendant, le peuple obéré est livré à tous ses ennemis. On cherche la guerre (le tous côtés indistinctement; on promène les légions d'Antium à Satricum, de Satricum à Vélîtres, et de là à Tusculum. Maintenant on menace des armes romaines, Latins, Herniques, Prénestins, et cela plus en haine du citoyen que de l'ennemi, afin d'écraser le peuple sous les armes, sans lui permettre de respirer à la ville, sans lui laisser le loisir de songer à la liberté, d'assister aux assemblées publiques, où il entendrait de temps à autre la voix tribunitienne réclamant un soulagement à tant de charges, un terme à tant d'injustices de toute sorte. Que si le peuple se souvient de la liberté des ancêtres, il ne souffrira pas qu'on adjuge un citoyen pour de l'argent prêté; ni qu'on fasse une levée avant de s'être occupé des dettes, avant d'avoir avisé aux moyens de les réduire, avant que chacun sache bien ce qui lui appartient, ce qui appartient à autrui, s'il lui reste un corps libre, ou s'il le doit aussi aux fouets de ses tyrans. » Le prix offert à la sédition excita la sédition sur l'heure. Au moment où une foule de débiteurs venaient d'être condamnés, et où le sénat, au bruit des armements des Prénestins, venait de décréter l'enrôlement de nouvelles légions, le peuple, secondé par les tribuns, s'opposa à ce que ces mesures eussent aucun effet. Les tribuns ne permettaient pas qu'on emmenât les citoyens condamnés, et les jeunes gens se refusaient à donner leurs noms. Pour le présent, ce qui inquiétait les sénateurs, ce n'était pas tant l'exécution des jugements prononcés contre les débiteurs que la levée; car on annonçait déjà que l'ennemi, parti de Préneste, avait pris position sur le territoire de Gabies. Cependant cette nouvelle même, loin d'effrayer les tribuns du peuple, n'avait fait que les animer encore dans leur projet de résistance, et rien ne put éteindre la sédition dans Rome, que la guerre, quand elle arriva, pour ainsi dire, au pied de ses murs. XXVIII. En effet, quand les Prénestins apprirent qu'on n'avait point levé d'armée à Rome, ni désigné de général, que les patriciens et le peuple étaient en lutte, leurs chefs, profitant de l'occasion, emmènent des troupes à la hâte, ravagent en passant la campagne, et portent leurs enseignes jusqu'auprès de la porte Colline. Grande fut l'épouvante dans Rome : on crie aux armes ; on court sur les remparts et aux portes; enfin on abandonne la sédition pour la guerre, et l'on nomme dictateur T. Quinctius Cincinnatus. 295 Celui-ci nomma A. Sempronius Atratinus maître de la cavalerie. A cette nouvelle ( tant celte magistrature était redoutée), les ennemis s'éloignèrent des murailles, et la jeunesse romaine se soumit à l'édit sans résistance. Tandis qu'on lève une armée à Rome, l'ennemi va placer son camp non loin du fleuve Allia : de là il dévaste au loin la campagne, se vantant « De s'être porté dans un lieu fatal à la république romaine, et qu'il allait y être témoin de la même terreur, de la même déroute que dans la guerre des Gaulois. En effet, si le jour seul d'Allia est pour les Romains un sujet de crainte, jusque là qu'ils l'ont frappé d'un interdit religieux, et marqué du nom de ce lieu; combien plus encore doivent-ils redouter l'Allia lui-même, qui rappelle un si grand désastre? Là sans doute ils croiront voir les visages farouches, ils croiront entendre la voix terrible des Gaulois. " Tirant de ces choses vaines de vaines pensées, ils avaient commis leurs espérances à la fortune de ce lieu. Les Romains, de leur côté : « Partout où ils trouvent un ennemi latin, ils savent assez que c'est le même qu'ils ont vaincu au lac Régine, et tenu dans la paix et dans l'oppression pendant cent ans. Ce lieu , qui leur rappelle un désastre, les animera à détruire la mémoire de leur honte, loin de leur faire craindre qu'il y ait une terre où le destin leur ait interdit la victoire. Bien plus, si les Gaulois eux-mêmes se présentaient de nouveau en ce lieu, les Romains combattraient comme ils ont combattit à Rome pour reconquérir leur patrie, et comme, le jour suivant, à Gabies, où ils ont obtenu par leurs efforts que, de tant d'ennemis qui avaient pénétré dans les murs de Rome,pas un ne pût porter chez eux la nouvelle de leurs succès et de leurs revers. " XXIX. C'est dans ces sentiments que les deux armées se trouvèrent en présence sur les bords de l'Allia. Quand le dictateur romain se vit en face de l'ennemi rangé et prêt à combattre : « Ne vois-tu pas, A. Sempronius, dit-il, qu'ils ont compté sur la fortune de ce lieu en prenant position sur l'Allia? Puissent les dieux immortels ne leur avoir point donné de plus sûr gage de confiance , ni de secours meilleur! Pour toi, qui comptes sur tes armes et ton courage, mets-toi à la tête de tes cavaliers, et lance-les au milieu de l'armée ennemie; moi, avec les légions, je porterai nos enseignes contre leurs lignes troublées et éperdues. Venez-nous en aide, dieux témoins des serments ! Venez punir comme ils le méritent ceux qui vous ont outragés et qui se sont placés sous votre protection pour nous trahir ! " Les Prénestins ne résistèrent ni aux cavaliers, ni aux fantassins : au premier choc, au premier cri, leurs rangs furent rompus; puis, leurs troupes ne pouvant tenir sur aucun point, ils tournent le dos. Culbutés, dispersés et emportés par la frayeur au-delà de leur camp, ils ne suspendirent leur course qu'en vue de Préneste. Là, ces fuyards se rallient, et s'emparent d'une position qu'ils fortifient à la hâte : ils avaient craint que s'ils se réfugiaient dans leurs murs, on ne brûlât aussitôt leurs campagnes, et qu'après une entière dévastation on ne mit le siége devant la ville. Mais lorsque, après avoir pillé leur camp sur l'Allia, le romain vainqueur apparut, ils abandonnèrent aussi ce retranchement, et se croyant à peine en sûreté derrière leurs rem- 296 parts, ils se renferment dans la ville de Préneste. Outre cette ville, il yen avait huit autres sous la domination des Prénestins : on y porta la guerre tour à tour; on les prit sans beaucoup de peine, et ensuite on mena l'armée à Vélitres. Cette place fut également emportée , et alors on revint à Préneste, l'objet principal de cette guerre. On n'eut pas besoin d'employer la force; la ville capitula. T. Quinctius, après avoir remporté la victoire dans une bataille rangée, pris deux camps ennemis, forcé neuf villes, et reçu Préneste à composition, rentra dans Rome. ll triompha, et porta au Capitole une statue de Jupiter Imperator, enlevée de Préneste. Elle fut consacrée entre la chapelle de Jupiter et celle de Minerve; et au-dessous fut scellée une tablette, monument de ses exploits, avec une inscription conçue à peu près en ces termes : " Jupiter et tous les dieux ont donné à T. Quinctius, dictateur, de prendre neuf villes. » Vingt jours après son élection, il abdiqua la dictature. XXX. On tint ensuite les comices pour l'élection des tribuns militaires, avec puissance de consuls : il en sortit un nombre égal de patriciens et de plébéiens. Les patriciens nommés furent P. et C. Manlius, avec L. Julius : le peuple donna C. Sextilius, M. Albinius, L. Antistius. Les Manlius, qui l'emportaient en naissance sur les plébéiens et en crédit sur Julius, furent, sans que l'on eût consulté le sort, et sans examen préalable, extraordinairement chargés de la campagne contre les Volsques : ce dont bientôt eux-mêmes et les sénateurs, qui leur avaient confié cette charge se repentirent. Avant d'avoir reconnu le pays, ils envoyèrent des cohortes au fourrage; sur un faux bruit qu'elles étaient enveloppées, ils marchèrent à la hâte à leur secours, sans même avoir le soin de retenir l'auteur de la nouvelle , lequel était un ennemi latin qui s'était donné à eux pour soldat romain; et eux-mêmes tombèrent dans une embuscade. Là, tandis qu'ils se maintiennent sur un terrain désavantageux, par le seul courage des soldats qui se font tuer et qui tuent, ailleurs, le camp romain, assis dans la plaine, est emporté par l'ennemi. D'un côté comme de l'autre les intérêts de la république furent trahis par l'imprudence et l'inhabilité des généraux : tout ce qui put survivre de la fortune du peuple romain ne fut sauvé que par la valeur du soldat qui tint ferme, même sans chef. Dès que ces événements furent connus à Rome, on voulut d'abord nommer un dictateur; mais comme on apprit que les Volsques demeuraient tranquilles , et qu'il ne parut pas qu'ils dussent profiter ni de la victoire, ni de l'occasion, on rappela l'armée et les généraux. On fut alors en repos, au moins du côté des Volsques; car il y eut à la fin de l'année quelque alarme par suite d'une insurrection des Prénestins et des peuplades latines qu'ils avaient soulevées. La même année , on enrôla de nouveaux colons pour Sétia qui se plaignait elle-même de manquer d'habitants. Au milieu des malheureuses chances de la guerre, on eut pour consolation la paix domestique, conquête des tribuns militaires plébéiens, due au crédit et à l'ascendant qu'ils avaient sur leur ordre. XXXI. Le commencement de l'année suivante fut marqué par une violente sédition qui s'alluma sous les tribuns militaires avec puissance 297 de consuls, Sp. Furius, Q. Servilius, élu pour la seconde fois; C. Licinius, P. Clélius, M. Horatius, L. Géganius. L'objet et la cause de cette sédition , c'étaient les dettes : Sp. Servilius Priscus et Q. Clélius Siculus, nommés censeurs pour en connaître, furent arrêtés dans leur travail par la guerre. Des messages alarmants d'abord , et ensuite des fuyards de la campagne annoncèrent que les légions des Volsques avaient envahi les frontières et dévastaient en tous sens le territoire romain. Dans cette situation critique, loin que la terreur du dehors comprimât les luttes intestines, la puissance tribunitienne ne s'opposa qu'avec plus de violence aux enrôlements: il fallut que le sénat consentit à ce que la perception du tribut et les poursuites contre les débiteurs fussent suspendues pendant toute la durée de la guerre. Quand ce répit eut été gagné au peuple, aucun empêchement ne fut plus mis aux levées. Des légions récemment enrôlées on trouva bon de former deux armées, et de les diriger séparément sur le territoire volsque. Sp. Furius et M. Horatius marchent à droite, vers la côte maritime, sur Antium ; Q. Servilius et L. Géganius à gauche, vers les montagnes, sur Ecetra. Ni l'un ni l'autre ne rencontrèrent l'ennemi. En conséquence commença le pillage; mais ce ne fut pas un brigandage sans ordre et à la course, comme le pillage des Volsques, qu'encourageaient les discordes de l'ennemi et qu'effrayaient sa valeur; ce fut la juste vengeance d'une armée justement irritée, vengeance rendue plus terrible encore par sa durée. En effet, les Volsques, qui craignaient à chaque instant de voir sortir de Rome une armée, avaient borné leur incursion aux extrémités du territoire: le Romain, au contraire, qui voulait attirer l'ennemi au combat, avait intérêt à séjourner sur ses terres. Aussi on brûla toutes les habitations éparses des campagnes, et même quelques villages; on ne laissa ni un arbre fruitier, ni les semis qui pouvaient promettre une moisson; on emporta tout un butin d'hommes et de bestiaux trouvés hors des murs; après quoi les deux armées furent ramenées à Rome. XXXII. Après un court délai accordé aux débiteurs pour respirer, lorsque l'on fut une fois tranquille du côté de l'ennemi, on recommença vivement à les poursuivre, et loin d'avoir à attendre quelque diminution de leurs anciennes dettes, ils durent en contracter de nouvelles, à cause d'un tribut imposé pour la construction en pierres de taille d'un mur désigné par les censeurs : le peuple fut contraint de subir cette charge , ses tribuns n'ayant point d'enrôlement à combattre. Bien plus, vaincu par l'influence des principaux citoyens, il ne nomma pour tribuns militaires que des patriciens, L. Emilius, P. Valérius, pour la quatrième fois; C. Véturius, Ser. Sulpicius, L. et C. Quinctius Cincinnatus. Par la même influence, pour repousser les Latins et les Volsques, dont les légions réunies étaient campées près de Satricum, on parvint à faire prêter serment sans obstacle à toute la jeunesse et à lever trois armées : l'une devait garder la ville; une autre devait, en ras d'alerte, marcher contre les premiers mouvements qui surviendraient de côté ou d'autre; la troisième, de beaucoup la plus forte, partit pour Satricum, sous le commandement de P. Valerius et L. Emi- 298 lius. Là, comme on trouva l'armée ennemie rangée dans la plaine, on attaqua sur-le-champ; mais au moment où l'on avait sinon la victoire du moins bon espoir de vaincre, une pluie qui tomba à flots vint mettre fin au combat. Le lendemain, on recommença. Pendant quelque temps, les légions latines surtout, qu'une longue alliance avait formées aux leçons de la milice romaine, se maintinrent avec une valeur et une chance égales; mais la cavalerie ayant chargé, jeta le désordre dans leurs rangs; l'infanterie en profita et porta en avant ses enseignes : autant l'armée romaine gagnait de terrain, autant en perdait l'ennemi ; et dès que la ligne de bataille plia, rien ne put résister à la valeur romaine. Mis en déroute, les ennemis coururent non vers leur camp, mais vers Satricum, à deux milles de l'a; ils furent taillés en pièces , principalement par la cavalerie; le camp fut pris et pillé. La nuit suivante, ils quittèrent Satricum, et, d'une marche qui ressemblait à une fuite, se dirigèrent sur Antium. L'armée romaine suivit de près leurs traces ; mais la peur fut plus agile que la colère, et les ennemis entrèrent dans la ville avant que le Romain pût harceler ou retarder leur arrière-garde. Quelques jours furent employés à ravager la campagne, les Romains n'ayant point l'appareil nécessaire pour l'assaut des murailles , et l'ennemi n'étant pas en force pour tenter les chances d'un combat. XXXIII. Sur ces entrefaites, une querelle s'éleva entre les Antiates et les Latins : les Antiates, vaincus par les maux qu'ils avaient soufferts, et réduits par la guerre dans laquelle ils étaient nés et avaient vieilli , aspiraient à se rendre; les Latins, reposés par une longue paix, étaient poussés par la première ardeur d'une défection récente à persévérer opiniâtrement dans la guerre : cette lutte cessa quand chacun eut reconnu qu'il n'était au pouvoir d'aucun des deux peuples d'empêcher l'autre de poursuivre ses desseins. Les Latins se retirèrent et s'affranchirent de la solidarité d'une paix qui leur semblait déshonorante; les Antiates, délivrés de ces incommodes arbitres de leurs projets pacifiques, remirent leur ville et leurs terres aux Romains. Alors les Latins éclatèrent; furieux, pleins de rage de ce qu'ils n'avaient pu ni causer du tort aux Romains par la guerre, ni retenir les Volsques sous les armes, ils mirent à feu la ville de Satricum, leur premier asile dans leur déroute, et de toute cette ville, où leurs torches n'épargnèrent pas plus les lieux sacrés que les lieux profanes, il ne reste que le temple de Matuta Mère. Et même, ce ne fut, dit-on, ni leurs scrupules religieux, ni leur respect des dieux qui les arrêtèrent, mais bien une voix formidable sortie du temple avec de fatales menaces, s'ils ne portaient leurs feux impies loin du sanctuaire. Le même transport de fureur les porta sur Tusculum dont ils voulaient châtier les habitants, qui, après avoir abandonné la ligue commune du Latium, s'étaient faits non seulement alliés, mais citoyens de Rome. Tombant à l'improviste sur la ville, dont les portes étaient ouvertes, ils s'en emparèrent au premier cri ; toutefois ils ne prirent point la citadelle où les Tusculans s'étaient réfu- 299 giés avec leurs femmes et leurs enfants, et d'où ils avaient envoyé des messages à Rome pour instruire le sénat de leur détresse. Avec cette diligence que la foi du peuple romain considérait comme un devoir, une armée partit pour Tusculum; elle était conduite par L. Quinctius et Ser. Sulpicius, tribuns militaires. Ils voient les portes de Tusculum fermées, et les Latins, devenus en même temps assiégeants et assiégés, défendre d'un côté les remparts de la ville, de l'autre, attaquer la citadelle; effrayer et trembler tout ensemble. L'arrivée des Romains avait changé les dispositions de l'un et de l'autre parti. Les Tusculans avaient passé d'une grande terreur à la plus vive allégresse; et les Latins, après avoir compté fermement qu'ils prendraient bientôt la citadelle, comme ils avaient pris la ville, commençaient à n'avoir plus qu'un faible espoir de se sauver. Au cri poussé de la citadelle par les Tusculans, l'armée romaine répond par un cri plus terrible encore. Les Latins sont pressés des deux côtés : ils ne peuvent ni soutenir l'élan des Tusculans qui se précipitent des hauteurs de la citadelle, ni repousser les Romains qui montent aux remparts et travaillent à abattre les barricades des portes. Les murs sont d'abord franchis à l'aide d'échelles; puis, les barrières des portes tombent brisées; serrés entre deux lignes, par devant et par derrière, les ennemis, à qui il ne reste plus de force pour combattre, ni d'issue pour fuir, sont massacrés des deux côtés jusqu'au dernier. Tusculum reconquis, l'armée fut reconduite à Rome. XXXIV. A mesure que les succès obtenus cette année à la guerre ramenaient partout la paix au dehors, dans la ville croissait chaque jour la violence des patriciens et les misères du peuple; car, en voulant le contraindre à payer ses dettes, on lui ôtait tout pouvoir de se libérer. Aussi, une fois leur patrimoine épuisé, ce fut par leur honneur et par leur corps que les débiteurs, condamnés et adjugés, satisfirent leurs créanciers, et leur supplice acquittait leur parole. Par suite, les plébéiens, non seulement les plus humbles, mais les principaux d'entre le peuple, étaient devenus tellement soumis, que loin de disputer aux patriciens le tribunat militaire, pour lequel ils avaient tant lutté autrefois, ils ne cherchaient pas même à solliciter ou à prendre en main les magistratures plébéiennes : il n'y en avait pas un qui fût assez hardi, assez entreprenant pour se risquer jusque-là, et la possession d'une dignité que le peuple n'avait eue à lui que quelques années semblait à jamais recouvrée par les patriciens. Mais, pour que ce corps n'en conçût pas trop de joie, il survint un léger incident qui , comme d'ordinaire, amena les événements les plus graves. M. Fabius Ambustus, personnage influent parmi les hommes de son ordre, et même parmi le peuple, qui savait n'être pas méprisé de lui, avait marié lainée de ses deux filles à Ser. Sulpicius , et la plus jeune à C. Licinius Stolo, homme considérable, quoique simple plébéien; et cette alliance même, que Fabius n'avait pas dédaignée, lui avait attiré la faveur de la multitude. Le hasard voulut qu'un jour, pendant que les deux soeurs, réunies dans la maison de Ser. Sulpicius, tribun militaire, passaient le temps, comme d'habitude, à causer ensemble, Sulpicius, revenant chez lui au sortir du forum, le licteur, 300 suivant l'usage, frappa la porte de sa baguette. A ce bruit, la jeune Fabia, pour qui cet usage était inconnu, s'étant effrayée, sa soeur se prit à rire et à s'étonner de son ignorance. Ce sourire piqua au vif ce coeur de femme si prompt à s'émouvoir des plus petites choses. J'imagine aussi que la vue de cette foule qui suivait le tribun en lui demandant ses ordres lui fit estimer bien heureux le mariage de sa soeur, et que cette mauvaise disposition, qui porte chacun de nous à ne vouloir pas être moins que ses proches, dut lui donner du regret du sien. Son père, l'ayant trouvée un jour l'esprit encore troublé de cette récente blessure, il lui demanda " si elle était malade. " Elle voulut d'abord lui cacher la cause d'un chagrin qui n'était ni bienveillant pour sa soeur, ni flatteur pour son mari; mais, insistant avec douceur, il finit par lui arracher l'aveu que son chagrin venait de cette union inégale qui l'avait mise dans une maison où ne pouvaient entrer ni honneurs ni crédit. Ambustus consola sa fille et lui dit d'avoir bon courage; qu'au premier jour elle verrait chez elle les mêmes honneurs qu'elle voyait chez sa soeur. Dès lors il commença à se concerter avec son gendre, après s'être adjoint L. Sextius, jeune homme de coeur,auquel il ne manquait, pour pouvoir aspirer à tout, qu'une naissance patricienne. XXXV. Un prétexte se présentait de tenter des nouveautés, c'était la masse énorme des dettes. Le peuple ne devait espérer de soulagement à ce mal qu'en plaçant les siens au sommet du pouvoir. Tel était le but auquel il fallait tendre. A force d'essayer et d'agir, les plébéiens avaient déjà fait un grand pas; encore quelques efforts, et ils arriveraient au faite, et ils pouraient égaler en dignités ces patriciens qu'ils égalent en mérite. » Ils jugèrent à propos de commencer par se faire nommer tribuns du peuple : cette magistrature leur ouvrirait la voie aux autres dignités. Créés tribuns, C. Licinius et L. Sextius proposèrent plusieurs lois qui toutes étaient contraires au pouvoir des patriciens et favorables au peuple. La première, sur les dettes , avait pour but de faire déduire du capital les intérêts déjà reçus, le reste devait se payer en trois ans par portions égales. Une autre limitait la propriété, et défendait qu'un citoyen possédât plus de cinq cents arpents de terres. Une troisième supprimait les élections de tribuns militaires, et rétablissait les consuls, dont l'un serait toujours choisi parmi le peuple. Chacune de ces lois était de la plus haute importance, et ne pouvait passer sans les plus violentes luttes. Aussi, voyant attaquer à la fois toutes les choses qui excitent le plus l'ambition des hommes, la propriété, l'argent, les honneurs, les patriciens, épouvantés et tremblants, n'ayant trouvé, après plusieurs conférences publiques et particulières, qu'un seul et unique remède, c'est-à-dire cette opposition tribunitienne déjà tant de fois éprouvée dans des luttes antérieures, obtinrent de quelques tribuns qu'ils combattraient les projets de leurs collègues. Dès que ceux-ci virent les tribus citées par Licinius et Sextius pour donner leurs suffrages, ils arrivèrent, soutenus d'un renfort de patriciens, et empêchèrent la lecture des projets de lois, ainsi que les autres formalités en usage pour prendre le voeu du peuple. De nouvelles assemblées ayant été souvent encore convo- 301 quées, mais sans succès, les projets de lois semblaient écartés à toujours. « A la bonne heure, dit alors Sextius, puisque l'on reconnaît ici tant de force à l'opposition tribunitienne, ce sera aussi l'arme avec laquelle nous défendrons le peuple. Allons, patriciens, indiquez des comices pour des élections de tribuns militaires, je ferai en sorte que vous trouviez moins de charme à ce mot, Je m'oppose, qui vous plaît tant aujourd'hui dans la bouche de nos collègues. » Ces menaces n'étaient que trop sérieuses : aucune élection, hormis celles des édiles et des tribuns du peuple, ne put avoir lieu. Licinius et Sextius, réélus tribuns du peuple, ne laissèrent créer aucun magistrat curule; et, comme le peuple renommait toujours les deux tribuns, et que ceux-ci empêchaient toujours les élections des tribuns militaires, la ville demeura ainsi pendant cinq ans privée de ses magistratures. XXXVI. Les autres guerres avaient été heureusement suspendues; mais les colons de Vélitres , se prévalant de l'inaction de Rorne, qui n'avait pas d'armée, firent plusieurs incursions sur les terres de la république et osèrent assiéger Tusculum. A cette nouvelle et à la voix des Tusculans, de ces vieux alliés, de ces nouveaux concitoyens qui demandaient du secours, un vif sentiment de pudeur toucha non seulement les patriciens, mais le peuple lui-même. Les tribuns du peuple s'étant désistés, un interroi tint les comices, et l'on créa tribuns militaires L. Furius, A. Manlius, Ser. Sulpicius, Ser. Cornélius, P. et C. Valérius. Ceux-ci trouvèrent le peuple moins docile aux levées qu'aux comices, et ce ne fut pas sans beaucoup de peine qu'ils parvinrent à enrôler une armée. Ils partirent enfin, repoussèrent de Tusculum l'ennemi, et le refoulèrent même jusque dans ses murailles; puis, Vélitres fut assiégé avec plus de vigueur que ne l'axait été Tusculum. Toutefois Vélitres ne put être emporté par ceux qui en avaient commencé le siége. On créa auparavant de nouveaux tribuns militaires: Q. Servilius, C. Véturius, A. et M. Cornélius, Q. Quinctius, M. Fabius; et ces tribuns même ne firent rien de mémorable à Vélitres. Des débats encore plus importants s'étaient élevés à Rome. En effet , de concert avec Sextius et Licinius, qui avaient proposé les projets de lois, et qu'on avait déjà renommés huit fois tribuns du peuple, un des tribuns militaires, le beau-père de Stolon, Fabius, premier auteur de ces lois, proclamait hautement la part qu'il y avait prise. Il s'était d'abord trouvé, dans le collège des tribuns du peuple, huit opposants; il n'en restait plus que cinq ; et ces tribuns (comme il arrive d'ordinaire à ceux qui se séparent de leur corps), embarrassés et interdits , bornaient leur opposition à répéter ces paroles d'autrui, qu'on leur avait apprises comme une leçon: « Une grande partie du peuple est dehors, à l'armée, devant Vélitres. C'est un devoir de différer les comices jusqu'au retour des soldats, afin que tout le peuple puisse voter sur des choses qui l'intéressent. » Sextius et Licinius, appuyés par leurs collègues et par le tribun militaire Fabius, et, grâce à une expérience de tant d'années, devenus habiles à manier les esprits de la -multitude, prenaient à partie les principaux patriciens, 302 et les fatiguaient de questions relatives aux lois présentées au peuple : « Oseraient-ils, quand on distribuait deux arpents de terre aux plébéiens, réclamer pour eux-mêmes la libre jouissance de plus de cinq cents arpents? Voudraient-ils posséder chacun les biens de près de trois cents citoyens, quand le champ du plébéien serait à peine assez grand pour recevoir sa maison et sa tombe? Prennent-ils donc plaisir à voir le peuple écrasé par l'usure , quand le paiement du capital devrait l'acquitter, et forcé de livrer son corps aux verges et aux supplices? et les débiteurs adjugés et emmenés par troupeaux du forum? et les maisons des nobles remplies de prisonniers? et partout où demeure un patricien, un cachot pour des citoyens? " XXXVII. Lorsque, par la peinture de ces indignités, les tribuns eurent inspiré à la multitude, qui les écoutait et qui tremblait pour elle-même, encore plus d'indignation qu'eux-mêmes n'en ressentaient , continuèrent : « Les patriciens, disaient-il tout haut , ne cesseront d'envahir les biens du peuple, de le tuer par l'usure, si le peuple ne tire de son sein un consul qui veille sur sa liberté. On méprise désormais les tribuns du peuple, car cette puissance e brisé elle-même ses forces par son opposition. L'égalité n'est pas possible, quand l'empire est pour ceux-là et que les tribuns n'ont que le droit de défense : si on ne l'associe à l'empire, jamais le peuple n'aura dans l'état la part de pouvoir qui lui revient. Personne ne peut penser que les plébéiens doivent se contenter de leur admission aux comices consulaires; s'il n'est impérieusement établi qu'un des consuls sera pris dans le peuple, jamais ou n'aura de consul plébéien. Aurait-on déjà oublié que, depuis qu'on a jugé à propos de remplacer les consuls par des tribuns militaires, afin que le peuple pût parvenir à la dignité suprême, pas un plébéien, pendant quarante-quatre ans, n'a été nommé tribun militaire? Comment croire maintenant que, sur deux places, ils consentiront à accorder au peuple sa part d'honneur, eux qui sont habitués à occuper huit places aux élections des tribuns militaires? et qu'ils se prêtent à lui ouvrir le consulat, eux qui lui ont tenu si longtemps le tribunat fermé? Il faut obtenir par une loi ce qu'on n'aura jamais par faveur aux comices; il faut mettre hors de concours un des deux consulats pour en assurer l'accès au peuple ; car si les deux restent au concours, ils seront toujours l'un et l'autre la proie du plus puissant. A cette heure, les patriciens ne peuvent plus dire ce qu'auparavant ils ne cessaient de répéter, qu'il n'y point parmi les plébéiens d'hommes propres aux magistratures curules. La république a-t-elle été plus inhabilement ou plus mollement administrée depuis P. Licinius Calvus, premier tribun tiré du peuple, que durant ces années où les seuls patriciens ont été tribuns militaires? Bien au contraire: des patriciens ont été condamnés après leur tribunat , un plébéien jamais. Les questeurs aussi, comme les tribuns militaires, sont depuis quelques années choisis parmi le peuple, et jamais le peuple romain n'a eu lieu de s'en repentir. Il ne manque plus aux plébéiens que le consulat; c'est le rempart, c'est le couronnement de la liberté : que l'on y arrive, et alors le peuple 303 pourra vraiment croire les rois chassés de la ville, et sa liberté affermie. En effet, de ce jour, viendront au peuple tous ces avantages qui relèvent tant les patriciens : l'autorité, les honneurs, la gloire des armes, la naissance, la noblesse; et après avoir joui de ces grands biens , ils les lais-seront plus grands encore à leurs enfants. » Lorsqu'ils virent les discours de ce genre favorablement accueillis, ils publièrent un nouveau projet de loi qui remplaçait les duumvirs chargés des rites sacrés par des décemvirs moitié plébéiens, moitié patriciens. Les comices où devaient se discuter toutes ces propositions furent différés jus-qu'au retour de l'armée qui assiégeait Vélitres. XXXVIII. L'année s'écoula avant la rentrée des légions. Ainsi suspendue, celte affaire passa à de nouveaux tribuns militaires; car pour les tribuns du peuple, ils étaient toujours les mêmes, le peuple s'obstinant à les réélire, surtout les deux auteurs des projets de lois. On créa tribuns militaires T. Quinctius, Ser. Cornélius, Ser. Sulpicius, Sp. Servilius , L. Papirius, L. Véturius. Dès le commencement de l'année, on en vint, à propos de la discussion des lois, aux plus violents débats ; et, comme leurs auteurs avaient convoqué les tribus sans s'arrêter à l'opposition de leurs collègues , les patriciens alarmés eurent recours aux deux seuls moyens de salut qui leur restassent, au premier pouvoir et au premier citoyen de Rome. Ils résolurent de nommer un dictateur, et nommèrent M. Furius Camille, qui choisit pour maître de la cavalerie L. Émilius. De leur côté , les auteurs des lois, en présence de tous ces préparatifs de leurs adversaires, font, pour la cause du peuple, de nouveaux efforts de courage, et, l'assemblée convoquée, appellent les tribus à voter. Lorsque le dictateur, escorté d'une foule de patriciens. plein de colère et de menaces, fut monté sur son siége, l'affaire s'engagea par cette première lutte entre les tribuns du peuple, dont les uns proposaient la loi, tandis que les autres la repoussaient; mais si l'opposition l'emportait par le droit, elle était vaincue par la faveur qui s'attachait aux lois et à ceux qui les avaient présentées. Déjà les premières tribus avaient dit : " Ainsi que tu le requiers. " Alors Camille : « Puisqu'à présent, Romains, dit-il, c'est au caprice des tribuns et non plus à la souveraineté du tribunat que vous obéissez, et que ce droit d'opposition, conquis autrefois par la retraite du peuple, vous l'anéantissez aujourd'hui comme vous l'avez acquis, par la force; moi, dictateur, dans l'intérêt commun de la république, aussi bien que dans le vôtre, je viendrai en aide à l'opposition, et protégerai de mon autorité votre droit que l'on détruit. En conséquence, si C. Licinius et L. Sextius cèdent à l'intervention de leurs collègues, je ne ferai point intervenir une magistrature patricienne dans une assemblée populaire; mais si, en dépit de l'intervention, ils prétendent imposer ici des lois comme dans une ville prise, je ne souffrirai point que la puissance tribunitienne se détruise elle-même. " Comme, au mépris de ces paroles, les tribuns du peuple n'en poursuivaient pas moins leur opération, Camille, transporté de colère, envoya des licteurs dissiper la foule ; menaçant en outre, si on persistait, d'obliger toute la jeunesse au serment militaire, et d'emmener à l'instant cette 304 armée hors de la ville. Il avait inspiré au peuple une grande terreur : quant aux chefs, cette lutte avait plutôt ranimé qu'abattu leur courage. Mais avant que le succès se fût décidé de part et d'autre, il abdiqua sa magistrature, soit que son élection fût entachée de quelque vice, comme certains auteurs l'ont écrit, soit que les tribuns eussent proposé au peuple, lequel aurait donné son consentement, de condamner M. Furius, s'il faisait acte de dictateur, à une amende de cinq cent mille as. Mais , à mon avis, les auspices l'effrayèrent beaucoup plus que cette proposition sans exemple ; ce qui me porte à le croire, c'est d'abord le caractère même de l'homme, et ensuite la nomination d'un autre dictateur, P. Manlius, par qui il fut immédiatement remplacé : car, à quoi bon ce nouveau choix, pour une lutte où M. Furius eût déjà succombé? D'ailleurs , l'année suivante eut pour dictateur le même M. Furius, lequel certes eût rougi de reprendre une autorité qui, l'année précédente, aurait été brisée entre ses mains. De plus, au temps même où cette amende dont on parle aurait été proposée, il pouvait ou résister à cette loi, qui tendait, il le voyait bien, à réduire son autorité, ou laisser passer toutes les autres à l'occasion desquelles celle-là avait été présentée. Enfin, de tout temps et jusqu'à nos jours, depuis que les forces tribunitiennes et consulaires sont en lutte, la dictature a toujours été au-dessus de toute atteinte. XXXIX. Entre l'abdication du premier dictateur et l'entrée de Manlius eu fonctions, les tribuns ayant profité d'une espèce d'interrègne pour convoquer une assemblée du peuple, on put voir quels étaient, parmi les projets de lois, ceux que le peuple préférait et ceux que préféraient leurs auteurs. En effet, l'on acceptait les lois sur l'usure, mais on repoussait le consulat plébéien, et l'on aurait donné sur chacune de ces choses une décision conforme, si les tribuns n'eussent déclaré que le peuple devait prononcer sur le tout en même temps. P. Manlius, le dictateur, fit ensuite pencher la balance du côté du peuple, eu nommant maître de la cavalerie le plébéien C. Licinius, qui avait été tribun militaire. Le sénat, dit-on, se plaignit de ce choix : le dictateur s'excusa auprès des sénateurs sur la parenté qui l'unissait à Licinius, et en niant que la dignité de maître de la cavalerie fût supérieure à celle de tribun consulaire. Une fois les comices indiqués pour l'élection des tribuns du peuple, Licinius et Sextius firent si bien, que tout en déclarant qu'ils ne voulaient plus du tribunat, ils excitèrent vivement le peuple à leur continuer un honneur qu'ils sollicitaient jusque par leur refus hypocrite. " Depuis neuf ans déjà, ils sont là comme en bataille contre la noblesse , courant les plus grands risques personnels sans aucun profit pour la république; avec eux ont déjà vieilli et les lois qu'ils ont proposées, et toute la vigueur de la puissance tribunitienne. On a combattu d'abord leurs lois par l'intervention de leurs collègues, puis par l'envoi de la jeunesse à la guerre de Vélitres; enfin, la foudre dictatoriale a été lancée contre eux. Maintenant qu'il n'y a plus à craindre d'obstacles ni de leurs collègues, ni de la guerre, ni du dictateur, qui même a présagé le consulat au peuple, en nommant un plébéien maître de la 305 cavalerie, c'est le peuple qui se nuit à lui-même et à ses intérêts. ll ne tient qu'à lui de délivrer la ville et le forum de ses créanciers, de délivrer les champs de leurs injustes possesseurs, et cela à l'heure même. Mais ces bienfaits, quand donc enfin les appréciera-t-il avec la reconnaissance qu'ils méritent, lui qui, tout en acceptant des lois qui lui sont avantageuses, enlève l'espoir des honneurs à ceux qui les ont faites? Il serait peu généreux au peuple romain de revendiquer l'allégement de ses dettes et la mise en possession des terres que les patriciens ont usurpées, et de laisser non pas seulement sans honneurs, mais même sans espoir des honneurs, les vieillards tribunitiens qui l'ont fait réussir. Qu'ils commencent donc par bien arrêter dans leur esprit ce qu'ils veulent, et ensuite, aux comices tribunitiens, ils déclareront leur volonté. S'ils veulent accepter conjointement toutes les lois proposées, ils peuvent réélire les mêmes tribuns du peuple, car ceux-ci présenteront alors leurs propres projets de lois ; si, au contraire , ils ne veulent accueillir que ce qui peut les intéresser personnellement, il est inutile de continuer les mêmes hommes dans une dignité si mal voulue : ils renoncent au tribunat, et le peuple n'aura point les lois proposées. " XL. Pour répondre à ce discours effronté des tribuns, dont l'indigne conduite tenait dans la stupeur et le silence les autres sénateurs, Ap. Claudius Crassus, petits-fils du décemvir, voulant désabuser le peuple, s'avança, dit-on , avec plus de haine et de colère que d'espérance, et parla à peu près en ces termes : « Il ne serait point nouveau ni imprévu pour moi, Romains, de m'entendre adresser aujourd'hui encore les reproches constamment adressés à notre famille par des tribuns séditieux : « La race Claudia, dès le principe, n'a rien eu plus à coeur dans la république que la majesté des patriciens; toujours ils ont été opposés aux intérêts du peuple. " Le premier de ces reproches, je ne le repousse ni ne le désavoue : depuis que nous avons été tout ensemble admis à la cité et au patriciat, nous avons tâché que l'on pût dire avec vérité que, grâce à nous, s'était accrue plutôt qu'affaiblie la majesté de cet ordre, dans lequel nous avons été placés par vous. Quant à l'autre reproche, j'oserai, Romains, en mon nom et au nom de nies ancêtres, soutenir que jamais (à moins que des mesures avantageuses à la république tout entière ne soient estimées nuisibles au peuple, comme s'il habitait une autre ville), nous n'avons, ni dans nos relations privées, ni pendant nos magistratures, fait sciemment dommage au peuple, et qu'on ne pourrait avec vérité citer de nous un seul fait, un seul mot qui aient été contre votre intérêt, si parfois ils ont été contre vos désirs. Après tout, quand bien même je ne serais ni de la famille Claudia, ni d'un sang patricien , mais le premier Romain venu, pourvu que je connusse que je suis né d'un père et d'une mère libres et que je vis dans une cité libre , pourrais-je nie taire? Souffrirais-je en silence que ce L. Sextius et ce C. Licinius, tribuns à perpétuité, s'il plaît aux dieux, aient pris depuis neuf ans qu'ils règnent un tel empire, qu'ils refusent de vous ac- 306 corder le libre droit de suffrage dans les comices et pour l'acceptation des lois? C'est sous condition, disent-ils, que nous consentirons à être réélus tribuns une dixième fois. Qu'est-ce à dire, sinon : ce que les autres recherchent, nous en faisons un tel mépris que , sans un grand avantage, nous ne l'accepterons point? " Mais enfin quel est cet avantage , moyennant lequel nous pourrons vous avoir à jamais tribuns du peuple? " C'est disent-ils, que nos propositions, quelles vous plaisent ou vous déplaisent, vous servent ou vous nuisent, soient toutes acceptées par vous. " Je vous en conjure, tribuns du peuple, vrais Tarquins, supposez à ma place un citoyen qui, du milieu de l'assemblée, vous crie : Avec votre bon plaisir, qu'il nous soit permis de choisir dans vos projets de lois ceux que nous croirons salutaires pour nous et de rejeter les autres. Non, disent-ils, cela ne se peut. Tu voterais les lois sur l'usure et sur les terres qui vous conviennent à tous, et jamais, ce qui serait à Rome un vrai prodige, Lu ne voudrais voir consuls L. Sextius et ce C. Licinius que tu as en horreur, en abomination ! Ou prends tout ou je n'accorde rien. C'est présenter à celui que la faim presse du poison avec du pain, et lui enjoindre de ne pas toucher à l'aliment qui le fera vivre, ou d'y mêler ce qui doit lui donner la mort. En vérité, Sextius, si cette ville était libre, est-ce que de toutes parts on ne t'aurait pas crié : Va-t'en d'ici avec tes tribunats et tes projets de lois! Comment ! si tu te refuses à présenter des lois utiles au peuple, il n'y aura personne qui les présente? Si un patricien, si un Claudius (ce qui, selon eux, est pire encore) venait dire : " Ou prenez tout ou je n'accorde rien " qui de vous. Romains, le souffrirait? Ne mettrez-vous donc jamais les choses devant les hommes? Prêterez-vous toujours une oreille facile à tout ce que diront vos tribuns, pour la fermer quand parlera quelqu'un des nôtres? Mais par Hercule! ce langage n'est pas d'un bon citoyen. Eh bien! la proposition qu'ils s'indignent de vous voir repousser, Romains, est tout à fait conforme à ce langage. Je demande, dit Sextius, qu'il ne vous soit pas permis de faire consuls qui bon vous semble. Car, n'est-ce pas là ce qu'il demande, lui qui vous ordonne de choisir un des consuls parmi le peuple, en vous ôtant le pouvoir de nommer deux patriciens ! Qu'aujourd'hui vienne une guerre , comme celle des Étrusques, alors que Porsena prit pied au Janicule, ou comme naguère celle des Gaulois , quand tout ici, moins le Capitole et la citadelle, était à l'ennemi , et que ce L. Sextius briguât le consulat en concurrence avec M. Furius ou tout autre patricien, pourriez-vous souffrir que L. Sextius fût assuré d'être consul , et que Camille eût à lutter contre un refus? Est-ce là mettre les honneurs en commun, que d'autoriser la nomination de deux plébéiens au consulat, et non pas celle de deux patriciens? que de vouloir qu'un plébéien soit nécessairement appelé à l'une des deux places, et de permettre que les patriciens soient exclus de toutes deux? Quel est ce nouveau partage, cette nouvelle communauté? C'est peu pour toi que de venir au partage d'un droit auquel tu n'avais point jusqu'ici participé; faut-il encore qu'en réclamant cette part tu emportes le tout? Je crains, dit-il, que s'il est permis de nommer deux patriciens , vous ne 307 nommiez jamais un plébéien. N'est-ce pas dire : Comme jamais, de votre propre gré, vous n'éliriez des indignes, je vous imposerai la nécessité d'élire ceux que vous ne voulez pas? Que s'ensuit-il, sinon que le plébéien qui aura seul concouru avec deux patriciens ne devra aucune reconnaissance au peuple, et pourra se dire nommé par la loi, non par vos suffrages? XLI. " Ils cherchent moins à solliciter qu'à extorquer les honneurs, et ils obtiendront ainsi les plus hautes charges, sans vous devoir rien, pas même ce qu'ils vous devraient pour les moindres; ils aiment mieux tenir les honneurs de circonstances étrangères que de leur propre mérite. Ainsi, voilà quelqu'un qui refuse de se laisser examiner, apprécier; qui trouve juste d'avoir pour lui les honneurs à coup sûr, quand tous les autres luttent pour les conquérir; qui s'affranchit de votre choix ; qui veut rendre vos suffrages obligatoires et esclaves, de spontanés et libres qu'ils sont. Je laisse de côté Licinius et Sextius, dont vous comptez les années de perpétuel pouvoir, comme celles des rois au Capitole : quel est aujourd'hui dans Rome le citoyen si humble à qui cette loi ne donne un plus facile accès au consulat qu'à nous et à nos enfants? Car, le voulussiez-vous , vous ne pourriez pas toujours nous élire, au lieu que vous devrez élire ceux-ci, alors même que vous ne le voudriez pas. C'en est assez sur l'inconvenance de cette mesure (car la convenance ne regarde que les hommes); mais que dirai-je de la religion et des auspices, dont la violation est un mépris, un outrage direct aux dieux immortels? C'est par les auspices qu'a été fondée cette ville ; c'est par les auspices qu'en paix et en guerre, au dedans et au dehors, se règlent toutes choses: qui est-ce qui l'ignore? Or, d'après la coutume de nos ancêtres, en quelles mains sont les auspices? aux mains des patriciens, ce me semble; car on n'a recours aux auspices pour la nomination d'aucun magistrat plébéien. Les auspices nous sont tellement propres, que non seulement le peuple, s'il crée des magistrats patriciens, ne peut les créer autrement qu'avec les auspices , mais que nous- mêmes, avec les auspices, nous nommons un interroi, sans avoir besoin du suffrage du peuple, et que nous avons, pour notre usage privé, les auspices qu'ils n'ont pas même pour leurs magistratures. N'est-ce donc pas abolir dans cette cité les auspices que de les ravir, en nommant consuls des plébéiens aux patriciens qui seuls ont droit de lès avoir? Qu'ils se jouent maintenant de nos pratiques religieuses. Qu'importe que les pou-lets ne mangent pas? qu'ils sortent trop tard de la cage? ou comment un oiseau chante? Ce sont là des misères! mais c'est en ne méprisant aucune de ces misères que nos ancêtres ont fait si grande cette république. Aujourd'hui , comme si désormais nous n'avions plus besoin d'être en paix avec les dieux, nous profanons toutes les cérémonies. Qu'on choisisse donc dans la foule les pontifes, les augures, les rois des sacrifices; mettons sur la tête du premier venu, pourvu que ce soit un homme , l'aigrette du flamine ; livrons les anciles, les sanctuaires, les dieux et le culte des dieux à des mains sacrilèges ; plus d'auspices pour la présentation des lois, pour l'élec- 308 tion des magistrats ; que les comices par centuries et par curies puissent se réunir sans l'approbation du sénat! Que Sextius et Licinius, comme Romulus et Tatius, règnent dans la ville de Rome, puisqu'ils donnent pour rien et l'argent et les terres d'autrui ! Il est doux de piller le bien des autres ! et l'on ne songe pas qu'une de ces lois porte dans les campagnes la dévastation et la solitude, en chassant de leurs domaines les anciens maîtres, et que l'autre abolit la bonne foi, avec qui périt toute société humaine ! Par tous ces motifs, je suis d'avis que vous repoussiez les lois proposées. Quoi que vous fassiez, veuillent les dieux vous être favorables! " XLII. Le discours d'Appius ne servit qu'a reculer l'époque de l'acceptation des lois. Réélus tribuns pour la dixième fois, Sextius et Licinius firent recevoir la loi qui créait pour les cérémonies sacrées des décemvirs en partie plébéiens : on en choisit cinq parmi les patriciens et cinq parmi le peuple; et l'on put croire que c'était un pas de fait dans la voie du consulat. Content de cette victoire, le peuple accorda aux patriciens que, sans s'occuper de consuls pour le moment, on nomme-rait des tribuns militairês. On nomma A. et M. Cornélius pour la seconde fois, M. Géganius, P. Manlius, L. Véturius, P. Valérius pour la sixième. A l'exception du siége de Vélitres, dont le dénouement était plus tardif que douteux, au dehors les affaires de Rome étaient tranquilles, quand, le bruit d'une iri uption des Gaulois, tout à coup répandu, détermina la cité à créer pour la cinquième lois M. Furius dictateur; celui-ci nomma T. Quinctius Pennus maître de la cavalerie. Ce fut celte année, selon Claudius, qu'on livra bataille aux Gaulois près du fleuve Anio, et qu'eut lieu sur un pont ce combat remarquable, dans lequel T. Manlius, provoqué par un Gaulois, marcha à sa rencontre à la vue des deux armées, le tua et le dépouilla de son collier. Des autorités plus nombreuses m'amènent à croire que ces choses se passèrent au moins dix ans plus tard ; quant à cette année, ce fut dans la campagne d'Albe que le dictateur M. Furius en vint aux mains avec les Gaulois. Quoique le souvenir de leur ancienne défaite, eût laissé aux Romains une vive appréhension de ce peuple, la victoire ne fut pour eux ni incertaine ni difficile. Plusieurs milliers de Barbares furent massacrés dans la plaine, plusieurs lors de la prise du camp; les autres, en désordre, gagnèrent pour la plupart l'Apulie; et, grâce à l'éloignement du lieu où ils avaient fui, non moins qu'au trouble et à la frayeur qui les avaient dispersés de côté et d'autre, on ne put les atteindre. Du consentement du sénat et du peuple, on décerna le triomphe au dictateur. A peine avait-il mis fin à cette guerre, qu'une sédition plus terrible l'accueillit dans Rome. Le dictateur et le sénat, ayant succombé dans une lutte violente, les lois tribunitiennes furent adoptées, et, en dépit de la noblesse, s'ouvrirent des comices consulaires, dans lesquels, pour la première fois, un plébéien, L. Sextius, fut créé consul. Les débats ne cessèrent point pour cela; car les patriciens refusant d'approuver l'élection, le peuple fut sur le point d'en venir à une retraite, après avoir fait 309 d'ailleurs d'effroyables menaces de guerre civile. Le dictateur offrit des conditions qui apaisèrent les discordes : la noblesse accorda au peuple un consul plébéien, et le peuple à la noblesse un préteur chargé d'administrer la justice dans Rome, et choisi parmi les patriciens. Ainsi, après de longues querelles, la paix se rétablit entre les ordres; et le sénat, estimant qu'en aucune circonstance on ne pouvait rendre aux dieux un hommage plus mérité, décréta que les grands jeux seraient célébrés, et qu'on y ajouterait un quatrième jour; mais comme les édiles du peuple reculaient devant cette charge, les jeunes patriciens s'écrièrent qu'ils l'acceptaient volontiers pour honorer les dieux immortels, et que, dans ce but, ils se faisaient édiles. On leur adressa d'universelles actions de grâces, et un sénatus-consulte enjoignit au dictateur de demander au peuple la création de deux édiles patriciens , et l'approbation du sénat pour tous les comices de l'année. Dans ce livre Tite-Live ne cite nominativement que Claudius, dont il rejette la narration ( voyez le dernier chapitre). Il a eu cependant sous les jeux un plus grand nombre d'auteurs, car il remarque souvent leurs dissentiments, Voyez. ch. II, IX, XII, XXXVIII, XLII. Souvent aussi il a consulté tous ceux qu'il avait sous la main, puisqu'il affirme ou que les auteurs s'accordent (ch. XII) ou bien que tous se taisent sur tel fait ( ch. XX ). Il est vrai que dans ce dernier exemple le fait en question se trouve raconté par Zonaras, VII, 24 ; mais ce récit paraît n'avoir pris naissance que plus tard; et ce qui y donna probablement lieu, c'est que Manlius habitait au Capitole, et qu'il fut précipite de cet endroit. Peut-être Tite-Live contredit-il ce bruit populaire, parce qu'il n'est appuyé sur aucune autorité. Dans le dissentiment des auteurs il choisit quelquefois une opinion, sans mentionner les divergences ( Conf. Plut. Camill., ch. XXXVI, les ch. XV et suiv. de ce livre et les trois récits divers de Diodore XIV, 117; Plut. ch. XXXIV, Tite-Live ch. II). Quelquefois il suit l'opinion du plus grand nombre et des plus anciens, de Fabius, par exemple (cf. infra ). Ainsi au ch. II il laisse de côté un récit fabuleux, emprunté sans doute aux traditions religieuses (Plutarque, 33; Varron, L. L. p. 47), poursuivre l'opinion sur laquelle, suivant Plutarque (ch. XXXVI), s'accordaient la plupart des auteurs; lui-même, au chap. XLII, dit s'en rapporter au récit qui a pour lui les autorités les plus nombreuses. Dans le chapitres I on reconnaît deux sources différentes ; l'une qui place le jour d'Allia avant le 15 des calendes de Sextilis, qui fut la journée meure de la bataille; l'autre, suivant laquelle le 17 des calendes serait aussi un jour néfaste, parce que les auspices ayant été défavorables ce jour-là, la bataille fut néanmoins livrée trois jours après, le 15 des calendes. CHAP. I. — Quae ab condita urbe... pleraque interiere. Voyez la réfutation de ce passage, p. 759 et suiv. IBID. — Aeque eum abdicare se dictatura, nisi anno circumacto, passi sunt. Les commentateurs ne sont pas d'accord sur le sens de ce passage. Suivant les uns, Camille aurait exerce la dictature un an entier. Les autres prétendent qu'il l'exerça seulement pendant le reste de l'année civile, à la fin de laquelle il sortit de charge avec les autres magistrats. Cette dernière interprétation n'est pas contrariée par le passage suivant de Plutarque (Camille, ch. XXI) : φοβηθεῖσα τὸν θόρυβον ἡ βουλὴ τὸν μὲν Κάμιλλον οὐκ εἴασε βουλόμενον ἀποθέσθαι τὴν ἀρχὴν ἐντὸς ἐνιαυτοῦ, καίπερ ἓξ μῆνας οὐδενὸς ὑπερβαλόντος ἑτέρου δικτάτορος. Elle est pleinement justifiée par la création des interrois, dont il est question plus loin; création qui ne pouvait avoir lieu que pour suppléer à l'absence de toute magistrature curule. IBID. — Interregnum initium P. Cornelius Scipio interrex, et post eum M. Furius Camillus. ls tribunus militum consulari potestate erat. On a suivi le teste de Drakenborch; seulement après Camillus on a retranché iterum, qui se lit il est vrai dans tous les manuscrits, mais qui est assez difficile à expliquer. Au reste, le traducteur n'a pas suivi ce texte, mais bien celui qu'a adopté M. Lemaire :« Interregnum iniit tum P. Cornelius Scipio interrex, et post eum M. Furius Camillus. iterum is tribunus militum... » IBID. — Tum de diebus religiosis agitari coeptum. On trouve sur l'établissement des jours religieux quelques détails dans deux fragments de Cassius Hemina et de Verrius Flaccus, qui nous ont été conservés, l'un par Macrobe (Saturn., liv. I, ch, XVI ), l'autre par Aulu-Gelle (l. X, ch. XVII). Voici le récit de Verrius Flaccus: Urbe . « Gallis Senonibus recuperata, L. Attilius in senatu verba fecit, L. Sulpicium tribunum militum, ad AIliam adversus Gallos pugnaturum, rem divinam dimicandi gratia postridie idus fecisse : tum exercitum populi romani occidione occisum, et post diem tertium a ejus diei urbem proeter Capitolium captam esse; compluresque alii senatores recordari sese dixerunt, quotiens belli gerendi gratia res divina postridie kalendas, nonas, idus, a magistratu populi romani facta essent, ejus belli proximo deinceps proelio rem publicam male gestam esse. Tum senatus eam rem ad pontifices rejecit, ut ipsi quod videretur, statuerent. Pontifices decreverunt, nullum iis diebus sacrificium recte futurum. » Le récit de Cassius Hemina ne diffère pas essentiellement de celui de Verrius Flaccus; seulement il attribue à un haruspice, L. Aquinius, appelé dans le sénat sur la proposition des tribuns militaires, les paroles prêtées par Verrius à L. Attilius. Voyez d'ailleurs Plutarque (Quæstion. roman. n. XXV), sur les motifs qui ont fait placer au nombre des jours religieux les lendemains des calendes, 835 des nones et des ides. Aulu Gelle loc. cit. et I. IV, ch. IX) remarque qu'Il ne faut pas, comme le vulgaire ignorant, confondre les jours religieux malheureux (religiosi infausti ), avec les jours néfastes (nefasti). Les jours, chez les Romains, furent d'abord divisés en jours fastes et jours néfastes, permis et défendus; c'es-à-dire en jours destinés aux affaires et en jours destines au repos. Pendant les jours néfastes, l'action des tribunaux était suspendue; c'est ce qui Ovide exprime par ce vers : Ille nefastus erit, per quem tria verba silentur. Fast., I, 47. Ces trois mots, qu'il ne désigne pas, caractérisaient les différentes fonctions du préteur, c'étaient do, dico, addico. Tant que duraient ces jours, tout acte public était défendu; on ne pouvait porter aucune loi, ni assembler le peuple, ni nommer les magistrats. On les désignait sur les calendriers par la lettre N; les jours fastes étaient marques par la lettre F. Il y avait encore des jours mixtes qu'on appelait dies intercisi parce qu'ils ne pouvaient élite fastes que pendant l'espace intermédiaire de l'immolation de la victime et de l'offrande des entrailles : inter caesa et porrecta, dit Varron ( L. L. I, 31, p. 61 Egger ). On appelait jours religieux ( Aulu-Gelle, ibid.) ceux qui, ayant été marques par quelque grande calamite publique, avaient été déclarés par les pontifes religiosi infansti, atri. Sur les fastes publies, ils étaient marques avec de la craie et du charbon. Pendant ces jours on devait s'abstenir d'offrir des sacrifices et d'entreprendre aucune affaire. Ils étaient donc néfastes aussi, mais tous les jours néfastes n'étaient pas religieux. CHAP. II. — Ad fanum Voltumnae.... (Voyez p. 820, col. 1 ) Voltumna, dans le temple de laquelle se tenaient les assemblés générales de la confédération étrusque, et dont le nom et le caractère rappellent une épithète et une attribution communes de Jupiter et de Minerve (Βοθλαῖος et Βουλαία, de Βουλή, consilium, d'où Βουλευτής, qui, avec la terminaison passive en ουμενα, aurait forme Voltumna), paraît avoir été la même que la Conso des Romains, déesse des conseils publics et protectrice des sénateurs (Creuzer, Symbolique, traduct. de M. Guigniaut, tome 1, deuxième partie, p. 483 ).
IBID. — Seniores... in verba sua jurantes
centuriaret. Il les enrôla dans les centuries, c'est-à-dire parmi les
fantassins. Les cavaliers étaient divisés par décuries. On trouve dans
Aulu-Gelle, liv. XVI, ch. IV, une ancienne formule de serment militaire, qu'il
avait lui-même extraite du cinquième livre de l'ouvrage de Cincius Alimeatus,
sur l'art militaire. La voici : CHAP. V. — Tribus quatuor ex novis civibus additœ, Stellalina, Tromentina, Sabatina, Arniensis : eaeque vitginti quinque tribuum numerum explerere. La tribu Stellatine tirait son nom de la plaine de Stellate, en Étrurie, entre Capène et Veies; la Sabbatine, du lac Sabbatin, aussi en Étrurie, et la Tromentine, du territoire de Tromente. Quant à la tribu Arnienne, son nom a donné lieu à de nombreuses contestations; les uns l'ont appelée Armensis, d'autres, et parmi eux Doujat (ed. ad usum Delphini ), Axiensis ; d'autres enfin Narsiensis. C'est cette leçon, qu'ont suivie Crevier et Dureau-de-Ia-Malle. Cependant Drakenborch, et avant lui Clavier ( Ital. ant., l. II, ch. III ), avaient prouvé jusqu'à l'évidence que le véritable nom de cette tribu ne pouvait être qu'Arniensis, et ils le font venir du fleuve Arnus, en Étrurie. Le nombre des tribus, fixé à vingt par la constitution de Servius Tullius, fut porté à vingt et une par l'adjonction de la tribu Claudia, l'année de la mort de Tarquin. Nous le voyons ici de vingt-cinq; plus tard il s'éleva jusqu'à trente-cinq, limite qu'il ne dépassa pas. CHAP. VI. — Tertius exercitus ex causariis senioribussque. On appelait causarii les citoyens que des causes légitimes exemptaient du service militaire. Ces causes étaient assez nombreuses : celaient l'âge, un privilège accorde pour quelque grand service rendu à l'état, comme on en voit un exemple dans la personne de P. Aebatius, liv. XXXIX, ch. XIX ; (voyez aussi liv. XXIII, ch. XX, une exemption de ce genre, mais pour cinq ans seulement, accordée aux soldats de Préneste); c'étaient encore certaines dignités, comme les magistratures, les sacerdoces; l'éméritat, ou l'accomplissement des années de service auxquelles on était oblige par la loi ; enfin les maladies, les vices de conformation. Les colons maritimes étaient aussi exempts du service militaire, et leur exemption était qualifiée de sacrosancta (voy.l. XXVII, ch. XXXVIII). Cependant, dans certaines circonstances impérieuses, comme celles où se trouvait la république à l'époque où nous sommes parvenus, on n'avait égard à aucune exemption, et les causarii étaient enrôlés comme les autres citoyens (voyez liv. VII, ch. XXVIII, et l. Vlll, ch. XX). Les guerres contre les Gaulois étaient toujours au nombre de ces circonstances exceptionnelles ( voyez Cicer., Pro Fonteio, n. XIX; Philipp., n. XIX, et Plutarque, Vie de Camille, 41 ad fin. ed. Reisk. ). Au reste, quand les censarii étaient appelés à faire comme les autres le service militaire, on leur en réservait toujours le partie la moins pénible. CHAP. IX. — Legiones urbanae, quibus Quinctius praefuerat Nous avons vu, chap. VI, que Quinctius commandait l'armée composée des causarii et des vieillards. Il n'est pas probable qu'on ait choisi cette armée pour la donner à Camille tandis que, sous les ordres de Q. Servilius, il y 836 en avait une autre composée de soldats jeunes et valides, et dont on pouvait également disposer. Il semblerait donc convenable de substituer ici, dans le texte, Q. Servilius à Quinctius. Cependant, un peu plus bas, c'est bien Quinctius et non Q. Servilius qu'on envoie prendre le commandement de l'armée laissée par Camille chez les Volsques. Ce passage ne peut s'expliquer qu'en supposant, avec Gronove, que les généraux avaient changé d'armée, et que Q. Servilius avait pris celle de Quinctius, et Quinctius celle de Q. Servilius. CHAP. XI. — Solens eum in magistratibus, solum apud exercitus esse.
Mes bienfaits vous font peur, et d'un esprit
tranquille LAFOSSE, Manlius Capitolinus, act, I, sc. III. CHAP. XI. - Ipse armatus capientesgue arcem. Dans le traduction de cette phrase, il s'est glissé une faute d'impression : lisez tout armés au lieu de tout rames. Dans les lignes suivantes, illius gloriae pars virilis apud omnes milites, Tite-Live a indiqué une idée que Cicéron avait développée sous toutes ses faces, et avec une admirable éloquence, dans son discours pour Marcellus. CHAP. XII.— Quae nunc servitia romana ab solitudine vindicant. Au temps où Tite-Live écrivait, et déjà même bien auparavant, dans les campagnes d'Italie, le nombre des esclaves surpassait de beaucoup celui des hommes libres. Cela tenait à trois causes principales: l'agglomération de toutes les terres entre les mains d'un petit nombre de possesseurs qui les faisaient cultiver par des esclaves; l'émigration de la plus grande partie de la population pauvre ou peu aisée, attirée à Rome par les distributions de blé qu'on y faisait au peuple ; enfin la dispersion des citoyens dans l'immense étendue de l'empire. On se fera une idée de l'importance de cette dernière cause de de population pour l'Italie, si l'on se rappelle que, dans la seule province d'Asie, et seulement quarante ans après la soumission de cette contrée, Mithridate put faire égorger un nombre de citoyens romains que Valère-Maxime évalue à quatre-vingt mille, et qui s'élevait à cent soixante mille, si l'on en croit Plutarque et Dion Cassius. Au reste, les premiers empereurs, effrayés de la diminution progressive de la population libre en Italie, et de l'accroissement du nombre des esclaves, essayèrent à plusieurs reprises d'y remédier (voy. Suétone, Caes., 42, et Aug. 42); mais leurs efforts furent vains : le mal alla encore en augmentant, au point que le sénat ayant pense, dit Sénèque (de Clement., liv. I, ch. XXIV ), à distinguer les esclaves par un habit particulier, fut oblige d'y renoncer, à cause des dangers qui eussent menacé l'empire, s'ils eussent pu se compter. CHAP. XII. — Libraque et aere liberatum emittit. « Manlius achète, par le cuivre et la balance, les droits du créancier sur son débiteur, auquel il donne ensuite la liberté. La vente par le cuivre et la balance se consommait ainsi : le peseur public tenait un balance, en présence de cinq témoins, tous citoyens romains et en âge de puberté; l'acheteur, tenant une pièce de monnaie d'airain, prononçait cette formule :. « Hunc ego hominem ex jure Quiritium meum esse aio, isque mihi emptus est hoc aere æneaque Iibra. » Ensuite il frappait la balance avec la pièce de monnaie, qu il remettait au vendeur. comme prix de son acquisition. Cette coutume avait pris son origine dans le temps où les Romains pesaient le cuivre, faute de monnaie.. CREVIER. — Voyez, dans la note sur le ch. XXXIV, les droits que la loi accordait au créancier sur son débiteur. CHAP. XII. — Thesauros gallici auri occultari a Patribus. « Ce qui pouvait, dit Rollin (Hist. rom.., tome II, p. 526 ) donner quelque ombre de vraisemblance au reproche calomnieux de Manlius, lorsqu'il accusait les sénateurs de cacher l'or des Gaulois, c'est ce que Tite-Live rapporte dans le livre précèdent, ch. L, qu'on avait placé sous le piédestal de la statue de Jupiter l'or enlevé aux Gaulois. » Nous avons reconnu dans une note du livre précédent ( p. 852 et suiv. ), que Camille n'avait pu reprendre aux Gaulois l'or qu'ils avaient reçu pour la rançon du Capitule. Faudra-t-il donc aussi rejeter comme également faux, et les reproches adresses par Manlius aux patriciens, et le fait rapporte par Tite-Live, livre V, chapitre L, et la tradition qui, suivant Pline, hist. nat., livre XXXIII, chap. V, attribuait cette origine aux deux mille livres d'or enlevées par M. Crassus du temple de Jupiter? Nous ne le pensons pas: Niebuhr (hist. rom., t. IV, p. 350 de la tr. fr. ) donne de tous ces faits une explication fort simple, la voici : « Pour contenter l'ennemi, on aura pris l'or des temples du Capitole, et on aura fait vœu de le rendre au double. On prétend que, pour payer la rançon, on leva une taxe de propriété (« cum conferendum ad redimendum a Gallus civitatetn aurum fuerit, tributo collationem faciam . » mais cette taxe, impossible à percevoir dans la détresse où l'on était, aura bien pu être imposée plus tard, pour restituer avec usure ce qu'on avait pris dans les sanctuaires. CHAP. XV. — Agmine ingenti... venit... hinc senatus, hinc plebs, etc.
Et quels soupçons surtout ne doit pas faire naître
LAFOSSE, Manlius Capitolinus, act. I, sc. III. IBID. — Jam sibi ex favore mulititudinis crimen et perniciem quaeri. VALERIUS.
Jusqu'à quand voulez-vous, si prompt, si
redoutable 837 MANLIUS.
Et quels moyens, seigneur, de guérir vos soupçons?
LAFOSSE, Manlius Capitolinus, act. I, ac. III. IBID. — Sortem aliquam ferte. C'est la leçon de tous les manuscrits et des plus anciennes éditions; c'est celle qu'a suivie Gronove et qu'ont adoptée après lui MM. Lemaire et Liez. Ils l'expliquent comme dans notre traduction : « Demandez-nous enfin un capital quelconque, et ne changez pas incessamment vos réclamations en y ajoutant tous les jours de nouveaux intérêts. Cependant, il faut l'avouer, le sens donné à ferle dans cette explication n'est pas très satisfaisant Cette difficulté arrêta de bonne heure les commentateurs; aussi dès 1551, Frobein substitua-t-il aliam à aliquam. Sa leçon, qui des lors fut reçue dans tous les textes, a été adoptée par Drakenbocth, qui l'explique ainsi : « Mais pourquoi vous exhorte je a rien sacrifier de ce qui vous appartient? acceptez d'autres conditions ; retranchez du capital, etc. » Il s'appuie sur ce que, dans les manuscrits, alius et aliquis sont très souvent confondus, et justifie d'ailleurs le sens donne par lui à sortem et à ferte par de nombreux exemples pris, et dans Tite Live lui-même, et dans les écrivains du même siècle; il a été suivi par Crévier et Dureau de la Malle. Doujat, dans son édition ad usum Delphlni, tout en adoptant le texte des manuscrits, dit qu'on pourrait l'expliquer d'une autre manière: « Supportez aussi, dit suivant lui Manlius aux patriciens, supportez aussi votre part des malheurs publics; venez en aide aux plébéiens, retranchez du capital de leurs dettes, etc. CHAP. XVII.— Voces exprobrantium, multltudini quod dflensores suos, etc.
Un peuple variable, incertain et timide, LAFOSSE, Manlius Capitolinus, act. I, sc. III. CHAP. XX. — Ne fratres quidem... homines prope quadraginlos... dona...
Tandis que tout se tait, jusqu'à vos propres
frères, LAFOSSE, Manlius Capitolinus,act. V, sc. I. CHAP. XX. — Dum murales coronas, civicas octo. Il y avait plusieurs espères de couronnes militaires. « Les plus honorables, dit Aulu-Gelle (N. A., V, 6 ), sont celles que l'on nomme triomphales, obsidionales, civiques, murales, castrales et navales. On cite encore la couronne ovale ; la dernière de toutes est celle d'olivier, qui se donne à ceux qui, sans s'être trouvés au combat, procurent le triomphe au vainqueur. Les couronnes triomphales sont des couronnes d'or, qu'on envoie aux généraux pour s'en parer à leur triomphe; c'est ce qu'on appelle aurum coronarium. Dans les premiers temps elles étaient de laurier; depuis on les fit d'or. « La couronne obsidionale est celle qui est offerte par des assiégés au général qui les a délivrés. Elle est de gazon cueilli dans le lieu où les assiéges étaient enfermés. « On appelle couronne civique celle que reçoit comme un témoignage de reconnaissance un citoyen de la main d'un autre citoyen à qui il a sauvé la vie dans un combat. Elle est faite de feuilles de chêne ou d'yeuse.... « La couronne murale est celle que décerne un général à celui qui le premier s'est présenté à l'assaut et a escaladé les murailles d'une ville ennemie; c'est pourquoi elle est ornée de créneaux, « On appelle castrale la couronne qu'un général décerne au soldat qui a pénétré le premier, en combattant, dans le camp ennemi. Elle est surmontée d'ornements en forme de retranchements. « La couronne navale se donne à celui qui, dans un combat sur mer, s'est le premier élancé avec ses armes sur un vaisseau ennemi. Elle est ornée de proues. « Les couronnes murale, castrale et navale, sont en or. La couronne orale n'est que de myrrhe; elle ornait le front des généraux qui rentraient en ville avec les honneurs de l'ovation. » Pline (Hist. nat., Iiv. VIl, ch. XXVIII) dit qu'avant sa dix septième année Manlius avait enlevé deux dépouilles; qu'il fut le premier chevalier auquel on donna une couronne murale; qu'il obtint six couronnes civiques, trente-sept récompenses militaires; qu'il reçut vingt trois blessures par devant, et sauva P. Servilius, maître de la cavalerie, quoique blessé lui-même à l'épaule et à la cuisse. IBID. — Tribuni de saxo Tarpeio dejecerunf. Denys, Plutarque et Varron, cité par Aulu-Gelle, N. A, livre XVII, ch. XXI, sont ici d'accord avec Tite-Live. Des termes de Dion-Cassius (fr. XXXI, ed. Reimar) comparés à ceux de Zonaras et de Diodore de Sicile (XV, 25), on tire. un autre récit qui n'est pas non plus sans vraisemblance. Manlius, voyant qu'il ne pouvait échapper aux efforts que le sénat faisait pour le perdre, se serait décidé à risquer le tout pour le tout, et se serait emparé du Capitole. Abandonné alors par les plébéiens de distinction, il aurait accueilli un esclave, qui, paraissant s'être glissé à travers les postes du dictateur, lui promettait l'appui de ses pareils, parmi lesquels, disait-il, une conjuration s'était formée. Manlius se promenait sans défiance avec lui sur le bord du précipice, lorsque le traître se serait jeté sur lui et l'aurait poussé dans l'abîme. Voyez Niebuhr, Hist. rom. t. IV, p. 411 de la tr. fr. — D'après un fragment de Cornélius Nepos que nous a conservé Aulu-Gelle ( loc. cit. ), Manlius aurait péri par les verges. IBID. — Hunc exitum habuit vir, nisi in libera civitate natus esset. memorabilis. « Les hommes qui vivent en société, sous quelque forure de gouvernement que ce 838 soit, ont besoin d'être ramenés souvent à eux-mêmes, ou aux principes de leurs institutions, par des accidents externes ou internes. Quant à ces derniers, ils sont de deux sortes: ou il faut qu'ils soient l'effet d'une loi qui oblige tous les citoyens à rendre souvent compte de leur conduite, ou c'est un homme qui, par l'excellence de son caractère et la supériorité de ses vertus, supplée à ce que la loi n'a pas opéré. Ainsi le retour au bien, dans une république, dépend ou d'un homme ou d'une loi. Les lois dont les Romains se servirent pour ramener la république à son principe furent celle qui créa des tribuns du peuple, celle qui nomma des censeurs, et toutes celles tendant à réprimer l'ambition et l'insolence. « Pour donner de la vigueur et de la vie à ces sortes d'établissements, il faut un homme vertueux qui puisse opposer son courage à la puissance des transgresseurs. Les exemples les plus remarquables de pareils coups frappés par cette autorité sont, après la prise de Rome, la mort de M. Manlius Capitolinus, celle du fils de Manlius Torquatus ; la punition infligée par Papirius Cursor à Fabius, son maître de la cavalerie, et l'accusation des Scipion. Ces événements, aussi terribles qu'éloignés des règles ordinaires, n'arrivent jamais sans ramener les hommes au premier principe de la république. Quand ils commencèrent à devenir plus rares, ils laissèrent à la corruption le temps de faire plus de progrès, et ne purent avoir lieu eux-mêmes qu'en devenant plus dangereux et s'opérant avec plus de tumulte.... « L'exemple de Manlius prouve combien les plus belles qualités, les plus grands services rendus à l'état, sont effacés par cette affreuse ambition de régner. On voit qu'elle eut sa source, chez Manlius, dans la jalousie qu'il conçut des honneurs accordés à Camille. Il fut tellement aveuglé par cette passion, que sans examiner l'état des moeurs de Rome, sans s'apercevoir que le sujet sur lequel il avait à opérer n'était pas encore apte à recevoir une forme de gouvernement vicieuse, il se mit à exciter des troubles contre le sénat et contre les institutions de son pays, C'est à cette occasion que se fit sentir l'excellence des lois et de la constitution de Rome. A l'instant de sa chute, pas un de ces nobles si ardents à se soutenir et à se défendre réciproquement entre eux, ne fit un mouvement pour le servir; pas un de ses parents ne fit une démarche en sa faveur; et tandis que les autres accusés voyaient leur famille en deuil, les cheveux couverts de poussière, et avec tout l'extérieur de la plus profonde tristesse, se montrer avec eux pour exciter la commisération du peuple, Manlius ne vit aucun des siens paraître avec lui. Les tribuns, si accoutumés à favoriser tout ce qui paraissait à l'avantage du peuple, et dont l'intérêt était d'autant plus marqué qu'il paraissait nuire à la noblesse, les tribuns dans cette occasion se réunissent aux nobles contre cet ennemi commun. Enfin le peuple, qui avait montré d'abord tant de faveur à Manlius, au moment où celui-ci est cité par les tribuns, qui portent sa cause à son tribunal, ce môme peuple, de défenseur devenu juge, sans aucun ménagement le condamne au dernier supplice. « J'avoue que je ne crois pas qu'il y ait de fait dans l'histoire qui prouve plus l'excellence de la constitution romaine que celui où l'on voit un homme doué des plus belles qualités, qui avait rendu les services les plus signalés et au public et aux particuliers, ne trouver, dès qu'il devient coupable, personne qui fasse le plus petit mouvement pour embrasser sa défense. C'est que l'amour de la patrie avait dans tous les coeurs plus de pouvoir qu'aucun autre sentiment. Ayant plu d'égard aux dangers présents, auxquels l'ambition de Manlius l'avait exposée qu'a ses services passés, Renie ne vil que sa mort pour se délivrer de ces dangers. « Telle fut, dit Tite-Live, la fin de cet homme, qui eût été recommandable s'il ne fût pas né dans un pays libre. » « Sans contredit, si Manlius fût né au temps de Marius et de Sylla, où les coeurs étaient déjà corrompus et où il eût pu les diriger d'après son ambition, il aurait eu les mêmes succès que Marius, Sylla et tous ceux qui depuis aspirèrent à la tyrannie; et si Marius et Sylla eussent vécu au temps de Manlius, ils eussent échoué comme lui. Car un homme peut bien par sa conduite et ses manières criminelles commencer à corrompre un peuple; mais il est impossible que sa vie soit assez longue pour qu'il puisse en recueillir le fruit; et quand bien même ce temps lui suffirait pour réussir, le caractère naturellement impatient des hommes, qui ne peuvent souffrir de retard dans leurs jouissances, serait un obstacle à ses succès, en sorte que, par trop d'empressement ou par erreur, on le verrait à contretemps tenter son entreprise et y échouer. » ( MACHIAVEL, Discours sur la première dérade de Tite-Live; liv. III, c. I et VII, trad. de Guirodet. ) Voici le jugement que porte sur Manlius un ancien historien latin, Q. Clandius Quadrigarius, dans un fragment qui nous a été conserve par Aulu-Gelle ( XVII, 2 ). « Nam M. Manlius, quum Capitolium servasse a Gallis supra ostendi, cujusque operam cum M. Furio dictatore apud Gallos comprime fortem atque exseperabilem respublica sensit, is et genere, et vi, et virtute bellica nemini concedebat simul forma, factis, eloquentia, dignitate, acrimonia, confidentia pariter praecellebat : ut facile intelligeretur magnum viaticum ex se atque in se ad rempublicam evertendam habere. » « Car M. Manlius, qui sauva des Gaulois le Capitole, comme je l'ai montré plus haut, et dont l'activité, secondée par M. Furius, dictateur, se montra merveilleusement forte et insurmontable contre eux, au profit de la république, ne le cédait à personne en naissance, en vigueur, en vertu guerrière Il se faisait également remarquer par sa taille, sa bravoure, son éloquence, sa dignité, sa sévérité, son assurance, en sorte qu'il était facile de voir qu'il avait par lui et en lui de puissantes ressources pour le renversement de la république. » ( Trad. de M. Armand Cassan, Lettres inéd. de Fronton et Mare-Aurèle ). Case. XXIX.-- Eae quoque expugnatæ. Niebuhr (t. II, p. 661; t. IV, p. 379 de la tr. fr.) combat à tort Tite-Live au sujet de la prise de Vélitres. Il s'appuie du témoignage de l'ancienne inscription citée plus bas par notre auteur; or ce monument est au contraire favorable à l'historien romain. Tite-Lirv en effet dit que Velitres fut prise avec huit autres villes, et c'est aussi ce qu'affirme Paul Diacre (II, 1 ). De plus, il remarque expressément que Préneste ne fut pas enlevée de vive force, mais qu'elle se rendit; d'où l'on peut conclure que Velitres était comprise dans les neuf villes prises d'assaut. Si Tite-Live, dans son récit, ne parle d'abord que de huit villes, c'est qu'il veut distinguer Vélitres, et insister sur sa conquête. C'est à tort aussi que Wachsmuth ( De aeltere Geschichte des roem. Staates, p. 416 ) avance que l'inscription ne mentionnait que neuf villes, car Tite-Live, se contentant de donner le sommaire de ce monument, n'avait pas besoin d'ajouter que Préneste se rendit le dixième jour, ou bien que les neuf villes avaient été prises en neuf jours, comme le voudrait Heusinger, dont la conjecture oppida 839 novem diebus novem, ne paraît pas nécessaire. La principale difficulté, élevée par Niebuhr, tient à ce que Vélitres est prise ici sans grand'peine par les Romains, tandis que dans la suite toute la puissance romaine échoua devant cette place durant plusieurs années. Mais rien n'empêche d'admettre que les Veliterniens, ayant recouvré leur indépendance à la faveur des troubles de Rome, fortifièrent leur ville avec plus de soin et, s'étant mis à l'abri d'une nouvelle surprise, opposèrent à une seconde attaque une résistance longue et opiniâtre. Cf., ch. XXXVI. CHAP. XXXIV. — In orbe vis patrum in dies miseriaeque plebis crescebant. Nous ne pouvons nous refuser ici au plaisir de citer quelques belles pages où M. Michelet a éloquemment exprimé cette misère du peuple romain : le lecteur y trouvera d'ailleurs les principaux traits de la législation des douze tables au sujet des débiteurs. La connaissance de ces lois jettera de vives lumières sur plusieurs passages de ce livre, qui, sans cela, présenteraient de sérieuses difficultés. « Voyons quelle était à Rome la situation des plébéiens. Le cens du consul Valerius Publicola donna cent trente mille hommes capables de porter les armes, ce qui ferait supposer une population de plus de six cent mille antes, sans compter les affranchis et les esclaves. Il fallait que cette multitude tirât sa subsistance d'un territoire d'environ treize lieues carrées. Nulle autre industrie que l'agriculture; entouré des peuples ennemis, les terres étaient exposées à de continuels ravages, et la ressource incertaine du butin enlevé à la guerre ne suffisait pas pour les compenser. La guerre ôte plus au vaincu qu'elle ne donne au vainqueur, quelques gerbes de blé que rapportait le plébéien ne compensaient pas la perte de sa chaumière incendiée, de ses charrues, de ses bœufs, enlevés l'année précédente par les Èques ou les Sabins. Lorsqu'il rentrait dans Rome, vainqueur et ruiné, et que ses enfants l'entouraient en criant pour avoir du pain, il allait frapper à la porte du patricien ou du riche plébéien, demandait à emprunter jusqu'a la campagne prochaine, promettant d'enlever aux Volsques ou aux Étrusques de quoi acquitter sa dette, et hypothéquant sa première victoire. Cette garantie ne suffisait pas ; il fallait qu'il engageât son petit champ, et le patricien lui donnait quelque subsistance, en stipulant le taux énorme de douze pour cent par année. Depuis l'institution des comices par centuries, le pouvoir politique ayant passe de la noblesse à la richesse, l'avidité naturelle du Romain fut stimulée par l'ambition, et l'usure était le seul moyen de satisfaire cette avidité. La valeur du champ engagé était bientôt absorbée par les intérêts accumulés. La personne du plébéien répondait de la dette, quand on dit la personne du père de famille, on dit sa famille entière; car sa femme, ses enfants ne sont que ses membres. Dès lors il pouvait encore voler au forum, combattre à l'armée; il n'en était pas moins nexus, lie; ce bras qui frappait l'ennemi, sentait déjà la chaîne du créancier. La terrible diminutio capitis était imminente. Le malheureux allait, venait, et déjà il était mort. Enfin l'époque fatale arrive. Il faut payer. La campagne n'a pas été heureuse. L'armée rentre dans Rome. Que deviendra le plébéien ? Les douze tables donnent la réponse ; elles n'ont fait que consacrer les usages antérieurs. Écoutons ce chant terrible de la loi (lex horrendi carminis erat ). TITE-LIVE. « Qu'on l'appelle en justice ! s'il n'y va, prends des témoins, contrains-le. S'il diffère et veut lever le pied, mets la main sur lui. Si l'age ou la maladie l'empêche de comparaître, fournis un cheval, mais point de« litière. Eh quoi I le malheureux est revenu blesse dans Rome; son sang coule pour le pays, le jetterez-vous mourant sur un cheval? n'importe, il faut aller. Il se présente au tribunal avec sa femme en deuil et ses enfants qui pleurent. » « Que le riche réponde pour le riche; pour le prolétaire, qui voudra. — La dette avouée, l'affaire jugée, a trente jours de délai. Puis, qu'on mette la main sur lui, qu'on le mène au juge. — Le coucher du soleil ferme le tribunal. S'il ne satisfait pas au jugement, si personne ne répond pour lui, le créancier l'emmènera et l'attachera avec des courroies ou avec des chaînes qui pèseront quinze livres; moins de quinze livres, si le créancier le veut. — Que le prisonnier vive du sien. Sinon, donnez-lui une livre de farine, ou plus, à votre a volonté. » Grâce soit rendue à l'humanité de la loi ! elle permet au créancier d'alléger la chaîne et d'augmenter la nourriture; elle lui permet bien d'autres choses en ne les défendant pas; et les fouets, et l'humidité d'une prison ténébreuse et la torture d'une longue immobilité... J'aime encore mieux m'arrêter dans l'horreur de ce cachot, que de chercher ce qu'est devenue la famille de ce pauvre misérable, esclave aujourd'hui comme lui, heureux si, par une émancipation prudente, il a su préserver à temps ses enfants. Sinon, leur père pourra, de l'ergastulum obscur où ou le retient, les entendre crier sous le fouet, ou peut-être, au milieu des derniers outrages, l'appeler à leur secours... « S'il ne s'arrange point, tenez-le dans les liens soixante jours; cependant produisez-le en justice par trois jours de marché, et là, publiez à combien se monte la dette. » Hélas! lorsque l'infortune sortira des tortures du cachot pour subir le grand jour et l'infamie de la place publique, ne se trouvera t-il donc personne pour l'arracher à ces mains cruelles? « Au troisième jour de marché, s'il y a plusieurs créanciers, qu'ils coupent le corps du débiteur. S'ils coupent plus ou moins qu'ils n'en soient pas responsables. S'ils veulent, ils peuvent le vendre à l'étranger au delà du Tibre. » Ainsi, dans Shakspeare, le juif Shylock stipule, encas de non paiement, une livre de chair à prendre sur le corps de son débiteur. » (Histoire romaine, liv. I, ch. 2, t. I, p. 155 et suiv., 2e edit. ). Il paraît difficile d'admettre que le ternie secanto de la loi des douze tables, ait été jamais pris dans le sens que M. Michelet lui donne, d'après Aulu-Gelle. Si la prescription de la loi eût été aussi cruelle, l'occasion n'eût pas manqué à Tite-Live d'en tirer des mouvements oratoires; or il n'y fait pas une seule allusion. Du reste le sens prêté à secare n'est pas le seul dont il soit susceptible. Dans Cicéron sector indique l'acheteur. Voyez Philipp., II, 26: pro Rosc. Amer., XXIX; de Invent., I, 45; Asconius, sur Cic. in Verr., II, 1, 20, ne laisse aucun doute à cet égard. On peut donc penser que par secanto la loi prescrivait uniquement le partage des biens du débiteur; et, ce qui porterait encore a préférer ce sens, c'est qu'elle autorise plus bas à vendre le prisonnier au delà du Tibre. Elle n'avait donc d'autre objet que de satisfaire l'avidité et l'avarice des créanciers. CHAP. XXXIV. — Quum ad id, moris ejus insueta, expavisset minor Fabia, risui sorori fuit... nupta in domo, quam nec honos, nec gratia intrare posset. Cette petite aventure n'est rien moins que vraisem- 840 blable. La jeune Fabia avait pu s'habituer au bruit du licteur dans la maison de son père. D'ailleurs de ce que son mari, Licinius Stolon, était plébéien, il ne s'ensuivait pas qu'elle dût désespérer d'entendre un jour ce bruit chez elle : il y avait vingt quatre ans que le peuple était admis au partage du tribunat militaire; le père de Licinius avait été deux fois élevé à cette dignité (l.V, ch. XVIII et XX), et son grand-père, P. Licinius Calvus, était le premier de son ordre qui en eût été revêtu (l. V, ch. XII ). Du reste rien ne prouve que cette anecdote, dont Beaufort ( de l'Incert., Il, c. 10,) et Niebuhr (t. III, 2; t. V, p. 3, tr. fr. ) ont démontré la fausseté, soit empruntée à des annales plus récentes, car Tite-Live la donne comme authentique. Il faut en voir l'origine dans la haine des patriciens qui la répandirent de bonne heure, afin de dissimuler leur défaite, en assignant aux rogations de Licinius Stolon une cause aussi puérile. La famille Licinia est une de celles qui fournirent le plus de grands hommes à la république. Trois de ses branches se sont surtout illustrées, les Crassus, les Lucullus, les Murena. CHAP. XXXV. — Creatique tribuni C. Licinius et L. Sextius. Dodwell intercale ici une année à laquelle il donne, pour tribuns militaires avec puissance de consuls, L. Papirius, L. Menenius, Ser. Sulpicius, Serv. Cornelius, qu'il trouve mentionnes dans Diodore pour la première année de la cent troisième olympiade. Voyez, au reste, dans son ouvrage mime les raisons qu'il développe, pour justifier sa conjecture. Dissert. X, de Cyclis Romanorum, sect. 82. CHAP. XLI. — Omitto Licinium Sextiumque, quorum annos in perpetua potestate, tanquam regum in Capitolio, numeratis. Ce passage a été expliqué de différentes manières, par les commentateurs. Les uns out vu, dans ces mots, in Capitolio une allusion aux fastes capitolins, les autres au lieu où se tenaient alors les comices tribuniciennes. J. Gronove pense qu'il faut les retrancher du texte où ils ont pu, dit il, être ajoutés par un copiste qui aura trouvé que la phrase ne finissait pas d une manière harmonieuse. Suivant M. Lemaire, qui adopte l'explication de Gisb. Cuper, Tite-Live aurait eu en vue les statues des rois, qui, au rapport de Pline, XXXIII, 1 et de Dion Cassius, XLIII, se trouvaient au Capitole, et sur les piédestaux desquelles était gravée la durée des différents règnes. Or, les années pendant lesquelles Licinius et Sextius avaient exercé le tribunat, se suivaient sans interruption, comme celles de ces règnes; on pouvait donc aussi les compter en se servant de l'adjectif numéral avec le mot annos (novem annos), au lieu de l'adverbe terminé en um, nonum, dont on se servait ordinairement. Crevier, qui ponctue différemment, et place la virgule après regum, au lieu de la placer après Captlolio, pense qu'il s'agit ici des clous que l'on enfonçait tous les ans dans le mur de droite du temple de Jupiter, et qui servaient, dit-on, à compter les années. Il faudrait alors traduire ainsi: « Je laisse de côté Licinius et Sextius; vous pouvez compter au Capitole les années de leur pouvoir perpétuel comme celui des rois. » Mais il est constant que ces clous n'étaient pas une indication chronologique et n'avaient qu'un objet purement religieux. Voy. M. Leclerc, ouv. cit. p. 69. IBID. — Quid enim, si pulli non pascentur. Benjamin Constant, dans son ouvrage sur le polythéisme romain, l. XII, ch. I, fait allusion ace passage de Tite-Live. « Tite-Live, dit-il, ne peut s'empêcher de parler avecun sourire involontaire des pratiques relatives aux poulets sacrés; mais tout à coup il se le reproche, et, reprenant une gravité forcée : » c'est en ne méprisant pas ces pratiques, dit-il, que nos ancêtres ont rendu la république glorieuse. On voit qu'il aimerait à rendre hommage aux institutions de Numa; mais, après les avoir décrites avec éloge, il les fait redescendre, maigre lui, jusqu'au rang subalterne d'un calcul. Il appelle la religion un moyen efficace de subjuguer une multitude ignorante et féroce. « La crainte des dieux, dit-il, ne peut s'emparer des âmes sans quelque supposition de miracle. Numa feignit donc des entrevues secrètes avec Égérie; et, comme il est beau de pouvoir à volonté . suspendre les assemblées populaires, et frapper le peupie d'immobilité, il inventa les jours fastes et néfastes (l. I, ch. XIX.) » Ainsi chaque pratique, chaque rite, chaque tradition, chaque article de loi est analysé, expliqué, dépouillé de tout prestige. On croit defendre la religion en indiquant son but, et l'on ne sait pis qu'en lui donnant un but hors d'elle-même, on porte la hache à la racine de l'arbre dont on veut sauver les rameaux. » CHAP. XLI. — Apicem dialem. « Apex, du vieux mot latin apere, lier, signifie une petite branche d'arbre, de ceux qu'on appelait felices, laquelle s'attachait avec de la laine sur le bonnet du flamine. Le fil de laine s'appelait apiculus. Souvent apex se prend, comme ici, pour le bonnet lui-même. » CREVIER. CHAP. XLIi. — Bellatum cum Gallis. Pour le récit des combats entre les Romains et les Gaulois ou ne peut prouver le défaut de sincérité des sources où a puisé Tite-Live, et l'on n'est pas fondé à invoquer contre lui le silence de Polybe, qui ne parle que des incursions des Gaulois coutre les Romains; incursions qui, suivant lui, n auraient pas été repoussées. Polybe ne donne de cette guerre qu'un abrogé fort succinct. De plus les calculs chronologiques prouvent qu'il a omis plusieurs faits. Dans le compte qu'il a soin de toujours donner des années écoulées dans l'intervalle d'une expédition à l'autre, il manque huit années. Il arrive en effet au nombre quatre-vingt-dix-neuf; tandis qu'il s'est réellement écoulé un intervalle de cent dix-sept ans depuis la prise de Rome jusqu'a la mort du consul Lucius. Niebuhr (t. III, p. 87 ; t. V, p. 104, tr. fr.) dit à ce sujet : « On doit à Polybe une foi entière pour son temps; mais il n'en est pas de même dans des époques plus anciennes, pour lesquelles il a dû chercher dans les annales, au risque d'omettre les faits d'une année, comme cela paraît lui être arrivé pour la dictature de 394 ( 396 ). IBID. — Pluribus auctoribus magis adducor. Tite-Live rejette le récit de Claudius et adopte une version plus accréditée, Les annaies variaient en ce que, suivant les unes, le premier combat, celui de l'année 388, fut livré sur les bords de l'Anio, tandis que le second, celui de I'année 394., eut lieu près d'Albe. Telle était l'opinion suivie par Claudius Quadrigarius, Plutarque et Polybe qui toutefois omet le combat peu important de l'Anio. Suivant d'autres ( Tite-Live, Denys, etc. ), le premier combat fut celui d'Albe, et le second celui de l'Anio. Le changement d'armes, la mention du vin d'Albe, et d'autres détails, qu'on trouve dans Denys d'Halicarnasse, prouvent que les annales étaient sur ce point plus explicites que ne l'est Tite-Live, dont la brièveté en cet endroit doit s'expliquer par son empressement habituel d'arriver à la fin du livre. C'est pour cela aussi que les grandes et dernières luttes 841 entre les patriciens et les plébéiens, qui assurèrent It triomphe définitif des lois Liciniennes, sont à peine indiquées. CHAP. XLI.— L. Sextius de plebe, primus consul factus. Dans la dernière partie de ce livre Tite-Live suit surtout Fabius, ou du moins son système chronologique. De la prise de Rome par les Gaulois à la création des premiers consuls plébéiens il y a vingt-deux ans, selon le revit de Tite-Live ( cl. Perizonius Animadv. Hist., c. ult., p. 462). C'était l'opinion de Fabius Aulu-Gelle, V. 6). Suivant d'autres, cet intervalle était de vingt-trois ans, et dans la vingt-quatrième même se plaçait le consulat plébéien. C'est ce dernier système qu'adopte Tite-Live dans le livre suivant, mettant ainsi sa narration en désaccord avec celle du sixième livre; soit qu'il l'ait empruntée à d'autres annales, soit qu'il ait eu des fastes différents sous lev yeux. Ainsi l. V il, ch I, il dit que Camille vécut vingt-cinq ans après la prise de Rome. S'il en est ainsi, les consuls plébéiens de l'année précédente ont été en charge pendant la vingt-quatrième année, et durent par conséquent être désignés la vingt-troisième. C'est ainsi encore que dans le même livre, ch. XVIII, à la fin de l'an 400, il compte trente-cinq ans depuis l'incendie de Rome, et onze depuis l'institution du consulat plébéien; ce qui place cette institution à la vingt-quatrième année qui suivit la prise de Rome. CHAP. XLII. — Quum tamen per dictatorem conditionibus sedatae discordiae sunt. « Ce fut, dit Plutarque, en terminant la biographie de Camille, le dernier acte de sa vie publique. L'année suivante, une maladie contagieuse exerça sur Rome ses ravages; une multitude infinie de citoyenus, et parmi eux beaucoup de magistrats, en furent victimes; Camille fut du nombre. A ne considérer que son âge, et sa vie comblée d'honneurs, sa mort ne fut certainement pas prématurée. Cependant elle affligea plus les Romains, à elle seule, que toutes celles qu'ils eurent à déplorer dans ces tristes circonstances. » IBID. — Ut ludi maximi fierent, et dies unus ad triduum adjiceretur. Il s'agit ici des féries latines, dont il a été question dans le livre précédent, ch. V. Le témoignage de Plutarque ne laisse aucun doute à cet égard; ταῖς δὲ καλουμέναις Λατίναις μίαν ἡμέραν προσθέντας ἑορτάζειν τέτταρας, παραυτίκα δὲ θύειν καὶ στεφανηφορεῖν Ῥωμαίους ἅπαντας. (Vie de Camille, 55, ed. Reisk. ) Il ajoute que Camille fut reconduit chez lui aux applaudissements du peuple tout entier, et que, pour rendre grâces aux dieux de la réconciliation des deux ordres de l'état, on décida qu'un temple serait élevé a la Concorde, selon le voeu qu'en avait fait ce grand homme, de manière à dominer le lieu où s'assemblaient les comices.
|