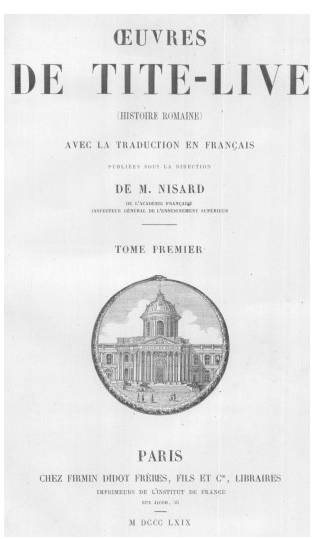|
ALLER A LA TABLE DES MATIERES DE TITE-LIVE TITE-LIVE Ab Urbe Condita, Livre III
Collection des Auteurs latins sous la direction de M. Nisard, Oeuvres de Tite-Live, t. I, Paris, Firmin Didot, 1864
110 LIVRE TROISIÈME. SOMMAIRE.— Troubles causés par les lois agraires — Le Capitole tombé au pouvoir d'esclaves et de bannis est délivré, et ceux-ci massacrés. Deux dénombrements; le premier présente cent quatre mille deux cent quatorze citoyens, sans compter les célibataires des deux sexes; le second cent dix-sept mille deux cent dix-neuf. — Revers éprouvés contre les Èques.— L. Quinctius Cincinnatus, nommé dictateur, est tiré de la charrue pour conduire cette guerre. Il bat les ennemis et les fait passer sous le joug. — On augmente le nombre des tribuns du peuple, que l'on porte à dix, trente-six ans après la création de cette magistrature. — Des députés vont recueillir et apportent à Rome les lois d'Athènes. On charge de les rédiger et de les promulguer des décemvirs, qui remplacent les consuls, et tiennent lieu de tous les autres magistrats; ainsi, l'an 103 de la fondation de Rome, le pouvoir qui avait passé des rois aux consuls passe des consuls aux décemvirs. — Ils rédigent dix tables de loi, et la douceur de leur administration fait conserver pour l'année suivante cette forme de gouvernement. — Ils ajoutent deux nouvelles tables aux premières, abusent de leur pouvoir, refusent de s'en dépouiller, et le conservent une troisième année, jusqu'à ce que l'incontinence d'Appius Claudius mette un terme à leur odieuse domination. — Épris d'une jeune fille, il aposte un de ses affidés pour la réclamer comme son esclave, et réduit Virginius, père de cette infortunée, à l'égorger avec un couteau saisi dans une boutique voisine, seul moyen de sauver sa fille du déshonneur. — Le peuple soulevé par ce cruel abus de pouvoir se retire sur l'Aventin, et force les décemvirs d'abdiquer. — Appius, et le plus coupable de ses collègues, après lui, sont jetés en prison; exil des autres. — Victoires sur les Sabins, les Èques et les Volsques. — Décision peu honorable du peuple romain; choisi pour arbitre entre Ardée et Aricie, il s'adjuge le territoire que ces deux villes se disputaient. I. [1] Après la prise d'Antium, Titus Aemilius et Quintus Fabius sont faits consuls. Ce Fabius Quintus était le même qui seul avait survécu à la destruction de sa famille à Crémère. [2] Déjà, dans un premier consulat, Aemilius avait proposé de distribuer des terres au peuple; aussi, lors de son second consulat, on vit se ranimer l'espérance des partisans de la loi agraire : les tribuns, certains de l'emporter, puisque cette fois le consul est pour eux, renouvellent des tentatives qui si souvent avaient échoué devant l'opposition des consuls. Aemilius n'avait pas changé de sentiment. [3] Les possesseurs des terres et la majorité des patriciens se plaignirent qu'un chef de l'État s'associât aux poursuites tribunitiennes, et achetât la popularité par des largesses prodiguées aux dépens d'autrui; ils détournèrent sur le consul tout l'odieux que ces menées avaient excité contre les tribuns. [4] Un conflit terrible allait éclater, si Fabius, par un expédient qui ne blessait aucun des deux partis, n'eût terminé la querelle. L'année précédente, sous la conduite et les auspices de Titus Quinctius, on avait enlevé aux Volsques une portion de leur territoire : [5] Antium, ville voisine, favorablement située sur le bord de la mer, pouvait recevoir une colonie : il était donc facile de donner des terres au peuple, sans exciter les cris des propriétaires, sans troubler la paix de Rome. [6] L'avis de Fabius est adopté. Il crée triumvirs Titus Quinctius, Aulus Verginius et Publius Furius chargés de faire le partage On invite ceux qui veulent des terres à donner leurs noms. [7] Mais, dès lors, comme toujours 111 il arrive, l'abondance fit naître le dégoût, et si peu se firent inscrire qu'on fut obligé de leur adjoindre des Volsques pour compléter la colonie. Les autres, en grand nombre, aimèrent mieux solliciter des terres à Rome que d'en obtenir ailleurs. [8] Les Èques demandaient la paix à Quintus Fabius qui s'était avancé contre eux avec une armée; ils ne tardèrent pas à rendre eux-mêmes cette paix illusoire par une subite incursion sur les terres des Latins. II. [1] L'année suivante, Quintus Servilius [il était consul avec Spurius Postumius] fut envoyé contre les Èques. Il établit sur le territoire des Latins un camp retranché, où son armée, attaquée par les maladies, fut retenue dans un repos forcé. [2] La guerre se prolongea trois ans, jusque sous le consulat de Quintus Fabius et de Titus Quinctius. Sans y être appelé par la voie du sort, Fabius, qui avait donné la paix aux Èques après les avoir vaincus, reçut alors ce commandement. [3] Parti avec la ferme confiance qu'au seul bruit de son nom les Èques poseraient les armes, il envoya des députés à l'assemblée de leur nation, avec ordre de leur dire : « Le consul Fabius déclare que, si naguère du pays des Èques il a porté la paix à Rome, il revient aujourd'hui de Rome apporter la guerre aux Èques, de cette même main qu'il leur avait une fois tendue en signe de paix, et qui maintenant a ressaisi les armes. [4] Les dieux savent de quel côté sont les parjures et les traîtres; ils les voient, et leur vengeance ne se fera point attendre. Toutefois, il en est temps encore, que les Èques, par leur repentir, préviennent les calamités de la guerre : c'est le vœu du consul. [5] Si leur repentir est sincère, ils trouveront un refuge assuré dans cette clémence qu'ils ont déjà éprouvée; mais, s'ils se complaisent dans leur parjure, ce sera moins leurs ennemis que les dieux irrités qu'ils auront à combattre. » [6] Loin de se laisser émouvoir par ces paroles, les Èques faillirent maltraiter les délégués du consul, et envoyèrent vers l'Algide une armée contre les Romains. [7] Dès que ces nouvelles furent connues à Rome, l'indignation, bien plus que la crainte du péril, fit sortir de Rome l'autre consul; et les deux armées consulaires marchèrent à l'ennemi en ordre de bataille, pour combattre sur-le-champ. [8] Mais il se trouva que le jour était déjà sur le déclin; et une voix s'écria des postes avancés de l'ennemi : « C'est faire une vaine parade de vos forces, Romains, ce n'est point là faire la guerre : [9] vous vous rangez en bataille à la nuit tombante; il nous faut une plus longue journée pour le combat qui se prépare. Demain, au lever du soleil, revenez en bataille : il y aura de quoi combattre, soyez tranquilles. » [ 10] Le soldat, que ces paroles ont irrité, est ramené dans le camp jusque au lendemain. Il trouvait longue cette nuit qui différait le combat. Cependant il prend de la nourriture et du repos. Le lendemain au point du jour, l'armée romaine devance l'ennemi de quelques instants sur le champ de bataille. Les Èques se présentent enfin. [11] De part et d'autre on combattit avec acharnement. La colère et l'indignation animent les Romains; le sentiment des périls que leur faute avait appelés sur eux, et le désespoir d'inspirer désormais aucune confiance poussaient les Èques à tout oser, à tout entreprendre. [12] Néanmoins ils ne purent soutenir le choc des Romains. Vaincus et forcés de se retirer sur leur territoire, leurs esprits n'en furent pas plus enclins à la paix; 112 une multitude indomptable reprochait à ses chefs d'avoir commis la fortune de leurs armes à une bataille rangée, où la tactique romaine devait l'emporter. [13] Les Èques étaient plus propres à ravager, par des incursions, le pays ennemi; une foule de petits corps détachés leur était plus favorable à la guerre que la lourde masse d'une armée. III. [1] Ils quittent donc leur camp après en avoir confié la garde à un simple détachement, et se jettent avec tant d'impétuosité sur le territoire de Rome que la terreur se répand jusque dans la ville. [2] Cette attaque imprévue causait d'autant plus d'effroi que la dernière crainte possible était qu'un ennemi vaincu, presque assiégé dans son camp, songeât à un coup de main. [3] Les paysans épouvantés encombraient les portes et signalaient à grands cris, non point une simple incursion et la présence de quelques bandes de pillards, mais, comme la peur grossit les objets, c'était toute l'armée, toutes les légions ennemies qui, prêtes au combat, venaient fondre sur Rome. [4] Ces bruits confus, et dont le vague laissait un vaste champ à l'exagération, volent de bouche en bouche. Le mouvement, le bruit de ceux qui criaient aux armes rappelaient l'épouvante d'une ville prise d'assaut. [5] Heureusement le consul Quinctius, revenu de l'Algide, se trouvait à Rome; sa présence porta remède à l'effroi. Il dissipe le trouble en reprochant aux Romains de craindre un ennemi vaincu. Il place des piquets à toutes les portes. [6] Il convoque le sénat, proclame en son nom la suspension de toutes les affaires, et confie à Quintus Servilius le commandement de la ville pour courir à la défense du territoire; mais il n'y rencontra plus d'ennemis. [7] Son collègue y avait mis bon ordre. Posté de manière à leur couper la retraite, il s'était jeté sur cette troupe embarrassée dans ses manœuvres par le butin dont elle s'était chargée, et lui avait fait chèrement expier ses dévastations. [8] Peu échappèrent à cette surprise; on reprit tout le butin; et le consul Quinctius, par son retour à Rome, rendit aux affaires leur marche quatre jours suspendue. [9] On fit ensuite le cens et Quinctius ferma le lustre. Le dénombrement donna cent vingt-quatre mille deux cent quatorze [ou 104.714] citoyens, non compris les hommes et les femmes sans enfants. [10] Aucun autre événement remarquable ne signala cette guerre. Les Èques s'enfermèrent dans leurs places fortes, souffrant que les Romains portassent autour d'eux le feu et le pillage. Le consul, après avoir, à diverses reprises, promené les ravages de son armée sur tout le territoire ennemi, rentra dans Rome comblé de gloire et de butin. IV. [1] Les consuls de l'année suivante furent Aulus Postumius Albus et Spurius Furius Fuscus. Pour Furius, on écrit quelquefois Fusius. Je fais cette remarque pour empêcher qu'un changement de noms ne fasse supposer un changement de personnes. [2] Il était hors de doute que l'un des consuls irait faire la guerre aux Èques. Ceux-ci donc demandèrent des secours aux Volsques d'Écétra, qui s'empressèrent de leur en accorder, tant ces nations mettaient, à l'envi, de persévérance à poursuivre les Romains de leur haine; dès lors les préparatifs de la guerre furent poussés avec la plus grande vigueur. [3] Les Herniques apprennent et dénoncent à l'avance aux 113 Romains la défection d'Écétra et sa connivence avec les Èques. La colonie d'Antium elle-même inspirait des soupçons. Lors de la prise de cette ville, un grand nombre de ses habitants s'étaient réfugiés chez les Èques, qui durant toute cette guerre n'eurent pas de meilleurs soldats. [4] Après la retraite des Èques dans leurs places fortes, cette multitude dispersée était revenue à Antium, où elle acheva d'aliéner les esprits déjà hostiles aux Romains. [5] Ils en étaient encore à mûrir leurs projets, lorsque le sénat, sur l'avis qu'il se tramait une trahison, chargea les consuls de mander à Rome les chefs de la colonie, pour apprendre d'eux ce qu'il en était. [6] Ceux-ci obéirent sans difficulté; introduits dans le sénat par les consuls, ils répondirent aux questions qu'on leur posa, de manière à s'en retourner plus suspects qu'ils n'étaient venus. [7] Dès lors la guerre ne fut plus douteuse. Spurius Furius, l'un des consuls, à qui ce commandement était échu, marcha contre les Èques, et rencontra l'ennemi occupé à ravager les terres des Herniques. Ignorant à quelle multitude il avait affaire, car on ne l'avait encore vue nulle part réunie, il engage imprudemment le combat avec une armée inférieure en forces. [8] Repoussé au premier choc, il se retire dans son camp; mais il n'était pas au terme de ses périls. La nuit suivante et le lendemain, le camp se trouva si étroitement investi et pressé avec tant de vigueur, qu'il ne fut pas même possible d'envoyer un courrier à Rome. [9] On y apprit des Herniques la défaite du consul et le siège de l'armée consulaire. L'effroi fut si grand dans le sénat, que par un décret, signal ordinaire d'une extrême détresse, il chargea Postumius, l'autre consul, « de veiller à ce que la république n'essuyât aucun dommage. » [10] On jugea que le plus sage était de garder à Rome le consul pour enrôler tout ce qui pouvait porter les armes, d'envoyer à sa place Titus Quinctius secourir le camp avec une armée d'alliés, [11] et, pour la former, d'exiger que les Latins, les Herniques et la colonie d'Antium fournissent à Quinctius des « subitaires » , comme on appelait alors ces auxiliaires improvisés. V. [1] Cependant des mouvements nombreux, des attaques multipliées s'exécutaient de tous côtés, et les ennemis, à la faveur de la supériorité du nombre, cherchaient à entamer sur divers points les forces romaines, convaincus qu'elles ne pourraient suffire à tout. [2] Ainsi, pendant qu'on assaillait le camp, une partie de l'armée se détachait pour ravager le territoire romain, et brusquer, si le hasard lui était favorable, une tentative sur Rome elle-même. [3] Lucius Valérius demeura pour garder la ville, et l'on envoya le consul Postumius repousser du territoire les ravages de l'ennemi. [4] Nulle part les soins et les travaux ne se ralentirent un instant. On plaça des sentinelles dans la ville, des détachements devant les portes, des gardes sur les remparts; et, ce qui était indispensable dans un péril si grand, la suspension des affaires fut ordonnée pour plusieurs jours. [5] Cependant le consul Furius, qui d'abord avait tranquillement souffert qu'on l'assiégeât dans son camp, se précipite par la porte décumane sur un ennemi qui n'est point sur ses gardes. Il pouvait le poursuivre; mais il s'arrête, de peur qu'on ne force le camp 114 d'un autre côté. [6] Furius, lieutenant et frère du consul, se laisse emporter trop loin, et, dans l'ardeur de la poursuite, ne voit ni la retraite des siens ni le mouvement de l'ennemi sur ses derrières. Coupé, il fait de nombreux mais inutiles efforts pour se frayer un chemin vers le camp, et, les armes à la main, tombe dans la mêlée. [7] Le consul, à la nouvelle que son frère est enveloppé, retourne au combat : il se précipite avec plus d'ardeur que de prudence au milieu du danger, reçoit une blessure, et c'est à peine si ceux qui l'entourent parviennent à l'enlever. Ce malheur jette le trouble dans l'esprit de ses soldats, et redouble l'ardeur des ennemis. [8] La mort du lieutenant et la blessure du consul les enflamment au point de rendre toute résistance impossible aux Romains, qui, refoulés dans leur camp, s'y voient assiégés de nouveau, mais avec des espérances et des forces bien moindres. Le salut général allait être compromis, lorsque arriva Titus Quinctius avec l'armée étrangère des Latins et des Herniques. [9] Il attaqua sur leurs derrières les Èques, dont l'attention se tournait alors vers le camp des Romains, auxquels, dans leur farouche orgueil, ils montraient la tête du lieutenant Furius. En même temps, à un signal qu'il a donné de loin, on exécute du camp une vigoureuse sortie, et les forces nombreuses de l'ennemi se trouvent enveloppées. [10] Le carnage fut moins grand, mais la déroule des Èques plus complète sur le territoire de Rome. Épars, ils emmenaient leur butin, lorsque Postumius fondit sur eux de divers points avantageux où il avait posté des troupes. Ces vagabonds fuyant en désordre donnent dans l'armée de Quinctius qui, triomphant, ramenait le consul blessé. [11] C'est alors que l'armée consulaire, dans un combat brillant, vengea la blessure du consul, le massacre de son lieutenant et de ses cohortes. Ces journées furent désastreuses aux deux partis. [12] Il est difficile, pour des événements si loin de nous, de préciser avec exactitude le nombre des combattants et celui des morts. Valérius d'Antium, cependant, n'hésite point dans ses calculs. [13] Selon lui, les Romains perdirent cinq mille huit cents hommes chez les Herniques; les Èques deux mille quatre cents de ces pillards qui ravageaient le territoire de Rome, et qui furent taillés en pièces par le consul Aulus Postumius; mais cette multitude chargée de butin, que rencontra Quinctius, essuya une bien autre perte : il en périt, dit-il, en poussant jusqu'à la minutie la précision du nombre, quatre mille deux cent trente. [14] Quand l'armée fut de retour à Rome et le cours des affaires repris, on vit quantité de feux briller dans le ciel; d'autres prodiges s'offrirent aux yeux ou frappèrent, sous des formes imaginaires, des esprits effrayés. Pour calmer les craintes, on ordonna trois jours de fête pendant lesquels une foule d'hommes et de femmes ne cessa de remplir les temples, implorant la clémence des dieux. [15] Après quoi, le sénat renvoya dans leurs foyers les cohortes des Latins et des Herniques, non sans leur avoir décerné des actions de grâces pour leur active coopération à la guerre. Les mille soldats d'Antium, dont le secours tardif n'était arrivé qu'après le combat, furent congédiés en quelque sorte avec ignominie. VI. [1] On assemble ensuite les comices; Lucius Aebutius et Publius Servilius, désignés consuls, entrent en 115 charge aux calendes d'août, époque où s'ouvrait alors l'année. [2] La chaleur était accablante, et précisément il régnait dans la ville et dans la campagne un mal pestilentiel également funeste aux hommes et aux bêtes. La violence de la maladie trouva un aliment dans ces troupeaux et ces campagnards que la crainte du pillage avait fait recevoir dans les murs. [3] Cet amas, ce mélange d'animaux de toute espèce, fatal aux gens de la ville par l'infection extraordinaire qu'il répandait, suffoquait ceux de la campagne entassés dans d'étroites demeures et consumés de chaleur et d'insomnie. Les soins mutuels, le simple contact propageaient la maladie. [4] On suffisait à peine à ces maux accablants, lorsque des députés herniques viennent annoncer que les Èques et les Volsques réunis ont établi sur leurs terres un camp, d'où ils ravagent leur pays avec une nombreuse armée. [5] L'absence des sénateurs leur dit assez le fléau qui désolait la ville, et ils emportèrent cette triste réponse : « Que les Herniques, en se joignant aux Latins, se protègent eux-mêmes. La colère des dieux a frappé Rome d'une maladie soudaine qui la dépeuple. Si le mal laisse quelque relâche, on portera, comme l'année précédente, comme en toutes circonstances, du secours aux alliés. » [6] Les députés se retirèrent chez eux, avec des nouvelles bien plus affligeantes que ne l'avait été leur triste message. Il leur fallait soutenir seuls une guerre qu'ils auraient eu peine à soutenir avec l'appui des forces romaines. [7] L'ennemi ne s'en tint pas longtemps au pays des Herniques. Il vint de là porter ses armes sur les terres de Rome, déjà ravagées avant que la guerre ne les infestât. Pas un seul homme, même sans armes, ne s'offrit à lui, et, à travers un pays sans défenseurs et sans culture, il s'avança jusqu'à la troisième pierre milliaire du chemin de Gabies. [8] Aebutius, l'un des consuls romains, était mort, et son collègue Servilius traînait, avec un faible espoir, une vie languissante. Le mal avait frappé la plupart des magistrats, la majeure partie du sénat, presque tous les hommes en état de porter les armes; et, loin de pouvoir faire les préparatifs de défense que réclamait un danger si pressant, à peine avait-on assez de forces pour se maintenir tranquilles dans un poste. [9] Les sénateurs à qui le permettaient leur âge et leurs forces montaient la garde en personne. Les rondes et la surveillance appartenaient aux édiles plébéiens; en leurs mains étaient tombées la suprême puissance et la majesté consulaire. VII. [1] Abandonné, sans chef, sans forces, l'État dut son salut à ses dieux protecteurs et à cette fortune de Rome, qui mit dans l'esprit des Volsques et des Èques le brigandage au lieu de la conquête. [2] En effet, ils étaient si loin du moindre espoir, je ne dis pas de s'emparer de Rome, mais d'approcher seulement de ses murs, que de loin la vue de ses édifices et des hauteurs qui la couronnent détourna leurs desseins; [3] un murmure confus s'éleva de tout le camp : « Pourquoi, dans ces campagnes vastes et désertes, au milieu de la mortalité des animaux et des hommes, perdaient-ils leur temps, oisifs et sans butin, tandis que des pays intacts, les riches et fertiles campagnes de Tusculum étaient à leur portée ? » Aussitôt ils arrachent leurs enseignes, et, par des chemins 116 détournés, à travers les champs de Labicum, ils se portent sur les hauteurs de Tusculum. C'est là que la fureur de la guerre, que la tempête vint éclater. [4] Cependant les Herniques et les Latins, touchés de compassion, rougissant même de ne mettre aucune entrave à la marche de l'ennemi commun, dont les bataillons menaçaient la cité romaine, et de laisser, sans les secourir, assiéger leurs alliés, réunissent leurs armées et s'avancent vers Rome. [5] Ils n'y trouvèrent plus l'ennemi; instruits de sa marche, ils volent sur ses traces et se présentent à lui au moment où il descendait de Tusculum dans la vallée d'Albe. Les chances du combat étaient loin d'être égales; le dévouement des alliés ne fut pas heureux ce jour-là. [6] La maladie ne faisait pas moins de ravages dans Rome que le fer dans les rangs des alliés. Le consul qui, seul, avait survécu, succombe; avec lui meurent aussi d'autres personnages illustres : les augures Marcus Valérius et Titus Verginius Rutilus; Servius Sulpicius, grand curion. [7] La classe obscure fut surtout en butte à la violence du mal. Le sénat, dépourvu de tout secours humain, tourna vers la divinité les voeux des peuples et les siens; il enjoignit aux citoyens d'aller avec leurs femmes et leurs enfants supplier les dieux et implorer leur protection. [8] Poussés à ces actes par leurs propres souffrances, invités à les accomplir par l'autorité publique, ils remplissent tous les temples. On voyait des mères prosternées balayer de leur chevelure la poussière des lieux sacrés, sollicitant ainsi la clémence céleste et la cessation du fléau. VIII. [1] Dès lors, soit que le courroux des dieux eût été fléchi, soit que la saison la plus dangereuse eût atteint son terme, les malades échappés à la contagion commencèrent par degrés à se rétablir. [2] Les esprits se reportèrent bientôt vers les affaires publiques, et, après quelques interrègnes, Publius Valérius Publicola, le troisième jour du sien, créa consuls Lucius Lucrétius Tricipitinus et Titus Véturius Géminus, que d'autres appellent Vétusius. [3] Ils entrent en charge le troisième jour avant les ides d'août, lorsqu'on avait déjà recouvré assez de forces non seulement pour repousser la guerre, mais encore pour l'entreprendre. [4] Aussi, les Herniques étant venus dire que l'ennemi avait franchi leurs frontières, on promit hardiment du secours, et on leva deux armées consulaires. Véturius eut ordre de marcher contre les Volsques et de porter la guerre dans leur pays; [5] Tricipitinus, chargé de protéger le territoire des alliés, ne dépassa point le pays des Herniques. Dès la première rencontre, Véturius enfonce l'ennemi et le met en fuite. [6] Tandis que Lucrétius campe chez les Herniques, une armée de pillards lui dérobe sa marche, se dirige sur les hauteurs de Préneste, et se répand dans la plaine. Ils ravagent les campagnes de Préneste et de Gabies, et de là, par un détour, se portent sur les collines de Tusculum. [7] Cette marche jeta dans Rome une grande terreur, résultat de la surprise bien plus que de l'impuissance de repousser la force. Quintus Fabius commandait la ville; ayant armé la jeunesse et distribué les postes, il rétablit partout le calme et la sécurité. [8] Aussi, bornant leurs rapines aux lieux qui se trouvaient le plus à leur proximité, les ennemis n'osèrent pas appro- 117 cher de Rome. Leurs bandes revenues sur leurs pas, et, à mesure qu'elles s'éloignaient de la capitale ennemie, conduites avec plus de négligence, rencontrent le consul Lucrétius, éclairé de longue main sur leur marche, formé en bataille et disposé au combat. [9] Les Romains, préparés d'avance, attaquent l'ennemi sous le coup d'une épouvante soudaine; quoique inférieurs en nombre, ils culbutent et mettent en fuite cette immense multitude, la poussent dans des gorges profondes d'une issue difficile, et l'enveloppent. [10] Là, on effaça presque jusqu'au nom de Volsque : treize mille quatre cent soixante-dix hommes tués dans la bataille et dans la déroute, dix-sept cent cinquante prisonniers, vingt-sept enseignes militaires enlevées, voilà ce que je trouve dans quelques annales. Que ces calculs soient exagérés, il est certain, toutefois, que la perte fut énorme. [11] Le vainqueur, maître d'un immense butin, vint reprendre ses positions. Les deux consuls alors réunissent leurs camps; les Èques et les Volsques, les débris de leurs forces. Pour la troisième fois dans cette campagne, on livra bataille. La même fortune disposa de la victoire; on battit l'ennemi, on s'empara même de son camp. IX. [1] La république se trouvait ainsi rendue à son premier état; aussi les succès militaires ramenèrent-ils bientôt les troubles intérieurs. [2] Gaius Térentilius Harsa, cette année tribun du peuple, persuadé, en l'absence des consuls, que le champ était ouvert aux entreprises du tribunat, déclame plusieurs jours contre l'orgueil des patriciens, et attaque surtout l'autorité consulaire comme excessive, comme intolérable dans un état libre. [3] « Le nom en était moins odieux, le pouvoir, plus révoltant peut-être que celui des rois. [4] Ce sont deux maîtres au lieu d'un, avec une puissance sans contrôle et sans bornes. Indépendants et déréglés eux-mêmes, ils font peser sur le peuple toute la crainte des lois et des supplices. [5] Pour mettre un terme à cette licence, il va proposer la nomination de cinq citoyens, chargés de définir par une loi l'autorité consulaire. Quand le peuple aura donné aux consuls des droits sur lui, qu'ils en usent; leurs passions, leurs caprices du moins ne seront plus des lois. » [6] Les patriciens tremblent que l'absence des consuls n'aide à leur imposer ce joug, et le préfet de Rome, Quintus Fabius, convoque le sénat. Il invective avec tant de véhémence contre la loi et son auteur, que les menaces des deux consuls eux-mêmes, tonnant à côté du tribun, ne lui eussent pas imprimé plus de terreurs. [7] « Dans sa marche insidieuse, il avait épié ce moment pour attaquer la république. [8] Si les dieux irrités eussent, l'année précédente, entre la peste et la guerre, suscité un pareil tribun, rien n'eût conjuré la perte de Rome. C'est après la mort des deux consuls, quand la cité languissait, abattue dans la confusion de toutes ses parties, qu'il eût présenté cette loi spoliatrice de l'autorité consulaire. À la tête des Volsques et des Èques, il eût dirigé l'attaque de la ville. [9] Mais quoi ? n'est-il pas libre, si quelque citoyen a souffert de l'arrogance ou de la tyrannie des consuls, de les assigner, de les accuser devant ces juges mêmes qui comptent dans leurs rangs la victime ? [10] Ce n'est pas l'autorité des con- 118 suls, c'est la puissance tribunitienne qu'il rend odieuse et insupportable; cette puissance calmée, réconciliée avec le sénat, et à laquelle il veut rendre ses antiques fureurs. Au reste, Fabius ne vient point le supplier d'abandonner son entreprise. [11] Mais vous, s'écrie-t-il, tribuns ses collègues, nous vous prions de vous rappeler avant tout que c'est pour la protection du citoyen, et non pour la perte de l'état que cette puissance vous fut accordée, qu'on vous créa les tribuns du peuple et non les ennemis du sénat. [12] À nous la douleur, à vous tout l'odieux d'une attaque contre la république sans défense; à vous, qui pourrez, sans rien perdre de vos droits, diminuer la haine qui s'y attache. Faites que votre collègue n'entame point l'affaire avant l'arrivée des consuls; les Èques et les Volsques, eux-mêmes, l'année précédente, quand la peste eut moissonné nos deux premiers magistrats, ralentirent les fureurs d'une guerre acharnée et implacable. » [13] Les tribuns décident Térentilius à différer; et, par le fait, à retirer sa proposition, et sur-le-champ on pressa le retour des consuls. X. [1] Lucrétius revint chargé d'un immense butin, d'une gloire plus grande encore. Il en relève l'éclat à son arrivée par le soin qu'il prend de faire exposer dans e Champ de Mars tout le butin. Pendant trois jours chacun peut reconnaître et emporter sa propriété; on vend ce qui reste sans maître. [2] D'un accord unanime, on décernait au consul le triomphe; mais cet honneur fut différé. Le tribun présentait sa loi, et le consul n'avait rien plus à cœur que cette affaire. [3] On l'agita plusieurs jours dans le sénat et devant le peuple. Térentilius, cédant enfin à la majesté consulaire, se désiste, et l'on rend au vainqueur et à son armée les honneurs mérités. [4] Lucrétius triompha des Volsques et des Èques. Le triomphateur menait après lui ses légions. On accorda à l'autre consul d'entrer en ovation, mais sans le cortège de ses soldats. [5] L'an d'après, la loi Terentilia, présentée par tout le collège des tribuns, attaqua les nouveaux consuls. C'était Publius Volumnius et Servius Sulpicius. [6] Cette année encore le ciel parut en feu; la terre essuya de violentes commotions; une vache parla; et cette merveille, niée l'année précédente, obtint crédit cette fois. Entre autres prodiges, il plut des lambeaux de chair, et une immense quantité d'oiseaux, voltigeant au milieu de cette pluie, la dévorait, dit-on. Ce qui tomba sur la terre y resta plusieurs jours, sans se corrompre. [7] Les livres de la Sibylle, consultés par les duumvirs sacrés, répondirent qu'on était menacé d'une nuée d'étrangers, qui s'empareraient des hauteurs de la ville, pour y répandre le carnage; ils recommandaient surtout de s'abstenir des dissensions civiles. C'était fait à dessein pour entraver la loi, disaient les récriminations des tribuns : un conflit violent se préparait; [8] tout à coup, car chaque année ramenait le même cercle d'événements, les Herniques font savoir que les Volsques et les Èques, malgré le délabrement de leurs forces, remettent sur pied leurs armées. À Antium se noue cette intrigue; les colons antiates s'assemblent ouvertement à Écétra; telle est la source, tels sont les moyens de cette guerre. [9] À ces nouvelles, le sénat décrète une levée, et ordonne aux deux consuls de répartir en- 119 tre eux les commandements militaires. L'un devait marcher contre les Volsques, l'autre contre les Èques. [10] Les tribuns cependant font retentir le Forum de leurs cris. « Cette guerre des Volsques est une fable où les Herniques ont joué leur rôle. Ce n'est déjà plus avec la force qu'on écrase la liberté du peuple romain; on l'élude par l'artifice. [11] Comme le massacre presque général des Volsques et des Èques ne permet plus d'ajouter foi à un armement spontané de leur part, on cherche de nouveaux ennemis; on verse l'infamie sur une colonie fidèle et voisine; le sénat déclare la guerre aux Antiates innocents; il la fait au peuple de Rome; [12] il le charge du poids des armes; il en pousse précipitamment les bataillons hors des murs, punissant, par l'exil et l'éloignement des citoyens, les attaques des tribuns. [13] C'est ainsi, et ces menées n'ont point d'autre but, qu'on l'emportera sur la loi, à moins qu'ils ne profitent du moment où rien n'est encore fait, où ils sont à Rome, et revêtus encore de la toge, pour se conserver une patrie, pour se garantir du joug. [14] L'appui ne manquera pas au courage; tous les tribuns sont d'accord; point d'ennemis à redouter, point de périls au-dehors; les dieux ont pourvu, l'année précédente, à la sûre défense de la liberté. » Ainsi parlaient les tribuns. XI. [1] Dans une autre partie du Forum, en face d'eux, les consuls avaient établi leurs sièges, et procédaient à l'enrôlement. Les tribuns accourent et entraînent avec eux leur auditoire. À peine on avait commencé l'appel, comme pour préluder, que la lutte s'engage. [2] Le licteur arrête-t-il un citoyen par ordre du consul, le tribun ordonne de le relâcher; les droits sont méconnus, la force et les coups sont les seuls moyens d'obtenir ce qu'on prétend. [3] Ce que les tribuns avaient fait pour empêcher l'enrôlement, les patriciens le firent à leur tour contre la loi présentée tous les jours de comices. [4] Le signal ordinaire de la querelle était l'ordre d'aller aux voix, que donnaient au peuple les tribuns; les patriciens alors refusaient de quitter leurs places. Les anciens ne se trouvaient guère dans ces rencontres, où rien n'était donné à la prudence, et tout à la force, à la témérité; [5] les consuls eux-mêmes s'en écartaient souvent, de crainte, au milieu de ce désordre, d'exposer leur dignité à quelque affront. [6] Il y avait là Céson Quinctius, jeune homme fier de la noblesse de son origine, de sa taille, de sa force. Ces qualités, qu'il devait aux dieux, il les avait rehaussées lui-même par une foule d'actions d'éclat, et par ses succès à la tribune; nul n'était plus éloquent, nul plus intrépide dans Rome. [7] Debout au milieu de la troupe des patriciens, que sa taille dominait, et comme s'il eût porté toutes les dictatures, tous les consulats dans sa voix et dans la force de son corps; seul, il suffisait aux attaques tribunitiennes et aux tempêtes populaires. [8] Souvent, à la tête des siens, il chassa du Forum les tribuns, il dispersa et mit en fuite la populace. Quiconque tombait sous sa main s'en allait le corps meurtri, les habits en lambeaux, et il était facile de voir que, si l'on autorisait une pareille conduite, c'en était fait de la loi. [9] Ce fut alors que Aulus Verginius, quand les autres tribuns, ses collègues, étaient déjà terrassés en quelque sorte, porta contre Céson une accusation capitale. Mais cet esprit indomptable se trouva plus 120 irrité qu'abattu par cette démarche; il n'en fut que plus ardent à s'opposer à la loi, à harceler le peuple, à faire aux tribuns une guerre qu'ils semblaient avoir rendue légitime. [10] L'accusateur laisse l'accusé se précipiter de lui-même, et, par de nouveaux méfaits, exciter encore et alimenter le feu de la haine. On continue à proposer la loi, moins dans l'espoir de l'emporter que pour provoquer la témérité de Céson. [11] Une foule d'actes et de propos auxquels se livrait, dans ces débats, une jeunesse inconsidérée, retombaient sur lui seul, déjà en butte aux préventions. Toutefois on résistait à la loi, [12] et Aulus Verginius répétait au peuple : « Eh quoi ! Romains, ne sentez-vous pas que vous ne pouvez à la fois avoir Céson pour concitoyen, et la loi que vous désirez ? [13] Mais que parlé-je de la loi ? il entrave la liberté : par son arrogance il efface tous les Tarquins. Attendez qu'il devienne consul ou dictateur, ce simple citoyen qui règne déjà par l'effet seul de sa force et de son audace. » Une foule de gens appuyaient ces discours, se plaignant d'avoir été maltraités, et poussaient à l'envi le tribun à poursuivre son accusation. XII. [1] Déjà le jour du jugement approchait, et il était facile de voir que les esprits attachaient à la condamnation de Céson la cause de la liberté. Obligé de céder enfin, il descend aux plus humbles sollicitations. Il vient, suivi de ses parents, les principaux personnages de la ville. [2] Titus Quinctius Capitolinus, trois fois consul, en exposant les titres glorieux de Céson et ceux de sa famille, affirme que [3] « jamais dans la race des Quinctius, ni même dans la cité de Rome, on ne vit un caractère si grand, des qualités si précoces et si solides; c'est sous lui que Céson a fait ses premières armes, il l'a vu souvent aux prises avec l'ennemi. » [4] Spurius Furius avoue que « Quinctius Capitolinus lui ayant envoyé Céson lorsque sa position était devenue si critique, ce lui avait été un renfort, et que nul plus que lui n'avait personnellement coopéré au salut de la république. » [5] Lucius Lucrétius, consul de la dernière année, tout brillant d'une gloire récente, en abandonne une part à Céson, dont il rappelle les combats et raconte les exploits dans les diverses rencontres et en bataille rangée. [6] Il invite les Romains à se persuader que « ce jeune homme extraordinaire, doué de tous les avantages de la nature et de la fortune, exercera la plus grande influence sur les affaires de la cité, quelle qu'elle soit, où il portera ses pas, et que Rome doit préférer voir en lui l'un de ses citoyens que le citoyen d'une ville étrangère. [7] Ce qui blesse en lui, cette ardeur, cette audace, le temps l'affaiblit chaque jour; ce qui lui manque, la prudence, chaque jour vient l'accroître. Si l'âge, affaiblissant ses défauts, mûrit ainsi ses vertus, qu'on laisse un si grand homme se faire vieux dans la république. » [8] Son père, au milieu d'eux, Lucius Quinctius, surnommé Cincinnatus, s'abstenait de répéter ces éloges, de peur d'ajouter à la haine; mais il demandait grâce pour les erreurs, pour la jeunesse de Céson; il suppliait qu'on lui laissât son fils, à lui qui jamais de parole ou d'action n'avait offensé personne. [9] Les uns, soit honte, soit crainte, se détournaient de ses prières; d'autres lui opposaient les mauvais traitements dont leurs parents, dont eux-mêmes avaient à se plaindre; et, par la dureté de leurs réponses, ils annonçaient quel allait être leur jugement. 121 XIII. [1] Outre l'animosité générale, un chef d'accusation pesait sur l'accusé. Marcus Volscius Fictor, quelques années auparavant tribun du peuple, déposait [2] « que peu après la cessation de la peste, il avait rencontré une troupe de jeunes gens qui infestaient le quartier de Subure; qu'une rixe s'était alors engagée, et que son frère aîné, encore affaibli des suites de la maladie, atteint par Céson d'un coup de poing, était tombé sans connaissance. [3] On l'avait reporté à bras jusque chez lui, et il le croyait mort des suites de ce coup. Il ne lui avait pas été permis, sous les consuls des années précédentes, de poursuivre cette horrible affaire. » Aux clameurs de Volscius, les esprits s'enflammèrent à tel point qu'il s'en fallut peu que Céson ne pérît victime de la fureur du peuple. [4] Verginius ordonne de saisir cet homme, de le jeter dans les fers. Les patriciens repoussent la force par la force. Titus Quinctius ne cesse de crier « que lorsqu'un citoyen, sous le poids d'une accusation capitale, est à la veille du jugement, on ne peut l'arrêter avant sa condamnation, avant sa défense. » [5] Le tribun proteste « qu'il ne veut point, avant la condamnation, envoyer l'accusé au supplice, mais bien le retenir dans les fers jusqu'au jour du jugement. Quand un homme en a tué un autre, le peuple romain doit avoir l'assurance qu'il subira la peine de son crime. » [6] On s'adresse aux tribuns dont la décision, par un moyen terme, maintient leur intervention, s'oppose à la mise aux fers, ordonne qu'on citera le coupable, et qu'une caution pécuniaire répondra au peuple de sa comparution. [7] Quand il s'agit de fixer la somme qu'il convenait d'exiger, on ne put s'accorder, et le sénat eut à prononcer. L'accusé, gardé à vue pendant la délibération, [8] dut fournir des répondants, et chacun d'eux s'engager pour trois mille as. Les tribuns devaient en régler le nombre; ils le portèrent à dix, sur la demande de l'accusateur. C'était le premier exemple de cautions en affaires publiques. Renvoyé du forum, Céson, la nuit suivante, s'exila chez les Étrusques. [9] Le jour du jugement on allégua qu'il ne s'était éloigné que pour aller en exil. Verginius néanmoins s'obstinait à tenir les comices; on eut recours à ses collègues qui congédièrent l'assemblée. [10] L'argent promis fut exigé du père avec tant de rigueur qu'il vendit tous ses biens, se retira comme un banni, au-delà du Tibre, et y vécut quelque temps dans une chaumière écartée. XIV. [1] Ce jugement et la proposition de la loi tinrent Rome en haleine, tandis qu'elle se reposait de la guerre extérieure. [2] Les tribuns, par suite de cette espèce de victoire et de l'abattement où l'exil de Céson avait jeté le sénat, regardaient leur loi comme adoptée; les plus âgés d'entre les patriciens renonçaient, quant à eux, à la direction de la république; [3] mais les jeunes gens, et surtout les compagnons de Céson, sentirent grandir leur fureur contre le peuple, et non s'affaiblir leur courage. Ils durent toutefois à leurs revers l'avantage de mettre dans leurs attaques une certaine mesure. [4] La première fois, après l'exil de Céson, qu'on présenta la loi, disciplinés d'avance et soutenus par une nombreuse armée de clients, dès que les tribuns leur en offrirent l'occasion en les poussant hors de leurs places, ils tombèrent sur eux avec tant d'ensemble que l'honneur ou l'odieux n'en 122 revint en particulier à personne; et le peuple, au lieu d'un Céson, se plaignait d'en avoir trouvé mille. [5] Les jours d'intervalle où les tribuns ne s'occupaient pas de leur loi, rien n'égalait la douceur et le calme de ces mêmes jeunes gens. Ils abordaient avec bienveillance les plébéiens, leur adressaient la parole, les invitaient chez eux, les appuyaient au forum, et, sans les interrompre, laissaient les tribuns tenir paisiblement leurs autres assemblées. Jamais aucun d'eux, soit en public, soit en particulier, ne se montrait farouche que lorsqu'on arrivait à traiter de la loi. [6] Partout ailleurs cette jeunesse était populaire. Non seulement les tribuns achevèrent paisiblement leur magistrature, mais encore, l'année suivante, leur réélection s'opéra sans qu'une voix y mît obstacle, tant on se gardait de toute violence. Peu à peu, ces caresses, ces attentions avaient adouci le peuple. Grâce à ces moyens, on éluda toute l'année l'adoption de la loi. XV. [1] La ville était plus calme lorsque Gaius Claudius, fis d'Appius, et Publius Valérius Publicola, arrivèrent au consulat. Rien de nouveau ne signalait cette nouvelle année. Présenter la loi, la repousser; voilà ce qui occupait les esprits. [2] Plus la jeunesse patricienne s'insinuait auprès du peuple, plus, à leur tour, les tribuns, par leurs accusations, cherchaient à la rendre suspecte. [3] « On tramait une conspiration, Céson était dans Rome. C'est la mort des tribuns, le massacre du peuple qu'on médite. Les vieux patriciens ont chargé les jeunes d'extirper de la république la puissance tribunitienne, et de rendre à l'état la forme qu'il avait avant qu'on se retirât sur le Mont-Sacré. » [4] Rome cependant craignait que les Volsques et les Èques ne reprissent des hostilités, pour ainsi dire périodiques, et dont chaque année amenait régulièrement le retour. Mais, plus pressant, un nouveau danger surgit tout à coup. [5] Des exilés et des esclaves, au nombre d'environ deux mille cinq cents, le Sabin Appius Herdonius à leur tête, s'emparent, la nuit, du Capitole et de la citadelle. [6] Ils égorgent sur-le-champ ceux qui refusent de se joindre à eux et de prendre les armes. Quelques-uns, au milieu du trouble, entraînés par l'effroi, volent au forum. Ces cris : « Au armes ! » et « L'ennemi est dans la ville ! » se succèdent tour à tour. [7] Les consuls redoutent et d'armer le peuple et de le laisser sans armes. Ignorant quel fléau soudain, étranger ou domestique, produit du ressentiment populaire, ou de la perfidie des esclaves, s'est jeté sur la ville, ils veulent calmer le trouble, et, souvent, ne parviennent qu'à l'exciter. Sur cette multitude tremblante et consternée, l'autorité n'avait plus d'empire. [8] Cependant on distribue des armes, mais avec réserve, assez seulement, comme on ignore quel est l'ennemi, pour former un corps de troupes qui suffise à tout événement. Au milieu de cette anxiété, sans savoir à quelle espèce, à quel nombre d'ennemis on avait affaire, on passa le reste de la nuit à distribuer des postes sur tous les points favorables à la défense de la ville. [9] Le jour enfin dévoila quelle était cette guerre, quel en était le chef. C'étaient les esclaves, qu'Appius Herdonius appelait à la liberté du haut du Capitole. « Il avait pris en main la cause du malheur; il voulait ramener dans leur patrie ceux que l'injustice en avait exilés, et détruire le joug pesant de 123 l'esclavage. Il aimerait mieux que le peuple romain l'ordonnât ainsi lui-même. S'il ne doit rien espérer de ce côté, il s'adressera aux Volsques et aux Èques; il tentera, il provoquera les derniers efforts. » XVI. [1] Le fait devenait clair pour les sénateurs et les consuls; mais ils redoutaient que derrière ces menaces ne fussent cachées les intrigues des Véiens et des Sabins; [2] ils craignaient qu'à l'heure où tant d'ennemis s'agitaient dans la ville, on ne vit arriver, de concert avec Herdonius, les légions étrusques et sabines; puis ces éternels ennemis, les Volsques et les Èques, disposés cette fois, non point à ravager le territoire, mais à marcher sur Rome, qu'ils jugeaient prise en partie. [3] Mille sujets divers excitaient les alarmes, les esclaves surtout. Chacun pouvait avoir son ennemi chez soi. Se fier à lui, s'en méfier, au risque de provoquer sa vengeance, était également dangereux. [4] À peine, avec de la concorde, semblait-il possible de sauver la république. Néanmoins, dans ce redoublement, dans ce déluge de maux, personne ne songeait à l'animosité des tribuns et du peuple; ce mal peu dangereux n'en était un qu'en l'absence de tout autre, et, dans ce moment, la peur de l'étranger devait, ce semble, le faire cesser. [5] Et cependant ce fut presque le seul danger réel dans cette crise malheureuse. Tel était le délire des tribuns, qu'à les entendre ce n'était pas la guerre, mais un vain simulacre de guerre, et que cette invasion du Capitole n'était imaginée que pour détourner de la loi l'attention des esprits. « La loi une fois adoptée, disaient-ils, ces hôtes, ces clients des patriciens, ne voyant plus d'objet à cette levée de boucliers, s'en retourneraient avec moins de bruit encore qu'à leur arrivée. » [6] Ils font donc quitter les armes au peuple, et l'appellent à l'assemblée pour y voter la loi. Les consuls, de leur côté, convoquent le sénat, plus alarmés des craintes nouvelles qu'inspirent les tribuns, qu'ils ne l'avaient été de la surprise de la nuit. XVII. [1] Dès qu'il apprend qu'on a quitté les armes et abandonné les postes, Publius Valérius laisse son collègue présider le sénat, s'élance hors du palais, et se rend auprès des tribuns dans leur assemblée. [2] « Qu'est-ce à dire, tribuns, s'écrie-t-il ? sous la conduite d'Appius Herdonius et sous ses auspices, voulez-vous renverser la république ? A-t-il si bien réussi à vous corrompre celui qui n'a pu ébranler vos esclaves ? Est-ce donc quand l'ennemi est sur nos têtes qu'il faut poser les armes et présenter des lois ? » [3] Puis, adressant la parole à la multitude : « Si le salut de l'état, si le vôtre, Romains, vous touchent si peu, ayez du moins quelque respect pour vos dieux, en ce moment au pouvoir de l'ennemi. Jupiter, très bon et très grand, Junon, reine des dieux, Minerve, les autres dieux et déesses, sont assiégés : un camp d'esclaves occupe les pénates de la patrie ! [4] Ne dirait-on pas que la nation est frappée de démence ? Des milliers d'ennemis sont dans nos murs, que dis-je ? ils sont dans la citadelle, au-dessus du forum et du sénat : au forum, cependant, on tient les comices; au sénat on délibère; comme au sein de la paix, le sénateur donne son avis, le peuple son suffrage. [5] Ne convenait-il pas mieux à tous, patriciens et plébéiens, consuls, tribuns, dieux et hommes, de protéger Rome par les armes, de cou- 124 rir au Capitole, de délivrer et de rendre à la paix cette demeure auguste de Jupiter très bon et très grand ? [6] Romulus, notre père, toi qui naguère repris le Capitole sur ces mêmes Sabins à qui l'or l'avait livré, inspire ton courage à tes enfants ! Montre-nous le chemin où, sur tes pas, s'élança ton armée. Me voici le premier, moi consul, prêt à te suivre, autant qu'un mortel peut approcher d'un dieu, et à marcher sur tes traces. » [7] Il finit en disant : « Que pour lui, il prend les armes et appelle aux armes tous les Romains; si quelqu'un s'y oppose, il méconnaîtra, pour le poursuivre, et l'autorité consulaire, et la puissance tribunitienne, et les lois les plus sacrées; quel que soit l'opposant, partout, au Capitole et au forum, il le tiendra pour un ennemi. [8] Que ces tribuns, qui défendent de prendre les armes contre Herdonius, les fassent lever contre Publius Valérius, leur consul; il osera, lui, contre les tribuns, ce que le chef de sa race osa contre les rois. » [9] Les dernières violences semblaient inévitables. Le spectacle d'une révolte dans Rome se préparait pour les ennemis. Cependant la loi ne put passer, ni le consul marcher au Capitole. La nuit amortit la lutte qui s'engageait. Les tribuns reculèrent devant les ténèbres et la peur des armes consulaires. [10] Délivrés des auteurs de la sédition, les patriciens se mêlent au peuple, s'avancent au milieu des groupes, et y sèment des paroles adaptées à la circonstance. Ils les engagent à considérer les périls où ils entraînent la république. [11] « Il ne s'agit plus d'une querelle entre patriciens et plébéiens; c'est, à la fois, le sénat et le peuple, la citadelle de Rome, les temples de ses dieux, les pénates publics, ceux de chaque citoyen, qu'on livre à l'ennemi. » [12] Tandis qu'au forum on cherchait ainsi à calmer la discorde, les consuls, dans l'appréhension d'un mouvement de la part des Sabins ou des Véiens, se tenaient aux portes et sur les remparts. XVIII. [1] La même nuit, à Tusculum, on vint annoncer la prise de la citadelle, l'occupation du Capitole, et l'état de trouble où d'autres causes avaient plongé la ville. [2] Lucius Mamilius était en ce moment dictateur de Tusculum. Sans perdre un instant, il convoque le sénat; et, ceux qui avaient apporté ces nouvelles ayant été introduits, il conseille fortement [3] « de ne pas attendre que, de Rome, des députés viennent demander secours. Le péril même des Romains, leur position critique, les dieux, la foi des traités, réclament l'aide des Tusculans. S'attacher, par un service signalé, un peuple si puissant et si voisin, est une faveur que les dieux ne leur offriront pas une seconde fois l'occasion de mériter. » [4] On décide d'envoyer du secours; on enrôle les jeunes gens, on leur donne des armes. À Rome, au point du jour, à leur arrivée, on les prit de loin pour des ennemis. C'étaient les Volsques et les Èques qu'on croyait voir en eux. Mais bientôt, ces vaines terreurs dissipées, on leur ouvre la ville et ils descendent en ordre sur le forum. [5] Là, Publius Valérius, tandis que son collègue veillait à la garde des portes, formait déjà ses bataillons. [6] Sa mâle autorité avait prévalu. Il avait promis « qu'après la délivrance du Capitole et le retour de la paix dans Rome, si le peuple consentait à l'écouter, il lui dévoilerait la fourberie dont la loi des tribuns devait assurer le triomphe; et qu'ensuite, plein du souvenir de ses 125 ancêtres, digne du surnom qui lui transmettait de leur part l'obligation, en quelque sorte héréditaire, de protéger les intérêts populaires, il n'apporterait plus aucun obstacle à l'assemblée du peuple. » [7] Sous ses ordres et malgré les réclamations des tribuns, les bataillons se mettent à gravir la pente du Capitole, et avec eux la légion tusculane : alliés et citoyens se disputent l'honneur de reprendre cette citadelle. Chaque chef excite ses soldats. [8] L'ennemi s'effraie alors; il ne compte plus que sur la force de sa position. Tandis que la peur l'agite, les Romains et leurs alliés dirigent contre lui leurs enseignes. Déjà ils s'étaient ouvert un chemin jusqu'au vestibule du temple, quand Publius Valérius, excitant les siens, périt au premier rang. [9] Publius Volumnius, consulaire, le voit tomber; il ordonne à ceux qui l'entourent de couvrir le corps, et prend la place et les fonctions du consul. L'ardeur, l'impétuosité du soldat empêchèrent qu'il se doutât d'une si grande perte, et il vainquit avant de s'apercevoir qu'il combattait sans général. [11] Une foule d'exilés souillèrent le temple de leur sang; beaucoup furent pris en vie. Herdonius fut tué. Ainsi fut recouvré le Capitole. Les prisonniers, selon qu'ils étaient libres ou esclaves, subirent chacun le supplice réservé à leur condition. Les Tusculans reçurent des actions de grâces; on purifia le Capitole, on y offrit des sacrifices. [11] Chaque plébéien porta, dit-on, à la maison du consul le quart d'un as, pour ajouter à la pompe de ses funérailles. XIX. [1] La paix une fois rétablie, les tribuns pressent le sénat d'accomplir la promesse de Publius Valérius, et s'adressent à Gaius Claudius pour qu'il garde du parjure les mânes de son collègue, et laisse présenter la loi. Le consul proteste qu'avant d'avoir remplacé son collègue, il ne permettra point la présentation de la loi. [2] Ces contestations se prolongèrent jusqu'aux comices chargés d'élire un consul subrogé. Au mois de décembre, grâce à tous les efforts des patriciens, on nomma consul Lucius Quinctius Cincinnatus, père de Céson, qui dut entrer en charge aussitôt. [3] Le peuple était consterné : il se voyait aux mains d'un consul irrité, tout puissant par la faveur du sénat, par son mérite et par l'influence de ses trois fils, dont aucun ne le cédait à Céson en grandeur d'âme, mais qui, par leur prudence et leur modération quand les circonstances l'exigeaient, lui étaient supérieurs. [4] Dès qu'il fut revêtu de sa magistrature, assidu à son tribunal, il y déploya une égale énergie pour contenir le peuple et réprimander les patriciens. « C'était, disait-il, par la faiblesse de cet ordre, que les tribuns se perpétuant dans leurs charges, régnaient non sur la république du peuple romain, mais comme sur une famille en désordre, par la langue et les invectives. [5] Avec Céson, son fils, le courage, la fermeté, toutes les vertus militaires et civiles de la jeunesse se trouvaient exilées de Rome et bannies. Des bavards, des séditieux, des artisans de discordes, deux fois, trois fois tribuns, grâce aux plus criminelles intrigues, vivent dans une royale licence. [6] Cet Aulus Verginius, ajouta-t-il, pour n'avoir pas été au Capitole, est-il moins digne du supplice qu'Herdonius ? Mille fois plus, sans doute, si l'on veut en juger avec équité. Herdonius au moins, en se 126 déclarant votre ennemi, vous avertissait en quelque sorte de prendre les armes; cet autre, quand il niait la guerre, vous ôtait les armes des mains; il vous livrait nus à vos esclaves et aux bannis. [7] Et vous [je le dirai sans offense pour Gaius Claudius et pour les mânes de Publius Valérius], vous avez porté vos enseignes au pied du Capitole avant d'exterminer d'abord ces ennemis du forum ? J'en rougis pour les dieux et les hommes ! quand l'ennemi était maître de la citadelle et du Capitole, quand un chef d'exilés et d'esclaves, souillé de toutes les profanations, s'était établi dans la demeure de Jupiter, très bon et très grand, ce fut, avant Rome, Tusculum qui prit d'abord les armes ! [8] On a pu douter qui de Lucius Mamilius, chef des Tusculans, ou de Publius Valérius et de Gaius Claudius, consuls romains, délivrerait la citadelle de Rome. Et nous, qui naguère n'avons pas souffert que les Latins, voyant l'ennemi sur leur territoire, prissent les armes pour leur propre défense, aujourd'hui, si les Latins n'avaient d'eux-mêmes saisi leurs armes, nous serions captifs et anéantis. [9] Est-ce là, tribuns, porter secours au peuple, que de le livrer sans défense au massacre ? Eh quoi ! si quelque homme de votre peuple, si le dernier de cette classe que vous retranchez en quelque sorte du reste de la nation pour en faire votre patrie à vous, votre république particulière, si l'un d'eux venait dire que ses esclaves, les armes à la main, assiègent sa demeure, vous penseriez qu'il le faut secourir. [10] Et Jupiter, très bon et très grand, que des exilés et des esclaves tenaient assiégé, aucun secours humain ne lui était dû ! Et ceux-là demandent qu'on les déclare inviolables et sacrés, eux pour qui les dieux ne sont ni sacrés ni inviolables ! [11] Tout couverts que vous êtes de forfaits envers les dieux et envers les hommes, vous ne cessez de dire que vous porterez votre loi cette année. Alors j'en atteste les dieux, ce jour où l'on me créa consul fut plus fatal à la république, plus fatal mille fois que celui où périt Publius Valérius notre consul, si vous l'emportez. [12] Mais, ajouta-t-il, avant tout, Romains, mon collègue et moi avons résolu de conduire les légions contre les Volsques et les Èques. Je ne sais par quelle fatalité, dans les combats plus que dans la paix, nous trouvons les dieux favorables. Le péril où ces peuples auraient pu nous jeter, s'ils avaient su que des exilés occupaient le Capitole, il vaut mieux l'apprécier par le passé que d'en faire un jour l'épreuve. » XX. [1] Le peuple était ému des paroles du consul; les patriciens, revenus à eux, croyaient voir renaître la république. L'autre consul, plus hardi à seconder qu'à diriger une entreprise, laisse sans difficulté son collègue s'engager dans une affaire si épineuse; mais il réclame dans l'exécution sa part des fonctions consulaires. [2] Cependant les tribuns se jouaient de ces paroles qu'ils disaient chimériques, et demandaient avec persistance : « Comment les consuls emmèneraient une armée que personne ne leur laisserait enrôler ? » [3] -- « Nous n'avons que faire d'enrôlement, répondit Quinctius; lorsque Publius Valérius, pour reprendre le Capitole, donna des armes au peuple, tous jurèrent, sur sa demande, de se réunir à son ordre, de ne point se séparer sans son ordre. [4] Nous décrétons que vous tous qui avez prêté ce serment, demain, vous 127 vous trouviez en armes au lac Régille. » Les tribuns, à l'aide de sophismes, cherchent à détruire les scrupules du peuple : « Quinctius n'était qu'un simple citoyen, quand ils se lièrent par ce serment. » [5] Mais alors on n'avait point encore, comme dans notre siècle, cette indifférence pour les dieux; on ne savait point interpréter les serments et les lois, pour les plier à son gré; on préférait y conformer sa conduite. [6] Les tribuns, désespérant de mettre obstacle à ces desseins, cherchèrent à différer le départ de l'armée; le bruit se répandait d'ailleurs « que les augures avaient eux-mêmes reçu l'ordre de se trouver au lac Régille, et d'inaugurer un emplacement où, d'après les rites sacrés, on pût traiter des affaires publiques. Là, tout ce qu'à Rome la violence tribunitienne avait obtenu devait disparaître dans les comices. [7] On adopterait tout ce que voudraient les consuls, car l'appel des tribuns était sans force à plus d'un mille de Rome; et, eux-mêmes, s'ils s'y rendaient confondus dans la foule des Quirites, seraient soumis à l'autorité consulaire. » [8] Ils s'effrayaient de ces bruits; mais bientôt la terreur fut au comble; car Quinctius répétait publiquement : « Qu'il ne convoquerait pas les comices pour l'élection des consuls. Les maux de la république n'étaient pas de ceux que des remèdes ordinaires parviendraient à guérir; elle avait besoin d'un dictateur : si quelque brouillon cherche à compromettre la tranquillité de l'état, il apprendra que la dictature n'admet point d'appel. » XXI. [1] Le sénat était au Capitole, les tribuns s'y rendent avec le peuple consterné. La multitude, à grands cris, implore tour à tour la pitié des consuls et celle des sénateurs. Mais le consul demeura inébranlable jusqu'à ce que les tribuns eussent promis de se soumettre à l'autorité du sénat. [2] Sur un rapport du consul, relatif aux demandes des tribuns et du peuple, des sénatus-consultes ordonnèrent « que les tribuns ne présenteraient point leur loi cette année, et que les consuls n'emmèneraient point l'armée hors des murs. À l'avenir, continuer les magistrats dans leurs charges, réélire les mêmes tribuns serait, au jugement du sénat, une atteinte à la république. » [3] Les consuls se conformèrent à ces décrets; mais les tribuns, malgré les réclamations des consuls, furent réélus. Les patriciens, à leur tour, pour ne rien céder au peuple, portaient de nouveau Quinctius. Jamais, de toute l'année, sortie plus véhémente de la part du consul. [4] « Faut-il s'étonner, pères conscrits, du discrédit de votre autorité auprès du peuple ? C'est vous-mêmes qui la ruinez. Ainsi, parce que le peuple viole vos décrets en continuant ses magistrats, vous allez les violer vous-mêmes, pour égaler en dérèglements cette multitude; [5] comme si la prépondérance dans un état était attachée à la légèreté et à la licence. Car il y en a plus, sans doute, à détruire ses propres délibérations et ses décrets que ceux d'autrui. [7] Imitez, pères conscrits, cette foule inconsidérée; destinés à servir de modèle aux autres, suivez vous-mêmes leur funeste exemple, plutôt que de les ramener à la justice par la vôtre. Pour moi, loin d'imiter les tribuns, je ne souffrirai pas, au mépris de votre sénatus-consulte, ma réélection au consulat. [8] Et toi, Gaius Clau- 128 dius, je t'en conjure, détourne aussi le peuple romain de tels excès; et juge assez bien de moi pour être persuadé que, loin de voir dans tes démarches un obstacle à mon élévation, à mes yeux elles relèveront la gloire de mon refus, et contribueront à éloigner de moi l'odieux attaché à une élection nouvelle. » [8] Les deux consuls décrètent en commun « qu'aucun citoyen ne doit porter Lucius Quinctius au consulat; si quelqu'un le fait, on annulera son suffrage. » XXII. [1] Les consuls furent Quintus Fabius Vibulanus pour la troisième fois, et Lucius Cornélius Maluginensis. On fit, cette année, le dénombrement des citoyens; mais, sans fermer le lustre, car la prise du Capitole et la mort du consul étaient d'un sinistre augure. [2] Quintus Fabius et Lucius Cornélius ne furent pas plutôt en charge, qu'avec l'année commencèrent les troubles. Les tribuns aigrissaient le peuple. Les Latins et les Herniques annonçaient une guerre formidable de la part des Volsques et des Èques. Déjà les légions volsques étaient à Antium, et cette colonie elle-même inspirait de graves soupçons de défection; à grand-peine on obtint des tribuns qu'avant tout on songerait à la guerre. [3] Les consuls se partagent les commandements. Fabius devait conduire les légions à Antium; Cornélius, rester à la garde de Rome pour empêcher qu'une partie des ennemis, comme c'était la coutume des Èques, ne vînt ravager le territoire. [4] Les Herniques et les Latins eurent ordre de fournir des soldats, aux termes des traités; et les deux tiers de l'armée se composèrent d'alliés; le reste, de citoyens. Dès que les alliés, au jour prescrit, furent arrivés, le consul établit son camp hors de la porte Capène; puis, après la revue de son armée, il marche sur Antium, et s'arrête non loin de la ville et du campement ennemi. [5] Les Volsques, que n'avait pas encore rejoints l'armée des Èques, reculent devant le combat, et pourvoient à leur repos et à leur sûreté derrière des palissades. Le lendemain, Fabius, qui ne veut point confondre et réunir les alliés et les citoyens, fait des trois peuples trois corps séparés, qu'il dispose autour des retranchements ennemis. [6] Il se place au centre avec les légions romaines. On avait ordre de prêter attention aux signaux qu'il donnerait, pour que les alliés pussent attaquer en même temps que lui, ou se retirer, s'il sonnait la retraite. Chaque nation avait sa cavalerie disposée selon les règles. [7] Cette triple attaque enveloppe le camp. Pressés de toutes parts, les Volsques ne peuvent tenir à cette impétuosité; on les précipite de leurs retranchements. Les Romains franchissent les palissades, poussent vers un seul point cette troupe effrayée, et la chassent du camp. [8] Dans le désordre de la fuite, la cavalerie, que la difficulté de franchir les retranchements avait jusque-là rendue spectatrice du combat, prend part à la victoire en massacrant les fuyards. [9] Grand fut le carnage au-dedans et au-dehors du camp : plus grand encore le butin; car l'ennemi put à peine emporter ses armes. On eût complètement détruit cette armée sans les forêts qui couvrirent sa fuite. XXIII. [1] Tandis que ces événements se passent sous Antium, les Èques détachent en avant l'élite de leur jeunesse, et la citadelle de Tusculum, surprise pendant la nuit, tombe entre leurs mains. Le gros de l'armée s'établit non loin des murs de 129 la ville, pour opérer une diversion. [2] Ces nouvelles volent à Rome, de Rome au camp d'Antium, et produisent autant d'effet sur les Romains que si l'on eût annoncé la prise du Capitole. Le service des Tusculans était récent encore : la conformité du péril qui les menace avec celui dont ils ont préservé Rome semble réclamer les mêmes secours qu'on a reçus d'eux. [3] Fabius abandonne tout, transporte à la hâte le butin du camp dans Antium, y laisse un faible détachement, et précipite vers Tusculum la marche de ses troupes. Les soldats ne purent emporter que leurs armes et ce qu'ils trouvèrent sous leur main d'aliments préparés. De Rome, les envois de Cornélius subvinrent à leurs besoins. [4] Pendant quelques mois on fit la guerre à Tusculum. Le consul, avec une partie de son armée, assiégeait le camp des Èques; il avait cédé le reste aux Tusculans pour reprendre leur citadelle. La force ne put y réussir, mais la famine en arracha les ennemis. [5] Quand ils furent réduits à l'extrémité, les Tusculans les firent passer, nus et sans armes, sous le joug. Couverts d'ignominie, ils fuyaient vers leurs demeures quand le consul Fabius les atteint sur l'Algide, et les extermine jusqu'au dernier. [6] Avec son armée victorieuse, il vient ensuite camper à Columen. L'autre consul, jugeant qu'après cette déroute de l'ennemi, les remparts de Rome sont hors de tout péril, s'éloigne lui-même de la ville. [7] Alors, par deux points différents, les deux consuls entrent sur le territoire ennemi, et rivalisent d'efforts pour étendre leurs ravages, l'un chez les Volsques, l'autre chez les Èques. Quelques historiens rapportent que cette année-là eut lieu la défection des Antiates, et que le consul Lucius Cornélius, chargé de cette guerre, s'empara de leur ville : toutefois, les plus anciens écrivains ne faisant nulle mention de ces faits, je n'oserais les garantir. XXIV. [1] Cette guerre terminée, celle que les tribuns font dans Rome vient agiter le sénat. Ils s'écrient : « Que c'est une perfidie de retenir l'armée au-dehors; une entrave apportée à l'adoption de la loi; mais qu'ils n'en accompliront pas moins leur entreprise. » [2] Lucius Lucrétius, préfet de Rome, obtint cependant que, pour entamer leurs poursuites, les tribuns attendront le retour des consuls. [3] Une nouvelle cause de trouble s'était levée. Aulus Cornélius et Quintus Servilius, questeurs, avaient assigné Marcus Volscius pour avoir porté contre Céson un témoignage dont la fausseté n'admettait aucun doute. [4] Il résultait d'une foule de preuves que le frère de Volscius, du moment qu'il tomba malade, ne reparut jamais en public, n'eut même aucun relâche dans sa maladie, et mourut après plusieurs mois de consomption. [5] Bien plus, à l'époque où le témoin reportait son accusation, Céson n'avait point paru à Rome. Ceux qui servaient avec lui attestaient qu'il était constamment resté sous les drapeaux et sans congé. Pour appuyer ces faits, une foule de citoyens proposaient, à leurs risques, un juge à Volscius. [6] Il n'osa subir cette épreuve et ce concours de circonstances ne laissait pas plus de doute sur la condamnation de Volscius, que jadis le témoignage de Volscius sur celle de Céson. [7] Les tribuns y apportaient du retard, en protestant qu'ils ne permettraient point aux questeurs de tenir les 130 comices pour le jugement, qu'on ne les eût auparavant tenus pour la loi. Les deux affaires traînèrent ainsi jusque à l'arrivée des consuls. [8] Après leur entrée triomphale, à la tête de l'armée victorieuse, il ne fut plus question de la loi, et la plupart croyaient à la défaite des tribuns. [9] Mais, comme l'année touchait à sa fin, et qu'ils aspiraient à une quatrième élection, ils avaient réservé pour les débats des comices l'ardeur qu'ils auraient mise à lutter pour la loi. Les consuls s'opposèrent avec autant de vigueur à la continuation du tribunat que si l'on eût présenté une loi attentatoire à la majesté consulaire; mais la victoire n'en resta pas moins aux tribuns. [10] Cette même année, sur la demande des Èques, on leur accorda la paix : on termina le cens commencé l'année précédente, et on clôtura le lustre, le dixième depuis la fondation de Rome. Le dénombrement donna cent dix-sept mille trois cent dix-neuf citoyens. [11] Les consuls de cette année recueillirent une immense gloire militaire et domestique. Au-dehors, ils avaient conquis la paix; au-dedans, si l'accord ne fut point parfait, du moins la ville ne fut pas aussi agitée qu'en d'autres temps. XXV. [1] Lucius Minucius et Lucius Nautius, appelés ensuite au consulat, débutent par les deux affaires que leur léguait l'année précédente. [2] Toujours par les mêmes moyens, les consuls mettaient obstacle à la loi; et les tribuns, au jugement de Volscius. Mais il y avait chez les nouveaux questeurs plus d'énergie, plus de considération. [3] C'étaient Marcus Valérius, fils de Manius, petit-fils de Volésus, et Titus Quinctius Capitolinus, trois fois consul. Ce dernier, dans l'impossibilité de rendre Céson à la famille des Quinctius, et à la république le plus illustre de ses jeunes citoyens, poursuivait, d'une guerre aussi juste que les motifs en étaient touchants, le faux témoin qui avait privé de défense un innocent. [4] Les tribuns, et Verginius surtout, insistaient sur leur loi. On donna aux consuls deux mois pour l'examiner. Après avoir dévoilé au peuple le piège qu'elle couvrait, ils devaient permettre enfin qu'on la mît aux voix. Cet intervalle ramena le calme dans la ville; [5] mais les Èques surent abréger ce repos. Ils rompent le traité conclu l'année précédente avec les Romains, et défèrent le commandement à Gracchus Cloelius. C'était, sans contredit, le premier de leur nation. [6] Sous sa conduite ils vont sur les terres de Labici, puis sur celles de Tusculum, porter leurs armes et leurs ravages, et, chargés de butin, établissent leur camp sur l'Algide. Dans ce camp, Quintus Fabius, Publius Volumnius et Aulus Postumius, envoyés de Rome, viennent réclamer contre cet oubli de toute justice, et demander réparation, d'après les traités. [7] « Si le sénat de Rome vous a chargés d'une mission, répond le général des Èques, adressez-vous à ce chêne; j'ai autre chose à faire que de vous entendre. » Un chêne immense, en effet, s'élevait au-dessus de la tente du général et la couvrait de son ombre. [8] Un des envoyés s'écrie alors en se retirant : « Hé bien ! que ce chêne sacré, que tous les dieux sachent donc que vous rompez les traités; qu'ils soient aujourd'hui favorables à nos plaintes, et bientôt à nos armes, quand nous poursuivrons la vengeance des dieux et des hommes, dont on viole 131 également tous les droits. » [9] À Rome, dès que les ambassadeurs sont de retour, le sénat ordonne à l'un des consuls de conduire une armée contre Gracchus, au mont Algide, et charge l'autre de ravager le territoire des Èques. Les tribuns, comme toujours, s'opposaient à l'enrôlement; et peut-être l'eussent-ils finalement rendu impossible, sans de nouvelles terreurs qui surgirent tout à coup. XXVI. [1] Une nuée de Sabins vint presque sous les murs de Rome porter le fer et le ravage : la désolation régnait dans les champs, la terreur dans la ville. Cette fois, plus docile, le peuple prit les armes; les tribuns se récriaient en vain, on enrôla deux grandes armées. [2] L'une, sous Nautius, marcha contre les Sabins. Campé auprès d'Érétum, ce général, avec de petits corps détachés, et le plus souvent par des courses nocturnes, prit si bien sa revanche en ravageant le territoire des Sabins, que celui de Rome avait l'air intact en comparaison. [3] Minucius n'eut point la même fortune ni la même vigueur de caractère dans la conduite de son expédition; car, ayant placé son camp non loin de l'ennemi, sans avoir éprouvé d'échec notable, il se tenait enfermé dans ses lignes. [4] L'ennemi s'en aperçoit; cette timidité, comme il arrive d'ordinaire, augmente son audace, et, la nuit, il attaque le camp; mais ses efforts ayant obtenu peu de succès, le lendemain il l'enveloppe d'une ligne extérieure. Avant que les retranchements ennemis eussent fermé toute issue, cinq cavaliers s'élancent au travers des postes ennemis, et vont apprendre à Rome que le consul et son armée se trouvent assiégés. [5] Rien de plus surprenant, rien de moins attendu ne pouvait arriver; aussi, la crainte, la terreur furent telles qu'on eût dit que c'était la ville et non l'armée que l'on assiégeait. [6] Le consul Nautius est rappelé; mais, comme cet appui parut insuffisant, on songea à créer un dictateur pour soutenir l'état ébranlé. Lucius Quinctius Cincinnatus réunit tous les suffrages. [7] Qu'ils sachent apprécier une telle leçon ! ceux pour qui toutes les choses humaines ne sont, au prix des richesses, qu'un objet de mépris, et qui s'imaginent que les grandes dignités et la vertu ne sauraient trouver place qu'au sein de l'opulence. [8] L'unique espoir du peuple romain, Lucius Quinctius, cultivait, de l'autre côté du Tibre, et vis-à-vis l'endroit où se trouve à présent l'arsenal de nos navires, un champ de quatre arpents, qui porte encore aujourd'hui le nom de « Pré de Quinctius » . [9] C'est là que les députés le trouvèrent, creusant un fossé, selon les uns, et appuyé sur sa bêche, selon d'autres, derrière sa charrue; mais, ce qui est certain, occupé d'un travail champêtre. Après des salutations réciproques, ils le prièrent, en faisant des voeux pour sa prospérité, et pour celle de la république, de revêtir sa toge, et d'écouter les instructions du sénat. Surpris, il demande plusieurs fois si quelque malheur est arrivé, et ordonne à Racilia, son épouse, d'aller aussitôt chercher sa toge dans sa chaumière. [10] L'ayant revêtue, il s'approche après avoir essuyé la poussière et la sueur de son front; les députés le saluent dictateur, le félicitent, le pressent de se rendre à la ville, et lui exposent la terreur qui règne dans l'armée. [11] Un bateau avait été préparé pour Quinctius, par les ordres du sénat; à la descente, il fut reçu par ses trois fils, venus à sa rencontre; puis arrivèrent ses autres parents, et 132 ses amis, et enfin la plus grande partie des sénateurs. Au milieu de ce nombreux cortège, et précédé des licteurs, il se rend à sa maison. [12] Le concours du peuple était immense; mais il était loin d'éprouver, à la vue de Quinctius, une joie égale à celle des patriciens. Il jugeait le pouvoir trop grand, et que l'homme qui allait l'exercer s'y montrerait trop dur. Pour cette première nuit, on s'en tint à une garde exacte dans la ville. XXVII. [1] Le lendemain, avant le jour, le dictateur se rend au forum, et nomme maître de la cavalerie Lucius Tarquitius, de famille patricienne; et qui, bien qu'il eût fait ses campagnes dans l'infanterie, à cause de sa pauvreté, était considéré à l'armée comme infiniment supérieur à tout le reste de la jeunesse romaine. [2] Il se rend ensuite, avec son maître de la cavalerie, à l'assemblée du peuple; proclame la suspension des affaires, ordonne que les boutiques se ferment dans toute la ville; défend que personne s'occupe de ses affaires privées; [3] donne à tous ceux qui pouvaient servir à l'armée l'ordre de se trouver en armes, avec du pain pour cinq jours, et douze pieux, au Champ de Mars, avant le coucher du soleil. [4] Ceux que leur âge rendait incapables du service militaire, devaient, tandis que leurs voisins préparaient des armes et allaient chercher des pieux, faire cuire leur pain. [5] Les jeunes gens courent de tous cotés pour se procurer des pieux; chacun en prend à sa proximité, sans que personne s'y oppose, et tous se trouvent avec exactitude au rendez-vous du dictateur. [6] Là, on se forme en un ordre également propre à la marche et au combat. On se prépare ainsi à tout événement; le dictateur se met à la tête des légions; le maître de la cavalerie conduit ses cavaliers. Dans les deux troupes, c'étaient, comme l'exigeait la circonstance, des exhortations continuelles [7] à doubler le pas, à se hâter pour atteindre de nuit les ennemis; « on assiégeait le consul et l'armée romaine; depuis trois jours ils étaient enfermés; on ne savait ce que chaque jour ou chaque nuit pouvait amener; souvent les événements les plus importants dépendent d'un moment; [8] hâtez-vous, porte-enseigne, soldats avancez, » s'écriait la troupe, pour seconder les vues de ses chefs. Au milieu de la nuit, ils arrivent sur l'Algide, et, s'apercevant qu'ils sont près de l'ennemi, ils plantent leurs enseignes. XXVIII. [1] Alors le dictateur, autant que l'obscurité peut le permettre, fait, à cheval, le tour du camp ennemi, en examine l'étendue et la forme; ordonne aux tribuns de faire placer tous les bagages en un même lieu, et aux soldats d'aller avec leurs armes et leurs pieux prendre chacun leur rang : ces ordres sont à l'instant exécutés. [2] Puis, dans le même ordre que durant la marche, il développe son armée sur une longue ligne autour du camp ennemi. Au signal donné, tous doivent pousser un grand cri; chacun doit ensuite creuser un fossé devant soi et planter ses pieux. [3] On publie cet ordre, et le signal le suit de près; le soldat exécute le commandement; le bruit de ces cris retentit tout autour des ennemis, traverse leur camp, et parvient jusqu'à celui du consul, portant aux uns la terreur, aux autres le délire de 133 la joie. [4] Les Romains reconnaissent le cri de leurs concitoyens, se félicitent de l'arrivée du secours, et de leurs postes et par leurs vedettes harcèlent l'ennemi. [5] Le consul s'écrie qu'il est temps d'agir; « ces clameurs annoncent non seulement l'arrivée des leurs, mais encore le commencement de l'attaque; grande serait sa surprise, si dans sa limite extérieure le camp ennemi n'était déjà menacé. » Il ordonne donc aux siens de prendre les armes, et de le suivre. [6] C'est de nuit que ses légions commencent le combat. Leurs cris apprennent au dictateur que de ce côté aussi la lutte était engagée. [7] Déjà les Èques se préparaient à prévenir l'investissement de leurs ouvrages, lorsque l'ennemi, qu'ils assiégeaient, commença l'attaque; craignant qu'il ne se fît jour à travers leur camp, ils se défournent des travailleurs pour faire face à leur ligne intérieure, et laissent la nuit libre aux opérations de Quinctius. Ils se battirent jusqu'au jour contre le consul. [8] Lorsque le jour parut, ils étaient déjà enfermés par la circonvallation du dictateur, et ils soutenaient à peine le combat contre une seule armée, quand celle de Quinctius reprenant les armes aussitôt que ses travaux sont achevés, attaque les retranchements. C'était une nouvelle bataille à livrer, et la première ne s'était en rien ralentie. [9] Alors, entre deux périls qui les menacent, les Èques cessent de combattre, recourent aux prières, supplient d'un côté le dictateur, de l'autre le consul de ne pas attacher à leur destruction l'honneur de la victoire, et de leur permettre de se retirer sans armes. Le consul les renvoie au dictateur; celui-ci ajoute l'ignominie à leur malheur. [10] Il ordonne que Gracchus Cloelius, leur chef, et les premiers d'entre eux lui soient amenés enchaînés; qu'on lui cède la ville de Corbion : « Il n'a pas besoin du sang des Èques; il leur permet de se retirer; mais, pour leur arracher enfin l'aveu qu'il a soumis et dompté leur nation, ils passeront sous le joug. » [11] Trois lances composent ce joug; deux sont fixées en terre; au-dessus d'elles, une troisième est attachée en travers. Ce fut sous ce joug que le dictateur laissa partir les Èques. XXIX. [1] Le camp des ennemis, dont il resta maître, se trouva rempli de butin de toute espèce [car il les avait renvoyés nus]; il ne le partagea qu'entre ses soldats. Quant à ceux du consul et au consul lui-même : [2] « Soldats, leur dit-il d'un ton de reproche, vous n'aurez point de part aux dépouilles d'un ennemi dont vous avez failli vous-mêmes devenir la proie; et toi, Lucius Minucius, jusqu'à ce que tu montres le caractère d'un consul, c'est comme lieutenant que tu commanderas ces légions. » [3] Minucius, aussitôt, abdique le consulat, et, docile à l'ordre du dictateur, demeure à l'armée. La supériorité dans le commandement captivait alors si facilement l'obéissance, que, plus sensible au bienfait qu'à l'humiliation, cette même armée décerna au dictateur une couronne d'or du poids d'une livre, et, à son départ, le salua comme son patron. [4] À Rome, le préfet Quintus Fabius convoque le sénat, lequel ordonne que Quinctius, à la tête de l'armée qu'il ramenait, entrera triomphant dans la ville. On mène devant son char les généraux ennemis, on porte devant lui les enseignes militaires; à sa suite marchent ses soldats chargés de butin. [5] Des festins furent, dit-on, préparés devant 134 toutes les portes; les convives, au milieu des chants de triomphe et des plaisanteries usitées dans ces fêtes, se mirent à la suite du char. [6] Le même jour on décerna, d'un consentement unanime, au Tusculan Lucius Mamilius, le titre de citoyen de Rome. Sans plus tarder, le dictateur eût abdiqué sa charge, sans les comices assemblés pour l'affaire du faux témoin Volscius, à laquelle les tribuns n'osèrent mettre empêchement, grâce à la crainte qu'inspirait le dictateur. Volscius, condamné, se retira en exil à Lanuvium. [7] Le seizième jour Quinctius abdiqua la dictature qu'on lui avait conférée pour six mois. Dans cet intervalle, le consul Nautius remporta, près d'Érétum, un avantage signalé sur les Sabins, qui, outre la dévastation de leurs champs, eurent à déplorer cette nouvelle défaite. Fabius Quintus alla remplacer Minucius dans l'Algide. [8] Vers la fin de l'année, les tribuns se donnèrent quelque mouvement pour leur loi. Mais, sous prétexte que les deux armées étaient absentes, les patriciens obtinrent qu'on ne porterait aucune proposition devant le peuple; le peuple emporta, pour la cinquième fois, la nomination des mêmes tribuns. [9] Des loups se montrèrent, dit-on, au Capitole, et furent chassés par des chiens; en conséquence de ce prodige, on purifia le temple. Tels furent les événements de cette année. XXX. [1] Viennent ensuite les consuls Quintus Minucius et Marcus Horatius Pulvillus Au commencement de l'année, tout était paisible au-dehors; à l'intérieur, des troubles furent excités par les mêmes tribuns, et par la même loi. [2] On en serait venu à des termes plus violents, tant les têtes étaient échauffées, si, comme à point nommé, ne fût arrivée la nouvelle d'une attaque nocturne des Èques sur Corbion, et de l'enlèvement de la garnison. [3] Les consuls convoquent le sénat, qui leur prescrit de lever une armée de « subitaires » , et de la conduire au mont Algide. Alors les débats cessent au sujet de la loi, et une nouvelle lutte s'engage pour l'enrôlement. [4] L'autorité consulaire allait succomber sous les efforts des tribuns, lorsque survinrent de nouvelles terreurs. On annonça que l'armée sabine était descendue dans la campagne de Rome pour la piller, et marcher ensuite sur la ville. [5] La crainte du péril décida les tribuns à permettre l'enrôlement, non, toutefois, sans une condition. Comme pendant cinq ans on avait pu éluder leurs efforts, et qu'ils avaient peu profité à la cause populaire, ils demandent qu'à l'avenir, il soit créé dix tribuns du peuple. [6] La nécessité arracha aux patriciens leur consentement; seulement ils spécifièrent qu'on ne pourrait réélire les mêmes tribuns. Mais afin d'empêcher qu'après la guerre, cette clause, comme tant d'autres, ne demeurât sans effet, les comices, se réunirent sur-le-champ pour l'élection des tribuns. [7] Trente-six ans après la création des premiers tribuns on porta leur nombre à dix, deux de chaque classe, et on prit des mesures pour qu'il en fût de même à l'avenir. [8] Ensuite on opéra l'enrôlement. Minucius, parti contre les Sabins, ne rencontra pas l'ennemi. Horatius, quand déjà les Èques, après avoir massacré la garnison de Corbion, s'étaient emparés de la ville d'Ortona, leur livra bataille dans l'Algide, leur tua beaucoup, de monde, et les chassa non seulement de l'Algide, mais aussi de Corbion et d'Ortona. Corbion fut détruite pour avoir livré sa garnison. 135 XXXI .[1] On créa ensuite consuls Marcus Valérius et Spurius Verginius. Au-dedans comme au-dehors tout fut tranquille; mais une disette de blé, causée par des pluies excessives, pesa sur le peuple, et on fit passer une loi qui lui partageait le mont Aventin. [2] Les mêmes tribuns du peuple, réélus l'année suivante, sous le consulat de Titus Romilius et Gaius Véturius, ne cessaient de prôner leur loi dans toutes leurs assemblées. « Ils rougiraient d'avoir vainement augmenté leur nombre, si cette affaire devait dormir pendant les deux années de leur charge, comme elle avait fait durant le dernier lustre. » [3] Au moment où toute leur activité se concentrait sur cette affaire, des courriers arrivent tremblants de Tusculum, et annoncent que les Èques sont sur leurs terres. On eût éprouvé quelque honte, après les services récents qu'avait rendus ce peuple, à différer le secours. Les deux consuls, envoyés avec une armée, rencontrèrent l'ennemi à son poste ordinaire, sur l'Algide. [4] C'est là qu'on en vint aux mains. Plus de sept mille ennemis y restèrent; les autres prirent la fuite. Le butin fut immense; mais, pour réparer l'épuisement du trésor, les consuls firent tout vendre. Cette mesure excita néanmoins le mécontentement de l'armée, et fournit aux tribuns des motifs pour noircir les consuls auprès du peuple. [5] Aussi, dès qu'ils sortirent de charge, et sous le consulat de Spurius Tarpéius et d'Aulus Aternius, ils furent cités, Romilius par Gaius Claudius Cicéron, tribun du peuple; Véturius par Lucius Aliénus, édile plébéien. [6] L'un et l'autre, à la grande indignation des patriciens, furent condamnés; Romilius, à payer dix mille as, et Véturius quinze mille. L'échec qu'éprouvèrent ces consuls ne rendit point leurs successeurs plus traitables. « On pouvait bien, disaient-ils, les condamner, mais le peuple et les tribuns ne sauraient faire passer leur loi. » [7] Renonçant alors à une loi qui avait vieilli depuis qu'on l'avait présentée, les tribuns traitèrent les patriciens avec plus de douceur. Ils les priaient de « mettre un terme à leurs dissensions : si les lois plébéiennes leur déplaisaient si fort, ils n'avaient qu'à autoriser la création, en commun, de commissaires choisis parmi le peuple et parmi les patriciens, pour rédiger des règlements dans l'intérêt des deux ordres, et assurer à tous une égale liberté. » [8] Les patriciens étaient loin de rejeter ces offres; mais « nul, disaient-ils, n'était appelé à donner des lois, s'il ne sortait de l'ordre des patriciens. » Ainsi, d'accord sur le besoin de nouvelles lois, on n'était divisé que sur le choix du législateur. On envoya donc à Athènes Spurius Postumius Albus, Aulus Manlius, Publius Sulpicius Camérinus, avec l'ordre de copier les célèbres lois de Solon, et de prendre connaissance des institutions des autres états de la Grèce, de leurs moeurs et de leurs droits. XXXII. [1] Les guerres étrangères ne troublèrent point cette année. Celle qui suivit, sous le consulat de Publius Curiatius et Sextus Quinctilius, fut encore plus paisible, grâce au silence que gardèrent constamment les tribuns. On en était redevable d'abord à l'envoi des députés à Athènes, à l'attente des lois qu'ils en devaient rapporter; [2] puis à deux fléaux terribles qui éclatèrent en même temps, la famine et la peste, également funestes aux hommes et aux bêtes. Les champs se dépeuplèrent; la ville s'épuisa en funérailles; une foule de maisons 136 illustres se couvrirent de deuil. [3] Le flamine de Quirinus Servius Cornélius succomba, et aussi l'augure Gaius Horatius Pulvillus; à sa place, les augures élurent Gaius Véturius avec d'autant plus d'empressement, qu'il avait été condamné par le peuple. [4] La mort frappa le consul Quinctilius et quatre tribuns du peuple. Une succession de désastres marqua cette année, qui d'ailleurs ne fut point troublée par l'ennemi. [5] Les consuls suivants furent Gaius Ménénius et Publius Sestius Capitolinus. Cette année se passa encore sans guerres étrangères; mais, à l'intérieur, des troubles s'élevèrent. [6] Déjà les envoyés étaient de retour avec les institutions d'Athènes. Les tribuns n'en apportaient que plus d'instance à demander qu'on se mit enfin à rédiger les lois. Ou convint de créer des décemvirs avec une autorité sans appel, et, pour cette année, de n'élire aucun autre magistrat. [7] Devait-on en choisir quelques-uns dans l'ordre des plébéiens ? On agita longtemps cette question. Enfin on céda aux patriciens, à condition seulement que la loi Icilia, au sujet du mont Aventin, et les autres lois sacrées, ne sauraient être abrogées. XXXIII .[1] L'an trois cent deux de la fondation de Rome, la forme de la constitution se trouve de nouveau changée, et l'autorité passe des consuls aux décemvirs, comme auparavant elle avait passé des rois aux consuls. [2] Ce changement eut moins d'éclat, parce qu'il eut peu de durée. D'heureux commencements furent suivis de trop d'abus, qui hâtèrent la chute de cette institution, et on en revint à deux magistrats, auxquels on rendit le titre et l'autorité de consuls. [3] Les décemvirs furent Appius Claudius, Titus Génucius, Publius Sestius, Lucius Véturius, Gaius Julius, Aulus Manlius, Publius Sulpicius, Publius Curiatius, Titus Romilius, Spurius Postumius. [4] Claudius et Génucius, qui avaient été désignés consuls pour cette année, obtinrent, en échange de cette dignité, la dignité du décemvirat, et cet honneur fut accordé à Sestius, l'un des consuls de l'année précédente, pour avoir, malgré l'opposition de son collègue, soumis celle affaire au sénat. [5] Après eux, on nomma les trois envoyés qui étaient allés à Athènes; on ne voulait pas qu'une mission si lointaine restât sans récompense; on pensait, d'ailleurs, que la connaissance qu'ils avaient acquise des lois étrangères serait utile à l'établissement d'un nouveau droit. [6] Les autres servirent à compléter le nombre. C'est, dit-on, sur des hommes appesantis par l'âge que se portèrent les derniers suffrages, dans l'idée qu'ils s'opposeraient avec moins de vivacité aux décisions de leurs collègues. [7] Le plus influent d'entre eux tous était Appius, que soutenait la faveur populaire; il avait si complètement revêtu un nouveau caractère, que, de cruel et implacable persécuteur du peuple, il en était devenu tout à coup le courtisan, et captait ses moindres faveurs. [8] Tous les dix jours chaque décemvir rendait au peuple la justice. et, durant cette présidence, il avait douze licteurs. Chacun de ses neuf collègues n'avait pour escorte qu'un seul appariteur. Dans un parfait accord entre eux, accord qui ne devait pas toujours être utile aux particuliers, ils observaient, à l'égard des autres, la plus scrupuleuse équité. [9] Pour montrer quelle était leur modération, un seul exemple suffira. On ne pouvait appeler de leurs décisions; cependant, un cadavre ayant été déterré dans la 137 maison de Publius Sestius, homme de famille patricienne; après qu'on l'eut découvert et porté devant l'assemblée, [10] le décemvir Gaius Julius, malgré l'évidence et l'atrocité du crime, se contenta de citer Sestius, et de traduire devant le peuple celui dont la loi le rendait juge : il se désista de son droit, pour que ce sacrifice de l'autorité du magistrat profitât à la liberté populaire. XXXIV. [1]Tandis que cette justice, incorruptible comme celle des dieux, se rendait également aux grands et aux petits, les décemvirs ne négligeaient pas la rédaction des lois. Pour satisfaire une attente qui tenait toute la nation en suspens, ils les présentèrent enfin sur dix tables, et convoquèrent l'assemblée du peuple. [2] « Pour le bonheur, pour la gloire, pour la prospérité de la république, pour la félicité des citoyens et celle de leurs enfants, ils les engageaient à s'y rendre et à lire les lois qu'on leur proposait. [3] Quant à eux, autant que dix têtes humaines en étaient capables, ils avaient établi entre les droits de tous, grands et petits, une exacte balance; mais on pouvait attendre davantage du concours de tous les esprits et de leurs observations réunies. [4] Ils devaient en particulier, et dans leur sagesse, peser chaque chose, la discuter ensuite, et déclarer sur chaque point ce qu'il y avait d'additions ou de suppressions à faire. [5] Ainsi, le peuple romain aurait des lois qu'il pourrait se flatter non seulement d'avoir approuvées, mais encore d'avoir proposées lui-même. » [6] Après que chacun des chapitres présentés eut subi les corrections indiquées par l'opinion générale, et jugées nécessaires, les comices par centuries adoptent les lois des dix tables. De nos jours, dans cet amas énorme de lois entassées les unes sur les autres, elles sont encore le principe du droit public et privé. [7] On répandit ensuite le bruit qu'il existait encore deux tables, dont la réunion aux autres compléterait en quelque sorte le corps du droit romain. Cette attente, à l'approche des comices, fit désirer qu'on créât de nouveau des décemvirs. [8] Le peuple lui-même, outre que le nom de consul ne lui était pas moins odieux que celui de roi, ne regrettait pas l'assistance tribunitienne; car les décemvirs souffraient qu'on appelât entre eux de leurs décisions. XXXV. [1] Mais, lorsqu'on eut indiqué le troisième jour de marché pour la réunion des comices qui devaient élire les décemvirs, [2] la brigue s'alluma si vive, que les premiers personnages eux-mêmes [dans la crainte, sans doute, que la possession d'une si grande autorité, s'ils laissaient le champ libre, ne tombât en des mains qui en seraient peu dignes] se mirent sur les rangs; et cette charge, qu'ils avaient repoussée de toutes leurs forces, ils la demandaient en suppliant à ce même peuple contre lequel ils s'étaient élevés. [3] En les voyant risquer leur dignité à cet âge, et après tous les honneurs dont ils avaient été chargés, Appius se sentit aiguillonné : il eût été difficile de dire s'il fallait le compter au nombre des décemvirs, ou parmi les candidats. [4] Il était par instants plus près de briguer que d'exercer sa magistrature : il décriait les hommes les plus recommandables, portait aux nues les plus insignifiants et les plus obscurs. [5] Lui-même, entouré de la faction tribunitienne, des Duilius, des Icilius, parcourait le forum, et, par eux, se faisait valoir auprès du peu- 138 ple. Ce fut au point que ses collègues eux-mêmes, tout entiers à lui jusqu'à ce moment, ouvrirent enfin les yeux, et se demandèrent ce qu'il prétendait. [6] Ils ne voyaient rien de sincère sous ces apparences : « Sûrement cette affabilité dans un homme si superbe n'était pas désintéressée. Cette affectation de se mêler avec la populace, et ces familiarités avec de simples particuliers, étaient moins d'un homme empressé de se démettre de sa charge que d'un ambitieux qui cherchait à s'y continuer. » [7] N'osant encore s'opposer ouvertement à son ambition, ils entreprennent d'en paralyser les efforts, en feignant de les seconder. D'un commun accord, ils lui assignent la présidence des comices, sous prétexte qu'il était le plus jeune. [8] Cet artifice avait pour but de l'empêcher de se nommer lui-même, ce dont personne, à l'exception des tribuns du peuple, n'avait jamais donné le détestable exemple. Mais lui, après avoir invoqué le bien de l'état, se chargea de tenir les comices, et sut tirer parti de l'obstacle qu'on lui suscitait. [9] Il écarte par ses cabales les deux Quinctius, Capitolinus et Cincinnatus, son oncle Gaius Claudius, constant défenseur de la cause des patriciens et d'autres citoyens d'un rang aussi élevé; il fait élire au décemvirat des hommes qui étaient bien loin de les égaler en illustration. [10] Lui-même se nomme le premier, et encourt par ce fait des reproches d'autant plus amers qu'on croyait cette audace impossible. [11] On nomma avec lui Marcus Cornélius Maluginensis, Marcus Sergius, Lucius Minucius, Quintus Fabius Vibulanus, Quintus Poetilius, Titus Antonius Mérenda, Kaeso Duillius, Spurius Oppius Cornicen, Manius Rabuléius. XXXVI. [1] Dès ce moment Appius jeta le masque; il s'abandonna bientôt à son caractère, et réussit à façonner ses nouveaux collègues à ses manières avant même qu'ils fussent entrés en charge. [2] Chaque jour ils se rassemblaient sans témoins; après avoir arrêté de concert les plans ambitieux que chacun préparait en secret, ils cessèrent de déguiser leur orgueil. Difficiles à aborder, répondant à peine, ils atteignirent ainsi les ides de mai, [3] époque où les magistrats entraient alors en charge. Dès le début, le premier jour de leur magistrature se signala par un appareil de terreur. Les premiers décemvirs avaient établi qu'un seul aurait les douze faisceaux, et cette marque de souveraineté royale passait à tour de rôle à chacun d'entre eux. Ceux-ci parurent tous ensemble, précédés chacun de douze faisceaux. [4] Cent vingt licteurs remplissaient le forum; ils portaient des haches attachées aux faisceaux, et le motif sur lequel s'appuyaient les décemvirs, pour ne point supprimer la hache, c'est qu'ils étaient revêtus d'un pouvoir sans appel. [5] C'étaient dix rois pour l'appareil; et la terreur se propageait à la fois parmi les moindres citoyens et les patriciens les plus illustres, par l'idée qu'on cherchait ainsi à provoquer, à commencer le massacre. Qu'une voix favorable à la liberté vînt à s'élever dans le sénat ou devant le peuple, aussitôt les verges et les haches la réduiraient au silence et rendraient les autres muettes d'effroi. [6] En effet, outre qu'on ne pouvait recourir au peuple, l'autorité des décemvirs était sans appel; par leur accord ils empêchaient qu'on ne pût appeler de leurs décisions particulières à 139 celles de leurs collègues; différents en cela de leurs prédécesseurs, qui avaient souffert que par ce moyen on modifiât leurs jugements, et qui même avaient renvoyé devant le peuple certaines affaires qui semblaient être de leur ressort. [7] Quelque temps une égale terreur régna sur toutes les classes; mais peu à peu elle s'appesantit tout entière sur les plébéiens. On ménageait les patriciens; ce fut au bas peuple que s'attaquèrent le caprice et la cruauté. Dans toutes les causes portées à leur tribunal, ils ne considéraient que la qualité des personnes, et la faveur usurpait tous les droits de l'équité. [8] Leurs arrêts étaient d'avance forgés chez eux; ils les prononçaient au forum. Appelait-on d'un décemvir à son collègue ? On s'en retournait avec le repentir de ne s'en être pas tenu à la décision du premier. [9] Un bruit, dont on ignorait l'auteur, s'était même répandu que leur conspiration ne limitait pas au temps actuel l'asservissement de la république; mais qu'un accord clandestin les avait entre eux engagés par serment à ne point réunir les comices, et à perpétuer leur décemvirat pour conserver le pouvoir qu'ils avaient dans les mains. XXXVII .[1] Le peuple alors jette autour de lui ses regards; il les porte sur les patriciens, épiant un souffle de liberté du côté d'où naguère ses soupçons n'attendaient que la servitude, soupçons qui ont amené la république à cet état de malheur. [2] Les chefs du sénat détestaient les décemvirs, détestaient le peuple. S'ils désapprouvaient ce qui se passait, c'était avec la pensée que ces violences avaient été méritées. Ils refusaient leur secours à des hommes que leur avidité pour la liberté avait plongés dans l'esclavage, [3] et voulaient laisser les griefs s'accumuler pour que le dégoût du présent fît du retour des consuls et de l'ancien état de choses un objet de désir. [4] Déjà s'était écoulée la plus grande partie de l'année, et deux tables de lois avaient été ajoutées aux dix tables de l'année précédente; une fois ces tables adoptées par les comices, il n y avait plus de raison pour que la république eût encore besoin de la nouvelle magistrature. [5] On attendait que bientôt seraient convoqués les comices pour la nomination des consuls. Ce qui seul inquiétait le peuple, c'était de savoir comment la puissance tribunitienne, boulevard de la liberté, et dont il avait interrompu l'existence, pourrait se rétablir. [6] Il n'est fait cependant nulle mention des comices; et les décemvirs, qui d'abord pour se farder de popularité affectaient de paraître avec d'anciens tribuns, se forment un entourage de jeunes patriciens dont la foule assiège leurs tribunaux. [7] Ils y traînent, ils y poursuivent le peuple corps et biens : la fortune était alors à celui qui la convoitait avec assez de puissance pour l'obtenir. [8] Bientôt même, on cessa de respecter les personnes; les uns furent frappés de verges, les autres de la hache. Et, pour que la cruauté ne fût point stérile, la confiscation des biens suivait le supplice du possesseur. L'appât de ces récompenses corrompit la jeune noblesse, qui, loin de s'opposer à l'usurpation, préférait ouvertement à la liberté de tous la licence dont elle jouissait. XXXVIII . [1] Les ides de mai arrivèrent. On n'avait substitué aux décemvirs aucun autre magistrat : quoique rendus à la vie privée, ils se mon- 140 trèrent en public sans rien diminuer de leur arrogance dans l'exercice du pouvoir, rien de l'appareil qui entourait leur dignité. La tyrannie n'était plus douteuse. [2] On pleure la liberté perdue sans retour. Nul vengeur ne se présente ou n'apparaît dans l'avenir. Les Romains n'étaient pas seuls à douter de leur courage; déjà ils devenaient un objet de mépris pour les nations voisines, honteuses de reconnaître un empire là où n'était point la liberté. [3] Les Sabins, réunis en un corps nombreux, font une incursion sur !es terres de Rome, promènent au loin leurs ravages, emmènent, sans obstacle, comme butin, quantité d'hommes et d'animaux, et rallient à Érétum leurs bandes dispersées; ils y établissent leur camp, espérant tout de la discorde des Romains, et se flattant qu'elle serait un obstacle à l'enrôlement. [4] Ces nouvelles, confirmées par la fuite des gens de la campagne, répandent l'effroi dans la ville. Les décemvirs tiennent conseil. Isolés entre la haine des patriciens et celle du peuple, ils reçoivent encore de la fortune un surcroît de terreur. [5] Les Èques, dans une autre direction, ont placé leur camp sur l'Algide. Ils étendent de là leurs courses et leurs ravages sur le territoire de Tusculum; et des envoyés de cette ville en apportent la nouvelle et implorent du secours. [6] Vaincus par la peur, les décemvirs se décident à consulter le sénat sur ces deux guerres qui les pressent à la fois. Ils font sommer les sénateurs de se rendre à l'assemblée, n'ignorant point quels orages de haine allaient fondre sur eux. [7] La désolation des campagnes, la cause des périls dont on était menacé, leur seraient sans nul doute imputées. On chercherait à étouffer, dans leurs mains, leur magistrature, s'ils ne résistaient par leur bon accord et si des coups d'autorité sur quelques-uns des plus audacieux ne réprimaient les tentatives des autres. [8] Lorsqu'on entendit, au forum, la voix du crieur qui convoquait les sénateurs à se réunir auprès des décemvirs, ce fut comme un événement nouveau; car on avait, depuis longtemps, négligé la coutume de prendre l'avis du sénat : le peuple en fut dans l'étonnement. « Qu'était-il donc arrivé, pour que, après un si long intervalle, on reprît les anciens usages ? [9] C'était aux ennemis et à la guerre qu'il fallait rendre grâces, si l'on observait encore quelque forme de liberté. » On parcourt des yeux toutes les parties du forum pour y chercher les sénateurs; mais à peine en peut-on découvrir un. [10] De là on se porte à la salle du sénat, on y observe la solitude qui règne autour des décemvirs. Ceux-ci comprirent alors combien la haine de leur pouvoir était générale, et le peuple vit bien, dans l'absence des sénateurs, leur refus de reconnaître à des particuliers le droit de convoquer le sénat. « C'était le commencement d'un retour à la liberté; si le peuple marchait d'accord avec le sénat, et si, à l'exemple des sénateurs, qui refusaient, malgré la convocation, de se réunir en assemblée, lui, de son côté, repoussait l'enrôlement. » [11] Voilà ce que murmurait la foule. À peine voyait-on un sénateur dans le forum; fort peu se trouvaient à la ville. Dégoûtés de l'état des choses, ils s'étaient retirés dans leurs terres, occupés de leurs intérêts particuliers, au défaut des intérêts publics, et persuadés qu'ils seraient d'autant plus à l'abri des vexations, qu'ils s'éloigneraient davantage de la société et de la 141 présence de leurs farouches oppresseurs. [12] Comme ils ne s'étaient point rendus à la première sommation, on envoya, dans leurs maisons, des appariteurs pour prendre les gages des amendes et s'informer si leur refus était prémédité. Les appariteurs rapportent que les sénateurs sont dans leurs terres. Les décemvirs aimaient mieux qu'il en fût ainsi que de savoir les sénateurs présents et rebelles à leur autorité. [13] Ils ordonnent de les mander tous, et fixent l'assemblée au lendemain. Elle fut plus nombreuse encore qu'ils ne l'avaient espéré : le peuple en conclut que les patriciens trahissaient la cause de la liberté, puisque le sénat reconnaissait le droit de convocation à des hommes dont la charge était expirée, et que la violence seule élevait au-dessus des simples citoyens. XXXIX. [1] Mais les sénateurs mirent plus d'obéissance à se rendre à l'assemblée, que de soumission dans leurs avis. [2] On rapporte que Lucius Valérius Potitus, après la proposition d'Appius Claudius, et avant qu'on ne recueillît par ordre les suffrages, demanda la permission de parler de la république; sur les menaces prohibitives des décemvirs, il déclara qu'il porterait sa dénonciation devant le peuple, et excita une vive agitation dans l'assemblée. [3] Ce fut avec une égale intrépidité que Marcus Horatius Barbatus se présenta dans cette lutte. « Il les nommait les dix Tarquins; il leur rappelait que les Valérius et les Horatius étaient à la tête des Romains quand on expulsa les rois. [4] Et ce n'était pas qu'on fût alors choqué d'un nom qu'il était permis de donner à Jupiter; d'un nom qu'avaient porté Romulus, fondateur de Rome, et ses successeurs après lui; d'un nom que la religion avait conservé dans les solennités de ses sacrifices. C'était l'orgueil et la violence des rois, qui avaient alors soulevé la haine. [5] Ce que personne n'avait supporté d'un roi, ou du fils d'un roi, qui donc le supporterait chez tant de simples citoyens ? [6] Qu'ils prissent garde, en prohibant dans le sénat la liberté de la parole, de la pousser à se faire entendre au-dehors; car il ne voyait pas pourquoi lui, simple particulier, n'aurait pas autant le droit d'assembler le peuple, qu'ils l'avaient eux-mêmes de convoquer le sénat. [7] Il ne tenait qu'à eux d'éprouver combien la douleur, combattant pour la liberté, est plus énergique que la cupidité luttant pour une injuste domination. [8] On proposait de délibérer sur la guerre contre les Sabins, comme si le peuple romain avait quelque ennemi plus redoutable que ceux qui, créés pour faire des lois, n'avaient laissé subsister dans l'état aucune ombre de légalité; par qui, comices, magistrats annuels, succession dans l'autorité, unique gage d'une égale liberté, tout avait été renversé; qui enfin, simples particuliers, conservaient les faisceaux et une autorité royale ! [9] Les rois, une fois expulsés, on avait créé des magistratures patriciennes; puis, après la retraite du peuple, des magistratures plébéiennes. Mais, on le demandait, à quel ordre ceux-ci appartenaient-ils ? À celui du peuple ? Qu'avaient-ils donc fait par le peuple ? À celui des patriciens ? eux qui, depuis près d'une année, n'avaient pas convoqué le sénat, et qui ne l'assemblent aujourd'hui que pour défendre de parler de la république ? [10] C'était trop compter sur la terreur qu'ils inspiraient : les maux qu'on endurait semblaient enfin plus cruels que ceux qu'on pouvait avoir à craindre. » 142 XL. [1] À cette violente sortie d'Horatius, les décemvirs ne trouvèrent de refuge ni dans la colère ni dans la patience, et ne surent par quel biais se tirer d'affaire. [2] Gaius Claudius, oncle d'Appius le décemvir, vint alors, dans un discours auquel les prières avaient plus de part que les reproches, le supplier, par les mânes de son frère, par les mânes paternels, [3] « de respecter les liens de la société où il était né, plutôt que cette sacrilège alliance qu'il avait contractée avec ses collègues; c'était pour lui qu'il lui adressait cette prière, bien plus que pour la république. [4] La république, après tout, si elle ne peut obtenir leur assentiment, rentrera, malgré eux, dans ses droits. Mais les grandes collisions amènent de grands ressentiments; il tremblait sur les suites. » [5] Bien que les décemvirs eussent, par leurs défenses, exclu de la discussion tout objet étranger à celui qu'ils mettaient en délibération, ils eurent assez de pudeur pour ne pas interrompre Claudius. Il développa donc son opinion, et conclut à ce que le sénat ne prît aucun arrêté. [6] Tous comprirent par là que Claudius regardait les décemvirs comme de simples citoyens, et nombre de personnages consulaires applaudirent à ces paroles. [7] Un autre avis, plus menaçant en apparence, mais en effet moins hostile, proposait aux sénateurs de se concerter pour nommer un interroi. Délibérer, c'était reconnaître pour magistrats, quels qu'ils fussent, ceux qui avaient convoqué le sénat; tandis qu'on les replaçait dans la vie privée si l'on suivait l'avis qui refusait au sénat le pouvoir de prendre un arrêté. [8] Au moment où la cause des décemvirs allait échouer, Lucius Cornélius Maluginensis, frère de Marcus Cornélius, l'un d'entre eux, et que l'on avait, à dessein, réservé pour parler après tous les autres consulaires, feignit une grande sollicitude pour la guerre, et prit en réalité la défense de son frère et des autres décemvirs. [9] « Il ne concevait pas, disait-il, par quelle fatalité les décemvirs rencontraient, parmi ceux qui avaient brigué le décemvirat, leurs seuls ou du moins leurs plus violents adversaires; [10] ni comment, après tant de mois écoulés sans que la cité fût menacée au-dehors, lorsque personne, pendant tout ce temps, n'avait élevé de contestation sur la validité du pouvoir des magistrats qui dirigeaient l'état, on profitait du moment où l'ennemi était, pour ainsi dire, aux portes, pour semer les discordes civiles; à moins qu'on n'eût songé à profiter du désordre pour jeter quelque ombre sur l'exécution d'un projet arrêté. [11] Du reste, il était juste qu'alors que des soins plus sérieux occupaient les esprits, personne ne préjugeât une si grave question. Il était bien d'avis, ajoutait-il, que, lorsqu'on aurait terminé ces guerres imminentes, lorsque la république serait rendue à la tranquillité, les allégations de Valérius et d'Horatius, qui prétendaient que les décemvirs avaient dû quitter leur magistrature avant les ides de mai, fussent soumises aux délibérations du sénat; [12] et que, dès ce moment, Appius Claudius fût prévenu qu'il devait se préparer à rendre compte des comices que, lui décemvir, il avait tenus pour nommer des décemvirs, et à répondre s'ils avaient été créés pour une année seulement, ou jusqu'à l'acceptation des lois que l'on attendait. [13] Quant à présent, tout ce qui n'était pas la guerre devait être écarté; si l'on pensait que les bruits en fussent mal fondés, et que les messagers et même les députés de Tus- 143 culum n'eussent apporté que de vaines frayeurs, il fallait envoyer des commissaires chargés de prendre des informations plus précises. [14] Si, au contraire, on ajoutait foi aux récits des courriers et des envoyés, on devait immédiatement s'occuper de lever des troupes; les décemvirs devaient conduire les armées partout où ils le jugeraient convenable; rien ne devait l'emporter sur ce soin. » XLI. [1] Les plus jeunes sénateurs insistaient pour qu'on se rangeât à cet avis. Mais, plus animés que jamais, Valérius et Horatius se lèvent et s'écrient : « Qu'ils ont à parler sur la république. Ils s'adresseront au peuple, si, dans cette enceinte, une faction les empêche de se faire entendre. Ils nient que des hommes privés, en présence des sénateurs ou du peuple, puissent leur imposer silence; de chimériques faisceaux ne sauraient les faire reculer. » [2] Appius, alors, voyant que, s'il n'opposait à leur violence une égale audace, c'en était fait du décemvirat, [3] « Malheur, s'écrie-t-il, à qui élèvera la voix en dehors de la question ! » Et, comme Valérius déclarait qu'il ne se tairait pas sur l'ordre d'un simple citoyen, il fit avancer un licteur. [4] Déjà Valérius implorait, du seuil de l'assemblée, l'assistance du peuple : Lucius Cornélius retient Appius dans ses bras, déguisant ainsi l'intérêt qu'il lui porte; il met un terme au débat, et obtient pour Valérius la faculté de s'expliquer librement. Cette liberté ne produisit que des déclamations, et les décemvirs obtinrent ce qu'ils demandaient. [5] Les consulaires eux-mêmes et les plus vieux sénateurs, par un fonds de haine pour la puissance tribunitienne, dont le peuple, à leur avis, désirait bien plus ardemment le retour que celui de l'autorité consulaire, aimaient mieux, en quelque sorte, attendre que les décemvirs sortissent volontairement de charge, que de voir le peuple, en haine des décemvirs, se soulever de nouveau. [6] « Si par des voies de douceur, pensaient-ils, et sans la tumultueuse intervention de la multitude, on ramenait le pouvoir aux mains des consuls, les guerres qu'on ferait intervenir, ou la modération des consuls dans l'exercice de leur autorité, pourraient conduire le peuple à l'oubli de ses tribuns. » [7] Le silence du sénat fut l'édit d'enrôlement. Les jeunes gens, n'osant résister à un pouvoir sans appel, apportent leurs noms. Les légions enrôlées, les décemvirs désignent, parmi eux, ceux qui feront la guerre, ceux qui commanderont les armées. [8] Les chefs du décemvirat étaient Quintus Fabius et Appius Claudius. La guerre s'annonçait plus redoutable au-dedans qu'au-dehors. Le caractère violent d'Appius semblait plus propre à étouffer un mouvement populaire; Fabius avait montré moins de persévérance dans le bien, que d'ardeur pour le mal. [9] Cet homme s'était distingué d'abord comme citoyen et comme soldat; mais le décemvirat et ses collègues opérèrent sur lui un changement tel, qu'il aimait mieux copier Appius, que de rester semblable à lui-même. On lui confia la guerre des Sabins, et il eut pour collègues Manius Rabuléius et Quintus Poetélius. [10] Marcus Cornélius fut envoyé vers l'Algide avec Lucius Minucius, Titus Antonius, Kaeso Duillius et Marcus Sergius. Spurius Oppius demeura avec Appius, pour l'aider à défendre la ville, et leur pouvoir fut égalé à celui de tous les décemvirs réunis. 144 XLII .[1] Au-dehors, comme au-dedans, la république fut malheureuse. [2] L'unique tort des chefs était de s'être attiré la haine de leurs concitoyens; toute la faute fut d'ailleurs aux soldats. Pour empêcher qu'aucun succès n'eût lieu sous la conduite et les auspices des décemvirs, ils se laissaient vaincre, achetant, au prix de leur déshonneur, le déshonneur de leurs chefs. [3] Mis en déroute par les Sabins à Érétum, ils le furent sur l'Algide par les Èques. Les fuyards d'Érétum, profitant du calme de la nuit, se rapprochent de la ville, et, entre Fidènes et Crustumérie, se retranchent sur une hauteur. [4] L'ennemi les y suit; mais ils n'osent égaliser le combat, et cherchent leur sûreté dans la force de leur position et de leurs retranchements, bien plus que dans leur courage et dans leurs armes. [5] La honte fut plus grande encore en Algide, et plus grande la perte. L'ennemi s'empara même du camp. Dépouillé de tous ses bagages, le soldat se réfugie à Tusculum, espérant l'hospitalité de la bonne foi et de la pitié, qui, d'ailleurs, ne lui manquèrent pas. [6] À Rome, la terreur fut si grande, que les sénateurs, oubliant leur haine pour le décemvirat, décrétèrent qu'on établît des postes dans la ville : ceux à qui leur âge permettait de porter les armes devaient protéger les murs et former une garde devant les portes. [7] Ils envoyèrent à Tusculum un secours d'armes, aux décemvirs l'ordre de sortir de la citadelle, de tenir les soldats dans un camp, de transporter celui de Fidènes sur les terres des Sabins, et, par une guerre offensive, d'ôter à l'ennemi toute pensée d'assiéger la ville. XLIII. [1] À ces désastres causés par l'ennemi, les décemvirs ajoutent deux crimes affreux, l'un au camp, et l'autre dans Rome. [2] Lucius Siccius, qui servait dans l'armée dirigée contre les Sabins, exploitant la haine qui s'attachait aux décemvirs, engageait secrètement les soldats à rétablir les tribuns et à se révolter. On l'envoie reconnaître une position pour y placer un camp, [3] et des soldats l'escortent, avec ordre de se défaire de lui au premier endroit favorable. [4] Il ne succomba point sans vengeance. Il fit, en se débattant, tomber autour de lui plusieurs de ses assassins, et, environné de toutes parts, se défendit avec un courage égal à sa force extraordinaire. [5] Le reste revient annoncer au camp que Siccius, malgré des prodiges de valeur, a péri dans une embuscade, et quelques soldais avec lui. [6] On crut d'abord ceux qui rapportèrent ces nouvelles. Une cohorte partit donc avec la permission des décemvirs, pour ensevelir les morts; mais n'en voyant aucun dépouillé, et trouvant Siccius revêtu de ses armes, étendu au milieu des autres, qui tous avaient le visage tourné contre lui; n'apercevant le corps d'aucun des ennemis, nulle trace de leur retraite, ils ne doutèrent point que Siccius n'eût péri de la main des siens, et ils rapportèrent son cadavre. [7] L'irritation fut à son comble dans le camp, et c'est à Rome qu'on voulait sur-le-champ transporter Siccius. Mais les décemvirs se hâtèrent de lui décerner des funérailles militaires aux frais de l'état. On l'ensevelit au milieu des regrets des soldats, et de l'exécration que le nom des décemvirs avait excitée parmi le peuple. 145 XLIV. [1] La ville fut ensuite témoin d'un forfait enfanté par la débauche, et non moins terrible dans ses suites que le déshonneur et le meurtre de Lucrèce, auquel les Tarquins durent leur expulsion de la ville et du trône; comme si les décemvirs étaient destinés à finir ainsi que les rois et à perdre leur puissance par les mêmes causes. [2] Appius Claudius s'enflamma d'un amour criminel pour une jeune plébéienne. La père de cette fille, Lucius Verginius, un des premiers centurions à l'armée de l'Algide, était l'exemple des citoyens, l'exemple des soldats. Sa femme avait vécu comme lui, et ses enfants étaient élevés dans les mêmes principes. [3] Il avait promis sa fille à Lucius Icilius, ancien tribun, homme passionné, et qui plus d'une fois avait fait preuve de courage pour la cause du peuple. [4] Épris d'amour pour cette jeune fille, alors dans tout l'éclat de la jeunesse et de la beauté, Appius entreprit de la séduire par les présents et les promesses; mais voyant que la pudeur lui interdisait tout accès, il eut recours aux voies cruelles et odieuses de la violence. [5] Marcus Claudius, son client, fut chargé de réclamer la jeune fille comme son esclave, sans écouter les demandes de liberté provisoire. L'absence du père semblait favorable à cette criminelle tentative. [6] Virginie se rendait au forum, où se tenaient les écoles des lettres. L'attidé du décemvir, le ministre de sa passion, met sur elle les mains, et s'écrie que fille de son esclave, esclave elle-même, elle doit le suivre; si elle résiste, il l'entraînera de force. [7] Tremblante, la jeune fille demeure interdite, et, aux cris de sa nourrice qui invoque le secours des Romains, on se réunit en foule. Les noms si chers de Verginius, son père, et d'Icilius, son fiancé, sont dans toutes les bouches. Leurs amis, par l'intérêt qu'ils leur portent, la foule par l'horreur d'un pareil attentat. se rallient à elle. [8] Déjà Virginie est à l'abri de toute violence. Claudius alors s'écria qu'il est inutile d'ameuter la foule, qu'il veut recourir à la justice et non à la violence. Il cite devant le juge la jeune fille, que les défenseurs engagent à l'y suivre. [9] On arrive devant le tribunal d'Appius, et le demandeur débite sa fable bien connue du juge, qui lui-même en était l'auteur : il raconte que « la jeune fille, née dans sa maison, puis introduite furtivement dans celle de Virginius, a été présentée à celui-ci comme son enfant. [10] Il produira des preuves à l'appui de ses assertions, et les soumettra à Verginius lui-même, plus lésé que nul autre par cette supercherie. » [11] Les défenseurs de Virginie remontrèrent que Virginius était absent pour le service de la république; qu'il arriverait. dans deux jours, s'il était prévenu, et qu'en son absence il serait injuste de décider du sort de ses enfants. [12] Ils demandent au décemvir que l'affaire soit renvoyée dans son entier après l'arrivée du père; qu'au nom de la loi, son ouvrage, il accorde la liberté provisoire, et ne souffre pas qu'une jeune fille soit exposée à perdre son honneur avant sa liberté. XLV. [1] Appius, prenant la parole, avant de prononcer son arrêt dit « Que sa sollicitude pour la liberté est écrite dans cette même loi que les amis de Verginius invoquent à leur appui. [2] Cependant elle ne saurait favoriser la liberté au point d'admettre la supposition des faits et des personnes. Certes, lorsqu'on réclame la sortie d'esclavage, 146 comme chacun peut agir d'après la loi, la liberté provisoire est incontestable; quant à cette fille, soumise au pouvoir paternel, il n'est personne, le père excepté, à qui le maître doive la céder. [3] Il est donc à propos qu'on fasse venir le père; cependant le demandeur ne peut faire le sacrifice de ses droits; il lui est permis d'emmener la jeune fille; il suffit qu'il promette de la représenter à l'arrivée de celui que l'on dit être son père. » [4] Au moment où l'iniquité de ce jugement excitait plus de murmures qu'il n'enhardissait de gens à réclamer, Publius Numitorius, oncle de la jeune fille, et Icilius, son fiancé, se présentent. [5] La foule leur ouvre un chemin, persuadée que l'intervention d'lcilius est le moyen le plus puissant pour résister à Appius, lorsque le licteur déclare « Que l'arrêt est prononcé, » et veut écarter Icilius, en dépit de ses cris. [6] Le caractère le plus paisible se fût enflammé à une si criante injustice. « C'est par le fer, Appius, qu'il faudra m'éloigner d'ici, si tu veux couvrir du silence le mystère de tes desseins. Cette jeune vierge sera ma femme : je la veux chaste et pure. [7] Réunis donc les licteurs de tous tes collègues, ordonne de préparer les verges et les haches; on ne retiendra point hors de la maison paternelle la fiancée d'lcilius. [8] Non, malgré la perte du tribunat et de l'appel au peuple, les deux boulevards de la liberté romaine, nos femmes, nos enfants n'ont point été livrés encore au despotisme de vos passions. [9] Exercez votre fureur sur nos corps et sur nos têtes, mais que la pudeur soit au moins respectée. Si l'on a recours à la violence contre cette fille, nous invoquerons, moi, pour ma fiancée, le secours des Romains qui m'entendent; Verginius, pour sa fille unique, celui des soldats; tous, l'assistance des dieux et des hommes, et tu n'obtiendras qu'en nous égorgeant l'exécution de ton arrêt. [10] Je t'en conjure, Appius, considère deux fois où tu vas t'engager. [11] Verginius, à son arrivée, verra ce qu'il doit faire pour sa fille. Qu'il sache seulement que s'il cède un instant à Claudius, il lui faudra chercher pour elle un autre époux. Quant à moi, je ne cesserai de réclamer la liberté de ma fiancée, et la vie me manquera plus tôt que la constance. » XLVI. [1] La multitude était émue, et la lutte paraissait imminente. Les licteurs entourent Icilius; tout se borne cependant à des menaces. [2] Appius prétend « Que ce n'est pas Virginie que défend Icilius; mais que cet homme turbulent, et qui respire encore le tribunat, cherche à faire naître une émeute. Il ne lui en fournira point aujourd'hui l'occasion. [3] Qu'il le sache bien toutefois : ce n'est pas à ses emportements, mais à l'absence de Verginius, au titre de père, et à son respect pour la liberté, qu'il accorde de suspendre ses fonctions de juge et l'exécution de son arrêt. Il demandera à Claudius de se relâcher quelque peu de ses droits, et de permettre que la jeune fille jouisse de la liberté jusqu'au lendemain. [4] Si le père ne comparaît pas le jour d'après, il annonce à Icilius et à ses pareils que le législateur ne manquera point à sa loi, non plus que l'énergie au décemvir. Il n'aura nul besoin de réunir les licteurs de ses collègues pour mettre à la raison les auteurs de la sédition; il lui suffira des siens. » [5] L'injustice 147 ajournée, les défenseurs de Virginie se retirent et décident qu'avant tout le frère d'lcilius et le fils de Numitorius, jeunes gens pleins d'ardeur, gagneront de ce pas la porte, et courront en toute hâte chercher au camp Verginius. [6] De cette démarche dépend le salut de sa fille, si le lendemain il arrive à temps pour la préserver de l'injustice. Ils obéissent, se mettent en marche, et courent à bride abattue porter au père ce message. [7] Comme le demandeur insistait pour qu'on lui assurât par caution la comparution de la jeune fille, et qu'Icilius disait s'en occuper pour gagner du temps et donner de l'avance à ses courriers, la foule, de toutes parts, leva les mains, et chacun se montra prêt à répondre pour lui. [8] Ému jusqu'aux larmes, « Merci, s'écria-t-il, demain j'userai de vos secours, c'est assez de répondants pour aujourd'hui. » Virginie est donc provisoirement remise en liberté, sous la caution de ses proches. [9] Appius siège encore quelques instants, pour ne pas paraître occupé de cette seule affaire; mais comme l'intérêt de celle-là absorbait toutes les autres, personne ne se présentant, il se retira chez lui pour écrire au camp à ses collègues, « de n'accorder aucun congé à Verginius, et de s'assurer de sa personne. » [10] Cet avis perfide arriva trop tard, ce qui devait être; et déjà, muni de son congé, Verginius était parti dès la première veille. Le lendemain, furent remises les lettres qui ordonnaient de le retenir; elles restèrent sans effet. XLVII. [1] À Rome, cependant, au point du jour, l'attente tenait, dans le forum, toute la ville en suspens, lorsque Verginius, dans l'appareil du deuil, conduisant sa fille, les habits en lambeaux, accompagné de quelques femmes âgées et d'une foule de défenseurs, s'avance sur la place publique. [2] Il en fait le tour, et sollicite l'appui de ses concitoyens. Il ne s'en tient pas à implorer leur secours, il le réclame comme prix de ses services. « C'est pour leurs enfants, pour leurs femmes, que, chaque jour, il se montre sur le champ de bataille, et il n'est point de soldat dont on cite plus de traits d'audace et d'intrépidité. Mais quel avantage en résulte-t-il, si, tandis que la ville jouit de la plus parfaite sécurité, leurs enfants ont à souffrir les horreurs que pourrait amener une prise d'assaut ? » [3] C'est ainsi qu'il haranguait les citoyens, en passant au milieu d'eux. De semblables plaintes s'échappaient de la bouche d'lcilius. Mais ce cortège de femmes en silence et en pleurs touchait plus encore que leurs paroles. [4] Le caractère obstiné d'Appius se raidit contre ces dispositions, tant le délire, bien plus que l'amour, avait troublé son esprit; il monte sur son tribunal. Après quelques plaintes qu'articula le demandeur « Sur ce que, pour capter la faveur du peuple, on lui avait, la veille, refusé justice, » sans lui laisser terminer sa requête, et sans donner à Verginius le temps de répondre, Appius prend la parole. [5] Le discours par lequel il motiva son arrêt peut se trouver fidèlement rapporté par quelques-uns de nos anciens auteurs; mais aucun ne paraît vraisemblable à côté d'un jugement si inique. Je me bornerai à rapporter simplement le fait, et à dire qu'Appius adjugea la jeune fille en qualité d'es- 148 clave. [6] La stupeur fut le premier effet d'une décision si surprenante et si atroce; elle fut suivie de quelques instants de silence. Mais lorsque Claudius s'avança au milieu des femmes polir s'emparer de Virginie, il fut reçu avec des pleurs et des cris lamentables. [7] Verginius, levant contre Appius son bras menaçant : « C'est à Icilius, dit-il, que j'ai fiancé ma fille, et non à Appius; c'est pour l'hymen, et non pour la honte, que je l'ai élevée. Tu veux donc, comme les brutes et les animaux sauvages, te jeter indistinctement sur le premier objet de ta passion ? Le souffriront-ils, ces citoyens ? Je ne sais; j'espère du moins que ceux qui ont des armes ne le souffriront pas. » [8] Le groupe des femmes et celui des défenseurs repoussaient Claudius loin de la jeune fille; mais le silence se rétablit à la voix du héraut. XLVIII. [1] Le décemvir, dans la démence de la passion, s'écrie : « Que ce n'est point seulement par les injures d'lcilius la veille, ni par la violence de Virginius, dont le peuple romain vient d'être témoin, mais encore par des avis certains qu'il est convaincu de l'existence de conciliabules secrets, tenus toute la nuit dans la ville, pour exciter une sédition. [2] Préparé à une lutte à laquelle il s'attendait, il est descendu au forum avec des hommes armés, non pour tourmenter de paisibles citoyens, mais pour réprimer, d'une manière digne de la majesté de son pouvoir, ceux qui troubleraient la tranquillité de Rome. [3] Demeurer en repos est donc la plus sage parti. Va, dit-il, licteur, écarte cette foule; ouvre au maître un chemin pour saisir son esclave. » Au ton courroucé dont il prononce ces paroles, la multitude s'écarte d'elle-même, et la jeune fille délaissée demeure en proie à ses ravisseurs. [4] Alors Verginius, n'espérant plus de secours : « Appius, dit-il, je t'en supplie, pardonne avant tout à la douleur d'un père l'amertume de mes reproches; permets ensuite qu'ici, devant la jeune fille, je demande à sa nourrice toute la vérité. » [5] Cette faveur obtenue, il tire à l'écart sa fille et la nourrice près du temple de Cloacine, vers l'endroit qu'on nomme aujourd'hui les Boutiques Neuves, et là, saisissant le couteau d'un boucher : « Mon enfant, s'écrie-t-il, c'est le seul moyen qui me reste de te conserver libre. » Et il lui perce le coeur. Levant ensuite les yeux vers le tribunal : « Appius, s'écrie-t-il, par ce sang, je dévoue ta tête aux dieux infernaux. » [6] Au cri qui s'élève à la vue de cette action horrible, le décemvir ordonne qu'on se saisisse de Verginius; mais celui-ci, avec le fer, s'ouvre partout un passage, et, protégé par la multitude qui le suit, gagne enfin la porte de la ville. [7] Icilius et Numitorius soulèvent le corps sanglant, et, le montrant au peuple, ils déplorent le crime d'Appius, cette beauté funeste, et la cruelle nécessité où s'est trouvé réduit un père. [8] Les femmes répètent, en les suivant avec des cris : « Est-ce pour un pareil destin que l'on met au monde des enfants ? Est-ce là le prix de la chasteté ? » Elles se livrent ensuite à tout ce que la douleur, d'autant plus sensible chez elles que leur esprit est plus faible, leur inspire en ce moment de plus lamentable et de plus touchant. [9] Mais les hommes, et surtout Icilius, n'avaient de paroles que pour réclamer la puissance tribunitienne et l'appel au peuple; et toute leur indignation était pour la patrie. 149 XLIX. [1] La multitude s'anime et par l'atrocité du crime, et dans l'espoir qu'il serait une occasion favorable de recouvrer sa liberté. [2] Le décemvir cite Icilius, et, sur son refus de comparaître, ordonne qu'on l'arrête. Comme on ne laissait pas approcher ses appariteurs, lui-même, suivi d'une troupe de jeunes patriciens, perce la foule et commande de le conduire dans les fers. [3] On voyait déjà autour d'lcilius la multitude et les chefs de la multitude, Lucius Valérius et Marcus Horatius. Ceux-ci repoussent le licteur, et offrent, si l'on prétend agir légalement, de se porter caution pour Icilius contre un homme privé; mais, si l'on emploie la force, on y saura répondre. [4] La lutte s'engage furieuse. Le licteur du décemvir veut porter la main sur Valérius et Horatius; le peuple brise les faisceaux. Appius monte à la tribune, Valérius et Horatius l'y suivent; le peuple les écoute et couvre de murmures la voix du décemvir. [5] Déjà, au nom de l'autorité, Valérius ordonne aux licteurs de s'éloigner d'un simple citoyen; Appius, dont le courage est abattu, et qui craint pour sa vie, se réfugie dans sa maison, voisine du forum, à l'insu de ses adversaires et la tête enveloppée de sa toge. [6] Spurius Oppius, voulant prêter secours à son collègue, se précipite, d'un autre côté, sur la place, et voit l'autorité vaincue par la force. Il flotte ensuite entre mille partis opposés, entre mille conseils différents, qu'il s'empresse tour à tour d'accueillir; il se décide enfin à convoquer le sénat. [7] Ainsi, voyant que la plus grande partie des patriciens désapprouvait la conduite des décemvirs, et, dans l'espoir que le sénat mettrait un terme à leur puissance, la multitude s'apaise. [8] Le sénat fut d'avis qu'il ne fallait point irriter le peuple, et qu'on devait songer surtout à empêcher que l'arrivée de Verginius à l'armée n'excitât quelque mouvement. L. [1] On dépêche donc au camp, qui se trouvait alors sur le mont Vécilius, les plus jeunes sénateurs, pour recommander aux décemvirs d'arrêter à tout prix la révolte parmi les soldats. [2] Mais Verginius y avait excité une effervescence plus grande encore que celle qu'il avait laissée à Rome. Outre qu'il parut avec une escorte de quatre cents citoyens que l'horreur de ces indignités avait amenés de la ville avec lui, [3] l'arme qu'il tenait toujours à la main, le sang dont il était couvert, attirent sur lui les regards. D'ailleurs, toutes ces toges, dispersées dans le camp, en grossissaient le nombre, et offraient l'apparence d'une multitude de citoyens. [4] On lui demande ce que c'est; il n'a que des larmes pour toute réponse. Mais sitôt que l'empressement de ceux qui accouraient eut réuni une foule nombreuse, on fit silence, et Verginius raconta les faits comme ils s'étaient passés. [5] Levant ensuite des mains suppliantes vers ses compagnons d'armes, il les conjure : « de ne pas lui imputer un crime qui est celui d'Appius Claudius; de ne pas se détourner de lui comme du bourreau de son enfant. La vie de sa fille lui eût été plus chère que la sienne propre, s'il avait pu la lui laisser libre et pure; mais la voir comme une esclave entraînée à la honte ! Non ! La mort de ses enfants lui semblait préférable à leur ignominie, et sa piété paternelle avait pris les formes de la 150 cruauté. [7] Il n'eût pu survivre à sa fille, sans l'espoir de venger sa mort avec l'aide de ses frères d'armes. Eux aussi ont des filles, des soeurs, des épouses : la mort de son enfant n'a point éteint la passion d'Appius; l'impunité accroîtra son audace. [8] Par le malheur d'autrui qu'ils apprennent à se mettre en garde contre de pareils outrages. Pour lui, le destin lui a ravi sa femme; sa fille, à qui il n'était plus permis de vivre chaste, est morte tristement, mais avec sa vertu. [9] Appius ne peut plus assouvir ses infâmes passions dans sa famille; toute violence qu'il pourrait tenter sur sa personne sera repoussée avec le même courage dont il défendit sa fille. C'est aux autres de veiller sur eux et sur leurs enfants. » [10] Aux cris de Verginius, la foule répondit : « qu'elle ne manquera ni à sa douleur ni à la liberté. » Les citoyens en toge, mêlés aux soldats, font entendre les mêmes plaintes; ils font sentir combien ce spectacle avait été plus affreux que ce simple récit; ils annoncent en même temps que c'en est déjà fait des décemvirs à Rome. [11] D'autres, arrivés plus tard, disent qu'Appius, à demi-mort, a fui en exil; tous enfin poussent les soldats à crier aux armes, à saisir leurs enseignes, et à partir pour la ville. [12] Les décemvirs, troublés de ce qu'ils voient et de ce qu'ils apprennent de Rome, courent sur différents points du camp, calmer l'agitation. S'ils emploient la douceur, on ne leur répond pas; s'ils invoquent leur autorité, « ils ont affaire à des hommes et à des hommes armés. » [13] Les soldats marchent en ordre vers la ville, et occupent l'Aventin. À mesure qu'on accourt, ils exhortent le peuple à recouvrer sa liberté et à créer des tribuns. Du reste, point de menaces. [14] Spurius Oppius convoque le sénat : celui-ci se refuse à toute mesure violente; car les décemvirs eux-mêmes ont provoqué cette sédition. [15] On envoie trois députés consulaires, Spurius Tarpéius, Gaius Julius, Publius Sulpicius, demander, au nom du sénat : « En vertu de quels ordres les soldats ont quitté le camp ? ce qu'ils prétendent faire en occupant armés le mont Aventin ? Ont-ils abandonné la guerre contre l'ennemi pour s'emparer de leur patrie ? » [16] À ces questions les réponses ne manquaient point; mais il manquait quelqu'un pour les faire. On était encore sans chef avoué, personne n'osant s'exposer seul à tant de haines. Seulement, un cri unanime s'éleva de la multitude; elle demande qu'on lui envoie Lucius Valérius et Marcus Horatius : c'est eux qu'on chargera d'une réponse. LI. [1] Au départ des députés, Verginius fait sentir aux soldats que, « dans une affaire de peu d'importance, ils viennent de se trouver embarrassés par le défaut de chefs; leur réponse, sage d'ailleurs, est plutôt l'effet d'un accord fortuit qu'une mesure concertée en commun. [2] Il les engage à nommer dix d'entre eux, chargés de la direction suprême, et de les décorer d'un titre militaire en les appelant tribuns des soldats. [3] Et, comme on voulait tout d'abord lui déférer cet honneur : « Remettez, dit-il, le choix dont vous m'honorez à des temps meilleurs et pour vous et pour moi. [4] Ma fille, restée sans vengeance, m'empêche de goûter aucune gloire. D'ailleurs au milieu des troubles de la république, il ne vous convient point d'avoir à votre tête les hommes chargés des plus fortes hai- 151 nes. [5] Si je puis vous servir utilement, je le ferai aussi bien simple particulier. » [6] Ainsi donc, on crée dix tribuns des soldats. L'armée envoyée contre les Sabins n'était pas plus tranquille. [7] Là aussi, excités par Icilius et Numitorius, les soldats se séparent des décemvirs. Le meurtre de Siccius, dont ils nourrissaient le souvenir, n'agitait pas moins les esprits que l'histoire de Virginie, victime d'un si houleux libertinage. [8] Icilius, dès qu'il apprit la création des tribuns des soldats sur l'Aventin, craignit que l'impulsion donnée par les comices militaires ne se fit sentir sur ceux de la ville et n'amenât la nomination des mêmes hommes. [9] Au fait des assemblées populaires et aspirant lui-même à ces honneurs, il fait nommer aux siens, avant de marcher sur Rome, un égal nombre de ces magistrats avec la même autorité. [10] Ils entrent par la porte Colline, enseignes déployées, traversent la ville en rangs, et se rendent sur l'Aventin. Là, réunis aux autres, ils chargent les vingt tribuns de nommer deux d'entre eux à la direction suprême des affaires. [11] Les suffrages se réunissent sur Marcus Oppius et Sextus Manilius. Le sénat, craignant pour l'avenir de la république, s'assemblait tous les jours, et consumait le temps en disputes plutôt qu'en délibérations. [12] On reprochait aux décemvirs le meurtre de Siccius, l'indigne passion d'Appius et les désastres des armées. On était d'avis que Valérius et Horatius se rendissent sur l'Aventin; mais eux s'y refusaient, à moins que les décemvirs ne déposassent les insignes de leur magistrature, expirée dès l'année précédente. [13] Les décemvirs se plaignent qu'on les dégrade et protestent qu'ils ne déposeront point leur autorité qu'on n'ait adopté les lois pour l'établissement desquelles on les a créés. LII. [1] Persuadé par les conseils de Marcus Duillius, ancien tribun, qu'il n'obtiendrait rien en prolongeant ces négociations, le peuple passe de l'Aventin sur le mont Sacré. [2] « Tant qu'ils n'abandonneront pas la ville, assurait Duillius, ils n'inspireraient au sénat aucune inquiétude; le mont Sacré devait lui rappeler la constance du peuple; il saurait que le rétablissement de la puissance tribunitienne peut seule ramener la concorde. » [3] Partis par la toute de Nomentum [voie Nomentana], appelée alors route de Ficuléa [voie Ficulensis], ils vont établir leur camp sur le mont Sacré, imitant la modération de leurs pères, et sans se livrer à aucune violence. Le peuple suivit l'armée, et pas un de ceux à qui l'âge le permettait ne resta en arrière. [4] À leur suite venaient leurs femmes, leurs enfants, demandant avec douleur pourquoi ils les laissaient dans une ville où la pudeur, la liberté, rien n'était sacré. [5] Rome n'était plus qu'une vaste et étrange solitude; on ne voyait que quelques vieillards dans le Forum : il parut un désert quand on convoqua le sénat. Déjà plusieurs voix, jointes à celles de Valérius et d'Horatius, s'écriaient : [6] « Qu'attendez-vous encore, sénateurs ? Si les décemvirs ne mettent pas une borne à leur obstination, souffrirez-vous que tout périsse dans une conflagration générale ? Quelle est donc, décemvirs, cette autorité que vous tenez comme embrassée ? Est-ce pour les toits et les 152 murailles que vous ferez des lois ? [7] N'avez-vous pas honte de voir dans le forum plus de vos licteurs que de citoyens en toge ? Que ferez-vous si l'ennemi marche sur vous ? Que ferez-vous si le peuple, voyant sa retraite sans effet, se présente en armes ? La chute de Rome est-elle nécessaire pour amener celle de votre autorité ? [8] Il faut vous passer du peuple ou lui rendre ses tribuns. Nous nous passerons plutôt, nous, de magistrats patriciens, que les plébéiens des leurs. [9] Avant de connaître, avant d'avoir éprouvé cette puissance, ils en arrachèrent l'établissement à nos aïeux : maintenant qu'ils en ont goûté les avantages, pensez-vous qu'ils veuillent y renoncer; dans un moment surtout où l'autorité n'emploie pas assez de ménagement pour qu'ils ne sentent pas la nécessité d'un appui ? » [10] Ces reproches retentissent de toutes parts, et les décemvirs, vaincus par cette unanimité, s'en remettent à la discrétion du sénat. Ils prient seulement et préviennent les sénateurs de les protéger contre la haine publique, pour que leur supplice n'accoutume pas ce peuple à voir répandre le sang des patriciens. LIII. [1] Alors Valérius et Horatius reçoivent mission de se rendre auprès du peuple, de lui faire, pour son retour, les conditions qu'ils jugeront convenables, et de préserver les décemvirs de la haine et de l'exécration de la multitude. [2] Ils partent, et les transports de joie du peuple les accueillent au camp. C'étaient sans contredit ses libérateurs; leurs efforts avaient commencé le mouvement et allaient le terminer. On leur rendit des actions de grâces à leur arrivée. Icilius parla au nom de tout le peuple. [3] Ce fut lui encore qui traita des conditions. Les députés demandèrent qu'on leur exposât ce que voulait le peuple; interprète des résolutions prises avant leur arrivée, Icilius fit des propositions de nature à prouver que le peuple comptait plus sur la justice de ses demandes que sur ses armes. [4] Il exigeait, en effet, le rétablissement de la puissance tribunitienne et de l'appel au peuple, qui, avant la création des décemvirs, étaient la sauvegarde du citoyen, et une amnistie générale pour tous ceux qui avaient engagé les soldats ou le peuple à se retirer pour recouvrer leur liberté. [5] Les décemvirs seuls furent de sa part l'objet d'une demande cruelle. Il trouvait juste qu'on les lui livrât, et menaçait de les brûler vifs. [6] Les députés répondirent : « Les demandes que vous avez délibérées en commun sont si justes, qu'on vous les eût de plein gré proposées : vous demandez des garanties pour votre liberté et non la faculté de nuire à celle des autres. [7] Votre ressentiment se pardonne; mais on ne saurait l'autoriser. En haine de la cruauté, vous devenez cruels, et presque avant d'être libres, vous voulez déjà tyranniser vos adversaires. [8] Est-ce donc que notre cité ne fera jamais trêve aux vengeances des patriciens contre le peuple, ou du peuple contre les patriciens ? Le bouclier vous convient mieux que l'épée. [9] C'est assez, c'est bien assez abaisser vos adversaires, que de les réduire à une égalité parfaite de droits, de leur ôter les moyens de nuire aux autres, en empêchant qu'on leur nuise. [10] Au reste, voulez-vous un jour qu'on vous redoute ? Recouvrez d'abord vos magistrats et vos droits; arbitres de nos personnes et de notre fortune, vous prononcerez alors selon les causes. 153 Aujourd'hui, il vous suffit de revendiquer votre liberté. » LIV. [1] D'un accord unanime on s'en remet à la décision des députés qui promettent de revenir après avoir tout terminé. [2] Ils vont exposer au sénat les conditions dont le peuple les a chargés, et les décemvirs voyant que, contre leur attente, il n'est question pour eux d'aucune peine, ne se refusent à rien. [3] Appius, dont le caractère farouche avait la plus forte part de l'aversion publique, mesurant à sa haine celle qu'on lui portait, « Je n'ignore point, dit-il, le sort qui m'attend. [4] Je le vois; on va donner des armes à nos adversaires, et jusqu'alors on diffère de nous attaquer. Il faut du sang à la haine. Ce n'est pas moi cependant qui mettrai du retard à résigner le décemvirat. » [5] Un sénatus-consulte portait que les décemvirs abdiqueraient au plus tôt; que Quintus Furius, grand pontife, nommerait des tribuns populaires, et qu'on ne rechercherait personne pour la révolte de l'armée et du peuple. [6] Ces décrets achevés, les décemvirs lèvent la séance, se rendent au forum, et prononcent leur abdication au milieu des plus vifs transports de joie. [7] On va porter au peuple cette nouvelle. Les députés entraînent sur leurs pas tout ce qu'il reste à la ville de citoyens. Cette foule en rencontre une autre que sa joie poussait hors du camp; on se félicite de la liberté, de la concorde qu'on a rétablies. [8] Les députés s'adressant à cette assemblée : « Puissent votre bonheur, votre prospérité, votre félicité et celle de la république, marquer ce retour dans votre patrie, dans vos pénales, auprès de vos femmes et de vos enfants ! Mais que cette modération, qui, malgré tant de besoins et une multitude si grande, a respecté le champ d'autrui, vous accompagne dans Rome. Allez sur l'Aventin d'où vous êtes partis; [9] dans ce lieu d'un augure si favorable, où vous jetâtes les premiers fondements de votre liberté, vous élirez vos tribuns. Le grand pontife doit s'y rendre pour tenir les comices. » [10] D'universels applaudissements et des transports de joie témoignaient de l'approbation générale. Ils lèvent les enseignes pour se rendre à Rome, et font assaut de gaieté avec ceux qui viennent à leur rencontre. Ils traversent en armes la ville et se rendent sans bruit sur l'Aventin; [11] aussitôt, formés en comices et présidés par le grand pontife, ils nomment leurs tribuns, et en tête Lucius Verginius; après lui viennent Lucius Icilius et Publius Numitorius, oncle de Virginie, auteurs de l'insurrection; [12] ensuite Gaius Sicinius, descendant de celui que la tradition regarde comme le premier tribun du peuple élu sur le mont Sacré, et Marcus Duillius, qui s'était fait remarquer dans la même charge avant la création des décemvirs, et dont l'appui n'avait pas manqué au peuple dans sa lutte contre eux. [13] Enfin, les espérances que faisaient naître Marcus Titinius, Marcus Pomponius, Gaius Apronius, Appius Villius, Gaius Oppius les firent élire bien plus que leurs services. [14] Dès l'entrée en charge, Icilius demanda au peuple et le peuple décréta l'amnistie pour toute révolte contre les décemvirs. [15] Aussitôt après, la création de deux consuls avec appel au peuple fut décrétée sur la proposition de Marcus Duillius. On prit toutes ces décisions dans les Prés Flaminiens, nommés aujourd'hui Cirque Flaminius. 154 LV. [1] Un interroi nomma ensuite les consuls Lucius Valérius et Marcus Horatius, lesquels entrèrent aussitôt en fonction. Ce consulat populaire ne lésait en rien les droits des patriciens, et fut cependant en butte à leur haine. [2] Tout ce qui se faisait pour la liberté du peuple leur semblait une usurpation sur leur puissance. [3] D'abord, il était un point de droit en contestation pour ainsi dire permanente : il s'agissait de décider si les patriciens étaient soumis aux plébiscites. Les consuls portèrent dans les comices par centuries une loi déclarant que les décisions du peuple assemblé par tribus lieraient tous les citoyens. On donnait ainsi aux tribuns l'arme la plus terrible. [4] Une autre loi, émanée des consuls, rétablit l'appel au peuple, unique soutien de la liberté. Mais ce n'était point assez; on mit ce droit hors d'atteinte pour l'avenir, et une disposition nouvelle fit défense [5] de créer aucune magistrature sans appel, déclarant juste et légitime devant les dieux et devant les hommes le meurtre de l'infracteur, et à l'abri de toute recherche celui qui le commettrait. [6] Le sort des plébéiens était ainsi suffisamment assuré par l'appel au peuple et l'appui du tribunat; mais les consuls, en faveur des tribuns eux-mêmes, et pour leur rendre une inviolabilité dont le souvenir s'était déjà presque effacé, firent revivre d'antiques cérémonies. [7] À la religion, qui les rendait sacrés, on joignit une loi portant que tout agresseur des tribuns du peuple, des édiles, des juges, des décemvirs, verrait sa tête dévouée aux dieux infernaux, et ses biens confisqués au profit du temple de Cérès, de Liber et de Libera. [8] Cette loi, selon les jurisconsultes, n'établissait d'inviolabilité en faveur de personne, mais dévouait seulement l'auteur de toute attaque contre ces magistrats. [9] Ainsi, l'édile peut être saisi et traîné en prison par ordre d'un magistrat supérieur. Bien que cette mesure soit illégale, puisqu'elle frappe un homme que protège cette loi, cela prouve cependant que l'édile n'est point inviolable; [10] les tribuns l'étaient, au contraire, en vertu de l'antique serment du peuple, lors de la création de cette puissance. [11] On a prétendu quelquefois que cette même loi Horatia place également sous sa sauvegarde les consuls, ainsi que les préteurs créés sous les mêmes auspices qu'eux; que le juge c'est le consul. [12] Il est facile de réfuter cette interprétation; en effet, à cette époque ce n'était pas au consul, mais bien au préteur que l'usage donnait le nom de juge. Telles furent les lois que portèrent les consuls. [13] Ils ordonnèrent de plus qu'on remît dans le temple de Cérès, à la garde des édiles plébéiens, les sénatus-consultes que !es consuls supprimaient jadis ou altéraient à leur gré. [14] Ensuite, sur la proposition de Marcus Duillius, tribun du peuple, le peuple décida, « que laisser le peuple sans tribuns, et créer des magistrats sans appel, serait un crime puni des verges et de la hache. » [15] Les patriciens voyaient toutes ces mesures avec plus de peine qu'ils n'y mettaient d'obstacles; car on n'avait encore sévi contre personne. LVI. [1] La puissance tribunitienne et la liberté du peuple ainsi affermies, les tribuns pensent que le moment est venu d'attaquer impunément chacun de leurs adversaires, et choisissent Verginius pour 155 premier accusateur; Appius, pour premier accusé. [2] Verginius avait assigné Appius; celui-ci se présenta dans le forum, escorté de jeunes patriciens, et fit revivre tout à coup le souvenir de son infâme pouvoir, par sa présence et celle de ses satellites. [3] Verginius dit alors : « Le discours oratoire ne fut imaginé que pour les causes douteuses. Je ne perdrai donc pas mon temps à porter une accusation en forme contre un homme de la cruauté duquel nos armes seules ont pu faire justice; et je ne veux pas qu'il ajoute à ses autres crimes l'impudence de se défendre. [4] Ainsi donc, Appius Claudius, je te fais grâce de tous les forfaits qu'au mépris des dieux et des lois tu as accumulés l'un sur l'autre pendant deux ans. Pour un crime seul, celui d'avoir refusé la liberté provisoire à une personne libre, je te ferai, si tu ne choisis un juge, conduire dans les fers. » [5] Appius ne mettait le moindre espoir ni dans l'appui des tribuns, ni dans le jugement du peuple; cependant il s'adresse aux tribuns : aucun ne se présente; le viateur a déjà la main sur lui. « J'en appelle, » s'écria-t-il. [6] Ce mot, garantie suffisante de la liberté provisoire, sorti d'une bouche qui avait prononcé provisoirement l'esclavage, retentit dans le silence. [7] Chacun se dit tout bas « qu'il est des dieux attentifs aux actions humaines; que les châtiments de l'orgueil et de la cruauté, pour être tardifs, n'en sont pas moins terribles; [8] que le destructeur de l'appel y a recours lui-même, et implore l'assistance du peuple, dont il a foulé aux pieds tous les droits; qu'il se voit traîné dans les fers et réduit à invoquer la liberté provisoire, celui qui condamna à la servitude une personne libre. » Au milieu de ces murmures de l'assemblée, on entendait la voix de ce même Appius implorer la protection du peuple romain. [9] Il rappelait ses ancêtres, les services qu'ils rendirent à l'état dans la paix et dans la guerre; « son fatal dévouement au peuple romain, lorsque pour lui donner l'égalité dans les lois, il abdiqua le consulat en dépit des patriciens; ses lois, enfin, encore debout, tandis qu'on en jetait l'auteur dans les fers. [10] Au reste, il verra tout ce qu'il doit attendre de bien ou de mal lorsqu'il aura la faculté de se défendre. Aujourd'hui, citoyen romain, il réclame le droit commun à tout citoyen accusé : celui de se défendre, de se soumettre au jugement du peuple romain. [11] Il ne redoute pas tellement la haine que l'équité et la pitié de ses concitoyens ne lui inspirent aucune confiance. Si l'on veut, sans l'entendre, le conduire en prison, de nouveau il s'adresse aux tribuns du peuple; qu'ils se gardent d'imiter ceux qu'ils poursuivent de leur haine. [12] Si les tribuns, par leur silence, avouent qu'ils se sont engagés à supprimer l'appel au peuple par un serment semblable à celui dont ils font un crime aux décemvirs, de nouveau il en appelle au peuple, il invoque les lois relatives à cet appel, celles des consuls, celles des tribuns, publiées cette année même. [13] Qui donc usera de l'appel, si on en refuse le droit à un homme qui n'est point condamné, qu'on n'a point encore entendu ? Quel plébéien, quel citoyen obscur trouvera dans les lois un appui qui aura manqué à Appius Claudius ? Son exemple apprendra si les nouvelles lois ont affermi la tyrannie ou la liberté; si le recours 156 et l'appel au peuple, ces deux barrières élevées contre l'injustice des magistrats, sont une réalité, ou s'ils n'existent que dans de vains caractères. » LVII . [1] Verginius réplique : « Que le seul Appius est hors de toute loi, hors de toute société civile et humaine. [2] On n'a qu'à jeter les yeux sur ce tribunal, repaire de tous les crimes. Là, ce décemvir perpétuel se jouait des biens, des personnes, du sang des citoyens; tenait sans cesse levées sur eux ses verges et ses haches, et, bravant les dieux et les hommes, [3] entouré de bourreaux et non de licteurs, passant des rapines et du meurtre à la débauche, il avait osé, sous les yeux du peuple romain, traiter une jeune fille libre comme une prisonnière de guerre, l'arracher des bras de son père, et la livrer à son client, ministre de ses turpitudes. [4] C'est là que, par un arrêt barbare, par une horrible sentence, il avait armé la main d'un père contre son enfant. C'est là que, pour avoir recueilli le corps palpitant de la jeune fille, il avait condamné son fiancé et son oncle à être jetés en prison; plus sensible aux obstacles apportés à ses désirs infâmes qu'à la mort de sa victime. C'est aussi pour lui que fut construite cette prison qu'il prenait plaisir à nommer le domicile du peuple romain. [5] Qu'Appius renouvelle son appel; qu'il le réitère cent fois; autant de fois il le sommera lui-même de choisir un juge qui décide s'il n'a pas, provisoirement, décrété l'esclavage; s'il s'y refuse, il le tient pour condamné et ordonne sa mise aux fers. » [6] Personne ne paraissait improuver ces mesures; mais les esprits étaient profondément émus, et ce traitement, infligé à un personnage si élevé, faisait craindre au peuple l'abus de sa propre liberté. Appius fut conduit en prison, et le tribun remit son assignation à un autre jour. [7] Cependant des députés vinrent à Rome de la part des Latins et des Herniques féliciter le sénat et le peuple du retour de la concorde; et, à cette occasion, ils portent au Capitole, et offrent à Jupiter, très bon et très grand, une couronne d'or d'un poids médiocre, comme les fortunes de ce temps où la religion se parait de piété plutôt que de magnificence. [8] On apprit de ces députés que les Èques et les Volsques faisaient tous leurs efforts pour se préparer à la guerre. [9] En conséquence, les consuls eurent ordre de se partager les commandements. La guerre des Sabins échut à Horatius; à Valérius, celle des Èques et des Volsques. Ils décrètent l'enrôlement pour l'armée. L'affection du peuple pour eux était telle, que non seulement les jeunes gens, mais aussi une foule de volontaires, dont la plupart avaient achevé le temps de leur service, s'empressèrent de se faire inscrire. Cette incorporation des vétérans rendit l'armée aussi redoutable par le choix que par le nombre des soldats. [10] Avant de quitter Rome, les consuls firent exposer en public, gravées sur l'airain, les lois des décemvirs, connues sous le nom de lois des douze tables. Quelques historiens prétendent que, sur l'ordre des tribuns, les édiles se chargèrent de ce soin. LVIII. [1] Gaius Claudius, détestant les crimes des décemvirs, et surtout la tyrannie de son neveu, s'était retiré à Régille, antique berceau de sa famille. Malgré son grand âge, il en revint pour conjurer le péril qui menaçait l'homme dont il avait fui les vices. Vêtu en suppliant, accompagné de sa famille et de ses client, il s'adressait à chacun 157 dans le forum. et priait [2] qu'on épargnât à la famille Claudia cette tache de honte qui la classerait parmi les gens dignes de la prison et des fers. « Cet homme, disait-il, dont la postérité honorerait l'image, le législateur de Rome, le fondateur du droit romain, gisait dans les fers, au milieu des voleurs nocturnes et des brigands. [3] Si l'on met un instant de côté le ressentiment pour écouler à la réflexion, on aimera mieux accorder à tant de Claudius celui que réclament leurs prières, que de rendre, en haine d'un seul, tant de prières inutiles. [4] Il n'a lui-même en vue que sa famille et son nom, et n'est nullement réconcilié avec celui qu'il vient secourir dans son malheur. Le courage a reconquis la liberté, la clémence établira l'union des deux ordres sur des bases solides. » [5] Quelques-uns se sentaient émus du dévouement de ce vieillard bien plus que du sort de celui qui en était l'objet. Mais Verginius réclamait leur pitié pour lui et pour sa fille. « Ce n'est point cette famille Claudia, dont le caractère est de tyranniser le peuple, qu'on doit écouter, mais les amis de Virginie et les prières des trois tribuns qui, nommés pour prêter leur appui au peuple, demandent à ce même peuple son appui. » [6] Leurs larmes paraissaient plus justes. Aussi, Appius, perdant tout espoir, n'attendit pas le jour de l'assignation et se donna la mort. [7] Numitorius, ensuite, s'attache à poursuivre Spurius Oppius, le plus odieux des autres décemvirs; il se trouvait à Rome à l'époque de l'arrêt inique de son collègue. [8] Les crimes personnels d'Oppius firent cependant son malheur bien plus que ceux qu'il n'avait pas empêchés. On produisit un témoin qui comptait vingt-sept campagnes et huit récompenses extraordinaires. Il montre au peuple les dons qu'on lui décerna, déchire sa tunique et découvre son dos lacéré par les verges. Pour toute plainte il dit que si l'accusé peut lui imputer le moindre délit, quoique rentré dans la vie privée, il aura le droit de sévir de nouveau contre lui. [9] Oppius, à son tour, est jeté dans les fers, et, avant le jour du jugement, il met aussi fin à sa vie. Les tribuns ordonnèrent la confiscation des biens de Claudius et d'Oppius. Les autres décemvirs se condamnèrent à l'exil, et leurs biens furent aussi confisqués. [10] Marcus Claudius, ce maître prétendu de Virginie, fut cité et condamné. Grâce à Verginius, il échappa à la peine de mort; et, après le jugement, s'exila à Tibur. [11] Les mânes de Virginie, plus heureuse morte que pendant sa vie, après avoir erré, pour satisfaire leur vengeance, autour de tant de maisons, quand disparut le dernier coupable, trouvèrent enfin le repos. LIX. [1] Une terreur profonde s'était emparée des patriciens, et déjà la vue des tribuns produisait l'effet de celle des décemvirs; mais Marcus Duillius, tribun du peuple, mettant à ce pouvoir excessif un frein salutaire : [2] « C'est assez de liberté, s'écria-t-il, c'est assez de représailles; je ne souffrirai plus, cette année, qu'on assigne personne, qu'on jette personne en prison. [3] Je n'approuve pas, en effet, qu'on recherche d'anciens délits déjà effacés, quand le châtiment des décemvirs a expié les nouveaux. Il ne se passera rien qui appelle l'intervention des tribuns; j'en trouve la garantie dans la sollicitude constante des consuls 158 pour votre liberté. » [4] Cette modération du tribun eut un double effet; elle dissipa !a frayeur des patriciens et accrut leur haine contre les consuls. Ils leur reprochaient d'être si dévoués au peuple que les patriciens se trouvaient redevables de leur salut et de leur liberté à un magistrat plébéien, plutôt qu'à ceux de leur ordre. Leurs ennemis étaient rassasiés de leurs supplices avant que les consuls songeassent à prévenir ces excès. [5] Nombre d'entre eux accusaient de lâcheté l'approbation que les sénateurs avaient accordée à leurs lois; et il n'était pas douteux que, dans toutes ces révolutions, ils n'eussent subi l'empire des circonstances. LX. [1] Les consuls, après avoir réglé les affaires de la ville et assuré le sort du peuple, se rendirent chacun dans son département. Valérius avait en tête les armées des Volsques et des Èques réunies sur l'Algide; il soutint la guerre par sa prudence. [2] S'il eût tenté sur le champ la fortune, je ne sais si dans la disposition d'esprit où les revers des décemvirs avaient laissé les Romains et leurs ennemis, la lutte n'eût pas été pour nous des plus fatales. [3] Son camp était à un mille de l'ennemi; il y retenait son armée. Les autres, rangés en bataille, occupaient de leurs lignes tout l'espace renfermé entre les deux camps. Ils provoquaient au combat les Romains, dont aucun ne répondait. [4] Las enfin de leur immobilité et d'attendre inutilement le combat, les Èques et les Volsques, prenant en quelque sorte ce silence pour un aveu de leur victoire, vont piller, les uns chez les Herniques, les autres chez les Latins, et laissent dans le camp assez de monde pour le garder, mais pas assez pour combattre. [5] Instruit de ces dispositions, le consul leur rend la terreur qu'ils avaient apportée naguère; il range son armée en bataille, et provoque à son tour l'ennemi. [6] Ceux-ci sentant qu'ils ne sont pas en forces, évitent le combat. Le courage des Romains s'enflamme aussitôt, et ils regardent comme vaincus des hommes qui tremblent derrière leurs retranchements. [7] Ils passent tout le jour sous les armes, prêts à combattre, et se retirent avec la nuit; pleins d'espérances, ils prennent de la nourriture et du repos. En proie à des pensées bien différentes, les ennemis dépêchent à la hâte des courriers de tous côtés pour rappeler les pillards. On ramena les plus rapprochés; il fut impossible de rejoindre les autres. [8] Au point du jour, les Romains sortent de leur camp, prêts à attaquer les palissades, si l'on refuse le combat. Le jour était déjà avancé, l'ennemi ne bougeait point; le consul ordonne l'attaque. L'armée s'ébranle; mais les Volsques et les Èques s'indignent que des armées victorieuses cherchent leur salut derrière des retranchements plutôt que dans leur courage et dans leurs armes. Ils demandent donc à leurs chefs et en obtiennent le signal du combat. [9] Une partie de leurs troupes était déjà sortie des portes; les autres marchaient à la suite, et descendaient pour prendre leurs postes respectifs; mais le consul romain n'attend pas que la ligne ennemie soit renforcée de tous ses bataillons, et commence l'attaque. [10] Il choisit l'instant où tous ne sont pas encore sortis et où ceux qui le sont n'ont point encore formé leurs rangs, et ressemblent à une foule d'hommes errant au hasard et cherchant à se reconnaître. À ce trouble des 159 esprits viennent se joindre les cris et l'impétuosité des Romains qui fondent sur eux. [11] Les ennemis reculent au premier choc. Ensuite, reprenant courage, et ramenés par les reproches de leurs chefs, qui leur demandent de toutes parts s'ils veulent fuir devant des vaincus, ils rétablissent le combat. LXI. [1] Le consul, de son côté, recommande aux Romains de « se souvenir que c'est la première fois, depuis leur nouvelle liberté, qu'ils combattent pour la liberté de Rome. C'est pour eux-mêmes que sera la victoire, et non pour que les vainqueurs soient la proie des décemvirs. [2] Ils ne marchent point sous un Appius, mais sous le consul Valérius, issu des libérateurs et lui-même libérateur du peuple romain. Ils ont à prouver que dans les précédentes batailles c'est aux chefs et non aux soldats qu'il a tenu qu'on ne fût victorieux. [3] Il serait honteux d'avoir montré plus de courage contre leurs concitoyens que contre leurs ennemis, et d'avoir repoussé avec plus de force le despotisme des leurs que le joug de l'étranger. [4] Virginie avait été la seule jeune fille dont la pudeur eût été en péril durant la paix; Appius, le seul homme dont la passion eût été à craindre; mais, si le sort de la guerre leur est contraire, leurs enfants, à tous, seront exposés à la violence de ces milliers d'ennemis. [5] Il n'a garde de prévoir des périls que Jupiter, que Mars, père de Rome, ne laisseront point tomber sur une ville fondée sous de pareils auspices. » Il leur rappelle l'Aventin et le mont Sacré. « Qu'ils rapportent entière la puissance romaine dans ces lieux, quelques mois auparavant témoins de la conquête de leur liberté; [6] il faut montrer que l'esprit des soldats romains est, après la ruine des décemvirs, le même qu'il était avant la création de ces magistrats. » [7] À peine a-t-il prononcé ces mots dans les rangs de l'infanterie, qu'il vole vers les cavaliers. « Allons, dit-il, jeunes gens, que votre courage, autant que la noblesse de votre rang, vous place au-dessus des fantassins. [8] Au premier choc l'ennemi a reculé devant eux. Chargez-le de toute la vitesse de vos chevaux, et chassez-le du champ de bataille. Il ne soutiendra pas votre impétuosité, et maintenant même il hésite plutôt qu'il ne résiste. » [9] Ils pressent aussitôt leurs chevaux et les lancent sur l'ennemi déjà ébranlé par l'infanterie. Ils rompent ses lignes et courent jusqu'aux derniers rangs; là, une partie trouve le champ libre et fait demi-tour, coupe à la plupart des fuyards la retraite du camp, et les en éloigne en galopant autour de l'enceinte. [10] L'infanterie, le consul lui-même et le gros de la mêlée se portent vers le camp, qui bientôt est emporté. On y fit un grand carnage, et un butin plus grand encore. La nouvelle de ce combat fut portée à la ville, ainsi qu'à l'autre armée, dans le pays des Sabins. [11] À Rome, on l'accueillit avec joie; au camp, elle excita dans le cœur des soldats une noble émulation. [12] Déjà Horatius, en les exerçant par des courses sur les terres ennemies, et par de légères escarmouches, les avait accoutumés à compter sur leurs forces, à oublier leurs défaites sous les décemvirs, et ces petits combats étaient un encouragement à de plus grandes espérances. [13] Les Sabins, cependant, exaltés par leurs succès de l'année précédente, ne cessaient de les défier, et leur demandaient « à quel résultat pouvaient 160 prétendre de petits corps qui, semblables à des brigands, se montraient et disparaissaient tout à tour ? C'était perdre le temps : pourquoi diviser en une foule d'escarmouches l'objet d'une seule affaire ? [14] Pourquoi n'en pas venir aux mains, et ne pas s'en remettre une fois encore à la décision de la fortune ? » LXII. [1] Au courage qu'ils ont repris d'eux-mêmes, se joint chez les Romains l'indignation dont les enflamment ces reproches. « Déjà, disaient-ils, l'autre armée allait rentrer triomphante dans la ville, et eux, ils étaient en butte aux insultes et aux outrages de l'ennemi. Quand donc, si ce n'est à cette heure, les croira-t-on capables de se mesurer avec lui ? » [2] Dès que le consul s'aperçoit qu'on murmure dans le camp, il assemble ses troupes; « Soldats, leur dit-il, vous savez, je pense, ce qui s'est passé sur l'Algide. L'armée s'y est montrée digne d'un peuple libre. Les sages dispositions de mon collègue, la valeur des soldats leur ont donné la victoire. [3] Pour moi, je ne prendrai de conseils et de résolutions que ceux que vous me suggérerez vous-mêmes. Nous pouvons prolonger la guerre avec avantage, nous pouvons la terminer promptement. [4] Si je prends le premier parti, j'accroîtrai chaque jour, par les mêmes moyens qui les ont préparés, vos espérances et votre courage. Si vous vous sentez assez de coeur pour tenter la fortune, eh bien ! qu'un cri semblable à celui que vous poussiez sur le champ de bataille me soit garant de vos intentions et de votre valeur. » [5] Le plus vif enthousiasme accompagne ce cri. Le consul fait des voeux pour que le succès couronne leurs efforts, promet de les satisfaire, et de les conduire le lendemain au combat. Le reste de la journée se passe à préparer les armes. [6] Le jour suivant, dès que les Sabins voient se former l'armée romaine, ils s'avancent à leur tour, et brûlent d'en venir aux mains. Le combat fut ce qu'il devait être entre deux armées pleines de confiance en elles-mêmes, stimulées encore, l'une, par ses anciens, par ses éternels succès, et l'autre, par une victoire récente. [7] La prudence vint en aide aux forces des Sabins. Outre qu'ils opposent à leurs adversaires un front de bataille pareil au leur, ils tiennent en réserve deux mille hommes destinés à tomber sur l'aile gauche des Romains au plus fort de l'action. [8] Cette aile, prise en flanc et enveloppée, allait être écrasée, lorsque les cavaliers de deux légions, au nombre d'environ six cents, sautent de cheval, et se portent au premier rang, au milieu de leurs camarades qui fléchissaient déjà; outre qu'ils présentent à l'ennemi de nouveaux adversaires, la part qu'ils prennent au péril, la honte, enfin, réveillent le courage des fantassins. [9] Ils rougissaient de voir la cavalerie remplir les fonctions de son arme et de la leur; et de ne pas valoir même un cavalier démonté. LXIII. [1] Ils retournent au combat qu'ils ont abandonné, et reprennent le poste d'où ils s'étaient retirés. Un moment suffit non seulement à rétablir l'équilibre, mais encore à faire plier à son tour l'aile des Sabins. [2] Les cavaliers, protégés par ces rangs de l'infanterie, regagnent leurs chevaux, volent à l'autre extrémité, pour lui annoncer leur victoire, et chargent l'ennemi déjà ébranlé par la déroute de son aile principale. Aucun corps ne montra plus de valeur dans cette 161 journée. [3] Le consul a l'oeil à tout, félicite les braves, et gourmande ceux qu'il voit mollir. Ses reproches élèvent leur courage à l'égal des plus intrépides, et la honte opère sur eux l'effet de la louange sur les autres. [4] Ils poussent un nouveau cri, unissent partout leurs efforts, et culbutent une armée qui ne résiste plus à la valeur romaine. Les Sabins se dispersent dans la campagne, et laissent leur camp devenir la proie de l'ennemi. Ce ne fut point cette fois, comme sur l'Algide, les dépouilles de nos alliés que recouvrèrent les Romains, mais bien les leurs perdues dans le ravage de leurs campagnes. [5] Pour cette double victoire, remportée en deux lieux divers, le mauvais vouloir du sénat ne décréta qu'un seul jour de supplications en l'honneur des consuls. Le peuple, néanmoins, sans y être appelé, se rendit en foule aux supplications, le jour suivant, et cette démonstration libre et populaire eut en quelque sorte plus d'éclat par l'intérêt qu'on y prit. [6] Les consuls, comme ils en étaient convenus, entrèrent dans Rome à un jour l'un de l'autre, et convoquèrent le sénat dans le champ de Mars. Ils y rendaient compte de ce qui s'était passé, lorsque les principaux du sénat se plaignent qu'on les ait à dessein réunis au milieu des soldats, afin d'agir sur eux par la terreur. [7] Les consuls, pour ôter tout prétexte à ces plaintes, transférèrent l'assemblée dans les prés Flaminiens, où l'on voit aujourd'hui le temple, et où se trouvait déjà alors le domaine d'Apollon. [8] L'immense majorité des sénateurs vote contre le triomphe; Lucius Icilius porte cette question devant le peuple. Au milieu d'une foule d'opposants, on remarquait Gaius Claudius, [9] dont les cris reprochaient aux consuls de vouloir triompher du sénat et non de l'ennemi. Ils demandaient cette faveur comme prix de services privés rendus à un tribun, plutôt qu'en récompense de leur courage. Jamais, jusque là, on n'avait consulté le peuple pour le triomphe. L'appréciation des droits à cet honneur, la décision qui l'accorde, furent toujours le privilège du sénat. [10] Les rois eux-mêmes n'avaient pas attenté à la majesté de cet ordre suprême. Les tribuns devaient se garder d'étendre à ce point leur puissance, qu'il n'y eût plus à Rome de conseil public. La liberté régnerait enfin dans la ville, et une juste balance dans les lois, lorsque chaque ordre s'en tiendrait à ses droits, et ferait respecter sa dignité. » [11] Cette opinion fut suivie et développée par le reste des plus anciens sénateurs; néanmoins toutes les tribus adoptèrent la proposition, et, pour la première fois, on décerna le triomphe par l'ordre du peuple, et sans l'autorisation du sénat. LXIV. [1] Cette victoire des tribuns et du peuple leur inspira une fâcheuse confiance; elle amena les tribuns à s'entendre pour leur réélection, et, afin de voiler leurs projets ambitieux, [2] pour celle des consuls ils alléguaient que les sénateurs avaient résolu, en outrageant les consuls, de miner les droits du peuple. [3] « Qu'arriverait-il si, dans un temps où les lois étaient encore mal affermies, des consuls, soutenus de leurs factions, attaquaient les tribuns encore neufs dans leur charge ? On ne verrait pas toujours des consuls comme Valérius et Horatius, préférant la liberté du peuple à leurs 162 propres intérêts. [4] Un hasard, heureux dans cette circonstance, donna la présidence des comices à Marcus Duillius, homme prudent et qui prévoyait les déchirements inséparables d'une réélection. [5] Il déclare qu'il ne tiendra nul compte des votes en faveur des tribuns sortants; et ses collègues insistent pour qu'on laisse toute liberté aux suffrages des tribus ou qu'on cède la présidence à des tribuns qui relèveront de la loi et non de la volonté du sénat. [6] Au début de cette dispute, Duillius prie les consuls de s'approcher de son siège, et leur demande leurs intentions au sujet des comices consulaires. Ils répondent qu'ils nommeront de nouveaux consuls. Soutenu de cet appui populaire dans une cause qui ne l'était pas, le président se présente avec eux à l'assemblée. [7] Là, interrogés de nouveau en présence du peuple, pour savoir ce qu'ils feraient si les Romains, en mémoire de leur liberté civile rétablie avec leur appui, en mémoire des dernières guerres et de leurs succès, les nommaient une seconde fois consuls, les consuls firent la même réponse. [8] Duillius, après avoir fait l'éloge de leur persévérance à se montrer jusqu'au bout différents des décemvirs, présida les comices. On élut cinq tribuns, mais les intrigues des neuf anciens qui briguaient ouvertement cet honneur, ayant empêché les tribus d'en compléter le nombre, Duillius renvoya l'assemblée et ne réunit plus les comices. [9] On avait, disait-il, satisfait à la loi qui, sans préciser nulle part le nombre des tribuns, spécifiait seulement qu'on pourrait en laisser à élire, et chargeait les élus de compléter entre eux le nombre de leurs collègues. [10] Il citait à l'appui le texte de la loi : « Si je propose la nomination de dix tribuns du peuple, et si vous ne complétez le même jour le nombre de dix, ceux que les tribuns nommés se choisiront pour collègues seront aussi légitimement élus que les autres, élus le premier jour. » [11] Duillius persévéra jusqu'à la fin, il nia que la république pût avoir quinze tribuns, fit fléchir enfin l'ambition de ses collègues, et sortit de charge emportant l'estime du sénat et du peuple. LXV. [1] Les nouveaux tribuns du peuple suivirent, dans le choix de leurs collègues, la volonté du sénat : ils élurent même deux patriciens consulaires Spurius Tarpéius et Aulus Aternius. [2] On nomma consuls Spurius Herminius et Titus Verginius Caelimontanus. Aussi peu portés à favoriser le sénat que le peuple, ils jouirent de la paix au-dedans comme au-dehors. [3] Lucius Trébonius, tribun du peuple, en haine des patriciens qu'il accusait de l'avoir trompé comme ses collègues l'avaient trahi, proposa [4] « que celui qui présenterait au peuple la nomination de ses tribuns, ne pourrait discontinuer de prendre les votes qu'après la nomination de dix de ces magistrats. » Tout son tribunat se passa en poursuites contre les patriciens, ce qui lui mérita le nom d'Asper. [5] Marcus Géganius Macérinus et Gaius Julius, furent ensuite nommés consuls. Des dissensions s'étant élevées entre les tribuns et la jeune noblesse, ils les dissipèrent sans offenser le tribunat et sans porter atteinte à la dignité du sénat. [6] Un décret d'enrôlement pour la guerre contre les Volsques et les Èques, tenu comme en suspens, empê- 163 cha toute sédition populaire. Les consuls affirmaient d'ailleurs que la tranquillité intérieure était le gage de la paix au-dehors; tandis que les discordes civiles excitent le courage de l'étranger. [7] La sollicitude pour la paix amena ainsi le calme domestique. Mais l'un des deux ordres se prévalait toujours de la modération de l'autre. Le peuple était en repos; la jeunesse patricienne commença contre lui les insultes. [8] Les tribuns intervinrent en faveur des plus faibles. Ce fut d'abord avec peu de succès; et bientôt on cessa même de respecter leur personne, surtout durant les derniers mois, alors que les grands étaient de connivence dans ces insultes, et que toute autorité, comme il arrive toujours, perdait son ressort à mesure que la fin de l'année approchait. [9] Déjà le peuple commençait à désespérer du tribunat, à moins qu'on n'y fit entrer des hommes semblables à Icilius. Depuis deux ans ses tribuns n'en avaient que le nom. [10] Les plus vieux sénateurs, qui trouvaient leur jeunesse trop bouillante, aimaient mieux cependant, s'il fallait subir un excès, qu'il vînt de leur côté que du côté de leurs adversaires; [11] tant il est difficile de mettre quelque mesure dans la défense de la liberté. On feint d'appeler l'égalité et chacun veut s'élever au détriment d'autrui. Pour se mettre en garde coutre les autres on se rend soi-même redoutable. Nous éprouvons une injustice, et comme s'il était indispensable d'être agresseur ou victime, nous devenons injustes nous-mêmes. LXVI . [1] Ensuite, Titus Quinctius Capitolinus, consul pour la quatrième fois, eut pour collègue Agrippa Furius. Ils ne trouvèrent ni sédition à l'intérieur, ni guerre étrangère; mais l'une et l'autre étaient imminentes. [2] Il n'était plus possible de contenir l'animosité des citoyens; les tribuns et le peuple étaient ameutés contre les patriciens, et les assignations données à quelques membres de la noblesse amenaient chaque jour devant les assemblées de nouveaux débats. [3] Au premier bruit de ces désordres et comme à un signal donné, les Èques et les Volsques prennent les armes. Leurs chefs, avides de butin, leur avaient persuadé que les levées, ordonnées deux ans auparavant, n'avaient pu avoir lieu par le refus du peuple de reconnaître aucune autorité. [3] « Aussi, n'avait-on point envoyé d'armée contre eux. La licence avait fait perdre l'habitude des combats. Rome n'est plus pour les Romains une commune patrie : tout ce qu'ils ont montré jusque-là de ressentiment et de haine contre les étrangers, ils le tournent contre eux-mêmes. Jamais occasion plus favorable d'accabler ces loups qu'aveugle une rage intestine. » [5] Ils réunissent leurs armées, et ravagent d'abord les campagnes du Latium. Ils ne rencontrent aucune résistance; les auteurs de la guerre triomphent; l'ennemi étend ses ravages jusque sous les murs de Rome, du côté de la porte Esquiline et montre aux habitants de la ville, comme une insulte, la désolation de leurs campagnes. [6] Dès qu'ils se furent retirés à Corbion, après avoir chassé impunément leur proie devant eux, le consul Quinctius convoqua l'assemblée du peuple. LXVII. [1] C'est là qu'il prononça le discours suivant : « Quoique ma conscience ne me fasse aucun reproche, Romains, ce n'est cependant qu'avec une extrême honte que je me présente devant votre assemblée. Vous le savez, la tradition en conser- 164 vera le souvenir pour nos descendants, les Èques et les Volsques, à peine les égaux des Herniques, sous le quatrième consulat de Titus Quinctius, se sont impunément présentés en armes sous les murs de Rome. [2] Si j'avais su que cette infamie fût réservée à cette année [quoique depuis longtemps l'état des affaires ne permette de rien prévoir d'heureux], l'exil ou la mort, à défaut d'autre moyen, m'eussent évité le déshonneur. [3] Quoi ! si des hommes de coeur eussent manié ces armes que nous avons vues devant nos portes, Rome était prise sous mon consulat ! J'avais assez d'honneurs, assez et trop de jours; il m'eût fallu mourir à mon troisième consulat. [4] À qui s'adresse le mépris de ces lâches ennemis ? À nous, consuls, ou bien à vous, Romains ? Si la faute en est à nous, enlevez l'autorité à ces mains indignes, et, si ce n'est assez, infligez-nous un châtiment. [5] Si c'est votre faute, ah ! que les dieux et les hommes se gardent de vous en punir; il suffit que vous vous en repentiez. Non, l'ennemi n'a pas méprisé des lâches, il n'a pas eu confiance en son courage. Si souvent mis en déroule et en fuite, dépouillé de son camp et de ses terres, envoyé sous le joug, il sait se connaître et nous connaître. [6] La discorde qui règne entre les divers ordres, l'acharnement des patriciens et des plébéiens les uns contre les autres : voilà le poison qui nous tue. Cette soif immodérée, chez nous, de puissance; chez vous, de liberté; votre dégoût pour les magistrats patriciens, le nôtre pour les plébéiens, ont enflé leur courage. [7] Au nom des dieux, que voulez-vous ? Vous avez désiré des tribuns du peuple; nous avons consenti à vous les donner par amour pour la concorde. Vous avez voulu des décemvirs; nous avons souffert leur création. Vous vous êtes dégoûtés des décemvirs; nous les avons forcés à résigner leurs charges. [8] Votre ressentiment les poursuivit dans la vie privée; nous avons supporté la mort et l'exil des plus illustres, des plus honorables personnages. [9] Vous avez voulu de nouveau créer des tribuns du peuple; vous les avez créés : des consuls de votre ordre, bien que cela nous parût une injure pour les patriciens, nous avons vu donner au peuple une magistrature patricienne. Vous avez l'appui du tribunat, l'appel au peuple, des plébiscites obligatoires pour les patriciens; sous prétexte d'égalité dans les lois, vous opprimez nos droits; nous l'avons souffert, nous le souffrirons. [10] Quel sera donc le terme de nos dissensions ? Quand n'aurons-nous qu'une seule ville ? quand sera-t-elle notre commune patrie ? Nous, vaincus, nous supportons mieux le repos que vous, nos vainqueurs. [11] Vous suffit-il de vous être rendus redoutables pour nous ? C'est en haine de nous qu'on occupe l'Aventin; c'est en haine de nous qu'on occupe le mont Sacré. Les Esquilies sont presque tombées au pouvoir de l'ennemi, le Volsque en franchissait la chaussée, et personne ne l'en a repoussé. Contre nous vous êtes des hommes, contre nous vous avez des armes. LXVIII. [1] « Courage ! et quand vous aurez ici assiégé le sénat, quand vous aurez semé la haine dans le forum, quand vous aurez rempli les prisons des premiers citoyens, [2] profitez de cette ardeur si bouillante, et sortez par la porte Esquiline. Si vous n'osez encore le faire, voyez du 165 moins du haut de vos murs vos champs dévastés par le fer et la flamme, voyez emmener le butin, et fumer épars les toits incendiés. [3] Mais c'est l'état seul qui souffre. On brûle nos campagnes, on assiège notre ville, l'honneur de la guerre reste aux ennemis. Et vous donc ! en quel état sont vos intérêts privés ? Bientôt chacun apprendra quelles pertes il a faites dans la campagne. Que pourrez-vous obtenir ici en dédommagement ? [4] Les tribuns vous ramèneront-ils, vous rendront-ils ce que vous avez perdu ? Des cris, des paroles tant qu'il vous plaira d'en ouïr; des accusations contre les premiers de la cité, des lois les unes sur les autres, des assemblées enfin. Mais jamais aucun de vous n'a retiré de ces assemblées le moindre avantage pour ses affaires, pour sa fortune [5] Qui de vous en a rapporté autre chose à sa femme ou à ses enfants, que des haines, des rancunes, des inimitiés publiques ou privées, contre lesquelles votre courage et votre innocence ne sauraient vous garantir, et qui nécessitent des secours étrangers ? [6] Certes, lorsque vous faisiez la guerre guidés par nous, consuls, et non par des tribuns; dans le camp et non dans le forum; lorsque vos cris étaient la terreur de l'ennemi dans les batailles, et non celle des sénateurs de Rome dans l'assemblée; chargés de butin, maîtres du camp de l'ennemi, gorgés de richesses et de gloire, de celle de l'état et de la vôtre, vous reveniez triomphants chez vous dans vos pénates; maintenant vous en laissez sortir l'ennemi chargé de vos dépouilles. [7] Restez attachés à cette tribune, passez votre vie au forum ! la nécessité de combattre vous poursuit à mesure que vous la fuyez. Il vous semblait doux de marcher contre les Èques et les Volsques ? la guerre est à vos portes. Si vous ne l'en chassez, vous l'aurez bientôt dans vos murs, elle montera sur la citadelle, au Capitole; elle vous poursuivra dans vos demeures. [8] Il y a deux ans que le sénat ordonna l'enrôlement, et décida que l'armée partirait pour l'Algide. Nous demeurons tranquillement chez nous, disputant à la manière des femmes, jouissant de la tranquillité présente, sans prévoir que de ce repos naîtrait une foule de guerres. [9] Je sais qu'on pourrait dire des choses plus agréables : mais il faut sacrifier l'agrément à la vérité, et si mon caractère ne m'en faisait une loi, la nécessité m'y réduirait. En vérité, Romains, je voudrais vous plaire, mais j'aime encore mieux vous sauver, quelles que doivent être vos dispositions à mon égard. [10] La nature veut que celui qui parle à la multitude pour son propre intérêt, soit plus goûté que celui dont l'esprit n'envisage que le bien général, à moins que vous ne pensiez que ces complaisants publics, ces courtisans du peuple qui ne veulent vous voir ni sous les armes ni en repos, vous excitent, vous poussent dans votre propre intérêt. [11] De vos agitations, ils recueillent de l'honneur ou du profit. Comme la bonne harmonie des deux ordres réduirait ces hommes au néant, ils préfèrent un mauvais rôle à la nullité, et, pour être quelque chose, ils se font chefs d'émeutes et de séditions. [12] Si vous pouviez enfin vous dégoûter de ces abus, et reprendre les moeurs de vos pères et vos anciennes habitudes, en dépouillant les nouvelles, je ne me refuse à aucun supplice, [13] si dans peu de jours je n'ai battu et mis en fuite ces dévastateurs de 166 nos campagnes, si je ne les ai chassés de leur camp, et fait passer de nos portes et de nos remparts, dans leurs villes, la terreur dont vous êtes frappés. LXIX. [1] Rarement le peuple accueillit la harangue d'un tribun populaire avec plus de faveur que ce discours du plus austère des consuls. [2] La jeunesse même, qui au milieu de ces alarmes était dans l'habitude d'user du refus de servir comme de l'arme la plus redoutable aux patriciens, ne respirait que guerre et combats. La retraite des gens de la campagne, dépouillés et blessés, et dont les récits étaient plus terribles encore que leur aspect, remplit la ville d'indignation. [3] Le sénat rassemblé, tous les yeux se tournèrent sur Quinctius, comme vers l'unique vengeur de la dignité romaine. Les premiers des sénateurs assuraient « Que sa harangue était à la hauteur de la majesté consulaire, digne de tous ses précédents consulats, digne d'une vie toute remplie des honneurs dont il avait souvent joui, et qu'il avait plus souvent mérités. [4] Les autres consuls trahissaient la dignité du sénat pour caresser le peuple, ou, par leur raideur à maintenir les droits des patriciens, aigrissaient la multitude pour la dompter. » Le discours de Quinctius, conservateur de la majesté du sénat, de la bonne harmonie entre les deux ordres, était surtout celui des circonstances. [5] Ils le prient, ainsi que son collègue, de veiller sur la république. Ils prient les tribuns d'unir leurs efforts à ceux des consuls, pour rejeter la guerre loin de la ville et de ses murs, et de maintenir dans une conjoncture si critique l'obéissance du peuple aux ordres du sénat. C'est l'appel de leur commune patrie, implorant leur secours pour ses campagnes ravagées, pour Rome en quelque sorte assiégée. » [66] D'un accord unanime on ordonne et on opère l'enrôlement. Les consuls avaient déclaré dans l'assemblée du peuple « Qu'on n'avait pas le temps d'examiner les causes d'exemption. Tous les jeunes gens avaient à se rendre le lendemain, au point du jour, dans le Champ de Mars. [7] La guerre terminée on examinerait les raisons de ceux qui n'auraient point donné leurs noms. On regarderait comme déserteur celui dont les motifs ne seraient pas reconnus valables. » Le jour suivant, toute la jeunesse se présenta. [8] Chaque cohorte élut ses centurions, et eut deux sénateurs à sa tête. Toutes ces mesures furent prises, dit-on, avec tant de célérité, que les enseignes tirées ce jour-là même du trésor, par les questeurs, et portées au Champ de Mars, en furent levées à la quatrième heure du jour. Cette armée nouvelle, accompagnée de quelques cohortes de vétérans volontaires, ne s'arrêta qu'à la dixième pierre milliaire. [9] Le jour suivant les vit en présence de l'ennemi, et ils établirent leur camp auprès du sien, dans les environs de Corbion. [10] Le troisième jour, le courroux, chez les Romains, chez l'ennemi le souvenir de ses nombreuses révoltes, le remords et le désespoir ne permirent point de retarder un moment de plus le combat. LXX. [1] Dans l'armée romaine, les deux consuls jouissaient d'une égale autorité; mais, adoptant le parti le plus sage pour le succès d'une entreprise si importante, Agrippa avait remis le commandement suprême aux mains de son collègue. 167 Celui-ci reconnaissait cette abnégation par la déférence avec laquelle il traitait Agrippa; il prenait son avis, lui faisait part de sa gloire, et cherchait à élever jusqu'à lui un homme qui n'était pas son égal. [2] Dans la bataille, Quinctius commandait l'aile droite, Agrippa la gauche. Spurius Postumius Albus reçut, en qualité de lieutenant, le commandement du centre; Publius Sulpicius, avec le même titre, celui de la cavalerie. [3] L'infanterie de l'aile droite donna avec ardeur, et fut bien reçue par les Volsques. [4] Publius Sulpicins se fit jour avec sa cavalerie à travers le centre de l'ennemi. Il lui était facile de rejoindre les siens par le même chemin, avant que l'ennemi n'eût reformé ses rangs désorganisés; mais il aima mieux le prendre à dos. Un moment lui eût suffi, au moyen d'une charge sur les derrières, pour dissiper un ennemi alarmé de cette double attaque; mais la cavalerie des Volsques et des Èques l'arrêta quelque temps, en lui opposant la même manoeuvre. [5] Alors Sulpicius s'écrie : « Qu'il n'y a plus à hésiter. Les Romains sont entourés et coupés, s'ils ne font tous leurs efforts pour se tirer avec avantage de ce combat de cavalerie. Il ne suffit pas de mettre en fuite le cavalier, s'il conserve ses moyens d'attaque; il faut exterminer le cheval et le combattant, afin qu'aucun ne revienne à la charge, et ne puisse recommencer le combat. On ne résistera pas à des hommes devant lesquels ont plié les rangs serrés de l'infanterie. [7] Les soldats ne furent pas sourds à ces paroles. D'une seule charge, ils mettent en déroute toute la cavalerie, en démontent la plus grande partie, et percent de leurs traits cavaliers et chevaux. De ce moment, ils n'eurent plus à soutenir de combat de cavalerie. [8] Ils attaquent ensuite les lignes de l'infanterie, et font savoir leurs succès aux consuls, lorsque déjà les rangs ennemis commençaient à plier. Cette nouvelle redouble le courage des Romains victorieux, et abat celui des Èques qui reculent. [9] La victoire commença par le centre où le passage de la cavalerie avait rompu les rangs. [10] L'aile gauche fut ensuite mise en déroute par Quinctius; on eut plus de peine à l'aile droite. Là, Agrippa, animé par la jeunesse et par la force, voyant que sur les autres points le succès se fait moins attendre que de son côté, saisit les enseignes des mains des porte-étendards, les porte en avant et en jette même quelques-unes au milieu des rangs les plus serrés de l'ennemi. [11] Le soldat redoute la honte de les perdre, et se précipite pour les reconquérir. La victoire est enfin égale partout. Un exprès vient alors annoncer, de la part de Quinctius, « qu'il est vainqueur et menace le camp de l'ennemi; mais qu'il ne veut point l'attaquer avant de savoir si on a terminé le combat à l'aile gauche. [12] Si l'ennemi est en déroute, que son collègue vienne se réunir à lui, afin que toute l'armée prenne une part égale au butin. » [12] Les deux consuls victorieux se saluent avec des félicitations réciproques, devant le camp ennemi. Le petit nombre de ses défenseurs fut mis en fuite en un instant, et les retranchements envahis sans résistance. Les consuls ramènent à Rome leur armée chargée d'un immense butin, et rapportant en outre les objets qu'on avait perdus dans le pillage de la campagne. [14] Je ne vois nulle 168 part que les consuls aient demandé le triomphe, ni que le sénat le leur ait décerné; on ne dit point la cause qui leur fit mépriser cet honneur ou désespérer de l'obtenir. [15] Pour moi, s'il est permis de conjecturer sur des faits si loin de nous, voici mon opinion : les consuls Valerius et Horatius avaient eu la gloire de vaincre les Volsques et les Èques, et de terminer la guerre des Sabins; le sénat, cependant, leur avait refusé le triomphe. Ceux-ci eurent quelque honte de le demander pour des succès moindres de moitié. Ils craignirent, s'ils l'obtenaient, qu'on ne regardât cet honneur plutôt comme une faveur personnelle que comme une récompense de leurs services. LXXI. [1] Cette victoire si glorieuse, remportée sur l'ennemi, fut ternie dans Rome par un jugement du peuple romain au sujet des limites de ses alliés. [2] Les habitants d'Aricie et d'Ardée étaient en discussion pour quelques terres, sources pour eux de guerres nombreuses. Fatigués de pertes fréquentes et mutuelles, ils prennent les Romains pour arbitres. [3] Ils viennent plaider leur cause devant le peuple assemblé par les magistrats, et poursuivent les débats avec ardeur. On avait entendu les témoins, on allait appeler les tribus et recueillir les voix, lorsque se lève Publius Scaptius, plébéien d'un âge fort avancé : « Consuls, dit-il, s'il m'est permis de parler dans l'intérêt de l'état, il est une erreur que je ne laisserai pas commettre au peuple dans cette affaire. » [4] Les consuls ayant refusé de l'entendre à cause de son peu d'importance, il s'écrie qu'on trahit les intérêts publics; et comme on cherchait à l'éloigner, il s'adresse aux tribuns. [5] Ceux-ci, comme toujours, instruments de la multitude, au lieu d'en être les maîtres, cèdent au désir de la foule qui veut entendre Scaptius, et accordent à celui-ci la faculté de dire ce qu'il veut. [6] Il déclare « qu'il est dans sa quatre-vingt-troisième année, et qu'il a fait la guerre sur le terrain en litige; ce n'était point dans sa première jeunesse; il faisait alors sa vingtième campagne : c'était durant la guerre de Corioles. Il a conservé le souvenir d'un événement effacé par le temps, mais gravé dans sa mémoire. [7] Or, le territoire en question faisait partie de celui de Corioles. À la prise de cette ville, il était tombé au domaine du peuple romain. Il est surpris que les Ardéates et les Ariciniens, qui jamais n'élevèrent leurs prétentions sur ce territoire tant que subsista Corioles, espèrent le ravir au peuple romain, légitime propriétaire, en le prenant pour arbitre. [8] Il ne lui reste que peu de temps à vivre; il ne peut cependant s'empêcher, malgré son grand âge, d'élever la voix, unique moyen qui lui reste, de revendiquer pour la république, un terrain qu'il a concouru de ses bras à lui acquérir. Il conseille fortement au peuple de ne pas prononcer contre lui-même par une délicatesse mal entendue. » LXXII. [1] Les consuls, voyant que Scaptius était écouté non seulement en silence, mais encore avec faveur, prennent à témoin les dieux et les hommes que c'est une action indigne, et s'adjoignent les principaux patriciens. [2] Ils se présentent ainsi à chaque tribu; les prient de ne pas donner le plus détestable exemple du plus odieux des crimes, celui de juges qui font leur profit de l'objet en litige. Surtout dans cette occasion où, si jamais il était permis à un juge de se payer lui-même de sa 169 peine, les avantages qu'ils recueilleraient de cette possession n'égaleraient pas le tort que leur ferait cette injustice, en leur aliénant l'affection de leurs alliés. [3] La perte de l'estime et de la confiance est plus grande qu'on ne peut l'apprécier. Voilà le jugement que les délégués rapporteront chez eux; voilà ce qu'ils publieront, ce qu'apprendront leurs ennemis ! Quelle douleur pour les uns, quelle joie pour les autres ! [4] Pensent-ils que ce soit à Scaptius, le vieillard à la harangue, que leurs voisins attribueront ce jugement ? Scaptius y trouvera sans doute quelque célébrité; mais le peuple romain n'y gagnera que le nom de prévaricateur et d'escroc judiciaire. [5] Quel juge, dans une affaire privée, s'était jamais adjugé l'objet de la dispute ? Scaptius lui-même, déjà mort à toute pudeur, ne le ferait point. » [6] Voilà ce que les consuls, ce que les patriciens ne cessaient de répéter. Mais la cupidité et Scaptius, qui l'avait mise en jeu, eurent plus de poids que ces paroles. Les tribus appelées à voter, adjugèrent ces terres au domaine public du peuple romain. [7] Le résultat eût été le même, les sans doute, si l'on se fût présenté devant d'autres juges; mais la bonté de la cause ne saurait laver ici l'iniquité du jugement. Les Ariciniens et les Ardéates ne le virent pas avec plus d'indignation et d'amertume que les patriciens de Rome. Le reste de l'année se passa dans le repos, sans troubles intérieurs, et sans guerres étrangères. LIVRE III. Notre historien, dans ce livre, ne cite nominativement que Valerius Antias (ch. V). Il lui reproche des inexactitudes dans l'énonciation des nombres; mais il le suit dans le récit assez prolixe de la guerre contre les Èques (ch. IV et V), et peut-être aussi dans les chapitres VIII et XXXI. Aux chapitres VIII, XXIII et XXIV il nous apprend qu'il a suivi plusieurs auteurs, bien qu'il ne fasse pas connaître les variantes de leurs récits (voyez Denys d'Halicarnasse, X, 20). On voit même qu'au moins pour le ch. LXX, il avait consulté toutes les sources dont il pouvait disposer. Dans ce livre, il se guide aussi de préférence sur les écrivains de la date la plus reculée. Ainsi, relativement aux événements rapportés chapitre XXIII, la plupart des historiens racontaient que la ville d Antium s'était révoltée et avait été assiégée et prise par Cornelius ( voyez les Tables triomphales et Denys d'Hal., X, 22), tandis que les plus anciens gardaient le silence à cet égard; or, c'est à ces derniers que Tite-Live donne la préférence. Du reste, M. Lachmann se trompe quand il suppose que dans Tite-Live le consul Cornelius ne prend aucune part à la guerre. Il est bien vrai que d'abord il reste à. Rome pour la défendre (ut Romae praesidio esset, ch. XXII ); mais l'auteur ajoute au chapitre suivant que Cornelius, après la déroute des ennemis, jugeant les remparts de Rome à l'abri de tout danger, s'éloigna lui-même de la ville. Tite-Live peut donc sans encourir le reproche de contradiction le faire triompher avec son collègue au chapitre XXIV. CHAP. I. - Unus exstinctae ad Cremeram genti superfuerat. Fabius, a cette époque, ne pouvait avoir que vingt-quatre ou vingt-cinq ans, car à l'époque de la destruction de sa famille près du lac Cremère, il était encore enfant, et onze ans seulement s'étaient écoules entre cet événement et le consulat de Quintus. Or, comme l'usage n'était pas d'accorder le consulat à cet âge, plusieurs critiques en ont conclu, comme on l'a vu plus haut, que l'histoire du dévouement de la famille Fabia avait été falsifiée. Mais ce n'est pas le sent exemple de dispense d'âge accordée à an jeune patricien de grande espérance. L'exception dont Scipion fut l'objet ne peut laisser de doute à cet égard, ainsi que nous l'avons déjà dit ( voyez la note du ch. L, livre II). CHAP. I. - Fabius Quintus. Remarquez le prénom placé devant le nom comme au ch. XXIX, et IV, 17, 18; VII, 22. Par une exception contraire, ou rencontre quelquefois le surnom placé devant le nom, ainsi, IV, 25 et VII, 9, on lit : Macer Licinius au lieu de Licinius Macer ; et, XXIII, 14, Marcellus Claudius pour Claudius Marcellus, Voyez Schweighoeuser sur Appien, Hann. 37. IBID. - Triumviri agro dando. Ailleurs ces magistrats sont appelés triumviri coloniae deducendae ou de colonia deducenda, ou agrarii ou simplement encore triumviri. Voyez IV, 11; VI, 21; VIII, 16; IX, 28, 46; XXI, 25; XXVII, 21; XXXI, 49; XXXII, 29; XXXIV, 45, 55; XXXIX, 55; XLI, 13. CHAP. II. - Romanus. Pour Romani, comme on l'a déjà vu, II, 27, et comme on le verra encore, V III, 5, XXIV, 27, etc. De même on rencontre Samnis pour Samnites, VII, 35; Tarquiniensis pour Tarquinienses, IX, 41; et Carthaginiensis pour Carthagienenses, XXIV, 47 ; XXVIII, 44. CHAP. III. - Agrestes. Le traducteur, en rendant ce mot par paysans, n'a sans doute pas voulu prouver qu'il partageait les singulières idées qu'un érudit en gants jaunes a omises récemment sur la prétendue féodalité des temps anciens; idées dont la critique judicieuse et spirituelle d'un savant universitaire, M. Rossignol, a fait si complètement justice (voyez Revue des deux mondes, 15 février 1859). Il fallait, pour ne pas laisser d'incertitude, traduire agrestes par gens de la campagne, comme l'ont fait MM. Dureau de la Malle et Liez. IBID. - Justitio. Dans les malheurs extraordinaires, dans les grands dangers de la république, tout travail, toute affaire cessait, soit par un mouvement spontané, soit d'après un ordre de l'autorité. Le cours de la justice était aussi interrompu, ce qui faisait donner à cet état de choses le nom de justitium. Voyez ch. XXIII; IV, 26, 31; VI, 2,7;VII, 6, 28; IX, 7; XXIII, 25; XXV 1, 26, etc. Cf. Adam, Ant. rom., t. II, p. 104 et 352 de la tr. fr., 2e édit. IBID. - Praefecto urbis relicto. Quand les rois, et après eux les consuls, jusqu'au règne d'Auguste, s'absentaient de Rome, ils nommaient un préfet de la ville (Tac., Ann., VI, Il). Ce magistrat, qui les remplaçait temporairement, pouvait assembler le sénat, quoiqu'il ne fût pas sénateur (Aulu-Gelle, N. A., livre XIV, ch. dern.); il pouvait aussi tenir les comices, comme nous l'avons vu plus haut, livre I, ch. LIX et LX. Mais depuis l'institution du prêteur il fut uniquement chargé de la célébration des feriae latinae. Sous Auguste, cette magistrature reprit une très grande importance, et fut confiée aux hommes les plus distingues de l'état. On peut consulter, sur l'extension qu'elle reçut alors, Adam, ouvr. cité, t.1, p. 255. IBID. - Census deinde actus. Le cens, comme nous l'avons vu (I, 42, fut institué par le roi Servius Tullius et eut lieu quatre fois sous son règne, s'il faut en croire Valère Maxime ( III, 4). Interrompu sous Tarquin-le-Superbe, il fut rétabli la seconde année après l'expulsion des rois ( voyez Denys d'Halic., V, 20). Il eut lieu depuis trois fois avant celui dont il est question ici : la première, par ordre du dictateur T. Lartius, l'an 256; la seconde, sous le consulat de Sp. Cassius et de Postumus Cominius, l'an 251; le troisième, sous L. Furius et 804 A . ou C. Manlius,en 280. C'est ce que nous apprend Denys d'Halicarnasse, V, 75; VI, 65; VI, 96; et IX, 56. Celui dont parle Tite-Live dans ce passage était donc le neuvième depuis la fondation de Rome. Voltaire, dont le scepticisme s'attaquait à tout, ajoute peu de foi au cens de Servius. « Le premier dénombrement que nous ayons d'une nation profane est celui que fit Servius Tullius, sixième roi de Rome. Il se trouva, dit Tite-Live, quatre-vingt mille combattants, tous citoyens romains. Cela suppose trois cent quarante mille citoyens au moins, tant vieillards que femmes et enfants, à quoi il faut ajouter au moins vingt mille domestiques, tant esclaves que libres. » Or on peut raisonnablement douter que le petit état romain contint cette multitude. Romulus n'avait régné (supposé qu'on puisse l'appeler roi) que sur environ trois mille bandits, rassembles dans un petit bourg entre des montagnes. Ce bourg était le plus mauvais terrain de l'Italie. Tout son pays n'avait pas trois mille pas de circuit. Servius était le sixième chef ou roi de cette peuplade naissante. La règle de Newton, qui est indubitable pour les royaumes électifs, donne à chaque roi vingt et un ans de règne, et contredit par là tous les anciens historiens, qui n'ont jamais observé l'ordre des temps, et qui n'ont donné aucune date précise. Les cinq rois de Rome doivent avoir régné environ cent ans. » Il n'est certainement pas dans l'ordre de la nature qu'un terrain ingrat, qui n'avait pas cinq lieues en long et trois en large, et qui devait avoir perdu beaucoup d'habitants dans ses petites guerres presque continuelles, pût être peuplé de trois cent quarante mille âmes. il n'y en a pas la moitié dans le même territoire où Rome aujourd'hui est la métropole du monde chrétien, où l'affluence des citoyens et des ambassadeurs de tant de nations doit servir à peupler la ville, où l'or coule de la Pologne, de la Hongrie, de la moitié de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, par mille canaux, dans la bourse de la daterie, si d'autres causes ne l'interceptent. » L'histoire de Rome ne fut écrite que plus de cinq cents ans après sa fondation. Il ne serait pas du tout surprenant que les historiens eussent donne libéralement quatre-vingt mille guerriers à Servius Tullius, au lieu de huit mille, par un faux zèle pour la patrie. Le zèle eût été plus grand et plus vrai s'ils avaient avoue les faibles commencements de leur république. Il est plus beau de s'être élevé d'une si petite origine à tant de grandeur, que d'avoir eu le double des soldats d'Alexandre pour conquérir environ quinze lieues de pays en quatre cents années. » Voltaire, Dict. philos., art. DÉNOMBREMENT. Tout cela, comme on le voit, est plus piquant que juste. On peut sans doute, comme nous avons eu plus d'une fois occasion de le dire, révoquer en doute la plupart des faits relatifs aux deux premiers rois de Rome. Mais l'époque de Servius a un caractère historique incontestable, et si dans l'année où nous sommes parvenus le cens presentait un effectif de cent vingt-quatre mille deux cent quatorze citoyens, chiffre qui n'a pas été conteste, que je sache, on conçoit que sous Servius il ait déjà pu s'élever à quatre-vingt mille citoyens, comme le dit Tite-Live (I, 44), mais non de quatre-vingt mille citoyens en état de porter les armes, comme le disait Fabius Pictor, dont Tite-Live récuse le témoignage dans cet endroit. Niebuhr lui-même, si peu crédule pour toute l'histoire qui précède les guerres puniques, regarde les chiffres des cens comme entièrement exacts ( voyez t. I, p. 613; t. II, p. 313 de la tr. fr.), bien qu'il en tire des conséquences en faveur de son idée favorite. CHAP. III. - Prætor orbos orbasque. M. Liez, dans une savante note, a prouvé que par ces mots il fallait entendre les célibataires.. « Heineccius, dit-il au chapitre XXV du livre I de son livre intitulé Antiquitatum romanarum jurisprudentiam illustrantium syntagma, énumère les causes de l'éloignement des Romains pour le mariage, et termine par ces mots : « Et praecipue illa orbitatis praemia, quae toties celebrant veteres. Colebantur ejusmodi μισόγαμοι ab omnibus. » Ici le sens de orbitas, interprété par μισόγαμοι ne saurait être contesté. Nous pourrions citer encore de nombreux passages des anciens où il doit se traduire par célibat. Nous nous bornerons à deux ou trois.. « Coepisse orbitatem in auctoritate summa ac potentia esse, captationem in questu maximo. » (Pline, H. N. ,XV, prooem.) « Filium filiamque ingerebat orbis senibus. » (Petron. Satyr., ad fin.) « Hunc igitur sordidum orbos senes circumveniendi modum. » (Id., ibid.) Plus haut il emploie la périphrase : « Qui vero nec uxores unquam duxerunt, » pour exprimer absolument la même chose. « Servius, ajoute M. Liez, avait fait passer les droits de citoyens des hommes aux choses, des individus aux propriétés. Ainsi chez nous l'importance des contributions fait les électeurs et les éligibles; mais il fallait prévenir la concentration de ces propriétés et l'épuisement de cette classe privilégiée de citoyens, diminuée sans cesse par la guerre. De la ces faveurs, ces distinctions accordées aux chefs de nombreuses familles, et ces peines portées contre les célibataires, rayés du rôle des citoyens. (Voyez Montesquieu, Gr. et Dec., ch. XIII.) » CHAP. IV. - Furioe, Fusios scripsere quidam. La permutation des lettres s et r, non seulement à la fin des mots, comme dans orbos et arbor, mais même dans l'intérieur des mots entre deux voyelles, comme dans les vieilles formes citées par Varron et Festus, foedesum, plusima, meliosem, majosibus, devenus plus tard foederum, plurima, meliorem, majoribus, est un fait grammatical que la langue latine ne pressente pas seule, mais qu'on retrouve dans toute celte grande famille d'idiomes connue sous le nom de langues indo-européennes. Consultez sur ce point M. Bopp, Vergleichende Grammatik des Sanshrit, Zend, Griechischen, Lateinischen. Litthanischen, Gottischen und Dudschen, Berlin, 1855 et suiv. § 22, 86 et 127. Voyez aussi pour le sanscrit, Bopp, Gramm. crit. Ling. sanscr., § 75, d: pour le grec, Maittaire, Gr. Ling. dialecti, p. 146, B ; Matthiae, Gr. gr., § 15, p. 61; pour le latin, Joh. Adam Hartung, Ueber die casus, p. 106 et suiv., et pour les idiomes germaniques, Jacob Grimm, Deutsche gramm., t. I, p. 802. Aux exemples cités par M. Hartung pour la langue latine on peut encore ajouter ce passage de Tite-Live, livre III, ch. vii : « T. Veturium Geminum, sive ille Vetusius fuit.. » Et cet autre de Cicéron (Ep. fam., IX, 21) : « Quorum princeps L. Papirius Mugillanus... . sed tum Papisii dicebamini. » - La traduction : Comme on l'écrit quelquefois, n'indique pas assez l'ancienneté de cette orthographe. IBID. - Videret ne quid respublica detrimenti caperet. C'est le premier exemple de ce sénatus-consulte qui, dans des cas graves, où le salut de la république était compromis, confiait un pouvoir dictatorial à l'un des deux consuls, et même quelquefois à tous deux. Depuis on eut souvent recours à cette mesure de salut public exclusivement 805 dirigée contre les attaques extérieures. Opimius le premier , en fit usage contre les citoyens à l'époque où les tentatives démocratiques des Gracques mirent l'aristocratie romaine dans un si grand danger. Plutarque, en rapportant cette dernière circonstance dans la vie des Gracques (Caius Gracch. ch. XVIII), n'a pas voulu, comme quelques-uns l'ont cru, faire entendre que cette institution datait de l'année où les généreux défenseurs de la cause populaire succombèrent sous les coups de leurs ennemis. Manuce, dans son traité de Senatu romano, p. 928, et Drakenborch, sur ce passage, en ont déjà fait la remarque. CHAP. IV. - Proconsule T. Quinctium... mitti. C'est la première mention du proconsulat qu'on rencontre dans Tite-Live et dans les autres historiens. Toutefois, comme T. Quinctius ne fut nommé que pour le moment, on est autorisé à reculer cette institution jusqu'à Publilius Philo, le premier dont on ait prorogé le pouvoir consulaire, l'an de Rome 127. Voyez Tite-Live, VIII, 23 et 26. Le titre de proconsul, dans l'acception la plus ordinaire, désignait celui qui, après avoir rempli le consulat ou la préture (XXIII, 30 ), était préposé à l'administration d'une province avec l'empire et la juridiction; ou bien encore celui dont on avait prorogé le pouvoir pour continuer une guerre commencée. Quelquefois aussi de simples particuliers étaient investis de cette autorité, comme P. Corn. Scipion, qui l'obtint à l'âge de vingt-quatre ans, durant la deuxième guerre punique (XXVI, 19). CHAP. V. - Decumana porta. Les camps romains étaient de forme carrée et avaient quatre portes, une à chaque face ; celle qui regardait l'ennemi s'appelait porta praetoria vel extraordinaria: les deux portes latérales porta principalis dextra et porta principalis sinistra, et celle de derrière porta decumana. Contentons-nous de citer sur cette dernière le passage classique de Tacite, Ann., I, 66 : « Tanta inde consternatio irrupisse a Germanos credentium, ut cuncti ruerint ad portas, quarum decumana maxime petebatur, aversa hosti et fugientibus tutior. » On n'est pas d accord sur l'étymologie de ce mot : les uns le tirent des dimensions de la porte, les autres de ce que près de la se trouvaient les dixièmes cohortes. Voyez X, 32 ; XXXIV, 47 ; XL, 27 et 51; Polyb., VI, 26; X, 39; Lipsius, de Mill. rom., II, 57; IV, 8 et V; 5, Stewech, ad Veget., I, 23; Patric., de Re milit.; Schel. ad Hygin. et Polyb. in Graev. Thes. t.X, p.945, 1084, 1152, 1164, 1279. IBID. - Antias Valerius. Nous avons déjà eu occasion de dire (p. 770, col. 2) que Antias était un surnom propre à la famille Valeria, et le ch. XXXIV du livre XXIII ne peut laisser aucun doute à cet égard. Nous avons prouvé aussi dans les notes sur le ch. I de ce livre que le surnom précède quelquefois le nom de la famille. C'est donc à tort que le traducteur a rendu ici Antias Valerius par l'Antiote Valerius, et Valerius Antias (XXIII, 34 ; XXVI, 49) par Valerius d'Antium. Du reste, M. Liez est tombé dans la même erreur. IBID. - Et exsequendo subtiliter numerum. Nous verrons plus loin Tite Live faire des reproches plus graves à Valerius Antias et le taxer tantôt d'exagération (XXXVI, 38 ), tantôt même de mensonge (XXVI, 49 : Adeo nullus mentiendi modus est ). CHAP. VI. - Principium anni agebatur. Il s'agit ici de l'année consulaire et non de l'année civile, qui commençait toujours au 1er janvier. Les consuls entrèrent en charge d'abord le 23 ou 21 février, jour où, suivant la tradition, avait eu lien l'expulsion des Tarquins puis le 1er août. A l'époque des decemvirs, le commencement de l'année consulaire fut placé au Ier mai; cinquante ans plus tard au 15 décembre ; puis au 1er juillet jusqu'à l'an de Rome 530, année où il fut transféré au 15 mars. Enfin en 598 ou 599, il fut définitivement fixé au 1er janvier, et depuis, l'année consulaire et l'année civile commencèrent le même jour. Sur le motif de ce changement voyez Denys d'Halicarnasse, X, p. 678 et Ovide, Fast., I, 81; III, 147. CHAP. VI. - Et auxere vim morbi. Je m'étonne que les critiques, qui ont reproché à l'histoire romaine tant de prétendus emprunts faits à l'histoire grecque, n'aient pas vu ici une imitation de la peste d'Athènes en 429. Il y avait cependant des rapprochements curieux à faire, et il était facile de retrouver une grande analogie entre le récit de Tite-Live et celui de Thucydide, dont je crois devoir transcrire ici quelques passages pour qu'on puisse en juger. « Ce qui par surcroît de malheur accabla surtout les Athéniens, ce fut l'affluence de ceux qui vinrent de la campagne dans la ville; les nouveaux venus en souffrirent particulièrement. Par le manque de maisons, comme ils logeaient durant l'été dans des cabanes étouffantes, la mortalité s'ensuivait et avec le plus grand désordre. Ils expiraient entassés les uns sur les autres; plusieurs à demi morts se roulaient dans les rues, autour de toutes les fontaines, pour s'y désaltérer; et les temples dans lesquels ils s'étaient abrités se remplissaient de morts qui y avaient expiré. » (Thucyd., II, 52, trad. de M. Ambr. Didot.) « Ce que ce mal avait surtout de plus affreux, c'était le découragement de ceux qui se sentaient attaqués, et qui, bientôt saisis de désespoir, périssaient par leurs soins mutuels en se communiquant la contagion de l'un à l'autre comme des troupeaux de moutons. » (Ibid., 51.) On le voit, avec un peu de bonne volonté, il serait facile d'accuser Tite-Live de plagiat; niais ce serait a tort: les mêmes faits doivent amener les mêmes résultats, et rien dans la narration de notre historien ne choque la vraisemblance. S'il eût copié Thucydide, il se serait étendu sur les symptômes de la maladie, tandis qu'il se borne à en constater la cause et les effets; Niebuhr lui-même n'a pas ici révoque en doute la véracité de l'historien romain, et même il en tire des conséquences favorables à son système. Suivant lui , les gentes eurent à souffrir plus de diminution que la commune, « et ainsi les patriciens perdirent de plus en plus le caractère de bourgeoisie pour se réduire à l'état d'oligarchie. » IBID. - Cura aedilium plebei erat. Tite-Live parle ici pour la première fois des édiles plébéiens, magistrats dont l'institution remonte à celle des tribuns (an de Rome 260 ), dont ils étaient en quelque sorte les assesseurs. Ils étaient particulièrement charges de la célébration de certains jeux , du soin des édifices publics et c'est de là qu'ils tiraient leur nom (ab ædium cura), des bains, des égouts, de la voie publique, des marches, des approvisionnements, de la surveillance des femmes de mauvaise vie, en un mot de tout ce qui concernait la police urbaine. On voit que leurs fonctions offrent beaucoup d'analogie avec celles qu'ont remplies successivement les lieutenants puis les préfets de police. L'an de Rome 587, les édiles plébéiens ayant reculé devant les frais qui entraînerait la célébration des Grands Jeux, les jeunes patriciens offrirent de s'en charger si on 806 les nommait édiles. On créa donc deux édiles patriciens. Telle fut l'origine de l'édilité curule, dans laquelle, ainsi que dans la préture instituée à la même époque, les patriciens voyaient une compensation de l'admission des plébéiens au consulat. Mais ils ne jouirent pas longtemps de cet honneur exclusif; la même année les tribuns réclamèrent énergiquement et le sénat eut honte, dit Tite-Live, d'exiger qu'on choisit encore les édiles curules parmi les patriciens. On convint d'abord de les prendre de deux ans en deux ans parmi les plébéiens; puis on finit par laisser le choix libre (Tite-Live, VI, 42 et VII, 1). Lédilité curule et l'édilité plébéienne n'en restèrent pas moins distinctes. La première, à laquelle ne furent sans doute admises que les familles plébéiennes les plus riches, puisqu'elle exigeait de grandes dépenses, se distinguait par la robe prétexte, le droit d'images, la prérogative de prendre place dans le sénat et d'y donner son avis, et enfin la chaise curule, tandis que les édiles plébéiens n'avaient, ainsi que les tribuns, d'autre siége que des bancs (subsellia). Voyez sur les édiles romains le savant ouvrage de Fr. Guil. Schubert, de Romanorum aedilibus. Regiomontii, 1828, in-8°. Nous renvoyons aux notes sur le chapitre 1 du livre VII la discussion des opinions émises par Niebuhr sur cette importante question. CHAP. VI. - Per lartranos agros. Il a déjà été question, Livre I, ch. XXXIX, de Lavici, ancienne ville du Latium, située sur la via Lavicana, près de la ville moderne la Colonna. Les manuscrits varient sur l'orthographe de ce nom: les uns l'écrivent par un v, les autres par un b, et cette différence n'a rien qui doive étonner quand on se rappelle que les copistes confondent continuellement ces deux lettres. Ce qui semblerait assurer la préférence à la leçon Labici, Labicani, c'est une inscription publiée par Reinesius, class. II, inscr. 26; par Spon, Miscell. erud. ant., p. 131; et par Fabretti, Inscr. ant., p. 411, où il est mention d'un CVRATOR. VIAE. LABIC., id est, Labicanae. CHAP. VII. - Curio maximus. Chacune des trente curies établies à Rome peu de temps après sa fondation avait son chef ou curion particulier, dont la principale fonction était de sacrifier ou de présider aux sacrifices pour les curies. Noyez Varron, de L. L., V, 83, p. 25; VI, 46, p. 65 (Egger ); Denys d'Halicarnasse,II, 7, 23, 64. Les trente curions étaient tous subordonnes au grand curion, lequel était élu dans l'assemblée des comices par curies. Paul. Diac.: « Maximus Curio cujus auctoritate curiœ omnesque curiones reguntur. » C. Mamilrus Vinius fut le premier plébéien revêtu de cette dignité, l'an de Rome 544. VoyezTite-Live, XXVII, 8. CHAP. VIII. - Quum aliquot interregna exissent. Sous les rois, lorsque le trône était vacant, le sénat nommait un de ses membres qui, pendant cinq jours, avait la principale direction des affaires, avec toutes les marques distinctives de l'autorité royale. Celui-ci les transmettait à un autre, et elles passaient ainsi entre les mains d'un certain nombre de sécateurs jusqu'à l'élection du roi. Voy. Tite-Live, I, 17 et 22; Denys d'Halicarnasse, II, 57. Sous la république, on créait un interroi lorsque, comme dans la circonstance dont il s'agit, l'un ou l'autre consul était mort avant la fin de son consulat, ou lorsque les deux consuls étaient absents, ou enfin lorsque l'intervention des tribuns du peuple avait empêché les élections ( voyez VI, 36). Les comices devant être présidées par un magistrat suprême qui exit le droit de prendre les auspices, il fallait nécessairement, quand il n'y avait ni consuls ni dictateur, créer un magistrat extraordinaire, qui put remplir ces importantes fonctions. Aussi l'interrègne fut-il la seule magistrature que les patriciens ne partagèrent jamais avec les plébéiens. » Quem in ipsum patricium esse, et a patriciis prodi necesse erat. » Cic., pro Dom.,14. Le passage qui nous occupe semble prouver que l'interrègne sous la république avait la même durée que sous les rois. CHAP. IX. - C. Terentillus Arsa. Niebuhr (t. III, p. 369 de la tr. fr.) prouve que des différentes leçons Terentilius, Terentillius, Terentillus, la première doit être préférée par analogie, Terentilius venant de Terentius de meme que Quinctilius de Quinctius, Publilius de Publius. « Comme nom de gens, aboute-t-il, Terentillus est une leçon inadmissible; elle est née de l'i de l'écriture lombarde, que l'on peut à peine distinguer de 1. Il faut donc, au chapitre X, lire aussi lex Terentilia.. Quant au surnom, le même critique prétend que la véritable orthographe en est Harsa, qu'on trouve en effet dans plusieurs manuscrits. M. Michelet le dérive de ardere et le traduit par boute-feu. IBID. - Tempore capto. Glareanus a eu tort de vouloir changer capto en apto. Cette formule se rencontre plus d'une fois dans Tite-Live (cf. XXVI, 12; XXX, 42; XXXIII, 28 et peut ètre XXXV, 19) et équivaut à capta occasione, qu'on rencontre dans Frontin, Strat.,l, II, 1. Les Grecs disaient de même λαβεῖν καιρόν. Voyez Eurip., Iph. Taur., 907; Heliod., Aethiop., II, 17 et 33. IBID. - Ad tollendum e republica consulare imperium. La proposition de Terentilius Arsa avait une portée que ne se dissimulaient pas les patriciens, mais qu'ils n'avouaient pas. Le droit de rendre la justice était passé des rois aux consuls, et, dans leurs arrêts, ils suivaient pour règle l'arbitraire et les coutumes bien plus encore que les lois, qui étaient alors en petit nombre et souvent négligées, la connaissance en étant exclusivement réservée aux patriciens. Ces derniers avaient trop d'intérêt à laisser dans le vague et l'indécision la limite de leurs droits et de ceux du peuple, pour consentir à la codification des coutumes et des lois. Aussi s'opposèrent-ils dix ans à la loi Terentilia. Niebuhr justifie la proposition de Terentilius, qui en effet était de toute justice. « Ces époques désastreuses, dit-il, ont cela d'avantageux qu'elles font connaître les vices des institutions existantes; beaucoup de citoyens attendent de leur abolition le retour du bien-être. Il n'y a point de doute que telle fût la cause des motions qui, après la peste et les désastres de la guerre, eurent pour objet l'amélioration des lois. » (T. III, p 369 de la tr. fr.) CHAP. X. - Ovans sine militibus urbem iniret. Le général dont la victoire n'avait offert aucune difficulté, présente nul péril (Aulu-Gelle, N. A., V, 6), amène aucun résultat important, n'obtenait qu'un triomphe d'un ordre inférieur, l'ovation. Il entrait dans la ville non pas sur un char, mais à pied ou à cheval; couronné non de laurier, mais de myrte ; entouré non de ses soldats, mais d'une troupe de musiciens. Au lieu d'un bœuf on immolait une brebis (ovem ), et c'est de là, suivant Plutarque (Vie de Marcell., ch. XXII), que ce genre de triomphe tirait son nom. L'étymologie de Festus, qui fait dériver le mot otatio des acclamations O! dont les soldats remplissaient l'air, paraîit aussi fausse que ridicule. Le premier qui obtint cet honneur fut P. Postumius Tubertus, la septième année après l'expulsion des rois (Plin., H. N., XV, 29). 807 CHAP. X. - Carmen pluit. Le même prodige, qui est raconté par Valère Maxime (l, VI, 5) et par Denys d'Hal. ( X, 2 ), a été plus d'une fois révoqué en doute. Niebuhr ne partage pas le scepticisme des commentateurs de Tite-Live, et croit qu'il y a un fond de vérité dans ce récit. « Il ne faut pas rejeter ce phénomène comme fabuleux, quelque incroyable qu'il paraisse. Il pleuvait, dit-on, des flocons de chair, que les corbeaux ingens numerus avium, Tite Live; rπτερωτῶν ἀγέλοις, Denys d'Hal.) dévoraient, mais ce qui en restait sur le sol ne se corromπait point. Peut-être que depuis qu'on observe généralement et avec soin, on n'a rien vu de pareil; et cependant combien peu s'est écoulé de temps depuis que l'on recueille les expériences qui ne paraissent pas rationnelles ou concordantes avec le système dominant. Mais cela ne se fût-il lamais représenté, faudrait-il pour ce motif rejeter un rapport formel atteste par des contemporains? Pas plus que nous n'avons de raison pour nous moquer de la loi de Moise, parce qu'il est encore inconcevable que les habits et les murs soient infectés de la lèpre, attendu que cela n'arrive pas aujourd'hui.. (T. III, p. 366 de la tr. fr.) IBID. - Libri per duumviros sarrorum aditi. C'étaient les livres Sibyllins, appelles ailleurs fatales (XLII, 2 ). Ces livres, suivant la tradition rapportes par Denys d'Halicarnasse (IV, 62), mais sur laquelle Tite-Live garde le silence, avaient été apportes à Rome, sous Tarquin-l'Ancien ou sous Tarquin-le-Superbe, et étaient au nombre de trois. Les duumriri sacrorum étaient charges de les consulter dans les circonstances difficiles; l'an de Rome 387, le nombre de ces ministres fut porté à dix; plus tard mène Sylla l'éleva à quinze. CHAP. XI.- Discedere pupulum jussissent. Au moment de voter les lois, le héraut appelait les centuries selon leur rang; elles quittaient alors la place ou elles étaient assemblées, et chacune allait se renfermer dans l'enclos (septum ou ovile) qui lui était destiné. C'était un espace entouré de planches (locus tabulatis inclusus), qui était rapproché du tribunal consulaire. De là venait l'expression intro vocatae sc. in ovile ( Tite-Lire, X, 13). Un étroit passage élevé au-dessus du sol et nommé pons ou ponticulus y conduisait. Chaque centurie y passait l'une après l'autre (discedebat). CHAP. XII. - Cui Cincinnato cognoment erat. Dion Cassius (Excerpta Peiresc., p. 574) prétend qu il était ainsi surnommé parce qu'il se frisait les cheveux, ce que Zonaras (VII, 18) a répété, sans doute d'après cet historien. Mais cette étymologie s'accorde difficilement avec la simplicité des moeurs de Quinctius. Il est donc beaucoup plus vraisemblable que ce surnom lui venait de ce que sa chevelure était si naturellement bouclée qu'on eût pu croire qu'il as ait recours à des moyens artificiels. CHAP. XIII. - ln Subura. Subura ou Suburra était un quartier de Rome très fréquenté, entre l'Esquilin et le Coelius. Voy. Juven., III, 5, et Adler, Descript. de Rome, p. 145 et suiv. IBID. - Solum redisse exilii causa. C'est l'expression consacrée, voyez ch. LVIII; XXI, 63; XLIII, 2. Cic., pro Domo sua, 30 « Qui erant rerum capitalium condemnati, non prius hanc civitatem amittebant quam erant in eam recepti, quo vertendi, hoc est, mutandi soli causa venerant. » Dans ce dernier passage, les mots hoc est mutandi sont évidemment une glose passée dans le texte. Cicéron n'avait nul besoin d'expliquer cette locution à ses auditeurs. CHAP. XIV. - Seniores Patrum.... juniores. Niebuhr (t. III, p. 386, cf. t. II. p. 52, n. 46), tout en reconnaissant que par juniores Tite-Live entendait parler de jeunes gens, prétend que cependant on ne peut méconnaître ici les majores et les minores gentes. Sans nier les divisions qui pouvaient exister entre les majores et les minores, comme il les appelle, divisions qu'amènent toujours des distinctions insultantes, je doute fort qu'il en soit même indirectement question dans ce passage. On peut voir d'ailleurs ce qu'il faut entendre par Patres majorum et minorum gentium dans une savante note de M. Burnouf sur Tacite, Ann., XI, 25. On y trouvera des idées beaucoup plus nettes que dans tout ce qui a été écrit sur ce sujet par le critique allemand (voyez les passages cités et t. III, p. 151 et suiv. de la tr. fr.). Car quoi que puisse dire ce dernier, je n'admettrai jamais que les écrivains du siècle d'Auguste, et notamment Tite-Live, se soient mépris sur le sens des mots majores et minores dans les livres anciens, et les aient quelquefois traduits dans leur aveuglement par seniores et majores, surtout quand je vois que Cicéron (de Rep., II, 28) connaissait parfaitement la portée et l'origine de ces deux dénominations. CHAP. XV. - Servitiis, id est, servis. Remarquez cet emploi de l'abstrait pour le concret. De même plus haut, servitia regum superbonorum est pour servos, etc. (voyez encore ch. XVII; XXVIII, 11, etc.); de même XXI, 22 et XXI 1, 59 et 51, remigium est pour remiges; VIII, 12, dictatura pour dictator, etc. CHAP. XVI. - Fidem abrogare, id est non habere fidem, non credere. De même Cicéron, pro Q. Rosc., 44 : « Quibus abroges fidem jusjurandi, » id est, quibus fidem habendam in jurejurando neges; et Quaest. Acad., IV, 36; « aequaliter omnibus abrogatur fides, » id est, nulli creditur. Je regarde donc avec Crevier les mots non credendo comme une glose passée dans le texte. CHAP. XVII. Jupiter optimus maximus. Cicéron, de Nat Deor., II, 25, cherche à expliquer pourquoi l'épithète optimus précède maximus : • Sed ipse Jupiter .... dicitur.... a malorihus nostris optimus maximus; et quidem ante optimus, id est beneficentissimus simul quam maximus; quia majus est certeque gratius prodesse omnibus, quam opes magnas habere.» Rousseau n'est pas de cet avis. « Celui qui peut tout, dit-il au livre IV de l'Émile, ne peut vouloir que ce qui est bien, donc l'être souverainement bon, parce qu'il est souverainement puissant, doit être souverainement juste. » Et il ajoute en note : « Quand les anciens appelaient optimus maximus le Dieu suprême, ils disaient très vrai; mais en disant maximus optimus, ils auraient parlé plus exactement; puisque sa bonté vient de sa puissance, il est bon parce qu'il est grand. » Quoi qu'en dise Rousseau, quand les hommes invoquent l'Être suprême, ils s'adressent à sa bonté, plus encore qu'à sa puissance. IBID. - Jupiter optimus maximus, Juno regina et Minerva. Ces trois divinités étaient σύνναιοι et adorées dans le temple du Capitole, comme protectrices de la république. C'étaient celles que les poètes supposaient avoir été apportées de la citadelle de Troie à Rome. Voyez le IXe excursus de Heyne sur le chant II de l'Énéide. Ces trois noms se trouvent réunis dans Cicéron (pro Domo sua, 57 ), dans Valère-Maxime (V, X, 2 ), sur les médailles et sur les inscriptions. D'où l'on peut conclure que Junon reine était adorée à Rome avant la prise de Véies, 808 à la suite de laquelle la statue de cette déesse fut apportée sur l'Aventin, où on lui éleva un temple. Voyez V, 21, 22 et 31. CHAP. XVII.- Consules, tribunos, deos, hominesque omnes annales opem ferre. Gronovius, Crevier et d'autres encore, pensent qu'au lieu de deos il faut lire cives ; ce qui donne une gradation plus exacte. Par hommes ils entendent tous ceux qui ne jouissaient pas du droit de cité, comme les esclaves, les artisans et les étrangers. Pour moi, je suis d avis qu'on ne doit rien changer, que l'orateur, dans une circonstance aussi pressante, n'a pas froidement énuméré les différentes classes d'individus qui devaient prendre les armes pour défendre Rome, mais que, voulant frapper les esprits par des antithèses énergiques, il oppose d'abord les consuls aux tribuns, ces deux pouvoirs rivaux que le danger de la patrie commune doit réunir, et enfin les dieux et les hommes, également intéressés à protéger le sanctuaire de Jupiter très grand et très bon. L'invocation à Romulus qui suit immédiatement ne me paraît laisser aucun doute à cet égard. Dans Silius Italicus, XiI, 608 et suiv., au moment où Rome est assiégée par Annibal, Jupiter court au Capitole, et les autres dieux sur les sept collines qui leur sont consacrées pour les défendre arec les armes qui leur sont propres. IBID. - Princeps familiae suae. Valérius Publicola. Ce Glareanus sur lequel, au dire d'un brillant historien, le vent prosaïque des glaciers avait souflé le doute, a prétendu, et d'autres encore après lui, que Tite-Live faisait ici parler P. Valérius comme s'il s'agissait de son aïeul ou de son trisaïeul, bien que Denys d'Halicarnasse, au livre XI, p. 688, dise qu'il était fils de Valerius Publicola. Ce même Denys, ajoute-t-il, fait encore mention de P. Valérius au livre Vll, p. 417, et cependant il le fait mourir à la bataille du lac Régille, livre VI, p. 550. Mais Gronovius répond judicieusement au compatriote de Zuingle qu'il ne comprenait pas bien le sens du mot familia, que princeps familiae suae veut dire uniquement qu'avec le père de l'orateur avait commencé, dans la gens Valeria, la famille des Publicola ; qu'il en existait d'autres dans cette gens, comme par exemple la famille des Volusii, celle des Maximi ou Lacticini. De son côté, Drakenborch justifie Denys d'Halicarnasse, dont l'apparente contradiction, comme nous l'avons vu ( notes du livre lI, ch. XIX), a fourni un argument à Niebuhr contre l'authenticité du récit de la bataille livrée près du lac Régille. P. Valérius, consul en 292, était bien, dit-il, le fils de Valérius Publicola, l'un des fondateurs de la liberté romaine. C'est ce dont ne permet pas de douter le passage des Fastes Capitolins. où il est ainsi désigné: P. VALERIVS. P. F. VOLVSI. N. POPLICVLA. D'un autre côte, Denys a pu, sans manquer à la vérité historique, dire que P. Valerius, fils de Publicola, avait été tue dans la bataille en question; Publicola pouvait avoir eu deux fils portant le même prénom, ce qui n'était pas sans exemple à Rome. En effet, nous voyons par un passage d'Aulu-Gelle (N. A., XVII, 21) qu'Appius Claudius Caudex avait un frère appelé Appius Claudius, mais distingué par le surnom Caecus :. « Anno deinde post Romm conditam quadringentesimo ferme et nonagesimo, consulibus Ap. Claudio, cui cognomentum Caudex fuit, Ap. filius Caeci fratre, et M. Fulvio Flacco, bellum adversus Poenos primum emptum est. » CHAP. XVIII. - Suae fortunae a quoque sumptum supplicium est. C'est-à-dire que les hommes libres eurent la tête tranchée, et que les esclaves furent mis en croix. CHAP. XVIII. - Quadrantes... jactasse fertur. L'as valait alors environ 0,08 c.; la valeur du quadrant ou quart d'as n'était donc que de 0,02 c. Mais nous avons vu plus haut que le cens de l'année 290 avait donné un total de 101,214 citoyens. Or, les plébéiens composant la majorité de la population, la somme résultant d'une aussi modeste contribution devait être encore assez considérable. CHAP. XIX. - Comita consulis subrogandi. Quand un consul ou un autre magistrat mourait dans l'exercice de ses fonctions avait l'expiration du temps que devait durer si charge, le consul survivant ou tout autre fonctionnaire désigné pour tenir les comices, demandait au peuple de pourvoir au remplacement (subrogabat ). Celui que le peuple substituait au défunt (suffeciebat ) ajoutait à son titre l'épithète de suffectus. Voyez II, 8; XXIII, 24, etc. IBID. - Neque sacri, neque sancti sunt. « Sacer est ce que la religion a consacré; sanctus est ce qui est déclaré inviolable par une clause particulière de la loi. (sanctione) Ainsi sanctus est moins fort que sacer. » (CREVIER.) CHAP. XX. - Omnes in verba juraverint. « Le serment eut tant de force chez ce peuple ( les Romains ), que rien ne l'attacha plus aux lois. Il fit bien des fois, pour l'observer, ce qu'il n'aurait jamais fait pour la gloire ni pour la patrie. « Quinctius Cincinnatus, consul, ayant voulu lever une armée dans la ville contre les Èques et les Volsques, les tribuns s'y opposèrent.. » Eh bien I dit-il, que tous ceux qui ont prêté serment au consul de l'année précédente marchent sous mes enseignes. « En vain les tribuns s'écrièrentls qu'on n'était plus lié par ce serment; que quand on l'avait fait Quinctius était un homme privé ; le peuple fut plus religieux que ceux qui se mêlaient de le conduire. Il n'écouta ni les distinctions ni les interprétations des tribuns. » Lorsque le même peuple voulut se retirer sur le mont Sacré, il se sentit retenu par le serment qu'il avait fait aux consuls de les suivre à la guerre; il forma le dessein de les tuer; on lui fit entendre que le serment n'en subsisterait pas moins. On peut juger de l'idée qu'Il ai ait de la violation du serment par le crime qu'il voulait commettre. » Après la bataille de Cannes, le peuple effrayé voulut se retirer en Sicile; Scipion lui fit jurer qu'il resterait à Rome; la crainte de violer leur serment surmonta toute autre crainte. Rome était un vaisseau tenu par deux ancres dans la tempête, la religion et les moeurs. » Montesquieu, Esprit des lois, VII, XIII. IBID. - De proferendo exitu. L'ancienne leçon de proferendo exercitu a été blâmée avec raison par les critiques. Des différentes corrections proposées, de proferendo cum exercitu, de proferendo exercitus exitu, de proferendo exitu, etc., la dernière, qui a été reçue dans cette édition, paraît la seule admissible. CHAP. XXI. -- in reliquum magistratus continuari et eosdem refici. Ce passage confirme ce qui a été dit plus haut, que les tribuns n'étaient pas considérés comme des magistrats. CHAP. XXII. - Eques, cui superare velum haud facile fuerat. Les vainqueurs du monde, dit M. Liez, auraient pu apprendre des cuirassiers français, à la bataille de la Moskowa, comment la cavalerie enlève des retran- 809 chements. Voyez Ph. de Ségur, Hist. de la campagne de Russie, livre VII, ch. II. CHAP. XXIII. - Ad Columen... exercitu relicto, castra locat. Columen, suivant Ortelius, devait être un lieu situé dans le Latium, près du mont Algide, et qu'on appelle aujourd'hui Colonia. La leçon exercitu relicto, qui est évidemment fautive, a été corrigée de différentes minières : exercitu reliquo, reducto, relato, refecto, recollecto ou collecto. Crevier se prononce pour reducto, qui a été généralement suivi par les traducteurs. CHAP. XXIV. - Ferebant Volscio judices. C'est l'expression consacrée. Dans les affaires litigieuses, le demandeur proposait au défendeur le juge ou les juges qu'il avait choisis (judicem vel judices adversario ferebat), et lui demandait s'il n'en voulait pas d'autres (ne alium procaret, id est, posceret), en l'invitant à les choisir lui-même (ut judicem diceret, voyez ch. VII). Quand les parties étaient d'accord sur ce point, le préteur nommait (dabat vel addicebat) le juge ou les juges agréés par elles, selon une certaine formule qui rependait à la nature de l'action. Voyez Adam, Antiq. rom., t. I, p. 385 et suiv. de la tr. fr. CHAP. XXV. - Cum M. Valerio Valerii Filio. On a proposé de lire Manii au lieu de Valerii, l'usage étant de designer les fils non pas par le nom,miais par le prénom de leur père. C'est ce même Manius Valerius qui fut dictateur l'an de Rome 261. CHAP. XXVI. - L. Quinctius Cincinnatus consensu omnium dicitur. Tite-Live, pour cet épisode, a suivi la narration la plus ancienne. Voyez Denys d'Halicarnasse, X, 31. IBIGn. - Operae pretium est audire. Voltaire, qui dans son besoin de destruction s'attaquait aux traditions les plus respectables, ne partage pas l'admiration de Tite-Live pour la pauvreté de cette époque. Voici ce qu'il en dit dans son Apologie du Mondain.
J'entends ici des
pédants à rabats, VOLTAIRE, Apologie du Mondain. Machiavel, qui jugeait beaucoup plus sérieusement l'antiquité, s'est défendu de ce scepticisme qui dessèche l'âme et ferme tout accès aux sentiments généreux. « Une des lois les plus utiles dans un état libre, est celle qui maintient les citoyens dans la pauvreté. On ne voit pas quelle était la loi qui produisait à Rome cet heureux effet, car la loi agraire dont on devait naturellement l'attendre reçut toujours des oppositions. Il est cependant prouvé par le fait que quatre cents ans après la fondation de Rome, cette ville était extrêmement pauvre, et ce rare bonheur ne pouvait avoir d'autre principe que l'assurance où l'on était que la pauvreté ne fermait le chemin d'aucune dignité, d'aucune magistrature, et que les honneurs allaient trouver la vertu sous quelque toit qu'elle habitait. Cette vérité reconnue rendait les richesses moins désirables. » On en vit une preuve lorsque le consul Minutius fut enveloppé avec son armée par les Èques, et que la peur que l'on eut à Rome que cette ville ne devînt leur proie obligea de recourir à un dictateur, dernier remède aux plus grands maux. Le choix tomba sur L. Quinctius Cincinnatus, que l'on trouva labourant lui-même dans une petite maison de campagne où il s'était retiré. Tite-Live a consacré ce fait par ces paroles admirables : « Il est bon d'entendre ces gens qui méprisent tout sur la terre, hormis les richesses, et croient que l'honneur et la vertu ne peuvent se trouver que sous des palais remplis d'or ! » » Cincinnatus labourait lui-même ses champs, qui ne s'étendaient pas au delà de quatre arpents, quand les envoyés du sénat vinrent lui apprendre qu'on l'avait nommé dictateur, et le péril imminent où la république était exposée. Il prit sa toge, vint à Rome et forma promptement une armée pour aller délivrer Minutius. Il vainquit en effet les Èques, et prit sur eux un riche butin ; niais il ne souffrit point que l'armée délivrée eût sa part de ce butin: Je ne veux pas, dit-il, que vous participiez aux dépouilles de ceux dont vous avez failli vous-mêmes devenir la proie. Il priva aussi Minutius da consulat, et le réduisit à la qualité de lieutenant, en lui adressant ces paroles: Vous demeurerez dans ce grade jusqu'à ce que vous ayez appris à être consul. » Il avait choisi, pour être maître de la cavalerie, L. Tarquinius, qui combattait à pied à cause de sa pauvreté. Remarquons ici les honneurs qu'on rendait à Rome à la pauvreté, et que quatre arpents suffisaient à l'entretien d'un citoyen aussi distingue par son mérite que l'était Cincinnatus. La pauvreté des Romains au temps de Regulus nous est encore connue. Ce général, étant en Afrique, demanda au sénat la permission de revenir, parce que ses fermiers avaient totalement dégradé son champ. » J'ai ici deux choses à remarquer: d'abord la pauvreté de ces grands hommes, et combien ils la goûtaient, contents d'illustrer leurs nones par des victoires, et laissant l'état en retirer tout l'avantage; car s'ils avaient songé à s'enrichir par la guerre, ils se seraient peu mis en peine de voir dégrader leurs pauvres métairies. Je remarque en second lieu la grandeur de leur courage. Se trouvaient-ils à la tète d'une armée? leur âme s'élevait à une hauteur supérieure à celle de tous les princes; ils ne comptaient pour rien ni monarchies, ni républiques ; ils ne s'étonnaient d'aucun obstacle, ils ne s'épouvantaient d'aucun ennemi ; mais rentrés dans l'état de particuliers, ils devenaient économes, modestes, attentifs à conserver leurs petits biens, soumis aux magistrats et respectueux envers les anciens. Conçoit-on qu'un tel changement puisse s'opérer dans la même âme? Cette pauvreté était encore en honneur au temps de Paul-Émile; on vit luire à cette époque les derniers beaux 810 jours de la république; un citoyen dont les triomphes enrichirent Rome y vécut content dans la pauvreté. Elle y était encore tellement estimée, qu'en distribuant les récompenses méritées pendant la guerre, Paul-Émile gratifia sou gendre d'une coupe d'argent, la première pièce de vaisselle qui fût entrée dans sa maison. » On ferait voir, par bien d'autres raisons, que la pauvreté est plus avantageuse que la richesse; qu'elle a fait fleurir des cités, des provinces, des religions, et que la richesse les a perdues, si cette matière n'avait souvent été traitée par une infinité d'écrivains. » MACHIAVEL, Réfl. sur Tite-Live, livre III, chap. XXV, t. 1I, p. 547 de la tr. fr. CHAP. XXVII. - Vallisque duodenis. « C'étaient des branches d'arbres ordinairement bifurquées, ou ayant trois et au plus quatre rameaux, afin qu'on pût en les plantant les entrelacer et en former une palissade plus serrée et plus impénétrable. « CREVIER. Voyez Lipsius, Mil. rom., V, 11. IBID. - Puncto seape temporis rerum momenta verti. Nous verrons plus bas (XXXII, 17) une pensée analogue: « Ex parvis rebus seape magnarum momenta pendent. » Cette réflexion n'a pas échappé à Voltaire, qui la met dans la bouche de César :
J'ai servi,
commandé, vaincu quarante années, CHAP. XXVIII. - Tribus hastis jugum fit. Dans les temps anciens le joug imposé aux boeufs avait la forme d'un II, et de là le nom donné aux trois lances réunies sous lesquelles on faisait passer les vaincus en signe de servitude. Les expressions consacrées en pareille circonstance sont sub jugum, ou sub jugo mitti, ou traduci, ou emitti (IX, 6, 15), ou abire, comme dans le passage qui fait l'objet de cette note. Paul Diac.: « Jugum sub quo victi transiliant, hoc modo fiebat : fixis duabus hastis, super castigabatur tertia.Sub iis victos descinctos transire cogebant.. » Cf. Zonaras, VII, 17. CHAP. XXIX. - Et tu L. Minuci. « Non seulement Rome fut moins ingrate que les autres républiques, mais même en punissant ses généraux elle mit toujours dans ses châtiments plus de bonté et plus d'égards. Avaient-ils péché par malice, elle les punissait avec douceur; n'avaient-ils failli que par ignorance, quelquefois au lieu de les punir elle les honorait et les récompensait. Cette conduite était fort bien vue. Rome était persuadée qu'il importait extrêmement que ses généraux eussent l'esprit libre et dégagé d'inquiétudes, et que nulle espèce de considérations étrangères ne pût gêner leurs opérations. Elle ne voulait point ajouter de nouveaux embarras, de nouveaux périls, à une chose qui de soi-même en est remplie; elle croyait enfin qu'une maladresse de cette nature l'empêcherait de trouver jamais des généraux qui se portassent vigoureusement à une expédition. Par exemple, envoyait-elle une armée en Grèce contre Philippe de Macédoine, ou en Italie contre un peuple qui avait remporté d'abord quelque victoire, le général chargé de cette guerre était d'abord agité de tous les soins qui accompagnent de pareilles entreprises; si, l'esprit déjà tourmenté de ces soins naturellement graves et importants, il avait eu encore sous les yeux l'exemple effrayant de généraux mis en croix ou livrés à d'autres supplices pour avoir perdu une bataille, comment, au milieu de tant de soucis, aurait-il été capable de prendre un parti courageux? Persuadée par conséquent que ses généraux étaient assez punis par la honte seule d'être vaincus, Rome ne voulait pas les effrayer par la crainte d'une punition plus rigoureuse. » Citons un exemple de sa conduite relativement aux fautes où il entrait de la malice. Sergius et Virginius étaient campés sous les murs de Veies. Sergius occupait le coté par où les Toscans pouvaient apporter du secours; le quartier de Virgimus se trouvait à l'opposé. Sergius, attaqué par les Falisques et par d'autres peuples, aima mieux se laisser rompre et mettre en fuite que d'envoyer demander du secours à Virginius. Celui-ci, attendant toujours que son collègue s'humiliât, pour ainsi dire, devant lui, aima mieux être témoin du déshonneur de sa patrie et de la ruine d'une de ses arrimes que de faire un seul mouvement. Tout cela sans doute était criminel, et l'impunité des deux généraux n'aurait pu faire porter qu'un jugement très désavantageux de la discipline romaine. Mais, quoique une autre république les eût envoyés au dernier supplice, Rome ne les condamna qu'à une amende; non que leur faute ne fût digne d'un châtiment plus rigoureux, mais parce que les Romains se piquèrent dans cette occasion de suivre les principes de leurs ancêtres. » A regard des fautes d'ignorance, quel exemple plus frappant que celui de Varron, dont la témérité fit gagner à Annibal cette fameuse bataille de Cannes qui mit Rome sur le penchant de sa ruine? Non seulement on ne le punit pas, parce qu'il avait moins péché par malice que par ignorance; mais tout le sénat fut le recevoir aux portes de Rome, lui rendit les plus grands honneurs, et, ne pouvant pas le remercier de la bataille qu'il avait perdue, le remercia d'être revenu à home et de n'avoir pas désespéré du salut de la république. » Quand Papirius Cursor voulut faire mourir Fabius, pour avoir, contre sa défense, donne bataille aux Samnites, parmi les raisons que le père de Fabius opposait à l'obstination du dictateur, il faisait valoir celle-ci, qui après les défaites les plus sanglantes, les Romains n'avaient jamais traite leurs généraux comme Papirius voulait traiter son fils après une victoire signale. » MACHIAVEL, Refl. sur Tite-Live, livre I, ch. XXXI, t. 1, p. 277 et suiv. de la tr. fr. CHAP. XXIX. - Volscius damnatus. Cicéron, dans son discours pro Domo sua, prétend que Ceson fut rappelé et que les tribuns, voyant combien son père était aimé et considéré du peuple, n'osèrent s'opposer à ce jugement. CHAP. XXX. - Vincebaturque consulare imperium tribunitio auxilio. Crévier fait avec raison observer ici la propriété des termes consulare imperium, parce que le consulat était une magistrature; trubunitium auxilium, parce que le tribunat n'était qu'un secours, auxilii latio, contre les abus de l'autorité. CHAP. XXXI. - De Arentino publicando. « On a vu, livre I, ch. XXIII, que l'Aventin avait été donné aux nouveaux citoyens, tirés de Politorium, dle Tellènes et de Ficane. Apparemment qu'ils n'en avaient point occupé la totalité, ou qu'ils avaient depuis changé de demeure; car Denys d'Halicarnasse rapporte, livre X, qu'à cette époque il était en grande partie couvert d'arbres. La loi d'Icilius, en maintenant les propriétés dont t'acquisition avait été faite légalement, revenait sur celles qui étaient le fruit de la fraude ou de la violence; elle les reprenait en remboursant aux possesseurs actuels leurs dépenses, sur l'estimation d'arbitres nommes à cet effet, et les ren- 811 dait gratuitement au peuple, avec la partie restée vacante pour y construire des habitations. » CREVIER. CHAP. XXXII. - Placet creari decemviros. « Dans le feu des disputes entre les patriciens et les plébéiens, ceux-ci demandèrent que l'on donnât des lois fixes, afin que les jugements ne fussent plus l'effet d'une volonté capricieuse ou d'un pouvoir arbitraire. Après bien des résistances, le séna y acquiesça. Pour composer ces lois on nomma des decemvirs. On crut qu'on devait leur accorder un grand pouvoir, parce qu'ils avaient à donner des lois à des partis qui étaient presque incompatibles. On suspendit la nomination de tous les magistrats; et, dans les comices, ils furent élus seuls administrateurs de la république. Ils se trouvèrent revêtus de la puissance consulaire et de la puissance tribunitienne; l'une leur donnait le droit d'assembler le sénat, l'autre celui d'assembler le peuple; mas ils ne convoquèrent ni le sénat ni le peuple. Dix hommes dans la république eurent seuls toute la puissance législative, toute la puissance exécutive, toute la puissance des jugements. Rome se vit soumise à une tyrannie aussi cruelle que celle de Tarquin. Quand Tarquin exerçait ses vexations, Rome était indignée du pouvoir qu'il avait usurpé; quand les triumvirs exercèrent les leurs, elle fut étonnée du pouvoir qu'elle avait donné. » Mais quel était ce système de tyrannie, produit par des gens qui n'avaient obtenu le pouvoir civil et militaire que par la connaissance des affaires civiles, et qui, dans les circonstances de ces temps-là, avaient besoin au dedans de la lâcheté des citoyens pour qu'ils se laissassent gouverner, et de leur courage au dehors pour les défendre? » MONTESQUIEU, Esprit des lois, XI, 15.
Ces luttes
éternelles, LA HARPE, Virginie, act. I, sc. I. CHAP. XXXII. - Aliaeque sacratae leges abrogarentur. Il faut en excepter la loi sacrée relative aux tribuns du peuple, dont le pouvoir fut nul sous les decemvirs. Sur les lois sacrées, voyez p.798. Case. XXXIII. - Anno trerentesimo altero. Il s'en faut d'un an que la chronologie de Tite-Live ne s'accorde ici avec celle de Dodwell. CHAP.. XXXIV. - Tam legibus condendis opem dabatur. « Les decemvirs travaillèrent avec beaucoup d'application durant toute l'année à dresser leur code de lois, qu'ils tirèrent, partie des anciennes ordonnances des rois de Rome, partie de ce qu ils empruntèrent des lois de la Grèce, que leur interpréta un certain Hermodore, fort homme de bien, l'un des principaux d'Éphèse, lequel, exilé de sa patrie, se trouvait alors par hasard à Rome. Pline, livre XXXIV, ch. V, nous apprend qu'on lui érigea une statue dans la grande place de cette ville.» Rome. IBID. - Quas consensus omnium, non jussisse latas magis quam tulisse videri posset. « Il faut distinguer ferre de jubere. Proposer des projets de lois, ferre leges. était la fonction du magistrat; jubere, c'est-à-dire convertir la simple proposition en loi, lui donner force de loi, appartenait au peuple. » CREVIER. CHAP. XXXIV. - Desiderium decemviros iterum creandi.
Un an devait finir
l'ouvrage et leur puissance; Virginie, act. I, sc. 1. CHAP. XXXV. - In trinum mundinum. Les marchés auxquels on venait de la campagne vendre des denrées à Rome étaient comme des jours de foire. Ils se tenaient régulièrement de neuf en neuf jours, novem dies, d'où le mot latin nundinae. (Voyez Adam, Ant. Rom., t. I, p. 135 et 319; t. II, p. 95 de la tr. fr. M. Liez le transcrit dans sa longue note, sans en avertir ses lecteurs.) IBID. -Tanta exarsit ambitio. « Ce mot exprime le désir des honneurs, mais innocent et légitime, au lieu qu'ambtus exprime les brigues et les moyens illicites employés pour y parvenir. » CREVIER. IBID. - Q. Poetilius, T. Antonius Merenda, Caeso Duilius, Sp. Oppius Cornicen, Man. Rabuleius. S'il faut eu croire Denys d'Halicarnasse, ces cinq décemvirs étaient plébéiens. CHAP. XXXVI. - Primum honoris diem denuntiatjone ingentis terroris insignem fecere. « La création des decemvirs, chargés par le peuple romain de faire des Iois, semble contredire ce principe, que le pouvoir nuisible à l'état est celui qu'usurpe la force, et non celui qui est conféré par les suffrages d'un peuple libre. Devenus tyrans avec le temps, les decemivirs foulèrent aux pieds la liberté de Rome. » Il y a deux choses à considérer : la manière de donner l'autorité, et le temps pour lequel elle est donnée. Il est toujours dangereux de la donner pour longtemps, et j'appelle longtemps une année ou plus; ses bons ou ses mauvais effets dépendent des bonnes ou des mauvaises qualités de ceux qui en sont revêtus. D'autre part, si on compare l'autorité des decemvirs avec celle du dictateur, la première paraîtra bien plus étendue. La création du dictateur n'anéantissait pas l'autorité des tribuns, du consul, du sénat: le dictateur ne pouvait les en dépouiller; s'il avait le droit de priver un consul, un sénateur de son état, il ne pouvait détruire le consulat ni le sénat; l'autorité du sénat, des consuls et des tribuns, demeurait toujours comme un surveillant qui l'empêchait de sortir de son devoir. Il n'en fut pas de même lors de la création des decemvirs : le consulat et le tribunat furent abolis. On leur donna, pour la composition des lois et pour toute autre matière, le pouvoir suprême du peuple lui-même. Demeurés seuls, sans consuls, sans tribuns, sans appel au peuple, sans surveillants qui les observassent, ils purent aisément, dès la seconde année, excités par l'ambition d'Appius, se porter aux derniers excès. » Ainsi, quand nous avons dit que l'autorité librement confèrée n'était pas dangereuse dans un état, nous avons supposé qu'un peuple ne se portait point à la conférer sans les précautions nécessaires ni pour un temps trop considérable. Mais toutes les fois que, trompé ou aveuglé de quelque manière que ce puisse être, il la donnera 812 aussi Imprudemment que le peuple romain la donna aux decemvirs, il éprouvera les mêmes malheurs. En voulez-vous la preuve? considérez les raisons qui continrent les dictateurs dans le devoir, celles qui en firent sortir les decemvirs; considérez de quelle manière les républiques réputées sages ont donne l'autorité pour un long temps, Sparte à ses rois, Venise a ses doges, vous verrez dans ces deux états un surveillant toujours attentif qui empêche les rois et les doges d'abuser de leur pouvoir. Il n'importe ici que la substance de l'état ne soit pas corrompue ; un pouvoir absolu parvient bientôt à la corrompre et a se faire des partisans. N'importe encore que le tyran soit sans richesses et sans parenté : les richesses et tous les autres avantages courent au-devant du pouvoir; et les décemvirs en sont un exemple particulier. » MACHIAVEL, ouvr. cité, livre I, ch. XXXV, t. I, p. 294. CHAP. XXXVI. - Nec attinuisse demi securim. « Valérius Publicola avait introduit l'usage de porter les faisceaux sans hache devant les consuls. Les decemvirs rétablirent l'usage contraire, sous prétexte qu'il avait été permis d'appeler des consuls au peuple, au lieu que leur magistrature avait été créée sans appel. » CREVIER. Case. XXXVII. - Illi ferre, agere plebem, etc. Les commentateurs proposent diverses manières de restituer ce passage. La conjecture de Doujat, approuvée par Crévier et Liez, paraît la plus plausible. La voici : Hi ferre, agere plebem plebisque res fortunasque : quicquid capitum foret, potentioris esse. IBID. - Hac mercede juventus nobilis corrupta.
Ainsi de commander la
flatteuse habitude LA HARPE, Virginie, act. I, sc. 1. CHAP. XXXVIII. - Ad pignora capienda. Le sénateur qui refusait on négligeait de se rendre aux assemblées du sénat était, s'il ne donnait pas une excuse légitime, puni d'une amende, pour sûreté de laquelle on exigeait de lui des gages (pignora), qui étaient vendus en cas de non paiement. Voyez Cicéron, de Legibus, III, 4; Aulu-Gelle, N. A., XIV, 7; Plin., Ep., IV, 29; et surtout Cicéron, Philipp., I, 5. CHAP. XXXIX. - Valeriis et Horatiis ducibus pulsos reges. Le recit de Tite-Live ne justifie pas cette prétention des Horaces d'avoir été à la tête de la révolution qui bannit les rois, car il ne veut sans doute pas, comme des commentateurs l'ont cru, faire allusion ici au dévouement d'Horatius Cocles. Son assertion n'en est pas pour cela moins exacte; nous savons par Denys d'Halicarnasse que ce fut M. Horatius qui fit révolter l'armée contre Tarquin-le-Superbe, et qui, dans son second consulat, rendit inutiles tous les efforts tentés par Porsenna pour rétablir les Tarquins. CHAP. XL. - Aut socii. A l'exemple de Dureau de la Malle et de Liez, on a suivi dans la traduction la correction proposée par Crévier, et qui consiste à lire soli au lieu de socii. En effet C. Claudius, dont l'avis était le plus rigoureux, avait brigué le decemvirat. (Voyez chap. XXXV.) Mais peut-être pourrait-on se dispenser de rien changer à ce passage, si ce n'est l'ordre des mots. Je propote de lire : « Ut decemviros oppugnarent, aut socii, aut hi maxime qui decemviratum petissent. » Peut-être même faut-il conserver la phrase telle qu'elle est, en admettant que ce qu'elle offre d'irrégulier dans sa construction tient au désordre inséparable des mouvements passionnes. Ce qu'il y a de certain, c'est que les decemvirs avaient rencontré deux sortes d'adversaires, ceux-là même qui avaient inutilement brigué le décemvirat, tels que C. Claudius, et leurs propres amis, tels que L. Valérius Pontus, Horatius Barbatus et Cornelius. Socii a ici le sens d'amici, familiares, sodales. CHAP. XLII. - Nihilo militioe, quam domi, melius respublira administrata est. « On vit manifestement, pendant le peu de temps que dura la tyrannie des decemvirs, à quel point l'agrandissement de Rome dépendait de sa liberté. L'état sembla avoir perdu l'âme qui le faisait mouvoir. » Il n'y eut plus dans la ville que deux sortes de gens : ceux qui souffraient la servitude et ceux qui, pour leurs intérêts particuliers, cherchaient à la faire souffrir. Les sénateurs se retirèrent de Rome comme d'une ville étrangère; et les peuples voisins ne trouvèrent de résistance nulle part. » MONTESQUIEU, Gr. et Dec. des Romains, ch. I. CHAP. XLIII. - L. Siccium. Voyez pour les traits de bravoure de Siccius Dentatus, l'Achille romain, le discours que lui prête Denys d'Halicarnasse, livre X, ch. XXXVI et suiv. Valère Maxime, III, 2 ; et Pline, Vll, 28. CHAP. XLIV.- Ad clamorem nutricis. Les nourrices, chez les anciens, devenaient souvent les gouvernantes des jeunes filles qu'elles avaient elevees. IBID. - Virginium reipublicae causa dixissent abesse.
Quoi donc, oubliez-vous LA HARPE, Virginie. act. II, sc. III. CHAP. XLVI. - Non Virginiam defendi ab Icilio.
Je sais tout ce que tu
médites ; CHAP. XLVIII. - Non ut quemquam quietum violaret.
Romains, sachez qu'ici cet appareil des armes
LÀ HARPE, Virginie, act. II, sc. III. IBID. - Prope Cloacinae. Vénus Cloacine était ainsi nommée parce que la statue de cette déesse avait été trouvée dans un égout. Voy. Lactance, I, XX, 1 I. Spanheim, de Praest. et Usu numism., diss. X, p. 191, et les interprètes de saint Augustin, de Civ. Dei. IBID. - Ad tabernas. Sur l'emplacement du temple de Vénus Cloacine ou Cluacine (Plin., XV, 29 et 36), voyez Martian., Urb. rom., III, 5; Panvini, Descr. urb., reg. VIII; Fabricius, Descr. urb., c .X; Nardini, Rom. vet., V, 8. Hoc te uno, quo possum.
Reçois de mon amour la marque la plus chère. . LA HARPE, Virginie, act. IiI, sc. III. Te, inquit, Appi.
... La voilà, monstre! es-tu satisfait?
Ibid., act. V, sc. III. CHAP. XLVIII. - Eamne liberorum procreandorum conditionem. « Le spectacle de la mort de Virginie, immolée par son père à la pudeur et à la liberté, fit évanouir la puissance des décemvirs. Chacun se trouva libre, parce que chacun fut offensé; tout le monde devint citoyen, parce que tout le monde se trouva père. Le sénat et le peuple rentrèrent dans une liberté qui avait été confiée à des tyrans ridicules. » Le peuple romain, plus qu'un autre, s'émouvait par les spectacles : celui du corps sanglant de Lucrèce fit finir la noyaute ; le debiteur qui parut sur la place couvert de plaies fit changer la forme de la république; la vue de Virginie fit chasser les decemvirs ; pour faire condamner Manlius il fallut ôter au peuple la vue du Capitole; la robe sanglante de César remit Rome dans la servitude. » MONTESQUIEU, Esprit des Lois, XI, 15. CHAP. L. - Ne quod celus App. Claudii esset.
Romains, voyez ce sang! c'est moi... Non, par ma main
LA HARPE, Virginie, act. V, sc. III. CHAP. LI. - Praerogativam. Dans les assemblées du peuple, le sort décidait dans quel ordre voteraient les centuries ou tribus (sortitio fiebat ). On jetait leurs noms dans une urne (sitella defertur, Cic., N. D, I, 38; sitella allata est ut sortirentur, Tite-Live, XXV, 5). On agitait cette urne pour mêler les bulletins; la centurie ou la tribu désignée par le sort pour avoir l'initiative dans l'émission des votes recevait le titre de praerogativa; celles qui la suivaient étaient dites primo vocatae (Tite-Lise, X, 15 et 22), les autres jure vocatae, (XXVII, 6). Le vote de la centurie prérogative était regardé comme le plus Important. Par extension le mot praerogativa désignait ce vote lui-même, et était pris quelquefois pour un signe ou in gage, pour un avis ou un augure favorable de l'avenir ( supplicatio est praerogativa triumphi, Cic., Fam., XV, 5), pour un exemple, une autorité, comme dans le passage qui donne lieu à cette note, etc. CHAP. LII. - Via Nomentana, ceu Ficulensi. Cette voie était ainsi nommée parce qu'elle conduisait à Nomentum et à Ficulea ou Ficulnes, villes des Sabins. Voyez Drakenborch, et Adler, Descript. de Rome, p. 61). CHAP. LIV. - Abdicant se magistratu, ingenti omnium laetitia. « On remarquera d'abord que l'établissement du decemvirat fut produit a Rome par les mêmes causes qui, partout ailleurs, ont toujours fait tomber dans la mérite faute : le trop grand désir d'être libre de la part du peuple, de la part des nobles la trop grande envie de commander. Quand ces deux passions sont extrêmes, si les deux partis ne s'accordent point à faire une loi qui serve de rempart et de sauvegarde à la liberté, mais que l'un des deux au contraire s'efforce d'élever un citoyen, tout est perdu : on a un tyran. Ce fut le désir d'abolir le consulat d'une part, le tribunat de l'autre, qui réunit à Rome les nobles et le peuple pour créer des décemvirs et leur confier une autorité si absolue.. Les décemvirs une fois créés, le peuple se plut à favoriser Appius, persuadé qu'il était devenu tout populaire, et qu'il abaisserait la noblesse. Mais lorsqu'un peuple commet la faute d'élever quelqu'un afin qu'il abaisse le parti contraire, ce favori est bien malhabile s'il ne se rend point absolu. Qu'il se serve d'abord de la faveur du peuple pour abattre la noblesse, et qu'il ne commence l'oppression du peuple qu'après que les nobles seront abattus : alors le peuple sentira vainement son esclavage; tout refuge lui sera ôté. « Telle est la méthode toujours employée par ceux qui, dans le sein d'un état libre, ont établi une tyrannie. Et si Appius avait su la mettre en usage, sa tyrannie, plus profondément enracinée, n'eût pas été si promptement abattue. Il se conduisit tout différemment. Tel fut l'excès de son imprudence, qu'il se donna pour ennemis ceux dont la faveur l'avait mis on état d'usurper le pouvoir suprême et pouvait consolider son usurpation, et qu'il voulut être l'ami de ceux qui, dans le principe, n'ayant pas concouru à son élévation, n'auraient pas eu le pouvoir de l'y maintenir; aussi perdit-il tous ses véritables amis, tandis que la folie le portait à se lier avec tous ceux qui ne pouvaient l'être. En effet, quoique la noblesse aspire à la tyrannie, ceux des nobles qui ne la partagent pas détestent toujours le tyran. Jamais assez riche pour rassasier leur avarice, n'ayant jamais assez d'emplois pour assouvir leur ambition, il doit renoncer à les gagner tous. C'est ainsi qu'en laissant le peuple pour se lier avec la noblesse Appius commit une faute énorme. » Indépendamment des raisons ci-dessus alléguées, il est évident que toute violence a besoin, pour s'établir, d'une force supérieure à la résistance qu'elle éprouve. Aussi les tyrans qui ont le peuple pour ami, et pour ennemi la noblesse, voient s'élever bien plus sûrement leur autorité que ceux qui, haïs du peuple, ne sont appuyés que par les grands. La faveur du peuple leur suffit pour être les maîtres au dedans; elle suffit à Nabis, tyran de Sparte, lorsqu'attaqué par les Grecs et par les Romains, assuré d'un très petit nombre de nobles, mais cheri du peuple, il trouva les moyens de se défendre. Sans l'amitié du peuple il s'en serait vainement flatté. » Il n'en est. pas de même des tyrans qui n'ont d'amis que la noblesse. Trop faibles au dedans, ils ont besoin de s'étayer par des forces extérieures, soit en se procurant une garde composée d'étrangers, soit en armant les campagnards, afin d'en tirer les mêmes services que le peuple leur aurait rendus ; ou en se liant avec des voisins assez puissants pour les défendre. C'est par ces moyens seulement que, malgré la haine du peuple, un tyran peut se soutenir. Mais Appius ne pouvant point armer les campagnards, parce que la ville et la campagne étaient à Rome la même chose, et négligeant les autres moyens qu'il aurait pu employer, sapa lui-même les fondements de son édifice. » Les fautes énormes du peuple et du sénat dans la création des décemvirs ne sauraient être excusées par ce qu'on a dit ci-dessus au sujet de la dictature. Il est certain que l'autorité qui détruit la liberté n'est point celle que le peuple donne, mais celle que l'ambition sait lui arracher. Il n'est pas moins vrai que le peuple ne doit la donner qu'avec des précautions qui ne permettent guère d'en abuser; au lieu d'élever ces barrières salutaires, les Romains les abattirent toutes, en détruisant toutes les magistratures, afin de faire des decemvirs les seuls magistrats de la république. Et ce fut, comme on l'a dit, d'une part, le désir d'abolir le consulat, de l'autre, celui de se défaire des tribuns, qui aveugla le peuple et le sénat 814 au point de les faire concourir à l'établissement le plus destructeur. Les hommes, disait le roi Ferdinand, ressemblent a certains petits oiseaux de proie, que leur avis dite naturelle acharne tellement sur celle qu'ils poursuivent, qu'ils ne sentent pas que d'autres plus forts fondent sur eux pour les déchirer. » On voit toutes les fautes que commirent les Romains en voulant maintenir la liberté, celles que commit Appius en voulant se rendre absolu. » Une des fautes les plus énormes d'Appius fut de changer trop promptement de manière et de caractère. On ne peut assez louer sa finesse à tromper le peuple en prenant des manières toutes populaires, son adresse à trouver les moyens pour faire proroger les décemvirs, son audace en se nommant lui-même contre l'opinion de la noblesse, son attention de se donner des collègues dévoués à ses volontés. Il mérita toute sorte de blâmes, lorsque, changeant tout d'un coup de caractère, il se montra l'ennemi du peuple, de son ami qu'il était; lorsque d'affable et d'humain, il se rendit fier et cruel ; et cela si promptement, que sa fausseté dut frapper les moins attentifs sans lui laisser la moindre excuse. Pour devenir méchant après avoir paru bon, il est des gradations à observer; il faut si bien ménager ce changement, l'accorder si bien aux circonstances, que les vieux amis qu'il vous fait perdre se trouvent remplacés d'avance par les nouveaux qu'il vous attire, de manière que votre pouvoir n'en soit nullement affaibli. Autrement, découvert et sans amis, vous êtes perdu sans ressource. » MACHIAVEL, Refl. sur Tite-Live, liv.l, ch. XL et XLI. CHAP. LIV.- Præsto erit pontifex maximus. Dans les temps réguliers la présidence des comices assembles pour l'élection des tribuns du peuple appartenait à l'un des tribuns en fonction que le sort désignait (voyez chap. LXIV). Mais comme, après l'abdication des decemvirs, il n'existait pas de tribuns, le grand pontife, qui, comme les tribuns, était nommé dans les comices par tribus, se trouvait être le seul magistrat en état de présider l'assemblée. CHAP. LV. - Tenerentur ne patres plebiscitis. On appelait plébiscites les lois que le peuple adoptait dans les comices par tribus, sur la proposition des tribuns. CHAP. LVI. - Plebiscitis. « On n'avait point de droit à se disputer sous les decemvirs; mais, quand la liberté revint, on vit les jalousies renaître ; tant qu'il resta quelques privilèges aux patriciens, les plébéiens les leur ôtèrent. » Il y aurait eu peu de mal si les plébéiens s'étaient contentés de priver les patriciens de leurs prérogatives, et s'ils ne les avaient pas offensés dans leur qualité même de citoyen. Lorsque le peuple était assemble par curies et par centuries, il était composé de sénateurs, de patriciens et de plébéiens. Dans les disputes, les plébéiens gagnèrent ce point, que seuls, sans les patriciens et sans le sénat, ils pourraient faire des lois qu'on appela plébiscites, et les comices où on les fit s'appelèrent comices par tribus. Ainsi il y eut des cas où les patriciens n'eurent point de part à la puissance législative, où ils furent soumis à la puissance législative d'un autre corps de l'état: ce fut le délire de la liberté. Le peuple, pour établir la démocratie, choqua les principes mêmes de la démocratie. » MONTESQ., Esprit des Lois, XI, 16. IBID. - .Judicibus, decemviris nocuisset. Les mots judicibus et decemviris ont embarrassé les interprètes et embarrassaient déjà les jurisconsultes au temps de Tite Live. Bauer croit que par le mot jurdicibus la loi Romaines désignait les édiles plébéiens, que Denys d'Halicarnasse VII, 90) appelle ὑπηρετας τῶν δημάρχων καὶ συνάρχοντας καὶ δικαστάς, et que par decemviri on indique d'une manière plus précise les tribuns du peuple. Mais ces deux magistratures étant déjà nommées dans la loi, l'interprétation de Bauer ne parait pas admissible, et il vaut mieux croire avec quelques commentateurs qu'il s'agit ici de quelques officiers de justice subalternes, puisque les juges qui portèrent le nom de decemvirs ne furent institués que beaucoup plus tard. On a aussi proposé de lire duumviri, magistrature dont il a déjà été question I, 26 ; mais les manuscrits portent tous decemviri. Dans celui que M. Lemaire a consulté, ce mot manquait dans le principe, mais il a été rétabli postérieurement. CHAP. LVI. - Ad aedem Cereris, Liberi, Liberæque. Voyez Hartung, Religion des Romains, t. II, p. 155. CHAP. LVII. - Tabulis duodecim est nomen. « Je me trouve fort dans mes maximes lorsque j'ai pour moi les Romains ; et je crois que les peines tiennent à la nature du gouvernement, lorsque je vois ce grand peuple changer à cet égard de lois civiles à mesure qu'il changeait de lois politiques. » Les lois royales, faites pour un peuple composé de fugitifs, d'esclaves et de brigands, furent sévères. L'esprit de la république aurait demandé que les décemvirs n'eussent pas mis ces lois dans leurs Douze Tables; mais des gens qui aspiraient à la tyrannie n'avaient garde de suivre l'esprit de la république. » Tite-Live (liv. I, chap. XXXVIII) dit, sur le supplice de Métius Suffécius, dictateur d'Albe, qui fut condamné par Tullus Hostilius à être tiré par deux chariots, que ce fut le premier et le dernier supplice où l'on témoigna avoir perdu la mémoire de l'humanité. Il se trompe, la loi dis Douze Tables est pleine de dispositions très cruelles. » Celle qui découvre le mieux le dessein des décemvirs est la peine capitale prononcée contre les auteurs des libelles et les poètes. Cela n'est guère du génie de la république, où le peuple aime à voir les grands humiliés; mais des gens qui voulaient renverser la liberté craignaient les écrits qui pouvaient rappeler l'esprit de la liberté. » Après l'expulsion des decemvirs, presque toutes les lois qui avaient fixé les peines furent ôtées. On ne les abrogea pas expressément; mais la loi Porcia ayant défendu de mettre à mort un citoyen romain, elles n'eurent plus d'application. » Voila le temps auquel on peut rappeler ce que Tite-Live dit des Romains, que jamais peuple n'a plus aimé la modération des peines. » Que si l'on ajoute à la douceur des peines le droit qu'avait un accusé de se retirer avant le jugement, on verra bien que les Romains avaient suivi cet esprit que j'al dit être naturel à la république. » MONTESQUIEU, Esprit des Lois, XI, 15. Les Romains faisaient le plus grand cas de la loi des Douze Tables. Cicéron, au chap. XLIV de l'Orateur, en fait un pompeux éloge et ne craint pas de les préférer, tant était grande la sagesse qui y régnait, à tout ce que les philosophes avaient écrit sur la même matière. Ce jugement si favorable ne doit pas étonner si l'on réfléchit que ce code était l'abrégé ou l'extrait de tout ce qu'il ) avait de meilleur dans les lois antérieures et dans la législation grecque. Aussi les jeunes patriciens qui étudiaient la jurisprudence étaient-ils obligés de l'apprendre par coeur, 815 comme des vers, sans changer ni transposer un seul mot tamquam carmen necessarium, Cic., de Leg., II, 23 ). Le temps ne nous en a malheureusement conservé que quelques fragments, qui ont été lobjet de savantes recherches. Les éditions les plus estimées sont celles de Jacq. Godefroy, de Bouchaud, de Dirksen, qui présentent tous une classification différente. M. Michelet, dans les notes du tome I de son Histoire romaine, a inséré les textes les plus importants recueillis par les différents éditeurs et les a interprétés. On peut consulter aussi le chapitre que l'auteur de ce commentaire a consacré à cette importante question dans son Précis d'Histoire romaine, ch. V. CHAP LVIII. - Appius sibi mortem conscivit. D'autres, et notamment Denys d'Halicarnasse, prétendaient qu'il avait été mis à mort par l'ordre des tribuns. CHAP. LXIV. - Auctores populares sententiae haud popularis nactus. La plupart des éditions portent Auctores popularis sententiae haud populares nactus, ce qui est évidemment une fausse leçon produite par une transposition de désinences; Horatius et Valerius, comme le remarque Crevier, devaient être des personnages incontestablement populaires, tandis que leur dessein de procéder à l'élection de nouveaux consuls, et par là de faire échouer le projet des tribuns, devait être moins agréable au peuple. CHAP. LXV. - Dum decem tribunos plebei faceret. Jusque là on avait laissé aux tribuns élus les premiers la facilité de se choisir des collègues pour remplir le nombre de dix, sans qu'ils eussent besoin de recourir aux suffrages du peuple. Voyez Adam, Antiq. rom., t. I, p. 213 de la tr. fr. CHAP. LXVII. - Esquilias... aggerem. On montait aux Esquilles par une chaussée que Tarquin-le-Superbe avait fait construire. CHAP. LXVIII. - Cum stipendia... faciebatis. On ne ne donnait point encore à cette époque de paie aux soldats romains ; mais du temps de Tite-Live stipendia facere et militare étaient synonymes. CHAP. LXIX. - Cujus non probassent causam. Ceux dont les raisons étaient trouvées valables s'appelaient causarii. IBID. - Quarta diei hora. Le jour chez les Romains était de douze heures comme la nuit, et s'étendait depuis six heures du matin, suivant notre manière de compter, jusqu'à six heures du soir. Quarta diei hora équivaut donc pour nous à dix heures du matin. IBID. - Signa ex ærario prompta. Quand une guerre était finie et qu'on avait licencié les légions, les étendards, c'est-à-dire les aigles faites d'un métal précieux, étaient déposées dans le trésor public, d'où on les retirait quand une nouvelle campagne allait commencer. Cf. IV, 22; VII, 23 ; Denys d'Halic., X, p. 645. CHAP. LXXII. - Circumire tribunos. Perizonius a vu le premier qu'il fallait lire circumire tribus, comme dans Suétone, Aug., 56, et plus haut, ch. XVIII, circumire piebem. C'étaient en effet les tribus qui étaient appelées à prononcer, comme on le voit plus bas, vocatae tribus judicaverunt. IBID. - Concionali seni. Cette épithète de Concionalis, dont on ne trouverait peut-être pas d'autre exemple dans Tite-Live, était prise en mauvaise part. Concionalis hirudo ærarii, misera ac jejuna plebecula. Cic., ad Att., I, 16; ad Quint. fr., II, 5. CHAP. LXXII - Quadruplatoris. On appelait quadruplatores les dénonciateurs des crimes contre l'état (delatores publicorum criminum, Cic., Verr., II, 8, 9 ), soit parce qu'ils recevaient comme salaire le quart des biens de ceux qui étaient condamnes sur leur déposition ; soit parce que l'amende imposée au coupable convaincu était quadruple (quadupli damnari ).
IBID. - Controversiosam adjudicaret rem. On
prétend que c'est le seul
exemple qu'on connaisse de l'adjectif controversiosus. Mais
Sénèque, Ep.
85, paraît l'avoir aussi employé. |