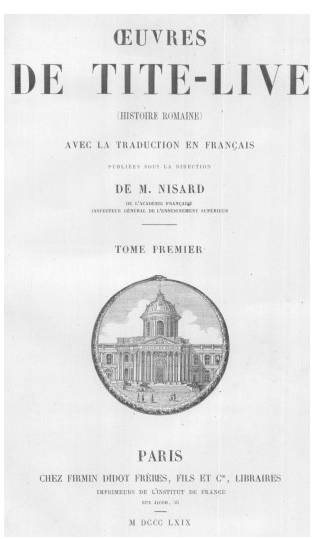|
ALLER A LA TABLE DES MATIERES DE TITE-LIVE TITE-LIVE Ab Urbe Condita, Livre I
Collection des Auteurs latins sous la direction de M. Nisard, Oeuvres de Tite-Live, t. I, Paris, Firmin Didot, 1864
Introduction
1 PRÉFACE. (1) Aurai-je lieu de m'applaudir de ce que j'ai voulu faire, si j'entreprends d'écrire l'histoire du peuple romain depuis son origine ? Je l'ignore; et si je le savais, je n'oserais le dire, (2) surtout quand je considère combien les faits sont loin de nous, combien ils sont connus, grâce à cette foule d'écrivains sans cesse renaissants, qui se flattent, ou de les présenter avec plus de certitude, ou d'effacer, par la supériorité de leur style, l'âpre simplicité de nos premiers historiens. (3) Quoi qu'il en soit, j'aurai du moins le plaisir d'avoir aidé, pour ma part, à perpétuer la mémoire des grandes choses accomplies par le premier peuple de la terre; et si parmi tant d'écrivains mon nom se trouve perdu, l'éclat et la grandeur de ceux qui m'auront éclipsé serviront à me consoler. (4) C'est d'ailleurs un ouvrage immense que celui qui, embrassant une période de plus de sept cents années, et prenant pour point de départ les plus faibles commencements de Rome, la suit dans ses progrès jusqu'à cette dernière époque où elle commence à plier sous le faix de sa propre grandeur : je crains encore que les origines de Rome et les temps les plus voisins de sa naissance n'offrent que peu d'attraits à la plupart des lecteurs, impatients d'arriver à ces derniers temps, où cette puissance, dès longtemps souveraine, tourne ses forces contre elle-même. (5) Pour moi, je tirerai de ce travail un grand avantage; celui de distraire un instant du spectacle des maux dont notre époque a été si longtemps le témoin, mon esprit occupé tout entier de l'étude de cette vieille histoire, et délivré de ces craintes qui, sans détourner un écrivain de la vérité, ne laissent pas d'être pour lui une source d'inquiétudes. (6) Les faits qui ont précédé ou accompagné la fondation de Rome se présentent embellis par les fictions de la poésie, plutôt qu'appuyés sur le témoignage irrécusable de l'histoire : je ne veux pas plus les affirmer que les contester. (7) On par- 2 donne à l'antiquité cette intervention des dieux dans les choses humaines, qui imprime à la naissance des villes un caractère plus auguste. Or, s'il est permis à un peuple de rendre son origine plus sacrée, en la rapportant aux dieux, certes c'est au peuple romain; et quand il veut faire du dieu Mars le père du fondateur de Rome et le sien, sa gloire dans les armes est assez grande pour que l'univers le souffre, comme il a souffert sa domination. (8) Au reste, qu'on rejette ou qu'on accueille cette tradition, cela n'est pas à mes yeux d'une grande importance. (9) Mais ce qui importe, et doit occuper surtout l'attention de chacun, c'est de connaître la vie et les moeurs des premiers Romains, de savoir quels sont les hommes, quels sont les arts qui, dans la paix comme dans la guerre, ont fondé notre puissance et l'ont agrandie; de suivre enfin, par la pensée, l'affaiblissement insensible dé la discipline et ce premier relâchement dans les moeurs qui, bientôt entraînées sur une pente tous les jours plus rapide, précipitèrent leur chute jusqu'à ces derniers temps, où le remède est devenu aussi insupportable que le mal. (10) Le principal et le plus salutaire avantage de l'histoire, c'est d'exposer à vos regards, dans un cadre lumineux, des enseignements de toute nature qui semblent vous dire : Voici ce que tu dois faire dans ton intérêt, dans celui de la république; ce que tu dois éviter, car il y a honte à le concevoir, honte à l'accomplir. (11) Au reste, ou je m'abuse sur mon ouvrage, ou jamais république ne fut plus grande, plus sainte, plus féconde en bons exemple : aucune n'est restée plus longtemps fermée au luxe et à la soif des richesses, plus longtemps fidèle au culte de la tempérance et de la pauvreté, tant elle savait mesurer ses désirs à sa fortune. (12) Ce n'est que de nos jours que les richesses ont engendré l'avarice, le débordement des plaisirs, et je ne sais quelle fureur de se perdre et d'abîmer l'état avec soi dans le luxe et la débauche. Mais ces plaintes ne blesseront que trop, peut-être, quand elles seront nécessaires; ne commençons donc pas par là ce grand ouvrage. (13) Il conviendrait mieux, si l'historien avait le privilège du poète, de commencer sous les auspices des dieux et des déesses, afin d'obtenir d'eux, à force de voeux et de prières, l'heureux succès d'une si vaste entreprise. SOMMAIRE. - Descente d'Énée en Italie; ses exploits.— Règne d'Ascagne à Albe, et des Silvius ses successeurs. — La fille de Numitor, surprise par Mars, devient mère de Romulus et de Remus. — Meurtre d'Amulius. — Fondation de Rome. — Établissement du sénat. — Guerre contre les Sabins.— Consécration de dépouilles opimes à Jupiter-Feretrien. — Division du peuple en curies. — Défaite des Fidenates et des Véiens. — Apothéose de Romulus. — Numa Pompilius institue les cérémonies religieuses; élève un temple à Janus; fait la paix avec tous les peuples voisins, et ferme, le premier, les portes de ce temple. A la faveur des entretiens nocturnes qu'il feint d'avoir avec la nymphe Égérie, il inspire à ce peuple farouche des sentiments religieux. — Tullus Hostilius porte la guette chez les Albains. — Combat des Horaces et des Curiaces. — Horace absous. — Supplice de Vettius Suffetius. — Ruine d'Albe; incorporation de ses habitants dans Rome. —Guerre déclarée aux Sabins. — Tullus périt frappé de la foudre. — Ancus Marcius renouvelle les cérémonies instituées par Numa; il défait les Latins, leur donne droit de cité, et leur assigne le mont Aventin pour demeure. Seconde prise de Politorium, ville du Latium, dont les anciens Latins s'étaient emparés, et ruine de cette ville. Ancus jette un pont de bois sur le Tibre; unit le mont Janicule à la ville, et recule les frontières de son empire; bâtit Ostie, et meurt après un règne de vingt-quatre ans. Sous son règne, Lucumon, fils du Corinthien Démarate, vient de Tarquinie, ville d'Étrurie, à Rome; admis dans l'intimité d'Ancus, il prend le nom de Tarquin, et monte sur le trône après la mort d'Ancus. Il augmente de cent le nombre des sénateurs; soumet les Latins; trace l'enceinte du cirque, et institue des jeux. Attaqué par les Sabins, il augmente les centuries des chevaliers. Pour mettre à l'épreuve la science de l'augure Attius Navius, il lui demande si ce qu'il pense dans le moment est possible, et, sur sa réponse affirmative, il lui ordonne de couper un caillou avec un rasoir, ce que l'augure fait sur-le-champ. — Défaite des Sabins; Rome entourée de murailles; construction des égouts. —Tarquin est assassiné par les fils d'Ancus après un règne de trente-huit ans. — Il a pour successeur Servius Tullius, fils d'une noble captive de Corniculum : la tradition rapporte que dans son enfance ou avait vu, dans son berceau, des feux briller autour de sa tète ; défaite des Veiens et des Étrusques. Établissement du cens, qui porte, dit-on, à quatre-vingt mille le nombre des citoyens. Cérémonie du lustre. Division du peuple par classes et par centuries. Le roi recule le Pomaerium, pour réunir à la ville les monts Quirinal, Viminal et Esquilin. De concert avec les Latins, il élève un temple à Diane sur le mont Aventin. - Il est tué par L. Tarquin, fils de Priscus, à l'Instigation de sa fille Tullie, après un règne de quarante-quatre ans. A sa mort, L. Tarquin le Superbe, sans l'aveu du sénat ni du peuple, s'empare du trône : le jour de l'usurpation, l'infâme Tullie fait passer son char sur le corps de son père. Tarquin s'entoure de grandes armées pour la sûreté de sa personne. Turnus Herdonius perit victime de sa perfidie. Tarquin fait la guerre aux Volsques, et de leurs dépouilles élève un temple a Jupiter dans le Capitole. Le dieu Terme et la déesse de la Jeunesse résistent à la destruction, et leurs autels restent debout dans le nouveau temple. La ruse de Sextus Tarquin, son fils, met en son pouvoir la ville des Gabiens. Ses fils se rendent à Delphes, consultent l'oracle pour savoir auquel d'entre eux doit obtenir la couronne : l'oracle répond que celui-là régnera qui donnera le premier baiser à sa mère. Ils se méprennent sur le sens de l'oracle; Junius Brutus qui les avait accompagnes se laisse tomber comme par mégarde, et baise la terre : l'événement ne tarde pas à justifier son interprétation; en effet, la tyrannie de Tarquin le Superbe ayant soulevé la haine générale, son fils Sextus y met le comble en ravissant l'honneur à Lucrèce qu'il avait surprise la nuit par la violence; celle-ci fait appeler Trisipitinus son père, et Collatin son mari, et se poignarde sous leurs yeux après leur avoir fait jurer de ne pas laisser sa mort sans vengeance. Ce serment s'accomplit, grâce aux efforts de Brutus surtout. Après un règne de vingt-cinq ans Tarquin est chassé. —Création des premiers consuls, L. Junius Brutus et L. Tarquimus Collatin. [I, 1] (1) C'est d'abord un fait assez constant, qu'après la prise de Troie la vengeance des Grecs, s'étant exercée sur le reste du peuple troyen, ne respecta qu'Énée et Anténor, soit que le droit d'une ancienne hospitalité les protégeât, soit que les conseils qu'ils avaient toujours donnés, de rendre Hélène et de faire la paix, engageassent le vainqueur à les épargner. (2) C'est encore une chose universellement connue, qu'après diverses aventures, Anténor, à la tête d'une troupe nombreuse d'Hé 4 nètes, qui, chassés de la Paphlagonie par une sédition, et privés de leur roi Pylémène, mort sous les murs de Troie, cherchaient un chef et une retraite, pénétra jusqu'au fond du golfe Adriatique, (3) et que, chassant devant eux les Euganéens, établis entre la mer et les Alpes, les Hénètes, réunis aux Troyens, prirent possession de leur territoire. Le lieu où ils descendirent d'abord a conservé le nom de Troie, ainsi que le canton qui en dépend, et toute la nation formée par eux porte le nom de Vénètes. (4) Énée, rejeté de sa patrie par la même catastrophe, mais destiné par le sort à fonder de bien plus grandes choses, arriva d'abord en Macédoine, passa de là en Sicile, d'où, cherchant toujours une patrie, il vint aborder avec sa flotte au rivage de Laurente, appelé aussi du nom de Troie. (5) À peine sur cette plage, les Troyens, auxquels une si longue navigation sur ces mers, où ils erraient depuis tant d'années, n'avait laissé que des armes et des vaisseaux, se répandent dans les campagnes pour chercher du butin, lorsque le roi Latinus et les Aborigènes, qui occupaient alors le pays, accourent en armes de la ville et les alentours, pour repousser l'agression de ces étrangers. (6) Suivant les uns, ce ne fut qu'après une défaite que Latinus fit la paix et s'allia avec Énée. (7) Suivant d'autres, les armées étaient en présence, et on allait donner le signal, lorsque Latinus s'avança entouré de l'élite des siens, et invita le chef de ces étrangers à une entrevue. Il lui demanda quelle était leur nation, d'où ils venaient, quel malheur les avait exilés de leur pays, et quel projet les amenait sur les rivages Laurentins. (8) Lorsqu'il eut appris qu'ils étaient Troyens, que leur chef était Énée, fils d'Anchise et de Vénus, et que, fuyant leur patrie et leurs maisons en cendres, ils cherchaient un asile et un emplacement pour y bâtir une ville, pénétré d'admiration à l'aspect de ce peuple glorieux et de celui qui le conduisait, les voyant d'ailleurs disposés à la guerre comme à la paix, il tendit la main à Énée, pour gage de leur future amitié. (9) Le traité se fit alors entre les chefs, et les armées se rapprochèrent; Énée devint l'hôte de Latinus, et, dans son palais, à l'autel de ses dieux pénates, Latinus, pour resserrer par des noeuds domestiques l'union des deux peuples, lui donna sa fille en mariage. (10) Cette alliance affermit les Troyens dans l'espérance de voir enfin un établissement durable fixer leur destinée errante. Ils bâtissent une ville. Énée la nomme l.avinium, du nom de sa nouvelle épouse. (11) De ce mariage naquit bientôt, comme du premier, un fils qui reçut de ses parents le nom d'Ascagne. II. (1) Les Aborigènes et les Troyens eurent une guerre commune à soutenir. Turnus, roi des Rutules, à qui Lavinie avait été promise avant l'arrivée d'Énée, indigné de se voir préféré un étranger, avait à la fois déclaré la guerre à Latinus et à Énée. (2) Aucune des deux armées n'eut à s'applaudir de l'issue du combat : les Rutules furent vaincus; la victoire coûta aux Aborigènes et aux Troyens leur chef Latinus. (3) Turnus et les Rutules, se défiant de leur fortune, cherchent un appui dans la puissance alors très florissante des Étrusques et de leur roi Mézence. Ce prince, qui dès l'origine avait établi le siège de son empire à Caeré, ville fort opulente, n'avait pas vu sans om 5 brage s'élever une cité nouvelle : croyant bientôt la sûreté des peuples voisins menacée par le rapide accroissement de la colonie troyenne, ce fut sans répugnance qu'il associa ses armes à celles des Rutules. (4) Pressé de faire face à une ligue si formidable, Énée, pour s'assurer contre elle du dévouement des Aborigènes, voulut réunir sous le même nom deux peuples déjà soumis aux mêmes lois; il les confondit sous la dénomination commune de Latins. (5) Dès ce moment les Aborigènes ne le cédèrent aux Troyens ni en fidélité ni en zèle pour Énée : fort de ces dispositions, Énée, avec ces deux peuples dont l'union se resserrait chaque jour, osa braver la puissance des Étrusques, qui remplissaient alors du bruit de leur nom la terre et la mer dans toute la longueur de l'Italie, depuis les Alpes jusqu'au détroit de Sicile; et bien qu'il eût pu, à l'abri de ses murailles, tenir tête à l'ennemi, il fit sortir ses troupes et présenta le combat. (6) La victoire resta aux Latins; mais c'est là que se terminèrent les travaux mortels d'Énée : de quelque nom qu'il soit permis de l'appeler, il est enseveli sur les bords du Numicius : on le nomme Jupiter Indigète. III. (1) Ascagne, fils d'Énée, n'était pas encore en âge de régner : toutefois il atteignit la puberté sans que son pouvoir eût souffert d'atteinte. La tutelle d'une femme (tant Lavinie avait de force d'âme) suffit pour conserver aux Latins leur puissance, et à cet enfant le royaume de son aïeul et celui de son père. (2) Je ne déciderai point (car comment certifier des faits d'une si haute antiquité ?) si c'est bien d'Ascagne qu'il s'agit, ou d'un autre enfant né de Creuse, avant la chute de Troie, et qui accompagna son père dans sa fuite; de celui enfin qui portait le nom d'lule, et auquel la famille Julia rattache son origine. (3) Cet Ascagne donc (quelle que soit sa mère et le lieu de sa naissance, il est certain qu'il était fils d'Énée), voyant la population de Lavinium s'augmenter à l'excès, laissa cette ville, déjà florissante et considérable pour ces temps-là, à sa mère ou à sa belle-mère, et alla lui-même fonder, au pied du mont Albain, une ville nouvelle, qui, étendue en long sur le flanc de la montagne, prit de cette situation le nom d'Albe-la-Longue. (4) Entre la fondation de Lavinium et l'établissement de cette colonie sortie de son sein, il s'était écoulé environ trente ans. Et dans cet intervalle cet état avait pris un tel accroissement, surtout par la défaite des Étrusques, qu'à la mort même d'Énée, et ensuite pendant la régence d'une femme et l'apprentissage que faisait son jeune fils de l'art de régner, ni Mézence et ses Étrusques, ni aucun autre peuple voisin n'osèrent remuer. (5) Le traité de paix avait établi pour limite entre les Étrusques et les Latins, le fleuve Albula, aujourd'hui le Tibre. (6) Ascagne a pour successeur Silvius son fils, né, je ne sais par quel hasard, au fond des forêts. (7) Il est père d'Énée Silvius, qui a pour fils Latinus Silvius. Celui-ci fonda quelques colonies; ce sont les Anciens Latins; (8) et depuis ce temps, Silvius resta le surnom commun de tous les rois d'Albe. Puis se succèdent de père en fils, Alba, Atys, Capys, Capétus, Tibérinus : celui-ci se noie en traversant le fleuve Albula, auquel il donne son nom, devenu si célèbre dans la postérité. (9) Tibérinus a pour fils Agrippa, qui lui suc 6 cède et transmet le trône à Romulus Silvius. Ce Romulus, frappé de la foudre, laisse le sceptre aux mains d'Aventinus. Ce dernier, enseveli sur la colline qui fait aujourd'hui partie de la ville de Rome, lui donna son nom. (10) Procas, son successeur, père de Numitor et d'Amulius. lègue à Numitor, l'aîné de ses fils, l'antique royaume de la race des Silvius. Mais la violence prévalut sur la volonté d'un père et sur le respect pour le droit d'aînesse. (11) Amulius chasse son frère, et monte sur son trône : et, soutenant un crime par un nouveau crime, il fait périr tous les enfants mâles de ce frère : sous prétexte d'honorer Rhéa Silvia, fille d'Amulius, il en fait une vestale; lui ôte, en la condamnant à une éternelle virginité, l'espoir de devenir mère. IV. (1) Mais les destins devaient sans doute au monde la naissance d'une ville si grande, et l'établissement de cet empire, le plus puissant après celui des dieux. (2) Devenue par la violence mère de deux enfants, soit conviction, soit dessein d'ennoblir sa faute par la complicité d'un dieu, la Vestale attribue à Mars cette douteuse paternité. (3) Mais ni les dieux ni les hommes ne peuvent soustraire la mère et les enfants à la cruauté du roi : la prêtresse, chargée de fers, est jetée en prison, et l'ordre est donné de précipiter les enfants dans le fleuve. (4) Par un merveilleux hasard, signe éclatant de la protection divine, le Tibre débordé avait franchi ses rives, et s'était répandu en étangs dont les eaux languissantes empêchaient d'arriver jusqu'à son lit ordinaire; cependant, malgré leur peu de profondeur et la tranquillité de leur cours, ceux qui exécutaient les ordres du roi les jugèrent encore assez profondes pour noyer des enfants. (5) Croyant donc remplir la commission royale, ils les abandonnèrent aux premiers flots, à l'endroit où s'élève aujourd'hui le figuier Ruminal, qui porta, dit-on, le nom de Romulaire. (6) Ces lieux n'étaient alors qu'une vaste solitude. S'il faut en croire ce qu'on rapporte, les eaux, faibles en cet endroit, laissèrent à sec le berceau flottant qui portait les deux enfants : une louve altérée, descendue des montagnes d'alentour, accourut au bruit de leurs vagissements, et, leur présentant la mamelle, oublia tellement sa férocité, que l'intendant des troupeaux du roi la trouva caressant de la langue ses nourrissons. Faustulus (c'était, dit-on, le nom de cet homme) les emporta chez lui (7) et les confia aux soins de sa femme Larentia. Selon d'autres, cette Larentia était une prostituée à qui les bergers avaient donné le nom de Louve; c'est là l'origine de cette tradition merveilleuse. (8) Telles furent la naissance et l'éducation de ces enfants. À peine arrivés à l'âge de l'adolescence, ils dédaignent l'oisiveté d'une vie sédentaire et la garde des troupeaux; la chasse les entraîne dans les forêts d'alentour. (9) Mais, puisant dans ces fatigues la force et le courage, ils ne se bornent plus à donner la chasse aux bêtes féroces; ils attaquent les brigands chargés de butin, et partagent leurs dépouilles entre les bergers. Une foule de jeunes pâtres, chaque jour plus nombreuse, s'associe à leurs périls et à leurs jeux. V. (1) Dès ce temps-là, la fête des Lupercales était célébrée sur le mont Palatin, appelé d'abord Pallantium, de Pallantée, ville d'Arcadie. (2) C'est là qu'Évandre, un des Arcadiens établis longtemps 7 auparavant dans ces contrées, avait institué, d'après la coutume de son pays, cette solennité, où des jeunes gens, emportés par l'ivresse d'une joie licencieuse, couraient tout nus en l'honneur de Pan, protecteur des troupeaux, et que les Romains ont appelé depuis du nom d'lnuus. (3) Au milieu de ces fêtes, dont la célébration avait été annoncée, surpris à l'improviste par les brigands furieux de l'enlèvement de leur butin, Romulus se défend avec vigueur, Rémus est pris; ils livrent leur prisonnier au roi Amulius, et le noircissent à ses yeux. (4) Ils l'accusent surtout de faire, avec son frère, des incursions sur les terres de Numitor, et d'y conduire au pillage, comme en pays ennemi, une troupe armée de jeunes vagabonds. Rémus est donc livré à la vengeance de Numitor. (5) Dès le commencement, Faustulus s'était flatté de l'espérance que ces nourrissons étaient de sang royal; car l'ordre donné par le roi, d'exposer des enfants nouveau-nés, était connu de lui, et l'époque où il les avait recueillis coïncidait avec cette circonstance; mais il n'avait pas voulu révéler ce secret avant le temps, à moins que l'occasion ou la nécessite ne le fissent parler : (6) la nécessité arriva la première. Cédant à la crainte, il dévoile à Romulus le secret de sa naissance. Le hasard avait voulu que, de son côté, Numitor, maître de la personne de Rémus, apprit que les deux frères étaient jumeaux, et qu'à leur âge, à leur noble fierté, le souvenir de ses petits-fils se réveillât dans son coeur; à force de questions il touchait à la vérité et n'était pas loin de reconnaître Rémus. (7) Ainsi de tous côtés un complot s'ourdit contre le roi. Romulus, trop faible pour agir à force ouverte, se garda bien de venir à la tête de ses pâtres; il leur ordonne de se rendre au palais à une heure convenue et par des chemins différents; là ils tombent sur le roi : à la tête des gens de Numitor, Rémus leur prête main-forte, et Amulius est massacré. VI. 6] (1) À la faveur du premier trouble, Numitor va s'écriant que l'ennemi a pénétré dans la ville, qu'il assiège le palais, et il en écarte la jeunesse albaine en l'envoyant occuper et défendre la citadelle; puis, quand il voit les jeunes vainqueurs accourir en triomphe après ce coup de main, il convoque une assemblée, rappelle les attentats de son frère contre sa personne, l'origine de ses petits-fils, leur naissance, comment ils ont été élevés, à quels indices on les a reconnus, et il annonce la mort du tyran, et s'en déclare l'auteur. (2) Les jeunes frères se présentent au milieu de l'assemblée à la tête de leur troupe, saluent roi leur aïeul, et la multitude entraînée lui en confirme, par d'unanimes acclamations, le titre et l'autorité. (3) Numitor ainsi replacé sur le trône d'Albe, Romulus et Rémus conçurent l'idée de fonder une ville aux lieux témoins de leurs premiers périls et des soins donnés à leur enfance. La multitude d'habitants dont regorgeaient Albe et le Latium, grossie encore du concours des bergers, faisait espérer naturellement que la nouvelle ville éclipserait Albe et Lavinium. (4) À ces projets d'établissement vient se mêler la soif du pouvoir, mal héréditaire chez eux, et une lutte monstrueuse termine un débat assez paisible dans le principe. Ils étaient jumeaux, et la prérogative de l'âge ne pouvait 8 décider entre eux : ils remettent donc aux divinités tutélaires de ces lieux le soin de désigner, par des augures, celui qui devait donner son nom et des lois à la nouvelle ville, et se retirent, Romulus sur le mont Palatin, Rémus sur l'Aventin, pour y tracer l'enceinte augurale. VII. (1) Le premier augure fut, dit-on, pour Rémus : c'étaient six vautours; il venait de l'annoncer, lorsque Romulus en vit le double, et chacun fut salué roi par les siens; les uns tiraient leur droit de la priorité, les autres du nombre des oiseaux (2) Une querelle s'ensuivit, que leur colère fit dégénérer en combat sanglant; frappé dans la mêlée, Rémus tomba mort. Suivant la tradition la plus répandue, Rémus, par dérision, avait franchi d'un saut les nouveaux remparts élevés par son frère, et Romulus, transporté de fureur, le tua en s'écriant : « Ainsi périsse quiconque franchira mes murailles. » (3) Romulus, resté seul maître, la ville nouvelle prit le nom de son fondateur. Le mont Palatin, sur lequel il avait été élevé, fut le premier endroit qu'il eut soin de fortifier. Dans tous les sacrifices qu'il offrit aux dieux, il suivit le rite albain; pour Hercule seulement, il suivit le rite grec tel qu'Évandre l'avait institué. (4) C'est dans cette contrée, dit-on, qu'Hercule, vainqueur de Géryon, amena des boeufs d'une beauté merveilleuse; après avoir traversé le Tibre à la nage, chassant son troupeau devant lui, il s'arrêta sur les rives du fleuve, dans de gras pâturages, pour refaire et reposer ses boeufs; et, lui-même, fatigué de la route, il se coucha sur l'herbe : (5) là, tandis qu'appesanti par le vin et la nourriture, il dormait d'un profond sommeil, un pâtre du canton, nommé Cacus, d'une force redoutable, séduit par la beauté de ces boeufs, résolut de détourner une si riche proie. Mais, comme il craignait qu'en les chassant droit devant lui, leurs traces ne conduisissent leur maître à sa caverne lorsqu'il les chercherait, il choisit seulement les plus beaux, et les saisissant par la queue, il les traîne à reculons dans sa demeure. (6) Hercule, s'éveillant aux premiers rayons de l'aurore, regarde son troupeau, et s'apercevant qu'il lui en manque une partie, il va droit à la caverne voisine, dans l'idée que les traces y conduiraient. Toutes se dirigeaient en sens contraire, aucune n'allait d'un autre côté : dans le trouble où l'incertitude jetait ses esprits, il s'empresse d'éloigner son troupeau de ces dangereux pâturages. (7) Au moment du départ, quelques génisses marquèrent par des mugissements, comme c'est l'ordinaire, leur regret d'abandonner leurs compagnes; celles que l'antre recelait répondirent, et leur voix attira de ce côté l'attention d'Hercule. Il court à la caverne : Cacus s'efforce de lui en disputer l'entrée, implorant, mais en vain, le secours des bergers; il tombe sous la redoutable massue. (8) Évandre, venu du Péloponnèse chercher un asile dans ces nouvelles contrées, les gouvernait bien plus par son ascendant que par l'effet d'une autorité réelle. Il devait cet ascendant à la connaissance de l'écriture, merveille toute nouvelle pour ces nations ignorantes des arts; et plus encore à la croyance répandue sur sa mère Carmenta, qu'on regardait comme une divinité, et dont les prédictions, antérieures à l'arrivée de la Sibylle en Italie, avaient frappé ces peuples d'admiration. (9) Attiré par le concours des 9 pasteurs assemblés en tumulte autour de cet étranger, que leurs cris désignaient comme un meurtrier, il apprend en même temps et le crime et la cause qui l'a fait commettre. Puis, frappé de l'air auguste du héros, et de la majesté de sa taille, si supérieure à celle des hommes, il lui demande qui il est. (10) À peine a-t-il appris son nom, celui de son père et de sa patrie : « Fils de Jupiter, Hercule, s'écrie-t-il, je te salue; ma mère, fidèle interprète des dieux, m'a prédit que tu devais augmenter le nombre des habitants de l'Olympe, et qu'en ces lieux s'élèverait en ton honneur un autel destiné à recevoir un jour de la plus puissante nation du monde le nom de Très-Grand, et dont tu réglerais toi-même culte. » (11) Hercule, lui tendant la main, répond qu'il accepte le présage, et que, pour accomplir les destinées, il va dresser un autel et le consacrer. (12) Il choisit alors la plus belle génisse de son troupeau, et le premier sacrifice est offert à Hercule. Les Potitii et les Pinarii, les deux familles les plus considérables du canton, choisis pour ministres du sacrifice, prennent place au banquet sacré. (13) Le hasard fit que les Potitii seuls assistèrent au commencement du festin, et qu'on leur servit la chair de la victime : elle était consommée à l'arrivée des Pinarii, qui prirent part au reste du banquet : c'est l'origine de l'usage, perpétué jusqu'à l'extinction de la famille Pinaria, qui lui interdisait les prémices des victimes. (14) Les Potitii, instruits par Évandre, restèrent pendant plusieurs siècles les ministres de ce culte, jusqu'au moment où, ayant abandonné à des esclaves ces fonctions héréditaires dans leur famille, ils périrent tous en expiation de leur sacrilège. (15) De tous les cultes institués alors par Romulus, ce fut le seul qu'il emprunta aux étrangers : il applaudissait dès lors à cette apothéose du courage, dont les destins lui préparaient l'honneur. VIII. (1) Les cérémonies religieuses régulièrement établies, il réunit en assemblée générale cette multitude dont la force des lois pouvait seule faire un corps de nation, et lui dicta les siennes : (2) et persuadé que le plus sûr moyen de leur imprimer un caractère sacré aux yeux de ces hommes grossiers, c'était de se grandir lui-même par les marques extérieures du commandement, entre autres signes distinctifs qui relevaient sa dignité, il affecta de s'entourer de douze licteurs. (3) On pense qu'il régla ce nombre sur celui des douze vautours qui lui avaient présagé l'empire; mais je partage volontiers le sentiment de ceux qui, retrouvant chez les Étrusques, nos voisins, l'idée première des appariteurs et de cette espèce d'officiers publics, comme celle des chaises curules et de la robe prétexte, pensent que c'est dans leurs coutumes qu'il faut rechercher aussi l'origine de ce nombre. Ils l'avaient adopté parce que les douze peuples qui concouraient à l'élection de leur souverain fournissaient chacun un licteur à son cortège. (4) Cependant la ville s'agrandissait, et son enceinte s'élargissait chaque jour, mesurée plutôt sur ses espérances de population future que sur les besoins de sa population actuelle. (5) Mais pour donner quelque réalité à cette grandeur, Romulus, fidèle à cette vieille politique des fondateurs de villes qui publiaient que la terre leur avait enfanté des habitants, ouvre un asile dans 10 ce lieu fermé aujourd'hui par une palissade qui se trouve à la descente du Capitole, entre les deux bois. (6) Esclaves ou hommes libres, tous ceux qu'excitent l'amour du changement viennent en foule s'y réfugier. Ce fut le premier appui de notre grandeur naissante. (7) Satisfait des forces qu'il avait conquises, Romulus les soumet à une direction régulière : il institue cent sénateurs, soit que ce nombre lui parût suffisant, soit qu'il n'en trouvât pas plus qui fussent dignes de cet honneur. Ce qui est certain, c'est qu'on les nomma Pères, et ce nom devint leur titre d'honneur; leurs descendants reçurent celui de Patriciens. IX. (1) Déjà Rome était assez puissante pour ne redouter aucune des cités voisines; mais elle manquait de femmes, et une génération devait emporter avec elle toute cette grandeur : sans espoir de postérité au sein de la ville, les Romains étaient aussi sans alliances avec leurs voisins. (2) C'est alors que, d'après l'avis du sénat, Romulus leur envoya des députés, avec mission de leur offrir l'alliance du nouveau peuple par le sang et par les traités. (3) « Les villes, disaient-ils, comme toutes les choses d'ici-bas, sont chétives à leur naissance; mais ensuite, si leur courage et les dieux leur viennent en aide, elles se font une grande puissance et un grand nom. (4) Vous ne l'ignorez pas, les dieux ont présidé à la naissance de Rome, et la valeur romaine ne fera pas défaut à cette céleste origine; vous ne devez donc pas dédaigner de mêler avec des hommes comme eux votre sang et votre race. » (5) Nulle part la députation ne fut bien accueillie, tant ces peuples méprisaient et redoutaient à la fois pour eux et leurs descendants cette puissance qui s'élevait menaçante au milieu d'eux. La plupart demandèrent aux députés en les congédiant : « Pourquoi ils n'avaient pas ouvert aussi un asile pour les femmes ? Qu'au fond c'était le seul moyen d'avoir des mariages sortables. » (6) La jeunesse romaine ressentit cette injure, et tout sembla dès lors faire présager la violence. Mais, dans la pensée de ménager une circonstance et un lieu favorables, Romulus dissimule son ressentiment et prépare, en l'honneur de Neptune Équestre, des jeux solennels, sous le nom de Consualia. (7) Il fait annoncer ce spectacle dans les cantons voisins, et toute la pompe que comportaient l'état des arts et la puissance romaine se déploie dans les préparatifs de la fête, afin de lui donner de l'éclat et d'éveiller la curiosité. (8) Les spectateurs y accourent en foule, attirés aussi par le désir de voir la nouvelle ville, surtout les peuples les plus voisins : les Céniniens, les Crustuminiens, les Antemnates. (9) La nation entière des Sabins vint aussi avec les femmes et les enfants. L'hospitalité leur ouvrit les demeures des Romains, et à la vue de la ville, de son heureuse situation, de ses remparts, du grand nombre de maisons qu'elle renfermait, déjà ils s'émerveillaient de son rapide accroissement. (10) Arrive le jour de la célébration des jeux. Comme ils captivaient les yeux et les esprits, le projet concerté s'exécute : au signal donné, la jeunesse romaine s'élance de toutes parts pour enlever les jeunes filles. (11) Le plus grand nombre devient la proie du premier ravisseur. Quelques-unes des plus belles, réservées aux principaux sénateurs, étaient portées dans leurs maisons par des plébéiens chargés de ce soin. (12) Une entre autres, bien 11 supérieure à ses compagnes par sa taille et sa beauté, était, dit-on, entraînée par la troupe d'un sénateur nommé Talassius; comme on ne cessait de leur demander à qui ils la conduisaient, pour la préserver de toute insulte, ils criaient en marchant : 'à Talassius'. C'est là l'origine de ce mot consacré dans la cérémonie des noces. (13) La terreur jette le trouble dans la fête, les parents des jeunes filles s'enfuient frappés de douleur; et, se récriant contre cette violation des droits de l'hospitalité, invoquent le dieu dont le nom, en les attirant à la solennité de ces jeux, a couvert un perfide et sacrilège guet-apens. (14) Les victimes du rapt partagent ce désespoir et cette indignation; mais Romulus lui-même, les visitant l'une après l'autre, leur représente « que cette violence ne doit être imputée qu'à l'orgueil de leurs pères, et à leur refus de s'allier, par des mariages, à un peuple voisin; que cependant c'est à titre d'épouses qu'elles vont partager avec les Romains leur fortune, leur patrie, et s'unir à eux par le plus doux noeud qui puisse attacher les mortels, en devenant mères. (15) Elles doivent donc adoucir leur ressentiments, et donner leurs coeurs à ceux que le sort a rendus maîtres de leurs personnes. Souvent le sentiment de l'injure fait place à de tendres affections. Les gages de leur bonheur domestique sont d'autant plus assurés, que leurs époux, non contents de satisfaire aux devoirs qu'impose ce titre, s'efforceront encore de remplacer auprès d'elles la famille et la patrie qu'elles regrettent. » (16) À ces paroles se joignaient les caresses des ravisseurs, qui rejetaient la violence de leur action sur celle de leur amour, excuse toute puissante sur l'esprit des femmes. X. (1) Elles avaient déjà oublié leur ressentiment lorsque leurs parents, plus irrités que jamais, et les habits souillés en signe de deuil, soulevaient les cités par leurs plaintes et leurs larmes. Leur désespoir ne se renfermait pas dans les murs de leurs villes; ils se rassemblaient de toutes parts auprès de Titus Tatius, roi des Sabins. Le nom de ce prince, objet de la plus haute considération dans ces contrées, attirait autour de lui leurs envoyés. (2) Les Céniniens, les Crustuminiens et les Antemnates étaient au nombre des peuples qu'avait frappés cet outrage. Tatius et ses Sabins leur parurent trop lents à prendre un parti. Ces trois peuples se liguent pour une guerre commune. (3) Mais les Crustuminiens et les Antemnates étaient encore trop lents à se lever au gré des Céniniens et de leur impatiente vengeance; seuls avec leurs propres forces, ceux-ci envahissent le territoire romain. (4) Mais, tandis qu'ils pillaient en désordre, Romulus vient à leur rencontre avec son armée. La facile victoire qu'il remporte leur apprend que la colère sans la force est toujours impuissante. Il enfonce leurs rangs, les disperse, les poursuit dans leur déroute, tue de sa main leur roi, et se pare de sa dépouille. La mort du chef ennemi lui livre la ville. (5) Au retour de son armée victorieuse, Romulus, qui, au génie des grandes choses alliait l'habileté qui les fait valoir, suspend à un trophée disposé à cet effet les dépouilles du roi mort et monte au Capitole. Là il les dépose au pied d'un chêne consacré par la vénération des pasteurs, en fait hommage à Jupiter, et trace l'enceinte d'un temple qu'il dédie à ce dieu sous un nouveau surnom : (6) « Jupiter Férétrien, s'écrie-t-il, c'est à toi qu'un roi vainqueur offre ces armes 12 d'un roi, et qu'il consacre le temple dont sa pensée vient de mesurer l'enceinte. Là seront déposées les dépouilles opimes que mes descendants, vainqueurs à mon exemple, arracheront avec la vie aux rois et aux chefs ennemis. » (7) Telle est l'origine de ce temple, le premier dont Rome ait vu la consécration. Dans la suite, les dieux ont voulu ratifier la prédiction des fondateurs du temple, en appelant ses descendants à l'imiter, sans permettre toutefois qu'elle s'étendît trop, de peur de s'avilir. Dans un si grand nombre d'années remplies par tant de guerres, on ne remporta que deux fois les dépouilles opimes, tant la fortune fut avare de cet honneur. XI. (1) Tandis que les Romains sont à ces solennités religieuses, les Antemnates saisissent l'occasion, et envahissent leurs frontières abandonnées. Une légion romaine s'y porte aussitôt, et surprend l'ennemi dispersé dans la campagne. (2) À la première attaque, au premier cri de guerre, les Antemnates sont mis en fuite, leur ville prise. Alors Hersilie, femme de Romulus, obsédée par les supplications de ses compagnes enlevées, profite de l'enivrement d'une double victoire pour supplier le vainqueur de faire grâce à leurs parents et de les recevoir dans la ville naissante : c'est le moyen, suivant elle, d'en accroître la puissance par la concorde. Elle l'obtient sans peine. (3) Il marche ensuite contre les Crustuminiens qui venaient l'attaquer; mais ceux-ci, déjà découragés par les revers de leurs alliés, font encore moins de résistance. (4) On envoya des colonies chez les uns et chez les autres. Il se présenta plus de monde pour Crustuminum, à cause de la fertilité du pays; tandis que de fréquentes émigrations, de la part surtout des familles appartenant aux femmes enlevées, venaient de ces lieux mêmes grossir la population romaine. (5) La dernière guerre fut celle des Sabins; ce fut aussi la plus sérieuse : car ce peuple agit sans précipitation ni colère; ses menaces ne précédèrent point l'agression; (6) mais sa prudence ne rejeta point les conseils de la ruse. Spurius Tarpéius commandait dans la citadelle de Rome. Sa fille, gagnée par l'or de Tatius, promet de livrer la citadelle aux Sabins. Elle en était sortie par hasard, allant puiser de l'eau pour les sacrifices. (7) À peine introduits, les Sabins l'écrasent sous leurs armes, et la tuent, soit pour faire croire que la force seule les avait rendus maîtres de ce poste, soit pour prouver que nul n'est tenu à la fidélité envers un traître. (8) On ajoute que les Sabins, qui portaient au bras gauche des bracelets d'or d'un poids considérable et des anneaux enrichis de pierres précieuses, étaient convenus de donner, pour prix de la trahison, les objets qu'ils avaient à la main gauche. De là, ces boucliers qui, au lieu d'anneaux d'or, payèrent la jeune fille, et qui l'ensevelirent sous leur masse. (9) Selon d'autres, en demandant aux Sabins les ornements de leurs mains gauches, Tarpéia entendait effectivement parler de leurs armes; mais les Sabins, soupçonnant un piège, l'écrasèrent sous le prix même de sa trahison. XII. (1) Quoi qu'il en soit, ils étaient maîtres de la citadelle. Le lendemain, l'armée romaine, rangée en bataille, couvrait de ses lignes l'espace compris entre le mont Palatin et le mont Capitolin. Les Sabins n'étaient point encore descendus à 13 sa rencontre, que, déjà transportée par la colère et le désir de reprendre la place, elle s'élance sur la hauteur. (2) De part et d'autre les chefs animent les combattants; c'était Mettius Curtius du côté des Sabins; du côté des Romains, Hostus Hostilius. Celui-ci, placé au premier rang et malgré le désavantage de la position, soutenait les siens de son audace et de son courage; (3) mais à peine fut-il tombé que l'armée romaine plie tout à coup, et est refoulée jusqu'à la vieille porte du Palatin. Entraîné lui-même par la multitude des fuyards, Romulus élève ses armes vers le ciel : (4) « Jupiter, s'écrie-t-il, c'est pour obéir à tes ordres, c'est sous tes auspices sacrés qu'ici, sur le mont Palatin, j'ai jeté les fondements de cette ville. Déjà la citadelle, achetée par un crime, est au pouvoir des ennemis; eux-mêmes ont franchi le milieu du vallon, et ils avancent jusqu'ici. (5) Mais toi, père des dieux et des hommes, repousse-les du moins de ces lieux; rends le courage aux Romains, et suspends leur fuite honteuse. (6) Ici même je te voue, sous le nom de Jupiter Stator, un temple, éternel monument du salut de Rome préservée par la protection puissante. » (7) Il dit; et, comme il eût senti sa prière exaucée : « Romains, poursuit-il, Jupiter très bon et très grand ordonne que vous vous arrêtiez et que vous retourniez au combat. » Ils s'arrêtent en effet, comme s'ils obéissaient à la voix du ciel. Romulus vole aux premiers rangs. (8) Mettius Curtius, à la tête des Sabins, était descendu de la citadelle, et avait poursuivi les Romains en déroute dans toute la longueur du Forum. Il approchait déjà de la porte du Palatin, et criait : « Ils sont vaincus, ces hôtes perfides, ces lâches ennemis; ils savent enfin qu'autre chose est d'enlever des jeunes filles, autre chose de combattre des hommes. » (9) À cette orgueilleuse apostrophe, Romulus fond sur Mettius avec une troupe de jeunes gens des plus braves. Mettius alors combattait à cheval; il devenait plus facile de le repousser. On le poursuit, et le reste de l'armée romaine, enflammé par l'audace de son roi, enfonce les Sabins à leur tour. (10) Mettius, dont le cheval est épouvanté par le tumulte de la poursuite, est jeté dans un marais. Le danger qui environne un personnage aussi important attire l'attention des Sabins. Les uns le rassurent et l'appellent, les autres l'encouragent, et Mettius parvient enfin à s'échapper. Le combat recommence au milieu du vallon; mais là encore l'avantage demeure aux Romains. XIII. (1) Alors, les mêmes Sabines, dont l'enlèvement avait allumé la guerre, surmontent, dans leur dés, espoir, la timidité naturelle à leur sexe, se jettent intrépidement, les cheveux épars et les vêtements en désordre, entre les deux armées et au travers d'une grêle de traits : elles arrêtent les hostilités, enchaînent la fureur, (2) et s'adressant tantôt à leurs pères, tantôt à leurs époux, elles les conjurent de ne point se souiller du sang sacré pour eux, d'un beau-père ou d'un gendre, de ne point imprimer les stigmates du parricide au front des enfants qu'elles ont déjà conçus, de leurs fils à eux et de leurs petits-fils. (3) « Si cette parenté, dont nous sommes les liens, si nos mariages vous sont odieux, tournez contre nous votre colère : nous la source de cette guerre, nous la cause des blessures et du massacre de nos époux et de nos pères, 14 nous aimons mieux périr que de vivre sans vous, veuves ou orphelines. » (4) Tous ces hommes, chefs et soldats, sont émus; ils s'apaisent tout à coup et gardent le silence. Les chefs s'avancent pour conclure un traité, et la paix n'est pas seulement résolue, mais aussi la fusion des deux états en un seul. Les deux rois se partagent l'empire, dont le siège est établi à Rome. (5) Ainsi, la puissance de Rome est doublée. Mais, pour qu'il soit accordé quelque faveur aux Sabins, les Romains prennent, de la ville de Cures, le surnom de Quirites. En témoignage de ce combat, le marais dans lequel Curtius faillit d'être englouti avec son cheval fut appelé le lac Curtius. (6) Une paix si heureuse, succédant tout à coup à une guerre si déplorable, rendit les Sabines plus chères à leurs maris, à leurs pères, et surtout à Romulus. Aussi, lorsqu'il partagea le peuple en trente curies, il les désigna par le nom de ces femmes. Leur nombre surpassait sans doute le nombre des curies; mais la tradition ne nous a point appris si leur âge, leur rang, celui de leurs maris, ou le sort enfin décidèrent de l'application de ces noms. (8) À la même époque, on créa trois centuries de cavaliers, appelées, la première, Ramnenses, de Romulus; la seconde, Titienses, de Titus Tatius. On ignore l'étymologie de Lucères, nom de la troisième. Depuis ce temps, non seulement la souveraineté fut commune aux deux rois, mais elle fut aussi exercée par l'un et l'autre dans une parfaite harmonie. XIV. (1) Quelques années après, des parents du roi Tatius ayant maltraité les députés des Laurentins, ce peuple réclama, au nom du droit des gens. Mais le crédit et les sollicitations des agresseurs eurent plus de succès auprès de Tatius; (2) aussi leur châtiment retomba-t-il sur sa tête. Il était venu à Lavinium pour la célébration d'un sacrifice solennel; il y fut tué au milieu d'un soulèvement. (3) Romulus ne montra pas, dit-on, dans cette circonstance, toute la douleur convenable, soit qu'il n'eût partagé le trône qu'avec regret, soit que le meurtre de Tatius lui parût juste. Il ne prit pas même les armes; seulement, comme l'outrage reçu par les députés voulait être expié, Rome et Lavinium renouvelèrent leur traité. (4) Mais cette paix inspira peu de confiance. Un autre orage plus menaçant éclatait presque aux portes de Rome. Le voisinage de cette ville, dont la puissance grandissait chaque jour, inquiétait les Fidénates : sans attendre qu'elle réalise tout ce que semble lui promettre l'avenir, ils commencent à lui faire la guerre. Ils arment leur jeunesse, la mettent en campagne, et dévastent le territoire qui est entre Rome et Fidènes. (5) De là, ils tournent vers la gauche, parce que, sur la droite, le Tibre leur opposait un obstacle, et sèment devant eux la terreur et la désolation. Les habitants des campagnes fuient en tumulte, et leur retraite précipitée dans Rome y porte la première nouvelle de l'invasion. (6) L'imminence du péril n'admettait pas de retard. Romulus alarmé fait sortir son armée, et vient camper à un mille de Fidènes. (7) Là, il laisse une garde peu nombreuse et se remet en marche avec toutes ses forces. Il en met une partie en embuscade dans des lieux couverts de broussailles, et marche ensuite avec la plus grande partie de son infanterie et toute sa cavalerie. Ce mouvement, 15 opéré avec une apparence de bravade et de désordre, et les incursions de la cavalerie jusque sous les portes de la ville, attirent les ennemis : c'était là ce que voulait Romulus. Des charges de cavalerie rendirent aussi plus naturelle la fuite que ses soldats devaient simuler. (8) En effet, tandis que les cavaliers exécutent leurs manoeuvres, et qu'ils semblent hésiter entre le désir de fuir et l'honneur de combattre, l'infanterie lâche pied : aussitôt les Fidénates ouvrent les portes de la ville; ils affluent dans la plaine, se jettent en masse sur l'armée romaine, la chassent devant eux, et entraînés par l'ardeur d'une poursuite acharnée, s'engagent dans l'embuscade. (9) Mais les soldats romains qui l'occupent se montrent tout à coup, fondent sur eux, et les prennent en flanc; ceux-ci s'épouvantent, et la réserve du camp, qui s'ébranle à son tour, accroît encore leur frayeur. L'effroi, qui les frappe de toutes parts, laisse à peine à Romulus et à sa cavalerie le temps de faire volte face; ils prennent la fuite; (10) et, comme cette fuite est réelle, ils regagnent la ville avec plus de désordre et de précipitation qu'ils n'en avaient mis à poursuivre ceux qui ne fuyaient que par artifice; (11) mais ils n'échappent pas davantage à l'ennemi. Les Romains les poussent l'épée dans les reins, et, avant qu'on ait eu le temps de refermer les portes, vainqueurs et vaincus entrent ensemble, comme si ce n'était qu'une seule armée. XV. (1) Des Fidénates, le feu de la guerre se communique aux Véiens, lesquels, descendant comme eux des Étrusques, étaient liés à leur cause par la communauté d'origine, et par l'irritation de leur défaite; outre qu'ils songeaient avec crainte à la proximité d'une ville dont les armes devaient menacer tous les voisins. Ils se répandent donc sur ses frontières, plutôt pour s'y livrer au pillage, que pour y faire une guerre en règle. (2) C'est pourquoi ils ne se fixent nulle part, ils n'attendent pas l'armée romaine. Chargés de butin, ils reviennent à Véies. Les Romains, trouvant la campagne libre, se disposent néanmoins à provoquer un engagement décisif; ils passent le Tibre, et plantent leur camp. (3) À la nouvelle de leurs préparatifs et de leur marche sur la ville, les Véiens sortent et s'avancent à la rencontre de l'ennemi. Il leur semblait plus convenable de vider la querelle dans une bataille, que de se retrancher derrière des murs, et d'y combattre pour leurs foyers. (4) Dans cette circonstance, Romulus, dédaignant la ruse, vainquit avec l'aide seule de ses troupes déjà vieillies au métier de la guerre. Il poursuivit les Véiens battus jusque sous leurs remparts, et n'essaya pas d'assiéger leur ville, doublement forte par ses murailles et par sa position. Il revint sur ses pas, et ravagea le pays, plutôt pour user de représailles que par amour du butin. (5) Ces dévastations, jointes à la perte de la bataille, achevèrent la ruine des Véiens. Ils envoient des députés à Rome, et proposent la paix; une trêve de cent ans leur est accordée, mais au prix d'une partie de leur territoire. (6) Tels sont, à peu près, les événements militaires et politiques du règne de Romulus. Ils s'accordent assez avec l'opinion de la divinité de l'origine de ce roi, et ce qu'on a écrit touchant les circonstances miraculeuses qui suivirent sa mort. Rien ne dément cette opinion, surtout si l'on considère le courage que déploya Romulus dans le rétablissement de son aïeul sur le trône, son projet gigantesque de bâtir une ville, 16 et son habileté à la rendre forte, par le parti qu'il savait tirer, soit de la paix, soit de la guerre. (7) Cette force, qu'elle recevait de son fondateur, Rome en usa si bien, que, depuis ces premiers progrès, sa tranquillité, pendant quarante ans, ne fut jamais troublée. (8) Romulus fut cependant plus cher au peuple qu'au sénat; mais il était surtout aimé des soldats. Il en avait choisi trois cents, qu'il appelait Célères, pour garder sa personne, et il les conserva toujours, non seulement durant la guerre, mais encore pendant la paix. XVI. (1) Après ces immortels travaux, et un jour qu'il assistait à une assemblée, dans un lieu voisin du marais de la Chèvre, pour procéder au recensement de l'armée, survint tout à coup un orage, accompagné d'éclats de tonnerre, et le roi, enveloppé d'une vapeur épaisse, fut soustrait à tous les regards. Depuis, il ne reparut plus sur la terre. (2) Quand l'effroi fut calmé, quand à l'obscurité profonde eut succédé un jour tranquille et pur, le peuple romain, voyant la place de Romulus inoccupée, semblait peu éloigné de croire au témoignage des sénateurs, lesquels, demeurés près du roi, affirmaient que, pendant l'orage, il avait été enlevé au ciel. Cependant, comme si l'idée d'être à jamais privé de son roi l'eût frappé de terreur, il resta quelque temps dans un morne silence. (3) Enfin, entraînés par l'exemple de quelques-uns, tous, par acclamations unanimes, saluent Romulus, dieu, fils de dieu, roi et père de la ville romaine. Ils lui demandent; ils le conjurent de jeter toujours un regard propice sur sa postérité. (4) Je suppose qu'il ne manqua pas alors de gens qui accusèrent tout bas les sénateurs d'avoir déchiré Romulus de leurs propres mains; le bruit même s'en répandit, mais n'acquit jamais beaucoup de consistance. Cependant l'admiration qu'il inspirait, et la terreur du moment, ont consacré le merveilleux de la première tradition. (5) On ajoute que la révélation d'un citoyen vint fortifier encore cette croyance. Tandis que Rome inquiète déplorait la mort de son roi, et laissait percer sa haine contre les sénateurs, Proculus Julius, autorité grave, dit-on, même à propos d'un fait aussi extraordinaire, s'avança au milieu de l'assemblée, et dit : (6) « Romains, le père de cette ville, Romulus, descendu tout à coup des cieux, m'est apparu ce matin au lever du jour. Frappé de terreur et de respect, je restais immobile, tâchant d'obtenir de lui, par mes prières, qu'il me permît de contempler son visage : (7) « Va, dit-il, annoncer à tes concitoyens que cette ville que j'ai fondée, ma Rome, sera la reine du monde; telle est la volonté du ciel. Que les Romains se livrent donc tout entiers à la science de la guerre; qu'ils sachent, et après eux leurs descendants, que nulle puissance humaine ne pourra résister aux armes de Rome. » À ces mots, continua Proculus, il s'éleva dans les airs. (8) Il est étonnant qu'on ait si facilement ajouté foi à un pareil discours, et aussi combien la certitude de l'immortalité de Romulus adoucit les regrets du peuple et de l'armée. XVII. (1) Cependant l'ambition du trône et les rivalités agitaient le sénat. Nul, parmi ce peuple nouveau, n'ayant encore de supériorité constatée, les prétentions ne s'élevaient pas encore entre les citoyens; la question se débattait entre les deux races de peuple. (2) Les Sabins d'origine, qui depuis 17 la mort de Tatius n'avaient pas eu de roi de leur nation, et qui, dans cette société fondée sur l'égalité des droits, craignaient de perdre ceux qu'ils avaient à l'empire, exigeaient que le roi fût élu dans le corps des Sabins. Les vieux Romains, de leur côté, repoussaient un roi étranger. (3) Cependant ce conflit de volonté n'empêchait pas les citoyens de vouloir unanimement le gouvernement monarchique. On ignorait encore les douceurs de la liberté. (4) Mais cette ville sans gouvernement, cette armée sans chef, environnées d'une foule de petits états toujours en fermentation, faisaient craindre aux sénateurs l'attaque imprévue de quelque peuple étranger. On sentait le besoin d'un chef, mais personne ne pouvait se résoudre à céder. (5) Enfin, il fut convenu que les sénateurs, au nombre de cent, seraient partagés en dix décuries, dont chacune devrait conférer à l'un de ses membres l'exercice de l'autorité. La puissance était collective : un seul en portait les insignes, et marchait précédé des licteurs. (6) La durée en était de cinq jours pour chaque individu et à tour de rôle. La royauté resta ainsi suspendue pendant un an, et l'on donna à cette vacance le nom d'interrègne, encore en usage aujourd'hui. (7) Le peuple, alors, se plaignit vivement de ce qu'on eût aggravé sa servitude, et qu'au lieu d'un maître il en eut cent. Il paraissait décidé à ne plus souffrir désormais qu'un roi, et à le choisir lui-même. (8) Les sénateurs conclurent de ces dispositions du peuple qu'ils devaient résigner volontairement les pouvoirs qu'on allait leur arracher. (9) Mais, en abandonnant au peuple la toute-puissance, ils en retinrent effectivement plus qu'ils n'en accordaient; car ils subordonnèrent l'élection du roi par le peuple à la ratification du sénat. Cette prérogative usurpée s'est perpétuée jusqu'ici dans le sénat, pour la sanction des lois et les nominations aux emplois de la magistrature; mais ce n'est plus qu'une formalité vaine. Avant que le peuple aille aux voix, le sénat ratifie la décision des comices, quelle qu'elle soit. (10) Mais, à cette époque, l'interroi convoqua l'assemblée, et dit : « Romains, au nom de la gloire, du bien-être et de la prospérité de Rome, nommez vous-mêmes votre roi : tel est le voeu du sénat. Nous ensuite, si vous donnez à Romulus un successeur digne de lui, nous ratifierons votre choix. » (11) Le peuple fut si flatté de cette condescendance, que, pour ne pas être vaincu en générosité, il se contenta d'ordonner que l'élection serait déférée au sénat. XVIII. (1) Dans ce temps-là vivait Numa Pompilius, célèbre par sa justice et par sa piété. Il demeurait à Cures, chez les Sabins. C'était un homme très versé, pour son siècle, dans la connaissance de la morale divine et humaine. (2) C'est à tort qu'à défaut d'autre on lui a donné pour maître Pythagore de Samos. Il est avéré que ce fut sous le règne de Servius Tullius, plus de cent ans après Numa, que Pythagore vint à l'extrémité de l'Italie, dans le voisinage de Métaponte, d'Héraclée et de Crotone, tenir une école de jeunes gens voués au culte de ses théories. (3) Et même en admettant qu'il eût été contemporain de Numa, de quels lieux eût-il attiré des hommes épris de l'amour de s'instruire ? par quelle voie le bruit de son nom était-il arrivé jusque chez les Sabins ? quelle langue l'aidait à communiquer? et com- 18 ment enfin un homme seul aurait-il pu pénétrer à travers tant de nations, aussi différentes de moeurs que de langage ? (4) Je pense plutôt que Numa puisait en lui même les principes de vertu qui réglaient son âme, et que le complément de son éducation fut moins l'effet de ses études dans les écoles philosophiques étrangères, que de la discipline mâle et rigoureuse des Sabins, la nation la plus austère de l'antiquité. (5) À ce nom de Numa, et bien que l'élection d'un roi parmi les Sabins dût sembler constituer la prépondérance de ce peuple, personne, parmi les sénateurs romains, n'osa préférer à un tel homme, ni soi, ni tout autre de son parti, sénateur ou citoyen, et tous, sans exception, décernèrent la couronne à Numa Pompilius. (6) Mandé à Rome, il voulut, à l'exemple de Romulus, qui n'avait jeté les fondements de la ville et pris possession de la royauté qu'après avoir consulté les augures, interroger les dieux sur son élection. Un augure, qui dut à cet honneur de conserver à perpétuité ce sacerdoce public, conduisit Numa sur le mont Capitolin. Là, il fit asseoir sur une pierre le nouveau roi, la face tournée au midi, (7) et lui-même, ayant la tête voilée, et dans la main un bâton recourbé, sans noeuds, appelé 'lituus', prit place à sa gauche. Alors, promenant ses regards sur la ville et la campagne, il adressa aux dieux ses prières; il traça en idée des limites imaginaires à l'espace compris centre l'Orient et l'Occident, plaçant la droite au midi et la gauche au nord; (8) puis, aussi loin que sa vue pouvait s'étendre, il désigna, en face de lui, un point imaginaire. Enfin, prenant le 'lituus' dans la main gauche, et étendant la droite sur la tête de Numa, il prononça cette prière : (9) « Grand Jupiter, si la volonté divine est que Numa, dont je touche la tête, règne sur les Romains, apprends-nous cette volonté par des signes non équivoques, dans l'espace que je viens de fixer. » (10) Il définit ensuite la nature des auspices qu'il demandait, et lorsqu'ils se furent manifestés, Numa, déclaré roi, quitta le temple. XIX. (1) Désormais maître du trône, Numa voulut que la ville naissante, fondée par la violence et par les armes, le fût de nouveau par la justice, par les lois et la sainteté des moeurs : (2) et comme il lui semblait impossible, au milieu de guerres perpétuelles, de faire accepter ce nouvel ordre de choses à des esprits dont le métier des armes avait nourri la férocité, il crut devoir commencer par adoucir cet instinct farouche, en le privant par degrés de son aliment habituel. Dans ce but, il éleva le temple de Janus. Ce temple, construit au bas de l'Argilète, devint le symbole de la paix et de la guerre. Ouvert, il était le signal qui appelait les citoyens aux armes; fermé, il annonçait que la paix régnait entre toutes les nations voisines. (3) Deux fois il a été fermé depuis le règne de Numa, la première, sous le consulat de Titus Manlius, à la fin de la première guerre punique; la seconde, sous César Auguste, lorsque, par un effet de la bonté des dieux, nous vîmes, après la bataille d'Actium, la paix acquise au monde, et sur terre et sur mer. (4) Quand donc Numa l'eut fermé, quand par des traités et par des alliances il eut consommé l'union entre Rome et les peuples circonvoisins, quand il eut dissipé les inquiétudes sur le retour probable de tout danger extérieur, il redouta l'influence 19 pernicieuse de l'oisiveté sur des hommes que la crainte de l'ennemi et les habitudes de la guerre avaient contenus jusqu'alors. Il pensa d'abord qu'il parviendrait plus aisément à adoucir les moeurs grossières de cette multitude et à dissiper son ignorance, en versant dans les âmes le sentiment profond de la crainte des dieux. (5) Mais ce but ne pouvait être atteint sans une intervention miraculeuse. Numa feignit donc d'avoir des entretiens nocturnes avec la déesse Égérie. Il disait que, pour obéir à ses ordres, il instituait les cérémonies religieuses les plus agréables aux dieux, et un sacerdoce particulier pour chacun d'eux. (6) Avant tout, il divisa l'année suivant les cours de la lune, en douze mois; mais comme chaque révolution lunaire n'est pas régulièrement de trente jours, et que par conséquent l'année solaire eût été incomplète, il suppléa cette lacune par l'interposition des mois intercalaires, et il les disposa de telle façon que tous les vingt-quatre ans, le soleil se retrouvant au même point d'où il était parti, chaque lacune annuelle était réparée. (7) Il établit aussi les jours fastes et les jours néfastes, car il pressentait déjà l'utilité de suspendre parfois la vie politique. XX. (1) Il songea ensuite à créer des prêtres, quoiqu'il remplît lui-même la plupart des fonctions qu'exerce aujourd'hui le flamine de Jupiter. (2) Mais il prévoyait que cette cité belliqueuse compterait plus de princes semblables à Romulus qu'à Numa, de princes faisant la guerre et y marchant en personne; et, de peur que les fonctions de roi ne gênassent les fonctions de prêtre, il créa un flamine, avec mission de ne jamais quitter les autels de Jupiter, le revêtit d'insignes augustes, et lui donna la chaise curule pareille à celle des rois. Il lui adjoignit deux autres flamines, l'un consacré à Mars, l'autre à Quirinus. (3) Il fonda ensuite le collège des Vestales, sacerdoce emprunté aux Albains, et qui n'était point étranger à la famille du fondateur de Rome. Il leur assigna un revenu sur l'état, afin de les enchaîner exclusivement et à toujours aux nécessités de leur ministère : le voeu de virginité et d'autres distinctions achevèrent de leur imprimer un caractère vénérable et sacré. (4) Il institua aussi en l'honneur de Mars Gradivus douze prêtres, sous le nom de saliens; il leur donna pour insignes la tunique brodée, recouverte, sur la poitrine, d'une cuirasse d'airain; leurs fonctions étaient de porter les boucliers sacrés qu'on nomme anciles, et de courir par la ville en chantant des vers et en exécutant des danses et des mouvements de corps particulièrement affectés à cette solennité. (5) Il nomma grand pontife Numa Marcius, fils de Marcus, sénateur; il lui confia la surveillance de tout ce qui tenait à la religion. Par des règlements consignés dans des registres spéciaux, il lui conféra la prérogative de diriger les cérémonies religieuses, de déterminer la nature des victimes, à quels jours et dans quels temples elles seraient immolées, quels fonds subviendraient à toutes ces dépenses, (6) et enfin, la juridiction sur tous les sacrifices célébrés soit publiquement, soit dans l'intérieur des familles. Ainsi, le peuple savait où venir puiser des lumières, et la religion ne courait pas le risque d'être offensée par l'oubli des rites nationaux et l'introduction des rites étrangers. (7) Le grand pontife ne réglait pas seulement les sacrifices aux dieux du ciel, mais encore les sacrifices aux dieux mânes, 20 et les cérémonies funéraires, et il apprenait aussi à distinguer, parmi les prodiges annoncés par la foudre et d'autres phénomènes, ceux qui demandaient une expiation. Pour obtenir des dieux la connaissance de ces secrets, Numa dédia, sur le mont Aventin, un autel à Jupiter Elicius, et consulta le dieu par la voie des augures, sur les prodiges qui étaient dignes d'attention. XXI. (1) Ces expiations, ces rapprochements intimes entre le peuple et les ministres de la religion, cette tendance nouvelle des esprits vers les exercices pieux, firent perdre à cette multitude ses habitudes de violence et tomber ses armes; et la constante sollicitude des dieux, qui paraissaient intervenir dans la direction des destinées humaines, pénétra les coeurs d'une piété si vive, que la foi et la religion du serment, à défaut de la crainte des lois et des châtiments, eussent suffi pour contenir les citoyens de Rome. (2) Tous, d'ailleurs, réglaient leurs moeurs sur celles de Numa, leur unique exemple; aussi les peuples voisins, qui jusqu'alors avaient vu dans Rome, non pas une ville, mais un camp planté au milieu d'eux pour troubler la tranquillité générale, se sentirent peu à peu saisis pour elle d'une telle vénération, qu'ils eussent considéré comme un sacrilège la moindre hostilité contre une ville occupée tout entière au service des dieux. (3) Plus d'une fois, sans témoins, et comme s'il se fût rendu à une conférence avec la déesse, Numa se retirait dans un bois, traversé par une fontaine dont les eaux intarissables s'échappaient du fond d'une grotte obscure. Ce bois fut par lui consacré aux muses, parce qu'elles y tenaient conseil avec son épouse Égérie. (4) La Bonne Foi eut aussi un temple consacré à elle seule. Numa voulut que les prêtres de ce temple y allassent montés dans un char couvert, à deux chevaux, et qu'ils eussent, pendant les cérémonies, la main enveloppée jusqu'aux doigts; voulant dire que la bonne foi devait être protégée, et que la main en est le symbole et le siège. (5) Il institua beaucoup d'autres sacrifices, et les lieux destinés à leur célébration reçurent des prêtres le nom d'Argées. Mais la plus belle, la plus grande de ses oeuvres, fut d'avoir maintenu, pendant toute la durée de son règne, la paix et la solidité de ses institutions. (6) Ainsi deux rois agrandirent successivement la cité romaine, l'un par la guerre, l'autre par la paix. Romulus avait régné trente-sept ans, Numa quarante-trois. Rome alors était puissante, et les arts dont elle était redevable à la fois à la paix et à la guerre, avaient perfectionné sa civilisation. XXII. (1) La mort de Numa ramena un interrègne. Mais le peuple élut roi Tullus Hostilius, petit-fils de cet Hostilius qui s'était illustré contre les Sabins, dans le combat au pied de la citadelle. Le sénat ratifia l'élection. (2) Ce prince, loin de ressembler à son prédécesseur, était d'une nature plus belliqueuse encore que Romulus. Sa jeunesse, sa vigueur et la gloire de son aïeul, animaient son courage. Persuadé qu'un état s'énerve dans l'inaction, il cherchait de toutes parts des prétextes de guerre. (3) Le hasard voulut que des laboureurs des pays de Rome et d'Albe se livrassent les uns envers les autres à des déprédations réciproques. (4) Albe alors était gouvernée par Caius Cluilius. Chaque parti envoya, presque dans le même temps, des ambassadeurs pour demander réparation. Tullus avait ordonné aux siens d'exposer, avant tout, leur re- 21 quête; il s'attendait à un refus de la part des Albains, ce qui lui fournissait un légitime sujet de guerre. (5) Les Albains mirent plus de lenteur dans la négociation. Accueillis par Tullus, admis à sa table, ils rivalisèrent avec le prince de prévenance et de courtoisie. Dans cet intervalle, les députés romains avaient présenté leurs réclamations, et sur le refus des Albains, ils leur avaient déclaré la guerre pour le trentième jour. Tullus en est informé. (6) Il mande alors à une conférence les députés d'Albe, et les requiert d'expliquer le motif de leur voyage. Ceux-ci, ne sachant pas encore ce qui s'est passé, et afin de gagner du temps, allèguent de vaines excuses : « C'est bien malgré eux qu'ils s'exposent à déplaire à Tullus; mais ils subissent la loi de leurs instructions. Ils viennent réclamer la restitution de ce qu'on leur a enlevé, et, s'ils ne l'obtiennent, ils ont ordre de déclarer la guerre. » (7) À cela, Tullus répond : « Annoncez donc à votre roi que le roi des Romains atteste les dieux que celui des deux peuples qui le premier a dédaigné de faire droit à la requête des députés doit être responsable des conséquences funestes de cette guerre. » XXIII. (1) Les Albains portent chez eux cette réponse. Des deux côtés on se prépare avec ardeur à la guerre. Ce conflit avait tout le caractère d'une guerre civile, car il mettait, pour ainsi dire, aux prises les pères et les enfants. Les deux peuples étaient de sang troyen; Lavinium tirait son origine de Troie; Albe de Lavinium; et les Romains descendaient des rois d'Albe. (2) Cependant l'issue de la guerre rendit la querelle moins déplorable. On ne combattit point en bataille rangée; on détruisit seulement les maisons de l'une des deux villes, et la fusion s'opéra entre les deux peuples. (3) Les Albains envahirent les premiers, avec une armée formidable, le territoire de Rome. Leur camp n'en était pas à plus de cinq milles; ils l'avaient entouré d'un fossé, lequel fut, pendant quelques siècles, appelé du nom de leur chef, 'le fossé Cluilius', jusqu'à ce que le temps eût fait disparaître et la chose et le nom. (4) Cluilius, étant mort dans le camp, les Albains créent dictateur Mettius Fufétius. Mais le fougueux Tullus, dont l'audace s'était accrue par la mort de Cluilius, s'en va publiant partout que la vengeance des dieux, après s'être manifestée d'abord sur la personne du chef, menace de punir du crime de cette guerre impie quiconque porte le nom Albain. Puis, à la faveur de la nuit, il tourne le camp ennemi, et envahit à son tour le territoire d'Albe. (5) Ce coup de main fait sortir Mettius de ses retranchements. Il s'approche le plus possible de l'ennemi, et de là il envoie un émissaire à Tullus, avec ordre d'exposer au roi l'utilité d'une entrevue avant d'engager l'action; que s'il accorde cette entrevue, il a, lui Mettius, à faire des propositions dont la teneur intéresse Rome et Albe tout ensemble. (6) Tullus ne se refuse point à l'entrevue, quoiqu'il en attende peu de fruit, et range son armée en bataille. Le même mouvement s'exécute parmi les Albains. Alors le général albain prend la parole : (7) « Des attaques injustes, dit-il, du butin enlevé contre la foi des traités, réclamé et non rendu, sont les causes de cette guerre. Ce sont celles du moins que j'ai entendu donner par notre roi Cluilius, celles que tu produiras sans doute aussi toi-même, ô Tullus ! Mais, sans recourir à des raisons spécieuses, et pour déclarer ici la vérité, je 22 dis que l'ambition seule arme l'un contre l'autre deux peuples voisins, deux peuples unis par les liens du sang. (8) Si nous faisons bien ou mal, c'est ce dont je ne décide pas; ce soin regarde les auteurs de la querelle. Quant à cette guerre, comme chef des Albains, je dois la soutenir. Je veux, Tullius, te soumettre un simple avis. Nous sommes environnés, toi et les miens, par la nation étrusque; le danger est grand pour tous, plus grand même pour vous; et vous le savez d'autant mieux que vous êtes plus voisins. Les Étrusques sont tout-puissants sur terre, et plus encore sur mer. (9) Souviens-toi qu'au moment où tu donneras le signal du combat, ce peuple, les yeux fixés sur les deux armées, attendra que nous soyons épuisés et affaiblis pour attaquer à la fois le vainqueur et le vaincu. Puis donc qu'au lieu de nous contenter d'une liberté assurée, nous courons les chances de la servitude, en convoitant la conquête d'une domination douteuse; au nom des dieux, trouvons un moyen qui, sans dommage sérieux pour les deux peuples et sans effusion de sang, puisse décider enfin lequel des deux doit commander à l'autre. » (10) Tullus, bien que l'espérance de la victoire le rendît plus intraitable, agréa néanmoins cette proposition. Mais, tandis que les deux chefs cherchaient ce moyen, la fortune prit soin de le leur fournir. XXIV. (1) Il y avait par hasard dans chacune des deux armées trois frères jumeaux, à peu près de même force et de même âge. C'étaient les Horaces et les Curiaces. L'exactitude de leur nom est suffisamment constatée, et les annales de l'antiquité offrent peu d'actions aussi illustres que la leur. Toutefois cette illustration même n'a pas prévalu contre l'incertitude qui subsiste encore aujourd'hui, de savoir à quelle nation les Horaces, à laquelle les Curiaces appartenaient. Les auteurs varient là-dessus. J'en trouve cependant un plus grand nombre qui font les Horaces Romains; et j'incline vers cette opinion. (2) Chacun des deux rois charge donc ces trois frères de combattre pour la patrie. Là où sera la victoire, là sera l'empire. Cette condition est acceptée, et l'on convient du temps et du lieu du combat. (3) Préalablement, un traité conclu entre les Romains et les Albains porte cette clause principale, que celui des deux peuples qui resterait vainqueur exercerait sur le vaincu un empire doux et modéré. Dans tous les traités, les conditions varient; la formule de tous est la même. (4) Voici l'acte de cette espèce le plus ancien qui nous ait été transmis. Le fécial, s'adressant à Tullus lui dit : « Roi, m'ordonnes-tu de conclure un traité avec le père patrat du peuple albain ? » Et sur la réponse affirmative, il ajouta : « Je te demande l'herbe sacrée. -- Prends-la pure, répliqua Tullus. » (5) Alors le fécial apporta de la citadelle l'herbe pure, et s'adressant de nouveau à Tullus : « Roi, dit-il, me nommes-tu l'interprète de ta volonté royale et de celle du peuple romain des Quirites ? Agrées-tu les vases sacrés, les hommes qui m'accompagnent ? -- Oui, répondit le roi, sauf mon droit et celui du peuple romain. » (6) Le fécial était Marcus Valérius : il créa 'père patrat' Spurius Fusius, en lui touchant la tête et les cheveux avec la verveine. Le père patrat prêta le serment et sanctionna le traité. Il employa, à cet effet, une lon- 23 gue série de formules consacrées qu'il est inutile de rapporter ici. (7) Ces conditions lues, le fécial reprit : « Écoute, Jupiter, écoute, père patrat du peuple albain; écoute aussi, peuple albain. Le peuple romain ne violera jamais le premier les conditions et les lois. Les conditions inscrites sur ces tablettes ou sur cette cire viennent de vous être lues, depuis la première jusqu'à la dernière, sans ruse ni mensonge. Elles sont, dès aujourd'hui, bien entendues pour tous. Or, ce ne sera pas le peuple romain qui s'en écartera le premier. (8) S'il arrivait que, par une délibération publique ou d'indignes subterfuges, il les enfreignit le premier, alors, grand Jupiter, frappe le peuple romain comme je vais frapper aujourd'hui ce porc; et frappe-le avec d'autant plus de rigueur que ta puissance et ta force sont plus grandes. » (9) Il finit là son imprécation, puis frappa le porc avec un caillou. De leur côté, les Albains, par l'organe de leur dictateur et de leurs prêtres, répétèrent les mêmes formules, et prononcèrent le même serment. XXV. (1) Le traité conclu, les trois frères, de chaque côté, prennent leurs armes, suivant les conventions. La voix de leurs concitoyens les anime. Les dieux de la patrie, la patrie elle-même, tout ce qu'il y a de citoyens dans la ville et dans l'armée ont les yeux fixés tantôt sur leurs armes, tantôt sur leurs bras. Enflammés déjà par leur propre courage, et enivrés du bruit de tant de voix qui les exhortaient, ils s'avancent entre les deux armées. (2) Celles-ci étaient rangées devant leur camp, à l'abri du péril, mais non pas de la crainte. Car il s'agissait de l'empire, remis au courage et à la fortune d'un si petit nombre de combattants. Tous ces esprits tendus et en suspens attendent avec anxiété le commencement d'un spectacle si peu agréable à voir. (3) Le signal est donné. Les six champions s'élancent comme une armée en bataille, les glaives en avant, portant dans leur coeur le courage de deux grandes nations. Tous, indifférents à leur propre danger, n'ont devant les yeux que le triomphe ou la servitude, et cet avenir de leur patrie, dont la fortune sera ce qu'ils l'auront faite. (4) Au premier choc de ces guerriers, au premier cliquetis de leurs armes, dès qu'on vit étinceler les épées, une horreur profonde saisit les spectateurs. De part et d'autre l'incertitude glace la voix et suspend le souffle. (5) Tout à coup les combattants se mêlent; déjà ce n'est plus le mouvement des corps, ce n'est plus l'agitation des armes, ni les coups incertains, mais les blessures, mais le sang qui épouvantent les regards. Des trois Romains, deux tombent morts l'un sur l'autre; les trois Albains sont blessés. (6) À la chute des deux Horaces, l'armée albaine pousse des cris de joie : les Romains, déjà sans espoir, mais non sans inquiétude, fixent des regards consternés sur le dernier Horace déjà enveloppé par les trois Curiaces. (7) Par un heureux hasard, il était sans blessure. Trop faible contre ses trois ennemis réunis, mais d'autant plus redoutable pour chacun d'eux en particulier, pour diviser leur attaque il prend la fuite, persuadé qu'ils le suivront selon le degré d'ardeur que leur permettront leurs blessures. (8) Déjà il s'était éloigné quelque peu du lieu du combat, lorsque, tournant la tête, il voit en effet ses adversaires le poursuivre à des distances très inégales, et un 24 seul le serrer d'assez près. Il se retourne brusquement et fond sur lui avec furie. (9) L'armée albaine appelle les Curiaces au secours de leur frère; mais, déjà vainqueur, Horace vole à un second combat. Alors un cri, tel qu'en arrache une joie inespérée, part du milieu de l'armée romaine; le guerrier s'anime à ce cri, il précipite le combat, (10) et, sans donner au troisième Curiace le temps d'approcher de lui, il achève le second. (11) Ils restaient deux seulement, égaux par les chances du combat, mais non par la confiance ni par les forces. L'un, sans blessure et fier d'une double victoire, marche avec assurance à un troisième combat : l'autre, épuisé par sa blessure, épuisé par sa course, se traînant à peine, et vaincu d'avance par la mort de ses frères, tend la gorge au glaive du vainqueur. Ce ne fut pas même un combat. (12) Transporté de joie, le Romain s'écrie : « Je viens d'en immoler deux aux mânes de mes frères : celui-ci, c'est à la cause de cette guerre, c'est afin que Rome commande aux Albains que je le sacrifie. » Curiace soutenait à peine ses armes. Horace lui plonge son épée dans la gorge, le renverse et le dépouille. (13) Les Romains accueillent le vainqueur et l'entourent en triomphe, d'autant plus joyeux qu'ils avaient été plus près de craindre. Chacun des deux peuples s'occupe ensuite d'enterrer ses morts, mais avec des sentiments bien différents. L'un conquérait l'empire, l'autre passait sous la domination étrangère. (14) On voit encore les tombeaux de ces guerriers à la place où chacun d'eux est tombé; les deux Romains ensemble, et plus près d'Albe; les trois Albains du côté de Rome, à quelque distance les uns des autres, suivant qu'ils avaient combattu. XXVI. (1) Mais, avant qu'on se séparât, Mettius, aux termes du traité, demande à Tullus ce qu'il ordonne : « Que tu tiennes la jeunesse albaine sous les armes, répond Tullus; je l'emploierai coutre les Véiens, si j'ai la guerre avec eux. » Les deux armées se retirent ensuite. (2) Horace, chargé de son triple trophée, marchait à la tête des Romains. Sa soeur, qui était fiancée à l'un des Curiaces, se trouve sur son passage, près de la porte Capène; elle a reconnu sur les épaules de son frère la cotte d'armes de son amant, qu'elle-même avait tissée de ses mains : alors, s'arrachant les cheveux, elle redemande son fiancé et l'appelle d'une voix étouffée par les sanglots. (3) Indigné de voir les larmes d'une soeur insulter à son triomphe et troubler la joie de Rome, Horace tire son épée, et en perce la jeune fille en l'accablant d'imprécations : (4) « Va, lui dit-il, avec ton fol amour, rejoindre ton fiancé, toi qui oublies et tes frères morts, et celui qui te reste, et ta patrie. Périsse ainsi toute Romaine qui osera pleurer la mort d'un ennemi. » (5) Cet assassinat révolte le peuple et le sénat. Mais l'éclat de sa victoire semblait en diminuer l'horreur. Toutefois il est traîné devant le roi, et accusé. Le roi, craignant d'assumer sur sa tête la responsabilité d'un jugement, dont la rigueur soulèverait la multitude; craignant plus encore de provoquer le supplice qui suivrait le jugement, convoque l'assemblée du peuple : « Je nomme, dit-il, conformément à la loi, des duumvirs pour juger le crime d'Horace. » (6) La loi 25 était d'une effrayante sévérité : « Que les duumvirs jugent le crime, disait-elle; si l'on appelle du jugement, qu'on prononce sur l'appel. Si la sentence est confirmée, qu'on voile la tête du coupable, qu'on le suspende à l'arbre fatal, et qu'on le batte de verges dans l'enceinte ou hors de l'enceinte des murailles. » (7) Les duumvirs, d'après cette formule de la loi, n'auraient pas cru pouvoir absoudre même un innocent, après l'avoir condamné. « Publius Horatius, dit l'un d'eux, je déclare que tu as mérité la mort. Va, licteur, attache-lui les mains. » (8) Le licteur s'approche; déjà il passait la corde, lorsque, sur l'avis de Tullus, interprète clément de la loi, Horace s'écrie : « J'en appelle. » La cause fut alors déférée au peuple. (9) Tout le monde était ému, surtout entendant le vieil Horace s'écrier que la mort de sa fille était juste; qu'autrement il aurait lui-même, en vertu de l'autorité paternelle, sévi tout le premier contre son fils, et il suppliait les Romains, qui l'avaient vu la veille père d'une si belle famille, de ne pas le priver de tous ses enfants. (10) Puis, embrassant son fils et montrant au peuple les dépouilles des Curiaces, suspendues au lieu nommé encore aujourd'hui le Pilier d'Horace : « Romains, dit-il, celui que tout à l'heure vous voyiez avec admiration marcher au milieu de vous, triomphant et paré d'illustres dépouilles, le verrez-vous lié à un infâme poteau, battu de verges et supplicié ? Les Albains eux-mêmes ne pourraient soutenir cet horrible spectacle ! (11) Va, licteur, attache ces mains qui viennent de nous donner l'empire : va, couvre d'un voile la tête du libérateur de Rome; suspends-le à l'arbre fatal; frappe-le, dans la ville si tu le veux, pourvu que ce soit devant ces trophées et ces dépouilles; hors de la ville, pourvu que ce soit parmi les tombeaux des Curiaces. Dans quel lieu pourrez-vous le conduire où les monuments de sa gloire ne s'élèvent point contre l'horreur de son supplice ? » (12) Les citoyens, vaincus et par les larmes du père, et par l'intrépidité du fils, également insensible à tous les périls, prononcèrent l'absolution du coupable, et cette grâce leur fut arrachée plutôt par l'admiration qu'inspirait son courage, que par la bonté de sa cause. Cependant, pour qu'un crime aussi éclatant ne restât pas sans expiation, on obligea le père à racheter son fils, en payant une amende. (13) Après quelques sacrifices expiatoires, dont la famille des Horaces conserva depuis la tradition, le vieillard plaça en travers de la rue un poteau, espèce de joug sous lequel il fit passer son fils, la tête voilée. Ce poteau, conservé et entretenu à perpétuité par les soins de la république, existe encore aujourd'hui. On l'appelle le Poteau de la Soeur. On éleva un tombeau en pierre de taille, à l'endroit où celle-ci reçut le coup mortel. XXVII. (1) La paix avec les Albains ne fut pas de longue durée. Le dictateur n'eut pas assez de fermeté pour résister à la haine du peuple, qui lui reprochait d'avoir abandonné le sort de l'état à trois guerriers; l'événement ayant trompé ses bonnes intentions, il eut recours à la perfidie pour recouvrer la faveur populaire. (2) De même qu'il avait cherché la paix dans la guerre, de même il chercha la guerre dans la paix. Mais, trouvant dans les siens plus de courage que de force, il fait 26 un appel aux autres peuples; il les pousse à déclarer la guerre à Rome, à la lui faire ouvertement. Il se réserve, à lui et aux siens, la faculté de trahir, tout en conservant les apparences d'une union sincère. (3) Les Fidénates, colonie romaine, associent les Véiens au complot; et, encouragés par les assurances de Mettius, qui promettait de se joindre à eux, ils prennent les armes, et se préparent à la guerre. (4) Quand la révolte a éclaté, Tullus donne ordre à Mettius de venir avec ses troupes, marche ensuite aux ennemis, traverse l'Anio, et vient camper au confluent de cette rivière et du Tibre. Les Véiens avaient passé le Tibre entre ce point et la ville de Fidènes. (5) Leurs lignes formaient l'aile droite, et se déployaient sur les bords du fleuve; à l'aile gauche étaient les Fidénates, plus rapprochés des montagnes. Tullus conduit ses soldats contre les Véiens, et oppose les Albains au corps d'armée des Fidénates. Mettius n'était pas plus brave que fidèle; aussi, n'osant ni garder le poste qui lui est confié, ni passer ouvertement à l'ennemi, il se rapproche insensiblement des montagnes. (6) Lorsqu'il se croit assez loin des Romains, il commande halte à sa troupe; puis, ne sachant plus que faire, il déploie ses colonnes, pour gagner du temps. Son dessein était de porter ses forces du côté où tournerait la fortune. (7) Les Romains, qui gardent leur position, s'étonnent d'abord d'un mouvement qui laisse leur flanc à découvert; mais bientôt un cavalier accourt à toute bride informer Tullus que les Albains se retirent en effet. Tullus, épouvanté, fait voeu de consacrer à Mars douze prêtres saliens, et de bâtir un temple à la 'Pâleur' et à la 'Peur'. (8) Il ordonne ensuite au cavalier d'une voix menaçante, et assez haute pour être entendue de l'ennemi, de retourner au combat, et de ne point s'alarmer; ajoutant que le mouvement des Albains s'exécute d'après son ordre, pour prendre à dos les Fidénates. Il lui commande en même temps d'enjoindre aux cavaliers de tenir les lances hautes. (9) Cette manoeuvre habile dérobait à la plus grande partie de l'infanterie romaine la vue de la retraite des Albains. Quant à ceux qui avaient aperçu cette retraite, trompés par les paroles du roi, qu'ils croyaient sincères, ils en combattent avec plus d'ardeur. La terreur gagne les Fidénates. Ils avaient entendu aussi la réponse du roi, et l'avaient comprise; car, la plupart d'entre eux, ayant été détachés de Rome pour fonder la colonie, savaient la langue latine. (10) Craignant que les Albains, descendus brusquement des hauteurs, ne leur coupent le chemin de la ville, ils lâchent pied et tournent le dos. Tullus les presse, met en déroute le corps des Fidénates, et revient avec plus d'audace contre les Véiens, étourdis déjà de la défaite de leurs alliés. Les Véiens ne peuvent soutenir le choc; ils se débandent et prennent la fuite. Mais le fleuve, qui coule sur leurs derrières, les arrête. (11) Arrivés sur ses bords, les uns jettent lâchement leurs armes et s'élancent au hasard dans les flots, les autres, hésitant entre la fuite et le combat, sont égorgés au milieu de leurs irrésolutions. Dans aucune bataille les Romains n'avaient encore versé tant de sang ennemi. XXVIII. (1) Alors, l'armée albaine, qui était demeurée spectatrice du combat, descend dans la plaine. Mettius félicite Tullus de sa victoire, 27 et Tullus le remercie avec bonté. Pour assurer les heureux effets de cette journée, Tullus ordonne aux Albains de réunir leur camp à celui des Romains, et prépare, pour le lendemain, un sacrifice lustral. (2) Dès qu'il fait jour, et que tout est prêt, il convoque, suivant la coutume, les deux armées à une assemblée générale. les hérauts, commençant l'appel par les derniers rangs, font avancer les Albains les premiers. Ceux-ci, curieux de voir ce qui allait se passer, et d'entendre la harangue du roi des Romains, se tiennent tout près de sa personne. (3) La légion romaine, aux ordres de Tullus, se range, tout armée, autour des Albains. Les centurions avaient ordre d'exécuter avec promptitude tout ce qui leur serait commandé. (4) Tullus, alors, commence en ces termes : « Romains, si jamais, dans aucune guerre, vous avez dû rendre grâces d'abord aux dieux immortels, et ensuite à votre courage, ce fut dans le combat d'hier. En effet, vous avez eu à vous défendre, non seulement contre les armes de vos ennemis, mais, chose bien plus dangereuse, contre la trahison et la perfidie de vos alliés; (5) car, afin que vous ne demeuriez pas plus longtemps dans l'erreur, sachez que je n'avais point ordonné aux Albains de gagner les montagnes. Il est vrai que je feignis d'avoir donné cet ordre; mais c'était par prudence, et pour ne pas vous décourager, en vous dévoilant la désertion de Mettius; c'était encore pour effrayer les ennemis et les mettre en désordre, en leur faisant croire qu'ils allaient être enveloppés. (6) Je n'accuse pas tous les Albains; ils ont suivi leur chef, comme vous m'auriez suivi moi-même si j'avais voulu changer mes dispositions. Mettius seul a dirigé le mouvement; Mettius, le machinateur de cette guerre, Mettius, le violateur du traité juré par les deux nations. Mais je veux désormais qu'on imite son exemple, si je ne donne pas aujourd'hui, en sa personne, une éclatante leçon aux mortels. » (7) Alors les centurions armés entourent Mettius. Tullus continue : « Pour le bonheur, la gloire, la prospérité du peuple romain, et de vous aussi, peuple d'Albe, j'ai résolu de transporter à Rome tous les habitants d'Albe, de donner le droit de cité au peuple, et aux grands le droit de siéger au sénat; de ne faire, en un mot, qu'une seule ville, un seul état. Albe s'était jadis partagée en deux peuples. Eh bien ! qu'elle se réunisse maintenant en un seul. » (8) À ces mots, les Albains, sans armes, au milieu de cette troupe armée, sont agités par des sentiments divers; mais, contenus par la terreur, ils gardent le silence. (9) Tullus reprend : « Mettius Fufétius, si tu pouvais encore apprendre à garder la foi des traités, je te laisserais vivre, pour recevoir de moi cette leçon; mais la perfidie est un mal incurable; que ton supplice enseigne donc aux hommes à croire à la sainteté des lois que tu as violées. De même que tu as partagé ton coeur entre Rome et Fidènes, de même ton corps sera partagé, et ses lambeaux dispersés. » (10) On fait approcher ensuite deux chars, attelés de quatre chevaux, et Tullus y fait lier Mettius. Les chevaux, lancés en sens contraire, entraînent chacun, avec l'un des chars, les membres déchirés et sanglants de Mettius. (11) Tous les regards se détournent de cet 28 horrible spectacle. C'était le premier, et ce fut le dernier exemple, parmi les Romains, d'un supplice où les lois humaines aient été méconnues. C'est même un de leurs titres de gloire d'avoir préféré toujours les châtiments plus doux. XXIX. (1) Cependant on avait déjà détaché la cavalerie, pour transporter à Rome tous les habitants d'Albe. On y conduisit ensuite les légions pour détruire la ville. (2) À leur entrée, elles ne virent point ce tumulte ni cette terreur qui trouble d'ordinaire les villes conquises, lorsque les portes ont été brisées, les murs renversés par le bélier, et la citadelle emportée d'assaut; lorsque l'ennemi pousse des cris de mort, court et se répand dans les rues, et porte partout le fer et la flamme; (3) une tristesse morne et silencieuse serrait tous les coeurs. On ne savait que laisser, que prendre; la crainte leur avait ôté le conseil. On s'interrogeait les uns les autres : ceux-ci restaient immobiles sur le seuil de leurs portes; ceux-là erraient à l'aventure, au sein même de leurs maisons, pour les revoir une dernière fois. (4) Mais quand la voix menaçante des cavaliers leur enjoignit de sortir; quand le fracas des maisons abattues se fit entendre de toutes les extrémités de la ville; que la poussière, soulevée de toutes parts et du milieu des ruines, enveloppa l'espace d'un nuage épais, chacun emporta précipitamment ce qu'il put, et s'éloigna, abandonnant ses lares, ses pénales, le toit sous lequel il était né, sous lequel il avait grandi. (5) De longues files d'émigrants remplissaient les rues. Le spectacle de leurs misères communes renouvelait leurs larmes; on entendait aussi des cris lamentables, ceux des femmes, surtout, lorsqu'elles voyaient, en passant, les temples des dieux investis de soldats, et les dieux eux-mêmes qu'elles laissaient, pour ainsi dire, en captivité. (6) Dès que les Albains furent sortis, les édifices publics, les maisons privées, furent indistinctement rasés. Albe existait depuis quatre cents ans : une heure suffit à sa dévastation et à sa ruine. On épargna pourtant les temples des dieux; Tullus l'avait ainsi ordonné. XXX. (1) Cependant Rome s'augmentait des débris de sa rivale, et doublait le nombre de ses habitants. Le mont Célius est ajouté à la ville; et, pour y attirer la population, Tullus y bâtit son palais et y fixe sa demeure. (2) Il veut aussi que le sénat ait sa part dans l'agrandissement de l'état, et il ouvre les portes de ce conseil auguste aux Tullius, aux Servilius, aux Quinctius, aux Geganius, aux Curiatius et aux Cloelius. Pour les membres du sénat, devenus ainsi plus nombreux, Tullus fait construire un édifice qu'il destine à leurs assemblées, et qu'on appelle encore aujourd'hui le palais Hostilius. (3) Enfin, pour que l'adjonction du nouveau peuple fût profitable en quelque chose à tous les ordres de l'état, il crée dix compagnies de chevaliers, choisis tous parmi les Albains. Il complète ainsi ses anciennes légions, et il en forme de nouvelles, tirées du sein de cette même population. (4) Alors, plein de confiance dans ses forces, il déclare la guerre aux Sabins, la nation la plus considérable à cette époque, et la plus belliqueuse, après les Étrusques. Les deux peuples se plaignaient réciproquement de quelques injures, dont on avait 29 inutilement demandé la réparation de part et d'autre. (5) Tullus alléguait que, près du temple de Féronie, des marchands romains avaient été arrêtés en plein marché; les Sabins, qu'on avait retenu quelques-uns de leurs concitoyens prisonniers à Rome, quoiqu'ils se fussent réfugiés dans le bois sacré. C'étaient là les prétextes de la guerre. (6) Les Sabins, qui n'avaient pas oublié que Tatius avait transporté à Rome une partie de leurs forces, et que la puissance romaine venait encore de s'accroître par la réunion des Albains, cherchèrent autour d'eux des secours étrangers. (7) Voisins de l'Étrurie, ils confinaient au territoire des Véiens, lesquels, dominés encore par le ressentiment d'anciennes défaites, n'étaient que trop portés à une rupture. Toutefois les Sabins n'en purent tirer que quelques volontaires; l'argent leur amena aussi quelques aventuriers de la dernière classe du peuple. La cité elle-même ne leur fournit aucun secours, et (chose moins surprenante de la part de tout autre peuple), le respect pour la trêve conclue avec Romulus arrêta les Véiens. (8) On faisait donc de part et d'autre les plus grands préparatifs Mais, comme le succès pouvait dépendre beaucoup de la promptitude avec laquelle on préviendrait l'ennemi, Tullus entre le premier sur le territoire des Sabins. (9) Un combat sanglant eut lieu près de la forêt Malitiosa. L'excellence de leur infanterie, et surtout l'augmentation récente de leur cavalerie, y servirent puissamment les Romains. (10) La cavalerie, par une charge soudaine, mit les Sabins en désordre; ils ne purent ni soutenir le choc, ni se rallier, ni s'ouvrir un chemin pour fuir; on en fit un grand carnage. XXXI. (1) Rome goûtait déjà les fruits de cette victoire si glorieuse pour le règne de Tullus, et pour elle si féconde, lorsqu'on annonça au roi et aux sénateurs qu'une pluie de pierres était tombée sur le mont Albain. (2) Comme on avait peine à croire ce prodige, on envoya sur les lieux pour s'en assurer. Ceux qui furent chargés de ce soin virent en effet tomber du ciel une grande quantité de pierres, aussi pressées que la grêle, lorsque le vent la chasse sur la terre. (3) Ils crurent même entendre sortir d'un bois sacré, au sommet de la montagne, une voix retentissante, qui ordonnait aux Albains de faire des sacrifices suivant le rite de leur pays : car ce devoir avait été négligé, comme si, en quittant leur patrie, les Albains eussent aussi abandonné leurs dieux, soit pour adopter ceux des Romains, soit par mépris de toute religion, ce qui est l'effet ordinaire du ressentiment contre la mauvaise fortune. (4) Les Romains, de leur côté, en expiation de ce prodige, célébrèrent des sacrifices publics qui durèrent neuf jours; et, soit que la voix céleste du mont Albain eût, au rapport de la tradition, prescrit cet usage, soit que les aruspices l'eussent conseillé, il est certain qu'il fut maintenu, et que des fêtes se succédaient pendant neuf jours, toutes les fois que le même prodige se répétait. (5) Peu de temps après, Rome fut désolée par une maladie pestilentielle qui inspira le dégoût absolu de la guerre à ses habitants. Mais le belliqueux Tullus ne leur donnait point de relâche. Il estimait le séjour des camps plus propice que celui des villes à maintenir le corps en santé. Enfin, il ressentit lui-même les atteintes du fléau. (6) L'épuisement de ses forces accabla cet esprit turbulent, et ce prince, qui trouvait indigne d'un roi de s'occuper de religion, donna tout 30 à coup dans les superstitions, même les plus frivoles, et remplit la ville de cérémonies religieuses. (7) À son exemple, les Romains, revenant aux habitudes qui avaient marqué le règne de Numa, crurent que l'unique remède à leurs maux était d'apaiser et de fléchir les dieux. (8) On dit même que Tullus, ayant découvert, en feuilletant les livres de Numa, le récit de certains sacrifices secrets institués en l'honneur de Jupiter Elicius, se cacha pour vaquer à ces mystérieuses cérémonies; mais qu'ayant négligé, soit dans les préparatifs, soit dans la célébration, certains rites essentiels, il n'évoqua le fantôme d'aucune divinité; que Jupiter, irrité, au contraire, de semblables profanations, frappa de sa foudre le prince et le palais, et les consuma tous deux. Tullus régna trente-deux ans, et laissa une glorieuse réputation militaire. XXXII. (1) Après la mort de Tullus, l'autorité revint, selon l'usage, aux mains des sénateurs. Ceux-ci nommèrent un interroi. Les comices assemblés, Ancus Marcus fut élu roi par le peuple. Le sénat ratifia l'élection. Ce prince était petit-fils de Numa par sa fille. (2) À peine commença-t-il à régner, que, plein de la gloire de son aïeul, et considérant combien le règne précédent avait été malheureux, malgré tout son éclat, soit à cause de l'indifférence de Tullus pour les cérémonies religieuses, soit à cause des altérations qu'il leur avait fait subir, il regarda comme son premier devoir de les ramener à la pureté de leur institution, et ordonna au grand prêtre d'en transcrire les préceptes sur des tablettes blanches, de se conformer aux textes de Numa, et de les exposer aux regards du public. Ce début fit espérer aux citoyens avides de repos et aux états voisins que le nouveau roi imiterait les moeurs et le gouvernement de son aïeul. (3) Aussi les Latins, qui s'étaient liés à Tullus par un traité, sortirent de leur inaction, et reprirent courage. Ils firent des incursions sur les terres de Rome, et répondirent avec arrogance aux députés qu'on leur envoya pour demander satisfaction; car ils s'étaient imaginés que l'indolent Ancus passerait sa vie dans les temples et aux pieds des autels. (4) Mais Ancus unissait au caractère de Numa celui de Romulus, et il sentait bien que si la paix avait été nécessaire à son aïeul pour civiliser une nation nouvelle de moeurs si farouches, il pourrait difficilement prétendre au même résultat sans essuyer d'injures. On commençait par tenter sa patience, on finirait par la mépriser. Ces circonstances réclamaient donc un Tullus plutôt qu'un Numa. (5) Mais Numa avait fondé des institutions religieuses pour les temps de paix; Ancus en créa pour les temps de guerre. Il voulut qu'un rite particulier fût consacré à la guerre, pour les formes à observer tant dans la conduite que dans la déclaration des hostilités. Il emprunta aux Équicoles, ancien peuple de l'Italie, beaucoup de leurs usages; ce sont les mêmes qu'observent encore aujourd'hui les féciaux dans leurs réclamations. (6) Le fécial, arrivé sur les frontières du peuple agresseur, se couvre la tête d'un voile de laine et dit : « Écoute, Jupiter; écoutez, habitants des frontières (et il nomme le peuple auquel elles appartiennent); écoute 31 aussi, Justice : je suis le héraut du peuple romain; je viens chargé par lui d'une mission juste et pieuse; qu'on ajoute foi à mes paroles. » Il expose ensuite ses griefs; (7) puis, attestant Jupiter, il continue : « Si moi, le héraut du peuple romain, j'outrage les lois de la justice et de la religion, en demandant la restitution de ces hommes et de ces choses, ne permets pas que je puisse jamais revoir ma patrie. » (8) Cette formule, il la dit en franchissant la frontière, il la dit au premier homme qu'il rencontre, il la dit en entrant dans la ville ennemie, il la dit encore à son arrivée sur la place publique; mais en faisant de légers changements soit au rythme, soit aux termes du serment. (9) S'il n'obtient pas satisfaction, après trente-trois jours, délai prescrit solennellement, il déclare ainsi la guerre : « Écoute, Jupiter, et toi, Janus Quirinus, et vous tous, dieux du ciel, de la terre et de l'enfer, écoutez : (10) Je vous prends à témoin de l'injustice de ce peuple (et il le nomme) et de son refus de restituer ce qui n'est point à lui. Au reste, les vieillards de ma patrie délibéreront sur les moyens de reconquérir nos droits. » Le héraut revenait aussitôt à Rome pour qu'on en délibérât, (11) et le roi communiquait immédiatement l'affaire aux sénateurs, à peu près en ces termes : « Les objets, griefs et procès que le Père patrat du peuple romain des Quirites, a redemandés, exposés, débattus auprès du Père patrat et du peuple des Anciens Latins, et desquels il attendait la restitution, la réparation et la solution, n'ont été ni restitués, ni réparés, ni résolus; dis-moi donc, demandait-il au premier à qui il s'adressait, ce que tu en penses. » (12) Celui-ci répondait alors : « Je pense que, pour faire valoir nos droits, la guerre est juste et légitime; en conséquence, j'y donne mon plein et entier consentement. » On interrogeait ainsi chacun à son tour, et si la majorité adoptait cet avis, la guerre était décidée. L'usage était alors que le fécial portât aux frontières du peuple ennemi, un javelot ferré, ou un pieu en cornouiller durci au feu. Là, en présence de trois adultes au moins, il disait : (13) « Puisque les peuples des Anciens Latins ou les citoyens des Anciens Latins ont agi contre le peuple romain des Quirites, et failli envers lui, le peuple romain des Quirites a ordonné la guerre contre les Anciens Latins; le sénat du peuple romain des Quirites, l'a proposée, décrétée, arrêtée, et moi et le peuple romain, nous la déclarons aux Anciens Latins, peuples et citoyens, et je commence les hostilités. » (14) En disant ces mots, il lançait son javelot sur le territoire ennemi. Telles furent alors les formalités auxquelles on eu recours, dans les réclamations adressées aux Latins, et dans la déclaration de guerre. Cette coutume a depuis été constamment observée. XXXIII. (1) Ancus, après avoir laissé aux flamines et au reste des prêtres, le soin des sacrifices, marche à la tête d'une armée nouvellement enrôlée contre Politorium, ville des Latins, qu'il emporte d'assaut. À l'exemple des rois, ses prédécesseurs, qui avaient agrandi l'état en conférant le droit de cité aux ennemis vaincus, il fit transférer à Rome tous les habitants. (2) Et, comme les anciens Romains avaient axé leur demeure autour du mont Palatin, les Sabins sur le Capitole et dans la citadelle, les Albains sur le mont Célius, il as - 32 signa le mont Aventin aux derniers venus. Là aussi trouvèrent place les citoyens de Tellènes et de Ficana, quand les Romains eurent conquis ces deux villes. (3) Bientôt on fut obligé d'attaquer une seconde fois Politorium, dont les Anciens Latins s'étaient ressaisis, depuis qu'elle avait été abandonnée par ses habitants; et on la rasa de peur qu'elle ne servit encore de retraite aux ennemis de Rome. (4) La guerre s'étant enfin concentrée devant Médullia, les chances du combat y furent quelque temps balancées, et la victoire indécise, car la place était forte et bien pourvue, et la garnison nombreuse; de plus, l'armée latine, campée dans la plaine, en vint maintes fois aux prises avec les Romains. (5) Mais Ancus, appuyé de toutes ses troupes, fait un dernier effort : les Latins sont vaincus en bataille rangée. Possesseur d'un immense butin, Ancus revient à Rome, où il admet au rang de citoyens plusieurs milliers de Latins. Il les établit auprès du temple de Vénus Murcia, comme pour opérer la jonction entre les monts Palatin et Aventin. (6) Le Janicule aussi est lié au corps de la ville, non par défaut de terrain, mais pour garantir cette position contre les surprises. On atteignit ce but, non seulement par le moyen d'un mur prolongé jusqu'aux habitations, mais par un pont de bois, le premier qu'on éleva sur le Tibre, et qui rendit facile le passage d'une rive à l'autre. (7) Le 'fossé des Quirites', très propre à interdire l'accès du côté de la plaine, est aussi l'oeuvre d'Ancus. (8) Depuis ce prodigieux accroissement de Rome, il était devenu plus difficile de reconnaître, au milieu d'une aussi grande multitude, les bons et les mauvais citoyens, et les crimes, moins connus, se multipliaient. Pour imprimer la terreur et arrêter les progrès de la perversité, Ancus fit construire, au centre de la ville, une prison qui dominait aussi le Forum. (9) Sous ce règne, le territoire de Rome et ses frontières s'accrurent autant que la ville elle-même. On prit aux Véiens la forêt Maesia; l'empire fut reculé jusqu'à la mer, Ostie fondée à l'embouchure du Tibre, des salines établies autour de cette ville, et le temple de Jupiter Férétrien agrandi, en reconnaissance des derniers succès. XXXIV. (1) Pendant le règne d'Ancus, un étranger nommé Lucumon, homme actif et opulent, vint à Rome. Il y fut attiré principalement par l'ambition et l'espérance d'y obtenir les honneurs qu'on lui refusait à Tarquinies, où sa famille était également étrangère. (2) Démarate, son père, obligé de fuir Corinthe, sa patrie, à la suite de troubles civils, s'était, par hasard, retiré à Tarquinies. Là, il s'était marié et avait eu deux enfants, Lucumon, et Arruns. Lucumon survécut à son père, dont il recueillit seul l'héritage; Arruns était mort auparavant, laissant sa femme enceinte. (3) Démarate, qui l'avait suivi de près, ignorant la grossesse de sa bru, ne fit aucune mention de son petit-fils dans son testament; de sorte que l'enfant, étant né postérieurement à la mort de son aïeul, n'eut aucune part dans la succession, et fut laissé dans un état de misère qui lui fit donner le nom d'Égérius. (4) Héritier, au contraire, des richesses paternelles, Lucumon en conçut un orgueil que sa femme Tanaquil s'attacha encore à développer. 33 Fille d'une haute naissance, Tanaquil n'était nullement disposée à descendre en acceptant une alliance qui l'eût fait déchoir. (5) Le mépris des Étrusques pour Lucumon, ce fils d'un étranger, d'un proscrit, était un affront qu'elle ne pouvait souffrir; et, plus sensible à l'élévation de son mari qu'à l'amour de sa patrie, elle résolut de quitter Tarquinies. (6) Le séjour de Rome parut lui convenir davantage. Elle espérait que chez un peuple nouveau, où la noblesse datait d'un jour et n'était que le fruit du mérite personnel, un homme courageux et entreprenant comme Lucumon trouverait bientôt sa place. Tatius et Numa, tous deux étrangers, avaient régné dans Rome; on était même allé à Cures offrir cet honneur à Numa; Ancus était fils d'une Sabine, et n'avait pour titre de noblesse que l'illustration de ce même Numa. (7) Elle n'eut pas de peine à persuader l'ambitieux Lucumon, fort peu attaché d'ailleurs à sa patrie, à laquelle il ne tenait que par sa mère. Ils se rendent donc à Rome avec leur fortune. (8) Comme ils approchaient du Janicule, Lucumon sur son char et Tanaquil à côté de lui, un aigle s'abattant avec lenteur, enlève le bonnet qui couvre la tête de Lucumon; puis reprenant son vol et planant avec de grands cris au-dessus du char, il s'abat de nouveau, et, comme s'il eût été chargé de ce soin par les dieux, vient replacer le bonnet sur la tête de l'étranger. Il se perd ensuite dans les nues. (9) Tanaquil, savante, comme tous les Étrusques, dans l'art d'expliquer les prodiges célestes, reçut, dit-on, ce présage avec transport. Elle embrasse son époux; elle veut qu'il s'abandonne aux plus magnifiques espérances; qu'il considère l'espèce de l'oiseau, la région du ciel d'où il est descendu, le dieu dont il est le messager : elle ajoute que le prodige s'est accompli sur la partie du corps la plus haute; que l'ornement dont les hommes couvrent leur tête n'a été enlevé un instant de la sienne que pour y être replacé ensuite par la volonté des dieux. (10) Tout remplis de ces pensées, ils entrent à Rome et y achètent une maison. Lucumon prit le nom de Lucius Tarquinius Priscus. (11) Sa qualité d'étranger et ses richesses le firent bientôt distinguer des Romains : lui-même aidait la fortune et se conciliait la faveur par son affabilité, par une hospitalité généreuse et par les bienfaits avec lesquels il cherchait à s'attacher tout le monde. Enfin son nom parvint jusqu'au roi. (12) Une fois connu du prince, il ne tarda pas à gagner son amitié par ses manières libérales et son habileté à remplir les charges qui lui furent confiées; il était de tous les conseils publics et privés, et consulté sur la guerre et sur la paix. Après l'avoir éprouvé en toutes choses, le roi finit par le nommer, dans son testament, tuteur de ses enfants. XXXV. (1) Ancus avait régné vingt-quatre ans, aussi grand qu'aucun autre de ses prédécesseurs, dans la paix comme dans la guerre. Déjà ses fils touchaient à la puberté; et Tarquin insistait d'autant plus vivement sur la nécessité d'élire un nouveau roi. (2) Quand les comices furent convoqués, il avait su d'avance éloigner les jeunes princes, sous le prétexte d'une partie de chasse. Il fut le premier, dit-on, qui osa briguer ouvertement la royauté, et haranguer le peuple pour capter ses suffrages. (3) « Sa demande n'était pas sans exemple, disait-il; et il n'était pas le premier, ce qui d'ailleurs eût pu surprendre et indigner tout le monde, 34 mais le troisième étranger qui prétendait à la couronne. Tatius n'était pas seulement étranger; il était ennemi, et pourtant on l'élut roi. Numa ne connaissait Rome que de nom, et cependant il avait été appelé à y régner, sans qu'il eût la pensée de le demander. (4) Pour lui, dès qu'il avait pu disposer de sa volonté, il était venu à Rome avec sa femme et toute sa fortune; et, depuis qu'il était arrivé à cet âge où l'homme peut rendre à un état des services utiles, il avait plus vécu à Rome que dans son ancienne patrie. (5) Dans la paix et dans la guerre, il s'était formé sur les leçons d'un assez grand maître, Ancus lui-même; c'est à lui qu'il devait la connaissance des lois et du culte de Rome. Il avait rivalisé avec tous les citoyens d'attachement et de respect envers le roi, et, avec le roi, de bonté envers tous les citoyens. » (6) Comme il ne disait rien qui ne fût vrai, le peuple, d'un consentement unanime, lui déféra la royauté. Cet homme, si remarquable d'ailleurs, porta sur le trône le même génie ambitieux qui lui en avait ouvert le chemin. Aussi attentif à affermir son autorité qu'à étendre les bornes de son royaume, il nomma cent nouveaux sénateurs, désignés depuis sous le nom de 'Pères du second rang'. Il se créait ainsi ostensiblement un parti, qu'il enchaînait à lui par des honneurs. (7) Sa première guerre fut contre les Latins; il prit d'assaut la ville d'Apioles, et rapporta de cette expédition des richesses plus considérables qu'il n'en pouvait attendre d'une conquête de si peu d'importance. Il les employa à célébrer des jeux avec plus de pompe et de magnificence que les rois ses prédécesseurs. (8) Ce fut alors qu'il traça l'enceinte, appelée aujourd'hui le grand Cirque. Il destina des places particulières aux sénateurs et aux chevaliers, et chacun d'eux y fit construire des loges, (9) soutenues sur des échafauds de douze pieds de hauteur, et qu'on nomma Fori. Les jeux étaient des courses de chevaux et des combats d'athlètes dont les acteurs étaient tirés la plupart de l'Étrurie. Ils devinrent annuels; on les appela tantôt les Grands Jeux, tantôt les Jeux Romains. (10) Tarquin fit encore distribuer à des particuliers le terrain qui environne le Forum, afin qu'ils y élevassent des portiques et des boutiques. XXXVI. (1) Il se préparait aussi à entourer la ville d'une muraille de pierres, lorsque la guerre des Sabins vint traverser son projet. Leur attaque fut si subite, qu'ils avaient déjà franchi l'Anio avant qu'il fût possible à l'armée romaine d'aller à leur rencontre et de les arrêter. (2) La terreur avait gagné Rome. À la première bataille, le carnage fut grand de part et d'autre, et la victoire indécise. Mais les ennemis s'étant retirés dans leur camp laissèrent aux Romains le temps de lever de nouvelles troupes. (2) Tarquin vit que la faiblesse de son armée venait de l'insuffisance de sa cavalerie; il résolut d'ajouter de nouvelles centuries aux trois déjà formées par Romulus, les Ramnes, les Titienses et les Lucères, et de les honorer de son nom. (3) Comme Romulus avait consulté les augures avant d'organiser cette milice, Attus Navius, le plus célèbre d'alors, prétendit qu'on n'y pouvait rien changer ni rien ajouter sans obtenir l'autorisation des auspices. (4) Le roi fut blessé de la liberté du pontife. On rapporte que, se raillant de sa science, il dit : « Or çà, devin, consulte tes pro- 35 nostics, et dis-moi si ce que je pense maintenant est faisable? » Le devin interroge l'augure, et répond affirmativement. « Eh bien ! ajoute le roi, je pensais que tu couperais cette pierre avec un rasoir. Prends-la donc et fais ce que ces oiseaux ont déclaré possible. » Alors, sans hésiter, Navius, dit-on, trancha la pierre. (5) La statue de cet Attus, représenté la tête voilée, se voyait sur le Comitium, à l'endroit où ce fait eut lieu, et sur les degrés, à gauche, de la salle du sénat. On ajoute que la pierre y fut aussi placée pour consacrer à perpétuité le souvenir de ce prodige. (6) Ce qu'il y a de certain, c'est que, dès ce moment, les augures acquirent tant de crédit, et leur sacerdoce tant de considération, que, dans la suite, on n'osa plus rien entreprendre, ni dans la guerre ni dans la paix, sans les avoir préalablement consultés. Les assemblées du peuple, les levées de troupes, les délibérations les plus graves, étaient interrompues et ajournées si les oiseaux ne les approuvaient. (7) Tarquin ne fit alors d'autre changement aux compagnies de centuries, que d'en doubler le nombre, en sorte que trois centuries formaient un corps de dix-huit cents hommes. (8) Pour désigner les derniers incorporés, on ajouta le mot 'nouveaux' à l'ancienne dénomination; mais aujourd'hui qu'on les a doublées, on les appelle 'les six centuries'. XXXVII. (1) Cette arme ainsi augmentée, Tarquin livre une seconde bataille aux Sabins. S'aidant encore de la ruse, malgré ce développement de forces nouvelles, il fit mettre le feu à une quantité de bois amassé sur les bords de l'Anio et qu'on jeta tout enflammé dans le fleuve. Le vent favorise l'incendie, et ces bois, la plupart réunis en radeaux, viennent s'attacher aux pilotis du pont, et l'embrasent. (2) Ce spectacle épouvante les Sabins pendant qu'ils combattent, et devient un obstacle à leur retraite lorsqu'ils sont mis en déroute. Un grand nombre, échappé au fer des Romains, périt dans le fleuve; et leurs armes, emportées par le Tibre jusqu'à Rome, y annoncent l'éclatante victoire de Tarquin, avant l'arrivée du messager qui en apportait la nouvelle. (3) La cavalerie eut presque tout l'honneur de cette journée. Placée aux deux ailes, et voyant le centre de l'infanterie romaine lâcher pied, elle fondit avec tant d'impétuosité sur le flanc des légions sabines, que non seulement elle les arrêta dans l'ardeur de leur poursuite, mais qu'elle les força bientôt à fuir. (4) Les fuyards coururent vers les montagnes, mais peu y trouvèrent un abri : le reste fut, comme nous l'avons dit, culbuté dans le fleuve par la cavalerie. (5) Tarquin, persuadé qu'il fallait profiter de la terreur des vaincus, envoya le butin et les prisonniers à Rome; puis, pour accomplir un voeu fait à Vulcain, il mit le feu aux dépouilles ennemies, entassées en un vaste monceau, et entra sur le territoire des Sabins. (6) Ceux-ci, malgré leur défaite et leur peu d'espoir pour l'avenir, n'ayant pas d'ailleurs le temps de délibérer, vinrent au-devant des Romains avec des troupes levées sans ordre et à la hâte. Une seconde défaite, anéantissant presque toutes leurs ressources, les obligea à demander la paix. XXXVIII. (1) Ils perdirent Collatie et tout son ter- 36 ritoire. Le gouvernement en fut donné à Égérius, neveu de Tarquin. Voici comment les habitants se rendirent, et la formule dont on usa en cette circonstance. (2) Le roi, s'adressant aux députés, leur demanda : « Êtes-vous les députés et les orateurs envoyés par le peuple collatin, pour vous mettre, vous et le peuple de Collatie, en ma puissance ? -- Oui. -- Le peuple collatin est-il libre de disposer de lui ? -- Oui. -- Vous soumettez-vous à moi et au peuple romain, vous, le peuple de Collatie, la ville, la campagne, les eaux, les frontières, les temples, les propriétés mobilières, enfin toutes les choses divines et humaines ? -- Oui. -- Eh bien ! j'accepte en mon nom et au nom du peuple romain. » (3) La guerre des Sabins terminée, Tarquin rentra triomphant dans Rome. Il tourna ensuite ses armes contre les Anciens Latins. (4) Il n'en vint jamais avec eux à une action décisive; mais, en attaquant séparément toutes les villes de leur pays, il subjugua tous ceux qui portaient le non de Latins. Il prit Corniculum, Ficuléa la Vieille, Camérie, Crustumérie, Amériola, Médullia, Nomentum, villes qui avaient de tout temps appartenu ou qui s'étaient données aux Latins. (5) La paix conclue, il commença, dans l'intérieur de la ville, des travaux considérables, et y déploya plus d'activité encore qu'il n'en avait montré dans les guerres qu'il venait de soutenir. (6) Le peuple, rentré dans ses foyers, n'y eut pas plus de repos que dans les camps. Tarquin fit en effet continuer le mur de pierres de taille dont la guerre des Sabins avait interrompu la construction, et fortifia la ville dans toute la partie encore ouverte. Comme les eaux s'écoulaient difficilement des quartiers bas de la ville, autour du Forum, et des vallées qui sont entre les collines, il les dessécha au moyen d'égouts qui les reçurent de ces différents points et les conduisirent, ainsi que celles des hauteurs de la ville, jusqu'au Tibre. (7) Il traça ensuite l'enceinte du temple que, pendant la guerre des Sabins, il avait voué à Jupiter Capitolin, et dont les fondations présagèrent dès lors la majesté future. XXXIX. (1) Vers ce temps-là, un prodige, aussi extraordinaire par lui-même que par les événements qui le suivirent, se manifesta dans le palais. Une flamme embrasa, dit-on, la chevelure d'un enfant endormi, nommé Servius Tullius. (2) Un pareil miracle excita de tous côtés, dans le palais, des cris qui attirèrent le roi et sa famille. Comme un des serviteurs s'empressait d'apporter de l'eau pour éteindre la flamme, la reine le retint, et, faisant cesser le tumulte, défendit de toucher à cet enfant, jusqu'à ce qu'il s'éveillât de lui même. Mais bientôt la flamme s'évanouit avec le sommeil de l'enfant. (3) Alors Tanaquil, ramenant son mari dans l'intérieur du palais : « Vois-tu, lui dit-elle, cet enfant que nous élevons dans une condition si humble ? Sache qu'il sera la lumière qui doit ranimer un jour nos espérances prêtes à s'éteindre, et soutenir notre trône ébranlé. Entourons donc de tous nos soins et de toute notre tendresse ce gage d'une gloire immense pour Rome et pour nous. » (4) Depuis ce moment ils traitèrent Servius comme s'il eût été leur fils, et lui firent apprendre tout ce qui excite les esprits et leur donne l'ambition d'une haute fortune. Les desseins des dieux ne pouvaient manquer de s'accomplir. Les qualités d'un roi se développèrent chez cet enfant avec la jeunesse, 37 et lorsque Tarquin chercha un gendre, personne, parmi les jeunes Romains, ne méritant d'être comparé à Tullius, c'est à lui qu'il donna sa fille. (5) Cet honneur insigne, quelle qu'en fût la cause, ne permet pas de croire que Servius Tullius fût né d'une esclave, et qu'il l'eût été lui-même dans son enfance. J'accepte plus volontiers l'opinion suivante. On prétend qu'à la prise de Corniculum, Servius Tullius, chef de cet état, périt, laissant sa veuve enceinte; que, reconnue parmi les autres captives, cette femme, par la seule considération de sa naissance, obtint de la reine d'être rendue à la liberté, et fut logée à Rome, dans le palais de Tarquin l'Ancien; que là elle accoucha de Servius, (6) et que sa reconnaissance pour une hospitalité généreuse établit entre les deux femmes une étroite intimité; que l'enfant, né et élevé dans le palais, y fut l'objet de la tendresse et des égards respectueux de tous, et qu'enfin le sort de sa mère, tombée au pouvoir de l'ennemi après la conquête de sa patrie, avait fait croire qu'il était fils d'une esclave. XL. (1) Tarquin avait presque atteint la trente-huitième année de son règne, et Servius Tullius jouissait de la plus haute considération, non seulement auprès du roi, mais aussi parmi les sénateurs et le peuple. (2) Les deux fils d'Ancus, toujours indignés de la perfidie de leur tuteur, qui les avait chassés du trône paternel, et de la domination d'un roi qui, loin d'être citoyen de Rome, n'était pas même d'origine italienne, sentirent plus vivement cet affront lorsqu'ils prévirent que le sceptre, non seulement leur échapperait encore après Tarquin, mais tomberait, déshonoré, aux mains d'un esclave; (3) qu'ainsi cette ville, où un siècle auparavant Romulus, fils d'un dieu, et dieu lui-même, avait régné tout le temps de son séjour sur la terre, allait obéir, après lui, au fils d'une esclave, destiné lui-même à l'esclavage. Ils considéraient la honte du nom romain, celle de leur propre maison, surtout si, du vivant des fils d'Ancus, on laissait le trône à des étrangers, à des esclaves. (4) Le fer seul pouvait empêcher cette injure. Mais leur ressentiment les animait plus contre Tarquin que contre Servius. Le roi, s'il survivait à son gendre, tirerait de cet assassinat une vengeance plus terrible que ne ferait un simple particulier, outre qu'après la mort de Servius il ne manquerait pas d'assurer la possession du trône au nouveau gendre qu'il lui plairait de choisir. (5) C'est donc contre le roi lui-même qu'ils méditent de diriger leurs coups. Ils choisissent, pour l'exécution du complot, deux pâtres déterminés. Ces hommes, munis de leur équipement de pâtre, pénètrent dans le vestibule du palais, et y engagent, avec le plus de bruit possible, une querelle simulée qui attire sur eux toute l'attention des gardes. Comme ils imploraient tous deux la justice du prince, et que leur voix, retentissant dans le palais, arrivait jusqu'aux oreilles de Tarquin, celui-ci les fait venir en sa présence. (6) D'abord ils parlent tous deux à la fois, sans que l'un veuille donner à l'autre le temps de s'expliquer. Mais le licteur, leur imposant silence, leur ordonne de parler chacun à son tour. Ils cessent alors de s'interrompre, et l'un d'eux commence à exposer le fait, de la façon convenue. (7) Pendant que le roi, tourné vers cet homme, est tout en- 38 tier à son récit, l'assassin lève sa hache, lui en décharge un coup sur la tête, et, laissant le fer dans la blessure, s'échappe avec son complice. XLI. (1) Tarquin tombe mourant dans les bras de ceux qui l'entourent; mais les meurtriers, qui fuient, sont arrêtés par les licteurs. Des cris s'élèvent; le peuple accourt et demande avec étonnement ce qui se passe. Au milieu du tumulte, Tanaquil donne l'ordre de fermer les portes du palais, et écarte les témoins. En même temps elle prescrit les secours que réclame la blessure de son mari, comme si elle espérait encore le sauver, et elle se ménage d'autres ressources si cet espoir vient à lui manquer. (2) Faisant appeler Servius, et lui montrant Tarquin près d'expirer, elle le conjure, en lui prenant la main, de venger la mort de son beau-père, et ne pas souffrir que sa belle-mère devienne le jouet de ses ennemis. (3) « Si tu es un homme, ajoute-t-elle, le trône est à toi, Servius, et non pas à ceux qui ont recouru à des mains étrangères pour consommer le plus affreux de tous les crimes. Lève-toi, obéis aux dieux qui t'ont destiné à la puissance royale, toi, dont ils annoncèrent la haute fortune par la flamme céleste qui brilla jadis autour de ta tête. Que cette flamme t'échauffe aujourd'hui; qu'aujourd'hui ton réveil commence. Et nous aussi, quoique étrangers, n'avons-nous pas régné? Songe qui tu es, et non d'où tu sors. Si l'imprévu empêche ta résolution, du moins laisse-moi te conduire. » (4) Cependant la multitude redouble ses cris; son empressement devient irrésistible. Alors, d'une fenêtre élevée qui dominait la rue Neuve (car le roi habitait près du temple de Jupiter Stator), Tanaquil harangue le peuple, (5) et l'exhorte à se rassurer. « La soudaineté du coup a étourdi le roi, dit-elle, mais la plaie n'est pas profonde; il a déjà repris ses sens; sa blessure a été examinée, le sang étanché, et le prince est hors de danger. Elle se flatte que dans peu ils le verront lui-même. En attendant, il leur ordonne d'obéir à Servius Tullius. C'est Tullius qui rendra la justice, et remplira les autres fonctions royales. » (6) Servius sort revêtu de la trabée, et, précédé des licteurs, s'assied sur le trône, prononce sur quelques affaires, et feint de vouloir, sur d'autres, consulter le roi. Ainsi, Tarquin, depuis quelques jours, avait cessé de vivre, et Servius, cachant cette mort, affermissait sa puissance, sous prétexte d'exercer celle d'un autre. Enfin, la vérité est déclarée, et, au milieu des lamentations qui retentissent dans le palais, Servius, entouré d'une garde sûre, s'empare de la royauté. Ce fut le premier exemple d'un roi nommé par le sénat seul et sans la participation du peuple. (7) Les fils d'Ancus, sur la nouvelle que les assassins avaient été pris, que le roi vivait, et que l'autorité de Servius était plus solide que jamais, s'étaient exilés volontairement à Suessa Pométia. LXII. (1) Servius, après avoir mis sa puissance à l'abri de toute opposition de la part du peuple, voulut aussi la préserver des accidents domestiques; et, afin de n'être pas traité par les enfants du feu roi comme celui-ci l'avait été par les fils d'Ancus, il fait épouser ses deux filles aux deux jeunes Tarquins, Lucius et Arruns. (2) Mais la prudence de l'homme fut déjouée par l'inflexible loi du destin, et la soif de régner fit naître de toutes parts, au sein de la maison royale, des ennemis 39 et des traîtres. Heureusement pour la tranquillité présente de Servius, la trêve avec les Véiens et les autres peuples de l'Étrurie était expirée, et la guerre recommença. (3) Dans cette guerre, le bonheur de Servius éclata comme son courage. Il tailla les ennemis en pièces, malgré leur nombre, et revint à Rome, roi désormais reconnu, soit qu'il en appelât aux sénateurs, soit qu'il en appelât au peuple. (4) Ce fut alors que, dans le loisir de la paix, il entreprit une oeuvre immense; et si Numa fut le fondateur des institutions religieuses, la postérité attribue à Servius la gloire d'avoir introduit dans l'état l'ordre qui distingue les rangs, les fortunes et les dignités, en établissant le cens, la plus salutaire des institutions, pour un peuple destiné à tant de grandeur. (5) Ce règlement imposait à chacun l'obligation de subvenir aux besoins de l'état, soit en paix, soit en guerre, non par des taxes individuelles et communes comme auparavant, mais dans la proportion de son revenu. Servius forma ensuite les diverses classes des citoyens et les centuries, ainsi que cet ordre, fondé sur le cens lui-même, aussi admirable pendant la paix que pendant la guerre. XLIII. (1) La première classe était composée de ceux qui possédaient un cens de cent mille as et au-delà; elle était partagée en quatre-vingts centuries, quarante de jeunes gens et quarante d'hommes plus mûrs. (2) Ceux-ci étaient chargés de garder la ville, ceux-là de faire la guerre au dehors. On leur donna pour armes défensives, le casque, le bouclier, les jambières et la cuirasse, le tout en bronze; et pour armes offensives, la lance et l'épée. (3) À cette première classe, Servius adjoignit deux centuries d'ouvriers, qui servaient sans porter d'armes, et devaient préparer les machines de guerre. (4) La seconde classe comprenait ceux dont le cens était au-dessous de cent mille as, jusqu'à soixante-quinze mille, et se composait de vingt centuries de citoyens, jeunes et vieux. Leurs armes étaient les mêmes que celles de la première classe, si ce n'est que le bouclier était plus long et qu'ils n'avaient pas de cuirasse. (5) Le cens exigé pour la troisième classe était de cinquante mille as : le nombre des centuries, la division des âges, l'équipement de guerre, sauf les jambières, que Servius supprima, tout était le même que pour la seconde classe. (6) Le cens de la quatrième classe était de vingt-cinq mille as, et le nombre des centuries égal à celui de la précédente; mais les armes différaient. La quatrième classe n'avait que la lance et le dard. (7) La cinquième classe, plus nombreuse, se composait de trente centuries : elle était armée de frondes et de pierres, et comprenait aussi les cors et les trompettes, répartis en deux centuries. Le cens de cette classe était de onze mille as. (8) Le reste du menu peuple, dont le cens n'allait pas jusque-là, fut réuni en une seule centurie, exempte du service militaire. Après avoir ainsi composé et équipé son infanterie, il leva, parmi les premiers de la ville, douze centuries de cavaliers; (9) et des trois que Romulus avait organisées, il en forma six, en leur laissant les noms qu'elles avaient reçus au moment de leur institution. Le trésor public fournit dix mille as pour achat de chevaux, dont l'entretien fut assuré par une taxe annuelle de deux mille as, payée par les veuves. Ainsi retombaient sur le riche toutes les charges, dont le 40 pauvre était soulagé (10) mais le riche trouva des dédommagements dans les privilèges honorifiques que lui conféra Tullius; car si, jusque-là, suivant l'exemple de Romulus et la tradition des rois ses successeurs, les suffrages avaient été recueillis par tête, sans distinction de valeur ni d'autorité, de quelque citoyen qu'ils vinssent, un nouveau système de gradation dans la manière d'aller aux voix concentra toute la puissance aux mains des premières classes, sans paraître toutefois exclure qui que ce fût du droit de suffrage. (11) On appelait d'abord les chevaliers, puis les quatre-vingts centuries de la première classe. S'ils ne s'accordaient pas, ce qui arrivait rarement, ou prenait les voix de la seconde classe; mais on ne fut presque jamais obligé de descendre jusqu'à la dernière. (12) Il ne faut pas s'étonner que le nombre des centuries, porté maintenant à trente-cinq, et par conséquent doublé, et celui des centuries de jeunes gens et de vieillards, ne se rencontrent plus avec le nombre anciennement fixé par Tullius; (13) car il avait divisé la ville en quatre quartiers, formés des quatre collines alors habitées, et c'est lui qui donna à ces quartiers le nom de tribus, à cause, j'imagine, d'un tribut qu'il leur imposa et dont il proportionna la quotité aux moyens de chaque particulier. Ces tribus n'avaient rien de commun avec la division et le nombre des centuries. XLIV. (1) Lorsqu'à l'aide de la loi, qui menaçait de prison et de mort ceux qui négligeraient de se faire inscrire, Tullius eut accéléré le dénombrement, il ordonna, par un édit, à tous les citoyens, cavaliers et hommes de pied, de se rendre au Champ de Mars, dès la pointe du jour, chacun dans sa centurie. (2) Là, il rangea les troupes en bataille, et les purifia en immolant à Mars un 'suouetaurile'. Ce sacrifice, qui marquait la fin du recensement, s'appelait la clôture du lustre. On dit que le nombre des citoyens inscrits alors fut de quatre-vingt mille. Fabius Pictor, le plus ancien des historiens romains, ajoute que ce nombre ne comprenait que les hommes en état de porter les armes. (3) Cet accroissement de population obligea Tullius à donner aussi plus d'étendue à la ville. Il y enferma d'abord les monts Quirinal et Viminal, et après eux les Esquilies; puis il fixa lui-même sa demeure dans ce quartier, afin d'en relever l'importance. Il entoura la ville de boulevards, de fossés et d'un mur, et en conséquence porta plus loin le pomerium. (4) Ce mot, à n'en regarder que l'étymologie, désigne la partie située au-delà des murs : c'est plutôt un espace libre que les Étrusques laissaient autrefois en deçà des murs, lorsqu'ils bâtissaient une ville; consacrant toujours par une inauguration solennelle toute la partie du terrain qu'ils avaient marquée, et autour de laquelle devait s'étendre leur muraille. Ainsi, au dedans, les maisons ne pouvaient être contiguës aux remparts, ce qui ne s'observe généralement plus aujourd'hui, et au dehors, restait une portion du sol interdite aux profanes envahissements des hommes. (5) Il n'était permis ni de bâtir sur ce terrain, ni d'y labourer. Les Romains l'appelèrent pomerium autant parce qu'il était en deçà du mur, que parce que le mur était au-delà. Cet espace consacré reculait à mesure que la ville s'agrandissait et que les remparts recevaient un développement. 41 XLV.(1) Servius, après avoir augmenté la force matérielle de Rome et sa grandeur morale, après avoir formé tous les citoyens aux exercices de la guerre et aux travaux utiles de la paix, résolut, pour ne pas devoir l'accroissement de sa puissance au succès seul de ses armes, de l'étendre encore par la politique, tout en continuant à embellir la ville. (2) Déjà, dès cette époque, le temple de Diane, à Éphèse, avait une grande célébrité. On disait qu'il était l'oeuvre de la piété commune de toutes les cités de l'Asie. Servius, à force de vanter aux principaux chefs latins, avec lesquels il avait contracté à dessein des liaisons d'amitié et d'hospitalité publiques et particulières, cet accord parfait dans le culte des mêmes dieux et de la même religion, finit par les engager à se joindre aux Romains, pour construire à Rome un temple de Diane, commun aux deux peuples. (3) C'était proclamer la suprématie de Rome, cette prétention qui avait causé tant de guerres. Les Latins, après tant d'inutiles efforts pour conquérir cette suprématie, semblaient y avoir renoncé, lorsqu'un Sabin crut avoir trouvé l'occasion de la revendiquer et de la rendre à sa patrie. (4) Une génisse, d'une beauté extraordinaire, était née, dit-on, chez cet homme : ses cornes, suspendues pendant plusieurs siècles dans le vestibule du temple de Diane attestèrent l'existence de cette merveille. (5) On la regarda comme un prodige, et avec raison, et les devins annoncèrent que celui qui immolerait cette victime à Diane assurerait l'empire à sa nation. Cette prédiction était venue à la connaissance du ministre du temple de la déesse. (6) Lorsque le Sabin jugea que le jour convenable pour le sacrifice était arrivé, il vint à Rome présenter sa génisse au temple. Le prêtre romain, frappé de la grandeur extraordinaire de cette victime, que la renommée avait déjà rendue célèbre, et se rappelant la prédiction, interpelle ainsi le Sabin : « Étranger, que vas-tu faire ? Offrir à Diane, sans avoir d'abord pris soin de te purifier, un sacrifice impie ? Que ne vas-tu auparavant te tremper dans les eaux du fleuve ? Le Tibre coule au fond de la vallée » (7) À ces paroles, des scrupules s'éveillent dans l'âme de l'étranger. Voulant d'ailleurs que tout fût accompli selon les rites, afin que l'événement répondît au prodige, il quitte le temple et descend vers le Tibre. Pendant ce temps, le prêtre immole la génisse : cette supercherie remplit d'allégresse le roi, et la ville entière. XLVI. (1) Un si long exercice de la royauté pouvait faire croire à Servius qu'elle lui était irrévocablement acquise; mais, apprenant que le jeune Tarquin contestait quelquefois son élection, comme ayant eu lieu sans le concours du peuple, il s'attacha d'abord à gagner la faveur de la multitude, en lui partageant des terres prises sur l'ennemi. Bientôt après il osa lui demander si sa volonté et l'ordre des Romains étaient qu'il régnât sur eux. Il ne lui manqua aucun des suffrages qu'avaient eus ses prédécesseurs. (2) Tarquin n'en perdit pas pour cela l'espérance de remonter sur le trône de son père; et, comme il s'était aperçu des dispositions hostiles du sénat contre le partage des terres, il crut le moment favorable pour se plaindre à cette compagnie, et pour y établir son crédit, en ruinant, par ses attaques, celui du roi. Son âme était dévorée d'ambition; et Tullia, sa femme, irritait en- 42 core ses turbulentes inquiétudes. (3) Le palais des rois de Rome devint alors le théâtre de tragiques horreurs, comme si l'on eût voulu hâter par le dégoût de la monarchie l'arrivée de la liberté, et que celui-là fût le dernier règne qui devait s'ouvrir par un crime. (4) Ce Lucius Tarquin, fils ou petit-fils de Tarquin l'Ancien (ce qui n'est pas suffisamment établi; mais, sur la foi de la plupart des auteurs, je le suppose fils de ce dernier), avait un frère, Arruns Tarquin, jeune homme d'un caractère doux et inoffensif. (5) Les deux Tulliae, aussi remarquables que les Tarquins eux-mêmes par une grande différence de moeurs, avaient, comme je l'ai dit plus haut, épousé ces deux princes. Mais le hasard, et aussi, je pense, la fortune de Rome, voulurent que le mariage ne réunit pas dans la même destinée les deux naturels violents. Ce fut, sans doute, afin de prolonger le règne de Servius et de donner aux moeurs romaines tout le temps de se former. (6) L'altière Tullia s'indignait de ne trouver dans son époux ni ambition ni courage. Toute sa sollicitude était tournée sur l'autre Tarquin, tout son enthousiasme était pour lui; lui seul était un homme, le vrai sang des rois. Elle méprisait sa soeur, qui était l'épouse de cet homme et qui en empêchait les généreuses pensées par la timidité de ses conseils. (7) Cette conformité de goûts ne tarda pas à rapprocher le beau-frère et la belle-soeur, car le mal appelle toujours le mal. Mais ici ce fut la femme qui provoqua le désordre. Dans les entretiens secrets qu'elle s'était ménagés, de longue main, avec l'homme qui n'était point son époux, elle n'épargne aucune invective, ni à son mari, ni à sa soeur : ajoutant qu'il vaudrait mieux pour elle d'être veuve, et pour lui, de vivre dans le célibat, que d'être unis l'un et l'autre à des êtres si indignes d'eux, et de languir honteusement sous l'influence de la lâcheté d'autrui. (8) Si, disait-elle, les dieux lui eussent donné l'époux qu'elle méritait, elle verrait bientôt dans ses mains le sceptre qu'elle voyait encore dans celles de son père. Elle ne tarda pas à remplir le jeune homme de son audace. (9) Enfin, la mort presque simultanée d'Arruns et de la soeur de Tullia permet à celle-ci et à son complice de contracter un nouveau mariage, que Servius n'approuva point mais qu'il n'osa empêcher. XLVII. (1) Dès ce moment la vieillesse de Tullius leur fut de jour en jour plus odieuse, et son règne plus pesant. Impatiente de passer d'un crime à un autre, Tullia nuit et jour harcèle son mari, et le presse de recueillir le fruit de leurs premiers parricides. (2) Ce qui lui avait manqué, disait-elle, ce n'était pas un époux, un esclave qui partageât en silence sa servitude; c'était un homme qui se crût digne de régner, qui se souvînt qu'il était fils de Tarquin l'Ancien, et qui aimât mieux saisir la puissance que l'attendre. (3) « Si, ajoutait-elle, tu es vraiment cet homme que j'ai cherché, que je pensais avoir trouvé, je te reconnais pour mon époux et pour mon roi; sinon, mon sort est pire qu'auparavant, puisque le crime s'y joint à la lâcheté. (4) Que tardes-tu? Il ne t'a pas fallu, comme ton père, arriver de Corinthe et de Tarquinies, pour enlever, par l'intrigue, un trône étranger. Tes dieux pénates, ceux de ta patrie, l'image de ton père, ce palais qu'il habita, ce trône où il s'assit, le nom de Tarquin, tout annonce que tu es roi, 43 tout te convie à l'être. (5) Si ton coeur est froid en présence de ces hautes destinées, pourquoi tromper Rome plus longtemps ? Pourquoi souffrir qu'on te regarde comme le fils d'un roi ? Va à Tarquinies ou à Corinthe; rentre dans l'état obscur d'où tu es sorti, digne frère d'Arruns, fils indigne de Tarquin. » (6) Ces reproches, et d'autres encore, enflamment le jeune homme. Elle-même ne pouvait se contenir à l'idée de Tanaquil, de cette étrangère qui réussit deux fois, par le seul ascendant de son courage, à faire deux rois, de son mari et de son gendre; tandis qu'elle, Tullia, issue du sang royal, serait impuissante à donner la couronne aussi bien qu'à l'ôter. (7) Dominé bientôt lui-même par l'ambition effrénée de sa femme, Tarquin commence à s'insinuer auprès des sénateurs, ceux de la dernière création surtout; il les flatte, il leur rappelle les bienfaits de son père, et en réclame le prix. Ses libéralités lui gagnent les jeunes gens; ses magnifiques promesses, ses accusations contre Servius grossissent de toutes parts le nombre de ses partisans. (8) Enfin, quand il juge le moment favorable pour exécuter son projet, il se fait suivre d'une troupe de gens armés, et s'élance tout à coup dans le Forum. Au milieu de la terreur universelle, il monte sur le siège du roi, en face du sénat, et fait sommer ensuite, par un héraut, tous les sénateurs de se rendre auprès du roi Tarquin. (9) Ils accourent aussitôt; les uns comme étant dès longtemps préparés à ce coup de main; les autres, de peur qu'on ne leur fasse un crime de leur absence, étonnés d'ailleurs de cet étrange événement, et persuadés que c'en est déjà fait de Servius. (10) Tarquin commence par attaquer avec amertume la basse extraction de Servius. « Cet esclave, dit-il, fils d'une esclave, après l'indigne assassinat de Tarquin l'Ancien, sans qu'il y eût d'interrègne, suivant l'usage, sans qu'on eût, pour son élection, assemblé les comices, et obtenu les suffrages du peuple et le consentement du sénat, a reçu, des mains d'une femme, ce sceptre comme un présent. (11) Les effets de son usurpation répondent à la bassesse de son origine. Ses prédilections pour la classe abjecte dont il est sorti, et sa haine pour tous les hommes honorables, lui ont inspiré l'idée d'arracher aux grands ce sol qu'il a partagé aux plus vils citoyens. (12) Toutes les charges de l'état, autrefois communes à tous, il les a fait peser uniquement sur les premières classes : et il n'a établi le cens qu'afin de signaler la fortune du riche à l'envie du pauvre, et de savoir où prendre, quand il le voudrait, de quoi fournir à ses largesses envers des misérables. » XLVIII. (1) Averti par un messager, dont l'émotion le fait hâter, Servius arrive, pendant ce discours, et s'écrie, du vestibule même du sénat : « Qu'est-ce cela, Tarquin ? Qui te rend si audacieux de convoquer le sénat, moi vivant, et de t'asseoir sur mon trône ? » (2) Tarquin répond avec fierté qu'il occupe la place de son père, place plus digne du fils d'un roi, d'un héritier du trône, que d'un esclave; que depuis assez longtemps Servius insulte à ses maîtres, et se passe insolemment de leur concours. À ces mots, les partisans des deux rivaux poussent des cris confus; le peuple se porte en foule vers la salle d'assemblée; il est aisé de voir que celui qui régnera sera celui qui aura vaincu. (3) Tarquin, entraîné par sa position critique 44 à tout oser, plus jeune d'ailleurs et plus vigoureux que Servius, saisit ce prince par le milieu du corps, l'emporte hors du sénat, et le précipite du haut des degrés. Il rentre ensuite pour rallier les sénateurs. (4) Les appariteurs du roi, les officiers qui l'entourent, prennent la fuite. Servius lui-même, à demi mort, et suivi de ses gens épouvantés, se réfugiait vers son palais, lorsque des assassins, envoyés à sa poursuite par Tarquin, l'atteignent et le tuent. (5) On croit que ce crime (ceux qu'elle avait déjà commis rendent le fait assez vraisemblable) fut le résultat des conseils de Tullia. Ce qui n'est pas douteux, c'est que, montée sur son char, elle pénétra jusqu'au milieu du Forum, et là, sans se déconcerter à l'aspect de tant d'hommes rassemblés, elle appela hors du sénat son mari, et la première le salua du nom de roi; (6) mais, sur l'ordre que lui donna Tarquin de s'éloigner de toutes ces scènes de tumulte, elle reprit le chemin de sa maison. Arrivée en haut du faubourg Ciprius, à l'endroit où s'élevait jadis un petit temple de Diane, le conducteur de son char, tournant par la côte Virbia, pour gagner le quartier des Esquilies, arrêta les chevaux, et, tout pâle d'horreur, lui montra le cadavre de son père étendu sur le sol : (7) on dit qu'alors elle commit un acte infâme, et d'une affreuse barbarie. Le nom de la rue, qui depuis s'est appelée 'la rue du crime', a perpétué jusqu'à nous cet horrible souvenir. Cette femme égarée, en proie à toutes les furies vengeresses qui la poursuivaient depuis le meurtre de sa soeur et de son mari, fit passer, dit-on, les roues de son char sur le corps de son père. Puis, toute couverte et toute dégouttante du sang paternel, elle poussa ses roues souillées jusqu'aux pieds des dieux pénates, qui lui étaient communs avec son mari. Mais la colère de ces dieux préparait à ce règne infâme une catastrophe digne de son commencement. (8) Servius Tullius régna quarante-quatre ans, avec une telle sagesse, qu'il eût été difficile, même à un successeur bon et modéré, de balancer sa gloire. Ce qui ajoute encore à cette gloire, c'est qu'avec lui périt la monarchie légitime; (9) et cependant, cette autorité si douce, si modérée, il avait, dit-on, la pensée de l'abdiquer, parce qu'elle était dans la main d'un seul; et ce dessein généreux il l'aurait accompli, si un crime domestique ne l'eût empêché de rendre la liberté à son pays. XLIX. (1) Tarquin prit, sans hésiter, possession du trône. Il fut surnommé le Superbe, parce que, gendre du roi, il refusa la sépulture à son beau-père, disant que Romulus avait eu le même sort. (2) Il fit périr les premiers des sénateurs qu'il soupçonnait d'avoir servi le parti de Servius Tullius; et, sentant trop bien que l'exemple qu'il donnait, en s'emparant du trône par la violence, pourrait tourner contre lui-même, il s'entoura de gardes. (3) Car tout son droit était dans la force, lui qui n'avait eu ni les suffrages du peuple, ni le consentement du sénat. (4) Ne pouvant compter sur l'affection des citoyens, il lui fallait régner par la terreur. Afin d'en étendre les effets, il s'affranchit de tous conseils, et s'établit juge unique de toutes les affaires capitales. (5) Par ce moyen, il pouvait mettre à mort, exiler, priver de leurs biens non seulement ceux qui lui étaient suspects ou qui lui déplaisaient, mais encore ceux dont il ne pouvait rien 45 espérer que leurs dépouilles. (6) Cette politique farouche avait eu pour but principal de diminuer le nombre des sénateurs; Tullius résolut de n'en point nommer d'autres, afin que leur affaiblissement les rendît méprisables et qu'ils souffrissent avec plus de résignation l'ignominie de ne pouvoir rien dans le gouvernement. (7) C'est en effet le premier roi qui ait dérogé à l'usage suivi par ses prédécesseurs, de consulter le sénat sur toutes les affaires. Il gouverna sous l'inspiration de conseils occultes. Il fit la paix ou la guerre suivant son caprice, conclut des traités, fit et défit des alliances, sans s'inquiéter de la volonté du peuple. (8) Il recherchait surtout l'amitié des Latins, afin de se faire à l'étranger un appui contre ses sujets. Il s'attachait leurs principaux citoyens, non seulement par les liens de l'hospitalité, mais aussi par des alliances de famille. (9) Il donna sa fille à Octavius Mamilius de Tusculum qui tenait le premier rang parmi les Latins, et qui, si l'on en croit la renommée, tirait son origine d'Ulysse et de Circé. Cette union mit dans ses intérêts tous les parents et tous les amis de Mamilius. L. (1) Il exerçait déjà une grande influence sur les chefs des Latins, quand il leur proposa de se rendre, à un jour marqué, au bois sacré de la déesse Férentina, ajoutant qu'il voulait les entretenir de leurs intérêts communs. (2) Ils s'y réunissent en grand nombre, au point du jour. Tarquin y vient aussi, mais un peu avant le coucher du soleil. Dans cet intervalle et pendant toute la journée, différentes questions avaient jeté le trouble parmi les membres de l'assemblée. (3) Turnus Herdonius, d'Aricie, s'irritait surtout de l'absence de Tarquin : « Fallait-il s'étonner que Rome l'eût surnommé le Superbe (Car c'est ainsi qu'ils le désignaient déjà dans leurs secrets murmures) ? Quoi de plus insolent, en effet, que de se jouer ainsi de toute la nation latine ? (4) Faire venir ses chefs loin de leurs demeures, et manquer lui-même à son appel ? N'est-ce pas tenter leur patience, afin de les écraser sous le joug, s'ils se montrent disposés à le subir ? Qui ne voit sa tendance à dominer tout le Latium ? (5) Encore, si ses sujets avaient lieu de se féliciter de leur choix; si du moins il devait le trône à leur volonté, et non pas à un parricide, les Latins aussi pourraient se fier à lui, bien qu'après tout leur qualité d'étrangers ne les oblige pas à la même défiance. (6) Mais si, au contraire, les Romains gémissent de leur tolérance, s'ils sont assassinés les uns après les autres, exilés, ruinés, de quel droit les Latins espéreraient-ils un meilleur traitement ? S'ils voulaient l'en croire, ils retourneraient chacun dans ses foyers, et ne se mettraient pas en peine d'être plus exacts à l'assemblée que celui qui l'avait convoquée. » (7) Turnus était un esprit turbulent et factieux, et c'est à cela même qu'il devait son influence. Comme il parlait ainsi, Tarquin arrive et l'interrompt. (8) L'assemblée se tourne vers le roi pour le saluer, et le silence s'établit. Ceux qui sont près de Tarquin l'avertissent de se justifier de son retard à l'assemblée. Tarquin dit qu'il a été pris pour médiateur entre un père et un fils; que son désir de les réconcilier l'a retenu, et que, cette circonstance ayant fait perdre la journée, il leur exposera, le lendemain, le motif 46 pour lequel il les a convoqués. (9) Turnus, dit-on, ne goûta point cette excuse, et rompit le silence : « Il n'y a pas, dit-il, de différends plus prompts à terminer que ceux d'un père et de son fils, et la question se décide en peu de mots : Que le fils obéisse, ou qu'il soit puni. » LI. ] (1) Le citoyen d'Aricie, après avoir ainsi relevé les paroles du roi de Rome, quitte l'assemblée. Mais, plus sensible à cette injure qu'il ne le fit paraître, Tarquin jura intérieurement d'immoler Turnus, et par là d'inspirer aux Latins la terreur qui comprimait tous les esprits. (2) Mais, comme il n'avait pas le droit de le faire périr publiquement, il imagina de lui intenter une accusation calomnieuse. Par l'entremise de quelques habitants d'Aricie, il suborne un esclave de Turnus, et en obtient, à prix d'or, qu'il laissera porter secrètement, dans la maison de son maître, un grand nombre d'épées. (3) Une nuit suffit à l'exécution de ce projet. Tarquin, un peu avant le jour, mande auprès de lui les principaux des Latins, et, affectant l'émotion que cause un événement extraordinaire, il leur dit que, « grâce aux dieux, dont la providence a retardé hier son départ, ils ont été sauvés, eux et lui, d'un grand péril. (4) Il a su, en effet, que Turnus, afin de régner seul sur les Latins, avait formé le projet de l'assassiner, ainsi que les principaux citoyens du pays; projet qui avait dû s'exécuter la veille pendant l'assemblée, mais que l'absence de celui qui l'avait convoquée, et à qui Turnus en voulait le plus, l'avait fait différer. (5) De là cette colère contre un retard dont la prolongation trompait les espérances du conspirateur. Nul doute maintenant, si les rapports sont vrais, que demain, au lever du jour, Turnus ne se présente à l'assemblée, les armes à la main, avec tous ses complices. (6) On dit qu'on a porté chez lui une grande quantité d'épées. Pour vérifier ce fait, lui, Tarquin, les prie de le suivre chez Turnus. » (7) Le caractère violent de Turnus, ses paroles de la veille, le retard de Tarquin, cause probable de l'ajournement du crime, toutes ces circonstances font naître les soupçons. Les chefs latins suivent Tarquin, poussés par un sentiment de crédulité naturelle, mais bien résolus de déclarer l'accusation mensongère s'ils ne trouvaient point ces armes qu'on leur dénonçait. (8) Turnus dormait encore lorsqu'ils arrivèrent. Des gardes l'entourent; on saisit les esclaves qui se préparaient à défendre leur maître, et l'on apporte en même temps les épées de tous les coins de la maison. La conspiration semble alors avérée. Turnus est chargé de chaînes, et l'assemblée des Latins convoquée tumultueusement. (9) La vue des armes, exposées à tous les regards, excite une telle indignation que, sans donner à Turnus le temps de se défendre, on le condamne à périr d'un nouveau genre de supplice. Ou le couvre d'une claie chargée de pierres, et on le noie dans les eaux de Férentina. LII. (1) Tarquin rappelle ensuite les Latins à l'assemblée, et, après les avoir félicités du châtiment qu'ils ont infligé à ce factieux, dont les complots parricides étaient manifestes, il ajoute que : (2) « Les Latins étant originaires d'Albe, et cette ville avec toutes ses colonies ayant été soumise à l'empire 47 de Rome par un traité conclu sous le règne de Tullus, il pourrait bien faire valoir auprès d'eux un droit aussi ancien à la souveraineté sur tous les peuples Latins. (3) Mais il croit qu'il serait plus avantageux à tous de renouveler ce traité; qu'il vaut mieux pour les Latins s'associer à la fortune de Rome, que de craindre sans cesse, comme il leur était arrivé, sous le règne d'Ancus d'abord, ensuite sous celui de son père, la destruction de leurs villes et le ravage de leurs campagnes. » (4) Bien que ce traité contînt la reconnaissance explicite de la suprématie romaine, il ne fut pas difficile de persuader aux Latins d'y souscrire. Ils voyaient les plus considérables d'entre eux d'intelligence avec le roi, et la mort récente de Turnus était un avertissement pour ceux qui pouvaient être tentés de résister. (5) Le traité fut renouvelé, et la jeunesse du pays latin reçut de Tarquin l'ordre de se trouver en armes au bois de Férentina, à un jour indiqué. (6) Tous, de toutes les contrées du Latium, se rendirent à l'appel. Mais, voulant qu'ils n'eussent ni chefs distincts, ni signes secrets de ralliement, ni drapeaux particuliers, Tarquin les incorpora dans les centuries romaines. Latins et Romains, comptant chacun par moitié dans les centuries, celles-ci furent doublées, et reçurent pour chefs des centurions romains. LIII. (1) Si Tarquin méconnut les lois de la justice pendant la paix, il fut loin, cependant, d'ignorer l'art de la guerre. Il eût même égalé sous ce rapport les rois ses prédécesseurs, si la gloire du général n'eût été ternie par les vices du roi. (2) Il commença contre les Volsques cette guerre qui dura plus de deux cents ans. Il prit d'assaut leur ville, Suessa Pométia; (3) il en vendit le butin, et tira de cette vente quarante talents d'or et d'argent. Ce fut alors qu'il conçut l'idée d'élever à Jupiter ce vaste temple, digne du roi des dieux et des hommes, digne de l'empire romain, digne enfin de la majesté du lieu où furent assis ses fondements. L'argent pris sur l'ennemi fut mis en réserve pour la construction de cet édifice. (4) Tarquin entreprit ensuite contre Gabies, ville voisine de Rome, une guerre dont l'issue ne fut ni aussi heureuse, ni aussi prompte qu'il l'avait espéré. Repoussé après un assaut inutile, obligé même de renoncer, par suite de cet échec, à un siège régulier, il résolut, ressource peu digne d'un Romain, d'employer la ruse et la perfidie. (5) Tandis que, paraissant ne plus songer à la guerre, il feignait d'être uniquement occupé de la construction du temple de Jupiter, et d'autres ouvrages commencés dans la ville, Sextus, le plus jeune de ses trois fils, d'accord avec lui, s'enfuit chez les Gabiens, se plaignant à eux de la cruauté intolérable de son père. (6) Il dit « que Tarquin, non content d'exercer sa tyrannie sur les autres, la fait peser sur sa propre famille. Il redoute le nombre de ses enfants, et comme il a dépeuplé le sénat, il veut aussi dépeupler sa maison, et ne laisser d'héritiers ni de son nom ni de sa couronne. (7) Quant à lui, Sextus, échappé au glaive de son père, il n'a cru trouver nulle part un asile plus sûr que chez les ennemis de Lucius Tarquin. Car, il faut bien qu'ils le sachent, la guerre, qui paraît abandonnée, est toujours menaçante; elle recommencera dans l'occasion, et fondra sur eux 48 à l'improviste. (8) S'ils repoussent ses prières, il parcourra tout le Latium; il ira chez les Volsques, chez les Èques et chez les Herniques, jusqu'à ce qu'il trouve un peuple assez généreux pour défendre les fils contre la persécution et la cruauté impie de leur père. (9) Peut-être en rencontrera-t-il un à qui une juste indignation fera prendre les armes contre le plus orgueilleux de tous les rois, et le plus ambitieux de tous les peuples. » (10) Les Gabiens craignant, s'ils ne cherchent à le retenir, qu'il ne quitte leur ville irrité contre eux, l'accueillent avec bonté. Ils lui disent : « Qu'il ne doit point s'étonner lui-même que Tarquin traite ses propres enfants comme il a traité ses concitoyens, ses alliés; (11) qu'à défaut d'autres victimes, sa cruauté devait se tourner contre lui-même; qu'au reste, lui, Sextus, est le bienvenu parmi eux, et qu'ils espèrent pouvoir bientôt, aidés de son courage et de ses avis, porter la guerre des murailles de Gabies sous celles de Rome. » LIV. (1) Depuis ce jour, Sextus fut admis dans leurs conseils. Là, il adoptait hautement, sur toutes les affaires civiles, l'opinion des anciens Gabiens auxquels elles étaient plus familières. Mais il n'en était pas ainsi pour la guerre, qu'il demandait de temps en temps, disant que sur ce point ses avis étaient d'autant meilleurs qu'il connaissait mieux les forces des deux peuples, et combien la tyrannie de Tarquin était odieuse aux Romains, insupportable même à ses enfants. (2) Tandis qu'il poussait insensiblement les premiers de la ville à la révolte, que lui-même, avec une troupe de jeunes gens entreprenants, il allait faire des incursions, piller sur le territoire de Rome; que ses actes, que ses paroles, conformes à son plan de fausseté, augmentaient son influence fatale, il finit par obtenir le commandement général de l'armée des Gabiens. (3) Pour ne pas laisser entrevoir ses desseins, il livrait souvent de petits combats où l'avantage restait aux Gabiens. Aussi l'enthousiasme devint-il si vif que grands et petits, tous regardaient son arrivée à Gabies comme une faveur des dieux. (4) Magnifique d'ailleurs envers le soldat, auquel il abandonnait le butin, et dont il partageait les fatigues et les dangers, il gagna tellement son affection, que son père n'était pas plus puissant à Rome que lui à Gabies. (5) Quand il se croit assez fort pour tout oser, il dépêche à son père un des siens, chargé de lui demander ce qu'il doit faire, maintenant que les dieux lui ont accordé un pouvoir absolu dans la ville de Gabies. (6) Le messager, dont la fidélité, j'imagine, parut douteuse, ne reçut pas de réponse verbale; mais Tarquin, prenant un air pensif, passa dans les jardins du palais, suivi de l'émissaire de son fils. Là, dit-on, se promenant en silence, il abattait, avec une baguette, les têtes des pavots les plus élevées. (7) Fatigué de questionner et d'attendre une réponse, le messager s'en retourne à Gabies, croyant avoir échoué dans sa mission. Il rapporte ce qu'il a dit, ce qu'il a vu, et ajoute que le roi, soit par haine, soit par colère, soit enfin par un effet de cet orgueil qui lui est naturel, n'a pas prononcé une seule parole. (8) Mais Sextus, pénétrant sous cette énigme le sens de la réponse et les intentions de son père, fit périr les principaux citoyens, les uns, en les accusant devant le peuple, les autres, en profitant de la haine qu'ils avaient soulevée con- 49 tre eux. Plusieurs furent condamnés publiquement; quelques-uns, offrant moins de prise aux accusations, périrent en secret. (9) D'autres purent fuir sans obstacles; d'autres furent exilés; les biens des bannis et des morts furent partagés au peuple. (10) Ces largesses, le produit de ces spoliations, ]es séductions de l'intérêt privé, étouffèrent le sentiment des malheurs publics, jusqu'au jour où Gabies, privée de conseils et de forces, tomba enfin sans résistance au pouvoir de Tarquin. LV. (1) Maître de Gabies, Tarquin fit la paix avec les Èques, et renouvela le traité avec les Étrusques. Il donna ensuite toute son attention aux ouvrages intérieurs de Rome. Le plus important était le temple de Jupiter, qu'il bâtissait sur le mont Tarpéien, et qu'il voulait laisser comme un monument de son règne et du nom de Tarquin. C était en effet l'ouvrage de deux Tarquins : le père avait fait le voeu, le fils l'avait accompli. (2) Et, afin que l'emplacement du Capitole fût réservé tout entier à Jupiter, à l'exclusion de toute autre divinité, il résolut d'en faire disparaître les autels et les petits temples que Tatius y avait élevés, consacrés et inaugurés, conformément au voeu qu'il en avait fait pendant un combat contre Romulus. (3) Tandis qu'on jetait les premiers fondements de l'édifice, la volonté des dieux se révéla, dit-on, par des signes qui annonçaient la puissance future de l'empire romain. Les augures permirent qu'on enlevât tous les autels, excepté celui du dieu Terme; (4) et l'on interpréta cette exception de la manière suivante : le dieu Terme gardant sa place, et seul de tous les dieux n'ayant pas été dépossédé de son sanctuaire sur le mont Tarpéien, présageait la solidité et la durée de la puissance romaine. (5) Ce premier prodige, qui montrait la perpétuité de l'empire, fut suivi d'un autre qui en présageait la grandeur. On dit qu'en creusant les fondations du temple, on trouva une tête humaine parfaitement conservée. (6) Ce nouveau phénomène désignait clairement que là serait aussi la tête de l'empire; et l'interprétation en fut ainsi donnée par les devins de Rome et par ceux qu'on avait fait venir d'Étrurie. (7) Tous ces présages portaient de plus en plus le roi à ne pas épargner les dépenses. Les richesses de Pométia, qui devaient servir à terminer l'entreprise, suffirent à peine pour les fondations. (8) À cet égard, Fabius, historien plus ancien d'ailleurs, me semble plus digne de foi que Pison. (9) Le premier fait monter la valeur de ces richesses à quarante talents; le second prétend que Tarquin avait mis en réserve, pour la construction du temple, quarante mille livres pesant d'argent, somme exorbitante qui ne pouvait provenir du pillage d'aucune ville d'alors, et qui suffirait, et au-delà, pour construire encore aujourd'hui les monuments les plus magnifiques. LVI. (1) Tarquin, uniquement occupé du désir d'achever ce temple, fit venir des ouvriers de toutes les parties de l'Étrurie, et mit à contribution, non seulement les deniers de l'état, mais encore les bras du peuple. Ce fardeau ajouté à celui de la guerre ne semblait pourtant pas trop lourd au peuple, glorieux, au contraire, de bâtir de ses mains les temples des dieux. (2) Mais on l'employa dans la suite à d'autres ouvrages, qui, 50 pour avoir moins d'éclat, n'en étaient pas moins pénibles. C'était la construction des galeries autour du cirque, et le percement d'un égout destiné à recevoir les immondices de la ville : deux ouvrages que la magnificence de nos jours est à peine parvenue à égaler. (3) Outre ces travaux, qui tenaient le peuple en haleine, Tarquin, persuadé qu'une population nombreuse est à charge à l'état quand elle est inoccupée, et voulant d'ailleurs, par des colonies nouvelles, étendre les limites de l'empire, envoya des colons à Signia et à Circéi, places qui devaient un jour protéger Rome du côté de la terre et du côté de la mer. (4) Au milieu de tous ces travaux, on vit avec terreur un nouveau prodige. Un serpent, sorti d'une colonne de bois, jeta l'épouvante parmi tous les habitants du palais, et les mit en fuite. Tarquin, d'abord moins effrayé, en conçut pourtant de graves inquiétudes pour l'avenir. (5) Les devins étrusques étaient ordinairement consultés sur les présages qui se manifestaient en public; mais ce dernier paraissant menacer sa famille, (6) Tarquin résolut de consulter l'oracle de Delphes, le plus célèbre du monde. Toutefois, ne sachant quelle serait la réponse du dieu, il n'osa confier à des étrangers le soin de l'aller recevoir, et envoya deux de ses fils en Grèce, à travers des contrées alors inconnues, et des mers plus inconnues encore. (7) Titus et Arruns partirent accompagnés du fils de Tarquinia, soeur du roi, Lucius Iunius Brutus, lequel était d'un caractère bien différent de celui qu'il affectait de montrer en public. Instruit que les premiers de l'État, que son oncle, entre autres, avaient péri victimes de la cruauté de Tarquin, ce jeune homme prit dès ce moment le parti de ne rien laisser voir dans son caractère ni dans sa fortune qui pût donner de l'ombrage au tyran, et exciter sa cupidité; en un mot, de chercher dans le mépris d'autrui une sûreté que la justice ne lui offrait pas. (8) Il contrefit l'insensé, livrant sa personne à la risée du prince, lui abandonnant tous ses biens, et acceptant même l'injurieux surnom de Brutus. C'est à la faveur de ce surnom que le libérateur de Rome attendait l'accomplissement de ses destinées. (9) Conduit à Delphes par les Tarquins, dont il était le jouet plus que le compagnon, il apporta, dit-on, au dieu, un bâton de cornouiller, creux et renfermant un bâton d'or, emblème mystérieux de son caractère. (10) Arrivés enfin, les jeunes princes, après avoir exécuté les ordres de leur père, eurent la curiosité de savoir auquel d'entre eux reviendrait le trône de Rome. On prétend qu'une voix répondit du fond du sanctuaire : « Celui-là possédera la souveraine puissance, qui le premier de vous, jeunes gens, baisera sa mère. » (11) Les Tarquins exigent le plus rigoureux silence sur cet incident, à l'égard de Sextus, leur frère, qui était resté à Rome, afin qu'ignorant la prédiction il perdît toute chance à l'empire. Quant à eux, ils abandonnent à la fortune le soin de décider lequel des deux, à leur retour, baisera sa mère. (12) Mais Brutus, donnant une autre interprétation aux paroles de la Pythie, feignit de se laisser tomber, et baisa la terre, la mère commune de tous les hommes. Lorsqu'ils revinrent à Rome, on y faisait de grands préparatifs de guerre contre les Rutules. LVII. (1) Les Rutules habitaient la ville d'Ardée. 51 C'était une nation puissante et riche, et pour le temps et pour le pays. La guerre leur fut déclarée à cause de l'épuisement des finances, résultat des travaux somptueux, entrepris par Tarquin, lequel désirait de combler le vide et de regagner en même temps, par l'appât du butin, le coeur de ses sujets. (2) Ceux-ci, en effet, irrités de son orgueil et de son despotisme, s'indignaient que le prince les enchaînât depuis si longtemps à des travaux de manoeuvres et d'esclaves. (3) D'abord on essaya de prendre Ardée d'assaut; mais cette tentative eut peu de succès. On convertit le siège en blocus, et l'ennemi fut resserré dans l'enceinte de ses murs. (4) Durant ce blocus, et comme il arrive ordinairement dans une guerre moins vive que longue, on accordait assez facilement des congés; mais aux officiers plutôt qu'aux soldats. (5) De temps en temps les jeunes princes abrégeait les ennuis de l'oisiveté par des festins et des parties de débauche. (6) Un jour qu'ils soupaient chez Sextus Tarquin, avec Tarquin Collatin, fils d'Égérius, la conversation tomba sur les femmes; et chacun d'eux de faire un éloge magnifique de la sienne. (7) La discussion s'échauffant, Collatin dit qu'il n'était pas besoin de tant de paroles, et qu'en peu d'heures on pouvait savoir combien Lucrèce, sa femme, l'emportait sur les autres. « Si nous sommes jeunes et vigoureux, ajouta-t-il, montons à cheval, et allons nous assurer nous-mêmes du mérite de nos femmes. Comme elles ne nous attendent pas, nous les jugerons par les occupations où nous les aurons surprises. » (8) Le vin fermentait dans toutes les têtes. « Partons, s'écrièrent-ils ensemble, » et ils courent à Rome à bride abattue. Ils arrivèrent à l'entrée de la nuit. De là ils vont à Collatie, (9) où ils trouvent les belles-filles du roi et leurs compagnes au milieu des délices d'un repas somptueux; et Lucrèce, au contraire, occupée, au fond du palais, à filer de la laine, et veillant, au milieu de ses femmes, bien avant dans la nuit. (10) Lucrèce eut tous les honneurs du défi. Elle reçoit avec bonté les deux Tarquins et son mari, lequel, fier de sa victoire, invite les princes à rester avec lui. Ce fut alors que S. Tarquin conçut l'odieux désir da posséder Lucrèce, fût-ce au prix d'un infâme viol. Outre la beauté de cette femme, une réputation de vertu si éprouvée piquait sa vanité. (11) Après avoir achevé la nuit dans les divertissements de leur âge, ils retournent au camp. LVIII. (1) Peu de jours après, Sextus Tarquin, à l'insu de Collatin, revient à Collatie, accompagné d'un seul homme. (2) Comme nul ne soupçonnait ses desseins, il est accueilli avec bienveillance, et on le conduit, après souper, dans son appartement. Là, brûlant de désirs, et jugeant, au silence qui l'environne, que tout dort dans le palais, il tire son épée, marche au lit de Lucrèce déjà endormie, et, appuyant une main sur le sein de cette femme : « Silence, Lucrèce, dit-il, je suis Sextus Tarquin : je tiens une épée, vous êtes morte, s'il vous échappe une parole. » (3) Tandis qu'éveillée en sursaut et muette d'épouvante, Lucrèce, sans défense, voit la mort suspendue sur sa tête, Tarquin lui déclare son amour; il la presse, il la menace et la conjure tour à tour, et n'oublie rien de ce qui peut agir sur le coeur d'une femme. (4) Mais, voyant qu'elle s'affer - 52 mit dans sa résistance, que la crainte même de la mort ne peut la fléchir, il tente de l'effrayer sur sa réputation. Il affirme qu'après l'avoir tuée, il placera près de son corps le corps nu d'un esclave égorgé, afin de faire croire qu'elle aurait été poignardée dans la consommation d'un ignoble adultère. (5) Vaincue par cette crainte, l'inflexible chasteté de Lucrèce cède à la brutalité de Tarquin, et celui-ci part ensuite, tout fier de son triomphe sur l'honneur d'une femme. Lucrèce, succombant sous le poids de son malheur, envoie un messager à Rome et à Ardée, avertir son père et son mari qu'ils se hâtent de venir chacun avec un ami sûr; qu'un affreux événement exige leur présence. (6) Spurius Lucrétius arrive avec Publius Valérius, fils de Volésus, et Collatin avec Lucius Iunius Brutus. Ces deux derniers retournaient à Rome de compagnie lorsqu'ils furent rencontrés par le messager de Lucrèce. (7) Ils la trouvent assise dans son appartement, plongée dans une morne douleur. À l'aspect des siens, elle pleure; et son mari, lui demandant si tout va bien : « Non, répond-elle; car, quel bien reste-t-il à une femme qui a perdu l'honneur ? Collatin, les traces d'un étranger sont encore dans ton lit. Cependant le corps seul a été souillé; le coeur est toujours pur, et ma mort le prouvera. Mais vous, jurez-moi que l'adultère ne sera pas impuni. (8) C'est Sextus Tarquin, c'est lui qui, cachant un ennemi sous les dehors d'un hôte, est venu la nuit dernière ravir, les armes à la main, un plaisir qui doit lui coûter aussi cher qu'à moi-même, si vous êtes des hommes. » (9) Tous, à tour de rôle, lui donnent leur parole, et tâchent d'adoucir son désespoir, en rejetant toute la faute sur l'auteur de la violence; ils lui disent que le corps n'est pas coupable quand le coeur est innocent, et qu'il n'y a pas de faute là ou il n'y a pas d'intention. (10) -- C'est à vous, reprend-elle, à décider du sort de Sextus. Pour moi, si je m'absous du crime, je ne m'exempte pas de la peine. Désormais que nulle femme, survivant à sa honte, n'ose invoquer l'exemple de Lucrèce ! » (11) À ces mots, elle s'enfonce dans le coeur un couteau qu'elle tenait sous sa robe, et, tombant sur le coup, elle expire. Son père et son mari poussent des cris. LIX. (1) Tandis qu'ils s'abandonnent à la douleur, Brutus retire de la blessure le fer tout dégoûtant de sang et, le tenant levé : « Je jure, dit-il, et vous prends à témoin, ô dieux ! par ce sang, si pur avant l'outrage qu'il a reçu de l'odieux fils des rois; je jure de poursuivre par le fer et par le feu, par tous les moyens qui seront en mon pouvoir, l'orgueilleux Tarquin, sa femme criminelle et toute sa race, et de ne plus souffrir de rois à Rome, ni eux, ni aucun autre. » (2) Il passe ensuite le fer à Collatin, puis à Lucrétius et à Valérius, étonnés de ce prodigieux changement chez un homme qu'ils regardaient comme un insensé. Ils répètent le serment qu'il leur a prescrit, et, passant tout à coup de la douleur à tous les sentiments de la vengeance, ils suivent Brutus, qui déjà les appelait à la destruction de la royauté. (3) Ils transportent sur la place publique le corps de Lucrèce, et ce spectacle extraordinaire excite, comme ils s'y attendaient, une horreur universelle. Le peuple maudit l'exécrable violence de Sextus; (4) il est ému par la douleur du père, par Brutus, lequel, condamnant ces larmes et ces plaintes inutiles, pro- 53 pose le seul avis digne d'être entendu par des hommes, par des Romains, celui de prendre les armes contre des princes qui les traitent en ennemis. (5) Les plus braves se présentent spontanément tout armés; le reste suit bientôt leur exemple. On en laisse la moitié à Collatie pour la défense de la ville, et pour empêcher que la nouvelle de ce mouvement ne parvienne aux oreilles du roi; l'autre moitié marche vers Rome sur les pas de Brutus. (6) À leur arrivée, et partout où cette multitude en armes s'avance, on s'effraie, on s'agite; mais, lorsqu'on les voit guidés par les premiers citoyens de l'état, on se rassure sur leurs projets, quels qu'ils soient. (7) L'atrocité du crime ne produisit pas moins d'effet à Rome qu'à Collatie. De toutes les parties de la ville, on accourt au Forum, et la voix du héraut rassemble le peuple autour du tribun des Célères. Brutus était alors revêtu de cette dignité. (8) Il harangue le peuple, et sa parole est loin de se ressentir de cette simplicité d'esprit qu'il avait affectée jusqu'à ce jour. Il raconte la passion brutale de Sextus Tarquin, et la violence infâme qu'il a exercée sur Lucrèce, la mort déplorable de cette femme, et la douleur de Tricipitinus, qui perdait sa fille, et s'affligeait de cette perte moins encore que de l'indigne cause qui l'avait provoquée. (9) Il peint le despotisme orgueilleux de Tarquin, les travaux et les misères du peuple, de ce peuple plongé dans des fosses, dans des cloaques immondes qu'il lui faut épuiser; il montre ces Romains, vainqueurs de toutes les nations voisines, transformés en ouvriers et en maçons. (10) Il rappelle les horreurs de l'assassinat de Servius, et cette fille impie faisant passer son char sur le corps de son père; puis il invoque les dieux vengeurs des parricides. (11) De pareils forfaits et d'autres plus atroces sans doute, qu'il n'est pas facile à l'historien de retracer avec la même force que ceux qui en ont été témoins, enflamment la multitude. Entraînée par l'orateur, elle prononce la déchéance du roi, et condamne à l'exil Lucius Tarquin, sa femme et ses enfants. (12) Brutus lui-même, ayant enrôlé et armé tous les jeunes gens qui s'empressaient de donner leurs noms, marche au camp devant Ardée, afin de soulever l'armée contre Tarquin. Il laisse le gouvernement de Rome à Lucrétius, que le roi lui-même avait nommé préfet de la ville quelque temps auparavant. (13) Au milieu du tumulte général, Tullia s'enfuit de son palais, recueillant partout sur son passage les exécrations de la foule, et entendant vouer sa tête aux furies vengeresses des parricides. LX. (1) Lorsque la nouvelle en arrive dans le camp, le roi, surpris et effrayé, accourt à Rome en toute hâte, pour y étouffer la révolution naissante. Brutus est informé de son approche, et, pour ne pas le rencontrer, il se détourne de sa roule. Ils arrivèrent tous deux presque en même temps par des chemins opposés, Brutus au camp, et Tarquin à Rome. (2) Tarquin trouva les portes fermées, et on lui signifia son exil. L'armée, au contraire, reçut avec enthousiasme le libérateur de Rome, et chassa de ses rangs les enfants du roi. Deux d'entre eux suivirent leur père en exil à Caeré chez les Étrusques. Sextus Tarquin, qui s'était retiré à Gabies comme dans ses propres états, y périt assassiné par ceux 54 dont ses meurtres et ses rapines avaient autrefois soulevé les haines. (3) Le règne de Tarquin le Superbe fut de vingt-cinq ans; et celui de tous les rois, depuis la fondation de Rome jusqu'à son affranchissement, de deux cent quarante-quatre. (4) Les comices alors assemblés par centuries, et convoqués par le préfet de Rome, suivant le plan de Servius, nommèrent deux consuls, Lucius Iunius Brutus et Lucius Tarquin Collatin. TITRE. - Les meilleures éditions de Tite-Live portent peur titre : TITI LIVII PATAVINI HISTORIARUM AB URBE CONDITA. « Il ne faut pas prendre de la ville de Rome dans les commencements l'idée que nous donnent les villes que nous voyons aujourd'hui, à moins que ce ne soient celles de la Crimée, faites pour renfermer le butin, les bestiaux et les fruits de la campagne. Les noms anciens des principaux lieux de Rome out tous du rapport a cet usage. » La ville n'avait pas même de rues, si l'on appelle de ce nom la continuation des chemins qui y aboutissaient. Les maisons étaient placées sans ordre et très petites; car les hommes, toujours au travail ou dans la place publique, ne se tenaient guère dans les maisons. » Mais la grandeur de Rome parut bientôt dans ses édifices publics. Les ouvrages qui ont donné et qui donnent encore aujourd'hui la plus haute idée de sa puissance ont été faits sous les rois. On commençait a bâtir la ville éternelle. » MONTESQUIEU, Grandeur et décadence des Romains, chap. I. On le volt, Montesquieu croit à l'histoire primitive de Rome, au moins dans son ensemble. Ce puissant génie, qui ne pouvait ignorer les attaques dirigées depuis deux siècles contre l'authenticité de ces antiques traditions, n'a pas cru devoir s associer aux doutes d'un scepticisme qui détruit tout sans rien reconstruire. Niebuhr et d'autres après lui n'ont pas craint de jeter le vieux roman par terre. Ils ont refait l'histoire de Rome; mais à chaque édition nouveau système. Auquel faudra-t-il s'en tenir? Saris doute l'histoire traditionnelle de Rome n »est pas à l'abri de la critique: toutes ses sources n'ont pas la même valeur; on y remarque des contradictions, des faits inexacts, des dates incertaines ; comme dans toutes les histoires primitives, sans en excepter la nôtre, le merveilleux y joue son rôle oblige; mais sur ces données est-on en droit de dire qu'elle n'est autre chose qu'un roman? Nous ne pouvons ici entrer dans les détails ; contentons-nous de répondre à l'argument qui a obtenu le plus de faveur. « Au temps des rois, l'écriture n'existait pas encore à Rome : comment a-t-on pu conserver le souvenir des événements? » Sur quelle autorité s'appuient les critiques pour déclarer que l'écriture était inconnue dans les premiers siècles de Rome? Sur deux passages surtout, l'un de Tacite et l'autre de Tite-Live, que nous croyons devoir reproduire ici : « In Italia Etrusci ab Corinthio Demarato, Aborigenes ab Evandro lifteras) didicerunt, et forma litteris latinis quae veterrimis Graecorum. » Tac., Ann., XI, 14. « Quae ab condita urbe Roma ad captam eamdm urbem Romani sub regibus primum, consulibus deinde ac dictatoribus, decemvirisque ac tribunis consularibus gessere, foris belli, domi seditiones, quinque libris exposui; res quum vetustate nimia obscuras, velut quae magno ex intervallo loci vix cernuntur, tum quod parvae et rarae per eadem tempora littera fuere, una custodia fidelis memorate rerum gestarum, et quod etiam, si quae in commentariis pontiificum, alisque publicis privatisque erant monumentis, incensa urbe pleraque interiere. » Tite-Live, VI, 1. Suivant les critiques, il résulterait de ces deux passages que dans les temps les plus anciens de Rome l'écriture était inconnue, puisque les Étrusques eux-mêmes, qui étaient le peuple le plus civilisé de l'Italie, reçurent l'alphabet de Démarate de Corinthe, père de Tarquin-l'Ancien, c'est-à-dire 658 ans environ avant J .-C. D'un autre côte, le passage de Tite-Live prouverait que cet historien se défiait beaucoup des monuments anciens, et que l'incendie de Rome par les Gaulois avait fait disparaître presque toutes les sources historiques. Mais les deux textes que nous venons de citer sont-ils bien concluants? ne sont-ils pas contraires aux faits les plus positifs de l'antiquité? Et d'abord, à Tacite et à Tite-Live on peut opposer Tacite et Tite-Live eux-mêmes. En effet, le premier, tout en disant que l'alphabet a été apporté aux Étrusques par Démarate, affirme que les lettres avaient été données aux Aborigènes, ou, en d'autres termes, aux Latins, par Evandre lui-même, c'est-à-dire quelques siècles avant l'époque assignée à Romulus. Or, on peut se demander comment il s'est fait que les Étrusques aient été regardés comme le peuple le plus anciennement civilisé de l'Italie, s'ils ignoraient l'usage de l'écriture, alors que depuis plusieurs siècles les Latins, leurs voisins, jouissaient de ce bienfait? Et qu'on se garde bien de croire que cette tradition sur l'antiquité de l'écriture dans le voisinage de Rome est 760 une fable qu'on doit entièrement rejeter. Un vase, découvert il y a deux ou trois ans dans des fouilles pratiquées sur l'ancien emplacement de la ville pélasgique d'Agylla, porte gravé sur la base un alphabet grec, et sur la pause un syllabaire en lettres de la forme la plus archaïque, dont quelques-unes même, comme le FAU et le KOPPA, appartiennent au plus antique alphabet des Grecs, à celui qu'ils avaient reçu immédiatement de la Phénicie. On y rencontre même des formes qui n'existent sur aucun monument connu, et qui ressemblent d'une manière frappante aux lettres primitives de l'alphabet phénicien. ( Voyez les Annales de l'institut archéologique de Rome, t. V III, p. 186 et suiv.) N'est-on pas autorisé à croire qu'AgyIla, qui n'interrompit jamais ses rapports avec la Grèce, en avait reçu directement son alphabet dès le temps où l'écriture y fut connue, et qu'on y avait même adopté une méthode de lecture qui devait eu faciliter la propagation. Ainsi, à l'époque de Romulus, l'écriture alphabétique était en usage aux portes de Rome; comment admettre que ce bienfait ne s'était pas répandu jusque dans la ville nouvelle qui était intéressée à ne pas rester en arrière des cités voisines, et qui d'ailleurs comptait peut-être parmi ses habitants plus d'un Pélasge et plus d'un Grec? Quant à Tite-Live, n'est-il pas évident que lorsqu'il dit: parvae et rarae per eadem tempora litterae, il veut faire entendre qu'on écrivait peu et avec concision, en un mot, qu'on ne connaissait point encore la forme littéraire; mais il atteste par cela méfie que l'usage de l'écriture existait. Et certes, comme on vient de le voir, il était déjà ancien à l'époque où il fait cette observation; et nous prouverons bientôt qu'on en trouve des preuves incontestables sous les rois. D'ailleurs, lui-même dans ce passage cite les mémoires des Pontifes et d'autres monuments tant publics que particuliers; et, quand il dit que la plupart périrent, il fait entendre en même temps qu'un certain nombre d'entre eux échappèrent à l'incendie. Dans le même chapitre, il raconte que le premier soin des tribuns militaires nommés l'an de Rome 367 (386 av. J.-C.) fut de rechercher les traités et les lois qui subsistaient encore (les Douze Tables et quelques lois royales), et que de ces documents les uns furent rendus publics, d'autres tenus secrets (suppressa, que l'on a traduit à tort par supprimés,et cela principalement par les pontifes, qui voulaient contenir la multitude à l'aide du frein religieux. Ce fut le même moyen qu'employa plus tard Vespasien pour reconstituer les archives nationales qu'un incendie du Capitole avait détruites.... « Ipse restitutionem Capitolii aggressus, ærearum tabularum tria millia quæ simul conllagraverant restituenda suscepit, undique investigatis exemplaribus; instrumentum imperii pulcherrimum ac vetustissimum quo continebantur pene ab erordio Urbis senatusconsulta, plebiscita de societate ac foedere et privilegio cuicunque concessis. » Suétone, Vesp., chap. VIII. Nous devons ici aller au-devant d'une objection qu'on pourra nous faire. Suivant Plutarque ( Vie de Numa, c. 1 ), un certain Clodius dont la critique n'a pu encore déterminer l'âge assurait, que, lors de la prise et du pillage de Rome, les anciennes tables avaient été perdues, et que celles qu'on possédait de son temps avaient été falsifiées pour flatter quelques familles qui voulaient absolument faire remonter leur origine aux premières races, etc. Mais ce passage de Plutarque ne saurait être envisagé comme une difficulté. On peut répondre que, quelle que soit la confiance que mérite ce Clodius, cité avec si peu d'égard par l'historien, il est évident qu'Il exagérait. Et, lors même qu'Il aurait dit la vérité en tout point, si la falsification n'avait d'autre but que de montrer les liens qui existaient entre des familles récentes et des familles plus anciennes, la falsification ne pouvait évidemment porter que sur les monuments qui intéressaient les familles, et non pas sur d'autres; par conséquent elle ne pouvait s'étendre aux lois, aux traités, etc. Cicéron, dans sa République (II, l0), semble avoir prévu les objections auxquelles donnerait lieu l'histoire des premiers temps de Rome, et il y répond d'une manière brillante, mais peut-être en exagérant un peu la civilisation du premier siècle de la ville éternelle. « Romulus, dit-il, vivait, il y a moins de six cents ans, dans un temps où les sciences et les lumières étaient déjà fort anciennes ( jam inveteratis LITTERIS atque doctrinis ) et où l'on avait dépouillé ces antiques erreurs d'une civilisation naissante et grossière. En effet, si, comme on l'établit par les annales des Grecs, Rome fut fondée dans la seconde année de la septième olympiade, l'existence de Romulus se rapporte au temps que la Grèce était déjà remplie de poètes et de musiciens, siècle où des fables contemporaines n'auraient obtenu que bien peu de croyance. En effet, ce fut cent huit ans après la promulgation des lois de Lycurgue que l'on établit la première olympiade, bien que par une méprise de nom quelques auteurs en aient rapporte l'institution à Lycurgue lui-même. D'autre part, les calculs les plus modérés placent Homère trente ans au moins avant Lycurgue. On peut eu conclure aisément qui Homère précéda de beaucoup d'années le temps de Romulus. Ainsi, l'instruction des hommes et les lumières même du siècle devaient laisser alors peu de place au succès d'une fiction. L'antiquité, en effet, a pu recevoir des fables quelquefois même assez grossières ; mais cette époque, déjà cultivée, était prête à repousser par la dérision toute supposition invraisemblable. » (Traduction de M. VILLEMAIN. ) Aux auteurs grecs cités par Cicéron on pourrait en ajouter beaucoup d'autres tels qu'Hésiode, les poètes cycliques,Tyrtée (vers 681)), Terpandre (677), Archiloque, Alcman (vers 670), Stésicore (né en 632), etc. C'est au septième siècle que fleurirent au midi de la péninsule italique les législateurs Zaleucus et Charondas. Au sixième siècle, au temps des Tarquins, la critique d'Homère avait pris naissance, et par conséquent la grammaire et la philosophie de la langue. Quelques années auparavant florissait Solon, qui composa des poèmes dont le temps nous a conservé des fragments, et qui avait donne à sa patrie des lois écrites qu'avaient précédées celles de Lycurgue. Dans cette période des écoles philosophiques avaient été fondées par Thalès, à Milet, par Pythagore, à Crotone, et les poètes comme les philosophes élevaient les esprits et ennoblissaient les âmes. Comment croire que de la Grande-Grèce, où cet immense développement littéraire et scientifique exerça une influence si remarquable, cette civilisation féconde ne se soit pas étendue jusque dans le Latium, quand on sait que l'Étrurie, si voisine de Rome, n'y resta pas étrangère, elle qui, par ses relations commerciales, embrassait toutes les côtes de l'Asie-Mineure, de la Grèce, des îles de la mer Ionienne et de la mer Tyrrhénienne ? Cent ans s'étaient à peine écoulés depuis l'époque assignée à la fondation de Rome, quand Démarate, chassé par la tyrannie de Cypselus, vint s'établir à Tarquinie, ou il enseigna à l'Italie l'art de peindre les vases, et fonda une 761 colonie d'artistes à la tête desquels étaient Euchyre et Eugramme qui devaient sans doute ces surnoms à leur habileté. « Ce ne fut pas, dit Cicéron (Rep. II, 19 ), un faible ruisseau détourné dans nos murs, mais un fleuve immense qui nous apportait par torrents les sciences et les arts de la Grèce... Ayant eu deux enfant. de son union avec une femme de cette ville, il les instruisit dams toutes les sciences sur le modèle de l'éducation grecque. » (Trad. de M. VILLEMAIN. ) Ce fut l'un de ces enfants, Tarquin l'Ancien, qui devint roi de Rome. Mais sans insister sur l'influence que put exercer à Rome la littérature grecque bien avant la conquête de la Grèce, n'avons-nous pas la preuve qu'il existait en Italie une littérature toute nationale! C'est un fait qu'on ne peut révoquer en doute pour l'Étrurie et qu'atteste le discours de Claude retrouvé et conservé à Lyon, et le passage ou J. Lydus (de Ostent., cap. III) parle des livres de Tarchon de manière à prouver qu'il les avait sous les yeux. Quant à Rome, on ne peut nier qu'elle n'ait eu, dès les temps les plus reculés, des chants populaires dont quelques fragments sont parvenus jusqu'à nous. On sait que Fabius Pictor, cité par Denys d'Halicarnasse (I, 79), parlait, au sujet de Romulus et de Rémus, de chants nationaux qui de son temps étaient encore dans la bouche de tous les Romains. Mais ces chants, dont on a voulu, dans ces derniers temps, faire des épopées ou des cycles, ne furent pas la seule source à laquelle purent puiser les écrivains qui les premiers voulurent faire perdre à l'histoire nationale la forme sèche et aride qu'on lui avait donnée jusqu'alors dans les Annales des pontifes. Les documents auxquels ils purent recourir étaient plus nombreux qu'on ne semble l'admettre; passons-les rapidement en revue. L'un des adversaires les plus redoutables de l'Histoire primitive de Rome admet que ces sources étaient au nombre de cinq : « 1° les grandes annales; 2. les actes publics; 3° les livres des magistrats; 4° les lintei libri, qu'il faut peut-être confondre avec les précédents; 5° les mémoires des familles censoriales qui rentrent probablement aussi dans quelques unes des catégories précédentes. » Mais cette énumération est loin d'être complète et exacte. Les sources auxquelles puisèrent les plus anciens historiens de Rome peuvent se ranger sous quinze chefs différents, savoir:
1° Annales des
pontifes. A ces sources il convient d'ajouter encore les documents postérieurs à l'abolition de la royauté et peut-être seulement à la prise de Rome, mais antérieurs à la rédaction de l'histoire, savoir;
16° Acta
senatus. Je vais parler successivement de ces différentes classes de documents historiques, et j'essaierai de prouver qu'ils avaient plus d'importance qu'on n'a bien voulu le croire. 1° Annales des pontifes. M. Victor Leclerc, dans un savant et ingénieux mémoire qu'il vient de publier sur ces monuments, et qui fait partie d'un volume intitulé : Des journaux chez les Romains. - Recherches précédées d'un mémoire sur les Annales des pontifes (Paris, 1838), a prouvé d'une manière victorieuse, et avec ce talent d'écrivain qui caractérise tous ses travaux, l'importance et l'authenticité de ces antiques et vénérables chroniques de Rome. Les paroles de cet éloquent professeur ont trop d'autorité, ses investigations sont trop consciencieuses, ses déductions trop sûres et trop persuasives, pour qu'il ne nous suffise pas de reproduire ici le résumé qu'il fait lui-même de son livre, auquel nous aurons souvent recours dans la suite de cette discussion. « I. Les Annales des pontifes étaient des espèces de tables chronologiques tracées d'abord sur des planches de bois peintes en blanc, et où le grand pontife, peut-être depuis le premier siècle de Rome, mais au moins depuis l'an 550 jusqu'à l'an 623, ou peu de temps après, indiquait année par année, d'un style bref et simple, les événements publics les plus mémorables. » II. Ces tables, soit qu'on les eût laissées sur bois, soit qu'on les eût transportées sur pierre ou sur bronze, ne périrent pas toutes dans l'invasion des Gaulois; et, conservées avec le soin que Rome donna toujours aux anciens monuments écrits, elles furent consultées, pour des temps antérieurs, par Caton, Polybe, Varron, Cicéron, Valerius Flaccus, et par d'autres écrivains, que Denys d'Halicarnasse, Tite-Live, Quintilien, le premier Pline, Aulu-Gelle, Vopiscus, ont eus entre les mains. Il est probable même, d'après Aulu-Gelle et Servius, qu'elles furent recueillies en corps d'ouvrage, quoiqu'il ne faille pas les confondre avec beaucoup d'autres recueils qui portaient le nom des pontifes. Convenir qu'elles ont pu être diminuées par le temps, interpolées, divisées en livres, rajeunies pour le style, comme les vieux textes l'ont été souvent, ce n'est pas en détruire l'existence, comme plusieurs critiques l'ont essayé. » III. Quant à l'autorité de ces Annales, les fables religieuses ou politiques qu'elles devaient contenir, si l'on en juge par les traces qui en restent, n'ont rien de plus merveilleux que tant d'autres fables dans les anciennes chroniques de tous les peuples. « Ce genre de documents est désigné dans les historien latins sous des noms très divers qui ont plus d'une fois embarrassé les savants. M. Leclerc a prouvé qu'il fallait admettre conne annales des pontifes les ouvrages cites sous les titres Annales pontificum ou pontificis, Annales publici, Annales maximi et Commentarii pontificum, bien que cette dernière expression puisse s'appliquer quelquefois aux livres de discipline religieuse. 2° Livres sacrés. - Rituels. C'est sans doute aux rituels des pontifes (libri pontificii) que Tite-Live a emprunte la formule du fécial et du pater patratus, consacrant le traité entre Albe et Rome ( Tite-Live, I, 24), celle du jugement d Horace, meurtrier de sa soeur ( lex horrendi criminis, I, 26), et celle du traité entre le premier Tarquin et les Sa- 762 bins pour la cession de Collatie, formule qu'il reproduit presque littéralement, quand trois siècles plus tard le peuple campanien et la ville de Capoue se donnent au sénat romain. C'était, on n'en saurait douter, à une semblable source que Varron et Juba, traduits par Plutarque ( Quaest. rom., IV), avaient puisé cette vieille histoire que rapporte aussi Valère-Maxime (VII, III, 1 ) d'un Romain qui, sous le roi Servius, assura par un stratagème l'empire à sa ville natale. Ce qui prouve du reste que ces recueils si précieux pour la religion ne périrent pas dans l'incendie de Rome, c'est que Cicéron les cite pour constater que l'appel au peuple existait sous les rois. Quand, après le départ des Gaulois, un senatus-consulte, sur la proposition de Camille, ordonna que tous les lieux saints occupés un instant par l'ennemi seraient solennellement purifiés, il fut décidé que, pour cette cérémonie expiatoire, les livres seraient consultés par les duumvirs. (Tite-Live, V, 50.) Il s'agit sans doute, comme l'a pensé M. Leclerc. ( ouvr. cité, p. 66), des libri sibyllini ou fatales, livres mystérieux que les duumvirs des sacrifices allaient consulter, sur l'ordre du sénat, et qui furent ensuite confiés aux decemvirs, puis aux quindecemvirs des sacrifices, chargés des jeux séculaires, et d'après les commentaires desquels Censorin (de Die natali, 17 ), remonte jusqu'aux jeux de l'an 298. Ces documents devaient être du nombre de ceux qui avaient échappé aux ravages des Gaulois. Tite-Live lui-même ( V, 10) raconte qu'à la nouvelle de l'invasion des Gaulois les prêtres et les vestales, uniquement occupes du soin de conserver tout ce qui intéressait la religion, renfermèrent une partie des objets sacrés dans des tonneaux de terre cuite, qui furent ensevelis près de la demeure du flamen quirinalis, et, que s'étant distribue le reste, ils l'emportèrent à Céré où ils allèrent chercher un asile. Certes, parmi les objets sacrés devaient figurer au premier rang les livres et les rituels qui faisaient la force de la caste patricienne. 3° Chants religieux. « Entre les monuments qui survécurent à la catastrophe de l'an 565, je trouve dans l'ordre des temps, dit M. Leclerc (ouv. cité, p. 51 et suiv.) le chant des fratres arvales, que l'on peut faire remonter à Numa, peut-être plus haut (Servius, ad En., VIII, 285, et dont une copie reproduite sur le marbre au temps d'Héliogabale,d'après d'autres copies transmises d'àge en âge, retrouvée en 1778 dans les fouilles pour la construction de la sacristie de Saint-Pierre, a été interpretée par Lanzi, et plus récemment par MM. Hermann et Grotefend; l'hymne des Saliens, qui avait dû se conserver de même, où Varron, avant d'en citer quelque chose (de Ling. lat., VII, 26, Orf. Müller), reconnaît les premiers accents de la poésie romaine (Ibid.,VII, 3, Romanorum prima verba poetica); qu'il semble regarder aussi comme plus ancien que Numa ( Ibid. ), et qui, pour les Saliens eux-mêmes, si l'ou en croit Horace (Ep., II, I, 86 ) et Quintilien (I, VI, 40), aurait eu besoin d'être expliqué. Peut-être faut-il placer encore dans cette catégorie la prière osque rapportée par Caton l'Ancien ( de Re Rust., c. CLX), ainsi que les oracles attribués à Marcius et à Publicius, bien que l'époque n'en soit pas bien connue. 4° Libri lintei . - Libri magistratuum, censorum tabulae. Il ne faut pas confondre les libri lintei et les libri magistratuum, bien que les uns et les autres paraissent avoir été des catalogues de magistrats. Tite-Live (IV, 7 et 22, avec la correction de Beaufort : et quos linteos) les cite comme deux recueils bien distincts. Les livres lintéens, ainsi nommés de la matière sur laquelle ils étaient tracés, existaient encore du temps de Licinius Mlacer et de Tubéron, qui, comme nous aurons occasion de le voir, les consultèrent dans le temps de Moneta pour des laits relatifs aux années 310, 315, 318 et 320, et par conséquent antérieurs a la prise de Rome (Tite-Live, IV, 7, 13, 20, 23 ). Du reste, il paraît que l'usage d'écrire sur des étoffes de lin se maintint fort tard, puisqu'on retrouve encore des livres de ce genre au temps d'Aurélien (Vopiscus Aurel., cap. I et VIII); il est même mention dans le Code Théodosien de lois écrites sur des mappae linteae, pour être exposées dans toute l'Italie. Les livres des magistrats échappèrent aussi aux désastres de l'année 365 (590 av. J.-C.), puisque le même Licinius (Tite-Live, IV, 7 et 20) s'en fait une autorité pour un fait de l'année 509 ( 441 av. J.-C.). Quant aux mémoires des censeurs (censorum tabulae ou commentarii τιμητικὰ οu ὑπομνήματα Denys dΗal., I, 71, et IV, 22), que les fils recevaient de leurs pères, et qu'ils tenaient à transmettre à leurs descendants comme un héritage sacré (Denys, I, 71), Denys d'Halicarnasse les cite en parlant d'un recensement fait sous le roi Servius Tullius; non, comme le remarque M. Leclerc, qu'il y eût déjà des censeurs, mais parce que les anciens registres avaient pu être déposés dans les archives de cette magistrature. Le même historien les cite encore pour un dénombrement fait deux ans avant la prise de Rome, et dont il s'aide pour déterminer l'année de la fondation de Rome ( II, 25, 24). Polybe fait également usage de cette source, et Varron y cherchait des traces de l'ancienne langue latine (de Ling. lat., VI, 86, Egger). 5° Lois royales. - Plébiscites .- Sénatus-consultes. Le savant auquel j'ai emprunte les extraits qui précèdent range encore parmi les monuments échappes aux ravages des Gaulois » les lois royales, inscrites aussi sur le bois, la pierre ou le bronze, et que l'on recueillit après l'incendie (Tite Live, VI, 1 ), comme celles de Numa, dont Cicéron atteste encore l'existence dans les archives publiques (quas in monumentis habemus, de Rep., II, 14. Quas scitis exstare, ibid, V, 2) ; celles de Tullus qu'il semble comprendre dans les commentaires des rois (ex regum commentariis, pro Rabir. perd., c. V), et dont l'empereur Claude invoquait encore l'autorité (Tacit., Ann., XII, 8) ; commue le tableau des centuries de Servius que Verrius Flaccus avait consulté (Festus V, Pro sensu et Procum), et d'autres dispositions de ce roi législateur; plusieurs des lois qui suivirent, les lois sacrées de l'an 260 (Cic., de Leg., II, 7, etc.), celles que les consuls de l'an 281 avaient fait graver sur une colonne de bronze, et qui avaient offert à Varron le plus ancien exemple le de l'usage d'intercaler (Macrobe, Saturn., I, 15; H. Dodwell, de Roman. cycl., p. 640 ) ; surtout celles des douze Tables, que Tite-Live connaissait, mais dont il ne s'est point servi pour l'histoire. » « A ce genre de documents appartiennent ceux que les édiles furent chargés, l'an 501 (av. J.-C. 449), de garder dans le temple de Cérès quand on se fut aperçu que les consuls n'en étaient point fidèles dépositaires (Tite-Live. II, 55; Pomponius, de Orig. juris, c. XXI; Zonaras, Annal., VII, 16), et qui, confiés à des tables de bronze, pouvaient échapper à la destruction. » M. LECLERC, ouvr. cit., p. 57. 763 6° Traités. Les monuments de ce genre dont le temps nous a conservé des traces sont nombreux, et l'authenticité de le plupart d'entre eux n'a pas été révoquée en doute par les critiques qui ont jeté à terre le vieux roman. Le plus ancien est celui que Romulus, s'il faut en croire Denys d'Halicarnasse, fit pour cent ans avec les Veiens, et qu'il grava sur des colonnes (στήλοις ἐνεχόραζε), Denys, II, 55). Au témoignage du même historien, Servius réunit en une confédération commune tous les peuples Iatins. Il éleva à Rome un temple où devaient se tenir les assemblées des confédéré, et y ouvrit un asile. Ce temple était consacre a Diane et bâti sur l'Aventin, la plus haute des collines de Rome. il y écrivit les lois de cette alliance, régla les rites des fêtes, les époques et la police des marchés, et fit graver sur une colonne de bronze les décrets de la confédération. Cette colonne existait encore du temps de Denys, qui assure l'avoir vue et nous apprend que l'inscription était en lettres grecques (Denys, IV, 26). Denys fait aussi mention (IV, 48) d'un traité conclu avec les Latins par Tarquin-le-Superbe, et que les deux parties contractantes inscrivirent sur des colonnes (συνθηκας τε γράψαντες ἐν στήλαις); ce qui semblerait prouver qu'il en existait un exemplaire chez chacun des deux peuples. Ce fut peut-être ce dernier traité, si ce n'est celui de Servius, qu'invoquèrent les Ardéates en 442 avant J: C., lorsqu'ils vinrent réclamer les secours de Rome : « Legati ab Ardea neniunt pro veterrima societate renovatoque foedere recenti auxilium prope eversae urbis implorantes. » (Tite-Live, IV, 9.) Tarquin, après avoir vaincu les Gabiens, fit inscrire les conditions de la nouvelle alliance qu'il conclut arec eux sur un bouclier de bois couvert d'une peau de boeuf, que l'on voyait encore à Rome du temps de Denys d'Halicarnasse,dans le temple de Sancus ou Jupiter Fidius. (Voyez Denys dHal., IV, 58; Verrius Flaccus, cité par Paul Diacre, d'après Festus, s. v. Clupeus.) Un autre traite conclu par le même prince avec les Sabins est cité par Denys d'Halicarnasse (IV, 65), et c'est sans doute à ces deux actes qu'Horace (Ep. II, 1, 25) fait allusion dans ces vers :
Fœdera regnm Polybe (III, 22) a traduit littéralement le premier traité conclu entre les Romains et les Carthaginois, l'année même qui suivit l'expulsion des rois. Il était gravé sur une table d'airain et conserve, avec une quantité d'autres monuments du même genre, dans les archives des édiles au temple de Jupiter Capitolin (Id. Ibid., 26). L'historien nous apprend que les Romains les plus habiles, même en les étudiant, avaient peine à en comprendre certaines expressions (ὥστε τοὺς συνετωτάτους ἔνια μόλις ἐξ ἐπιστάσεως διευκρινεῖν. M. Leclerc (ouvr. cité p. 59 pense avec beaucoup de vraisemblance qu'Aristote (Polit. III, 5,10, éd. de Coray) fait allusion aux traités de Rome avec Carthage, en les rapportant aux Tyrrhéniens. « La date de ces monuments, ajoute-t-il,a été vainement contestée par Hooke ( Roman htstory, Book III, ch. VII; Dissertation on the credibility of the history of the first 500 years of Rome; p. 430, éd. de Londres ), et par d'autres. M. de Sainte-Croix (Mem. de l'Acad. des Inscript. t.XLVI, p. 1. ), réfuté dernièrement par Lachman, a élevé des doutes sur leur sens, parce qu'on y trouve ce que Tite-Live, maigre son patriotisme, ne laisse pas mène entrevoir, que Rome, avant cette révolution qui l'affaiblit, était maîtresse d'Ardée, d'Antium, de Circei, de Terracine, dont les peuples, dans le texte, sont appelés ses sujets (ὑπήκοοι); comme si l'on devait s'en tenir à l'autorité de cet historien et de ses copistes, pour juger des documents qu'il n'a point connus, persuadé qu'il n'avait à consulter Polybe que pour les guerres puniques. Si le raisonnement de M. de Sainte-Croix était fondé., il faudrait aussi rejeter un traité dont on a fait grand usage dans ces derniers temps pour prouver le peu de confiance que mérite Tite-Live; je veux parler des conditions imposées par Porsenna à Rome. « ln foedere quod, expulsis regibus, populo romano dedit Porsenna nomitim comprehensum invenimus ne ferro, nisi in agricultura, uterentur. » (Pline, Hist. Nat. XXXIV, 14; Cf. Tacite, Hist., III, 72). Mais de ce que Tite-Live, par une exagération de patriotisme, a passé sous silence ce fait important, on ne peut, ni conclure que son livre est un roman, ni prétendre que Rome n'a pas été prise par le roi étrusque. En 260 (av. J.-C. 491), Rome conclut avec les Latins en traité que Denys d'Halicarnasse analyse (II, 95), et qu'il avait pu lire derrière les Rostres, sur la colonne de bronze où fut recopié du temps de Cicéron ( Pro Balbo, XVIII ). Tite-Live (II, 33), en fait mention, mais en très peu de mots : •« Nisi foedus cum Latinis, columna aenea insculptum monumento esset, etc. » Vient ensuite le traité conclu avec les Ardéates en 310 (445 av. J.-C.); les termes dans lesquels Tite-Live en parle ([V, 7) méritent d'être rapportées pour plus d'un motif : « Dis consulibus curn Ardeatibus foedus renovatum est: idque monumenti est, consules eos illo anno fuisse, qui neque in annalibus priscis neque in libris magistratuum inveniuntur. Credo, quod tribuni militum initio anni fuerunt, eo, perinde ac si totum annum in imperio fuerint, suffectis his consulibus, pratermissa nomina consulum horum. Licinius Macer auctor est, et in foedere Ardeatino, et in linteis libris ad Monetae inventa. » Il résulte de ce passage deux faits importants : d'abord que le traité existait encore du temps de Tite-Live aussi bien que les libri lintei, les anciennes annales et les livres des magistrats; en second lieu, que ces prétendues confusions de noms dont on a fait tant de bruit peuvent s'expliquer par des raisons très plausibles, analogues a celles que donne ici Tite-Live. Si nous terminons cette énumération par les deux traités conclus avec Carthage en 408 et 476 (315 et 277 av. J.-C.), et traduits par Polybe, qui les avait vus dans le même dépôt que le premier, nous aurons indiqué ce qui nous reste de traces des monuments de ce genre qui existaient encore au commencement du 6e siècle de Rome et que purent consulter les Romains qui, les premiers, donnèrent une forme plus littéraire aux annales de leur patrie. 7° Tables triomphales. On doit joindre aux documents indiqués plus haut les tables triomphales. Tite-Live n'en a mentionné que trois (VI, 29 ; XL, 52; XLI, 28), bien qu'il en existât un plus grand nombre (Festus, s. voc. Navali; Cf. Brisson, de Form,., p.553; Marini, atti dei fratelli arvali, t. I, p. 57). L'usage de ces tables, qui se perpétua jusque dans les derniers temps de la république, remontait assez haut, et il faut qu'on l'ait conservé avec un soin religieux, puisque Cincius parait avoir vu celle du dictateur T. Quinctius 762 (Festus, s. voc. Trientemi),et que le grammairien Attilius Fortunatianus (p. 2680, Putsch), put lire encore au Capitole celles de L. Aemilius Regillus et d'Acilius Glabrion. (Voy. Tite-Live, XL, 52.) On ne saurait décider si Tite-Live a vu de ses propres yeux les monuments qu'il cite, ou s'il n'en parle que d'après les annales. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il ne les transcrit pas textuellement, et qu'il altère le mètre saturnin dans lequel ils étaient écrits. (C. Hermann, Elem. metr., p. 616; Walch, emend. Liv., p. 254 et suiv. ) 8° Inscriptions. Il est probable que les premiers historiens ne négligèrent pas cette classe de monuments, qui devaient avoir été conservés d'autant plus religieusement, qu'ils flattaient tout à la fois et l'orgueil national, et l'orgueil des familles. Tout porte à croire que les bases des statues élevées aux grands hommes, par exemple à Servius Tullius, à Horatius Coclès, à Lucrèce, à Porsenna, à Hermodore ( Val. Max., III, IV, 5; Pline, XXXIV, Il; Aulu-Gelle, IV, 5), et aux quatre ambassadeurs romains tués à Fidènes en 516 (137 ans av. J -C.), dont les noms s'étaient conserves jusqu'au temps de Tite-Live (IV, 17), et même de Pline (Hist. nat. XXXIV, 1 f ), devaient être décorées d'une inscription conçue, sauf les modifications subies parla langue, à peu prés dans les mêmes termes que celles qui nous sont parvenues, c'est-à-dire en sers saturnins, comme celles des tombeaux de la famille des Scipions, ou en prose comme celles que cite M. Leclerc p. 20 et suiv.). Il devait en être de même des temples, des autels, des tableaux votifs. Du temps d'Auguste (Tite-Live, IV, 20), on lisait encore l'inscription qui avait été peinte sur la cuirasse de lin déposée par Cossus, en 317 (436 ans avant J.-C.), dans le temple de Jupiter Férétrien, avec les secondes dépouilles opimes. Du reste, cette inscription n'est pas la plus ancienne dont il soit rait mention dans les auteurs latins. Pline (XVI, 87 ) parle d'un chêne plus âgé que Rome, qu'on voyait encore de son temps sur le mont Vatican, et dont l'inscription eu caractères étrusques et de bronze attestait que dès les temps les plus recules cet arbre était sacré. Remarquons en passant qu'une inscription étrusque ne pouvait avoir été placée dans Rome qu'a une époque où les Étrusques y dominaient, c'est-à-dire sous l'un des trois derniers rois, ce qui prouve encore que des cette époque l'usage de l'écriture était commun chez les Romains. Citons encore les vers en vieilles lettres latines, joints, suivant le témoignage de Pline ( XXXV, 57), aux peintures du temple d'Ardée; les boucliers que le même écrivain (XXXV, 5) vit suspendus dans le temple de Bellone en l'honneur de la famille Claudia, et chargés d'inscriptions mémoratives par Appius Claudius, consul en 258 (493 av. J.-C ); les vers grecs qui accompagnaient les ouvrages de plastique et de peinture de Damophile et de Gorgasus, dans le temple de Cérès, dédié par le consul Sp. Cassius en 260 (193 av. J.-C.) ; l'inscription de Duilius qui se place en 499 ( 261 av. J.-C.); celles du caveau funèbre des Scipions, celle qu'Annibal fit graver en caractères puniques et caractères grecs au cap Lacinium ( Polyb. III, XXXIII, 18 ), etc. 9° Monnaies. On sait par le témoignage de Pline ( XXXIII, 13 ), et par celui de Cassiodore ( Var., VII, 52 ), que les plus anciennes monnaies, celles de bronze, commencèrent à être marquées sous le règne de Servius. Celles où paraissent pour la première fuis des caractères alphabétiques, les as de forme carrée avec l'inscription ROMANON, sont regardées par les savants comme appartenant au troisième siècle de Rome ou au quatrième au plus tard. Et ce qui prouve que cette opinion n'a rien d'invraisemblable, c'est qu'on possède des médailles écrites des villes de la Grande-Grèce, dont rage remonte sans aucun doute au commencement du sixième siècle avant notre ère, notamment celles de Sybaris, qui ne peuvent en aucun cas être plus récentes que l'année 510 où cette ville fut détruite, année qui, comme on le sait, suivit immédiatement celle où Tarquin fut banni de Rome. En admettant que pour les premiers temps de Rome les monnaies n'aient pas été d'un grand secours pour les recherches historiques, elles purent offrir cet avantage bien avant la lin du cinquième siècle de la fondation de Rome, époque à laquelle, suivant Niebuhr et surtout suivant son école, l'histoire romaine commence à offrir quelque certitude. Elles donnent d'ailleurs, ce qui est surtout important à constater, une preuve matérielle et irrécusable que l'écriture à Rome est moins récente qu'on ne veut le faire croire. Les pecuniæ elles-mêmes, plus anciennes encore que ces monnaies, annoncent un art de transmission, mais un art déjà parvenu à un certain degré de pureté, et qui ne peut appartenir qu'à une époque civilisée. 10° Archives des familles. -- Éloges funèbres. Les familles conservaient aussi dans le tablinum (Pline, XXXV, 2) leurs propres mémoires, commentant, qui se transmettaient de génération en génération : c'est un fait dont on a des preuves pour la famille Sergia (Varron, de Ling. lat., VI, 90), et pour la famille Porcia (Aulu-Gelle, Xlll, 19 ). A ces documents appartenaient sans doute les tables génealogiques, στέμματα, qui, suivant le Clodius dont parle Plutarque, auraient été altérées par la flatterie a la suite de la destruction de Rome par les Gaulois, altération qui ne pouvait, comme nous rasons déjà remarqué, porter que sur quelques noms propres, et non sur des faits essentiels que d'autres monuments attestaient. Ajoutons encore à ces documents les éloges funèbres, laudes funebres (Tite-Live, VIII, 40), mortuorum laudationes (Cic. Brut., c. XVI; Quintil, Ill, VII, 2; Polybe, V I, 53; Denys d'Hal., V, 17), et les autres discours publics, orationes, comme par exemple celui d'Appius Caecus au sujet de Pyrrhus, que l'on conservait comme autant de souvenirs des ancêtres. Sans doute tous ces documents ne furent pas a l'abri des falsifications intéressées que leur tirent subir les familles (Tite-Live, VIII, 40); mais ces falsifications durent être de même nature que celles des στέμματα, et ne purent en aucune façon changer le caractère des faits historiques, puisque c'eût été enlever toute vraisemblance aux actions dont les faussaires voulaient faire honneur à leur race. 11° Images des ancêtres. Lorsqu'un Romain de distinction vient à mourir, dit Polybe, et qu'on célèbre ses funérailles, on le transporte eu grande pompe dans le Forum et on le place près des Rostres, ordinairement debout pour que toute la foule puisse le voir, rarement couché. Tout le peuple alors l'entoure, et, s'il a laissé un fils déjà grand, qui se trouve à Rome, ce fils, ou dans le cas contraire, quelqu'un des autres membres de la famille, monte à la tribune aux harangues et célèbre les vertus du mort et ses belles actions. Il en résulte que le peuple, se rappelant cette vie 763 glorieuse et la passant pour ainsi dire en revue, le deuil n'est plus seulement un deuil de famille, mais un deuil public. « Quand le cadavre a été enseveli et que l'on a rempli tous les devoirs religieux, l'image du mort est placée dans l'endroit le plus en évidence de la maison, et entourée d'un édicule en bois. Cette image consiste en un masque de la plus exacte ressemblance, et reproduisant non seulement la forme des traits, mais même la couleur du visage. Ces images, dans les fêtes publiques, sont tirées de leur châsse et parées avec soin. Lorsqu'il meurt un personnage éminent de la famille; elles accompagnent le convoi, portées par des hommes dont la taille et tout l'extérieur rappellent le plus les défunts, et qui se revêtent en outre de la prétexte s'ils représentent un consul ou un préteur, de la robe de pourpre pour un censeur, et de la robe brochée d'or s'il s'agit d'un triomphateur. Ensuite ils s'avancent montés sur des chars, précédés des licteurs et des autres insignes attribués aux magistratures que chacun d'eux a exercées durant sa vie. Arrivés près des Rostres, tous prennent place sur des chaises d'ivoires. Il n'est pas de spectacle plus beau et plus doux pour un jeune homme ami de la gloire et de la vertu. Qui ne se sentirait exalté en voyant réunies toutes ces images, pour ainsi dire vivantes et animées, d'hommes qui se sont illustrés par leur mérite? Non, il n'est pas de plus beau spectacle ! » Du reste, celui qui prononce l'oraison funèbre du citoyen qu'on doit ensevelir rappelle, quand il a fini de parler du mort, la gloire et les exploits de tous les morts dont les images l'entourent, en commençant par le plus ancien; et par cet éloge ainsi renouvelé, la gloire des citoyens qui ont fait quelque chose de grand devient immortelle et le souvenir des bienfaiteurs de la patrie se transmet d'âge en âge à la postérité. « ( Polybe, VII, 53, 54.) Ce passage, si je ne me trompe, répond victorieusement aux assertions du Clodius dont nous avons parlé plus haut. Il est difficile en le relisant d'admettre que les στέμματα des familles romaines aient, après la destruction de Rome, subi des altérations aussi grandes que celles qu'il suppose pour être en droit de nier l'authenticité des anciens monuments. Admettons que lors de l'incendie de la ville toutes les images de famille aient été détruites sans aucune exception ; elles étaient tellement connues du peuple, qui les voyait passer sous ses yeux dans toutes les cérémonies publiques, que les artistes romains purent sans peine, à celte époque où les rapports de Rome avec la Grèce sont attestes par des preuves irrécusables, les rétablir avec assez de fidélité pour que l'amour-propre national n'eût rien à regretter de ses pertes et que le fil de la tradition ne fût pas interrompu. Certes, si quelque inexactitude, quelque falsification se fût fait remarquer, le peuple n'eût pas manqué d'invoquer ses souvenirs et de faire justice du faussaire. Cet argument s'applique aux éloges funèbres; les faits qu'ils rappelaient étaient tellement du domaine public, qu'on n'aurait pu les altérer impunément. Quelque mémoire accusatrice serait venue, à l'aide de ses souvenirs et des monuments publics, des traités, des annales, etc., rétablir la vérité, surtout à une époque où toute l'existence nationale était concentrée dans Rome, ou lu grandes familles étaient l'objet de l'attention geai• raie, et ou la jalousie des familles plébéiennes n'aurait pas permis l'introduction de traditions mensongères qui eussent augmenté encore l'importance des antagonistes du parti populaire. 12° Acta civilia. L'institution des actes de l'état civil, connue des Athéniens, datait dans Rome de Servius Tullius, s'il faut en croire Pison, cité par Denys d'Halicarnasse (IV, 18). La surveillance en fut confiée plus tard aux censeurs (Tite-Live, IV, 8; VI, 27, XLIII, 16), puis aux questeurs, puis aux préfets du trésor (Tacite, Ann. XIII, 28; Capitolin, M. Aurel., c. lx ). On inscrivait jour par jour sur ces registres, les naissances, les mariages, les répudiations, les divorces, les morts. (Voyez Juste Lipse, sur Tacite, Ann., V, 4, et M. Leclerc, ouvr. cit., p. 198-200.) 13° Chants nationaux. M. Leclerc range dans cette classe « ceux qui, au temps de Denys d'Halicarnasse, ou du moins de Fabius Pictor, célébraient encore la belliqueuse adolescence des fondateurs de Rome (Denys, I, 79), surtout les chants militaires, tels que ceux dont l'usage n'a pas toujours été négligé par Tite-Live même (IV, 20, 53; V, 49; VII, 10, 58; X, 30): chants héroïques des festins, des combats, des triomphes, des funérailles, qui tous, après avoir passé de bouche en bouche (Cic, Brut., c. XIX;; Tuscul., I, 2; IV, 2; de Leg., Il, 24; Varron ap. Nonium, II, 70; Val. Max., II, 4, 10; Quintil., I, X, 20 ), avaient pu être fixés et perpétués par l'écriture. A cette classe se rattachent aussi les chants satiriques dont la loi des Douze Tables dut réprimer l'âpreté et les excès. 14° Monuments, édifices, statues, reliques, etc. La plupart des faits rapportés dans les documents historiques dont nous venons de donner un aperçu, sans doute bien incomplet, trouvaient leur confirmation dans des monuments que les Romains avaient chaque jour sous les yeux. Sans parler de la cabane de Romulus, qu'on voyait en allant au grand cirque, non loin du Tibre, au détour du mont Palatin (Denys d'Hal., I, 79; Vitruve, II, 1 ; Sénèque, Consol. ad Helv., c. IX), les murs d'Ancus Martius (Tite-Live, I, 33), l'édifice sacré du Capitole (I, 53), les égouts de Tarquin (Cloaca maxima, I, 56), étaient, ainsi que plusieurs statues citées par Pline (XXXLV, 11), et par Servius (ad Aen., Vll l, 641), autant de témoignages de l'existence des anciens rois. A d'autres vestiges comme les peintures sur mur à Ardee, a Lanuvium, à Céré, se rattachait le souvenir d'une civilisation antérieure à la fondation de Rome. Enfin, le figuier ruminal, que du temps de Tite-Live I 4; X, 23), on voyait encore dans le comitium, et qui, cinquante ans plus tard, reprit une jeunesse nouvelle ; le poteau de la Soeur, qu'on n'avait pas cessé de renouveler jusqu'à l'époque d'Auguste (Hodie quoque semper refechum manet, Tite-Live, I, 26) ; la quenouille et le fuseau de Tarquanil, que Varron vit encore dans le temple de Sancus ( Pline, VIII, 74); les deux robes prétextes dont Servius avait revêtu la statue de la Fortune, et qui durèrent jusqu'à la mort de Séjan ( Ibid.), étaient des preuves, équivoques sans doute pour la plupart, de faits que la tradition pouvait avoir altérés, mais qui n'en avaient pas moins un fond historique. 15° Archives des peuples voisins de Rome. Lors même que les Gaulois auraient détruit, dans leur invasion, tous les documents historiques dont nous venons de donner une rapide énumération, et que la plus précieuse partie de ces antiques vestiges de l'histoire n'au- 766 rait pas été transportée à Céré (Tite-Live, V, 40) par les pontifes, ou conservée au Capitole (Plut. Camille, ch. XX ), et même sur le mont Palatin, qui ne fut pas entièrement incendié, s'il faut en croire Diodore de Sicile (XIV, 115 ), les annales des villes italiques eussent offert aux Romains le moynu de réparer les pertes qu'ils avaient pu faire. Toutes ces villes, qui pour la plupart n'eurent point à souffrir de l'invasion gauloise, avaient leurs archives nationales, où devait se retrouver la mention de leurs guerres, de leurs traités, de leurs rapports avec Rome. M. Leclerc prouve jusqu'a l'évidence (p. 71 et suiv.) qu'Antemna, Tibur, Aricie, Laurente, Lanuvium, Anagni, Préneste, Laviniunm, Tarente, Cumes, les Sabins, les Samnites, les Étrusques, les Euganéens avaient des fastes, des libri lintei, des histoires, des livres sacrés. » Ce n'est peut-être pas une illusion de penser que chez tous ces peuples de l'Italie primitive, Rome put trouver encore, dans le butin de la victoire, les documents de leur histoire nationale; car un de ses plus anciens historiens, l'homme qui avait profité le mieux de ces fruits de la conquête, le vieux Caton, au second livre de ses Origines (Ap. Serv., ad Aen. XI, 715 ), reprochant aux Liguriens de ne plus savoir d'où ils étaient venus, d'être sans tradition, sans lettres, leur faisait honte de cette exception. Ainsi donc si cette induction est permise, tous les autres peuples italiques lui avaient transmis leurs annales I » Documents postérieurs à l'abolition de la royauté, et peut-être seulement à la prise de Rome, mais antérieurs à la rédaction de l'histoire. 16° Acta senatus. Les actes du sénat furent tenus secrets jusqu'à César, mais durent être conservés de bonne heure et accessibles aux patriciens qui s'occupèrent de rédiger l'histoire de Rome. Le secret dans lequel cette assemblée enveloppait ses délibérations ayant surtout pour objet la politique du moment ne devait pas s'étendre sur les époques anciennes. D'ailleurs, il est évident qu'on ne cachait au peuple que certaines délibérations d'une haute importance, comme, par exemple, celles auxquelles donnèrent lieu la guerre contre Persée (Tite-Live, XLII, 4; Val. Max., II, 2, 1) et la troisième guerre punique (Val. Max., ibid.). Dans ce cas elles étaient rédigées par des sénateurs mêmes, tandis que dans tous les autres elles étaient recueillies par de simples secrétaires pris en dehors du sénat (Denys d'Hal., X, 21, etc.); scribae, librarii, notarii. 17° Acta forensia. On peut comprendre sous ce titre les actes du pouvoir populaire et ceux des tribunaux. « Les premiers comprenaient les lois, les plébiscites, le résultat des élections par comices, les édits ou proclamations des tribuns, des édiles, des autres magistrats du peuple. On les déposait, comme les sénatus-consultes et les traites, dans les archives annexées à plusieurs temples, à celui de Jupiter au Capitole, de Cérès, de la Liberté, des Nymphes, surtout à celui de Saturne. Actes authentiques et obligatoires, ils étaient nécessairement publiés. » Les actes judiciaires, les arrêts des divers juges, l'étaient aussi. En tête ils portaient les noms des consuls, comme on le voit dans Ammien et dans saint Augustin, qui, d'après l'usage légal, les appelle Gesta.» (M. Leclerc, ouvr. cité. ) 18° Acta militaria ou bellica. « Une autre classe d'actes, celle des actes ou journaux militaires, acta militaria ou bellica, forma dès les premiers temps une classe à part, dont les principaux documents, amassés pendant une longue suite de guerres avec tant de peuples, furent peut-être rassemblés plus tard dans le trésor militaire foulé par Auguste ( Suétone, Aug., c. 49; Tacite, Annal. I, 78; Dion, LV, 25, etc.) ....On peut croire que dans ces archives militaires, outre les états de situation, ceux des peines et des récompenses, les différentes sortes de congés, les privilèges accordés aux vétérans, les itinéraires et les cartes (Végèce, III, 6) se conservaient aussi les rapports adressés par les généraux au sénat, et que, lorsque les armes envoyaient à Rome de ces lettres couronnées de lauriers qui annonçaient des victoires, elles ne manquaient pas de les joindre, dans le recueil de leurs actes, aux pages plus modestes et plus simples qui constataient leur nombre et leurs services. » (M. Leclerc, ouvr. cité, p. 205 et suiv.) -------------------------- Il résulte de tout ce qui précède que Rome, dès les premiers siècles de son existence, connut l'écriture alphabétique, que les premiers Romains qui s'occupèrent de rédiger l'histoire nationale sous une forme littéraire avaient à leur disposition des documents nombreux et variés qui, se contrôlant mutuellement, pouvaient permettre de suivre avec exactitude, depuis les temps les plus reculés, la série des événements qui avaient contribué au développement de la puissance romaine; que ces documents ne consistaient pas seulement en d'antiques traditions plus ou moins altérées par la vanité des familles, mais que, pour la plupart, c'étaient des actes officiels gravés sur le marbre, sur le bronze, sur le plomb ou sur des planches de chêne, ou bien encore peintes sur des matières plus fragiles, il est vrai, mais que l'on renouvelait avec soin; que ceux de ces documents qui disparurent par suite de l'invasion gauloise purent être renouvelés à l'aide des monuments qui avaient été conservés, des copies de traités et des annales qui devaient exister et qui existaient en effet chez les peuples du voisinage. Sans doute, comme il arrive toujours dans l'histoire primitive des empires, beaucoup de fables se sont mêlées à la vérité; mais on ne peut de bonne foi se croire par lit autorisé à soutenir que l'histoire des cinq premiers siècles de Rome est une longue suite de mensonges, artistement arrangés par des Grecs qui voulaient flatter leurs maîtres. « Proscrire l'histoire d'un siècle parce qu'il s'y mêle des fables, c'est, dit l'éloquent écrivain que j'ai déjà cité plus d'une fois, proscrire l'histoire de tous les siècles. Les premiers siècles de Rome nous sont suspects à cause de la louve de Romulus, des boucliers de Numa, du rasoir de l'augure, de l'apparition de Castor et Pollux; des récits ornés on défigurés ainsi ne peuvent être selon vous que des récits tout à fait mensongers. Effacez donc alors de l'histoire romaine toute l'époque de César, à cause de l'astre qui parut à sa mort, dont Auguste avait fait placer l'image au-dessus de la statue de son père adoptif dans le temple de Vénus, et que plusieurs monuments de numismatique et de glyptique nous montrent encore; celle d'Auguste lui-même, puisqu'on le disait fils d'Apollon métamorphosé en serpent ; et jusqu'au siècle de Tacite, qui ne dédaigne pas de faire entrer dans la fortune de Vespasien les miracles d'Alexandrie. Les prodiges compilés par Julius Obsequens, peut-être au temps même de Tacite, ne commencent maintenant qu'à l'an 563 de 767 Rome : en sont-ils pour cela moins nombreux? Que l'on songe à tout ce qui pouvait alors encore se dire et se croire, qu'on se souvienne aussi que plus les temps sont reculés, plus le merveilleux dans l'histoire est fréquent et facile : on cessera sans doute d'être plus rigoureux pour les vieilles annales des Romains que pour celles de tous les peuples du monde. » (M. Leclerc, ouvr. cité, p. 166). Ainsi le merveilleux introduit dans l'histoire d'un peuple n'autorise pas à révoquer en doute l'authenticité de cette histoire dans son ensemble, encore moins à la refaire de fond en comble, sur des hypothèses purement gratuites. Une saine critique doit éliminer le merveilleux, ou plutôt l'expliquer, et c'est précisément ce que firent ou du moins ce que tentèrent quelques-uns des premiers historiens de Rome, et notamment Pison qui « cherchait déjà pour les fables des interprétations naturelles, et n'admettait comme vrais que les faits vraisemblables. » M. Leclerc, ouvr. cité, p. 150.) Tite-Live a-t-il procédé avec la même sévérité, et pour dégager la cérité de l'erreur, a-t-il confronté tous les documents que l'ai énumérés plus haut? On est autorisé à croire, maigre son silence à cet égard, qu'il a transcrit plus d'une fois les annales des pontifes, sinon sur l'original, du moins sur des auteurs qui les avaient consultées (voyez M. Leclerc, ouvr. cité, p. 27). Tite-Live, quoiqu'il n'indique pas ses sources, puise évidemment dans les antiques chroniques, à la fois étrusques et pontificales, tout ce qui répand sur sa narration un air vénérable d'antiquité religieuse, de tradition sainte. Soit qu'il en eût profité lui-même, soit qu'il écrive d'après des annalistes qui avaient pu les connaître. (Voyez ce qui a été dit plus haut § 2 sur la formule du fécial et du pater patratus, etc., d'après M. Leclerc, ouvr. cité, p. 37 et suiv., et p. 93 et suiv. ) Tite-Live cite plusieurs inscriptions (II, 33; IV, 20; VIII, 11, etc.), mais il n en discute qu'une seule, l'inscription votive de la cuirasse déposée par Cossus en 317 dans le temple de Jupiter Férétrien avec les secondes dépouilles opimes. Il est d'ailleurs constant, comme nous venons de le dire, que s'il a surtout composé son histoire avec le secours des livres, les auteurs auxquels il a eu recours avaient fait usage des plus anciens documents, et que quelques uns d'entre eux avaient procède avec assez de critique pour qu'il ne crût pas devoir recommencer des recherches laborieuses qui n'entraient pas dans ses vues et qui répugnaient à sou talent. --------------------------- Les critiques qui ont prétendu refaire l'histoire primitive de Rome n'ont pas seulement appuyé leur scepticisme sur le passage de Tite Live que nous avons discuté plus haut ( p. 759 ), mais aussi sur la longue durée du règne des sept rois. Isaac Newton trouve qu'il est sans exemple dans l'histoire que sept rois consécutifs aient régné 214 ans, et regarde la chose connue impossible. Réduisant donc de son autorité privée la durée de chaque reigne à une moyenne de 17 ans, et par conséquent toute la période royale a 119 ans, il reporte l'époque de la fondation de Rome à l'an 630 av. J. C. Mais un tel calcul ne saurait être admis. Si Newton eut vécu de nos jours, il se serait bien gardé de le produire. En effet, les derniers siècles de notre histoire lui eussent fourni une repense à son objection, puisque, si l'on ajoute ensemble les règnes des sept rois Capétiens qui out précédé la révolution française on trouve une durée de 232 ans :
Charles IX, de
1560 à 1371, 14 ans. Or, si Louis XVI n'eût pas vécu dans des temps de troubles, on peut admettre que son règne eût été au moins de 40 ans, ce qui eût fait, pour cette série de princes, une durée de 255 ans, et par conséquent une moyenne de 36 ans 1/7 pour chaque roi. Remarquez d'ailleurs qu'il n'en est pas de la royauté à Rome comme de la royauté héréditaire où le fils, virant concurremment avec son père, parvient quelquefois au trône dans un âge déjà assez avancé : Romulus et ses successeurs étant appelés à régner par la voie de l'élection montent jeunes sur le trône et pensent tous fournir une longue carrière. PRÉFACE. Page 1. - In tanta scriptorum turba. Tite-Live en nomme un assez grand nombre dans le cours de son ouvrage, et entre autres Q. Fabius Pictor, Valerius Antias, L. Pison, Q. Aelius Tuberon, C. Licinius Macer, Coelius, Polybe, etc. Il ne sera pas inutile d'entrer ici dans quelques détails sur ceux de ces écris ails dont Tite-Live a fait plus particulièrement usage dans sa première décade. Je me contenterai presque toujours, dans cette partie de mon travail, de traduire, en l'abrégeant, l'excellente dissertation de M. Frid. Lachmann, de Fontibus historiarum Titi-Livii, Goerttingue, 18.2.2 et 1828,, in-4°. Nous voyons, à en juger uniquement par le témoignage de notre auteur, que le nombre des historiens qui l'avaient devancé était considérable. Il dut nécessairement faire un choix. Or, il n'était pas alors aussi facile que de nos jours de rassembler tout ce qu'on pouvait avoir écrit sur un sujet aussi vaste et aussi important. L'ouvrage de VaIerius Antias à lui seul formait soixante-quinze volumes, et celui de Cn. Gellius au moins quatre-singt-dix-sept. La plupart de ces historiens avaient suivi ou copié leurs devanciers : les comparer entre eux eût été un long travail, dont le résultat n'aurait pas payé la peine. D'un autre côté, un génie comme celui de Tite-Live ne pouvait s'astreindre à entrer dans les plus petits détails à faire de la critique sur tous les faits. La durée de sa vie n'aurait pu suffire à une telle tâche. Aussi, bien que Tiite-Live affirme au chapitre XX du livre IV qu'Il a reproduit le récit de tous les auteurs qui l'ont précédé, ce qui, soit dit en passant, n'est pas exact, puisque le personnage auquel se rapporte celte assertion paraît avoir porté le titre de maître de la cavalerie, et non celui de tribun des soldats, dans les écrivains qu'a suivis Diodore de Sicile (XII, 80, cf. Niebuhr, Roem. Gesch., II, 211), et le porte réellement dans Valère Maxime (III, 2, 4, dans Aurelius Victor (Vir illustr., c. XXV ); bien qu'au chapitre XXI du livre VII, il invoque le témoignage de toutes les annales, une telle assertion ne peut s'entendre que de presque toutes les annales : « Omnium prope annalium, » comme il le dit expressément dans un autre passage (XXII, 31). De même aussi quand il avance qu'un fait ne se trouve dans aucun auteur, cette 768 affirmation doit se restreindre à ceux dont il a fait usage; ce qu'on est suffisamment autorisé à admettre d'après cette phrase (XXXII, 6): « Caeteri graeci et latini auctores quorum quidem legi annales. » Car on ne saurait admettre avec Lévesque (Hist. rom. t. I, p, 18 et 20 ), ni avec Chr. Kruse (Commentat. de fide Livii, Lips. 1811, p. 10 ), que Tite-Live ait compulsé toua les auteurs qui avaient écrit l'histoire avant lui. Pour pouvoir déterminer sur quels écrivains porta le choix de Tite-Live, il sera bon d'examiner, autant du moins que le permettent le petit nombre de fragments que lui ou d'autres nous ont conservés, chacun des historiens qu'il a suivis, de voir quelle estime il fait de chacun d'eux. Par là, on pourra se rendre compte, d'après l'importance des sources auxquelles il puise, du degré de confiance qu'il mérite, de la manière dont il a fait usage de ces documents, et des motifs qui l'ont porté à préférer tel historien à tel autre. Tous avaient rédigé des annales suivies, et aucun n'avait fait de l'histoire des premiers siècles un ouvrage spécial, comme ou le fit plus tard pour des époques postérieures. Claudius avait même omis ou du moins résumé très sommairement tous les faits antérieurs à la guerre contre les Gaulois. D'un autre côté, il ne faut pas croire que les plus anciens annalistes se soient bornés à une sèche et aride analyse des événements, car le jugement qu'en porte Cicéron s'applique surtout à la simplicité de leur style, à la brièveté d'un récit dénué de tout ornement. On ne peut dire non plus qu'ils soient restés entièrement étrangers à la littérature grecque; mais pleins de sincérité, supérieurs à l'esprit de parti et incapables de songer à embellir l'histoire, plus voisins d'ailleurs .de l'antiquité qu'ils retraçaient, et formés aux leçons de l'expérience tant dans l'administration civile que dans la guerre, ils l'emportèrent sur leurs successeurs, qui pour la plupart ne furent ni hommes d'état ni guerriers; et, ce que ne firent pas ces derniers, ils â appuyèrent dans leurs récits sur les monuments publics et privés qui périrent dans la suite par différents événements, et plus encore parce qu'ils furent négligés comme le furent eux-mêmes les historiens qui les avaient consultés, quand on leur préféra des écrivains plus habiles, mais moins amis de la vérité. Le plus ancien des historiens latins, de l'aveu de Tite-Live, est Q. Fabius Pictor, qui dans ses annales latines (il en avait aussi composé de grecques) écrivit l'histoire nationale depuis la fondation de Rome jusqu'à son temps. C'était un homme grave, un sénateur, et Polybe (I, 14), en considérant sa vie et son caractère n'admet pas qu'on puisse croire qu'il ait volontairement altéré la vérité historique. Denys d'Halicarnasse (1V, 6) nous apprend qu'Il jouissait d'une grande autorité chez ceux qui vinrent après lui; quand il le prend pour guide il ne croit pas devoir recourir à un autre témoignage ( VII, 71 ), et quand il s'en écarte il tombe ordinairement dans l'erreur ( IV, 6 et 30). La fin de la seconde guerre punique, à laquelle il avait assisté, l'amour de sa patrie victorieuse, le désir d'en célébrer les exploits l'engagèrent à écrire l'histoire; mais il faut se garder de croire avec Polybe (I, 14, et III, 9), que le patriotisme l'ait rendu partial pour les Romains; de même que de son récit sur Fabius Rullianus (Tite-Live, VIII, 30) il ne faut pas conclure qu'il ait cherché à exagérer la gloire de sa famille. Fabius était très versé dans la connaissance de l'antiquité et des anciens rites sacrés. Il avait écrit seize livres au moins sur le droit pontifical. Beaufort, (de l' Incertitude, etc., I, 10, 11, p. 470 et suiv.), Lévesque (Hist. crit., préf., p. 14, et Mem. de l'lnst., t. II, p..561, 585, etc.), et Niebuhr ( passim) ont prétendu, pour être en droit d'attaquer l'authenticité des premiers siècles de l'histoire romaine, que les annales de cet auteur étaient brèves et succinctes. Cette assertion paraît fondée, si l'on compare avec sa narration de la guerre punique des récits plus étendus. Mais on peut dire que si Denys d'Halicarnasse lui fait un crime de sa brièveté (I, 6) et étend ce reproche à d'autres écrivains, c'est surtout pour faire valoir sa manière large et abondante; telle est du moins la conséquence qu'on peut tirer de son jugement sur Polybe et sur d'autres historiens. Quant à l'opinion de Cicéron (de Orat., II, 12; de Legib., I, 2), elle porte avant tout sur la forme et non sur le fond. Du reste, par plusieurs fragments et surtout par le très long extrait que nous a conservé la traduction arménienne de la chronologie d'Eusèbe (t. I, p. 387 et suiv., éd. d'Aucher), on peut se convaincre que tout ce qui concerne Énée et les premiers temps de Rome était dans Fabius raconté plus longuement que dans Tite-Live. Les faits que ce dernier rapporte dans son livre VI se trouvaient contenus dans le livre IV de Fabius (A. Gell., V, 6; Tite-Live, VII, dernier chapitre), et les emprunts que lui fait Tite-Live (par ex., VIII, 30 ; X, 37 ), prouvent que sa narration n'était pas aussi sèche qu'on l'a prétendu. D'un autre côté, des passages deDenys que nous venons de citer et d'autres encore (I, 80, 83; IV, 30, et VIi, 70), on peut conclure que ses annales grecques étaient suffisamment développées. Fabius, autant qu'il avait pu le l'aire, avait conservé à son livre la forme propre aux annales. Même pour les événements les plus recules, il avait cherché à préciser les dates. Ainsi nous voyons par Plutarque (Rom.,14) qu'il avait placé au quatrième mois l'enlèvement des Sabines, parce que les Consualia se célébraient quatre mois après les Palilia. D'un autre côté, le fragment conservé par Eusèbe prouve qu'il avait cherché à déterminer la seize des rois albains. Quelque opinion qu'on doive se faire de la similitude que Plutarque remarque entre la narration de Fabius et celle de Dioclès, il est constant que Fabius savait le grec, puisqu'il fut envoyé en ambassade à Delphes, et de plus qu'il n'était pas étranger à la littérature grecque, puisqu'Il connaissait l'ère des Olympiades ( Solin. c. II et Denys), puisqu'il avait évalué une somme en talents (Tite-Live, I, 55; cf. Niebuhr, I, 297 ) et que dans ses annales grecques, s'il faut s'en rapporter à Denys (I, 217 ), il exprimait les distances en stades.
L'ère suivie par Fabius pour la fondation de Rome différait de cinq
ans de celle que Caton adopta (Voyez Denys, Solin, Diodore), et ce qui
porte à croire que cette supputation était très ancienne, c'est que la
célébration des jeux séculaires, qui se renouvelait tous les cent ans,
avait lieu dans des années vraiment centenaires, suivant l'ère de Fabius,
et postérieures au contraire de cinq ans à la fin du siècle, d'après le
système de Caton. C'est ce que prouvent les anciens historiens, qui nous
apprennent que ces jeux furent célébrés pour la deuxième fois en 305,
pour la troisième fois en 505 (Cens., de Die. nat., c. XVII), pour la
quatrième en 605 (le même et Zosime, II, 4 ). L. CINCIUS ALIMENTUS, contemporain de Tite-Live ( XXI, 38 ; cf. XXVI, 23 et 28; XXVII, 7 et 39 ), était issu d'une famille plébéienne, il est vrai, mais ancienne et distinguée ( Voy. Festus, voc. Cincia ); ce qui, soit dit en passant, prouve que les anciens écrivains n'étaient pas tous issus de la caste patricienne. Cincius appartenait à l'ordre des sénateurs, il avait exercé la préture et acquis une grande expérience tant dans l'administration que dans la guerre. Particulièrement versé dans la science du droit, il s'était occupé avec fruit de rechercher les antiquités de Rome et des villes de l'Italie, et s'était rendu célèbre par plusieurs ouvrages sur les rites religieux, la jurisprudence et la langue de sa patrie (cf. Niebuhr, I, p. 191).Longolius a prétendu que la part active prise par Cincius aux affaires publiques n'avait pas dû lui laisser le loisir nécessaire pour écrire tous les livres qu'on lui attribue, et, à l'exemple de Vossius ( Hist. lat, c. IV et V ), n'exceptant que les courts mémoires relatifs à la lutte contre Annibal, et surtout à la part que Cincius eut occasion d'y prendre, il attribue tous les autres ouvrages à différents écrivains du même nom. Mais cette opinion ne repose sur aucune preuve. Tite-Live, dans sa troisième décade (XXXI, 38), l'appelle maximus auctor; il ne le nomme qu'une fois dans la première (VIII, 3), et ce qui prouve qu'il avait sous les yeux cet auteur lui-même, et non pas un écrivain qui le citait, c'est qu'il le caractérise par ces mots : diligentissimus latium (id est antiquorum) monumentorum auctor. Denys d'Halicarnasse lui rend la même justice (I, 6 et 74 ). Versé dans la connaissance de la langue grecque, Cincius avait compose dans cet idiome des annales fort étendues qui embrassaient tout l'espace écoulé depuis la fondation de Rome jusqu'à son temps. Un savant allemand, M. Wachsmuth, a conjecturé que Cincius avait écrit en latin, et que Denys s'était servi d'une traduction grecque de cet ouvrage ; mais c'est une erreur : il n'est mention dans aucun écrivain des annales latines de Cincius, et Cicéron, toutes les fois qu'il passe en revue les anciens historiens, qui ont employé la langue nationale, ne fait pas mention de Cincius.
Tite-Live (XXI, 38) a fait usage de Cincius dans la troisième
décade,
pour laquelle il a consulté d'autres historiens grecs que Polybe (XXXIX,
52; XXXII, 6; XXIX, 27 ). Dans la première il le cite rarement, parce
qu'il a, pour celte partie de son ouvrage, préféré les auteurs latins
aux auteurs grecs. II est vraisemblable que Cincius avait, dans ses
annales ainsi que dans tous ses livres, fait preuve de plus d'exactitude
qu'aucun autre, comme par exemple au sujet de la confédération latine
(V. Festus, sub v. Prætor). L'historien qui vient ensuite, car Tite-Live n'a pas fait usage de quelques autres écrivains plus anciens, est L. CALPURNIUS, L. F. C. N. PISO FRUGI, personnage prétorien, consulaire et censorien (censorius) titre qu'ajoutent souvent à son nom les auteurs qui le citent ( Denys, I, 40, Excerpta Maii XII, 10; Censorinus de Die nat. c. XVII; Pline Xlll, 13). Guerrier expérimenté, jurisconsuite habile, orateur assez distingué, homme d'une probité et d'une intégrité reconnues (Cic., Tusc., III, 8; pro Font., c. XIII; Verr., III, 84, IV, 25; Plin., XXXIII, 2; Valer. Max., IV, 5), d'une sévérité antique (Val. Max., II, 7, 9; Frontin, stratag., IV, 1; Oros., V, 6; Paul Diacre, IV, 25), il avait, alors qu'il était tribun, porté la première loi sur les concussions, et avait, dans l'administration des monnaies, mérité la confiance genérale (Pigh, Annal., a.603 et 599 ). Enfin Pline dit de lui (II, 53), que c'est un auteur important (auctor gravis). Ses Annales ou son Histoire, car c'est sous l'un de ces deux titres que l'on désigne indifféremment son ouvrage, s'étendaient depuis la fondation de Rome jusqu'à l'époque où il vivait, il est évident, d'après un passage de Censorin (ch. XVII), qu'elles contenaient l'an de Rome 608: ce qui ne doit pas surprendre, puisque Pison fut consul l'an de Rome 620, l'année où mourut Tibérius Gracchus, où Numance fut détruite. Quelques critiques pensent même qu'il survécut à Marius, et qu'il continua à écrire l'histoire jusque dans un âge très avancé ; mais cette assertion ne repose que sur un passage de Plutarque ( Mar., c. XLIII), où il est question d'un certain Caïus Pison Γαῖός τις Πείσων, qu'évidemment on ne peut confondre avec le nôtre, dont le prénom était Lucius. Du reste, son histoire ne devait pas être divisée en plus de sept livres, puisque dans le septième se trouvait le récit des événements accomplis dans l'année de Rome 596. Censorin., l. c.). Cicéron reproche à Pison son style grêle et sec (Annales exilier scripti, Brut., c. XXVIII; cf. Orat.,II, 12; de Leg. I, 2 ). Aulu-Gelle au contraire (XI, 14) lui trouve une agréable simplicité, tant pour la forme que pour le fond (simplicissima suavitas et rei et orationis ). On peut toutefois juger, par son anecdote sur Romulus et les buveurs (Aulu-Gelle, loc. cit.), qu'il ne s'était pas fait une loi absolue de la concision. La même conséquence peut être tirée du fragment que nous a conservé Denys d'Halicarnasse (IV, 15 ), et d'après lequel on voit qu'il s'était étendu assez longuement sur les anciennes institutions (cf. Varron de L. L. V, 149; Pline, XXXIII, 2, etc.). Ce qui prouverait encore que son histoire n'était pas réduite à des proportions trop mesquines c'est qu'on en lit plus tard un abrégé, si toutefois on peut ajouter foi à l'auteur de Orig. gent. rom, (ch. XVIII); et qu'enfin, dans l'Histoire des Consuls, on trouvait beaucoup de détails que Tite Live a passés sous silence, comme trop minutieux pour figurer dans son cadre ( voyez Pline, XXXIII, 2; Denys, Exc. Maii, XII, 10). On peut donc conjecturer que les sept livres des Annales de Pison avaient urne étendue assez considérable, et l'on cessera d'en douter si l'on songe que dans le premier il était question de l'Italie, des temps antérieurs à la fondation de Rome ( Varron, de R. R., I, p. 258, Gesn.) et des premiers rois; que le second traitait des derniers rois et des premiers consuls; et que le troisième renfermait les événements que Tite-Live raconte dans le dernier chapitre de son livre IX (Auulu-Gelle, Vi, 9). Pour asseoir le jugement qu'on doit porter sur cet historien, il ne faut pas oublier qu'il avait une connaissance très profonde des antiquités et de la religion, soit qu'il eût compose un ouvrage spécial sur ce sujet, soit qu'Il eût traité fréquemment de telles questions dans ses Annales (cf. fragm. ap. Serv. ad Aen. X, 76. Ma- 770 crobe, Sat., I, 12; III, 2. Arnob., III, p. 151 et suiv., Orell. cf. Festus. v. Tarpeia) ; qu'il avait apporté un soin extrême à rechercher les noms des magistrats ( Tite-Live, II, 58; X, 9 ); qu'instruit dans les lettres grecques, il avait inséré dans ses Annales des étymologies grecques ( Varron, de R. R., II, 5, Servius, ad Aen., II, 761), genre de recherches auxquelles on attachait beaucoup d'importance à cette époque. Il fut aussi l'un des premiers qui s'efforcèrent de trouver des explications vraisemblables pour les mythes et les traditions fabuleuses (cf. Niebuhr I, p.242, 245) d'où il résulta que beaucoup de faits étaient présentés dans son livre sous un tout autre jour que dans ses devanciers. ( Denys, II, p. 320; IV, 7, p. 653 et 30. Les Annales, sur lesquelles Denys appuie ses calculs chronologiques dans ce dernier passage sont celles de Pison.) Glareanus, Gronovius et d'autres, d'après Tite-Live (I, 55), trouvant exagérée la somme que, suivant Pison, Tarquin avait mise en réserve pour la construction du temple de Jupiter Capitolin, se sont crus, pour ce motif, autorisés à suspecter la bonne foi de ce vieil historien; mais Niebuhr (t. I, p. 297) a prouvé qu'il était d'accord avec Fabius. Du premier livre (I, 55 ) au dixième (X, 9) Tite-Live cite souvent Pison. Dans le premier passage, il préfère à son témoignage celui de Fabius; dans le second, il l'invoque pour réfuter deux historiens plus récents, Macer et Tubéron. Après Pison se présentent des historiens qui ne prêtent pas encore à leurs écrits le charme du style, mais qui racontant seulement, et d'une manière un peu prolixe, donnent aux fables une apparence historique, et ajoutent à leurs récits beaucoup de détails empruntés aux traditions populaires, aux mémoires des familles, le tout sans beaucoup de critique et avec un excès de confiance: donnant ainsi à l'histoire des proportions beaucoup plus étendues, une forme plus agréable, comme on peut le voir par Denys d'Halicarnasse, qui les a particulièrement suivis, mais avec tous les défauts qu'on doit rencontrer dans un rhéteur. Toutes les fois que dans les dix premiers livres Tite-Live cite Claudius, il doit s'agir de Q. CLAUDIUS QUADRIGARIUS, contemporain de Sisenna; car le Claudius Licinius, ou plutôt Licinus ( voyez Perizon., ad Aelian., Hist. anim., VIII., 549, et Drakenborch, ad Liv. XXVI, 6), qui, cité seulement par le premier de ces deux noms dans la troisième décade et dans les suivantes, ne peut pas toujours être facilement distingué du premier, avait écrit ses livres sur l'histoire romaine (Rerum romanarum libri ), non à partir de la fondation de Rome, mais seulement depuis les guerres puniques, et avait même raconté la seconde avec assez de développements. Il est fort douteux que ce soit Claudius Quadrigarius qui ait traduit en latin les Annales Grecques d'Acilius. Tite-Live (XXV, 39; XXXV, 14) distingue le traducteur d'Acilius de Claudius Quadrigarius, qu'il cite souvent sans ajouter ce second nom (XXXIII, 10; XXXVIII, 41 et 23; XLIV, 15). Les Annales que Tite-Live consulte dans ces différents passages ne sont pas, suivant M. Lachmanu, la traduction d'Acilius, comme on le croit généralement, mais l'ouvrage même de Claudius. Dans la première décade Tite-Live ne parle pas de version latine, et les Annales ou l'histoire de Quadrigarius commençaient à la guerre contra les Gaulois, tandis que celles d'Acilius remontaient jusqu'aux origines de Rome (auvt. Orig. gent. rom. c. x, et Denys, III, 77, p. 581 ). Or de ces Annales qui racontaient au livre XIX le septième consulat de Marius, dont Claudius était contemporain (Aulu-Gelle, X, 1 ), et s'étendaient même plus loin, puisque Aulu-Gelle (X, 15) en cite le livre XXIII, Tite-Live ne put consulter que les deux premiers livres pour la seconde partie de sa première décade, à partir de l'invasion gauloise, puisque le troisième contenait l'époque de Pyrrhus (Aulu-Gelle, III, 8 bis ). Mais il ne crut pas pouvoir se dispenser de recourir à l'ouvrage de cet excellent et véridique historien (optimi et sincerissimi scriptoris, nom que lui donne Antonius Julianus dans Aulu-Gelle, XV, 1 ; cf. Fronton, XIII, 27, et Jan. Gebhard, Antiq. lect. II, 5), ouvrage écrit d'un style large, pur et brillant (purissime atque illustrissime scriptum, Aulu-Gelle, IX, 15 ). A en juger par les fragments qui nous restent de cet auteur, il faut peut-être rabattre un peu d'un tel éloge, et reconnaître que le style de Claudius était prolixe et avait quelque chose de l'emphase oratoire, ce qui ne doit pas donner, puisque Claudius, au témoignage de Nonius (v. Horrea), s'était fait connaître comme orateur. Tite-Live a fait souvent usage de Claudius, et même pour des faits omis par d'autres écrivains (VIII, 19); mais il ne s'en sert qu'avec précaution et même ajoute plus de confiance à plusieurs auteurs (VI, 42 ). Parfois il le réfute (IX, 5 );d'autres fois, sans le suivre ( VIII, 19 ), il ajoute à son propre récit quelque donnée fournie par lui; et enfin ailleurs (X, 57) sans prendre Claudius et Fabius pour autorités, il les cite cependant l'un et l'autre. Q.VALERIUS ANTIAS dont le surnom, propre à la famille Valérie (Tite-Live, XXIII, 54), ne saurait prouver qu'il était né à Antium, ou qu'il avait favorisé les habitants de cette ville (Tite-Live, III, 5), vivait sans aucun doute du temps de Sylla (cf. Velleius Paterc., II, 9; Vossius, Hist. lat., p. 45; Perizon ad Aelian., H. Anim., VI, p. 216 ). lI avait conduit son histoire depuis la fondation de Rome jusqu'aux temps de Sylla. Elle devait être comprise dans un grand nombre de livres, puisque Priscien (IX, p. 468, Krehl) cite le soixante-quatorzième, et Aulu-Gelle (VII, 9) le soixante-quinzième. Il paraît aussi qu'elle s'étendait longuement sur l'époque mythique, car c'était seulement dans le second livre qu'on trouvait le règne de Numa. Jaloux d'augmenter la gloire de sa famille et celle des Romains, Valérius se laissait aller à l'amplification, et avide de présenter des faits nouveaux et merveilleux ( Pline, II, 107), il mérita le reproche de ne s'accorder pour certains détails avec aucun historien (Aulu-Gelle, VI, 8; VII, 19) ; du reste, recherchant avec soin les fables et même les étymologies grecques, mais avec assez peu d'exactitude, et faisant par exemple dériver Ancus d'ἀγκών. Tite-Live, dans les parties différentes de son ouvrage qui nous sont restées, fait mention de Valerius Antias. Toutes les fois qu'il parle des jeux Séculaires, il s'appuie sur les calculs de cet auteur, qui diffèrent de ceux qu'on trouvait dans les autres historiens. Nul doute que dans la première décade il ne l'ait souvent suivi, bien qu'il prononce rarement son nom; nul doute qu'il n'ait adopté ses prolixes récits, en les abrégeant, il est vrai, mais seulement quand ils étaient d'accord avec la narration plus succincte d'historiens antérieurs. Car il se déliait de sa véracité et de son exactitude, et lui reproche plus d'une foie d'avoir exagéré les nombres (III, 5 ; cf. Oros., IV, 20 ; V, 3). 771 Il faut aussi ranger parmi les historiens d'une époque plus récente C. LICINIUS MACER, ami et contemporain de Sisenna (Cic., de Leg., I, 2), le même, suivant toute apparence, qui fut ennemi de Rabirius et que Cicéron condamna pour concussion (Cic., ad Att., I, 4; Plut., Cic., c. IX). En effet, tout ce que Cicéron dit de l'historien dans le livre des Lois (loc. cit.) s'accorde avec ce qu'il dit de l'orateur dans le Brutus (c. LXVII ). Or, l'orateur n'est autre que le prêteur condamné par Cicéron (cf. Valer. Maxim., IX, XII, 7 ). Licinius Macer ne vécut pas dans l'obscurité; il fut questeur (cf. Pigh., a. 675), et commanda une armée en qualité de prêteur ( Voyez sa lettre an sénat, dans Nonius Marc., p. 259, Merc. v. Contendere). Esprit ardent et énergique, orateur véhément, connu par les troubles qu'il excita comme tribun du peuple, il écrivit des annales qui s'étendaient depuis la fondation de Rome jusqu'à l'époque où il vivait. Son style était diffus, ce qui lui mérita de la part de Cicéron de graves reproches : par exemple celui de bavardage prétentieux, d'abondance ridicule et qui va jusqu'à l'impudence dans les discours qu'il prête à ses personnages ( de Legib., 1, 2 ). Mais peut-être Cicéron jugeait-il son ennemi avec une injuste partialité. Denys d'Halicarnasse, qui a fait de nombreux emprunts à Macer, paraît au contraire l'avoir fort goûté, précisément à cause des développements dont Cicéron lui fait un crime, comme aussi pour avoir inséré dans le cours de son récit des considérations et des réflexions nombreuses. Et ce qui prouverait l'impartialité de ce jugement, c'est qu'il ne s'aveugle pas sur ses défauts, et blâme en lui l'absence de critique et de graves erreurs de chronologie (VI, 11 ; VII, 1. Voyez plus bas les notes sur Tite-Live, IX, 46, et un exemple de confusion dans les dates, II, 34 ). Macer avait traité longuement des temps les plus anciens et des villes de l'Italie ; mais il avait adopté les fables grecques. Il fallait qu'il fût bien peu initié dans les antiquités romaines pour avoir regardé comme fabuleuse l'année de dix mois, et prétendu que sous Romulus l'année était delà de douze mois avec intercalation. Cependant il avait tenu compte des monuments, consulte les livres Linteens, noté les points sur lesquels ils différaient des anciennes annales, et enfin fait usage des traités pour asseoir ses affirmations historiques (Tite-Live, IV, 7, 20 et 25 ). Tite-Live l'a souvent consulté, mais avec précaution; et soupçonnant qu'il a pu sacrifier la vérité à la gloire de sa famille, il lui préfère des historiens plus anciens (VII, 9; cf., IX, 46, et X, 9 et 11). Vient ensuite AELIUS TUBERON, que Tite-Live cite fréquemment. Vossius (de Hist. lat., I, 12) et tous ceux qui l'ont suivi, tels qu'Harles, et même Ryckius (De primis Ital. colon., p. 439), et Hardouin (Ind. script., Plin.), ont cru que le Tubéron consulté par Tite-Live était Lucius Tubéron, contemporain et parent de Cicéron, et lieutenant de son frère Quintus en Asie. Mais on a peine à concevoir qu'ils soient tombés dans cette erreur, et qu'ils n'aient pas remarqué que l'historien en question portait le surnom de Quintus, que Tite-Live lui-même lui donne (IV, 23 ), et qui lui a été conservé dans l'index des auteurs cités par Pline (l, II et XXXVI). Or ce prénom était celui du père et du fils de Lucius. On ne trouve nulle part que le père, stoïcien rigide, disciple de Panétius (Voy. Van Lynden, diss. de Panaetio, § 13 ), et suivant Cicéron ( Brut., 51), dur, austère et négligé dans son langage comme dans ses moeurs, ait jamais écrit l'histoire, genre d'études qui devait répugner à le sévérité de ses principes. Certes, si l'historien du même nom eût été petit-fils de Paul-Émile par sa mère, et contemporain de Rutilius (Cic., ad Att., IV, 16; XV, 4) Tite-Live, en citant ses autorités, ne le placerait pas après Licinius Macer, beaucoup plus récent que le personnage en question (IV, 23; X, 9 ), et Cicéron, qui (Brut., 31), en parlant de ses écrits, affirme que quelques-uns de ses discours existaient encore de son temps, n'aurait pas gardé le silence sur un ouvrage aussi important qu'une histoire. D'après ces considérations, M. Lachmann pense que l'histoire dont il s'agit est l'oeuvre de Quintus, petit-fils du stoïcien, de l'accusateur de Ligarius (Cic. Orat., et Quintil., X, t, 3; XI, I, 80), qui plus tard abandonna les études historiques pour la jurisprudence (Pompon. in DD. de Or. jur., II, 46; cf. Bach, Hist. jur., II, § 50 et DD). Il paraît que ce travail, commencé par son père et interrompu par les troubles civils au milieu desquels celui-ci s'était trouvé jeté, avait été transmis à Quintus comme un héritage, avec recommandation de l'achever ; et en effet, Ciceroni se borne à dire de lui qu'il se mit à écrire l'histoire. Denys d'Halicarnasse, son ami, et qui lui avait dédié son jugement sur Thucydide (voyez le début et la fin de cet opuscule, et le commencement de la lettre à Ammaeus sur Thucydide, où il donne à Tubéron le surnom de Κόιντος, vante son talent et le soin qu'il apporte à ses recherches historiques. (Ant. rom., I. 80, δεινὸς ἀνὴρ καὶ περὶ τὴν συναγωγὴν τῆς ἱστορίας ἐπιμελής. ) Son histoire commençait à la fondation de Rome, mais il y avait donné place aux traditions troyennes ( Serv., ad Aen., II, 15; Or. gent. rom., c. XVII), et traitait dans son introduction de la manière d'écrire l'histoire. ( Nonius, v. protinus, p. 376, Mercer ). Nonius en cite le livre XiV (v. Luxuriabat ); et un passage d'Aulu-Gelle (VI, 3 et 4) prouve qu'il avait raconté la guerre contre Carthage. Suétone a fait usage de Q. Tubéron pour un fait relatif à Jules César (Jul. Caes. c. LXXXIII), si toutefois ce fait n'a pas été extrait du livre que Tubéron avait adressé à C. Oppius (Aulu-Gelle, VIll, 9). Tubéron était de son temps renomme comme historien, et surtout pour le soin avec lequel il recueillait et comparait les anciens auteurs, et même les monuments. I1 est hors de doute qu'il consulta les livres Lintéens, mais avec réserve; et là où les anciens écrivains n'étaient pas d'accord, il ne les suit qu'en hésitant. Tite-Live le dit expressément (IV, 2) ; et ceux qui voient dans les mots et Tubero incertus veri est un reproche fait à l'historien comme peu digne de foi, ne saisissent pas bien le sens de ce passage. Tubéron expliquait les mythes sous le point de vue historique ( Serv., ad Aen., Il, 15 ), et s'était occupé avec soin des institutions de Rome. (Aulu-Gelle, X, 28.) Il était habile politique, bon orateur; mais son goût pour l'antiquité lui faisait rechercher avec trop de soin les formes de l'ancien langage ( Pompon., in D. loc. cit.) C'est pour ces différents motifs que Tite-Live, bien qu'en général il s'attache aux historiens d'une époque antérieure, crut devoir consulter Tubéron son contemporain. Il préfère, il est vrai, dans un ou deux passages (X, 9 et 11) l'autorité de Pison à celle de Tubéron et de Licinius Macer; mais dans beaucoup d'autres, bien qu'il ne le cite pas, il paraît l'avoir pris pour guide. Tels sont les historiens que consulta Tite-Live pour rédiger sa première décade. Il les cite tous au vingt-troisième chapitre du livre IV, là où aux historiens plus anciens, Fabius, peut-être Cincius et Pison, il oppose Tubéron . Valérius Antias et Licinius Macer. S'il ne 772 parle pas de Claudius c'est que l'ouvrage de ce dernier commençait plus tard. Avant d'examiner quel usage Tite-Live a dû faire des ressources historiques qu'il avait à sa disposition, disons quelques mots des auteurs qu'il a négligés, soit parce qu'ils lui paraissaient avoir trop peu d'importance, et qu'il voulait éviter des frais inutiles, soit enfin parce qu'il n'avait pu se les procurer : c'est du moins ce qu'on peut conclure de la comparaison des fragments qui nous restent de ces écrivains, avec le texte même de Tite-Live, puisqu'il est constant qu'un savant dont l'autorité est certes très grave n'a jamais été consulté par lui, bien qu'il ait eu plus d'une fois occasion de le citer, et que l'opinion et le témoignage de cet arbitre imposant eussent pu lever les doutes où le jetait le désaccord de tonales autres. Il s'agit, on le voit de M. CATON, de Caton aussi remarquable par sa connaissance de l'antiquité que par son expérience de tout ce qui s'était fait tant dans la paix que dans la guerre; de Caton qui avait scruté avec soin les annales de Rome, et même celles de l'Italie, écrivain tout à la fois savant et plein de charme, que Salluste appelle le plus habile écrivain de la littérature romaine, auquel Tite-Live lui-même (XXXIX, 40) donne de dignes éloges, et qu'il aurait dû prendre, sinon pour guide, du moins pour conseil dans plus d'une circonstance. En effet, dans le premier livre de ses Origines, qui contenait toute cette partie de l'histoire romaine renfermée par Tite-Live dans sa première décade, Caton traitait des événements qui avaient précédé et suivi la fondation de Rome, des mythes, des institutions; il racontait l'histoire des rois et des consuls avec assez de développements et de soins, comme on peut en juger par le fragment relatif à Mamilius (Priscian, VI, p. 244, Krehl ) et se rapportant aux faits racontes par Tite-Live ( III, 18 et 19); par le fragment qui concerne Cédicius (Anis Gelle, III, 7), et par d'autres encore. Tite-Live ne parle de cet ouvragre que parvenu à l'époque où Caton a vécu; il y fait alusion au chapitre XV du livre XXXIV, en fait mention dans le discours de L. Valérius contre Caton (XXXIV, 5), et le cite au chapitre XXV du livre XLV, et Épitomé, 49. Si, dans la première partie de son ouvrage, il eût consulté Caton, il y eût trouvé des documents bien préférables à ceux qu'il a suivis : c'est ce dont on peut se convaincre par quelques fragments. Ainsi, au chapitre XXII du livre I, Cluilius, auquel Tite-Live donne le titre de roi des AIbains, ne portait dans Caton que celui de préteur, ce qui peut seul faire comprendre comment, après sa mort, les Albains nommèrent un dictateur (cf. Licinius Macer dans Denys d'Hal., V, 74), etc. Comment a-t-il pu se faire que Tite-Live ait négligé un écrivain de cette importance? C'est une question difficile à résoudre. Peut-être quand il commença à ecrire ne connaissait-il pas la supériorité du mérite de Caton, sur laquelle tous les Romains n'étaient pas d'accord, puisque Cicéron établit une discussion à ce sujet entre Atticus et Brutus. De plus, dans les Origines, beaucoup de récits étaient très sommaires (Corn. Nep., Cat.,5); elles renfermaient, comme le dit Salluste, beaucoup de choses en peu de mots(multa paucis absolvens), et s'occupaient beaucoup plus des faits que des noms ( Corn. Nep., loc. cit.; cf. A. Gell., III, 7; X, 24, les fragm. de Caton et Plin., VIII, 5.) Enfin le titre de ce livre devait peu fixer l'attention d'un écrivain qui recherchait surtout les annales. Du reste, Tite-Live adopta l'ère qui porte le nom de Caton, soit qu'en cela il ait suivi ses historiens de prédilection, soit que celte supputation fût alors généralement adoptée, comme plusieurs données recueillies par M. Lachmaun doivent nous porter à le croire. Tite-Live a également negligé, sans doute comme trop récent, SULPICIUS GALBA, auteur d'une histoire très développée (Plut., Rom., 17; Oros. IV, 25; Corn. Nep Annibal, 13; Suétone, Galb., 5 : multiplex nec incuriosa historia ). Il ne paraît pas non plus avoir connu les annales de SCRIBONIUS LIBON dont Cicéron cite le livre XI V, ni CASSIUS HEMINA (Voy. Maffei, Verona illustrata, Il, 25, sqq.), qui florissait vers l'an de Rome 608 (115 ans av. J.-C), et qui, commençant son ouvrage à la fondation de Rome, l'avait conduit jusqu'à son époque, ou du moins jusqu'à la seconde guerre punique. Ce livre portait, suivant les uns, le titre d'Annales, suivant d'autres, celui d'Histoire, et était assez étendu. Ainsi, par exemple, le livre I contenait les faits antérieurs à la fondation; le livre II, l'histoire de Romulus, de Numa, etc., et l'époque consulaire traitée probablement d'une manière plus succincte, puisque dans ce même livre se trouvait l'année 335 où Rome avait été détruite (Macrob., I, 16 ). Pline l'appelle un très ancien historien. Ainsi que nous l'apprennent ses fragments, il avait beaucoup emprunté aux livres sacrés et aux traditions, et s'il a eté laissé de côté par Tite-Live, c'est peut-être parce qu'il avait recueilli les fables avec trop de soin, et qu'il avait donné pour les noms de villes les étymologies les plus absurdes. Tite-Live n'a pas non plus fait usage de C. SEMPRONIUS TUDITANUS, que Denys d'Halicarnasse appelle le plus savant des historiens romains λογιώτατον τῶν Ῥομαίων συγγρεαγέων, et dont les mémoires commençant à la fondation de Rome (Macrob., I, 16) avaient, au livre Xlii (cf. Pline, XIII, 13), atteint l'an 571 (182 ans av. J.-C.), et s'étendaient probablement au delà. Un fragment de Tuditanus, conservé par Asconius (ad Cic. pr. Cornel., p. 138, Cren.), s'accorde avec le récit de Tite-Live (II, 53) qui cependant ne l'avait pas mis à contribution, non plus que les Historiae communes de Lutatius. (Cf. Vossius, Hist. lat., I, 12.)
Ce fut peut-être un avantage pour lui, attendu l'insuffisance de la
critique dont il fait preuve, que de n'avoir pas consulté divers écrits
plus récents et fort étendus, tels que les annales d'A. POSTUMIUS
ALBINUS, écrivain léger et bavard ; son livre sur l'arrivée d'Énée
(Polyb. excerpt., I, 28), et le grand ouvrage de CN. GELLIUS, dont
Denys, son imitateur, nous a conservé plusieurs passages assez
ridicules. Mais il faut regretter qu'il n'ait pas eu recours aux
savantes annales de VARRON qui commençaient à l'an 1 de Rome, et
devaient être assez développées, puisque dans un fragment du livre III,
conservé par Charisius, il est question de Servius Tullius. On devait
aussi y trouver les preuves qu'il invoquait à l'appui de l'ère nouvelle
qu'il avait introduite. Il est également fâcheux que Tite-Live n'ait
connu ni le livre où Varron racontait les commencements de Rome (Quintil.,
I,7), si toutefois cet ouvrage ne doit pas être confondu avec les
annales, ni enfin les antiquités du même auteur, mises à profit par
Denys d'Halicarnasse. Varron et d'autres écrivains plus récents avaient
jeté beaucoup de clarté sur plusieurs points de l'histoire; beaucoup de
faits voilés par la religion, et que les historiens antérieurs n'avaient
pas pu ou du moins n'avaient pas ose divulguer, avaient avec le temps
été mis en lumière et allégués pour expliquer l'histoire. Ill semble résulter de plusieurs allusions aux événements de son temps, que Tite-Live écrivit au commencement du règne d'Auguste. S'il eût écrit vingt ou trente ans plus tard, il eût sans doute adouci les plaintes que lui inspirent dans sa préface et l'aspect des maux de sa patrie, et une époque ou le remède est devenu aussi insupportable que le mal (ce qui semble s'appliquer à l'assassinat de César, cf. 1V, 6), et le souvenir récent des guerres civiles, fléau toujours plus funeste aux états que la guerre étrangère, que la famine, que les épidémies, que tous les maux qu'on attribue au courroux des dieux (IV, 9; cf. IX, 19), et enfin l'affaiblissement des forces de la république (VII, 9 et 25). Le passage relatif à la restauration du temple de Jupiter Féretrien, par Auguste César, même lorsqu'on ne le regarderait pas comme ayant été intercalé plus tard, peut avoir été écrit d'assez bonne heure. En effet ce fut par le conseil de Pomponius Atticus, mort en 721 ( Corn. Nep., Att. 20 ), qu'Auguste releva le temple en question, et tous ceux dont Tite-Live l'appelle le restaurateur furent presque tous réparés en 726 (cf. Dion. Cass., LIII, init., ainsi que les interprètes d'Horace, III, od. 6 et ceux du monument d'Ancyre); les temples qui furent élevés par lui ne le furent que plus tard (Suéton, Aug., 19, 30). Au chapitre XXXVI du livre IX, Tite-Live représente la forêt Cimima comme plus inabordable et plus horrible que ne l'ont été récemment les bois de la Germanie. Appliquer ce passage aux expéditions de Drusus ou de Germanicus ce serait trop rapprocher l'époque où Tite-Live écrivit son histoire; il parait donc beaucoup plus convenable de l'entendre de Jules César, qui à la vérité ne pénétra pas dans ces sombres retraites, mais les fit un peu mieux connaître. Peut-être même, et c'est l'interprétation la plus vraisemblable, veut-il dire seulement que la forêt Ciminia était autrefois aussi inaccessible que l'avaient été récemment, pour César, les bois de la Germanie. Du reste, le livre XXVII (ch. XII) ne peut avoir été écrit avant l'année 734, où Agrippa vainquit les Cantabres (Velleius Paterc., 90, cf. 96; Flor., IV, 12; Dion. Cass., LIII, 22 et suiv.; MIV, 11 ); car si Tite-Live eût fait allusion à l'expédition d'Auguste coutre ce peuple en 729 il en eût parle d'une autre manière. On voit, par ce qui précède, que si Tite-Live a négligé, non pas seulement des écrivains d'une valeur secondaire, mais même des auteurs qui n'étaient pas à dédaigner, il a eu recours à un assez grand nombre d'historiens éminents; que parmi ces derniers, quelques-uns sont très anciens et d'un grand poids; d'autres, plus récents et d'une moindre autorité. Il reste à examiner, autant qu'il est permis de le faire, comment il a combiné ces différentes sources et celles où il a puisé dans chacune des parties de son ouvrage. D'abord il est constant qu'il ne suit pas continuellement un seul et même livre, se contentant de jeter un regard sur les autres, d'ajouter à son écrit les notions nouvelles qu'ils présentent, ou de signaler les variantes qu'on y rencontre. Ses sources varient continuellement, souvent même il en consulte plusieurs à la fois, surtout dans le première décade, qui, renfermant une moins grande abondance de faits, se prêtait plus facilement à ce genre de travail, et d'ailleurs parce qu'il lui manquait un guide tel que Polybe. En effet, aucun écrivain, en comparant les assertions de ceux qui l'avaient précédé, n'avait introduit le flambeau de la critique dans ce chaos de traditions si diverses, et aucun historien latin ne paraissait à Tite-Live digne d'autant de confiance que Polybe. Aussi le voit-on rapporter souvent quatre opinions différentes empruntées à différentes annales; quelquefois même il affirme les avoir toutes examinées. On ne peut donc, que pour chaque passage isolé, connaître quel écrivain il suit de préférence aux autres, et nous établirons d'autant plus sûrement cette distinction, que Tite-Live, du moment qu'il adopte un récit, le suit scrupuleusement jusqu'an bout. C'est ce dont ou peut se convaincre par plusieurs passages, où, après avoir raconté un fait, il revient sur les détails, qu'il corrige d'après d'autres écrivains. Quant au jugement qu'on doit porter sur les passages dont les sources ne se font reconnaître par aucuns signes certains, voici quelques observations que nous croyons devoir soumettre à nos lecteurs. Toutes les fois que Tite-Live ne nomme pas son autorité, c'est qu'il s'en rapporte à l'opinion unanime des historiens, ou à la tradition vulgaire. Sur plusieurs points où les historiens différaient de sentiments, comme par exemple les origines de Rome, et même des événements postérieurs, une opinion vulgaire avait prévalu, opinion gravée dans la mémoire des hommes, transmise par la parole, ou confirmée par les cérémonies du culte. Cette opinion, il la présente comme la plus répandue, vulgationem famam (I, 7) frequentiorem famam (Il, 35, où il la préféré au récit de Pison ), et la met en avant même au sujet de Scipion. C'est à elle qu'il faut s'en tenir, suivant lui, pour les temps reculés; il l'avait retrouvée, sinon dans plusieurs historiens, du moins dans quelques-uns et c'est elle qu'il suit, particulièrement dans le premier livre comme dans tous les passages où il rencontre des variantes. C'est pour ce motif que souvent, malgré l'extrême différence de la forme, il est tout à fait d'accord avec Denys d'Halicarnasse. Tite-Live, au chapitre II du livre XLV et au chapitre II 774 du livre XLII, nous fait connaître les principes qui le guident dans la comparaison des sources et dans la preférence qu'il accorde à tel ou tel écrivain. » Cette assertion, dit-il dans le premier passage, est celle d'un plus grand nombre d'historiens qui appartiennent à une époque plus rapprochée du souvenir des événements; « et dans l'autres » Les annales d'un plus grand nombre d'écrivains dignes de plus de confiance attestent qu'Eumène vint lui-même à Rome. Lorsque les auteurs contemporains lui manquent, comme il s'en plaint au chapitre XL du livre VIII, et que les récits diffèrent entre eux, c'est toujours à l'antiquité (vetustati) qu'il s'en réfère. Voilà pourquoi, au chapitre IX du livre VII, les plus anciens auteurs gardant le silence sur le fait qu'il rapporte, il le déclare douteux, bien qu'il le rencontre dans la plupart des autres (voyez encore VIII, 26; cf. I, 44, 55; Il, 18, 21; VIII, 50; X, 9, 46), Néanmoins il tient grand compte de la multiplicité des témoignages (I, 24 ; II, 32; Ill, 23 ; VI, 42), et même au chapitre XLVI du livre I, il rejette une assertion de Pison, tout ancien qu'il est, parce qu'elle est unique ( voyez Denys d'Halic., IV, 7 ), et bien qu'elle pût lever une difficulté, faire disparaître une erreur historique et chronologique. Au chap .IX du livre X où Macer et Tubéron contredisent Pison, il laisse la question incertaine. Ainsi donc, Tite-Live parait avoir constamment suivi l'opinion qui avait pour elle les autorités les plus nombreuses et surtout les plus anciennes, Mais quand les faits étaient racontés trop brièvement,il a eu également recours à des écrivains plus récents, dont le récit était plus développé. Quelquefois même il a emprunté à ces derniers des données que ne fournissaient pas les autres, surtout lorsqu'il pouvait se rendre compte des motifs de l'omission (II, 8; VIII, 18). ll arrive aussi qu'il raconte les faits autrement que les anciens historiens (que Fabius, par exemple, voy. X, 57 ), et qu'il préfère un récit plus long à une narration trop courte; toutefois jamais au hasard, mais toujours guidé par la vraisemblance et par d'autres indices. De cet aperçu rapide et surtout de l'indication que nous allons donner des sources où Tite-Live a puisé pour chacune des parties de son ouvrage, il résulte avec évidence que cet historien ne mérite pas le reproche de légèreté poétique qu'on lui a trop souvent adressé; qu'à l'exception de quelques concessions faites à l'orgueil national, et moins importantes peut-être qu'on n'a bien voulu le croire, il n'a jamais volontairement altéré les faits; qu'il s'est proposé des règles de critique, imparfaites sans doute ou plutôt incomplètes, et qu'enfin il a été constamment guidé par ce besoin impérieux de tous les historiens dignes de ce nom: la recherche de la vérité. PAGE 2. - Ea nec affirmare nec refellere in animo est. On voit que Tite-Live n'attache pas une grande importance aux fables dont l'orgueil national avait embelli les premiers documents de l'histoire romaine. S'il les reproduit, c'est qu'elles impriment à la naissance de la ville éternelle un caractère plus auguste. L'important à ses yeux c'est de connaître la vie et les moeurs des premiers Romains, de savoir par qui a été fondée et agrandie la puissance de Rome. Ce passage et quelques autres qu'on pourrait citer (p. e. XXI, 62; XLIII, 13) ne suffisent-ils pas pour prouver que Tite-Live s'est fait un devoir d'une critique aussi rigoureuse qu'elle pouvait l'être à l'époque où il écrivait, et qu'il n'a pas accepte et employé en aveugle les traditions que lui avaient transmises ses devanciers. Du reste, on ne saurait trop affirmer le sentiment de haute moralité qui l'a porté à écrire la vie du premier peuple de la terre, principes terrarum populi, et l'on partage malgré soi la tristesse dont il est saisi au souvenir de tant de gloire et à la vue de tant de corruption. IBID. - Si, ut poetis, nobis quoque mos esset. Les poètes n'étaient pas les seuls qui commençassent par invoquer les dieux. Voyez l'exorde du discours de Démosthène pour Ctésiphon, la préface de Valère-Maxime et les notes de M. Hase sur ce dernier auteur, pages 5 et 4. IBID. - Jovem indigetem appellant. Les héros qui, pour les services rendus par eux à l'humanité, avaient reçu après leur mort les honneurs de l'apothéose, étaient ap¬pelés par les Grecs θεοὶ χθόνιοι ἐγχώριοι, τοπικοὶ, ἐντόπιοι, πατρῷος et par les Romains dit indigetes ou patrii. Dii patrii, indigetes et Romule Vestaque mater. VIRG., Geor.,I, 498. On n'est pas d'accord sur l'origine du mot indigetes. Les uns le font venir d'ιndigeo, parce que les dieux n'ont besoin de rien, ou parce que les hommes en ont besoin, ce qui est une étymologie absurde; d'autres de indu pour in et de ago avec le sens d'habiter; d'autres enfin comparent ce mot avec le verbe indigetare ou indigitare invoquer, prier, de indu et de cito, et mieux peut-être de in et de digitus (comp. ἐνδειχθείς). Suivant cette dernière étymologie, les dieux indigètes auraient été ainsi appelés parce qu'ils n'étaient dieux que par une sorte de désignation publique et non pas par droit de naissance. Mais l'opnion la plus vraisemblable est celle qui fait dériver ce mot de endo et de geniti, nés dans le pays où on les adorait, comme en grec θεοὶ ἐγγενεῖς (Soph. Antig., v. 199, etc., et M. Leclerc, ouvr. cité, p. 156 ). LIVRE I. Tite Live, dans ce livre où il reproduit les traditions vulgaires, a, comme on devait s'y attendre, fait surtout usage de Fabius Pictor, le plus ancien historien romain (scriptorum antiquissimus ), qu'il se contente de nommer soit seul (ch. XLIV), soit avec Pison (ch. LV), et lui accorde, dans le récit des événements les plus reculés, plus de confiance qu'à Pison, qui, faisant disparaître la couleur mythique que Tite-Live a cru devoir conserver, s'était attaché à présenter les faits sous un point de vue tout moderne, et avait modifie les mythes en les expliquant, ou même en avait présente d'autres. Cependant les sources auxquelles il pulse ne se bornent pas à ces deux auteurs. Dès le début il déclare que ses autorités sont nombreuses. (Voy. chap. I, III, VII, XI, XXIV, XXXI, XXXVIII, XLIV, XLVI, XLVIII.) S'attachant surtout aux documents antiques, il néglige les récits plus récents et plus développés que Denys d'Halicarnasse a admis, et raconte beaucoup de faits tout autrement que lui. Dans l'histoire antérieure à la fondation de Rome, il paraît avoir suivi Fabius; c'est du moins ce qu'on peut conclure d'un long fragment de cet auteur conservé par Eusèbe dans sa Chronologie (t. I, p.587 et suiv. de l'ed. d'Aucher), où l'on retrouve sur les Troyens, sur Énée, sur la suite des rois albains, des notions conformes au texte de Tite Live, quoique plus étendues, mais entièrement différentes du récit de Denys et des autres historiens. Ils se rencontrent encore en ce point que Tite-Live voit comme lui dans le miracle des trente marcassins l'indication, non 775 de trente colonies, mais de trente années, interprétation déjà adoptées du temps de Ptolémée Philadelphe par Lycophron (Cassandr. 1235) et par plusieurs Romains. Du reste, l'origine troyenne de Rome était admise bien longtemps avant Fabius. Le premier monument public où elle soit mentionnée est, autant qu'on peut le savoir, la célèbre colonne de Duilius. Antérieurement à Polybe, Postumius Albinus avait composé un ouvrage spécial sur l'arrivée d'Enée en Italie. CHAP. I. - On comparera avec intérêt les premiers chapitres de ce livre avec les chants I, VI, VII et VIII de l'Énéide. Il existe un étonnant rapport entre les fables du poète et celles de l'historien. IBID. - Sur Pylémène, chef des Hénètes. Voy. Hom., Ilad., II, 851 ; il fut tué par Ménélas, V , 576 et suiv. IBID. - Sur les Euganéens. Voy. Pline, Hist. nat., III, 23 et 21; Silius Italicus, VIII, 604; Martial, IV, 25. IBID. - Pagoque inde trojana nomen est. Pagus répond à notre mot français canton; il était composé de plusieurs villages vici. La réunion de plusieurs pagi formait ce que Tite-Live appelle ici gens. CREVIER. IBID. - Duplex inde fama est. Des deux traditions rapportées par Tite-Live, la dernière paraît être fort ancienne. Voyez Caton. cité dans Orig. gent. rom.,c. XIII. CHAP. II.- Caere, ville pélasgique, d'abord sous le nom d'Agylla, puis plus tard soumise à l'Étrurie. Aujourd'hui Cervetri. Il n'en restait que des ruines du temps de Tite-Live. Voy. Strabon , l. V , p. 220. IBID. - Aeneas adversus tanti belli terrorem. Comparez Denys d'Halicarnasse, I, 59, 60. IBID. - Numicium flumen, aujourd'hui Rivo di Nemi. Suivant Denys d Halicarnasse, I, 64 , le corps d'Énée ne fut pas retrouvé. Comp. Ovide, Met. XIV, 600 et suiv.; Tibulle, II, V, 45. IBID. - Jusque fasque est. L'usage était de changer les noms des mortels mis au rang des dieux. Ainsi Romulus prit le nom de Quirinus; Melicerte, celui de Palemon, etc. CREVIER. CHAP. III.- Hiccine fuerit Ascanius an major quam hic. Fabius ne parle pas d'une double tradition. D'autres historiens le disaient né d'une Troyenne; mais pour ne pas attribuer aux roi d'Albe une origine étrangère, ils lui donnaient pour successeur son frère Silvius , né de Lavinie. (Voy. Fabius, loc. cit.; Lutatius et Tubero in Orig. gent. rom.; Denys. d'Hal.; Festus, v. Sivii: Cato ap. Servium.) Tite-Live, en le faisant fils de Lavinie et père de Silvius, augmente d'une génération la série des rois albains. Quelle autorité a-t-il suivie à cet égard? On l'ignore. Servius (ad Aen., I, 274) tient cette assertion pour une cireur. La plupart des historiens prétendent qu'Ascagne continua la guerre, et que ce fut lui qui donna la mort à Turnus. Peut être Pison racontait-il les faits comme Tite-Live. Ce qu'il y a de certain, c'est que dans son histoire, si toutefois on peut en croire le témoignage du faux Au¬relius Victor, Turnus ne mourait pas de la main d Ascagne, mais de sa propre main. (Orig. gent. rom., c. XIII. ) Tite-Live adopte sur la fondation de la ville la tradition vulgaire reproduite par Fabius, mais avec plus de développements. (Orig. gent. rom., c. XX; Serv. ad Aen. 630; Quintil. lnst. or., I, 6, 12, et Nonius, p.518, Mercer. Le récit de Plutarque est entièrement d'accord avec celui de Tite-Live. Des historiens plus récents, comme Licinius Macer, dans Denys d'Halicarnasse, racontent les faits d'une manière différente. CHAP. Ill. - Ab eo coloniae aliquot deductæ. L'auteur de l'origine du peuple romain (Origo gent. rom., cap. XVII.), nomme ces colonies Préneste, Tibur, Gabies, Tusculum, Cora, Pométia, Coriole [ le texte de l'id. d'Arntzen porte Locri j Crustumium, Caméria, Bovillae. Virgile (Aen., VI, 773 et suiv.) joint aux colonies des rois albains Nomentum, Fidène, Collatia, Castrum Inui et Bola. CREVIER. - Voy. Denys d'Italie., III, 31 et Heyne, sur l'Énéide, loc. cit. IBID. - Prisci Latini appellati. Festus de Verb. sign., p. 382., Dac.: Prisci Latini proprie appellati sunt ii qui priusquam conderetur Roma fuerunt. Niebuhr, rejetant cette explication, regarde les deux mots comme l'équivalent de Prisci et Latini, et y trouve l'indication de deux peuples différents. (Voyez t. I, p. 112, et t. II, p. 91 de la trad. fr. par M. de Golbéry). M. Leclerc (ouvr. cité, p. 165) repousse avec raison cette idée qui est. purement arbitraire. CHAP. IV. - In custodiam datur. Les accusés, de quelque distinction n'étaient pas renfermés dans une maison publique. Ils étaient confiés à la garde de quelque magistrat, qui les retenait dans sa maison sous sa responsabilité : c'est ce qu'on appelle in custodiam dare. Cic. in Cat., I, 8; Salluste, Cat.. 47; Tac., Ann., VI, 3. LIEZ. - D'après cette observation l'expression française, est jetée en prison, ne serait pas une traduction exacte; mais le mot vincta est là pour la justifier. IBID. - Ficus ruminalis. Paul Diac., p. 478. Dac., Ruminalis dicta est ficus quod sub ea arbore lupa mammam dedit Remo et Romulo. Mamma autem rumis dicitur. Unde et rustici appellant hedos subrumos qui adhuc sub mammis habentur. - Toute cette fable de l'allaitement des deux jumeaux par une louve paraît devoir son origine au désir d'expliquer l'origine inconnue du nom de Rome. Les uns le fout venir de ῥώμη. courage et force; d'autres, de Rumo, ancien nom du Tibre, qu'ils dérivent de ῥοός, ῥέω, d'autres de Romulus, d'autres encore de ruma, rumis, rumen. Tacit. Ann., XIII, 58, 1. Harduin. ad. Plin, XV, 18, 20. IBID. - Submissas præbuisse mammas. Virg. En., VIII, 630. - " On voit encore au Capitole un groupe de bronze représentant la louve qui allaite Remus et Romulus. Il y fut placé il y a vingt et un siècles par les deux Oliginus, édiles curules, l'an de Rome 457 (avant J.-C., 296 ). Ils employèrent l'argent des amendes à ce monument. Il fut frappé de la foudre sous le consulat de Torquatus et de Cotta, l'an de Rome 686 (av. J: C., 67 ). On le voit aujourd'hui dans le même état où la foudre le mit alors. J'y ai remarqué avec curiosité et satisfaction le coup de tonnerre qui glissa le long des côtes et a fondu une partie de la cuisse.» Le président DE BROSSES. - Ce groupe avait été doré. Voy. Cic. in Cat., III, 8. IBID. - Sunt qui Larentiam, etc. Tel était le récit de Valérius Antias (Orig. gent. rom., c. XXI) et même d'historiens plus anciens (cf. Cato. ap., Macrob., Saturn., I, 10), Bien que cette explication de la louve paraisse beaucoup plus récente que tout ce qui est rapporté de Larentia, nourrice de Romulus, et des frères Arvales. Ce qu'il y a de certain c'est que Tite-Live, dans la narration rapide que renferme ce livre, ne paraît pas tenir compte des historiens les plus récents. Il diffère essentiellement des frag- 776 ments qui nous restent de Licinius Macer et de Valérius Antias. Cf. fr. ap. Orig. gent. rom., c. XIX et XXI; Macrob. Saturn., I. 41 et 13. Arnob., Adv. gent. V, I; Plin., Hist. nat. VI, 7 ; II!, 5 (cf. Tite-Live, I, 53, avec lequel sont d'accord Tac., Hist., III, 72; Denys d'Hal., IV, 55, XIII, 13; Plut., Rom. 14 : de Fort. Rom., t. VII, p. 271. Reisk. CHAP V. - Lupercal hoc fuisse ludicrum ferunt. On sait que les Lupercales étaient une fête célébrée en l'honneur de Pan, surnommé Lyceus, λύκειος de λύκος, loup, d'où s'était formé le nom de Lupercus (quasi lupos a pecore arcens). Mais ce surnom et cette étymologie paraissent fautifs et provenir d'une confusion avec λυκαῖος; véritable nom de Pan, tiré d'une ville et d'une montagne d'Arcadie (Λυκαῖα et ὄρος Λυκαῖον). Les prêtres de ce dieu étaient appelés Luperci. Cette fête, dont l'origine se perd dans la nuit des temps, fut rétablie par Auguste, et subsista probablement jusqu'au sixième siècle de notre ère. Au cinquième siècle on la célébrait encore à Rome et dans la Gaule; à Autun, par exemple (voy. M. Desmichels, Hist. du Moyen âge, t. I, p, 342 et suiv. ). Mon savant confrère et honorable ami, M. le comte Bengnot, dans son excellent livre sur la Destruction du paganisme en Occident, t. II, p. 275--279, a prouvé que le pape Gelase, auquel on attribue l'abolition de cette fête païenne en 495, se borna à défendre aux chrétiens d'y assister, et laissa aux païens le droit de les célébrer : Nullus baptizatus dit le saint pontife, nullus christianus hoc celebret, sed soli pagani quorum ritus est exequantur. « Sans pouvoir citer, dit M. Beugnot, l'époque précise où les Lupercales cessèrent d'être célébrées à Rome, on est d'accord, pour représenter la procession qui a lieu pendant la fête de la Purification de la Sainte Vierge, et dans laquelle les assistants portent des cierges allumés, fête qui, pour ce motif, est nommée Chandeleur, comme ayant été établie afin de tenir lieu des Lupercales, pour lesquelles le peuple montrait un si grand attachement. Au lieu d'une cérémonie bouffonne et indécente, on plaça une fête qui, en satisfaisant la passion des Romains pour les solennités, rappelait à leur esprit des pensées nobles et pures. » IBID. - Sur Evandre et sur Carmenta sa mère, voyez Denys d'Halic., I, 51 et suiv., le 1er excursus de Heyne, et ses notes sur l'Énéide, VIII, 51 et suiv. IBID. - Vocarunt Inuum. Suivant Servius ad Aen., VI, 745, ab ineundo passim cum omnibus animalibus sic dictus. IBID. - Remus cepisse. Tite-Live s'est un peu écarté du récit de Fabius, en ce qui concerne l'attaque, par suite de laquelle Romulus est fait prisonnier. Il suppose que Rémus assiste au combat, tandis que, suivant Fabius, il était aile à Caenina offrir un sacrifice. Voy. Denys d'Hal., I, 80.) Plutarque est, sur ce point comme sur beaucoup d'autres, d'accord avec Fabius. Suivant Tuberon ( Denys d'Hal., ibid. ) que Tite-Live paraît avoir suivi, Rémus fut pris avant que son frère pût accourir à son secours. IBID. - Faustulo spes fuerat. Spes et sperare, comme ἐλπίς, ἐλπίζειν, ἔλπεσθαι en grec, ne se prennent pas toujours en bonne part, et indiquent souvent l'attente, le soupçon, la prévision. Voyez Thuc., I, 1, et Tite-Live, II, 3 : Spe omnium serius fuit. IBID. - Geminos esse fratres. « Quintilianus, Inst. Orat., IX, 14; quadam ordine permutato fiunt supervacua ut FRATRES GEMINI ; nam si praecesserint GEMINI, FRATRES addere non est necesse. Hanc tamen ejus observationem perpetuam non esse, non modo locus hic Livii, sed etiam plura alia exempla docent; confer in primis Ovidii Heroid„ XVI, 271. O decus, o praesens GEMINORUM gloria FRATRUM ; ejusdem Heroid., XVII, 249; Metamorphos. IV, 1117 ; ita et eodem libro, verso 773, cujus in introitu GEMINAS habitasse SORORES. Haud aliter Terentius in Heaut. V, 1, 80. Non ita me dii ament, auderet facere haec VIDUAE MULIERI. » LEMAIRE. CHAP. VI. - Templa capiunt. « Debout, le visage tourné vers l'immuable nord, séjour des dieux étrusques, l'augure décrit avec le lituus, un bâton recourbé, une ligne (cardo) qui, passant sur sa tête du nord au midi, coupe le ciel en deux régions, la région favorable, de l'est : et la région sinistre, de l'occident. Une seconde ligne (decumanus, dérivé du chiffre X) coupe en croix la première et les quatre régions formées par ces deux lignes se subdivisent jusqu'au nombre de seize. Tout le ciel, ainsi divise par le lituus de l'augure, et soumis à sa contemplation ( contemplari ), devient un temple ( templum ). « La volonté humaine peut transporter le temple ici-bas, et appliquer à la terre la forme du ciel. Au moyen de lignes parallèles au cardo et au decumanus, l'augure forme un carré autour de lui. Varron nous a transmis la formule par laquelle on décrivait un templum pour prendre les augures sur le mont Capitolin. Le temple existe également, qu'il soit simplement désigné par les paroles, ou qu'il ait une enceinte. Les limites en sont également sacrées, infranchissables. Il a toujours son unique entrée au midi, son sanctuaire au nord. Toute demeure sacrée n'est pas un templum, un fanum. Le temple étrusque est un carré plus long que large d'un sixième. Les tombeaux, souvent même les édifices civils, les places publiques, affectent la même force et prennent le même caractère sacré. Telles étaient à Rome les curies du sénat, les rostres et ce qui y touchait dans le Champ-de-Mars, tout l'emplacement de l'autel du dieu. Les villes sont aussi des temples ; Rome fut d'abord carrée ( Roma quadrata) ; la même forme se présente aujourd'hui encore dans les enceintes primitives de plusieurs des plus anciennes villes de l'Étrurie. Les colonies appliquent la forme de leur métropole à leurs nouvelles demeures; et, comme on fait aux jeunes arbres transplantés, elles s'orientent sur une nouvelle terre comme elles l'ont été sur le sol paternel. Il n'est pas jusqu'aux armées, ces colonies mobiles qui, dans leur camp de chaque soir, ne présentent pour la forme et la position l'image sacrée du templum d'où elles ont emporté les auspices. Le prétoire du camp romain arec son tribunal et son auguraculum était un carré de deux cents pieds. » Les terres étaient aussi partagées d'après les règles et l'art des aruspices. On traçait les limites des champs d'après les lignes cardo et decumanus. » MICHELET, Histoire romain, introduction, chap. V, t. I, p. 51, 1ere édition. Cf. Niebuhr Roemische Geschichte, t. II, p. 700. Les passages classiques sur le templum se trouvent dans Varron de Ling. lat., lib. Vil, cap. 6 et suiv.; Festus aux mots : Contemplari, Sinistræ, Posticum ostium, Decumanus, et Hygin, de Limit., p. 152. CHAP. VII. - Novos transiluisse muros. Peut-être la tradition voulait-elle designer par cette expression, novos muros, le silion (primigenius sulcus) qu'une charrue traînée par un taureau et par une vache traçait autour de l'emplacement que devait occuper la ville nouvelle, pour en déterminer les limites. Voyez Festus et ses commentateurs au mot Primigenius, et Varron de Lingua Latina, V, 145. Egg. 777 CHAP. VII. - Condita urbs. Les Romains n'étaient pas d'accord sur la date de la fondation de Rome. Caton la plaçait au II des calendes de mai, c'est-à-dire au 21 avril de la première année de la septième olympiade (751 ans av. J.-C. ). Varron la reculait de deux années. M. Ideler, dans son Manuel de chronologie, t. II, p 172, pense que cette dernière supputation doit être, maigre son peu de certitude, préférée à l'autre. C'est celle qu'a suivie Bossuet. Il est probable, et plusieurs textes le prouvent, qu'avant Romulus il avait existé différents établissements sur l'emplacement des sept collines. Volney, dans ses Recherches nouvelles sur l'histoire ancienne (t. 1I, p. 109 et suiv.), a parfaitement indiqué ce qu'il faut entendre par fondations de villes : « En général, dit-il, ces grandes réunions de maisons que l'on appelle villes, ont eu deux manières d'être fondées : 1° la première par un concours lent et progressif d'habitants, que des motifs de défense commune, de facilité de commerce, d'aisance de la vie ont appelés et fixés autour d'un premier noyau d'habitation : à ce premier genre de ville l'on ne saurait presque désigner de fondateur, ni d'époque de fondation. » La seconde manière se fait par un concours subit de colons que leur propre volonté ou celle d'un gouvernement engagent ou contraignent à bâtir une ville, comme un particulier bâtit une maison : ici appartient et s'applique le nom de fondation, parce que la date est aussi précise que le fait est remarquable. » Mais si, comme il est souvent arrivé, le lieu choisi pour une telle fondation avait déjà une habitation antérieure, soit village, soit bourgade; si même il y existait une ville du premier genre, c'est-à-dire sans fondateur connu, actuellement ruinée par la guerre ou par d'autres accidents, cette seconde fondation pourra devenir un sujet de controverse, parce que l'habitation antérieure suppose une fondation originelle, après laquelle il ne doit plus y avoir que restauration. Enfin, si des princes et des rois avaient, par vanité, fait ou simulé de telles fondations pour donner leur nom à des villes qui déjà avaient un fondateur connu; si les peuples ou leurs agents municipaux avaient, par adulation, provoqué de telles fondations fictives, on sent que le mot et la chose seraient tombés dans un désordre assez difficile à éclaircir. Voila ce qui est arrive à une foule de villes anciennes, spécialement dans l'Asie-Mineure, la Mésopotamie, la Syrie, etc. ou les géographes trouvent quantité de villes fondées, c'est à dire rebâties, restaurées par des rois grecs, par des empereurs romains, dont elles prirent le nom, quand néanmoins il est certain qu'elles existaient longtemps auparavant, qu'elles avaient par conséquent une fondation première, véritable, connue ou inconnue. » IBID. - lb Evandro instituta. Fabius racontait aussi la traditon relative à Evandre et à Hercule. Voyez Victorinus de Orthographia, p. 2468. Polybe et les poètes grecs de l'époque alexandrine ne sont donc pas les premiers qui en aient fut mention. C'est ce que reconnaît Niebuhr, t. 1, p. 97 de l'ed. allem., t. I, p. 123 de la trad. fr. Caton, d'après le témoignage de Servius et de Solin, Cassius Hemma Or. gent. rom. CAP. VI) et Cincius (Servius ad Virg. Georg. I, 10 parlaient aussi du mythe d'Evandre. Les livres sibyllins ayant fait connaître Hercule à Rome antérieurement à l'année 356 (Voyez Tite-Live, V, 15), le nom de ce dieu dut de bonne heure, et longtemps avant la censure d'Apprus CIaudius Caecus, se mêler aux fables italiennes. Comparez le récit de Tite-Live avec Virg. Aen., VIll, 190. L'historien ne peut être ici taxé de crédulité. Il se borne à rappeler un récit qui a cours (memorant) ; et s'il ne fait pas de critique, c'est qu'il respecte une vieille croyance à laquelle ses concitoyens viennent de se rattacher avec plus de force que jamais. CHAP. VII. - Genus omne Potitiorum interiit. Voyez IX, 29 et 34 ; Cic. Nat. Deor., II, 4; Macrobe, Sat. lII, 6 ; Orig. gent. rom., VIII; et surtout Valère Maxime, I, 1, 17, et les notes des interprètes. L'extinction de cette famille est rapportée à l'an de Rome 441 (312 av. J: C.). La traduction : Ils périrent tous EN EXPIATION DE LEUR SACRILÈGE, fait peut-être dire à l'auteur plus qu'il n'a voulu dire. CHAP. VIII. - Apparitores et hoc genus. On voit par là qu'Il ne faut pas confondre, comme on l'a fait plus d'une fois, les appariteurs et les licteurs. Appartlores était, suivant quelques auteurs, le nom générique donné à la classe des serviteurs publics des magistrats, laquelle se subdivisait en scribae, prœcones, lictores, accensi, et viatores. On rangeait aussi dans cette classe le carnifex. Voyez Adam's Roman antiquities, p.161, 8'eéd., 1819 (T. I, p. 274 de la trad. franç., 2e édit.); et Fr. Creuzers, Abriss der roem. antiquitaeten, § 175 et 174, p. 152 de la 2e edit., Leipzig et Darmstadt, 1829. D'autres, et de ce nombre parait être M. Creuzer (ouvr. cité, p. 236), en font une subdivision de la classe des serviteurs publics. IBID. - Ab Etruscis finitimis. Ce passage prouve que Tite-Live avait recherché les ouvrages qui traitaient des antiquités étrusques. Nous en verrons encore d'autres preuves. IVID. - Denys d'Halicarnasse prétend que Rome, au moment de sa fondation, ne comptait pas plus de trois mille hommes d'infanterie et environ mille cavaliers. IBID. - Ementiebantur. Nouvelle preuve du cas que fait Tite-Live des fables qu'on rencontre à l'origine de tous les empires. CHAP. IX. - Legatos circa vicinas gentes misit. Tite-Live n'est pas ici d'accord avec Fabius Pictor, dans l'histoire duquel Romulus n'envoyait pas de députés, mais recourait immédiatement à la force (voyez Plut. Rom., 14 ; Denys d'Hal., II, 30). IBID. - Consualia. Ces fêtes, célébrées le 18 ou le 21 août, tiraient leur nom du dieu Consus, auquel elles étaient consacrées. Suivant les uns, qui ne peuvent appuyer leur conjecture que sur ce passage de Tite-Live, ce nom équivalait à equestres; suivant d'autres, il serait l'équivalent du surnom σεισίχθων, donné par les Grecs à Neptune, et devrait être rapproché de concussor; suivant d'autres encore le nom de consus serait le participe d'un vieux verbe conso, le même que consulo, d'où il résulterait que Consus était le dieu du conseil (voy. Plut. Rom., 14 ; Festus, s. v. Consualia; Arnob., Adv. gent., III, p. 115). Les savants qui ont adopté cette étymologie s'autorisent encore d'un passage où Tertullien raconte (de Spect., 5) que de son temps on avait trouvé, en fouillant dans le cirque, un autel sur lequel on lisait cette inscription : CONSUS CONSILIO MARS DUELLO LARES COMITIO POTENTES. Mais l'opinion la plus vraisemblable est celle qui reconnaît dans les consualia des fêtes funèbres et qui admet que consus, remplacé plus tard, par conditus, vient de condo, comme clausus, préféré a clauditus, vient de claudo (Ascon. in Cic. Verr., II, 10). Ainsi Consus, le dieu caché, ne serait autre que Pluton, Jupiter Stygius, que Tite-Live confond avec Neptunus equestris, sans doute à cause du cheval qui accom- 778 pagnait la statue du dieu. Mais je crois avoir prouvé ailleurs (Monuments d antiquité figurée, p. 85 et suiv.) d'une manière évidente que le cheval peut être aussi considéré comme un attribut du dieu de la mort. Ce qui vient d'ailleurs à l'appui de l'explication qu'Asconius donne du nom de Consus, c'est que l'autel de ce dieu restait toujours caché et n'était découvert que pendant les courses ( Plut., Rom., 11 ). Voyez, sur les consualia et sur le sens du mot consus, Ed. Jacobi Handwoerleb. der gr. und roem. Mythologie, s. v. et surtout J. A. Hartung, die religion der Roemer, t. II, p. 87 et suiv. CHAP. IX. - Antemnates. Plutarque ( Rom., 17) ajoute le nom des Fidénates. CHAP. - Ad rapiendas virginies discurrit. Suivant Denys d'Hal. (II, 30), le nombre des femmes enlevées fut de 683 ; suivant une autre tradition rapportée par Plutarque ( Rom. 14 ce nombre se serait borné à 30, et l'enlèvement n'aurait été qu'un prétexte pour attaquer les Sabins. Il est certain qu'en admettant comme véritable cet épisode de l'histoire romaine, on ne peut s'empêcher de reconnaître que l'enlèvement des Sabines prépara la grandeur de Rome en la faisant entrer dans cette voie de guerres et de conquêtes où elle marcha jusqu'à ce qu'elle eût soumis le monde. Si les peuples voisins avaient accueilli la demande de Romulus, les Romains auraient trouvé partout autour d'eux des pères, des frères, des parents auxquels ils n'auraient peut-être lamais déclaré une guerre parricide. Le refus que firent ces peuples d'admettre Rome dans leur alliance fut cause qu'elle resta toujours comme un camp ennemi placé au milieu de ces villes pour leur ruine commune. « Romulus et ses successeurs, dit Montesquieu ( Grand. et déc. des Rom., ch. I), furent presque toujours en guerre avec leurs voisins pour avoir des citoyens, des femmes ou des terres. Ils revenaient dans la ville avec les dépouilles des peuples vaincus; c'étaient des gerbes de blé et des troupeaux : cela y causait une grande joie. Voilà l'origine des triomphes qui furent dans la suite la principale cause des grandeurs où cette ville parvint. » IBID. - Nuptialem hanc vocem factam. Voyez, sur l'étymologie du mot Talassius, Plut., Rom., 15; Quest. Rom., 50; et Varron, cité par Festus, s. v. Talassio. Ces écrivains s'accordent pour le faire dériver de ταλασία, lanificium, ou τάλαρος, corbeille où les femmes déposaient leur laine. CHAP. X. - Nomen Coeninum. Tout ce qui portait le nom de Ceniniens, tout le peuple réuni. Tite-Live emploie souvent cette locution pour désigner tout un peuple : Nomen Latinum, Hernicum, Romanum, Etruscum, etc. G. Canter, Nov. lect., II, 10, prétend que cette périphrase est empruntée a la langue grecque, mais aucun des exemples cités ne favorise cette opinion reproduite par Vechner, Hellenolexia, II, p. 528. IBID. - Ferculo. Quelques manuscrits ont feretro, qu'il faut peut-être préférer. IBID. - Bina... opima patla sunt spolia. L'an de Rome 318 (avant J.-C. 415) A. Cornélius Cossus enleva les dépouilles opimes sur Lars Tolumnius, roi des Veiens, et l'an 552 ( 221 av. J.-C.) M. Claudius Marcellus obtint le meure honneur en tuant Viridomartus, chef des Gaulois, cf. IV, 20; et Plut. Rom., 16. Sur l'étymologie du mot opima, voyez Plut. l. c. Le général qui avait remporté les dépouilles opimes entrait dans Rome monté sur un char à quatre chevaux portant son trophée sur son épaule (Plut., ibid.) Pour tout ce qui concerne les dépouilles opimes remportées par Romulus et le triomphe de ce roi, notre historien adopte le récit des auteurs les plus anciens. D'autres, suivis par Denys d'Halicarnasse (II, 34) le font rentrer à Rome traîné dans un char attelé de quatre chevaux blancs (Propert., IV, t, 12 ; cf. Plut., Rom., 16 ). CHAP. XI. - Per occasionem ac solitudinem, c'est-à-dire per occasionem solitudunis. C'est la figure de langage que les grammairiens appellent ἓν διὰ δυοῖν. IBID. - Romana legio. D'après sa division en dix cohortes dont chacune se composait de trois manipules se partageant chacun en deux centuries, le nombre total des soldats de la légion aurait dû être de 6,000 hommes. Mais ce nombre varia à différentes époques. Suivant Plutarque, la légion était, sous Romulus, forte de 3,000 fantassins et de 500 cavaliers. Depuis Servius jusqu'à la bataille de Cannes, le nombre des soldats légionnaires fut de 4,200 hommes. Du temps de Polybe il fut porte à 5,200 hommes (Polyb. VI, 19 et suiv.); et enfin Marius, durant son premier consulat, les éleva toutes à 6,000 légionnaires. Voyez Creuzer, Abriss der roem. Antiq., 235, p. 367. IBID. - In Crustuminum. Le nom de la ville de Crustumère n'est pas écrit d'une manière uniforme dans tous les auteurs. Virgile (Aen., VII, 631) l'appelle Crustumeri pour Crustumerii; Pline (Hist. nat., III, 9 et alias). Crustumerium, Silius Italicus Crustunium. Tite-Live la désigne indifféremment par les mots Crustumerium, Crustumeria, Crustumium et Crustuminum, si toutefois dans ce dernier cas il ne faut pas sous-entendre agrum et voir dans Crustuminum un adjectif. IBID. - Additur fabulae. Il faut bleu se garder de conclure du mot fabula que Tite-Live considère toute cette anecdote comme une fable. Le mot fabula en latin, comme μῦθος en grec, signifie tout récit vrai ou mensonger. Pour tout ce qui concerne Tarpeia, notre auteur suit Fabius ( Voyez Denys d'Hal., II, 40. Cf. Plut. Rom., 17 et Servius ad Aen., I, 430), et laisse de côté Pison, auquel il fait allusion en disant: Sunt qui eam ex pacto, etc. (Voyez Denys, II, 39. Florus, I, I, 12, etc.) Une telle explication était tout à fait dans l'esprit de Pison (Voyez plus haut, p. 767 col. 1), et plus honorable pour la jeune Romaine. Deux faits que rapportait également Pison, venaient à l'appui de l'opinion émise par cet historien. Tarpeia avait été, en récompense de son dévouement, ensevelie sur le lieu même où elle avait reçu la mort. Or, si elle eût trahi sa patrie, bien loin d'obtenir cet insigne honneur sur la montagne sainte (τὸν ἱερώτατον τῆς πόλεως... λόφον. ) ses restes eussent été déterrés et jetés au vent. De plus, chaque année, les Romains lui faisaient des libations funèbres ( Denys, II, 40) et avaient même institué des jeux en son honneur (Tertull. de Spectac., 6.) CHAP. XII. - Statori Jovi. Sénèque de Benef., IV, 7, donne une autre étymologie plus ingénieuse que vraie, du surnom de Stator donné à Jupiter : « Jovem rite dices Statorem : qui non, ut historici tradiderunt, eo quod, post votum susceptum acies Romanorum fugientium stetit, sed quod stant beneficio ejus omnia Stator stabilitorque est. « On voit encore aujourd'hui, dans le forum de Rome, trois colonnes du temple de Jupiter Stator, fondé l'an de Rome 458 (av. J.- C. 295, sur l'emplacement même que, suivant la tradition, Romulus s'etait contenté de consacrer Tite. Live. X, 37). 779 CHAP. XII. - Porta Palatii. Elle se trouvait non loin de la tribune aux harangues. On l'appelait aussi Porta Romuli. CHAP. XIII. - Ne se sanguine, etc. Corneille dans Horace, acte II, scène 6, a imite et paraphrasé ce discours, mais il est resté bien loin de l'énergique concision de Tite-Live. IBID. - Nec pacem modo. Virgile Aen., VIII, 639) fait de la conclusion de ce traité l'une des scènes représentées sur le bouclier d'Énée. IBID. - Geminata urbe. " Rome accrut beaucoup ses forces par son union avec les Sabins, peuples durs et belliqueux comme les Lacédémoniens dont ils étaient descendus. Romulus prit leur bouclier qui était large, au lieu du petit bouclier argien dont il s'était servi jusqu'alors (Plut. Rom., 21). Et on doit remarquer que ce qui a le plus contribue à rendre les Romains les maîtres du monde, c'est qu'ayant combattu successivement contre tous les peuples, ils ont toujours renoncé à leurs usages sitôt qu'ils en ont trouve de meilleurs. " MONTESQUIEU, Grand. et décad. des Rom., ch. 1. " Cicéron, dit Rollin (Hist. rom., t. I), admire avec raison la profonde sagesse de Romulus dans le traité qu'il conclut ici avec les sabins, et il ne craint point de dire que ce traité fut la source, le principe, le fondement de toute la puissance et de toute la grandeur romaine, par la coutume salutaire qui s'établit depuis à l'exemple de Romulus, et qui fut inviolablement observée dans tous les temps, d'admettre au nombre des citoyens les ennemis vaincus et de leur accorder dans Rome le droit de bourgeoisie. " IBID. - Lucerum nominis et originis causa incerta est. M. Niebuhr (Hist. rom., t. 1, p. 329 et suiv.; t. I, p.417 et suiv. de la tr. fr.), pour expliquer ce mot resté obscur pour les Romains eux-mêmes, fonde, de son autorité privée, une ville de Lucerum sur le mot Caelius, et en fixe l'origine au règne de Tullus Hostilius. (Voyez M. Leclerc, ouvr. cité p. 146.) Mais avec un pareil système d'interprétation, il n'est pas de difficulté historique qu'on ne puisse résoudre. Mieux vaut, ce me semble, s'en tenir à l'explication donnée par Cicéron (d. Rep., II, 8). e Romulus, dit-il, avait partage le peuple en trois tribus appelées du nom de Tatius, du sien et de celui de Lucumon, mort à ses côtes dans le combat contre les Sabins.. Or ce Lucumon était, comme le mot meule l'indique, un chef étrusque venu, s'il faut en croire Denys d'Halicarnasse (II, 37), de la ville de Solonium pour secourir Romulus. Peut-être ce chef est il le même que celui auquel Denys a précédemment (ch. XXXVI) donné le nom de Caelius, et qui, avec les familles dont il avait été suivi, forma un établissement sur celle des collines de Rome à laquelle il donna son nom, établissement qui fut sans doute renouvelé plus tard par Caelès Vibenna ou Vivenna. (Voy. Tac. Ann. IV, 65, la note de mon savant confrère M. J. L. Burnuouf, et le discours de Claude, découvert à Lyon en 15281. L'étude attentive des premiers temps de l'histoire romaine nous a conduits, mon ami M. Fr. Orioli et aloi, à reconnaître que Rome, dès l'origine, se présente arec un triple caractère, latin, sabin et étrusque, que l'élément étrusque resta vis-à-vis des deux autres dans un état réel d'infériorité sous les deux premiers rois, niais qu'ayant déjà pris de l'importance dans les dernières années de Numa, il réclama à son tour le droit de donner à l'état un roi pris dans son sein, et qu'ayant ainsi obtenu la prépondérance, il la conserva presque sans interruption jusqu'à l'établissement de la république. Voyez Annales de l'Institut archéologique, année 1832, p. 64). C'est cet élément étrusque que représente le Lucumon dont parlent Cicéron et Denys d'Halicarnasse. CHAP. XIV. - Lavinii quum ad solenne sacrificium eo venisset, interficitur. Tel paraît avoir été le récit des historiens les plus anciens (Plut. Rom., 23; Denys, II, 51). Licinius Marer racontait la mort de Tatius d'une manière différente. Suivant lui, Romulus n'accompagnait pas Tatius qui s'était rendu à Lavinium pour arranger le différend et non pour un sacrifice solennel. IBID. - Foedus inter Romam Laviniumque urbes renorvatum est.. Il n'est pas facile de comprendre comment un traité entre Rome et Lavinium pouvait expier l'ou¬trage fait aux députés, ainsi que le meurtre de Tatius : car ce mot d'expiation emporte toujours l'idée de cérémonies religieuses. Il faut qu'elles soient comprises dans foedus, car Denys d'Halicarnasse (çl, 53) et Plutarque, Vie de Romulus (c. 24), en font mention expresse. Ainsi les cérémonies qui accompagnèrent la conclusion du traité furent destinées à apaiser les dieux, et les deux peuples, compensant l'insulte par le sang, et le sang par l'insulte, se tinrent pour satisfaits. LIEZ. IBID. - Velut agmine uno irrumpit. Il est difficile de dire à quelle source Tite-Live a puise pour la prise de Fidènes. Ce stratagème inconnu à Denys d'Halicarnasse (II, 55) et à Plutarque, qui (Rom., 25) prescrite deux traditions différentes, a un caractère beaucoup plus récent et se retrouve dans le récit d'une autre attaque dirigée contre la même ville. CHAP. XV. - Toute la narration de la guerre contre Veies a une couleur peu antique. Plutarque (Rom., 24) et Denys d'Halicarnasse (II, 51) placent avant cette expédition la prise de Camerium, où parmi les dépouilles on trouva un char attelé de quatre chevaux que Romulus consacra dans le temple de Vulcain, où il fit aussi placer sa propre statue couronnée par la victoire. Suivant Denys, elle était accompagnée d'une inscription grecque rappelant ses exploits. On a objecté à Denys que cette inscription eût été bien longue et que les inscriptions étendues datent d'une époque beaucoup plus récente. Cette difficulté n'est pas sérieuse. Si cette inscription a existé, elle devait être eu vers, et un distique ( l'Anthologie grecque en offre des preuves nombreuses) dit en peu de mots beaucoup de choses. Ce qui devait être surtout révoqué en doute, c'est le groupe de Romulus couronné par la victoire. L'art à cette époque était encore dans l'enfance et se bornait à la représentation des dieux. ( Voyez M. Ch. Ottfr. Muller Handbuch. der archoeologie der Kunst, § 66-72. CHAP. XVIII. - Falso Samium Pythagoram edunt. Cette critique s'adresse sans doute à Pison et à Valerius Antias qui admettaient cette tradition ( Plin., XIII, 13; Tite-Live, XL, 29). IBID. - Disciplina tetrira ac tristi veterum Sabinorum. Les mœurs dures et sévères des Sabins étaient passées en proverbe. Virgile (Georg., II, 53.2) y fait allusion Hanc olim veteres vitam coluere Sabini, ainsi qui Horace (Il, EP. I, vers. 25 : vel Gabiis vel cum rigidis aequata Sabinis. IBID. - De templo descendit. Toute cette cérémonie du sacre de Numa présente un caractère trop original 780 pour qu'on la considère comme une pure invention des historiens. Elle devait avoir été conservée dans les annales des pontifes ou dans les rituels. CHAP. XIX. - Argiletum. C'était une éminence à l'orient du mont Palatin, du côté du forum. Elle tirait son nom de l'argile dont elle était formée (Varron, L. L. V, 157 ) et non comme le prétendait une tradition reproduite par Virgile (Aen., VIII, 315), du meurtre d'un certain Argus tué chez Evandre et à son insu :
Nec non et sacri
monstrat nemus Argileti, C'était, au temps des empereurs, le quartier des libraires.
Argiletanas mavis
habitare tabernas MARTIAL, I, 4. IBID - Simulat sibi cum dea Egeria congressus nocturnos esse. Le mot simulat prouve que Tite-Live ne croit pas aveuglément aux traditions populaires ; mais que, suivant lui, elles ont toutes un fondement historique. - On montre encore aux environs de Rome la grotte de la nymphe Égérie. CHAP. XX .- Virginesque Vestae legit. On attribue généralement à Numa l'institution des vestales; cependant quelques historiens la font remonter jusqu'à Romulus. (Voyez Plut. Rom., 22; Denys d'Halic., II, 65 .) IBID .- Sacra omnia exscripta exsignataque attribuit. Pison, au rapport de Pline (Hist, nat., XIII, 27), racontait, dans le premier livre de son mémorial (primo commentariorum), c'est-à-dire dans la partie de son ouvrage où il traitait du règne de Numa, la tradition relative à le découverte des livres de ce roi, omise ici par Tite-Live, mais rapportée par lui à l'époque même où cette découverte eut lieu. Dans ce dernier passage, notre auteur invoque le témoignage de Valérius Antias qui avait aussi fait mention de cet événement (Voyez Plut., Num., 22). Cassius Hemina en avait aussi parlé (Plin. loc. cit. Cf. Florid. Sabin. Subseciv. c. XIII). IBID. - Jovi Elicio aram in Aventino dicavit. - Jupiter Elicius parait être le même que Ζεὺς καταιβάτης, descensor, fulgurator, sur lequel on peut consulter la dissertation de Burmann. Il est cependant plus vraisemblable que ce nom vient de l'opinion répandue dès les temps les plus reculés chez les Étrusques et chez les Romains, qu'au moyen de certaines cérémonies, de certaines prières, la foudre pouvait être attirée (elici) du ciel sur la terre. Cette étymologie, adoptée par Ovide (Fast. III, 525 et suiv.), est beaucoup plus vraisemblable que l'explication donnée par Tite-Live. Tout porte à croire que les Étrusques s'étaient livrés à quelques essais sur l'électricité; c'est du moins ce qu'on peut déduire d'un long passage de Valerius Antias, rapporté par Arnobe (Adv. gent. V, p. 154, ed. Lugd. Batav. 1651), et que Plutarque a traduit dans sa vie de Numa, ch. XV, ainsi que des deux passages suivants, empruntés par Pline aux Annales de Pison : « Extat annalium memoria, sacris quibusdam e precationibus vel cogi fulmina vel impetrari. Vetus fama Etruriæ est, impetratum, Volsinios urbem agris depopulatis subeunte monstro, quod vocavere Voltam. Evocatum et a Porsenna suo rege. Et ante eum a Numa saepius hoc factitatum, in primo annalium suorum tradit L. Piso, gravis auctor; quod imitatum parum rite Tullum Hostilium ictum; fulmine (II, 51 ). » « L. Piso primo Annalium auctor est Tullum Hostilium, regem ex Iibris eodem, quo ilium, sacrficio Jovem coelo devocare conatum, quoniam parum rite quaedam fecisset, fulmine ictum (XXVIII, 4). » Cf. plus bas ch. XXXI. Plusieurs savants, et entre autres Lenz, dans le Magazin fur Philologie herausgegiben von Rupreti und Srhlichthorst, t. II, p. 48 et suiv., ont soupçonné qu'il est question dans ces différents passages de conducteurs électriques, et que l'on doit rapporter à la force et a la nature de la matière électrique les flammes qui, au rapport des historiens anciens, ont apparu tout a coup sur les mats des navires, sur la pointe des lances ou des étendards enfoncés en terre, sur la tête des enfants ou des hommes faits, etc. Toutefois il paraît douteux que les hommes, à l'aspect de semblables prodiges, en aient entrevu la cause et aient été conduits à la découverte, que le génie de Francklin nous a révélée vers la fin du dernier siècle (cf. Heyne, Opusc. Acad., t. III, p. 125 ). Ils durent plutôt recourir à des pratiques superstitieuses, à des prières, à des sacrifices pour écarter ces présages, qu'ils regardaient comme funestes. Le savant M. Libri qui, à d'autres titres qu'Ennio Quirino Visconti, mérite d'être regardé comme l'une des plus glorieuses conquêtes de la France sur la péninsule italique, nie positivement dans son Histoire des sciences mathématiques en Italie (t. I, p. 21), que les Étrusques aient possédé le paratonnerre; mais il reconnaît qu'ils avaient fait des observations électriques, notamment sur l'origine terrestre du tonnerre qui monte quelquefois de bas en haut. Voyez encore sur cette question les Étrusques de M. Ch. Ottlried Müller, t. II, p. 174; M. Ed. Jacobi, Handw. der gr. und rom. Mythol., t. 1, p. 298 et t. Il, p. 528; et M. Hartung, Religion des Romains, t. lI, p. 12. CHAP. XXI. - Numa tres et quadraginta. « Le règne de Numa, long et pacifique, était très propre à laisser Rome dans sa médiocrité; et, si elle eût eu dans ce temps-là un territoire moins borne et une puissance plus grande, il y a apparence que sa fortune eût été fixée pour jamais. » Une des causes de sa prospérité, c'est que ses rois furent tous de grands personnages. On ne trouve point ailleurs dans les histoires une suite non interrompue de tels hommes d'état et de tels capitaines. » MONTESQUIEU, Grand. et dec. des Rom., ch. 1. « Les malheurs des rois qui succédèrent à Numa donnèrent bien plus de lustre à sa gloire. De cinq qui régnèrent après lui, le dernier chassé du trône vieillit dans un honteux exil. Aucun des quatre autres ne mourut de sa mort naturelle : trois périrent dans les embûches qu'on leur dressa, et Tullus Hostilius, le successeur immediat de Numa.... fat frappé de la foudre. » PLUTARQUE, vie de Numa, ch. XXII, trad. de Ricard. CHAP. XXII. - Imperitabat tum C. Cluilius Albae. Le nom que conserva longtemps la fossa Cluilia ne permet guère d'élever de doute sur tout ce récit. Denys d'Halicarnasse ( III, 2 ) donne au chef des Albains le nom de Κοίλιος et celui de Κοιλία au fossé en question. Mais au livre VIII il l'appelleΚλοιλία. C'est ainsi qu'elle est désignée par Plutarque (Coriol., 30), et par Festus (v. Claelia fossa). Il y avait à Albe une famille Cloelia qui fut transportée à Rome après la ruine d'Albe. Cluilius et Cloelis paraissent être un même nom. IBID - Utrimque legati fere sub idem tempus, ad res repetendas missi. Ces événements sont racontés de la même manière, pu Diodore de Sicile ( Excerpta legationum, vol. II, part. II, p. 163, ed. Lud. Diadorf). 781 Or Diodore suit Fabius. (Voyez Dodwel de Cycl., p. 511; Heyne, Fontes Diodor. in comment. societ. Gott. VIII, p. 118, suiv.;Niebuhr, II, p. 79; Fragm. Euseb., cd. Aucher loc. cit.) Il se règle aussi sur l'ère de Fabius : c'est ce que prouve par de nombreux exemples, Petau, Doctr. temp. IX, 55. CHAP. XXiII, - Ibi infit Albanus. Corneille (Horace, acte 1, scène IV) a imité ce discours.
Que faisons-nous,
Romains, « J'ose dire que dans ce discours, imite de Tite-Live, l'auteur français est au-dessus du romain, plus nerveux, plus touchant; et quand on songe qu'il était gêné par la rime et par un langage embarrassé d'articles et qui souffre peu d'inversions, qu'il a surmonté toutes ces difficultés, qu'il n'a employé le secours d'aucune épithète, que rien n'arrête l'éloquente rapidité de son discours, c'est là qu'on reconnaît le grand Corneille. » (VOLTAIRE, observ. sur Corneille.) CHAP XXIV. - Nominum error manet. L'incertitude où l'on était du temps de Tite-Live, sur la question de savoir à quelle nation appartenaient les Horaces et à quelle autre les Curiaces, est un des arguments que les sceptiques ont invoqué contre l'authenticité de l'histoire primitive de Rome. Mais de bonne foi peut-elle autoriser à nier un fait accompagné de circonstances qui avaient dû laisser de profonds souvenirs? Voyez ce qui a été dit plus haut (p. 761, col. 2) sur la formule du traité conclu entre Albe et Rome. » IBID. - Nec ullius vetustior foederis memoria est. Ce qui suit prouve que toutes les formules employées dans cette circonstance avaient été religieusement conservées par le collège des Féciaux. IBID. - Patrem patratum. Le pater patratus était le chef du collège des Féciaux. « Cura... volebant bellum indicere, Pater patratus, hoc est princeps Fecialium proficiscebatur ad hostium fines et præfatus quaedam solennia, clara voce dicebat ; Se bellum indicere propter certas caussas : aut quis socios laeserant, aut quia nec abrepta animalia, nec obnoxios reddiderant. Et haec Clarigatio dicebatur, a claritate vocis. Post quam clarigationem, hasta in eorum fines missa indicabatur jam pugnae principium. Post tertium autem et tricesimum diem, quam res repetissent ah hostibus, feciales hastam mittebant. » SERVIUS, ad Virg. Aen., Xl, 53. CHAP. XXIV. - Verbena capot capillosque tangens. On employait la verveine dans les purifications. (Voyez Fessus sub voce Sagmina. Plis., Hist. nat., XXXII, 2: « Non aliunde sagmina in remediis publicis fuere et in sacris legationibusque verbenae. Certe utroque nomine Idem significatur, hoc est gramen ex arce cum sua terra evulsum. » IBID. - Ex illis tabulis cerare. Donc celle formule était écrite, les mots Legibus deinde recitatis ne peuvent laisser d'incertitude à cet égard. CHAP. XXV. - Jacentem spoliat. La dernière partie de ce combat a été imitée par Corneille (Horace, acte IV, scène II) :
Resté seul contre
trois, mais en cette aventure, « Le récit du combat des Horaces et des Curiaces, imité de Tite-Live, est comparable à l'original. Ce n'est pas un petit mérite d'avoir su alors exprimer avec élégance et précision des détails que la nature de notre langue et de notre versification rendait très difficiles. Ceux qui connaissent les entraves de notre poésie, avoueront que Corneille ne fut pas étranger à cet art d'exprimer et d'ennoblir les petits détails, que Racine porta depuis au plus haut degré de perfection. » LA HARPE, cours de littérature. 782 Cuir. XXV. - Sepulcra exstant. On a prétendu reconnaître le tombeau des Curiaces dans le mausolée à cinq pyramides qu'on voit en sortant d'Albano pour se rendre à Laricia ; mais les détails que donne Tite-Live sur le lieu de la sépulture des cinq guerriers et la forme du monument qui est étrusque, ne permettent pas d'admettre cette opinion, qui d'ailleurs a été depuis longtemps réfutée. Voyez Christ. Müller, Roms Campagna, t. II, p. t 149 et suiv.; Ch. Ottfr. Müller Handb.der archaeol. der Kunst, § 170; et Annales de l'Institut archéol., 1833, p. 45. CHAP. XXVI. - Movet feroci juveni animum comploratio sororis. Voyez Corneille, Horace, acte IV, scène V. IBID. - Quaecumque Romana lugebit hostem. Corneille (loc. cit.) :
Va dedans les
enfers plaindre ton Coriace. IBID. - Vel extra pomarium. Cette antique formule est du nombre de celles qui avaient évidemment survécu à l'incendie de Rome. (Voyez plus haut, p. 761). IBID. - Hunccine, aiebat, etc. (Horace, acte V, scène III). Corneille n'est pas resté au dessous de Tite-Live dans sa paraphrase de ce discours si simple et si énergique.
Romains,
souffrirez-vous qu'on vous immole un homme IBID. - Admiratione magis virtutis, quam jure causae. « Tullus, roi de Rome, et Metius, roi des Albains, étaient convenus que celui des deux peuples dont les champions seraient vaincus, demeurerait soumis à l'autre. » Les trois Curiaces perdirent la vie. Le dernier des Horaces, demeuré seul, fit passer Métius et ses états sous la domination des Romains. Le jeune vainqueur, retournant à Rome, rencontra une de ses soeurs qui, accordée en mariage à un des trois Curiaces, pleurait la mort de son époux. Il la tue; et cette action sanguinaire l'ayant fait traduire en jugement, il fut absous après de grands débats, moins par considération pour son mérite, que par compassion pour les larmes de son père. « Il y a trois choses à remarquer sur cet événement. » La première, c'est qu'on ne doit jamais hasarder toute sa fortune avec une partie seulement de ses forces. » La seconde, que, dans une ville bien réglée, les mérites et les démérites ne doivent pas se compenser. » La troisième, qu'un accord est nécessairement vicieux toutes les fois qu'on doit ou qu'on peut douter de la fidélité de l'exécution. En effet, c'est un événement si affreux pour un état de tomber dans l'esclavage, qu'on ne devait jamais penser qu'aucun des deux rois ou des deux peuples consentit à perdre sa liberté par la défaite de trois de ses soldats. Aussi Metius tacha-t-il de se soustraire au traité ; et quoique ce prince se fût confessé vaincu et qu'il eût promis d'obéir à Tullus dans le premier moment de la victoire des Romains, il ne chercha pas moins à le tromper, à la première occasion, lorsque les Romains voulurent marcher contre les Veiens. II s'était aperçu, mais trop tard, de l'imprudence de ces conventions. ». MACHIAVEL, réflexions sur la première décade de Tite-Live, livre I, ch. XXII, trad. de M. de Menc. Paris, 1752, t. I, p. 249. « Horace avait bien mérité de la république en triomphant des Curiaces; mais le crime affreux qu'il commit en tuant sa soeur, causa tant d'indignation aux Romains, que, malgré l'éclat prodigieux et le mérite récent de sa victoire, il ne parvint pas sans peine à sauver sa vie. Un esprit loger qui ne verrait que la superficie des choses citerait ce trait comme un exemple de l'ingratitude du peuple. Un observateur plus judicieux, et mieux instruit des vrais principes qui doivent gouverner une république, blâmera plutôt les Romains d'avoir absous Horace, que d'avoir voulu le condamner. En voici la raison. Une république bien ordonnée ne compense pas le mérite et le démérite; mais après avoir établi des récompenses pour les bonnes actions, et des punitions pour les mauvaises, si un citoyen récompensé pour avoir bien fait, commet une action qui mérite châtiment, elle punira une mauvaise,action, sans aucun égard pour les bonnes. Une république fidèle à ce principe jouira longtemps de sa liberté; elle se perdra promptement si elle s'en écarte. » Idem. ch. XXIV, t. I, p. 235. CHAP. XXX. - Roma interim cresrit Albae ruinis. «Rome s'accroît cependant des ruines d'Albe. « Voulez-vous qu'une ville étende au loin sa domination, employez tous les moyens imaginables pour la peupler extrêmement, car jamais une ville ne deviendra puissante sans celte extrême population. Ces moyens se réduisent à deux, la douceur et la force. Si vous prenez le parti de la douceur, ouvrez toutes vos portes aux étrangers qui voudront s'établir chez vous, rendez-leur cet établissement aussi assuré qu'agréable. Si vous prenez celui de la force, détruisez toutes les villes voisines et obligez tous les habitants à porter chez vous leurs foyers. Rome fut si fidèle à ces principes, que, dès le temps de son sixième roi, elle comptait quatre-vingt mille habitants en état de porter les armes. Elle imitait un bon cultivateur qui, pour former un élève plus vigoureux, plus capable de porter des fruits et de les conduire à maturité, en retranche impitoyablement les premiers rameaux, et, par celte utile rigueur, retenant la sève dans le tronc de l'arbre, le met en état de pousser des branches plus vigoureuses et plus fertiles. « L'exemple de Sparte et d'Athènes prouve la nécessité d'employer ces moyens pour fermier un puissant état. Ces deux républiques étaient extrêmement guerrières, elles avaient les meilleures lois : jamais cependant elles ne s'agrandirent autant que Rome, qui semblait moins bien policée, et gouvernée par de moins bonnes lois. Cette différence ne peut que venir des raisons ci-dessus expliquées, Rome, attentive à augmenter sa population, pouvait mettre deux cent quatre-vingt mille hommes sous les armes; Sparte et Athènes n'ont jamais pu passer le nombre de vingt mille chacune. » Ce ne fut point, en effet, par l'excellence du climat, mais seulement par la différence des principes que Rome eut cet avantage sur ces deux villes. » Persuadé que rien ne pouvait plus aisément corrompre les lois que le mélange des étrangers, Lycurgue, fondateur de Sparte, disposa toutes choses pour les éloigner de la ville. Peu content de leur défendre de s'y marier, 783 de leur refuser le droit de bourgeoise, et tous les genres de liaisons qui unissent les hommes entre eux, il voulut que dans sa république on ne fit usage que d'une monnaie de cuir, afin d'ôter à tout le monde l'envie d'y venir établir quelque commerce, ou exercer une industrie. Il était donc impossible que Sparte fût jamais peuplée. » Tous nos établissements imitent la nature, il n'est ni possible ni naturel qu'un tronc faible et léger soutienne des branches considérables. Il est Impossible de même qu'une petite république soumette des villes ou des royaumes plus étendus et plus puissants qu'elle, sans éprouver le sort de cet arbre, qui, chargé de branches plus fortes que le tronc, se fatigue extrêmement a les soutenir, et se voit briser par le plus petit vent. Tel fut, en effet, le sort de Sparte, après s'être emparée de toutes les villes da la Grèce; la révolte de Thèbes entraîna celle de toutes les autres, et le tronc demeura sans branches. Rome ne craignait pas un pareil malheur : elle avait un tronc assez tort pour soutenir facilement les plus grosses branches. » C'est donc à ce principe et à quelques autres que Rome fut redevable de sa puissance. C'est ce que Tite-Live a voulu dire par ces mots : « Rome s'accroît cependant des ruines d'Albe. » MACHIAVEL, ouvrage, cité, livre II, ch. III, t. II, p. 27 et suiv. IBID. - Eam sedem Tullus regiae capit. Tullus d'origine étrusque comme l'a prouvé le savant Orioli, Annales de l'hist. archeol. 1832, p. 59 et suiv., établit son palais dans le lieu même qu'occupaient les Luceres, c'est-à-dire les familles étrusques, venues à Rome sous le premier roi. IBID. - Qum Hostilia usque ad patrum nostrorum Caelatem appellata est. César qui l'avait réparée lui avait donné le nom de Julia. IBID. - Ad Feroniae fanum. Au pied du mont Soracte, aujourd'hui Saint-Oreste, et a trois milles d'Anxur, aujourd'hui Terracine.
Quis Jupiter
Anxurus arvis (VIRG. Aen. VII, 799. )
Ora manusque tua
lavimus, Feronia, lympba; HORAT I, sat. V, 23. CHAP. XXXI. - In monte Albano lapidibus pluisse. Sur ce prodige et sur tous ceux dont parle Tite-Live, tels que pluies de sang, comètes, éclipses, apparitions célestes, etc., voyez, J. A. F. Steger, Von den Prodigien, Brunsv., 1800 et Heyne Opusc. Acad. t. III, p. 198-215 et 255-274. IBID. - Fulmine ictum cum domo conflagrasse. Pline, XXVIIII, 2 : « L. Piso primo Annalium auctor est Tullum Hostilium regem ex Numae libris eodem, quo ilium sacriflcio Jovem coelo devocare conatum, quoniam parum rite quaedam fecisset, fulmine ictum. » Tite Live reproduit évidemment le récit de Pison, mais en l'amplifiant à sa manière. Ainsi les livres de Numa deviennent sous sa plume de longs mémoires (Volventern commentarios Numae). Suivant d'autres récits Tullus malade aurait été tué par Ancus Martius et ses partisans, qui auraient en même temps incendié son palais, pour mieux cacher leur crime. Cf. Denys d'Hal. III, 35. IBID. - Regnavit annos duos et trigpinta. « On ne peut considérer attentivement le génie et le caractère des trois premiers rois de Rome, Romulus, Numa et Tullus, sans admirer le rare bonheur de cette ville. Romulus, prince féroce et belliqueux, eut pour successeur un roi paisible et religieux, suivi d'un prince aussi féroce que Romulus, et plus ami de la guerre que de la paix. Il fallait en effet que Rome eût, dans les premières années de sa fondation, un législateur expérimenté qui réglât ses mœurs et sa police : mais il fallait aussi que ses autres rois reprissent le génie belliqueux de Romulus, afin de l'empêcher de s'amollir et de devenir la proie de ses voisins. Cette observation nous fournit une maxime: c'est qu'après la mort d'un grand prince, son génie soutient encore son état; et qu'avec des vertus bien moins éminentes, son successeur peut jouir du fruit de ses travaux et se maintenir paisiblement. Mais la ruine de l'état est inévitable si le prince faible règne trop longtemps, ou que ses successeurs ne reprennent point le génie mâle et vigoureux du premier. Le roi David fut recommandable par sa valeur, par ses connaissances, par son jugement : après avoir vaincu par son courage et dompté tous ses voisins, il laissa Salomon, son fils, paisible possesseur de son royaume. Ce prince fortuné jouit saris peine des travaux de son père, et n'eut besoin, pour conserver son empire, que d'y entretenir les arts de la paix et ceux de la guerre, déjà crées par ce grand roi. Il n'en fut pas de même de Roboam son fils; et comme il n'avait ni la vigueur de son aïeul, ni la fortune de son père, il ne put conserver qu'avec beaucoup de peine la sixième partie de ses états. » Bajazet, sultan des Turcs, aima plus la paix que la guerre : mais les grandes victoires de Mahomet, son père, qui avait, comme David, terrassé tous ses voisins, usaient affermi les fondements de son empire; et les arts de la paix suffirent à ce prince pour s'y conserver glorieusement. Mais c'en était fait de la puissance ottomane, si Soliman, qui règne aujourd'hui, avait moins ressemblé à son aïeul qu'à son père. On peut juger que ce prince surpassera son aïeul même. Je conclus de ces exemptes, qu'après un excellent prince, un état peut se soutenir sous un prince faible; mais qu'il n'en est pas de même, si celui-ci a pour successeur un prince faible comme lui. Je n'excepte de cette règle que les états qui, semblables à celui de France, se soutiennent par la seule force de leurs anciennes constitutions. Or, j'appelle princes faibles ceux qui sont incapables de faire la guerre. »Je répète donc que le génie belliqueux de Romulus, affermit assez la puissance de Rome, pour que Numa, son successeur, pût s'occuper longues années à y faire fleurir les arts de la paix. Tullus, qui lui succéda, fit revivre par son courage la réputation de Romulus. Ancus, qui vint après lui, avait reçu de la nature un génie également propre à la paix et à la guerre. Il s'attacha même d'abord à entretenir la paix : mais, voyant que ses voisin; le méprisaient comme un prince lâche et efféminé, il sentit que les armes seules pouvaient soutenir la grandeur romaine, et que Rome voulait un prince plus ressemblant à Romulus qu'à Numa. » Que ce prince serve donc d'exemple à ceux qui gouvernent un état. S'ils ressemblent à N ma, leur trône toujours chancelant s'affermira ou s'ébranlera au gré du hasard et des circonstances. S'ils allient comme Romulus la sagesse avec le courage, le sceptre assuré dans leur main ne pourra en être arraché que par une force excessive. On peut certainement présumer que Rome n'aurait jamais pu s'affermir, ni produire toutes les merveilles dont sa valeur étonna le monde, si elle n'avait pas eu pour le troisième de ses rois un prince dont le caractère 784 guerrier sût rajeunir l'éclat que ses premières victoires avaient d'abord jeté. Et ce danger de périr sous un roi faible ou méchant, Rome y fut exposée tant qu'elle eut des rois. » MACHIAVEL, ouvrage cité, liv. I, chap. XIX, t. I, p. 241. CHAP. XXXII. - Longe antiquissintum ratas. Id est : « Primum et gravissimum, optimum factu, quod maxime curæ cordique est, » ut III, 10; VI, 40; VII, 31 ; IX, 51; et πρεσβύτερον apud Herod. V, 63 et Aelian. Var. Hist. V, 17. IBID. - Relata in album. « L'album où se promulguaient les actes de l'autorité publique est défini par Servius (ad Aen. I, 373 ), fabula dealbata: ce qui fait entendre que ces inscriptions étaient tracées sur du bois peint en blanc. Souvent aussi, principalement dans l'antiquité grecque, elles l'étaient sur la muraille même, à en juger par plusieurs expressions de Platon (Lois VI, 23 ; IX, 4 ), de Démosthène (contre Timocrate, p. 707 Reiske), et par la longue façade destinée à cet usage qu'on voit encore à Pompéi, que Mazois a dessinée, et que M. Letronne (Recherches sur l'Égypte, p. 427) compare à ces pilastres mentionnés dans quelques inscriptions grecques, παραστάδες. Tel est l'usage que Suidas explique au mot Λεύκωμα, muraille enduite de chaux propre à la transcription des actes publics : Τοῖχος γύψῳ ἀληλεμμένος πρὸς γραφὴν πολιτικῶν πραγμάτων ἐπιτήδειος. A Rome c'était une tablette de bois simplement blanchie πίναξ λελευκωμένος, comme disaient, en parlant des proscriptions, les historiens grecs Dion Cassius et Jean d'Antioche (Excerpt. Peirese. p. 658, 798. Hesychius : πινάκιον, τὸ λεύκωμα), ou recouverte de stuc, si l'on adopte l'interprétation que, d'après Winckelmann (Seconde lettre sur Herculanum), M. Fea dans le prodrome de ses Frammenti di fasti consolari, Rome, 1820, donne au mot dealbare qu'il traduit par intonaeare di marmo. Ainsi se publiaient l'édit annuel et les autres actes du préteur ( Voyez Plaute, Persa, I, 2, 22 et la note latine de M. Naudet, t. II, de son édition, p. 547 ). On connaît aussi l'album des juges, des décurions, des sénateurs, des citharèdes, etc. (Voyez Mazzocchi, in Tab. Heracl. p. 309 ). » M. LECLERC, ouvr. cité p. 83 et suiv. C'était sur un album que le grand pontife exposait aux yeux du peuple les événements mémorables de l'année. « Res omnes singulorum annorum mandabat litteris pontifex maximus, efferebatque in album et proponebat tabulam domi, potestas ut esset populo cognoscendi. » Cic de Orat. II, 12. IBID. - Jus ab antiquo gente Aequicolis quod nunc Fetiales habent, descripsit. - Les féciaux, dont il a déjà été question chapitre XXIV, passaient pour avoir été établis par Numa ( Plut. Num. 12. Cic. de Leg, II. 9), qui, suivant Denys d Halicarnasse (I, 21, II, 72), aurait emprunté cette institution aux Grecs. Mais il paraît que des les temps les plus anciens, elle était en usage chez les peuples de l'Italie et notamment chez les Albains et chez les Samnites. Voyez chapitre XXIV, et VIII, 59. C'était du reste une opinion généralement admise que les Equicoles étaient les auteurs des formules qui constituaient en quelque sorte le droit des féciaux, Valerius ( Epitom. de prænomin. ) en attribue la rédaction à Sertor Resius : « Ab Aequicolis Sertorem Resium, qui primus jus fetiale instituit. » Les Equicoles et mieux Equicules (Heyne ad Virg., Aen., VII, 747) appelés aussi Èques, Equens, Equiculains (Aequi, Aequani, Aequiculani), étaient une race sauvage, de montagnards établis sur les dette rives de l'Anio, entre les Marses, les Péligniens et les Sabelles. CHAP. XXXII. - Filo, id est vitta, infula ut apud Tibull. I, v, 15. Festus : « Flamen dialis dictus, quod assidue filo veletur. » Varro, L. L. V, 113 : « Filum, quod minimum est hilum; id enim minimum est in vestimento. » IBID. - Hastam in fines eorum emittebat. Toutes les cérémonies, toutes les formules usitées dans les déclarations de guerre faites par les féciaux portent évidemment le cachet d'une haute antiquité ( Voyez, p. 761 ); quelques-unes d'entre elles paraissent d'une haute antiquité, tant en Asie (Herod. IV, 131 ) qu'en Germanie ( Voyez Grimm, deutsche Rechtss Alterthumer, p. 164 ), et se conservèrent même au moyen âge. Ainsi lorsqu'en 1284 les Pisans vinrent jusqu'à Gênes provoquer les Génois au combat, ils lancèrent dans le port des flèches d'argent. (Giovanni Villani, dans Muratori, XIII, 294, cité par M. Michelet, Origines du droit français, p. 288.) CHAP. XXXIII. - Tellenis, Ficanaque captis... Polltorium, urbem Latinorum... Medulliam. Sur la position de ces différentes villes, voyez Sickler, Handbuch der alten Geographie, p. 366 et 375. IBID. - Ad Murcia datae sedes. - Murcia était une déesse latine identifiée avec Venus et dont le temple était situé sur le mont Aventin ( Serv. ad Aen. VIII, 656). On n'est pas d'accord sur l'étymologie de ce nom. Suivant les uns, Murcia ou Murtiae équivaut à Myrtea et viendrait de ce que près du temple de Venus, sur l'Aventin, se trouvait un bois de myrtes (Plin., H. N. XV, 36, 20. Serv. ad Aen. I, 724. Varro et Festus, sub. voc. Plut. Ouest. Rom. XX). Suivant d'autres il serait dérivé du mot syracusain μυρκός délicat ( Saumaise sur Solin, p. 637 ). Enfin d'autres pensent qu'elle avait été ainsi appelée comme rendant lâche et paresseux, murcidus, saint August., de Civ. D. IV, 16. Arnob. IV, 9). Voy. J. A. Hartung, Religion des Romains, t. II, p. 249. IBID. - Quiritum quoque fossa. Niebultr (t. iI, p.66, de la tr. fr. ) croit que c'est la Marrana qui fait suite à la fosse Cluilia. IBID. - Carcer.... imminens foro aedificatur. Cette prison, le plus ancien monument de Rome, occupe le vide d'une carrière taillée dans le mont Capitolin. Elle fut plus tard augmentée et fortifiée par Servius Tullius. CHAP. XXXIV. - Lucumo. Du mot Lucumo, en étrusque Laucame, les Latins ont fait Lucmo, Prima galeritus posuit praetoria Lucmo. Propert. IV, (V,) I.28. C'était proprement le titre que portait le magistrat suprême de chacune des douze villes composant les confédérations étrusques (Serv. ad. Aen. V III, 475: « Tuscia duodecim Lucumones habuit, id est reges, quibus unus praeerat »). Mais on le rencontre souvent chez les historiens romains employé comme nom propre, par exemple dans le passage qui nous occupe et VI, 53, dans Denys d'Halicarnasse, II, 37. M. Ch. Ottfried Müller ( Die Etrusker, t. I, p. 563), pense avec beaucoup de vraisemblance que Lucumo n'etart pas un nom d'Individu, mais un titre, un surnom qu'on donnait aux fils aînés des familles nobles qui par leur naissance pouvaient aspirer aux plus hautes dignités, et que c'est de là que vient le surnom latin de Lucius ( Lucii [appellati], ut quidam arbitrantur a Lu- 785 cumonibus etruscis. » Val. Max., de Nomin. 18.) Voyez M. Poirson, Hist. rom., t. I, chap. 2. CHAP. XXXIV. - Damarati Corinthii filius erat. Nieb., t. 1, p. 595 ; t. II, p. 70 de la tr. fr., semble penser que la tradition qui donnait une origine grecque à Tarquin n'avait été introduite dans l'ancienne épopée romaine que peu de temps avant Polybe. Mais, sans revenir ici sur ces prétendues épopées qui paraissent n'avoir existé que dans l'imagination du sceptique allemand (Voy. M. Leclerc, ouvr. cité, p. II, 147 et passim ), il est constant que cette tradition était déjà admise quand Fabius écrivit son histoire, puisque Denys en la rapportant (IV, 6, 30 et 64), cite l'autorité de ce vieil historien. On la trouvait aussi dans Cassius Hemrna ( Macrob. III, 4) et enfin l'empereur Claude dans son discours en faveur des Gaulois (tab. I, voyez le Tacite de M. Burnouf, t. lI, p. 514 ), en fait mention, d'après les livres étrusques. IBID. - Nobilemque una imagine Numae esse. Tite-Live veut faire entendre par là que la noblesse d'Ancus ne datait que de Numa, que dans sa généalogie il ne pouvait compter qu'un degré, ne présenter qu'une seule image. On sait toute l'importance que les Romains attachaient au jus imaginum donné par les magistratures curules (Chladenius de Gentilitat. vet. Rom., p. 31-40, p. 158 ). Cette institution existait-elle déjà à l'époque de Tarquin l'Ancien? Rien n'empêche de le croire, car le droit d'images parait remonter à l'origine du patricial; mais on ne peut, à cet égard, tirer aucune conséquence du passage qui nous occupe, car il est possible que Tite-Live, en parlant de la noblesse d'Ancus, se soit servi d'une expression en usage de son temps, et ait voulu faire entendre seulement qui Ancus ne comptait qu'un ancêtre. CHAP. XXXV. - Minorum gentium sunt appellati. Voy. au sujet de cette dénomination une savante note de M. Burnouf sur Tacite, Ann. XI, 25, t. III, p. 517 et suiv. IBID. - Apiolas. Voyez Pline III, 5, 9; Strab. V, p. 231; Denys d'Hal., III, p. 186. IBID. - Circus Maximus. Dans la vallée Murcia, entre l'Aventin et le Palatin. Il avait trois stades et demi de long sur un de large, et pouvait contenir 150,000 spectateurs et même suivant d'autres 485,000. CHAP. XXXVI. - Sabinum bellum coeptis intervenit. Tite-Live qui, dans ce passage, suit les anciens auteurs, ne parle pas des prétendues victoires remportées par Tarquin l'Ancien sur les Étrusques (Deys d'Hal., II, 55; Oros., II, 4 ), et n'exagère pas les succès que ce prince obtint contre les Sabins. IBID. - In comitio. C'était une partie du forum près des rostres, qui conduisait dans la curie. Ce lieu était ainsi appelé parce qu'on y tenait les comitia curiata (a coeundo. Varro, Ling. lat., IV, 32), et que d'abord les consuls puis les préteurs y rendaient la justice. Voyez Adler, Descript. de Rome, p. 241. C'était aussi là qu'on recevait les ambassadeurs. Voyez Tite-Live, XLV, 20. CHAP. XXXVIII. - Tarquinius triumphans Romam rediit. C'est la première mention d'un triomphe qu'on rencontre dans Tite-Live et plusieurs écrivains attribuent à Tarquin l'origine de cette cérémonie; mais Denys d'Halicarnasse et Plutarque ( Vie de Rom. ), la font remonter jusqu'à Romulus. IBID. - Cloacis e fastigio in Tiberim ductis. Ce monument, le plus important de Rome au témoignage de Pline (XXX VI, 15), a résisté au temps comme semblait le prévoir le savant Romain (durant a Tarquinio Prisco annis DCC prope inexpugnabiles ). Voyez la description de Rome, par MM. Platner, Bunden, Gerhard et Ruestel, t. I, p. 152 et suiv. CHAP. XXXVIII. - Ad aedem in Capttolio Jovis. ll ne fut construit que par Tarquin-le-Superbe. Voyez chapitre LV. CHAP. XLI. - Cum trabea. La trabée était une robe blanche bordée de larges bandes de pourpre. C'élait le costume des rois qu'adoptèrent les consuls. Celle que portaient les augures était rayée de pourpre ( virgata ou palmata ). IBID. - Suas opes firmavit., Agrippine usa du même stratagème pour assurer l'empire à Néron. Tacite, Hist. XII, 66. Racine, Britann., acte IV, sc. II., LIEZ. IBID. - Suessam Pometiam exsulatum ierant. Suessa Pometia était la ville la plus importante des Volsques. (Denys d'Hal., IV, 6; Strab., VI, p. 231; Tac., Hist. III. 72; Virg., En., Vl, 776 ). Elle fut prise par Tarquin-le-Superbe qui y fit un butin considérable (Voy. chapitre LIII ), et conquise une seconde fois par les consuls Opiter Virginius et Sp. Cassius, qui la détruisirent de fond en comble (II, 17 ). Strabon prétend qu'elle existait encore de son temps, mais Pline, beaucoup plus croyable, dit (V, 5 ) qu'elle faisait partie des vingt-trois villes qui avaient disparu depuis longtemps de cette contrée et particulièrement des marais Pontins, paludes Pomptinae, auxquels elle avait donné son nom. CHAP. XLIII.- Qui centum millium aeris. II est difficile de déterminer le rapport de cette somme à notre monnaie actuelle, les métrologues n'étant pas d'accord sur la valeur de l'as au temps de Servius. S'il faut en croire Denys d'Halicarnasse, les cent mille as dont parle Tite-Live valaient 100 mines attiques ; or suivant les calculs de M. Saigey, la mine attique valait 71 fr. 87 c.; donc la valeur de l'as etait de 0, 07 c., c'est-à-dire d un huitième plus faible que celle qu'on lui a donnée dans les tables qui accompagnent le Dictionnaire d'antiquités, par M. Bouillet. On a donc pour la classification de Servius les résultats suivants :
1ere classe.
71,870 fr. 00 c. C'est sur l'appréciation de Denys que s'appuie aussi l'évaluation suivie généralement en Allemagne, et dont voici les chiffres :
1ere classe. 2,152
thalers.
Mais quel que soit
le thaler pris ici pour unité, celui de Saxe à 3 fr. 90 c., ou celui de
Prusse a 3 fr. 71 c., il est évident qu'il y a dans ces calculs une
grave erreur, puisque, quelle que soit la valeur du thaler qu'on a eu en
vue, on n'aurait pour les cent mille as, dans la première supposition,
que 8,314 fr. 80 c., et dans la seconde que 7,809 fr. 70 c. sommes
environ dix fois au-dessous de la valeur réelle. CHAP. XLIII. - Clypeum...Scutum pro clupeo. Le clypeum ou clypeus était un bouclier rond qui couvrait suffisamment des hommes armes de pied en cap. Le scutum au contraire ou bouclier long couvrait tout le corps et était nécessaire à des soldats qui n'as aient pas de cuirasse. Il y a entre le clypeus et le scutum la même différence qu'entre l'ἄσπις et le θυρεός des Grecs (voyez Blasius Caryophilus, de veterum Clypeio, p. 45); de même aussi les ocreae n'étaient autre chose que leurs κνήμιδες, IBID. - Additae huic classi duce fabrum centuriae. Elles furent plutôt ajoutées à la deuxième classe, comme l'affirme Denys d'Halic., IV, 17. IBID. - Accensi. Paul Diacre : « Accensi dicebantur, qui in locum mortuorum subito subrogabantur; dicti ita quia ad censum adjiciebantur. » Varro, de L. L. VI, 3 : . Accensi, ministratores. Ascriptivi dicti quod olim adscribebantur inermes qui succederent armatis militibus. » IBID. - Inde una centuria facta est immunis militia. Un passage de Valerius Flaccus (Fetsus, s. v. Procensu et Procum, p. 385 et et 387 ; Dacier) porte à croire que l'on as ait encore du temps d'Auguste la loi de Sersius qui divisait le peuple en classes et en centuries; mais, bien qu'a la lin du chapitre LX Tite-Live fasse allusion aux mémoires de Servius (ex commentariis Servii Tulii), rien ne prouve qu'il ait consulté ce document pour le chapitre XLIII. Il ne dit pas qu'il suit Fabius, bien qu'il le cite au chapitre suivant à l'occasion du cens, et rapporte même quelques-unes de ses paroles. Niebuhr ( t. I, p.478; t. II, p. 175, de la tr. franç.), s'appuie sur la différence des chiffres donnés par Tite-Live et Denys pour révoquer en doute l'authenticité de la constitution du roi Servius; mais il paraît dans l'erreur. La différence tient à ce que Tite-Live suit Fabius, tandis que Denys donne, d'après les tables des censeurs un nombre plus exact, que Paul Diacre représente aussi d'après d'autres sources. Du reste M. Boeckh vient de prouver dans ses Metrologische Untersüchungen (p. 427-446), qu'il est fort douteux que les documents relatifs au cens de Servius Tullius soient arrivés intacts et sous leur forme première aux historiens romains ou grecs qui nous les ont fait connaître. IBID. - Et vis omnis perses primores civitatis. Servius en décrétant que l'on ne voterait plus par curie, comme autrefois, mais par centurie, livrait à la première classe la décision de toutes les affaires. En effet une centurie représentant un suffrage si la première classe tout entière était d'accord pour adopter ou pour rejeter une proposition, elle devait nécessairement avoir la majorité, puisqu'elle avait quatre-vingt-dix-huit suffrages, tandis que les suffrages réunis des autres classes ne pouvaient jamais s'élever au delà de quatre-vingt-quinze. Par ces changements, qui faisaient passer tout le pouvoir entre les mains de ceux qui composaient la premiers classe, c'est-à-dire des plus riches . Servius remplaça l'aristocratie de naissance par une aristocratie de richesse. Toutefois c'était un avantage pour les plébéiens : c'était un progrès pour eux; car dans l'ancien système, ils n'auraient jamais pu aspirer qu'à devenir les clients des patriciens, tandis que maintenant si la fortune leur venait ils pouvaient au moins, à titre de riches, prendre part aux affaires de l'état. La richesse est une chose mobile, qui passe de main en main, qu'on peut acquérir par son courage, son habileté, son industrie. Un plébéien pouvait donc, en surmontant, il est vrai, d'immenses difficultés, monter peu à peu de classe en classe jusqu'a la première. Un autre avantage que les plébéiens retirèrent de cette organisation nouvelle, c'est qu'étant enfermés dans une même classe, ils purent se voir, se compter, prendre confiance les uns dans les autres et s'enhardir dans leur lutte contre l'aristocratie, qui les privait ainsi de tout droit politique; d'ailleurs leur nombre serrait d'être singulièrement augmenté. Par les lois de Servius, comme nous verrons de le remarquer, le client ne connaissait plus son patron, il n'y avait plus que des pauvres et des riches. Tous les pauvres, plébéiens étrangers, clients, affranchis, n'avaient plus qu'un même intérêt. Les lois de Servius peuvent donc être regardées comme des lois populaires, bien qu'elles constituent une forte aristocratie ; elles affranchirent les plébéiens du joug de la curie; ils n'étaient rien dans l'état, ils furent dès lors comptés pour quelque chose. Nous les verrons bientôt commencer une lute de plusieurs siècles, pour obtenir des riches l'égalité des droits politiques. Afin de prévenir les plaintes que les plébéiens pourraient élever, Servius compensa pour eux la non-participation aux droits politiques par divers privilèges qu'il leur accorda. Ainsi les prolétaires, c'est-à-dire les plébéiens de la sixième classe, furent exemples de tout impôt et même du service militaire, qui, à cette époque ou le soldat était contraint de s'équiper et de se nourrir à ses frais, n'était pas un impôt moins lourd que les autres. Quant aux autres classes, elles payèrent collectivement la même somme, c'est-à-dire que le petit nombre des riches de la première classe paya une somme égale à celle que devaient fournir les citoyens beaucoup plus nombreux, mais moins riches, de chacune des classes inférieures. Les cinq premières classes furent obligées au service militaire, mais ceux de la première classe devaient se fournir d'un équipement plus complet et plus cher que les autres. Cette équitable répartition des charges pouvait faire prendre patience, pour quelque temps au moins, aux citoyens de la dernière classe. CHAP. XLIV. - Pomoerium profert. Voy. à l'occasion du pomoerium, et mieux, pomenium, les notes de M. Burnouf sur les chapitres XXIII et XXIV du livre XII des Annales de Tacite, t. II, p. 530 et suiv. CHAP. XLV. - Dianae Ephesace fanum. Le temple de Diane d'Éphèse ne fut achevé qu'entre les olympiades XC et C (Ch. Ottfr. Müller, Archaeologie der Kunst, § 80, 1, p. 57, ed. II). Or, Pline (XXXVI, 22) nous apprend qu'il fallut 220 ans pour le construire; ce qui placerait l'époque de sa fondation entre 640 et 600 avant J: C.; il n'y aurait donc rien d'étonnant que sous le règne de Servius (577 à 532 ), cet édifice eût été assez avance pour que la renommée de sa splendeur et de son importance politique fût parvenue jusqu'à Rome. IBID. - Ut Romae fanum Dianae populi Latini cum populo Romano facerent. - Tite-Live passe très rapidement sur l'un des actes les plus importants du roi Servius, sur la confédération latine formée à l'imitation des Amphictyonies de la Grèce et de l'Asie-Mineure, et dont les députés se réunissaient tous les ans à Rome, centre de la confédération, pour célébrer dans le temple de Diane, élevé à frais communs, les féries latines. Voyez Denys d'Hal., IV, 23 et 45-50. IBID. - Interea Romanus immolat Dianae. Cette vieille histoire tonte sacerdotale se retrouve, comme 787 nous l'avons déjà dit (p.762, col. I), dans Valère-Maxime, VII, 5,1, et dans Plutarque ( Quaest. rom.. 4 ), qui l'emprunte à Juba et à Varron. CHAP. XLVI. - Filius neposne fuerit parum liquet, etc. il fait allusion à Pison, qui seul de tous les historiens (voy. Denys d'Hal., IV, 7, p. 633 et détermine par des calculs chronologiques, prétendait que Lucius et Aruns étaient petits-fils et non pas fils de Tarquin-l'Ancien. Cette dernière opinion était celle de Fabius Denys, ibid., 6 et 50), que Tite-Live prend peut-être pour guide. Plus tard, l'opinion de Pison prévalut, comme s'appuyant sur la chronologie. (Voyez Denys, Florus, Aurelius-Victor, Plutarque (Public., 21); le discours de Claude dans les inscriptions de Grunter, p. 502; Pompon., de Or. Jur., avec la correction de Bynkershoek; Constantin-Manasses; les Fastes Capitolins.) La version des écrivains plus anciens est également suivie par Cicéron (Brut. 14), Strabon ( V, p. 231 ), Aulu-Gelle (XVII, 21), etc. CHAP. XLVIII. - Ad summum Cyprium vicum. Non loin du poteau de la Soeur et des Esquilies. Voyez Varron, L., IV, 52. Donat, de Urb. Rom., III, y.; Nardini, III,15. IBID. - Deponere eum in animo habuisse. Les écrivains plus récents qu'a suivis Denys prétendaient que ce projet avait été la cause de la sedition qui éclata contre Servius. CHAP. XLIX. - Inde Tarquinius regnare occoepit. « Tarquin prit la couronne sans être élu par le sénat ni par le peuple. Le pouvoir devenait héréditaire ; il le rendit absolu. Ces deux révolutions furent bientôt suivies d'une troisième. » Son fils Sextus, en violant Lucrèce, fit une chose qui a presque toujours fait chasser les tyrans d'une ville où ils ont communauté; car le peuple, à qui une action pareille fait si bien sentir sa servitude, prend d'abord une résolution extrême. Un peuple peut aisément souffrir qu'on exige de lui de nouveaux tributs ; il ne sait pas s'il ne retirera point quelque utilité de l'emploi qu'on fera de l'argent qu'on lui demande ; mais quand on lui fait un affront, il ne sent que son malheur, et il y ajoute l'idée de tous les maux qui sont possibles. » Il est pourtant vrai que la mort de Lucrèce ne fut que l'occasion de la révolution qui arriva; car un peuple lier, entreprenant, hardi, et renfermé dans des murailles, doit nécessairement secouer le joug, ou adoucir ses moeurs. » Il devait arriver de deux choses l'une : ou que Rome changerait son gouvernement, ou qu'elle resterait une petite et pauvre monarchie. » L'histoire moderne nous fournit un exemple de ce qui arriva pour lors à Rome; et ceci est bien remarquable : car comme les hommes ont eu dans tous les temps les mêmes passions, les occasions qui produisent les grands changements sont différentes, mais les causes sont toujours les mêmes. » Comme Herri VIII, roi d'Angleterre, augmenta le pouvoir des communes pour avilir les grands, Servius Tullius, avant lui, avait étendu les privilèges du peuple pour abaisser le sénat; mais le peuple, devenu d'abord plus hardi, renversa l'une et I'autre monarchie. » Le portrait de Tarquin n'a point été flatté; son nom n'a échappé a aucun des orateurs qui ont eu à parler contre la tyrannie; mais sa conduite avant son malheur, que l'on voit qu'il prévoyait ; sa douceur pour les peuples vaincus, sa libéralité envers les soldats, cet art qu'il eut d'intéresser tant de gens à sa conservation, ses ouvrages publics, uns courage à la guerre, sa constance dans son malheur, une guerre de vingt ans qu'il fit ou qu'il fit faire au peuple romain sans royaume et sans biens, ses continuelles ressources, font bien voir que ce n'était pas un homme méprisable. Les places que la postérité donne sont sujettes, comme les autres, aux caprices de la fortune. Malheur à la réputation de tout prince qui est opprimé par un parti qui devient le dominant, ou qui a tenté de détruire un préjugé qui lui survit ! » MONTESQUIEU, Grandeur et Décadence des Romains, chap. I. CHAP. L. - Ad lucum Ferentinuae s. e. aquae ( voy. ch. Lu ), ou plutôt Deae. Ce bois sacré était situé non loin de Ferentinum, ville du Latium, dans le pays des Herniques, au pied du mont Albain. C'est là, comme on le voit dans Denys d'Halicarnasse (cf. Tite-Live, VII, 25 et Festus), que se tenaient les assemblées fédératives des peuples latins. Tarquin les avait convoqués pour délibérer sur la guerre qu'il projetait contre les Sabins, violateurs du traité conclu avec Servius. CHAP. LI. - Crate superne injecta. Ce genre de supplice, particulièrement usité chez les Carthaginois (cf. IV, 50; Plaut. Poen., V, 2. v. 63, et la note de Taubmann; Tac., Germ., 12; Ferrar., Elect. II, 7 ; Stevrick. ad Veget. III, 4), était exprimé en grec par le mot καταποντισμός (Wesseling. ad Diod. Sic., XVI, 55). CHAP. LIII.- Gabios proplnquam urbem. Gabies, ancienne ville des Volsques, à douze milles à l'est de Rome. et à onze milles à l'ouest de Préneste. C'était une colonie d'Alba Longa. Elle était déjà en ruines sous le règne d'Auguste. Une antique tradition prétendait que Romulus et Rémus y avaient été élevés. CHAP. LV. - Caput humanum. Tite-Live abrége ici Fabius, auquel il donne plus bas la préférence sur Pison, comme plus ancien et en outre plus digne de foi. Or, Fabius (Arnob. VI, 7) entrait, sur la découverte de le tête en question, qui était celle d'un certain Olus ou Aulos (cf. Plin. XXVIII, 2; Serv. ad Aen. IX, 418; VIII, 545), dans beaucoup de détails que Pline ( loc. cit. ) dit être constantissima annalium affirmatio. Sur l'origine de cette légende et de ses différentes variétés, voyez l'ingénieux article que mon savant ami M. Orioli a publie dans les Annales de l'institut archéologique, 1832, p. 51-60. IBID. - Quadraginta milla pondo argenti. M. Lies prétend qu'au cours d'alors, ces quarante mille livres d'or valaient 96,000,000 fr., somme, ajoute-t-il, qu'on n'aurait pas trouvée alors dans toute l'Italie. Ni l'une ni l'autre de ces deux assertions ne sauraient être admises. Sous la république, la livre d'argent monnayé valait 69 fr. ( voy. Saigey, ouvr. cité, p. 74), donc les quarante mille livres en question ne représentent en francs qu'une somme de 2,760,000 fr. Quant à la richesse de l'Italie sous le règne de Tarquin, c'est assurément la réduire beaucoup trop que de supposer que dans toute l'Italie en n'aurait pu trouver une somme de 96,000,000. La grande Grèce, la Sicile et l'Etrurie, sinon en numéraire, du moins en métaux confectionnes, devaient certainement dépasser ce chiffre. CHAP. LVI. - Cloacam Maximam. Cet égout existe encore sous son nom antique, et semble encore aujourd'hui, suivant la belle expression de M. Michelet, plus ferme et plus entier que la roche Tarpéienne, qui le domine. IBID. - Signiam Circeiosque. Ces deus villes étaient situées sur les frontières des Volsques, la seconde au 788 bord de la mer sur le promontoire de Circée, aujourd'hui Monte-Circello. Segni est le nom moderne de Signia. CHAP. LVI. - Delphos ad maxime inclutum in terris oraculum mittere statuit. Quoi qu'on ait pu dire sur Brutus (voy. Niebuhr, t. II, p. 287 et 295 de la trad. franç.; et M. Michelet, qui renchérit sur les idées de son devancier, t. 1, p. 79 et suiv.), les rapports de Rome avec l'oracle de Delphes, rapports que Niebuhr ne nie pas, et dont il se fait même un argument en faveur de ses idées sur les livres sibyllins (t. II, p. 281 de la trad. franç ; cf. p. 281) prouvent en faveur de la civilisation romaine à cette époque et même dans les siècles antérieurs. IBID. - Sorore regis natus. La tradition suivie par Denys d'Halicarnasse, et d'après laquelle Tarquinia était la tante du roi et non pas sa soeur, paraît beaucoup plus vraisemblable. C'est le seul moyen d'expliquer comment les fils de Brutus étaient à peu près du même âge que ceux de Tarquin, ainsi qu'on le soit dans l'histoire de la conspiration. Resterait la difficulté qui résulte du mot juvenis dont Niebuhr n'a pas manqué de tirer parti. Mais ce mot n'aurait-il pas été pris par Tite-Live dans le même sens que les Grecs donnaient quelquefois au mot νεανίας et à ses dérivés νεανικός et νεανικῶς, celui de fort, énergique, grand (voy. Plat., Alcib., I, 2; Plut., Num. ch. I; Ages., ch. XI; cf., les gloses des Héroïques de Philostrate, p. 484, éd. de M. Boissonade; Viger, Idiot., gr. p. 115, M. Boissonade sur Nicétas, Eugenianus, 183). Juvenilis a le sens que les Grecs donnaient au mot νεανίας dans ces vers de Stace (Silv. I, 4, 50) :
Ipsa etiam cnuctos
gravis inclementia fati Hoc est ingens praecipitium, ingens periculum. - Certes il fallait a Brutus une grande énergie, une grande force d'âme pour se résigner au rôle qu'il soutint jusqu'au moment décisif. Et ce qui semblerait prouver encore que Brutus était plus âgé que les fils de Tarquin, c'est qu'il est chargé de les accompagner. Comes his additus. Si le sens proposé pour inventa était admis, il faudrait placer une virgule après ce mot. CHAP. LVII. - Lanae deditam. L'amour des femmes pour les travaux de I aiguille était regardé par les anciens comme une grande preuve de sagesse (Anth. Pal., VII, 424); de la les épithètes de φιλέριθος (Anth. Pal., VI, 217) et ἀνυσιεργός (Theocr., Idyll. XXVII, 14). L'épithète de lanifica est souvent un sujet d'éloges sur les monuments funéraires. Témoin cette inscription citée par Spon dans ses Misc. Erud. antiq., p. 151.
HIC. SITA. EST. AMVMONE. MARCI. OPTIMA.
ET. PVLCHERRUMA Voy. Gruter, p. 796, 9. Orelli Inscr. lat, select. ampl. collect., n° 4,860 p. 354 et 355. Cf. Warton ad Theocr., loc. cit. Falsteri, de lanifiicii honore antiquo, dans ses Amoenit. phitol., t. II. ch. XVI, p. 104. CHAP. LIX. - De orbitate Triciptini. C'était le surnom qui désignait la branche de la famille Lucretia, à laquelle appartenait Sp. Lucretius, père de Lucrèce. Les autres étaient désignées par les surnoms de Cinna, Vespilio, Ofella. CHAP. LX.- Ex commentariis Servii. Voyez les notes sur le chapitre XLI.
|