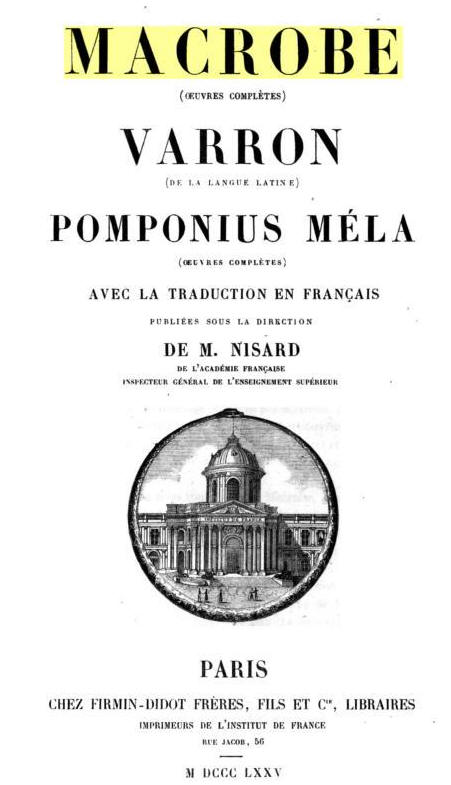|
ALLER A LA TABLE DES MATIERES DE MACROBE
MACROBE
COMMENTAIRE DU SONGE DE SCIPION
LIVRE SECOND Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
LIVRE II.
CHAP. I. De l'harmonie produite par le mouvement des sphères, et des moyens employés par Pythagore pour connaître les rapports des sons de cette harmonie. Des valeurs numériques propres aux consonances musicales, et du nombre de ces consonances. Eustathe, fils bien-aimé, et que je chéris plus que la vie, rappelez-vous que, dans la première partie de notre commentaire, nous avons traité des révolutions de la sphère étoilée, et des sept autres corps inférieurs; maintenant nous allons parler de leur modulation harmonique. « Qu'entends-je, dis-je, et quels sons puissants et doux remplissent la capacité de mes oreilles? — Vous entendez, me répondit-il, l'harmonie qui, formée d'intervalles inégaux, mais calculés suivant de justes proportions, résulte de l'impulsion et du mouvement des sphères, et dont les tons aigus, mêlés aux tons graves, produisent régulièrement des accords variés; car de si grands mouvements ne peuvent s'accomplir en silence, et la nature veut que, si les sons aigus retentissent à l'une des extrémités, les sons graves sortent de l'autre. Ainsi, ce premier monde stellifère, dont la révolution est plus rapide, se meut avec un son aigu et précipité, tandis que le cours inférieur de la lune ne rend qu'un son grave et lent; car pour la terre, neuvième globe, dans son immuable station, elle reste toujours fixe au point le plus abaissé, occupant le centre de l'univers. Ainsi les mouvements de ces astres, parmi lesquels deux ont la même portée, produisent sept tons distincts, et le nombre septénaire est le nœud de presque tout ce qui existe. Les hommes qui ont su imiter cette harmonie avec la lyre et la voix se sont frayé le retour vers ces lieux. » De ce que nous avons fait connaître l'ordre dans lequel sont disposées les sphères, et expliqué la course rétrograde des sept étoiles mobiles, en opposition à celle des cieux, il s'ensuit que nous devons faire des recherches sur la nature des sons produits par l'impulsion de ces puissantes masses; car ces orbes, en fournissant leur course circulaire, éprouvent un mouvement de vibration qui se communique au fluide qui les environne : c'est de ce mouvement communiqué que résulte le son. Tel est nécessairement l'effet du choc occasionné par la rencontre impétueuse de deux corps. Mais ce son, né d'une commotion quelconque ressentie par l'air, et transmis à l'oreille, est doux et harmonieux, ou rude et discordant. Si la percussion a lieu suivant un rythme déterminé, la résonnance donne un accord parfait ; mais si elle s'est faite brusquement, et non d'après un mode régulier, un bruit confus affecte l'ouïe désagréablement. Or, il est sûr que dans le ciel rien ne se fait brusquement et sans dessein ; tout y est ordonné selon des lois divines et des règles précises. Il est donc incontestable que le mouvement circulaire des sphères produit des sons harmonieux, puisque le son est le résultat du mouvement, et que l'harmonie des sons est le résultat de l'ordre qui règne aux cieux. Pythagore est le premier des Grecs qui ait attribué aux sphères cette propriété harmonique et obligée, d'après l'invariable régularité du mouvement des choses célestes ; mais il ne lui était pas facile de découvrir la nature des accords et les rapports des sons entre eux. De longues et profondes méditations sur un sujet aussi abstrait ne lui avaient encore rien appris, quand une heureuse occurrence lui offrit ce qui s'était refusé jusqu'alors à ses opiniâtres recherches. Il passait par hasard devant une forge dont les ouvriers étaient occupés à battre un fer chaud, lorsque ses oreilles furent tout à coup frappées par des sons proportionnels, et dans lesquels la succession du grave à l'aigu était si bien observée, que chacun des deux tons revenait ébranler le nerf auditif à des temps toujours égaux, en sorte qu'il résultait de ces diverses consonances un tout harmonique. Saisissant une occasion qui lui semblait propre à confirmer sa théorie par le sens de l'ouïe et par celui du toucher, il entre dans l'atelier, suit attentivement tous les procédés de l'opération, et note les sons produits par les coups de chaque ouvrier. Persuadé d'abord que la différence d'intensité de ces sons était l'effet de la différence des forces individuelles, il veut que les forgerons fassent un échange de leurs marteaux ; l'échange fait, les mêmes sons se font entendre sous les coups des mêmes marteaux, mus par des bras différents. Alors toutes ses observations se dirigent sur la pesanteur relative des marteaux ; il prend le poids de ces instruments, et en fait faire d'autres qui diffèrent des premiers, soit en plus, soit en moins : mais les sons rendus par les coups des derniers marteaux n'étaient plus semblables à ceux qui s'étaient fait entendre sous le choc des premiers, et ne donnaient que des accords imparfaits. Pythagore en conclut que les consonances parfaites suivent la loi des poids ; en conséquence, il rassembla les nombreux rapports que peuvent donner des poids inégaux, mais proportionnels, et passa des marteaux aux cordes sonores. Il tendit une corde sonore avec des poids différents, et dont le nombre égalait celui des divers marteaux ; l'accord de ces sons répondit à l'espoir que lui avaient donné ses précédentes observations, et offrit de plus cette douceur qui est le propre des corps sonores. Possesseur d'une aussi belle découverte, il put dès lors saisir les rapports des intervalles musicaux, et déterminer, d'après eux, les différents degrés de grosseur, de longueur et de tension de ses cordes, de manière à ce que le mouvement de vibration imprimé à l'une d'elles pût se communiquer à telle autre éloignée de la première, mais en rapport de consonance avec elle. Cependant, de cette infinité d'intervalles qui peuvent diviser les sons, il n'y en a qu'un très petit nombre qui servent à former des accords. A cet égard, ils se réduisent à six, qui sont l'épitrite, l'hémiole, le rapport double, triple, quadruple, et l'épogdoade. L'épitrite exprime la raison de deux quantités dont la plus grande contient la plus petite une fois, plus son tiers, ou qui sont entre elles comme quatre est à trois ; il donne la consonance nommée diatessaron. L'hémiole a le même rapport que deux quantités dont la plus grande renferme la plus petite une fois, et sa moitié en sus; telle est la raison de trois à deux. C'est de ce rapport que naît la consonance appelée diapentès. La raison double est celle de deux quantités dont l'une contient l'autre deux fois, ou qui sont entre elles comme quatre est à deux ; on lui doit l'intervalle nommé diapason. La raison triple est le rapport de deux quantités dont la plus grande renferme l'autre trois fois juste, ou qui sont l'une à l'autre comme trois est a un ; c'est suivant cette raison que procède la consonance appelée diapason et diapentès. La raison quadruple a lieu lorsque de deux grandeurs, l'une contient l'autre quatre fois juste, ou lorsqu'elles sont entre elles comme quatre est à un ; cette raison donne le double diapason. L'épogdoade est le rapport de deux quantités dont la plus grande contient la plus petite une fois, plus son huitième ; telle est la raison de neuf à huit : c'est cet intervalle que les musiciens désignent sous le nom de ton. Les anciens faisaient encore usage d'un son plus faible que le ton, et qu'ils appelaient demi-ton ; mais gardons-nous de croire qu'il soit la moitié du ton, car il n'y a pas plus de demi-tons que de demi-voyelles. D'ailleurs, le ton n'est pas de nature à pouvoir être divisé en deux parties égales, puisqu'il a pour base 9, dont les deux moitiés ne peuvent être deux entiers ; donc le ton ne peut donner deux demi-tons. Ce son, nommé demi-ton par nos ancêtres, est au ton comme 243 est à 256 ; c'était le diésis des premiers pythagoriciens. Maintenant on appelle diésis un son qui est au-dessous du demi-ton ; et ce dernier, Platon le nomme limma. Il y a donc cinq consonances musicales, savoir : le diatessaron, le diapentès, le diapason, le diapason et le diapentès, et le double diapason. C'est à ce nombre que se bornent les intervalles que peut parcourir la voix de l'homme, et que son oreille peut saisir ; mais l'harmonie céleste va bien au-delà de cette portée, puisqu'elle donne quatre fois le diapason et le diapentès. Maintenant revenons à nos cinq accords : le diatessaron consiste en deux tons et un demi-ton (nous laissons de côté, pour éviter les difficultés, les tiers et les quarts de ton) ; il résulte de l'épitrite. Le diapentès consiste en trois tons et un demi-ton ; il résulte de l'hémiole. Le diapason a six tons ; il est né du rapport double. Quant au diapason et diapentès, qui est formé de neuf tons et d'un demi-ton, nous le devons à la raison triple. Enfin, le double diapason, qui renferme douze tons, est le résultat de la raison quadruple. Chap. II. Dans quelle proportion, suivant Platon, Dieu employa les nombres dans la composition de l'âme du monde. De cette organisation de l'âme universelle doit résulter l'harmonie des corps célestes. Lorsqu’après avoir ajouté à la doctrine des nombres qu'il devait à l'école de Pythagore les créations profondes de son divin génie, Platon se fut convaincu qu'il ne pouvait exister d'accords parfaits sans les quantités dont nous venons de parler, il admit en principe, dans son Timée, que l'ineffable providence de l'éternel architecte avait formé l'âme du monde du mélange de ces mêmes quantités. Le développement de son opinion nous sera d'un grand-secours pour l'intelligence des expressions de Cicéron relatives à la partie théorique de la musique ; et, pour qu'on ne dise pas que le commentaire n'est pas plus facile à entendre que le texte, nous croyons devoir faire précéder l'un et l'autre de quelques propositions qui serviront à les éclaircir. Tout solide a trois dimensions, longueur, largeur, profondeur ou épaisseur; il n'est aucun corps dans la nature qui en ait une quatrième. Cependant les géomètres se proposent pour objet de leurs études d'autres grandeurs qu'ils nomment mathématiques, et qui, ne tombant pas sous les sens n'appartiennent qu'à l'entendement. Le point suivant eux est une quantité qui n'a pas de parties ; il est donc indivisible, et n'a par conséquent aucune des trois dimensions. Le point prolongé donne la ligne, qui n'a qu'une dimension appelée longueur; elle est terminée par deux points. Si vous tirez une seconde ligne contiguë a la première, vous aurez une quantité mathématique de deux dimensions, longueur et largeur ; on la nomme surface. Elle est terminée par quatre points, c'est-à-dire que chacune de ses extrémités est limitée par deux points. Doublez ces deux lignes, ou placez au-dessus d'elles deux autres lignes, il en résultera une grandeur ayant trois dimensions, longueur, largeur et profondeur ; ce sera un solide terminé par huit angles. Tel est le dé à jouer, qui, chez les Grecs, s'appelle cube. La nature des nombres est applicable à ces abstractions de la géométrie. La monade ou l'unité peut être comparée au point mathématique. Celui-ci n'a pas d'étendue, et cependant il donne naissance à des substances étendues; de même la monade n'est pas un nombre, mais elle est le principe des nombres. Deux est donc la première quantité numérique, et représente la ligne née du point, et terminée par deux points. Ce nombre deux, ajouté à lui-même, donne le nombre quatre, qu'on peut assimiler à la surface qui a deux dimensions, et qui est limitée par quatre points. En doublant quatre, on obtient le nombre huit, qui peut être comparé au solide, lequel se compose, comme nous l'avons dit, de deux lignes surmontées de deux autres lignes, et terminées par huit angles. Aussi les géomètres disent-ils qu'il suffit de doubler le double deux pour obtenir un solide. Deux donne donc un corps, lorsque ses additions successives égalent huit. C'est pour cette raison qu'il est au premier rang des nombres parfaits. Voyons maintenant comment le premier nombre impair parvient à engendrer un solide. Ce premier des impairs est trois, que nous assimilerons à la ligne ; car de la monade découlent les nombres impairs, de même que les nombres pairs. En triplant trois, on obtient neuf ; ce dernier nombre correspond à deux lignes réunies, et figure l'étendue en longueur et largeur. Il en est ainsi de quatre, qui est le premier des nombres pairs. Neuf multiplié par trois donne la troisième dimension, ou la hauteur : ainsi, vingt-sept, produit de trois multiplié deux fois par lui-même, a pour générateur le premier des nombres impairs, de même que huit, produit de deux multiplié deux fois par lui-même, a pour générateur le premier des nombres pairs. Il suit de là que la composition de ces deux solides exige le concours de la monade et de six autres nombres, dont trois pour le solide pair, qui sont deux, quatre et huit, et trois pour le solide impair, savoir, trois, neuf et vingt-sept. Platon, qui nous explique dans son Timée la manière dont l'Éternel procéda à la formation de l'âme universelle, dit qu'elle est un agrégat des deux premiers cubes, l'un pair et l'autre impair, tous deux solides parfaits. Cette contexture de l'âme du monde par le moyen des nombres solides ne doit point donner à entendre qu'elle participe de la corporéité, mais qu'elle a toute-la consistance nécessaire pour pénétrer de sa substance l'universalité des êtres et la masse entière du monde. Voici comment s'exprime Platon à ce sujet : « Dieu prit d'abord une première quantité surtout le firmament, puis une seconde double de la première; il en prit une troisième, qui était l'hémiole de la seconde et le triple de la première ; la quatrième était le double de la seconde; la cinquième égalait trois fois la troisième, la sixième contenait huit fois la première, et la septième la contenait vingt-sept fois. Il remplit ensuite chacun des intervalles que laissaient entre eux les nombres doubles et triples par deux termes moyens propres à lier les deux extrêmes, et à former avec eux les rapports de l'épitrite, de l'hémiole et de l'épogdoade. » Plusieurs personnes interprètent comme il suit ces expressions de Platon : La première partie est la monade ; la seconde est le nombre deux ; la troisième est le nombre ternaire, hémiole de deux, et triple de l'unité ; la quatrième est le nombre quaternaire, double de deux; la cinquième est le nombre neuf, triple de trois ; la sixième est le huitième nombre, qui contient huit fois l'unité ; la septième enfin est le nombre vingt-sept, produit de trois multiplié deux fois par lui-même. Il est aisé de voir que, dans ce mélange, les nombres pairs alternent avec les impairs. Après l'unité, qui réunit le pair et l'impair, vient deux, premier pair, puis trois, premier impair; ensuite quatre, second pair, qui est suivi de neuf, second impair, lequel précède huit, troisième pair, que suit vingt-sept, troisième impair; car le nombre impair étant mâle, et le nombre pair femelle, tous deux devaient entrer dans la composition d'une substance chargée d'engendrer tous les êtres, et en même temps ces quantités devaient avoir la plus grande solidité pour lui communiquer la force de vaincre toutes les résistances. Il fallait, de plus, qu'elle fût formée des seuls nombres susceptibles de donner des accords parfaits, puisqu'elle devait entretenir l'harmonie et l'union entre toutes les parties de l'œuvre de sa création. Or, nous avons dit que le rapport de 2 à 1 donne le diapason ou l'octave ; que celui de 3 à 2, c'est-à-dire l'hémiole, donne le diapentès ou la quinte; que de la raison de 4 à 3, qui est l'épitrite, naît le diatessaron ou la quarte; enfin que de la raison de 4 à 1, nommée quadruple, procède le double diapason ou la double octave. L'âme universelle, ainsi formée de nombres harmoniques, ne peut donner, en vertu de son mouvement propre, l'impulsion à tous les corps de la nature que nous voyons se mouvoir, sans qu'il résulte de cette impulsion des accords dont elle a le principe en elle-même, puisqu'en la composant de nombres respectivement inégaux, Dieu, comme vient de nous le dire Platon, combla le vide que ces quantités numériques laissaient entre elles par des hémioles, des épitrites et des épogdoades. La profondeur du dogme de ce philosophe est donc savamment exposée dans ces paroles de Cicéron : « Qu'entends-je, dis-je, et quels sons puissants et doux remplissent la capacité de mes oreilles? — Vous entendez, me répondit-il, l'harmonie qui, formée d'intervalles inégaux, mais calculés suivant de justes proportions, résulte de l'impulsion et du mouvement des sphères. » Observez qu'il fait mention des intervalles, et qu'après avoir assuré qu'ils sont inégaux entre eux, il n'oublie pas d'ajouter que leur différence a lieu suivant des rapports précis. Il entre donc dans l'idée de Platon, qui rapproche ces intervalles inégaux par des quantités proportionnelles, telles que des hémioles, des épitrites, des épogdoades, et des demi-tons, qui sont la base de l'harmonie. On conçoit maintenant qu'il serait impossible de bien saisir la valeur des expressions de Cicéron, si nous ne les eussions fait précéder de l'explication des rythmes musicaux dont il vient d'être question, ainsi que de celle des nombres qui, selon Platon, sont entrés dans la composition de l'âme du monde, et si nous n'eussions fait connaître la raison pour laquelle cette âme a été ourdie avec des quantités harmoniques. A l'aide de ces développements, on peut se faire une idée juste du branle général donné par la seule impulsion de l'âme, et de la nécessité que de ce choc communiqué il résulte des accords harmonieux, puisque cette harmonie tient à l'essence du principe moteur. Chap. III. On peut encore apporter d'autres preuves et donner d'autres raisons de la nécessité de l'harmonie des sphères. Les intervalles des sons dont la valeur ne peut être fixée que par l'entendement, relativement à l'âme du monde, peuvent être calculés matériellement dans le vaste corps qu'elle anime. C'est ce concert des orbes célestes qui a fait dire à Platon, dans l'endroit de sa République où il traite de la vélocité du mouvement circulaire des sphères, que sur chacune d'elles il y a une sirène qui, par son chant, réjouit les dieux ; car le mot sirène est, chez les Grecs, l'équivalent de déesse qui chante. Les théologiens ont aussi entendu par les neuf Muses les huit symphonies exécutées par les huit globes célestes, et une neuvième qui résulte de l'harmonie totale. Voilà pourquoi Hésiode, dans sa Théogonie, donne à la huitième muse le nom d'Uranie ; car la sphère stellaire, au-dessous de laquelle sont placées les sept sphères mobiles, est le ciel proprement dit; et, pour nous faire entendre qu'il en est une neuvième, la plus intéressante de toutes, parce qu'elle est la réunion de toutes les harmonies, il ajoute : « Calliope est l'ensemble de tout ce qu'il y a de parfait. » Par ce nom de Calliope, qui signifie très belle voix, le poète veut dire qu'une voix sonore est la neuvième des muses ; et, pour exprimer énergiquement que cette muse est un tout harmonique par excellence, il la nomma l'ensemble de tout ce qu'il y a de parfait. C'est par suite de cette idée théologique qu'Apollon a reçu le nom de Musagète, c'est-à-dire de guide des Muses, parce qu'il est, comme dit Cicéron, «chef, roi, modérateur des autres flambeaux célestes, intelligence et principe régulateur du monde. » Que par les Muses on doive entendre l'harmonie des sphères, c'est ce que n'ignorent pas ceux qui les ont nommées Camènes, c'est-à-dire douces chanteuses. Cette opinion de la musique céleste fut accréditée par les théologiens, qui cherchèrent à la peindre par les hymnes et les chants employés dans les sacrifices. On s'accompagnait en certaines contrées de la lyre ou cithare, et dans d'autres de la flûte ou autres instruments à vent. Ces hymnes en l'honneur des dieux étaient des stances nommées strophes et antistrophes. La strophe répondait au mouvement direct du ciel des fixes, et l'antistrophe au mouvement contraire des corps errants ; et le premier hymne adressé à la Divinité eut pour objet de célébrer ce double mouvement. Le chant faisait aussi partie des cérémonies funéraires chez plusieurs nations dont les législateurs étaient persuadés que l'âme, à la sortie du corps, retournait à la source de toute mélodie, c'est-à-dire au ciel. Et en effet, si nous voyons qu'ici-bas tous les êtres animés sont sensibles aux charmes de la musique ; si elle exerce son influence non seulement sur les peuples civilisés, mais aussi sur les peuples barbares, qui ont des chants propres à exciter leur ardeur guerrière, et d'autres qui leur font éprouver les douces langueurs de la volupté, c'est que notre âme rapporte avec elle du céleste séjour le souvenir des concerts qu'elle y a entendus. Cette réminiscence produit sur elle un tel effet, que les caractères les plus sauvages et les cœurs les plus féroces sont forcés de céder à l'influence de l'harmonie. C'est là, je crois, ce qui a donné lieu à ces fictions poétiques sur Orphée et Amphion, qui nous représentent le premier apprivoisant, au son de sa lyre, les animaux les plus sauvages, et le second faisant mouvoir les pierres mêmes. C'est sans doute parce que les premiers ils firent servir la poésie et la musique à amollir des peuplades sauvages, et jusqu'alors aussi brutes que la pierre. Effectivement, l'harmonie a tant d'empire sur nos âmes, qu'elle excite et modère le courage des guerriers. C'est elle qui donne le signal des combats et celui de la retraite; elle provoque le sommeil, elle empêche de dormir; elle fait naître les inquiétudes et sait les calmer; elle inspire le courroux, et invite à la clémence. Qui plus est, elle agit sur les corps dont elle soulage les maux ; et de là l'usage d'administrer aux malades des remèdes au son de la musique. Au surplus, on ne doit pas être surpris du grand empire que la musique exerce sur l'homme, quand on voit les rossignols, les cygnes et d'autres oiseaux, mettre une certaine méthode dans leur chant. Et qui peut ignorer que, parmi les animaux qui vivent dans l'air, dans l'eau et sur la terre, il en est plusieurs qui, se laissant attirer par des sons modulés, viennent se jeter dans les filets qui leur sont tendus? Le chalumeau du berger ne maintient-il pas la tranquillité dans le troupeau qui se rend aux pâturages? Ces divers effets de la musique n'ont rien d'étonnant d'après ce que nous avons dit, savoir, qu'elle est la cause formelle de l'âme universelle, de cette âme Qui remplit, qui nourrit de sa flamme féconde Tout ce qui vit dans l'air, sur la terre et sous l'onde. Tout doit être, en effet, soumis au pouvoir de la musique, puisque l'âme céleste, par qui tout est animé, lui doit son origine. Lorsqu'elle donne l'impulsion circulaire au corps de l'univers, il résulte de cette communication de mouvement des sons modifiés par des intervalles inégaux, mais ayant entre eux des rapports déterminés, et tels que ceux des nombres qui ont servi à son organisation. Il s'agit de savoir si ces intervalles, que l'entendement seul est capable d'apprécier dans cette substance immatérielle, peuvent être soumis au calcul dans le monde matériel. Archimède, il est vrai, croyait avoir trouvé le nombre de stades qu'il y a de la terre à la lune, de la lune à Vénus, de Vénus à Mercure, de Mercure au soleil, du soleil à Mars, de Mars à Jupiter, et de Jupiter à Saturne. Il croyait également que l'analyse lui avait donné la mesure de l'intervalle qui sépare l'orbe de Saturne de la sphère aplane; mais l'école de Platon, rejetant avec dédain des calculs qui n'admettaient pas de distances en nombre double et triple, a établi, comme point de doctrine, que celle de la terre au soleil est doublé de celle de la terre à la lune ; que la distance de la terre à Vénus est triple de celle de la terre au soleil ; que la distance de la terre à Mercure est quadruple de celle de la terre à Vénus; que la distance de la terre à Mars égale neuf fois celle de la terre à Mercure; que la distance de la terre à Jupiter égale huit fois celle de la terre à Mars ; enfin, que la distance de la terre à Saturne égale vingt-sept fois celle de la terre à Jupiter. Porphyre fait mention de cette opinion des platoniciens, dans un de ses traités qui jette quelque jour sur les expressions peu intelligibles de Timée ; il dit qu'ils sont persuadés que les intervalles que présente le corps de l'univers sont les analogues de ceux des nombres qui ont servi à la formation de l'âme du monde, et qu'ils sont de même remplis par des épitrites, des hémioles, des épogdoades et des demi-tons ; que de ces proportions naît l'harmonie, dont le principe, inhérent à la substance de l'âme, est ainsi transmis au corps qu'elle met en mouvement. Cicéron avance donc une proposition savante et vraie dans toutes ses parties, quand il dit que le son qui résulte du mouvement des sphères est marqué par des intervalles inégaux, mais dont la différence est calculée. CHAP. IV. De la cause pour laquelle, parmi les sphères célestes, il en est qui rendent des sons graves, et d'autres des sons aigus. Du genre de cette harmonie, et pourquoi l'homme ne peut l'entendre. C'est ici le moment de parler de la différence des sons graves et des sons aigus, dont il est question dans ce passage. « La nature veut que, si les sons aigus retentissent à l'une des extrémités, les sons graves sortent de l'autre. Ainsi le premier monde stellifère, dont la révolution est plus rapide, se meut avec un son aigu et précipité, tandis que le cours inférieur de la lune ne rend qu'un son grave et lent. » Nous avons dit que la percussion de l'air produit le son. Or, le plus ou le moins de gravité ou d'acuité des sons dépend de la manière dont l'air est ébranlé. Si le choc qu'il reçoit est violent et brusque, le son sera aigu ; il sera grave, si le choc est lent et faible. Frappez rapidement l'air avec une baguette, vous entendrez un son aigu ; vous en entendrez un grave, si l'air est frappé plus lentement. Qu'une corde sonore soit fortement tendue, les sons produits par ses vibrations seront aigus ; relâchez-la, ces sons deviendront graves. Il suit de là que les sphères supérieures, ayant une impulsion d'autant plus rapide qu'elles ont plus de masse, et qu'elles sont plus rapprochées du centre du mouvement, doivent rendre des sons aigus, tandis que l'orbe inférieur de la lune doit faire entendre un son très grave ; d'abord, parce que le choc communiqué est fort affaibli quand elle le reçoit, et aussi parce que, entravée dans les étroites limites de son orbite, elle ne peut que circuler lentement. La flûte nous offre absolument les mêmes particularités : des trous les plus voisins de l'embouchure sortent des sons aigus ; et des plus éloignés, ou de ceux qui avoisinent l'autre extrémité de l'instrument, sortent des sons graves. Plus ces trous sont ouverts, et plus les sons auxquels ils donnent passage sont perçants ; plus ils sont étroits, et plus les sons qui en sortent sont graves. Ce sont deux effets d'une même cause. Le son est fort à sa naissance, il s'affaiblit à mesure qu'il approche de sa fin ; il est éclatant et précipité, si l'issue qu'on lui offre est large; il est gourd et lent, si cette issue est resserrée, et éloignée de l'embouchure. Concluons de ce qui précède, que la plus élevée des sphères, qui n'a d'autres limites que l'immensité, et qui est très près de la force motrice, fait sa révolution avec une extrême rapidité, et rend conséquemment des sons aigus. La raison des contraires exige que la lune rende des sons graves, et ceci est une nouvelle preuve que l'air mis en mouvement a d'autant moins de forces qu'il s'éloigne davantage du lieu de son origine. Voilà la cause de la densité de l'atmosphère qui environne la dernière des sphères, ou la terre, et de l'immobilité de ce globe. Comprimé de tous côtés par le fluide presque coagulé qui l'entoure, il est hors d'état de se mouvoir en tel sens que ce soit ; et cela devait être, d'après ce qui a été démontré plus haut, savoir, que la partie la plus basse d'une sphère est son centre, et que ce centre est immobile; car la sphère universelle se compose de neuf sphères particulières. Celle que nous nommons stellifère, et qui prend le nom de sphère aplane chez les Grecs, dirige et contient toutes les autres; elle se meut toujours d'orient en occident. Les sept sphères mobiles, placées au-dessous d'elle, sont emportées par leur mouvement propre d'occident en orient; et la neuvième, ou le globe terrestre, est immobile, comme centre de l'univers. Cependant les huit sphères en mouvement ne produisent que sept tons harmoniques, parce que Mercure et Vénus, tournant autour du soleil, dont ils sont les satellites assidus, dans le même espace de temps, n'ont, selon plusieurs astronomes, que la même portée. Telle est aussi l'opinion du premier Africain, qui dit : « Les mouvements de ces huit sphères, parmi lesquelles deux ont la même portée, produisent sept tous distincts, et le nombre septénaire est le nœud de presque tout ce qui existe. » La propriété du nombre septénaire a été pleinement démontrée au commencement de cet ouvrage. Quant à ce passage peu intelligible de Cicéron, il est, je crois, suffisamment éclairci par les notions élémentaires, succinctes et précises, que nous venons de donner sur la théorie de la musique. Nous n'avons pas cru devoir parler des nètes, des hypates, et de plusieurs autres noms des cordes sonores, ni des tiers et des quarts de ton ; et nous aurions fait parade d'érudition sans aucun fruit pour le lecteur, si nous eussions dit que les notes représentent une lettre, une syllabe, ou un mot entier. Parce que Cicéron parle ici du rapport et de l'accord des sons, fallait-il profiter de cette occasion pour traiter de la diversité des modes musicaux ? C'aurait été à n'en pas finir. Nous devons nous en tenir à rendre claires les expressions difficiles à entendre : dire plus qu'il ne faut en pareil cas, c'est épaissir les ténèbres au lieu de les dissiper. Nous n'irons donc pas plus loin sur ce sujet, que nous terminerons en ajoutant seulement un fait qui, suivant nous, mérite d'être connu : c'est que des trois genres de musique, qui sont l'enharmonique, le diatonique et le chromatique, le premier est abandonné à cause de son extrême difficulté, et le troisième décrié pour sa mollesse. C'est ce qui a décidé Platon à assigner à l'harmonie des sphères le genre diatonique. Une chose encore que nous ne devons pas oublier de dire, c'est que si nous n'entendons pas distinctement l'harmonie, produite par la rapidité du mouvement circulaire et perpétuel des corps célestes, cette privation a pour cause l'intensité des rayons sonores, et l'imperfection relative de l'organe chargé de les recevoir. Et en effet, si la grandeur du bruit des cataractes du Nil assourdit les habitants voisins, est-il étonnant que le retentissement de la masse du monde entier mise en mouvement anéantisse nos facultés auditives ? Ce n'est donc pas sans intention que l'Émilien dit: « Quels sons puissants et doux remplissent la capacité de mes oreilles? » Il nous fait entendre par là que si le sens de l'ouïe est pleinement occupé chez les mortels admis aux concerts célestes, il s'ensuit que cette divine harmonie n'est pas appropriée à ce sens si imparfait chez les autres hommes. Mais continuons le travail que nous avons entrepris. CHAP. V. Notre hémisphère est divisé en cinq zones, dont deux seulement sont habitables; l'une d'elles est occupée par nous, l'autre l'est par des hommes dont l'espèce nous est inconnue. L'hémisphère opposé a les mêmes zones que le nôtre ; il n'y en a également que deux qui soient le séjour des hommes. « Vous voyez sur la terre les habitations des hommes disséminées, rares, et n'occupant qu'un étroit espace; et même, entre ces taches que forment les points habités, s'étendent de vastes solitudes. Ces peuples divers sont tellement séparés, que rien ne peut se transmettre des uns aux autres. Que pourront faire, pour l'extension de votre gloire, les habitants de ces contrées, dont la situation, relativement à la vôtre, est oblique, ou transversale, ou diamétralement opposée? « Vous voyez encore ces zones qui semblent environner et ceindre la terre ; il y en a deux qui, les plus éloignées l'une de l'autre, et appuyées chacune sur l'un des deux pôles, sont assiégées de glaces et de frimas. Celle du centre, la plus étendue, est embrasée de tous les feux du soleil. Deux sont habitables : l'australe, occupée par vos antipodes, qui, conséquemment, vous sont étrangers ; et la septentrionale, où vous êtes. Voyez dans quelle faible proportion elle vous appartient. Toute cette partie de la terre, fort resserrée du nord au midi, plus étendue de l'orient à l'occident, est comme une île environnée de cette mer que vous appelez l'Atlantique, la grande mer, l'Océan, qui, malgré tous ces grands noms, est, comme le voyez, bien petite. » Cicéron, après nous avoir précédemment expliqué le cours du ciel des fixes qui enveloppe le monde entier, celui des globes inférieurs, ainsi que leur position relative, et la nature des sous qui résultent de leur mouvement circulaire, les modes et les rythmes de cette céleste musique, et la qualité de l'air qui sépare la lune de la terre, se trouve nécessairement amené à décrire la dernière ; cette description est laconique, mais riche en images. Quand il nous parle de ces taches formées par les habitations des hommes, de ces peuples séparés les uns des autres, et placés dans une position respective diamétralement opposée, ou qui ont, soit des longitudes, soit des latitudes différentes, on croit, en le lisant, avoir sous les yeux la projection stéréographique de la sphère. Il nous prouve encore l'étendue de ses connaissances, en ne permettant pas que nous partagions l'erreur commune qui veut que l'Océan n'entoure la terre qu'en un seul sens; car, s'il eût voulu nous laisser dans cette fausse opinion, il eût dit simplement : « Toute la terre n'est qu'une petite île de toutes parts baignée par une mer, etc. » Mais en s'exprimant ainsi : » Toute cette partie de la terre où vous êtes est comme une île environnée, » il nous donne de la division du globe terrestre une idée exacte, qu'il laisse à développer à ceux qui sont jaloux de s'instruire. Nous reviendrons dans peu sur ce sujet. Quant aux ceintures dont il parle, n'allez pas croire, je vous prie, que les deux grands maîtres de l'éloquence romaine, Cicéron et Virgile, diffèrent de sentiment à cet égard : le premier dit, il est vrai, qu'elles environnent la terre, et le second assure que ces ceintures, qu'il nomme zones d'après les Grecs, environnent le ciel. Mais nous verrons par la suite que tous deux ont également raison, et qu'ils sont parfaitement d'accord. Commençons par faire connaître la situation des cinq zones ; le reste de la période qui commence ce chapitre, et que nous nous sommes chargés de commenter, en sera plus facile à entendre. Disons d'abord comment elles ceignent notre globe ; nous dirons ensuite comment elles figurent au ciel. La terre est la neuvième et la dernière des sphères ; l'horizon, ou le cercle finiteur, dont il a été déjà question, la divise en deux parties égales. Ainsi l'hémisphère dont nous occupons une partie a au-dessus de lui une moitié du ciel qui, vu la rapidité de son mouvement de rotation, va bientôt la faire disparaître à nos yeux pour nous montrer son autre moitié, maintenant exposée aux regards dos habitants de l'hémisphère opposé. En effet, placés au centre de la sphère universelle, nous devons être de tous côtés environnés par le ciel. Cette terre donc, qui n'est qu'un point relativement au ciel, est pour nous un corps sphérique très étendu, qu'occupent alternativement des régions brûlées par un soleil ardent, et d'autres affaissées sous le poids des glaces. Cependant au centre de l'intervalle qui les sépare se trouvent des contrées d'une température moyenne. Le cercle polaire boréal, ainsi que le cercle polaire austral, sont en tous temps attristés par les frimas. Ces deux zones ont peu de circonférence, parce qu'elles sont situées presque aux extrémités du globe; et les terres dont elles marquent la limite n'ont pas d'habitants, parce que la nature y est trop engourdie pour pouvoir donner l'être, soit aux animaux, soit aux végétaux; car le même climat qui entretient la vie des premiers est propre à la végétation des derniers. La zone centrale, et conséquemment la plus grande, est toujours embrasée des feux de l'astre du jour. Les contrées que borne de part et d'autre sa vaste circonférence sont inhabitables à cause de la chaleur excessive qu'elles éprouvent; mais le milieu de l'espace que laissent entre elles cette zone torride et les deux zones glaciales appartient à deux autres zones moindres que l'une, plus grandes que les autres, et jouissant d'une température qui est le terme moyen de l'excès de chaud ou de froid des trois autres. Ce n'est que sous ces deux dernières que la nature est en pleine activité. La figure ci-après facilitera l'intelligence de notre description verbale. Soit le globe terrestre A, B, C, D; soient les droites G, I et E, F, limites des deux zones glaciales; soient M, N et K, L, limites des deux zones tempérées ; soit enfin A, B, la ligne équinoxiale ou la zone torride. L'espace compris entre G, C, I, ou la zone glaciale boréale, et celui compris entre E, D, F, ou la zone glaciale australe, sont couverts d'éternels frimas ; les lieux situés entre M, B, K et N, A, L, sont sous la zone torride : il suit de là que l'espace renfermé entre G, M et I, N, et celui entre KE et FL, doivent jouir d'une température moyenne entre l'excès du chaud et l'excès du froid des zones qui les bornent. Il ne faut pas croire que ces lignes soient de notre invention ; elles figurent exactement les deux cercles polaires dont il a été question ci-dessus, et les deux tropiques. Comme il ne s'agit ici que de la terre, nous ne nous occuperons pas du cercle équinoxial, mais nous reviendrons sur sa description dans un moment plus convenable. Des deux zones tempérées où les dieux ont placé les malheureux mortels, il n'en est qu'une qui soit habitée par des hommes de notre espèce, Romains, Grecs ou Barbares; c'est la zone tempérée boréale qui occupe l'espace GI, MN. Quant à la zone tempérée australe, située entre KL et EF, la raison seule nous dit qu'elle doit être aussi le séjour des humains, comme placée sous des latitudes semblables. Mais nous ne savons et ne pourrons jamais savoir quelle est cette espèce d'hommes, parce que la zone torride est un intermédiaire qui empêche que nous puissions communiquer avec eux. Des quatre points cardinaux de la sphère terrestre, trois seulement, l'orient, l'occident et le nord, conservent leurs noms, par la raison que nous pouvons déterminer les lieux où ils prennent naissance ; car, bien que le pôle nord soit inhabitable, il n'est pas très éloigné de nous. A l'égard du quatrième point, on le nomme midi, et non pas sud ou auster; car le sud est diamétralement opposé au nord ou septentrion, au lieu que le midi est la région du ciel où, pour nous, commence le jour. Il prend son nom, qui signifie milieu du jour, du méridien ou de la ligne circulaire qui marque le milieu du jour quand le soleil y est arrivé. Nous ne devons pas laisser ignorer qu'autant le vent du nord est supportable, lorsqu'il arrive dans nos contrées, autant l'auster ou le vent qui nous vient du quatrième des points cardinaux est glacial au moment de son départ. Mais, forcé par sa direction de traverser l'air embrasé de la zone torride, ses molécules se pénètrent de feu, et son souffle, si froid naguère, est chaud lorsqu'il nous parvient. En effet, la nature et la raison s'opposent à ce que, de deux zones affectées d'un même degré de froid, il parte deux vents d'inégale température: nous ne pouvons douter, par la même raison, que notre vent du nord ne soit chaud au moment de son arrivée chez les habitants de la zone tempérée australe, et que les rigueurs de l'auster ne soient aussi tolérables pour eux que le sont pour nous celles du septentrion. Il est également hors de doute que chacune de nos zones tempérées complète son cercle chez nos périéciens réciproques qui ont le même climat que le nôtre : d'où il suit que ces deux zones sont habitées dans toute leur circonférence. Est-il quelque incrédule à cet égard ? qu'il nous dise en quoi notre proposition lui parait erronée ; car si notre existence, dans les régions que nous occupons, tient à ce que la terre est sous nos pieds et le ciel au-dessus de nos têtes, à ce que nous voyons le soleil se lever et se coucher, enfla à ce que l'air qui nous environne et que nous aspirons entretient chez nous la vie, pourquoi d'autres êtres n'existeraient-ils pas dans une position de tout point semblable à la nôtre? Ils doivent respirer le même air, puisque la même température règne sur toute la longueur de la même bande circulaire ; le même soleil qui se lève pour nous doit se coucher pour eux, et réciproquement ; comme nous, ils ont leurs pieds tournés vers la terre et la tête élevée vers le ciel; nous ne devons cependant pas craindre qu'ils tombent de la terre dans le ciel, car rien ne tombe de bas en haut. Si, pour nous, le bas a sa direction vers la terre, et le haut vers le ciel (question qui ne veut pas être traitée sérieusement), le haut est également pour eux ce qu'ils aperçoivent en portant leurs regards dans une direction opposée à celle de la terre, vers laquelle leurs corps ne peuvent avoir de tendance. Je suis persuadé que ceux de nos périéciens qui ont peu d'instruction s'imaginent aussi que les pays situés au-dessus d'eux ne peuvent être habités par des êtres semblables à eux, et que si nos pieds regardaient les leurs, nous ne pourrions conserver notre aplomb. Cependant aucun de nous n'a jamais éprouvé la peur de tomber de la terre vers le ciel : nous devons donc être tranquilles à cet égard relativement à eux ; car, comme nous l'avons démontré précédemment, tous les corps gravitent vers la terre par leur propre poids. De plus, on ne nous contestera pas que deux points de la sphère terrestre, directement opposés entre eux, ne soient l'un a l'autre ce qu'est l'orient à l'égard de l'occident. La droite qui sépare les deux premiers est un diamètre de même longueur que celui qui sépare les deux derniers. Or il est prouvé que l'orient et l'occident sont tous deux habités. Quelle difficulté y a-t-il donc à croire que deux points opposés d'un même parallèle le soient aussi? Le germe de tout ce qu'on vient de dire existe, pour le lecteur intelligent, dans le petit nombre de lignes extraites de Cicéron au commencement de ce chapitre. Il ne peut nous montrer la terre environnée et ceinte par les zones, sans nous donner à entendre que, dans les deux hémisphères, l'état habituel de l'atmosphère, sous les deux zones tempérées, est le même sur toute la longueur du cercle qu'elles embrassent; et lorsqu'il dit que « les points habités par l'homme semblent former des taches, » cela n'a pas de rapporta ces taches partielles que présentent les habitations dans la partie du globe que nous occupons, lesquelles sont entrecoupées de quelques lieux inhabités; car il n'ajouterait pas que « de vastes solitudes s'étendent entre ces taches, » s'il ne voulait parler que de ces espaces vides, au milieu desquels on distingue un certain nombre de taches. Mais comme il entend parler de ces quatre taches que nous savons être au nombre de deux sur chaque hémisphère, rien n'est plus juste que cette expression de solitudes interposées. En effet, si la demi-zone sous laquelle nous vivons est séparée de la ligne équinoxiale par d'immenses solitudes, il est vraisemblable que les habitants des trois autres demi-zones sont dans les mêmes rapports de distance que nous, relativement à la zone torride. Cicéron joint en outre à cette description celle des habitants de ces quatre régions. Il nous expose leur situation particulière et leur situation relative. Il commence par dire qu'il est sur la terre d'autres hommes que nous, et dont la position respective est telle qu'il ne peut exister entre eux aucun moyeu de communication ; et la manière dont il s'exprime prouve assez qu'il ne parle pas seulement de l'espèce d'hommes qui, sur notre hémisphère, est éloignée de nous de toute la zone torride, car il aurait dit que ces hommes sont tellement séparés de nous, que rien ne peut se transmettre de leurs contrées dans les nôtres, et non pas, comme il l'a fait, que « ces peuples divers sont tellement séparés, que rien ne peut se transmettre des uns aux autres ; » ce qui indique suffisamment le genre de séparation qui existe entre ces diverses espèces d'hommes. Mais ce qui a vraiment rapport aux régions que nous habitons, c'est ce qu'il ajoute, lorsqu'en peignant la situation de ces peuples à notre égard et entre eux, il dit «qu'elle est oblique, ou transversale, ou diamétralement opposée. Il ne s'agit donc pas de notre séparation avec une autre espèce d'hommes, mais de la séparation respective de toutes les espèces ; et voici comment elle a lieu. Nos antéciens sont éloignés de leurs périéciens de toute la largeur de la zone glaciale australe; ceux-ci sont séparés de leurs antéciens, qui sont nos périéciens, de toute la largeur de la zone torride, et ces derniers le sont de nous de toute la largeur de la zone glaciale boréale. C'est parce qu’il y a solution de continuité entre les parties habitées, c'est parce qu'elles sont séparées les unes des autres par d'immenses espaces qu'une température brûlante ou froide à l'excès ne permet pas de traverser, que Cicéron donne le nom de taches aux parties du globe occupées par les quatre espèces d'hommes. Il n'a pas oublié non plus de décrire la manière dont les habitants des trois autres demi-zones ont leurs pieds placés par rapport à nous ; il désigne clairement nos antipodes en disant : « La zone australe, dont les habitants ont les pieds diamétralement opposés aux nôtres. » Cela doit être, puisqu'ils occupent la portion de la sphère qui fait place à la nôtre. Reste à savoir ce qu'il entend par les peuples dont la position à notre égard est transversale ou oblique. A n'en pas douter, les premiers sont nos périéciens, c'est-à-dire ceux qui habitent la partie inférieure de notre zone. Quant à ceux qui nous sont obliques, ce sont nos antéciens, ou les peuplades de la partie sud-est de la zone tempérée australe. CHAP. VI. De l'étendue des contrées habitées, et de celle des contrées inhabitables. Nous avons maintenant à parler de l'étendue des régions habitées du globe, et de celle des régions inhabitables ; ou, ce qui revient au même, de la largeur de chacune des zones. Le lecteur nous entendra sans peine, s'il a sous les yeux la description de la sphère terrestre, donnée au chapitre précédent : au moyen de la figure jointe à cette description, il lui sera aisé de nous suivre. La terre entière, ou sa circonférence A, B, C, D, a été divisée, par les astronomes géographes qui l'avaient précédemment mesurée, en soixante parties. Son circuit est de deux cent cinquante-deux mille stades : d'où il suit que chaque soixantième égale quatre mille deux cents stades. L'espace de D à C en passant par B, ou du sud au nord en passant par l'ouest, renferme donc trente soixantièmes, et cent vingt-six mille stades : par conséquent, le quart du globe, à partir de B, centre de la zone torride, jusqu'à C, contient quinze soixantièmes, et soixante-trois mille stades. La mesure de ce quart de circonférence nous suffira pour établir celle de la circonférence entière. L'espace de B à M, moitié de la zone torride, comprend quatre soixantièmes, ou seize mille huit cents stades. Ainsi la zone torride entière a une étendue de huit soixantièmes, qui valent trente-trois mille six cents stades. A l'égard de notre zone tempérée, elle a, dans sa largeur de M à G, cinq soixantièmes et vingt-un mille stades. Quant à la zone glaciale renfermée entre G et C, on lui donne six soixantièmes, ou vingt-cinq mille deux cents stades. Les dimensions exactes que nous venons de donner de la quatrième partie de notre sphère suffisent pour faire connaître celles du second quart de B en D, puisqu'elles sont parfaitement les mêmes ; et quand on a la mesure de la surface hémisphérique que nous habitons, on connaît celle de l'hémisphère inférieur, qui s'étend de D à G, en passant par A, ou du sud au nord en passant par l'est. Observons ici qu'en figurant la terre sur une surface plane, nous n'avons pu lui donner la sphéricité qui lui convient; mais nous avons cherché à faire sentir cette sphéricité, en nous servant, pour notre démonstration, non des méridiens, mais de l'équateur et de ses parallèles, parce que ce dernier cercle peut remplacer l'horizon. Cependant le lecteur n'en doit pas moins regarder l'espace de D à C, en passant par B, comme l'hémisphère supérieur dont nous occupons une partie ; et l'espace de D à C en passant par A, comme l'hémisphère inférieur. Chap. VII. Le ciel a les mêmes zones que la terre. La marche du soleil, à qui nous devons la chaleur ou la froidure, selon qu'il s'approche ou s'éloigne de nous, a fait imaginer ces différentes zones. Nous venons d'exposer la situation et l'étendue en largeur des cinq zones ; remplissons maintenant l'engagement que nous avons pris de démontrer que Virgile et Cicéron ont eu tous deux raison, le premier, en plaçant ces cercles dans le ciel, et le second, en les assignant à la terre, et que tous deux n'ont eu à cet égard qu'une seule et même opinion. L'excès de froidure ou de chaleur, ainsi que la modification de ces deux excès qu'éprouve notre globe, sont l'effet du fluide éthéré, qui communique aux diverses parties correspondantes de la terre les degrés de froid et de chaud qu'il éprouve lui-même : et comme on a supposé dans le ciel des cercles qui limitent ces différentes températures, on a dû les tracer aussi autour de notre sphère. Il en est d'elle comme d'un petit miroir qui, en réfléchissant un grand objet, nous renvoie toutes ses parties sous une plus petite dimension, mais dans le même ordre qu'elles observent chez cet objet. Mais nous nous ferons mieux entendre au moyen de la figure ci-après. Soit la sphère céleste A, B, C, D, renfermant la sphère terrestre S, X, T, U; soit le cercle polaire boréal céleste désigné par la droite I, O; le tropique du Cancer, par la droite G, P, et l'équateur par la droite A, B. Représentons le tropique du Capricorne par la droite F, Q ; le cercle polaire austral par la droite E, R; et le zodiaque par la transversale F, P. Soient enfin les deux zones tempérées de la terre, figurées par les droites M et L ; et les deux zones glaciales, par les droites N et K. Il est aisé de voir maintenant que chacune des cinq divisions de la terre reçoit sa température de chacune des parties du ciel qu'elle voit au-dessus d'elle. L'arc céleste D, R correspond à l'arc terrestre S, K; l'arc céleste R, Q correspond à l'arc terrestre K, L ; la portion du cercle Q, P est en rapport avec la portion du cercle L, M; O, P répond à M, N, et O, C à N, T. Les deux extrémités de la sphère céleste D, R et C, O sont toujours couvertes de frimas; il en est de même des deux extrémités de la sphère terrestre S, K et N, T. La partie du ciel Q, P éprouve des chaleurs excessives ; la portion de notre globe L, M les éprouve également. Les régions tempérées du ciel s'étendent de O en P et de Q en R ; les régions tempérées de la terre sont situées de N en M, et de L en K ; enfin, l'équateur céleste A, B, couvre l'équateur terrestre U, X. Cicéron n'ignorait certainement pas cette correspondance des cercles célestes et terrestres ; on ne peut en douter d'après ses paroles : « Il y en a deux, dit-il, qui, les plus éloignes l'un de l'autre, et appuyés chacun sur l'un des deux pôles, sont assiégés de glaces et de frimas : » c'est nous dire que les frimas nous viennent de la voûte éthérée. C'est encore à elle que nous devons les chaleurs excessives; car Cicéron ajoute : « La zone du centre, la plus étendue, est embrasée de tous les feux du soleil. » Ces deux assertions sur l'excès de froidure et de chaleur, communiqué aux zones terrestres par les pôles de l'éther et par le soleil, prouvent que l'orateur romain savait que les zones corrélatives existent primitivement dans le ciel. Maintenant qu'il est démontré que les deux sphères céleste et terrestre ont les mêmes ceintures ou zones (car ce sont deux noms d'une même chose), faisons connaître la cause de cette diversité de température dans l'éther. La zone torride est limitée par les deux tropiques, celui d'été de G en P, celui d'hiver de F en Q. La bande zodiacale se prolonge de F en P ; nous pouvons donc supposer le tropique du Cancer au point P, et le tropique du Capricorne au point F. On sait que le soleil ne dépasse jamais ces deux signes, et que lorsqu'il est arrivé aux bornes qu'ils assignent, il revient sur ses pas; ce sont ces bornes qu'où a nommées solstices. L'astre du jour, parvenu au tropique du Cancer ou sur la frontière de notre zone tempérée, nous donne les chaleurs de l'été, parce qu'alors ses rayons plus directs pénètrent avec plus de force tous les corps soumis à leur influence. C'est alors aussi que les régions australes éprouvent les rigueurs de l'hiver, parce que le soleil est à son plus grand éloigneraient du tropique du Capricorne; et réciproquement, quand il entre dans ce dernier signe, il ramène l'été à ces régions, et l'hiver devient notre partage. Il est bon d'observer qu'il n'arrive dans chacun des signes du zodiaque qu'en suivant la direction de trois points du ciel, savoir, de l'est, de l'ouest et du midi, et que jamais il ne pénètre dans ce cercle par le septentrion. La raison en est que cet astre parvenu en P commence à rétrograder, au lieu de s'avancer vers O : il n'atteint donc jamais les limites du pôle septentrional, et ne peut, par conséquent, nous envoyer ses rayons de ce point du cial. Ainsi, ce n'est que par les points est et ouest (puisque son mouvement propre se fait d'occident en orient), et par le midi (puisque sa route est tracée sur le méridien de chaque pays), qu'il se rend dans le zodiaque. L'ombre que donnent les corps vient à l'appui de cette assertion : au lever du soleil, cette ombre est dirigée vers l'occident; à son coucher, elle est tournée vers l'orient; et lorsqu'il est à sa plus grande hauteur, elle se projette vers le nord; mais jamais, dans notre zone, elle ne tend vers le sud; ce qui prouve bien que le soleil ne visite point le pôle nord, car l'ombre est toujours située derrière les corps, du côté opposé à la lumière. Quant aux contrées de la zone torride, les plus voisines de la nôtre, et qui probablement ne sont pas désertes, leurs habitants ont l'ombre dans la direction du sud pendant tout le temps que le soleil occupe le Cancer ; car, dans cette position, ils ont cet astre au nord, puisque c'est vers ce point qu'il se dirige en les quittant. Syène, chef-lieu de la Thébaïde, que l'on rencontre après avoir suivi une longue chaîne de montagnes arides, est située sous ce même tropique du Cancer; et le jour du solstice, vers la sixième heure, le soleil se trouvant au zénith de cette ville, l'ombre disparaît totalement; le style même du cadran solaire, ou son gnomon, n'en projette point. C'est de ce phénomène que parle Lucain, quand il dit qu'à Syène l'ombre du soleil ne s'étend jamais ni à droite ni à gauche; ce qui n'est pas exact, puisque cette disparition de l'ombre n'a lieu que pendant un intervalle de temps fort court, c'est-à-dire pendant le temps que le soleil est au zénith. Il suit de là que le soleil ne franchit jamais les bornes de la zone torride, parce que le cercle oblique du zodiaque ne s'étend que d'un tropique à l'autre. L'ardeur des feux que ressent cette zone est donc occasionnée par le séjour continuel qu'y fait ce soleil, source et régulateur de la flamme éthérée. Par conséquent les deux zones les plus distantes de cet astre, privées de sa présence, sont constamment engourdies par les froids les plus rigoureux, tandis que les deux intermédiaires jouissent d'une température moyenne qu'elles doivent à celles qui les avoisinent. Cependant, de ces deux zones dites tempérées, celle sous laquelle nous vivons a des parties où la chaleur est plus forte que dans d'autres, parce qu'elles sont plus près de la zone torride : de ce nombre sont l'Ethiopie, l'Arabie, l'Egypte et la Libye. L'atmosphère, dans ces contrées, est tellement dilatée par la chaleur, qu'il s'y forme rarement des nuages, et que leurs habitants connaissent à peine la pluie. Par la raison contraire, les régions limitrophes de la zone glaciale boréale, telles que le Palus-Méotide, celles baignées par l'Ister et le Tanaïs, celles enfin qui se trouvent au delà de la Scythie, et dont les naturels ont reçu de l'antiquité le nom d'hyperboréens, comme ayant dépassé les limites naturelles du nord; ces contrées, dis-je, ont un hiver qui dure presque toute l'année, et l'on conçoit à peine la rigueur du climat sous lequel ils vivent ; mais le centre de cette zone doit à sa position de jouir d'une température uniforme et bienfaisante. Chap. VIII. Où l'on donne; en passant, la manière d'interpréter un passage des Géorgiques relatif au cercle du zodiaque. Nous avons posé pour fait incontestable que l'un et l'autre tropique sont les limites du zodiaque, et que jamais le soleil ne les dépasse, soit en s'avançant vers nous, soit en se dirigeant dans le sens opposé. Nous avons ajouté que les zones tempérées, dans l'un et l'autre hémisphère, commencent où finit le zodiaque, ou, si l'on veut, la zone torride. C'est donc pour nous une nécessité de chercher à savoir ce qu'entend Virgile, toujours si exact dans ses descriptions scientifiques, quand il dit, en parlant de ces zones :
Deux autres ont reçu
les malheureux mortels, Ces expressions pourraient faire croire que le zodiaque pénètre les zones tempérées, et que le soleil les traverse : ce qui n'est pas admissible, puisqu'il s'arrête aux tropiques. Peut-être Virgile regarde-t-il comme faisant partie de ces dernières zones les contrées de la zone torride qui les avoisinent, et que nous avons dit être habitées. En effet, Syène est sous le tropique; et à trois mille huit cents stades de cette ville, en s'avançant vers la ligne équinoxiale, on rencontre Méroé; plus loin encore, à huit cents stades, on se trouve dans le pays d'où nous vient la cannelle. Toutes ces régions, situées sous la zone torride, sont faiblement peuplées, il est vrai ; cependant l'existence y est supportable : mais au delà elle cesse de l'être, à cause de l'excès des feux du soleil. C'est vraisemblablement parce que la zone torride offre tant de terres habitées (et il est probable qu'il en est de même vers l'autre extrémité voisine de nos antéciens), que la poésie épique, qui a le droit de tout agrandir, se permet de prolonger le cours du soleil à travers les zones tempérées. La raison en est que des deux côtés les limites de la zone torride ont cela de commun avec les zones tempérées, qu'elles ont des habitants. Peut-être, par une licence poétique, a-t-il substitué une particule presque semblable, aimant mieux dire per ambas que sub ambas. Car, en réalité, le zodiaque pénètre au delà et en deçà, au-dessous des zones tempérées, mais n'y entre pas. Nous savons qu'Homère lui-même et Virgile, son imitateur en tout, ne se font pas faute d'échanger ainsi les particules. Peut-être enfin (ce qui me paraît le plus probable) Virgile a-t-il voulu donner au mot per le sens du mot inter; car le zodiaque fait sa révolution entre et non à travers les deux zones tempérées. Or il est ordinaire à ce poète d'employer per pour inter, comme dans cet autre passage : Circum perque duas in morem fluminis Arctos. Le Dragon ne coupe cependant point les deux Ourses ; il les embrasse l'une et l'autre par sinuosités, mais il ne passe pas au travers de ces constellations. Cependant ce vers est aisé à entendre, si nous substituons, comme l'a fait Virgile, la préposition entre (per) à la préposition au travers (inter). Nous n'avons rien à ajouter à ce que nous venons de dire pour la défense du passage rapporté ci-dessus ; et, d'après les notions que nous avons données sur les bornes de l'orbite solaire, il est impossible de ne pas entendre cet endroit d'un poète aussi correct que le cygne de Mantoue. Nous laissons à l'esprit du lecteur le soin de trouver ce qu'on pourrait alléguer de plus pour terminer cette discussion. Chap. IX. Notre globe est enveloppé par l'Océan, non pas en un sens, mais en deux différents sens. La partie que nous habitons est resserrée vers les pôles, et plus large vers son centre. Du peu d'étendue de l'Océan, qui nous parait si grand. Les éclaircissements que nous venons de donneront, je crois, leur utilité ; nous allons maintenant, ainsi que no.us l'avons promis, démontrer que l'Océan entoure la terre, non pas eu un seul sens, mais en deux sens divers. Son premier contour, celui qui mérite véritablement ce nom, est ignoré du vulgaire : car cette mer, regardée généralement comme le seul Océan, n'est qu'une extension de l'Océan primitif, que le superflu de ses eaux oblige à ceindre de nouveau la terre. La première ceinture qu'il forme autour de notre globe s'étend à travers la zone torride, en suivant la direction de la ligne équinoxiale, et fait le tour entier du globe. Vers l'orient, il se partage en deux bras, dont l'un coule vers le nord, et l'autre vers le sud. Le même partage se fait à l'occident ; et ces deux derniers bras vont à la rencontre de ceux qui sont partis de l'orient. L'impétuosité et la violence avec lesquelles s'entrechoquent ces énormes masses avant de se mêler donnent lieu à une action et à une réaction, d'où résulte le phénomène si connu du flux et du reflux, qui se fait sentir dans toute l'étendue de notre mer. Elle l'éprouve dans ses détroits, comme dans ses parties les moins resserrées, par la raison qu'elle n'est qu'une émanation du véritable Océan. Cet Océan donc, qui suit la ligne que lui trace l’équateur terrestre, et ses bras, qui se dirigent dans le sens de l'horizon, partagent le globe en quatre portions, dont ils font autant d'îles. Par son cours à travers la zone torride, qu'il environne dans toute sa longueur, il nous sépare des régions australes ; et au moyen de ses bras, qui embrassent l'un et l'autre hémisphère, il forme quatre îles, dont deux dans l'hémisphère supérieur, et deux dans l'hémisphère inférieur. C'est ce que nous fait entendre Cicéron, quand il dit : « Toute cette partie de la terre occupée par vous n'est qu'une petite île ; » au lieu de dire toute cette terre n'est qu'une petite île : par la raison qu'en entourant la terre en deux sens divers, l'Océan la partage réellement en quatre îles. La figure ci-après donnera une idée de ce partage. On y verra l'origine de notre mer, qui n'est qu'une faible partie du tout, et aussi celle de la mer Rouge, de la mer des Indes et de la mer Caspienne : bien que je n'ignore pas que cette dernière n'a, selon l'opinion de plusieurs personnes, aucune communication avec l'Océan. Il est évident que les mers de la zone tempérée australe ont aussi leur source dans le grand Océan. Mais comme ces pays nous sont encore inconnus, nous ne devons pas garantir la certitude du fait. Relativement à ce que dit Cicéron, que « toute cette partie de la terre est fort resserrée du nord au midi, plus étendue de l'orient à l'occident, » nous pouvons nous en convaincre en jetant les yeux sur la figure précitée; car l'excès de la largeur de cette zone sur sa longueur est dans la même proportion que l'excès de la longueur du tropique sur la longueur du cercle polaire boréal. En effet, bornée dans son extension longitudinale par la rencontre du cercle polaire, si court lui-même, elle peut, au moyen de la longueur du tropique, donner à ses flancs un plus grand développement. Cette forme de la partie de la terre que nous habitons l'a fait comparer, par les anciens, à une chlamyde déployée; et c’est parce que le globe tout entier, y compris l'Océan, peut être regardé, à raison de son peu d'étendue, comme le point central de tel cercle céleste que ce soit, que notre auteur a dû ajouter, en parlant de l'Atlantique : « Et, malgré tous ces grands noms, il est, comme vous voyez, bien petit. » Sans doute l'Atlantique doit être pour nous une mer immense ; mais elle doit paraître bien petite à ceux qui l'aperçoivent de la voûte éthérée, puisque la terre n'est, à l'égard du ciel, que l'indicateur d'une quantité, c'est-à-dire un point qu'il est impossible de diviser. En appuyant si soigneusement sur l'exiguïté de la sphère terrestre, le premier Africain a pour but, comme la suite nous le prouvera, de faire sentir à son petit-fils qu'une âme vraiment grande doit peu s'occuper d'étendre sa réputation, qui ne peut jamais être que très bornée, vu le peu d'espace qu'elle a pour circuler. Chap. X. Bien que le monde soit éternel, l'homme ne peut espérer de perpétuer, chez la postérité, sa gloire et sa renommée; car tout ce que contient ce monde, dont la durée n'aura pas de fin, est soumis à des vicissitudes de destruction et de reproduction. « Et quand même les races futures, recevant de leurs aïeux la renommée de chacun d'entre nous, seraient jalouses delà transmettre à la postérité, ces inondations, ces embrasements de la terre, dont le retour est inévitable à certaines époques marquées, ne permettraient pas que cette gloire fût durable, bien loin d'être éternelle. » C'est de sa conscience que le sage attend la récompense de ses belles actions; l'homme moins parfait l'attend de la gloire; et Scipion, qui désire que son petit-fils tende à la perfection, l'engage à ne pas ambitionner d'autre récompense que celle qu'il trouve en lui-même, et à dédaigner la gloire. Comme elle a deux puissants attraits, celui de pouvoir s'étendre au loin et celui de nous survivre longtemps, le premier Africain a d'abord mis sous les yeux de l'Émilien le tableau de notre globe, qui n'est qu'un point par rapport au ciel, et lui a ôté tout espoir d'étendre au loin le bruit de sa renommée, en lui faisant observer que les hommes de notre espèce n'occupent qu'une bien faible partie de ce même globe, et que cette partie même ne peut être entièrement remplie de la célébrité d'un nom, puisque celui des Romains n'avait pas encore franchi le Caucase, ni traversé les flots du Gange. Maintenant il va lui prouver que la gloire a peu de durée, afin de le convaincre entièrement qu'elle ne mérite pas d'être recherchée. « Quelque circonscrite que soit, lui dit-il, la carrière que peut parcourir la réputation du sage et de l'homme vraiment grand, cette réputation ne sera pas éternelle, ni même de longue durée, vu que tout ce qui existe à présent doit être anéanti, soit par les embrasements, soit par les inondations de la terre. » Mais ce passage de Cicéron veut être développé, parce qu'il décide implicitement la question de l'éternité du monde, qui, pour beaucoup de personnes, est l'objet d'un doute. Il n'est pas facile, en effet, de concevoir que cet univers n'ait pas eu de commencement; et, s'il en faut croire l'histoire, l'usage de la plupart des choses, leur perfectionnement, leur invention même est d'une date toute récente. Si l'on s'en rapporte aux traditions, ou bien aux fictions de l'antiquité, les premiers hommes, grossiers habitants des bois, différaient peu des animaux féroces. Leurs aliments, ajoute-t-elle, ne ressemblaient pas aux nôtres ; ils se nourrissaient de glands et de fruits sauvages, et ce ne fut que bien tard qu'ils cultivèrent la terre. Elle nous ramène ainsi à la naissance des choses, à celle de l'espèce humaine, et à la croyance de l'âge d'or, qui fut suivi de deux âges désignés par des métaux d'une pureté progressivement décroissante, lesquels âges firent place enfin aux temps si dégradés du siècle de fer. Mais, en laissant de côté la fiction, comment ne croirait-on pas que le monde a commencé, et même depuis bien peu de temps, quand on voit que les faits les plus intéressants des annales grecques ne remontent pas au delà de deux mille ans? car avant Ninus, que plusieurs historiens donnent pour père à Sémiramis, l'histoire ne relate aucun événement remarquable. Si l'on admet que cet univers a commencé avec les temps et même avant les temps, comme disent les philosophes, comment se fait-il qu'il ait fallu une suite innombrable de siècles pour amener le degré de civilisation où nous sommes parvenus ? Pourquoi l'invention des caractères alphabétiques qui nous transmettent le souvenir des hommes et des choses, est-elle si nouvelle? Enfin, pourquoi diverses nations n'ont-elles acquis que depuis peu des connaissances de première nécessité? Témoin les Gaulois, qui n'ont connu la culture de la vigne et celle de l'olivier que vers les premiers siècles de Rome, sans parler de beaucoup d'autres peuples qui ne se doutent pas d'une foule de découvertes qui sont pour nous des jouissances. Tout cela semble exclure l'idée de l'éternité des choses, et pourrait nous faire croire que la naissance du monde a une époque fixe, et que tous les êtres ont été produits successivement. Mais la philosophie nous apprend que ce monde a toujours été, et que l'Éternel l'a créé avant les temps. En effet, le temps ne peut être antérieur à l'univers, puisqu'il se mesure par le cours du soleil. Quant aux choses d'ici-bas, elles s'anéantissent en grande partie, bien que l'univers soit indestructible; puis elles rentrent de nouveau dans la vie. C'est l'effet de l'alternation des embrasements et des inondations, dont nous allons exposer la cause nécessaire. Selon les plus anciens physiciens, le feu éthéré se nourrit de vapeurs ; ils nous assurent que si la nature a placé, comme nous l'avons dit ci-dessus, l'Océan au-dessous de la zone torride que traverse le zodiaque, c'est afin que le soleil, la lune, et les cinq corps errants qui parcourent cette zone en tous sens, puissent tirer leur aliment des particules qui s'élèvent du sein des eaux. Voilà, disent-ils, ce qu'Homère donne à entendre aux sages, quand ce génie créateur, qui nous rend témoins des actions des dieux sur toute la nature, feint que Jupiter, invité à un banquet par les Éthiopiens, se rend dans l'Océan avec les autres dieux, c'est-à-dire avec les autres planètes; ce qui ne veut dire autre chose, sinon que les astres se nourrissent de molécules aqueuses. Et quand ce même poète ajoute que les rois d'Ethiopie sont admis aux festins des dieux, il peint, par cette allégorie, les peuples de cette contrée de l'Afrique, seuls habitants des bords de l'Océan, et dont la peau, brûlée des feux du soleil, a une teinte presque noire. De ce que la chaleur s'entretient par l'humidité, il suit que le feu et l'eau éprouvent alternativement un excès de réplétion. Lorsque le feu est parvenue cet excès, l'équilibre entre les deux éléments est détruit. Alors la température trop élevée de l'air produit un incendie qui pénètre jusqu'aux entrailles de la terre; mais bientôt l'ardeur dévorante du fluide igné se trouve ralentie, et l'eau recouvre insensiblement ses forces; car la matière du feu, épuisée en grande partie, absorbe peu de particules humides. C'est ainsi qu'à son tour l'élément aqueux, après une longue suite de siècles, acquiert un tel excédant qu'il est contraint d'inonder la terre ; et pendant cette crue des eaux, le feu se remet des pertes qu'il a essuyées. Cette alternative de suprématie entre les deux éléments n'altère en rien le reste du monde, mais détruit souvent l'espèce humaine, les arts et l'industrie, qui renaissent lorsque le calme est rétabli ; car cette dévastation causée, soit par les inondations, soit par les embrasements, n'est jamais générale. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'Egypte est à l'abri de ces deux fléaux: Platon nous l'assure dans son Timée. Aussi cette contrée est-elle la seule qui ait élevé des monuments et recueilli des faits dont la date remonte à plusieurs myriades de siècles. Il est donc quelques parties de la terre qui survivent au désastre commun, et qui servent à renouveler l'espèce humaine; voilà comment il arrive que, la civilisation ayant encore un asile sur quelques portions du globe, il existe des hordes sauvages qui ont perdu jusqu'à la trace des connaissances de leurs ancêtres. Insensiblement leurs mœurs s'adoucissent; elles se réunissent sous l'empire de la loi naturelle : l'ignorance du mal et une franchise grossière leur tiennent lieu de vertus. Cette époque est pour elles le siècle d'or. L'accroissement des arts et de l'industrie vient bientôt après donner plus d'activité à l'émulation ; mais ce sentiment si noble dans son origine produit bientôt l'envie, qui ronge sourdement les cœurs. Dès lors commencent, pour cette société naissante, tous les maux qui l'affligeront un jour. Telle est l'alternative de destruction et de reproduction à laquelle est assujetti le genre humain, sans que la stabilité du monde en souffre. Chap. XI. Il est plus d'une manière de supputer les années : la grande année, l'année vraiment parfaite, comprend quinze mille de nos années. « Qui plus est, que vous importe d'être nommé dans les discours des hommes qui naîtront dans l'avenir, lorsque ceux qui vous ont précédé sur la terre, plus nombreux peut-être que leurs descendants, et qui certainement valaient mieux, n'ont jamais parlé de vous? Que dis-je? parmi ceux même qui peuvent répéter notre nom, il n'en est pas un qui puisse recueillir le souvenir d'une année. L'aunée, selon les calculs vulgaires, se mesure sur le retour du soleil, c'est-à-dire d'un seul astre ; mais il faut que tous les astres soient revenus au point d'où ils sont partis une première fois, et qu'ils aient ramené, après un long temps, la même face du ciel, pour que l'année véritable soit entièrement révolue; et je n'ose dire combien cette année comprend de vos siècles. Ainsi, le soleil disparut aux yeux des hommes, et sembla s'éteindre, quand l'âme de Romulus entra dans nos saintes demeures ; lorsqu'il s'éclipsera du même côté du ciel et au même instant, alors toutes les étoiles, toutes les constellations se trouveront dans la même position : alors seulement l'année sera complète. Mais sachez que, d'une telle année, la vingtième partie n'est pas encore écoulée. » Le premier Africain continue à insister sur les motifs qui doivent détourner son petit-fils d'ambitionner la gloire. Il vient de lui prouver que cette gloire, resserrée dans un champ bien étroit, ne pouvait même le parcourir longtemps ; il lui démontre à présent qu'elle ne peut embrasser la durée d'une seule année. Voici sur quoi est appuyée cette assertion. Il est d'autres années que celles vulgairement appelées de ce nom : le soleil, la lune, les planètes et les autres astres ont aussi leur année, qui se compose du temps que chacune de ces étoiles emploie à revenir au même point du ciel d'où elle était partie. C'est ainsi que le mois est une année lunaire, parce que la révolution synodique de la lune s'achève dans cet intervalle de temps. Aussi le mot latin mensis (mois) est-il dérivé de mené, mot grec qui signifie lune. Cependant le soleil ouvre la grande année, dit Virgile, qui veut exprimer la différence de l'année solaire à l'année lunaire. On conçoit que le mot grand n'est employé ici que comparativement ; car la révolution de Vénus et celle de Mercure est à peu près de la même longueur que celle du soleil; Mars met deux ans à tracer son orbite; Jupiter douze, et Saturne trente. Mais le retour de ces corps errants à leur point de départ doit être suffisamment connu. Quant à l'année dite du monde, et qu'on nomme avec raison l'année accomplie, parce que sa période rétablit dans les deux les aspects primitifs de tous les astres, elle renferme un grand nombre de siècles, ainsi que nous allons le démontrer. Toutes les constellations, toutes les étoiles qui semblent attachées à la voûte céleste ont un mouvement propre que l'œil humain ne peut apercevoir, non seulement elles sont chaque jour entraînées avec tout le ciel, mais elles se meuvent encore sur elles-mêmes ; et ce second mouvement est si lent, que l'observateur le plus assidu, quelque longue que soit son existence, les voit toujours dans la même situation où il a commencé de les voir. Ce n'est donc que lorsque chacun de ces corps lumineux a retrouvé sa position primitive et relative, que finit la révolution de la grande année; en sorte que l'un quelconque de ces astres doit alors occuper, respectivement aux autres, et en même temps qu'eux, le point du ciel qu'il occupait au commencement de cette même année : alors aussi les sept sphères errantes doivent être revenues à leur première place, toutes ensemble. Cette restitution parfaite des aspects s'accomplit, disent les physiciens, en quinze mille ans. Ainsi, de même que l'année lunaire se compose d'un mois, l'année solaire de douze mois, et celle de chaque étoile errante du nombre de mois ou d'années ci-dessus relatés, de même la grande année se compose de quinze mille années. On peut véritablement l'appeler année accomplie, par la raison qu'elle ne se mesure point sur la révolution du soleil, c'est-à-dire d'un seul astre, mais sur la coïncidence, en un même temps, de la fin des huit révolutions sidérales, avec le point de départ de chacun des astres en particulier. Cette grande année se nomme encore l'année du monde, parce que le monde, à proprement parler, c'est le ciel. Il en est du commencement de l'année parfaite comme de celui de l'année solaire, que l'on compte, soit à partir des calendes de janvier, jusqu'aux mêmes calendes de l'année suivante; soit du jour qui suit ces calendes, jusqu'au jour anniversaire; soit enfin de tel autre jour d'un mois quelconque, jusqu'au jour qui lui correspond à un an de date : chacun est libre de commencer où il veut la période de quinze mille ans. Cicéron la fait commencer à l'éclipsé de soleil qui arriva au moment de la mort de Romulus; et quoique depuis cette époque l'astre du jour ait voilé plusieurs fois sa lumière, ces phénomènes souvent répétés n'ont pas complété la restitution périodique des huit sphères ; elle ne sera accomplie que lorsque le soleil, nous privant de sa lumière dans la même partie du ciel où il se trouvait quand Romulus cessa de vivre, les autres planètes, ainsi que la sphère des fixes, offriront les mêmes aspects qu'elles avaient alors. Donc, à dater du décès de Romulus, il s'écoulera quinze mille ans (tel est le sentiment des physiciens) avant que le synchronisme du mouvement des corps célestes les rappelle aux mêmes lieux du ciel qu'ils occupaient dans cet instant. On compte cinq cent soixante-treize ans depuis la disparition du premier roi des Romains jusqu'à l'arrivée du second Scipion en Afrique ; car, entre la fondation de Rome et le triomphe de l'Émilien après la ruine de Carthage, il existe un intervalle de six cent sept ans. En soustrayant de ce nombre les trente-deux années du règne de Romulus, plus les deux années qui séparent le songe de Scipion de la fin de la troisième guerre punique, on trouvera un espace de temps égal à cinq cent soixante-treize ans. Cicéron a donc eu raison de dire que la vingtième partie de l'année complète n'était pas encore écoulée. Cette assertion est facile à prouver, car il ne faut pas être un bien habile calculateur pour trouver la différence qu'il y a entre cinq cent soixante-treize ans et la vingtième partie d'une période de quinze mille ans. Chap. XII. L'homme, n'est pas corps, mais esprit. Rien ne meurt dans ce monde, rien ne se détruit. « Travaillez en effet, et sachez bien que vous n'êtes pas mortel, mais ce corps seulement. Cette forme sensible, ce n'est pas vous : l'âme de l'homme, voilà l'homme, et non cette figure extérieure que l'ou peut indiquer avec le doigt. Sachez donc que vous êtes dieu ; car celui-là est dieu qui vit, qui sent, qui se souvient, qui prévoit, qui gouverne, régit et meut le corps confié à ses soins, comme le Dieu suprême gouverne toutes choses. De même que ce Dieu éternel meut un monde en partie corruptible, de même l'âme éternelle meut un corps périssable. » On ne peut assez admirer la sagesse des avis que le premier Africain donne à son petit-fils par l'organe de Cicéron. En voici le précis depuis l'instant de l'apparition de ce personnage. Publius commence d'abord par révéler au jeune Scipion l'heure de sa mort, et la trahison de ses proches ; il a pour but d'engager l'Émilien à faire peu de cas de cette vie mortelle, et d'une si courte durée. Puis, afin de relever son courage que devait affaiblir une semblable prédiction, il lui annonce que, pour le sage et pour le bon citoyen, notre existence ici-bas est la route qui conduit à l'immortalité. Au moment où l'attente d'une aussi haute récompense enflamme son petit-fils au point de lui faire désirer la mort, celui-ci voit arriver Paulus, son père, qui emploie les raisons les plus propres à le dissuader de hâter l'instant de son bonheur par une mort volontaire. Son âme, ainsi modifiée par l'espoir d'une part, et par la résignation de l'autre, se trouve disposée à la contemplation des choses divines, vers lesquelles son aïeul veut qu'il dirige sa vue. S'il lui permet de porter ses regards vers la terre, ce n'est qu'après l'avoir instruit sur la nature, le mouvement, l'harmonie des corps célestes : la jouissance de toutes ces merveilles, lui dit-il, est réservée à la vertu. L'Émilien vient de puiser de nouvelles forces dans l'enthousiasme qu'une telle promesse fait lui éprouver; c'est ce moment que choisit son grand-père pour lui inspirer le mépris de la gloire, envisagée par le commun des hommes comme la plus digne rétribution du mérite. Il la lui montre resserrée par les lieux, bornée par les temps, à raison du peu d'espace qu'elle a à parcourir sur notre globe, et des catastrophes auxquelles la terre est exposée. Ainsi dépouillé de son enveloppe mortelle, et en quelque sorte spiritualisé, le jeune Scipion est jugé digne d'être admis à un important secret, celui de se regarder comme une portion de la Divinité. Ceci nous conduit tout naturellement à terminer notre traité par le développement de cette noble idée, que l'âme est non seulement immortelle, mais même qu'elle est dieu. Le premier Africain, qui, dégagé naguère des liens du corps, avait été admis au céleste séjour, et qui se disposait à dire à un mortel, Sachez donc que vous êtes dieu, ne veut lui faire cette sublime confidence qu'après s'être assuré que ce mortel se connaît assez bien lui-même pour être convaincu que ce qu'il y a de caduc et de périssable chez l'homme ne fait point partie de la Divinité. Ici, l'orateur romain, qui a pour principe d'encadrer les pensées les plus abstraites dans le moins de mots qu'il est possible, a tellement usé de cette méthode, que Plotin, si concis lui-même, a écrit sur ce sujet un livre entier ayant pour titre : Qu'est-ce que l'animal? Qu'est-ce que l'homme? Il cherche, dans cet ouvrage, à remonter à la source de nos plaisirs, de nos peines, de nos craintes, de nos désirs, de nos animosités ou de nos ressentiments, de la pensée et de l'intelligence. Il examine si ces diverses sensations sont réfléchies par l'âme seule, ou par l'âme agissant de concert avec le corps ; puis, après une longue dissertation bien métaphysique, bien ténébreuse, et que nous ne mettrons pas sous les yeux du lecteur, de crainte de l'ennuyer, il termine en disant que l'animal est un corps animé; mais ce n'est pas sans avoir discuté soigneusement les bienfaits que l'âme répand sur ce corps, et le genre d'association qu'elle forme avec lui. Ce philosophe, qui assigne à l'animal toutes les passions énoncées ci-dessus, ne voit dans l'homme qu'une âme. Il suit de là que l'homme n'est pas ce qu'annonce sa forme extérieure, mais qu'il est réellement la substance à laquelle obéit cette forme extérieure ; aussi le corps est-il abattu, lorsqu'au moment de la mort de l'animal la partie vivifiante s'éloigne de lui. Voilà ce qui arrive à l'apparence mortelle de l'homme; mais quanta son âme, qui est l'homme effectif, elle est tellement hors de toute atteinte de mortalité, qu'à l'exemple du Dieu qui régit cet univers, elle régit le corps aussi longtemps qu'elle l'anime. C'est à quoi font allusion les physiciens quand ils appellent le monde un grand homme, et l'homme un petit monde. C'est donc parce que l'âme semble jouir des prérogatives de la Divinité, que les philosophes lui ont donné, comme l'a fait Cicéron, le nom de Dieu. Si ce dernier parle d'un monde en partie corruptible, c'est pour se conformer à l'opinion du vulgaire, qui s'imagine, en voyant un animal étendu sans vie, un feu éteint, une substance aqueuse réduite à siccité, que différents corps de la nature se réduisent au néant ; mais la saine raison nous dit que rien ne meurt dans ce monde. Cette opinion était celle de Cicéron, celle aussi de Virgile, qui dit que la mort est un mot vide de sens. En effet, la matière qui paraît se dissoudre ne fait que changer de formes, et se résoudre en ceux des éléments dont elle était le composé. Ce sujet est l'objet d'une autre dissertation de Plotin. En traitant de la destruction des corps, il affirme d'abord que tout ce qui est susceptible d'évaporation l'est aussi de réduction au néant; ensuite il se fait cette objection : Pourquoi donc les éléments dont l'évaporation est si sensible ne finissent-ils pas par s'anéantir? Mais il répond bientôt à cette difficulté, et la résout de la manière qui suit : Les éléments, bien qu'effluents, ne se dissolvent pas, parce que les émanations des corpuscules organiques ne s'éloignent pas de leur centre ; c'est une propriété des éléments, mais non des corps mixtes, dont les évaporations s'écartent au loin. Il est donc démontré qu'aucune partie du vaste corps de l'univers n'est soumise à la destruction. Ainsi, cette expression de monde en partie corruptible n'est, comme nous l'avons dit, qu'une concession faite à l'opinion commune; et nous allons voir Cicéron finir son ouvrage par un argument irrésistible en faveur de l'immortalité de l'âme; cet argument est fondé sur ce qu'elle donne l'impulsion au corps. Chap. XIII. Des trois syllogismes qu'ont employés les platoniciens pour prouver l'immortalité de l'âme. « Un être qui se meut toujours existera toujours; mais celui qui communique le mouvement qu'il a reçu lui-même d'un autre, doit cesser d'exister quand il cesse d'être mû. L'être qui se meut spontanément est donc le seul qui soit toujours en mouvement, parce qu'il ne se manque jamais à lui-même : qui plus est, il est pour tout mobile source et principe d'impulsion. Or, ce qui est principe n'a pas d'origine; tout ce qui existe la tire de lui, lui seul la trouve en lui-même; car s'il était engendré, il ne serait pas principe. N'ayant pas d'origine, il ne peut avoir de fin. En effet, un principe anéanti ne pourrait ni renaître d'un autre principe, ni en créer lui-même un nouveau, puisqu'un principe n'a pas d'antérieur. « Ainsi le principe du mouvement réside dans l'être qui se meut par lui-même ; il ne peut donc ni commencer ni finir. Autrement le ciel s'écroulerait, la nature resterait en suspens, et ne trouverait aucune force qui lui rendit l'impulsion primitive. « Si donc il est évident que l'être qui se meut par lui-même est éternel, peut-on nier que cette faculté ne soit un attribut de l'âme ? Effectivement, tout ce qui reçoit le mouvement d'ailleurs est inanimé. L'être animé seul trouve en lui son principe moteur : telle est la nature de l'âme, telle est son énergie, que si, de tous les êtres, seule elle se meut sans cesse par elle-même, dès lors elle a toujours existé, elle existera toujours. » Tout ce passage de Cicéron est extrait mot pour mot du Phédon de Platon, qui contient les arguments les plus puissants en faveur de l'immortalité de l'âme. Ces arguments concluent en somme que l'âme est immortelle, parce qu'elle se meut d'elle-même. Il convient ici de faire remarquer que le mot immortalité peut s'entendre de deux manières : une substance est immortelle quand, par elle-même, elle est hors des atteintes de la mort; elle est immortelle aussi, lorsqu'une autre substance la met à couvert de ces mêmes atteintes. La première de ces facultés appartient à l'âme, et la seconde au monde : celle-là, par sa propre nature, n'a rien à démêler avec la mort ; celui-ci tient des bienfaits de l'âme le privilège de l'immortalité. Nous devons ajouter que cette expression, « se mouvoir sans cesse », a également deux acceptions : le mouvement est continuel chez l'être qui, depuis qu'il existe, n'a pas cessé d'être mû ; il est continuel chez l'être principe, qui se meut de toute éternité. Ce dernier mode de mouvement perpétuel appartient à l'âme. Il était nécessaire d'établir ces distinctions, ayant de faire connaître les syllogismes qu'ont employés divers sectateurs de Platon pour démontrer le dogme de l'immortalité de l'âme. Les uns arrivent à leur but par une série de propositions tellement enchaînées, que la conclusion déduite des deux premiers membres du syllogisme qui précède devient le premier membre du syllogisme qui suit. Voici comment ils raisonnent : L'âme se meut d'elle-même ; tout ce qui se meut de soi-même se meut sans cesse, donc l'âme se meut sans cesse. De cette conséquence naît un second syllogisme : L'âme se meut sans cesse; ce qui se meut sans cesse est immortel, donc l'âme est immortelle. C'est ainsi qu'au moyen de deux syllogismes ils prouvent deux choses : l'une, que l'âme se meut sans cesse, c'est la conséquence du premier raisonnement; l'autre, qu'elle est immortelle, c'est la conséquence du second. D'autres platoniciens argumentent à l'aide d'un triple syllogisme. Voici comment ils procèdent : L'âme se meut par elle-même ; ce qui se meut par soi-même est principe d'impulsion, donc l'âme est principe d'impulsion. Ils continuent ainsi : L'âme est principe d'impulsion ; ce qui est principe d'impulsion n'a pas d'origine, donc l'âme n'a pas d'origine. Puis ils ajoutent immédiatement : L'âme n'a pas d'origine; ce qui n'a pas d'origine est immortel, donc l'âme est immortelle. D'autres enfin ne forment qu'un seul syllogisme de cette suite de propositions : L'âme se meut d'elle-même ; ce qui se meut de soi-même est principe d'impulsion ; un principe d'impulsion n'a pas d'origine; ce qui n'a pas d'origine est immortel ; donc l'âme est immortelle. Chap. XIV. Arguments d'Aristote pour prouver, contre le sentiment de Platon, que l'âme n'a pas de mouvement spontané. La conclusion des différents raisonnements relatés ci-dessus, c'est-à-dire l'immortalité de l'âme, n'a de force qu'auprès de ceux qui admettent la première proposition, ou le mouvement spontané de cette substance ; mais si ce principe n'est pas reçu, toutes ses conséquences sont bien affaiblies. Il est vrai qu'il a pour lui l'assentiment des stoïciens ; cependant Aristote est si éloigné de le reconnaître, qu'il refuse à l'âme non seulement le mouvement spontané, mais même la propriété de se mouvoir. Ses arguments pour prouver que rien ne se meut de soi-même sont tellement subtils, qu'il en vient jusqu'à conclure que s'il est une substance qui se meut d'elle-même, ce ne peut être l'âme. Admettons, dit ce philosophe, que l'âme est principe d'impulsion, je soutiens qu'un principe d'impulsion est privé de mouvement. Puis sa manière de procéder le conduit d'abord à soutenir qu'il est, dans la nature, quelque chose d'immobile, et à démontrer ensuite que ce quelque chose est l'âme. Voici comment il argumente : Tout ce qui existe est immobile ou mobile; ou bien une partie des êtres se meut, et l'autre partie ne se meut pas. Si le mouvement et le repos existent conjointement, tout ce qui se meut doit nécessairement se mouvoir sans cesse, et tout ce qui ne se meut pas doit toujours être en repos; ou bien tous les êtres à la fois sont tantôt immobiles, et tantôt en mouvement. Examinons maintenant laquelle de ces propositions est la plus vraisemblable. Tout n'est pas immobile, la vue seule nous le garantit, puisque nous apercevons des corps en mouvement. Elle nous dit aussi que tout ne se meut pas, puisque nous voyons des corps immobiles. Il est également démontré que tous les êtres à la fois ne sont pas tantôt en mouvement et tantôt immobiles, car il en est qui se meuvent sans cesse ; tels sont incontestablement les corps célestes. D'où l'on doit conclure, continue Aristote, qu'il en est aussi qui ne se meuvent jamais. Quant à cette dernière assertion, on ne peut lui opposer aucune objection, aucune réfutation. Cette distinction est parfaitement exacte, et ne contrarie nullement les sentiments des platoniciens. Mais de ce que certains êtres sont immobiles, doit-on en conclure que l'âme le soit? Lorsque les platoniciens disent que l'âme se meut d'elle-même, ils n'en infèrent pas que tout se meut ; ils peignent seulement le mode de mouvement de cette substance : ainsi l'immobilité peut être le partage de plusieurs êtres, sans que cela porte atteinte au mouvement spontané de l'âme. Aristote, qui pressentait cette difficulté, n'a pas plutôt établi qu'il y a des êtres immobiles, qu'aussitôt il veut ranger l'âme dans cette catégorie. Il commence d'abord par affirmer que rien ne se meut de soi-même, et que tout ce qui se meut reçoit une impulsion étrangère. Si cela pouvait être vrai, il ne resterait aucun moyen de défense aux sectateurs de Platon ; car comment admettre que l'âme se meut d'elle-même, si le mouvement spontané n'existe pas ? Voici la marche que suit Aristote dans son argumentation : De tous les êtres qui ont la faculté de se mouvoir, les uns se meuvent par eux-mêmes, les autres par accident. Ceux-là se meuvent par accident qui, ne se mouvant pas par eux-mêmes, sont placés sur un corps en mouvement : telle est la charge d'un navire, tel est aussi le pilote en repos. Le mouvement par accident a également lieu lorsqu'un tout se meut partiellement, et que son intégrité reste en repos : je puis remuer le pied, la main, la tête, sans changer de place. Une substance se meut par elle-même, quand son mouvement n'étant ni accidentel, ni partiel, toutes ses molécules intégrantes se meuvent à la fois : tel est le feu, dont l'ensemble tend à s'élever. A l'égard des êtres qui se meuvent par accident, il est incontestable que le mouvement leur vient d'ailleurs. Maintenant je vais prouver qu'il en est ainsi de ceux qui semblent se mouvoir par eux-mêmes. Parmi ces derniers, les uns ont en eux la cause de leur mouvement : tels sont les animaux, tels sont les arbres, qui certainement ne se meuvent pas d'eux-mêmes, mais sont mus par une cause interne ; car la saine raison doit toujours distinguer l'être mû de la cause motrice. Les autres reçoivent visiblement une impulsion étrangère : celle de la force, ou celle de la nature. Le trait parti de la main qui l'a lancé semble se mouvoir de lui-même, mais son principe d'impulsion n'est autre que la force. Si nous voyons quelquefois la terre tendre-vers le haut, et le feu se porter vers le bas, cette direction est encore un effet de la force ; niais c'est la nature qui contraint les corps graves à descendre, et les corps légers à s'élever. Ils n'en sont pas moins, comme les autres êtres, privés d'un mouvement propre ; et quoique leur principe d'impulsion ne nous soit pas connu, on sent cependant qu'ils obéissent à je ne sais quelle puissance. En effet, s'ils étaient doués d'un mouvement spontané, leur immobilité serait également spontanée, Ajoutons qu'au lieu de suivre toujours la même direction, ils se mouvraient en tous sens. Or cela leur est impossible, puisque les corps légers sont toujours forcés de monter, et les corps graves toujours forcés de descendre. Il est donc évident que leur mouvement est subordonné aux lois immuables de la nécessité. C'est par ces arguments, et d'autres semblables, qu'Aristote croit avoir démontré que rien de ce qui se meut ne se meut de soi-même. Mais les platoniciens ont prouvé, comme on le verra bientôt, que ces raisonnements sont plus captieux que solides. Voyons à présent de quelles assertions le rival de Platon cherche à déduire que si certains êtres pouvaient se mouvoir d'eux-mêmes, cette faculté n'appartiendrait pas à l'âme. La première proposition qu'il avance à ce sujet découle de celle-ci qu'il regarde comme incontestable, savoir, que rien ne se meut par son mouvement propre ; et voici comment il débute : Puisqu'il est certain que tout ce qui se meut reçoit d'abord son impulsion, il est hors de doute que le premier moteur, ne recevant l'impulsion que de soi-même (sans quoi il ne serait pas premier moteur), doit nécessairement être en repos, ou jouir d'un mouvement spontané ; car si le mouvement lui était communiqué, l'être qui le lui communiquerait serait lui-même mû par un autre être qui, à son tour, recevrait l'impulsion d'un autre, et ainsi de suite, en sorte que la série des forces motrices ne s'arrêterait jamais, Si donc on ne convient pas que le premier moteur soit immobile, on doit demeurer d'accord qu'il se meut de lui-même : mais alors un seul et même être renferme un moteur et un être mû ; car tout mouvement exige le concours d'une force motrice, d'un levier, et d'une substance mue. La substance mue ne meut pas ; le levier est mû et meut; la force motrice meut et n'est pas mue. Ainsi l'être intermédiaire participe des deux extrêmes, et ces deux extrêmes sont opposés, puisque l'un d'eux est mû et ne meut point, tandis que l'autre meut et n'est pas mû. Voilà ce qui nous a fait dire que tout ce qui se meut recevant son impulsion d'ailleurs, si le moteur est mû lui-même, il faut remonter indéfiniment au principe de son mouvement, sans pouvoir jamais le trouver. De plus, s'il était vrai qu'un être pût se mouvoir par lui-même, il faudrait, de toute nécessité, que chez cet être le tout reçût l'impulsion du tout, ou bien qu'une partie la reçût de l'autre partie; ou bien encore que la partie la reçût du tout, ou le tout de la partie. Mais que cette impulsion vienne du tout ou de la partie, il s'ensuivra toujours que cet être n'a pas de mouvement propre. Tous ces arguments d'Aristote se réduisent au raisonnement suivant : Tout ce qui se meut a un moteur ; ainsi le premier moteur est immobile, ou reçoit lui-même l'impulsion d'ailleurs. Mais, dans cette seconde hypothèse, il n'est plus principe d'impulsion, et dès lors la suite des forces impulsives se prolongea l'infini. Il faut donc s'en tenir à la première, et dire que la cause du mouvement est immobile. Voici donc par quel syllogisme l'antagoniste de Platon réfute le sentiment de ce dernier, qui soutient que l'âme est le principe du mouvement : L'âme est principe d'impulsion ; le principe d'impulsion ne se meut pas, donc l'âme ne se meut pas. Mais il ne s'en tient pas à cette première objection si pressante contre le mouvement de l'âme ; il oppose encore à son adversaire des raisonnements non moins énergiques. Une seule et même chose ne peut être principe et émanation : car, en géométrie, ce n'est pas la ligne, mais c'est le point qui est l'origine de la ligne ; en arithmétique, le principe des nombres n'est pas un nombre; qui plus est, toute cause productive est improductible ; donc la cause du mouvement est sans mouvement, donc aussi l'âme principe du mouvement ne se meut pas. J'ajoute, continue Aristote, qu'il ne peut jamais se faire que les contraires se trouvent réunis en une seule et même chose, en un seul et même temps, sur un seul et même point. Or, on sait que mouvoir, c'est faire une action, et qu'être mû, c'est souffrir cette action. Ainsi l'être qui se meut par lui-même se trouve au même instant dans deux situations contraires; il fait une action, et la reçoit, ce qui est impossible; donc l'âme ne peut se mouvoir. Il y a plus : si l'essence de l'âme était le mouvement, cette substance ne serait jamais immobile, car nul être ne peut contrarier son essence. Jamais le feu ne sera froid, jamais la neige ne sera chaude ; et cependant l'âme est quelquefois en repos : la preuve en est que le corps n'est pas toujours en mouvement. Donc l'essence de l'âme n'est pas le mouvement, puisqu'elle est susceptible d'immobilité. J'objecte encore, poursuit Aristote, 1° que si l'âme est principe d'impulsion, ce principe ne peut avoir d'action sur lui-même; car une cause ne peut s'appliquer les effets qu'elle produit. Un médecin rend la santé à ses malades, un pédotribe enseigne aux lutteurs les moyens de se rendre plus vigoureux ; mais ni l'un ni l'autre ne prend sa part des avantages qu'il, procure. Qu'il n'existe pas de mouvements sans ressort, c'est un principe de mécanique. Voyons maintenant si l'on peut admettre que l'âme ait besoin d'un ressort pour se mouvoir; si cette proposition n'est pas recevable, il est impossible que l'âme puisse se mouvoir. Que si l'âme se meut, elle doit, indépendamment de ses autres mouvements, posséder celui de locomotion, et conséquemment son entrée au corps et sa sortie de cette enveloppe doivent se succéder fréquemment. Mais nous ne voyons pas que cela puisse avoir lieu ; donc elle ne se meut pas. Que si l'âme a la propriété de se mouvoir, son mouvement appartient à un genre quelconque : cette substance se meut sur place ; ou bien elle se meut en se modifiant, soit qu'elle s'engendre elle-même, soit qu'elle s'épuise insensiblement, soit qu'elle s'accroisse, soit qu'elle se rapetisse : car voilà quels sont les divers genres de mouvement. Examinons maintenant de quelle manière chacun de ces mouvements pourrait avoir lieu. En admettant que l'âme se meuve sur place, elle ne peut se mouvoir qu'en ligne droite, ou en ligne circulaire ; mais il n'existe pas de ligne droite infinie, car l'entendement ne conçoit pas de lignes sans extrémités. Si donc elle se meut en suivant une ligne dont la longueur est bornée, elle ne peut se mouvoir sans cesse ; car une fois parvenue à l'une des extrémités, elle est bien forcée de s'arrêter avant de revenir sur ses pas. Elle ne peut pas non plus se mouvoir en ligne circulaire, par la raison que toute sphère se meut autour d'un point immobile que nous nommons centre. L'âme ne peut donc se mouvoir de cette sorte sans avoir en elle un point fixe ; mais alors elle ne se meut pas tout entière. Si ce point central n'est pas en elle, il est hors d'elle; ce qui est aussi absurde qu'impossible. Il suit de là que cette substance ne se meut pas sur place. Veut-on qu'elle se meuve en s'engendrant elle-même, il en résultera qu'elle est et qu'elle n'est pas la même. Se meut-elle en se consumant, dès lors elle n'est plus immortelle. Si elle s'accroît ou se rapetisse, elle sera, dans un même temps, ou plus grande ou plus petite qu'elle-même. C'est de cet amas de subtilités qu'Aristote déduit le syllogisme qui suit : Si l'âme se meut, son mouvement doit appartenir à un genre quelconque. Mais on ne voit pas de quel genre ce mouvement pourrait être ; donc elle ne se meut pas. Chap. XV. Arguments qu'emploient les platoniciens en faveur de leur maître contre Aristote ; ils démontrent qu'il existe une substance qui se meut d'elle-même, et que cette substance n'est autre que l'âme. Les preuves qu'ils en donnent détruisent la première objection d'Aristote. Des arguments si subtils, si ingénieux, si vraisemblables, exigent que nous nous rangions du côté des sectateurs de Platon, qui ont fait échouer le dessein formé par Aristote de battre en ruine une définition aussi exacte, aussi inattaquable que celle que leur maître a donnée de l'âme. Cependant, comme la passion ne m'aveugle pas au point de me faire accroire que je puisse, avec d'aussi faibles moyens que les miens, résister à l'un de ces philosophes, et prendre parti pour l'autre, j'ai jugé convenable de réunir en masse les traités apologétiques que nous ont laissés, à l'appui de leurs opinions, les hommes illustres qui se sont fait gloire de reconnaître Platon pour leur chef; et j'ai pris la liberté d'exposer mes propres sentiments à la suite de ceux de ces grands personnages. Munis de ces armes, nous allons réfuter les deux propositions qu'Aristote soutient vraies : l'une, que rien ne se meut de soi-même ; l'autre, que s'il était une substance qui eût un mouvement propre, ce ne serait pas l'âme. Nous prouverons clairement que le mouvement spontané existe, et nous démontrerons qu'il appartient à l'âme. Commençons d'abord par nous mettre en garde contre tous les sophismes de l'adversaire de Platon. Parce qu'il est parvenu à établir incontestablement que plusieurs substances qui semblent se mouvoir d'elles-mêmes reçoivent l'impulsion d'une cause interne et latente, il regarde comme accordé que tout ce qui se meut, bien qu'il semble se mouvoir de soi-même, obéit cependant à un mouvement communiqué : cela est en partie vrai, mais la conséquence est fausse. Qu'il y ait des êtres dont le mouvement propre ne soit qu'apparent, c'est ce dont nous convenons; mais il ne suit pas de là nécessairement que tout ce qui se meut de soi-même soit mû d'ailleurs. Quand Platon dit que l'âme se meut d'elle-même, il n'entend pas la mettre au nombre des êtres qui n'ont qu'une mobilité d'emprunt ; quoiqu'elle paraisse tenir à leur essence, telle que celle des animaux qui ont en eux un moteur secret (ce moteur est l'âme), ou telle que celle des arbres soumis à l'action d'une puissance (c'est la nature) qui opère en eux mystérieusement. Le mouvement que ce philosophe attribue à l'âme appartient en propre à cette substance, et n'est pas l'effet d'une cause soit interne, soit externe. Nous allons fixer le sens de cette proposition. Nous disons du feu qu'il est chaud, nous disons aussi qu'un fer est chaud ; nous considérons la neige comme un corps froid, nous attribuons également à la pierre cette propriété de froideur; nous qualifions le miel de doux, et c'est par la même expression que nous désignons la saveur du vin miellé. Mais chacun de ces mots, chaleur, froideur, douceur, a plus d'une acception. La chaleur du feu et celle d'un fer chaud ne nous offrent pas la même idée; car le feu, chaud par lui-même, ne doit pas sa chaleur à une autre substance, tandis que le fer ne peut avoir qu'une chaleur empruntée. La froideur de la neige, la douceur du miel constituent la nature de ces corps ; mais la pierre reçoit de la neige sa froideur, et le vin miellé est redevable au miel de sa douceur. Il en est de même des mots repos et mouvement : nous attribuons ces deux états aux êtres dont le mouvement ou le repos sont spontanés, aussi bien qu'à ceux qui doivent leur mobilité ou leur immobilité à une cause étrangère. Mais, chez ces derniers, ni le mouvement ni le repos ne peuvent être perpétuels ; tandis que les premiers ne cessent de se mouvoir, parce que, chez eux, se mouvoir et exister n'étant qu'une seule et même chose, ils ne peuvent contrarier leur essence. Le fer peut donc perdre de sa chaleur, mais le feu ne cessera jamais d'être chaud; donc aussi l'âme est la seule substance qui se meuve d'elle-même; et si les animaux et les arbres semblent jouir de cette propriété, ils n'en jouissent qu'en apparence; car ils reçoivent l'impulsion d'une cause interne et latente, qui est l'âme ou la nature : ils peuvent donc perdre une faculté qui ne fait pas partie d'eux-mêmes. Il n'en est pas ainsi du mouvement de l'âme et de la chaleur du feu ; ces deux modes sont respectivement inhérents à ces deux substances. En effet, quand on dit que le feu est chaud, cette expression n'offre pas à l'esprit deux idées distinctes, celle d'un être échauffé et celle d'un être qui échauffe, mais l'idée simple du fluide igné. Cette manière de parler, neige froide et miel doux, n'emporte pas avec elle l'idée d'un être qui donne et d'un être qui reçoit. De même, lorsque nous disons que l'âme se meut par elle-même, nous ne la considérons pas comme formée de deux substances, dont l'une meut et dont l'autre est mue, mais comme une substance simple dont l'essence est le mouvement ; et comme on a spécifié le feu, la neige, le miel, par leurs qualités sensibles, on a aussi spécifié l'âme par l'appellation d'être qui est mû par soi-même ; et, bien qu'être mû soit un verbe passif, il ne faut pas croire qu'il en soit de ce verbe comme de ceux-ci : être coupé, être manié, qui supposent deux actions, l'une faite et l'autre reçue. Être mû présente, il est vrai, une idée complexe, lorsqu'il s'agit des êtres qui sont mus par d'autres êtres, mais jamais lorsqu'il est question de l'âme, qui ne peut, en aucun cas, être soumise à une action. Le verbe s'arrêter n'est pas au nombre des verbes passifs, et cependant il exprime une action soufferte quand on l'emploie en parlant d'un corps forcé au repos par un autre corps, comme dans cet exemple : Les piques s'arrêtent sur le sol dans lequel on les a enfoncées. Il en est tout autrement du verbe être mû regardé comme passif, et qui cependant ne l'est pas quand son sujet ne souffre pas d'action. Ce que nous allons dire prouve clairement que l'action reçue réside dans la chose elle-même, et non dans le verbe qui l'exprime : quand le feu tend à s'élever, il ne souffre pas d'action; lorsqu'il tend à descendre, il en reçoit une, parce qu'il ne prend cette dernière direction qu'en cédant à la force d'un autre corps. C'est cependant un seul et même verbe qui représente ces deux manières d'être si opposées. Ainsi, les verbes être mû, être chaud, peuvent être pris tous deux soit activement, soit passivement. Si je dis qu'un fer est chaud, qu'un stylet est mû, j'exprime une action soufferte et non pas une action faite par ces deux êtres ; mais quand je dis que le feu est chaud, que l'âme est mue, je ne puis concevoir ces deux substances comme soumises à une action, puisque le mouvement est l'essence de l'âme, comme la chaleur est l'essence du feu. Aristote emploie ici une subtilité captieuse pour avoir une occasion d'accuser Platon, et de lui soutenir qu'il fait de l'âme une substance tout à la fois active et passive. Ce dernier avait dit : « L'être qui se meut spontanément est donc le seul qui puisse toujours être mû, parce qu'il ne se manque jamais à lui-même. » Sur quoi le premier se récrie : « Une substance ne peut en même temps être mue et se mouvoir spontanément. » Mais ce n'est là qu'une chicane de mots, et ce ne peut être sérieusement qu'un aussi grand homme use de pareilles arguties; car quel est celui qui ne sent pas que se mouvoir n'est pas une action double? Dira-t-on que se punir soi-même exige le concours de deux personnes, l'une qui punit, l'autre qui est punie ? Se perdre, s'envelopper, s'affranchir, sont dans le même cas. Cette manière de s'énoncer ne fait entendre autre chose, sinon que celui qui se punit, qui se perd, qui s'enveloppe, qui s'affranchit, agit sur lui-même sans la coopération d'une autre personne. Il en est de même de cette expression, se mouvoir spontanément. Elle exclut l'idée d'un moteur étranger ; et c'est pour éloigner cette idée de l'esprit du lecteur, que Platon a fait précéder notre dernière citation de ces mots : « Un être qui se meut toujours existera toujours; mais celui qui communique le mouvement qu'il a reçu lui-même d'un autre, doit cesser d'exister quand il cesse d'être mû. » Pouvait-il s'exprimer d'une manière plus claire, et démontrer plus expressément que ce qui se meut de soi-même n'est pas soumis à une impulsion étrangère, qu'en disant que si l'âme est éternelle, c'est parce qu'elle n'a d'autre moteur qu'elle-même? Donc, se mouvoir soi-même n'offre qu'un seul sens, celui de n'être mû par aucune autre substance. Et qu'on ne croie pas qu'un seul et même être puisse être moteur et être mû ; car une substance ne se meut d'elle-même que parce qu'elle peut se passer de moteur. Il est donc incontestable que certains êtres peuvent se mouvoir sans être mus ; donc aussi cette faculté peut appartenir à l'âme; et, pour qu'elle jouisse d'un mouvement spontané, il n'est pas nécessaire qu'elle soit formée de deux êtres, l'un actif et l'autre passif, ni que, chez elle, le tout reçoive l'impulsion du tout ou d'une partie du tout, comme le veut Aristote; il suffit, pour qu'elle se meuve d'elle-même, qu'elle n'ait pas de moteur. Quant à cette distinction qu'il établit entre les mouvements, lorsqu'il dit que comme il y a des êtres qui sont mus et ne meuvent point, de même il en est qui meuvent et ne sont pas mus, elle est plus subtile que facile à démontrer ; car il est évident que tout ce qui est mû, meut : le gouvernail meut le navire, et le navire meut l'air environnant, et l'onde qu'il sillonne. Est-il un corps qui reçoive le mouvement sans le communiquer? Cette première assertion, que ce qui est mû ne meut pas, est donc détruite ; et elle entraine dans sa chute cette seconde, que ce qui meut n'est pas mû. Il vaut infiniment mieux s'en tenir à la distinction de Platon, telle qu'on la trouve dans son dixième livre des Lois : Tout être en mouvement se meut, et en meut d'autres, ou bien il est mû, et en meut d'autres. Le premier cas est celui de l'âme, et le second celui de tous les corps de la nature ; il y a donc analogie et dissemblance entre ces deux sortes de mouvement. Ils ont cela de commun que tous deux donnent aux autres l'impulsion ; et leur différence consiste en ce que le premier existe par lui-même, et que le second existe par communication. De cet assemblage d'opinions émanées du génie fécond des platoniciens, il résulte qu'il n'est pas vrai que tout ce qui se meut n'ait qu'un mouvement emprunté. Nous ne dirons donc pas, pour éviter la difficulté de recourir à un autre moteur, que le principe d'impulsion est immobile, car nous venons de prouver qu'il se meut de lui-même; et dès lors ce syllogisme d'Aristote, résumé de diverses prémisses, et d'une complication de distinctions, n'a plus de force : « L'âme est le principe du mouvement; le principe du mouvement ne se meut pas, donc l'âme ne se meut pas. » Puisqu'il est incontestable que quelque chose se meut de soi-même, démontrons que ce quelque chose est l'âme. Cette démonstration sera d'autant plus aisée, que nous tirerons nos arguments d'assertions irréfragables. L'homme reçoit le mouvement de l'âme ou du corps, ou bien de l'agrégat de ces deux êtres. Si nous discutons ces trois causes supposées du mouvement, nous trouverons que les deux dernières ne sont pas admissibles, et nous serons forcés de conclure que l'âme est le seul moteur de l'homme. Parlons d'abord du corps: une masse inanimée n'a pas de mouvement propre ; cette proposition peut se passer de démonstration, car l'immobilité ne peut engendrer le mouvement; donc ce n'est pas le corps qui donne l'impulsion à l'homme. Voyons à présent si l'agrégat de l'âme et du corps est doué du mouvement spontané; mais c'est chose impossible, car le corps ne peut être mû si l'âme ne se meut point. Deux êtres en repos ne peuvent produire le mouvement; l'amertume ne naît point de la mixtion de deux substances douces, ni la douceur, de deux substances amères : un froid dont l'intensité est doublée ne peut procurer la chaleur ; et cette dernière, en doublant son degré de force, ne peut occasionner le froid ; car toute qualité sensible, ajoutée une fois à elle-même, ne peut qu'augmenter ; mais de l'amalgame de deux substances dont les propriétés sont semblables, jamais il ne peut naître un mixte ayant des propriétés contraires ; donc le mouvement ne peut naître de l'agrégat de deux êtres privés de mouvement, donc cet agrégat ne peut donner le mouvement à l'homme. Des propositions précédentes, qui sont incontestables, nous allons former un syllogisme qu'il est impossible de réfuter : Tout être animé est mû ; il l'est, soit par l'âme, soit par le corps, soit enfin par l'agrégat de l'âme et du corps. Mais les deux dernières suppositions ne peuvent être admises, donc l'âme est le seul moteur de l'être animé. Il suit de là que l'âme est principe d'impulsion; mais le principe d'impulsion se meut de lui-même, ainsi que nous l'avons démontré plus haut. Il est donc de toute certitude que l'âme se meut d'elle-même. Chap. XVI. Nouveaux arguments des platoniciens contre les autres objections d'Aristote. Aristote, qui ne se tient pas pour battu, fait ici de nouvelles objections relatives au principe d'impulsion. Nous les avons exposées ci-dessus dans l'ordre qui les lie; en voici maintenant le résumé. Un seul et même être, dit-il, ne peut être principe et émanation ; donc l'âme, principe du mouvement, n'est pas mue. Car alors le principe et ses conséquences seraient une seule et même chose ; ou, ce qui revient au même, le mouvement dériverait du mouvement. La réponse à cette objection est facile et péremptoire. Nous convenons qu'il peut exister une différence entre le principe et ses conséquences, mais cette différence ne va jamais jusqu'au contraste, ou jusqu'à l'opposition qu'on remarque entre le repos et le mouvement; car si le principe du blanc était le noir, si le principe de l'humidité était la sécheresse, le bien naîtrait du mal, et la douceur de l'amertume. Mais il n'en est pas ainsi, parce qu'il n'est pas dans la nature des choses que le principe et ses conséquences soient entièrement opposées. Il peut arriver cependant qu'il y ait entre eux une différence telle que doit l'offrir une source et ses dérivations ; ressemblance si analogue à celle qui se trouve entre le mouvement inhérent il l'âme, et celui qu'elle transmet à tous les corps de l'univers. Aussi Platon désigne-t-il le premier de ces mouvements par le nom de spontané; et le second, il l'appelle purement et simplement mouvement. D'après cette distinction, on peut juger de la diversité de ces deux mouvements, dont l'un est cause, et l'autre effet d'impulsion. Il est donc évident qu'un principe et ses conséquences ne peuvent différer au point d'être directement opposés, et que, dans le cas dont il s'agit, la différence n'est pas très grande. Ainsi se trouve anéantie cette conséquence si adroitement déduite par Aristote, que la cause du mouvement est sans mouvement. Passons à sa troisième objection : Les contraires, dit-il, ne peuvent se rencontrer à la fois dans un seul et même être. Or, mouvoir et être mû sont deux choses contraires; donc l'âme ne peut se mouvoir, car alors cette substance serait en même temps mue et motrice. Mais nous avons pulvérisé ce syllogisme, en démontrant plus haut que le mouvement de l'âme ne peut offrir l'idée d'une action faite et d'une action reçue, puisque se mouvoir de soi-même n'est autre chose qu'être mû sans le secours d'un moteur. C'est donc ici une unité d'action qui ne peut admettre les contraires; car il ne s'agit pas d'un être agissant sur un autre être, mais d'une substance dont l'essence est le mouvement. Cette assertion de Platon offre à son antagoniste l'occasion d'élever une quatrième objection : Si l'essence de l'âme est le mouvement, poursuit Aristote, pourquoi donc s'arrête-t-elle de temps en temps? Le feu, dont l'essence est la chaleur, ne la perd jamais; la neige, essentiellement froide, ne cesse jamais de l'être: donc l'âme devrait toujours être en mouvement. Mais dans quelle circonstance suppose-t il que l'âme est immobile? Nous allons bientôt le savoir. Si le mouvement de l'âme, dit ce philosophe, entraîne celui du corps, nécessairement le repos du corps force l'âme à être immobile. Il se présente sur-le-champ un double moyen de défense contre un tel sophisme. D'abord, le corps peut être en mouvement sans qu'on doive en conclure que l'âme se meut ; il peut aussi sembler conserver la plus parfaite immobilité, sans que la pensée, l'ouïe, l'odorat et les autres sensations cessent d'être en action. Pendant le sommeil même nous songeons, nous respirons ; or toutes ces opérations n'auraient pas lieu si l'âme était immobile. Ajoutons qu'on ne peut pas dire que le corps est en repos, lors même qu'il ne paraît pas se mouvoir. L'accroissement des membres, et, sans parler de cet accroissement qui n'a qu'une époque, le mouvement alternatif de contraction et de dilatation du cœur, la conversion des substances alimentaires en un suc distribué par le canal thorachique à la masse du sang, et la circulation des humeurs, attestent suffisamment l'agitation perpétuelle de cette substance. Ainsi l'âme et le corps se meuvent sans cesse : la première, parce qu'il lui est donné de se mouvoir par elle-même de toute éternité; et le second, parce que, depuis qu'il existe, il n'a pas cessé de recevoir l'impulsion de la cause motrice. Aristote trouve ici la matière de sa cinquième objection. « Si l'âme, dit-il, est le principe d'impulsion des autres êtres, elle ne peut se donnera elle-même l'impulsion; car une cause ne peut s'appliquer les effets qu'elle produit. » Il me serait aisé de démontrer que la causalité de plusieurs substances s'étend non seulement sur ces mêmes substances, mais encore sur d'autres qu'elles. Quoi qu'il en soit, je veux bien lui accorder ce point, pour que l'on ne croie pas que je prends plaisir à détruire toutes ses assertions : cette concession ne nuira pas à notre démonstration du mouvement de l'âme. Nous avons dit que cette substance est principe et cause du mouvement : parlons du principe, nous reviendrons bientôt sur la cause. Il est évident que tout principe est inhérent à l'être dont il est le principe; donc tout ce qui, dans une substance, dérive de son principe, doit se trouver dans ce principe : c'est ainsi que le principe de la chaleur ne peut pas n'être point chaud. Dira-t-on que le feu qui communique sa chaleur à d'autres corps n'est pas chaud ? « Mais le feu, dit Aristote, ne s'échauffe pas lui-même, puisque toutes ses molécules sont naturellement chaudes. » C'est ici que je l'attendais : car ce qu'il dit du feu s'applique à l'âme, chez laquelle le moteur et la substance mue sont si étroitement unis que tous deux sont confondus dans son mouvement. Mais en voilà assez sur le principe. Quant à la cause, comme nous avons accordé de plein gré qu'aucun être ne peut s'appliquer à lui-même les effets qu'il produit sur les autres êtres, nous conviendrons volontiers que l'âme, cause du mouvement de tout ce qui existe, ne peut être pour elle-même principe d'impulsion; et nous nous contenterons de dire qu'elle fait mouvoir tout ce qui, sans elle, serait immobile. Nous ajouterons qu'elle ne peut se donner à elle-même le mouvement, mais qu'elle le tient de son essence. Cela suffira pour paralyser la sixième objection d'Aristote. On pourrait peut-être lui accorder qu'il n'est pas de mouvement sans ressort, lorsque le moteur et le corps mis en mouvement sont deux êtres différents ; mais vouloir qu'il en soit ainsi relativement à l'âme, dont l'essence est le mouvement, c'est une bien mauvaise plaisanterie. Si le feu, que meut une cause interne, n'a pas besoin de ressort pour prendre une direction ascendante, à plus forte raison l'âme, essentiellement mobile, peut-elle s'en passer. Nous allons voir que, dans ses dernières objections, cet illustre philosophe, d'une gravité si remarquable dans ses autres écrits, a recours à des finesses peu dignes de lui. « Si l'âme se meut, dit-il, elle doit, indépendamment de ses autres mouvements, posséder celui de locomotion; elle doit, successivement et fréquemment, entrer au corps et en sortir : mais cela n'a pas lieu, donc elle ne se meut pas. Le premier venu lui répondra, sans hésiter, qu'il est des corps doués de mouvement qui cependant ne changent pas de place. On lui opposerait encore fort à propos l'un de ses arguments, en lui adressant la question suivante : Ne dites-vous pas que les arbres se meuvent? Il en conviendrait, je pense; et alors on le battrait avec ses propres armes. Si les arbres se meuvent, il est clair que, nonobstant leurs autres mouvements, ils doivent avoir, ainsi que vous le dites, la faculté de changer de place; cependant elle leur est refusée : donc les arbres ne se meuvent pas. A quoi l'on ajouterait, pour donner à ce syllogisme le ton de gravité convenable : Mais ils se meuvent : donc tout ce qui se meut ne change pas de place. Et de là résulterait cette conclusion judicieuse : S'il est démontré que les arbres se meuvent d'un mouvement qui leur est propre, pouvons-nous refuser à l'âme la propriété de se mouvoir d'un mouvement conforme à son essence? Cette réplique, et d'autres encore, ne manqueraient pas de force, lors même que le mouvement ne serait pas l'essence de l'âme. En effet, puisqu'elle anime le corps en s'unissant avec lui, et puisqu'elle l'abandonne à une époque préfixe, on ne peut lui refuser la faculté de locomobilité. Il est vrai que ce mouvement d'entrée et de sortie est souvent irrégulier, parce qu'il n'a lieu qu'en vertu des décrets mystérieux et raisonnés de la nature, qui, pour enchaîner la vie au sein de l'être animé, inspire à l'âme un tel amour pour le corps, qu'elle se plaît dans les liens qui la retiennent, et qu'elle ne voit presque toujours arriver qu'avec peine le moment de quitter sa station. Nous venons de répondre, je crois, d'une manière péremptoire à la septième objection; passons aux dernières questions qu'accumule Aristote, afin de nous embarrasser. « Si l'âme se meut, continue-t-il, ce mouvement appartient à un mode quelconque : si elle se meut sur place, elle ne peut se mouvoir qu'en ligne droite ou en ligne circulaire. Se meut-elle en s'engendrant elle-même, ou bien en s'épuisant insensiblement? S'accroît-elle ou diminue-t-elle? Qu'on nous dise s'il est pour elle quelque autre manière de se mouvoir. Mais tout cet amas indigeste de questions découle d'un seul et même argument captieux, dont Aristote a tiré de fausses conséquences. Il part du principe qu'il n'y a pas de mouvement spontané, et veut trouver dans l'âme ce que lui offrent toutes les autres substances, l'être mû et l'être moteur; comme s'il pouvait y avoir en elle une différence entre ce qui meut et ce qui est mû. Mais, me dira-t-on, si cette distinction n'existe pas, de quelle espèce est ce mouvement de l'âme, et comment le comprendre? Ma réponse à cette question est de renvoyer les curieux, soit à Platon, soit à Cicéron. Je dirai plus : c'est qu'elle est la source et le principe de tout mouvement, et l'on concevra sans peine la valeur de cette qualification de principe du mouvement attribuée à l'âme, si on la conçoit comme un être invisible se mouvant sans moteur, et dont l'impulsion sur lui-même et sur tous les autres êtres n'a ni commencement ni fin. De tous les objets sensibles, le seul qu'on puisse lui comparer est une source d'eau vive dont les fleuves et les lacs tirent leur origine, bien qu'elle-même semble n'en avoir aucune ; car si elle en avait une, elle ne serait pas source : et bien qu'il ne soit pas toujours aisé de la découvrir, elle n'en donne pas moins naissance, soit au Nil, soit à l'Éridan, soit à l'Ister, soit au Tanaïs. Lorsqu'en admirant la rapidité du cours de ces fleuves et la masse de leurs eaux, on se demande d'où elles sortent, la pensée remonte vers les lieux où elles ont pris naissance, et qui sont l'origine du mouvement que l'on a sous les yeux. De même, lorsqu'en observant le mouvement des corps, soit divins, soit terrestres, vous voulez remonter à son auteur, que votre entendement arrive jusqu'à l'âme, qui sait nous faire mouvoir sans le ministère du corps. C'est ce qu'attestent nos peines, nos plaisirs, nos craintes et nos espérances ; car son mouvement consiste dans la distinction du bien et du mal, dans l'amour de la vertu, dans un penchant violent pour le vice : et de là découlent toutes les passions. C'est elle qui fait mouvoir chez nous l'irascibilité, et cette ardeur que nous montrons à nous armer les uns contre les autres, d'où dérive insensiblement cette fureur inquiète des combats.. C'est elle encore qui nous inspire les ardents désirs et les affections véhémentes; mouvements salutaires quand la raison les gouverne, mais qui nous entraînent avec eux dans l'abîme, s'ils ne la prennent pas pour guide. Tels sont les mouvements de l'âme qu'elle exécute quelquefois sans le ministère du corps, et quelquefois aussi de concert avec lui. Si maintenant on veut connaître ceux de l'âme universelle, que l'on jette les yeux sur le mouvement rapide du ciel et sur la circulation impétueuse des sphères planétaires placées au-dessous de lui, sur le lever, sur le coucher du soleil, sur le cours et le retour des autres astres, mouvements qui sont tous produits par l'activité de l'âme du monde. S'il pouvait donc être permis à quelqu'un de regarder comme immobile celle qui met tout en mouvement, ce ne serait pas à un aussi puissant génie qu'Aristote, mais à celui qui ne se rend ni à la puissance de la nature, ni à l'évidence des raisonnements. Chap. XVII. Les conseils du premier Africain à son petit-fils ont eu également pour objet les vertus contemplatives et les vertus actives. Cicéron, dans le Songe de Scipion, n'a négligé aucune des trois parties de la philosophie. Après avoir appris et démontré à l'Émilien que l'âme se meut, son aïeul lui enjoint d'exercer la sienne, et lui en indique les moyens. Exercez la vôtre, Scipion, à des actions nobles et grandes, à celles surtout qui ont pour objet le salut de la patrie : ainsi occupée, son retour sera plus facile vers le lieu de son origine. Elle y réussira d'autant plus vite, si dès le temps présent, où elle est encore renfermée dans la prison du corps, elle en sort par la contemplation des êtres supérieurs au monde visible, et s'arrache à la matière. Quant à ceux qui se sont rendus esclaves des plaisirs du corps, et qui, à la voix des passions, fidèles ministres de la volupté, ont violé les lois sacrées de la religion et des sociétés, leurs âmes, une fois sorties du corps, roulent dans la matière grossière des régions terrestres, et ne reviennent ici qu'après une expiation de plusieurs siècles. » Nous avons dit plus haut qu'il y a des vertus contemplatives et des vertus politiques; que les premières conviennent aux philosophes, et les secondes aux chefs des nations ; et que, par les unes comme par les autres, on peut arriver au bonheur. Ces deux genres de vertus sont quelquefois le partage de deux sujets différents; quelquefois aussi elles se trouvent réunies dans un seul homme, assez favorisé par la nature et par l'éducation pour pouvoir les pratiquer tous deux. Tel citoyen peut être étranger aux sciences, et cependant réunir les talents d'un bon administrateur, la prudence, Ta justice, la force et la tempérance; et, bien qu'il ne joigne pas à la pratique des vertus actives celle des vertus contemplatives, il n'en sera pas moins admis au séjour de l'immortalité. Tel autre, né avec l'amour du repos et peu d'aptitude aux affaires, se sentira porté par son heureux naturel vers les choses d'en haut, et, négligeant les affaires temporelles pour s'occuper des spirituelles, dirigera les moyens que lui fournit la science vers l'étude de la Divinité : celui-là aussi se frayera une route au ciel par ses vertus spéculatives. Cependant il n'est pas rare de voir une même personne posséder à un haut degré l'art d'agir et celui de philosopher. Notre Romulus doit être placé parmi ceux dont les vertus furent seulement actives : sa vie ne fut qu'un continuel exercice de ces vertus. Nous mettrons dans la seconde classe Pythagore, qui, peu fait pour agir, se renferma dans l'étude et l'enseignement des choses divines et de la morale ; nous placerons dans la troisième, celle des vertus mixtes, Lycurgue et Solon chez les Grecs, Numa chez les Romains, ainsi que les deux Catons, et beaucoup d'autres fortement imbus des principes de la philosophie, et en même temps solides appuis de l'État ; car il n'en a pas été de Rome comme de la Grèce, qui a fourni un si grand nombre de sages contemplatifs. Notre Scipion, que son aïeul se charge d'endoctriner, réunissant les deux genres de vertus, doit, en conséquence, recevoir des avis sur les moyens de perfectionner l'un et l'autre genre; et, comme dans ce moment il porte les armes pour le service de son pays, les premières vertus qu'on lui inculque sont les vertus politiques. « Exercez surtout votre âme aux actions qui ont pour objet le salut de la patrie : ainsi occupée, son retour sera plus facile vers le lieu de son origine. » Viennent ensuite les principes philosophiques, parce que Scipion est également recommandable comme lettré et comme guerrier. « Elle y réussira d'autant plus vite, si dès le temps présent, où elle est encore renfermée dans sa prison du corps, elle en sort par la contemplation des êtres supérieurs au monde visible, et s'arrache à la matière. » Voilà l'espèce de mort que doit rechercher celui qui est imbu des leçons de la sagesse ; et c'est ainsi qu'il parvient à dédaigner, autant que le permet la nature, son enveloppe mortelle, qui lui semble un fardeau étranger. Une fois que le premier Africain a mis sous les yeux de son petit-fils les récompenses qui attendent l'homme de bien, il le trouve favorablement disposé à aspirer aux vertus du haut genre. Mais comme un code de lois qui oublierait de prescrire des châtiments pour les coupables serait imparfait, Cicéron termine son traité par l'exposition des peines infligées à ceux qui ne se sont pas bien conduits. C'est un sujet sur lequel s'est beaucoup plus étendu le personnage que met en avant Platon. Le révélateur Her assure que pendant des milliers d'années les âmes des coupables éprouveront les mêmes peines, et qu'après s'être purifiées pendant un long séjour dans le Tartare, il leur sera permis de retourner à la source de leur origine, c'est-à-dire au ciel. Il est en effet de toute nécessité que l'âme rejoigne les lieux qui l'ont vue naître. Mais celles qui habitent le corps comme un lieu de passage ne tardent pas à revoir leur patrie; tandis que celles qui le regardent comme leur véritable demeure, et s'abandonnent aux charmes qu'il leur offre, sont d'autant plus de temps à remonter aux cieux, qu'elles ont eu plus de peine à quitter la terre. Mais terminons cette dissertation sur le songe de Scipion par le morceau suivant, qui ne sera pas déplacé. La philosophie a trois parties, la morale, la physique et la métaphysique. La première a pour but d'épurer parfaitement nos mœurs; la seconde s'occupe de recherches sur les corps d'une nature supérieure, et la troisième a pour objet les êtres immatériels qui ne tombent que sous l'entendement. Cicéron les emploie toutes trois. Que sont, en effet, ces conseils d'aimer la vertu, la patrie, et de mépriser la gloire, sinon des préceptes de philosophie morale? Quand Scipion parle des sphères, de la grandeur, nouvelle pour l'Émilien, des astres qu'il a sous les yeux, du soleil, prince des flambeaux célestes, des cercles du ciel, des zones de la terre, et de la place qu'y occupe l'Océan; quand il découvre à son petit-fils le secret de l'harmonie de l'empyrée, n'est-ce pas là de la haute physique? Et lorsqu'il traite du mouvement et de l'immortalité de l'âme, qui n'a rien de matériel, et dont l'essence, qui n'est pas du domaine des sens, ne peut être comprise que par l'entendement, ne plane-t-il pas dans les hauteurs de la métaphysique? Convenons donc que rien n'est plus parfait que cet ouvrage, qui renferme tous les éléments de la philosophie. NOTES SUR LECOMMENTAIRE DU SONGE DE SCIPION.
CHAP. I. Nisi prius de animae immortalitate constaret. L'âme, chez les anciens philosophes, n'était pas un être abstrait, mais un être réel et matériel, de l'essence duquel il était de vivre et de penser. Ils la concevaient formée de la portion la plus subtile de la matière, ou du feu éther, auquel elle allait se réunir, après la mort du corps. Cette matière étant supposée éternelle, ainsi que nous le verrons bientôt, l'âme devait nécessairement être immortelle; et, en sa qualité de substance simple, émanée du feu principe, elle avait sa place dans la région ta plus élevée du monde, et n'en descendait que par la force d'attraction de la matière inerte et ténébreuse dont étaient formés la terre et les éléments. Forcée alors d'animer les corps des hommes et des animaux, elle ne pouvait remonter vers la sphère lumineuse qu'après la décomposition de la masse brute qu'elle avait organisée. On voit par là que les deux dogmes de la nature de Pâme et de son immortalité étaient essentiellement liés entre eux et avaient le même but, celui de conduire l'homme par la religion, en lui persuadant que la mort ne faisait que séparer la matière grossière de la substance éthérée qui le constituait animal intelligent et raisonnable, et qu'ainsi il ne mourait pas tout entier. (Vidend. Clem. Alex. Strom. lib. V; Plat, in Gorgia, in Phœd., in Re-pub. lib. X; Virg. in Enéide lib. VI, in Georg. lib. IV; Ocell. tucan.; Arisl. de Mundo.) II. Solum vero ei simillimum de visibilibus solem reperit. Platon admet deux demiourgos, l'un invisible à l'œil, incompréhensible à la raison; l'autre visible, qui est le soleil, architecte de notre monde, et qu'il appelle le fils du père, ou de la première cause. (Proclus, in Timaeo.) III. Omnium, quœ videre sibi dormientes videntur, quinque sunt principales diversitate, et nomine. « Somnium est ipse sopor; insomnium, quod videmus in somniis; somnus, ipse deus, » dit Servius, in Enéide lib. V. Ce chapitre de Macrobe est extrait, en grande partie, des deux premiers chapitres de l'Oneirocritica d'Artémidore, ouvrage futile quant au fond, mais qui ne masque pas d'intérêt pour les philologues. Enfants du Sommeil et de la Nuit, les Songes étaient adorés en Grèce et en Italie. Ils étaient honorés d'un culte particulier chez les habitants de Sicyone, qui leur avaient dédié une chapelle dans le temple du dieu de la santé. On sait que les oniroscopes de l'antiquité prévenaient leurs dupes que, pendant la saison de la chute des feuilles, tous les rêves étaient fantastiques, et qu'ainsi il était inutile de les consulter. Nous ignorons si les pythies modernes accordent un pareil sursis aux cerveaux faibles qui veulent connaître leur avenir. (Vidend. Cicer. de Divinat.; Philo, de Somniis.) V. Ac prima nobis tractanda pars illa de numeris. Tout, dans cet univers, a été lait, selon Pythagore, non par la vertu des nombres, mais suivant les proportions des nombres, il croyait, dit M. de Gérando, trouver dans les lois mathématiques, ou hypothétiques, les principes des lois physiques ou positives, et transportait, comme le lit depuis son imitateur Platon, dans le domaine de la réalité, les lois qui sont du domaine de la pensée. Dans la théorie des nombres mystiques, l'unité s'appelle monade. Elle est, sous ce nom, le premier anneau de la chaîne des êtres, et l'une des qualifications que les anciens philosophes ont données à la Divinité. Le symbole de la monade est le point mathématique. De cet être simple est émanée la dyade, représentée par le nombre 2, et aussi par la ligne géométrique. Emblème de la matière ou du principe passif, la dyade est encore l'image des contrastes, parce que la ligne, qui est son type, s'étend indifféremment vers la droite et vers la gauche. La triade, nombre mystérieux, figurée par 3 et par le triangle équilatéral, est l'emblème des attributs de la Divinité, et réunit les propriétés des deux premiers nombres. Pour de plus amples notions sur ces sublimes rêveries pythagoriciennes et platoniciennes, on peut consulter Mart. Capella, de Nuptiis Pholologiœ et Mercurii, ainsi que le trentième chapitre d'Anacharsis. VI. Hœc monas initiumfinisque omnium. Nous trouvons ici le germe et le modèle de la Trinité des chrétiens. Macrobe distingue d'abord, avec Platon son maître, l'ἀγαθὸς des Grecs, l'être par excellence, et la première cause. Vient ensuite le logos ou le verbe, intelligence du Dieu suprême, appelé mens en latin, et νόος en grec. Quant à l'âme universelle, le spiritus de Virgile, il la place plus près du monde auquel elle donne la vie, et il la regarde comme la source de nos âmes. On voit que ce troisième attribut, qui n'est autre que le principe d'action universelle, reconnu dans la nature, semble tenir de plus près à la matière, tandis que le logos tient plus immédiatement à la monade, qui est tout intellectuelle. Chalcidius, philosophe chrétien, savant platonicien du IVe siècle, et commentateur de Timée, nous dit que son maître concevait premièrement un dieu suprême et ineffable, cause de tous les êtres ; puis un second dieu, providence du père, qui a établi les lois de la vie éternelle et de la vie temporelle; enfin, un troisième dieu nommé seconde intelligence, et conservateur de ces mêmes lois. Ces principes métaphysiques, dit Eusèbe (Prépar. evang. lib. XI, cap. 18), sont bien antérieurs à Platon, et taisaient partie des dogmes des docteurs hébreux. Il aurait pu ajouter que les Juifs les tenaient des Égyptiens, qui probablement avaient trouvé cette trinité ou triade dans les livres attribués à Zoroastre. Du moins, le père Kircher, dans son Œdipe (tom. iii, p. 575), dit à la fin de son chapitre sur la théologie égyptienne : « Voilà les « plus anciens dogmes théologiques enseignés par Zoroastre, ensuite par Hermès. » Nam primo omnium hoc numero anima mundana generata est, sicut Timœus Platonis edocuit. Le système planétaire des anciens était formé de sept sphères mobiles, y compris le soleil. Ces sept sphères, dont la terre, regardée comme immobile, ne faisait point partie, étaient chargées de tempérer la rapidité des mouvements de la sphère des fixes, et de régir les corps terrestres. Le souffle de la vie qui leur était distribué était désigné par la flûte aux sept tuyaux, embouchée par le grand Pan, ou par le dieu universel, qui en lirait des sons auxquels elles répondaient. De là cette vénération pour le nombre 7, dans lequel se divise et se renferme la nature de ce souffle, d'après les principes de la théologie des païens et de celle des chrétiens. « Comme le souille de Pan, celui « du Saint-Esprit est divisé en sept souffles. » (Saint-Justin, Cohort. ad Gentil, p. 31.) Dans ce chapitre de Macrobe, nous voyons l'âme universelle formée de la monade ou de l'unité. De cette unité, point mathématique, découlent de droite et de gauche 2 et 3, premiers nombres linéaires, l'un pair et l'autre impair ; plus, 4 et 9, premiers plans, tous deux cariés, l'un pair et l'autre impair; enfin, 8 et 27, tous deux solides ou cubes, l'un pair et l'autre impair, ce dernier étant la somme de tous les autres. Le nombre septénaire, à cause de son rapport aux sept planètes, a occupé le premier rang parmi les nombres sacrés chez tous les peuples de l'ancien monde. Il y avait sept castes chez les Indiens et chez les Égyptiens; le Nil avait sept embouchures, le lac Mœris sept canaux ; et les Perses avaient leurs sept grands génies ou archanges, formant le cortège d'Ormuzd, leurs sept pyrées; et Ecbatane avait ses sept enceintes, etc. A l'imitation de leurs anciens maîtres, les Juifs divisaient Jérusalem en sept quartiers ; leur tabernacle ne fut fini qu'au bout de sept mois, et la construction de leur temple dura sept ans; leur création fut terminée, selon Moise, en sept jours; leur chandelier a sept branches, etc. Enfin, ce nombre, qui se reproduit si souvent dans le système religieux des chrétiens, est répété vingt-quatre fois dans l'Apocalypse. VIII. Quatuor esse virtutum genera, politicas, purgatorias. Macrobe met, avec raison, au premier rang, les vertus politiques, ou celles de l'homme social. Ce sont les seules dont parle Cicéron dans le Songe de Scipion. Les vertus épuratoires ou philosophiques sont moins méritantes, parce qu'elles séparent l'homme de la vie active delà société; mais les deux autres genres, tels que les décrit Plotin, appartiennent proprement à la mysticité, et ne sont bons qu'à surcharger les sociétés humaines de membres inutiles, tels que les anachorètes de la Thébaïde, et ces nombreux couvents de moines qui, depuis quatorze cents ans, sont les vers rongeurs des États catholiques romains. XX. Et hac longitudine ad ipsum circulum, per quem sol currit, erecta. Macrobe nous dit ici que la longueur de cette colonne est de 4.800.000 stades, ou de 20.000 lieues; et Pline l'Ancien, liv. II, chap. 10, pense que cette colonne ne s'étend que jusqu'à la lune, éloignée de la terre, suivant Eratosthène, de 780.000 stades, ou de 32.500 lieues; d'où il suivrait que les deux distances de la terre à la lune et au soleil seraient entre elles comme 1 : 6 2|3, au lieu d'être comme 1 : 395 1|3, d'après les observations les plus récentes. Les anciens, si peu instruits de la distance réciproque des planètes, ne l'étaient pas davantage sur la grosseur de ces corps errants, puisque le même Macrobe termine ce chapitre en nous démontrant que le soleil est huit fois plus grand que la terre ; erreur un peu moins grossière que celle de ce philosophe grec qui croyait l'astre du jour un peu plus grand que le Péloponnèse. XXI. Horam fuisse mundi natcentis, Cancro gestante tunc lunam. Ce thème généthliaque s'accorde parfaitement avec le sentiment de Porphyre (de Antro Nympharum), qui fait commencer l’année égyptienne à la néoménie du Cancer, et conséquemment au lever de Silius, qui monte toujours avec ce signe. C'est parce que le lever de la canicule excite l'intumescence des eaux du Nil, que les prêtres du pays faisaient présider le Cancer à l'heure natale du monde. Cette position du zodiaque ne peut, en effet, convenir qu'à l'Egypte, qui suit, pour ses opérations agricoles, un ordre presque inverse de relui observé dans les autres climats : d'où l'on peut conclure que les anciens écrivains ont fait, avec raison, honneur à ici le confiée de l'invention des sciences astronomiques. XXII Nam ea, quœ est media et nona tellus. Cicéron a mieux aimé suivre le sentiment de Platon, d'Aristote et d'Archimède, que celui de la secte italique fondée par Pythagore, ou celui de la secte ionique fondée par Thalès, qui, probablement, avait apporté d'Egypte le mouvement de la terre, 600 ans avant l'ère vulgaire. Parmi les philosophes qui pensaient comme Thaïes et Pythagore, on cite Philolaüs, Nicétas de Syracuse, Aristarque de Samos, Anaximandre, Seleucus, Héraclide de Pont, et Ecphantus. Ces deux derniers n'attribuaient cependant à la terre que le mouvement sur son axe, ou diurne. En général, les pythagoriciens soutenaient que chaque étoile est un monde, ayant, comme le nôtre, une atmosphère et une étendue immense de matière éthérée. C'est d'après des autorités aussi positives que Copernic a donné son système. (Vidend. Arist. de Cœlo; Senec. Quœst. natur. lib. VII; Fréret, Académie des Inscript, tom. XVIII, p. 108. Lib. II. CHAP. I. Quis hic, inquam, quis est, qui complet aures meas tantus et tam dulcis sonus. On dit que Pythagore, après avoir (ait un premier essai des consonances musicales sur des marteaux, en fit un second sur une corde sonore tendue avec des poids. Pressée dans sa moitié précise, elle lui donna le diapason ou l'octave; dans son fiers elle rendit le diapentès ou la quinte; dans son quart, le diatessaron ou la quarte; dans son huitième elle donna le ton, et dans son dix-huitième le l'2 ton. Le ton, dans le rapport de 9 à 8, et le 112 ton, dans celui de 256 à 243, servaient à remplir les intervalles du diapason, du diapentès et du diatessaron; car l'harmonie des anciens se composa d'abord de ces trois consonances, auxquelles on ajouta plus tard le diapason et le diapentès, puis le double diapason. Cette découverte, dit l'abbé Batteux dans ses notes sur Timée de Locres, fit un si grand éclat dans le monde savant, qu'on voulut l'appliquer à tout, et particulièrement au système de l'univers. En conséquence, on plaça, sur chacun des orbes mobiles, une sirène ou une muse chargée de surveiller l'exécution d'une suite de sons qui, représentée par lès syllabes dont nous nous servons pou solfier, donnerait : la Lune, si, ut, ré, etc. Vénus, ut, ré, mi, etc. Mercure, ré, mi, fa, etc. le Soleil, mi, fa, sol, etc. Mars. fa, sol, la, etc. Jupiter, sol, la, si, etc. Saturne, la, si, ut, etc. De la terre à la lune 1 ton ; de la lune à Vénus 1|2 ton ; de Vénus à Mercure 1|2 ton; de Mercure au soleil 1 ton 1|2 ; du soleil à Mars 1 ton ; de Mars à Jupiter 1|2 ton ; de Jupiter à Saturne 1|2 ton; de Saturne au ciel des fixes 1|2 ton. En tout 6 tons. Quelques écrivains, du nombre desquels est Pline (lib. II, cap. 23), assurent que de la terre au ciel on comptait 7 tons, ou de Saturne à l’empyrée 1 ton 1|2; car Vénus et Mercure avaient la même portée. (Voyez Anachars. cap. 27, 31; Mém. de l'Académ. des inscript., Mus. des anc.; Arist. Probl. 19 et 39; Plutarq. De Musica; Censorinus, de Die natali, cap. 10 et 13; Martian. Capella, Boèce, Ptolémée.) III. Quia primi forte gentes. C'est un fait démontré par mille expériences, que la plus mauvaise musique produit sur les peuples barbares des sensations plus fortes, sans comparaison, que n'en peut exciter la plus douce mélodie chez les nations civilisées. Forster assure, dans son Voyage autour du Monde, que Cook avait à son bord un joueur de cornemuse qui fit de grands miracles dans la mer du Sud, où il jeta quelques insulaires dans d'incroyables extases. On a vu aussi, vers le milieu du siècle dernier, un missionnaire qui, se déliant de sa théologie, se munit d’une guitare, et attira à lui, comme par enchantement, des troupes entières de sauvages dans l'Amérique méridionale, où il parvint à fixer, dans quelques cabanes, des hommes qui avaient voyagé, depuis le berceau, au sein des forêts, et erré constamment de solitude en solitude. V. Spatium.... facite inhabitabile victuris. Cette division du ciel et de la terre en cinq zones ou ceintures, dont celle du centre, ainsi que les deux qui avoisinent les pôles, passaient pour inhabitables, n'était pas une invention du vulgaire ignorant, mais bien un système adopté par les plus célèbres philosophes, les plus grands historiens et les plus habiles géographes de la Grèce et de Rome. Suivant cette théorie, les fertiles et populeuses régions situées sous la zone torride, qui fournissent à leurs habitants non seulement le nécessaire, mais toutes les commodités de la vie, qui, de plus, font passer leur superflu dans toutes les autres contrées de la terre, étaient regardées comme le séjour de la stérilité et de la désolation : et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que cette erreur subsista même après les conquêtes d'Alexandre r et après des entreprises commerciales faites dans plusieurs parties de l'Inde, situées entre les tropiques. Cette imperfection des connaissances géographiques est d'autant plus inconcevable, que quatre grands empires ont successivement gouverné l'ancien monde.
|