![]()
CELSE
LIVRE ΙII
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
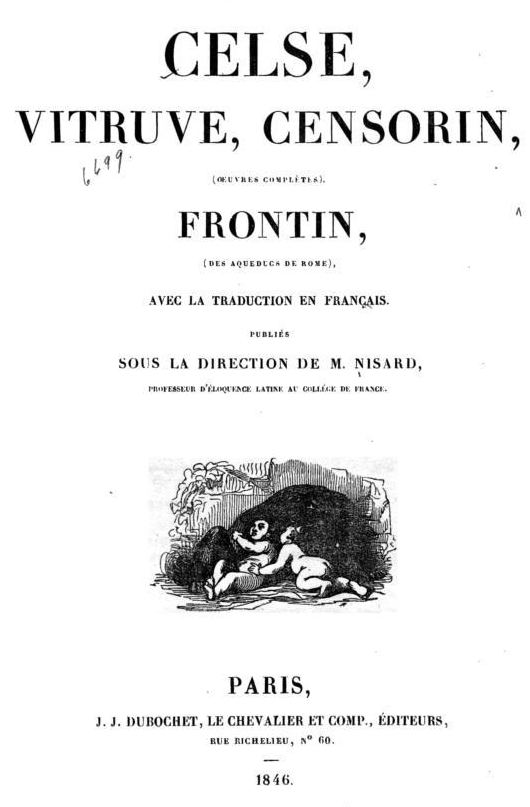
CELSE.
TRAITÉ DE LA MÉDECINE.LIVRE III.
Chap. I. Des différentes espèces de maladies. II. Il est facile de savoir dès le début si la maladie est aiguë ou chronique; et cela n’est pas vrai seulement pour les affections dont la forme est constante mais pour celles aussi dont le caractère est variable. — Comment on reconnaît si le mal est à la période d’augment, d’état ou de déclin. — Moyens diététiques destinés à combattre les premiers symptômes d’une maladie. III. Des différentes espèces de fièvres. IV. Traitement des fièvres; multiplicité des méthodes curatives. V. Considérations relatives aux fièvres en particulier; et d’abord du temps où il convient de donner à manger aux fébricitants. VI. De la soif qui accompagne la fièvre. —Quand doit-on faire boire les malades. — Le pouls, auquel nous accordons tant de créance, est souvent la cause des plus grandes erreurs, car il présente des variations nombreuse, en raison de l’âge, des sexes et des tempéraments. — Une seconde indication à laquelle noua ajoutons foi et qui nous trompe également, c’est la chaleur; car elle peut s’élever par l’effet de la température, du travail, du sommeil, de la peur et des anxiétés morales. — Moyens de constater l’état fébrile. VII. Du traitement des fièvres pestilentielles. VIII. Du traitement de la fièvre que les médecins appellent hémitritée. IX. Du traitement des fièvres lentes. X. Il faut examiner ai la fièvre existe seule, ou si elle est accompagnée d’autres signes fâcheux, c’est-à-dire de douleur de tête, de sècheresse de la langue et de gonflement des hypocondres. — Des remèdes propres à combattre ces différents symptômes. XI. Remèdes contre le frisson qui précède la fièvre. XII. Remèdes contre le tremblement dans les fièvres. XIII. Traitement de la fièvre quotidienne. XIV. Traitement de la fièvre tierce. XV. Traitement de la fièvre quarte. XVI. Traitement de la fièvre double-quarte. XVII. Traitement de la fièvre qui de quarte est devenue quotidienne. XVIII. Des trois espèces de délire; et d’abord du traitement de celui que les Grecs appellent frénésie. XIX. De la maladie cardiaque. XX. De la léthargie. XXI. De l’hydropisie. — On en reconnaît trois espèces: la première a reçu des Grecs le nom de tympanite, la seconde celui de leucophlegmatie ou hyposarque, et la troisième celui d’ascite. — Traitement de chaque espèce. XXII. De la consomption. — On distingue aussi trois sortes de consomption: on les nomme en grec, atrophie, cachexie, phtisie. —Traitement. XXIII De l’épilepsie. XXIV. De la jaunisse. XXV. De l’éléphantiasis. XXVI. De L’apoplexie. XXVII. De la paralysie.
I. Après avoir passé en revue ce qui concerne les maladies en général, j'arrive au traitement de chacune d'elles en particulier. Les Grecs ont divisé les maladies en deux classes, qu'ils ont appelées aiguës et chroniques; mais les mêmes affections, n'offrant pas toujours une terminaison semblable, ont été considérées comme aiguës par les uns, et mises par les autres au nombre des affections chroniques. Il suit de là qu'il y a nécessité d'établir encore de nouvelles divisions. En effet, on voit des maladies affecter une marche aiguë et rapide ; en peu de temps elles enlèvent le malade ou se dissipent d'elles-mêmes ; d'autres traînent en longueur, et sont également éloignées d'une solution favorable ou funeste; dans une troisième classe on trouve celles dont le caractère est tantôt aigu et tantôt chronique; les fièvres où cela s'observe si fréquemment ne sont pas le seul exemple de ces variations, et d'autres maladies en fournissent la preuve. Enfin il reste une quatrième distinction à faire relativement aux affections qu'on ne peut désigner sous le nom d'aiguës parce qu'elles ne sont pas mortelles, et qu'on ne saurait appeler chroniques, attendu qu'il est facile de les guérir en les combattant dès le principe. J'indiquerai successivement leur place en traitant spécialement de chaque affection ; mais je diviserai d'abord les maladies en celles qui paraissent résider dans la constitution tout entière, et en celles qui n'intéressent que certaines parties du corps. Je commencerai par les premières, après un court préambule sur les généralités du sujet. Il n'est point de maladies où le hasard ne puisse réclamer une part égale à celle de la science, puisque la médecine est impuissante quand la nature se refuse à seconder ses efforts. Toutefois le médecin est plus excusable d'échouer contre une affection aiguë que contre une maladie chronique. Dans le premier cas, en effet, on a peu le temps d'agir, et si pendant ce court intervalle les accidents ne cèdent pas à l'emploi des remèdes, te malade succombe : dans le second cas, au contraire, on a pour réfléchir et changer la médication la latitude convenable ; et quand le médecin est arrivé de bonne heure auprès d'un malade docile, la mort ne peut guère survenir sans qu'il y ait de sa faute. Néanmoins lorsqu'une affection chronique a déjà jeté de profondes racines, elle devient aussi difficile à traiter qu'une affection aiguë. Plus les maladies aiguës sont éloignées de leur début et plus les maladies chroniques sont récentes, plus il est facile de les guérir. Il ne faut pas non plus ignorer que les mêmes remèdes ne conviennent pas à tous les malades ; car de là vient que les praticiens les plus célèbres nous ont vanté comme uniques les médicaments les plus différents, selon les résultats que chacun d'eux en avait retirés. Lors donc qu'un moyen ne réussit pas, l'intérêt du malade doit passer avant l'autorité du médecin qui propose le remède, et il ne faut pas craindre d'en essayer d'autres, en observant toutefois de changer promptement dans les maladies aiguës ceux dont on n'a rien obtenu; tandis que dans les maladies qui marchent lentement et se résolvent de même, il convient de ne pas condamner sur-le-champ les médicaments dont l'action n'est pas immédiate ; et l'on doit encore moins les repousser, pour peu qu'ils aient amené de soulagement, parce qu'avec le temps ils produiront tout leur effet. II. Il est facile, au reste, de savoir dès le commencement si la maladie est aiguë ou chronique; et cela n'est pas vrai seulement pour les affections dont la forme est constante, mais pour celles aussi dont le caractère est variable. Une fièvre continue par exemple, accompagnée de violentes douleurs, sera l'expression d'un état aigu ; mais si les douleurs et la fièvre sont modérées, s'il existe entre les accès un temps bien marqué, et que de plus on rencontre les signes exposés dans le livre précédent, il est alors évident que la maladie sera de longue durée. On doit encore examiner si le mal est à la période d'augment, d'état ou de déclin, parce que certains remèdes conviennent quand la maladie s'accroît, d'autres en plus grand nombre quand elle décline, et que pour employer les moyens applicables à la première période des affections aiguës, il est préférable d'attendre la rémission. Une maladie prend de l'accroissement quand les douleurs deviennent plus vives, que les accès sont plus violents, et mêlés entre eux de telle façon qu'on en voit se déclarer avant et ne se terminer qu'après l'accès attendu. Dans l'état chronique où les signes que nous indiquons font défaut, on peut juger de même que l'affection s'aggrave, si le sommeil est interrompu, si les digestions sont moins bonnes, les déjections plus fétides, les sens plus lourds et l'esprit plus paresseux ; si l'on ressent une impression générale de froid ou de chaleur, et si la peau se décolore. Les signes contraires à ceux-ci témoignent que la maladie touche à sa fin. Il faut en outre nourrir plus tardivement le malade dans un état aigu, et différer jusqu'au déclin, afin de briser la violence du mal en lui enlevant d'abord des matériaux nuisibles; s'il s'agit au contraire d'une maladie chronique, on arrivera plus vite à l'alimentation, pour donner au sujet des forces proportionnées à la durée de son affection. En supposant qu'au lieu d'être générale, la maladie n'intéresse qu'une partie du corps, il serait toujours mieux d'agir sur la constitution entière, puisque par ce moyen on obtiendrait de même la guérison de l'affection locale.[1] Il est aussi très important de savoir si le malade a été bien ou mal traité dès le principe, parce que les remèdes seront moins efficaces s'ils ont échoué déjà contre lui. Si pourtant une mauvaise médication ne lui a pas enlevé ses forces, il est facile encore de le rétablir, en le soumettant à un traitement convenable. Puisque j'ai d'abord exposé les signes précurseurs de la maladie, je dois commencer aussi par indiquer les moyens curatifs qui répondent à ces prodromes. Si donc quelques-uns des accidents énoncés plus haut viennent à se manifester, il n'y a pas de meilleurs remèdes que le repos, la diète, et l'eau pure pour boisson, dans le cas où l'on devrait accorder à boire. Il suffit quelquefois d'observer ces précautions un jour seulement, ou deux jours au plus, si la persistance des symptômes donne quelque inquiétude. Après la diète il faut prescrire une alimentation restreinte, et toujours de l'eau pour boisson. Le lendemain on peut boire du vin, et l'on prend ensuite alternativement un jour de l'eau et du vin le jour suivant, jusqu'à ce que tout sujet de crainte ait disparu. En se gouvernant ainsi, on fait souvent avorter une maladie grave. L'erreur du plus grand nombre est de croire qu'ils pourront dès le premier jour dissiper leur malaise, soit par l'exercice ou le bain, soit en ayant recours aux purgatifs ou aux vomitifs, en provoquant des sueurs ou en faisant usage du vin. Non que ces moyens ne puissent parfois amener des résultats favorables, mais ils sont le plus souvent infidèles;[2] au lieu que l'abstinence est toujours utile sans être jamais dangereuse, puisqu'on reste le maître de la proportionner à la gravité du mal. Si les symptômes sont légers, on se contentera d'interdire le vin, ce qui vaut mieux que de restreindre les aliments. S'ils deviennent un peu plus graves, il est facile non seulement de se réduire à l'eau, mais de supprimer la viande. Quelquefois aussi on devra manger moins de pain qu'à l'ordinaire et se borner à une nourriture humectante, composée presque exclusivement de plantes potagères. Enfin si les accidents apparaissent plus menaçants, il suffit encore de renoncer à l'usage du vin, de s'imposer une diète rigoureuse, et d'observer en même temps un repos absolu. Il n'est pas douteux que, si l'on a recouru de bonne heure à ces précautions, sans vouloir dissimuler son état, on rend pour ainsi dire impossible toute maladie sérieuse. III. Ce sont là les règles à suivre par les personnes en santé quand elles n'ont à redouter que l'imminence d'une maladie. Il sera question maintenant du traitement des fièvres qui constituent des affections générales et sont extrêmement communes. On les distingue en fièvres quotidiennes, tierces et quartes; quelques-unes même reviennent à de plus longs intervalles, mais celles-ci sont rares, et se confondent avec les types précédents par leur nature et le traitement qu'elles comportent. Les fièvres quartes sont les plus simples : presque toujours elles débutent par un frisson auquel la chaleur succède ; puis l'accès étant terminé, la fièvre disparaît pendant deux jours et revient le quatrième. Il y a deux espèces de fièvres tierces : l'une est semblable aux fièvres quartes pour le début et la terminaison, avec cette seule différence que l'intervalle qui sépare les accès est d'un jour seulement, et qu'ils reparaissent le troisième ; l'autre, beaucoup plus pernicieuse, revient également le troisième jour, mais, sur quarante-huit heures, trente-six environ sont données à l'accès, quelquefois plus, d'autres fois moins ; il n'y a pas même d'intermission complète, mais seulement une légère rémission. Les médecins, pour la plupart, ont donné le nom d'hémitritée à cette dernière espèce. Les fièvres quotidiennes sont variées et nombreuses : il en est qui commencent de suite par la chaleur, d'autres par le froid, d'autres par le frisson (par froid j'entends le refroidissement des extrémités, et il y a frisson lorsque tout le corps est pris de tremblement) ; on voit de ces fièvres dont les accès se terminent franchement, de manière qu'il y a apyrexie complète : dans certains cas l'état fébrile, bien qu'ayant perdu sa violence, a laissé des traces qui persistent jusqu'au retour du prochain accès; souvent enfin le type quotidien présente à peine quelque rémission, et revêt presque la forme continue. Ces fièvres sont tantôt accompagnées d'une chaleur intense, et tantôt d'une chaleur supportable; les accès reviennent chaque jour les mêmes, ou bien ils sont inégaux ; de sorte qu'un jour ils seront moins forts, et plus prononcés le jour suivant; les uns arriveront le lendemain à la même heure, les autres viendront plus tôt, ou plus tard. Tel accès durera un jour et une nuit, tel antre sera plus court ou plus long ; quelques-uns se termineront par la sueur et d'autres sans cela. Tantôt ces sueurs indiquent le retour à la santé, et tantôt elles ne font qu'ajouter à la faiblesse du malade. Quelquefois encore on n'a qu'un accès par jour, et d'autres fois deux, ou plus encore; d'où il suit que dans le même jour il y a souvent plusieurs redoublements suivis de rémission, et que chacun d'eux répond à celui qui précède, il arrive aussi que les accès sont tellement confondus qu'on ne peut déterminer ni le moment de leur invasion, ni l'intervalle qui les sépare. Il n'est pas vrai, comme on l'a prétendu, qu'il n'y ait de fièvres irrégulières que celles qui dépendent d'une vomique, d'une inflammation ou d'une plaie; s'il en était ainsi, le traitement en serait plus facile : mais les effets attribués aux causes évidentes peuvent également reconnaître des causes cachées, et ce n'est pas raisonner, mais disputer sur les mots, que de prétendre, lorsque la fièvre affecte dans le cours d'une maladie des formes variables, qu'il n'y a point la fièvre irrégulière, mais plusieurs fièvres nouvelles. Et d'ailleurs quand cette opinion serait démontrée, elle ne changerait rien au traitement. Dans certains cas, le temps de la rémission est très étendu, et dans d'autres il est à peu près nul. IV. Telle est la marche générale des fièvres. Quant aux méthodes curatives, on en peut compter autant qu'il y a d'écrivains sur la matière. D'après Asclépiade, l'office du médecin consiste à guérir sûrement, promptement et agréablement. Gela est à désirer sans doute; mais d'ordinaire, par trop de précipitation et d'envie de plaire au malade, on l'expose à des dangers. Dans le cours du traitement on recherchera quels sont les ménagements à prendre pour satisfaire autant que possible à ces obligations, sans cesser toutefois de mettre en première ligne la guérison du mal. Ce qu'il y a de plus important d'abord, c'est de fixer le régime qu'on doit dès les premiers jours imposer au malade. Les anciens favorisaient la coction à l'aide de certains médicaments, parce qu'ils redoutaient par-dessus tout la crudité ; ensuite, par un usage plus fréquent des lavements, ils expulsaient la matière qu'ils jugeaient nuisible. Asclépiade supprima les médicaments ; mais pour les lavements, sans les employer aussi souvent, il les prescrivait néanmoins dans la plupart des maladies. Selon lui, le meilleur remède contre la fièvre était la fièvre même; aussi pensait-il que pour abattre les forces du malade, il fallait l'exposer à la lumière, le fatiguer par l'insomnie, et lui faire endurer la soif à ce point que les premiers jours il ne permettait pas même qu'on se rinçât la bouche. Cela prouve d'autant mieux l'erreur de ceux qui s'imaginent que sa méthode est agréable en toutes choses : si plus tard il cédait aux malades jusqu'à les livrer à leur intempérance, il n'est pas moins vrai qu'au début il se conduisait en bourreau. Je reconnais, quant à moi, que les potions médicamenteuses et les lavements ne doivent être administrés que rarement ; mais il ne suit pas de là qu'il faille affaiblir le malade, puisqu'on a tout à craindre de sa faiblesse. Il suffit donc de diminuer la matière qui se trouve en excès, et qui se dissipe tout naturellement dès qu'on ne cherche pas à la renouveler. Ainsi, les premiers jours on prescrira la diète ; on laissera le malade, s'il n'est pas trop faible, jouir de la lumière du jour, qui sert aussi à résoudre les humeurs, et l'on aura soin de le faire coucher dans la chambre la plus vaste. Relativement au sommeil, on le tiendra éveillé dans le jour, pour qu'il repose le plus possible pendant la nuit; et quant à la soif, on ne devra ni lui donner à boire avec exagération, ni lui faire subir de privation cruelle. On peut lui permettre encore de se rincer la Couche s'il l'a sèche et mauvaise, lors même que ce ne serait pas le moment indiqué pour les boissons; et, comme le dit fort bien Érasistrate, la bouche et l'arrière-gorge ont souvent besoin d'être humectées, sans que cela soit nécessaire pour les parties intérieures ; or, il n'y a dans ce cas aucune utilité à faire souffrir le malade. Telle est donc la conduite à tenir en commençant. La nourriture donnée à propos est le meilleur remède; mais la question est de savoir à quelle époque on en doit accorder. A cet égard les anciens procédaient généralement avec lenteur, et attendaient au cinquième et sixième jour; peut-être en effet le climat de l'Asie et de l'Égypte permet-il d'agir ainsi. Asclépiade, après avoir épuisé le malade de toutes les façons les trois premiers jours, lui donnait des aliments le quatrième. Dans ces derniers temps, Thémison, prenant en considération non le moment où commence la fièvre, mais celui où elle cesse ou du moins se ralentit, attendait trois jours à partir de ce moment, puis nourrissait immédiatement le malade, si la fièvre n'avait point reparu; lorsqu'elle se montrait de nouveau, il différait jusqu'à la fin de l'accès, ou jusqu'au temps de la rémission, si la fièvre était continue. Mais ces divers préceptes n'ont rien d'immuable, car on peut prescrire des aliments le premier, le second, le troisième jour, et d'autres fois seulement le quatrième ou le cinquième ; on peut en donner après un seul accès, de même qu'après deux ou plusieurs. Tout cela dépend de la maladie, de la constitution, du climat, de l'âge, et de l'époque de l'année. Au milieu de circonstances si différentes entre elles, il n'est guère possible d'assigner invariablement un temps bien précis. La maladie qui enlève le plus de forces au malade exige une réparation plus prompte; il en est de même des climats où la déperdition est plus grande, et c'est pour cela qu'en Afrique on se trouverait mal, à ce qu'il paraît, de mettre un malade tout un jour à la diète; l'enfant veut être nourri plus promptement que le jeune homme, et l'abstinence doit être moins longue en été qu'en hiver. Il n'y a pour le médecin qu'une seule règle, qu'il doit observer partout et toujours: c'est d'examiner attentivement l'état des forces, afin de les combattre par la diète quand elles sont exagérées, ou de venir à leur aide par l'alimentation dès qu'il commence à en redouter l'insuffisance. Son rôle, en effet, consiste à ne pas surcharger le malade de matériaux nuisibles, et à éviter aussi de le jeter dans l'épuisement par un jeûne trop sévère. Je trouve encore cette opinion dans Érasistrate; et quoiqu'il n'indique pas avec exactitude le moment où l'inanition se fait sentir à l'estomac ou au corps, cependant, en appelant l'attention sur ce point, et en prescrivant de nourrir quand le corps réclame des aliments, il montre assez qu'il n'y a pas lieu d'en donner tant que les forces sont en excès, mais qu'il faut savoir prévenir la défaillance. L'on peut comprendre d'après cela que le même médecin ne saurait soigner à la foison grand nombre de personnes, et que le meilleur praticien est celui qui ne perd pas de vue son malade. Mais ceux qui n'exercent que par intérêt, trouvant plus de profit à faire la médecine du peuple, embrassent volontiers des préceptes qui n'exigent pas d'assiduité comme le cas actuel. Il est facile, en effet, sans suivre exactement son malade, de compter les jours et les accès; mais il faut être là quand on s'occupe de la seule chose essentielle, c'est-à-dire de fixer l'instant où le malade va devenir trop faible, s'il ne prend pas de nourriture. Dans la plupart des cas cependant, c'est le quatrième jour qui est le plus convenable pour commencer l'alimentation. Mais au sujet des jours il règne encore une autre incertitude. Les anciens se réglaient surtout sur les jours impairs, et les nommaient critiques, comme s'ils jugeaient la maladie. Ces jours étaient le troisième, le cinquième, le septième, le neuvième, le quatorzième, et le vingt-unième. Au septième jour était attribuée la plus grande puissance; puis venaient le quatorzième et le vingt-unième. En conséquence, ils laissaient passer les accès des jours impairs et donnaient ensuite de la nourriture, persuadés que les accès suivants devaient être moins graves. C'est au point qu'Hippocrate craignait en général une rechute lorsque la fièvre ne cessait pas un jour critique. Asclépiade eut raison de répudier ces idées corn me dépourvues de fondement, et de soutenir que les jours n'offrent ni plus ni moins de dangers pour être pairs ou impairs. Quelquefois, en effet, les jours pairs sont les plus fâcheux; et c'est à la fin des accès qu'ils présentent qu'on doit de préférence faire manger le malade. Dans le cours de la fièvre, il arrive encore que l'ordre des jours est interverti, et que le plus grave est celui qui d'ordinaire était le moins violent. Bien plus, le quatorzième, qui, aux yeux des anciens, était doué d'une grande vertu, est précisément un jour pair. D'après eux, le huitième jour ressemblait au premier et commençait le second septénaire : eh bien ! ils se contredisaient en cela, puisque c'étaient non le huitième, le dixième et le douzième jour auxquels ils attachaient de l'importance, mais le neuvième et le onzième ; et, procédant ainsi sans aucune apparence déraison, ils n'allaient pas du onzième au treizième, mais au quatorzième. Hippocrate a dit aussi que le quatrième jour était le plus pénible pour un malade qui devait être guéri le septième. La fièvre selon cet auteur peut donc devenir plus intense un jour pair, et ce jour néanmoins servir de base à un pronostic assuré. Dans un autre endroit il signale comme ayant cette double signification chaque quatrième jour, par exemple le quatrième, le septième, le onzième, le quatorzième, et le dix-septième; de sorte qu'il passe du nombre impair au pair : et il n'est pas même fidèle à sa proposition, puisqu'à partir du septième il faut cinq jours et non quatre pour arriver au onzième. Tant il est vrai, quelle que soit la manière dont on envisage les nombres, qu'on ne peut rien trouver de raisonnable à ce sujet, dans Hippocrate du moins. Les anciens se laissèrent égarer sur ce point par les nombres pythagoriciens, qui jouissaient alors d'une grande célébrité. Or, le médecin n'a que faire de compter les jours, mais il doit observer les accès pour être en mesure d'indiquer le moment où il convient de prescrire des aliments. Il importe bien plus de savoir si l'on doit nourrir le malade quand la fièvre a cessé, ou avant sa disparition complète. Les anciens n'accordaient de nourriture qu'aux malades entièrement exempts de fièvre ; Asclépiade en donnait malgré la persistance de l'état fébrile, pourvu seulement qu'il fût moins intense. Mais en cela sa méthode est mauvaise : non qu'il ne faille parfois songer de bonne heure à l'alimentation, si l'on craint un redoublement prochain, mais parce qu'en général il vaut mieux attendre que le malade soit sans fièvre; en effet, pris dans le temps de l'apyrexie, les aliments sont moins sujets à se corrompre. Néanmoins, il n'est pas vrai, comme Thémison le pensait, que, s'il y a deux heures d'intermittence, on puisse en tirer parti pour faire manger le malade, de telle sorte que la digestion s'accomplisse dans cet espace de temps. Rien de mieux sans doute si elle pouvait s'effectuer aussi promptement; mais, l'intervalle étant trop court, il vaut mieux que le travail digestif commence au déclin de la fièvre, que de s'achever au début de l'accès suivant. Si donc l'apyrexie se prolonge davantage, c'est le moment qu'il faut choisir ; si le temps est trop limité, on devra donner des aliments avant que le malade soit entièrement délivré de la fièvre. Ce que l'on dit ici de l'intermittence s'entend également de la rémission, qui peut être très marquée dans une fièvre continue. On demande ensuite si pour alimenter on doit attendre autant d'heures que l'accès en a pris, ou si, cela n'étant pas toujours possible, il suffit d'en laisser passer une partie. Le plus sûr est de mettre un intervalle égal à la durée de l'accès; mais si la fièvre s'est prolongée beaucoup, on peut se montrer moins rigoureux, pourvu cependant qu'on attende au moins la moitié du temps. On observera ce précepte, non seulement dans la fièvre dont il est question, mais dans toutes les autres. V. Ces considérations sont applicables à toutes les fièvres en général : je vais parler maintenant de ce qui les concerne en particulier. Lorsqu'il n'y a eu qu'un seul accès, provoqué soit par une tumeur à l'aine, soit par la fatigue, la chaleur ou quelque circonstance semblable, et sans qu'on ait à redouter l'influence d'une cause interne, on peut le lendemain donner des aliments, l'heure de l'accès une fois passée, et la fièvre n'ayant point reparu. Mais si l'on ressent une chaleur profonde, accompagnée de pesanteur à la tête ou aux hypocondres, et qu'on n'aperçoive pas la raison de ce désordre, quand bien même ce seul accès serait suivi d'apyrexie complète, comme on peut craindre une fièvre tierce, il faut attendre le troisième jour, et donner des aliments après l'heure de l'accès, mais en petite quantité, parce qu'on peut craindre aussi une fièvre quarte; enfin si le malade n'a pas éprouvé de nouvel accès au quatrième jour, il est permis de le nourrir en toute assurance. Si au contraire la fièvre est revenue le lendemain, le troisième ou le quatrième jour, c'est qu'il y a maladie déclarée. Quant aux fièvres tierces et quartes dont les retours sont réglés, où l'apyrexie est complète et les intervalles bien tranchés, le traitement en est plus facile, et il en sera question en leur lieu. J'ai à m'occuper en ce moment des fièvres quotidiennes. Accorder des aliments de deux jours l'un est ici le mode le plus convenable; par ce moyen il y a un jour où la fièvre peut diminuer, et un autre jour où l’on soutient les forces. Mais on peut nourrir le jour même, dans les fièvres quotidiennes dont les accès cessent entièrement sans laisser aucuns vestiges. Quand la fièvre procède non par accès décidés, mais par redoublements quotidiens, suivis de rémissions incomplètes, il faut prendre pour le repas le temps de la rémission la plus longue. Si l'accès est plus grave un jour et plus léger le lendemain, on fera manger le malade après le jour marqué par une fièvre intense ; car en général l'accès le plus violent est suivi d'une nuit plus paisible, de même qu'il est précédé d'une nuit plus orageuse. Mais si la fièvre est continue, sans aucune rémission, et qu'il y ait nécessité toutefois d'accorder quelque nourriture, le moment à choisir pour cela devient l'objet d'un grand dissentiment. Les uns pensent qu'il faut préférer le matin, heure où les malades sont généralement plus calmes. Si en effet l'amélioration existe, c'est ce moment qu'on doit saisir, non parce que c'est le matin, mais parce qu'il y a rémission. Si à cette heure même, au contraire, le malade est sans repos, il est d'autant moins opportun de le nourrir que c'est la gravité du mal qui le prive du bénéfice ordinaire de la matinée, et cela doit faire craindre que le milieu de la journée, où presque toujours l'état des malades s'exaspère, ne devienne plus alarmant encore. Aussi d'autres médecins réservent dans ce cas les aliments pour le soir ; mais c'est précisément alors que la plupart des malades sont le plus accablés : il y a donc lieu d'appréhender que l'excitation produite par la nourriture n'ajoute à l'intensité du mal. Pour ces divers motifs, j'attends jusqu'au milieu de la nuit, parce que, arrivé la, on a traversé les instants les plus critiques et qu'on en est aussi loin que possible; de plus, les heures qui précèdent le jour sont en général remplies par le sommeil, et l'on a devant soi la matinée, c'est-à-dire le temps le plus favorable aux malades. Mais dans les fièvres Irrégulières qui peuvent signaler leur retour immédiatement après le repas du malade, il convient de donner des aliments dès que l'accès est passé. Cependant si plusieurs accès se succèdent dans le même jour, on doit examiner s'ils sont en tout point semblables, ce qui est pour ainsi dire impossible, ou s'ils sont inégaux. Quand il y a similitude entière, il faut permettre l'alimentation après l'accès dont la terminaison n'a pas lieu entre midi et le soir. Quand ils sont dissemblables, il faut rechercher en quoi ils diffèrent ; car si un accès se montre plus intense et l'autre plus léger, c'est après le plus grave que le malade doit manger, ou après celui qui a duré le plus de temps, s'il y en a eu un plus long, et un autre plus court ; de même si l'on rencontre deux accès dont l'un est plus fort et l'autre plus prolongé, il faut considérer si le malade est plus fatigué de la violence du premier que de la durée du second, et n'accorder d'aliments qu'après l'accès dont il aie plus souffert. Il est encore essentiel de connaître le nombre et la nature des rémissions qui succèdent à ces accès; car si l'un d'eux laisse le malade dans l'agitation et que l'autre soit suivi d'apyrexie, c'est ce dernier état qui se prête le mieux à l'alimentation; si le malade conserve toujours un mouvement fébrile, on choisit alors le temps de la plus longue rémission; de sorte que, dans les accès qui se touchent, c'est au déclin du premier qu'il faut s'empresser de faire manger le malade. En effet, le médecin doit considérer comme une règle invariable de prendre d'abord pour le repas le moment le plus éloigné de l'accès attendu, et de choisir ensuite l'heure où le malade se trouve aussi bien que possible ; et ce précepte est d'observation non seulement entre deux accès, mais quand il y en a plusieurs. Bien qu'il soit toujours préférable de donner des aliments de deux jours l'un, on peut en accorder une fois par jour s'il y a faiblesse, et plus encore s'il s'agit de fièvres continues qui ne présentent pas de rémissions et fatiguent extrêmement le malade, ou lorsque deux ou plusieurs accès surviennent le même jour. En conséquence, à partir du premier jour, l'alimentation sera quotidienne si le pouls est tombé dès le commencement; et même on y reviendra plusieurs fois dans la journée si le malade a été pris de défaillance au milieu de plusieurs accès. On aura soin pourtant de la restreindre après les accès qui réclameraient la diète si l'état des forces le permettait. Comme la fièvre s'annonce, commence, s'accroît, reste stationnaire ou diminue, pour demeurer à l'état de rémission ou cesser entièrement, il faut savoir que les meilleurs moments pour alimenter le malade sont l'apyrexie, puis la rémission bien tranchée ; et en troisième lieu, quand le cas l'exige, la période de déclin. Hors de là, il y a danger. Si cependant en raison de la faiblesse du malade il est urgent de le nourrir, mieux vaut s'y décider quand la fièvre est arrivée à son dernier degré d'accroissement, que lorsqu'elle est à l'état d'augment, et quand elle est seulement imminente, que lorsqu'elle se déclare. Il n'y a pas d'heure néanmoins où l'on ne puisse être tenu de ranimer le malade qui tombe en défaillance. Ce n'est pas assez que le médecin étudie les fièvres en elles-mêmes, il doit encore avoir égard à toute l'habitude du corps, et en tenir compte dans le traitement, soit qu'il y ait excès ou défaut des forces, soit que d'autres complications surviennent. Il est toujours utile d'inspirer de la sécurité aux malades, afin de ne pas ajouter l'anxiété morale aux souffrances du corps; cela est important surtout s'ils ont pris quelques aliments : aussi dans le cas où de fâcheuses nouvelles pourraient les agiter, il faut tâcher de leur en dérober la connaissance pendant leur maladie, on, si cela n'est pas possible, laisser passer du moins les heures du repas et du sommeil, et ne s'ouvrir à eux qu'au réveil. VI. Relativement à la nourriture, on a facilement raison des malades, parce que souvent leur estomac refuse les aliments qu'ils ont sollicités. Mais pour les boissons on a de grands combats à soutenir ; et la lutte est d'autant plus vive, que la fièvre est plus intense. La fièvre en effet allume la soif, et c'est précisément quand l'eau leur est le plus contraire que le besoin s'en fait le plus sentir. Néanmoins on doit faire comprendre aux malades que leur soif va cesser en même temps que la fièvre ; que l'on prolongerait l’accès en leur faisant prendre quelque chose, et qu'en ne buvant pas ils seront plus tôt soulagés de l'altération qu'ils éprouvent. Mais par la raison qu'en état de santé, on supporte plus facilement la faim que la soif, il y a lieu, la maladie survenant, de montrer plus de tolérance pour les boissons que pour les aliments. Le premier jour cependant, on ne doit accorder aucun liquide, à moins que le pouls ne tombe subitement, et, dans ce cas, il convient aussi de nourrir le malade; le lendemain au contraire, et les jours où la diète est de rigueur, on peut donner à boire ai la soif est ardente. Ce n'est pas sans raison qu'Héraclide de Tarente a dit que, lorsqu'il y a chez un malade amas de bile ou de crudités, il est utile de délayer ces matières corrompues à l'aide d'une légère quantité de boissons. Il faut en général les réserver, si on les donne seules, pour l'heure où les repas devraient avoir lieu, ou bien choisir le moment où l'on invite le malade au sommeil, attendu que la soif entraîne presque toujours l'insomnie. On reconnaît assez généralement que les boissons trop abondantes sont nuisibles aux personnes qui ont la fièvre, et principalement aux femmes qui en sont atteintes après l'accouchement. L'on peut, il est vrai, d'après la nature de la fièvre et de la rémission, fixer les époques convenables pour prescrire des aliments et des boissons ; mais il n'est pas très facile de savoir quand un malade a la fièvre, quand son état s'améliore, ou quand il tombe dans l'affaiblissement : ce sont là pourtant des circonstances essentielles à connaître pour régler le boire et le manger Ainsi le pouls, auquel nous accordons tant de créance, est souvent la cause des plus grandes erreurs ; car sa lenteur ou sa fréquence varie souvent en raison de l'âge, des sexes et des tempéraments. Chez une personne bien portante, mais dont l'estomac est faible, ou même au début de la fièvre, on observe communément que les pulsations sont si lentes et si faibles que le sujet parait sans forces, bien qu'il puisse facilement supporter le grave accès qui le menace. Au contraire elles deviennent plus vives et plus développées sons l'excitation produite par le soleil, le bain, l'exercice, la crainte, la colère, et toute espèce d'affection de l'âme ; il suffit même de la première approche du médecin, pour que le malade, inquiet du jugement qu'il va porter sur son état, éprouve de l'agitation dans le pouls. Aussi le praticien exercé, au lieu de saisira peine entré le bras du malade, vient s'asseoir près de lui avec un visage ouvert, l'interroge sur sa santé, combat ses craintes, s'il en a, par des raisons plausibles, et arrive ensuite à l'exploration du pouls. Mais le trouble excité par la vue seule du médecin ne peut-il pas se produire encore sous l'influence de mille autres causes? Une seconde indication à laquelle nous ajoutons foi et qui nous trompe également, c'est la chaleur; car elle peut s'élever par l'effet de la température, du travail, du sommeil, de la peur, et des anxiétés morales. Il faut donc tenir compte de ces conditions diverses, mais ne pas leur accorder une confiance sans bornes. On saura tout d'abord qu'il n'y a point de fièvre quand les pulsations sont régulières, et la chaleur modérée comme dans l'état de santé; il ne faut pas non plus se presser de conclure que le mouvement fébrile existe, parce que la chaleur sera plus vive et le pouls plus fréquent. Mais la fièvre est réelle si la peau est inégalement aride, si le malade accuse de la chaleur au front et aux hypocondres, si le souffle qui sort des narines est brûlant, s'il y a rougeur ou pâleur inaccoutumée, si les yeux sont pesants, très secs ou un peu larmoyants, si la sueur lorsqu'elle se déclare ne se répand pas également partout, et si les pulsations des veines n'ont lieu qu'à des intervalles inégaux. Pour se livrer a cet examen le médecin ne doit pas se placer dans l'obscurité, ni au chevet du malade, maison face de lui, au grand jour, afin de pouvoir apprécier tous les signes fournis par le visage. Lorsque après l'invasion de la fièvre il y a eu de l'amendement, il faut voir si les tempes ou quelque autre partie du corps ne sont pas en moiteur, ce qui annonce une sueur prochaine; et quand cette tendance à la transpiration se manifeste, il convient de faire boire au malade de l'eau chaude, dont l'effet sera salutaire s'il survient une sueur générale. Dans ce but, les malades doivent avoir les pieds et les mains sous les couvertures ; mais il ne faut pas les en accabler comme on le fait la plupart du temps à leur préjudice, au plus fort de la fièvre, et même de la fièvre ardente. Dès que la sueur se prononce, il faut essuyer chaque membre avec un linge chaud ; et lorsqu'elle a entièrement cessé, ou même quand il n'y a pas en de transpiration, si le malade paraît, autant qu'il peut l'être, en état de prendre quelque nourriture, on doit lui faire des onctions légères sous la couverture, l'essuyer, et lui donner ensuite des aliments. Les meilleurs pour les fébricitants sont les aliments liquides ou ceux qui approchent le plus de cette consistance, et qui sont très peu nourrissants, comme les crèmes farineuses par exemple ; et encore doivent-elles être fort claires si la fièvre est considérable. Pour rendre ces aliments plus substantiels, on y ajoute avec avantage du miel écume; mais si l'estomac le supporte mal, il faut y renoncer, ainsi qu'aux crèmes elles-mêmes. On peut donner en place de la panade à l'eau, ou bien de la fromentée, qu'on fait bouillir dans de l'eau miellée si l'estomac est en bon état et le ventre resserré, ou que l'on prépare avec de l'oxycrat, si l'estomac est languissant et le ventre relâché. Cela suffit pour une première alimentation. La seconde comporte quelque chose déplus, mais en choisissant toujours parmi les substances peu nutritives, comme les légumes, les coquillages ou les fruits. Ces aliments sont les seuls appropriés à la période d'accroissement des fièvres. Quand elles cessent, ou deviennent moins intenses, on commence de même par la nourriture la plus légère; mais on y joint quelques aliments tirés de la classe moyenne, en ayant toutefois égard aux forces du sujet et à la nature de la maladie. Lorsqu'il y a manque de forces et dégoût pour les aliments, il faut les varier, selon le précepte d'Asclépiade, afin qu'en goûtant un peu de chacun, le malade prévienne le besoin. Mais si l'on n'a à combattre ni la faiblesse ni l'inappétence, il est inutile de solliciter le malade par la variété des mets, de peur qu'il n'en prenne plus qu'il n'en peut digérer. Et il n'est pas vrai, comme le dit Asclépiade, que la digestion se fasse mieux en composant ainsi son régime d'un certain nombre d'aliments. Les malades en effet mangent plus volontiers, mais la digestion dépend toujours de la nature et de la quantité des substances nutritives. Il n'est jamais prudent d'accorder beaucoup de nourriture au malade quand la douleur conserve toute sa violence ou que la maladie s'accroît; on le peut seulement lorsqu'il y a tendance marquée vers la guérison. Les fièvres nécessitent encore d'autres observations. Aux yeux de quelques-uns, par exemple, la seule chose importante est d'examiner si le corps est resserré ou relâché ; car le premier état peut faire périr par suffocation, et le second par épuisement. Si donc il y a resserrement, on doit prescrire des lavements, pousser aux urines et provoquer la sueur détentes les manières. En pareil cas, il est encore utile de tirer du sang, d'imprimer au malade de fortes secousses par la gestation, de l'exposer au grand jour, et de lui faire subir la faim, la soif et l'insomnie. Il est bon aussi de le conduire au bain, de l'oindre en sortant, puis de le baigner de nouveau, et de faire avec l'eau tiède d'abondantes fomentations sur les régions inguinales; quelquefois même on peut mêler de l'huile à l'eau chaude de la cuve. De plus, le malade devra manger plus tard et moins souvent, choisir de préférence des aliments ténus, simples, peu consistants, chauds ; les prendre en petite quantité et user surtout de plantes potagères, telles que la patience, l'ortie et la mauve; ou encore faire usage de bouillon de poissons à coquille, celui, par exemple, de moule ou de langouste. Quant à la viande, on ne doit la donner que bouillie. Pour les boissons on peut se montrer plus libéral, en accorder avant et après le repas, et laisser le malade boire, en mangeant, même au delà de sa soif. Au sortir du bain, on peut lui donner du vin plus onctueux ou plus doux, ou lui permettre une ou deux fois du vin grec salé. Au contraire, si le corps est relâché, il faut arrêter la sueur, tenir le malade dans le repos et l'obscurité, le laisser dormir à sa volonté, n'agiter le corps que par une douce gestation, et le gouverner selon la nature du mal. S'il y a dérangement du ventre et si l'estomac ne peut rien garder, il faut, dès que la fièvre a diminué, faire avaler beaucoup d'eau chaude au malade pour le forcer à vomir, à moins que la gorge, l'épigastre ou le côté ne soient douloureux, ou que la maladie ne soit ancienne. S'il y a des sueurs, on rend la peau plus ferme au moyen du nitre ou du sel mêlés à de l'huile. Si la transpiration est faible, les onctions avec l'huile suffisent ; mais si elle est abondante, on les pratique avec l'huile de rose, de coing ou de myrte, en y ajoutant un peu de vin astringent. Toutes les fois qu'il y a maladie par évacuation, on ne doit pas négliger, en se rendant au bain, de se faire oindre avant de se baigner. Si c'est la peau qui est frappée de relâchement, il vaut mieux se servir d'eau froide que d'eau chaude. Quand on arrive à l'alimentation, il faut prescrire un régime fortifiant, froid, sec, simple, et peu susceptible de se corrompre ; ainsi l'on y fait entrer le pain grillé, la viande rôtie, et du vin plus ou moins astringent. Il faut boire chaud s'il existe un flux de ventre, et boire froid quand les sueurs fatiguent et qu'il survient des vomissements. VII. 1. Dans les fièvres, le caractère pestilentiel réclame aussi une attention spéciale. La diète, les purgatifs ou les lavements ne sont alors d'aucune utilité, et quand les forces le permettent, le mieux est de tirer du sang, surtout si la fièvre est accompagnée de douleur. Si ce moyen n'offre pas assez de sécurité, il faut, des que la fièvre est moins forte, débarrasser l'estomac en faisant vomir. La nécessité des bains se fait plus tôt sentir dans les cas de ce genre que dans les autres maladies. Le vin, qu'il faut donner chaud et plus pur, est de même indiqué, ainsi que toutes les substances glutineuses, y compris les viandes de même nature. Plus le malade peut être enlevé rapidement par de pareils orages, plus on est tenu de chercher contre eux des secours expéditifs, en donnant même quelque chose à la témérité. S'il s'agit d'un enfant, et qu'en raison de sa faiblesse il n'y ait pas lieu de le saigner, il faut appliquer des ventouses, prescrire des lavements avec l'eau simple ou la décoction d'orge, et ne permettre ensuite que des aliments légers. Le traitement des enfants ne saurait être en tout point semblable à celui des hommes faits; et dans cette maladie, de même que dans toutes les autres, on doit, en ce qui les concerne, procéder avec plus de réserve, admettre difficilement l'emploi de la saignée et des lavements, et renoncer à leur imposer comme moyens curatifs la veille, l'abstinence, la soif, ainsi que l'usage du vin. Il est convenable de les faire vomir quand la fièvre est tombée, puis de les nourrir très légèrement, et de favoriser ensuite leur sommeil. Abstinence le lendemain si la fièvre persévère, et, le troisième jour, même régime que le premier. Enfin il faut autant que possible faire consister le traitement dans l'observance de ces deux préceptes : prescrire la diète à propos, et nourrir en temps opportun. 2. Si le malade est consumé par une fièvre ardente, il ne faut lui donner aucune boisson médicamenteuse, mais chercher à le rafraîchir même dans le temps des redoublements, par des fomentations d'eau et d'huile qu'on mélange avec la main, jusqu'à ce qu'elles blanchissent. La chambre à coucher doit être spacieuse, pour fournir largement à la respiration du malade un air pur. Au lieu de l'étouffer sous le poids des couvertures, on aura soin de n'en mettre sur lui que de légères ; on peut en outre appliquer sur l'estomac des feuilles de vigne trempées dans de l'eau froide. Il est inutile de lui faire endurer une soif trop vive ; et même on doit le nourrir plus tôt, c'est-à-dire le troisième jour, en pratiquant avant le repas les onctions indiquées plus haut. S'il y a dans l'estomac un amas de pituite, il faut vers la fin de l'accès provoquer le vomissement, et donner ensuite des légumes froids ou des fruits, choisis parmi ceux qui conviennent à l'estomac. Si cet organe au contraire est dans un état de sécheresse, il convient d'administrer aussitôt une décoction d'orge ou de fromentée, ou bien une crème de riz avec laquelle on aura fait bouillir de la graisse nouvelle. Quand la fièvre est dans sa plus grande violence, il faut, s'il existe une soif ardente, faire boire au malade une grande quantité d'eau froide, pourvu que ce ne soit pas avant le quatrième jour; on lui en donnera même bien au delà de sa soif, et lorsque le ventre et l'estomac sont ainsi remplis outre mesure, et se trouvent suffisamment rafraîchis, il faut faire vomir. Quelques médecins ne croient pas le vomissement nécessaire, et se contentent, pour toute médication, d'eau froide administrée jusqu'à satiété. Après avoir suivi l'une ou l'autre pratique, on doit bien couvrir le malade, et lui faire prendre une situation favorable au sommeil. Presque toujours à la suite d'une longue altération, d'une insomnie prolongée, et lorsqu'on a calmé la chaleur au moyen de l'eau prise à discrétion, il survient un sommeil complet accompagné d'une sueur considérable, et c'est là ce qui constitue le meilleur remède dans cette maladie ; mais, pour agir ainsi, il faut qu'à l'exception de la chaleur il n'existe ni douleur ni gonflement des hypocondres, ni embarras dans le thorax, les poumons et l'arrière-gorge, ni ulcères, ni déjections alvines.[3] Si cette fièvre est accompagnée d'une toux légère et si la soif est modérée, on n'a pas besoin de faire boire de l'eau froide, et l'on se conformera simplement au traitement prescrit pour les autres fièvres. VIII. Quant à l'espèce de fièvre tierce que les médecins appellent hémitritée, il faut mettre tous ses soins à ne pas s'en laisser imposer. La plupart du temps, en effet, elle se compose de redoublements et de rémissions si rapprochés, qu'on pourrait la confondre avec une autre maladie; la durée de l'état fébrile varie entre vingt-quatre et trente-six heures, de sorte qu'on croit avoir affaire à un nouvel accès, tandis que c'est le même qui se prolonge. Il est très important de n'accorder d'aliments que lorsque la rémission est bien franche, et de saisir aussitôt ce moment pour en donner; car beaucoup de malades succombent brusquement par la faute du médecin, qui n'a pas su reconnaître l'indication ou la mettre à profit. On doit dès le principe tirer du sang, à moins qu'un motif sérieux ne s'y oppose, et prescrire ensuite des aliments qui, sans augmenter la fièvre, donnent au malade la force de supporter la longue durée de ses accès. IX. Quelquefois encore on est atteint de fièvres lentes qui n'offrent pas de rémission, et dès lors il n'y a pas de temps marqué pour donner de la nourriture ou des médicaments. En pareil cas le médecin doit s'appliquer à changer la nature de la maladie, dans l'espoir de la rendre plus accessible aux moyens curatifs. Souvent donc il est à propos de frotter le corps du malade avec de l'eau froide et de l'huile; il en résulte parfois un frisson qui devient le point de départ d'un mouvement nouveau, et ce frisson est suivi d'une augmentation de chaleur à laquelle succède la rémission. Dans ces fièvres, les frictions faites avec de l'huile et du sel paraissent aussi produire de salutaires effets. Mais si le froid, l'engourdissement et l'agitation du corps se prolongent longtemps, il devient convenable de donner, même pendant la fièvre, trois ou quatre verres de vin miellé, ou de vin bien trempé, pris avec les aliments ; par ce moyen la fièvre acquiert une intensité plus grande, et la chaleur plus vive qui en résulte, en faisant disparaître les premiers symptômes, permet d'espérer une rémission, et par suite la guérison du mal. Bien de moins nouveau assurément que la méthode appliquée de nos jours par certaines gens, et qui guérit quelquefois par des remèdes contraires ceux que des médecins trop circonspects traînaient en longueur. Chez les anciens, en effet, avant Hérophile et Érasistrate, et après Hippocrate, on trouve un certain Pétron qui dès le principe accablait les fébricitants de couvertures, pour exciter au plus haut degré la chaleur et la soif. Lorsque ensuite la fièvre inclinait vers la rémission, il faisait boire de l'eau froide; et si la sueur s'établissait, le malade, selon lui, ne courait plus aucun danger ; s'il n'obtenait pas de transpiration, il ingérait une plus grande quantité d'eau froide, et provoquait après le vomissement. Quand il réussissait par l'un ou l'autre procédé à délivrer le malade de la fièvre, il lui donnait aussitôt de la viande de porc rôtie et du vin; si l'état fébrile persistait, il faisait bouillir de l'eau chargée de sel, et la prescrivait comme boisson, pour produire un effet purgatif par l'excitation du ventre. Sa médecine n'allait pas au delà, et elle ne fut pas moins secourable a ceux que les successeurs d'Hippocrate n'avaient pu guérir, qu'elle ne l'est maintenant aux malades longtemps et vainement traités par les sectateurs d'Hérophile ou d'Érasistrate. Cette méthode cependant n'en est pas moins téméraire, et tue la plupart des malades auxquels on l'applique dès le début; mais les mêmes moyens ne pouvant convenir à tous, il arrive souvent que la témérité vient en aide à ceux qu'un traitement rationnel n'a pas su rétablir. Aussi les médecins de cette espèce obtiennent-ils plus de succès sur les personnes que d'autres ont déjà soignées, que sur leurs propres malades. Mais il doit être permis même au médecin prudent de changer quelquefois sa manière d'agir, d'aggraver la maladie et d'allumer la fièvre; et cela par la raison que, si l'état présent se refuse à la médication, celui qui doit suivre s'y prêtera peut-être davantage. X. Il faut examiner aussi si la fièvre existe seule, ou si elle est accompagnée d'autres signes fâcheux, c'est-à-dire de douleur de tête, de sécheresse de la langue et de gonflement des hypocondres. On combat le mal de tête par des applications sur le front d'un mélange d'huile rosat et de vinaigre. On dispose pour cela deux bandes de la largeur et de la longueur du front, afin de pouvoir successivement en tenir une sur la partie souffrante et tremper l'autre dans le mélange. Au lieu de linge on peut se servir de la même manière d'une laine grasse. Si le vinaigre parait contraire, on se contentera d'huile rosat, et si celle-ci ne réussit pas mieux, on prendra de l'huile acerbe. Si ces moyens sont trop faibles, il faut piler de l'iris sèche, des amandes amères ou des herbes rafraîchissantes. En appliquant l'un de ces remèdes trempé dans du vinaigre, on diminue la douleur, mais non chez tous également. Comme calmant on peut employer encore le pain bouilli soit avec du pavot ou des feuilles de roses, soit avec de la céruse ou de la litharge. Il est bon aussi de respirer du serpolet ou de l'aneth. Y a-t-il inflammation et douleur des hypocondres? il faut appliquer d'abord des cataplasmes répercussifs, car s'ils étaient échauffants, ils détermineraient sur cette partie un plus grand afflux d'humeurs ; puis on les emploie chauds et humectants lorsque l'inflammation a perdu sa première violence, et pour en dissiper les derniers vestiges. L'inflammation se reconnaît aux quatre signes suivants : rougeur, tumeur, chaleur et douleur; on peut juger par là de l'erreur d'Érasistrate, qui prétend que toute fièvre est accompagnée d'inflammation. Si donc il y a douleur sans inflammation, toute médication externe est inutile, car la fièvre en fera justice. Mais s'il n'y a ni Inflammation, ni fièvre, et seulement douleur aux hypocondres, il faut recourir aussitôt à des fomentations chaudes et sèches. Si la langue est raboteuse et sèche, il convient de la nettoyer d'abord avec un pinceau trempé dans l'eau chaude et de l'enduire ensuite d'un mélange d'huile rosat et de miel. Le miel sert à déterger, l'huile rosat est un répercussif qui prévient en même temps la sécheresse. Si la langue est sèche sans âpreté, on se contente, après l'avoir nettoyée avec le linge, de l'enduire d'huile rosat à laquelle on ajoute un peu de cire. XI. Le froid précède ordinairement la fièvre, et il en résulte un état très pénible. On doit, lorsqu'on l'attend, refuser toute boisson au malade, parce qu'administrée peu de temps avant l'apparition du frisson, elle ajoute beaucoup à son intensité. Il faut de bonne heure avoir soin de bien couvrir le malade, et pratiquer sur les parties les plus exposées des fomentations sèches et chaudes, non de manière à provoquer la chaleur brusquement et sans mesure, mais à la développer graduellement : on doit aussi frictionner ces parties avec les mains imbibées de vieille huile, à laquelle on ajoute quelques ingrédients échauffants. Certains médecins se contentent d'une seule friction, faite avec n'importe quelle espèce d'huile. Quelques-uns, dans la rémission des fièvres, permettent trois ou quatre verres de crème d'orge, malgré la persistance de l'état fébrile; et quand l'accès est terminé, ils réparent l'estomac avec une alimentation froide et légère. Je pense, moi, qu'on ne doit faire cet essai que lorsque les aliments donnés au malade en une seule fois et après la fièvre ont eu peu de succès. Mais il faut surveiller la maladie avec une attention vigilante, pour ne pas se laisser tromper sur le temps de la rémission ; car il arrive souvent dans les cas de ce genre que la fièvre, au moment même où elle parait décliner, se ranime de nouveau. Pour pouvoir compter sur la rémission, il faut qu'elle se maintienne, et que l'agitation diminue ainsi que la fétidité de l'haleine (ὅζη en grec). Il est assez convenable, si les accès quotidiens sont semblables, de donner chaque jour un peu de nourriture ; s'ils sont inégaux, on fait prendre des aliments après l'accès le plus grave, et de l'eau miellée après le plus léger. XII. Le tremblement se déclare avant l'accès dans les fièvres qui affectent des retours bien réglés et des intermittences complètes. Cette forme est par cela même la moins dangereuse, et la plus accessible aux moyens de traitement. Il est impossible en effet, si les périodes n'ont rien de fixe, de prescrire avec opportunité ni lavements, ni bains, ni vin, ni médicament, car on ignore quand la fièvre doit venir ; de sorte que, reparaissant à l'improviste, les remèdes employés pour la combattre peuvent devenir eux-mêmes des agents funestes ; on doit se contenter alors d'observer la diète les premiers jours, et de prendre ensuite quelques aliments au déclin de l'accès le plus grave. Mais quand la fièvre parcourt régulièrement ses périodes, on a plus de facilité pour agir, parce qu'on peut calculer avec plus d'assurance le commencement et la fin des accès. Dans les fièvres déjà anciennes, l'abstinence n'est pas utile, et ne doit être observée que les premiers jours. Le traitement a deux objets à remplir : dissiper le tremblement, puis guérir la fièvre. Il faut donc, lorsque le malade après avoir tremblé passe du frisson à la chaleur, lui faire boire de l'eau tiède salée, et le forcer à vomir; car presque toujours ce frisson reconnaît pour cause un amas de bile dans l'estomac. Il faut revenir à ce moyen si le frisson se reproduit à l'accès suivant, parce que souvent on le dissipe ainsi. Comme on sait déjà de quelle nature est la fièvre, on doit, peu de temps avant l'invasion du troisième accès, conduire le malade au bain, et faire en sorte qu'il y soit au moment du frisson. S'il le ressent dans le bain même, il faut malgré cela renouveler l'épreuve à l'approche du quatrième accès, car ordinairement elle est suivie de succès. Si cependant on n'obtient rien du bain, il faut avant l'accès faire manger de l'ail au malade, ou lui donner de l'eau chaude avec du poivre, car ces substances développent une chaleur incompatible avec le frisson ; on a soin de le couvrir ensuite avant qu'il puisse être saisi de tremblement, en s'y prenant comme nous l'avons dit à l'occasion du froid ; on pratique aussitôt après d'activés fomentations, et l'on tout le long du corps des briques chaudes et des tisons éteints qu'on enveloppe dans du linge. Si ces précautions sont encore impuissantes à prévenir le frisson, on fait sous les couvertures du malade des onctions avec beaucoup d'huile à laquelle on associe quelques drogues échauffantes ; puis l'on fait des frictions aussi fortes que le malade peut les supporter, surtout aux pieds et aux mains, en l'obligeant à retenir son haleine. Il faut insister sur ces moyens quand même le frisson se prolongerait, car avec de la persévérance on finit souvent par triompher du mal. S'il y a des vomissements, on donne à boire de l'eau tiède pour faire vomir encore, et l'on continue d'agir ainsi jusqu'à ce que le frisson disparaisse. Si ce résultat se fait trop attendre, on a de plus recours aux lavements, qui sont utiles en débarrassant le corps des matières qui le surchargent. Enfin, comme derniers moyens, on emploie la gestation et les frictions. Il est très important, dans les maladies de ce genre, de faire choix d'une nourriture qui tienne le ventre libre, de prescrire des viandes gélatineuses et du vin astringent. XIII. Ces préceptes sont relatifs aux fièvres d'accès en général ; mais il importe ensuite de les distinguer entre elles, puisqu'elles ne comportent pas toutes un traitement semblable. S'il s'agit d'une fièvre quotidienne, il faut observer une diète rigoureuse les trois premiers jours, puis donner des aliments de deux jours l'un. Si l’état fébrile est déjà ancien, on doit, après l'accès, essayer du bain et donner du vin, surtout si la fièvre persiste après que le tremblement a cessé. XIV. S'il est question d'une fièvre tierce ou quarte parfaitement intermittente, il faut, les jours d'apyrexie, se livrer à la promenade ainsi qu'à d'autres exercices, et faire usage des onctions. Parmi les anciens médecins, on nommé Cléophante faisait longtemps avant l'accès répandre sur la tête du malade beaucoup d'eau chaude, et lui faisait ensuite boire du vin. Tout en se conformant à la plupart des préceptes de ce médecin, Asclépiade a cependant rejeté cette pratique, et avec raison, car elle est incertaine. Ce dernier auteur pense qu'il faut, dans la fièvre tierce, prescrire un lavement le troisième jour après l'accès, et faire vomir le cinquième après le tremblement; puis, quand la fièvre est tombée, donner, selon sa méthode, du vin et des aliments au malade sans attendre que la chaleur l'ait quitté ; le sixième jour il ordonne le repos du lit, dans l'espoir que la fièvre ne reviendra pas le septième. On peut admettre, il est vrai, que souvent les choses se passent ainsi, mais il est plus sûr encore d'adopter l'ordre suivant : le troisième jour prescrire un lavement, faire vomir le cinquième, et ne faire boire du vin au malade que le septième jour après l'accès. Si la maladie n'est pas enlevée dès les premiers jours et qu'elle traîne en longueur, le malade devra garder le lit le jour où il attend la fièvre, se faire frictionner, l'accès une fois terminé, et boire de l'eau après avoir mangé ; le lendemain, jour d'apyrexie, se priver d'exercice et d'onctions, et ne boire que de l'eau. C'est là ce qu'il y a de mieux à faire; mais si la faiblesse est menaçante, il conviendra de donner du vin après la fièvre, et un peu d'aliments dans le milieu du jour. XV. Le même traitement s'applique à la fièvre quarte ; mais comme la durée de celle-ci est en général beaucoup plus longue quand elle ne cède pas dans les premiers jours, il faut mettre plus de soin encore à régler dès le commencement la méthode curative. Lors donc que la fièvre s'annonce par un tremblement, le malade doit après l'accès se tenir en repos le jour mémo, le lendemain et le surlendemain, et boire seulement un peu d'eau chaude le premier jour au moment de l'apyrexie ; il fera même bien, s'il le peut, de s'en passer les deux jours suivants. Si la fièvre revient le quatrième jour avec tremblement, on fera vomir comme il a été dit plus haut, et après l'accès on pourra donner une nourriture légère et un setier de vin; le lendemain et le surlendemain, diète absolue, et seulement un peu d'eau chaude s'il y a de l'altération ; le septième jour il faut prévenir le frisson au moyen du bain, donner un lavement si la fièvre revient, et, dès que le malade est remis de cette fatigue, faire des onctions et des frictions énergiques, prendre ensuite des aliments et du vin dans la mesure indiquée déjà, et garder l'abstinence les deux jours suivants en continuant les frictions; le dixième jour enfin revenir au bain, et, si la fièvre reparaît, recommencer les frictions, et boire une plus grande quantité de vin. Il arrive souvent que le repos observé pendant tant de jours, ainsi que la diète et les remèdes dont on s'est servi, amènent la cessation de la fièvre. Si néanmoins elle persévère, il faut changer entièrement de méthode, et gouverner le malade de manière à lui conserver les forces qu'exige une maladie de longue durée. Aussi doit-on blâmer la pratique d'Héraclide de Tarente, qui ordonnait un lavement les premiers jours et prescrivait la diète jusqu'au septième. Or, en supposant qu'un malade puisse endurer une telle abstinence, à peine lui resterait-il, une fois délivré de la fièvre, la force de se rétablir, et par conséquent il succomberait d'épuisement si les accès se multipliaient. Lors donc qu'au treizième jour le mal n'a pas cédé, il devient inutile d'employer les bains, soit avant, soit après l'accès, à moins qu'il n'y ait plus de frisson ; et quant à cet accident, on pourra le combattre par les moyens que nous avons déjà fait connaître. Il sera nécessaire en outre, après la fièvre, d'oindre le malade, de le frotter fortement, de lui accorder ensuite une nourriture abondante et substantielle, et du vin selon son désir; le lendemain, après un repos convenable, promenade, exercice, onctions et frictions énergiques, pas de vin avec les aliments ; diète absolue le surlendemain. Le jour où la fièvre doit venir, le malade fera bien de se lever avant l'accès pour s'exercer, et passer ainsi dans une agitation volontaire le temps de la période fébrile, car l'exercice a souvent le pouvoir de chasser la fièvre ; mais si, pendant qu'il se livre au mouvement, un autre accès vient le surprendre, il doit alors se reposer. On combat cette espèce de fièvre au moyen de l'huile, des frictions, de l'exercice, de l'alimentation et du vin. S'il y a constipation, on a soin de tenir le ventre libre. Les sujets robustes supportent facilement ce traitement ; mais pour les personnes faibles, il faut remplacer l'exercice par la gestation, et si même elle est trop pénible, se contenter des frictions : dans le cas où ce moyen serait encore trop actif, on se bornera au repos, aux onctions et à l'alimentation, en prenant garde toutefois de transformer, par le fait d'une indigestion, la fièvre quarte en quotidienne. Sous la forme quarte en effet la fièvre ne tue personne, tandis qu'en prenant le type quotidien elle compromet la vie. Cela n'arrive jamais cependant sans la faute du malade ou du médecin. XVI. Mais si la fièvre est double quarte, et qu'il soit impossible de se livrer aux exercices que j'ai proposés, il faut se reposer tout à fait, ou, si cela présente des difficultés, se promener doucement ; puis dans l'état de repos s'envelopper avec soin la tête et les pieds ; à la fin de chaque accès prendre un peu de nourriture et de vin, et le reste du temps, a moins de grande faiblesse, observer la diète. Mais si les deux accès se touchent pour ainsi dire, il faut, quand l'un et l'autre sont passés, prendre quelques aliments, essayer ensuite pendant l'apyrexie de faire un peu d'exercice, employer les onctions et se nourrir. La fièvre quarte invétérée ne se terminant presque jamais qu'au printemps, on doit écarter avec soin tout ce qui pourrait vers cette époque faire obstacle à la guérison. Dans ces fièvres prolongées on se trouve bien de changer de temps en temps le régime, de passer du vin à l'eau, de l'eau au vin, des aliments doux à ceux qui sont acres, et des acres aux doux ; il est bon aussi de manger du raifort, puis de vomir, ou de se tenir le ventre libre avec du bouillon de poulet, d'ajouter à l'huile pour les frictions quelques drogues échauffantes, de boire avant l'accès deux verres de vinaigre, ou un de moutarde mêlé à trois verres de vin grec salé, ou encore de prendre délayé dans de l'eau un mélange à parties égales de poivre, de castoréum, d'assa foetida et de myrrhe. En employant ces remèdes et d'autres semblables, on doit avoir pour but d'imprimer au corps une secousse qui le fasse sortir enfin d'un état qui l'opprime. Quand la fièvre a disparu, il faut longtemps encore avoir présents à l'esprit les jours d'accès, et, à ces moments, éviter le froid, la chaleur, les indigestions et la fatigue; car les rechutes sont faciles si l'on ne sait pas veiller sur soi-même après la guérison. XVII. Mais si la fièvre quarte devient quotidienne par suite de quelque imprudence, on doit pendant deux jours observer la diète, faire usage des frictions, et ne donner à boire de l'eau que le soir seulement. La fièvre, dans ce cas, manque souvent au troisième jour; mais qu'elle reparaisse ou non, c'est après le temps de l'accès qu'il faut accorder des aliments. Si elle persiste, diète nouvelles, aussi rigoureuse que possible, pendant deux jours, et frictions tous les jours. XVIII. Je viens d'exposer le traitement des fièvres ; mais elles se compliquent d'autres affections, et je vais parler immédiatement de celles auxquelles on ne saurait assigner de siège bien déterminé. Je commencerai par le délire, et je traiterai d'abord de la forme aiguë et fébrile que les Grecs appellent frénésie.[4] Avant tout, il faut savoir que dans certains accès les malades extravaguent et tiennent des propos hors de sens ; ce signe a de la gravité, et ne peut exister sans une fièvre intense : cependant il n'a pas toujours des conséquences funestes, parce qu'en général il est de courte durée, et que l'intelligence redevient libre dès que la première violence du mal est passée. Il n'est pas besoin dans ce cas d'autres remèdes que de ceux indiqués pour guérir la fièvre. Mais il y a frénésie déclarée lorsqu'il y a continuité dans le délire, ou que le malade, sans perdre encore l'usage de sa raison, accueille pourtant des idées chimériques; la frénésie est complète quand l'esprit est dominé par ces vaines imaginations. Les caractères qu'elle présente sont du reste assez variés. On voit des frénétiques montrer de la gaieté, d'autres de la tristesse ; ceux-ci, faciles à contenir, n'extravaguent que dans leurs discours ; ceux-là s'agitent violemment et font des gestes désordonnés; parmi ces derniers il en est qui cèdent aveuglément à l'impulsion du mal, tandis que certains autres, employant l'artifice, savent sous les dehors de la raison préparer les occasions favorables à leurs mauvais desseins, et ne se trahissent que dans l'exécution. Pour ceux dont le délire ne s'exhale qu'en paroles, ou qui sont faiblement agités, il est inutile d'en venir aux moyens coercitifs ; mais il convient d'attacher ceux qui témoignent plus d'emportement, et de les mettre hors d'état de se nuire à eux-mêmes, ou de nuire à ceux qui les entourent. On ne doit pas croire sur parole un frénétique enchaîné, qui pour se débarrasser de ses liens veut exciter la compassion par des discours bien suivis, car c'est là une ruse familière aux insensés. Chez les anciens ces malades étaient presque toujours tenus dans les ténèbres, parce que, d'après eux, les frénétiques ne devaient rien voir qui pût devenir pour eux un sujet de terreur, et que l'obscurité leur paraissait aussi contribuer au repos de l'esprit. Asclépiade au contraire, regardant les ténèbres elles-mêmes comme une cause d'épouvante, voulait qu'on les laissât constamment jouir de la lumière. Ces deux manières d'agir sont trop absolues ; car il est des malades que la lumière agite davantage, d'autres qui sont plus troublés par l'obscurité, d'autres aussi qui semblent ne recevoir aucune impression du jour ou de la nuit. Ce qu'il y a de mieux à faire, c'est d'éprouver l'une et l'autre méthode, de rendre à la lumière celui qui redoute l'obscurité, et de tenir dans les ténèbres celui que la clarté épouvante. Mais lorsque le malade demeure à cet égard dans une complète indifférence, on doit préférer pour lui, s'il a conservé ses forces, un endroit éclairé, et un séjour obscur s'il est trop affaibli. Administrer des remèdes au plus fort du délire est chose vaine, attendu que la fièvre s'accroît alors en même temps. On doit se borner, dans ce cas, à contenir le malade ; puis on avise ensuite aux moyens de traitement, dès que son état le permet. Asclépiade a également avancé qu'on tuait les frénétiques en leur tirant du sang; et il donne pour raison que le délire étant toujours accompagné d'une fièvre intense, la saignée n'est convenable qu'au moment de la rémission. Mais lui-même cherchait dans cette situation à favoriser le sommeil par des frictions répétées; et cependant l'ardeur de la fièvre est un obstacle au sommeil, et les frictions ne sont jamais utiles qu'au déclin des accès : par conséquent il devait aussi les proscrire. Que faire donc? Il est permis, quand le péril est pressant, d'appeler à son aide les ressources qu'on devrait s'interdire en d'autres circonstances. La fièvre continue, par exemple, qui n'offre pas de rémission, a néanmoins des instants où elle cesse de croître; et, sans être favorables, ces instants sont encore les meilleurs pour l'administration des remèdes. Il convient donc, lorsque les forces du malade ne s'y refusent pas, de pratiquer la saignée, et l'on doit moins hésiter encore à ordonner des lavements. Après un jour d'intervalle, il faut raser la tête et la soumettre a des fomentations faites avec une décoction de verveine ou d'autres plantes astringentes; ou bien fomenter d'abord, raser ensuite, et renouveler les fomentations ; puis en dernier lieu répandre sur la tête de l'huile rosat, qu'on fait entrer aussi dans les narines ; faire respirer de la rue pilée dans du vinaigre, et employer les remèdes convenables pour exciter l'éternuement. Ces divers moyens ne sont indiqués qu'autant que le malade n'est pas affaibli ; car dans ce cas il faudrait seulement humecter la tête avec de l'huile rosat, en y ajoutant du serpolet ou d'autres substances semblables. Quel que soit l'état des forces, il est avantageux d'arroser la tête avec le suc de morelle et de pariétaire, qu'on exprime en même temps. Au déclin de la fièvre, on peut faire usage des frictions; mais si la frénésie est caractérisée par une joie trop vive, on doit y mettre plus de ménagement que lorsqu'elle a pour expression une tristesse profonde. En traitant ces égarements de l'esprit, il est nécessaire de se plier aux diverses formes qu'ils présentent. Il y a chez les uns de vaines terreurs à dissiper; témoin l'exemple de cet homme qu'agitait, malgré ses richesses, la crainte de mourir de faim, et auquel on annonçait de temps à autre des successions imaginaires. Il yen a d'autres dont il faut maîtriser l'audace, et qu'on ne peut dompter que par des châtiments physiques. C'est par la réprimande et la menace qu'on arrête parfois des éclats de rire insensés; parfois aussi, pour arracher ces malades à leur mélancolie, on a recourt à la musique, au son des cymbales, et à d'autres moyens bruyants. En général il vaut mieux entrer dans leur folie que de la combattre ouvertement, et les ramener, par degrés et sans qu'ils s'en doutent, de la déraison à des idées plus saines. Dans certains cas, on doit tâcher de captiver leur attention : aux gens de lettres, par exemple, on fera des lectures, soit d'une manière correcte s'ils y prennent plaisir, soit avec des incorrections calculées s'ils en paraissent choqués, parce qu'en voulant les relever ils sont obligés déjà d'exercer leur jugement; on peut même les contraindre à réciter les passages dont ils ont gardé le souvenir. Il y a de ces frénétiques auxquels on a pu rendre le goût des aliments, en les plaçant à table au milieu des convives. Chez tous ces malades le sommeil est aussi rare qu'il leur est nécessaire, puisque c'est à lui que la plupart d'entre eux doivent leur guérison. Pour les faire dormir, et remédier en même temps au désordre de l'intelligence, on applique sur la tête l'onguent de safran mêlé à celui d'iris. Si néanmoins l'insomnie persiste, on cherche à favoriser le sommeil en faisant boire au malade une décoction de pavot ou de jusquiame, en mettant sous son oreiller des pommes de mandragore, ou encore en appliquant sur le front de l'amome ou du suc de sycaminum. Je trouve ce nom dans les auteurs; mais comme les Grecs appellent συκάμινος le mûrier, qui ne fournit aucun suc, cela doit s'entendre du suc recueilli sur un arbre qui croit en Égypte, et qu'on nomme sycomore. Souvent aussi on fait sur la tête et le visage des fomentations au moyen d'une éponge trempée dans une décoction d'écorce de pavots. Asclépiade blâme encore ces remèdes, parce que dans bien des cas ils changent la frénésie en léthargie. Selon lui, le malade ne doit, le premier jour, ni boire, ni manger, ni dormir; le soir, il accorde un peu d'eau, et veut que l'on pratique des frictions avec la main, assez doucement toutefois, pour que la peau n'en conserve qu'une légère empreinte; le lendemain, même régime; le soir, crème d'orge, eau pour boisson et frictions nouvelles; car c'est, dit-il, en insistant sur ce moyen qu'on obtient du sommeil. Il survient en effet quelquefois, et même, de l'aveu d'Asclépiade, il peut devenir léthargique quand les frictions sont portées trop loin. Si néanmoins l'insomnie se prolonge, il faut s'adresser enfin aux médicaments dont je viens de parler, mais ceux-ci n'exigent pas moins de réserve, car en voulant faire dormir le malade on s'expose à ne pouvoir plus le tirer de son assoupissement. Le bruit de l'eau qui tombe d'un tuyau placé près du malade, la gestation après le repas et pendant la nuit, et surtout le balancement d'un lit suspendu, sont aussi des moyens d'inviter au sommeil. Si déjà le malade n'a pas été saigné, si son intelligence est troublée, et s'il ne dort pas, il est encore utile de lui poser à l'occiput des ventouses scarifiées, parce que ce remède, en diminuant la violence du mal, peut faciliter le retour du sommeil. Il faut savoir aussi régler l'alimentation: ne point donner trop de nourriture dans la crainte d'exciter le délire, et ne pas imposer non plus un jeûne trop sévère qui pourrait amener la défaillance. Il faut s'en tenir à des aliments légers, à la crème d'orge principalement; et pour boisson se contenter d'eau miellée qu'on donne à la dose de trois verres, deux fois par jour en hiver, et quatre fois en été. La seconde espèce de folie est généralement plus longue, parce qu'elle commence sans fièvre et détermine plus tard un état fébrile. Cette affection est caractérisée par une tristesse qui parait dépendre de l'atrabile. La saignée est utile dans ce cas; mais si quelque raison défend de la pratiquer, l'abstinence alors vient se placer en première ligne. La seconde chose à faire est d'évacuer, en faisant vomir au moyen de l'ellébore blanc. Il faut joindre à l'une ou l'autre médication deux frictions par jour : si le malade est robuste, il doit s'exercer fréquemment, vomir à jeun, et prendre sans vin des aliments de la classe moyenne. Toutes les fois que j'indiquerai cette classe, on saura qu'on peut aussi puiser dans la dernière ; il faut seulement ne pas la mettre seule à contribution, et ne rien choisir dans la première. Indépendamment de ces précautions, il faut entretenir constamment la liberté du ventre, éloigner du malade toute cause d'épouvante, et mieux encore lui redonner bon espoir. On tâchera de le distraire par les contes et les jeux qui lui plaisaient le plus en état de santé. Ses ouvrages, s'il en a fait, seront vantés avec complaisance, et lui seront remis sous les yeux. On combattra ses tristes imaginations par de douces remontrances, en lui faisant sentir que dans les choses qui le tourmentent il devrait trouver plutôt un sujet de contentement que d'inquiétude. Si la fièvre survient, on la traitera comme les autres fièvres. La démence la plus longue est celle de la troisième espèce. Celle-ci ne compromet pas la vie, et n'attaque d'ordinaire que les individus fortement constitués. Elle se présente sous deux formes distinctes ; les uns, sans être aliénés, sont déçus par de trompeuses images : telle était, d'après les poètes, la folie d'Ajax ou d'Oreste : d'autres au contraire sont pris d'aberration mentale. Quand le malade voit des fantômes, il faut s'assurer d'abord si ces illusions excitent la tristesse ou la gaieté. En cas de mélancolie, on purge avec l’ellébore noir, et s'il y a de l'hilarité, on provoque des vomissements avec l'ellébore blanc; on les administre l'un et l'autre dans du pain, pour abuser plus facilement le malade, lorsqu'il refuse de les prendre en potion. Si ces purgatifs agissent bien, le mal en sera notablement diminué; aussi doit-on, dans le cas où une première dose produirait peu d'effet, en donner une seconde quelque temps après. On n'oubliera pas que la folie gaie est moins grave que la folie triste. Il est de précepte invariable dans toutes les maladies de tenir d'abord le ventre libre lorsqu'on veut purger par en bas, et de le resserrer, au contraire, si l'on veut purger par en haut Si le malade a perdu le jugement, on a recours avec succès à certaines corrections. Dés que ses actes ou ses paroles attestent sa déraison, il faut pour le dompter employer le jeune, les chaînes et les châtiments; le forcer ensuite d'être attentif, d'exercer sa mémoire sur certains sujets et de se les rappeler. La crainte l'oblige ainsi par degrés à se rendre compte de ses actions. On se trouve bien encore d'exciter chez ces malades des terreurs soudaines, ou d'imprimer par un moyen quelconque une secousse profonde à leur intelligence. Cet ébranlement en effet peut être utile en les arrachant à leur situation première. Il n'importe pas moins d'observer si de temps à autre on les surprend à rire sans motifs, ou s'ils sont dominés par la tristesse et le découragement ; contre leur folie hilarité, il est mieux de faire agir la crainte, comme je lai dit plus haut ; et quand l'humeur devient trop sombre, il est bon d'employer deux fois par jour des frictions légères, mais longtemps prolongées : on doit faire aussi des affusions froides sur la tête, et prescrire des bains d'eau et d’huile. Voici les moyens généraux: les personnes affectées de démence fieront beaucoup d'exercice, et seront frictionnées souvent; elles ne prendront ni viande grasse, ni vin; seulement, après avoir été purgées, elles choisiront les aliments les plus légers de la classe moyenne. Il ne convient pas de les laisser seules ou avec des inconnus, non plus qu'avec les gens qu'elles dédaignent ou qui leur sont indifférents. Elles devront changer de pays, et, si la raison leur revient, voyager tous les ans. Rarement, mais quelquefois cependant, la crainte donne naissance au délire. Celui-ci n'est pas d'une autre espèce que les précédents, et n'exige pas un traitement distinct; a cette exception près, que c'est la seule démence où il soit utile de donner du vin. XIX. La maladie que les Grecs ont nommée cardiaque,[5] est essentiellement opposée à la frénésie, bien qu'elle succède souvent à cette affection : dans un cas le malade n'a plus l'usage de sa raison, et dans l'autre il la conserve. Le mal cardiaque est caractérisé par une extrême faiblesse, accompagnée de langueurs d'estomac et de sueurs immodérées. On le reconnaît aussitôt à la misère du pouls, à sa petitesse, ainsi qu'à des sueurs insolites dans leur forme et leur durée, qui envahissent en entier la poitrine, le cou, la tête même, tandis que les jambes et les pieds demeurent secs et froids. Ce mal est de la classe des affections aiguës. On commence par appliquer un cataplasme répercussif sur la région de l'estomac, et l'on tâche en second lieu d'arrêter la sœur. On a, pour remplir cette indication, l'huile astringente de roses et celle de coing ou de myrte : elles servent à faire des onctions légères sur le corps, et on les remplace ensuite par du cérat où l'on fait entrer un de ces ingrédients. Si la sueur ne cesse point, on frotte doucement le malade avec du plâtre, de la litharge d'argent ou de la terre cimolée, ou bien l'on répand sur lui l'une de ces substances à l'état pulvérulent! Les feuilles sèches de myrte ou de ronce réduites en poudre, ou la lie d'un bon vin astringent desséchée et bien triturée, peuvent rendre le même service, ainsi que beaucoup d'autres substances semblables : à leur défaut d'ailleurs on a la poussière des chemins. Pour diminuer la transpiration, il faut peu couvrir le malade, le tenir dans un endroit frais, et laisser les fenêtres ouvertes, afin que l'air extérieur puisse arriver jusqu'à lui. La troisième indication qui se présente est de réparer l'épuisement des forces par le vin et l'alimentation. On ne doit pas sans doute donner beaucoup de nourriture à la fois, mais en donner à plusieurs reprises le jour et la nuit, dans le but de soutenir le malade, sans le surcharger. Ces aliments seront fournis par la dernière classe, et appropriés à l'état de l'estomac. Hors le cas d'urgence, on ne se pressera pas d'accorder du vin. Si l'on craint une défaillance, on peut permettre du pain trempé dans du vin astringent, et même laisser boire ce vin, pourvu qu'il soit léger, pas tout à fait pur et tiède ; on le prescrit alors libéralement de temps à autre, en ajoutant, si le malade ne prend pas assez de nourriture, de la farine de froment séchée au feu; le vin ne doit être ni trop fort, ni trop faible ; et la mesure convenable pour le jour et la nuit sera de trois hémines, ou plus encore si le sujet est d'une taille élevée. Quand les aliments sont refuses par le malade, on a recours aux onctions, que l'on fait suivre d'affusions froides, et l'on essaya encore de le nourrir. Mais si l'estomac frappé d'inertie peut a peine garder les substances alimentaires, on excite le vomissement avant et après leur ingestion, et l'on fait manger une seconde fois le malade lorsqu'il a vomi. Si l'on n'obtient pas encore la tolérance de l'estomac, il faut que le malade prenne un verre de vin d'abord, et une heure après un second. Dans le cas où ce liquide serait également rejeté, il conviendrait d'enduire tout le corps d'oignons piles, lesquels une fois secs auraient pour effet d'arrêter le vomissement, et de permettre dès lors au vin de rendre au corps sa chaleur, et aux vaisseaux toute leur énergie. Comme dernière ressource, on fera prendre un lavement de crème d'orge ou de fromentée ; car on peut aussi par ce moyen soutenir les forces. Il n'est pas inutile non plus de faire respirer au malade quelque chose de fortifiant, de l'huile rosat par exemple, ou du vin ; et enfin, si les extrémités sont froides, il est bon de les frotter avec les mains, en prenant la précaution de les chauffer et de les graisser. Si par tous ces soins on réussit à modérer le mouvement sudoral et à prolonger les jours du malade, il a déjà pour lui le bénéfice du temps. Lorsque le sujet ne parait plus en péril, on peut craindre cependant qu'il ne soit repris des mêmes faiblesses ; aussi, tout en supprimant l'usage du vin, doit-on lui donner chaque jour une nourriture plus substantielle, jusqu'à ce que les forces soient suffisamment revenues. XX. Il existe encore une maladie qui, sous d'autres rapports, n'est pas moins opposée à la frénésie. Dans celle-ci, en effet, le sommeil est très rare, et l'esprit est toujours prêt aux actions d'audace ; dans l'autre, au contraire, on observe de l'engourdissement, et un penchant presque insurmontable au sommeil. Les Grecs ont appelé cet état léthargie.[6] C'est également une affection aiguë, et si l'on n'y porte remède, elle devient promptement mortelle. Certains praticiens essayent de réveiller ces malades au moyen de substances qui provoquent l'éternuement, ou qui peuvent les stimuler par leur odeur fétide. Tels sont : la poix crue, la laine grasse, le poivre, l'ellébore, le castoréum, le vinaigre, l'ail, l'oignon; on brûle encore près d'eux du galbanum, des poils, de la corne de cerf, ou, faute de mieux, toute autre drogue semblable, dont la combustion développe une mauvaise odeur. Un nommé Tharrias a prétendu que la léthargie dépendait d'un accès de fièvre, et finissait avec lui ; d'où il concluait que c'est mal à propos qu'on cherche à secouer les malades. Mais il importe d'examiner si le léthargique s'éveille à la fin de l'accès, ou s'il reste endormi pendant le cours de la fièvre, et lorsqu'elle a cessé. S'il sort en effet de son .assoupissement, il est inutile d'employer des remèdes propres à l'en tirer ; car ce n'est pas parce qu'il est éveillé qu'il va mieux, mais c'est parce qu'il va mieux qu'il s'éveille de lui-même. Si au contraire l'état soporeux se prolonge, il faut chercher à le troubler, en choisissant pour cela les heures où la fièvre offre le plus d'amendement, afin que le ventre fasse ses fonctions et qu'on puisse alimenter le malade. C'est par des affligions froides et subites qu'on produit l'excitation la plus forte : en conséquence, dans le temps de la rémission, le corps du malade est oint avec beaucoup d'huile, et mouillé tout entier avec trois ou quatre amphores d'eau froide qu'on lui verse sur la tête. Mais on n'aura recours à ce moyen que si la respiration est égale, et si les hypocondres présentent de la souplesse; autrement, il faudrait user, de préférence, des remèdes Indiqués plus haut. Cette méthode est sans doute la plus convenable pour combattre l'assoupissement; mais pour guérir la maladie elle-même, on doit raser la tête, et la fomenter avec de l'oxycrat dans lequel on aura fait bouillir du laurier ou de la rue; le lendemain, on y appliquera du castoréum, ou de la rue pilée dans du vinaigre, des baies de laurier, ou du lierre pilé dans de l'huile rosat et du vinaigre. La moutarde placée sous les narines est un excellent moyen pour dissiper le sommeil, ou, mise en contact avec la tête et le front, peut même guérir la léthargie. La gestation est encore utile en pareil cas; mais ce qui constitue le meilleur remède, c'est la nourriture donnée à propos, par conséquent au moment de la plus grande rémission. La crème d'orge est presque le seul aliment convenable, jusqu'à ce que la maladie commence à décliner; aussi faut-il en donner chaque jour, s'il y a chaque jour un accès violent ; s'il ne revient que de deux jours l'un, on donne la crème d'orge après l'accès le plus grave, et de l'eau miellée après le plus léger. Le vin, mêlé aux aliments que l'on doit prendre en temps opportun, n'est pas non plus d'un secours indifférent. Quand la léthargie succède à des fièvres de longue durée, cela ne change rien A la médication : trois ou quatre heures avant l'accès, on administre le castoréum avec la scammonée si le ventre est resserré ; et s'il ne l'est pas, on donne seulement le castoréum dans de l'eau. On accorde une nourriture plus substantielle lorsque les hypocondres sont souples; s'ils sont durs, il faut s'en tenir à l'usage de la crème d'orge, et appliquer sur cette région des médicaments qui agissent à la fois comme résolutifs et comme émollients. XXI. La léthargie, disons-nous, est une affection aiguë ; celle au contraire que les Grecs appellent hydropisie, devient facilement chronique lorsqu'elle est caractérisée par un épancheraient d'eau sous les téguments, à moins qu'on ne parvienne à la dissiper dès les premiers jours. On reconnaît trois espèces d'hydropisie : tantôt il y a forte tension du ventre, accompagnée d'une résonance fréquente, due au déplacement de l'air qu'il renferme; tantôt la surface du corps présente des inégalités qui tiennent au développement d'un certain nombre de tumeurs ; tantôt, l'abdomen est le siège d'un épanchement, et les secousses communiquées au corps rendent sensible la fluctuation du liquide. La première espèce a reçu des Grecs le nom de tympanite, la seconde celui de leucophlegmatie ou hyposarque, et la troisième celui d’ascite. Elles ont pour cause commune une trop grande abondance des humeurs : de là vient que, chez les malades qui en sont atteinte, les ulcères guérissent difficilement. Souvent cette maladie se déclare spontanément, souvent aussi elle survient à la suite d'une affection ancienne, et principalement de la fièvre quarte. Elle est plus facile à guérir chez les esclaves que chez les hommes libres. Comme, en effet, elle exige qu'on supporte la faim, la soif, mille autres sujétions fâcheuses, et qu'il faut s'armer d'une longue patience, ceux auxquels on peut imposer tout le traitement arrivent plus vite à la guérison que ceux qui jouissent d'une liberté nuisible. Mais les sujets même placés sous la domination d'un maître ne sont pas délivrés de leur maladie, s'ils sont absolument incapables de s'astreindre à toutes ces rigueurs. En voici la preuve : un médecin distingué, disciple de Chrysippe, se trouvant à la cour d'Antigone, soutint qu'un favori du roi, légèrement attaqué de cette maladie, mais bien connu par son intempérance, ne reviendrait pas à la santé : et comme un autre médecin d'Épire, nommé Philippe, promettait la guérison, il répondit que son confrère ne considérait que la maladie, et que lui tenait compte des habitudes du malade. L'événement justifia le pronostic; car, malgré la surveillance la plus sévère exercée par le médecin et le roi lui-même, il parvint, en avalant ses cataplasmes et en buvant son urine, à devenir ainsi l'artisan de sa perte. En général cependant, on réussit assez bien au début de la maladie en prescrivant le repos et l'abstinence complète d'aliments et de boissons; mais si le maλ a pris racine, il ne cède plus qu'à de très grands efforts. On rapporte que Métrodore, disciple d'Épicure, affligé d'hydropisie, et n'ayant pas la force de supporter la soif ainsi qu'il le fallait, avait pris l'habitude de boire après une longue privation, et de rejeter ensuite le liquide en se faisant vomir. Si l'estomac restitue tout ce qu'il a reçu, on apaise sans doute par ce moyen bien des sensations pénibles ; mais s'il ne rend rien, la maladie s'aggrave : cette méthode n'est donc pas applicable dans tous les cas. Si la fièvre accompagne l'hydropisie, il faut lui opposer d'abord le traitement dont on a fait connaître l'efficacité contre l'état fébrile; mais si le malade en est exempt, on se sert alors de remèdes propres à guérir la maladie spéciale. De quelque espèce que soit l'hydropisie, elle réclame les mêmes secours tant qu'elle n'a pas fait de trop grands progrès. Il faut marcher beaucoup, courir quelquefois, faire des frictions, notamment sur les parties supérieures, et pendant ce temps retenir son haleine; non seulement exciter la sueur par l'exercice, mais employer encore les bains de sable chand, les poêles, les fours et autres moyens semblables. Les plus utiles sont les étuves sèches et naturelles, comme celles que nous avons au-dessus de Baies, dans un endroit planté de myrtes. Les autres bains seraient contraires, de même que tout ce qui est humide. Il convient de faire prendre à jeun des pilules composées de deux parties d'absinthe et d'une partie de myrrhe. Les aliments doivent être tirés de la classe moyenne, en choisissant toutefois les plus fermes. Quant aux boissons, il n'en faut pas donner au delà de ce qui est nécessaire à l'entretien de la vie; et l'on doit préférer celle qui pousse aux urines. Encore vaut-il mieux obtenir cette évacuation par le fait de l'alimentation que par le secours des médicaments. Si cependant le cas l'exige, on pourra prescrire une décoction de quelque substance douée de propriétés diurétiques. Cette vertu parait exister dans l'iris, le nard, le safran, la cannelle, l'amome, le cassia, la myrrhe, le baume, le galbanum, le ladanum, la lambrusque, le panax, le cardamome, l'ébène, les semences de cyprès, les raisins de bois que les Grecs nomment staphisaigre, l'aurone, les feuilles de roses, l’acore, les amandes amères, l'origan, le styrax, le costus, enfin les semences du jonc carré et de celui qui est rond. Les Grecs appellent l'un κύπειρος; et l'autre σχοῖνος : toutes les fois qu'il en sera question, j'entendrai parler, non de ceux qui viennent ici, mais de ceux qu'on nous apporte avec les aromates. On commence par employer les plus doux de ces remèdes, les feuilles de rose par exemple, ou l'épi de nard. Le vin astringent, mais très léger, produit aussi de bons effets. Il n'est pas inutile de mesurer chaque jour le ventre avec un fil, et d'en déterminer la grosseur, afin de juger le lendemain s'il y a augmentation ou diminution du volume, car ce dernier changement attesterait les bons effets de la médication. On doit également tenir compte de la quantité des boissons et de celle des urines, attendu que si le malade rend plus d'eau qu'il n'en a bue, il y a lien d'espérer que la maladie se terminera favorablement. Asclépiade a laissé l'observation d'un homme qui, étant devenu hydropique à la suite d'une fièvre quarte, fut par lut mis à la diète et aux frictions pendant deux jours; le troisième, il n'avait déjà plus ni fièvre ni épanchement, et l'on put lui donner du vin et des aliments. Jusqu'ici le traitement est le même pour toute espèce d'hydropisie; mais à un degré plus élevé le mal exige des moyens spéciaux. Ainsi lorsque la tympanite existe et qu'il en résulte des douleurs fréquentes, il est bon de faire vomir tous les jours ou tous les deux jours après le repas, et de recourir à des fomentations chaudes et sèches. Si la douleur ne cède pas, on applique des ventouses non scarifiées, et si elle résiste encore, on pratique des scarifications, suivies d'une nouvelle application de ventouses. La dernière ressource à tenter quand ce moyen n'a rien produit, consiste à faire prendre en lavement une grande quantité d'eau chaude, que le malade doit rendre immédiatement. De plus, on pratiquera trois ou quatre fois par jour de fortes frictions sur le corps avec de l'huile et des drogues échauffantes ; mais au lieu de frictionner le ventre, on le recouvre de sinapismes qu'on renouvelle souvent, jusqu'à produire l'érosion de la peau. On cautérise plusieurs points de l'abdomen avec le fer rouge, et on laisse suppurer longuement les plaies qui en résultent. Le malade se trouvera bien aussi de sucer de la scille cuite ; mais longtemps encore après la disparition de la tympanite il devra s'abstenir de tout ce qui peut produire des flatuosités. Si l'on a affaire à la maladie qu'on nomme leucophlegmatie, il faut exposer au soleil les parties enflées, et ne pas les y laisser trop longtemps, de peur d'allumer la fièvre. Si le soleil est trop fort, on aura soin de couvrir la tête. On doit faire aussi des frictions avec les mains, en les trempant seulement dans de l'eau chargée de sel, de nitre et d'un peu d'huile; mais ce soin ne sera confié qu'aux femmes ou aux enfants, pour que le frottement soit plus doux. Ces frictions, si les forces le permettent, devront durer fine heure entière avant midi, et, passé ce temps, une demi-heure seulement. Les cataplasmes astringents sont avantageux, surtout quand tes sujets sont délicats. On doit en outre pratiquer au bas de la jambe, du coté interne, une incision d'environ quatre doigts, pour faciliter pendant plusieurs jours l'écoulement du liquide; il faut de même inciser profondément les parties tuméfiées ; ensuite on agite fortement le malade au moyen de la gestation; et quand les plaies commencent à se cicatriser, on augmente l'exercice et l'alimentation jusqu'à ce que le corps soit revenu à son premier état. Les aliments doivent être fortifiants et glutineux, principalement la viande ; le vin, si l'estomac le supporte, sera plus doux qu'à l'ordinaire, mais le malade s'arrangera pour boire alternativement pendant deux ou trois jours du vin et de l'eau. La boisson faite avec la semence de la laitue marine, qui sur les bords de la mer arrive à une grande hauteur, est également utile. Si le malade est robuste, on peut lui faire sucer de la scille cuite, comme je l'ai dit plus haut. Les auteurs recommandent pour la plupart de frapper les tumeurs aqueuses avec des vessies remplies d'air. S'il s'agit de la maladie caractérisée par un épanchement d'eau dans le ventre, la promenade est avantageuse, mais elle doit être plus modérée. Il faut appliquer des cataplasmes résolutifs sur l'abdomen, et les recouvrir d'une étoffe pliée en trois et assujettie par une bande, qu'on évitera de trop serrer. C’est un conseil donné par Tharrias, et que je vois généralement suivi. S'il y a des signes évidents d'une affection du foie ou de la rate, on fera sur l'organe malade une application de figues grasses, après les avoir écrasées et mêlées au miel. Si, nonobstant ces remèdes, l'épanchement ne se résout pas et que la quantité de liquide augmente, on prend la voie la plus prompte, en lui ouvrant une issue par le ventre même. Je sais qu'Érasistrate a désapprouvé cette opération : dans sa pensée, l'ascite reconnaissant pour cause une maladie du foie, c'est là d'abord ce qu'il faut traiter; et l'évacuation des eaux ne conduit à rien, puisqu'elles se reproduisent plus tard sous l'influence de la lésion qu'il indique. Mais, en premier lieu, le foie n'est pas le seul viscère dont l'altération puisse donner naissance à l'hydropisie, car elle dépend aussi d'une affection de la rate et de l'état cachectique du corps. Ensuite, quelle qu'en soit l'origine, il n'en faut pas moins évacuer le liquide qui se trouve là contre nature, parce qu'il exerce une action nuisible sur le foie et les autres parties internes. Cela fait, il importe sans doute de soigner la maladie réelle, car on n'obtient pas la guérison par l'écoulement des eaux, mais on laisse le champ libre aux moyens curatifs que la présence du liquide empêchait d'agir. On doit reconnaître aussi sans contestation que tous les malades affectés d'ascite ne guérissent pas après l'opération : elle ne réussit bien que chez les sujets jeunes et robustes, entièrement exempts de fièvre, ou jouissant au moins de longs intervalles d'apyrexie. Ceux au contraire dont l'estomac est vicié, que l'atrabile a conduits à l'hydropisie, ou qui sont dans un état cachectique, présentent de mauvaises conditions pour le succès de cette méthode. Le jour même où l'on donne issue à la collection aqueuse, il n'y a pas lieu de nourrir le malade, à moins qu'il n'y ait affaissement des forces; les jours suivants, on peut accorder des aliments et donner le vin plus pur, mais dans une juste mesure. Le malade ensuite arrivera par degrés à supporter l'exercice, les frictions, la chaleur du soleil, les sueurs abondantes, et les promenades sur l'eau : quant aux aliments, il faut les choisir avec discernement, jusqu'à ce que la guérison soit complète. Cette maladie s'accommode rarement des bains ; on doit provoquer plus fréquemment le vomissement à jeun ; enfin pendant l'été il est utile pour le malade de se livrer à la natation dans l'eau de mer. Les personnes atteintes d'hydropisie doivent, longtemps encore après leur rétablissement, éloigner d'elles les plaisirs de Vénus. XXII. Ceux qui sont attaqués par la consomption ont souvent une maladie plus longue et plus dangereuse que la précédente. On en distingue aussi plusieurs espèces. Dans l'une, le corps ne prend pas de nourriture, et les pertes continuelles qui ont lieu naturellement n'étant pas réparées, il en résulte un marasme extrême, auquel le malade succombe s'il n'est point secouru. Cette espèce a reçu des Grecs le nom d'atrophie, et se rattache ordinairement à deux causes : en effet, ou le malade, dominé par une crainte exagérée, se refuse les aliments nécessaires, ou bien, cédant à son intempérance, il en prend immodérément; de sorte que s'il ne mange pas assez, il s'affaiblit, et s'il mange trop, la corruption s'empare des matériaux pris en excès. La seconde espèce est celle que les Grecs appellent cachexie; elle consiste dans une mauvaise habitude du corps, d'après laquelle tous les aliments se corrompent. Cela s'observe presque toujours lorsque l'état général du corps, vicié par une affection de longue durée, ne se prête plus à la nutrition, bien que le mal ait disparu : cette disposition se rencontre encore quand on a subi l'action de médicaments pernicieux, qu'on a longtemps manqué du nécessaire, qu'on a fait usage d'aliments inusités et nuisibles, ou qu'il s'est présenté quelque circonstance semblable. Indépendamment de la consomption, la cachexie s'accompagne de pustules ou d'ulcères qui occupent la peau ; ou bien il y a tuméfaction de certaines parties du corps. La troisième espèce, et sans contredit la plus grave, est connue des Grecs sous le nom de phtisie. Elle commence le plus souvent par la tête, d'où elle se porte sur les poumons et y produit des ulcérations : de là naît une fièvre légère, qui cesse et reparaît ensuite. La toux est fréquente, les crachats sont purulents et quelquefois sanglants; et si l'on jette sur le feu le produit de l'expectoration, il s'en dégage une mauvaise odeur : c'est un caractère auquel on a recours quand on a des doutes sur l'existence de la maladie. Puisqu'il y a trois sortes de consomptions, il faut d'abord examiner de quelle nature est celle dont le malade est attaqué. S'il y a seulement défaut de nutrition, on doit en rechercher la cause; et si l'on voit que le malade n'a pris qu'une nourriture insuffisante, il faut y ajouter, mais graduellement, dans la crainte de provoquer une indigestion, en surchargeant tout à coup l'estomac par une masse d'aliments à laquelle il n'est pas préparé. Si le malade au contraire a pour habitude de manger au delà de ses besoins, il faut le mettre à la diète pendant un jour, le lendemain le nourrir très légèrement, et augmenter chaque jour son régime, jusqu'à ce qu'on ail atteint la mesure convenable. On doit lui conseiller en outre de se promener dans des lieux où règne une douce température, d'éviter le soleil, et de se livrer à des exercices manuels : s'il est trop faible, il aura recours à la gestation, aux onctions et aux frictions; autant que possible il fera les frictions lui-même, et y reviendra souvent dans la journée, avant et après avoir mangé : il mêlera à l'huile quelques drogues qui raniment la chaleur, et se frottera jusqu'à ce qu'il entre en transpiration. Il fera bien encore, étant à jeun, de se prendre la peau en plusieurs endroits, et d'exercer des tractions sur elle, pour qu'elle se relâche ; dans le même but, on peut appliquer sur la peau des emplâtres résineux, et les arracher ensuite. Le bain est quelquefois utile, mais après un repas léger ; et dans le bain même il convient de donner quelque nourriture. Si l'on n'a rien pris avant de se frictionner, il faut manger aussitôt après. On choisira les aliments parmi ceux qui sont de facile digestion et très nourrissants. Il suit de là que l'usage d'un vin astringent est également nécessaire. Il faut solliciter le cours des urines. S'il y a cachexie, on commencera par la dicte ; ensuite on prescrira des lavements ; et l’on reprendra peu à peu l'alimentation, en joignant à cela l'exercice, les onctions et les frictions. Les bains pris fréquemment, mais à jeun, sont plus utiles dans les cas de ce genre, et l'on doit y rester jusqu'à ce que la sueur se prononce. Il faut donner au malade une nourriture abondante et variée, en y faisant entrer les aliments de bon suc, ceux qui résistent le mieux à la corruption, et le vin astringent. Quand les remèdes indiqués ne produisent pas d'effet, on doit tirer du sang plusieurs jours de suite, mais en petite quantité, et sans cesser d'employer les autres moyens de traitement. Si le mal est plus grave et qu'il y ait phtisie véritable, il est nécessaire d'y porter remède dès le principe ; car il n'est pas facile de détruire cette affection lorsqu'elle a jeté de profondes racines. Quand le malade en a la force, il doit entreprendre de longues navigations et changer de climat, pour trouver un air plus épais que celui du pays dont il s'éloigne. On fait très bien, par exemple, de quitter l'Italie pour Alexandrie. En général, on supporte facilement le voyage au début de cette maladie, d'autant mieux qu'elle se déclare à l'époque de la vie où l'homme a le plus de vigueur, c'est-à-dire de dix-huit à trente-cinq ans. Mais lorsque la faiblesse du sujet s'oppose à ces courses lointaines, il devient très convenable alors d'essayer de courtes promenades en mer; et si quelque raison les interdit également, on doit se faire porter en litière, ou chercher d'autres moyens de mettre le corps en mouvement Dans cette position il faut renoncer aux affaires, éloigner de soi toute cause d'inquiétude, et s'abandonner au sommeil ; de plus, se tenir en garde contre les rhumes, qui pourraient détruire l'amélioration due aux soins qu'on a pris ; éviter par le même motif les indigestions, l'ardeur du soleil et l'action du froid; avoir la bouche couverte et le cou bien enveloppé, guérir la toux par les moyens qu'elle comporte, et combattre la fièvre chaque fois qu'elle reparaît, tantôt par la diète et tantôt par la nourriture donnée à propos; pendant ce temps, on doit boire de l'eau. Le lait, qu'on peut considérer comme un poison dans les douleurs de tête, dans les fièvres aiguës, dans la soif ardente qu'elles excitent, et qui n'est pas moins nuisible, soit qu'il y ait gonflement des hypocondres, urines bilieuses ou flux de sang, le lait, disons-nous, convient dans la phtisie, de même que dans toutes les fièvres longues et difficiles à guérir. Si le malade n'a pas encore eu de fièvre, ou si elle a disparu, il faut recourir à des exercices modérés, à la promenade surtout, et aux frictions légères. Le bain est contraire. Il faut donner d'abord des aliments acres, comme l'ail et le poireau assaisonnés avec du vinaigre, ou comme la chicorée, le basilic et la laitue, qu'on prépare de même; on passe ensuite à une nourriture adoucissante qui se compose de crèmes faites avec l'orge mondé, la fromentée ou l'amidon, auxquels on ajoute du lait. Ces substances peuvent être remplacées par le riz ou toute autre céréale. On fait usage alternativement de ces deux sortes d'aliments, et l'on en prend quelques-uns dans la classe moyenne. La première peut fournir entre autres des cervelles, de petits poissons, et d'autres substances alimentaires semblables. On emploie comme médicament la farine mêlée à la graisse de brebis ou de chèvre, et soumise à la cuisson. Le vin dont on fait usage doit être astringent et léger. Jusque-là, la maladie peut être combattue sans de trop grands efforts; mats si les symptômes s'aggravent, que la fièvre et la toux persévèrent sans relâche et que le dépérissement survienne, il est nécessaire d'en appeler à des moyens plus puissants. A l'aide du fer rouge, on fait alors une cautérisation sous le menton, une autre à la gorge, deux vers les mamelles, deux encore au-dessous des os que les Grecs nomment omoplates; et l'on entretient les plaies qui en résultent, jusqu'à ce que la toux ait cessé. Cette toux réclame aussi un traitement spécial. Alors il faut trois ou quatre fois par jour pratiquer de fortes frictions sur les extrémités, mais les faire d'une main légère sur la poitrine, et une heure après le repas frotter de nouveau les bras et les jambes; au bout de dix jours on fait prendre au malade un bain d'eau chaude et d'huile; pendant ce temps il ne doit boire que de l'eau, qu'on remplace enfin par du vin, en le donnant froid s'il n'y a plus de toux, et tiède s'il en existe encore. Il convient aussi d'accorder chaque jour des aliments pendant la rémission de la fièvre, et de s'aider des frictions et de la gestation ; tous les quatre ou cinq jours on revient aux aliments âcres, et de temps en temps on fait usage de renouée ou de plantain, trempés dans du vinaigre. Au nombre des remèdes on trouve encore le suc de plantain, qu'on donne seul, ou celui de marrube cuit avec du miel ; on présente un verre du premier, et du second, une cuillerée, qu'on avale peu à peu : on mêle aussi et l'on fait cuire ensemble une demi-partie de résine de térébenthine, et une partie de beurre et de miel. Mais en tête des moyens curatifs il faut placer le régime, l'exercice en voiture, la navigation, et les crèmes farineuses. Il faut surtout éviter la trop grande liberté du ventre. C’est un signe fâcheux dans cette maladie que de vomir souvent, et il devient beaucoup plus grave si l'on vomit du sang. Quand le malade commence à se trouver un peu mieux, il doit insister davantage sur l'exercice et les frictions, et augmenter sa nourriture; ensuite se frotter lui-même en retenant son haleine, et renoncer pendant longtemps à l'usage du bain, du vin, et aux plaisirs de Vénus. XXIII. Une maladie des plus connues est celle qu'on appelle le mal des comices, ou le haut mal. Celui qui en est atteint tombe subitement, rend de l'écume par la bouche, puis, au bout d'un certain temps, revient à lui et se relève de lui-même. Les hommes sont plus sujets que les femmes à cette affection. Elle est en général de longue durée, et sans abréger la vie se prolonge jusqu'à la mort; néanmoins, lorsqu'elle est récente elle peut tuer le malade. Souvent aussi quand les remèdes ont échoué, les garçons doivent leur guérison aux premières jouissances de l'amour, et les filles à l'apparition des menstrues. La chute du malade peut avoir lieu avec ou sans convulsions. On voit des gens employer, pour faire revenir les épileptiques, les moyens qu'ils croient propres à réveiller les léthargiques, et ce sont là de vaines tentatives. Dans la léthargie d'abord, ces moyens ne sont nullement curatifs ; mais on peut craindre que le malade ne périsse d'inanition s'il ne sort pas de son assoupissement, tandis qu'on est certain que l'épileptique reprendra ses sens. Lorsqu'une attaque survient, s'il n'y a pas de mouvements convulsifs, il faut toujours tirer du sang; dans le cas contraire on s'en abstiendra, à moins qu'on n'y soit conduit par d'autres indications. Mais il est nécessaire de faire prendre un lavement, de purger avec l'ellébore noir, ou même d'ordonner l'un et l'autre, si les forces le permettent : on doit ensuite raser la tête pour y faire des fomentations d'huile et de vinaigre, et n'accorder d'aliments que le troisième jour, et quand l'heure de l'attaque est passée. On ne doit composer l'alimentation ni de crèmes farineuses, ni des autres aliments doux et légers, non plus que de la chair des animaux, et surtout de celle de porc, mais tirer les substances nutritives de la classe moyenne ; car d'une part il faut soutenir les forces, et de l'autre se tenir en garde contre les indigestions. Les épileptiques doivent fuir le soleil, les bains, le feu, et tout ce qui peut donner de la chaleur ; ils fuiront également le froid, le vin, les plaisirs de l'amour, éviteront l'aspect des précipices et de tous les objets effrayants, ne chercheront pas à vomir, et s'interdiront la fatigue, les soucis, et le soin des affaires. Après avoir laissé manger le malade le troisième jour, il faut revenir à la diète le quatrième, et ne permettre ensuite d'alimentation que de deux jours l'un, jusqu'au quatorzième jour inclusivement. Passé ce terme, le mal a perdu son acuité, et doit être traité, s'il persiste, comme une affection chronique. Si le médecin n'a pas été appelé le jour où le malade est tombé pour la première fois, et si déjà les chutes sont devenues habituelles, il commencera par prescrire le régime indiqué plus haut, attendra le jour de l'attaque, et aura recours alors, soit à la saignée, soit aux lavements ou à l'ellébore noir, selon le précepte qui vient d'être établi. Les jours suivants on nourrira le malade avec les aliments que j'ai proposés, et l'on aura soin d'éviter tout ce que j'ai signalé comme contraire. Si la maladie ne cède pas à ces moyens, il faut en venir à l'ellébore blanc, le prescrire trois ou quatre fois, à peu de jours de distance, mais de telle façon que le malade n'en prenne jamais deux fois de suite, à moins d'une attaque inaccoutumée. Pendant les jours intermédiaires on entretiendra les forces du malade, et l'on ajoutera quelques moyens à ceux que j'ai fait connaître. Dès le matin à son réveil, il fout avec de l'huile vieille lui frotter bien doucement le corps, à l'exception de la tête et du ventre ; l'obliger ensuite à se promener aussi loin que possible, et en ligne droite; au retour de la promenade, le tenir dans un endroit où la chaleur soit tiède, et s'il n'est pas trop faible le frictionner fortement et longtemps, c'est-à-dire deux cents fois au moins. Cela fait, il faut lui verser sur la tête une grande quantité d'eau froide, lui faire prendre un peu de nourriture et le laisser reposer; avant la nuit, nouvelle promenade suivie des mêmes frictions, à la réserve toujours de la tête et du ventre ; puis vient le repas du soir ; enfin, au bout de trois ou quatre jours, on lui donnera pendant un jour ou deux des aliments acres. Si par ce traitement on n'obtient pas encore la guérison du malade, on doit lui raser la tête, y faire des onctions avec de l'huile vieille, du vinaigre et du nitre, et l'arroser d'eau salée ; ensuite lui faire boire à jeun du castoréum dissous dans de l'eau, et pour boisson ordinaire n'accorder que de l'eau qu'on ait fait bouillir. Quelques épileptiques se sont délivrés de cette affreuse maladie en buvant le sang d'un gladiateur récemment égorgé; déplorable secours que pouvait seul faire supporter un mal plus déplorable encore.[7] Quant au médecin, il devra, comme dernières tentatives, pratiquer une légère saignée aux deux pieds, faire des incisions à l'occiput et les recouvrir de ventouses; au-dessous de cette région appliquer le fer rouge au point d'articulation de la première vertèbre avec la tête, et, au moyen de deux cautérisations, donner issue aux humeurs nuisibles. Quand tous ces remèdes n'ont pu faire justice de la maladie, il y a tout lieu de penser qu'elle sera désormais incurable ; et, dans le but de soulager le malade, on lui conseillera seulement de faire beaucoup d'exercice, de revenir souvent aux frictions, de se borner à l'usage des aliments que j'ai prescrits plus haut, et d'éviter surtout les choses dont j'ai signalé le danger. XXIV. La maladie qu'on nomme quelquefois jaunisse, et d'autres fois royale, est également connue. Hippocrate ne la regarde point comme dangereuse si elle survient le septième jour de la fièvre, pourvu toutefois que les hypocondres restent souples. Dioclès va jusqu'à dire qu'elle est salutaire lorsqu'elle se déclare après la fièvre; mais que le malade succombe, si la fièvre parait après la jaunisse. Cette maladie se reconnaît à la couleur de la peau, à celle des yeux surtout, dont le blanc devient jaune. Elle s'accompagne ordinairement de soif, de douleur de tête, de hoquets fréquents, de dureté dans l'hypocondre droit, et, dès que le corps est agité fortement, de difficulté de respirer et de résolution des membres: enfin, quand la maladie s'est prolongée quelque temps, tout le corps devient d'un jaune pâle. Le premier jour le malade doit observer la diète, et le lendemain prendre un lavement. S'il y a fièvre, il faut la combattre par un régime convenable; s'il n'y a pas d'état fébrile, administrer la scammonée en lavage, ou du suc de poirée blanche étendu d'eau, ou des amandes amères, de l'absinthe, et une très petite quantité d'anis en infusion miellée. Asclépiade prescrivait aussi l'eau salée, qu'il donnait deux jours de suite comme purgatif, et rejetait les diurétiques. Quelques médecins au contraire les préfèrent aux remèdes précédents, et avec le secours d'aliments atténuants prétendent arriver au même but. Pour moi, je donne la préférence aux médicaments énergiques, quand le malade a de la vigueur; mais s'il a peu de force, il faut, je crois, en employer de moins actifs. S'il a été purgé, il ne doit prendre les trois premiers jours qu'un peu de nourriture tirée de la classe moyenne, et boire du vin grec salé, pour entretenir la liberté du ventre. Les trois autres jours, l'alimentation sera plus substantielle, et l'on pourra manger un peu de viande, tout en s'en tenant à l'usage de l'eau. On peut reprendre ensuite son régime habituel et se rassasier davantage ; au lieu de vin grec salé, on boira du vin astringent et sans mélange, et l'on variera sa manière de vivre en revenant quelquefois aux aliments acres, et d'autres fois au vin salé. Pendant tout ce temps il fout ordonner l'exercice et les frictions, le bain en hiver, et la natation dans l'eau froide en été. Le malade enfin, couché dans une chambre bien ornée, sera distrait par une compagnie livrée aux jeux, à la joie, aux plaisirs qui disposent l'esprit aux idées riantes ; et c'est pour cela sans doute que cette affection a reçu le nom de maladie royale. On se trouve bien encore d'appliquer sur les hypocondres des cataplasmes résolutifs ou des ligues sèches, s'il existe un état morbide du foie ou de la rate. XXV. Une maladie presque ignorée en Italie, mais très répandue dans certains pays, est celle que les Grecs appellent éléphantiasis : elle est au nombre des affections chroniques. Ce mal affecte la constitution tout entière, au point que les os même sont altérés. La surface du corps est parsemée de taches et de tumeurs nombreuses, dont la couleur rouge prend par degrés une teinte noirâtre. La peau devient inégale, épaisse, mince, dure, molle, et comme écailleuse ; il y a amaigrissement du corps et gonflement du visage, des jambes et des pieds. Quand la maladie a acquis une certaine durée, les doigts des pieds et des mains disparaissent en quelque sorte sous ce gonflement; puis une petite fièvre se déclare, qui suffit pour emporter le malade, accablé déjà par tant de maux. En conséquence il faut dès le commencement tirer du sang deux jours de suite, ou purger avec l'ellébore noir; faire observer ensuite une diète aussi rigoureuse que possible ; réparer peu à peu les forces et prescrire des lavements. Si ces moyens amènent du soulagement, on conseillera l'exercice, et principalement la course. C'est par le travail du corps qu'on doit d'abord appeler la sueur, pour l'exciter après à l'aide des étuves sèches. Les frictions sont de même indiquées ; mais l'emploi de ces différents remèdes demande beaucoup de réserve, afin que les forces du malade n'en reçoivent aucune atteinte. Les bains conviennent rarement ; les aliments ne doivent être ni gras, ni glutineux, ni venteux; et le vin peut être prescrit avec avantage, excepté dans les premiers jours. Le plantain pilé, et appliqué sur le corps, parait constituer dans cette maladie un remède très efficace. XXVI. Nous avons rarement aussi l'occasion d'observer une maladie dans laquelle le corps et l'esprit sont frappés de stupeur. Elle est quelquefois produite par un coup de foudre, d'autres fois par une maladie, et les Grecs la nomment apoplexie. Il faut dans ce cas tirer du sang, purger avec l'ellébore blanc, ou donner des lavements. On arrive ensuite aux frictions, et l'on choisit dans la classe moyenne des aliments qui ne soient pas gras ; on en prend aussi quelques-uns d'âcres ; et l'on s'abstient de boire du vin. XXVII. 1. La résolution des nerfs est au contraire une maladie qu'on rencontre fréquemment dans tous les pays, et qui peut envahir tout le corps ou n'affliger que certaines parties. Les anciens donnaient le nom d'apoplexie au premier état, et celui de paralysie au second; mais je vois que la dernière dénomination sert à désigner aujourd'hui ces deux formes de la maladie. En général, ceux qui sont fortement paralysés de tous les membres sont rapidement enlevés, et quand la mort n'est pas immédiate, ils peuvent bien prolonger leurs jours quelque temps, mais il est rare que la santé leur soit rendue : le plus souvent ils traînent une existence misérable, et ne retrouvent plus la mémoire. La paralysie partielle n'existe jamais à l'état aigu, c'est souvent une affection de longue durée, mais que l'on peut guérir. Lorsque la résolution générale des membres est très prononcée, la saignée a pour effet de tuer ou de sauver le malade ; les autres moyens de traitement, presque toujours impuissants à ramener la santé, ne font souvent que différer la mort, tout en compromettant la vie. Si l'intelligence et le mouvement ne se rétablissent pas après l'émission sanguine, il n'y à plus d'espoir ; s'ils se raniment au contraire, la guérison devient probable. Dès qu'un organe est paralysé, on doit, selon la force du sujet et l'intensité du mal, recourir à la saignée ou donner des lavements. Il y a les mêmes précautions à prendre dans les deux espèces de paralysie, c'est-à-dire qu'il faut éviter le froid avec le plus grand soin; chercher, en s'exerçant graduellement, à ressaisir bientôt la faculté de marcher, et, si la faiblesse des jambes s'y oppose, se servir de la gestation, ou se faire bercer dans son lit. Le malade essayera d'imprimer lui-même quelque mouvement au membre affecté; s'il n'en a pas le pouvoir, il s'aidera du secours d'autrui, et l'on fera même violence à la partie pour la rendre à son état naturel. Il est avantageux aussi d'exciter fortement la peau du membre paralysé par la flagellation avec des orties, ou par des sinapismes; mais il faut renoncer à ces moyens dès que les téguments commencent à rougir. On obtient le même effet en appliquant sur la peau de la scille et des oignons pilés, avec de l'encens. Il n'est pas indifférent non plus d'employer tous les trois jours des emplâtres résineux, pour opérer des tractions prolongées sur différents points de l'enveloppe extérieure; et quelquefois il convient de faire usage de ventouses scarifiées. Les agents les plus convenables pour pratiquer des onctions sont, l'huile vieille, ou le nitre mêlé à l'huile et au vinaigre. Il est très nécessaire de faire des fomentations chaudes avec de l'eau de mer, ou, à son défaut, avec de l'eau salée; et si l'on peut avoir à sa disposition des bains salés naturels ou artificiels, on s'en servira de préférence, en ayant bien soin de faire mouvoir dans l'eau les parties les plus affaiblies. Faute de mieux, les bains ordinaires sont encore utiles. Les aliments doivent être tirés de la classe moyenne, et consister surtout en gibier ; pour boisson on donnera de l'eau chaude sans vin : cependant, si la maladie est ancienne, on pourra, dans le but de tenir le ventre libre, prescrire du vin grec salé tous les quatre ou cinq jours. Il est avantageux de faire vomir après dîner. 2. La douleur peut aussi s'emparer des nerfs : dans ce cas, on ne doit employer ni les vomitifs, ni les diurétiques, ni provoquer la sueur par l'exercice comme le veulent certains médecins. Il faut boire de l'eau deux fois par jour, se faire frotter doucement dans le lit pendant quelque temps, puis faire recommencer les frictions en retenant son baleine. On doit principalement exercer les parties supérieures, prendre rarement des bains, et de temps en temps voyager, pour changer d'air. Au moment de la douleur, il convient de fomenter la partie qu'elle occupe avec de l'eau nitrée sans huile, de l'envelopper ensuite, et de l'exposer aux vapeurs de soufre qui se dégagent d'un petit brasier. On continue ces fumigations pendant un certain temps, mais à jeun, et quand la digestion est bien faite. On peut encore appliquer des ventouses sur le point douloureux, ou frapper légèrement la partie malade avec des vessies de bœuf remplies d'air. Il est de même utile d'employer comme topique un mélange à parties égales de suif, de semences de jusquiame et d'ortie pilées ; de faire des fomentations locales avec de l'eau dans laquelle on a fait bouillir du soufre, ou d'appliquer au siège même de la douleur de petites outres remplies d'eau chaude ou du bitume, mêlé à de la farine d'orge. C'est surtout au plus fort de ce mal qu'il faut user d'une gestation très vive : dans toute autre douleur cet exercice est, au contraire, extrêmement nuisible. 3. Le tremblement nerveux s'exaspère également sous l'influence des vomitifs et des diurétiques, et ne s'accommode pas mieux des bains et des étuves sèches. Le malade doit boire de l'eau, se promener beaucoup, recourir aux onctions, et se frictionner lui-même; la paume et d'autres exercices semblables lui serviront à fortifier les parties supérieures. On peut laisser la nourriture à son choix, pourvu qu'il s'applique à bien digérer. Après le repas, il faut cesser toute affaire, et n'user que bien rarement des plaisirs de l'amour. Si l'on s'y est livré, il faut se faire frictionner dans son lit doucement et longtemps, et employer pour cela la main d'un enfant, de préférence à celle d'un homme. 4. Lorsqu'il y a des indices d'une suppuration interne, il faut appliquer d'abord des cataplasmes répercussifs, afin de prévenir l'amas d'une matière nuisible. Si l'on ne peut empêcher la formation du foyer, on doit tâcher de le résoudre par des topiques convenables ; et si l'on n'en vient pas à bout, il est nécessaire d'attirer dans ce cas l'humeur au dehors, et de hâter la maturité du dépôt. La vomique alors se termine toujours par rupture ; le pus qu'on rend par les selles ou par la bouche en est la preuve, et l'on ne doit rien faire qui puisse en empêcher l'évacuation complète. Le malade fera principalement usage de crèmes farineuses et d'eau chaude; la suppuration une fois tarie, on lui accordera des aliments de facile digestion, mais plus substantiels ; et il devra les prendre tièdes d'abord, ainsi que l'eau, pour arriver à boire et à manger froid. Dans les premiers temps, on peut manger avec du miel des pignons, des noix grecques ou des avelines; mais il convient d'y renoncer ensuite, afin de laisser la cicatrice se former plus promptement. Alors vient le moment de prendre, comme cicatrisant, du suc de poireau ou de marrube, et de mêler du poireau à tous ses aliments. Il importe aussi de pratiquer des onctions sur les parties qui ne sont point affectées, de faire de petites promenades, et d'éviter, soit en luttant, soit en courant, ou de toute autre manière, de ranimer les plaies qui sont en voie de guérison. En effet, le vomissement de sang est très grave dans cette maladie, et l'on doit employer tous ses soins à s'en garantir. [1] La guérison de l’affection locale. Ce passage est altéré; et j’ai, d’après Targa, placé entre guillemets les mots qui embarrassent la construction de la phrase, et ne fournissent point de sens. Toutefois, comme il en faut un, j’ai cru devoir suivre pour la traduction la leçon de Van der Linden, que je reproduis ici : at, si quando is non in toto corpore, sed in parte est; magis tamen ad rem pertinet, vim totius corporis moliri, quam partis; cum per eam partes aegrœ sanentur. Voy. Targa, 1re éd., p. 104, note 55, et 2e éd., p. 107, note 6. [2] Amener des résultats favorables: Non quo non interdum id incidat. Ces mots étaient suivis de aut non decipiat, ce qui constituait un non-sens; je les ai donc retranchés, mais après m’être assuré qu’ils ne se retrouvent pas non plus dans la 2e édit. Targa. [3] Ni ulcères, ni déjections alvines. Après le mot dejectio, il y avait dans le texte non profluvium alvi, que j’ai supprimé comme n’ayant pas une signification différente, et taisant, par conséquent, double emploi. Targa fait en outre remarquer qu’il n’est pas rare de rencontrer dans Celse le mot dejectio, tandis qu’on n’y trouve jamais cette locution pro fluvium alvi, pour exprimer des évacuations alvines. [4] Que les Grecs appellent frénésie. Malgré le délire et l’état fébrile qui appartiennent essentiellement à la phrénitis (les anciens, ce serait à tort qu’on voudrait y retrouver l’encéphalite ou la méningite des modernes. L’assimilation ne serait pas moins erronée, si l’on se bornait à rapprocher la phrénitis des fièvres de nos pays. Pour arriver à la véritable interprétation des faits, il faut, comme M. Littré, demander des termes de comparaison aux auteurs qui ont étudié l’homme malade sous un climat plus analogue que le nôtre à celui de la Grèce et de l’Italie. Or, cet examen comparatif a conduit l’habile et savant traducteur d’Hippocrate à d’incontestables résultats; et, pour quiconque a lu le remarquable travail qui précède le premier et le troisième livre Des épidémies, il demeure évident que la phrénitis n’est réellement pas un symptôme qui puisse appartenir idiopathiquement on sympathiquement à plusieurs maladies, mais qu’elle doit être considérée comme une variété des fièvres rémittentes et continues des pays chauds. (Littré, t. II, p. 572.) Il faut le dire pourtant, sous le nom de frénésie, Cela n’a pas seulement décrit le délire aigu avec fièvre intense; sa description paraît comprendre encore diverses formes d’aliénation mentale non fébriles, comme la fureur maniaque et la mélancolie. A cet égard, il est moins clair et moins complet que Coelius Aurelianus, qui donne très au long le diagnostic différentiel de la frénésie (lib. I, cap. iv, v, vi, De morbis acutis, Amsterdam, 1722). Il la distingue soigneusement de la fureur appelée communément folie, de la mélancolie, de la manie même avec fièvre, de la léthargie; enfin des autres délires produits par certains poisons, ou se manifestant sous l’influence de diverses maladies, pleurésie, pneumonie, etc. [5] La maladie que les Grecs ont nommés cardiaque. Qu’est-ce que la maladie cardiaque? Dalechamp, dans ses notes sur Cœlius, croit que les plus anciens médecins avaient confondu l’affection cardiaque avec l’apoplexie. Mais cette opinion ne me paraît nullement justifiée. Dans ces derniers temps, le professeur Hecker a fait ressortir les analogies frappantes qui existent entre la suette anglaise de 1482, et le mal cardiaque, dont il emprunte la description à Coelius Aurelianus. Il reconnaît toutefois que, pour établir l’identité de ces deux affections, il manque un caractère essentiel, c’est-à-dire l’éruption miliaire. (Hecker, Der englische Schweiss, Berlin, 1834, p. 185-199.) [6] Les Grecs ont appelé cet état léthargie. Pour nous, la léthargie est caractérisée par un sommeil excessivement prolongé, et qui existe sans aucun trouble apparent des fonctions; tandis que ce mot, chez les anciens, emporte constamment l’idée d’un état aigu et fébrile. Un nommé Tharrias, dit Celse (ibid.), a prétendu que la léthargie dépendait d’un accès de fièvre, et finissait avec lui; d’où il concluait que c’est mal à propos qu’on cherche à secouer les malades. D’un autre côté, Coelius Aurélianus, après avoir dit que la phrénitis, s’aggravant, devient léthargus, et que le léthargus, déclinant, devient quelquefois phrénitis, ajoute plus loin (p. 714): « Si un délire croissent subitement avec une fièvre aiguë est la phrénitis, une somnolence avec fièvre est le léthargus. » Dans un autre endroit de son livre, il exprime que le léthargus peut être continu ou rémittent : « Nous reconnaissons le léthargus à l’occlusion et à l’hébétude des sens, à la somnolence, à la fièvre aiguë, soit continue, soit rémittente. » Cette possibilité, dit M. Littré, qu’une même fièvre soit tantôt continue, tantôt rémittente, est un des traits le plus caractéristique de la physionomie des fièvres des pays chauds. Ainsi Hippocrate place le léthargus entre la phrénitis et le causus, qui sont des fièvres rémittentes; Galien dit que la phrénitis peut se changer en léthargus; enfin Coelius Aurelianus y signale des paroxysmes et des réunissions. Tout cela autorise pleinement à conclure que le léthargus des anciens est, comme la phrénitis et le causus, une variété des fièvres rémittentes et continues des pays chauds. (Littré, t. II, p. 573.) [7] Un mal plus déplorable encore. Les siècles ont passé vainement sur les combats du cirque, ensevelissant dans la même poussière empereurs et gladiateurs; le préjugé barbare est resté; et, de nos jours, il n’est que trop vrai qu’on peut retrouver dans le vulgaire cette affreuse croyance que le sang humain encore chaud doit guérir de l’épilepsie : seulement, chez les modernes, le gladiateur est remplacé par le supplice. Voici, du reste, une preuve à l’appui. Le National, racontant, il n’y a pas longtemps, l’exécution d’un homme condamné à mort en Suède, notait, comme particularité du supplice, qu’une vieille femme, atteinte d’épilepsie, se trouvait au pied de l’échafaud, prête, au moment même où la tête serait séparée du corps, à plonger dans le sang tout fumant un morceau de pain qu’elle destinait à sa guérison.
|