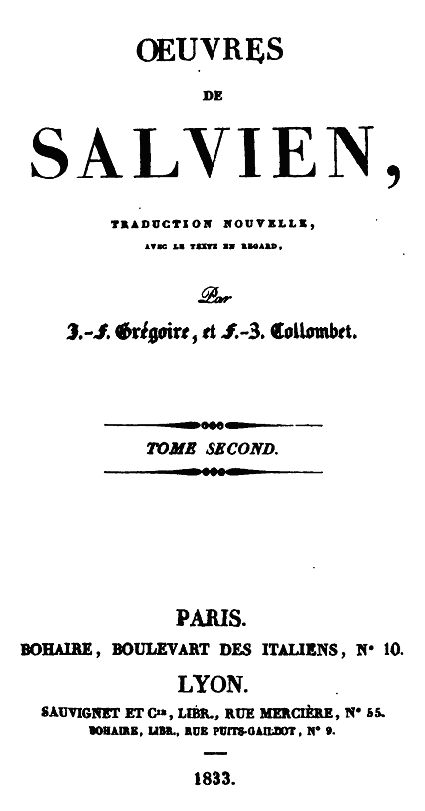
SALVIEN
DE LA PROVIDENCE ET DU JUSTE JUGEMENT DE DIEU EN CE MONDE.
LIVRE I
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
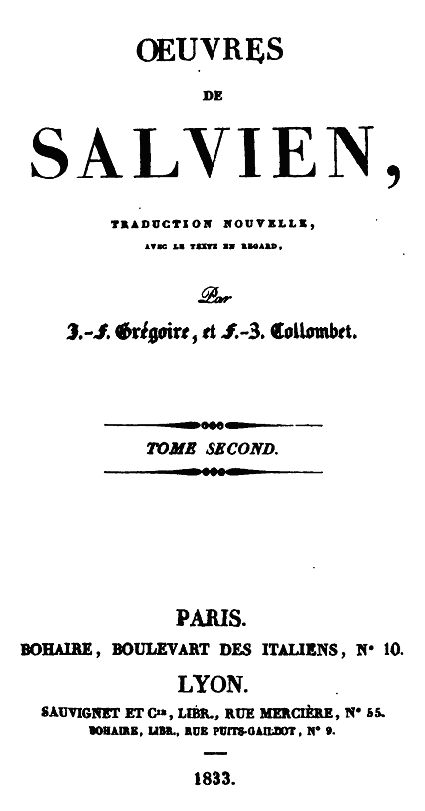
LIVRE I
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
SALVIEN, PRÊTRE,
|
AD S. SALONIUM EPISCOPUM Praefatio.Sancto episcopo Salonio Salvianus salutem in Domino. Omnes admodum homines, qui pertinere ad humani officii culturam existimarunt, ut aliquod linguarum opus studio ingeniorum excuderent; id speciali cura elaborarunt, ut sive utiles res ac probas, sive inutiles atque improbas stylo texerent, seriem tantum rerum nitore verborum illustrarent, causisque ipsis quas loqui vellent loquendo lucem accenderent. Itaque ad hanc se partem ex utroque genere litterarum scriptores mundialium negotiorum plurimi contulerunt, non satis considerantes quam probabilius materiis se impenderent, dummodo ea quaecumque dicerent, aut compto et blando carmine canerent, aut luculenta oratione narrarent. Omnes enim in scriptis suis causas tantum egerunt suas; et propriis magis laudibus quam aliorum utilitatibus consulentes, non id facere adnisi sunt ut salubres ac salutiferi, sed ut scholastici ac diserti haberentur. Itaque scripta eorum aut vanitate sunt tumida, aut falsitate infamia, aut verborum foeditatibus sordida, aut rerum obscenitate vitiosa; ut vere cum ingeniorum tantum laudem aucupantes, tam indignis rebus curam impenderent, non tam illustrasse mihi ipsa ingenia quam damnasse videantur. Nos autem, qui rerum magis quam verborum amatores, utilia potius quam plausibilia sectamur, neque id quaerimus ut in nobis inania saeculorum ornamenta, sed ut salubria rerum emolumenta laudentur; in scriptiunculis nostris non lenocinia esse volumus, sed remedia, quae scilicet non tam otiosorum auribus placeant quam aegrotorum mentibus prosint, magnum ex utraque re coelestibus donis fructum reportaturi. Si enim haec salus nostra sanaverit quorumdam non bonam de Deo nostro opinionem, fructus non parvus erit quod multis profui. Sin autem id non provenerit; et hoc ipsum infructuosum saltem non erit, quod prodesse tentavi. Mens enim boni studii ac pii voti, etiamsi effectum non invenerit coepti operis, habet tamen praemium voluntatis. Hinc ergo exordiar. LIBER PRIMUS.
I. Incuriosus a quibusdam et quasi negligens humanorum actuum Deus dicitur, utpote nec bonos custodiens, nec coercens malos; et ideo in hoc saeculo bonos plerumque miseros, malos beatos esse. Sufficere quidem ad refellenda haec, quia cum Christianis agimus, solus deberet sermo divinus. Sed quia multi incredulitatis paganicae aliquid in se habent, etiam paganorum forsitan electorum atque sapientum testimoniis delectentur. Probamus igitur ne illos quidem de incuriositate ac negligentia ista sensisse qui verae religionis expertes nequaquam utique Deum nosse potuerunt, quia legem per quam Deus agnoscitur nescierunt. Pythagoras philosophus, quem quasi magistrum suum philosophia ipsa suspexit, de natura ac beneficiis Dei disserens, sic locutus est: Animus per omnes mundi partes commeans atque diffusus, ex quo omnia quae nascuntur animalia vitam capiunt. Quomodo igitur mundum negligere Deus dicitur, quem hoc ipso scilicet satis diligit quod ipsum se per totum mundi corpus intendit? Plato et omnes Platonicorum scholae moderatorem rerum omnium confitentur Deum. Stoici eum gubernatoris vice intra id quod regat semper manere testantur. Quid potuerunt de affectu ac diligentia Dei rectius religiosiusque sentire, quam ut eum gubernatori similem esse dicerent? hoc utique intelligentes quod sicut navigans gubernator nunquam manum suam a gubernaculo, sic nunquam penitus curam suam Deus tollit a mundo; ac sicut ille et auras captans, et saxa vitans, et astra suspiciens, totus sit simul tam corporis quam cordis officio operi suo deditus, ita scilicet Deum nostrum ab universitate omnium rerum nec munus dignantissimae visionis avertere, nec regimen providentiae suae tollere, nec indulgentiam benignissimae pietatis auferre. Unde etiam illud mysticae auctoritatis exemplum, quo se non minus philosophum Maro probare voluit quam poetam dicens (Georg. IV): Deum namque ire per omnes. Terrasque tractusque maris coelumque profundum. Tullius quoque: « Nec vero Deus ipse, inquit (Tuscul. lib. I, cap. 27), qui intelligitur a nobis, alio modo intelligi potest quam mens soluta quaedam et libera et segregata ab omni concretione mortali, omnia sentiens et movens. » Alibi quoque: Nihil enim, inquit, praestantius Deo. Ab eo igitur mundum regi necesse est. Nulli igitur naturae obediens aut subjectus Deus. Omnem ergo regit ipse naturam Nisi forte nos videlicet sapientissimi ita sentiamus, ut eum a quo omnia regi dicimus, et regere simul et negligere credamus. Cum ergo omnes, etiam religionis expertes, vi ipsa et quadam necessitate compulsi, et sentiri omnia a Deo et moveri et regi dixerint; quomodo nunc eum incuriosum quidam ac negligentem putant, qui et sentiat omnia per subtilitatem, et moveat per fortitudinem, et regat per potestatem, et custodiat per benignitatem? Dixi quid de majestate ac moderamine summi Dei principes et philosophiae simul et eloquentiae judicarint. Ideo autem nobilissimos utriusque excellentissimae artis magistros protuli, quo facilius vel omnes alios idem sensisse vel certe sine auctoritate aliqua dissensisse monstrarem. Et sane invenire aliquos qui ab istorum judicio discrepaverint, praeter Epicureorum vel quorumdam Epicurizantium deliramenta, non possum: qui sicut voluptatem cum virtute, sic Deum cum incuria ac torpore junxerunt; ut appareat eos qui ita sentiunt, sicut sensum Epicureorum atque sententiam ita etiam vitia sectari. II. Non puto quod ad probandum nunc rem tam perspicuam etiam divinis uti hoc loco testimoniis debeamus; maxime quia sermones sacri ita abunde et evidenter cunctis impiorum propositionibus contradicunt, ut dum sequentibus eorum calumniis satisfacimus, etiam ea quae supra dicta sunt plenius refutare possimus. Aiunt igitur a Deo omnia praetermitti, quia nec coerceat malos nec tueatur bonos, et ideo in hoc saeculo deteriorem admodum statum esse meliorum; bonos quippe esse in paupertate, malos in abundantia; bonos in infirmitate, malos in fortitudine; bonos semper in luctu, malos semper in gaudio; bonos in miseria et abjectione, malos in prosperitate et dignitate. Primum igitur ab iis qui hoc ita esse vel dolent vel accusant, illud requiro, de sanctis hoc, id est, de veris ac fidelibus Christianis, an de falsis et impostoribus doleant. Si de falsis; superfluus dolor, qui malos doleat non beatos esse; cum utique quicumque mali sunt, successu rerum deteriores fiant, gaudentes sibi nequitiae studium bene cedere; et ideo vel ob hoc ipsum miserrimi esse debent ut mali esse desistant, vindicantes improbissimis quaestionibus nomen religionis, et praeferentes ad sordidissimas negotiationes titulum sanctitatis: quorum scilicet nequitiis si miseriae comparentur, minus sunt miseri quam merentur: quia in quibuslibet miseriis constituti, non sunt tamen tam miseri quam sunt mali. Nequaquam ergo pro his dolendum quod non sunt divites ac beati; multo autem pro sanctis minus: quia quamlibet videantur ignorantibus esse miseri, non possunt tamen esse aliud quam beati. Superfluum autem est ut eos quispiam vel infirmitate vel paupertate vel aliis istiusmodi rebus existimet esse miseros, quibus se illi confidunt esse felices. Nemo enim aliorum sensu miser est, sed suo. Et ideo non possunt cujusquam falso judicio esse miseri, qui sunt vere sua conscientia beati. Nulli enim, ut opinor, beatiores sunt quam qui ex sententia sua atque ex voto agunt. Humiles sunt religiosi, hoc volunt: pauperes sunt, pauperie delectantur: sine ambitione sunt, ambitum respuunt: inhonori sunt, honorem fugiunt: lugent, lugere gestiunt: infirmi sunt, infirmitate laetantur. Cum enim, inquit Apostolus, infirmor, tunc potens sum (II Cor. XII, 10). Nec immerito sic arbitratur, ad quem Deus ipse sic loquitur: Sufficit tibi gratia mea: nam virtus in infirmitate perficitur (Ibid., 9). Nequaquam ergo nobis dolenda est haec afflictio infirmitatum, quam intelligimus matrem esse virtutum. Itaque quidquid illud fuerit, quicumque vere religiosi sunt, beati esse dicendi sunt: quia inter quamlibet dura; quamlibet aspera, nulli beatiores sunt quam qui hoc sunt quod volunt. Soleant quamvis esse nonnulli qui turpia atque obscena sectantes, etsi juxta opinionem suam beati sunt, quia adipiscuntur quod volunt; re tamen ipsa beati non sunt, quia quod volunt, nolle debuerant. Religiosi autem hoc cunctis beatiores sunt, quia et habent quae volunt, et meliora quam quae habent omnino habere non possunt. Labor itaque, et jejunium, et paupertas, et humilitas, et infirmitas non omnibus sunt onerosa tolerantibus, sed tolerare nolentibus. Sive enim gravia haec, sive levia, animus tolerantis facit. Nam sicut nihil est tam leve quod ei non grave sit qui invitus facit, sic nihil est tam grave quod non ei qui id libenter exsequitur, leve esse videatur. Nisi forte antiquis illis priscae virtutis viris, Fabiis, Fabriciis, Cincinnatis, grave fuisse existimamus quod pauperes erant, qui divites esse nolebant; cum omnia scilicet studia, omnes conatus suos ad communia emolumenta conferrent, et crescentes reipublicae vires privata paupertate ditarent. Numquid parcam illam tunc agrestemque vitam cum gemitu et dolore tolerabant, cum viles ac rusticos cibos ante ipsos quibus coxerant focos sumerent, eosque ipsos capere nisi ad vesperam non liceret? Numquid aegre ferebant quod avara ac divite conscientia auri talenta non premerent, cum etiam argenti usum legibus coercerent? Numquid illecebrae et cupiditatis poenam putabant quod distenta aureis nummis marsupia non haberent, cum patricium hominem, quod usque ad decem argenti libras dives esse voluisset, indignum curia judicarent? Non despiciebant tunc, puto, pauperes cultus, cum vestem hirtam ac brevem sumerent, cum ab aratro arcesserentur ad fasces, et illustrandi habitu consulari, illis fortasse ipsis quas assumpturi erant imperialibus togis madidum sudore pulverem detergerent. Itaque tunc illi pauperes magistratus opulentam rempublicam habebant; nunc autem dives potestas pauperem facit esse rempublicam. Et quae, rogo, insania est, aut quae caecitas, ut egestuosa ac mendicante republica divitias posse credant stare privatas? Tales ergo tunc veteres Romani erant; et sic illi tunc contemnebant divitias, nescientes Deum, sicut nunc spernunt sequentes Dominum. Quanquam quid ego de illis loquor qui cura imperii propagandi, contemptum propriae facultatis ad publicas opes conferebant, et licet privatim pauperes essent, divitiis tamen communibus abundabant; cum etiam Graeci quidam sapientiae sectatores sine ullo publicae utilitatis affectu prope omni se rei familiaris usu, assequendae gloriae aviditate, nudaverint; nec solum hoc, sed etiam usque ad contemptum doloris ac mortis doctrinae suae culmen erexerint, dicentes scilicet etiam in catenis atque suppliciis beatum esse sapientem? Tantam virtutis vim esse voluerunt, ut non possit esse unquam vir bonus non beatus. Si ergo illi a quibusdam nunc etiam sapientibus viris miseri non putantur, qui nullos laboris sui fructus nisi ex praesenti tantum laude capiebant; quanto magis religiosi ac sancti viri miseri non putandi sunt, qui et praesentis fidei oblectamenta capiunt, et beatitudinis futurae praemia consequentur? III. Dixit quidam ex istis de quibus querimur cuidam sancto viro secundum veritatis regulam sentienti, id est, quod Deus omnia regeret ac pro humano genere necessariam nosset moderationem suam et gubernaculum temperaret, Quare ergo, inquam, tu ipse infirmus es? hoc utique eo sensu atque judicio, hoc est: Si Deus, ut putas, in hac praesenti vita omnia regit, si Deus cuncta dispensat; qua ratione fortis ac sanus est homo quem peccatorem scio, et tu infirmus, quem sanctum esse non ambigo? Quis tam profundi cordis virum non admiretur, qui merita religiosorum atque virtutes tam magnis retributionibus dignas putat, ut in praesenti hac vita carnes atque fortitudines corporum praemia putet debere esse sanctorum? Respondeo igitur, non unius tantum religiosi nomine, sed universorum. Quaeris igitur, quisquis ille es, qua ratione infirmi sint sancti viri. Respondeo breviter, quia ideo sancti viri infirmiores se esse faciunt; quia si fortes fuerint, sancti esse vix possunt. Opinor enim omnes omnino homines cibis ac poculis fortes esse; infirmos autem abstinentia, ariditate, jejuniis. Non ergo mirum est quod infirmi sunt qui usum earum rerum respuunt per quas alii fortes fiunt. Et est ratio cur respuant, dicente Paulo apostolo de se ipso: Castigo corpus meum, et servituti subjicio; ne forte cum aliis praedicaverim, ipse reprobus efficiar (I Cor. IX, 27). Si infirmitatem corporis appetendam sibi etiam Apostolus putat, quis sapienter evitat? Si fortitudinem carnis Apostolus metuit, quis rationabiliter fortis esse praesumit? Haec ergo ratio est, qua homines Christo dediti et infirmi sunt et volunt esse. Absit autem ut hoc argumento religiosos putemus a Deo negligi, per quod confidimus plus amari. Legimus Timotheum apostolum carne infirmissimum fuisse. Numquid negligebatur a Domino, aut ob infirmitatem Christo non placuit, qui ad hoc infirmus esse voluit ut placeret? quemque etiam ipse apostolus Paulus (I Tim. V, 23), licet nimiis jam infirmitatibus laborantem, non tamen nisi pauxillulum vini sumere ac delibare permisit; hoc est, ita eum voluit infirmitati suae consulere quod noluit tamen ad fortitudinem pervenire? Et hoc cur ita? Cur absque dubio, nisi quia, ut ipse dicit: Caro concupiscit adversus spiritum, spiritus autem adversus carnem. Haec enim, inquit, invicem sibi adversantur, ut non quaecumque vultis, illa faciatis (Gal. V, 17), Non imprudenter quidam hoc loco dixit quod si repugnante corporis fortitudine, quae optamus facere non possumus: infirmandum nobis carne sit ut optata faciamus. « Infirmitas enim carnis, inquit (Salv. epist. 5), vigorem mentis exacuit, et affectis artubus, vires corporum in virtutes transferuntur animorum; non turpibus flammis medullae aestuant, non male sanam mentem latentia incentiva succendunt, non vagi sensus per varia oblectamenta lasciviunt; sed sola exsultat anima, laeta corpore affecto, quasi adversario subjugato. » Haec ergo, ut dixi, religiosis viris causa infirmitatis est; eamque esse nec tu, ut arbitror, jam negas. IV. Sed sunt fortasse, inquis, alia majora: id est, quod multa in vita ista aspera atque acerba patiuntur, quod capiuntur, quod torquentur, quod trucidantur. Verum est. Sed quid facimus quod et prophetae in captivitatem abducti sunt et apostoli etiam tormenta tolerarunt? Et certe dubitare non possumus, quod tunc Deo maxime curae erant, cum pro Deo ista paterentur. At forsitan hoc ipso magis probare te dicis quod Deus in saeculo isto omnia negligat, et futuro totum judicio reservet, quia semper et boni omnia mala passi sunt, et fecerunt mali. Non infidelis quidem videtur assertio, maxime quia futurum Dei judicium confitetur. Sed nos ita judicandum humanum genus a Christo dicimus, ut tamen etiam nunc omnia Deum, prout rationabile putat, regere ac dispensare credamus; et ita in futuro judicio judicaturum affirmamus, ut tamen semper etiam in hoc saeculo judicasse doceamus. Dum enim semper gubernat Deus, semper judicat: quia gubernatio ipsa judicium est. Quot modis hoc vis probemus? ratione, an exemplis, an testimoniis? Si ratione; quis tam expers humanae intelligentiae est et hujus ipsius de qua loquimur, veritatis alienus, qui non agnoscat ac videat pulcherrimum mundi opus et inaestimabilem supernarum infernarumque rerum magnificentiam ab eodem regi a quo creata sit, quemque elementorum fabricatorem, eumdem etiam gubernatorem fore? qui cuneta scilicet qua potestate ac majestate condiderit, eadem etiam providentia ac ratione moderetur; praesertim cum etiam in his quae humano actu administrantur, nihil penitus sine ratione consistat, omniaque ita a providentia incolumitatem, quasi corpus ab anima vitam, trahant; ideoque in hoc mundo non solum imperia et provincias, atque rem civilem ac militarem, sed etiam minora officia et privatas domos, pecudes denique ipsas, et minutissima quaeque domesticorum animantium genera, non nisi humana ordinatione atque consilio, quasi quadam manu et gubernaculo, contineri. Et haec omnia sine dubio voluntate ac judicio summi Dei: scilicet ut eo exemplo omne genus humanum particulas rerum et membra regeret, quo ipse summam totius mundani corporis gubernaret. Sed in principio, inquis, creaturarum haec sunt a Deo statuta atque disposita; caeterum patrata universitate rerum atque perfecta, removit a se cunctam terrestrium rerum curam et ablegavit; laborem videlicet forte fugiens, a suo loco amandavit, et molestiam fatigationis evitans, aut occupatus negotiis aliis, partem rerum reliquit, quia totum obire non possit. V. Removet igitur a se, inquit, curam mortalium Deus. Et quae ergo nobis divinae religionis est ratio? quae vel causa Christum colendi, vel spes propitiandi? Si enim neglig it Deus in hoc saeculo genus hominum, cur ad coelum quotidie manus tendimus, cur orationibus crebris misericordiam Dei quaerimus, cur ad ecclesiasticas domos currimus, cur ante altaria supplicamus? Nulla est enim nobis ratio precandi, si spes tollitur impetrandi. Vides ergo quam stulta atque inanis sit hujus persuasionis assertio: quae utique si recipitur, nihil penitus de religione servatur. Sed ad illud forte confugies ut dicas nos metu futuri judicii Deum colere, et id omni praesentium officiorum cultu elaborare ut in die futuri saeculi mereamur absolvi. Quid ergo sibi vult apostolus Paulus praecipiens quotidie in Ecclesia ac jubens ut offeramus jugiter Deo nostro orationes, obsecrationes, postulationes, gratiarum actiones (I Tim. II, 1)? Et haec omnia quam ob causam? quam utique, nisi, ut ipse dicit, ut quietam et tranquillam vitam agamus in omni castitate (Ibid., 2). Pro praesentibus, ut videmus, Domino supplicari jubet et orare: quod utique non juberet, nisi exorare posse confideret. Quomodo ergo aliquis pro obtinendis futuri temporis bonis apertas Dei aures, pro praesentibus autem clausas atque obstructas putat? Aut quomodo nos in ecclesia supplicantes praesentem nobis salutem a Deo poscimus, si audiendos nos penitus non putamus? Nulla ergo nobis pro incolumitatibus ac prosperitatibus nostris vota facienda sunt. Quin potius ut modestia supplicationis vocem conciliet postulantis, dicendum fortasse nobis est: Domine, non prosperitatem vitae istius petimus, nec pro bonis praesentibus supplicamus; scimus enim aures tuas his obsecrationibus clausas esse et auditum te ad preces istiusmodi non habere, sed pro his tantummodo petimus quae sunt futura post mortem. Esto igitur, postulatio talis utilitate non careat; quomodo ratione subsistit? Si enim Deus a respectu hujus saeculi curam removit, et postulantium precibus aures suas clausit; absque dubio qui non audit nos pro praesentibus, non audit etiam pro futuris: nisi forte credimus pro precum diversitate aures suas Christum vel tribuere vel negare, id est, ut claudat eas cum rogantur praesentia. aperiat cum futura. Sed de his dicendum amplius non est. Tam stulta enim sunt et tam frivola, ut cavendum sit ne id ipsum quod pro honore Dei dicitur, injuria Dei esse videatur. Tanta quippe est majestatis sacrae et tam tremenda reverentia, ut non solum ea quae ab illis contra religionem dicuntur horrere, sed etiam quae pro religione nos ipsi dicimus cum grandi metu ac disciplina dicere debeamus. Igitur si stulte atque impie creditur quod curam humanarum rerum pietas divina despiciat, ergo non despicit. Si autem non despicit, regit. Si autem regit, hoc ipso quod regit judicat: quia regimen esse non potest, nisi fuerit jugiter in rectore judicium. VI. Sed parum esse fortasse quispiam putet quod hoc ratio declarat, nisi probetur exemplis. Videamus qualiter mundum a principio Deus rexerit; et ita eum omnia semper gubernasse monstrabimus, ut simul etiam judicasse doceamus. Quid enim Scriptura dicit: Formavit igitur Deus hominem de limo terrae, et inspiravit in eum spiraculum vitae (Gen. II, 7). Et quid postea? Posuit, inquit, eum in paradiso voluptatis (Ibid., 15). Quid deinceps? Dedit scilicet legem, praeceptis imbuit, institutione formavit. Quid autem post haec secutum est? Praeteriit homo mandatum sacrum, sententiam subiit, paradisum perdidit, poenam damnationis excepit. Quis non in iis omnibus et gubernatorem Deum videat et judicem? Constituit enim Adam in paradiso innocentem, expulit reum. In constitutione ordinatio est, in expulsione judicium. Quando enim eum in loco voluptatis posuit, ordinavit: quando autem reum de regno expulit, iudicavit. Ergo hoc de primo homine, id est, de patre. Quid de secundo, id est, de filio? Factum est, inquit Scriptura sacra, post multos dies ut offerret Cain de fructibus terrae munera Domino. Abel quoque obtulit de primitiis gregis sui et de adipibus ejus. Et respexit Dominus ad Abel et ad munera ejus: ad Cain vero et ad munera ejus non respexit (Gen. IV, 3-5). Priusquam de evidentiore judicio Dei dicam, puto quod etiam in his quae jam diximus, quaedam censura judicii est. In hoc enim quod unius sacrificium Deus suscipit, alterius excludit, evidentissime utique et de unius justitia et de iniquitate alterius judicavit. Sed hoc parum est. Cum igitur futuro facinori viam sternens fratrem in solitudinem trahit, secretis patrocinantibus scelus peragit, impiissimus pariter et stultissimus, qui ad perpetrandum maximum nefas sufficere sibi credidit si aspectus vitaret hominum, fratricidium Deo teste facturus. Unde puto quod haec in illo jam tunc opinio fuerit quae nunc in multis est, Deum scilicet terrestria non respicere et actus sceleratorum hominum non videre. Nec dubium est, cum post facinus admissum, Dei sermone conventus, nihil se de caede fratris scire responderit. Adeo inscium facti sui Deum arbitrabatur ut crederet feralissimum nefas tegi posse mendacio. At aliter expertus est quam putabat. Nam Deum, a quo non existimavit videri scelera cum occideret, sensit videre cum damnaretur. Hic nunc requirere ab illis volo qui negant res nunc humanas vel respici a Deo, vel regi, vel judicari; an cuncta in his quae diximus e diverso sint. Puto enim quod praesens est qui sacrificio interest, et regit qui Cain post sacrificia castigat, et sollicitus est qui ab interfectore interfectum requirit, et judicat qui percussorem impium justa animadversione condemnat. In quo quidem etiam illud non incommode: verum ne miremur nunc sanctos homines quaedam aspera pati, cum videamus quod jam tunc Deus etiam per maximum nefas primum sanctorum sivit occidi. Quae quidem qua ratione patiatur, neque humanae imbecillitatis est plena indagine cognoscere, neque tunc temporis disputare. Interim probare satis est omnia istiusmodi non negligentia aut incuria Dei fieri, sed consilio ac dispensatione permitti. Nequaquam autem injustum possumus dicere, in quo divinum esse judicium non possumus denegare: quia summa justitia est, voluntas Dei. Neque enim ideo non justum est quod divinitas agit, quia capere vim divinae justitiae homo non valet. Sed ad propositum revertamur. VII. Videmus ergo in his quae dicta sunt nihil incuria Dei actum, sed quia quaedam ex his dispositio divina ita ordinavit, quaedam patientia sustinuit, quaedam sententia judicavit. Sed non satis quidam forte existimant haec quae dicimus nos probasse per paucos. Videamus an id ipsum manifestare possimus etiam per universos. Aucta igitur ac multiplicata humani generis multitudine simul et iniquitate, videns Deus, inquit Scriptura sacra, quod multa malitia hominum esset in terra, et cuncta cogitatio cordis intenta esset ad malum omni tempore, poenituit eum quod hominem fecisset in terra; et tactus dolore cordis intrinsecus, Delebo, inquit, hominem quem creavi, a facie terrae (Gen. VI, 5-7). Consideremus quemadmodum in his omnibus et sollicitudo Domini pariter et severitas indicetur. Primum enim ait: Videns autem Deus; secundo, Tactus dolore cordis intrinsecus; tertio, Delebo, inquit, hominem quem creavi. In hoc siquidem quod videre omnia Deus dicitur, cura ejus ostenditur; in hoc quod dolet, terror irati; in hoc quod punit, severitas judicantis. Poenituit ergo, inquit Scriptura sacra, Deum quod hominem fecisset in terra; non quod Deus sit obnoxius huic motui aut ulli subjaceat passioni; sed sermo divinus ad insinuandam plenius nobis rerum scriptarum intelligentiam, quasi humano nobiscum affectu loquens, sub nomine poenitentis Dei vim demonstravit irati. Ira est autem Divinitatis, poena peccantis. Quid ergo post haec secutum est? Cum, inquit, vidisset Deus terram esse corruptam, dixit ad Noe: Finis universae carnis venit coram me: repleta est terra iniquitate a facie eorum, et ego disperdam eos cum terra (Ibid., 13). Et quid postea? Rupti sunt, inquit, omnes fontes abyssi magnae, et cataractae coeli apertae sunt: factaque est pluvia super terram quadraginta diebus et quadraginta noctibus (Gen. VII, 11, 12). Et paulo post: Consumpta est omnis caro quae movebatur super terram (Ibid., 21). Et deinceps: Remansit autem solus Noe, et qui cum eo erant in arca (Ibid., 23). Hic nunc requirere ab illis volo qui incuriosum rerum humanarum appellant Deum, an illo tempore vel curasse eum terrestria credant vel judicasse. Puto enim non judicavit tantum, sed etiam dupliciter judicavit. Nam dum servabat bonos, pium se retributorem, et dum condemnat malos, se verum judicem comprobavit. Sed haec forsitan apud stultos, quia ante diluvium, id est, quasi alio quodam saeculo gesta sunt, minus auctoritatis habere videantur. Quasi vero aut tunc alius Deus fuerit, aut postea eamdem mundi curam habere noluerit. Possum quidem divino munere per singulas post diluvium generationes probare quae dico; sed et enormitas vetat, et tamen certa quaedam et majora sufficiunt: quia cum idem sit absque dubio majorum pariter ac minorum Deus, id profecto intelligendum est in minoribus quod in majoribus comprobatur. VIII. Igitur cum post diluvium generationi hominum benedixisset Deus, immensamque hominum multitudinem benedictio ipsa generasset, loquitur ad Abraham Dominus e coelo (Gen. XII, 1), jubens ut deserat terram suam, inquirat alienam. Vocatur, sequitur, adducitur, collocatur; fit de paupere locuples, de ignoto potens, infimus peregrinatione, excellentissimus dignitate. Sed ne haec tamen quae ei data a Deo fuerant, muneris tantum viderentur fuisse, non meriti, qui laetabatur prosperis, probatur adversis. Sequitur quippe labor, periculum, timor. Vexatur commigratione, fatigatur exsilio, contumelia afficitur, uxore privatur; immolari sibi Deus filium jussit, pater obtulit; et quantum ad defunctionem cordis pertinet, immolavit. Rursum exsilia, rursum metus, Philistinorum invidia, Abimelech rapina: multa quidem mala, sed tamen paria solatia. Nam etsi a plurimis afficitur, tamen de omnibus vindicatur. Quid igitur in cunctis istis quae memoravimus? num Deus non est et inspector, et invitator, et ductor, et sollicitus, et sponsor, et protector, et munerator, et probator, et sublimator, et ultor, et judex? Inspector quippe est, dum ex omnibus unum elegit quem meliorem vidit; invitator, dum vocat; ductor, dum ad ignota perducit; sollicitus, dum ad ilicem visitat; sponsor, dum futura promittit; protector, quia inter gentes barbaras protexit; munerator, quia locupletavit; probator, quia tentari asperis voluit; sublimator, quia potentiorem omnibus fecit; ultor, quia eum de adversariis ultus est; judex, quia dum ulciscitur, judicavit. Subjungit autem statim huic historiae Deus dicens: Clamor Sodomorum et Gomorrhae multiplicatus est, et peccatum eorum aggravatum est nimis (Gen. XVIII, 20). Clamor, inquit, Sodomorum et Gomorrhae multiplicatus est. Pulchre clamorem dixit in se habere peccata. Grandis enim absque dubio peccantium clamor est, qui a terra ascendit ad coelum. Quare autem peccata hominum quasi clamare testatur? Scilicet quia caedi aures suas Deus dicit clamoribus peccatorum, ne differatur poena peccantium. Et vere clamor, et grandis clamor est, quando pietas Dei peccatorum clamoribus vincitur ut peccantes punire cogatur. Ostendit ergo Dominus quam invitus puniat etiam gravissimos peccatores, dicens quod clamor Sodomorum ad se ascenderit. Hoc est dicere: Misericordia quidem mea mihi suadet ut parcam, sed tamen peccatorum clamor cogit ut puniam. Cum ergo ista dixisset, quid consecutum est? Mittuntur angeli Sodomam (Gen. XIX, 1, seqq.), proficiscuntur, introeunt, bonorum foventur officio, malorum vexantur injuria; caecantur improbi, salvantur probi. Loth cum affectibus piis urbe educitur: urbs cum habitatoribus impiis concrematur. Interrogo hic utrumnam Deus ex judicio malos, an sine judicio concremarit? Qui sine judicio Sodomitas punitos a Deo dicit, iniquum Deum arguit. Si autem cum judicio malos perdidit, judicavit. Judicavit utique; et quidem jam quasi ad instar futuri judicii judicavit. Cum enim ad supplicium malorum gehennam in futurum arsuram esse manifestum sit, Sodomam et vicinas ei urbes coelestis flamma consumpserit. In praesenti autem illud quod futurum est, Deus voluit declarare judicium, quando super impium populum gehennam misit e coelo; sicut etiam apostolus dicit (II Petr. II, 6) quod Deus civitates Sodomam et Gomorrham eversione damnarit, exemplum ponens impie acturis: quamvis id ipsum quod ibi actum est, plus habuerit misericordiae quam severitatis. Quod enim poenam eorum tam diu distulit, misericordiae fuit; justitiae, quod aliquando punivit. Et ideo cum angelos Sodomam Deus mitteret, hoc nobis probare voluit, quod etiam malos puniret invitus. Scilicet ut cum legeremus quae a Sodomitis angeli pertulissent, et videremus scelerum immanitatem, criminum turpitudinem, libidinum obscenitatem; probaret utique nobis Deus quod ipse eos noluerit perdere, sed ipsi extorserint ut perirent. IX. Possum innumera proferre. Sed vereor ne dum satis rem probare nitimur, historiam texuisse videamur. Moyses in deserto positus gregem pascit (Exod. III), rubum ardere conspicit, Deum ex rubo audit, praecepta accipit, potestate exaltatur, ad Pharaonem mittitur, venit, loquitur, contemnitur, vincit. Aegyptus percutitur, Pharaonis inobedientia verberatur, et quidem non uno modo; scilicet ut plus sacrilegus torqueatur diversitate supplicii. Et quid postremo? decies rebellat, decies verberatur. Quid ergo dicimus? Puto quod in his omnibus et curare pariter res humanas Deum et judicare cognoscas. In Aegypto quippe tunc enim non simplex tantum, sed multiplex constat Dei fuisse judicium. Quotiescunque enim rebellantes Aegyptios percussit, toties judicavit. Sed post ista quae diximus, quid secutum est? Israel dimittitur, pascha celebrat, Aegyptios spoliat, dives abscedit, Pharaonem poenitet, exercitum contrahit, ad fugientes pervenit, castris jungitur, tenebris separatur, siccatur pelagus, Israel graditur, officiosa undarum patientia liberatur. Pharao sequitur, mare super eum volvitur, fluctu operiente deletur. Puto jam non obscurum in his quae acta sunt Dei esse judicium, et quidem non judicium tantum, sed etiam moderationem atque patientiam. Patientiae enim fuit quod Aegyptii rebellantes saepe percussi sunt; judicii, quod contumaciae pertinaces morte damnati. Igitur post hunc rerum gestarum ordinem ingreditur eremum victrix sine bello gens Hebraeorum. Agit iter sine itinere, viatrix sine via, praevio Deo, divino commilitio honorabilis, ductu coelesti potens, sequens mobilem columnam, nubilam die, igneam nocte, congruas colorum diversitates pro temporum diversitate sumentem; scilicet ut et diei lucem lutea obscuritate distingueret, et caliginem noctis flammeo splendore claritatis radiaret. Adde huc fontes repente natos, adde medicatas aquas vel datas vel immutatas, speciem servantes, naturam relinquentes. Adde aperta erumpentibus rivis montium capita, adde scaturientia novis pulverulenta arva torrentibus, adde inlatos itinerantium castris alitum greges Dei pietate indulgentissima, non usibus tantum hominum, sed etiam inlecebris servientes, datum per quadraginta annos astris quotidie famulantibus cibum, rorantes jugiter escis dulcibus polos, non ad victum tantum, sed etiam ad delicias profluentes. Adde homines in nullis membrorum suorum partibus accessus et decessus humanorum corporum nescientes, ungues non auctos, dentes non imminutos, capillos semper aequales, non attritos pedes, non scissas vestes, calciamenta non rupta, redundantem hominum honorem usque ad induviarum vilium dignitatem. Adde huc erudiendae gentis officio descendentem ad terras Deum, accommodantem se terrenis visibus Deum filium, innumerae multitudinis plebem in consortium divinae familiaritatis admissam, sacrae amicitiae honore pollentem. Adde huc tonitrua, adde fulgura, terribiles buccinarum coelestium sonos, tremendum undique totius aeris fragorem, polos sacris clangoribus mugientes, ignes, caligines, nebulas Deo plenas, loquentem cominus Dominum, legem divino ore resonantem, incisas digito Dei litteras, rupices paginas, saxeum volumen, discentem populum, et docentem Deum, ac mixtis pene hominibus atque angelis unam coeli ac terrae scholam. Sic enim scriptum est, quod cum retulisset Moyses verba populi ad Dominum, dixerit ei Dominus: Jam nunc veniam ad te in caligine nubis, ut audiat me populus loquentem ad te (Exod. XIX, 9). Et paulo post: Ecce, inquit, coeperunt audiri tonitrua, ac micare fulgura et nubes densissima operire mentem (Ibid., 16). Et iterum: Descenditque (Dominus) super montem Sina in ipso montis vertice (Ibid., 20). Ac deinceps: Loquebaturque cum Moyse, videntibus universis quod columna nubis staret ad ostium tabernaculi; stabantque et ipsi, et adorabant per fores tabernaculorum suorum. Loquebatur Dominus ad Moysen facie ad faciem, sicut loqui solet homo ad amicum suum (Exod. XXXIII, 9-11). Quae cum ita sint, videturne habere hominis curam Deus, haec tanta tribuens, haec tanta praestans, participem sermonis sui vilem homunculum faciens, et quasi in consortium sacrae sodalitatis admittens, aperiens ei plenas divitiis immortalibus palmas suas, alens eos nectaris poculo, pascens coelesti cibo? Quam, rogo, majorem eis gubernaculi sui praestare curam, quem majorem praestare potuit affectum, quam ut cum praesentis saeculi vitam agerent, speciem jam futurae beatitudinis possiderent? X. Sed respondeatur forte hoc loco, habuisse quondam hanc hominum curam Deum; caeterum nunc penitus non habere. Unde hoc ita credimus? forsitan quia, ut illi tunc, mannam quotidie non comedimus, cum agros triticeos plenos messibus demetamus; quia coturnices humanis se manibus ingerentes non apprehendimus, cum omnia avium, pecudum, bestiarum genera devoremus; quod salientes rupibus aquas apertis oribus non excipimus, cum vinarias domos vinearum fructibus inrigemus? Addo ego amplius aliquid, quod nos ipsi, qui illos tunc Deo curae fuisse et nos a Deo negligi dicimus, si accipere pro praesentibus bonis praeterita possemus, respueremus penitus conditionis istius optionem. Nollemus enim haec quae nunc habemus amittere, ut possemus ea quibus tunc illi usi sunt possidere; non quod nos meliora nunc habeamus quam gens illa tunc habuit, sed quia et illi qui quotidiano tunc coeli ac Dei ministerio pascebantur, antiquam ventris ingluviem bonis praesentibus praeferebant, turpissima scilicet ciborum carnalium recordatione moesti, et fetidissimo caeparum atque alliorum amore aegrescentes : non quod potiora essent quibus antea usi erant, sed quia, quod nunc a nobis fit, hoc tunc ab illis. Illi horrebant quae erant, et quae non erant desiderabant. Nos magis laudamus illa quae tunc fuerunt quam ista quae nunc sunt, non quia si eligendi facultas esset, semper habere illa mallemus, sed quia usitatum hoc humanae mentis est vitium, illa magis semper velle quae desunt. Et quia, ut ille ait, aliena nobis, nostra plus aliis placent, accidit quoque illud quod generale ferme est omni homini, ut Deo semper ingratus sit; insitoque hoc et quasi nativo malo se cuncti invicem vincunt, ut beneficiis Dei detrahant, ne debitores se esse cognoscant. Sed haec hactenus. Nunc ad negotii dudum coepti ordinem revertamur; quamvis, ut reor, non mediocriter jam probaverimus quae proposuimus; sed addamus tamen adhuc, si placet, quippiam: quia melius est plus probare aliquid quam necesse est, quam minus forsitan quam negotio debeatur. XI. Liberatus quondam de Pharaonis jugo populus Hebraeorum, ad Sina montem praevaricatus est, et statim a Domino pro errore percussus. Sic enim scriptum est: Percussit ergo Dominus populum pro errore vituli quem fecerat Aaron (Exod. XXXII, 35). Quod potuit majus et evidentius de peccatoribus Deus ferre judicium, quam ut statim consequeretur poena peccantes? Et tamen cum omnis populus reus fuerit, cur non est in omnes missa damnatio? Quia pius scilicet Dominus partem percussit sententiae suae gladio, ut partem corrigeret exemplo, praeberetque omnibus simul et coercendo censuram et indulgendo pietatem. Censura enim fuit quod castigavit, pietas quod pepercit: quamvis utrumque impari modo. Plus siquidem tunc pietati datum est quam severitati. Ideo utique, quia cum indulgentissimus Dominus propensiorem se semper miserationi praestet quam ultioni, licet in coercenda tunc Judaici exercitus parte judicio ac severitati censura divina aliquid attribuerit, majorem tamen sibi populi portionem pietas vindicavit: specialiter quidem hoc, et peculiari tunc innumerae plebis misericordia; ne omnes scilicet quos reatus complectebatur, poena consumeret. Caeterum erga quasdam personas, ut legimus, ac familias censura Dei inexorabilis est; sicut illud, ubi otiante sabbatis populo, is qui colligere ligna usurparat, occidi jubetur (Num. XV, 35) : quamvis enim opus ipsum hominis videretur innoxium, faciebat tamen eum diei observatio criminosum. Vel cum duobus lite certantibus, unus qui blasphemarat, morte multatur. Sic enim scriptum est: Ecce autem filius mulieris Israelitidis quem pepererat de viro Aegyptio inter filios Israel, jurgatus est in castris cum viro Israelite. Cumque blasphemasset nomen Domini, et maledixisset ei, adductus est ad Moysen (Levit XXIV, 10, 11). Et paulo post: Miserunt, inquit, eum in carcerem, donec viderent quid juberet Dominus. Qui locutus est ad Moysen, dicens: Educ blasphemum extra castra, et ponant omnes qui audierunt manus super caput ejus, et lapidet eum populus universus (Ibid. 12-14). Nunquid non praesens Dei est manifestumque judicium, et prolata quasi juxta humani examinis formam coelesti disceptatione sententia? Primum, qui peccaverat comprehensus est; secundo, quasi ad tribunal adductus; tertio, accusatus; deinde in carcerem missus; postremo, coelestis judicii auctoritate punitus. Porro autem non punitus tantum, sed punitus sub testimonio; ut damnare scilicet videretur reum justitia, non potestas: exemplo scilicet ad cunctorum emendationem proficiente, ut ne quis postea admitteret quod omnis in uno populus vindicasset. Hac igitur ratione atque judicio omnia Deus et nunc agit et semper egit, scilicet ut correctioni omnium proficeret quidquid singuli pertulissent. Sicut etiam et illud fuit, cum Abiu et Nadab, sacerdotalis sanguinis viri, coelesti igne consumpti sunt (Num. XXVI; Levit. X; II Paral. XXIV); in quibus utique non judicium tantum, sed praesens Deus ostendere voluit impendensque judicium. Sic enim scriptum est quod cum egressus ignis a Domino devorasset holocaustum (Levit. IX, 24), arreptis Nadab et Abiu filii Aaron thuribulis, posuerunt ignem et incensum desuper, offerentes coram Domino ignem alienum: quod eis praeceptum non erat. Egressusque ignis a Domino, devoravit eos, et mortui sunt coram Domino (Levit. X, 1, 2). Quid enim aliud quam extentam super nos dexteram suam et imminentem jugiter gladium voluit ostendere, qui errorem supradictorum statim in ipso opere punivit, nec pene prius peractum est facinus peccantium, quam ulcisceretur poena peccatum? Quamvis non id tantum in hac re actum sit, sed etiam multa alia. Cum enim in illis tunc non mens impia, sed facilitas nimium inconsulta punita sit, declaravit profecto Dominus quo supplicio digni essent qui contemptu Divinitatis aliquid admitterent, quando etiam illi percussi a Deo essent qui sola mentis inconsideratione peccassent, aut quam rei essent qui contra jussionem Domini sui facerent, cum etiam illi taliter plecterentur qui injussa fecissent. Porro autem etiam ex hoc consulere Deus voluit nostrae correctioni per censuram salubris exempli, ut omnes laici intelligerent quantum iram Dei timere deberent, cum a praesenti poena filios sacerdotis nec meritum parentis eriperet, nec ministerii sacri privilegium vindicaret. Sed quid ego de his dico quorum inconsiderantia quodammodo Deum tetigit et ad coelestem injuriam redundavit? Maria contra Moysen loquitur, et punitur; nec punitur tantum, sed judicii more punitur. Primum enim ad judicium vocatur, deinde arguitur, tertio verberatur. In objurgatione excipit vim sententiae, in lepra autem patitur piaculum criminosae: quamvis coercitio istiusmodi non Mariam tantum, sed etiam Aaronem humiliaverit, quia etsi deformari lepra summum antistitem non oportuit, et ipsum tamen Domini castigatio flagellavit: nec solum hoc, sed in poenam quam Maria patitur, Aaron etiam quasi culpae particeps coercetur. Maria enim supplicio afficitur, ut Aaron confusione mulctetur. Porro autem ut inexorabilem in quibusdam agnosceremus formam divini esse judicii, ne illius quidem intercessu qui laesus fuerat indulsit. Sic enim legimus ad Aaronem et Mariam dixisse Dominum: Quare igitur non timuisti detrahere servo meo Moysi? iratusque abiit. Et ecce Maria apparuit candens lepra quasi nix; clamavitque Moyses ad Dominum dicens: Obsecro, Domine, sana eam. Cui respondit Dominus: Si pater ejus spuisset in faciem illius, non debuerat saltem decem dierum rubore suffundi? Separetur septem diebus extra castra, et postea revocabitur (Num. XII, 8-14). Sufficiant igitur de hoc genere divisionis et de hac parte sermonis ista quae diximus. Infinitum enim est de omnibus disputare, quae nimis longum est etiam sine disputatione numerare. Sed adhuc tamen aliquid addamus. XII. Poenitet gentem Hebraeorum de Aegypto recessisse (Exod. XVI), percutitur; dolet deinde fatigari se labore itineris, affligitur; carnes desiderat, verberatur. Et quia quotidie mannam edens explere inlecebris cupit ventris ingluviem, optata quidem cupiditate saturatur, sed in ipsa tamen saturitate torquetur. Adhuc enim, inquit Scriptura, esca erat in ore ipsorum, et ira Dei ascendit in eos. Et occidit plurimos eorum, et electos Israel impedivit (Psal. LXXVII, 30, 31). Og contra Moysen rebellat, exstinguitur (Deut. III). Core conviciatur, obruitur. Dathan et Abiron murmurant, devorantur (Num. XVI). Aperta est enim, inquit, terra, et deglutivit Dathan, et operuit synagogam Abiron (Psal. CV, 17). Ducenti quoque et quinquaginta, ut sacer sermo testatur, principes viri qui tempore concilii per nomina vocabantur, surrexerunt contra Moysen: Cumque stetissent contra Moysen et Aaron, dixerunt: Sufficiat vobis, quia omnis multitudo sanctorum est, et in ipsis est Dominus. Cur elevamini super populum Domini (Num. XVI, 3)? Et quid post haec? Ignis, inquit, egressus a Domino interfecit ducentos quinquaginta viros qui offerebant in censum (Ibid., 35). Sed cum haec tanta fierent, coelestis cura non profuit. Adhibita est saepissime coercitio, sed emendatio non est secuta. Sicut enim nos, cum flagellamur assidue, non corrigimur, ita et illi cum caederentur saepissime, non emendabantur. Quid enim scriptum est? Murmuravit autem omnis multitudo filiorum Israel sequenti die contra Moysen et Aaron, dicens: Vos interfecistis populum Domini (Num. XVI, 41). Et quid postea? Percussa sunt statim et divino igne consumpta quatuordecim millia hominum et septingenti. Cum omnis ergo tunc populi multitudo peccaverit, cur non est in omnibus vindicatum? praesertim cum ex illa quam supra dixi seditione Core nullus evaserit. Cur ibi cunctum peccantum coetum interfici Deus voluit, hic tantummodo portionem? Scilicet quia plenus et justitiae et misericordiae Dominus, et pietati suae multa donat per indulgentiam, et severitate punit per disciplinam. Et ideo ibi praestitit disciplinae, ut proficeret cunctorum emendationi poenam omnium noxiorum; hic autem misericordiae suae tribuit, ne universus populus deperiret. Et tamen cum tam misericorditer egerit, quia in parte plebis castigatio toties repetita non profuit, ad ultimum omnes morte damnavit. Quae res et timori et emendationi nostrae simul proficere deberet, scilicet ne qui illorum exemplo penitus non corrigimur, illorum fortasse exitu puniamur. Non enim dubium est quid actum de eis fuerit. Nam cum universa gens Hebraeorum ad hoc de Aegypto exierit ut terram repromissionis intraret, praeter duos tantum sanctos nullus intravit. Sic enim scriptum est: Locutus est Dominus ad Moysen et Aaron, dicens: Usquequo multitudo haec pessima murmurat contra me? Vivo ego, ait Dominus: sicut locuti estis ante me hodie, sic faciam vobis. In solitudine hac jacebunt cadavera vestra (Num. XIV, 26, 29). Et quid postea? Parvulos, inquit, vestros de quibus dixistis quod praedae hostibus forent, introducam ut videant terram quae vobis displicuit. Vestra cadavera jacebunt in solitudine (Ibid., 31, 32). Et quid deinde? Omnes, inquit, mortui sunt atque percussi in conspectu Domini (Ibid., 36, 37). Quid est quod in his omnibus non sit? Vis videre rectorem? Ecce et praesentia corrigit, et futura disponit. Vis videre severum judicem? Ecce noxios punit. Vis videre justum et pium? Ecce innocentibus parcit. Vis videre in omnibus judicem? Ecce ubique judicium est. Nam et ut judex arguit, et ut judex regit. Judex promit sententiam, judex noxios perimit, judex innoxios muneratur.
|
AU SAINT ÉVÊQUE SALONIUS,
Salut dans le Seigneur. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Tous les hommes qui ont cru remplir un devoir envers le public en composant quelques écrits, ont mis un soin tout spécial, quelques sujets qu'ils traitassent, soit utiles et honnêtes, soit inutiles et immoraux, à enrichir d'expressions brillantes leurs matières disposées avec ordre, et à donner par la propriété des termes un nouveau jour aux questions qu'ils voulaient agiter. Ainsi en ont usé la plupart des poètes et des orateurs profanes, se mettant peu en peine de la vraisemblance et de l'utilité des sujets qu'ils traitaient, pourvu que leur poésie offrit des vers élégants et harmonieux, et leur prose un langage riche et éclatant. Car tous dans leurs écrits n'ont songé qu'à eux, et consultant plutôt leur propre renommée que l'intérêt d'autrui, ils se sont moins efforcés d'être utiles et salutaires que de paraître habiles et diserts. Voilà pourquoi leurs ouvrages ou ne présentent qu'une vaine enflure, ou ne respirent que la fausseté et l'infamie, ou souillent le cœur d'expressions dégoûtantes, ou salissent l'imagination par l'obscénité des faits. Ainsi, ces auteurs n'ambitionnant que le titre de beaux génies, et tout occupés de blâmables études, ont moins travaillé, ce semble, à polir qu'à dépraver les esprits. Pour moi, attachant plus de prix aux choses qu'aux paroles, préférant le bien public aux ap-applaudissements, je ne cherche pas à faire louer en moi les vains ornements du siècle, mais des avantages solides et réels. Je ne veux point offrir dans mes faibles écrits de frivoles agréments, mais des remèdes qui aient pour but moins de plaire à des oreilles oisives, que de guérir des cœurs malades. J'espère par là, avec l'aide du ciel, recueillir des fruits abondants. Si mes efforts peuvent détromper quelques personnes des fausses opinions qu'elles se forment de la Providence, ce ne sera pas un petit avantage de leur avoir été utile ; mais si je n'y réussis pas, j'aurai du moins la consolation de l'avoir essayé. Car des intentions droites et de pieux désirs, quand ils n'obtiendraient pas leur but, auraient toujours leur récompensé. D'après cela, je vais donc commencer. LIVRE PREMIER.Opinions des anciens philosophes sur la Providence de Dieu. — Les Épicuriens sont les seuls qui la nient. — Les impies sont indignes des prospérités de cette vie. — Les justes ne sont pas à plaindre dans les afflictions. — Eux seuls possèdent le bonheur. — Preuves tirées de l'exemple des premiers Romains. — Autres preuves fondées sur l'exemple des anciens philosophes. — Faux raisonnements des impies. — Les justes abattent les forces du corps pour augmenter celles de l'âme. — Leurs adversités ne sont que de frivoles objections contre la Providence. — Une providence humaine prouve celle de Dieu. — Preuves de la Providence tirées de l'Écriture. — Création du premier homme, le déluge, divers incidents de la vie d'Abraham, châtiment de Sodome, vocation de Moïse, sa mission, délivrance des Israélites, punition des Egyptiens, les Hébreux dans le désert, Dieu leur donne sa loi. — Les bienfaits de Dieu ne sont pas moins grands aujourd'hui. — Pourquoi Dieu n'extermine pas tous les pécheurs. — Exemples de sa miséricorde. — Exemples de sa sévérité, punition de Nadab et d'Abiu, punition de Marie sœur de Moïse. —Enumération de plusieurs châtiments qui prouvent la justice comme la clémence de Dieu. — Récapitulation générale. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Livre Premier.Il est des hommes qui accusent le Ciel de ne point se mêler des affaires humaines, comme ne protégeant pas les bons et ne réprimant pas les méchants. De là vient, disent-ils, que dans ce monde, on voit si souvent les justes dans le malheur et les impies dans la prospérité. Pour réfuter ces blasphèmes, la parole divine seule devrait suffire, puisque c'est à des Chrétiens que nous nous adressons ; mais parce que la plupart d'entre eux conservent encore des restes de l'incrédulité païenne, il pourrait se faire qu'ils préférassent l'autorité de ces sages du paganisme admis peut-être au nombre des élus. Nous allons donc prouver qu'ils n'ont jamais formé ces doutes injurieux à la Providence ; eux cependant qui étrangers à la vraie religion, ne pouvaient connaître Dieu d'aucune manière, parce qu'ils ignoraient la loi qui en donne la connaissance. Pythagore, que la philosophie elle-même a toujours admiré comme son maître, s'exprime ainsi quand il parle de la nature et des bienfaits de Dieu : C’est une âme répandue dans tous les êtres de la nature et dont tous les animaux sont tirés.[1] Comment dire après cela que Dieu néglige le monde ? N'est-ce pas l'aimer assez que de se répandre dans toutes les parties de ce vaste corps ? Platon et ses disciples regardent Dieu comme le modérateur de toutes choses. Les Stoïciens le comparent à un sage pilote veillant sans cesse au vaisseau qu'il dirige. Quelle idée plus juste et plus religieuse pourraient-ils nous donner de l'amour et de la vigilance de Dieu que de l'assimiler à un pilote ? Voulant sans doute nous faire entendre que, semblable au pilote qui sur mer n'abandonne jamais son gouvernail, Dieu de son côté prend un soin continuel des choses de la terre. Le pilote examine les vents, évite les écueils, considère les astres, et consacre à son emploi toutes les puissances de son corps et de son esprit. Tel est le Créateur : jamais il ne détourne-de l'univers ses regards paternels, jamais sa bienveillance ne cesse d'y répandre des bienfaits, jamais on ne voit sa bonté en interrompre le cours. Aussi Virgile, en rappelant à ce sujet les opinions mystérieuses des sages de l'antiquité, se montre non moins philosophe que poète. Dieu remplit, disent-ils, le ciel, la terre et l'onde.[2] Cicéron dit aussi : Dieu lui-même ne se présente à nous que sous cette idée d’un esprit pur, sans mélange, dégagé de toute matière corruptible, qui connaît tout, qui meut tout. — Et ailleurs : Rien n'est au dessus de Dieu. Il gouverne donc nécessairement le monde ; il n'est donc ni dépendant de la nature, ni soumis à ses lois ; il en est donc le souverain universel. A moins que nous n'allions croire dans notre orgueilleuse sagesse que celui qui régit toutes choses, les gouverne et les néglige à la fois. Si donc ces sages illustres, sans être éclairés des lumières de la vraie religion, entraînés par je ne sais quelle irrésistible nécessité, n'ont pu s'empêcher d'avouer que Dieu connaît, meut et régit toutes choses, se trouvera-t-il encore des hommes qui l'accusent de ne point se mêler des affaires humaines, lorsqu'il les connaît par sa prescience, les meut par sa force, les régit par sa puissance, et les conserve par sa bonté ? Voilà ce que les princes de la philosophie et de l'éloquence humaine ont pensé de la grandeur et de la providence de Dieu. J'ai cité à dessein ceux qui ont excellé dans ces deux arts sublimes, afin de montrer plus facilement que tous les autres ont été du même sentiment, ou du moins que des opinions contraires ne portent sur aucune autorité. Et certes, il serait difficile de rencontrer des philosophes qui pensent autrement de Dieu, excepté les Épicuriens et leurs sectateurs qui, dans leurs folles rêveries, alliant la volupté avec la vertu, croient pouvoir allier aussi l'incurie et l'indolence avec la Divinité. Il faut, pour penser de la sorte, partager non seulement les idées des Épicuriens, mais encore leurs excès et leurs vices. II. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'employer ici les divins témoignages de l'Ecriture pour prouver une vérité si incontestable ; alors surtout que les pages saintes contredisent manifestement les sacrilèges prétentions des impies ; de sorte qu'en répondant aux calomnies qu'ils avanceront plus tard, nous pouvons réfuter abondamment les erreurs dont il a été parlé déjà. Dieu, disent-ils, laisse aller toutes choses à l'aventure, parce qu'il ne réprime pas les méchants et ne protège pas les bons, et ainsi dans ce monde la condition des gens de bien est la plus déplorable ; car, les bons vivent dans la pauvreté, les méchants dans l'abondance ; les bons, dans la faiblesse, les méchants, dans la force ; les bons, toujours dans le deuil, les méchants, toujours dans la joie ; les bons, dans la misère et l'abjection, les méchants, dans la prospérité et les honneurs. Et d'abord, je demande à ceux qui de là prennent occasion ou de plaindre le sort des gens de bien, ou d'accuser la Providence, si ces plaintes ont pour objet les saints, c'est-à-dire, les vrais et fidèles chrétiens, ou bien les faux chrétiens et les imposteurs. Sont-ce les faux chrétiens ? Vaine compatissance que celle qui déplore l'infortune des méchants ! La prospérité ne fait que les endurcir, ravis qu'ils sont de voir leur malice couronnée d'heureux succès. Ils doivent au contraire être accablés de misères pour cesser d'être méchants, ces hommes qui couvrent de criantes injustices du voile de la religion, et qui cachent les plus infâmes commerces sous des dehors de sainteté. Certes, si l'on veut comparer leurs disgrâces avec leurs crimes, on les trouvera moins malheureux qu'ils ne méritent, parce que, quelque revers qu'ils éprouvent, leur infortune n'approche pas de leur impiété. Pourquoi donc les plaindre s'ils ne sont ni riches ni heureux ? Bien moins encore faut-il plaindre les saints ; quelque affligés qu'ils paraissent à ceux qui ignorent les secrets du ciel, ils ne peuvent cependant qu'être heureux. C'est peine inutile de regarder les maladies, la pauvreté et les autres accidents de la vie comme des maux pour eux, tandis qu'ils y trouvent la source de leur bonheur. C'est le sentiment de notre cœur, et non pas l'opinion d'autrui qui nous rend malheureux. Et voilà pourquoi l'on ne peut être malheureux dans les faux jugements des hommes, quand on est heureux dans sa conscience. Car nul, ce semble, n'est plus heureux que celui qui agit au gré de ses désirs. Les hommes religieux sont humiliés, mais ils aiment les humiliations ; ils sont pauvres, mais ils se complaisent dans la pauvreté ; ils vivent sans ambition, mais ils dédaignent le faste ; ils restent dans l'obscurité, mais ils fuient les honneurs ; ils pleurent, mais les larmes leur semblent douces ; ils sont faibles. Mais ils se réjouissent dans leur faiblesse. Car, dit l'Apôtre, lorsque je suis faible, alors je suis fort. Il a raison de penser ainsi, après avoir entendu ces paroles de la bouche de Dieu même : Ma grâce te suffit, car la force se perfectionne dans la faiblesse. Pourquoi donc plaindre les afflictions, les infirmités, lorsque nous savions qu'elles sont mères des vertus ? Ainsi, quoiqu'il puisse arriver, quiconque est vraiment religieux, doit être regardé comme possédant le bonheur ; car dans la condition la plus dure, la plus pénible, nul n'est plus heureux que celui qui est ce qu'il veut être. Quoiqu'il se rencontre des hommes qui, poursuivant de sales et honteux plaisirs, sont heureux dans leur opinion, parce qu'ils obtiennent ce qu'ils recherchent, cependant ils sont loin de l'être en effet ; ce qu'ils veulent, ils n'auraient jamais dû le vouloir. Or y. le bonheur dès gens de bien est d'autant plus complet qu'ils ont ce qu'ils souhaitent, et qu'ils ne sauraient rien avoir de meilleur que ce qu'ils ont. Aussi, le travail, le jeune, la pauvreté, les humiliations et les infirmités n'ont rien de si pénible pour ceux, qui les supportent, mais bien pour ceux qui refusent de les supporter Si tous ces maux paraissent légers ou pesants, ce sont les dispositions de lame qui les rendent tels. Car, comme il n'est rien de si facile qui ne semble pénible à qui le fait à contrecœur, de même aussi n'est-il rien de si pesant qui ne paraisse léger à qui le fait volontiers. A moins par hasard que ces hommes d'une antique vertu, les Fabius, les Fabricius, les Cincinnatus ne vous semblent avoir été sensibles à l'indigence, eux qui ne voulaient pas être riches, eux qui, consacrant tous leurs soins, tous leurs efforts à l'utilité commune, enrichissaient de leur pauvreté privée les forces naissantes de la république. Est-ce que cette vie sobre et agreste avait des douleurs et des gémissements, alors qu'ils prenaient devant le foyer où ils l'avaient eux-mêmes apprêtée, cette nourriture modeste et rustique dont ils ne pouvaient user que vers le soir ? Est-ce qu'ils déploraient, dans un cœur avare et insatiable, de ne pouvoir entasser des talents d'or, quand, ils réprimaient par des lois jusqu'à l'usage de l'argent ? Est-ce qu'ils-regardaient comme le supplice de l'ambition et de la cupidité de ne point voir leurs coffres regorger de pièces d'or, alors qu'ils jugeaient indignes du sénat un homme de race patricienne, qui avait voulu possèdes : jusqu'à dix livres d'argent ? Ils ne méprisaient pas, je pense, de pauvres vêtements, lorsqu'ils portaient une robe étroite et rude, lorsqu'ils étaient appelés de la charrue aux faisceaux et que sur le point d'endosser les ornements de consul et de dictateur, ils abattaient peut-être avec ces toges brillantes qu'ils allaient revêtir, la poussière de leur front trempé de sueur. Aussi ces magistrats indigents avaient une république opulente. Aujourd'hui les trésors du pouvoir appauvrissent la république. Eh ! je le demande, quelle folie, quel aveuglement de s'imaginer que des richesses privées puissent exister dans un état pauvre et mendiant ? Tels étaient donc ces vieux Romains ; et sans connaître Dieu, ils dédaignaient les richesses, comme les méprisent à présent ceux qui suivent le Seigneur. Au reste, pourquoi parler de ces hommes qui dans la vue d'agrandir l'empire, contribuaient du mépris de leurs biens à l'accroissement de l'opulence publique ? Quoiqu'ils fussent pauvres en particulier, ils se ressentaient pourtant de l'abondance commune. Quelques Grecs, sectateurs de la sagesse, sans aucun zèle pour la chose publique, ne se sont-ils pas aussi dépouillés de presque tout leur patrimoine, par l'avidité d'une vaine gloire ? Bien plus, n'ont-ils pas porté jusqu'au mépris de la douleur et de la mort la perfection de leur philosophie, prétendant que le sage est heureux même dans les fers et les supplices ? Le pouvoir de la vertu, disaient-ils, est si grand, qu'il est impossible à l'homme de bien de n'être pas toujours dans le bonheur. Si donc quelques personnes faisant profession de sagesse, sont loin de regarder comme malheureux ceux qui ne retiraient de leurs travaux d'autre fruit qu'une gloire passagère, combien moins faut-il appeler malheureux ces hommes saints et religieux qui goûtent les délices de la foi présente, et attendent les récompenses de la béatitude future ? III. Un de ces ennemis de la Providence disait à un saint homme qui, dans son opinion conforme aux règles de la vérité, croyait que Dieu régit toutes choses, qu'il exerce un pouvoir nécessaire aux hommes, et qu'il tient en main le gouvernail du monde : « D'où vient que vous êtes si infirme ? » Ce qui signifie en d'autres termes : « Si Dieu, comme vous le pensez, régit tout dans cette vie présente, s'il dispense tout, pourquoi cet homme que je sais être pécheur est-il plein de force et de santé ? pourquoi êtes-vous accablé de faiblesse, vous dont la vie est irréprochable ? » — N'admirez-vous point la profondeur de ce bel esprit qui assigne d'assez hautes récompenses aux mérites et aux vertus des Saints, pour croire que l'embonpoint et la vigueur du corps, dans cette vie présente, doivent être le seul apanage des justes ? Je réponds donc, et ce n'est pas seulement au nom d'un homme religieux, mais au nom de tous : — Vous me demandez, vous, pourquoi les justes sont accablés d'infirmités ? — Je réponds brièvement : Les hommes saints s'affaiblissent eux-mêmes dans la crainte qu'un corps trop robuste ne devienne, pour eux un obstacle à la sainteté. Car tous les hommes, je pense, deviennent forts par l'usage de nourritures délicates et de boissons délicieuses, faibles par l'abstinence, l'aridité des mets et des jeûnes. Rien donc de surprenant si l'on est faible quand on se prive de ce qui donne de la vigueur aux autres. Et la raison pour laquelle ils en agissent ainsi, l'apôtre saint Paul nous l'apprend en disant de lui-même : Je châtie rudement mon corps et le réduis en servitude, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. Si l'apôtre estime comme si désirable l'infirmité du corps, qui est sage de l'appréhender ? Si l'apôtre redoute la vigueur de la chair, qui est raisonnable de la désirer ? Et voilà pourquoi les hommes dévoués au Christ sont faibles et veulent l'être. Nous lisons que l'apôtre Timothée était d'une complexion très délicate. Etait-il négligé par le Seigneur, ou plaisait-il moins au Christ à cause de son infirmité, lui qui voulait être infirme dans le dessein de lui plaire ? L'apôtre Paul lui-même connaissant bien les maladies qui le travaillaient, ne lui permit cependant de prendre et de goûter, pour ainsi parler, qu'un peu de vin. Je veux dire qu'il lui permit de remédier à son infirmité, sans lui permettre toutefois d'arriver à une santé parfaite. Et pourquoi cette conduite ? Pourquoi ! si ce n'est sans doute, comme il le dit lui-même, parce que la chair s'élève contre l’esprit, et l’esprit contre la chair ; de sorte que vous ne faites pas les choses que vous voudriez. On a donc eu raison de dire à ce sujet que, si la force du corps nous empêche de faire ce que nous désirons, il nous faut abattre cette vigueur pour suivre les mouvements de l'esprit. Car l’affaiblissement de la chair donne à l’âme une force nouvelle, et dans des membres atténués, la vivacité du corps passe à l’intérieur pour la pratique des vertus. Le cœur ne brûle plus de feux impurs, de secrètes étincelles n'y allument plus de désirs insensés, les sens ne folâtrent plus vagabonds, emportés par mille séductions ; mais l’âme seule triomphe, satisfaite de voir le corps abattu, comme un ennemi subjugué. Voilà, comme je l'ai dit, le motif qui porte les Saints à maltraiter leur chair, et vous en conviendrez, je pense. IV. Mais, allez-vous m'objecter peut-être, il est d'autres maux bien plus graves. Ils éprouvent dans cette vie mille rigueurs, mille amertumes ; ils sont chargés de fers, ils sont torturés, ils sont livrés à une mort violente. Je l’avoue ; mais les prophètes aussi ont été emmenés en captivité, les apôtres aussi ont passé par les tourments. Et certes, peut-on croire que Dieu les regardât avec indifférence, lorsqu'ils souffraient pour lui ? Mais ce qui vous confirme, dites-vous, dans la pensée que Dieu néglige les choses de ce siècle, et qu'il se réserve pour le jugement futur de faire éclater sa justice, c'est que les bons souffrent toujours, et que les médians font souffrir. Cette assertion n'est point, il est vrai, d'un incrédule, puisqu'elle renferme l'aveu d'un jugement futur. Pour nous, nous reconnaissons que le Christ jugera le genre humain, sans nier pour cela que, même dès à présent, Dieu, suivant les desseins de sa sagesse, ne soit l'arbitre et le dispensateur souverain. Et si nous confessons qu'il doit juger dans un temps à venir, nous enseignons aussi qu'il n'a pas cessé dans ce monde d'exercer un jugement. Car, en gouvernant toujours, Dieu juge toujours aussi, parce que gouverner, c'est juger. Comment voulez-vous qu'on vous le prouve ? par la raison, ou par des exemples, ou par l'autorité ? Pour commencer par la raison : quel est l'homme assez dépourvu d'intelligence, assez ennemi de la vérité dont je parle, pour ne pas reconnaître et ne pas voir que ce merveilleux ouvrage de l'univers, cette magnificence inappréciable du ciel et de la terre, est conservée par la main qui les créa, que l'auteur des éléments en est aussi le modérateur, et que, s'il forma toutes choses avec pouvoir et majesté, il les soutient aussi avec sagesse et prévoyance. Dans la simple économie humaine, tout porte l'empreinte d'une raison admirable : ainsi tous les êtres reçoivent leur conservation de la Providence, comme le corps reçoit de l’âme le mouvement et la vie. Ainsi, dans ce monde, non seulement les empires et les provinces, la paix, et la guerre, mais encore les moindres emplois, les familles, les troupeaux eux-mêmes et jusqu'aux plus petits animaux domestiques, tout ressent l'action de l'autorité et de la prudence humaine ; tout marche, dirigé, pour ainsi dire, par un bras secret et un gouvernail mystérieux. En cela, Dieu a fait éclater sans doute sa volonté souveraine et ses jugements admirables ; il voulait que l'homme apprît à gouverner les détails, et, pour ainsi parler, les membres du monde, comme il régit lui-même dans sa totalité le corps de l'univers. —A la vérité, direz-vous : Au commencement du monde, Dieu a établi cet ordre de choses, mais après avoir achevé et perfectionné son ouvrage, il a éloigné et repoussé de lui tout soin des affaires humaines ; craignant peut-être le travail, il l'a exilé de sa demeure, s'est dérobé à l'embarras de la fatigue, ou, livré à d'autres occupations, il s'est déchargé d'une partie, dans la crainte de ne pouvoir vaquer au tout. — V. —Dieu, selon vous, rejette donc loin de lui le soin des choses d'ici-bas. Quel est alors le fondement d'un culte adressé à Dieu ? quel motif d'adorer le Christ, ou quel espoir de le fléchir ? Car si Dieu, dans le siècle, néglige la race des hommes, pourquoi chaque jour élever nos mains au ciel ? pourquoi, par de fréquentes prières, implorer la divine miséricorde ? pourquoi courir dans les temples ? pourquoi se prosterner devant les autels ? car il ne sert à rien de prier, si l'on nous ôte l'espoir d'obtenir. Vous voyez donc le vide et la folie de cette assertion ; si elle est une fois admise, c'en est fait de la religion. Mais peut-être vous retrancherez-vous dans une nouvelle objection, en disant que nous honorons Dieu par la seule crainte du jugement à venir ; et que tout notre but dans l'accomplissement de nos devoirs présents, c'est de mériter au jour du siècle futur une sentence favorable. Que veut donc l'apôtre Paul, quand il recommande et qu'il ordonne chaque jour dans l'assemblée d'offrir continuellement à notre Dieu des prières, des supplications, des demandes et des actions de grâces ? Et cela pour quel motif ? —Pour quel motif ! pour quel autre, si ce n'est, comme il le dit, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Il ordonne, comme on voit, de prier et de supplier le Seigneur pour le temps présent, ce qu'il ne ferait pas sans doute s'il n'avait la confiance d'être exaucé. Comment donc peut-on penser que les oreilles de Dieu seront ouvertes pour accorder les biens à venir, tandis qu'elles sont fermées et sourdes pour refuser les biens présents ? Pourquoi, lorsque nous prions dans l'assemblée, demandons-nous à Dieu les grâces de chaque jour, si nous croyons ne pis devoir être écoutés ? Il est donc inutile de faire des vœux pour notre bonheur et notre sûreté. Au contraire, pour que l'humilité de la prière fît agréer nos demandes, il nous faudrait peut-être parler ainsi : — Seigneur, nous ne te demandons ni les prospérités de cette vie, ni les biens présents ; nous savons que tes oreilles sont fermées à ces demandes, et que tu ne saurais écouter de semblables prières. Nous te supplions seulement de nous accorder ce que tu destines aux hommes après la mort. —Je veux bien qu'une pareille demande ne soit pas sans effet ; mais comment la concilier avec la raison ? Si Dieu ne se mêle pas du soin de ce siècle, s'il ferme ses oreilles aux vœux de ceux qui le prient, comment nous exaucerait-il pour les biens futurs, lorsqu'il ne nous écoute pas pour les biens présents ? A moins peut-être que le Christ ne ferme et n'ouvre ses oreilles selon la diversité des prières, c'est-à-dire les ferme quand on lui demande des faveurs présentes, et les ouvre quand on lui demande les biens à venir. Mais en voilà bien assez sur ce sujet ; car ces attaques sont si frivoles et si peu sensées, qu'il serait à craindre que les raisonnements qui doivent servir à la gloire de Dieu, ne semblent au contraire dégénérer en injure. La majesté divine doit imprimer dans les cœurs une si profonde révérence, que l'on doit non seulement n'entendre qu'avec horreur tout ce que les impies avancent contre la religion, mais encore la défendre soi-même avec une sainte frayeur et une circonspection respectueuse. Donc, si c'est une folie et une impiété de croire que la providence de Dieu abandonne le soin des choses humaines, il faut conclure qu'elle ne les néglige pas ; si elle ne les néglige pas, elle les gouverné ; si elle les gouverne, elle juge par là même ; car il ne saurait exister de gouvernement là où le chef ne juge en aucune manière. VI. Mais peut-être pensera-t-on que l'autorité de la raison n'est pas suffisante, si elle n'est confirmée par les exemples ? —Voyons de quelle manière Dieu a gouverné le monde dès !e commencement, et nous montrerons qu'il l'a toujours gouverné de même, afin de prouver qu'il y a toujours aussi exercé sa juridiction. Que dit l’Ecri-ture ? Dieu forma l’homme du limon de la terre, il répandit sur son visage un souffle de vie. Qu'ajoute-t-elle ? Il le plaça dans un Jardin de délices. Que fit-il ensuite ? Il lui donna une loi, lui traça des préceptes, et lui imposa des règles dévie. Qu'arriva-t-il après cela ? L'homme transgressa le commandement sacré, il subit la sentence, il perdit le paradis, il porta la peine de sa désobéissance. Qui ne reconnaît en tout cela un Dieu juge et souverain ? car il établit Adam innocent dans le paradis, il l'en chasse coupable. Dans l'établissement, c'est la sagesse ; dans l'expulsion, c'est la justice. Car, lors qu'il le plaça dans un lieu de délices, il se montra sage ; lorsqu'il le chassa coupable du royaume, il se montra juste. Ainsi se manifesta la Providence à l'égard du premier homme, c'est-à-dire du père. Que fait-elle à l'égard du second, c'est-à-dire du fils ? Il arriva longtemps après que Caïn présenta au Seigneur les prémices des fruits de la terre. — Abel présenta aussi les premiers nés de son troupeau et leur graisse, et le Seigneur regarda Abel et ses dons. — Mais il ne regarda ni Caïn ni ses dons. Avant d'en venir à une explication plus détaillée du jugement de Dieu, je pense qu'il existe un certain caractère de justice dans la simple expression du fait que je viens de rapporter. En agréant le sacrifice de l'un et en repoussant celui de l'autre, Dieu jugea sans doute de la piété de celui-là et de l'impiété de celui-ci. C'est peu encore. Alors donc que préparant les voies au forfait qu'il médite, Caïn entraine son frère dans la solitude, il consomme son crime, favorisé par le secret des lieux, impie à la fois et insensé, de s'imaginer, que pour commettre ce noir fratricide, il lui suffit de se dérober à l'aspect des hommes, lui qui doit immoler son frère en présence de Dieu ! D'où je peux conclure que dès lors Caïn était déjà dans l'erreur, aujourd'hui si commune, de ceux qui prétendent que Dieu détourne ses yeux des choses de la terre, et qu'il ne voit point les crimes des méchants. Et il n'y a pas lieu d'en douter, puisqu'au sortir de son homicide, interpellé de Dieu, il répondit qu'il ne savait rien du meurtre de son frère. Il croyait Dieu assez peu instruit de sa conduite pour oser couvrir d'un mensonge un exécrable attentat. Mais qu'il fut bientôt détrompé de son erreur ! car, en commettant son homicide, il s'imaginait que Dieu ne voit point les crimes ; mais en entendant sa condamnation, il sentit qu'il est présent à tout. Je voudrais ici demander à ceux qui pensent que Dieu ne voit point les choses humaines, qu'il ne les régit point, qu'il ne les juge point, si tout ce que je viens de dire peut prêter à un sens différent. Il est présent, ce me semble, aux actions des hommes, celui qui assiste au sacrifice ; il gouverne celui qui châtie Caïn après une offrande hypocrite ; il étend ses soins sur les créatures, celui qui redemande au meurtrier le sang qu'il vient de répandre ; il juge celui qui inflige au coupable un juste châtiment. Au reste, cessons de nous étonner si les Saints éprouvent aujourd'hui quelques rigueurs, lorsque nous voyons que dès le commencement du monde Dieu laisse immoler le premier des Saints par le plus noir forfait. Il n'appartient point à la faiblesse humaine de pénétrer ce mystère, et ce n'est point ici le lieu de s'en occuper. En attendant, il suffit de prouver que de semblables événements n'arrivent point par je ne sais quelle négligence de Dieu ; mais qu'il les permet dans sa prévoyante sagesse. Et comment qualifier d'injustice ce qui témoigne incontestablement d'un jugement divin ; car la volonté de Dieu, c'est la justice souveraine. La conduite de la divinité n'est point injuste, parce que l'homme ne peut concevoir l'étendue de l'éternelle justice. Revenons à notre sujet, VII. Nous voyons donc d'après ce qui a été dit qu'il n'arrive rien sans l'ordre de Dieu, mais que parmi les actions diverses, celles-ci sont réglées par sa sagesse, celles-là tolérées par sa patience, d'autres enfin condamnées par sa justice. Quelques personnes vont penser peut-être que ces preuves sont insuffisantes puisqu'elles ne portent que sur des faits particuliers. Voyons si nous pouvons en tirer des exemples qui s'appliquent à tous les hommes ensemble. Le genre humain s'étant accru et multiplié avec son iniquité, Dieu, dit l'Ecriture sainte, voyant que la malice des hommes se multipliait sur la terre et que toutes les pensées de leurs cœurs étaient tournées au mal en tout temps, —Il se repentit de ce qu'il avait créé l’homme sur la terre ; et, ému de douleur au-dedans de lui-même : — J'exterminerai de la face de la terre, dit-il, l’homme que j’ai créé, depuis l’homme jusqu'aux animaux. Examinons comment, dans toutes ces paroles, se révèlent et la sollicitude et la sévérité du Seigneur. Car elle dit d'abord : Le Seigneur voyant, ensuite ému de douleur au-dedans de lui-même, puis enfin j'exterminerai l'homme que j'ai créé. Dieu voit toutes choses, voilà qui montre sa vigilance ; il éprouve de la douleur, voilà le trouble de la colère ; il punit, voilà la sévérité d'un juge. Il se repentit donc, dit l'Ecriture-Sainte, de ce qu'il avait créé l’homme sur la terre. Non que Dieu soit sujet ou soumis à aucune passion, mas l'écrivain sacré pour nous faciliter l'intelligence des pages saintes, s'accommode en quelque sorte à notre langage, et, sous le nom de repentir, nous dévoile toute l'étendue de la colère divine. La colère est d'un Dieu, le repentir d'un coupable. Qu'arriva-t-il après cela ? Lorsque Dieu eut vu que la terre était corrompue, — Il dit à Noé : La fin de toute chair est venue pour moi ; car la terre est remplie d'iniquité par la présence des hommes, et moi je les perdrai avec la terre. Et qu’ajoute-t-il ensuite ? — Toutes les sources du grand abime furent rompues, et les cataractes du ciel furent ouvertes ; — et la pluie tomba sur la terre durant quarante jours et quarante nuits. Et peu après : Toute chair qui vivait sur la terre fut détruite. Puis ensuite : Noé resta seul, et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Je voudrais demander ici à ceux qui accusent Dieu de ne point se mêler des affaires humaines, s'ils doutent qu'il s'en soit alors occupé ou qu'il en ait jugé ? Car, à mon avis, il n'a pas jugé seulement, mais il a été doublement juge. En conservant les bons, il se montre rémunérateur bienveillant, et juge sévère en condamnant les coupables. Peut-être ces faits pourront-ils sembler moins imposants à des hommes égarés, parce qu'ils se sont passés avant le déluge, et pour ainsi dire, dans une autre ère. Comme si Dieu n'eût pas alors été ce qu'il fut toujours, ou qu'il eût ensuite dédaigné de prendre le même soin de l'univers ! Je pourrais, il est vrai, en parcourant toutes les générations qui ont suivi le déluge, prouver sans peine ce que j'avance ; mais la longueur m'arrête, et d'ailleurs, il suffît de quelques grands événements, puisque Dieu étant l'auteur des plus mémorables comme des plus obscurs, l'on doit nécessairement entendre de ces derniers ce qui s'applique aux premiers. VIII. Après le déluge, Dieu bénit le genre humain, et sa bénédiction ayant engendré une immense multitude d'hommes, du haut du ciel Dieu parle à Abraham, lui ordonnant de quitter sa patrie, de chercher une terre étrangère. Il est appelé, il obéit, il se laisse conduire, il s'établit dans le lieu marqué ; pauvre, il devient riche ; inconnu, il devient puissant ; obscur pèlerin, il s'élève à une dignité remarquable. Mais de peur que tous ces dons ne parussent plutôt des faveurs que des récompenses méritées, il est éprouvé par des revers, lui qui ne connaissait que les joies de la prospérité. Les travaux, les dangers et la crainte deviennent dès-lors son partage. Il éprouve les ennuis d'une émigration lointaine, les fatigues de l'exil ; son honneur est attaqué, il est privé de son épouse ; Dieu lui ordonne d'immoler son fils ; malgré la tendresse paternelle, il l'offre et le sacrifie, autant qu'on en peut juger par les dispositions de son cœur. De nouveaux exils, de nouvelles craintes, l'envie des Philistins, l'enlèvement de Sara par Abimélech, de longs chagrins, mais toujours des consolations égales. Car, s'il éprouve la haine de beaucoup d'ennemis, il est vengé de tous. Eh quoi ! dans les faits que nous venons de citer, Dieu ne se montre-t-il pas sous divers caractères ? Il examine, il invite, il conduit, il est plein de sollicitude, il promet, il protège, il récompense, il éprouve, il élève, il venge et il juge. Il examine, quand il choisit seul entre tous l'homme qui lui paraît le plus juste ; il invite, quand il l'appelle ; il conduit, quand il le mène dans des lieux inconnus ; il est plein de sollicitude, quand il le visite au chêne de Mambré ; il promet, quand il lui dévoile ses desseins futurs ; il protège, quand il le garde au milieu de nations barbares ; il récompense, quand il l'enrichit ; il éprouve, quand il le soumet à diverses rigueurs ; il élève, quand il le rend plus puissant que ses voisins ; il venge, quand il châtie ses ennemis ; il juge, car punir, c'est juger. Dieu dit encore à Abraham : Le cri de Sodome et de Gomorrhe s'est multiplié, et leur péché s'est aggravé devant moi. — Le cri de Sodome et de Gomorrhe s'est multiplié ! C'est avec raison qu'il attribue un cri au péché, car le cri des pécheurs est grand, sans doute, puisqu'il monte de la terre au ciel. Mais pourquoi donner des clameurs aux péchés ? N'est-ce pas pour marquer que ses oreilles en sont frappées avec tant de violence, qu'il ne saurait différer plus longtemps le châtiment des coupables ? Ah ! qu'il faut bien que ce.cri soit grand, puisque la patience de Dieu en est lassée et forcée d'en venir à la punition ! Le Seigneur nous montre donc combien c'est à regret qu'il punit même les plus grands pécheurs ; et, quand il dit que le cri de Sodome est monté jusqu'à lui, n'est-ce pas dire : Ma miséricorde, il est vrai, me porte à pardonner, mais le cri des coupables me force à punir. Apres ces paroles, qu'arriva-t-il ? Des anges sont envoyés à Sodome ; ils partent, ils entrent, ils sont accueillis favorablement par les gens de bien, outrages par les méchants ; les médians sont frappés d'aveuglement, les justes sauvés. Loth est retiré de la ville avec les tendres objets de ses affections ; Sodome est consumée avec ses habitants criminels. Je le demande, est-ce avec délibération que Dieu a livré ces impies aux flammes, ou sans délibération ? Dire que Dieu a perdu les Sodomites sans jugement, c'est l'accuser d'injustice ; mais si cette punition est un effet de sa justice, il a donc jugé. Oui, il a jugé ; et il nous a donné par cela une image du jugement futur. Comme il est certain que le feu doit servir, dans l'autre vie, de supplice aux méchants, de même Sodome et les villes voisines ont été consumées par la flamme céleste. Dieu a voulu préluder dès ce monde au jugement futur, en faisant tomber le feu du ciel sur un peuple impie. Ainsi l'apôtre dit que Dieu a puni les villes de Sodome et Gomorrhe, en les ruinant de fond en comble, pour les faire servir d'exemple à ceux qui vivraient dans l'impiété. Et cependant cette conduite indique plus de miséricorde que de sévérité. Car différer si longtemps leur châtiment, est un effet de sa miséricorde, et les punir enfin est un acte de sa justice. Ces anges envoyés à Sodome, ne sont-ils pas pour nous une preuve que Dieu ne châtie qu'à regret même les médians ? Quand nous lisons les outrages qu'ils essuyèrent de la part des Sodomites, quand nous voyons l'énormité de leurs crimes, l'excès de leurs débauches l'infamie de leurs passions, n'est-il pas manifeste que Dieu n'a pas voulu les perdre, mais qu'ils ont eux-mêmes arraché de ses mains la sentence de condamnation ? IX. Je pourrais accumuler les exemples, mais je crains qu'en m'efforçant de rendre assez évident ce que j'avance, je ne paraisse composer une histoire. Moïse dans le désert fait paître un troupeau, il aperçoit un buisson enflammé, il entend la voix de Dieu sortir du buisson, il reçoit des ordres, une haute puissance lui est communiquée, il est envoyé à Pharaon, il vient, il lui parle, il en est méprisé, il triomphe, L'Egypte est frappée, la désobéissance de Pharaon est punie, et cela de plusieurs manières, afin que ce prince sacrilège soit plus tourmenté par cette diversité de supplices. Mais qu'arriva-t-il enfin ? Dix fois il se révolte, dix fois il est frappé. Que dirons-nous donc ? Dieu ne semble-t-il pas en tout cela et surveiller et juger les choses humaines ? car on remarque alors en Egypte, non pas un simple jugement, mais bien plusieurs jugements divers. Autant de fois en effet il frappe les Egyptiens rebelles, autant de fois il juge. Mais qu'advient-il après ces événements ? Israël est congédié, il célèbre la Pâque, il dépouille les Egyptiens, il emporte avec lui leurs richesses, Pharaon se repent, il rassemble une armée, il atteint les fugitifs, il campe sous leurs yeux, il n'en est séparé que par les ténèbres, la mer est desséchée, les Israélites s'avancent, les ondes officieuses favorisent leur retraite, Pharaon les poursuit, la mer roule sur ses troupes, il est abîmé dans les flots. La justice de Dieu ne brille-t-elle pas d'une manière visible dans cette suite d'événements, et non seulement sa justice, mais encore sa patience et sa modération ? Sa patience, quand il frappe de plaies réitérées les Egyptiens rebelles ; sa justice, quand il punit de mort l'opiniâtreté de leur révolte. Ainsi délivrés, les Hébreux entrent dans le désert, victorieux sans combats. Ils s'avancent sans route frayée, voyageurs sans voie certaine ; Dieu marche à leur tête ; honorés de la divine alliance, invincibles sous la conduite du ciel, ils suivent la colonne mobile, enveloppée d'un nuage pendant le jour, reluisante de feu pendant la nuit, accommodant ainsi la variété de ses couleurs à la diversité des temps, pour tempérer la lumière du jour par une sorte d'obscurité, et éclairer les ténèbres de la nuit de ses flammes resplendissantes. Ajoutez à cela la rencontre inopinée de sources limpides, des eaux médicinales ou données ou changées par miracle, qui conservent leur apparence extérieure en se dépouillant de leur nature. Ajoutez des rochers qui s'entrouvrent pour faire jaillir de leur sein des ruisseaux rafraîchissants, de nouveaux torrents qui s'échappent à travers les champs poudreux. Ajoutez des nuées d'oiseaux qui tombent dans le camp de ces voyageurs, et qui, par une bonté compatissante de Dieu, ne servent pas moins à apaiser la faim qu'à flatter le goût, une nourriture qui, pendant quarante années, leur est fournie chaque jour par les cieux obéissants, la rosée qui se convertit en aliments délicieux, également propres à nourrir et à plaire par leur délicatesse. Ajoutez que les corps de ces hommes ne connurent ni les accroissements ni les décroissements naturels ; leurs ongles ne grandissent point, leurs dents ne diminuent point en nombre, leurs cheveux se conservent dans le même état, leurs pieds ne se brisent point de fatigue, leurs vêtements ne s'usent point, leurs chaussures ne se rompent point ; la munificence du Seigneur se manifestant à leur égard jusqu'à donner de la dignité aux choses les plus viles qui sont à leur usage. Ajoutez à cela Dieu descendant sur la terre, pour instruire son peuple, Dieu le fils, Raccommodant aux faibles regards des mortels, une multitude sans nombre admise à l'intime familiarité du Seigneur et honorée de cette amitié sublime. Ajoutez les tonnerres, ajoutez les éclairs, les terribles retentissements des trompettes célestes, le fracas redoutable qui ébranle les airs, les mugissements des cieux frappés d'un bruit solennel, les feux perçant les ténèbres, des nuées pleines de Dieu, le Seigneur parlant de près, la loi publiée par sa bouche sacrée, et gravée par son doigt adorable, la pierre qui reçoit des pages, le rocher qui se transforme en livre, le peuple qui écoute, Dieu qui enseigne, les hommes et les anges confondus qui font du ciel et de la terre comme un seul auditoire. Car Moïse ayant rapporté au Seigneur les paroles du peuple, le Seigneur lui dit : Voilà que je viendrai à toi en l’obscurité d'une nuée, afin que le peuple m'entende te parler. Et un peu après : Voilà, dit-il, que les tonnerres commencèrent à se faire entendre, et les éclairs à briller, et une nuée très épaisse à couvrir la montagne. Et encore : Le Seigneur descendit sur le haut de la montagne de Sina. Puis enfin : Et le Seigneur parlait à Moïse. — Tous voyant que la colonne de nuée s'arrêtait à l’entrée du tabernacle, se tenaient debout, et ils se prosternaient ensuite à la porte de leurs tentes. — Or, le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Or encore une fois, Dieu semble-t-il prendre soin de l'homme, quand il le comble de si hauts bienfaits et de faveurs si éclatantes, quand il daigne converser avec un vil mortel, quand il l'admet à une sorte de fraternité, qu'il lui ouvre ses mains pleines de richesses immortelles, qu'il le désaltère d'un nectar savoureux et lui fournit une nourriture céleste ? Je le demande, quelle preuve plus réelle de sa providence, quel témoignage plus évident de son amour pouvait-il lui donner, que de lui tracer, dès cette vie présente, une image de la béatitude future ? X. On va me répondre peut-être ici que Dieu put bien autrefois prendre soin des hommes, mais qu'il ne s'en occupe plus aujourd'hui. Sur quoi serait fondée cette opinion ? Serait-ce, par hasard, sur ce que nous ne mangeons pas la manne chaque jour, comme les Hébreux ? mais nos campagnes sont couvertes de riches moissons. Sur ce que nous ne voyons plus les cailles du désert venir s'offrir à nos mains avides ? mais nous dévorons toutes sortes d'oiseaux, toutes sortes d'animaux. Sur ce que nous ne recevons point dans nos bouches haletantes les eaux jaillissant du rocher ? mais nous enrichissons nos celliers des vins les plus délicats. Je dis plus : nous qui prétendons que Dieu prenait soin de ces hommes et qu'il nous néglige, s'il nous était libre d'échanger nos biens présents contre ces faveurs passées, nous ne balancerions pas à rejeter la condition des Hébreux. Car nous ne voudrions pas nous dépouiller de ce que nous possédons maintenant, pour acquérir ce dont ils jouissaient alors. Ce n'est pas que nous ayons rien de préférable à ce qu'ils avaient en partage, mais ce peuple, nourri chaque jour par le ministère du ciel et de Dieu, préférait aux mets actuels la vile nourriture dont il s'était gorgé naguère, affligé qu'il était du honteux souvenir des viandes, et languissant de désir pour les légumes dégoûtons des Egyptiens. Le présent valait mieux sans doute que le passé, mais nous faisons ce qu'ils faisaient alors. Ils avaient en horreur ce qui existait ; et ce qui n'existait pas, ils le désiraient. Nous louons plus ce qui fut alors que ce qui est aujourd'hui. Ce n'est pas que si le choix nous était donné, nous préférassions posséder toujours ce que nous souhaitons, mais c'est le vice ordinaire du cœur humain d'aspirer à ce qu'il n'a pas. Et, comme a dit quelqu'un : Nous envions la condition d’autrui, on envie la nôtre. Presque tous les hommes ont cela de commun qu'ils paient toujours Dieu d'ingratitude. Ce travers est inné, pour ainsi dire, en nous, et attaché à notre nature ; chacun s'efforce de renchérir sur ce point, on rabat des bienfaits de Dieu pour ne point se reconnaître débiteurs. Mais je m'arrête. Revenons maintenant à notre premier sujet. Nos preuves, ce semble, doivent être de quelque poids ; mais ajoutons-y encore, car il vaut mieux prouver trop que de ne prouver pas assez. XI. Le peuple hébreu délivré enfin du joug de Pharaon prévariqua au pied du mont Sina, et fut aussitôt frappé du Seigneur pour son crime car il est écrit : Le Seigneur frappa donc le peuple parce qu'il avait sacrifié au veau qu’Aaron lui avait fait. Quel jugement plus grand et plus manifeste Dieu pouvait-il exercer sur les pécheurs, que de mettre la punition si près du crime ? Mais puisque tout le peuple était coupable, pourquoi le châtiment ne tombe-t-il pas sur tous ? Parce que le Seigneur dans sa miséricorde frappe du glaive de sa justice une partie des prévaricateurs, pour corriger l'autre par cet exemple, et pour donner à tous en même temps une preuve de sa sévérité par la punition, et de sa bonté par l'indulgence. Il fait éclater sa sévérité quand il châtie, sa bonté quand il pardonne, avec cette différence toutefois qu'il donne plus à la bonté qu'à la sévérité. Ce Dieu compatissant se montre toujours plus enclin à la miséricorde qu'à la rigueur, et s'il accorde quelque chose à la justice et à la sévérité, en frappant de mort une partie de l'armée Israélite, sa bonté cependant réclame la plus grande-portion de ce peuple. En cela, se manifestaient sur ce peuple innombrable des desseins particuliers de miséricorde, afin que le châtiment ne pesât pas sur tous ceux qui avaient pris part à la faute. Au reste, nous lisons que la justice de Dieu est inexorable à l'égard de quelques personnes et de quelques familles, témoin cet homme condamné à être lapidé pour avoir ramassé du bois pendant que le peuple observait le repos du Sabbat. Quoique cette action parût innocente en elle-même, le précepte réel la rendait criminelle ; témoin encore ces deux hommes en contestation, dont l'un fut mis à mort pour avoir blasphémé ; car il est écrit : Or, voilà que le fils d’une femme israélite, quelle avait eu d'un homme égyptien, parmi les enfants d'Israël, étant sorti, eut une querelle dans le camp avec un homme Israélite ; et lorsqu'il eut blasphémé le nom de Dieu, et l’eut maudit, il fut amené devant Moïse. Et un peu après, il dit : — On le mit en prison jusqu'à ce que l'on connût ce que le Seigneur en ordonnerait ; — Lequel parla à Moïse, — disant : Fais sortir du camp le blasphémateur ; que tous ceux qui l'ont entendu mettent leurs mains sur sa tête, et que tout le peuple le lapide. N'y a-t-il pas là un jugement de Dieu présent et manifeste ? n'y a-t-il pas là une sentence débattue et portée par le ciel suivant les formalités des tribunaux humains ? D'abord le criminel est arrêté, en second lieu conduit devant le juge, en troisième lieu accusé, puis jeté en prison, enfin puni par un arrêt d'en haut. Et non seulement il est puni, mais il l'est sur la déposition des témoins, afin, sans doute, que sa condamnation paraisse l'effet de la justice et non de la puissance. Cet exemple devait profiter à tous les autres et les détourner d'un crime dont tout le peuple assemblé avait tiré vengeance sur un seul homme. Telle est, et telle a toujours été la sage conduite de Dieu : il fait servir à la correction de tous le châtiment infligé à quelques particuliers. C'est aussi ce qui arriva lorsqu'Abiu et Nadab, tous deux de race sacerdotale, furent consumés par le feu du ciel. En cela, Dieu voulut montrer non seulement sa justice, mais une justice toujours présente, toujours prête à punir. Car il est écrit : Nadab et Abiu, fils d’Aaron ayant pris leurs encensoirs, y mirent du feu, et de l’encens sur le feu, offrant devant le Seigneur un feu étranger ; ce qui ne leur avait point été ordonné. — Et un feu sortit de devant le Seigneur, les dévora, et ils moururent devant le Seigneur. Quelle autre intention pouvait-il avoir, si ce n'est de nous faire sentir que son bras est toujours étendu sur nous et son glaive toujours suspendu sur nos têtes, lui qui punit aussitôt dans l'acte même le crime des coupables ? car presque avant la consommation du péché, la peine a déjà frappé les pécheurs. Ce n'est pas là le seul exemple, il en existe une foule d'autres. Or, s'il punit en eux moins une impiété ouverte qu'une facilité trop inconsidérée, ne montre-t-il pas quels châtiments méritent ceux qui transgressent la loi par mépris pour la divinité, quand il n'épargne pas même une précipitation peu circonspecte ? Ne montre-t-il pas quel crime c'est d'aller contre les ordres de Dieu, quand il traite aussi sévèrement ceux qui les, méconnaissent ? Dieu a voulu encore par cet exemple d'une rigueur salutaire apprendre aux laïques combien ils doivent redouter son courroux, puisque les fils du grand-prêtre ne peuvent être, ni sauvés de la mort par le mérite de leur père, ni garantis par le privilège du ministère sacré. Mais pourquoi parler de ceux dont l'imprudence a, pour ainsi dire, touché à l'honneur de Dieu, et a semblé comme un outrage fait au ciel ? Marie murmure contre Moïse, elle est punie, son châtiment a lieu dans les formes. D'abord elle est citée, puis convaincue et condamnée. La réprimande lui fait sentir la rigueur de l'arrêt, la lèpre lui fait expier sa faute ; et la peine est d'autant plus grande qu'elle devient une humiliation, non pas pour Marie seulement, mais encore pour Aaron ; car si Aaron dut à sa qualité de grand-prêtre de n'être point déformé par la lèpre, il ne resta pas cependant impuni. Aaron a participé au châtiment de Marie comme ayant participé à sa faute. Le supplice est pour Marie, la confusion pour son frère, afin de nous convaincre que la justice divine est quelquefois inexorable à l'égard de certaines personnes. Dieu ne se laissa pas même fléchir alors par l'entremise de celui qui avait été offensé. Nous lisons que le Seigneur parla ainsi au grand-prêtre et à sa sœur. Pourquoi donc n’avez-vous pas craint de mépriser mon serviteur Moïse ? — Et irrité contre eux, il s'en alla. — Et voilà que Marie fut couverte d’une lèpre semblable à la neige. — Or, Moïse cria vers le Seigneur disant : O Dieu, je vous conjure guérissez-la. — Le Seigneur répondit : Si son père eut craché contre sa face, n’eût-elle pas été dans la confusion au moins durant sept jours ? Quelle soit séparée pendant sept jours hors du camp, et après on la rappellera. En voilà bien sans doute assez sur ce sujet, car on n'en finirait pas si l'on voulait s'étendre sur tous ces points, dont l’énumération seule est déjà trop longue. Ajoutons cependant quelque chose. XII. Les Hébreux se repentent d'avoir quitté l'Egypte, ils sont frappés ; ils se plaignent des fatigues du voyage, ils sont châtiés ; ils désirent des viandes, le bras du Seigneur s'appesantit sur eux. Nourris chaque jour de la manne, ils demandent dans leur sensualité des mets plus délicats, ils sont rassasiés selon leurs vœux, mais alors même ils éprouvent la vengeance du Seigneur. Les viandes étaient encore dans leurs bouches, dit l'Ecriture, quand la colère de Dieu éclata contre eux, frappa de mort les plus vigoureux, et abattit l’élite d’Israël. Og se révolte contre Moïse, il périt ; Coré le calomnie, il est abîmé ; Dathan et Abiron murmurent, ils sont dévorés par la terre. La terre s'ouvrit, et engloutit Dathan, et se referma sur les révoltés d'Abiron. Deux cent cinquante Lévites, qui, au temps du conseil, étaient appelés par leur nom, s'élevèrent contre Moïse. — Or, étant assemblés contre Moïse et Aaron, ils dirent : Qu'il vous, suffise que toute rassemblée soit sainte, et que le Seigneur soit au milieu d'elle. Pourquoi vous élevez-vous sur le peuple du Seigneur ? Et après cela : — Le feu du Seigneur sortant fit périr les deux cent cinquante hommes qui offraient l'encens. Malgré des exemples si éclatants, la vengeance de Dieu demeura sans effet. La correction fut souvent employée, mais l’amendement ne s'ensuivit point. Nous-mêmes, pour être tant de fois châtiés, nous n'en devenons pas meilleurs, comme aussi ils ne retiraient aucun fruit de leurs nombreuses punitions. Car il est écrit : Or, te lendemain toute la multitude des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron, disant : Vous avez fait mourir le peuple du Seigneur. Qu'arriva-t-il ? quatorze mille sept cents hommes furent frappés et consumés par le feu divin. Si tout le peuple avait péché, pourquoi la vengeance ne fut-elle pas exercée sur tous ; d'autant plus que dans la sédition de Goré dont j'ai parlé plus haut, personne n'avait échappé ? Pourquoi Dieu fait-il périr là tous les coupables, et ici seulement une portion ? C'est que le Seigneur, plein de justice et de miséricorde, donne beaucoup à sa bonté par l'indulgence, et ne punit dans sa sévérité que pour nous ramener à la vertu. Là il s'abandonne à sa sévérité pour faire servir à l’amendement de tous le châtiment des coupables ; ici, il suit le mouvement de sa miséricorde pour ne pas fciire périr tout le peuple. Et pourtant, après avoir si souvent fait éclater sa bonté, il les enveloppe tous à la fin dans la même sentence de mort, parce que le châtiment exercé tant de fois sur une portion du peuple était demeuré sans effet. Cet événement doit porter la crainte dans nos âmes et la réforme dans nos mœurs. Car si nous ne sommes instruits par leur exemple, nous pourrions peut-être partager leur sort infortuné. Nous savons tous quelle fut la fin malheureuse des Hébreux, lis sortirent d'Egypte pour habiter la terre de promission, et deux justes seulement purent y entrer. Il est écrit : — Le Seigneur parla à Moïse et à Aaron, disant : — Jusqu’à quand cette multitude perverse murmurera-t-elle contre moi ? Moi je vis, dit le Seigneur y comme vous avez parlé aujourd'hui en ma présence, ainsi, j’agirai envers vous. — Vos corps seront gisons dans le désert. Et que dit-il ensuite ? — J’introduirai vos enfants, dont vous avez dit qu'ils seraient en proie aux ennemis, afin qu’ils voient la terre que vous avez méprisée. — Vos cadavres resteront étendus dans cette solitude. Et quoi encore ? Tous furent frappés et moururent devant le Seigneur. Que ne trouve-t-on pas dans tout cela ? Voulez-vous voir un Dieu maître du monde ? Voilà qu'il réforme le présent et règle l'avenir. Voulez-vous voir un juge sévère ? Voilà qu'il punit les coupables. Voulez-vous voir un Dieu juste et miséricordieux ? Voilà qu'il pardonne aux innocents. Voulez-vous voir un juge universel ? Voilà que le jugement éclate partout. Comme juge, il condamne ; comme juge, il régit. Juge, il pardonne ; juge, il anéantit les prévaricateurs ; juge, il récompense ceux qui sont exempts de crimes.
|