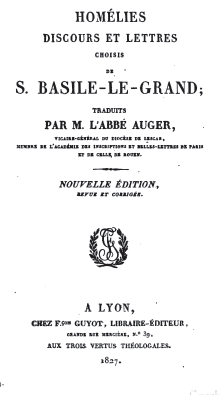
BASILE LE GRAND (SAINT)
LETTRES CHOISIES
Traduction française : l'Abbé AUGER.
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
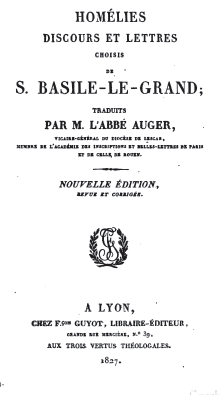
Traduction française : l'Abbé AUGER.
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
LETTRES CHOISIES DE S. BASILE-LE-GRAND.
RÉFLEXIONS PRÉLIMINAIRES
Les lettres de St. Basile sont célèbres dans l'histoire de l’Eglise. Elie du Pin, habile critique du dernier siècle, les regardait comme ce qu'il y avait peut-être de plus curieux et de plus savant dans toute l'antiquité ecclésiastique. « Elles sont écrites dit-il, avec une pureté, une noblesse, une éloquence inimitables, et contiennent une infinité de choses. On y voit toute l'histoire de son temps écrite sans prétention, les différents caractères des esprits, les intérêts contraires de chaque parti, les motifs qui les faisaient agir les uns et les autres, et les intrigues qu'ils mettaient en usage. L'état des Eglises d'Orient et d'Occident y est dépeint avec des traits naturels. Un grand nombre de questions de doctrine, de discipline et de morale y sont décidées, avec beaucoup d'habileté et de prudence. Il y a plusieurs lettres de consolation et d'exhortation qui sont très édifiantes, et très fortes ; et celles mêmes qui ne sont que de compliments sont pleines de pensées non moins ingénieuses que solides. J'ajoute à ces réflexions, qu'on est étonné, en voyant ce grand nombre de lettres, l’on en compte plus de trois cent cinquante, écrites à une multitude de personnes de différents états, et sur une. infinité d'affaires ecclésiastiques de diverses espèces, qu'un homme chargé du gouvernement d'une grande Eglise, avec la santé la plus frêle, ait pu étendre son attention et ses soins sur les grands intérêts des Eglises d'Orient et d'Occident, sans négliger ceux des particuliers, et principalement ceux-de ses amis ; qu'il ait pu suffire à tous ces détails qui pourraient effrayer l'homme le plus oisif et le plus robuste : tant il est vrai que l'activité de l'esprit supplée à tout, fournit à tout, et qu'une grande âme se rend maîtresse du corps .qu'elle anime ! Parmi ces lettres, j'ai choisi surtout celles qui sont faites pour plaire dans tous les temps et à toutes sortes de personnes, celles qui peuvent être des modèles d'une politesse ingénieuse et d'une sensibilité affectueuse, qui offrent une gaité décente, de la sérénité et du calme au milieu des peines et des infirmités, en un mot, celles qui peignent le mieux le caractère de celui qui les a écrites. J'ai mis à la tête toute sa correspondance avec le rhéteur Libanius ; on y verra comment deux hommes d'esprit, qui avaient conservé de l'amitié et de l'estime l'un pour l'autre malgré la différence de religion, se louent sans fadeur, se font quelques reproches sans aigreur, badinent avec décence, font, pour ainsi dire, assaut d'esprit et de politesse. Les anciennes et nouvelles éditions suivent différents systèmes pour l'ordre des lettres; pour moi, je n'en ai suivi aucun, et je les ai placées presque au hasard, avec l'attention seulement qu'il y eût quelque variété. Chaque lettre a son court sommaire, précédé de deux chiffres romains, qui annoncent l'ordre numéral de la lettre; le premier dans l'édition des Bénédictins, le second, dans celle de Morel.
CCCXXXV—CXLII. Saint Basile avait étudié à Constantinople sous le rhéteur Libanius, qui était né dans le paganisme, et qui y resta toujours attaché. Ce rhéteur avait beaucoup de réputation et de mérite. Ils demeurèrent toujours unis, malgré la différence de religion, et ils entretinrent un commerce de lettres, comme on le voit par celles qui suivent. Saint Basile avait tant de confiance dans la probité de Libanius, qu'il lui envoyait le plus de Cappadociens qu'il pouvait pour être instruits à son école. Il lui en envoie, et lui en recommande un dans la lettre suivante.
J'ai honte de vous envoyer les Cappadociens les uns après les autres, de ne pouvoir persuader tous nos jeunes gens à la fois de s'appliquer à l’étude de l'éloquence et des lettres, et de se mettre sous votre discipline pour profiter de vos instructions. Mais comme il est impossible de les trouver tous ensemble disposés à choisir ce qui leur convient, je vous les envoie à mesure que je les persuade, et je crois leur rendre le même service qu'à un homme pressé par la soif que je conduirais à une fontaine d'eau pure. Celui qui va maintenant vous joindre, ne tardera pas à être recommandable par lui-même, quand il aura été quelque temps à votre école. Il n'est maintenant connu que par son père, à qui la régularité de ses mœurs, les grandes places qu'il occupe, ont fait un nom parmi nous. C'est un de mes plus chers amis. Je ne puis mieux reconnaître l'amitié qu'il a pour moi, que de rendre son fils votre disciple, avantage que ne peut trop estimer quiconque sait distinguer le mérite.
CCCXXXVI—CXLIII. Cette lettre est la réponse à la précédente. Libanius annonce à saint Basile l'arrivée de son Cappadocien : il le félicite de la sagesse et des talents qu'il a montrés dès son jeune âge, et du genre de vie qu'il a embrassé.
Il y a déjà quelque temps que le jeune Cappadocien est arrivé. C'est un avantage qu'il soit né en Cappadoce, et de la plus illustre famille: mais il m'a apporté une lettre de l'incomparable Basile, qu'est-ce qui pouvait plus m'intéresser? moi qui vous ai oublié, à ce que vous dites, je vous respectais quoique vous fussiez encore fort jeune, quand je vous voyais le disputer aux vieillards en sagesse, et cela dans une ville le centre des plaisirs ; quand je vous voyais avoir fait déjà de grands progrès dans l'éloquence. Depuis que vous crûtes nécessaire de faire un voyage à Athènes, et que vous eûtes déterminé Celse à vous y suivre, je félicitais celui-ci de son étroite amitié avec vous. Lorsque vous fûtes retourné dans votre patrie, je me disais à moi-même; Que fait maintenant Basile? quel genre de vie a-t-il embrassé? suit-il le barreau à l’exemple des anciens orateurs? où enseigne-t-il l'éloquence aux enfants des premières familles? On m’apprit que vous étiez entré dans une bien plus excellente route, que vous songiez: à plaire à Dieu sans penser à amasser des richesses: j'enviai votre bonheur et celui des Cappadociens; je vous estimai heureux, vous d'avoir su prendre un tel parti, et les Cappadociens de posséder un citoyen de votre mérite.
Nota. J'ai supprimé la seconde partie de cette lettre comme étant obscure et peu intéressante.
CCCXXXVII—CXLIV. C’est pour recommander deux Cappadociens aux soins de Libanius que saint Basile lui écrit. La lettre est pleine de cette politesse ingénieuse qui loue finement et sans fadeur celui qui le mérite.
Voici un autre Cappadocien que je vous envoie, qui est aussi un de mes enfants: la place où je suis les rend tous mes enfants adoptifs. Sur ce pied-là il doit être regardé comme frère du précédent, et nous devons en prendre le même soin, moi qui lui tiens lieu de père, et vous qui serez son maître, s'il est possible que vous ayez des égards particuliers pour ceux qui viennent de ma part. Je dis s’il est possible; car je suis persuadé que vous êtes le même pour tous ceux qui écoutent vos leçons, et que là-dessus vos plus anciens amis n'ont aucun privilège. Il suffira au jeune homme, avant que l'âge lui ait donné de l'expérience, d'être compté parmi vos disciples. Renvoyez-le nous tel, qu'il remplisse notre attente et qu’il réponde à votre réputation dans l'art de la parole. Il amène avec lui un jeune homme de son âge, qui a la même passion pour l’éloquence. Il est de bonne famille, et m'est également cher. Je me flatte que vous le traiterez aussi bien que les deux autres, quoiqu'il soit beaucoup moins riche.
CCCXXXVIII—CXLV. Cette lettre est la réponse de Libanius à saint Basile : elle renferme une louange très fine et très délicate de la lettre de celui-ci. Le rhéteur annonce le plus noble désintéressement, en disant qu'il prend autant de soin des pauvres qui ne donnent rien, que des riches.
Je sais que vous m'écrirez souvent: Voici un autre Cappadocien que je vous envoie. Vous m'en enverrez, je suis sûr, un bon nombre, parce que vous faites de perpétuels éloges de moi, et que par-là vous excitez les pères et les enfants. Mais je ne dois pas vous taire ce qui est arrivé à votre agréable lettre. J'avais avec moi plusieurs personnages distingués qui ont été dans les charges, entre autres l'admirable Alypius, cousin du fameux Hiéroclès. Quand on m'eut remis votre lettre, et que je l'eus parcourue tout bas: Je suis vaincu, disais-je tout haut d'un air riant et satisfait. De quelle défaite parlez-vous, me demandèrent ceux qui étaient présents, et pourquoi n'êtes-vous pas fâché si vous êtes vaincu? J'ai été vaincu, leur répondis-je, en fait de lettres gracieuses: Basile est le vainqueur; Basile est mon ami, et c'est ce qui cause ma joie. À ces mots, ils témoignèrent qu'ils voulaient être eux-mêmes juges de la victoire. Alypius lut votre lettre, les autres l'écoutèrent: il fut décidé d'une voix unanime, que je ne m'étais pas trompé. Le lecteur gardait votre lettre, il voulait l'emporter, sans doute pour la faire voir à d'autres, et il ne la rendit qu'avec peine. Ecrirez-moi donc toujours de pareilles lettres, et soyez toujours vainqueur. Une telle défaite sera pour moi une victoire. Au reste, vous avez raison de penser que nos leçons ne s'achètent pas avec de l'argent. Quand on ne peut pas donner, il suffit qu'on puisse recevoir. Pour moi, si je rencontre quelqu'un qui soit pauvre, mais passionné pour l'éloquence, je le préfère aux riches. Quand j'étais jeune, je n'ai pas trouvé des maîtres de ce caractère; mais rien n'empêche que je ne vaille mieux de ce coté. Qu'aucun pauvre n'hésite donc à venir ici, pourvu qu'il possède l'envié et la facilité du travail.
CCCXXXIX—CXLVI. St. Basile badine agréablement sur les louanges que Libanius a prodiguées à sa dernière lettre : il prétend ne point mériter ces louanges. Il lui envois un nouveau disciple.
Que ne peut point dire un rhéteur, et un rhéteur tel que vous? On sait que le propre de son art est de faire paraître petit ce qui est grand, et de donner une grande idée des plus petites choses. C'est ainsi que vous venez d'en user à mon égard. Une lettre misérable, telle que vous devriez la traiter vous autres qui écrivez avec tant de délicatesse, une lettre qui ne vaut pas mieux que celle que vous avez entre les mains, vous la vantez au point de vous dire vaincu par elle, et de me céder la gloire de bien écrire ! Vous faites à peu près comme ces pères qui, pour se divertir, laissent leurs enfants s'applaudir de la victoire qu’ils leur ont cédée. Par cet artifice, ils ne se font point tort à eux-mêmes, et ils entretiennent l'émulation de leurs enfants. En vérité, on ne peut rien imaginer de plus agréable que ce que vous m'avez écrit pour vous amuser. C'est à peu près comme si Polydamas ou Milon[1] n'osaient entrer en lice avec moi pour la lutte ou pour le pugilat. J'ai eu beau chercher, je n'ai pu trouver d'exemple qui exprime bien ma faiblesse. Ceux qui aiment les hyperboles admireront plus le jeu que vous vous êtes permis en vous abaissant jusqu'à moi, que si vous aviez fait naviguer un Xerxès sur le mont Athos.[2] Pour nous, nous n'avons de commerce qu'avec Moïse, Elie, et d'autres saints hommes, qui nous présentent leur doctrine dans un langage barbare. Nous prêchons leurs maximes, dont le sens est aussi admirable que les expressions en sont grossières. Vous pouvez le remarquer par ce que je vous écris ; car le temps m'a fait oublier ce que j'ai appris de vous. Ecrivez-moi toujours, mais choisissez des sujets qui, en faisant paraître votre habileté, ne me fassent pas rougir. Je vous ai envoyé le fils d'Anysius, que je regarde comme mon propre fils. Or, s'il est mon fils, il ressemble à son père, c'est-à-dire qu'il est aussi pauvre que moi. Vous devez m'entendre, étant un rhéteur aussi habile.
LIBANIUS A BASILE.
CCCXL—CXLVII. Libanius répond à la lettre de saint Basile : il lui dit que tous ses efforts pour décrier la lettre précédente, n'ont fait que produire une lettre qui ne lui est pas inférieure ; que, quoi qu'il fasse, il n'est pas en lui de mal écrire.
Quand vous auriez médité longtemps sur le meilleur moyen d'appuyer ce que je vous ai écrit touchant votre lettre, vous n'auriez pu mieux réussir qu'en m'écrivant ce que vous venez de m'écrire. Vous me donnez le nom de rhéteur, et vous dites que l'art du rhéteur est de faire paraître petit ce qui est grand, et grand ce qui est petit; que j'ai voulu par ma lettre montrer que la vôtre est belle, quoiqu'elle ne soit pas belle, quoiqu'elle ne vaille pas mieux que la dernière ; qu'en général vous n'avez aucun talent pour l'éloquence, ayant oublié ce que vous en aviez appris auparavant, et les livres que vous avez à présent entre les mains ne pouvant la donner: et tout en voulant nous persuader cela, vous avez fait une lettre dont vous dites beaucoup de mal, mais qui est si belle, que ceux qui étaient avec moi sautaient de joie en la lisant. Je suis donc étonné que, voulant détruire votre première lettre par la dernière, vous l'ayez même embellie par la ressemblance qu'on a trouvée entre toutes les deux. Avec le dessein que vous aviez, vous auriez dû faire une lettre inférieure, afin de décrier la précédente. Mais, sans doute, il n’était pas dans votre nature de blesser la vérité: or, vous l'auriez blessée en affectant d'écrire mal, et en ne suivant pas votre talent. Prenez donc garde aussi de blâmer ce qui mérite d'être loué, de crainte qu'on ne vous mette au nombre des rhéteurs, si vous vous efforcez de faire paraître petit ce qui est grand en effet. Continuez de lire ces livres dont le sens, dites-vous, est aussi admirable que la diction en est grossière ; personne ne vous en empêche : mais les traces de nos livres, qui étaient autrefois les vôtres, sont encore et seront toujours gravées dans votre mémoire, tant que vous vivrez; et quoique vous en négligiez l'étude, le temps ne pourra jamais les effacer de votre esprit.
LIBANIUS A BASILE.
CCCXLI—CXLVIII. Libanius se plaint du silence de saint Basile, qui avait interrompu leur commerce épistolaire : il le prie de lui écrire, en lui témoignant l'estime qu'il faisait de ses lettres.
Vous ne m'avez pas encore pardonné ma faute, ce qui me fait trembler en vous écrivant. Que si vous m'avez pardonné, pourquoi ne m'écrivez-vous pas, ô le meilleur des hommes? Si vous conservez quelque chagrin, ce qui est fort éloigné de tout caractère raisonnable, et principalement du vôtre, pourquoi vous qui prêchez aux autres qu'il ne faut point garder sa colère jusqu'au coucher du soleil, la garderons pendant plusieurs soleils? Peut-être que vous avez voulu me punir, en me privant de vos paroles plus douces que le miel. N'en usez pas de la sorte, à mon généreux ami ! soyez plus complaisant à mon égard, et faites-moi jouir de vos lettres, qui me sont plus précieuses que l'or.
BASILE A LIBANIUS.
CCCXLII—CXLIX. Toute cette lettre roule sur une allégorie de la rose, et des épines dont elle est environnée. Saint Basile compare les lettres de Libanius à des roses, et les reproches qu'il y insère à des épines.
Ceux qui aiment les roses, comme font tous ceux qui aiment ce qui est beau, ne se fâchent point contre les épines dont la rose est accompagnée. Il me souvient d'avoir entendu quelqu'un, soit qu'il parlât sérieusement ou pour se divertir, qui disait que, comme les peines légères ne font que réveiller l'amitié, les épines dont la nature a environné les roses, sont autant d'aiguillons qui ne font que redoubler l'ardeur qu'on a de les cueillir. Il n'est pas nécessaire que je fasse l'application de ces épines et de ces roses à votre lettre, qui par sa douceur a été pour moi la fleur de la rose, m'a fait goûter tout le charme du printemps, et dont les plaintes et les reproches sont comme autant d'épines. Mais ces épines me font plaisir; elles ne font qu'enflammer davantage mon amitié pour vous.
LIBANIUS A BASILE.
CCCXLIII—CL. Libanius fait un bel éloge de l'éloquence de saint Basile, en disant que cette éloquence lui était naturelle, tandis que lui, Libanius, était obligé, pour entretenir la sienne, de lire tous les jours les grands modèles.
Si ce que vous m'écrivez n'est que l'expression d'un talent brut, que serait-ce donc si vous vouliez le polir? Nuls ruisseaux ne sont comparables aux fleuves d'éloquence qui coulent naturellement de votre bouche. Pour nous, si nous n'étions arrosés tous les jours, il ne nous resterait qu'à garder le silence.
BASILE A LIBANIUS.
CCCLIV—CLI. Il s'excuse sur la crainte et sur le défaut d'habileté, de ce qu'il lui écrit rarement : il se plaint de la paresse de Libanius, qui écrivait si bien, et à qui les lettres coûtaient si peu.
Si je vous écris rarement, la crainte et mon défaut d'habileté en sont cause. Mais vous, comment pourrez-vous justifier votre silence opiniâtre? Quand on se rappelle que vous passez votre vie dans l'exercice de l'éloquence, peut-on ne pas attribuer à de l'oubli pour moi votre paresse à m'écrire? Celui qui parle aisément doit écrire aisément ; et si avec le talent de parler il n'écrit pas, il est clair qu'il ne le fait que par dédain ou par oubli. Je me vengerai de votre silence par un salut. Je vous salue donc, ô mon respectable ami : écrivez-moi, si vous le jugez à propos ; ne m'écrivez point, si vous le trouvez plus commode.
LIBANIUS A BASILE.
CCCXLV—CLII. On voit par cette lettre toute l'estime que Libanius faisait de saint Basile, de ses discours et de ses lettres : il lui fait un reproche obligeant, de ce que, dans une circonstance, il avait refusé de l'instruire.
J'ai plus besoin de m'excuser de n'avoir pas commencé depuis longtemps à vous écrire, que de commencer aujourd'hui. Je suis toujours le même qui accourais avec tant d'empressement lorsque vous parliez en public, qui prêtais l'oreille avec tant de plaisir aux paroles qui coulaient de votre bouche, qui étais si charmé de vous entendre, qui ne me retirais qu'avec peine en disant à mes amis: Cet homme est bien supérieur aux filles d'Achéloüs;[3] il charme comme elles, et il ne nuit pas comme elles: ou plutôt, ses beaux discours, loin d'être nuisibles, sont fort utiles à ceux qui les écoutent. Puisque je pense ainsi de vous, que je suis persuadé de votre amitié, et que je passe pour avoir quelque facilité à parler, ce serait une extrême paresse de ne pas vous écrire avec confiance, d'autant plus que ce serait me faire tort à moi-même. Car je ne doute nullement que, pour une lettre courte et mal faite, je n'en reçoive de vous une aussi longue qu'agréablement écrite, et que vous ne craigniez à l'avenir de me faire une nouvelle injure. Cette parole, j’en suis sûr, va soulever bien des personnes, qui me réfuteront par des faits, et qui s'écrieront ; Basile a-t-il jamais fait injure à qui que ce soit? c'est comme si l’on accusait Eaque, Minos et son frère.[4] Pour moi, je consens que vous me surpassiez dans tout le reste; mais peut-on vous connaître sans ressentir des mouvements de jalousie, et n'est-il pas évident que vous avez fait une faute à mon égard? Si je vous la rappelle, empêchez les personnes de s'indigner et de crier. On ne vous a jamais demandé une grâce facile à accorder, qu'on ne l'ait obtenue ; et moi je vous ai demandé une grâce sans pouvoir l'obtenir. Que vous demandais-je donc? nous promenant souvent ensemble dans e prétoire, je vous priais de m'aider de vos lumières pour saisir la profondeur de l'enthousiasme d'Homère. S'il n'est pas possible, vous disais-je, de pénétrer tout son art, faites-m'en du moins comprendre une partie. Je vous marquais l'endroit où, les Grecs étant malheureux, Agamemnon cherche à adoucir par ses présents celui qu'il a offensé. Ce discours vous faisait rire ; et ne pouvant disconvenir que vous pouviez m'obliger si vous vouliez, vous ne le vouliez pas. Trouvez-vous que j'aie tort de me plaindre, vous et tous ceux qui sont fâchés que je vous reproche de m'avoir fait injure?
LIBANIUS A BASILE.
CCCXLVI—CLIII. Libanius renvoie à saint Basile quelques disciples qu'il lui avait confiés : les sentiments de sa lettre suffisent pour montrer qu'il était parfaitement honnête homme.
Vous jugerez par vous-même si les jeunes gens que vous m'avez envoyés ont profité avec moi pour l'éloquence. Quelque peu de fruit qu'ils aient retiré de mes leçons, votre amitié pour moi, j'en suis sûr, vous le fera paraître considérable. Il est un avantage que vous préférez à l'éloquence, je veux dire la sagesse, et l'attention de ne pas se livrer à des plaisirs déshonnêtes ; vous verrez qu'ils ont eu grand soin de se le procurer, et que dans leur conduite ils ont songe, comme il convenait, à ne pas faire honte à celui qui les a envoyés. Recevez donc votre bien, et applaudissez à des jeunes gens dont la pureté des mœurs fait votre gloire et la mienne. Vous exhorter à les chérir, ce serait exhorter un père à chérir ses enfants.
LIBANIUS A BASILE.
CCCXLVII—CLIV. Libanius avait besoin d'un certain nombre de petites poutres; il les demande d'un ton agréable à St. Basile qui pouvait les lui fournir.
Tout évêque est d'un tel caractère qu'il est fort difficile d'en rien tirer. Comme vous êtes plus prudent que les autres, cela me fait d'autant plus craindre de ne pas obtenir ma demande. J'ai besoin d'un certain nombre de petites poutres: un autre rhéteur se serait servi d'un terme plus magnifique; il aurait moins cherché à se faire entendre qu'à se faire admirer. Pour moi je m'exprime tout simplement, et je vous dis que, si vous ne m'envoyez pas les poutres dont j'ai besoin, je serai exposé aux injures de l'air.
BASILE A LIBANIUS.
CCCXLVIII—CLV. Saint Basile accorde à Libanius sa demande ; mais il lui prouve agréablement que la définition qu'il avait donnée d'un évêque convenait beaucoup mieux à. un rhéteur.
Si le verbe[5] dont vous avez forgé le mot avec lequel vous caractérisez un évêque, et que vous avez puisé dans les sources abondantes de Platon, si ce verbe, dis-je, signifie faire du gain, examinez, je vous prie, si le mot nous convient plus à nous que vous percez d'un trait si piquant dans votre lettre, qu'à la nation des rhéteurs qui font métier de vendre des paroles. Quel est l’évêque qui ait jamais trafiqué de discours, qui ait exigé un salaire de ses disciples? Vous mettez en vente des paroles, comme on y met des gâteaux et d'autres marchandises. Vous voyez que vous avez donné de l'humeur à un vieillard qui se venge. Au reste, j'envoie à un rhéteur pompeux autant de poutres[6] qu'il y avait de Spartiates qui ont combattu aux Thermopyles. Elles sont toutes d'une bonne longueur, et capables, comme dit votre Homère, de donner beaucoup d'ombre. Le fleuve Alphée s'est engagé à me les rendre.[7]
LIBANIUS A BASILE.
CCCXLIX—CLVI. Libanius badine sur les jeunes Cappadociens que lui envoyait saint Basile ; il les représente comme un peu bruts; mais il s'engage à les polir par ses leçons.
Vous ne cesserez donc jamais, mon cher Basile, de remplir le temple des Muses de vos Cappadociens, qui se sentent fort des frimas et des neiges de leur pays. Peu s'en faut qu’ils ne m'aient rendu Cappadocien moi-même, en me chantant sans cesse ces paroles : Je vous adore. Mais il faut le souffrir puisque Basile le veut. Au reste, soyez persuadé que j'étudie bien le caractère de vos jeunes gens, et que, par le langage noble et poli de ma Calliope, je les changerai au point que des ramiers sauvages vous paraîtront comme des colombes.
BASILE A LIBANIUS.
CCCL—CLVII. Saint Basile répond à Libanius, sur le même ton de plaisanterie. Il représente la Cappadoce comme très incommode pendant l'hiver, puisque la neige oblige tous les habitants de s'enterrer dans leurs maisons.
Votre chagrin est un peu passé; souffrez que ce soit là le début de ma lettre. Je vous permets de vous railler de notre pays: maïs pourquoi n'avoir fait mention que des neiges et des frimas, lorsque vous aviez contre nous tant d'autres matières à raillerie? Je vous dirai, mon cher Libanius, pour vous faire bien rire, que j'ai écrit cette lettre sous une couverture de neige. En la recevant, vous sentirez combien elle est froide : elle vous exprimera assez bien l'état de celui qui vous l'envoie, qui est maintenant renfermé dans son repaire sans oser jeter les yeux au dehors. Nos maisons ressemblent à des sépulcres : nous y sommes enterrés jusqu'à ce que revienne le printemps, qui rendra des morts à la vie, et nous redonnera, comme aux plantes, une nouvelle existence.
BASILE A LIBANIUS.
CCCLI—CLVIII. Libanius avait prononcé, dans un grand concours de monde, une harangue qui avait été fort applaudie : saint Basile le prie de la lui envoyer ; il marque la plus grande envie de la lire.
Plusieurs de ceux qui viennent de votre part et que j’ai vus, admirent votre talent pour l’éloquence. ils m'ont dit que vous aviez paru avec le plus grand éclat ; qu'on ne songeait dans toute votre ville qu'à Libanius qui devait parler ; que tout le monde accourait en foule ; que tous les âges et toutes les conditions montraient le plus vif empressement pour vous entendre ; que les hommes les plus constitués en dignité, que les militaires occupant les premiers grades, que les simples artisans, que les femmes mêmes ne voulaient pas être privées du plaisir d'assister à votre harangue. Quel est donc le sujet du discours qui a attiré tant de monde, qui a réuni une assemblée si brillante? On m'a rapporté que vous aviez fait le portrait du fâcheux.[8] Envoyez-moi, je vous conjure, un chef-d'œuvre qui a été si applaudi, afin que j'y applaudisse moi-même. Moi qui loue Libanius sans voir ses ouvrages, que ne ferai-je pas quand j'aurai entre les mains ce qui lui a mérité tant de louanges?
LIBANIUS A BASILE.
CCCLII— CLIX. Libanius envoie sa harangue à saint Basile, et témoigne combien il redoute le jugement d'un aussi grand orateur.
Je sue de tout mon corps en vous envoyant le discours que vous m'avez demandé. Eh! comment n'éprouverais-je pas une extrême inquiétude en soumettant mon ouvrage à la critique d'un homme qui, par ses talents rares pour l'éloquence, est capable d'effacer l'abondance de Platon et la force de Démosthène? Pour moi, je ne me regarde auprès de vous que comme un moucheron comparé à un éléphant. Je pense donc et je frémis quand je pense au jour où vous examinerez ma production : peu s'en faut que mon esprit ne s'égare.
BASILE A LIBANIUS.
CCCLIII-—CLX. Nous avons encore, parmi les ouvrages de Libanius, la harangue dont St. Basile fait un grand éloge dans cette lettre. Je lai lue; elle m'a paru agréablement écrite. Il y a de l'action et des pensées ingénieuses; mais, ainsi que dans ses autres ouvrages, point de grands traits d'éloquence. Libanius avait plus d'esprit que de génie ; il ne montre jamais cette abondance de Platon et cette force de Démosthène qu'il admirait avec raison dans saint Basile.
J'ai lu, ô le plus habile des hommes! la harangue que vous m'avez envoyée, et je l'ai admirée au-delà de tout ce que je saurais dire. O muses et écoles d'Athènes, que vous enseignez de grandes choses à vos élèves ! quels fruits ne recueille-t-on point, pour peu qu'on ait de commerce avec vous? ô source intarissable, quels hommes ne deviennent point ceux qui y puisent? Il me semblait, en vous lisant, voir votre fâcheux lui-même s'entretenir avec une babillarde. Il n'y a que Libanius sur la terre qui ait le talent de composer un discours plein d’une et de chaleur, qui puisse animer et vivifier la parole.
LIBANIUS A BASILE.
CCCLIV—CLXI. Libanius annonce combien il est sensible aux louanges de saint Basile ; il le prie de lui envoyer son discours contre l'ivrognerie : c'est l'homélie que j'ai traduite, et qui se trouve dans ce volume.
Je crois maintenant mériter toutes les louanges qu'on me donne ; et puisque Basile me loue, il me semble que je suis au-dessus de tout le monde. Fier de votre suffrage, je puis marcher la tête haute, et montrer l'orgueil d'un présomptueux qui méprise le reste du genre humain. Je désire fort de voir votre discours contre l'ivrognerie. Je ne prétends pas en faire un grand éloge d'avance; je dis seulement que, quand je le verrai, il m'apprendra l'art d écrire.
LIBANIUS A BASILE.
CCCLV—CLXII. Cette lettre est la réponse à la précédente. Saint Basile avait envoyé à Libanius le discours qu'il lui avait demandé. Ce rhéteur l’avait lu avec tant de plaisir, l'éloquence lui avait paru si attique, qu'il demande à saint Basile s'il était à Césarée ou à Athènes : il représente la rhétorique même qui fait l'éloge du discours et de l'orateur.
Habitez-vous Athènes, mon cher Basile, et vous êtes-vous oublié vous-même? Les citoyens de Césarée n'ont pu, sans doute, vous entendre. La Rhétorique dont j ai dicté les leçons n’était pas accoutumée à ces prodiges de l'art. Frappée de la beauté et de la nouveauté de vos expressions, comme si elle eut parcouru des routes escarpées et nouvelles, elle semblait me dire : Mon père, ce n'est pas là ce que vous avez enseigné. Cet homme est Homère, c'est Platon, c'est Aristote, c'est Susarion[9] qui savait tout. Voilà ce que médit de vous la Rhétorique. Je voudrais mériter de votre part d'aussi belles louanges.
BASILE A LIBANIUS.
CCCLVI—CLXIII. Saint Basile loue délicatement Libanius, et montre combien il était embarrassé de répondre à ses lettres.
C'est un vrai plaisir pour moi de recevoir de vos lettres, mais c'est une vraie peine quand vous exigez que j'y réponde. Eh ! que pourrais-je écrire à un homme qui parle si bien le pur langage d'Athènes? sinon que je fais profession et que je m'applaudis d'être le disciple de simples pécheurs.
LIBANIUS A BASILE.
CCCLVII. Les trois lettres suivantes sont tirées des monuments de l’Eglise grecque, t. 2, p. 96 et 97, et ne se trouvent pas dans les anciennes éditions. La première, qui n'est qu'un fragment, est de Libanius. Il loue le badinage noble et grave de son ami. On ne sait pas la peine que lui avait causée une de ses lettres et qu'il le prie de dissiper.
Pourquoi Basile a-t-il été fâché d'écrire une lettre que je puis dire être un vrai modèle de bonne philosophie? C'est vous-même qui nous avez appris à badiner, mais à user d'un badinage noble et grave, tel qu'il convient à un vieillard. Je vous en conjure au nom de l'amitié et de nos études communes, dissipez la peine que m'a causée votre lettre.....
LIBANIUS A BASILE.
CCCLVIII. Il regrette d'être séparé de son cher Basile. Il le plaint d'avoir été abandonné par Alcimus, abandon que lui fera supporter la douceur de son caractère.
O temps heureux ! où nous étions tout l'un pour l'autre? Maintenant nous sommes cruellement séparés. Pour vous, vous avez retrouvé une société qui vous convient; mais moi, je n'ai rencontré personne qui vous ressemble. J'apprends qu’Alcimus montre dans la vieillesse l'audace du jeune âge qu'il vole à Rome, et qu'il vous laisse l'embarras d'être avec des enfants. Comme vous êtes naturellement doux, vous le supporterez sans peine, puisque même vous ne vous êtes pas fait une peine de m'écrire le premier.
BASILE A LIBANIUS.
CCCLIX. St. Basile témoigne combien il désirerait d'aller trouver son cher Libanius. Il se plaint agréablement de son silence et l'invite à lui écrire.
Vous qui avez renfermé dans votre esprit tout l'art des anciens, vous vous taisez, et vous ne daignez pas même nous faire part dans des lettres de ce que vous savez. Pour moi, si l'art de Dédale était sûr, je me ferais des ailes comme à Icare pour voler vers vous.[10] Mais, comme il ne serait pas sage d'exposer de la cire au soleil, au lieu des ailes d'Icare, je vous envoie des paroles écrites, qui vous témoignent toute mon amitié. La nature de la parole est de manifester au-dehors les sentiments du cœur. Vous faites de la parole ce que vous voulez ; et avec un si grand talent vous gardez le silence ! Faites passer jusqu'à nous, je vous en conjure, les sources abondantes qui coulent de votre bouche.
XIX—III. Saint Basile s'excuse d'avoir tardé à répondre à la lettre de son ami ; il s'en prend au porteur même de la lettre qui était parti avec trop de précipitation : il se plaint que ses lettres sont trop courtes.
Il m'est venu dernièrement une lettre de vous, qui est bien de vous. Je l’ai reconnue moins au caractère de récriture qu'au style de la lettre. Elle renfermait peu de mots et beaucoup de sens. Je ne vous ai pas fait aussitôt réponse, parce que j'étais absent pour lors, et que votre messager, après avoir donné la lettre à un de mes amis, est parti sans m'attendre. Pierre vous entretiendra de ma part. Il acquittera pour moi une dette de l'amitié ; et ce sera une occasion pour vous engager à me récrire. Cela ne doit pas vous coûter infiniment ; car en général toutes les lettres que vous m'envoyez sont fort laconiques.
XIV—XIX. Il apprend à son ami la résolution qu'il a prise de renoncer au commerce et au bruit du monde, pour vivre désormais dans la retraite. Belle description d'une solitude propre pour la vie contemplative.
Mon frère Grégoire m'ayant écrit qu'il désirait depuis longtemps de me rejoindre, et ayant ajouté que vous aviez pris la même résolution, je me suis vu si souvent trompé par vous, que je n'ose plus croire que vous avez une véritable envie de venir. D'ailleurs, mille raisons m'ont empêché de rester pour vous attendre. Il faut que je parte pour le Pont,[11] où, s'il plaît à Dieu, je mettrai fin à mes courses. J'ai enfin renoncé aux vaines espérances que j'avais de vous voir, ou plutôt aux songes s'il faut dire la vérité : car j'approuve fort celui qui a dit que les espérances étaient les songes d'un homme qui veille. Je me retire donc dans le Pont pour y trouver un genre de vie particulier. Dieu m'y a fait découvrir une demeure parfaitement conforme à mon caractère ; une demeure réellement telle que nous l'imaginions dans nos moments de loisir pour noua amuser. C'est une montagne fort élevée, couverte d'une vaste et sombre forêt, arrosée vers le Septentrion par des eaux fraîches et limpides. Au pied de la montagne, s'étend une grande plaine, continuellement engraissée par les eaux qui viennent des hauteurs. La forêt qui l'entoure naturellement par une infinité d'arbres de toute nature, forme une espèce de palissade. L'île de Calypso, tant vantée par Homère, n'est rien en comparaison. Peu s'en faut que ce ne soit une île, puisqu'elle est enfermée de toutes parts. Elle est coupée dans deux de ses côtés par des vallées profondes. Un fleuve qui tombe d'un précipice, coule à son troisième côté, et lui sert d'un rempart inaccessible. De l'autre, une spacieuse montagne, jointe à la vallée par des chemins tortueux et impraticables, en interdit l'entrée. Il n'y a qu'un seul endroit, dont nous sommes les maîtres, par où l’on puisse approcher. L'habitation est sûr une éminence, laquelle est une sorte de tour ou de guérite, d'où la plaine se découvre à la vue, et d'où l'on aperçoit le fleuve dont les eaux se répandent tout autour. Cet aspect, à mon avis, cause autant de plaisir que le fleuve du Strymon[12] aux Amphipolitains. Encore ce dernier coule si tranquillement, ses eaux font si peu de bruit, qu'on a de la peine à lui donner le nom de fleuve : au lieu que le nôtre est plus rapide qu'aucun des fleuves que je connaisse. Son cours est rendu plus impétueux par un rocher voisin, d'où il se précipite dans un gouffre profond. C'est pour moi et pour tout autre un spectacle des plus agréables, outre que les habitants en retirent de grands avantages, et qu'il nourrit une quantité prodigieuse de paissons. Pourquoi parler des douces vapeurs qui sortent de la terre, ou du bon air que le fleuve fait respirer? Un autre admirerait peut-être la variété des fleurs ou le concert des oiseaux ; mais moi je n'ai pas le temps de m'occuper de pareilles bagatelles. Le plus grand avantage de ce lieu, c'est qu'outre qu'il produit, par son heureuse situation, toutes sortes de fruits en abondance, le plus flatteur pour moi est le repos et la tranquillité qu'on y goûte. J'y trouve une retraite entièrement éloignée du tumulte de la ville, où l'on ne rencontre absolument que quelques chasseurs qui se joignent quelquefois à nous: car ce pays offre encore le plaisir de la chasse. On n'y voit cependant, comme dans le vôtre, ni ours, ni loups, ni autres bêtes féroces ; il ne nourrit que des cerfs, des chèvres sauvages, des lièvres, et autres animaux semblables. Croyez-vous que je sois assez dépourvu de raison, pour préférer à un séjour si délicieux votre retraite de Tibérine[13] qui n'est qu'une horrible fondrière? Pardonnez-moi donc le désir que j'ai de m'y fixer. Alcméon mit fin à ses courses lorsqu'il eut rencontré les Echinades.
IV—CLXIX. Olympius avait envoyé des présents considérables à saint Basile, qui faisait profession d'une pauvreté austère. Il les refuse d'une manière fine et agréable.
Que faites-vous, ô mon admirable ami? vous voulez bannir de ma solitude la pauvreté qui m'est chère, la pauvreté mère de la sagesse. Si elle pouvait parler, elle vous accuserait de violence, et vous dirait : Je voulais demeurer avec un homme qui applaudît à Zénon,[14] lequel ayant tout perdu dans un naufrage, ne proféra que des paroles généreuses : Courage, dit-il, Fortune, tu nous réduis à porter un simple manteau ; avec un homme qui fait un grand mérite à Cléanthe de s'être loué pour tirer de l'eau d'un puits, afin de gagner de quoi vivre et de quoi payer ses maîtres ; avec un homme qui ne cessa jamais d'admirer Diogène, lequel était si jaloux de se borner à ce que demande la nature, qu'il jeta sa tasse, en voyant un enfant qui se baissait pour puiser de l'eau dans le creux de sa main. Voila les reproches que vous adresserait la Pauvreté, notre bonne amie, que vous voudriez bannir par vos présents magnifiques. Elle ajouterait même quelques menaces : Si je vous surprends encore ici, dirait-elle, je me vengerai de vous avec mes armes, je ferai voir que vous avez mené par le passé la vie voluptueuse des Siciliens et des Romains. En voilà assez sur ce chapitre. Je suis bien aise d'apprendre que vous vous occupez de votre santé, que vous prenez des remèdes. Je souhaite qu'ils vous soulagent : vous avez une âme si belle, qu'elle mérite bien le secours d'un corps sain et exempt d'infirmités.
XII—CLXXI. Il reproche agréablement à Olympius sa paresse, et le prie de lui écrire plus souvent.
Auparavant vous nous écriviez quelques mots, maintenant vous ne nous écrivez plus rien. Vous parliez peu d'abord, avec le temps vous êtes devenu absolument muet. Reprenez, je vous prie, votre ancienne méthode. Nous ne nous plaindrons plus du style laconique de vos lettres. Les plus courtes nous seront infiniment précieuses, comme étant le gage d'une grande affection. Ecrivez-nous seulement.
A THÉODORA, QUI FAISAIT PROFESSION D'UNE VIE RETIRÉE ET RÉGULIÈRE.
CLXXIII— CCCII. Cette lettre contient les plus belles maximes de morale, et peut servir de modèle à ceux qui aspirent à la perfection évangélique.
L'incertitude où je suis si mes lettres parviennent jusqu'à vous, me rend paresseux à vous écrire. La perfidie des messagers fait tomber les lettres en mille autres mains, surtout au milieu des troubles qui agitent à présent le monde. J'attends donc que vous me fassiez de vives plaintes, et que vous me pressiez de vous écrire, pour m'assurer si mes lettres vous sont rendues. Mais, soit que je vous écrive ou que je garde le silence, je me fais une loi de conserver au fond de mon cœur le souvenir de votre personne, et de demander pour vous à Dieu la grâce que vous puissiez achever votre carrière f et arriver au but que vous vous être proposé. Ce n'est pas une petite entreprise que de remplir avec fidélité tous ses engagements. Tout le monde peut embrasser un état de vie conforme aux maximes évangéliques ; mais je connais peu de personnes qui remplissent exactement jusqu'aux plus simples devoirs de leur profession, et qui ne négligent aucune des règles de l'Evangile. Parler avec sobriété, avoir les yeux purs comme Jésus-Christ le demande, travailler des mains pour plaire à Dieu, se servir de ses pieds et des autres membres de son corps selon l'ordre que le Créateur a établi, être modeste dans ses vêtements, circonspect dans le commerce des hommes, manger uniquement pour le besoin, retrancher le superflu dans ses possessions : ces préceptes, ainsi présentés, paraissent peu de chose; mais l'expérience nous apprend que la pratique exige de grands efforts. Et cette humilité parfaite, qui nous fait oublier l'éclat de notre naissance, qui empêche de nous applaudir des avantages naturels du corps ou de l'esprit, d'être fiers de la bonne opinion que les autres ont de notre mérite : cette vertu n'est-elle pas essentielle à la vie évangélique, aussi bien qu'une tempérance soutenue, l'assiduité dans la prière, la compassion pour les maux, de ses semblables, l'empressement à soulager les pauvres, la modestie des sentiments, la contrition du cœur, la pureté de la foi, l'égalité d'âme dans la mauvaise fortune, le souvenir perpétuel des jugements de Dieu et de son tribunal redoutable, devant lequel nous paraîtrons tous bientôt, et dont peu de personnes songent à se représenter les suites?
CCXCII—CCCLXXXVI. Il le félicite de ce qu'il s'était fait baptiser depuis peu : il lui parle des avantages du baptême, et l'exhorte à en profiter par une vie régulière.
Dieu a rempli la moitié de mes désirs en me faisant voir notre chère sœur votre épouse; il ne tient qu'à lui de suppléer le reste et de mettre le comble à ses dons en m'accordant la faveur de vous voir vous-même. Je le désire plus que jamais depuis que j'ai appris de quel honneur insigne tous avez été gratifié, en vous revêtant de cette robe immortelle qui couvre notre nature, qui détruit la mort dans notre chair, qui absorbe ce qu'il y a en nous de mortel. Puis donc que le Seigneur par sa grâce vous a admis dans sa famille, qu'il a effacé tous vos péchés, qu'il vous a ouvert le royaume des cieux, qu'il vous a montré le chemin qui conduit à la béatitude céleste, je vous exhorte, vous qui vous distinguez de tous. les autres par votre prudence, d'estimer cette grâce autant que vous le devez, de garder fidèlement ce trésor spirituel, de conserver avec tout le soin possible le dépôt du Roi suprême, afin que vous puissiez un jour le lui rendre tout entier, paraître devant lui brillant dans la splendeur des justes, n'ayant ni tache, ni ride, sans avoir souille en aucune manière votre habit d'immortalité, sanctifié dans tous vos membres, comme doit l'être celui qui s'est revêtu de Jésus-Christ. Vous tous, dit saint Paul, qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez été revêtus de Jésus-Christ (Gal. 3. 27.). Que tous vos membres soient donc saints, dignes de recevoir une robe sainte et brillante.
A ATHANASE, ÉVÊQUE D'ALEXANDRIE.
LXXXII—LI. Belle comparaison de la mer agitée avec l'Eglise divisée par un schisme qui la déchire. Saint Basile propose à Athanase un moyen de réunir plusieurs évêques orthodoxes qui étaient en division.
Lorsque j'envisage l'état présent des affaires, et que je vais les embarras qui retiennent comme dans des entraves toute ardeur pour le bien, je désespère absolument de nous-mêmes ; mais lorsque je pense à votre fermeté et à votre sagesse, lorsque je fais attention que le Seigneur vous a placé au milieu de nous comme un médecin pour remédier aux maux des Eglises, je reprends courage, je me rassure, et je conçois de meilleures espérances. Toute l'Eglise est en désordre : votre prudence ne peut l'ignorer. Du haut de votre esprit sublime, comme d'une tour, vous voyez tout ce qui se passe ; vous voyez, comme sur une vaste mer, des navires qui voguent ensemble, poussés par les flots qui sont violemment agités, faire naufrage, et parce qu'une cause étrangère soulève la mer avec violence, et parce que les navigateurs dans leur trouble s'embarrassent mutuellement et se brisent eux-mêmes. Je n'entreprends pas d'expliquer la comparaison : vous êtes trop éclairé pour qu'il soit besoin que j'en dise davantage, et d'ailleurs les circonstances ne me permettent point de parler librement. Où trouverons-nous un pilote assez habile pour nous diriger dans une navigation aussi périlleuse, un homme qui ait assez de crédit auprès du Seigneur pour le réveiller et obtenir de lui qu'il commande aux vents et à la mer? peut-on en choisir un autre que celui qui s'est exercé dès son enfance dans les combats pour la foi? Puis donc que tous les partisans de la vérité désirent sincèrement que les orthodoxes communiquent ensemble et se réunissent, je vous exhorte à écrire à tous une lettre qui nous marque ce que nous devons faire. Les évêques souhaitent que vous ouvriez les conférences sur la réunion des orthodoxes: mais comme leur conduite passée pourrait vous les rendre suspects, voici le parti que je vous propose, mon très religieux père. Envoyez-moi les lettres que vous écrirez aux évêques, soit par quelque personne sûre, soit par le ministère de notre cher frère Dorothée. Je ne remettrai vos lettres qu'autant que je serai sûr qu'on y fera réponse. Si j'y manque, je consens que vous ne me le pardonniez jamais (Gen. 43. 9.). Or cette promesse n'engageait pas plus fortement le fils de Jacob qui la faisait à son père, que moi qui vous la fais a vous notre père spirituel. Si vous désespérez de réussir, permettez-moi du moins de m'en charger, puisque je le fais à bonne intention, par un pur motif dé la paix, et pour réunir entre eux tous les orthodoxes, puisque c'est-là uniquement ce qui m'engage à prendre cet emploi et cette médiation.
A HÉLIE, GOUVERNEUR DE PROVINCE.
XCIV—CCCLXXXII. Saint Basile avait commencé de construire dans Césarée un grand édifice qui pouvait être utile à l'état et à l'Eglise ; ses ennemis voulaient l'empêcher de continuer cet ouvrage : il écrit au gouverneur de la province pour se justifier sur ce bâtiment ; il le prie de ne pas écouter les autres calomnies qu'on débitait à son sujet.
J'aurais bien voulu me rendre auprès de votre personne, afin que mes calomniateurs ne se prévalussent pas de mon absence : mais puisque mes maux, redoublant plus que jamais, m'en ont empêché, je me vois forcé de vous écrire. Il y a quelque temps que me trouvant près de vous, j'avais fort envie de vous faire le détail de ma conduite? et de vous entretenir des affaires de l'Eglise. Je me retins, croyant que ce serait une chose inutile et un zèle déplacé, d'aller donner de nouvelles inquiétudes à un homme déjà accablé de tant d'affaires. D'ailleurs, je dirai la vérité, je craignais de me voir réduit à blesser la délicatesse de votre conscience par le récit de nos disputes, à vous scandaliser, vous qui servez Dieu avec une piété si exemplaire, et qui attendez la récompense du zèle que vous montrez pour la Religion. Oui, si nous vous engagions dans nos affaires, à peine auriez-vous le temps de respirer et de vaquer à celles de l'état. Ce serait obliger un pilote qui conduit un navire neuf au milieu d'une violente tempête, de le charger de nouvelles marchandises, au lieu de le soulager d'une partie de sa charge. C'est pour cela, à ce qu'il me semble, que notre grand prince nous abandonne le gouvernement de l'Eglise ; il sait que ce soin nous regarde particulièrement. Je demanderais volontiers à ceux qui vous obsèdent et qui abusent de votre bonne foi, quel tort nous faisons à l'état, et si ses intérêts sont lésés le moins du monde par le gouvernement ecclésiastique : à moins qu'on ne dise que c'est offenser les droits de l'empire, de bâtir et d'orner une église magnifique en l'honneur de Dieu, d'y joindre une demeure honnête pour l’évêque, et des logements moins considérables pour les autres ministres des autels, logements, dont vous pouvez vous servir vous-même vous et votre suite. Quel mal faisons-nous en bâtissant des hospices pour les étrangers qui passent, ou qui, tombant malades, ont besoin d'être secourus ; en leur procurant, dans leurs maladies y des personnes pour les servir, des médecins, des bêtes de somme, des conducteurs? Il faut absolument ajouter les arts, ceux qui sont nécessaires pour vivre, et ceux qui aident à passer la vie avec quelque douceur. Il faut encore des ateliers pour diverses manufactures. Tous ces bâtiments embellissent la ville et font honneur au gouverneur lui-même, à qui on en attribue la gloire. Ce n'est point, sans doute, par ce motif que vous avez enfin consenti à nous gouverner. Vous pouvez, sans le secours de personne, rétablir des édifices que le temps a démolis, remplir d'habitants les déserts, et changer les solitudes en des villes peuplées. Toutefois ne doit-on pas honorer et considérer, plutôt que persécuter et outrager, celui qui vous seconde dans ces opérations? Et ne croyez pas que je vous parle de desseins chimériques : nous avons déjà mis la main à l'œuvre, et on apporte de toutes parts des matériaux. Dans ce qui précède, je me suis justifié envers le gouverneur. Je ne parlerai pas de ce que j'aurais pu vous dire comme à un chrétien et à un ami qui s'intéresse à ce qui me regarde ; je ne répondrai pas aux reproches de mes adversaires, parce que ma lettre est déjà trop longue, et qu'il n'y aurait pas de sûreté à confier mes raisons au papier. Cependant, de peur qu'avant que nous ayons pu vous joindre, vous ne vous laissiez ébranler par la calomnie, et que votre amitié pour moi ne se ralentisse, je vous conseille de faire ce que fit un jour Alexandre. On accusait un de ses amis ; il écoutait d'une oreille les accusations, et il bouchait l'autre avec le doigt, montrant par-là qu'un juge équitable ne devait point se laisser prévenir par les calomniateurs, mais qu'il fallait réserver une partie de son attention pour écouter l'apologie des absents.
XXX—VII. Il lui expose les raisons qui l'ont empêché de l'aller trouver, quelque envie qu'il en eût, la rigueur du froid, les maladies, les affaires, la mort de sa mère. Les Eglises étaient toujours dans l'agitation : il reconnaît que c'est aux prières d'Eusèbe que celles de Néocésarée et d’Ancyre devaient leur tranquillité.
Si je voulais vous mander un détail de toutes les raisons qui m'ont empêché de vous voir jusqu'à ce jour, quelque envie que j'en eusse, il faudrait vous écrire une longue histoire. Je ne parle ni de mes maladies fréquentes, ni de la rigueur de la saison, ni de l'embarras continuel des affaires, causes qui ne vous sont pas inconnues et dont je vous ai déjà fait part. Ma mère était mon unique consolation ; je viens de la perdre pour mes péchés. Et n'insultez pas à ma faiblesse en me voyant gémir à mon âge sur l'état d'orphelin ; mais par-donnez-moi d'être inconsolable de la perte d'une personne que rien ne peut remplacer dans le monde. Je suis donc retombé malade, condamné de nouveau à garder le lit, abandonné de presque toutes mes forces, et attendant, pour ainsi dire, ma dernière heure à chaque instant. La situation des Eglises n'est guère meilleure que la mienne ; elles ne voient luire aucun rayon d'espérance et les choses vont tous les jours de mal en pis. Néocésarée et Ancyre ont vu enfin des successeurs de leurs évêques morts ; jusqu'à présent elles sont tranquilles. Ceux qui ne nous veulent pas de bien n'ont pu rien encore entreprendre contre nous de ce que leur haine et leur animosité leur suggéraient. Nous en attribuons visiblement la cause à vos prières pour ces Eglises. Ainsi ne vous lassez point de prier pour elles et de fléchir le Seigneur. Allez de ma part ceux qui ont été jugés dignes de seconder votre zèle.
CXXXVIII—VIII. Il lui fait une vive peinture, de l'état où la maladie l’avait réduit : il lui parle des affaires de plusieurs Eglises, sur lesquelles il lui demande réponse: il fiait par se recommander à ses prières.
Dans quels sentiments croyez-vous que j'aie été en recevant votre lettre? Si j'avais voulu suivre le premier mouvement qu'elle m'inspirait, j'aurais volé vers vous; mais la faiblesse qui m'attachait au lit était si grande, que, bien loin de voler, je ne pouvais pas même me remuer. Il y avait cinquante jours que j'étais malade, lorsque j'ai été visité par notre très cher et excellent frère Elpidius. La fièvre m'a entièrement usé ; le peu de matière qu'elle trouvait dans un corps décharné, qui ressemble à une mèche desséchée par le feu, m'a fait tomber dans une longue faiblesse et dans une langueur importune. Le foie, mon ancien mal, se joignant à tous les autres, m'a empêché de prendre aucune nourriture, a chassé le sommeil de mes yeux, m'a conduit jusque sur les bords du tombeau, et ne m'a laissé qu'autant de vie qu'il en fallait pour sentir mes douleurs. J'ai usé d'eaux naturellement chaudes, et j'ai employé les remèdes des médecins: le mal a été supérieur à tout. Peut-être que l'habitude le rendra supportable, mais il n'est pas d'homme assez ferme pour résister à ses premières violences. Le plus grand chagrin que me cause ma longue maladie, c'est qu'elle me prive de l'avantage d’aller vous joindre. Or je sais par moi-même de quel plaisir je suis privé, quoique l'année précédente je n'aie fait que goûter du bout du doigt le miel si doux de votre Eglise (I. Rois. 14.27.). J avais bien des choses importantes à vous communiquer; et je souhaitais avec passion de vous voir pour m'éclaircir sur mes doutes. Il m'est impossible de trouver ici un ami sincère, un ami qui ait vos lumières et cette expérience acquise par de longs travaux dans l'Eglise, pour me donner des conseils dans les conjonctures présentes. Ce que je pourrais vous mander d'ailleurs n'est pas de nature à être mis dans une lettre; voici seulement ce que je puis vous écrire en toute sûreté. Le prêtre Evagre, fils de Pompeianus d'Antioche, qui s’était transporté dans l'Occident avec le bienheureux Eusèbe, est revenu de Rome. Il nous demande une lettre entièrement conforme à l'écrit dont on l'a chargé, nous rapportant la nôtre, comme si elle ne plaisait pas aux docteurs de ce pays: il demande encore qu'on y envoie au plus tôt des hommes de confiance, afin qu'on ait occasion de se voir réciproquement. Ceux de Sébaste, qui pensent comme nous, et qui ont découvert le poison caché dans la doctrine d'Eustathe, implorent notre assistance. Icône était autrefois la première ville de Pisidie après la capitale ; elle est maintenant métropole d'une province composée des débris de plusieurs autres. Elle m'invite à me rendre chez elle pour y nommer un évêque, parce que Faustin est mort. J'aurais donc eu besoin d'aller moi-même vous consulter, pour savoir si je dois me charger d'ordinations étrangères, la réponse que je dois donner aux habitants de Sébaste, et ce que je dois penser des conseils d'Evagre: mais ma mauvaise santé m'empêche de pouvoir vous joindre. Si vous avez quelqu'un qui doive bientôt venir ici, envoyez-moi, je vous conjure, des réponses sur tous ces chefs : sinon, demandez à Dieu qu'il m'inspire ce qui peut lui être le plus agréable; priez pour moi et engagez le peuple à joindre ses prières aux vôtres, afin que les jours ou les heures qui restent de mon pèlerinage soient entièrement consacrés au service et à la gloire du Seigneur.
XXVIII—LXII. L'Eglise de Néocésarée, qu'avait gouvernée St. Grégoire surnommé le Thaumaturge, venait de perdre son évêque : saint Basile écrit à cette Eglise pour la consoler de la perte de son pasteur, et pour l'engager à en choisir un autre digne de le remplacer, qui maintienne son peuple dans la foi orthodoxe, il fait un assez long et très bel éloge du pontife qui tenait de mourir,
La perte que vous venez d'essuyer, demanderait que je fusse dans votre ville pour rendre au saint prélat les derniers devoirs avec vous qui teniez de si près à son cœur, pour participer à votre tristesse par le spectacle même des objets tristes, et pour vous donner les conseils dont vous avez besoin. Mais comme beaucoup de raisons m’empêchent d'aller vous joindre, il me reste à vous témoigner par une lettre la part que je prends à votre douleur. Les actions et les vertus distinguées de celui que nous pleurons, lesquelles nous rendent sa perte si sensible, ne pourraient être renfermées dans Une lettre, et d'ailleurs il ne serait pas à propos d'en parcourir les détails lorsque notre âme est accablée par l'affliction. Ces actions et ces vertus sont telles qu'il est impossible d en perdre la mémoire, et qu'on ne doit point les passer sous silence : mais elles sont en si grand nombre que je ne pourrais parvenir à les rapporter toutes, et si j'en omettais quelques-unes je craindrais de trahir la vérité.
La mort nous a enlevé l'homme de notre siècle qui était doué des plus grandes qualités naturelles, le soutien de sa patrie, l'ornement des Eglises, la colonne de la vérité, l'appui le plus ferme de la foi en Jésus-Christ, gardien sûr de ses enfants, ennemi redoutable des ennemis de Dieu, attaché aux anciennes coutumes, opposé aux nouveautés, montrant dans sa personne la figure de l'Eglise primitive, et réglant sur ce modèle l'Eglise particulière confiée à ses soins; de sorte que les fidèles qu'il gouvernait semblaient avoir vécu avec les chrétiens qui ont brillé il y a deux cents ans et au-delà: tant le pontife dont nous parlons ne disait rien de lui-même, ne produisait aucune imagination nouvelle, mais savait, selon la bénédiction de Moïse, tirer du fond de son cœur, comme d'un excellent trésor, ce qu'il y avait de plus ancien préférablement à ce qui était nouveau. C'est pour cela que parmi ses égaux, sans avoir égard à son âge, tous d'un accord unanime lui déféraient la première place, parce qu'il se distinguait entre tous par une sagesse vraiment antique. Pour comprendre combien l'attachement aux anciennes maximes est utile, il suffit de jeter les yeux sur vous. Vous êtes les seuls des peuples que nous connaissons, ou du moins avec très peu d'autres, qui, grâce à son gouvernement, ayez joui du calme le plus paisible au milieu des orages et des tempêtes qui agitaient le monde chrétien. Les vents violents des hérésies ne vous ont point troublés, ces vents dangereux qui font subir tant de naufrages aux âmes inconstantes. Puissent-ils ne vous troubler jamais! je le demande au souverain Seigneur, qui avait choisi son serviteur fidèle pour être l'appui de l'Eglise, et pour y maintenir le plus longtemps possible la tranquillité. Ne l'exposez pas, cette tranquillité, dans la circonstance présente ; et en vous livrant à une douleur excessive, à des lamentations immodérées, ne fournissez pas à ceux qui veulent vous nuire l'occasion de vous surprendre. Que si vous voulez absolument verser des pleurs, ce que je ne vous conseille pas dans la crainte que vous ne ressembliez à ceux qui n'ont pas d'espérance, pleurez du moins d'une manière qui convienne au digne pasteur que la mort vient de vous ravir. Quoiqu'il ne soit point parvenu jusqu'à l'extrême vieillesse, cependant il a eu assez de vie pour vous bien gouverner. Il ne s'intéressait à son corps qu'autant qu'il lui donnait sujet de montrer la force de son âme dans les douleurs de la maladie. Quelqu'un de vous pensera peut-être que le temps et l'habitude de vivre avec les personnes, loin de nous rassasier pour elles, augmentent en nous le plaisir de les voir, et redoublent notre tendresse ; de sorte que plus vous avez joui longtemps d'un grand bien, plus vous en sentez la privation. Peut-être penserez-vous aussi que les cendres d'un juste doivent être honorées par tout ce qu'il y a d'hommes vertueux. Je désire moi-même que vous soyez tous dans ces sentiments; car je ne dis pas qu'on doive négliger la mémoire de votre pontife, mais je vous conseille de supporter votre douleur avec une modération raisonnable. Je n'ignore pas ce que peuvent dire ceux qui pleurent leurs évêques. Elle est muette cette bouche dont les paroles se répandaient comme les eaux d'un fleuve abondant. Ce cœur immense, dont personne ne pou-voit mesurer l'étendue, s'est évanoui, du moins pour les hommes, comme un vain songe. Qui jamais eut plus de pénétration pour prévoir l'avenir? qui jamais eut une âme plus ferme et plus décidée pour entreprendre avec promptitude les affaires? O ville infortunée, tuas déjà éprouvé bien des malheurs ; mais celui-ci t'a porté le coup le plus sensible. Ton plus bel ornement est absolument flétri, un morne silence règne dans ton église, tes grandes assemblées sont obscurcies par la douleur, le clergé regrette son chef, les Ecritures Saintes n'ont plus d'interprète, les enfants ont perdu leur père, les anciens leur égal, les magistrats leur maître, le peuple un prélat qui le gouvernait, les pauvres un ami compatissant qui les nourrissait. Tous lui donnent les noms les plus tendres, et chacun regarde sa perte par l'endroit qui le touche davantage.
Mais où m'emporte le plaisir que j'ai moi-même à pleurer? Ne nous réveillerons-nous pas? ne rentrerons-nous pas en nous-mêmes? ne nous résignerons-nous pas à la volonté du Maître commun, qui rappelle à lui ses saints après qu'ils ont fourni leur carrière? Souvenez-vous, dans la conjoncture présente, des paroles de l'Apôtre que votre pontife vous répétait sans cesse dans ses discours : Gardez-vous des chiens, gardez-vous des mauvais ouvriers (Phil. 3. 2.). Il est beaucoup de chiens. Que dis-je? toute la terre est pleine de loups ravissants qui, cachant leur malignité sous la peau de brebis, déchirent le troupeau du Fils de Dieu. Mettez-vous à l'abri de ces loups, en vous mettant sous la conduite de quelque vigilant pasteur. C'est à vous à le demander avec un esprit soumis, sans dispute et sans intrigue : c'est à Dieu à vous le désigner, lui qui, depuis votre illustre évêque Grégoire, jusqu'au pontife que vous venez de perdre, les a tous choisis les uns après les autres, et les a disposés comme des pierres précieuses pour l'ornement de votre Eglise. Ne désespérez donc point pour l'avenir ; le Seigneur connaît les siens, et il en peut produire que nous n'attendons pas. Il y a longtemps que j'aurais voulu finir cette lettre, la douleur que j'éprouve m'en empêche. Je vous conjure, au nom des pères, au nom de la foi orthodoxe, au nom de l’évêque dont vous regrettez la perte, de penser sérieusement au choix de son successeur, de croire que ce soin vous regarde chacun particulièrement, et, quel que soit le succès de la chose, bon ou mauvais, que chacun de vous sera le premier à en ressentir les effets. Que personne, comme ce n'est que trop l'ordinaire, ne rejette sur son voisin le soin des affaires publiques : car tandis que chaque particulier les néglige pour sa part, tous, sans y prendre garde, s'attirent à eux-mêmes un malheur qui leur est propre. Soit que mes avis soient ceux d'un homme qui s'intéresse à ses voisins, ou qui communique avec vous de sentiments, ou, ce qui est le plus véritable, qui, selon la loi de charité, craint d'encourir le blâme d'avoir gardé le silence, recevez-les avec bienveillance, je vous prie, persuadés que vous êtes ma gloire comme nous sommes la vôtre pour le jour du Seigneur, et que d'après le choix du pasteur que vous allez élire, ou nous serons unis davantage, ou qu'une séparation totale....... Je n'achève pas, je ne veux point présager un malheur que Dieu éloignera par sa grâce, je l'espère. Au reste, et c'est par où je finis, fi le pontife que nous pleurons n a pas travaillé de concert avec nous pour la paix de l'Eglise, à cause de certaines préventions,[15] comme il l'assurait lui-même, je prends à témoins Dieu et tous ceux qui me connaissent, que je ne cessai jamais de penser comme lui, et de l'inviter à prendre part aux combats que je livrais aux hérétiques.
CLXI—CCCXCIII. Amphiloque s'était caché de peur qu'on ne l'élût évêque : saint Basile le félicite après son élection, et l'exhorte à remplir dignement toutes les fonctions de son ministère, dans un temps surtout ou l'Eglise était désolée par l’erreur des Ariens.
Béni soit Dieu qui, dans tous les temps, choisit ceux qui lui plaisent, qui connaît ses vases d'élection et les emploie au service de ses saints. C'est lui qui, quand vous cherchiez, non pas à nous fuir, comme vous le dites vous-même, mais à vous dérober à l'élection qui devait se faire par nous, vous a arrêté par les liens inévitables de sa grâce, vous a placé au milieu de la Pisidie, pour conquérir des aptes, et pour ramener des ténèbres à la lumière des hommes dévoués au démon. Dites donc avec le Roi-Prophète : Où irai-je pour me cacher de votre présence, et pour me dérober à notre esprit (Ps. 138. 7.)? Voilà les prodiges que le Seigneur a coutume d'opérer dans sa miséricorde. Des ânesses s'égarent afin qu'Israël ait un roi (I. Rois. 9.). Ce roi donné à Israël était Israélite : pour vous, ce n'est pas la patrie qui vous a nourri et qui vous a conduit à un si haut degré de vertu, qui vous possède ; mais elle voit une ville voisine parée de ses ornements. Au reste, puisque tous ceux qui croient en Jésus-Christ ne font qu'un peuple, et que tous les chrétiens composent la même Eglise, quoiqu'elle soit dispersée partout, votre patrie se réjouit et s'applaudit de contribuer à l'exécution des décrets divins; elle ne croit pas avoir perdu un homme seul, mais par un seul nomme s'être acquis toutes les Eglises. Nous ne demandons à Dieu que la grâce de voua voir et d'entendre parler des progrès que voua faites pour l'avancement de l'Evangile et la prospérité des Eglises. Armez-vous donc de force et de courage; et, gouvernant le peuple que le très Haut a confié à vos soins, mettez-vous, comme un habile pilote, au-dessus de la tempête qu'a excitée le vent des hérésies. Empêchez que le vaisseau ne soit submergé par les flots amers des doctrines perverses. Attendez le calme que ramènera bientôt le Seigneur, quand il aura trouvé quelqu'un capable de commander de sa part aux vents et à la mer. Si vous voulez visiter un ami que ses longues infirmités conduisent en hâte à sa dernière fin, n'attendez pas un temps plus commode, ni que je vous donne le signal : c'est toujours le temps pour un père d'embrasser un fils qu'il chérit, et l'affection du cœur triomphe de tous les obstacles. Ne vous plaignez point que le fardeau qu'on vous a imposé soit au-dessus de vos forces ; même alors il ne serait pas insupportable, et vous ne succomberiez pas sous le faix : mais, si le Seigneur le porte avec vous, jetez dans son sein toutes vos inquiétudes (Ps. 54. 23.), et il vous soulagera lui-même. Permettez-moi seulement de vous donner cet avis: prenez garde de vous laisser entraîner à la corruption du siècle ; servez-vous de la sagesse que Dieu vous a donnée pour réformer les vices que vous trouverez établis. Jésus-Christ vous a envoyé, non pour suivre ceux qui se perdent, mais pour guider ceux qui se sauvent. Priez pour moi le Seigneur, afin que, si je dois vivre encore quelque temps, il me fasse la grâce de vous voir dans votre Eglise; ou, si je dois bientôt sortir de ce monde, je voie en Dieu, votre Eglise comme une vigne fleurissante de bonnes œuvres, et vous, comme un vigneron habile, comme un excellent serviteur, qui distribue dans le temps la nourriture à ses compagnons, et qui reçoit la récompense d'un prudent et fidèle économe. Ceux qui sont avec moi vous saluent. Portez-vous bien et réjouissez-vous dans le Seigneur. Que les dons de l'esprit et de la sagesse vous comblent de gloire.
CLXVI—CCLI. Il loue le zèle d'un de ses amis qui avait eu le courage d'aller visiter dans son exil Eusèbe, exilé par les Ariens; il félicite Eusèbe des maux qu'il a soufferts pour la défense de la vérité ; il lui en promet la récompense dans le ciel ; il se recommande à ses prières.
J'avais toujours eu beaucoup de vénération pour notre très honoré frère Eupraxius, et je n'avais mis au nombre de mes plus intimes amis ; mais j'ai redoublé mon estime et ma tendresse depuis qu'il vous a témoigné une si vive affection; il est allé vous trouver avec le même empressement, pour me servir des paroles de David, qu'un cerf pressé par la soif court à une fontaine pure pour se désaltérer ( Ps. 41. 2 ) Je le trouve heureux de pouvoir jouir de votre société ; mais vous êtes bien plus heureux, vous, d avoir couronné de la sorte les maux que vous avez soufferts pour Jésus-Christ, les travaux que Vous avez endurés pour la défense de la vérité : peu d’hommes craignant Dieu ont eu cet avantage. Votre vertu a été mise à l'épreuve : ce n'est pas seulement dans le calme que vous avez navigué, que vous avez gouverné habilement les autres ; mais vous vous êtes distingué au milieu des plus violentes tentations, et vous vous êtes élevé au-dessus de vos persécuteurs, en vous retirant en exil avec courage. Que les autres habitent paisiblement la terre où ils sont nés; pour nous, notre patrie est le ciel. Ils ont peut-être envahi notre siège episcopal, mais nous avons toujours avec nous Jésus-Christ. Heureux commerce ! quelles richesses nous acquérons pour des bagatelles que nous méprisons ! Nous avons passé par l'eau et par le feu, j'espère que nous serons mis dans un lieu de rafraîchissement. Le Seigneur né nous abandonnera pas jusqu’à la fin, il ne souffrira pas que la vérité demeure opprimée, il proportionnera ses consolations à nos douleurs. C'est là ce que nous espérons et ce que nous lui demandons. Je vous conjure de prier pour moi et de me donner votre bénédiction toutes les fois que vous m'écrirez. Fortifiez mon courage en m'apprenant de vos nouvelles, comme vous avez eu la complaisance de le faire.
CCXL—CXCII. Il les remercie de la lettre qu'ils lui ont écrite et de celui qu'ils ont chargé de la lettre. Il les exhorte à tenir ferme dans les persécutions : il déplore l'infortune d'un mauvais prêtre qui avait renoncé à la bonne doctrine pour devenir évêque par le crédit et par les cabales des Ariens. Il proteste qu'il ne reconnaît point pour évêque un homme installé de la sorte ; qu'il rompra tout commerce avec ceux qui ne seront point dans ce sentiment, et avec tous ceux qui se feront ordonner prêtres par un tel pontife.
Vous avec fort bien fait de m'écrire, et de m'écrire par un homme qui, sans aucune lettre était capable de me délivrer de mes inquiétudes, et de m'instruire exactement des choses. Il y avait mille objets que je désirais d'apprendre d'une personne bien informée, parce qu'on avait répandu beaucoup de nouvelles incertaines. Notre très cher et vénérable frère Théodose m'a parfaitement bien éclairci sur tout. Ce que je me conseille à moi-même, je vous l'écris dans cette lettre. Les maux que vous souffrez sont arrivés à beaucoup d'autres. Le temps passé et le temps présent fournissent une infinité d'exemples semblables, que nous connaissons par la tradition ou par l'histoire ; ils nous apprennent que les serviteurs de Dieu, villes et particuliers, ont toujours été persécutés pour le nom du Seigneur. Mais ces persécutions passent, et les maux ne sont pas éternels. Les grêles, les torrents, et autres calamités semblables, attaquent et détruisent tout ce qui ne résiste point, mais perdent toutes leurs forces contre les corps durs et solides : ainsi les persécutions violentes qui s'élèvent contre l'Eglise ne peuvent rien contre la fermeté de la foi en. Jésus-Christ. Comme donc le nuage de grêle passe et fait place au beau temps ; comme le torrent s'écoule et laisse la campagne à sec, de même les tempêtes qui nous tourmentent maintenant disparaîtront bientôt, pourvu que, sans envisager le présent, nous portions nos pensées et nos espérances jusque dans l'avenir. Quoique la tentation soit rude, accoutumons-nous à supporter ce qu'il y a de plus pénible. Si nos disgrâces ne sont que des jeux du démon, et si nos persécuteurs nous paraissent incommodes parce qu'ils sont ses ministres, mais sont très méprisables parce que Dieu a joint l'impuissance à leur malice, prenons garde qu'on ne nous reproche de nous affliger trop pour des peines médiocres. Il n'y a de vraiment affligeant que la perte de celui même qui, pour une gloire passagère (si l'on doit appeler gloire de se déshonorer soi-même), s'est privé de la splendeur éternelle des justes. Vous êtes les enfants de confesseurs, les enfants de martyrs qui ont répandu leur sang pour s'opposer au péché. Que chacun se serve de ses exemples domestiques pour être ferme dans la piété. On ne nous a point encore déchirés de coups, on n'a point confisqué nos maisons, on ne nous a point condamnés à l'exil, on ne nous a point traînés en prison. Quel mal ayons-nous souffert ? à moins que nous ne nous affligions de n'avoir pas été jugés dignes de souffrir pour Jésus-Christ. Si vous vous chagrines parce qu'on s'est emparé de votre église, et que vous êtes contraints de prier en pleine campagne le Seigneur du ciel et de la terre, songez que les Apôtres restoient renfermés dans le cénacle, tandis que ceux qui avoient crucifié le Seigneur célébraient les sacrifices de la loi judaïque dans un temple célèbre. Judas, qui aima mieux s'étrangler lui-même que de vivre avec infamie, est peut-être préférable à ceux qui ont endurci leur front contre tous les reproches, et qui commettent avec la dernière impudence les actions les plufr honteuses. Prenez garde seulement de vous laisser séduire par leurs mensonges, et de prendre pour dogme de foi tout ce qu'ils vous proposent. Ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des traîtres à Jésus-Christ, qui ne cherchent que leurs intérêts, et qui ne se mettent guère en peine de la vérité. Lorsqu'ils ont cru pouvoir obtenir une vaine puissance, ils se sont attachés aux ennemis de Jésus-Christ.; lorsqu'ils voient les peuples soulevés contre l'erreur, ils feignent de reprendre des sentimens orthodoxes. Je ne reconnois point pour évêque, et je ne mets point au rang des prêtres de Jésus-Christ, celui que de profanes mains ont installé pour la destruction de la foi. Voilà ce que je pense ; et sans doute vous pensez de même, si vous communiquez avec moi de sentîments. Si vous avez une opinion à part, chacun est maître de croire ce qu'il veut, nous sommes du moins purs de votre sang. Si je vous écris de la sorte, ce n'est pas que j'aie de voue aucune défiance, mais c'est pour fixer l'irrésolution de certaines personnes en leur déclarant nettement ce que je pense : c'est pour les empêcher d'entrer dans la communion d'un hérétique, et de s'ingérer aux fonctions sacerdotales, aprèg que la paix sera rendue à l'Eglise, si elles permettent qu'il leur impose les mains. Je salue tout le clergé, celui de la ville et des environs, avec tous les fidèles qui craignent Dieu.
A SAINT AMBROISE , EVEQUE DE MILAN.
CXCVII—LV. Saint Àmbroise avoit envoyé à St. Basile des prêtres pour demander qu'on lui rendit le corps du bienheureux Denys de Milan. Saint Basile lui écrit cette lettre pour féliciter l'Eglise de l'élection d'un pontife tel qu Ambroise, dont il fait un bel éloge. Il loue la conduite édifiante des prêtres qu'il a envoyés ; il raconte comment on leur a remis le corps du bienheureux Denys; il assure que les reliques sont véritables.
QU'ELLES sont grandes, qu'elles sont multiplies les grâces dont le Seigneur nous comble! il est impossible, et d'en mesurer la grandeur, et d'en compter la multitude. Mais une des plus considérables, c'est que, malgré la distance des lieux qui nous séparent, nous pouvons nous réunir par des. entretiens tacites confiés au papier. Dieu nous, donne deux manières pour converser ensemble, l'une par la liberté de nous joindre, l'autre par le commerce des lettres. Puis donc que je vous ai connu par vos paroles écrites, et que je vous ai connu, non en gravant dans ma mémoire les traits de votre visage, mais en jugeant de la beauté de l'homme intérieur par la variété des discours, car c'est de l'abondance du cœur que chacun de nous s'exprime (Matth. 12. 34.), j'ai glorifié Dieu qui, dans tous les siècles, se choisit des serviteurs fidèles. Il prit autrefois un simple berger pour gouverner son peuple. Amos qui gardait des chèvres, il le remplit de son esprit et releva à la dignité de prophète. Il tire aujourd'hui de la ville royale, pour conduire le troupeau de Jésus-Christ, le gouverneur de toute une nation, recommandable par l'élévation de ses sentiments, par la splendeur de sa naissance, par l'éclat de sa vie, par la force de son éloquence, par tous les avantages qui nous distinguent ici-bas. Ces avantages, cet homme illustre les a foulés aux pieds ; et n'en tenant aucun compte pour gagner Jésus-Christ, il a pris le gouvernail d'une grande Eglise, d'une Eglise célèbre par sa foi dans la divinité. Puis donc, homme de Dieu, que ce ne sont point les leçons des hommes qui vous ont appris les maximes de l'Evangile, mais que le Seigneur lui-même vous a tiré du milieu des juges de la terre pour vous placer sur la chaire des apôtres, combattez en guerrier généreux, réformez les erreurs de votre peuple ; et si par hasard il était infecté du poison de l’hérésie arienne, remettez-le sur la voie de nos pères : entretenez toujours par vos lettres le commerce de charité que vous avez commencé avec moi ; car par là nous serons toujours unis l'un et l'autre en esprit, quoique nous soyons séparés par un immense intervalle.
Votre empressement et votre zèle pour les reliques du bienheureux évêque Denys, attestent votre amour pour le Seigneur, votre respect pour vos prédécesseurs dans l'épiscopat, votre attachement à la foi ; oui, l’affection pour les serviteurs de Dieu se rapporte à Dieu lui-même, et celui qui honore les athlètes de la foi, montre qu'il est enflammé de la même ardeur pour la foi. Ainsi, une seule démarche décèle en vous bien des vertus. Je crois devoir vous apprendre que les prêtres vertueux qui ont été chargés par vous d'une pieuse commission, ont mérité les éloges de notre clergé par la pureté de leurs mœurs, et ont annoncé par leur sagesse particulière quelle pouvait être la décence de votre Eglise en général. De plus, avec autant de douceur que de force, après avoir bravé les rigueurs de la saison, ils ont persuadé aux possesseurs du corps bienheureux de leur abandonner ce qu'ils regardaient comme leur sûreté et leur défense. Or, il est bon que vous sachiez que ni magistrats, ni puissances dans le monde, n'auraient pu les y contraindre, si la constance édifiante de vos prêtres ne les eût touchés et gagnés. Ils ont été secondés dans leur projet, surtout par notre très cher fils et très religieux prêtre Thérasius, qui, s'étant exposé volontairement à la fatigue du voyage, a fait renoncer les possesseurs du corps à la disposition où ils étaient de ne pas s'en dessaisir, et qui, ayant persuadé par ses discours les plus opposés à l'entreprise, a recueilli les reliques avec le respect convenable, en présence de prêtres, de diacres, d'autres hommes craignant Dieu, et les a remises à vos envoyés. Vous les avez reçues avec autant de joie qu'ont témoigné de tristesse en les reconduisant ceux qui en étaient les maîtres. Que nul de vous n'ait de doute et d'inquiétude : c'est vraiment l'athlète invincible que vous demandez. Le Seigneur connaît ces os qui ont combattu avec une âme bienheureuse, il les couronnera avec elle dans ce jour où sa justice rendra à chacun ce qui lui est dû. Nous devons tous comparaître, dit saint Paul, devant le tribunal de Jésus-Christ, afin que chacun reçoive ce qui est dû aux actions qu'il aura faites étant revêtu de son corps (2. Cor. 5. 10.). Le corps vénérable a été renfermé dans un sépulcre à part ; aucun autre n'était près de lui. La sépulture était remarquable ; on lui a rendu les honneurs qu'on rend à un martyr. Ce sont les chrétiens qui lui avaient donné l'hospitalité, qui ont recueilli eux-mêmes ses dépouilles et qui viennent de les transférer. Ils ont pleuré comme s'ils étaient privés d'un père et d'un protecteur. Ils l'ont reconduit et vous l'ont livré, préférant votre satisfaction à leur consolation propre. Ceux qui ont remis le dépôt sont des hommes pieux, ceux qui Font reçu sont exacts. Il n'y a nulle part de fraude et de mensonge ; nous vous l'attestons : c'est une vérité certaine et incontestable.
ASCHOLIUS, ÉVÊQUE DE THESSALONIQUE.
CLXIV—CCCXXXVIII. Il le remercie des lettres qu'il lui a voit écrites, et des nouvelles qu'il lui avait apprises. Il compare les fidèles d'Orient affligés pour la foi, aux premiers chrétiens : il témoigne la joie qu'il ressent en apprenant avec quel courage ils souffrent la persécution : il se plaint cependant de la faiblesse de quelques-uns et du peu d'accord qui régnait parmi eux.
Je n'ai point de termes pour vous exprimer la satisfaction que m'a causée votre lettre : vous pouvez le conjecturer vous-même par la beauté des choses que vous m'avez écrites. Eh! que ne présente pas la lettre dont vous m'avez honoré? ne respire-t-elle pas l'amour pour le Seigneur? ne peint-elle pas le merveilleux courage et les admirables combats des martyrs, avec des traits si frappants, que l’on pense voir les faits se passer sous les yeux? n'offre-t-elle pas encore des marques d'estime et d'affection pour moi? n'y voit-on pas enfin tout ce qu'on peut imaginer de plus agréable? En lisant votre lettre à plusieurs reprises, et en remarquant la grâce de l’Esprit-Saint qui éclate à chaque ligne, il me semblait qu'elle avait été écrite dans les premiers temps du christianisme, où les Eglises fleurissaient affermies par la foi et unies par la charité, où les fidèles agissaient tous de concert comme les divers membres d'un même corps; où les persécuteurs et les persécutés étaient bien connus, où l'on voyait le nombre des chrétiens croître à mesure qu'on leur faisait la guerre; le sang des martyrs arroser et féconder les Eglises, produire une foule de défenseurs de la vérité, exemple et l'ardeur des premiers excitant les autres à combattre. Alors les chrétiens vivaient en paix les uns avec les autres; cette paix que Jésus-Christ nous a laissée régnait parmi eux: On n'en voit plus maintenant aucun vestige; l'aigreur qui altère les esprits l’a bannie entièrement. Toutefois, les lettres pleines de charité qu'on nous a envoyées de si loin, nous ont ramenés au bonheur des premiers temps. Le corps d'un martyr apporté chez nous des pays d'au-delà du Danube, annonce par lui-même l'intégrité de la foi qui domine dans ces contrées. Qui pourrait décrire la joie que nous ont causée ces nouvelles? quelle éloquence assez vive pourrait dépeindre les sentiments que ce récit a fait naître au fond de nos cœurs? En voyant le corps d'un généreux athlète, nous avons trouvé heureux celui qui l’a exhorté à combattre, et qui recevra lui-même du juste Juge la couronne de justice, parce qu'il en a fortifié plusieurs dans les combats pour la religion. En nous rappelant la mémoire du bienheureux Eutychès, et en faisant honneur à notre patrie d'avoir produit elle-même des semences de piété, vous nous avez comblés de joie par le souvenir des temps anciens, et pénétrés de douleur par la comparaison avec ce qui se passe de nos jours. Non, il n'est personne parmi nous qui approche de la vertu d’Eutychès : nous sommes si éloignés d'adoucir les Barbares, par la puissance de l'Esprit-Saint et par l'efficacité de ses opérations, que nos crimes seraient capables de rendre féroces les peuples les plus tranquilles. C'est à nos péchés qu'il faut attribuer les grands succès des hérétiques, et cette puissance qui s'étend si loin, qu'à peine pourrait-on trouver sur toute la terre un endroit où ils n'aient porté le feu. Vos récits offrent des combats de généreux athlètes > des corps déchirés pour la foi, des cœurs intrépides qui méprisent la fureur des Barbares, divers genres de supplices, le courage et la constance des martyrs au milieu des tourments de toute espèce. Et chez nous que voit-on? la charité refroidie, la doctrine des pères ravagée, de fréquents ravages dans la foi, les bouches des personnes pieuses réduites au silence, le peuple chassé des églises et contraint d'élever les mains en pleine campagne vers le Maître suprême des cieux, partout des persécutions cruelles, nulle part l'honneur du martyre, parce que ceux qui nous tourmentent portent comme nous le nom de chrétien. Priez le Seigneur pour qu'il dissipe nos maux, et joignez à vos prières celles des généreux défenseurs du nom de Jésus-Christ ; afin que, si le monde doit durer encore quelque temps, et si l'univers ne tend pas vers sa dissolution, Dieu réconcilié avec ses Eglises, les ramène à leur ancienne tranquillité.
CCXCIH—CLXVI. Il lui demande des nouvelles de sa santé, lui donne quelques préceptes de morale, s'excuse de ce qu'il ne l'a pas été voir, et le prie de lui écrire souvent.
Comment vous êtes-vous porté tout ce temps passé? avez-vous recouvré parfaitement l'usage e votre main? comment vont toutes vos affaires? s'arrangent-elles selon vos désirs, ainsi que je le souhaite, et d'après votre plan de vie? Ceux qui ont l'esprit changeant et volage ne peuvent guère mener une vie réglée ; mais les personnes qui ont une âme solide et ferme vont toujours à leur but d'un pas égal, sans jamais varier dans leur conduite. Un pilote ne peut ramener le calme quand il veut ; au lieu qu'il nous est fort aisé de nous établir dans une vie tranquille, si nous apaisons le tumulte que font naître au-dedans de nous les passions, et si nous nous élevons au-dessus de tous les accidents extérieurs. Les pertes de biens, les maladies, les autres disgrâces dont notre vie est traversée, n'altéreront pas l'homme vertueux, qui, tenant sa volonté soumise à celle du souverain Maître, surmonte aisément les tempêtes qui s'excitent de la terre. Ceux qui sont trop occupés de soins terrestres ressemblent à ces volatiles trop grasses, à qui leurs ailes deviennent inutiles, et qui se trament en bas avec les animaux broutants. Les affaires dont je suis accablé ne m'ont point permis de vous voir que comme des navigateurs qui se rencontrent. Mais, comme par un seul ongle on connaît le lion tout entier, il n'a pas été besoin que je vous pratiquasse beaucoup pour juger de ce que vous êtes. Je suis donc très flatté que vous preniez quelque intérêt à ce qui me regarde, que je ne sois pas absent de votre esprit, et que je vive un peu dans votre souvenir. Vos lettres me sont une preuve que vous ne m'oubliez pas. Aussi plus vous m'écrirez, plus vous me ferez de plaisir.
A MODESTE, PRÉFET DU PRÉTOIRE.
CCXXXIX—CCLXXIV. Saint Basile recommande une personne à Modeste, en le louant sur son penchant à obliger, et en montrant combien il s'intéresse à cette personne. C’est le même Modeste avec lequel saint Basile avait eu de si vifs démêlés pour la foi, et avec lequel il s’était réconcilié. On voit par cette lettre et par les deux suivantes, combien ce génie ferme et inébranlable dans les grandes conjonctures, était doux et humble dans le cours ordinaire de la vie.
Je vous ai déjà écrit plusieurs lettres de recommandation ; cependant vous me traitez avec tant d'égard, que je ne crains pas de vous fatiguer en vous écrivant toujours. C'est pour cela que j’ai remis cette lettre avec confiance à un de nos frères, persuadé que vous lui accorderez ce qu'il désire, et que vous me mettrez au nombre de ceux qui vous obligent, parce que je vous procure les occasions de faire du bien. Il vous dira lui-même en quoi il a besoin de votre secours, pourvu que vous daigniez jeter sur lui un regard favorable, et lui permettre de s'expliquer avec vous librement. Je fais ce qui dépend de moi en vous le recommandant, et je regarderai comme m'étant rendus à moi-même les bons offices que vous lui rendrez ; d'autant plus qu'il est venu de Tyanes tout exprès, dans l'idée qu'une lettre de recommandation de ma part lui serait fort avantageuse. Afin donc qu'il ne soit pas frustré dans son espérance, que moi je sois traité par vous avec les égards ordinaires, et que vous, Modeste, vous puissiez satisfaire votre penchant à obliger, accueillez-le avec bonté, je vous en conjure, mettez-le au rang de vos meilleurs amis.
CXI—CCLXXVI. C'est encore ici une lettre de recommandation. Il le supplie pour quelqu'un qui était accusé; il le prie, ou de lui rendre justice s'il est innocent, ou de le traiter avec indulgence s'il est coupable.
Je n'aurais jamais osé me permettre de vous importuner, moi qui connais si bien ce que je suis et le rang que vous occupez: mais voyant l'embarras d'un de mes amis qui a été cité pour comparaître, je me suis hasardé de lui donner une lettre de recommandation, afin que vous le traitiez avec quelque indulgence. Quand ma lettre ne mériterait aucun égard, le motif seul de bonté suffirait pour fléchir le plus humain des préfets, et pour m'obtenir la grâce que je lui demande. Si cet homme n'a fait aucun mal, sauvez-le pour l'intérêt de la vérité même : s'il a commis quelque faute, pardonnez-lui à cause de Basile qui vous en conjure. Qui peut mieux connaître que vous l'état de nos affaires? Rien n'échappe à vos connaissances, et vous réglez toutes choses avec une prudence merveilleuse.
CXI—CCLXXVII. Il craint de l'importuner par sa recommandation ; mais il ne peut s’empêcher de lui écrire encore en faveur de malheureux habitants de la campagne, qui avaient besoin d'être soulagés.
Je prie le Dieu bon d'augmenter pendant toute votre vie l'éclat de votre gloire, en proportion de l'honneur que vous nous faites en vous abaissant jusqu'à nous avec tant de bonté. Quelque envie que j'eusse de vous écrire et d'user de la liberté que vous m'avez accordée, j'en ai été empêché par une certaine pudeur, et par la crainte d'abuser de votre complaisance. Mais la permission de vous écrire que vous m'avez donnée vous-même, et le besoin de quelques personnes qui souffrent, suffisent pour m'enhardir. Si les supplications des faibles sont de quelque poids auprès des hommes puissants, laissez-vous fléchir par mes prières. Jetez un regard favorable sur de malheureux habitants de la campagne, qui travaillent sur le mont Taurus, où sont des forges de fer: n'exigez d'eux qu'un tribut supportable pour le fer qu'ils façonnent, de peur qu'ils ne succombent sous le poids, et qu'ils ne soient à l'avenir hors d'état de pouvoir servir le public. Je suis persuadé qu'ayant l’âme aussi bonne, vous prenez fort à cœur cette affaire.
CXVIII—CCCXVIII. Il le prie d'une manière fort agréable de venir le voir,
Vous m'êtes débiteur d'une dette que j'estime infiniment. Je vous ai donné mon amitié, et il faut que vous me la rendiez avec usure, puisque le Seigneur ne défend point une usure de cette espèce. Acquittez-vous donc, ô vous qui m'êtes si cher, en venant visiter notre pays. Venez ; voilà le principal. Et quelle est l'usure? venez au plus tôt, et amenez-nous un homme qui nous surpasse autant que les pères surpassent leurs enfants.
A SOPHRONIUS, INTENDANT DU PALAIS.
LXXVII—CCCXXXI. Il lui recommande instamment sa patrie, dont il décrit l'état déplorable d'une manière fort pathétique.
La grandeur des maux qui affligent ma patrie m'eût obligé de me rendre au camp, pour vous exposer, à vous et à tous ceux qui ont une grande influence dans les affaires publiques, l'affliction et le deuil où est plongée notre ville. Mais puisque je suis retenu par ma mauvaise santé et par le soin des Eglises, je m'empresse de vous écrire pour déplorer devant vous nos infortunes. Un navire agile de la tempête en pleine met et englouti par les flots, ne disparaît pas plus subitement ; une ville ébranlée par des tremblements de terre, ou inondée par le débordement des eaux, n'est pas renversée en moins de temps, que ne l'a été la nôtre par une nouvelle administration qui a causé sa destruction totale. Elle est ruinée de fond en comble, et il n'en reste plus que l'ombre et le nom. La forme de l'ancien gouvernement est abolie : les sénateurs effrayés par les excès des nouveaux chefs qui gouvernent, ont abandonné leurs maisons et la ville ; personne ne s'occupe des affaires les plus importantes. Cette grande cité, remplie autrefois de tant d'hommes habiles et de tout ce qui rend les villes florissantes, n'offre plus qu'un spectacle déplorable. La seule ressource qui nous reste dans nos malheurs, c'est de gémir devant vous sur nos maux, et de vous conjurer de tendre, s'il est possible, une main secourable à notre patrie qui se prosterne à vos genoux. Je ne puis vous suggérer les moyens que vous devez prendre pour rétablir nos affaires : votre prudence vous les suggérera elle-même ; et quand vous les aurez trouvés, vous pourrez vous servir de toute l'autorité que Dieu vous a donnée.
LVI—CCCLIV. Pergamius s’était plaint à saint Basile qu'il n’avait pas répondu à une de ses lettres : saint Basile s'excuse sur le défaut de mémoire et sur l'embarras des affaires : il l'invite agréablement à lui écrire, en le priant de n'attribuer son silence à aucun motif d'orgueil.
J'ai naturellement peu de mémoire, et la multitude des affaires augmente encore dans moi cette infirmité naturelle. Quoique je n'aie nulle idée que vous m'ayez écrit, je n'ai point de peine à croire que vous l'ayez fait, et je ne saurais vous soupçonner de mentir. Si je ne vous ai pas répondu, ce n'est nullement ma faute ; il faut s'en prendre à celui qui a négligé de me demander la réponse. La lettre que je vous envoie servira d'excuse à ma faute passée; ce seront aussi des avances pour en obtenir de vous une seconde. Quand vous m'écrirez, ne croyez pas que vous commenciez un second tour ; comptez plutôt que c'est vous acquitter pour ma lettre présente. Quoiqu'elle soit un acquit du passé, comme elle est de moitié plus longue que la vôtre, elle doit suffire pour deux. Vous voyez que la paresse me rend un peu sophiste. Cessez, mon cher ami, de me faire de grands reproches en peu de paroles, d'autant plus que ma faute n'est pas un crime énorme. Oublier ses amis ou les mépriser, lorsqu'on se voit élevé à quelque dignité nouvelle, est ce qu'il y a au monde de plus indigne. Si nous n'avons point de charité, comme le Seigneur nous ordonne d'en avoir, nous ne sommes pas marqués au sceau de ses enfants. Si nous nous laissons entier par un vain faste et par des sentiments d'arrogance, nous ne pouvons nous soustraire à la peine dont a été châtié l'orgueil du démon. Si vous m'avez fait des reproches bien persuadé que je les mérite, priez Dieu qu'il me fasse éviter le défaut que vous avez remarqué dans mon caractère. Mais si, comme il n'arrive que trop souvent, votre langue a parlé avant que votre esprit ait assez réfléchi, je me consolerai moi-même, et je vous prierai d'appuyer vos reproches par des faits. Soyez persuadé que l'oubli prétendu dont vous me faites un crime, est la suite d'une foule de soins qui m'accablent, et que je ne vous oublierai que quand je pourrai m'oublier moi-même. N'imputez donc pas à un défaut de caractère ce qui est l'effet de toutes les affaires qui m'occupent.
LXXV— CCCLXI. La ville de Césarée, par une suite de la persécution arienne, était réduite à un état déplorable ; Aburge devait sa naissance à cette ville : saint Basile le conjure de sauver sa propre patrie, et d'employer pour cela tout le crédit qu'il avait à la cour.
Entre plusieurs belles qualités qui vous relèvent au-dessus du reste des nommes, celle qui vous distingue surtout c'est l'affection pour votre patrie. Vous l’avez déjà payée de ses soins par la gloire que vous vous êtes acquise, qui rend votre nom illustre dans toute la terre. Cette même patrie oui vous a donné la naissance et qui vous a élevé, éprouve maintenant des infortunes qui paraissent aussi incroyables que les fables anciennes. Si ceux qui ont le plus fréquenté notre ville y revenaient à présent, ils auraient de la peine à la reconnaître, tant elle est déserte et désolée. On lui avait déjà enlevé un grand nombre de ses citoyens; presque tous les autres viennent de se réfugier à Podande.[16] Ceux qui restent, se voyant abandonnés de ceux qui ont fui, sont tombés eux-mêmes dans un si grand désespoir et ont causé un découragement si général, que la ville, dépourvue d'habitants et changée en une affreuse solitude, n'offre plus qu'un spectacle aussi affligeant pour nos amis, qu'agréable et satisfaisant pour ceux qui conspirent depuis longtemps notre perte. Qui donc nous tendra une main secourable, ou qui trouverons-nous qui compatisse à nos maux? Vous êtes le seul à qui nous puissions nous adresser, vous qui seriez touché du sort, même d'une ville étrangère aussi malheureuse que la nôtre, et qui le serez à plus forte raison du désastre de votre patrie. Si vous avez quelque pouvoir, faites-le paraître dans la conjoncture actuelle. Vous pouvez compter sur le secours de Dieu qui ne vous abandonna jamais, et qui vous a déjà donné de grandes marques de sa bonté. Veuillez seulement vous occuper enfin de nous, et vous servir de tout votre crédit pour tirer de l’abyme vos compatriotes.
LXIII—CCCLXXI. Il lui demande son amitié de la manière la plus honnête et la plus engageante.
Je mets au nombre de mes amis l'homme sage, quand il habiterait aux extrémités du monde, et que je ne l’aurais jamais vu de mes yeux : c'est la pensée d'Euripide le tragique. C'est ainsi que je m'annonce comme votre ami, quoique je ne vous connaisse point particulièrement, et que je n'aie jamais eu le bonheur de vous voir. Ne regardez pas ce discours comme une flatterie. La renommée qui publie avec éclat vos vertus par toute la terre, m’avait déjà inspiré de l'amitié pour vous : mais depuis que je me suis entretenu avec notre vénérable frère Elpidius, je vous conçois aussi parfaitement, et je suis aussi touché de votre mérite, que si nous eussions vécu longtemps ensemble, et que si une longue expérience m'eut fait connaître vos grandes qualités. Elpidius n'a point cessé de me raconter en détail vos vertus, votre grandeur d’âme, vos sentiments nobles, votre douceur, votre habileté dans les affaires, votre rare prudence, votre gravité naturelle mêlée de gaîté, votre éloquence peu commune ; en un mot, il m'a rapporté de vous dans un long entretien ce qu'il serait impossible de redire dans une lettre, à moins que de l'étendre toute mesure. Après cela, pourrais-je me défendre de vous aimer? pourrais-je m'empêcher de publier ce que je sens pour vous au-dedans de moi-même? Recevez donc, personnage admirable, recevez mon salut, comme la marque d'une amitié véritable et sincère ; car rien n'est plus éloigné que moi d'une flatterie basse et servile. Mettez-moi au nombre de vos meilleurs amis, et écrivez-moi souvent pour me consoler de votre absence.
CXLVIII—CCCLXXVI. Un ami de saint Basile, nomme Maxime, qui avait été gouverneur de Césarée, était tombé dans des malheurs affreux, dont il fuît une description touchante ; il intercède pour lui auprès de Trajan, afin qu'il le soulage dans ses maux.
C’est une grande consolation pour les malheureux de pouvoir déplorer leurs maux, surtout devant des hommes qui ont assez de sensibilité pour y compatir. Le très honoré frère Maxime, qui a gouverné notre patrie, est tombé dans une disgrâce telle qu'on n'en éprouva jamais. Dépouillé de tous les biens qu'il avait hérités de ses ancêtres ou qu'il avait acquis par son industrie, il a souffert mille insultes en sa personne; il erre depuis longtemps, et l'on n'a pas même épargné sa réputation, le plus grand de tous les biens, pour lequel un homme qui pense ne craint pas de s'exposer à tout. Il m'a fait un récit déplorable de ses infortunes tragiques, et m'a prié de vous les mettre sous les yeux. Comme je ne pouvais le soulager autrement dans ses malheurs, et que la honte l'empêche de vous en offrir le détail, je me suis chargé au moins fort volontiers de vous exposer une partie de ce que j'ai su de lui-même. Quand ses disgrâces annonceraient des torts et des fautes, elles sont toujours de nature à lui donner droit à notre compassion. Tomber tout à coup dans des maux extrêmes, c'est une preuve en quelque sorte que l'on est condamné à l'infortune. Un regard favorable de votre part suffira pour consoler Maxime. Qu'il sente lui-même les effets de cette douceur inépuisable que vous témoignez à tout le monde. On est généralement persuadé que votre crédit peut beaucoup dans le jugement de cette affaire. Celui qui vous remettra ma lettre, et qui a cru qu'elle lui serait utile, mérite bien que vous le soulagiez dans ses maux. J'espère que nous le verrons joindre sa voix à celle de tant d'autres pour publier votre sagesse et votre équité.
CXLIX—CCCLXXVII. Le sujet de cette lettre est le même que celui de la précédente. Saint Basile invite plus instamment Trajan à prendre sous sa protection un malheureux, victime d'une persécution cruelle.
Vous avez été vous-même le témoin des infortunes de Maxime, dont la condition était auparavant si brillante, et qui est maintenant le plus misérable des hommes. Il a été gouverneur de notre patrie ; eh ! plût à Dieu qu'il ne l’eut jamais été ! Non, on ne trouvera personne à l'avenir qui veuille prendre des gouvernements, s'ils ont une issue aussi malheureuse. Qu'est-il besoin que je vous raconte en détail ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, à vous dont la pénétration est si vive, que, pour peu qu'on vous donne d'ouverture, vous comprenez aisément tout le reste? Il ne sera cependant pas inutile de vous dire que, quoiqu'on ait accablé d'outrages Maxime avant votre arrivée, ces outrages seraient regardés comme des faveurs, si on les comparait aux maux qu'on lui a faits depuis que vous êtes venu. Il n'est point d'insultes, il n'est point de mauvais traitements dans la personne et dans les biens, que le préfet actuel n'ait imaginés contre lui. Il vient à présent avec des satellites pour mettre le comble à ses malheurs, à moins que vous ne daigniez tendre une main secourable à cet infortuné. Je sais qu'il n'est nullement nécessaire de vous exciter à la compassion ; mais comme je veux soulager un malheureux dans ses peines, je vous conjure d'ajouter quelque chose pour l'amour de moi à votre bonté naturelle, afin qu'il sache que ma sollicitation ne lui a pas été inutile.
CXCIII—CCCLXIX. Saint Basile était fort malade : il mande le détail de sa maladie à Mélèce d'une manière expressive en même temps et agréable, qui annonce le mauvais état de sa santé et la sérénité de son âme.
Je n'ai pu me garantir des rigueurs de l'hiver comme font les grues. Je ne le cède peut-être pas à ces oiseaux en prévoyance de l'avenir ; mais pour la liberté de la vie, je suis aussi éloigné d'eux que je suis loin de la faculté de voler. D'abord, je me suis trouvé arrêté par des affaires domestiques ; ensuite une fièvre violente et continue ma tellement épuisé que je crois avoir perdu de ma substance. La fièvre s'est tournée en quarte, et j'en ai en plus de vingt accès. Je suis maintenant sans fièvre, mais si exténué et si faible que je ressemble à une araignée. Tout chemin est pour moi impraticable, et le moindre souffle de vent m'est aussi périlleux que le dixième coup de mer à ceux qui naviguent. Je suis contraint de me renfermer dans mon logis et d'attendre le printemps, si je puis aller jusque-là et résister du mal qui dévore mes entrailles. Si Dieu me conserve par sa toute-puissance, je me transporterai avec joie dans votre solitude, et j'embrasserai de bon cœur un excellent ami. Demandez à Dieu qu'il dispose de ma vie comme il le jugera à propos pour le salut de mon âme.
CLXIII—CCCLXXVIII. Il le remercie de l'excellente lettre qu'il lui a écrite : il le prie de lui écrire souvent, d'autant plus que sa mauvaise santé le fait désespérer d'être jamais en état de l'aller voir.
J'ai vu votre âme dans votre lettre. Non, un peintre habile ne saisit pas mieux les traits du visage que les paroles représentent les secrets de l’âme. La fermeté de votre caractère, la justesse de votre discernement, la pureté de votre foi, étaient dépeintes au naturel dans toutes les lignes de votre lettre. Aussi m'a-t-elle fort console de votre absence. Ne négligez donc aucune occasion de m'écrire et de vous entretenir avec moi de loin, puisque je suis dans un état de faiblesse à ne plus espérer de vous aller parler moi-même en personne. Le saint évêque Amphiloque vous dira combien ma santé est mauvaise. Comme nous nous sommes pratiqués longtemps, il me connaît assez, et il a un talent merveilleux pour raconter ce qu'il a vu. Je ne souhaite que vous connaissiez l’état pitoyable où je suis, qu'afin que vous m'excusiez à l'avenir, et que vous ne me taxiez point de paresse si je ne vais pas vous visiter. Au lieu de m'obliger à taire des excuses, il faut plutôt que l’on me console de cette privation. S'il était possible d'aller vous trouver, je l'aurais fait avec plus d'empressement que les autres ne recherchent ce qu'ils souhaitent davantage.
A L’ÉPOUSE DU GÉNÉRAL ARINTHÉE.
CCLXIX—CLXXXVI. Arinthée, grand général, venait de mourir: saint Basile écrit à la veuve à laquelle il offre les plus grands motifs de consolation, en même temps qu'il fait un bel éloge de l'illustre époux qu'elle avait eu le malheur de perdre.
Il eût été à propos dans l'état où vous êtes que j'eusse été présent, afin de partager avec vous la perte que vous venez d'essuyer. Par-là, j'aurais adouci mes chagrins, et j'aurais rempli à votre égard l'office de consolateur. Mais comme je suis trop faible pour supporter la fatigue d'un long voyage, je m'entretiens avec vous par lettre, pour que vous ne me jugiez pas étranger à vos peines. Qui est-ce qui n'a pas gémi sur la mort de votre époux? quel cœur assez dur pourrait s'empêcher de pleurer amèrement la perte d'un aussi grand homme? Pour moi, elle me pénètre d'une douleur particulière, lorsque je me rappelle les égards dont il m'honorait, et la protection qu'il accordait aux Eglises. Cependant je fais réflexion qu'il était homme, et qu'après avoir fourni sa carrière, il a été rappelé par le souverain Modérateur des choses humaines dans le temps que ses décrets avaient marqué. Je vous exhorte à vous consoler par cette même pensée, et à vous en servir pour supporter votre affliction avec courage. Le temps peut ralentir votre douleur ; mais la tendresse que vous aviez pour votre époux, et votre cœur naturellement bon et sensible, me font craindre que vous ne vous abandonniez trop à la tristesse, que cette tristesse ne fasse en vous des blessures trop profondes. Les maximes de l'Ecriture sont utiles dans toutes les circonstances, et principalement dans des occasions pareilles. Rappelez-vous donc la sentence que le Créateur a prononcée contre nous (Gen. 3. 19. ), laquelle nous condamne à retourner dans la terre nous qui sommes tous sortis de la terre, sans qu'on puisse, quelque grand qu'on soit, se mettre au-dessus de cette loi de dissolution. Votre époux était aussi admirable par les qualités de l'âme que par les forces du corps, qui répondaient parfaitement à ses vertus. Il ne le cédait à personne dans ces deux parties ; mais enfin il était homme, et il est mort aussi bien qu'Adam, qu'Abel, que Noé, qu'Abraham, que Moïse, que tant d'autres qui participaient à la même nature. Il ne faut donc point nous affliger outre mesure parce qu'il nous a été enlevé, mais remercier Dieu de la grâce qu'il nous a faite de vivre avec lui. Avoir perdu votre époux, cela vous est commun avec toutes les femmes ; mais je ne crois pas qu'une seule pût se vanter d'avoir été unie à un homme tel que le vôtre. Il semblait que Dieu l'eût fait naître pour servir de modèle au genre humain. Tous les yeux se réunissaient sur lui, toutes les bouches s'ouvraient pour le louer. Les peintres et les statuaires ne pouvaient atteindre à la dignité de ses traits. Les historiens qui racontent ses actions guerrières tombent dans le merveilleux de la fable. Plusieurs ne sauraient encore ajouter foi au bruit qui a répandu une triste nouvelle ; ils ne peuvent se persuader qu'Arinthée ne soit plus. Mais il est passé, cet illustre personnage, comme le ciel, le soleil et la terre passeront, il est mort glorieusement, n'étant pas encore affaissé par l'âge et n'ayant rien perdu de sa célébrité. Il était grand dans ce monde, il est grand dans l'autre, et la gloire présente chez lui n'a fait aucun tort à la gloire future, parce qu'en mourant il a effacé les taches de son âme dans le bain de la régénération. C'est pour vous un grand motif de consolation de ce que vous ayez tant contribué à lui procurer cette grâce. Détachez-vous des choses temporelles pour ne penser qu'aux éternelles, afin de mériter par vos bonnes œuvres d'obtenir le même lieu de repos. Conservez-vous pour une mère âgée et pour une fille encore jeune, qui n'ont que vous seule pour consolation. Soyez pour les autres femmes un modèle de force ; modérez tellement votre douleur, que, sans la bannir de votre âme, vous ne vous y laissiez pas abattre. Songez à la récompense magnifique dont le Fils de Dieu a promis de payer notre patience, lorsqu'il viendra nous récompenser des bonnes œuvres que nous aurons faites pendant notre vie.
V—CLXXXVIII. Nectaire avait perdu un fils, l'héritier et l'espérance de sa maison : saint Basile lui écrit cette lettre, dans laquelle il le console par tous les motifs que peut fournir une philosophie chrétienne.
A peine s’était-il écoulé trois ou quatre jours depuis que la nouvelle de l'accident le plus fâcheux m’avait alarmé, je ne pouvais me résoudre à la croire, parce que celui qui l'apportait ne disait rien de positif, et parce que d'ailleurs je désirais qu'elle fût fausse : j'ai reçu la lettre d'un évêque qui ne m'a que trop confirmé la vérité d'une nouvelle aussi affligeante. Est-il besoin de vous dire combien j'ai poussé de gémissements, combien j'ai versé de larmes? Pourrait-on avoir un cœur assez dur, assez étranger à la nature humaine, pour être insensible à un événement pareil, ou pour n'en ressentir qu'une douleur médiocre? L'héritier d'une maison illustre, l'appui de sa famille, l'espérance de la patrie, le sang de parents si vertueux, l'objet de tous leurs vœux et de tous leurs soins, a donc été arraché de leurs bras dans la fleur de son âge ! Un accident aussi déplorable pourrait émouvoir un cœur d'airain et l'exciter à la compassion ; faut-il s'étonner qu'il m'ait louché si vivement, moi qui vous fus toujours si dévoué, et qui partageai toujours vos sujets de joie et de tristesse? Jusqu'alors vous n'aviez éprouvé que des afflictions légères, et tout paraissait s'arranger selon vos désirs : voilà que tout-à-coup, par la malice du démon, tout le bonheur de votre maison s'est éclipsé, toute la satisfaction de vos âmes s'est évanouie, et vous êtes devenus un triste exemple des misères humaines. Toute notre vie ne pourrait suffire à déplorer ce malheur comme il le mérite. Quand tous les hommes joindraient leurs gémissements aux nôtres, leurs plaintes ne pourraient égaler l'étendue d'une pareille disgrâce. Quand l’eau des fleuves se convertirait en pleurs, ce ne serait pas encore assez pleurer une perte aussi désolante. Toutefois, si nous voulons nous servir de ce don précieux que Dieu a renfermé au fond de nos cœurs, je veux dire une raison sage, qui sait modérée nos âmes dans la prospérité, et qui, dans les conjonctures fâcheuses, nous fait ressouvenir de la condition humaine, nous rappelle ce que nous avons vu et entendu, que notre vie est pleine de semblables infortunes, qu'elle en offre mille exemples, qu'outre cela Dieu nous défend de nous affliger pour ceux qui sont morts dans la foi en Jésus-Christ, à cause de l'espérance de la résurrection, qu'enfin le souverain Juge nous réserve des couronnes de gloire proportionnées à notre patience; si, dis-je, nous voulons permettre à notre raison de faire retentir ces maximes à nos oreilles, nous pourrons peut-être adoucir l'amertume de nos chagrins. Je vous exhorte donc à supporter en généreux athlète un coup aussi rude, à ne pas vous laisser abattre par la douleur, persuadé que, quoique nous ne pénétrions pas dans les secrets de Dieu, nous devons cependant nous soumettre, à ses ordres suprêmes, quelque affligeants qu'ils nous paraissent, parce qu'il est infiniment sage et qu'il nous aime. Il sait comment il dispose ce qui nous est utile à chacun, et pourquoi il nous a marqué à tous un terme de vie différent. Les hommes ne peuvent comprendre pouf quelle raison les uns sortent plus tôt de ce monde, tandis que les autres sont exposés plus longtemps aux maux de cette vie misérable. Nous devons donc adorer en tout la bonté de Dieu, et ne pas nous affliger de ce qui nous arrive, nous rappelant cette parole aussi magnanime que célèbre, qu'a prononcée Job, cet athlète fameux, lorsqu'il eut appris que ses dix enfants avaient été écrasés à la fois sous les ruines d'une maison dans un festin. Le Seigneur, dit-il, me les a donnés, le Seigneur me les a ôtés ; il est arrivé ce que le Seigneur a voulu (Job. I. 21.). Adoptons cette admirable parole. Le juste Juge récompense également celui qui montre un égal courage. Vous n'avez point perdu votre fils, vous l'avez rendu à celui qui vous l’avait prêté. Sa vie n'est pas éteinte, elle est changée en une meilleure. La terre ne couvre point votre enfant chéri, le ciel l'a reçu. Attendons encore quelque temps, et nous rejoindrons bientôt celui que nous regrettons. Nous n'en serons pas longtemps sépares : nous marchons tous dans cette vie, comme dans une route qui nous conduit au même terme. Les uns y sont déjà arrivés, les autres en approchent, d'autres y tendent à grands pas. La même fin nous attend tous. Votre fils a terminé sa carrière avant nous ; mais nous marchons tous dans la même voie, et nous arriverons tous au même domicile. Puissions-nous seulement égaler par nos vertus la pureté de son âme, afin que la simplicité de nos mœurs nous mérite le repos que Jésus-Christ accorde à ses enfants.
VI—CLXXXIX. Après avoir écrit au père, St. Basile écrit à la mère pour la consoler de la mort de son fils. Entre autres motifs, il lui rappelle l'exemple de lu mère des Macchabées. En général toutes ces lettres de consolation sont pleines d'un pathétique naturel.
J'avais résolu de ne vous point écrire et de garder le silence, parce que sans doute, comme les remèdes les plus doux causent de la douleur à un œil enflammé, ainsi les paroles les plus consolantes sont importunes à une âme abîmée dans la tristesse, si on les lui adresse lorsque la plaie est encore toute saignante. Mais quand j'ai fait réflexion que j'avais à parler à une chrétienne, versée depuis longtemps dans les choses divines, et disposée à souffrir les accidents de cette vie mortelle, je me suis cru obligé de m'acquitter de mon devoir. Je sais quelles sont les entrailles d'une mère; et quand je pense combien vous avez de douceur et de bonté pour tout le monde, je n'ai point de peine à comprendre que vous devez être sensiblement touchée du malheur qui vous arrive. Vous avez perdu un fils qu'admiraient pendant sa vie toutes les mères, qui auraient désiré en avoir un pareil, et qu'elles ont pleuré après sa mort, comme si toutes elles eussent été privées de leur propre enfant. Sa mort est aussi affligeante pour notre patrie que pour la Cilicie. Une maison illustre dont il était le soutien est comme renversée avec lui. O fatal effet de la malice du démon! quel coup douloureux il nous a porté! O terre malheureuse, exposée à subir une si cruelle disgrâce! Si le soleil a du sentiment, il a dû frémir d'un si désolant spectacle. Où trouver des expressions qui puissent égaler les angoisses de notre âme? Mais nous sommes gouvernés par une sage providence, comme nous l'apprenons de l'Evangile, qui nous dit que même un passereau ne tombe point sans la volonté du Père céleste (Matth. 10. 33.) C'est donc par la volonté du Créateur que nous est arrivé l'accident qui nous fait gémir. Or, qui peut résister à la volonté de Dieu? Recevons les peines qu'il nous envoie. Notre impatience, sans réparer le mal, ne fait que nous perdre nous-mêmes. Ne condamnons pas le juste jugement de Dieu. Nous sommes trop peu instruits pour pouvoir pénétrer dans les secrets de sa justice. Le Seigneur veut éprouver maintenant votre amour pour lui. Voici le temps de mériter par votre patience la récompense des martyrs. La mère des Macchabées vit la mort de ses sept enfants sans gémir, sans répandre d'indignes larmes : elle rendait grâces à Dieu en voyant ses fils délivrés des liens du corps par le feu, le fer, et les autres instruments des plus cruels supplices. Aussi s'est-elle acquis une gloire immortelle devant Dieu et devant les hommes. Votre affliction est grande, je l'avoue; mais les récompenses que Dieu réserve aux hommes patients sont bien plus grandes encore. Lorsque vous êtes devenue mère, et que vous voyant un fils vous avez rendu grâces à Dieu, vous saviez qu'étant mortelle, vous aviez donné la naissance à un homme mortel. Or, qu'y a-t-il d'étonnant qu'un homme mortel soit mort? Mais ce qui nous afflige, c'est sa fin prématurée. Nous ne saurions décider s'il était avantageux qu'il ne mourut pas sitôt: nos lumières sont trop courtes pour savoir choisir ce qui convient aux âmes, et pour mesurer les bornes de la vie humaine. Jetez les yeux sur ce monde que vous habitez, et songes que tout ce que vous voyez est périssable, sujet à la corruption. Regardez le ciel ; il sera détruit un jour. Le soleil lui-même ne subsistera pas éternellement. Tous les astres, les animaux aquatiques et terrestres, les ornements qui embellissent la terre, la terre elle-même, tout est corruptible, tout disparaîtra dans peu de temps. Que ces réflexions adoucissent le chagrin que vous cause votre perte. Ne considérez pas voire malheur en lui-même, car il vous paraîtrait insupportable ; mais comparez-le avec toutes les misères humaines, et cette comparaison adoucira votre tristesse. Un des motifs les plus forts que je puisse vous offrir, c'est que vous devez ménager la douleur de votre époux. Consolez-vous l'un l'autre, et n'aggravez pas ses peines en vous abandonnant trop à votre affliction. En général, je crois que les paroles ne sont pas suffisantes pour votre consolation, il faut avoir recours à la prière dans une conjoncture aussi fâcheuse. Je prie donc le Seigneur de toucher votre âme par son ineffable puissance, et d'éclairer votre esprit par des réflexions utiles, afin que vous puissiez trouver en vous-même de quoi vous consoler.
A UN PÈRE QUI AVAIT PERDU SON FILS ENVOYÉ AUX ÉCOLES POUR ÉTUDIER L'ÉLOQUENCE.
CCC—CCI. Un père avait perdu son jeune fils qui donnait les plus grandes espérances : saint Basile entre d'abord dans sa peine qu'il partage, et ensuite il lui présente tous les motifs capables de le consoler.
Puisque le Seigneur en nous donnant le soin de former à la piété les enfants de ceux qui croient en lui, nous en a faits comme les seconds pères, j'ai regardé la perte de votre bienheureux fils comme m'étant personnelle. Sa mort prématurée m'a fait gémir, surtout par un sentiment de compassion pour vous; j'ai considéré combien la douleur d'un père par la nature devait être accablante, puisque j'en ressentais une si vive, moi qui ne suis père que par adoption. Ce n'est pas celui qui n'est plus, qui doit exciter notre tristesse et nos larmes; ce sont ceux qui voient tout d'un coup s'évanouir leurs espérances, qui sont vraiment à plaindre. On ne saurait trop accorder de pleurs et de gémissements à leur disgrâce : ils avaient éloigné leur fils dans la fleur de la jeunesse, ils l’avaient envoyé aux écoles pour étudier l'éloquence; et on le leur rend muet, condamné à un silence éternel. Ces tristes réflexions d'abord m'ont vivement ému, j'ai senti que j'étais homme, j'ai versé des pleurs en abondance, j'ai poussé du fond de mon cœur des soupirs que condamnait ma raison, mais que justifient le malheur imprévu qui, comme un nuage, venait envelopper mon âme. Mais lorsque je suis un peu revenu à moi, et que j'ai considère des yeux de l'esprit la nature des choses humaines, je me suis justifié devant le Seigneur de m'être laissé transporter dans un événement fâcheux par la vivacité du sentiment; je me suis dît à moi-même qu'il fallait souffrir avec modération ces disgrâces auxquelles l'homme a été anciennement condamné par la justice divine. Il n'est plus cet enfant qui était dans la fleur de l'âge, qui devait vivre encore si longtemps qui se distinguent parmi ses égaux, qui était chéri e ses maîtres, qui du premier abord se conciliait les caractères les plus durs, qui avait un esprit si vif pour les sciences, un naturel si doux, une sagesse au-dessus de son âge, auquel on ne peut donner d'éloges sans rester au-dessous de la vérité, mais qui enfin était homme et engendré par un homme. Que doit penser le père d'un tel enfant? Ne doit-il pas se souvenir que son père est mort aussi? qu'y a-t-il donc d'étonnant que le fils d'un père mortel ait été père d'un fils mortel? Mais il est mort avant le terme ordinaire, avant que d'avoir été rassasié de la vie, avant que d'avoir pu se faire connaître et laisser un héritier de son nom. Ces réflexions, à mon avis, sont plutôt des motifs de consolation qu'un surcroît de douleur. Il faut remercier la divine Providence de ce qu'il ne laisse pas après lui d'orphelins, ni une femme veuve, exposée à une longue suite de peines, qui s'unirait peut-être à un autre époux, et qui négligerait ses premiers enfants. Peut-on être assez: peu raisonnable pour ne pas convenir que c'est pour lui un avantage d'avoir peu vécu, pour ne pas reconnaître qu’une vie plus longue ne fait que nous exposer à plus de maux. Il n'a point fait le mal, il n'a point tendu de piège à son prochain, il ne s'est point trouvé mêlé dans les intrigues du barreau, il ne s'est point vu dans la nécessité d'avoir commerce avec les méchants et de commettre le péché ; il n'a été ni menteur, ni ingrat, ni cupide, ni livré aux plaisirs, ni esclave des mouvements de la chair qui ont coutume d'asservir les âmes faibles. Son âme n'a été souillée d'aucun vice ; il est sorti pur du monde pour jouir d'une meilleure destinée. La terre ne couvre point notre cher enfant, le ciel l’a reçu. Le Dieu qui gouverne les choses humaines, qui règle le cours de notre vie, et qui l'avait mis dans ce monde, l'en a retiré. Nous avons une leçon et une ressource pour adoucir nos disgrâces extrêmes, dans cette parole célèbre du généreux Job: Le Seigneur me l’a donné, le Seigneur me l’a ôté ; il est arrivé ce que le Seigneur a voulu : que le nom du Seigneur soit béni dans tous les siècles (Job. I. 21.).
CCCII—CCCXLVIII. Grandeur de la perte et motifs de consolation, tel est l'ordre naturel de cette lettre adressée à la veuve d'un personnage illustre et vertueux que regret-toit tout l'empire.
Il n'est pas besoin que je vous dise combien j'ai été touché en apprenant la mort de Brison, du plus excellent des hommes. Quand on l’a pratiqué, quand on a été à portée de le connaître, et qu'on le voit enlevé subitement de ce monde, peut-on avoir le cœur assez dur pour ne point regarder sa perte comme une calamité publique? Ma douleur a été suivie aussitôt de l'inquiétude pour ce qui vous regarde. Je me disais a moi-même : Si ceux qui ne tenaient à Brison par aucun lien de parenté sont si affligés de son trépas, dans quelle profonde tristesse ne doit pas être plongée celle qui a une âme si douce, un cœur si sensible, une compassion si tendre pour les maux d'autrui, et qui, séparée de son époux, doit souffrir autant que si une violence cruelle, la divisant en deux parts, lui arrachait une moitié d'elle-même. Si, suivant la parole du Seigneur, le mari et la femme ne sont plus deux, mais une même chair (Matth. 19, 6.), une telle séparation, sans doute, n'est pas moins douloureuse qui si l'on divisait le même corps. Tels sont, sans parler de beaucoup d'autres, vos sujets de douleur ; et les motifs de consolation, quels sont-ils? D'abord l'ordre établi par Dieu dès l'origine, que tout ce qui vient au monde par la voie de la génération doit en sortir après un certain temps. Si depuis Adam jusqu'à nous les choses humaines ont été soumises à cet ordre, pourquoi nous révolter contre les lais communes delà nature, plutôt que dé nous résigner aux décrets de Dieu, qui à voulu qu'une âme généreuse et invincible sortît de ce monde sans que la maladie ait affaibli son corps, sans que les années l'aient flétri, dans toute la force de l'âge, après avoir acquis par les armes une gloire immortelle? Ne nous affligeons point de nous voir séparés d'un si grand homme ; remercions Dieu de la grâce qu'il nous a faite de vivre quelque temps avec un illustre personnage dont tout l'empire sent la perte, que regrette le prince, que les soldats pleurent, pour lequel tous les hommes constitués en dignité s'affligent comme s'ils avaient perdu leur enfant. Le souvenir qu'il vous a laissé de sa vertu pourrait suffire pour vous consoler. N'oubliez pas non plus que celui qui ne succombe pas à l'affliction, qui en supporte le poids par l'espérance qu'il a en Dieu, sera récompensé magnifiquement de sa patience. Selon le précepte dé l’Apôtre, il ne nous est pas permis de nous attrister comme les infidèles touchant ceux qui dorment du sommeil de la mort (I. Thess. 4. 13). Que vos enfants qui sont une image vivante de l'époux que Vous regrettez, vous consolent de son absence, et que les soins dé leur éducation vous distraient de votre douleur. Enfin songez uniquement à plaire à Dieu pendant le temps qui vous reste à vivre ; et il n'en faudra pas davantage pour ramener le calme dans votre esprit. L'ardeur avec laquelle nous nous disposerons à paraître devant le tribunal du Fils de Dieu, et à nous rendre dignes d être comptés au nombre de ses amis, est fort propre à étourdir nos chagrins et à nous empêcher d'y succomber. Que l'esprit de Dieu vous console, et consolez-moi vous-même en me donnant de vos nouvelles. Donner à toutes les femmes de vôtre siècle et de votre condition l'exemple d'une vertu courageuse.
LXXIV—CCCLXXIX. Martinien était un homme d'un grand mérite, et avait du crédit auprès du prince : saint Basile lui fait une vive peinture des malheurs affreux où les persécutions des Ariens avaient jeté la ville de Césarée; il le conjure de mettre ses maux, sous les yeux de l'empereur, et d'intercéder pour elle auprès de lui.
Que ne donnerais-je pas pour que nous pussions nous joindre, pour que j'eusse le bonheur de vous entretenir quelque temps ! Si c'est un grand témoignage de doctrine d avoir vu les villes et d'avoir connu les mœurs de beaucoup de peuples, je crois que votre commerce pourrait procurer cet avantage à peu de frais. Lequel est préférable de voir en détail beaucoup d nommes, ou d'entretenir un seul homme qui sait tout ce que les autres savent? Pour moi, je préfèrerais le dernier, d'autant plus qu'alors on parvient sans peine à connaître tout ce qu'il y a de bon, et qu'on apprend la vertu sans le mélange d'aucun mal, Alcinoüs désirait d'être une année à écouter Ulysse; moi, je voudrais employer toute ma vie à vous entendre, et je souhaiterais qu'elle me fût prolongée, quoique je ne la trouve pas fort agréable. Pourquoi donc ne fais-je que vous écrire, lorsque je devrais me transporter auprès de vous? c'est que notre patrie, dans le plus déplorable état, m'appelle à son secours. Vous n'ignorez pas tout ce qu’elle a souffert, vous savez que de vraies Ménades l'ont mise en pièces comme Penthée.[17]
Elle est coupée et déchirée par des médecins malhabiles, dont l'ignorance aggrave le mal et envenime les plaies. Puis donc quelle est démembrée et fort malade, il faut lui apporter tous les remèdes que nous pourrons. Les citoyens ont envoyé vers moi et me pressent J il faut que je me rende à leurs désirs. Ce n'est pas que je me flatte de leur être utile, mais je veux éviter le reproche de les abandonner. Les malheureux, vous le savez, sont aussi prompts à espérer que prêts à se plaindre, s'en prenant toujours à ce qu'on a oublié de faire. C'est pour cela même que j'aurais dû vous joindre, et vous conseiller, ou plutôt vous conjurer, de prendre un parti généreux et digne de vos sentiments, de ne point dédaigner notre ville qui se prosterne à vos genoux, mais de vous rendre à la cour, d'y parler avec votre liberté accoutumée, de leur faire comprendre qu'ils se trompent s'ils prétendent avoir deux provinces pour une. Non, ils n'en ont point introduit une seconde, transportée de quelque pays éloigné ; mais ils ont fait à peu près comme celui qui ayant un bœuf ou un cheval, croirait en avoir deux après l'avoir coupé par la moitié : il n'en aurait point deux, mais il aurait détruit le seul qu'il avait. Vous ferez entendre à ceux qui gouvernent sous le prince, que ce n'est pas là fortifier l'empire, que la puissance ne se mesure point par le nombre, mais par les forces réelles.
Au reste, les désordres que nous voyons arrivent, si je ne me trompe, de ce que d'autres n'osent parler de peur d'offenser personne, de ce que d'autres enfin, laissent aller les choses parce qu'ils ne s'en embarrassent guère. Le meilleur parti, ce serait d'aller vous-même trouver l'empereur s'il était possible ; c'est ce qu'il y aurait e plus utile aux affaires et de plus conforme à vos principes. Si la saison, et votre âge qui, comme vous dites, a pour compagne la paresse, ne vous le permettent point, quelle peine auriez-vous à écrire? Si vous donnez à votre patrie ce secours par lettres, d'abord vous aurez la satisfaction d'avoir fait ce qui était en vous ; ensuite vous aurez consolé suffisamment des malheureux en paraissant compatir à leurs maux. Que ne pouvez-vous venir vous-même sur les lieux pour être témoin de nos infortunes ! la vue même des objets ne pourrait que vous émouvoir, vous engager à élever la voix d'une manière qui réponde aux sentiments de votre âme et aux infortunes de notre ville. Mais enfin ne refusez pas de croire mon récit. Nous aurions vraiment besoin d'un Simonide,[18] ou de quelque autre poète qui excelle dans les poèmes élégiaques et plaintifs. Que dis-je, Simonide? il nous faudrait un Eschyle, ou quelque autre qui s'entendrait également à déplorer d'une voix forte et pathétique les grandes calamités de la vie humaine.
Les assemblées, les discours et les entretiens des personnes instruites, qu'on voyait et qu'on entendait dans la grande place de notre ville, en un mot, tout ce qui rendait notre ville célèbre a disparu. On voit maintenant dans notre place publique moins de savants et d'orateurs qu'on ne voyait jadis dans celle d'Athènes d'hommes diffamés en justice ou souillés d'un meurtre. La barbarie grossière de quelques Scythes et de quelques Massagètes a pris la place des sciences : on n'entend plus que ta voix des exacteurs cruels, et les cris des malheureux que l’on fait payer et que l’on déchire à coups de fouet. Les portiques retentissent de toutes parts de lamentations auxquelles ils semblent mêler leurs gémissements et leurs plaintes, comme s'ils étaient sensibles aux malheurs des habitants. Les gymnases sont fermés, les nuits ne sont plus éclairées ; mais les soins que nous cause l’embarras de conserver notre vie, ne nous permettent pas de songer à ces désordres. Il est fort à craindre, après qu'on a enlevé les principaux de la ville, que tout ne croule, les colonnes qui soutiennent l'édifice étant ôtées. Quel discours assez fort pourrait exprimer notre désastre? La partie la plus saine du sénat a pris la fuite, préférant à sa patrie un exil perpétuel à Podande. Quand je dis Podande, imaginez-vous cet affreux abîme où l’on précipitait les criminels à Lacédémone: ou, si vous avez vu quelques-uns de ces gouffres formés par la nature qui exhalent un air infect, vous aurez une juste idée du séjour r ou plutôt de la prison de Podande. Les citoyens sont divisés en trois parts. Les uns ont fui avec leurs femmes et ont abandonné leurs maisons ; les autres, parmi lesquels sont presque tous les principaux, sont emmenés comme des prisonniers: spectacle aussi douloureux pour leurs amis, que satisfaisant pour leurs ennemis, si toutefois il est un cœur assez barbare pour nous avoir souhaité tant de maux. La troisième partie est demeurée dans la ville ; mais ne pouvant soutenir l'absence de leurs amis et de leurs proches, ni fournir à leur subsistance, ils trouvent la vie odieuse et insupportable.
Voilà les disgrâces que je vous exhorte à mettre sous les yeux du prince ou de ses ministres avec votre voix ordinaire, avec cette juste assurance que doit vous inspirer votre vertu. Faites-leur sentir que, s'ils ne changent de système, ils ne trouveront bientôt personne sur qui ils puissent exercer leur humanité. Par là, ou vous secourrez la patrie, ou du moins vous ferez ce que fit autrefois Solon, lequel ne pouvant sauver la liberté de ses concitoyens qui étaient demeurés dans la ville, parce qu'on s'était emparé de la citadelle, se revêtit de ses armes et s'assit à sa porte, témoignant par cette contenance qu'il n'approuvait en aucune sorte ce qui se passait.[19] Je suis très convaincu que si on désapprouve maintenant vos représentations et vos démarches, elles vous feront par la suite une grande réputation de bonté et de prudence, quand on verra vos conjectures justifiées par l'événement.
CVI—CCCCVII. Saint Basile écrit à un guerrier; il le loue de ce qu'il remplit les devoirs de chrétien dans une profession où il n'est pas facile de les remplir.
Je mets au rang des plus grandes faveurs que j'ai reçues d'un Dieu plein de bonté la grâce qu'il m'a faite de vous connaître dans le cours de mes voyages. J'ai trouvé en vous un homme qui justifie par sa conduite qu'on peut aimer Dieu parfaitement dans la profession militaire, et que ce n'est pas l'extérieur et l'habit, mais l'esprit et les mœurs qui font le chrétien. Je vous voyais alors avec un plaisir extrême, et encore aujourd'hui j'éprouve la plus vive satisfaction toutes les fois que je me souviens de vous. Agissez donc toujours avec force et avec courage ; ne négligez rien pour conserver l'amour de Dieu dans votre cœur, et pour l'augmenter chaque jour, afin qu'il vous comble de plus en plus de ses bienfaits. Je ne demande point une autre preuve que vous vous souvenez de Basile : vos actions le prouvent assez.
[1] Polydamas et Milon, deux athlètes fameux dont il est parlé dans le discours sur la lecture des litres profanes.
[2] Athos, montagne de Thrace, les autres disent de Macédoine. On sait que Xerxès, dans son expédition contre les Grecs, la fit percer pour y faire entrer la mer et y faire passer sa flotte. Cette entreprise exécutée avait laissé une grande idée de la puissance de ce prince. Un Xerxès, le grec dit un barbare. Personne n'ignore que les Grecs appelaient barbare tout ce qui n’était pas grec.
[3] Filles d'Achéloüs, ou sirènes, connues dans la fable pour perdre les navigateurs qu'elles charmaient par leurs chants.
[4] Eaque, Minos et Rhadamanthe son frère étaient recommandables pendant leur vie par une grande équité, et furent choisis, après leur mort, pour être juges des enfers.
[5] Ce verbe était gripizein, d'où Libanius avait forgé l'adjectif dusgripistos.
[6] Autant de poutres. Sans doute trois cents ; car on sait que les Spartiates qui périrent tous au passage des Thermopyles, étaient au nombre de trois cents.
[7] Le fleuve Alphée s’est engagé à me les rendre. Tour agréable pour dire qu'il les lui envoie sans exiger qu'il les lui rende.
[8] Libanius, dans sa harangue, fait parler un homme d'une humeur fâcheuse, qui se plaint amèrement d'avoir épousé une femme babillarde.
[9] Je n'ai trouvé nulle part quel était ce Susarion dont Libanius fait un si grand éloge.
[10] Personne n'ignore la fable de Dédale, qui fit pour lui et pour son fils Icare des ailes qu'il attacha avec de la cire, et la chute malheureuse d'Icare, qui s'approcha trop près du soleil.
[11] Le Pont, province de l'Asie mineure aussi bien que la Cappadoce.
[12] Le Strymon séparait la Macédoine de la Thrace. Il prenait sa source au mont Hémus, et allait se rendre dans un golfe de la nier Egée, auprès d'Amphipolis, ville de Thrace, sur les confins de la Macédoine.
[13] Tibérine, pays de Cappadoce, dans lequel était situé le bourg d'Arianze, où St. Grégoire avait un bien. Arianze était voisin de la ville de Nazianze.
[14] Zénon, de la ville de Citium dans l’île de Chypre, chef de la secte des Stoïciens : jeté à Athènes par un naufrage, il regarda toute sa vie cet accident comme un grand bonheur. Cléanthe, fils de Phanias et natif d'Epire, fut son disciple ; Diogène, de la ville de Sinope, philosophe cynique fort connu.
[15] Je n'ai trouvé, ni dans l'histoire ecclésiastique, ni dans la rie de saint Basile, la vraie cause de ces préventions.
[16] Podande, petite ville ou place de la Cappadoce, que saint Basile, dans une des lettres qui suivent, représente comme un lieu fort malsain.
[17] On connaît l'histoire ou la fable de Penthée, roi de Thèbes, qui, ayant montré du mépris pour Bacchus, fut déchiré et mis en pièces par les Ménades ou Bacchantes.
[18] Simonide et Eschyle, poètes grecs; l'un élégiaque, et l'autre tragique, tous deux assez connus.
[19] Plutarque rapporte la chose un peu différemment. Pisistrate, dit-il, s'étant emparé de la souveraine puissance, Solon prit les armes et exhorta les citoyens a faire de même, Pisistrate lui fit demander sur quoi il comptait en agissant de la sorte : Sur ma vieillesse, lui fit-il répondre.