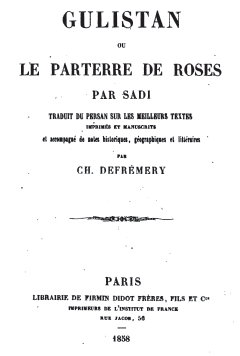
SAADI (Muslih-ud-Din Mushrif ibn Abdullah)
سعدی
LE PARTERRE DE ROSES.
PRÉFACE DU TRADUCTEUR.
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
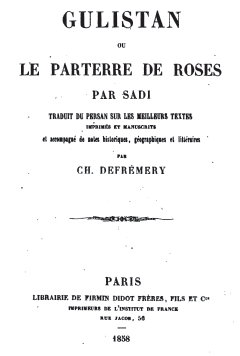

Miniature de Paul Zenker illustrant une édition de 1942 du Jardin des roses (Wikipédia)
Une circonstance qui prouve éloquemment combien peu de progrès réels a faits chez nous l'étude d'une des plus belles littératures de l'Orient, c'est le petit nombre des travaux sérieux tentés pour faire connaître au public français le principal ouvrage du plus grand poète moraliste de la Perse. Tandis que les Anglais possèdent au moins quatre traductions du Gulistan, et que les Allemands en comptent aussi plusieurs, nous ne pouvons citer qu'une seule version complète de ce livre faite sur l'original, et encore le format peu commode (in-4°) que l'auteur a cru devoir adopter, joint au système de traduction, beaucoup trop littéral, qu'il a suivi et par lequel il a été conduit, ainsi qu'il l'a reconnu lui-même, à n'écrire le plus souvent que du français persan,[1] a été cause que ce travail, d'ailleurs estimable à plusieurs titres, n'a pas obtenu tout le succès d'utilité et de curiosité auquel il semblait appelé. L'auteur de la plus récente version anglaise, M. Eastwick, s'est gardé avec soin de ce double écueil : grâce à l'esprit d'entreprise et au goût de son éditeur, il a fait de son livre une véritable merveille d'élégance typographique, jusque-là sans précédents, et que l'on à pu admirer à l'Exposition universelle de 1855. Tout, dans l'exécution matérielle de ce volume, mérite des éloges : le papier, les caractères, les encadrements, qui ne sont ni trop lourds ni trop compliqués, les illustrations en or et en couleur empruntées à de beaux manuscrits orientaux et reproduites avec un rare bonheur; et enfin, la couverture cartonnée, ornée d'arabesques et portant sur les plats le titre du livre en lettres d'or. M. Eastwick ne s'est pas borné à ces soins pour ainsi dire accessoires, il a fait de sa traduction une œuvre littéraire et s'est même imposé la tâche difficile de rendre en vers les vers très nombreux dispersés dans l'original. Il est seulement à regretter que les scrupules qui, dans son édition du texte publiée en 1850, l'avaient porté à mutiler l'ouvrage de Sadi, l'aient déterminé à introduire les mêmes coupures dans sa version. On s'explique toutefois mieux de pareilles suppressions dans le second cas que dans le premier ; car, l'étude de la langue persane n'étant pas abordée chez les Européens par des enfants, il ne saurait y avoir aucun inconvénient à laisser entre les mains des élèves des textes qui, à tout bien considérer, ne sont pas plus dangereux pour la morale que les Bucoliques, Anacréon, Horace et Martial.
Sadi aborde quelquefois un sujet très scabreux, celui de l'amour antiphysique; mais, si le fond cher lui est parfois immoral, l'expression reste le plus souvent chaste. D'ailleurs, c'est là un côté, le plus laid, il est vrai, des mœurs orientales, et l'historien, comme le philosophe, est bien obligé d'y arrêter un instant ses regards. M. Eastwick nous paraît donc en avoir usé un peu trop cavalièrement avec son auteur en supprimant, dans le chapitre V du Gulistan, dix historiettes sur vingt et une que renferme en tout ce chapitre, et en faisant plusieurs coupures dans les autres chapitres. Voici en quels termes sommaires il a prévenu le public de ces suppressions : « Quelques histoires plus conformes au goût oriental qu'à celui des Européens ont été omises. » D'ailleurs, M. Eastwick s'est permis d'autres retranchements sans daigner en avertir le lecteur, et sans qu'on puisse en apercevoir le motif. C'est ainsi que, dans le chapitre VIII, on rencontre trois vers qui sont complètement omis dans les deux publications du savant Anglais et dont on peut voir ci-dessous la traduction.
Mais en voilà assez sur les travaux de mes deux principaux devanciers, français et anglais. Je ne prétends pas donner un examen complet des nombreuses publications dont le Gulistan a été l'objet jusqu'ici. Cette tâche a d'ailleurs été accomplie pour la période antérieure à l'année 1825 par Silvestre de Sacy et par M. Sémelet, qui a seulement eu tort de confondre la traduction de Du Ryer avec l'extrait, beaucoup moins complet et sans aucune valeur, publié pour la première fois en 1704, sous le voile de l'anonyme, par d'Alègre, et réimprimé en 1714 et en 1737.
Je vais maintenant faire connaître, autant que l'insuffisance des documents biographiques orientaux me le permettra, la vie si longue et si bien remplie de Sadi. Pour cette étude ma principale source sera le recueil des œuvres de l'écrivain lui-même, et surtout son Bostân, qui n'a encore été traduit ni dans notre langue ni en anglais, mais dont je compte donner quelque jour une version conçue sur le même plan que le présent ouvrage.
Vers le milieu du sixième siècle de l'hégire (douzième de notre ère), la province de Fâris, ou, comme on l'appelle actuellement, Farsistân (la Perside des anciens), vit s'élever sur les débris de la puissance des sultans seldjoukides de l'Iran, une dynastie de princes d'origine turcomane, qui sont désignés par les chroniqueurs sous le nom de Salgariens, emprunté de celui de Salgar, porté par un de leurs ancêtres, ou sous le titre d'Atabecs, qu'ils partageaient avec d'autres dynasties de la Perse et de la Mésopotamie. Les Atabecs du Fâris, dont la capitale était Chiraz, furent au nombre de onze, et régnèrent environ cent vingt ans. Le cinquième de ces souverains, Sad-ben-Zengui, gouverna depuis l'année 591 (1195 de J. C.) jusqu'à l'année 623 (1226), et ce fut sous son règne que Sadi commença de se faire connaître. On dit même que le nom de Sadi n'est qu'un tékhallus ou surnom poétique, tiré du nom de ce prince. D'après le biographe des poètes persans, Daulet-Châh, le père du poète était attaché au service de l'Atabek, et ce fut pour ce motif que notre auteur prit le nom de Sadi. Le nom du père de Sadi était Abd-Allah. Quant à Sadi, il ne nous est connu que sous les surnoms où titres honorifiques (lakab) de Mocherrif ou Cherf Eddin, Moslih ou Moslih Eddin, qui signifient la gloire et l'avantage de la religion.
On n'est pas bien d'accord sur l'époque de la naissance du poète. Quelques écrivains, et notamment d'Herbelot, la mettent en l'année 571 (1175-6). D'autres, en faisant mourir Sadi à l'âge de cent deux ans, dans l'année 691 (1292), paraissent retarder de dix-huit ans le commencement de sa vie. C'est cette opinion qu'ont adoptée S. de Sacy, dans sa Biographie universelle, et sir Gore Ouseley. Mais cette date ne peut se concilier avec ce que nous apprend Sadi lui-même, au sujet de ses rapports avec le cheikh Chems-Eddin Aboulfaradj ben Djaouzy, mort, comme on sait, au mois de juin 1201. Daulet-Châh n'a pas vu cette contradiction. Amin-Ahmed-Râzy, dans son ouvrage de géographie historique intitulé : Heft-Iklim (les Sept Climats), donne à Sadi cent dix ans de vie, et le fait mourir en l'année 690 (1291). On peut donc admettre, jusqu'à preuve contraire, que notre auteur naquit vers l'année 580 (1184).
Sadi nous dit dans son Bostân que, lorsque son père lui fut enlevé, il se trouvait encore dans l'enfance. Un retour sur lui-même lui inspire les plaintes les plus touchantes sur le sort des orphelins : « Étends, dit-il, un ombrage tutélaire sur la tête de l'individu dont le père est mort. Secoue la poussière qui le couvre et arrache l'épine qui le blesse. Ne sais-tu pas ce qui l'a rendu fort abattu? L'arbre privé de sa racine sera-t-il jamais verdoyant? Quand tu vois un orphelin plongé dans l'abattement et la confusion, n'imprime pas un baiser sur la figure de ton propre fils.[2] Si l'orphelin pleure, qui le caressera pour l'apaiser? Et s'il se met en colère, qui supportera le fardeau de son mécontentement? Or ça, prends bien garde qu'il ne pleure pas, car le trône sublime de Dieu tremble sur sa base quand l'orphelin répand des larmes. Essuie avec commisération les pleurs de ses yeux, secoue avec sollicitude la poussière qui couvre sa face. S'il a perdu l'ombré qui couvrait sa tête, élève-le sous ton ombre tutélaire. Pour moi, alors que je reposais ma tête sur le sein de mon père, j'avais comme une couronne sur ma tête (litt. : j'avais ma tête possédant une couronne). Si une mouche se posait sur mon corps, l'esprit de plusieurs personnes en était troublé. Maintenant, que l'on vienne à me conduire en prison, personne de mes amis ne me sera en aide. J'ai connaissance de l'affliction qu'éprouvent les enfants (orphelins), parce que dans mon enfance mon père m'a laissé orphelin. »
Sadi nous apprend que dès son enfance il manifesta de grandes dispositions à la piété, qu'il se levait la nuit pour prier et pratiquait le jeûne. Après avoir commencé ses études à Chiraz, sa ville natale, il se transporta à Bagdad, qui de son temps était encore le siège du califat et la résidence des principaux savants de l'islamisme. Il suivit les cours du collège dit nizamien, c'est-à-dire fondé par le célèbre vizir Nizam al-Mulk, et y obtint un idrâr (ou pension). C'est dans cet établissement qu'il eut pour professeur Aboulfaradj ibn Aldjaouzy. Ce fut également à Bagdad qu'il contracta une liaison avec le cheikh Schihâb-Eddin Sohrawerdy, en compagnie duquel, selon Djami, il fit un voyage sur mer. Daulet-Châh ajoute que Sadi s'étant ensuite adonné à la science du sens interne (ou allégorique, bâthin) et à la vie contemplative, devint le disciple du grand cheikh Abd-Alkâdir Guilâny, et entreprit le pèlerinage en sa société. Cette assertion, répétée par Silvestre de Sacy, Ross et d'autres biographes du poète, ne saurait être exacte, puisque le célèbre soufi dont il s'agit mourut en l'année 1166. Daulet-Châh affirme que Sadi s'acquitta encore du pèlerinage quatorze fois, et le plus souvent à pied. Dans le Gulistan et le Bostân, notre auteur fait mention de diverses circonstances se rattachant à cette période de sa vie. Il nous apprend, par exemple, qu'il fut plus d'une fois sur le point de se laisser aller à la fatigue et au découragement, et qu'il ne fut rappelé au sentiment de la conservation que par les reproches énergiques d'un chamelier; qu'une caravane dont il faisait partie fut pillée par des voleurs arabes; enfin, que dans une autre occasion, lui et ses camarades, les pèlerins à pied, en vinrent aux mains les uns avec les autres.
Sadi ne se borna pas à visiter l'Arabie, mais il parcourut en outre la majeure partie du monde alors connu. Aussi a-t-il pu dire avec raison dans le Bostân: « J'ai beaucoup voyagé dans la partie la plus reculée du monde, j'ai passé mon temps avec des personnes de toute sorte, dans chaque localité j'ai trouvé du plaisir, et j'ai obtenu un épi de chaque meule. »
Une des premières contrées que visita Sadi, fut sans doute la Syrie. Djami raconte qu'il exerça longtemps la profession de porteur d'eau à Jérusalem et en Syrie, et qu'il donnait à boire aux gens par un esprit de charité. Sadi nous a lui-même raconte comment il prit en dégoût la société de ses amis de Damas, s'enfonça dans le désert qui avoisine Jérusalem et mena une vie errante, jusqu'à ce qu'il tombât entre les mains des Francs. On le fit travailler avec des juifs à nettoyer les fossés de Tripoli.[3] Un des principaux habitants d'Alep, avec lequel il avait eu d'anciennes relations, le vit dans ce triste état, en eut compassion, le racheta moyennant dix pièces d'or et l'emmena chez lui. Cet homme avait une fille qu'il fit épouser à Sadi, avec une dot de cent pièces d’or. Ce mariage fut loin d'être heureux, et dans la compagnie de cette femme querelleuse, insolente et insubordonnée, le poète put croire plus d'une fois qu'il n'avait fait que changer de captivité. Il dut être d'autant plus sensible à ses chagrins domestiques, qu'il mettait à très haut prix, ainsi qu'on le voit dans son Bostân,[4] les charmes qu'un homme peut trouver dans une union bien assortie.
Sadi paraît s'être marié une seconde fois, et sans doute encore pendant la portion de sa vie qu'il passa hors de sa patrie. « A Sanaa (dans le Yémen), dit-il, il me mourut un enfant. Comment exprimerais-je la douleur qui m'assaillit par suite de cette perte? Le destin n'a pas formé une figure aussi belle que celle de Joseph, sans que le poisson du tombeau l'ait dévoré comme Jonas. Dans ce jardin il n'est pas venu de cyprès élevé, que le vent de la mort n'ait à la fin déraciné. Il n'est pas surprenant que la rose se soit épanouie sur la terre, puisque tant de personnes aux membres de rose reposent dans la terre. Je dis en moi-même : « O toi, qui es l'opprobre des hommes, meurs, pour que l'enfant sans tache et le vieillard souillé partent en même temps. A cause du chagrin et de l'affliction que j'éprouvais d'être privé de sa vue (litt. du chagrin... sur sa taille, sa stature), je soulevai une pierre de son tombeau. Par suite de l'épouvante que je ressentis dans ce lieu sombre et étroit, tout mon être fut troublé et je changeai de couleur. Quand je fus revenu à moi de ce trouble profond, je crus entendre mon enfant chéri qui me disait : « Si tu as été effrayé de cet endroit obscur, sois prudent et entres-y avec éclat (c'est-à-dire, avec des bonnes œuvres qui illuminent pour toi la nuit du tombeau). Veux-tu que la nuit du tombeau soit aussi lumineuse que le jour ? Dès ce monde allume la lampe des bonnes actions. Le corps du laboureur tremble la fièvre, de peur que son palmier ne produise pas de dattes. Et des gens très avides s'imaginent que, sans avoir semé de froment, ils recueilleront une moisson. Sadi [ou bien un homme heureux][5] qui a planté un arbuste en a mangé le fruit ; une personne qui a répandu de la semence a recueilli la moisson. »
Parmi les villes et les pays que parcourut Sadi, il cite encore Baalbek et Damas en Syrie, Beîlékân, dans l'Arran, Basrah ou Bassora, Coufa, l'Egypte, le Maghreb ou Mauritanie, le Diarbecr, Kachgar, dans le Turkestan, l'île de Kich, dans le golfe Persique; la plaine de Roudbâr, l'Abyssinie et la partie la plus reculée du pays de Roum ou Asie-Mineure. Voici ce qu'il rapporte à propos de ce dernier voyage :
« J'entendis raconter qu'il y avait dans la partie la plus reculée du pays de Roum, un homme d'un caractère pur, savant et voué à la vie contemplative. Moi et quelques voyageurs accoutumés à traverser les déserts, nous partîmes, desireuxdevoircethomme.il baisa la tête, les yeux et la main de chacun de nous, nous fit asseoir avec considération et respect, et s'assit lui-même. Je lui vis de l'or, des champs ensemencés, des serviteurs et des meubles, mais il était dépourvu d'humanité et ressemblait à un arbre privé de fruits. Sous le rapport de la bonté de ses discours, c'était un homme plein d'empressement, mais son foyer était très froid. Pendant toute la nuit il n'eut pas le loisir de sommeiller, à cause de ses litanies,[6] et nous ne l'eûmes pas davantage, à cause de la faim qui nous tourmentait. Le matin venu, il se ceignit, ouvrit la porte et recommença ses caresses de la veille. Il y avait un homme très plaisant et d'un caractère agréable, qui se trouvait ainsi que nous hôte de cette demeure. « Donne-moi, dit-il au religieux, un baiser avec une faute d'orthographe (tashîf), car pour le pauvre des provisions (touché) valent mieux que des baisers (boucé). Ne place pas la main sur mon soulier pour me faire honneur, donne-moi du pain et frappe ma tête à coups de soulier. Les hommes vraiment dignes de ce nom ont obtenu la prééminence par leur libéralité, et non pas ceux qui passent les nuits à veiller et dont le cœur est mort. J'ai vu la même chose chez la sentinelle tartare, à savoir : un cœur mort et un œil qui veille. La noblesse consiste à se montrer généreux et à donner, du pain à autrui ; de vains discours ne sont qu'un tambour au ventre creux. Au jour de la résurrection elle sera placée dans le paradis, cette personne qui aura recherché la réalité et laissé de vaines prétentions. On peut rendre ses prétentions justes par ses actes, mais l'orgueil sans mérite est un faible support. »
Le principal voyage de Sadi fut celui de l'Hindoustan. Il est permit de supposer qu'il l'entreprit surtout dans un but de curiosité, et qu'il suivit pour pénétrer dans cette vaste région le chemin qui traverse la chaîne de l'Hindou-Kouch. Dans le trajet de Balkh à Bâmyân, il lui arriva une aventure qu'il rapporte dans le chapitre VII de son Gulistan, et qui prouve que si, comme le dit Daulet-Châh, Sadi se dirigea vers l'Asie Mineure et l'Inde pour y faire la guerre aux infidèles, en pieux et brave musulman, du moins son courage lui faisait quelquefois défaut. Dans la circonstance dont il s'agit, ce fut assez de la vue de deux Hindous, armés l'un d'un bâton, l'autre d'un maillet, pour terrifier le poète et son compagnon, jeune homme des plus robustes, et leur faire abandonner leur bagage, leurs armes, leurs vêtements.
Dans le Guzarate, Sadi visita la fameuse idole de Siva, adorée sous le nom de Soma ou Som-Nâth, c'est-à-dire, Seigneur de la Lune.[7] Il a raconté, dans son Bostân, comment il vint à bout de découvrir et de punir la supercherie des ministres du temple. Je vais donner en entier la traduction de ce curieux récit; mais je dois d'abord faire observer que Sadi, de même que d'autres écrivains musulmans, confond les Hindous et les Brahmanes avec les Parsis et les Mages, le culte de Brahma avec celui de Zoroastre. « A Soménât, j'ai vu une idole d'ivoire incrustée de pierreries, et telle que Menât[8] du temps du paganisme. Le sculpteur la forma de telle sorte qu'une plus belle idole ne saurait exister. Les caravanes partaient de tous les cantons pour voir cette figure inanimée. Les chefs de la Chine et du Turkestan espéraient de la sincérité de la part de cette idole, comme Sadi en espère de sa maîtresse au cœur de rocher. Les hommes éloquents se rendaient humblement de chaque endroit près de cette muette statue. Je fus impuissant à découvrir cette circonstance : Pourquoi un être vivant adore-t-il un minéral ? J'interrogeai avec douceur un mage avec lequel j'étais en relation, qui était beau de visage, partageait ma cellule et avait de l'amitié pour moi. « O Brahmane, lui dis-je, je m'étonne, de ce qui concerne cet endroit-ci, car les yeux y sont séduits par cette figure impuissante et enchaînés dans le puits de l'erreur ; la main de cette idole n'a aucune force et son pied ne peut marcher ; si tu la jettes, elle ne se relèvera pas. Ne vois-tu pas que ses yeux sont faits d'ambre jaune? C'est une erreur de chercher de la fidélité chez les avares (litt. ceux dont l'œil est avide).
« Lorsque j'eus prononcé ce discours, cet ami prit ma main ; il devint pareil au feu, par suite de sa colère, et s'attacha à moi pour me combattre. Il avertit de ce qui s'était passé les mages et les supérieurs du temple d'idoles. Au milieu de toute cette assemblée je ne vis pas un seul visage bienveillant. Comme ce chemin tortueux paraissait droit à leurs yeux, le droit chemin parut oblique à leurs regards; car, bien qu'un homme soit savant et sensé, il semble ignorant aux yeux des gens dépourvus de science. Comme un individu submergé, je restai privé de toute ressource et ne vis d'autre moyen à employer que la dissimulation. Quand tu t'aperçois que l'ignorant est en colère, le salut consiste dans la résignation et la douceur. Je louai hautement le chef des brahmanes : « O vieillard, lui dis-je, qui interprètes l'Avesta et le Zend, cette idole sculptée me plaît aussi, car c'est une figure agréable et une statue ravissante; sa forme m'a paru merveilleuse, mais je n'ai aucune connaissance de la réalité. Car je séjourne depuis fort peu de temps dans cette demeure; l'étranger discerne rarement le mal du bien. Tu connais la vérité, car tu es le vizir[9] de cet échiquier, tu es le conseiller du roi de cette localité. Le culte que l'on rend à la divinité sans la connaître et à l'imitation d'autrui, estime erreur. Heureux un contemplatif qui possède la connaissance! Quel est le sens caché que représente cette idole? Car je serai le premier de ses adorateurs.
« Le brahmane illumina son visage d'allégresse; il m'approuva, et dit : « O homme digne d'approbation, ta question est convenable et ta conduite belle : quiconque demande un guide parvient à l'hôtellerie. Qui, chaque matin, excepté cette idole-ci, de l'endroit où elle se trouve, élève la main vers le Dieu juste? Si tu veux, cette nuit, trouve-toi ici, car demain ce mystère te sera manifesté. »
« La nuit je me rendis dans ce lieu-là, par l’ordre du vieillard; de même que Byjen,[10] je fus prisonnier dans le puits du malheur. Comme toi j'ai erré beaucoup en voyageant, j'ai vu des idoles qui n'avaient aucune notion d'elles-mêmes. Ce fut une nuit longue comme le jour de la résurrection; autour de moi priaient les mages, sans avoir fait leurs ablutions; des prêtres qui n'avaient jamais troublé l'eau, et dont les aisselles exhalaient la même odeur qu'une charogne exposée au soleil. Peut-être avais-je commis une grande faute, puisque je souffris cette nuit-là un châtiment douloureux. Toute la nuit je fus éprouvé dans ces liens d'affliction, ayant une main sur mon cœur, l'autre levée pour prier. Voici que tout à coup le timbalier battit du tambour, et le coq annonça la mort du brahmane ; le prédicateur, vêtu de noir, de la nuit tira du fourreau sans opposition le sabre du jour; le feu de l'aurore tomba sur la mèche, et en un instant tout on monde fut illuminé. Tu aurais dit que dans la contrée du Zanguebar un Tartare fût sorti tout à coup de quelque coin. Les mages, à l'esprit pervers et dont le visage n'était pas lavé, entrèrent dans le temple, venant de la plaine et du voisinage. Il ne demeura personne dans la ville, soit homme, soit femme. Dans ce temple d'idoles il ne resta pas la place d'une aiguille. Quant à moi, j'étais malade de chagrin et ivre de sommeil.
« Tout à coup la statue éleva la main. Une seule clameur s'éleva parmi tous ces gens : tu aurais dit que la mer se fût mise à bouillonner. Lorsque le temple d'idoles eût été évacué par la foule, le brahmane me regarda en souriant : « Je sais, dit-il, qu'il ne te reste plus de difficulté. La vérité est devenue manifeste et l'erreur a disparu. » Quand je vis que l'ignorance était affermie en lui, et qu'une imagination absurde était implantée dans son esprit, je ne pus dorénavant dire rien de véritable, car il faut cacher la vérité aux sectateurs de l'erreur. Lorsque tu vois vis-à-vis de toi un homme supérieur en force et que tu luttes contre lui, cela n'est pas du courage, mais c'est rompre ton propre poignet. Je pleurai quelque temps par hypocrisie, et je fis : « Je me repens de ce que j'ai dit. » Le cœur des infidèles fut disposé à pleurer : il n'est pas surprenant que la pierre soit mise en branle par un torrent. Ils coururent vers moi en me saluant, et prirent mon bras avec respect. J'allai proférer des excuses près de la figure d'ivoire, assise sur un fauteuil d'or dressé sur un trône (une estrade) de bois de teck. Je déposai un baiser sur la main de cette méprisable idole, disant à part moi : « Que la malédiction soit sur elle et sur ses adorateurs! » Par imitation je me montrai infidèle pendant plusieurs jours, je fus comme un brahmane en ce qui concernait les préceptes du Zend.
« Quand je vis que j'étais regardé dans le temple comme un homme sûr (c'est-à-dire, dont on ne se méfiait pas), dans mon allégresse je ne touchai plus la terre. Une nuit je fermai solidement la porte du temple, je courus à droite et à gauche comme un scorpion, je regardai au-dessous et au-dessus du trône, et je vis un rideau brodé d'or, derrière lequel se trouvait caché un chef des adorateurs du feu, tenant dans sa main l'extrémité d'une corde. Il me fut connu avec promptitude dans cette circonstance, comme pour David le fer devint aussi malléable que la cire, il me fut connu, dis-je, que, de toute nécessité, quand cet homme tirait la ficelle, l'idole élevait la main comme pour demander justice. Le brahmane fut honteux à ma vue, car une couture sur la face extérieure de l'affaire[11] est une cause de confusion. Il se mit à courir ; mais je me précipitai sur ses traces et le lançai dans un puits, car je savais que si ce brahmane restait vivant, il ferait des efforts pour répandre mon sang, il jugerait à propos que je périsse de peur que je ne dévoilasse son secret. Quand tu es informé de ce qui concerne le méchant, fais-le périr lorsque tu en trouves la possibilité ; car, si tu le laisses en vie, cet homme dépourvu de mérite ne voudra pas que tu vives davantage. Quand bien même il poserait la tête sur le seuil de ta porte pour te rendre hommage, il te coupera la tête, s'il en obtient le pouvoir. Ne t'enquiers pas de l'affaire d'un homme perfide, mais quand tu l’as épié et que tu l'as découvert, ne lui accorde pas de pardon. En-somme, je tuai ce misérable à coups de pierres, parce qu'un mort ne saurait parler. Quand je vis que j'avais suscité du tumulte, j'abandonnai cette contrée et je m'enfuis. Lorsque tu as mis le feu dans un champ de roseaux, si tu es sage, tiens-toi sur tes gardes contre les lions (qu'il peut receler). Ne tue pas le petit du serpent qui mord les hommes, mais quand tu l’as tué, ne t'arrête pas davantage dans cette maison-là. Lorsque tu as tourmenté une ruche d'abeilles, enfuis-toi de ta place, car sinon tu périrais promptement. Ne lance pas de flèche à un homme plus adroit que toi, mais si tu en as jeté, enfuis-toi (litt. prends le pan de ta robe entre tes dents.) Dans les pages de Sadi ne se trouvé pas ce conseil-ci : « Quand tu as creusé au pied d'un mur, restes-en tout près. » En conséquence, après cette épreuve, je me rendis dans l'Inde (proprement dite), et de là dans le Hedjaz par le chemin du Yémen. »
Il serait intéressant de pouvoir fixer l'époque à laquelle Sadi accomplit ses nombreux et lointains voyages. Mais les biographes orientaux, en général trop sobres d'indications chronologiques, ne nous fournissent pour cela aucun moyen. Daulet-Châh, dont le récit est reproduit par Haddjy-Louthf Aly-beg, se contente de dire qu'à partir de sa douzième année, Sadi employa trente ans à acquérir des connaissances et trente autres à voyager. Force nous est encore de recourir à Sadi lui-même pour déterminer, au moins approximativement, le temps où il mena une vie si errante. Nous avons-vu qu'il étudia dans sa jeunesse à Bagdad, sous un personnage mort en l'année 1201. On voit dans le Gulistan que, quinze à seize ans après cette date, il se trouvait dans l'Irak persique ; et ce fut entre ces deux, époques que le poète visita le Turkestan, ainsi que le prouve le synchronisme qu'il établit entre ce fait et une paix conclue par le sultan du Khârezm avec les Carakhitaïens, Le passage du Gulistan où se trouve mentionné cet incident mérite de nous arrêter, à un autre point de vue. En effet, il montre que plus de quarante ans avant que l'écrivain composât ses deux principaux ouvrages, sa réputation comme poète avait pénétré jusqu'à Kachgar, malgré l'immense distance qui séparait cette ville de Chiraz. Si l’on s'en rapportait à J. Ross, on pourrait croire que Sadi a visité Dihly entre les années 607 et 633 de l'hégire (1210-1236). Mais cette opinion de l'orientaliste anglais repose uniquement sur une base ruineuse : la confusion d'Oghoulmich, prince de l'Irak, avec le souverain palan ou afghan de Dihly, Altmich.
Daulet-Châh et Louthf-Aly-Beg racontent une anecdote qui appartient à la période de la vie de Sadi que nous venons d'esquisser. C'est ce qui nous engage à en placer le récit en cet endroit. Mais il faut savoir d'abord que parmi les poètes contemporains de noire auteur, il y en avait un, nommé le khadjah (maître) Homâm-Eddin Tébrîzy (originaire de Tabriz ou Tauris), qui était un homme de mérite, d'un caractère agréable, d'un rang élevé, et jouissant, de plus, d'une grande opulence. Pour nous donner une idée de sa richesse, Daulet-Châh dit que ce personnage ayant invité à un festin le fils du premier ministre de l'empire mongol, étala dans son salon quatre cents bassins en porcelaine de la Chine. Comme dans ce temps-là, dit Khondémir, les diverses classes de la société se montraient fort éprises des gazels (odes) du cheikh Sadi et ne faisaient guère attention à la lecture des poésies d'un autre, Homâm-Eddin composa une gazel dont le premier vers était ainsi conçu :
« Par une seule œillade tu peux arranger notre affaire, mais tu ne t'occupes pas de secourir les malheureux. »
La pièce finissait par ce vers :
« Homâm possède une parole douce et qui gagne le cœur ; mais quel profit y a-t-il ? puisque le malheureux n'est pas de Chiraz. »
On voit que Homâm-Eddin ne devait pas être très bien disposé en faveur de son heureux rival, le poète de Chiraz. « Un jour, dit Daulet-Châh, celui-ci entra à Tabriz dans un bain chaud, où le khadjah Homâm se trouvait, entouré d'une grande pompe. Le cheikh répandit une tasse d'eau sur la tête du khadjah, qui lui fit cette question : « De quel endroit est le derviche? » Le cheikh répondit : « De la contrée bénie de Chiraz. — C'est une chose étonnante, répartit le khadjah, qu'un Chirazien dans notre ville soit plus qu'un chien.[12] » Homâm se mit en colère et sortit du bain. Le cheikh le suivit et s'assit dans un coin. Il se souvenait, ainsi que c'est la coutume, d'un jeune garçon, doué d'une grande beauté, qui accompagnait le khadjah (et qui, d'après Louthf-Aly, était le propre fils de celui-ci). Homâm séparait l'adolescent du cheikh Sadi. Sur ces entrefaites, il demanda à ce dernier : « Ne récite-t-on pas à Chiraz, les poésies de Homâm? — Si, certes, répondit le cheikh, elles y jouissent d'une grande célébrité. — Te les rappelles-tu quelque peu, reprit Homâm? — Je me souviens d'un vers, répliqua Sadi :
« Homâm, il y a un voile[13] entre moi et mon amante, il est temps que je jette de côté ce voile importun. »
Il ne resta pas le moindre doute à Homâm que cet homme ne fut Sadi ; il lui dit donc : « N'es-tu pas le cheikh Sadi? — Oui, certes, répartit le cheikh. Homâm tomba à ses pieds, lui fit des excuses, le conduisit à sa maison, lui donna un festin et le traita avec beaucoup de somptuosité. »
Parmi les poètes contemporains de Sadi et avec lesquels il fut en relation, on cite encore l'épicurien Nizary, surnommé Kouhistâny, parce qu'il était originaire de la ville de Pîrtchend, dans le Kouhistan,[14] et l'émir Khosrew, de Dihly. Daulet-Châh raconte même, sur la foi d'un ouvrage intitulé : Les Perles des secrets (Djéwâhir-al-asrâr), par le cheikh Azéri, que, dans la plus extrême vieillesse, Sadi contracta amitié avec l'émir Khosrew et entreprit derechef, exprès pour le voir, le voyage de l'Inde.[15] Cette dernière assertion, assez peu vraisemblable en elle-même, se trouve de plus contredite implicitement par un fait dont nous devons la connaissance au célèbre historien musulman de l'Inde, Mohammed-Firichtah. Cet écrivain nous apprend que Mohammed sultan, fils du souverain de Dibly, Ghiyâth-Eddin-Balaban, ayant été nommé par son père gouverneur de Moultân, y encourageait les lettres et surtout la poésie. Emir-Khosrew et un autre célèbre poète, également originaire de Dihly, Khadjah-Haçan, restèrent cinq ans à son service dans Moultân, et furent admis parmi ses commensaux. Dès son arrivée à Moultân, il envoya deux fois des messagers, avec des présents et des richesses considérables, à Chiraz, près du cheikh Sadi, pour le prier de venir à sa cour, promettant de lui faire construire un monastère à Moultân, et de doter cet établissement du revenu de plusieurs villages. Mais comme le cheikh était devenu vieux et impotent, il s'excusa chaque fois, non sans faire hommage au prince d'un manuscrit contenant toutes ses poésies, copiées de sa propre main. Il joignit à cet envoi des recommandations en faveur d'Emir-Khosrew.[16] Le prince Mohammed, plus connu sous le nom du Khan martyr (Khan Chehid), ayant été tué en l'année 1283, dans une bataille contre les Mongols,[17] ces circonstances si honorables à la fois pour lui et pour notre poète doivent être arrivées vers l'année 1280.
Après avoir amplement satisfait son goût pour les voyages, Sadi revint dans sa ville natale, résolu à y finir sa carrière. Il fit choix d'un ermitage situé à l'extérieur de la ville, dans le voisinage du monastère du cheikh Abou-Abd-Allah, fils de Khafif, objet de la vénération des habitants de Chiraz et de la munificence des deux Atabecs Zengui et Abou-Becr.[18] James Ross a cru, faute d'avoir bien compris les paroles de Djami, dans ses Vies des Soufis, que notre auteur appartenait à la noble maison de Abd-Allab Hafaif (sic). Mais le texte de Djami dit seulement que Sadi était au nombre des dévots fixés dans le voisinage du noble mausolée ou du monastère du cheikh Abou-Abd-Allah (ibn) Khafif. D'après Daulet-Châh, Sadi ne sortait pas de son ermitage, s'y occupant du culte de la divinité et de pieuses méditations, et sans doute aussi de la composition de ses nombreux écrits. Le célèbre voyageur africain, Ibn Batoutah, qui visita deux fois Chiraz, dans la première moitié du quatorzième siècle, dit que Sadi fit construire lui-même l'ermitage destiné à sa demeure, et dans l'enceinte duquel se trouvait un joli jardin. « Cet édifice, ajoute Ibn Batoutah, est situé dans le voisinage de la source du grand fleuve, connu sous le nom de Rocn-Abad. Le cheikh avait construit en ce lieu de petits bassins de marbre, afin qu'on pût y venir laver les vêtements. Les citoyens de Chiraz sortent de la ville pour visiter le mausolée de Sadi contigu à son ermitage ; ils mangent des mets préparés dans celui-ci et lavent leurs habits dans le fleuve; puis ils s'en retournent. C'est ainsi que j'en usai près de cet endroit.[19] »
Les princes, les grands et les hommes religieux venaient visiter Sadi dans sa riante retraite, et lui apportaient des mets savoureux. Le cheikh en mangeait une partie, en distribuait une autre, et tout ce qui restait, il le déposait dans un panier qu'il suspendait en dehors d'une fenêtre. Le chemin des bûcherons de Chiraz passait sous le balcon du cheikh. Les bûcherons affamés se régalaient de ces pains bien blancs, de ces pâtisseries, de ces rôtis délicieux. A ce propos Daulet-Châh et Louthf-Aly-Beg racontent une anecdote où Sadi est représenté comme ayant le don de faire des miracles. Un quidam, disent-ils, ayant revêtu le costume des bûcherons, voulut, par manière d'épreuve, mettre au pillage la desserte de la table du cheikh. Mais lorsqu'il étendit sa main vers le panier, elle se dessécha soudain. Il poussa un cri en disant : « O cheikh! viens à mon secours. » Le solitaire répondit : « Si tu es un bûcheron, que sont devenues tes fatigues nocturnes, tes piqûres, causées par les épines, et les ampoules de tes mains? Mais si tu es un pillard et un voleur, où sont ton lacet pour escalader les murailles, les armes et ton cœur endurci ? En effet, tu t'es mis à gémir sans avoir reçu aucune blessure. » Aussitôt Sadi fit une prière, et ce malheureux obtint sa guérison. De plus, le cheikh lui fit cadeau de la desserte du jour.
On voit que les Orientaux ont fait de Sadi une sorte de personnage légendaire. Djami et, d'après lui, Khondémir racontent fort sérieusement que le poète ayant été honoré de la société de Khidhr (le prophète Élie), celui-ci lui fit part de l'eau de la source de vie. « C'est par ce moyen, ajoute Khondémir, que le bruit de son éloquence et de sa faconde s'éleva plus haut que le portique de Saturne. » Djami dit encore que Khosrew de Dihly obtint la société de Khidhr, grâce aux bons avis de son guide spirituel, le cheikh Nizâm-Eddin Aouliya, et qu'il pria le prophète de laisser tomber dans sa bouche un peu de cette liqueur bénie qu'il avait avalée. A quoi Khidhr répondit que Sadi avait déjà obtenu cette félicité. Khosrew étant retourné tout affligé près de son précepteur, lui raconta sa déconvenue. Alors le cheikh Nizam-Eddin lui cracha dans la bouche, pour le consoler; si bien que, par l'heureuse influence de cette faveur du cheikh, Khosrew put composer quatre-vingt dix-neuf ouvrages, el se vanter d'avoir écrit de quatre à cinq cent mille vers.
Plusieurs faits consignés dans le Gulistan attestent de quelle considération Sadi jouissait près des grands et des plus hauts fonctionnaires de l'État, tels que le chef de la trésorerie. Le crédit dont le poète était en possession l'accompagna jusqu'à la fin de sa longue carrière, et survécut même à la puissance de ses princes légitimes, qui, peu d'années après la mort d'Abou-Becr-ben-Sad, fit place à la domination des Mongols de la Perse ou Ilkhanides. (663 = 1265.) Sous le gouvernement des chefs mongols représentant le souverain de Tabriz, Sadi se vit entouré d'autant d'égards et de respects qu'il en avait jadis obtenu sous les Atabecs. Voici ce qu'on lit à ce sujet dans un opuscule annexé à ceux de notre auteur :
« Du temps du gouvernement du Mélik Adil-Chems-Eddin-Tâzigouy, les généraux de Chiraz avaient donné aux fruitiers, moyennant un prix fixé arbitrairement et très élevé, une certaine quantité de dattes appartenant au trésor, et qui n'avaient alors qu'une valeur peu considérable. Le Mélik n'avait aucun soupçon de cette injustice. Par hasard on envoya plusieurs charges de dattes au frère du cheikh,[20] lequel avait une boutique de fruitier à la porte de l'hôtel de l'Atabek. Lorsqu'il vit que les choses se passaient ainsi, il se leva et s'étant rendu au monastère du grand cheikh Abou-Abd-Allah Mohammed, fils de Khafif, il exposa l'état de l'affaire à son frère le cheikh Sadi. Celui-ci, ayant été affligé de cela, forma la résolution de détourner cette calamité de la tête des pauvres habitants de Chiraz, et nommément de son frère. En conséquence, il dit : « Il faut d'abord écrire un placet » ; et aussitôt il traça cette pièce de vers sur un morceau de papier :
« Je sais avec certitude que tu n'as pas connaissance de l'état de mon frère. On lui donne des dattes moyennant un prix arbitrairement fixé. Il n'y a pas d'infortune pire que celle-là. Les enfants et les hommes pauvres la supportent. Mangeront-ils des dattes, puisqu'ils n'ont pat d'or? Celui que tu as envoyé en qualité de percepteur est un Turc tel qu'il n'y en a pas de pire. Par suite de l'excès de son indigence, il n'a jamais de caleçons sur ses jambes. O seigneur ! on le battra tellement, qu'il ne saura pas trouver le chemin de la porte. »
Lorsque Chems-Eddin eut lu la requête, il rit et ordonna sur-le-champ de faire la proclamation suivante : « Que tout, individu à qui l'on a donné des dattes, moyennant un prix arbitraire, vienne me trouver, car j'ai à lui parler. » Tous les fruitiers se rassemblèrent, et il leur demanda l'état de l'affaire. Ensuite on rendit à chacun l'or qu'il avait donné par le commandement des généraux. Quant à ceux qui n'avaient pas payé, Chems-Eddin prescrivit de ne pas leur reprendre les dattes et, de ne pas en exiger le prix. Après quoi il se leva, et, s'étant rendu près du cheikh Sadi, il lui fit ses excuses, implora le secours de sa bienveillance, et dit : « O cheikh, j'ai ordonné que l'on concédât en toute propriété à ton frère plusieurs charges de dattes que l'on a portées à sa boutique, et qu'on n'en reçût pas la valeur. De plus, comme j'ai appris que le frère du cheikh est pauvre, j'ai apporté pour lui une misérable parcelle d'or. Je prie le cheikh de lui remettre cet or. » Comme il savait que Sadi n'acceptait rien pour lui-même, il plaça sur la terre mille drachmes, après les avoir baisées, et prit congé. En conséquence, il fut connu que Hélic Chems-Eddin 'Adil Tazigouy avait donné aux fruitiers les dattes et le prix de celles-ci, par égard pour Sadi. »
Le poète de Chiraz n'eut pas moins à se louer des procédés du premier ministre de l'empire mongol, le khadjah Chems-Eddin, frère de l'auteur du Djihan-Cuchaï, Ala-Eddin Ata-Mélik Djoueïny. Voici ce qu'il raconte lui-même, à propos de ses relations avec ces deux hommes illustres. On verra par son récit que, dans un âge très avancé et à une époque postérieure à l'année 663 (1265), date de l'avènement du second sultan mongol de la Perse, Abaka-Khan, Sadi voyageait encore.
« Lors de mon retour du pèlerinage de la Kaaba, quand je fus arrivée la capitale Tabriz, que j’eus rencontré les hommes distingués, les savants et les saints personnages de cet endroit..., je voulus voir le chef du divan (de la trésorerie), Ala-Eddin et son frère, le khadjah Chems-Eddin, aussi chef du divan, car de nombreuses obligations réciproques nous avaient fermement unis. Un jour donc je formai le projet de les visiter. Tout à coup je les aperçus qui étaient à cheval, avec le souverain de la surface de la terre, Abaka-Kaân. Lorsque je vis cela, je voulus me retirer, mais j'en fus empêché par leur arrivée. Tous deux étant descendus de cheval, s'avancèrent vers moi, me témoignèrent de la bonté et baisèrent mes mains et mes pieds. Ils me firent voir de la joie et dirent: « Ceci n'était pas prévu, car nous n'avons pas eu connaissance de l'arrivée du cheikh. » Lorsque le sultan vit cela, il dit : « Il y a tant d'années que ce Chems-Eddin se trouve près de moi, il sait que je suis le souverain de la surface de la terre; cependant jamais il ne m'a montré la soumission et les caresses qu'il vient d'adresser à cet homme. « Les deux frères s'en retournèrent et remontèrent à cheval. Le sultan se tourna vers Chems-Eddin et dit : « Quelle est cette personne à laquelle vous avez fait tant de politesses? » « O seigneur! répondit-il, c'est notre père. » Le sultan répartit : « Je vous ai demandé à plusieurs reprises des nouvelles de votre père, et vous m'avez répondu qu'il était mort. » Ils répliquèrent : « O seigneur! c'est notre cheikh, vraisemblablement son nom et sa réputation seront parvenus aux nobles oreilles du souverain. C'est le cheikh Sadi, et dans le monde sa parole est connue et célèbre. Abaka ordonna qu'on le lui amenât. Plusieurs jours après, Sadi, pour complaire aux deux ministres, se rendit près de l'empereur. Au moment où il allait se retirer, celui-ci lui dit : « Donne-moi un conseil. » Sadi répondit : « On ne peut rien emporter de ce monde dans l'autre, si ce n'est la récompense et le châtiment. Maintenant tu as l'option. » Abaka reprit : « Exprime cette pensée en vers. » Sadi récita aussitôt ce distique touchant la justice et l'équité :
« Un roi qui veille sur le repos des sujets, qu'il lui soit licite de percevoir l'impôt, car c'est le salaire des fonctions de pasteur. Mais s'il n'est pas un pasteur des peuples, puisse-t-il être piqué par un serpent venimeux, car tout ce qu'il mange provient de la capitation d'un musulman (ez djizié-i-musulmânist.) »
Abaka pleura et dit plusieurs fois : « Suis-je pasteur, ou non ? » Chaque fois le cheikh répondait : « Si tu es berger, le premier vers te suffit, sinon, ce sera le second. » En prenant congé du souverain, il lui récita ces quelques vers :
« Le monarque est l'ombre de Dieu, l'ombre est intimement unie au corps. L'âme du vulgaire n'est pas capable de bonté, car le sabre ne deviendra pas souverain. Chaque avantage qui survient dans ce monde est une marque de la bienfaisance du roi. L'état ne recevra aucun bien de lui, si tous ses desseins sont le fruit de l'erreur. »
Le Sakib diwân (chef de la trésorerie) Chems-Eddin ayant écrit à Sadi pour lui adresser quelques questions, lui envoya par le porteur de la missive un turban (destâr) et cinq cents dinars, destinés, disait-il, à la nourriture des oiseaux du cheikh. Lorsque le messager fut arrivé à Ispahan, il se dit : « J'ai vu à plusieurs reprises le maître envoyer au cheikh de l'or à pleines charges pour la provision de ses oiseaux, et le cheikh le refuser. Je me rangerai donc parmi les oiseaux. » Il enleva cent-cinquante dinars, les déposa dans la boutique d'un marchand d'Ispahan, et, étant parvenu à Chiraz, il remit la lettre au cheikh. Quand celui-ci eut pris connaissance du message, il sut que l'esclave avait commis un acte d'indélicatesse. Mais il ne lui en témoigna rien et lui dit : « Reviens demain, afin que je te donne la réponse. » Le lendemain l'esclave étant venu le trouver, il lui remit un papier cacheté, dans lequel était écrit ce qui suit: « Que les nobles moments de mon cher fils soient unis aux actes obligatoires de la dévotion et des bonnes œuvres... Tu m'as envoyé un vêtement d'honneur et de l'argent. Que ton argent soit augmenté et ton ennemi foulé aux pieds. Puisses-tu, en retour de chaque dinar, obtenir une année de vie, de sorte que tu restes vivant trois cent cinquante années. »
Le khadjah s'étant tourné vers l'esclave, lui dit : « O homme de rien ! pourquoi as-tu agi de la sorte et en quel endroit as-tu porté l'or? » Le messager répondit : « J'ai vu plusieurs fois le maître donner à Sadi de l'or à pleines charges, et lui ne pas l'accepter. Quant à cette somme-ci, elle était destinée à la provision des oiseaux. Je me suis considéré comme un oiseau, et j'ai enlevé cent cinquante dinars. » Le khadjah dit à son frère Ala-Eddin : « Lève-toi sur l'heure, pars pour Chiraz et remets ce papier au khadjah Djélal-Eddin Khotény, afin qu'il prenne dix mille dinars et que, les ayant mis dans un sac, il les porte en présent au cheikh. » Le frère du ministre fit sur-le-champ ses préparatifs de départ, et se mit en route. Quand il arriva à Chiraz, il y avait six jours que Djélal-Eddin était mort. En conséquence, il porta l'assignation au cheikh Sadi et la lui remit. Lorsque le poète eut pris connaissance du contenu de la lettre, il écrivit aussitôt ces vers :
« Le message du chef de la trésorerie, gloire de l'empire et de la religion (de la fidélité de la fortune duquel la religion s'enorgueillit), ce message est arrivé et a augmenté pour Sadi le degré déconsidération dont il jouissait. Aussi peu s'en est fallu qu'il n'élevât sa tête au-dessus du ciel. Le ministre a ordonné que le chef (sadr) de Khoten, Djélal-Eddin, afin d'obtenir l'approbation de Son Excellence, me fît une visite. Mais le coursier de la mort s'était élancé sur sa tête, ainsi qu'il se précipite sur la tête des contemporains. Djélal ne sera plus vivant dans ce monde pour caresser les serviteurs du Créateur du monde. Je n'en espère pas davantage, dans l'autre monde, car il ne s'occupera pas de moi, occupé qu'il sera de répondre aux plaintes des hommes. »
Quand l'envoyé eut porté cette lettre au ministre et lui eut exposé l'état de l'affaire, le chef de la trésorerie ordonna de mettre cinquante mille dinars dans un sac et de les porter au cheikh, en lui disant: « Prends cet or et construis dans Chiraz un monastère pour les allants et venants. » Sadi, ayant lu l'ordre du khadjah et ses prières, accepta l'or, et avec cette sommeil fit bâtir un monastère (ribâthy) sous la citadelle dite Fahender. »
On a vu par la manière dont Sadi parla au sultan des Mongols de la Perse qu'il savait faire entendre aux puissants de la terre le langage de la vérité. Le même ton de franchise se retrouve dans de nombreux passages du Bostân et du Gulistan, ainsi que dans un opuscule intitulé : Troisième Traité de l'ouvrage qui a pour titre : Conseils aux rois, Nassîhat al moloûc, touchant les conseils adressés au sultan An-kyânou. Ce personnage, dont il est parlé dans Mirkhond, comme d'un chef mongol issu d'une illustre race et qui connaissait à fond les règles du gouvernement, fut vice-roi de Chiraz sous Abaka. Sadi lui dédia un traité où il renferma sous une forme très concise les principales maximes dont la connaissance est nécessaire aux gens en place, Ce fut là sans doute un des derniers écrits sortis de la plume de notre auteur. Sadi survécut encore quelques années à la mort d'Abaka et à la catastrophe qui termina les jours de son généreux bienfaiteur, le premier ministre de ce prince. Le même désaccord qui existe touchant l'époque de la naissance du poète se reproduit, quoique à un degré moindre, à propos de celle de sa mort. D'après un historien presque contemporain, Hamd-Allah-Mustaufi, Sadi mourut le dix-septième jour du mois de dhou'lhiddjeh 690 (11 décembre 1291), et cette date est répétée par Khondémir.[21] Mais Djami prétend que le trépas de Sadi eut lieu un vendredi du mois de chevvâl 691. Et on lit dans Daulet-Châh le passage suivant, qui semble confirmer l'assertion de Djami :
« Un homme illustre a composé le chronogramme que voici, au sujet de la mort de Sadi : « Le moment était la nuit du vendredi (c'est-à-dire, celle du jeudi au vendredi), et le mois, celui de chevval, l'année Kh. SS. A.[22] de l'ère des Arabes : le phénix de l'âme pure du cheikh Sadi secoua de dessus ses plumes et ses ailes la poussière de son corps. «
Mewlâna Houçaïn Alhérâwy a composé sur le même sujet la pièce de vers suivante, au mois de dhou'lka-deh 691 :
« Lorsque le phénix de l'âme pure du cheikh Sadi prit son vol par piété sincère, ce fut dans le mois de chewâl et le soir du vendredi, qu'il se plongea dans la mer de la miséricorde. Quelqu'un me demanda l'année de sa mort. Je répondis : « Il était du nombre des hommes distingués (Khâssân). C'est pourquoi l'époque de sa mort est indiquée par le mot Khâss (691). »
D'après Djami, le tombeau de Sadi se trouve à l'extérieur de Chiraz, à la distance de près d'une parasange (1 lieue ¼) un collège et un superbe monastère lui sont annexés, et le mercredi les habitants de la ville et d'autres lieux vont visiter le mausolée du cheikh. « C'est, dit W. Francklin, qui le vit il y a près de trois quarts de siècle, un grand bâtiment carré, à l'extrémité duquel on a pratiqué deux cabinets dans la muraille. Celui qui est à droite contient la tombe de Sadi, en pierre, longue de six pieds, large de deux et demi. Plusieurs religieux ont demandé et obtenu la grâce d'être enterrés autour de ce bâtiment.[23] »
« A en juger par ses écrits, dit Silvestre de Sacy, Sadi n'était point un de ces soufis hypocrites, qui embrassent la vie spirituelle pour vivre dans la volupté et la fainéantise, aux dépens de la crédulité des pieux musulmans ; car il traite sans ménagement ceux qui déshonorent, par une semblable conduite, la profession religieuse. Sa morale est, en général, pure, et ne peut être accusée ni de relâchement ni de rigorisme; il sait tenir le milieu entre le fatalisme qui réduit l'homme à l'état d'un être entièrement passif, et l'indépendance qui le livre tout à fait à lui-même, et semble le soustraire au pouvoir de la Divinité. Tous les ouvrages de Sadi ne sont pas cependant exempts de reproches; et le recueil de ses œuvres contient quelques poésies dont rien ne saurait excuser l'obscénité. Le Gulistan même offre certains passages dont les idées, comme les expressions, font pour nous un contraste choquant avec la morale et la sagesse du reste de ce livre; mais ceci tient à la différence des mœurs, et ne prouve rien contre la pureté des intentions de l'écrivain. Un caractère qui se fait remarquer dans les écrits de Sadi, surtout dans le Gulistan, c'est qu'il use de l'hyperbole et, en général, du style figuré, avec bien plus de sobriété que la plupart des écrivains de l'Orient, et qu'il tombe rarement dans l'amphigouri et l'obscurité. Le Recueil de ses œuvres est appelé par les Persans la Salière des poèts,[24] et a été imprimé en 1791, à Calcutta; 2 vol. in-fol. Use compose principalement de poésies et contient quelques ouvrages en prose, ou en prose mêlée de vers. Parmi ces derniers, le Gulistan tient le premier rang, tant par son importance que par la réputation dont il jouit à juste titre. »
Ce qui fait le principal charme du Gulistan, indépendamment du mérite du style, qui ne peut être apprécié que des personnes versées dans la connaissance de la langue persane, c'est l'extrême variété qui règne dans cet ouvrage. On y trouve de tout : bons mots, sentences philosophiques, anecdotes historiques, conseils pour la conduite de la vie ou la direction des affaires de l'État ; le tout entremêlé de vers et de prose. A côté d'un trait d'histoire, on rencontrera une plaisanterie; à la suite d'une parabole, quelque sentence piquante et ingénieusement exprimée.
Le Gulistan a été composé, comme l'auteur nous l'apprend, dans, l'année 656 de l'hégire (1258 de J.-C), c'est-à-dire, il y a juste six siècles. Le Bostân fut écrit en 655, et par conséquent, un an plus tôt. « C'est, dit S. de Sacy, un ouvrage en vers, divisé en dix livres, et dont l'objet et le plan diffèrent peu de ceux du Gulistan, mais qui porte davantage l'empreinte des idées religieuses et mystiques de l'auteur. Le style de Sadi me paraît moins attachant dans le Bostân que dans le Gulistan. Peut-être cela tient-il à l'uniformité de la versification du Bostân, tandis que dans le Gulistan la prose est mêlée de vers de toute sorte de mesures ; ce qui jette dans l'ouvrage une agréable variété. »
A la fin de son Gulistan Sadi se vante de n'avoir pas orné ce livre de pièces de vers empruntées aux poètes ses devanciers, ainsi que c'était la coutume des écrivains orientaux. Mais il ne s'est fait aucun scrupule de reproduire dans le Gulistan un assez grand nombre de vers du Bostân. Ces rapprochements qui, à ma connaissance, n'avaient été signalés par aucun des précédents éditeurs ou traducteurs de Sadi, ont été indiqués dans les notes de ma traduction.
Le recueil des poésies de Sadi se compose de kacideh (élégies) arabes et persanes, d'élégies funèbres (mérâcy), de molamma'ât ou pièces bigarrées d'arabe et de persan, de poésies pieuses et mystiques, d'odes ou gazels, de distiques et de quatrains. Au jugement de ses compatriotes, Sadi a surtout excellé dans l'ode. « Il est, dit Djami, le modèle des poêles qui composent des gazels. » Le même écrivain rapporte deux vers dont voici la traduction :
« Dans la poésie trois personnes sont des prophètes, quoique Mahomet ait dit : « Il n'y aura pas de prophète après moi ! » Ce sont, pour les descriptions (ou narrations), les élégies et l'ode, Ferdouci, Anvéri et Sadi. »
Il me reste maintenant à rendre compte de la manière dont j'ai exécuté mon travail et des sources que j'ai mises à contribution. Le projet de traduire le Gulistan sur les meilleurs textes, imprimés et manuscrits, a été conçu par moi il y a plus de quinze ans. Je collationnai à cette époque tout le texte de l'édition autographiée de Sémelet sur la charmante petite édition donnée à Tabriz en 1827. Je relevai aussi un certain nombre de variantes sur le texte donné à Calcutta, 1791, dans les Œuvres complètes de Sadi; sur une édition imprimée à Boulak, près du Caire, en 1834, et sur deux manuscrits de la Bibliothèque impériale (n° 1 du fonds Ducaurroy, et n° 66 du fonds Saint Germain). Depuis lors j'ai consulté avec fruit, en beaucoup de cas, trois autres manuscrits appartenant au même établissement, savoir :
1° Le manuscrit 292 ancien fonds persan. Petit in-4°, comprenant le Gulistan, avec un commentaire arabe, par Sorouri. Copié en 1035 de l'hégire (1625-6 de J. C.) ;
2° Le manuscrit 295 même fonds. In-8°, copié en 950 (1543-4), avec une traduction turque interlinéaire;
3° Le manuscrit 593 Saint Germain. Petit in-8°, copié en 904 (1498-9) par un nommé Ahmed, fils d'Émyr, de Sinope ; et accompagné de gloses interlinéaires et marginales, la plupart en arabe.
A la fin de septembre dernier, au moment où je venais d'achever la mise au net de ma traduction, M. Barbier de Meynard, attaché au ministère des affaires étrangères (direction politique), voulut bien mettre à ma disposition un volume grand in-8°, lithographié à Bombay, au mois de rébi premier 1267 (janvier 1851),et comprenant les Œuvres complètes de Sadi. J'ai revu ma version sur cette édition et l'ai citée dans mes notes ; toutefois le texte qu'elle présente pour le Gulistan n'est pas toujours correct, et reproduit souvent celui de l'édition de Tabriz. J'ai enfin consulté l'édition partielle de M. Eastwick, dont j'ai dit un mot au commencement de cette préface, et celle qu'a publiée aux Indes un savant orientaliste originaire du Tyrol.
Le texte de cette dernière édition est basé sur un manuscrit appartenant à la Société asiatique du Bengale, et qui fut copié en 1690 pour l'empereur Alemguir (Aurengzeb), sur un exemplaire qui avait été écrit par le célèbre calligraphe Imâd, d'après l'autographe de l'auteur. L'ordre suivi dans l'édition de M. Sprenger diffère en beaucoup d'endroits de celui que donnent les autres textes. C'est ainsi que le long morceau qui, dans ceux-ci et dans notre traduction, termine le septième chapitre, se trouve intercalé par M. Sprenger dans le troisième chapitre, dont il devient la vingtième historiette. La publication de M. Sprenger étant très rare sur le continent européen, de même que la plupart des ouvrages imprimés dans l'Inde, je n'ai pu en avoir connaissance que tout récemment, grâce à l'obligeance de M. Jules Mohl, membre de l'Institut. L'impression de mon travail était déjà parvenue à la page 144 ; je n'ai donc fait usage du texte de M. Sprenger qu'à partir de cet endroit, et je l'ai souvent cité dans mes notes. Mais pour la partie antérieure de ma traduction, je me trouve avoir quelquefois suivi des leçons qui se rencontrent également dans l'édition du savant Allemand, car le texte de celui-ci est souvent le même que celui des éditions de Tabriz et de Bombay, dont je me suis servi dans tout le cours de ma tache.
Le plus souvent j'ai suivi le texte de Sémelet, en le rectifiant ou le complétant à l'aide d'un ou plusieurs des autres textes imprimés et manuscrits dont je viens de parler. J'ai presque toujours eu soin d'indiquer les cas où je faisais quelque changement à la leçon admise par Sémelet, mais j'ai quelquefois omis de le faire, quand il ne s'agissait que de l'addition ou du changement d'un ou deux mots. J'ai cherché à rendre ma version aussi exacte que m'a paru le comporter le génie de notre langue, si différent de celui de la langue persane. J'y ai ajouté de nombreuses notes, historiques, géographiques ou littéraires, dont plus d'une a exigé de longues recherches. Quelquefois j'ai fait usage pour mon commentaire des gloses que m'ont fournies les manuscrits 292 ancien fonds et 593 Saint Germain. Je n'ai pas négligé non plus l'accessoire le plus agréable, selon moi, de toute traduction : je veux parler de ces notes dans lesquelles divers passages de l'auteur que l’on traduit sont rapprochés d'autres passages empruntés aux écrivains de plusieurs autres littératures. Ce travail de comparaison, exécuté avec autant de goût que de succès sur plusieurs classiques grecs, latins ou français, j'ai essayé de l'appliquer au Gulistan. Je n'ai pas la prétention d'avoir épuisé la matière ; c'est surtout lorsqu'il s'agit de rapprochements entre auteurs de diverses littératures, que l'on peut répéter avec notre inimitable fabuliste :
Mais ce champ ne se peut tellement moissonner
Que les derniers venus n'y trouvent à glaner.[25]
J'ai voulu seulement prouver que le Gulistan pouvait devenir l'objet d'un commentaire curieux et varié. C'est à d'autres plus savants à mettre cette vérité dans tout son jour. J'ai encore eu à cœur de démontrer combien était injuste l'arrêt porté si dédaigneusement contre la littérature de la Perse tout entière par un spirituel voyageur, plus familiarisé avec la botanique et la géologie qu'avec la langue persane et ses principaux écrivains, « Je voudrais, dit Victor Jacquemont, avoir le loisir d'apprendre assez le persan pour en faire justice quelque jour, et montrer aux Parisiens combien est puérile la littérature de la Perse; mais j'en sais tout juste assez pour avoir le droit d'avoir une opinion à moi là-dessus, non pour l'imposer aux autres.[26] »
Une littérature qui a produit des ouvrages tels que ceux de Ferdouci, de Sadi, de Hafiz, de Djami, de Houçain Vâïz, de Khondémir, d'Abou'lfazl, ne saurait être qualifiée de puérile que par une personne prévenue, ou tout à fait étrangère à la connaissance des principaux monuments de cette littérature. J'ose donc me flatter que la lecture de la présente traduction du Gulistan, tout imparfaite qu'elle est, pourra contribuer à prouver le peu de fondement de l'opinion de Jacquemont.
[1] Gulistan ou le Parterre de Fleurs, traduit littéralement par M. Sémelet Paris, 1834, p. 27, note.
[2] M. de Sacy, qui a cité ce passage dans ses notes sur le Pend-Nameh (p. 204-206), s'exprime ainsi : « Je pense que cela veut dire : Ne baise pas ton fils en ce moment, de peur que cela ne lui porte malheur. » Je serais plus disposé à croire que le poète a voulu dire que la vue des caresses prodiguées à un fils par son père pourrait rendre l'orphelin plus sensible à sa propre perte, et qu'il faut lui éviter ce surcroît de chagrin.
[3] Cf. Michaud, Histoire des Croisades, 4e édition, t. III, p. 359, sub anno 1203.
[4] Ce morceau, moins les sept derniers vers, a été reproduit avec une traduction par S. de Sacy, Pend-Nameh, p. 185 à 191.
[5] Sad en arabe signifie « bonheur, félicité », et Sadi peut être considéré comme un adjectif relatif dérivé de ce mot.
[6] Littéralement : « à cause des formules : Dieu soit loué et Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. »
[7] Cf. M. Reinaud, Mémoire géographique, historique et scientifique sur l'Inde ; Paris, 1849, in 4°, p. 268, 269.
[8] Nom d'une idole adorée à la Mecque et à Thaïf avant l'islamisme. Notices des manuscrits, t. II, p. 135; Essai sur l’hist. des Arabes, par M. Caussin de Perceval, t. I, p. 269, 272, etc. III, p. 288;
[9] Ferzin, c'est-à-dire, dans le jeu d'échecs européen, la reine.
[10] Héros persan, neveu de Roustem par sa mère. Il devint amoureux de Ményza, fille d'Afracyab, roi du Turkestan. Celui-ci avant découvert l'intrigue, fit arrêter Byjen dans la maison de son amante et l'emprisonna dans un puits, d'où peu de temps après Roustem le retira.
[11] C'est-à-dire, un secret ou une ruse grossière qui se trouve divulguée.
[12] Par hasard, ajoute Louthf-Aly, une taste pleine d'eau se trouvait là. Homâm dit (pour se moquer de la calvitie du cheikh) : « Il est surprenant que la tête des Chiraziens n'ait pas plus de cheveux que le dessous de cette tasse. » — « Il est plus surprenant, répliqua le cheikh, que le podex des Tabriziens soit aussi large que l'ouverture de cette même tasse. »
[13] Ou bien : Homâm est un voile.
[14] Cf. J. Ross, The Gulistan, p. 35-36; sir Gore Ouseley, Biographical notices of the persian poets, p. 16-18.
[15] Cf. Account of the Alesh Kedah, by Hajji Luthf Ali-Beg, of Ispahan, by N. Bland, p. 25 ; et le Journal asiatique, janvier 1843, p. 18.
[16] Tarikhi Firishta, édit. Briggs, Bombay, 1831, in-folio, t. I, p. 137,138 ; Siyer-Almotéakhkhirin ou Biographies des modernes, par Gholâm-Hoçaïn, apud Ross, p. 41, 43.
[17] Cf. le baron d'Ohsson, Hist, des Mongols, IV, 660, et les Voyages d'Ibn-Batoutah, t. III, p..174. — Djami se contente de dire, dans l'article qu'il a consacré à Khosrew de Dihly (ms. 112, f° 213 v°, 214 r°) que d'après un récit, durant sa jeunesse ce poète, mort en l'année 725 (1325), à l'âge de 74 ans, rencontra le cheikh Sadi et qu'il tirait gloire de cette circonstance. Mais Djami n'établit pas le rapprochement que lui prête J. Ross, entre Khosrew et le beau jeune homme que Sadi rencontra à Kachgar, près de 40 ans avant la naissance du poète de Dihly. Ross, p. 19.
[18] Cf. sur ce point The history of the Atabek of Syria and Persia, by... Mirkhond, édit. by W. H. Morley; London, 1848, in-4°.
[19] Voyages d’Ibn-Batoutah, publiés et traduits par C. Defrémery et le Dr B. R. Sanguinetti
[20] « Par les Persans, en général, dit sir W. Ouseley, mais principalement par ceux de Chiraz, Sadi est emphatiquement nommé le Cheikh, son nom étant rarement proféré. D'autres savants toutefois jouissent de ce titre, qui est donné aux chefs de tribus et aux aînés des familles. » Travels in various countries of the East, t. II, p. 10.
[21] L'auteur du Heft-Iklim (Ms. 17 Brueïx, f° 82 r°), dit aussi que Sadi mourut en l'année 690; mais il «joute fautivement, d'après Daulet-Châh (fol. 79 v°), que ce fut du temps de l'Atabek Mohammed, fils de Salgar- Châh.
[22] C’est-à-dire 691 en tenant compte de la valeur numérique de ces trois lettres.
[23] Voyage du Bengal à Chyras, trad. par Langlès, t. I, p. 114-116. Cf. Scott Waring, Voyage de l'Inde à Chyraz, p. 60-61 ; Morier, Second Journey, p. 62, 63 ; et sir W. Ouseley, Travels in various countries of the East, t. II, p. 8, et planche XXV.
[24] Némecdani cho'ara. D'après Daulet-Châh (Ms. 250, fol. 77, v°), ce titre n'a été donné qu'au Divan, ou recueil des poésies, de Sadi.
[25] La Fontaine, Fables, III, 1.
[26] Correspondance, édition de 1841, t. II, p. 303, 304.