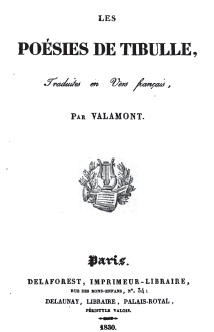
TIBULLE
POESIES
Traduction de VALAMONT.
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
LES
POÉSIES DE TIBULLE,
Traduites en vers français
Par VALAMONT.

Paris.
DELAFOREST, IMPRIMEUR-LIBRAIRE,
RUE DES BONS-ENFANS, N° 54 •
DELAUNAY, LIBRAIRE. PALAIS-ROYAL,
PERISTYLE VALOIS.
Cette traduction des Poésies de Tibulle est le fruit de mes loisirs pendant cinq années. J'ai pris beaucoup de soins pour la rendre le moins imparfaite qu'il m'a été possible, et je demande, en récompense, que la critique daigne, avant de prononcer son arrêt, considérer mon ouvrage avec une attention bienveillante. Au moment où je laisse échapper de mes mains ces feuilles chéries, me serait-il défendu de les recommander avec quelque chaleur à ces hommes dont une sentence peut faire le destin du livre et quelquefois de l'auteur? Il existe d'autres traductions de Tibulle en vers français. Ai-je eu tort de croire qu'il n'en était aucune qui jouît d'une réputation assez éclatante, assez solidement établie, pour interdire aux nouveaux venus jusqu'à l'espérance de faire mieux ?
J'ai travaillé sur l'édition de Heyne (1798), et je dois à ce savant distingué d'avoir souvent mieux compris Tibulle que ne l'ont fait la plupart des traducteurs français, qui n'ont pu profiter de ce secours ou qui l'ont négligé. Scaliger avait étrangement bouleversé le texte, et, toutefois, jusqu'à ces derniers temps, nous avons déféré presque généralement à l'autorité d'un si grand nom. Les personnes qui voudront se convaincre que Scaliger a souvent défiguré Tibulle, devront consulter le travail de Heyne. M. Amar a préféré cette dernière révision dans sa jolie Collection des classiques latins.
Désirant que mon ouvrage se recommandât du moins par la grande pureté du texte, j'ai suivi fidèlement celui de Heyne, en adoptant toutefois les corrections proposées dans l'édition d'Amar, lorsqu'elles m'ont paru nécessaires.
Des occupations d'un genre assez grave sembleraient devoir m'éloigner du commerce des Muses. J'espère cependant que ces distractions de jeunesse ne m'attireront pas le blâme de personnes que je respecte, et qui savent d'ailleurs combien il est de moments dont peut disposer l'homme le plus sérieusement occupé. Le temps, assez long, que j'ai mis à traduire un petit recueil, prouve bien que mes journées n'ont pas été remplies par ce travail d'agrément.
On ne connaît guères Tibulle que par ses ouvrages. Nous écarterons les fables débitées par quelques-uns de ses biographes, et nous nous bornerons à présenter, dans cette notice, les détails qui peuvent mériter l'attention et la confiance du lecteur.
Tibulle a perdu son prénom par la négligence des copistes. Il était de la gens Albia (Albus Tibullus), et chevalier romain. On connaît une autre gens Albia. Elle était patricienne, et donna des consuls à la république; mais elle n'a pas eu l'honneur de produire notre poète. L'auteur de sa vie, tirée des anciens manuscrits, lui donne le titre de chevalier. On ne sait s'il naquit à Rome. On n'est pas non plus d'accord sur l'époque de sa naissance. Cependant cette époque paraît déterminée avec précision, par ces deux vers de l'Élégie V, livre III :
Natalem nostri primum videre parentes,
Cum cecidit fato consul uterque pari.
Je suis né quand Modène, au pied de ses murailles,
A vu de nos consuls, les doubles funérailles.
C'est-à-dire l'an de Rome 711, lorsque Hirtius et Pansa périrent, dans la guerre de la république contre Antoine.
Mais ces deux vers sont suspects, et les critiques pensent qu'ils ont été empruntés, par un copiste, à Ovide, qui dit la même chose de lui.
On a lieu de croire qu'en effet Tibulle était plus âgé qu’Ovide.
Il accompagna Messala dans ses guerres d'Aquitaine, vers l'an de Rome 724, et il mérita les récompenses militaires. N'aurait-il eu alors que treize ou quatorze ans ?
Ovide lui-même dit quelque part de notre poète :
Successor fuit hic tibi, Galle, Properlius illi ;
Quartus ab his serie temporis ipse fui.
« Il a succédé à Gallus; Properce a suivi Tibulle; je suis venu le dernier. »
Le premier livre des Odes d'Horace fut publié l’an 733. Dans une de ces Odes, le favori de Mécènes cherche à consoler Tibulle de ce que Glycère lui préfère un jeune rival. Notre poète approchait donc alors de la maturité.
On pourrait ajouter d'autres preuves, mais cela paraît superflu.[1]
Horace naquit vers l'an de Rome 689, et les critiques rapportent la naissance de Tibulle à l'an 690. Il ne mourut donc pas si jeune qu'on le dit, mais à quarante-cinq ans environ, un peu après Virgile, vers 735. L'épigraphe composée par Domitius Marsus, leur contemporain :
Te quoque Virgilio comitem non aequa, Tibulle,
Mors juvenem campos misit ad Elysios, etc.
« Sur les pas de Virgile, au ténébreux rivage,
» Tibulle est, jeune encore, emporté sans retour; etc. »
Cette épigraphe n'est pas contraire à notre opinion ; le mot juvenis ayant, comme on sait, un sens très étendu.
Tibulle avait été riche, et il devint pauvre. Quelques-uns ont attribué ce malheur à sa prodigalité. En effet, un passage de la quatrième Élégie du livre second, aurait pu faire soupçonner que ses maîtresses l'aidèrent à dissiper sa fortune.
Illius est nobis lege colendus amor.
Quin etiam sedes jubeat si vendere avitas,
Ite sub imperium, sub titulumqne Lares.
Aimons à sa manière, ou ne la servons plus !
C'en est fait ; on l'ordonne : allons mettre à l'enchère
Ma rustique demeure et le champ de mon père.
On a été plus loin. Un commentateur d'Horace s'est attaché à représenter Tibulle comme un débauché, un homme sans règle et sans frein, forcé de vivre à la campagne pour fuir ses créanciers qui le poursuivaient à Rome. Mais ce n'est pas là le portrait que nous en fait le favori de Mécènes. On ne sait trop où ce commentateur téméraire a trouvé de quoi fonder une opinion si défavorable à notre poète. Il l'a confondu avec le personnage dont parle Horace, dans la Satire IV, livre Ier.
Nonne vides Albi ut male vivat filius...
... Magnum documentum ne patriam rem
Perdere quis velit !....
« Vois-tu la triste vie que mène le fils d'Albius? Grande leçon pour les jeunes gens qui seraient tentés de dissiper leur patrimoine ! »
Mais est-il à croire que l'aimable Horace ait employé des expressions si outrageantes à l'égard de ce Tibulle à qui il parle d'un ton si différent dans une épître que nous citerons bientôt?
Il est plus vraisemblable que le malheur des temps causa la perte de sa fortune, et que les vétérans d'Auguste le dépouillèrent, ainsi que d'autres chevaliers romains, dont le crime était de posséder de grandes richesses, et d'avoir tenu le parti de la république. Cette opinion est fondée entre autres sur ce passage du panégyrique de Messala[2] :
Languida non noster peragit labor otia, quamvis
Fortuna, ut mos est illi, me adversa fatiget.
Nam, mihi quum magnis opibus domus alta niteret,
Cui fuerant flavi dilantes ordine sulci
Horrea, fecundas ad deficientia messes,
Cuique pecus denso pascebant agmine colles,
Et domino satis, et nimium furique lupoque ;
Nunc desiderium superest : nam cura novatur,
Quum memor ante actos semper dolor admovet annos.
Sed licet asperiora cadant, spolierque relictis,
Non te deficient nostrae memorare camenae.
« C'est en vain que la fortune ennemie me persécute à sa manière ; le chagrin ne saurait me jeter dans un mol engourdissement. J'ai vu l'abondance régner dans ma maison opulente ; des moissons dorées couvraient mes sillons, et, chacune en son temps, enrichissaient mes greniers qui ne pouvaient suffire à tant de biens. Sur mes coteaux paissaient des troupeaux sans nombre. C'était assez pour le maître, assez pour les loups et les voleurs.
» Aujourd’hui je n'en ai plus que le regret. Il se renouvelle chaque fois qu'un souvenir douloureux me retrace mes premières années. Mais, fussé-je encore plus maltraité, et dépouillé de ce qui me reste, ma muse ne cessera jamais de célébrer tes louanges. »
Ainsi Tibulle aurait été dépouillé de la plus grande partie de ses biens. On fait encore observer, à l'appui de cette opinion, qu'il ne parle jamais d'Auguste dans ses poésies. Quoique ces arguments, tirés du silence d'un auteur, soient en général peu concluants, on a lieu de s'étonner que celui qui célébra Messala avec tant de complaisance, n'ait pas dit un mot du maître des Romains, bien que l'occasion s'en soit présentée plusieurs fois. S'il n'avait pas eu à se plaindre de lui, aurait-il fait une exception si remarquable parmi les poètes de son siècle?
Au reste, sa pauvreté ne fut pas indigence. Il s'estimait pauvre, parce qu'il s'était vu très riche; mais on peut croire, sur la foi d'Horace, que, même après ses malheurs, il jouissait encore d'une honnête aisance. Que dire des personnes qui avancent qu'il écrivait pour vivre? Elles se fondent sur une mauvaise interprétation de ce vers que nous avons cité :
Languida non noster peragit labor otia...
Mais est-il besoin d'en expliquer le véritable sens, pour réfuter une opinion si ridicule ? Il est trop évident que la misère et la faim n'ont pas inspiré l'amant de Délie, et que ce poète si élégant, si soigné, qui a laissé un si mince recueil, n'avait pas mis son Apollon aux gages d'un libraire.
Il sauva plusieurs débris de son patrimoine, entre autres une ferme dans les environs de Pedum. Il aima la campagne, et s'y retira souvent. On peut se convaincre par la lecture de l'épître d'Horace, dont nous avons déjà parlé, que ces retraites n'étaient pas motivées par la nécessité de fuir des créanciers impitoyables. Voici cette épître :
Albi, nostrorum sermonum candide judex,
Quid nunc te dicam facere in regione Pedana ?
Scribere quod Cassi Parmensis opuscula vincat ?
An tacitum silvas inter reptare salubres,
Curantem quidquid dignum sapiente, bonoque est?
Non tu corpus eras sine pectore. Di tibi fermam,
Di tibi divitias dederunt artemque fruendi.
Quid voveat dulci nutricula majus alumno,
Quam sapere et fari possit quae sentiat, et cui
Gratia, fama, valetudo, contingat abunde,
Et mundus victus non deficiente crumena ?
Inter spem, curamque, timores inter et iras,
Omnem crede diem tibi diluxisse supremum :
Grata superveniet quae non sperabitur hora.
Me pinguem et nitidum bene curata cute vises,
Cum ridere voles, Epicuri de grege porcum.
« Critique sincère de ma prose mesurée, cher Tibulle, à quoi vous occupez-vous dans les environs de Pedum ? Faites-vous des vers à l'envi de Cassius de Parme ? Ou bien vous promenez-vous en silence dans les bois y cherchant sous leur ombre salutaire des vérités dignes du sage et de l'homme de bien ? Vous n'êtes point un corps sans âme. Les dieux vous ont donné la beauté, la richesse avec le talent d'en jouir. Que peut souhaiter de plus la tendre nourrice à son élève chéri, que de savoir penser et exprimer ses pensées, et de joindre à ces avantages le crédit, la réputation, la santé, une table honnête entretenue par une fortune aisée ? Au milieu des espérances, des craintes, des inquiétudes et des mécontentements de la vie, regardez chaque jour comme le dernier qui luit pour vous. Celui qui surviendra sans être attendu vous en sera plus agréable. Je vous donne l'exemple : venez chez moi; vous trouverez un homme brillant de santé, prenant grand soin de son existence, enfin, pour peu que vous soyez en humeur de rire, un pourceau de la troupe d'Epicure. »
(Traduction de Binet.)
On a prétendu que cette pièce ne fut pas adressée à notre poète : mais à qui vont mieux ces mots : Nostrorum sermonum candide judex, et ceux-ci : Scribere quod Cassi Parmensis opuscula vincat ? Est-il probable qu'il ait existé, dans le même temps, un autre Albius qui fît aussi des vers ? Ce Cassius de Parme était un poète très fécond et peu estimé. Horace compare plaisamment ses écrits à ceux de Tibulle, qui étaient peu nombreux et très soignés. L'ensemble de la pièce, et surtout ce passage : Quam sapere et fari possit quœ sentiat, achèvent de nous convaincre. Cet heureux don d'exprimer ses sentiments avec éloquence n'appartient à personne mieux qu'à Tibulle.
D'ailleurs Horace s'adresse évidemment à lui, dans l'ode XXXIII du livre Ier.
Albi, ne doteas plus nimio, memor
Immitis Glycerae : neu miserabiles
Décantes elegos ; cur tibi junior
Laesa praenitent fide.
« Albius, ne t'afflige, pas outre mesure, en songeant à la cruelle Glycère, et ne fais pas entendre de lamentables élégies, parce qu'elle est parjure, et te préfère un jeune rival. »
Ici le genre même de la poésie est déterminé. Croira-t-on qu'il ait existé, dans ce temps, deux Albius, qui tous deux duraient composé des élégies ? Horace les appelle lamentables : un enfant d'Épicure pouvait, dans un accès de gaîté, caractériser ainsi les douces plaintes de l'amour malheureux.
L'épître que nous avons citée fut donc adressée à Tibulle.
Ces mots : Di tibi formam dederunt, semblent démentir l'opinion de je ne sais quels commentateurs qui décident ridiculement qu'il était petit, parce qu'il a dit peut-être :
Vel parvum Ætneae corpus committere flammae.
« Je précipiterai mon petit corps dans les flammes de l'Etna. »
Mais si le mot parvum est bien authentique (on en doute), marque-t-il autre chose qu'une opposition entre une chétive créature et le gouffre de l'Etna? Un petit homme peut être venustus, bellus, mais non formosus.
Ce vers : Non tu corpus eras, etc., et les cinq suivants, forment un éloge complet. Tibulle a les qualités solides et les qualités aimables ; une âme élevée, la sagesse, l'éloquence, une manière de vivre élégante et honorable, et enfin, le complément naturel de tous ces dons, une bonne renommée.
Horace le félicite de sa santé florissante ; mais, comme le dit M. Naudet (Voyez la Biographie universelle), « après avoir lu les vers de Tibulle, on croira qu'il ne jouissait pas d'un tempérament vigoureux. Il fut attaqué, à plusieurs reprises, de maladies qui le mirent en péril; la teinte de tristesse qui se mêle toujours à la douceur de ses pensées, ses fréquentes appréhensions d'une mort prochaine, l'idée constante que la femme qu'il aimait lui fermerait les yeux, toutes les habitudes de son esprit décèlent en lui l'influence d'une complexion délicate, et la brièveté de sa vie ne confirma que trop bien ses pressentiments. »
Tibulle nous apprend qu'il était pauvre, et cependant Horace parle de sa richesse, mais il est facile d'expliquer cette contradiction apparente. Le favori de Mécènes était fils d'un affranchi ; il était né assez pauvre, et l'on connaît la modération de ses désirs. Il pouvait trouver Tibulle riche, quoique celui-ci ne se considérât point comme tel, parce qu'il n'avait conservé de ses grands biens qu'une modeste aisance. C’était peut-être une leçon que le poète de Vénouse donnait à son ami, qui, moins philosophe, ne savait pas toujours oublier ce qu'il avait perdu, et jouir paisiblement de ce qui lui restait.
Ces mots: Quid nunc te dicum facere in regione Pedana, déterminent la situation de cette maison, de campagne, dont Tibulle nous occupe souvent dans ses élégies: Elle était aux environs de Pedum, ville des Latins qui avait disparu déjà du temps de Pline, mais que l'on place entre Tibur et Préneste, d'après des conjectures très bien fondées.
Quels peuvent être les plaisirs de notre poète à la campagne ? Horace le cherche au fond des bois, où il médite sans doute sur les grandes vérités de la philosophie. On aime à penser que le tendre Tibulle conserva du moins une retraite, où il pouvait rêver en liberté.
Comme Horace, il n'aimait pas la guerre, et l'a dit plus d'une fois. Cependant il suivit Messala dans les Gaules, et se distingua dans cette expédition. L'auteur de sa vie nous apprend qu'il obtint les récompenses militaires : Militaribus donis ornatus est. Il dit lui-même, à propos de ces guerres d'Aquitaine :
Non sine me est tibi partus honos.
« J'osai m'associer à tes nobles travaux. »
Il voulut suivre Messala en Asie, mais il tomba malade à Corcyre, et s'y arrêta. Ses frères d'armes partirent sans lui.
Ibitis Ægeas sine me, Messala, per undas
O utinam memores ipse cohorsque, met !
Me tenet ignotis aegrum Phaeacia terris.
« Amis, fuyez Corcyre, et courez à la gloire,
» Mais sur les flots d'Egée emportez ma mémoire !
» Ce bord peut-être, hélas ! voit mes derniers moments... »
Messala, le protecteur de Tibulle, descendait du fameux Valérius, qui attacha Messine à Rome, et reçut le surnom de Messina, changé depuis en celui de Messala. C'était une des familles les plus illustres de Rome. Horace, liv. I, satire VI, fait ainsi parler un parvenu :
At Novius collega gradu post me sedet uno :
Namque est ille pater quod erat meus.:..
« Mais Novius, mon collègue, est d'un degré au-dessous de moi, car il est ce qu'était mon père. »
Le poète lui répond :
Hoc tibi Paulus,
Et Messala videris ?
« Crois-tu donc être pour cela un Paul Émile, un Messala? »
Le descendant de Valérius Messina méritait les éloges que lui donna Tibulle. « Il fut décoré le premier du titre de préfet de Rome, afin que la réputation dont il jouissait diminuât ce que ses fonctions avaient d'odieux. Mais ce citoyen distingué ne les exerça que peu de jours, et il déclara en quittant sa place, comme il convenait à l'ami de Brutus, qu'on ne lui ferait jamais accepter une autorité incompatible avec la liberté publique... Le mérite de Messala était encore au-dessus de sa réputation. Dans sa première jeunesse, il fut recommandé par Cicéron à l'amitié de Brutus. Il suivit l'étendard de la république jusqu'à sa destruction aux champs de Philippes. Il accepta ensuite, et mérita la faveur du plus modéré des conquérants, et, dans la cour d'Auguste, il montra toujours la noblesse de son caractère et son amour de la liberté. Son triomphe fut justifié par la conquête de l'Aquitaine. En qualité d'orateur, il disputa la palme de l'éloquence à Cicéron lui-même. Il cultiva les Muses, et fut le protecteur de tous les hommes de génie. Il passait ses soirées à converser philosophiquement avec Horace à table, il se plaçait entre Délie et Tibulle, et il amusait ses loisirs en encourageant les talents poétiques du jeune Ovide. » (Gibbon, édit. de Guizot, tom. III, p. 357.)
Ajoutons à cette notice la réponse que Messala fit à Auguste, étonné de recevoir de lui d'éclatantes marques d'attachement à Actium, après l'avoir vu son ardent ennemi à Philippes. « N'en soyez pas surpris, répondit Messala ; vous m'avez toujours vu dans le meilleur parti. »
Tibulle a chanté trois maîtresses. La plus connue, celle peut-être qui lui a inspiré ses plus belles élégies, est la célèbre Délie, dont le véritable nom était Plautie, suivant les uns, Plancie, Planie ou Fulvie, suivant les autres. Elle était affranchie, comme l'indiquent deux vers, dont quelques traducteurs français n'ont pas saisi le sens. (Voyez liv. I, élégie VI ; Sit modo casta doce, etc.)
Il paraît que Délie n'était pas mariée quand Tibulle composa pour elle ses premières élégies : livre I, élégies I et III. Elle était peut-être la femme d'un autre quand il fit les élégies II, V et VI ; mais la chose est bien loin d'être prouvée.
Il chanta aussi Némésis, qui paraît avoir été de la même condition que Délie. On l'a confondue avec cette Glycère dont parle Horace.
Albi, ne doleas plus nimio, memor
Immitis Glycerœ…. (voyez plus haut.)
Tibulle approchait de l'âge mûr quand il aima cette maîtresse, puisqu'il redoute un jeune rival. Ovide nous apprend, d'un autre côté, que Némésis eut les derniers soupirs de Tibulle. Il est donc permis de croire que Némésis et Glycère sont une seule et même personne : la chose est du moins possible, et cela suffit pour faire excuser la préférence donnée au nom de Glycère dans la traduction.
Tibulle se plaint fréquemment de l'avarice et des infidélités de Némésis. Si l'on en croît son amant, elle eut, en effet, des torts assez graves, et mérita les reproches dont il l'accable souvent.
Le caractère de sa liaison avec Nééra semble un peu différent. Nééra était probablement d'une condition plus relevée que ses autres maîtresses.
Sed culta et duris non habitanda domus.
Et longe ante alias omnes mitissima mater,
Isque pater quo non alter amabilior.
… Tu dois l'existence aux plus aimables nœuds.
Tu naquis sous le toit de parents vertueux.
Leur enfant put sourire, en voyant la lumière.
Au père le plus tendre, à la plus chaste mère.
L'amour de Tibulle pour Nééra a quelque chose de plus décent, de plus délicat. Il la nomme son épouse, et quelquefois sa sœur; mais son vœu le plus cher est de s'appeler un jour son époux.
Cet amour ne fut pas heureux. Nééra fut entraînée loin de Rome, et Tibulle composa, pour se plaindre de cette séparation, deux de ses plus touchantes élégies. Plus tard un songe l'avertit de l'infidélité de son amante ; il ne peut y croire. Enfin, trop certain de son malheur, il le déplore dans une dernière élégie, et cherche vainement à s'étourdir au milieu des plaisirs de la table.
Il a aussi chanté les amours de Marathus et de Pholoé (liv. I, élégie VIII), et ceux de Sulpicie et de Cérinthe (livre II, élégie II; livre IV). Il est difficile de croire que ce fût un simple jeu d'esprit, et que ces amours fussent purement imaginaires. Le ton de Tibulle, dans ces pièces, est aussi naturel que dans celles où il parle pour lui-même. Rien n'est d'ailleurs plus éloigné de la manière des anciens, que ces fictions si familières aux modernes.
Tibulle fut l'ami des plus grands poètes de son temps. Il vante, dans ses écrits, Catulle et Valgius.[3] On a trouvé étrange qu'il n'ait pas fait mention d'Horace, qui deux fois a parlé de lui ; mais nous ne l'accuserons pas pour cela de froideur et d'ingratitude. Virgile, qui chérissait Horace, garde le même silence.
Tibulle mourut à quarante-cinq ans environ. Sa mère et sa sœur lui rendirent les derniers devoirs. Némésis et Délie confondirent leurs larmes sur son bûcher, et son admirateur Ovide déplora sa mort dans une touchante élégie, qui trouve ici sa place naturelle. Elle nous apprend qu'Ovide avait su, comme Horace, apprécier tout le mérite de Tibulle, et qu'il sentait vivement la perte que les Muses latines avaient faite en sa personne.
Si Memnon fut pleuré de sa mère immortelle,
Si les dieux sont émus quand le Styx nous appelle,
Viens, plaintive Elégie, et, les cheveux flottants,
Remplis ton ministère ; oui, pleure; il en est temps.
Ton enfant, ce poète au langage si tendre,
Sur le bûcher fumant n'est déjà plus que cendre.
Vois le fils de Vénus ; vois, son arc est brisé ;
Son flambeau sans éclat, son carquois épuisé.
A la pompe funèbre il vient l'aile baissée ;
Il frappe, en gémissant, sa poitrine oppressée.
Vois ses cheveux épars de ses larmes trempés ;
Entends de ses sanglots les sons entrecoupés.
Tel on le vit sortir du palais de son frère,
Quand la mort, bel Ascagne, enleva votre père.[4]
Vénus même est en pleurs, comme au fatal moment
Où l'affreux sanglier dévora son amant.
Poètes malheureux, et l'on osa nous dire
Qu'un Dieu vit dans nos cœurs, nous aime et nous inspire!
Ah ! la mort sacrilège en frémit de courroux ;
Sa main noire et profane aime à porter ces coups.
Le fils de Calliope,[5] au son de la cithare,
En vain fit tressaillir les rochers de l'Ismare ;
En vain au dieu des vers Linus[6] devait le jour ;
Et Linus et son frère ont passé sans retour.
Et cet Homère enfin, ce fleuve d'harmonie,
Où les enfants du Pinde abreuvent, leur génie,
II est aussi plongé dans la nuit des enfers ;
Mais la mort dévorante a respecté ses vers.
Et l'épouse et l'enfant du courageux Ulysse,
De la toile sans fin le touchant artifice,
Les destins de Priam, sa gloire, ses malheurs,
Dans le livre immortel nous font verser des pleurs.
Tibulle, ainsi vivront, d'une immortelle vie,
Ta première maîtresse et ta dernière amie.
Pourquoi de votre Isis implorer le secours,[7]
Et d'un lit solitaire écarter les amours?
Quand l'innocent succombe, (oserai-je le dire?)
Je ne puis croire aux Dieux ; il faudrait les maudire.
Sois pieux ; rends hommage à ces dieux éternels :
La mort saisit sa proie au pied de leurs autels.
N'attends rien de ta lyre, homme simple et crédule ;
Vois cette urne chétive : elle enferme Tibulle.
Eh quoi ! chantre divin, sans reculer d'horreur,
La flamme impitoyable a dévoré ton cœur ?
Rien ne peut donc braver sa criminelle atteinte ;
Ce feu du Capitole eût embrasé l'enceinte !
La tendre Cythérée a détourné les yeux ;
J'ai vu couler ses pleurs au moment des adieux.
Heureux, heureux du moins que ta froide poussière
N'ait pas trouvé l'oubli sous la rive étrangère.[8]
Une mère adoucit tes suprêmes instants,
Et sa pieuse main ferma tes yeux mourants.
Ta sœur, à ses côtés, tremblante, échevelée,
Répandit les parfums sur ton froid mausolée.
Némésis et Délie ont paru dans ces lieux ;
Et ta bouche glacée a reçu leurs adieux.
Plus heureux avec moi, dit, la triste Délie,
Tant que je lui fus chère il conserva la vie.
Et moi, dit Némésis, j'ai comblé son désir ;
Sa main pressa la mienne, à son dernier soupir.[9]
Si des faibles mortels, après l'heure funeste,
Un songe, un souvenir n'est pas tout ce qui reste,
Dans les champs fortunés Tibulle est descendu.
Venez donc l'accueillir, puisqu'il vous est rendu ;
Viens, Calvus ; viens surtout, jeune amant de Lesbie,
Et toi qui, par tes mains, mis un terme à ta vie,
Viens, sur de faux soupçons si tu fus condamné,
Amant de Lycoris, Gallus infortuné,[10]
De celui qui n'est plus si l'ombre est quelque chose,
Tibulle, en ces beaux lieux que ton ombre repose !
Et que puissent la terre et ton froid monument
Sur ta cendre paisible appuyer doucement !
Au prix de longs travaux que l'amant de Bellone
Achète un beau domaine, un immense trésor !
Sur la rive ennemie, où l'effroi l'environne,
Qu'il s'éveille, avant l'aube, aux sons guerriers du cor!
Je livre aux doux loisirs ma pauvreté chérie,
Près du feu pétillant qui brille à mon foyer ;
Et, comme un villageois, dans la saison fleurie,
Je sais planter la vigne, et greffer le pommier.
Leurs trésors, tous les ans, comblent mon espérance :
Le vin coule à grands flots, et remplit mon cellier.
C'est de ma piété la juste récompense.
Si je vois, sous l'ombrage à nos dieux consacré,
Une pierre, un vieux tronc de festons entouré,
Dans la plaine, à l'écart, je m'incline en silence.
Toujours ma main pieuse à l'autel de Palès
Porte les plus beaux fruits que la saison nous donne,
Et, quand vient la moisson, au temple de Cérès,
D'épis mûrs et de fleurs attache une couronne.
Un Priape rustique habite mon enclos,
Et sa faux menaçante écarte les oiseaux.
Vous, longtemps protecteurs d'un plus vaste héritage,
Dieux Lares, de Tibulle acceptez l'humble don !
Quand ses taureaux sans nombre erraient dans le vallon,
D'une belle génisse il vous faisait hommage.
Pour son bercail modeste et son petit troupeau,
C'est beaucoup aujourd'hui d'immoler un agneau.
La jeunesse alentour célèbre vos louanges.
Bénissez nos moissons ! bénissez nos vendanges !
Je suis pauvre : il suffit ; j'ai su trouver la paix.
Plus de travaux ingrats ; plus de courses lointaines.
J'aime, assis mollement sous un ombrage épais,
A fuir la canicule au bord de nos fontaines.
Quelquefois, sans rougir, armé de l'aiguillon,
Je presse mes taureaux penchés sur le sillon.
Si quelque agneau s'égare, et cherche en vain sa mère,
Je le prends dans mes bras ; je l'emporte au hameau.
Voleurs, loups ravissants, épargnez mon troupeau!
Chez un voisin plus riche allez ouvrir la guerre.
Bienfaisante Palès, nourrice des humains,
Tous les ans d'un lait pur j'arrose votre image.
De la table du pauvre acceptez cet hommage !
A ces vases d'argile épargnez vos dédains !
Le premier laboureur en inventa l'usage ;
L'argile, sans effort, s'arrondit sous ses mains.
Pourquoi de mes aïeux regretter l'opulence,
Et leurs vastes greniers succombant sous le faix,
Si ma moisson chétive est pour moi l'abondance,
Au lit accoutumé si je repose en paix ?
Que j'aime alors, au bruit de l'orage en furie,
A presser sur mon cœur ma maîtresse chérie !
Que j'aime à prolonger mon tranquille sommeil,
Si, mollement couché, j'entends, à mon réveil,
La pluie en murmurant tomber sur le feuillage !
Malheureux nautonnier que poursuit cet orage,
Sois plus riche que moi, tu l'as bien mérité !
Plutôt que mon départ afflige une beauté,
Périssent les trésors de l'Hydaspe sauvage !
Messala, c'est à vous de voler aux combats.
Décorez vos palais des prix de la victoire.
Esclave de l'amour, moi, je m'assieds, sans gloire,
Au seuil de son réduit que l'on ne m'ouvre pas.
Loin de moi les grandeurs, ô ma chère Délie !
Que Tibulle à tes pieds consume un doux loisir,
Et que tout l'univers me dédaigne et m'oublie !
Heureux, si je te vois à mon dernier soupir ;
Si je presse, en mourant, la main de mon amie !
Près du fatal bûcher tu viendras, quelque jour,
Me couvrir de baisers et me baigner de larmes ;
Mais défends à tes mains de profaner tes charmes :
Mon ombre en gémirait au fond du noir séjour.
Oui, tes pleurs, je le sais, couleront sur ma cendre ;
Le ciel d'un triple airain n'a pas armé ton cœur,
Et nos jeunes beautés, qui verront ta douleur,
De pleurer avec toi ne pourront se défendre.
Aimons, soyons heureux, tandis qu'il plaît au sort!
Le front couvert de deuil vois s'avancer la mort.
Quand l'austère vieillesse aura blanchi nos têtes,
Pourrons-nous, sans rougir, soupirer tendrement ?
Cythérée aujourd'hui nous convie à ses fêtes ;
De briser les verrous c'est encor le moment.
Là, je suis un héros... Que le Dieu des batailles.
De l'homme ambitieux presse les funérailles !
Quand j'ai fait la moisson, tranquille, exempt de soin,
Je méprise le faste, et j'échappe au besoin.
Apportez un vin pur ! puisse une heureuse ivresse
Assoupir un moment la douleur qui me presse !
Si je sommeille enfin de pampres couronné,
Laissez avec mes sens mon amour enchaîné.
Je n'ai plus ma Délie. On la veille ; on l'escorte ;
Un surveillant barbare ose fermer sa porte.
Porte jalouse, ô ciel ! puissent les fiers autans,
Puisse un foudre vengeur fracasser tes battants !
Que dis-je ? Ah ! pour moi seul, cessant ta résistance,
Sur l'airain plus docile enfin tourne en silence,
Et de tous les malheurs que j'appelai sur toi,
Daignent les immortels ne menacer que moi !
Mais de fleurs, par mes soins, mille fois couronnée,
Ne laisse pas ma plainte aux vents abandonnée !
Et toi, viens, ma Délie. As-tu peur des Argus?...
Vénus veut du courage ; au sein des nuits, Vénus
Du mortel amoureux est le guide fidèle.
Vénus rend sous ta main le verrou moins rebelle.
Glissant d'un pas léger, la beauté qu'elle instruit
Abandonne sa couche, et s'esquive sans bruit,
Et, souvent d'un jaloux trompant la vigilance,
Donne au geste un langage, une voix au silence.
Mais ce doux artifice et ces secrets charmants,
Vénus en fait mystère aux vulgaires amants
Qui n'oseraient sortir durant la nuit obscure.
Vous qui cherchez dans l'ombre amoureuse aventure,
Venez, ne craignez rien ; confiez, en tous lieux,
Votre tête sacrée à la garde des cieux.
Vénus éloignera les brigands homicides
Qui sur votre manteau portaient leurs mains avides;
En vain les nuits d'hiver m'opposent leurs frimas ;
L'orage, l'aquilon, rien n'arrête mes pas,
Si, m'ouvrant son réduit, mon amante fidèle
Tressaille au bruit léger du signal qui m'appelle.
Passants, éloignez-vous ; et, de grâce, à mes yeux
Ne faites pas briller ces flambeaux odieux.
L'amour veut du mystère ; évitez sa présence,
Et, détournant la tête, avancez en silence.
Ne m'interrogez pas. De vous suis-je connu,
Jurez, par tous les Dieux, que vous n'avez rien vu.
Les mortels indiscrets, qui bravent sa colère,
Sentiront que Vénus naquit dans l'onde amère.
Que dis-je ? nous pouvons mépriser leurs discours,
Car une autre Circé protégé nos amours.
A sa puissante voix, j'ai vu le char de l'Ourse,
J'ai vu le Tibre même arrêté dans sa course,
Et, de son art magique esclaves ténébreux,
Les morts prendre et quitter leurs ossements poudreux.
La terre, au loin s'ouvrant, donnait passage aux ombres;
Les vivants descendaient dans les royaumes sombres ;
A son gré s’apaisait l'orage obéissant,
Et brillaient les frimas sur l'épi jaunissant.
Des poisons de Colchos elle fait seule usage ;
Seule, des chiens d'Hécate elle assoupit la rage.
J'ai reçu d'elle un charme, admirable secours !
Désormais ton vieillard, ignorant nos amours,
Loin qu'un-fidèle avis lui profite et le touche,
N'en croira pas ses yeux, s'il me voit dans ta couche.
Mais fuis tous mes rivaux ; seul, je puis le tromper :
Nul autre à ses regards ne saurait échapper.
Elle voulait encor cette femme insensée
Loin de toi, chère amante, égarer ma pensée.
Déjà sa main, dans l'ombre, allumait le flambeau,
Et la noire victime attendait le couteau.
Qui ? moi, pouvoir te fuir ! moi, quitter ma Délie !
Ah ! faites qu'elle m'aime, et non que je l’oublie !
Vois ce guerrier farouche, et que ne saurait pas
Ton amoureuse étreinte arracher des combats,
Aux peuples de l'Asie il peut donner des chaînes,
Dissiper leur milice et camper dans leurs plaines,
Vêtu de pourpre et d'or, s'avancer radieux,
Et, cavalier superbe, attirer tous les yeux :
Avec toi, ma Délie, oh ! combien je préfère
Disperser mes troupeaux sur un mont solitaire,
Et doucement pressé dans tes bras caressants,
Sommeiller au désert sur les gazons naissants !
Qu'importe un lit de pourpre, arrosé de vos larmes ?
Si l'amour l'abandonne, il est pour moi sans charmes.
Et la plume légère, et les tissus vermeils
Ont-ils donné jamais de paisibles sommeils?
Pourquoi le sort jaloux m'a-t-il ravi Délie ?
Ai-je offensé Vénus par un langage impie ;
Dépouillé ses parvis des festons solennels,
Ou des Dieux tout-puissants profané les autels?
Ah ! je veux, s'il est vrai, de leurs temples antiques,
Humblement prosterné, baiser les saints portiques.
On me verra de pleurs arroser les degrés,
Et, d'un front suppliant, frapper les murs sacrés.
Et toi qui de Vénus méprises la puissance,
Moqueur impitoyable, insulte à ma souffrance !
De nos jeunes Romains tel frondait les amours,
Qui, soignant sa parure à la fin de ses jours,
Et, formant aux soupirs sa voix faible et cassée,
Aux fers de la beauté tendit sa main glacée ;
En plein jour, dans la place, arrêta ses valets,
Et, la nuit, sans rougir implora ses volets.
Les enfants, de leurs cris, l'assaillaient dans la rue ;
Pour détourner l'augure, on fuyait à sa vue.
Mais, si je fus toujours docile à tes leçons,
M'affliger, ô Vénus, c'est brûler tes moissons.
Amis, fuyez Corcyre, et courez à la gloire ;
Mais sur les flots d'Egée emportez ma mémoire.
Ce bord peut-être hélas ! voit mes derniers moments.
O mort, cruelle mort, écoute ma prière !
Épargne-moi les coups de ta faux meurtrière !
Ici ma triste mère, en ses noirs vêtements,
Ne pourrait de son fils recueillir la poussière.
Ma sœur ne viendrait pas la mouiller de ses pleurs,
Ni lui verser des flots de suaves odeurs.
Je n'ai pas ma Délie. Implorant leur clémence,
Aux Dieux, avant ma fuite, elle adressa des vœux ;
Trois fois, de nos devins consultant la science,
Elle en reçut trois fois des présages heureux.
Tous marquaient mon retour ; mais Délie, en alarmes,
Arrêtait sur mes pas ses yeux baignés de larmes.
Moi-même à tous les miens j'avais fait mes adieux,
Et, de prétextes vains colorant ma faiblesse,
Pour calmer sa douleur, je différais sans cesse.
« Un présage funeste avait frappé mes yeux ;
» Je redoutais Saturne et son jour odieux... »
Enfin si je sortais pour ce cruel voyage,
Mon pied savait toujours trébucher au passage.
Le mortel, dont la fuite affligea les Amours,
Jamais à son départ eut-il un Dieu propice ?
De ton Isis, Délie, où sont les vains secours?
Qu'importe sous ta main que l'airain retentisse?
En vain ton chaste corps, d'une eau sainte arrosé,
A goûté le sommeil dans un lit solitaire.....
Et pourtant maint tableau, dans son temple exposé,
Nous annonçait d'Isis le pouvoir salutaire.
Que nos vœux soient comblés, et, deux fois chaque jour,
En longs habits de lin-, ma pieuse maîtresse
Brillera dans la foule aux pieds 8e la déesse
Qui voulut à Délie accorder mon retour.
Ainsi puissé-je enfin, sous le toit de mon père,
Tous les mois, au dieu Lare adresser ma prière !
Que l'on vivait heureux quand les pauvres humains,
Soumis aux douces lois de Saturne et de Rhée,
N'avaient pas sur la terre ouvert de longs chemins,
Ni du premier vaisseau, sur la plaine azurée,
Abandonné la voile au souffle de Borée !
Sous le poids des trésors, l'audacieux marin
Ne faisait pas gémir la fragile nacelle ;
Le taureau, libre encor, levait un front rebelle ;
Le sauvage coursier ne rongeait pas le frein.
La bonne foi régnait ; c'était peine inutile
De borner son enclos, de fermer son asile.
La brebis, d'elle-même, à ces mortels heureux
Sans réclamer leurs soins, présentait sa mamelle,
Et du chêne à longs flots le miel coulait pour eux.
Point de cris ; point de guerre ; une main criminelle
N'avait pas de Bellone osé forger le fer.....
Combien tout est changé sous le roi Jupiter !
Que de nouveaux chemins vers la nuit éternelle !
Grands Dieux, mon cœur est pur; que mes jours soient sauvés !
Vous n'entendiez de moi ni plainte, ni blasphème ;
Mais si déjà je touche à mon heure suprême,
Du moins sur mon tombeau que ces mots soient gravés :
« tibulle, qui longtemps prit des conseils plus sages, »
« Oublia les amours a la voix d'un héros ; »
« Il suivit Messala sur la terre et les flots, »
« Et succomba sur ces rivages. »
Vénus, qui fut toujours l'arbitre de mon sort,
Dans l'aimable Elysée appellera mon ombre.
Là règnent les plaisirs, sans limite et sans nombre.
Mille oiseaux de leurs chants font résonner ce bord.
Les campagnes, au loin fécondes sans culture,
De romarin, de rose enfantent des moissons.
La jeunesse amoureuse engage à l'aventure
Les combats de Cythère, au doux bruit des chansons.
Lieux chéris des amants, retraite fortunée,
Où de myrtes fleuris leur tête est couronnée !
Mais l'horrible Tartare est plongé dans la nuit,
Et du noir Phlégéton le fracas l'environne.
De serpents hérissée apparaît Tisiphone ;
Devant son fouet vengeur tout s'écarte et s'enfuit.
Sur la porte d'airain gronde l'affreux Cerbère.
La roue épouvantable agite incessamment
Du souverain des Dieux le rival adultère.
De noirs vautours Titye éternel aliment,
Gît sur ce bord funeste, et couvre au loin la terre.
Tantale, au sein des flots, les poursuit, mais en vain
Devant sa lèvre ardente ils s'écoulent soudain,
Et du vieux Danaüs la famille coupable
Dans la cuve sans fond les porte avec douleur.
Ah ! fussiez-vous aussi dans ce lieu plein d'horreur,
Vous qui me souhaitiez le malheur qui m'accable !
Mais toi, je t'en supplie, écarte mes rivaux.
Sois fidèle à Tibulle et soumise à ta mère.
Quand le soir fait briller ta lampe ménagère,
Écoute ses récits, en tournant tes fuseaux.
Que, cédant au sommeil, ton esclave attentive
Sur la toile un moment laisse tomber ses mains,
Et, sans être annoncé, chez toi soudain j'arrive ;
Tel un Dieu quelquefois visita les humains.
Toi, viens, comme à mes yeux le hasard te présente,
Pieds nus, échevelée, embrasser ton amant !...
Oh ! puissent les coursiers de l'aurore brillante
Au gré de mes désirs hâter ce doux moment !
« Salut, Dieu des jardins ! puisse un épais feuillage
Eloigner de ton front le soleil et l'orage ;
Mais dis-moi ton secret pour fléchir la beauté !
Certes, un poil assez rude offusque ton visage ;
Les frimas de Borée et les feux de l'été
Sur tes flancs découverts ont marqué leur passage... »
Telle fut ma prière ; et du joyeux Bacchus
Soudain l'enfant rustique agitant sa faucille :
« O mon fils, crains l'Amour ! ses pièges sont tendus.
Vois nos jeunes beautés, sa riante famille !
Comment ne pas aimer? A nos yeux, tour-à-tour,
Il offre un sein d'albâtre, une taille divine,
Les lis d'un front modeste, aussi pur que le jour,
Et la simple bergère, et l'auguste héroïne...
Mais, à ses lois soumis, supporte ses rigueurs.
Tu le verras un jour courber sa tête altière.
Le temps du lion même adoucit les fureurs ;
L'eau tombant goutte à goutte enfin creuse la pierre ;
Un an donne au raisin son coloris vermeil ;
Un an mesure aux cieux le chemin du soleil.
Prodigue les serments ; un parjure frivole,
Comme un souffle rapide, avec l'amour, s'envoie.,
Jupiter l'a permis ; il défend que jamais
On enchaîne un volage aux serments qu'il a faits.
Assuré de ta grâce, atteste donc sans crainte
Et l'auguste Minerve, et la vierge du Cynthe.
Surtout, point de lenteurs, ou tes soins sont perdus.
On ne fait pas renaître un instant qui n'est plus.
Que la plaine a bientôt vu tomber sa parure,
Et le blanc peuplier sa belle chevelure !
Que sous le poids de l'âge il se traîne épuisé
Le coursier dont l'Alphée admira la vitesse !
J'ai vu le paresseux trop tard désabusé,
Et, jeune encor la veille, il pleurait sa jeunesse !
La couleuvre, au marais, sait dépouiller les ans :
Que ne peut la beauté leur échapper comme elle !
Dieu du vin, Dieu du jour, couple aux cheveux flottants,
A vous seuls appartient la jeunesse immortelle.
Toi, de l'objet aimé préviens chaque désir :
Qui jamais ne refuse est assuré de plaire.
On veut faire un voyage ? Allons ! il faut courir.
La soif de Sirius épuise en vain la terre ;
De son écharpe humide enveloppant les cieux,
La jeune messagère annonce en vain l'orage.
Sur la barque fragile on veut fuir le rivage?
Saisis le gouvernail, pilote audacieux ;
Et ne murmure point si le travail peut-être
De ta main délicate effaçait la blancheur.
Va gaîment de filets clore un vallon champêtre,
Et suis ta bien-aimée, intrépide chasseur.
Mais a-t-elle en ses jeux provoqué ton adresse?
Ami, laisse-toi vaincre, et lutte avec douceur.
Ainsi ta complaisance amollit sa rudesse.
Alors, que de baisers un instant défendus,
Puis cédés sans contrainte, et quelquefois rendus,
Et demandés enfin par ta jeune maîtresse !
Mais dans ce siècle avare on avilit l'Amour.
Aujourd'hui, chose infâme, il exige un salaire.
O toi qui, le premier, le rendis mercenaire,
Sois-tu récompensé dans l'infernal séjour !
Aimez les nourrissons des filles de Mémoire ;
Les vers, jeunes beautés, valent mieux qu'un trésor :
Ils ont au vieux Nisus donné son cheveu d'or,
Au roi des Phrygiens son épaule d'ivoire.
Les vers de votre nom feront vivre la gloire,
Tant qu'on verra Zéphyre agiter les ormeaux,
Et la Nuit dans les cieux promener ses flambeaux.
Mais toi dont la richesse a séduit une belle,
Puisse un affreux transport à nos yeux te saisir !
Va subir le destin des prêtres de Cybèle,
Et deviens, pour sa gloire, inhabile au plaisir !
Chez un amant Vénus aime un doux badinage ;
Des soupirs et des pleurs elle aime aussi l'usage. »
Ainsi parla l'oracle. O discours superflus !
Délie à mon rival avait prêté l'oreille.
Mais vous qui d'une belle essuyez les refus,
En vos malheurs du moins que ma voix vous conseille.
Mon logis est ouvert. A chacun son emploi :
Aux amants rebutés, moi, je donne audience.
Respectant quelque jour ma vieille expérience,
Leur cortège attentif me conduira chez moi.
Cependant tu gémis, infortuné Tibulle !
Ton art est en défaut, ta ruse est sans pouvoir...
Délie, épargne-moi ! je serais ridicule,
Si tes rigueurs longtemps déroutaient mon savoir.
J'ai dit en ma fureur : « Oublions la volage ! »
Mais un si noble effort a passé mon courage,
Et la douleur m'emporte, ainsi qu'aux jours d'hiver
Le givre en tourbillons est emporté dans l'air.
Abaisse ma fierté ; punis mon insolence ;
Que ton amant vaincu garde un humble silence ;
Ou plutôt, par Vénus, par notre amour secret,
Par ces tendres appas que pressa mon chevet,
Daigne excuser mon crime ! O maîtresse chérie !
Souviens-toi que mes vœux t'ont rendue à la vie.
Tu cédais aux douleurs, et touchais au tombeau :
Je portai vers ta couche un magique flambeau.
Des songes malheureux détournant le présage,
J'offris aux Dieux l'encens et les gâteaux d'usage,
Et, durant la nuit sombre, en habits solennels,
Neuf fois de Proserpine embrassai les autels.
J'ai tout fait, tout... Un autre a séduit mon amante.
C'est par moi, c'est pour lui que Délie est vivante.
Après sa guérison, j'espérais de beaux jours :
Mais j'espérais, hélas ! sans l'aveu des amours.
Je disais : « Pour me plaire, elle fuira la ville ;
Elle viendra régner sous mon chaume tranquille.
Je mettrai sous sa garde et le froment doré,
De sa frêle enveloppe en ma cour séparé,
Et de nos vendangeurs tes riantes corbeilles,
Dont le fruit sous nos pieds coule en ondes vermeilles.
Assise à mes côtés, elle aime, chaque soir,
A compter le troupeau qui revient au manoir,
Et souvent dans ses bras, maîtresse familière,
Berce un petit esclave, enfant de ma chaumière.
Elle offre aux Dieux des champs pour l'étable un agneau,
Du blé pour les sillons, du vin pour le coteau ;
Et maître et serviteurs, sous ses ordres tout plie :
Je ne suis rien chez moi ; cela plaît à Délie.
Messala quelquefois visite mon enclos.
Au verger, ma maîtresse, en l'honneur du héros,
Choisit les plus doux fruits que la saison voit naître,
Et lui fait les honneurs de ma table champêtre. »
O souhaits enchantés ! ô projets décevants !
Tout fuit, comme un vain songe emporté par les vents.
« Le vin, me disait-on, peut calmer vos alarmes. »
Mais sur mon cœur malade il se changeait en larmes.
J'ai près d'une autre femme invoqué les Amours :
Ton image en ses bras me poursuivait toujours.
Soudain fuyait Vénus ; et, de ma léthargie,
Ma crédule maîtresse accusait la magie.
Hélas ! qu'est-il besoin d'un art mystérieux ?
Pour m'enchanter, Délie, il suffit de tes yeux.
Thétis eut moins d'attraits quand, loin du vieux Nérée,
Un dauphin l'emporta sur la plaine azurée.
Un opulent rival me traverse et me nuit :
Quelque maudite vieille en tes bras le conduit.
Punisses, justes Dieux, cette femme exécrable,
Et de sang et de fiel empoisonnez sa table.
Puisse aux cris du hibou la méchante frémir !
Puisse une ombre autour d'elle incessamment gémir !
Que la faim la dévore, et que sa bouche impure
Aux monstres des forêts dispute leur pâture !
Enfin, de ses clameurs que les chiens irrités,
La poursuivent dans l'ombre au milieu des cités.
Le ciel entend mes vœux. Il est juste ; on m'offense :
Le courroux de Vénus assure ma vengeance.
Mais, toi, de l'avarice oublie enfin la voix :
Une belle à Plutus résista quelquefois.
Viens, un amant plus pauvre est aussi plus fidèle.
Soumis à sa maîtresse, il est toujours près d'elle.
Au milieu de la foule il marche, et, de la main,
Il ouvre à sa compagne un facile chemin.
Il sait, quand vient le soir, détacher ta ceinture,
Et de ton pied charmant délier la chaussure.
Inutiles discours ! je ne puis l'attendrir.
Ah ! frappons la main pleine ; elle viendra m'ouvrir.
Crains d'éprouver mon sort, ô toi qu'on me préfère.
Vois déjà s'envoler la Fortune légère.
Sur le seuil du logis pourquoi cet inconnu
Qui sans cesse en alerte, et tremblant d'être vu,
Passe, et bientôt revient? Il s'arrête ; il regarde ;
Il pousse un faible cri... C est le signal ; prends garde !
Profite bien du temps ; je crains pour tes amours.
Le bon vent sur les flots ne souffle pas toujours.
L'amour souvent me flatte, et sourit pour me plaire ;
Mais, après la victoire, il est triste et sévère.
Ah ! que veux-tu de moi ? Réponds, enfant cruel !
Un Dieu met-il sa gloire à tromper un mortel ?
Mes yeux ont vu le piège ; au sein des nuits, Délie
Dans les bras d'un rival me trahit et m'oublie.
En vain le nierait-elle ; hélas ! à son époux
Elle a nié cent fois nos secrets rendez-vous.
Malheureux ! c'est de moi qu'elle apprit à me nuire.
A tromper tous les yeux j'ai su trop bien l'instruire ;
Lui dire à son amant comme on ouvrait sans bruit ;
Comme, en feignant un mal, seule on passait la nuit ;
De quel simple, aux vallons, la vertu prompte et sûre
Peut d'un baiser de flamme effacer la blessure !
Possesseur imprudent d'une beauté sans foi,
Reprends-moi ses faveurs, si du moins c'est pour loi
Qu'elle échappe à l'encens d'une foule idolâtre :
De ses plus doux attraits dérobe mieux l'albâtre.
Observe en nos festins ses moindres mouvements,
Quand son doigt, sur la table, à ses jeunes amants
Dans la liqueur dorée exprime sa tendresse.
Même au pied des autels de la bonne Déesse,
A notre sexe en vain ce temple est défendu
Crains qu'un audacieux ne tente sa vertu !...
Mais parle, et, de ses pas observateur fidèle,
Dans ces lieux redoutés j'irai veiller sur elle.
Cher ami, plains mon sort, si j'ai pu te trahir.
Amour le commandait : il fallut obéir.
La nuit, c'était mot seul, je ne veux plus m'en taire,
Qui de ton chien fidèle excitais la colère.
Souvent, pour t'assoupir, convive un peu malin,
Je buvais une eau pure, et te versais du vin,
Ou, feignant d'admirer la bague éblouissante,
Je pressais dans la mienne une main caressante.
Qu'importe, homme imprudent, ce vain titre, d'époux?
L'Amour chez toi se glisse en dépit des verrous,
Et, du lit nuptial, ta compagne infidèle,
Feignant un mal soudain, vole où son cœur l'appelle.
A mes soins vigilants livre un si doux trésor,
Et charge-moi de fers s'il nous échappe encor !
Jeune homme aux cheveux blonds, à la toge flottante,
Nous saurons à vos yeux dérober votre amante.
Voulez-vous échapper à mes soupçons jaloux ?
Fuyez à son approche, ou passez loin de nous.
Le ciel ainsi l'ordonne ; une auguste prêtresse
Ainsi des immortels fait parler la sagesse.
Sitôt que dans son cœur a pénétré le Dieu,
Rien ne la fait trembler ; ni le fer, ni le feu.
On la voit du couteau se frapper éperdue,
Et son sang de Bellone a baigné la statue.
Sa poitrine, ses flancs de coups sont déchirés,
Et sa fureur s'exhale en ces mots inspirés :
« Respecte la beauté qu'Amour tient sous son aile,
Ou, comme en ces parvis mon sang à flots ruisselle,
Comme on voit des autels la cendre au loin voler,
De tes avides mains tes biens vont s'écouler. »
A ces mots, la prêtresse a menacé Délie.
Ah ! si tu dois faillir, que sa fureur t'oublie !
Je l'implore pour toi. Tu l'as peu mérité ;
Mais comment de ta mère oublier la bonté ?
De nos amours ta mère autrefois confident,
A souvent dans ma main placé ta main tremblante
Et, du seuil de la porte où m'attirait la nuit,
De mes pas dans la rue a reconnu le bruit.
Bonne vieille, ah ! poursuis d'heureuses destinées !
Que ne puis-je avec toi partager mes années !
Je t'aime, et, grâce a toi, j'aime encor ton enfant.
De mon juste courroux ce titre la défend.
Mais qu'elle soit plus sage, et que, simple affranchie,
D'une austère matrone elle ait la modestie !
Et fussé-je puni, si ma voix désormais
D'une beauté nouvelle ose vanter les traits !
Oui, je n'attendrais point de pitié pour mon crime,
Et tu pourrais, Délie, immoler ta victime,
Sans que ma main cruelle, outrageant tes appas,
Voulût, d'un seul instant, différer mon trépas.
Mais à Tibulle absent qu'une ardeur mutuelle
Garde à jamais ton cœur sans contrainte fidèle !
Malheur à la parjure!... En ses vieux jours, la faim
Souvent met le fuseau dans sa tremblante main,
Et souvent, pour autrui, l'espoir d'un vil salaire
Fait courir sous ses doigts la navette légère.
La folâtre jeunesse insulte à ses travaux,
Et dit : « Une infidèle a mérité ces maux ! »
Vénus, qui voit ses pleurs, et des cieux la contemple,
Par elle aux cœurs sans foi donne un terrible exemple.
Ah ! plutôt, ma Délie, à notre dernier jour,
Puissions-nous être encore un exemple d'amour !
Oui, la Parque autrefois a prédit ta naissance ;
Et l'immortel fuseau nous devait ce beau jour,
Illustre Messala, toi de qui la vaillance
A soumis l'Aquitaine et fait trembler l'Adour.
Rome, un nouveau triomphe a rehaussé ta gloire.
Les rois, chargés de fers, ont paru devant toi.
Le héros, dont la main les rangea sous ta loi,
Les suivait couronné, sur son char de victoire.
J'osai m'associer à ses nobles travaux.
Vous en fûtes témoins, vous, superbes montagnes,
Et vous, fleuves gaulois, dont les fertiles eaux
Du peuple aux cheveux blonds arrosent les campagnes.
Cydnus, M dirai-je encor tes flots silencieux
Qui lentement des mers vont chercher les rivages ?
Dirai-je le Taurus qui, dans ces lieux sauvages,
Porte avec ses frimas sa tête dans les cieux ;
Les rives de Sidon, populeuse contrée,
Où vole sans péril la colombe sacrée ;
Et toi, superbe Tyr, dont les vastes créneaux
Ont vu loin de tes ports fuir les premiers vaisseaux ?
Dirai-je enfin du Nil la source plus féconde
Quand le sol altéré s'ouvre aux feux du Cancer?
En des lieux inconnus, pourquoi, fleuve sans pair,
Nous cacher ta naissance et ton urne profonde ?
L'Egypte, grâce à toi, pour se» gazons flétris
Jamais ne supplia le maître des orages ;
Près du taureau divin, tu reçois les hommages
De ce peuple fameux que protège Osiris.
Osiris !... Dieu puissant, quelle gloire t'est due !
Ton génie autrefois inventa la charrue.
Tu soulevas la glèbe, et ta divine main
Dans les premiers sillons sema le premier grain.
Alors de fruits plus doux l'homme sut faire usage.
Osiris à la vigne ajouta des appuis,
Et la serpe tranchante émonda son feuillage ;
Le premier, dans la cuve il foula ses doux fruits ;
Le premier, fit l'essai du séduisant breuvage.
Le vin, d'un luth grossier tirant de joyeux sons,
Anima la jeunesse à danser aux chansons,
Et, du vieux laboureur consolant la misère,
Aux soucis dévorants il ferma sa chaumière.
Grâce à toi, Dieu du vin, bienfaisant Osiris,
Un esclave affligé dort au bruit de sa chaîne.
Osiris n'aime point la tristesse et la peine,
Mais les chansons d'Euterpe et les jeux de Cypris,
Les roses dont ses mains ont couronné nos têtes,
La pourpre radieuse et flottante à longs plis,
Les doux sons de la flûte et l'appareil des fêtes,
Et de son culte enfin les mystères chéris.
Du vaillant Messala célébrons le génie.
Viens, suivi des plaisirs, de nectar enivré !
Que tes cheveux flottants exhalent l'ambroisie,
Et de pampres fleuris que ton front soit paré.
Viens, sur l'autel fumant pour toi j'ai préparé
Les trésors de l'Hymette et l'encens d'Arabie.
Et puissent, Messala, de nombreux descendants
Ajouter à ta gloire, entourer ta vieillesse !
D'Albe et de Tusculum entends-tu la jeunesse
De tes heureux travaux bénir les monuments?
Sur le nouveau chemin qu'un pavé magnifique,
Par tes soins généreux, recouvrit à grands frais,
D'un pas plus assuré gagnant leur toit rustique,
Les laboureurs, le soir, chanteront tes bienfaits.
Dieu natal d'un héros, à ma voix qui t'implore,
Reviens toujours brillant, souvent reviens encore !
Oui, je sais de l'amour pénétrer les mystères,
Son doux chuchotement, ses œillades légères.
Je n'ai point consulté sur des secrets si beaux,
La fibre prophétique ou le chant des oiseaux ;
Je les dois à Vénus. Un fatal esclavage
M'a vendu chèrement cet unique avantage.
Pourquoi dissimuler? Amour est dans ton cœur ;
Eh ! que veux-tu prétendre à braver ton vainqueur !
Hélas ! pauvre insensé, pour fléchir ton amante,
Que fait ta chevelure au gré du vent flottante ;
Ce brillant coloris où l'art trompe les yeux ;
De ces ongles polis les contours gracieux?...
En vain chaque moment voit changer ta parure,
Et le désir de plaire étrécit ta chaussure ;
A soigner ses cheveux sans consumer le jour,
Lesbie, à moins de frais, t'inspire plus d'amour.
Sur toi quelque sorcière aurait-elle, en silence,
De ses poisons, dans l'ombre, essayé la puissance ?
La magie, à son gré, transplante les moissons ;
Arrête des serpents les élans vagabonds
Même à sa voix pâlit la nocturne courrière,
Si l'airain résonnant ne lui rend sa lumière.
Mais laissons la magie et ses philtres vainqueurs.
Ah ! la beauté sans elle amollit bien les cœurs.
Les plaisirs qu'à tes sens prodigua ta maîtresse,
Ses longs embrassements ont causé ton ivresse.
Reviens à lui, Lesbie, et ne résiste plus.
Grains d'attirer sur toi le courroux de Vénus.
Si tu veux des présents, d'un vieillard en démence
Ne souffre qu'à ce prix l'importune présence.
Mais à ces vains trésors préfère un jeune époux
Dont le naissant duvet rend les baisers plus doux.
Reçois-le dans tes bras, dans les siens qu'il te presse,
Et des rois malheureux méprisez la richesse.
Vénus d'un voile épais couvrira vos plaisirs.
Ton amant sur ta bouche allumant ses désirs,
Cueillera cent baisers, dans sa fougueuse étreinte,
Et sur ton cou d'ivoire en laissera l'empreinte.
La nuit, lorsqu'on est seule à pleurer ses beaux jours,
L'or ne console point du mépris des Amours.
On veut les rappeler, mais inutile peine !
De sa tresse ondoyante on voit blanchir l'ébène ;
Et, pour cacher des ans le cours profanateur,
On rend à ses cheveux leur première couleur,
Ou même à les détruire on s'occupe sans cesse ;
On prête à son visage un éclat de jeunesse...
Des fleurs de ton printemps hâte-toi de jouir !
Un jour les vit «clore, un jour les voit périr.
Pour tes vieux courtisans sois, si tu veux, sévère.
A cet enfant si tendre épargne ta colère.
De son teint languissant, que flétrit la douleur,
L'amour, le seul amour a causé la pâleur.
Absent, que de soupirs l'infortuné t'adresse !
Il dit, baigné de pleurs : « Pourquoi me fuir sans cesse?
Tu pouvais aux jaloux te soustraire un moment.
Ah ! lorsqu'on le veut bien, on les trompe aisément.
Aux larcins amoureux Vénus daigna m'instruire.
La nuit, sans bruit j'avance, et sans bruit je respire ;
Et, forçant les verrous qu'on voudrait m'opposer,
Sans bruit, près d'un rival, je savoure un baiser.
Mais qu'importe à Lesbie ? Est-il rien qui la touche ?
Pour me fuir, la cruelle a déserté sa couche,
Et souvent, sur la foi d'un serment imposteur,
M'a laissé de la nuit mesurer la lenteur.
Un fol espoir, dans l'ombre, abusant ma tendresse,
Tout me semblait alors la voix de ma maîtresse. »
Ami, plus de sanglots ! tu ne peux la fléchir.
Tes yeux chargés de pleurs sont lassés de s'ouvrir.
Lesbie, ah ! crains les Dieux ; de la beauté trop fière
Ils n'accueillent jamais l'encens et la prière.
Ton amant, comme toi, fut barbare et trompeur,
Mais, du ciel, sur sa trace accourait un vengeur...
Il se plaisait naguère à voir couler les larmes ;
A tromper les désirs, à nourrir les alarmes :
Combien il est changé ! Plus docile et plus doux,
Il abhorre aujourd'hui les dédains, les verrous...
Sur toi même destin doit venger même outrage,
Et tu diras un jour : « Que n'ai-je été plus sage ! »
Si tu voulais, Délie, abuser les Amours,
Fallait-il des serments emprunter le secours?
Ne le savais-tu pas? Du plus secret parjure,
Tardive quelquefois, la peine est toujours sûre.
Pardonnez-lui, grands Dieux ! qu'un seul jour, la beauté
Ait offensé vos lois avec impunité !
L'argent loin du rivage emporte la nacelle
Que sur les flots trompeurs guide un astre fidèle.
L'argent sous l'aiguillon fait gémir les taureaux,
Et du colon robuste il soutient les travaux :
Ah ! qu'il soit dissipé comme cendre légère !
C'est par lui qu'un rival a fléchi ta colère.
Tu fuis ! tes beaux cheveux par les vents hérissés,
Tes appas séducteurs sons la poudre effacés,
Des feux brûlants du jour osent braver l'outrage,
Et tes pieds délicats sont meurtris du voyage!...
Je te disais souvent : « Ce métal souhaité,
Cet or, de la plus belle il flétrit la beauté.
Qui trahit ses serments séduit par l'avarice,
Malheureux désormais, n'a plus Vénus propice.
Ah ! sois plutôt barbare, et, bravant les remords,
A Tibulle innocent fais souffrir mille morts.
Ne crois pas m'abuser, si tu m'es infidèle.
Ennemi de la ruse, un Dieu nous la révèle,
Et, d'une vieille esclave échauffant le caquet,
Souvent dicte à l'ivresse un propos indiscret,
Ou contraint, si telle est sa volonté suprême,
Le méchant qui sommeille à s'accuser lui-même. »
Ainsi, baigné de pleurs, je pensais la fléchir ;
Je tombais à ses pieds. Que je dois en rougir !
« Jamais, me disait-elle, oubliant ses promesses,
Délie au poids de l'or ne vendra ses caresses ;
Et ne voudra jamais posséder à ce prix
Les coteaux de Falerne ou les champs du Liris. »
Avec ce doux langage, ah ! tu m'aurais fait croire
Que l'éclair était sombre, et que l'aube était noire.
Tu pleurais même ; hélas ! dans ma simplicité,
J'essuyais de ces pleurs ton visage humecté...
Et, malgré tant d'amour, un autre a su te plaire !
Qu'il devienne inconstant comme tu fus légère !
Va, jamais ce barbare, enchaîné sous ta loi,
Ne sera plus soumis, ni plus tendre que moi.
J'ai pu me croire aimé ! Déplorable folie !
Il fallait craindre un piège, et soupçonner Délie.
Pour vanter ses appas, je chantais éperdu :
Ridicules transports ! suis-je assez confondu ?
Témoins d'un fol amour, périssez, vers infâmes,
Engloutis dans les flots, dévorés par les flammes !
Et toi, beauté vénale, objet de mon dédain,
Puisque tu veux de l'or, qu'il pleuve dans ta main !
Mais de ton séducteur que l'épouse adultère
Nourrisse impunément une flamme étrangère !
Et de Vénus furtive épuisant les faveurs,
Qu'elle oppose à l'hymen d'insolentes rigueurs !
Que nul ne frappe en vain à sa porte banale !
Qu'elle ose profaner la couche nuptiale !
Que la sœur du perfide à ses amants vaincus
Dispute sans rougir les palmes de Bacchus !
En ces nobles travaux la vigilante aurore,
Une coupe à la main, dit-on, la trouve encore.
Qui sait mieux de la nuit varier les plaisirs,
Et d'un cœur languissant réveiller les désirs?...
O vieillard insensé, ton épouse elle-même
D'un mortel plus aimable apprend cet art suprême.
Est-ce pour te charmer, toi, difforme et goutteux,
Qu'elle a passé l'ivoire en ses brillants cheveux ;
Avec tant d'artifice élevé sa coiffure,
Ou d'un tissu de pourpre essayé la parure?
C'est pour un jeune amant qu'on prend des soins si doux.
Pour lui sont prodigués les trésors de l'époux.
Faut-il s'en étonner ? elle est jeune ; elle est belle :
L'amour de son vieillard est un fléau pour elle.
Et voilà mon rival ! s'il a pu te fléchir,
A l'ours, au léopard la brebis peut s'unir.
Lui vendre mes baisers ! lui livrer mes délices !
Oh ! que tu vas un jour déplorer tes caprices !
Ce cœur, où tu régnais, sous d'autres lois rangé,
Bientôt par tes malheurs des siens sera vengé.
Sur un bouclier d'or, monument de ma gloire,
Je grave alors ces mots qui seront mon histoire :
« Tibulle échappe sans retour
Aux fers d’une beauté volage.
Vénus, accepte mon hommage ;
Tu m’as guéri d’un fol amour !»
Il eut un cœur de fer l'homme impie et sauvage
Qui forgea le premier les glaives inhumaine.
Alors, chez nos aïeux commença le carnage.
On courut à la mort par de plus prompts chemins.
Que dis-je?... Nos malheurs ne sont point son ouvrage.
Seuls, à nous égorger, nous employons les traits
Que destinait son bras aux monstres des forêts.
L'or a semé la guerre. Autrefois l'humble argile
Aux tranquilles humains versait le jus vermeil.
Point de camp, point de siège, et le berger tranquille
Au milieu du troupeau se livrait au sommeil.
Que n'ai-je alors vécu ? Le bruit de la fanfare,
Comme en ces temps affreux, n'eût pas glacé mon sang.
On m'entraîne aux combats, et peut-être un barbare
Porte en sa main le trait qui doit percer mon flanc.
Dieux Lares, sauvez-moi, vous qui m'avez vu naître !
De mes jeux enfantins témoins accoutumés,
Vous avez de mon père aimé le toit champêtre,
Aimez le simple bois dont il vous a formés..
Quand l'homme à tous ses vœux trouvait le ciel propice,
Les Dieux étaient de bois, leurs autels de gazon.
Du villageois pieux le plus beau sacrifice
Était les fruits, les fleurs que donnait la saison.
Ses enfants, près de lui, couronnés de feuillage
Offraient à Jupiter du miel et du laitage.
Dieux puissants, que Tibulle échappe au coup mortel,
Pour vous, dans son bercail, une victime est prête.
Ah ! puissé-je bientôt de fleurs parer sa tête,
Et, couronné de fleurs, la conduire à l'autel !
Qu'un autre à sa valeur enchaîne la victoire !
Peut-être en ma chaumière il viendra, quelque jour,
Enivré de mon vin, me raconter sa gloire,
Et d'un camp, sur ma table, esquisser le contour.
Vous provoquez la mort, insensés que vous êtes !
La mort sans bruit s'approche, et menace vos têtes;
Près du fleuve infernal, séjour du vieux nocher,
Point de pampres fleuris, ni de moisson dorée.
De simulacres vains, restes du noir bûcher,
Là, voltige dans l'ombre une foule éplorée.
Plus heureux, près des siens qui peut, dans son manoir,
Du repos des vieux ans savourer les délices !
Il conduit les taureaux et son fils les génisses ;
Sa femme, auprès du feu, veille au repas du soir.
Ah ! puissé-je, à mon tour, voir ma tête blanchie,
Et de mes vieux récits occuper le hameau !
Que la paix cependant règne dans la prairie !
La paix au laboureur a soumis le taureau.
Elle a planté la vigne ; ainsi, dans la chaumière,
Le fils boit le doux jus que recueillit son père.
La faucille à la Paix doit un éclat nouveau,
Et la lance, à l'écart, de rouille est dévouée.
Le pasteur, aux bons jours, plein du joyeux nectar,
Chante avec ses enfants, qu'il ramène en son char,
Quand la fête a cessé dans la forêt sacrée.
Alors chez les amants renaissent les combats.
Souvent à sa maîtresse on prodigue l'outrage ;
On brise ses verrous, on meurtrit ses appas,
Et d'une erreur funeste on déplore l'ouvrage.
Mais le fils de Vénus applaudit à ces jeux.
Le perfide, lui-même échauffant la querelle,
Vient brouiller les amants, et rit assis entre eux.
Ah ! celui qui jamais put frapper une belle
Est un lâche, un barbare, un sacrilège affreux.
Et ne suffit-il pas, dans un transport extrême,
D'arracher sa guirlande ou son voile amoureux ;
De voir couler ses pleurs? Heureux, trois fois heureux
Qui voit de son courroux pleurer celle qu'il aime !
Mais frapper sa maîtresse ! ah ! qui fut si cruel
Ne peut plaire à Vénus, et doit suivre Bellone !
O Paix, viens cependant, de ton sein maternel,
Epancher dans ces lieux les trésors de l'Automne !
Pasteurs, faites silence ! aux déités champêtres
Nous adressons nos vœux, comme ont fait nos ancêtres.
Viens couronné de pampre, aimable Dieu du vin.
Viens, Cérès ; d'épis murs orne ton front divin !
Qu'en ce jour solennel, oisive et solitaire,
La pesante charrue épargne enfin la terre.
Laissons, il en est temps, libre et pare de fleurs,
Le bœuf devant la crèche oublier ses labeurs.
Soyons tous à Cérès ; en l'honneur de la fête,
Que le fuseau léger, que l'aiguille s'arrête !
Loin de nous l'homme impur qui, la veille, en secret
A l'enfant de Cythère a livré son chevet.
Mais vous, troupe innocente, ici venez parée,
Et, de vos chastes mains, puisez l'onde sacrée.
Le front ceint de feuillage, en habit solennel,
Escortez l'humble agneau qui s'avance à l'autel.
Dieux, pour nous, pour nos champs, recevez ces hommages !
Eloignez les fléaux de nos gras pâturages !
Ne laissez pas mûrir, dans les sillons nouveaux,
Une moisson trompeuse et de vains chalumeaux !
Loin des loups ravissants que la brebis sommeille !
Ainsi, l'heureux colon, dont l'espoir se réveille,
Assuré des trésors que promet la saison,
Viendra parer de fleurs les autels de gazon.
Un essaim de valets, que sa maison vit naître,
Révèle à tous les yeux la richesse du maître, P
Et, près des feux sacrés, sous un ombrage épais,
Fait gaîment du repas les rustiques apprêts.
Nos vœux sont exaucés ; les flancs de la génisse
Ont annoncé des Dieux la volonté propice.
Versez, versez, amis, ce Chio renommé,
Vieilli, sous vingt consuls, dans l'argile enfumé !
Buvons ! un jour de fête, on pardonne sans peine
Au buveur qui chancelle égaré dans la plaine.
Buvons ! mais, tous ensemble, au milieu du festin,
Pour le héros que j'aime implorons le destin.
Et toi, dont l'Aquitaine a pleuré la victoire,
Toi, d'illustres aïeux rejeton plein de gloire,
Viens, Messala, préside à nos hymnes pieux !
Des bergers et des champs nous bénissons les Dieux.
Célestes bienfaiteurs, par vous, la race humaine
Qui pâturait jadis sous l'ombrage du chêne,
Assemblant avec art les premiers soliveaux,
Couvrit un humble toit de légers chalumeaux ;
Fit rouler la charrette, et, loin du bois sauvage,
Au bœuf, longtemps rebelle, enseigna l'esclavage.
Le pommier, plus fertile, eut des fruits savoureux.
Le verger du ruisseau but les flots amoureux.
Aux moissons, tous les ans, la plaine sans murmure
Vit tomber sous le fer sa blonde chevelure.
Le pressoir fit jaillir une heureuse liqueur,
Et la boisson du sage en tempéra l'ardeur.
Pour nous l'abeille, enfin, diligente ouvrière,
Leva son doux tribut sur la fleur printanière.
Le pâtre, aux jours sacrés, las du travail des champs,
A ses pas en cadence unit de joyeux chants,
Et, couronnant de fleurs les autels domestiques,
Anima sous ses doigts les chalumeaux rustiques.
La face enluminée, au père des buveurs
Il conduisit sans art de grotesques chanteurs ;
Le hameau de ces jeux applaudit la naissance ;
Un bouc, digne salaire, en fut la récompense.
Aux champs, de mille fleurs on voit l'enfant pieux
Former pour les autels un feston gracieux.
Des agneaux, près de lui bondissant dans la plaine,
Déjà l'humble bergère attend la blanche laine.
Leur toison, quelque jour tombant sous les ciseaux,
Ira de la fileuse entourer les fuseaux,
Et réveiller, le soir, de sa mère attentive,
Et l'agile navette, et la chanson naïve.
Les champs même autrefois ont vu naître l'Amour.
Au milieu des troupeaux il a reçu le jour.
Sur l'ardente cavale et la fière génisse,
Longtemps il éprouva son bras encor novice ;
Aujourd'hui, plus habile, au lieu des vils taureaux
Il frappe les bergers et souvent les héros ;
Dissipe nos trésors, et du vieillard crédule
Se plait même à tirer un aveu ridicule.
La beauté qu'il égare, aux heures du sommeil,
A ses gardes gisants dérobe son réveil ;
Des mains cherchant sa route, appuie un pied timide,
Et, seule au sein des nuits, vole où son cœur la guide.
Amour, daigne au banquet te placer avec nous.
Viens, mais viens innocent; viens, favorable et doux !
Malheur à qui ce Dieu lancé un regard sévère !
Heureux qui le désarme et fléchit sa colère !
Pour vous, pour vos troupeaux implorez, sa faveur.
Pour eux à haute voix ; pour vous priez du cœur.
Mais que dis-je? Au milieu des cors de Bérécynthe,
Nul ne peut vous entendre ; implores-le sans crainte.
Hâtez-vous ! la Nuit vient ; son char silencieux
Déjà traîne après lui l'essaim brillant des cieux.
Déjà le noir sommeil étend son aile obscure,
Et les songes menteurs ont peuplé la nature.
Prononce, il en est temps, les paroles propices,
Voici ton jour natal ; c'est l'instant solennel
Où le Dieu tutélaire attend des sacrifices,
Et veut qu'un pur encens brûle sur son autel.
Il vient, il vient lui-même accueillir ton offrande ;
Il exhale en ces lieux tous les parfums du ciel.
Le vois-tu, couronné d'une fraîche guirlande,
Effleurer ce laitage et ces gâteaux de miel ?
A ton humble prière il daignera sourire ;
Oui, fais des vœux, ami ; parle, ils seront comblés.
Mais j'entends ; et les Dieux dans ton cœur ont su lire.
De fidèles amours ! voilà ce qu'il désire ;
Non les brillants trésors près du Gange étalés,
Beaux lieux où le soleil fait rougir l'onde amère ;
Non les champs de Sicile, où cent bœufs accouplés
S'épuisent dès l'aurore à déchirer la terre.
Tes vœux sont exaucés ; vois-tu le Dieu d'amour
Précipiter son vol sous la voûte azurée ?
Il porte à Sulpicie une chaîne dorée
Qui doit aux coups du temps résister plus d'un jour.
Féconde leurs baisers, enfant de Cythérée,
Et de leurs nourrissons daigne peupler ta cour !
Glycère est loin de moi ; Glycère est au village.
Oh ! que Rome est sans elle un lieu triste et sauvage !
Vénus chez les pasteurs a rassemblé sa cour ;
Au langage rustique elle a formé l'Amour.
Armé d'un fer pesant, sous les yeux de Glycère,
Ami, de quelle ardeur j'irais ouvrir la terre,
Et, dans le champ fertile où doit mûrir le blé,
Presser les pas tardifs du taureau mutilé !
Je n'aurais point regret à voir, dans la prairie,
Ma main, après l'ouvrage, et brûlée et meurtrie.
Malgré ses cheveux d'or et son luth enchanteur,
Le beau Phébus lui-même un jour devint pasteur.
Des simples vainement il connut la puissance ;
Que fit contre l'Amour sa frivole science ?
Il tressa de l'osier les flexibles rameaux,
Et filtra, dans l'osier, le lait de ses troupeaux.
Que de fois même, assis au bord des précipices,
Il suspendit ses chants que troublaient ses génisses,
Ou, caressant l'agneau qu'il emportait le soir,
Il rencontra Phébc, qui rougit de le voir !
Alors de son trépied les oracles cessèrent ;
De ses temples muets les humains s'éloignèrent.
Que sont-ils devenus ces longs cheveux dorés
De sa marâtre même autrefois admirés ?
A ce front sans honneur, et souillé de poussière,
Qui ne méconnaîtrait le Dieu de la lumière ?
Sous le chaume rustique enchaîné par l'amour,
Il oublie et Délos, et le Pinde, et sa cour.
On en rit dans le ciel ; mais Vénus le seconds :
C'est un destin plus doux que d'éclairer le monde.
Dans le sublime Olympe on était plus heureux,
Quand les Dieux sans rougir osaient être amoureux.
Loin de moi cependant si tu retiens ma belle,
Que la terre, ô Cérès, à tes vœux soit rebelle !
Et puisse, ô Dieu du vin, ta charmante liqueur
Tarir dans les pressoirs du triste vendangeur !
Vos faveurs ont leur prix ; mais le ciel, toujours sage,
Ne fit point la beauté pour languir au village.
Rendez-moi ma maîtresse, et gardez vos bienfaits.
Nous avons l'eau du fleuve et le gland des forêts ;
Ce breuvage et ces fruits suffisaient à nos pères ;
Dans les champs sans culture ils trouvaient des bergères.
Pour eux de frais gazons Vénus parait les bois,
Et de l'hymen sévère ils ignoraient les lois.
Point de verrous maudits ; point de geôliers sauvages.
Revenez, temps heureux de nos aïeux plus sages !
Rendez-nous de ces mœurs l'antique liberté ;
De ses voiles pesant délivrez la beauté !
Glycère, loin de toi quand le destin m'enchaîne,
Un luxe malheureux n'adoucit point ma peine...
Eh bien, je veux aux champs m'exiler avec toi,
Cultiver ton domaine, et trembler sous ta loi.
O toi pour qui l'Amour est un maître sévère.
Viens, sous mon toit paisible évitons sa rigueur.
Notre siècle avili met Vénus à l'enchère ;
La balance à la main, Plutus règne en vainqueur.
Plutus, qui des mortels presse les funérailles ;
Qui, de fer et de bronze armant nos faibles bras,
Et poussant les nochers au milieu des batailles,
Les instruit, chez Neptune, à braver deux trépas.
Son favori du pauvre envahit l'héritage ;
A des troupeaux sans nombre il joint quelques agneaux;
Des marbres africains, roulant sur ce rivage,
Pour lui les blocs pesants font trembler les hameaux.
Par un môle orgueilleux les mers sont enchaînées ;
Le poisson prisonnier brave en paix leur courroux...
Hélas ! à moins de frais nos plaisirs sont plus doux,
Quand nos coupes d'argile, à l'envi couronnées,
Prolongent du festin les heures fortunées.
Mais quoi ? si l'opulence attendrit la beauté,
Si toujours le plus riche est le mieux écouté,
Oh ! vienne la richesse, et bientôt Rome entière
De superbes atours verra briller Glycère.
Elle aura de Céos les voiles précieux,
Où l'or, qui les émaille, en filets se promène.
Des vêtements de Tyr, de la pourpre africaine
Les rivales couleurs éblouiront ses yeux.
Même les noirs enfants de l'ardente Lybie,
Pour escorter ses pas vont quitter leurs déserts.
Heureux le riche ! heureux !... Tel est roi chez Lesbie,
Qui, plus humble autrefois, et traversant les mers,
Dans le marché de Rome a promené ses fers.
C'en est fait ; le destin m'asservit à Glycère.
Adieu ma liberté, doux présent de mon père !
Esclave de l'Amour, esclave infortuné,
Et sous sa loi sévère à gémir condamné,
J'ignore, hélas ! mon crime, et je brûle sans cesse.
Loin de moi ces flambeaux, redoutable maîtresse !
A mes vives douleurs qui viendra m'arracher?
Du sauvage Apennin que ne suis-je un rocher,
Ou, sur l'onde orageuse, un écueil immobile
Qu'assiège des autans la fureur inutile !
Que mes jours sont affreux !... moins affreux que mes nuits !
D'amertume et de fiel j'abreuve mes ennuis.
Mes vers n'ont plus de prix pour l'avare Glycère.
Voyez !... Sa main tendue appelle un vil salaire.
Laisse-moi, Dieu du Pinde ! on ne m'écoute pas.
T'ai-je invoqué jamais pour chanter les combats,
L'astre brillant du jour, sa féconde carrière,
Ou du flambeau des nuits l'inconstante lumière ?
Chez Glycère à Tibulle ouvre un facile accès,
Ou reprends, si tu veux d'inutiles bienfaits »
Devant le seuil fatal vainement je soupire...
Soyons riche à tout prix ! l'or seul peut la séduire.
Oui, dérobons aux Dieux le tribut des mortels ;
Mais surtout de Vénus dépouillons les autels.
C'est Vénus qui m'impose une avare maîtresse ;
Qu'elle éprouve d'abord ma fureur vengeresse !
Périssent à jamais l'opale et le saphir,
Les tissus de Céos, les vêtements de Tyr,
La perle dérobée au maritime empire,
Et tous ces vains trésors que l'infidèle admire !
Depuis qu'un luxe infâme éblouit sa raison,
Les chiens et les verrous défendent sa maison.
Mais faites briller l'or ! Tout cède à la richesse ;
Le logis est ouvert, et le chien vous caresse.
Ah ! c'est pour nos forfaits qu'elle a charmé nos yeux.
Femme avare et jolie est un fléau des cieux.
Malheur aux imprudents que son regard enflamme !
Elle fait de l'Amour un mercenaire infâme.
Toi, chez qui nul amant n'est bien venu sans or,
Puisses-tu voir le feu dévorer ton trésor !
Que le peuple joyeux contemple l'incendie,
Et qu'il laisse la flamme exercer sa furie !
A ta mort, quel ami, les yeux baignés de pleurs,
Sur ton bûcher funèbre ira jeter des fleurs?
La femme bonne et tendre est seule vénérée.
Qu'elle meure à cent ans, elle est encor pleurée.
Quelque vieillard fidèle, autrefois son amant,
Vient de festons sacrés parer son monument.
« Sommeille en paix, dit-il, d'une voix faible et tendre, »
Et que la terre, hélas ! soit légère à ta cendre ! »
Mes avis sont prudents ; ils seront superflus.
Aimons à sa manière, ou ne la serrons plus.
C'en est fait ; on l'ordonne : allons mettre à l'enchère
Ma rustique demeure et le champ de mon père.
Glycère, à ton pouvoir connais quels sont mes feux.
Mêle aux plus noirs poisons l'hippomane amoureux ;
Des herbes de Golchos, des sucs de Thessalie
Que la coupe fatale à mes yeux soit remplie :
Je la boirai, Glycère, et ne me plaindrai pas,
Si tu daignes sourire en m'offrant le trépas.
Phébus, un nouveau prêtre en les parvis s'avance.
Que les sons de ta lyre annoncent la présence ;
Et qu'en ce jour sacré, frémissant sous les doigts,
Elle daigne animer et soutenir ma voix !
L'encens fume ; à l'autel on conduit la victime.
Du laurier triomphal ceignant ton front sublime,
Viens, décoré de pourpre et lès cheveux flottants. ;
Fais luire à nos regards tes rayons éclatants.
Tel, du maître des Dieux tu chantas la victoire,
Quand Saturne ici-bas vint oublier sa gloire.
Par toi seul, aux devins que tu daignas choisir
L'oiseau, sans le connaître annonce l'avenir,
Et les flancs des taureaux a l'œil de l'aruspice
Révèlent un présage ou contraire ou propice.
Par toi seul, dévoilant nos destins en ses vers,
La Sibylle autrefois nous promit l'univers.
Qu'un adepte nouveau dès ce jour puisse lire,
Dans ces feuillets sacrés, le sort de notre empire !
On dit qu'au fils d'Anchise Amalthée en fit don,
Lorsqu'il sauva son père et les Dieux d'Ilion
Mais à tant de grandeurs alors pouvait-il croire ?
De Pergame embrasée il s'exilait sans gloire.
Le vaillant Romulus n'avait pas, en ce temps,
De la ville éternelle assis les fondements.
Sur le mont Palatin fumaient d'humbles chaumines.
Des troupeaux mugissants couvraient les sept collines.
Là, façonné sans art, un Dieu de simple bois
Recevait sous l'ormeau les dons du villageois,
Et, du berger nomade offrande vénérée,
Se balançait dans l'ombre une flûte sacrée,
Simple et doux instrument formé de chalumeaux
Dont la cire assemblait les tubes inégaux.
Le populeux Vélabre était un lac sauvage,
Où, parmi les roseaux se frayant un passage,
Chez l'heureux possesseur des troupeaux d'alentour
La fille du hameau voguait avec l'Amour,
Puis, repassant les flots, emportait pour salaire
Un agneau bondissant aussi blanc que sa mère,
Énée avec ses Dieux allait quitter le port.
La prêtresse lui dit : « O toi qui fuis ce bord,
Va, fils de Cythérée où Jupiter t'envoie.
Laurence offre un asile aux pénates de Troie,
Et, comme eux quelque jour révéré dans ces lieux,
Des flots du Numicus tu monteras aux cieux.
La victoire, aux Troyens tant de fois infidèle,
Vient planer sur ta flotte, et s'avance avec elle.
Je vois le camp Rutule en proie au feu vengeur.
Le farouche Turnus a trouvé son vainqueur.
Bientôt vont s'illustrer Lavinie et Laurence.
Albe au fils de Creuse enfin doit la naissance.
Dieu Mars, une Vestale, affrontant le trépas,
S'échappe des autels pour voler dans tes bras ;
L'imprudente à l'écart, et près de ton armure,
De son front virginal a laissé la parure.
Hâtez-vous ; des sept monts broutez l’herbe et le thym ;
Paissez, humbles troupeaux : Rome va naître enfin.
Rome, qu'on doit un jour nommer reine du monde,
Aussi loin que Gérés voit la terre féconde,
Aux lieux où naît l'aurore, aux lieux où le soleil
Dans les flots écumeux baigné son char vermeil.
Que de sa fille alors Pergame sera fière !
Oh ! qu'elle bénira ton voyage prospère !
Ce présage est certain ; puissé-je ainsi toujours
Me nourrir de laurier, et braver les Amours ! »
D'Amalthée, à ces mots, les regards s'animèrent,
Et sur son front divin ses cheveux s'agitèrent.
On dit qu'à son exemple Hérophile autrefois,
Mermesse, dont Phébus aimait surtout la voix,
Albuna, qui, du Tibre arrêtant l'eau captive,
Osa, son livre en main, passer sur l'autre rive,
Nous annonçaient encor cent prodiges affreux ;
Les spectres gémissants, l'étoile aux longs cheveux,
Des cailloux orageux la chute formidable,
Des bataillons dans l'air le choc épouvantable,
Le soleil sans rayons, et ses pâles coursiers
Entourés, dans leur vol, de nuages grossiers ;
Les Dieux baignés de pleurs dans leurs temples antiques,
Et des affreux taureaux les discours prophétiques.
Présages malheureux qu'ont suivis nos revers,
Soyez ensevelis dans l'abîme des mers !
D'un avenir plus doux assurant nos contrées,
Que le laurier pétille en ces flammes sacrées !
Je l'entends... Laboureurs, entonnez vos chansons !
Les greniers vont crouler sous le poids des moissons.
Le joyeux vigneron, enluminé de lie,
Foulera les raisins dans la cuve remplie.
La divine Paies nous appelle à ses jeux :
Fuyez loin du bercail, fuyez, loups dangereux !
Par les vapeurs du vin la jeunesse animée
Franchit, en bondissant, une paille enflammée.
Chaque épouse est féconde ; un nourrisson chéri
Dans ses bras enfantins presse un père attendri.
L'aïeul conduit ses pas ; déjà glacé par l'âge,
Il bégaie avec lui son innocent langage.
Veut-on fêter les Dieux protecteurs des hameaux?
On va goûter le frais sous d'antiques ormeaux,
Ou de ses vêtements, enlacés de feuillage,
On forme un dais rustique, et l'on boit sous l'ombrage.
La coupe tour-à-tour se vide et se remplit ;
On trouve sur les fleurs et sa table et son lit.
Echauffé par le vin, l'amant gronde et querelle :
Le repentir l'attend aux genoux de sa belle.
De son ivresse enfin l'imprudent délivré,
Va jurer mille fois qu'il était égaré.
Sans courroux, Dieu du Pinde, écoute mes prières.
Périssent à jamais les flèches meurtrières !
Que l'Amour, désarmé, chez les faibles humains,
N'abuse plus d'un art innocent dans tes mains !
Hélas ! d'un trait vainqueur Tibulle atteint lui-même,
Un an déjà passé, nourrit un mal qu'il aime.
Il ne sautait trouver ni mesure, ni son,
Aux vers où de Glycère il n'inscrit pas le nom.
Mais les Dieux du poète embrassent là défense :
Glycère, épargne-moi ! redoute leur vengeance ;
Et de Mestolinus, heureux triomphateur,
Laisse-moi quelque jour célébrer la valeur.
Le front ceint de lauriers, après le char d'ivoire,
Que la troupe s'avance, en s'écriant : Victoire !
Et, fixant les regards des assistants ravis,
Que le père applaudisse au triomphe du fils !
Ainsi puisse le ciel voir, dans leur marche sûre,
Apollon toujours beau, Diane toujours pure !
Emile a pris le glaive : Amour, que vas-tu faire ?
Imiter sa vaillance, et le suivre à la guerre,
Et, près de lui sans cesse, armé de javelots,
Affronter les périls de la terre et des flots ?
Ah ! plutôt venge-toi d'un transfuge infidèle !
Sous tes drapeaux vainqueurs que ta voix le rappelle !
Mais dans les camps peut-être on ne craint rien de toi ?
S'il est vrai, loin de Rome, amis, entraînez-moi.
Amour, maîtresse, adieu ! Tibulle a du courage.
Des belliqueux travaux Tibulle a quelque usage.
Dans mon casque poudreux, après un vil repas,
Je boirai l'eau du fleuve, et ne me plaindrai pas.
Inutile discours ! Menace téméraire !
Tout mon courage expire au logis de Glycère.
De le fuir désormais j'avais fait le serment,
Et mon pied de lui-même y revient constamment.
Puissé-je, Amour cruel, voir, après tant de larmes,
Sur tes flambeaux éteints les débris de tes armes !
C'est toi, dont la torture égarant nos douleurs,
Nous fait voir un salut dans les derniers malheurs !
Si j'invoque la Mort, la crédule Espérance
D'un avenir plus doux vient bercer ma souffrance.
Du senteur attentif elle conduit la main,
Quand sur un sol fertile il fait pleuvoir le grain ;
Elle anime un pêcheur dont le roseau, qui plie,
Promène aux bords du fleuve une amorce ennemie,
Souvent même, à sa vue, un esclave est séduit ;
Il chante, et de ses fers il entend moins le bruit.
La flatteuse cent fois m'a promis ta tendresse :
Ne la fais pas mentir, et tiens-moi sa promesse.
Cède, au nom de ta sœur morte à la fleur des ans !
A ses mânes sacrés j'ai porté des présents.
Humectant de mes pleurs le cyprès et la rose,
A la tombe, où sa cendre avant le temps repose,
J'ai consacré ces dons, et, le «sœur attristé,
A son ombre attentive appris ta cruauté.
De son client timide elle prend la défense.
Mon malheur l'intéresse, et ta rigueur l'offense.
La nuit, crains de la voir, dans un triste appareil,
S'avancer vers ta couche, et troubler ton sommeil ;
L'œil éteint, la pâleur sur le front répandue,
Et telle qu'aux enfers son ombre est descendue.
Mais pourquoi de Glycère éveiller les douleurs ?
Ses beaux yeux sont-ils faits pour répandre des pleurs?
Mon amour ne vaut pas un soupir de Glycère.
Ah ! la seule Phryné mérite ma colère.
Cette esclave perfide a causé tous mes maux,
Et près de sa maîtresse a conduit mes rivaux.
Dès le seuil du logis si j'entends mon amie,
La cruelle Phryné répond qu'elle est sortie,
Et si parfois, le soir, j'obtiens un rendez-vous,
Soutient qu'elle est malade ou craint son vieux jaloux.
Alors, que de soupirs et quels transports de rage !
Des plaisirs d'un rival je vois l'horrible image...
Détestable Phryné, ton sort serait affreux,
Si le ciel exauçait le moindre de mes vœux !
Du patron des Romains le beau mois vient de naître.
Ce jour ouvrait l'année à nos simples aïeux,
Et, dans Rome, avec pompe il voit soudain paraître
Les présents que la foule y promène en tous lieux.
Toi que j'aimai toujours, inconstante ou fidèle,
Charmante Nééra, quel don puis-je t'offrir ?
L'or séduit une avare, et ma lyre une belle :
Ah ! tu dois à mes chants te laisser attendrir.
D'un vélin précieux que la feuille légère,
Dont une main soigneuse a poli la blancheur,
Présente mon hommage à celle qui m'est chère,
Et que d'abord le titre ose en nommer l'auteur.
Dans cet heureux envoi j'aime un peu d'élégance.
Embelli par mes soins, sans doute il plaira mieux.
Nymphes de Castalie, il vous doit la naissance :
Oubliez un moment vos bois délicieux.
Déposez cet ouvrage aux pieds de ma maîtresse,
Et pour lui d'un sourire obtenez la faveur.
Qu'elle vous dise alors si j'ai bien sa tendresse,
Si l'amour s'affaiblit ou s'éteint dans son cœur.
Vous lui souhaiterez un avenir prospère,
Et vous direz tout bas : Un enfant d'Apollon,
Autrefois ton époux, et maintenant ton frère,
Ose à sa bien-aimée offrir cet humble don.
Il te chérit toujours, et bien plus que lui-même,
Qu'il te doive appeler son épouse ou sa sœur...
Sois plutôt son épouse ! Oui, de ce nom qu'il aime
Il veut, jusqu'à la tombe, espérer la douceur.
Quel homme a, le premier, d'une main criminelle,
Ravi la jeune épouse à son ami fidèle ?
Après ce coup fatal, quel barbare, à son tour,
Loin de sa bien-aimée a pu souffrir le jour ?
Ah ! tant de cruauté ne fut point mon partage.
La douleur brise enfin le plus ferme courage ;
Et je puis, quand du sort j'éprouve la rigueur,
Avouer, sans rougir, que je cède au malheur.
Eh bien ! lorsque Tibulle, ombre vaine et légère,
Aux cendres du bûcher mêlera sa poussière,
Viens, ma fidèle amie, en ces derniers moments,
Rendre un pieux hommage à mes restes fumants.
Viens, mais avec ta mère, et qu'auprès de ma cendre,
L'une pleure un époux et l'autre pleure un gendre.
En invoquant mon ombre, en implorant les Dieux,
Répandez sur vos mains les flots religieux,
Et recueille en ton sein, par un bienfait suprême,
Mes pâles ossements, seul débris de moi-même.
Sur ce dépôt funèbre, en poussant des sanglots,
D'un lait frais, d'un vin pur fais ruisseler les flots,
Et bientôt, l'essuyant d'une toile légère,
Que ta pieuse main le confie à la terre.
Des champs assyriens que les dons embaumés
Soient dans l'urne fatale avec lui renfermés.
Surtout, à ces présents ajoutez quelques larmes.
Ainsi dans le trépas je puis trouver des charmes.
Déplorant le malheur qui m'entraîne aux enfers,
Le passant sur ma tombe, un jour, lira ces vers :
« Ci-git Tibulle, a Nééra fidèle,
De regret et d'amour il expira loin d'elle. »
Ou tendent mes soupirs, quels sont toujours mes vœux,
Quand mon encens au ciel monte avec ma prière ?
Je ne demande point qu'un palais somptueux
Etale aux yeux jaloux mon opulence altière ;
Que Palès, favorable à mes troupeaux nombreux,
Jette sur mon domaine un, regard amoureux :
Je voudrais à la tienne associer ma vie !
Quand le sort, qui d'avance en a marqué la fin,
M'appellera sans toi dans la barque ennemie,
Je voudrais, plein de jours, expirer sur ton sein.
Auprès de son trésor laissons veiller l'avare ;
Qu'il entasse à plaisir les fruits de la saison ;
Que, traversant les flots, le marbre de Ténare
S'arrondisse en colonne autour de sa maison !
Dans la cour d'un palais de fastueux ombrages,
Sous les lambris dorés les parquets précieux,
Les perles dont l'Asie enrichit ses rivages,
Les tissus que la pourpre embellit de ses feux,
De la foule étonnée exciteront l'envie :
Mais, souvent, ce qu'elle aime il faudrait le haïr.
L'argent n'est pas un baume aux chagrins de la vie,
Et le sort à Plutus ne sait pas obéir.
Ton amant dans tes bras sourit à l'indigence,
Et, sans toi, sur un trône on le verrait languir.
Ah ! reviens à Tibulle, et son bonheur commence.
Heureux, heureux le jour qui nous doit réunir !
Si l'Amour à mes vœux refusait mon amie,
Si les Dieux en courroux se détournaient de moi,
Je verrais, sans plaisir, le fleuve de Lydie
M'apporter les trésors dont il combla son roi.
Qu'un autre les poursuive, ô maîtresse adorée,
Et me laisse en tes bras occuper mon loisir !
Vénus, entends ma voix de ta conque azurée,
Et toi, bonne Junon, daigne aussi nous bénir !
Mais si l'affreux destin, si la Parque fatale
A celle que j'attends ont fermé le retour,
Dieu du Styx et de l'or, que ta voix infernale
Me délivre, et m'entraîne au fond du noir séjour !
Dieux, éloignez de moi ces rêves menaçants,
Dont un sommeil pénible a fatigué mes sens !
Se peut-il que, troublé de vapeurs mensongères,
Je donne, en ma folie, un corps à des chimères !
Si le flanc des taureaux qu'on égorge à l'autel,
Révèle à nos Toscans les volontés du ciel,
A la faveur de l'ombre, un songe téméraire
Ne saurait abuser que le faible vulgaire.
Cependant, ô folie ! ô malheureux humains !
Nous prodiguons l'encens à ces fantômes vains.
Mais qu'il soit faux ou vrai ce funeste présage,
Qu'on appelle ma crainte ou ridicule bu sage,
Si je n'ai pas au crime abandonné mon cœur,
Ni poussé vers l'Olympe un cri blasphémateur,
Lucine bienfaisante, en toi je me repose.
Oh ! puisse l'innocence avoir tremblé sans cause !
La nuit, déjà moins sombre, abandonnant les airs,
Plongeait son char d'ébène au sein des flots amers;
Le Dieu que vainement le malheureux implore,
Le sommeil, sur mes sens ne régnait pas encore ;
Mais aux premiers regards du vigilant Phébus,
Il descendit enfin sur mes yeux abattus.
Le front ceint de lauriers, un jeune homme, à cette heure
Me sembla pénétrer dans mon humble demeure.
Jamais rien de si beau ne parut sous le ciel.
Ses traits et son maintien n'étaient point d'un mortel.
Sa blonde chevelure, en longs anneaux flottante,
De la myrrhe exhalait la rosée odorante.
Un brillant coloris animait sa blancheur.
Telle, aux cieux, du soleil on voit l'aimable sœur ;
Telle, à son jeune époux marchant d'un pas timide,
La vierge en rougissant suit l'Hymen qui la guide.
De la pomme aux vergers moins vif est le carmin ;
Moins vermeille est la rose enlacée au jasmin.
Une robe à longs plis l'entourait avec grâce,
Se jouait à ses pieds, et flottait sur sa trace.
Un luth à son côté brillait d'écaillé et d'or,
Et le travail sans prix l'embellissait encor.
Sous sa main qui prélude un son léger s'éveille ;
Les accents de sa voix captivent mon oreille.
Mais bientôt, de ses chants interrompant le cours,
Le divin messager commença ce discours :
« Salut, jeune poète, à qui le Dieu du Pinde,
Les filles de Mémoire et le vainqueur de l'Inde
Dispensent a l'envi d'immortelles faveurs !...
Mais le joyeux Bacchus et mes divines Sœurs
N'ont pu de l'avenir percer la nuit profonde.
Je le connais moi seul, grâce au maître du monde.
Je veux t'en dévoiler l'affreuse obscurité.
Du Dieu de la lumière apprends la vérité.
L'objet de ton amour, celle qui t'est plus chère
Qu'à son frère une sœur, une fille à sa mère,
Celle qui de ta vie a troublé les loisirs,
Dont le nom chez les Dieux monte avec tes soupirs,
Et qui, d'un voile épais quand la nuit t'environne,
A des songes menteurs sans pitié t'abandonne,
Celle enfin dont ta muse illustra la beauté,
Près d'un nouvel amant oubliera sa fierté.
A vos premiers liens seul ton cœur est fidèle ;
Ta maison chaste et pure est sans attrait pour elle.
Femmes! sexe trompeur ! puissent d'affreux tourments
Venger sur vous la honte et les pleurs des amants !
Toi, vole à ta maîtresse, et que ta voix l'implore ;
Puisqu'elle fut légère, elle peut l'être encore.
L'Amour fait au plus lâche affronter cent travaux.
Par lui le plus mutin se résigne à ses maux.
Phébus même autrefois, cédant à ses caprices,
Sur les bords du Pénée a gardé les génisses.
Combien il regrettait, dans ces champêtres lieux,
De sa voix, de son luth l'accord mélodieux
Le fils de Jupiter, le Dieu de la lumière
Ne possédait alors qu'une flûte légère.
Si ton âme aux rigueurs ne peut s'accoutumer,
Jeune insensé, crois-moi ; tu ne sais" pas aimer.
Ne tarde plus; va, prie, implore ta maîtresse.
La plainte amollirait le cœur d'une tigresse.
Que si ma voix jamais ne trompa les humains,
Porte-lui d'Apollon les ordres souverains.
J'ai moi-même à la tienne uni sa destinée,
Et la volage en vain rêve un autre hyménée. »
Je m'éveille à ces mots, les yeux baignés de pleurs.
Dieux puissants, de Tibulle éloignez ces malheurs !
Eh ! quoi ? celle que j'aime est donc si criminelle !
Non, tes vœux sont les miens, tu n'es pas infidèle.
Tu ne dois pas le jour aux monstres inhumains
Des rochers de Scythie ou des bords africains ;
Le portier des enfers, le farouche Cerbère
Ne t'a pas engendrée au sein de la chimère,
Non, tu dois l'existence aux plus aimables nœuds.
Tu naquis sous le toit de parents vertueux.
Leur enfant put sourire, en voyant la lumière,
Au père le plus tendre, à la plus chaste mère.
Dissipez donc, ô Dieux, mes rêves d'aujourd'hui !
Que le souffle des vents les emporte avec lui !
La terre enfin respire, et la saison fleurie
Loin de moi tous appelle aux thermes d'Etrurie.
Amis, ne tardez pas ; bienfaisante aujourd'hui,
Cette onde est sans pouvoir quand Sirius a lui.
Cependant je succombe, et mon heure s'avance.
Dieux ! sauvez ma jeunesse ; épargnez l'innocence.
Fauna, sur ses autels à mon sexe interdits,
M'a-t-elle vu jamais lever des yeux hardis ?
Un convive imprudent, de ma main forcenée,
A-t-il reçu jamais la coupe empoisonnée ?
Dans ma fureur impie, ai-je insulté le ciel,
Ou, d'un bras sacrilège, audacieux mortel,
Aux murs du Capitole ai-je porté la flamme?
Non, le cri du remords ne trouble point mon âme.
Le temps est loin encore où, sur mes noirs cheveux,
La jeunesse en fuyant doit marquer ses adieux.
Je suis né quand Modène, au pied de ses murailles,
A vu de nos consuls les doubles funérailles.
Faut-il du fruit naissant dépouiller les Jardins ?
Au pampre, avant l'automne, enlever ses raisins?
Dieu puissant, qu'autrefois le sort voulut élire
Pour régner sur l'Érèbe et le troisième empire,
Attends, pour me plonger dans le manoir profond,
Que la pâle vieillesse ait sillonné mon front,
Et que l'heureux Tibulle aux enfants du village
Ait raconté souvent les vertus d'un autre âge !
Viens dissiper l'effroi de mon cœur oppressé.
Hélas ! sur mes douleurs que de jours ont passé !
Et vous qui, balancés sur les ondes légères,
Bénissez des Toscans les Nymphes tutélaires,
Que j'attende aujourd'hui la vie ou le trépas,
Amis, vivez heureux, mais ne m'oubliez pas,
Et promettez au Roi des ténébreux abîmes
Un lait frais, un vin pur et de noires victimes!
A moi, divin Bacchus ! écoute ma prière.
Viens le thyrse à la main, le front paré de lierre.
Des amants, nous dit-on, tu peux briser les fers :
Délivre-moi des maux que toi-même as soufferts !
Esclave, au Dieu du vin cette heure est destinée.
Fais couler le nectar de l'amphore inclinée.
Un heureux jour nous luit : ses bienfaisants rayons
Dissipent des chagrins les noires légions.
Amis, à ces transports quand mon âme se livre,
Si quelqu'un m'abandonne, et renonce à me suivre,
Pour le combat du vin s'il nous refuse un jour,
Qu'il tombe en nous fuyant dans les pièges d'Amour!
Bacchus nourrit le cœur. P Lui sommes-nous rebelles?
Il nous frappe ; il nous livre aux caprices des belles.
On voit le tigre même, aux pieds de ce vainqueur,
Sous la main qui le flatte oublier sa fureur.
L'Amour, le seul Amour est plus puissant encore...
Du vin ! ma coupe est vide, et la soif me dévore.
Témoin de ses transports, et doucement flatté,
Bacchus aime à sourire au buveur en gaité ;
Mais, sitôt qu'on le brave, il se montre sévère ;
Et Penthée expirant sous les coups de sa mère,
Nous apprend, Dieu jaloux, quels châtiments affreux
Suivront de tes bienfaits le mépris dangereux.
O daigne à ces périls dérober l'innocence !
Que, seule, ma perfide éprouve ta puissance !...
Insensé ! qu'ai-je dit ? Légers tyrans des airs
Portez ce vœu coupable au fond des noirs déserts.
Je ne puis oublier l'ingrate qui m'oublie.
Les Dieux de tous leurs biens veuillent combler sa vie !
Mais le festin m'appelle. Éloignons le chagrin !
Enfin le ciel, plus doux, ramène un jour serein.
Hélas ! qu'un malheureux sait mal voiler sa peine !
Qu'aisément on dérobe un secret qui le gêne,
S'il veut, pour déguiser le trouble de son cœur,
Essayer le sourire ou les chants du buveur !
Eh ! quoi ? gémir toujours ! Loin de moi ces alarmes !
Bacchus n'est pas un Dieu qu'on abreuve de larmes.
Ariane autrefois, seule aux bords de Naxos,
Mêla sa voix plaintive aux murmures des flots,
Et Catulle, à jamais flétrissant un parjure,
A chanté de nos jours cette affreuse aventure.
Exemple mémorable offert à la beauté...
Qu'au jeune homme imprudent le mien soit présenté !
Heureux des maux d'autrui qui sachant faire usage,
Trouva sans l'acheter le secret d'être sage !
Ami, de la beauté crains les charmes puissants ;
Crains son humble prière et ses bras caressants.
Qu'elle atteste les Dieux, qu'elle atteste sa vie,
Chacun de ses serments est une perfidie.
Ce parjure odieux que ta fureur maudit,
Le vent déjà l'emporte, et Jupiter sourit.
Mais, quoi? toujours me plaindre ! Oublions l'infidèle !
Faisons trêve à mes pleurs...Que ne puis-je, auprès d'elle,
Mesurer désormais, dans les bras de l'Amour,
Tout l'espace des nuits, tout le cercle du jour !
Faible et cruelle amante, et pourtant chère encore !
Elle aime qui la trompe, et trahit qui l'adore.
Approchez, du festin ministres paresseux.
Mêlez une onde pure à ce vin généreux.
Que, fuyant nos transports, cette femme légère
Préfère à notre table une couche étrangère,
Je n'ai garde en soupirs de consumer la nuit.
Lorsque survient Bacchus, voit-on si l'Amour fuit?
Enfants, mon front serein dès longtemps vous demande,
Avec l'huile embaumée, une fraîche guirlande.
Messala, c'est toi que je veux chanter. Tes grandes qualités me sont connues, et je crains de manquer de forces pour les célébrer dignement ; cependant je commence. Si mes vers ne te rendent pas tout l'honneur qui t'est dû, si je reste au-dessous d'un si beau sujet, qu'il me suffise d'avoir entrepris ce que tu pourrais seul exécuter. Oui, seul tu pourrais, en retraçant tes actions, composer une histoire aussi belle que ta vie. Mais tu ne dédaigneras point mon faible hommage. Phébus, à tous les autres, préféra celui de quelques pauvres Crétois. Bacchus aima surtout le chaume hospitalier d'Icare. Sirius et la Vierge brillent dans l'azur des cieux pour l'attester aux siècles à venir. Alcide même, qui devait lin jour prendre place dans l'Olympe, se plut à visiter la cabane d'un vigneron. On n'immole pas toujours des victimes aux cornes dorées. C'est assez bien souvent de quelques grains d'encens pour apaiser les Dieux. Messala, puisses-tu sourire à ce faible ouvrage ! la reconnaissance me dictera sans cesse de nouveaux chants à ta gloire.
Qu'un autre célèbre en ses vers l'œuvre admirable du monde ; qu'il décrive la terre se fixant au milieu de l'immensité de l'air, la mer enveloppant cette masse arrondie, et l'atmosphère mobile s'élevant avec effort au-dessus d'elle ; qu'il dise comme l'éther enflammé se mélange avec les airs, et flotte au loin dans l'espace ; et comme la voûte des cieux, pendante sur nos têtes, emprisonne tous ces éléments. Pour moi, que mes vers soient dignes de mon héros, ou qu'ils ne puissent répondre à ses hauts faits (et je ne me laisse point abuser d'un fol espoir, je sais qu'ils ne pourront s'élever jusque-là), n'importe ; je veux te les consacrer sans réserve ; je veux décorer mes ouvrages de ton illustre nom.
Tu pourrais te glorifier d'une antique noblesse ; mais tu ne crois pas que la renommée de tes ancêtres suffise à la tienne. Tu ne vas point chercher ce qui fut inscrit sous chacune de leurs images. Tu veux rivaliser de gloire avec les auteurs de ta race. Ils t'auront fait moins d'honneur que tu n'en feras à tes descendants. Quelques lignes au bas de ton portrait seront loin de suffire pour ton éloge. Des volumes de vers immortels te seront consacrés. L'éloquence et la poésie se disputeront l'honneur de célébrer tes louanges. Fussé-je vainqueur dans cette lutte, afin d'associer mon nom à des actions si mémorables !
Quel homme a fait de plus grandes choses au Forum ou dans les camps? On ne sait qui louer davantage en toi de l'orateur ou du guerrier. Ainsi le fléau d'une balance, que pressent deux poids égaux, ne s'abaisse point d'un côté, ne s'élève point de l'autre, comme il arriverait quand les bassins, flottants et mobiles, porteraient une charge inégale. Qui sait mieux que toi calmer une multitude inconstante en proie à la fureur des partis? A ta voix éloquente, quel juge n'oublie sa colère, et ne se laisse attendrir ?
Ils étaient moins grands ces héros de Pylos et d'Ithaque, ce sage Nestor, ce fameux Ulysse, honneur de son humble patrie. En vain le premier a vu, durant trois fois cent années, le soleil parcourir dans les cieux le cercle fertile des saisons. En vain le second, voyageur audacieux, a visité des villes inconnues, et les régions où la barrière de l'Océan limite les derniers rivages.
Ses armes repoussèrent les peuples de la Thrace. Le Lotos ne put interrompre sa course. Il dompta même le fils de Neptune, le farouche habitant des cavernes de l'Etna, et fit jaillir le sang de sa paupière vaincue par le nectar de Maronée. Il promena les enfants orageux d'Eole sur la mer immobile. Aux lieux que la belle Artacie arrose de son onde glacée, il osa braver Antiphate et les sauvages Lestrigons. Lui seul put goûter les breuvages de la magicienne Circé, sans éprouver aucune métamorphose. En vain elle était fille
du soleil ; en vain ses poisons et ses enchantements pouvaient-ils enlever aux mortels leur forme première. Il visita les contrées ténébreuses des Cimmériens qui ne voient jamais l'aurore blanchir la rive orientale, soit lorsque Phébus étend le cercle des jours, soit lorsqu'il s'empresse de céder à la nuit l'empire du ciel. Il vit les enfants des Dieux, soumis à l'infernal Plu ton, et transformés en ombres légères, voltiger dans le royaume sombre. Son vaisseau rapide traversa les parages qu'habitent les Syrènes. Quand il fit voile entre ces gouffres épouvantables, où le menaçait de si près une double mort, il vit sans frayeur l'impétueuse Sylla, sa bouche dévorante, et ses chiens rampants au milieu des écueils où l'onde se brise avec fracas. La furieuse Charybde, qui tantôt s'élance des profondeurs de l'abîme, tantôt les entrouvre, et laisse voir le fond des mers, ne put cette fois engloutir sa proie. Passe-rai-je sous silence et la profanation des pâturages du soleil, et l'amour de Calypso, et les fertiles campagnes de l'Atlantide, et la terre des Phéaciens, où finirent les courses du malheureux Ulysse?
Qu'il ait vu toutes ces merveilles sans s'éloigner de nos rivages, ou que la poésie ait ouvert un nouveau monde aux voyages de ce héros, il a, je le veux bien, éprouvé plus de traverses que toi ; mais que son éloquence était loin d'égaler la tienne !
Quel autre est plus versé que toi dans l'art de la guerre? Quel autre sait mieux asseoir un camp, et l'entourer de fossés profonds ; opposer à l'ennemi des obstacles qui arrêtent sa marche ; environner de palissades un poste habilement choisi, pourvu de sources salutaires, et qui, offrant à nos guerriers un abord facile, soit inaccessible à l'ennemi ? Là, tu sais entretenir chez tes soldats une émulation continuelle. On dispute à qui saura mieux lancer l'épieu pesant ou la flèche légère ; frapper le but avec le javelot ; atteindre à coups de fronde la place désignée ; présenter le bouclier à droite ou à gauche, et l'opposer toujours au choc impétueux de la lance ; faire sentir le frein ou lâcher la bride au coursier trop rapide ou trop lent ; le pousser en ligne droite ou le forcer d'exécuter, dans un espace étroit, des marches circulaires.
Lorsque vient le moment des jeux terribles de Mars, quand les deux armées déploient leurs étendards, et sont près d'en venir aux mains, tu sais disposer à ton gré l'ordre du combat. Au besoin, tu formes le bataillon carré, et les troupes s'avancent en présentant de toutes parts un front égal. Si tu le juges convenable, tu formes de tes guerriers deux troupes séparées ; tu opposes ton aile droite à la gauche des ennemis, et la gauche à la droite. Ainsi deux années remportent, sous ta conduite, une double victoire.
Ma muse ne s'égare point dans de vaines louanges. Je célèbre des exploits véritables : j'en prends à témoins le belliqueux Liburnien, qui n'a pu résister à ta vaillance ; le Pannonien perfide, errant sur les Alpes glacées; les habitants d'Arupinum, qui naissent pauvres au milieu des armes, et qui portent si légèrement le fardeau de la vieillesse, qu'à leur aspect on s'étonne moins des trois cents ans du roi de Pylos. En vain l'astre du jour a-t-il, depuis leur naissance, poursuivi pendant un siècle sa marche féconde, ils savent encore monter lestement un cheval fougueux, lui serrer la bride, et le conduire à leur gré.
Ta valeur a fait plier sous le joug de Rome ces cavaliers superbes qui, fiers de leur liberté; n'avaient pas encore tourné le dos à l'ennemi. Mais tant de gloire ne te suffit pas. A ces exploits vont en succéder de plus grands encore. J'en ai pour garants des présages plus certains que ceux du célèbre Mélampe.
Le jour naissant commençait sous d'heureux auspices une nouvelle année, et tu venais de revêtir une robe éclatante de pourpre tyrienne, quand le soleil s'éleva plus brillant du sein des flots. Les vents ne se firent plus la guerre, et continrent leur souffle impétueux. Les fleuves vagabonds suspendirent leur course accoutumée. L'orageux Océan aplanit l'onde immobile. Nul oiseau ne traversa la plaine éthérée. Nulle bête sauvage n'osa paître dans les forêts sombres. Tu prononças les vœux solennels à la faveur d'un profond silence. D'une course rapide, le père des Dieux, roulant son char dans l'espace, abandonna l'Olympe voisin du ciel. Il vint prêter à tes prières une oreille attentive, et, d'un signe de sa tête sacrée, ce Dieu, qui ne mentit jamais, promit de les exaucer. La flamme brilla plus vive sur les autels chargés d'offrandes.
Messala, un Dieu t'anime à ces grandes entreprises. Il est temps de commencer. Nuls triomphes ne pourront se comparer aux tiens. Point d'obstacle qui t'arrête ; ni le Gaulois, ce belliqueux voisin de Rome ; ni les vastes campagnes de l'audacieuse Ibérie ; ni ces rives barbares, où vint s'établir une colonie de Théréens ; ni les contrées qu'arrosent le fleuve du Nil, le Choaspe qui abreuve les rois, le rapide Gyndès sur lequel Gyrus assouvit sa ridicule fureur, et qui, par mille canaux, circule dans les champs de Babylone ; ni le royaume de Tomyris que limite l'Araxe vagabond ; ni ces rivages situés aux bornes du monde, et voisins de l'aurore, où l'Indien barbare se nourrit, dans ses banquets, des mets les plus détestables ; ni ces climats enfin où les Mosins et les Gètes boivent les eaux de l'Ister et du Tanaïs. Que dis-je? aucune de ces nations qu'environne la barrière de l'Océan, n'osera prendre les armes contre toi. C'est à toi qu'il est réservé de soumettre la Bretagne encore indomptée, et cette partie du monde que sépare de nous la zone brûlante.
Car la terre, immobile dans les plaines de l'air qui l'environnent, est divisée en cinq régions. Il en est deux que désole un hiver éternel ; elles sont plongées dans une obscurité profonde. L'onde essaie en vain de couler ; elle se durcit, en glace, en frimas. Jamais le soleil ne se montre au-dessus de l'horizon ; mais la zone du milieu est toujours exposée a sa chaleur, soit qu'il s'approche de la terre, et décrive ses orbes les plus grands, soit qu'il s'empresse d'achever les journées hivernales. Aussi les efforts de la charrue ne soulèvent jamais la glèbe dans ces contrées. Point de moissons ; point de pâturages. Cérès et Bacchus n'y fécondent point les campagnes. Nul animal n'habite ces brûlantes régions. Entre elles et les zones glacées, il en est deux, la nôtre et celle qui lui est opposée, qui, entourées l'une et l'autre de climats semblables, tempèrent les frimas que leur envoie la zone glacée par les chaleurs de la zone torride. Ainsi nous voyons varier, chaque année, le cours paisible des saisons. Ainsi les taureaux ont appris à courber sous le joug un front docile ; les pampres flexibles à s'élever en longs rameaux, et la terre à produire, à mûrir, tous les ans, ces moissons qu'elle livre à la faucille. Le fer sillonne les champs ; l'airain sillonne la mer ; les villes même élèvent leurs superbes murailles.
Illustre guerrier, lorsque la pompe triomphale aura couronné tes exploits, seul, tu seras proclamé grand dans les deux mondes. Je ne puis suffire à chanter tant de gloire ; non, quand Phébus lui-même dicterait mes vers. Mais n'as-tu pas Valgius ? C’est lui qui pourra mettre la main à une œuvre si importante ; nul autre n'a plus approché de l'immortel Homère.
C’est en vain que la Fortune ennemie me persécute à sa manière. Le chagrin ne saurait me jeter dans un mol engourdissement. J'ai vu l'abondance régner dans ma maison opulente. Des moissons dorées couvraient mes sillons, et, chacune en son temps, enrichissaient mes greniers qui ne pouvaient suffire à tant de biens. Sur mes coteaux paissaient des troupeaux sans nombre. C'était assez pour le maître ; assez pour les loups et les voleurs. Aujourd'hui, je n'en ai plus que le regret. Il se renouvelle chaque fois qu'un souvenir douloureux me retrace mes premières années : mais fussé-je encore plus maltraité et dépouillé de ce qui me reste, ma muse ne cessera jamais de célébrer tes louanges.
Et mon zèle ne se bornera pas à t'offrir ce tribut poétique. Pour toi, j'oserais, traversant les mers, affronter le courroux des flots soulevés par la tempête ; résister seul à de nombreux bataillons, ou me précipiter dans les flammes de l'Etna. Je suis à toi sans réserve. Toi-même, songe quelquefois à Tibulle : qu'il ait quelque part à tes affections, et ses désirs seront comblés. Le sceptre de Lydie, une renommée égale a celle du célèbre Gylippe, l'honneur de publier des chants dignes de Mélésigènes, n'auraient pas pour moi plus de prix. Si tous mes vers, si quelques-uns peuvent se graver dans ta mémoire, ou, seulement, si tu les récites quelquefois, je te chanterai sans cesse, et les destins ne pourront me réduire au silence.
J'ignore si mon heure s'approche, si la mort s'avance vers moi d'un pas précipité, ou si une longue
vie m'est réservée ; mais quand la tombe aura recouvert ma cendre, quand j'aurai subi la fatale métamorphose, et, pendant de longues années, parcouru les campagnes sous la forme d'un coursier bondissant, ou, taureau superbe, régné sur les paisibles génisses, ou peut-être, oiseau léger, fendu la plaine éthérée: dès que j'aurai repris la figure humaine, je composerai de nouveaux chants à ta gloire.
Sulpicie à l'autel vient célébrer ta fête ;
Descends, Dieu des combats ; dans le ciel qui l'arrête?
Vénus, pardonne-lui ! Vois son glaive inhumain
S'abaisser devant elle, et tomber de sa main.
Et qui de Sulpicie ose braver l'empire ?
L'éclair brille en ses yeux, et Jupiter soupire.
Une Grâce naïve, animant ses appas,
Inspire son langage, et vole sur ses pas,
De ses cheveux flottants laisse échapper les ondes,
Ou, d'une main légère, unit leurs tresses blondes.
Il n'est point de parure, il n'est point de couleurs
Qui n'aient chez elle un charme à ravir tous les cœurs.
Ainsi l'heureux Vertumne, aux voûtes éternelles,
A sous mille ornements mille grâces nouvelles.
Quelle autre est plus jolie et plus digne, à vos yeux,
D'emprunter à Sidon ses voiles précieux ;
Aux déserts de Saba leurs moissons odorantes ;
Au sauvage Indien les merveilles brillantes
Que ravit son audace aux écueils de ces bords,
Où le soleil naissant a semé des trésors ?
Oh ! puisse un jour si beau souvent briller pour elle !
Muses, pour la chanter, venez troupe immortelle.
Les vers sont, dites-vous, le prix de la beauté :
Venez ! jamais ce prix ne fut mieux mérité.
Épargnez mon amant, sangliers vagabonds,
Qui, sur les monts déserts ou dans les frais vallons,
Aiguisez pour sa mort vos défenses cruelles !
Amours, tenez Cérinthe à l'ombre de vos ailes.
Si tes jeux, ô Diane, ont pour lui tant d'attraits,
Périssent mille fois les chiens et les forêts !
Quelle aveugle fureur ! A travers les épines,
Il marche, et de filets entoure les collines.
La ronce en vain déchire et ses pieds et sa main ;
Il avance ; il affronte un repaire inhumain...
Cependant Sulpicie, imitant son audace,
Voudrait au fond des bois s'égarer sur sa trace,
Et poursuivant la biche aux sons guerriers du cor,
A ses chiens découplés donner un libre essor.
Oh ! qu'une forêt sombre alors saurait me plaire !
Là, pour toi bien souvent je serais peu sévère.
Un sanglier farouche, à cet heureux montent,
Passerait sans péril auprès de mon amant.
Maintenant sois plus sage, et, fidèle à Diane,
Évite les plaisirs que sa rigueur condamne.
Si pour ton cœur volage une autre a plus d'attraits,
Qu'un monstre la déchire au fond de vos forêts !
Mais non ; laisse à ton père un passe-temps sauvage,
Et reviens près de moi goûter ceux de notre âge.
Phébus, pose ta lyre ; aujourd'hui les Amours
Pour la beauté mourante implorent ton secours.
Viens la rendre à la vie ! Un tel soin doit te plaire.
Est-il pour un Dieu même un plus doux ministère?
De son corps languissant, que flétrit la douleur,
Viens réparer la force, animer la pâleur !
Que l'aquilon fougueux chasse aux lointains rivages
Et les maux qu'elle endure, et nos tristes présages !
Puisse un charme magique, et le sommeil plus doux,
De l'Olympe avec toi descendre jusqu'à nous !
Déjà la mort sur elle a répandu son ombre.
Cérinthe adresse aux Dieux des prières sans nombre.
Souvent il les implore, et souvent, irrité,
Quand il voit ses douleurs, maudit leur cruauté.
Ami, des immortels ta flamme est approuvée.
Ne crains plus ; aime bien ; ta maîtresse est sauvée.
Tu pleures cependant ! Ah ! pour verser des pleurs,
Attends, jeune insensé, d'éprouver ses rigueurs.
Que lui fait maintenant cette foule attentive?
Toi seul, toujours chéri, tiens son âme captive.
Phébus, entends leur plainte, et, propice à nos vœux,
D'un seul coup de ton art, viens les sauver tous deux.
Quelle gloire pour toi ! Tu verras cette belle
Te bénir pour Cérinthe, et son amant pour elle ;
Et, digne objet d'envie au céleste manoir,
Tu feras même aux Dieux désirer ton savoir.
Oui, Cérinthe, à jamais il est sacré pour moi
Le jour où mon bonheur prit naissance avec toi.
Un Dieu, qui te protège, alors daignant sourire,
Aux vierges d'Italie annonça ton empire.
Je brûlai la première, et bénis cette ardeur,
Si le feu qui m'embrase a passé dans ton cœur.
Au nom des immortels, au nom de mes faiblesses,
Rends amour pour amour et baisers pour caresses.
Bon Génie, à sa fête ici daigne accourir,
Si toujours mon image éveille son désir ;
Mais s'il a des soupirs pour une autre mortelle,
Abandonne en courroux sa demeure infidèle.
Et vous, comblez enfin tant de vœux superflus,
Amours ; que je sois libre ou qu'il-ne le soit plus.
Oui, des nœuds les plus forts que Vénus nous enchaîne !
Que le temps à les rompre épuise en vain sa haine !
Cérinthe a même envie ; il brûle, et, plus discret,
Il implore Vénus, mais l'implore en secret.
Qu'importe ? Elle sait tout ; elle voit ce qu'on pense ;
Et peut comme la plainte exaucer le silence.
Junon, sois-nous propice ! Au jour de sa naissance,
Vois cette jeune Muse, implorer ta puissance !
Viens ; reçois son offrande. En habit solennel,
Tout entière au devoir elle avance à l'autel.
Que dis-je? tant d'éclat trahit un doux mystère.
Ce n'est pas à toi seule aujourd'hui qu'on veut plaire.
Puisse enfin le volage, à ses genoux conduit,
Près d'elle oublier l'heure et le jour qui s'enfuit !
Protège un nœud si beau, bienfaisante immortelle !
Elle est digne de lui, comme il est digne d'elle.
Que l'Argus qui les veille, abusé par l'Amour,
Quand Vénus les rassemble, en vain rôde alentour !
Oh ! viens de Sulpicie exaucer la prière !
Déjà coule un vin pur, et, tandis que sa mère
Lui prescrit tous les vœux que son cœur doit former,
Elle en fait un plus doux, et ne l'ose exprimer.
La flamme des autels de la sienne est l'emblème ;
Mais ne la guéris point de ce tourment qu'elle aime :
Et puisse, à pareil jour, brûlé, des mêmes feux,
Son amant avec elle en rendre grâce aux Dieux
O bonheur ! enfin j'ai su plaire.
Cet amour fait ma gloire, et je ne pus m'en taire.
Mes chants de Cythérée ont fléchi la rigueur,
Et je presse en mes bras l'idole démon cœur.
Je ne fais plus de vœux. Divulgue ma faiblesse,
Vous que méprise encore une ingrate maîtresse.
Lisez, lisez ces vers; un sceau mystérieux
Ne dérobera point ma pensée à vos yeux.
Sur un si digne amant quand j'obtiens la victoire,
Je ne puis me contraindre à rougir de ma gloire.
Fatal anniversaire ! en un désert sauvage,
Il faut donc, cher amant, le passer loin de toi !
Je le sens ; Rome seule a des charmes pour moi.
Le ciel pour la beauté ne fit point le village.
Mais déjà l'on m'entraine ; on prétend me fêter ;
Il faut courir gaiment à ce cruel voyage,
Et c'est toi que je vais quitter !
Ami, plus de voyage ! ici Vénus m'arrête.
Que cet anniversaire en est plus doux pour moi !
Tous les jours me sont jours de fêle,
Quand je les passe auprès de toi.
Tu pensais, voyant ma faiblesse,
M'oublier sans péril près d'une autre maîtresse !
Va !... de Sulpicius outrageant le beau nom,
Ingrat, donne à sa fille une rivale impure !
On m'entoure ; on me plaint d'un si lâche abandon,
Et plus d'un cœur aspire à venger mon injure.
Prends-tu quelque souci de ta fidèle amie
Qu'une fièvre mortelle aujourd'hui vient saisir ?
Si tu n'as pas même désir,
Je ne souhaite point qu'on me rende à la vie.
Et pourquoi souhaiter, hélas !
D'échapper à des maux qui ne t'affligent pas ?
Ah ! rends-moi ton amour ; pardonne à ta maîtresse !
Cette nuit, près de toi redoutant ma faiblesse,
Ami, j'ai pu te fuir ; j'ai vaincu mes transports...
Je n'ai rien fait, dans ma jeunesse,
Qui m'ait causé tant de remords !
Oui, tel fut mon serment ; je veux mourir fidèle.
En vain, tendre et flatteuse, une amante nouvelle
Voudrait loin de ta couche égarer mon ardeur,
Toi seule as ma pensée, et tu remplis mon cœur.
Oh ! puisse à tous les yeux l'Amour voiler tes charmes !
Je serai sans rivaux : je vivrai sans alarmes.
Qu'importe à la sagesse un éclat dangereux ?
Pour l'être sans envie, en est-on moins heureux ?
Loin des sentiers battus, dans un bois tutélaire,
Fussé-je «après de toi tranquille et solitaire !
Lumière de ma vie, au fond des noirs déserts,
Ton aimable présence est pour moi l'univers.
De mille déités paraisse la plus belle ;
Vénus même aujourd'hui peut me trouver rebelle.
J'en atteste Junon ; il n'est point, chez les Dieux,
De nom plus vénérable et plus saint à mes yeux.
Qu'ai-je fait, insensé ? Quoi ! donner un tel gage,
Et m'enchaîner moi-même aux pieds de la volage !
Qu'elle va triompher ! Que d'insultants mépris !
Voilà d'un fol babil, voilà le digne prix !
Eh bien ! ta volonté sera ma loi suprême.
On ne me verra point briser des nœuds que j'aime,
Mais, aux pieds de Vénus, ton esclave outragé
Ira porter sa chaîne, et reviendra vengé.
Oui, de vos trahisons la ville est informée.
Je voudrais l'ignorer ; ces bruits me font mourir :
Ne viens plus m'annoncer, cruelle renommée,
Des maux que tu ne peux guérir.
Sur les pas de Virgile, au ténébreux rivage,
Tibulle est, jeune encore, emporté sans retour.
Qui dira les douleurs, les soupirs de l'Amour?
Qui des nobles guerriers chantera le courage?
FIN.
ÉLÉGIE I.
Messala pressait Tibulle de le suivre à la guerre. Peut-être s'agit-il de l'expédition d'Asie. (Voyez Élégie III.) Notre poète refuse de braver les dangers des combats et des voyages, et d'augmenter sa fortune à ce prix. On sait que le métier des armes était très lucratif chez les Romains.
Tibulle a probablement écrit cette élégie dans sa campagne aux environs de Pedum. Les plaisirs de la vie rustique ne sont pas ici, comme dans quelques-uns de ses poèmes, l'objet de ses désirs. Il en jouit ; ce qu'il chante est véritablement sous ses yeux.
Scaliger a tort de prétendre que cette pièce a été composée la dernière. Tibulle y nomme Délie, et l'on sait qu'elle reçut son premier hommage. Selon la conjecture de Heyne, elle n'était pas mariée quand cette élégie fut écrite.
On connaît l'application frappante que Louis Racine a faite au crucifix des vers latins correspondons. Voltaire a tiré un autre parti de ce passage célèbre. Voici ce qu'il pense des consolations que se promet notre poète :
Je veux, dans mes derniers adieux,
Disait Tibulle à son amante.
Attacher mes yeux sur tes yeux,
Te presser de ma main mourante.
Mais quand on sent qu'on va passer,
Quand l'âme fuit avec la vie,
A-t-on des yeux pour voir Délie,
Et des mains pour la caresser?
Dans ces moments chacun oublie
Tout ce qu'il a fait en santé ;
Quel mortel s'est jamais flatté
D'un rendez-vous à l'agonie ?
Délie elle-même à son tour
S'en va dans la nuit éternelle.
En oubliant qu'elle fut belle,
Et qu'elle a vécu pour l'amour !
ÉLÉGIE II.
Cette élégie a été probablement composée après la troisième, où Tibulle ne se plaint pas encore de l'infidélité de sa maîtresse. Ici Délie paraît engagée à un autre. Mais quoique son amant emploie les expressions dominas, conjux, pour désigner celui qui semble avoir autorité sur elle, il n'est pas nécessaire de supposer qu'elle fût véritablement mariée. On sait que les lois romaines autorisaient le concubinage entre célibataires. Cette union temporaire n'avait pas un but aussi respectable que le mariage, et l'on ne doit pas considérer comme des amours adultères, celles qui rendaient infidèle une personne engagée par de semblables liens. Tels étaient, tout au plus ceux qui unissaient Délie au rival de Tibulle, car les poètes emploient sans cesse l'expression conjux, ou d'autres semblables, pour désigner un amant.
ÉLÉGIE III.
Cette belle Élégie fut écrite à Corcyre. A son retour de l'Aquitaine, où Tibulle l'avait accompagné, Messala fut aussitôt envoyé en Asie, l'an de Rome 725. Notre poète le suivit, mais il tomba malade à Corcyre, et s'y arrêta. Broukhusius assure qu'après sa guérison, il rejoignit son protecteur. Il cite à l'appui l'Élégie vu, mais elle ne prouve rien. Il est plus probable que Tibulle revint de Corcyre à Rome, où l'attirait son amour. Il témoigne en effet le plus grand empressement de revoir ses foyers et sa maîtresse. Il jouit d'avance du plaisir que son retour va causer à Délie. Il dévoue aux Dieux infernaux ceux qui lui avaient conseillé ce voyage.
Qui sait même si cette maladie n'était pas un prétexte ; si Tibulle qu'on avait eu tant de peine à séparer de son amie, et qui avait allégué plusieurs fois des présages contraires, pour obtenir de nouveaux délais, ne se repentait pas d'avoir cédé aux sollicitations de l'amitié et aux séductions de l'avarice ? Il regrettait Pedum et Délie; il avait eu le mal de mer; il se crut ou voulut se croire en danger. S'il avait été bien sérieusement malade, l'aurait-il pu dire en si beaux vers ? Se serait-il amusé à décrire, avec tant de complaisance, le bonheur de l'âge d'or et les délices de l'Elysée ?
ÉLÉGIE IV.
Tibulle s'adresse à une statue du dieu des jardins; à celle peut-être dont il est parlé dans la première Elégie :
Un Priape rustique habite mon enclos,
Et sa faux menaçante écarte les oiseaux.
Et si, comme il est assez probable, Tibulle était en présence de l'image du Dieu auquel il s'adressait, il aurait donc composé cette pièce dans sa solitude de Pedum.
Les personnes qui peuvent lire l'original verront bien pourquoi plusieurs passages ont été altérés dans la traduction.
ÉLÉGIE V.
S'il est permis de hasarder une conjecture sur le temps où cette pièce a été composée, ou dira qu'elle ne peut être antérieure à l'an 727.
On peut croire aussi que cette pièce fut composée à Rome.
ÉLÉGIE VI.
Le surveillant dont Tibulle s'est déjà plaint est de nouveau mis en scène dans cette Elégie. Il est aussi question, pour la seconde fois, de la mère de Délie ; et le poète en parle de manière à montrer qu'il lui a de grandes obligations. Il exprime sa reconnaissance en termes si tendres, si affectueux, que l'on prend soi-même en amitié cette vieille, qui cependant ne paraît pas avoir joué, dans toutes ces intrigues, un rôle bien honorable.
ÉLÉGIE VII.
Cette pièce a été composée pour l'anniversaire de la naissance de Messala, peu de temps après son triomphe, auquel Tibulle avait probablement assisté.
De beaux vers descriptifs, et quelques détails tout-à-fait étrangers à Messala, font le principal mérite de ce poème. Il n'est donc pas irréprochable, car la première règle d'une composition de ce genre serait de rendre le héros intéressant.
Cette Élégie (si c'en est une) ne prouve pas que Tibulle ait suivi son protecteur en Asie. Le poète énumère les différentes contrées que ce célèbre Romain a parcourues ; mais il ne dit point qu'il en ait visité aucune avec lui, excepté l'Aquitaine.
ÉLÉGIE VIII.
C'est la première fois que nous voyons Tibulle occuper sa muse à chanter d'autres amours-que les siens. Il s'exprime dans cette Élégie d'une manière aussi naïve et aussi naturelle que dans les précédentes, et l'on voit bien qu'il ne s'exerce pas sur un sujet imaginaire. Marathus et Pholoë furent donc des personnages réels. Leurs amours, dont Tibulle était le confident, ont pu l'inspirer comme les siens même, et donner à sa poésie ce même caractère de vérité que l'on retrouve dans les autres pièces.
Marathus, jeune homme à qui Tibulle s'intéresse, est dédaigné par la belle Pholoë, la même peut-être que celle dont parle Horace (livre I, ode xxxiii; et livre II, ode v). Tibulle entreprend de la fléchir, et il plaide la cause de Marathus avec toute la chaleur de l'amitié. J'ai changé le nom de Pholoë en celui de Lesbie, parce que le premier vers où son nom s'est présenté l'a voulu ainsi, et que ce changement m'a paru sans conséquence.
ÉLÉGIE X.
On s'accorde à placer cette Élégie avant la troisième, dans l'ordre des temps. Tibulle l'aurait composée avant de partir pour l'Asie à la suite de Messala. Mais nulle part il n'y fait mention de Délie ; or, il était déjà son amant lorsqu'il résolut de suivre Messala dans ce voyage, et, il n'aurait pas manqué de mettre au rang de ses plus grands malheurs, la nécessité de quitter sa maîtresse. Il paraît donc que cette Élégie est encore plus ancienne, et qu'elle a été composée avant le départ de Tibulle pour l'Aquitaine.
L'ensemble de cette pièce, où les détails de la vie champêtre tiennent une si grande place, et l'apostrophe aux dieux Lares, formés d'un bois antique, hôtes vénérables du toit paternel, feraient présumer que Tibulle a écrit cette charmante Elégie dans sa maison de campagne.
La Fontaine a presque traduit Tibulle :
Jamais le ciel ne fut aux humains si facile.
Que quand Jupiter même était de simple bois :
Depuis qu'on l'a fait d'or, il est sourd à nos voix.
ÉLÉGIE I.
Il est facile de reconnaître que les Elégies de Tibulle ne sont pas classées d'après l'ordre chronologique, et nous en avons eu la preuve dans le premier livre. Cependant, il paraît qu'en général celles du second furent composées après celles du premier, et ainsi de suite. Cette pièce, et probablement toutes celles qui suivent, sont donc postérieures à l'an 727.
ÉLÉGIE II
Les conjectures de Heyne ne me semblent pas ici très heureuses. Il pense qu'il ne s'agit pas, dans cette pièce, du jour natal de Cérinthe, mais de celui de sa maîtresse. Cependant ces vers s'adressent à Cérinthe, et paraissent célébrer un événement qui le concerne lui-même. D'ailleurs ce passage : Ipse suos Genius adsit, etc., prouve qu'il s'agit du jour natal d'un homme, puisque c'était Juno natalis et non Genius, qui présidait au jour natal des femmes. (Voyez livre IV, Élégie VI.)
En second lieu, rien ne démontre que le Cérinthe., dont il est tant parlé dans le quatrième livre, fût un simple affranchi ou un étranger, comme Heyne le prétend ; et, bien qu'il soit ici question d'un mariage, il est permis de croire que les époux étaient ce même Cérinthe, et la fille de Sulpicius. Ajoutons que le nom de Cérinthe a bien l'air supposé, comme ceux de Délie, Lygdamus, etc.
Ceux qui se fondent sur la prétendue différence de style, pour contester à Tibulle la propriété du quatrième livre, ne me semblent pas avoir assez fait attention a cette petite Élégie, où l'on retrouve tous les caractères de celles qui terminent le recueil. C'est la même élégance, la même délicatesse de pensée et d'expression, la même latinité, enfin le même sujet. Supposé que cette pièce eût été placée, par exemple, entre la quatrième et la cinquième du quatrième livre, nul doute qu'on ne les eût considérées comme étant du même auteur. Au reste nous reviendrons plus tard là-dessus.
Malgré l'autorité des critiques, je ne changerais pas ici l'ancienne ponctuation.
Natalis est alors le Dieu du jour natal, et non ce jour même. (Voyez livre IV, Élégie V.)
ÉLÉGIE III.
Ici commencent les amours de Tibulle et de Némésis, sa dernière maîtresse, si l'on en croit Ovide. La chose n'est pas sans difficultés, puisque le troisième livre, qui fut sans doute composé après le second, est consacré aux amours de Tibulle et de Nééra. Ne pourrait-on pas répondre, comme nous l'avons fait, que notre poète avait sur Nééra des vues plus légitimes ; qu'elle était d'une naissance plus distinguée et de mœurs plus pures que les autres amantes de Tibulle ? En ce cas, Némésis aurait bien été sa dernière maîtresse, à prendre ce mot dans son acception défavorable.
J'ai changé le nom de Némésis en celui de Glycère, parce que ce dernier qui, selon le témoignage d'Horace, fut aussi celui d'une maîtresse de Tibulle, m'a paru plus agréable. Némésis rappelle la déesse fatale qui poursuit l'orgueil et le crime. On se la représente armée d'un glaive menaçant. D'ailleurs ce changement m'a paru sans conséquence. On aurait tort de changer Je nom de Délie; Délie est historique-mais ses rivales sont moins connues. Enfin, j'ai peut-être rencontré juste, puisqu'on a dit que Némésis était la même que Glycère.
La maîtresse de Tibulle est à la campagne. Il exprime le désir de se rapprocher d'elle. Il ne craindra pas, à ce prix, de se soumettre aux travaux rustiques les plus pénibles, et s'en consolera par l'exemple d'Apollon devenu berger. Vient ensuite un morceau qui, de l'avis des meilleurs critiques, n'est pas à sa véritable place, et que j'ai mis à part sous le titre de fragment.
Dans les vingt derniers vers de la pièce, l'auteur revient à son premier sujet, de sorte qu'en retranchant le fragment intermédiaire, tout le reste se trouve parfaitement lié. Il est même probable que l'Élégie, ainsi rétablie, n'offre point de lacunes. L'auteur s'adresse à Cérinthe; d'autres lisent Cornutus, mais c'est mal à propos. Ce Cérinthe est, je suppose, celui de la pièce précédente.
ÉLÉGIE IV.
Cette Élégie est une des plus passionnées du recueil. Properce a peu de morceaux où l'on trouve plus de chaleur. Il fallait que Némésis eût de grands torts pour exciter si vivement la verve de notre poète. Il l'appelle sœva puella; l'amour qu'elle inspira est une ardeur dévorante. Il lui reproche sa vénalité, et lui témoigne presqu'autant de mépris que de ressentiment. Il voudrait que, pour la punir, les dieux livrassent aux flammes sa demeure et ses trésors, et que personne ne prît la peine d'éteindre l'incendie.
Il n'eût jamais fait contre Délie des imprécations si cruelles. L'expression de son amour pour sa première maîtresse est bien différente. Quand Délie est coupable, c'est le cœur serré, les yeux pleins de larmes, que son amant lui reproche une infidélité bientôt pardonnée. Il se plaint ; il ne s'emporte pas.
Plus tard, le ton de Tibulle va changer encore, quand Nééra sera devenue l'objet de son amour. Ces effets n'ont sans doute pas été calculés ; mais ils rendent bien plus agréable la lecture de ses poésies, qui ne pourraient sembler monotones qu'à dos lecteurs inattentifs, ou incapables d'observer et d'apprécier ces nuances de sentiment.
ÉLÉGIE V.
Tibulle célèbre l'installation d'un fils de Messala, admis dans le collège des Quindecemvirs, c'est-à-dire des quinze prêtres chargés de garder et de consulter les livres sibyllins.
Il invoque d'abord Apollon, dieu des augures, et passe à l'histoire des livres sacrés. Ils furent donnés à Énée par la Sibylle, au moment où ce héros abandonna les rivages de Troie. Tibulle décrit incidemment l'état où se trouvait alors le berceau de Rome. Il revient ensuite à la Sibylle, et lui fait prédire quelques-uns des événements les plus remarquables qui suivirent l'arrivée d'Enée en Italie. Le poète, par une transition un peu brusque, passe aux prodiges qui avaient annoncé les malheurs de son siècle, JI implore Apollon, et le supplie de préserver désormais, l'empire romain de pareilles calamités. Annonçant bientôt des présages favorables, il célèbre le bonheur que va goûter l'univers, et son imagination lui figure d'abord d'abondantes moissons, de belles vendanges, des fêtes villageoises, où les plaisirs de l'amour ont une grande part. Jl en prend occasion de se plaindre des rigueurs de sa maîtresse. Il lui demande grâce, et la supplie de l'épargner, afin qu'il puisse célébrer, un jour, les triomphes du fils de Messala.
J'ai cru nécessaire de donner une courte analyse de cette pièce, dont la contexture est un peu frêle et dont quelques morceaux offrent des difficultés qui tiennent au défaut apparent de liaison. Avec un peu plus d'attention, l'on retrouve le fil conducteur, et l'on admire le poète qui a su tirer un si beau parti de son sujet, et rendre si intéressante l'installation d'un prêtre Sibyllin.
On rapporte cet événement à l'an 730, ou environ. Ce serait aussi la date du poème.
On est tenté, malgré l'autorité des anciens et celle de l'auteur lui-même, de refuser à cette pièce le titre d'Élégie. C'est un nouvel exemple qui prouve que le sens de ce mot a été beaucoup restreint par les modernes. Le rythme élégiaque pouvait s'appliquer à presque tous les genres, et celui dans lequel sa sont exercés Tibulle, Ovide et Properce, ne serait pas exactement caractérisé par les beaux vers de Boileau :
D'un ton un peu plus haut, mais pourtant sans audace,
La plaintive Élégie, etc.
Rien de moins plaintif qu'une bonne partie des élégies d'Ovide. Properce est plus passionné, plus audacieux que tendre, et le sensible Tibulle ne soupire pas sans cesse. Il a quelquefois assez de malice et de gaité. Il est souvent poète descriptif. Il lui arrive enfin, comme à ses émules, d'oublier les amours, et d'occuper la muse de l'élégie d'objets plus sérieux et plus grands. La première partie de ce poème en est un exemple remarquable. Elle fait regretter, que Tibulle, considéré mal à propos, par quelques modernes, comme incapable de sortir du cercle dans lequel il s'est presque toujours renfermé, ait traité si rarement des sujets d'un ordre plus élevé.
ÉLÉGIE VI.
Aemilius Macer, poète distingué, contemporain de Tibulle. Il avait écrit sur des sujets d'histoire naturelle. Ses ouvrages sont perdus. Il ne faut pas le confondre avec Pompéius Macer, autre poète qui a chanté la guerre de Troie, et qui avait aussi de la réputation.
Le troisième livre des élégies renferme les amours de Tibulle et de Nééra. On s'est donné inutilement beaucoup de peine pour contester à notre poète la propriété de cette partie de ses œuvres. On l'a attribuée à un certain Lygdamus, et l'on a cité l'épitaphe qui termine la seconde élégie :
Lygdamiu hic situs est, etc.
Mais qui ne voit que Tibulle s'est désigné lui-même sous ce nom d'emprunt, selon la coutume assez ordinaire des poètes de son temps ? Lygdamus signifie blanc, comme Albius et le premier de ces noms est mis pour l'autre.
Nééra a beaucoup embarrassé les savants. Les uns l'ont confondue avec Délie, Némésis ou Glycère; les autres ont soutenu que Tibulle n'était point son amant; et qu'il a parlé pour un autre. Enfin, l'on a dit aussi que c'était un personnage purement imaginaire.
La vérité d'expression, le naturel parfait qui distinguent encore ici les ouvrages de Tibulle, ne permettent d'adopter aucune des deux dernières opinions, et l'on a aussi de bonnes raisons pour croire que Nééra n'était ni Délie ni Némésis.
L'amour qu'elle inspire à Tibulle semble avoir quelque chose de plus délicat ; c'est une affection plus pure et plus tendre. Nulle part il ne lui adresse de ces reproches injurieux qui nous, font rougir pour ses autres maîtresses. Il ne dit point qu'elle eût les mœurs et les vices des courtisanes; et, quand il s'afflige de son infidélité, c'est de manière à nous laisser croire qu'elle abandonne son amant pour prendre un époux. Lui-même avait, ce semble, le projet de s'unir avec elle par les liens du mariage. Il parle de sa mère, de son père, d'une manière décente, et propre à nous persuader qu'elle était d'une naissance très honnête. Enfin ce troisième livre n'offre pas une image licencieuse, pas un mot qui puisse blesser la pudeur.
Le nom de Nééra que l'on trouvé dans Homère, ne prouve point du tout qu'elle fût d'origine grecque. Ce peut être un nom fictif, et la signification permettrait seulement de supposer que Nééra était extrêmement jeune.
Tibulle avait, j'imagine, le pressentiment de sa mort prématurée; il éprouvait, en quelque sorte, l'affaissement de la vieillesse, et songeait à s'attacher une jeune amie qui charmât ses derniers jours.
Une mélancolie plus profonde et plus tendre; des craintes d'une mort prochaine plus vivement exprimées; le désir de trouver, désormais, un repos amoureux dans les bras d'une épouse chérie; enfin, des regrets amers de voir ce rêve s'évanouir : voilà ce que l'on trouve dans ces Elégies consacrées à celle des maîtresses de Tibulle qui eût été vraisemblablement la plus digne de lui.
ÉLÉGIE I.
Tibulle fait, selon l'usage des Romains, un présent à sa maîtresse, le premier jour de Mars. Ce n'est point de l'or, ni quelque bijou, ce sont des vers, seule offrande qui mérite de fléchir la beauté.. On peut supposer que cette première Élégie n'est qu'un envoi, qui sert de dédicace pour les pièces suivantes.
La description du volume, et les soins que prend le poète pour qu'il paraisse avec avantage, pourraient donner matière à de longs commentaires. On renvoie aux auteurs qui ont écrit sur les antiquités.
ÉLÉGIE II.
On a éloigné Nééra de Tibulle. Il ne pourra supporter cette séparation cruelle, et, dans la pensée de sa mort prochaine, il décrit ses funérailles. Peut-être avait-on surtout en vue cette Élégie, quand on a dit que Tibulle parlait de la mort avec volupté. Un homme réduit à chercher des consolations dans de vaines cérémonies, ne pouvait en effet s'exprimer d'une manière plus touchante. Il entoure une affreuse réalité de gracieuses images, et donne du charme aux détails qui semblaient-en être le moins susceptibles.
ÉLÉGIE III.
Tibulle est toujours séparé de Nééra ; il conserve encore quelque espérance, mais il répète qu'il ne pourra vivre sans son amante. Cette Elégie renferme, il faut l'avouer, quelques lieux communs qui la rendent plus difficile à traduire, les vers ne pouvant avoir d'autre mérite que l'élégance et le naturel. Mais aussi ces qualités précieuses donneraient toujours un air de fraîcheur et de nouveauté à des sentiments exprimés mille fois.
ÉLÉGIE IV.
Tibulle a vu en songe Apollon. Ce Dieu lui a prédit que Nééra serait volage, et lui a conseillé de redoubler de soins pour fixer le cœur de sa maîtresse. Ce sujet est bien simple ; il fournit cependant à notre poète une de ses plus longues élégies. Heyne la juge sévèrement. Il y voit beaucoup de choses inutiles. Il est vrai que cette pièce est plus ornée que la plupart des autres, et que le poète s'y complaît davantage dans les descriptions. Mais il s'agissait d'un songe, d'une révélation surnaturelle, et le récit d'un événement merveilleux comporte des couleurs plus brillantes et une plus grande richesse d'images.
Heyne ajoute que le poète fait intervenir Apollon pour un motif bien frivole. Il n'était pas frivole pour Tibulle, et c'est ce qu'il fallait considérer..Le célèbre critique me semble bien rigoureux. Le Dieu des vers et des augures avait qualité pour annoncer à son favori le malheur qui l'attendait. D'ailleurs, le plus chétif des hommes a-t-il rêvé que toutes les puissances célestes se sont occupées de lui pendant son sommeil, la poésie doit adopter avec empressement, et mettra en œuvre avec succès, une fiction si consolante et si propre à relever la dignité humaine, ou plutôt à déguiser notre faiblesse.
ÉLÉGIE V.
C'est là seconde fois que Tibulle malade s'adresse à des amis obligés de se séparer de lui. (Voyez livre I, Elégie III.) Il leur parle toujours avec une effusion de cœur qui prouve que l'amour était loin d'avoir étouffé chez lui les autres affections.
ÉLÉGIE VI.
Tibulle, malheureux en amour, cherche des consolations au milieu des plaisirs de la table. De toutes ses Elégies, il n'en est point qui offre des mouvements plus rapides et des transitions moins ménagées. On y reconnaît l'influence du Dieu qui inspire le poète ; on y trouve quelque chose de la fougue dithyrambique.
I. PANÉGYRIQUE DE MESSALA.
On n'a pas traduit en vers le panégyrique de Messala, parce qu'il offre aujourd'hui peu d'intérêt. On donne toutefois une version en prose, pour faciliter à quelques personnes la lecture de l'original, et, dans ce but, on s'est rapproché du texte le plus qu'il a été possible.
Plusieurs ont pensé que Tibulle n'était pas l'auteur de cet ouvrage. On l'a trouvé peu digne de lui. Mais ce jugement, assez sévère, étant la seule raison que l'on puisse alléguer, et d'ailleurs les manuscrits et les éditions qui pouvaient faire autorité, ayant donné ce poème sous le nom de Tibulle, il serait tout au plus permis d'exprimer quelques doutes sur son authenticité. Ces doutes s'affaibliront encore par les considérations suivantes :
1° On n'a pas lieu de s'étonner que Tibulle ait occupé sa muse à célébrer la gloire de Messala. Le nom de cet illustre Romain revient très souvent dans les vers de notre poète. On était, en quelque sorte, préparé à trouver dans son recueil ce panégyrique, et, jusqu'à preuve du contraire, on doit le lui attribuer plutôt qu'à tout autre.
2° Déjà dans l'Élégie VII du livre I, Tibulle a traité le même sujet, et il a montré qu'il savait peu louer. Cette Élégie a quelques-uns des défauts reprochés au panégyrique. Elle est un peu froide ; elle ne rend pas le héros intéressant ; elle est pleine de détails étrangers à Messala. Ou y remarque ces mêmes énumérations, plus ou moins fastidieuses, de localités ou d'événements.
3° Si cet ouvrage est apocryphe, celui qui l'a composé a voulu nous donner le change, et le faire attribuer à Tibulle, puisque l'on y parle en son nom, que l'on rappelle ses malheurs, la perte de sa fortune, comme dans la première Elégie. Ce déguisement annoncerait un auteur assez moderne, et, d'un autre côté, le style (que l'on s'accorde à louer) est celui du siècle d'Auguste. La latinité est très pure, très belle ; et, quoique l'ensemble de l'ouvrage ne mérite pas de grands éloges, on y trouve des morceaux qui ne peuvent avoir été composés que par un écrivain du premier ordre.
4°. Il est d'autant plus permis d'attribuer ce poème à Tibulle, que plusieurs passages prouveraient qu'il était fort jeune quand il le composa. Ce fut probablement un de ses coups d'essai, car une seule de ses Élégies, la dernière du premier livre, pourrait être antérieure à la guerre d'Aquitaine, encore devrait-il l'avoir composée peu de temps avant son départ pour cette expédition (en 724) ? tandis que le Panégyrique date probablement du commencement de 723, année du consulat de Messala. Tibulle célèbre cet événement-, et ne parle d'aucun de ceux qui l'ont suivi, comme la guerre d'Aquitaine, l'expédition d'Asie, le triomphe de son héros.
5° Si cet ouvrage n'était pas de Tibulle, il n'aurait pas été composé dans le temps que nous venons de déterminer, mais beaucoup plus tard ; et cependant l'on aurait complètement omis les circonstances les plus glorieuses de la vie de Messala ! Ces omissions me paraissent une des plus fortes preuves de l'authenticité du Panégyrique.
II. SULPICIE.
Les amours de Sulpicie et de Cérinthe font le sujet de presque tout le reste du quatrième livre. Heyne et Broukhusius estiment que Tibulle n'est pas l'auteur de ces petits poèmes. Vulpius et Ayrmannus sont d'un avis contraire. Leur opinion est aussi la mienne, et voici les raisons que j'alléguerais pour la soutenir.
1° Les manuscrits qui nous ont conservé les poésies de Tibulle renfermant ce quatrième livre, et ne disant point qu'il soit d'un autre que lui, il faut présumer que Tibulle en est l'auteur.
2° Les savants n'ont pu d'ailleurs démontrer que le quatrième livre dût être attribué à tel autre poète. Heyne avoue qu'il est à cet égard dans une complète ignorance. Broukhusius parle de Sulpicie qui vécut sous Doinitien, qui fit la satire que nous possédons encore sous son nom, et à qui l'amour conjugal inspira des poésies louées par Martial et d'autres auteurs. Mais le mari de cette jeune muse s'appelait Calenus, et non Cérinthe. D'ailleurs, les amours de notre Sulpicie ont quelque chose de furtif, et ceux de l'épouse de Calenus ne pouvaient offrir ce caractère. Enfin U est question d'un Messala dans ce quatrième livre, et il serait bien surprenant que le nom de cette famille eût figuré successivement dans deux, recueils de poésies de ce genre, l'un publié sous Auguste, l'autre sous Domitien.
3° Le nom de Messala, qui est un argument contre l'opinion de Broukhusius, en est un en faveur de la nôtre. On est accoutumé à voir ce nom dans les ouvrages de l'amant de Délie ; on osera dire que des vers où il est question de Messala, sont probablement de Tibulle.
4° Il a déjà parlé d'un Cérinthe dans les autres parties de son recueil. (Voyez livre II, Elégie II, et la note. Voyez aussi l'Elégie m du même livre.) Il est bien probable que ce Cérinthe est le même que l'amant de Sulpicie.
5° Bien plus, Tibulle se nomme lui-même dans une des Elégies du quatrième livre.
Nunc licet e cœlo mittatur amica Tibullo.
Peut-on croire que cette pièce soit de lui, et que celles qui la précèdent et la suivent n'en soient pas également?
6° L'épitaphe du poète, composée par Domitius Marsus son contemporain, termine le livre. Aurait-on placé cette épitaphe (dont l'authenticité n'est d'ailleurs point suspecte) à la fin d'un recueil étranger?
7° Enfin, que l'on compare avec la seconde Elégie du second livre, qui est certainement de Tibulle, tous ces petits poèmes dont on voudrait lui enlever la propriété, et que l'on juge si le sujet, la couleur, le style, tout, jusqu'à l'étendue des morceaux, n'a pas les plus grands rapports. Qu'en lisant ce quatrième livre, on parcoure les notes de Heyne ; où cet excellent critique renvoie aux passages correspondants qui se trouvent dans les parties du recueil reconnues pour authentiques, et l'on sera surpris de trouver, dans un si petit nombre de vers, tant d'expressions, de tournures, de sentiments et de pensées, qui annoncent que celui qui a composé les trois premiers livres, est aussi l'auteur du dernier.
Une seconde question se présente : les amours de Sulpicie et de Cérinthe furent-ils véritables, ou bien ne sont-ils qu'une invention du poète ?
On pourra dire, à l'appui de la dernière supposition, que l'ensemble des pièces qui roulent sur ce sujet, semble former un petit roman qui a son introduction, sa marche, son dénouement; que souvent, il est vrai, Tibulle parle en son nom, comme le ferait le confident d'un jeune couple, mais que souvent aussi il fait parler Sulpicie elle-même, et que cet artifice oratoire paraît déceler un écrivain qui se donne carrière dans un sujet de son invention. Mais le nom de Sulpicie, qui était celui d'une illustre famille de Rome, mais celui de Cérinthe, qui doit avoir désigné un personnage bien réel, puisque Tibulle. s'adresse deux fois à lui dans le second livre, où il ne s'agit pas de vaines fictions, mais surtout ce naturel parfait qui donne si bien aux vers de Tibulle l'air de poésies de circonstance, tout cela peut nous persuader que Cérinthe et Sulpicie ne furent point des êtres imaginaires, et que leur ami commun se plaisait à revêtir des charmes de sa poésie les sentiments dont ce jeune couple ne craignait pas de lui confier le secret.
III. LA CHASSE.
La chasse était, en général, un amusement réservé aux classes supérieures de la société. Ainsi donc cette Élégie, en permettant de supposer que la naissance de Cérinthe ne le plaçait pas à une trop grande distance de Sulpicie, nous autorise à croire que dans l'Elégie II, livre II, c'est bien Sulpicie qui est désignée comme l'épouse de Cérinthe.
VIII. LE DÉPART.
Le jour anniversaire de sa naissance ou de celle de Cérinthe, Sulpicie est invitée, sans lui, à se rendre à la campagne. Ses regrets font le sujet de cette petite pièce.
Eretum était un bourg du pays des Sabins, sur la voie Salaria, non loin du Tibre. Il dominait une colline appelée aujourd'hui Monte ritondo.
Le fâcheux qui entraine Sulpicie à la campagne s'appelle Messala. Est-ce l'ami de Tibulle ? Était-il rival de Cérinthe?
XIII. TIBULLE A SON AMIE.
Racine le fils a traduit, dans son Poème de la Religion, une grande partie de cette pièce, et il adresse à Jésus-Christ ce que Tibulle adressait à sa maîtresse :
Ma seule ambition est d'être tout à toi, etc.
XV. SUR LA MORT DE TIBULLE.
Ce quatrain est de Domitius Marsus, poète célèbre par ses épigrammes. Il vivait du temps d'Auguste. Cette petite pièce est tout ce qui nous reste de lui.
FIN DES NOTES.
[1] Voyez cependant le Tibulle de M. de Golbéry (Collection des classiques latins, par M. Lemaire), et les travaux remarquables de ce savant qui, nous devons l'avouer, rapporte la naissance, de Tibulle à l'an 710 ou 711.
[2] Nous verrons que Tibulle en est l'auteur.
[3] Poète épique très distingué, dont les ouvrages sont perdus. Horace le met au nombre des personnes dont il souhaiterait d'obtenir le suffrage. (Livre I, Satire x.) Il lui adressa une Ode sur la mort de son fils. On ignore absolument quels sujets Valgius avait traités. Il nous reste de lui deux vers qui devaient faire partie d'une églogue. On parle aussi de ses élégies et de ses épigrammes.
[4] Énée, fils d'Anchise et de Vénus.
[5] Orphée, fils d'Apollon et de Calliope.
[6] Linus, aussi fils d'Apollon et de Calliope, ou de Terpsichore.
[7] Voyez livre I, élégie III.
[8] Voyez même élégie, le commencement. Ovide ne songeait guère alors qu'il n'éviterait pas ce malheur.
[9] Voyez livre I, élégie i
[10] Cornélius Gallus, préfet d'Egypte et favori d'Auguste. Il fut, dit-on, accusé d'avoir conspiré contre lui, et condamné par sentence du sénat. Il mit fin a ses jours par une mort volontaire. C'était un poète très distingué.