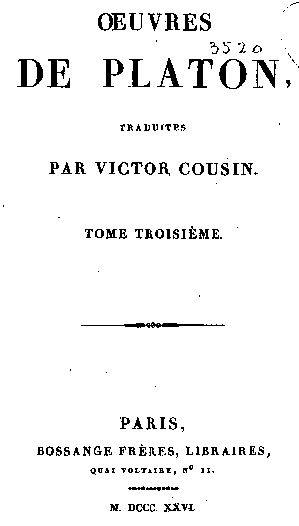
PLATON
GORGIAS
Oeuvres de Platon
Victor Cousin
| Protagoras | tome III - tome IV | Lysis |
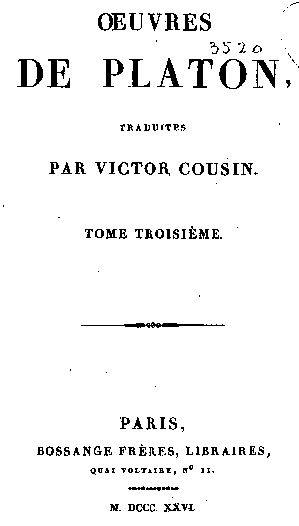
Pour avoir le texte grec d'une page, cliquer sur le numéro de page (entre [].)
|
page 127 GORGIAS, ou DE LA RHÉTORIQUE. page 128 (page blanche) page 129 ARGUMENT PHILOSOPHIQUE. « ON n'est pas d'accord, dit Olympiodore, sur le vrai but du Gorgias. Les uns prétendent qu'il s'y agit seulement de la rhétorique, sans autre motif, sinon que Socrate, dans sa discussion avec Gorgias, ne parle que de la rhétorique, caractérisant ainsi tout le dialogue par une seule de ses parties. D'autres soutiennent que le Gorgias traite du juste et de l'injuste, parce qu'il y est dit que l'homme juste est heureux et l'homme injuste misérable, d'autant plus misérable qu'il est plus injuste et qu'il l'est plus longtemps ; ne s'apercevant pas que ce point de vue est lui-même partiel, et ne se rapporte encore qu'à la discussion de Socrate avec Polus. D'autres enfin voient dans le Gorgias page 130 un dialogue théologique, à cause de l'épisode mythologique qui le couronne ; et ceux-ci se trompent encore plus que les autres. Pour nous, nous pensons que le but du Gorgias est l'exposition des principes sur lesquels repose le bonheur public (01) ..... Le Gorgias, dit plus loin Olympiodore, se divise en trois parties : la première, qui comprend la discussion de Socrate avec Gorgias ; la seconde, la discussion avec Polus ; la troisième, la discussion, avec Calliclès. » Les critiques modernes ne sont guère plus d'accord entre eux que ceux de l'antiquité. Le Gorgias contient tant de choses, et le lien qui unit toutes ses parties, est si délicat, que, pour peu que ce lien échappe, on peut supposer à ce grand dialogue les buts les plus divers, selon celle de ses parties dont on est frappé davantage ; et comme les considé- page 131 rations morales et politiques qui remplissent tout le milieu du Gorgias sont bien propres à fixer l'attention, elles devaient paraître aux yeux les plus exercés le centre et le but du dialogue ; aussi Scheiermacher lui-même finit-il par incliner à l'opinion d'Olympiodore. Rien de plus naturel, et pourtant, selon nous, rien de plus inexact. Selon nous, le vrai but du Gorgias est la rhétorique, comme le veut l'opinion la plus vulgaire et la seconde inscription du dialogue, quel qu'en soit l'auteur. Nous rendons hommage à la sagacité d'Olympiodore, qui a très bien compris que tous les points de vue de ses devanciers s'appliquent à une seule partie du dialogue; mais nous croyons que son point de vue a le même défaut ; qu'il ne rend pas compte de l'ouvrage tout entier, et que, pour le maintenir dans sa rigueur, il faudrait lui sacrifier toute la partie du Gorgias qui roule sur la rhétorique, et qui n'aurait plus page 132 alors aucune valeur en elle-même. Nous admettons volontiers la division qu'Olympiodore propose du dialogue en trois parties qui se rapportent à Gorgias, à Polus et à Calliclès, et nous croyons qu'en effet cette division embrasse tout l'ouvrage ; mais nous pensons que, si cette division est fondée, si les trois parties du dialogue sont liées l'une à l'autre, comme elles doivent l'être, si la troisième dérive de la seconde, et la seconde de la première, les deux dernières ne sont et ne peuvent être que des développements de la première, et que c'est dans celle-là qu'il faut chercher, avec le motif des deux autres, le but de tout le dialogue. Or, la première partie du Gorgias, la discussion de Socrate avec Gorgias roule incontestablement sur la rhétorique. Si le sujet de la première partie du Gorgias est la rhétorique, que sont les autres relativement à celle-là? Des preuves nouvelles, des principes du haut desquels le résul- page 133 tat obtenu dans la première partie s'aperçoit mieux ; et comme il est dans la nature des principes d'être plus généraux que la conséquence à laquelle ils doivent mener, les deux dernières parties du Gorgias ne peuvent démontrer la première, que précisément à condition de la surpasser en généralité, en grandeur et en intérêt ; de là l'illusion de Schleiermacher et d'Olympiodore. Socrate engage la discussion avec Gorgias sur la rhétorique, qu'il traite sévèrement. Gorgias la défend et se défend lui-même avec la finesse et la mesure que lui attribue l'histoire ; mais comme il est âgé, qu'il est étranger à Athènes, et y remplit Une mission diplomatique, il ne se livre à la discussion qu'avec une certaine réserve ; et quand elle entre dans le fond des choses, il cède la parole à son disciple Polus, jeune homme plus propre à soutenir une discussion un peu vive. Or, pour traiter à fond la question de la rhétorique, il faut avoir résolu celle du juste et de l'injuste, page 134 car la justice est la matière même de la rhétorique, puisque l'orateur parle toujours dans l'assemblée du peuple, pour ou contre des lois qu'il croit justes ou injustes, et, devant les tribunaux, dans des causes civiles ou politiques, pour ou contre un accusé qu'il veut faire considérer comme ayant agi justement pu injustement. Il faut savoir, si la rhétorique peut rien se permettre contre la justice, car de la solution de ce point dépend, l'idée que nous devons nous faire de la rhétorique. La seconde partie du Gorgias, ou la discussion avec Polus, doit donc être considérée comme une suite nécessaire de la première, et la troisième, la discussion avec Cal lie lès, n'étant évidemment que le développement et la généralisation de la seconde, puisqu'on y traite encore de la justice, mais avec plus d'étendue et de rigueur, se rapporte encore à la première, et par conséquent, à la rhétorique, En effet, la discussion avec Calliclès achevant de démontrer que la jus- page 135 tice est la règle absolue de nos actions, non seulement d'après les institutions sociales, mais selon là vérité des choses, il suit que la rhétorique ne peut rien se permettre contre là justice, et que si la rhétorique s'écarte de la justice, elle se met en dehors et de l'ordre social et de l'ordre naturel, qui tous deux proclament la justice comme la loi suprême de l'humanité, et attachent à son infraction des suites terribles et inévitables. De là, des conséquences en conséquences, cet épilogue mythologique où les suites de l'injustice non expiée en ce monde sont renvoyées à un autre où il n'y a plus d'ajournement ; épilogue qui se rapporte toujours à cette conclusion, que la rhétorique, qui ose se mettre en contraduction avec la justice, qui sauve son client, même coupable, et ne regarde que le succès du moment, cette rhétorique est à la fois et une bassesse pour celui qui l'emploie, et une calamité pour celui qu'elle croit sauver. Donc toutes les parties du Gorgias tiennent page 136 l'une à l'autre; donc toutes ont un but commun, la réfutation de la fausse rhétorique; donc la rhétorique est le vrai but du Gorgias, et les principes supérieurs auxquels Platon en appelle ne sont dans toute leur sublimité que la route nécessaire pour arriver logiquement à la conséquence qu'il voulait établir. Et si l'on objecte que cette conséquence est bien peu importante pour une discussion aussi élevée, nous répondrons que c'est méconnaître entièrement la place de la rhétorique dans l'ordre social de l'antiquité, où toutes les affaires publiques et privées se traitant devant le peuple entier ou devant une portion considérable du peuple, la parole était l'instrument universel, l'éloquence la condition de toute influence, et la rhétorique l'étude obligée de tout homme d'état. Le but, la place et la liaison de toutes les parties du Gorgias ainsi déterminés, on suit aisément Platon dans la longue carrière qu'il page 137 parcourt librement sans s'arrêter à en marquer les intervalles. Déjà du temps de Platon la rhétorique s'était définie elle-même l'art de persuader; et cette définition est encore celle qu'elle garde aujourd'hui. Si la définition est exacte, c'est-à-dire complète, elle ne doit supposer rien au-delà ; elle n'admet aucunes réserves secrètes qui puissent la modifier, la resserrer ou l'étendre, et y introduire aucun élément étranger. Si donc la rhétorique est l'art de persuader, et rien autre chose, c'est la persuasion qu'elle opère, et rien de plus ; la persuasion, dis-je, prise en elle-même, et quelle qu'elle soit. Mais qu'est-ce que la persuasion en elle-même? une croyance, une opinion. Or, il y a des croyances et des opinions fausses, comme il y en a de vraies. La rhétorique ou l'art de persuader est l'art de produire les unes comme les autres; autrement il faut changer la définition, et la changer c'est la détruire. page 138 Pour maintenir la définition qu'elle s'est faite elle-même, la rhétorique est donc contrainte de reconnaître que son objet est de persuader dans les limites de la vérité ou en dehors de ces limites, pourvu qu'elle persuade ; qu'elle est une ouvrière d'erreur aussi bien que de vérité, ou plutôt qu'il n'y a pour elle ni faux ni vrai ; qu'elle ne s'occupe ni de l'un ni de l'autre, mais seulement; du succès, par quelque route qu'elle y arrive; qu'elle est indifférente à la vérité ou au mensonge, c'est-à-dire, qu'elle est essentiellement un art de mensonge, puisque tout est mensonge là où le mensonge et la vérité peuvent être arbitrairement employés. De là toutes les conditions de la rhétorique, et la plus caractéristique de toutes, la condition de parler devant des auditeurs qui ne connaissent pas la matière sur laquelle on leur parle; car avec un auditoire éclairé, la rhétorique n'a plus qu'un seul moyen de succès, la vérité: et dans ce cas la puissance de page 139 la rhétorique est limitée ou détruite, puisque alors sa puissance n'est plus que celle de la vérité. Ainsi, pour déployer une puissance qui lui soit propre, il faut que la rhétorique ait affaire à des ignorants ; et comme sur toutes choses le nombre des hommes instruits est très petit, il faut que là rhétorique ait à faire à la multitude, comme représentant l'ignorance ; de sorte qu'à parler rigoureusement, la rhétorique; ou l'art de persuader n'est que l'art de trouver des expédients mensongers pour paraître savoir, sans savoir en effet aux yeux de gens qui ne savent pas ; pour paraître juste, homme de bien, bon citoyen, sans l'être; enfin, pour mettre partout l'apparence à la place de la réalité. S'il en est ainsi, la rhétorique n'est point un art. En effet, la rhétorique ne réussit qu'en flattant les parties inférieures de la nature humaine, tandis que. le caractère de F art est de s'adresser à ce qu'il y a de plus noble en nous, et de réveiller les sympa- page 140 thies puissantes, mais cachées, de l'âme avec la vérité par l'intermédiaire de la beauté, employée comme une forme de la vérité elle- même. Le beau est agréable, et l'art plaît sans doute ; mais l'agrément n'est pas la beauté, et l'art se propose autre chose que de faire plaisir. La rhétorique, indifférente à la vérité, substitue l'agrément à la beauté, et cherche seulement à plaire. La rhétorique n'est donc pas un art : c'est une routine sans principes, dit Platon, ἐμπειρία τις, une pratique servile, un métier qu'il ne craint pas de comparer aux métiers les plus bas, à celui de la cuisine, par exemple ; car tous deux ont le même but, savoir le plaisir, et tous deux ne sont que deux espèces diverses d'un même genre, la flatterie. Telles sont les conséquences qui sortent naturellement de la définition convenue de la rhétorique; et nous doutons que la rhétorique ancienne ou moderne puisse y échapper. Nul avocat, nul académicien ne pourrait faire une plus belle page 141 défense que Gorgias, et cependant il est forcé de reculer devant le bon sens et la dialectique inexorable de Socrate. Polus vient à son secours, et, sans s'en douter, soulève des questions qui tournent contre lui et accablent la rhétorique. Il s'avise de la défendre par les résultats qu'elle donne. L'élève de la rhétorique, l'orateur, dit Polus, domine les juges, et les assemblées du peuple, et peut perdre ses ennemis, les ruiner, les bannir, les faire mettre à mort, ou servir ses amis et soi-même ; il en est le plus heureux des hommes puisqu'il en est le plus puissant, et il est tout-puissant, puisqu'il fait tout ce qu'il veut. Non, répond Socrate, l'orateur n'a pas de pouvoir pour cela qu'il peut ruiner, bannir ou mettre à mort ; car à ce compte on pourrait dire que le plus scélérat des hommes en est le plus puissant, puis qu'il peut à tout moment incendier ou égorger, pourvu qu'il parvienne à échapper au châtiment. L'audace impunie n'est pas page 142
du pouvoir ; le pouvoir est, il est vrai,
de faire ce qu'on veut ; mais il faut bien distinguer entre les déterminations
régulières de la volonté et les caprices déréglés du désir. La volonté se
rapporte essentiellement au page 143 peu subtilement, on ne veut pas son mal, quoique souvent on le fasse, on ne veut que son bien ; on ne veut donc que le bien. On ne veut pas, à proprement parler, la chose que l'on fait en vue d'une autre; on ne vent que la chose en vue de laquelle on fait ce qu'on lait. Ce n'est pas la médecine amère que l'on veut, mais la santé qu'elle peut donner; ce n'est pas le crime que l'on veut, mais le bien qu'on espère au-delà. D'où il suit que l'homme ne voulant que le bien, s'il fait le mal, il ne le veut pas ; il ne fait donc pas ce qu'il veut en faisant le mal ; il n'a pas de pouvoir. L'élève de la rhétorique, comme le tyran, s'il ne fait pas le bien, ne veut pas ce qu'il fait ; il n'est pas puissant. Reste à prouver qu'il n'est pas heureux. En quoi peut consister le bonheur d'un être? Que l'on y pense sérieusement et qu'on voie s'il est possible que le vrai bonheur d'un être soit ailleurs que dans son rapport le plus intime à sa loi, et s'il est possible que page 144 la loi d'un être soit ailleurs que dans sa vraie nature. Or, qu'est-ce que l'homme ? une nature intelligente et libre, dont la loi par conséquent est la vérité et la justice. Le rapport de l'homme à la justice et à la vérité, voilà sa loi, voilà l'ordre pour lui et son vrai bonheur ; être en dehors de la justice et de la vérité, voilà pour lui le désordre et la misère. C'est donc dans l'âme que gît réellement le bonheur et le malheur ; c'est dans les profondeurs de l'homme invisible que se passent les évènements heureux ou malheureux de la vie. On ne peut dire d'un homme, fût-il le grand roi, dit Platon, s'il est heureux ou malheureux, tant qu'on ne sait pas où en est son âme par rapport à la science et à la justice. Plus il y a d'injustice et d'ignorance, plus il y a de malheur réel, quel que soit le bonheur apparent. Si donc le malheur véritable est l'infraction à l'ordre, il suit que le malheur est de commettre une injustice et non de la recevoir, d'être tyran, page 145 non d'être victime, d'être oppresseur, non d'être opprimé, et qu'ainsi l'orateur est loin d'être heureux parce qu'il peut être injuste, encore moins parce qu'il peut l'être impunément. En effet, non seulement l'ordre condamne toute injustice; mais quand une injustice a été commise, l'ordre y attache une peine, obligatoire pour l'être moral. Éluder cette peine, c'est faire à l'ordre une infraction nouvelle, c'est s'enfoncer encore plus le désordre et dans le malheur. Pensons-y bien. La vraie existence est celle de l'intelligence. Le vrai, le juste, le bien, le beau, l'ordre seul existe substantiellement ; le faux, l'injuste, le mal, le désordre tentent d'être en quelque sorte, sans pouvoir entrer en possession de l'existence. Le mal et le désordre sont des négations. La peine ou la satisfaction à la loi qui attache à l'injustice l'obligation d'une réparation douloureuse, est déjà un retour à l'ordre et à la véritable existence; c'est à son tour une négation de la page 146
négation du crime qu'elle rachète ou
qu'elle abolit, et par conséquent un bien. Au contraire, qu'est-ce que
l'impunité, à parler philosophiquement ? Ce n'est pas autre chose qu'une
tentative plus ou moins vaine pour donner de .l'existence et de la durée à ce
qui n'en peut et n'en doit pas avoir : c'est la tentative déplorable d'une
séparation radicale d'avec l'ordre ; c'est le sceau mis sur le crime, et par
conséquent sur le malheur. De là la maxime de Platon, que l'injustice est déjà
un grand mal, mais que l'injustice impunie est le plus grand et le dernier des
Ces considérations décisives qui dominent la discussion ne nous dispensent pas de faire connaître des arguments d'un ordre inférieur, rigoureux, mais subtils, qui occupent dans Platon une très grande place, et que le lecteur ne sera peut-être pas fâché de trouver ici resserrés et résumés en peu de mots. Pour prouver à Polus qu'il vaut mieux re- page 147 cevoir une injustice que de la commettre, Socrate part de l'identité du bien et du beau, identité qui, dans la philosophie de Platon, a le rang et l'autorité d'un principe. A considérer la question sous le rapport de la beauté, tout le monde convient qu'il n'est pas beau de commettre une injustice, et qu'il est plus contraire au beau de la commettre que de la recevoir. Tel est le sentiment universel du genre humain, qu'on ne peut rejeter sans rejeter sa propre nature. Maintenant de quoi se compose l'idée du beau ? de l'agréable et du bien (τὸ ἀγαθὸν) en toutes choses, pour les figures, les couleurs, la musique, les sciences, la morale. Le beau étant donc le bien et l'agréable, le laid se définit par les contraires, savoir, ce qui est douloureux et mauvais. Si donc il est plus laid de faire une injustice que de la recevoir, c'est évidemment parce que cela est ou plus douloureux, ou plus mauvais. Or est-il plus douloureux de faire une injustice que de la page 148 recevoir? Non. Ce n'est donc pas à cause de la douleur que l'injustice est laide; ce n'est pas par conséquent à cause de la douleur et du mal pris à-la-fois ; c'est donc le mal en lui-même qui nous fait regarder l'injustice comme plus honteuse à commettre qu'à recevoir, et l'injustice ne blesse le sentiment du beau que parce qu'elle est contraire à la notion du bien. D'où il suit que le consentement universel dépose qu'il est mieux de recevoir l'injustice que de la commettre. Mais le bien dans son opposition à l'agréable, c'est l'utile en soi. Aussi dans l'application Platon emploie souvent le mot ὀφέλιμον pour synonyme d'ἀγαθόν. Or nul ne préférant le laid au beau, le mal au bien, le nuisible à l'utile, Socrate a donc démontré à Polus que lui-même n'aimerait pas mieux faire une injustice que de la recevoir. Voilà pour la première maxime. — Quant à la seconde, savoir, que la punition de l'injustice vaut mieux que son impunité, le raisonnement de Socrate page 149 n est pas moins concluant, et il est du même genre que le précédent. Être puni de l'injustice qu'on a commise, c'est être puni justement. Or, d'après le sentiment universel, tout ce qui est juste est beau; et si punir justement est beau, l'effet ayant le caractère de sa cause, être puni est beau conséquemment ; et le beau étant le bien, c'est-à-dire étant ou agréable ou utile, comme on l'a dit plus haut, à défaut de l'agrément, qui ne se rencontre pas dans la punition, il faut que l'utilité y soit. Mais relativement à quoi ? relativement à l'âme. L'âme a ses biens et ses maux comme le corps a les siens. Les maux du corps sont la pauvreté, la maladie, l'obscurité, les pertes et les privations physiques; ceux de l'âme sont l'ignorance, la lâcheté, l'intempérance, l'injustice. Mais le sentiment intime du genre humain et l'opinion universelle faisant regarder les maux de l'âme comme plus honteux et plus laids que ceux du corps de toute la différence de la beauté de l'âme d'avec celle page 150 du corps; donc, dans la théorie de l'identité du beau et du bien, les uns sont de plus grands maux que les autres ; et, toujours dans la même théorie, comme ils ne sont pas tels parce qu'ils causent une douleur plus grande, il reste que ce soit parce qu'ils sont plus nuisibles. Les maux de l'âme, et parmi eux l'injustice, sont donc les maux les plus nuisibles, les derniers de tous les maux. La médecine est la réparatrice du corps; la puissance judiciaire, la justice (ἡ δίκη), est la libératrice de l'âme. La justice est plus belle que la médecine : elle est donc meilleure; et comme la médecine n'agit pas par le plaisir, mais par la douleur, c'est aussi par la douleur que la justice agit et délivre l'âme. Le coupable qui évite la punition est un malade qui évite le fer et le feu qui seuls peuvent le sauver, sans se douter que tous ses efforts pour échapper à la punition qu'il mérite, n'ont d'autre effet que d'empêcher qu'il soit délivré de son mal. La conclusion de tous ces raisonnement page 151 est que notre premier soin doit être de ne commettre aucune injustice, et le second, quand nous en avons commis une, d'invoquer la punition au lieu de l'éviter, et de nous hâter de nous délivrer par elle de cette triste maladie de l'injustice et du désordre, qui pourrait, en séjournant dans l'âme, y engendrer une corruption incurable. Maintenant appliquons tout ceci à l'éloquence. Loin que l'orateur soit heureux de pouvoir commettre l'injustice à son profit ou au profit de ses amis, il en est profondément malheureux ; loin qu'il soit heureux de pouvoir par la rhétorique assurer à lui-même ou à d'autres l'impunité de l'injustice, cette impunité est pour lui et pour eux le dernier des malheurs; et si la rhétorique voulait être vraiment utile, elle devrait faire précisément le contraire de ce qu'elle fait, et au lieu de défendre un client coupable contre la juste sentence d'une punition salutaire, elle devrait la solliciter en son nom comme un bienfait. page 152 Écoutons Platon. « Votre ennemi, dit-il à l'orateur, a-t-il commis une injustice, et voulez-vous lui nuire? faites tout pour l'empêcher d'être cité devant un tribunal. Ne pouvez-vous l'empêcher ? Il faut le tirer d'affaire à tout prix; de sorte que, par exemple, s'il a volé de l'argent, il ne le rende pas, mais le garde ou l'emploie en dépenses criminelles; si son crime mérite la mort, qu'il ne la subisse pas, et, s'il se peut, qu'il ne meure jamais et soit immortel dans le crime. S'agit-il, au contraire, d'un de vos amis, ou de vos proches, ou de vous-même ? Hâtez-vous d'exposer le crime au grand jour; présentez-vous de bon cœur à la justice, comme au médecin, pour souffrir les incisions et les brûlures sans regarder à la douleur; il ne faut penser qu'à ce qu'on a mérité. Sont-ce des fers? il faut leur tendre les mains ; une amende? la payer; l'exil? s'y condamner; la mort? la subir; enfin il faut déposer contre soi-même, et mettre en œuvre toutes les res- page 153 sources de la rhétorique, afin que, par la manifestation et la correction de son crime, on se délivre du plus grand des maux, qui est l'injustice. » Gorgias et Polus, n'ayant pas osé contester les principes moraux de Socrate, sont conduits aisément, d'aveu en aveu, aune contradiction manifeste avec leurs premières prétentions. Mais ils trouvent un défenseur dans leur hôte Calliclès, orateur et philosophe très accrédité à Athènes, et qui, pour échapper aux conséquences de la dialectique de Socrate, nie hardiment ses principes, et développe le système philosophique sur lequel s'appuient intérieurement ses deux amis, sans oser le montrer à nu et le défendre. Quel est ce système ? L'éternel système des tyrans et des charlatans, de tous les contempteurs de l'espèce humaine : le système que Platon a déjà réfuté dans le Théétète et le Philèbe, et dont il dévoile et réfute ici les conséquences oratoires et politiques. page 154 Socrate, selon Calliclès, n'a pas eu grand-peine à triompher de Gorgias et de Polus ; car il a toujours argumenté de l'ordre légal. Sans doute, dans l'ordre légal, il n'y a rien de plus beau que la justice, et il est plus honteux de commettre l'injustice que de la recevoir ; d'où Socrate s'est empressé de conclure qu'il en est ainsi dans la vérité des choses. Mais ce n'est là qu'une déclamation bonne pour le peuple et les enfants ; car autre chose est l'ordre légal, autre chose l'ordre naturel. La loi de la nature est que l'homme cherche le plaisir et le bonheur, et ne s'arrête que devant la limite de ses forces. Le plus fort l'emporte donc et doit l'emporter sur le plus faible, et l'inégalité est d'institution naturelle. Le monde se partage naturellement et légitimement en forts et en faibles, en oppresseurs et en opprimés, en tyrans et en esclaves. Il en est ainsi dans l'espèce animale, dont l'espèce humaine n'est qu'une continuation ; et il en est encore ainsi page 155 dans l'espèce humaine elle-même, si on l'examine bien, et si on consulte sincèrement son histoire. Mais les faibles, par peur et par envie, ont inventé les lois et l'égalité, c'est-à-dire une fausse justice qui essaie d'arrêter la vraie justice, d'établir un équilibre chimérique, de donner des droits à tous, même à la faiblesse, en dépit de l'ordre naturel, qui veut que les plus forts et les meilleurs soient les premiers; ordre si vrai, que toutes les institutions humaines le compriment à peine, et que, malgré les entraves légales, il reparaît avec tout esprit énergique et ferme qui rétablit les droits de la supériorité naturelle, et ressaisit la souveraineté par force ou par adresse, ici par l'épée, là par la parole, selon les temps et les lieux. Le but de la vie, pour tout homme qui pense, est de se faire jour à travers ces barrières artificielles, d'acquérir de la fortune et du pouvoir, de servir ses amis, d'écraser ses ennemis, de satisfaire ses passions et page 156 d'être heureux. Telle est la vérité des choses. La philosophie qui méconnaît l'ordre naturel et se passionne pour l'ordre légal et pour l'idéal abstrait d'une fausse justice, est une philosophie niaise. Le vrai philosophe est l'élève de la rhétorique, qui, connaissant son époque, marche à la domination par la parole, et gouverne les hommes qu'il méprise; tandis que Socrate, avec son enthousiasme pour l'ordre légal et la justice, serait incapable de se défendre contre les caprices et les retours de ce peuple qu'il sert et qu'il aime, mais que ses ennemis gouvernent et peuvent à tout moment soulever contre lui. Il faut voir dans Platon avec quelle vigueur de dialectique Socrate examine et combat pied à pied chacun des points du système moral et politique de Calliclès, opposant aux sophismes de son altière immoralité les arguments les plus simples et les plus forts, tirés de la conscience du genre humain, et page 157 partout élevant le sens commun à la plus haute philosophie. Mais il faut nous contenter de présenter ici les résultats de cette admirable polémique. 1° Socrate, trouvant dans le discours de Calliclès ces deux mots les plus forts et les meilleurs presque toujours ensemble, s'attache à dissiper cette confusion et à distinguer l'idée de la force et celle de la justice. Veut-on les confondre ? il faut de deux choses l'une : ou ramener l'idée de la justice à celle de la force, ou l'idée de la force à celle de la justice; il faut par les meilleurs, entendre les plus forts, ou par les plus forts, les meilleurs; et dans les deux cas les attaques de Calliclès contre l'ordre légal et la justice sociale tombent également; car si la justice est la force, la plus grande force étant dans le plus grand nombre, et le plus grand nombre ayant fait et maintenant les lois, ces lois qui déclarent que là justice est dans l'égalité et qu'il est plus honteux de commettre page 158 une injustice que de la souffrir, il s'ensuit que ce qui est selon la loi est aussi selon la nature, puisque, en fait de force, l'autorité dernière est incontestablement le plus grand nombre; ou si l'on essaie de ramener l'idée du plus fort à celle du meilleur, c'est-à-dire apparemment du plus juste, on s'impose alors l'obligation de tirer rationnellement l'idée de tyrannie de l'idée de justice, et de prouver que l'homme juste a le droit de se faire une part plus large dans la distribution des biens de ce monde, au lieu de s'imposer à lui-même la règle qu'il prescrit aux autres, et se de soumettre à la justice de la société humaine, qui est l'égalité. Enfin, si l'on essayait de tourner la justice contre elle-même, sur ce principe que le meilleur et le plus juste est le plus digne de commander, il faudrait se hâter de répondre que le meilleur et le plus juste est le plus digne de commander sans doute, mais selon les règles de la justice ; ce qui page 159 renverse toute idée de pouvoir arbitraire. La. justice consiste d'abord à se commander à soi-même, avant d'essayer de commander aux autres; elle consiste à gouverner ses passions, au lieu d'y soumettre ses semblables. L'idée qui répond immédiatement à l'idée de la justice, n'est pas celle de la domination, mais de la tempérance. Ainsi, de quelque manière que l'on considère et que l'on prenne l'expression de plus fort et de meilleur, on n'en peut rien tirer contre l'ordre légal, qui nous apparaît alors comme fondé sur la double base de la force et de la justice, confondues ensemble, et imposant à qui que ce soit et à tous les titres le respect des lois, l'égalité et la tempérance. 2° Mais la tempérance est une folie dans un système qui réduit le souverain bien au plaisir et tout mal à la seule douleur. Voici contre ce système quelques arguments qui rappellent ceux du Philèbe. Le bien et le mal sont contraires l'un à l'autre et ne peu- page 160 vent aller ensemble, ils s'excluent absolument; tandis que le plaisir et la peine se tiennent, s'engendrent l'un l'autre et disparaissent l'un avec l'autre. Car le plaisir n'est que la satisfaction d'un désir; tout désir est un besoin ; tout besoin pris en soi est pénible : où cesse le besoin, cesse le désir, et où cesserait le désir, cesserait en même temps le plaisir de le satisfaire. La fin de la peine est donc la fin du plaisir; la peine et le plaisir sont donc des phénomènes relatifs, sans caractère fixe et indépendant, tandis que dans l'intelligence le bien exclut le mal, ou le mal le bien, et que la fin de l'un, loin d'être la fin de l'autre, en est le commencement et le triomphe. Si donc le bien est absolu et le plaisir relatif, le bien et le plaisir ne sont pas la même chose. — Non seulement la peine et le plaisir sont relatifs en eux-mêmes, ils le sont encore par la diversité des sujets auxquels ils s'appliquent également. En effet, on voit les médians et page 161 les bons souffrir ou jouir à-peu-près de même; l'homme raisonnable n'est pas plus exempt de chagrins que l'insensé, seulement il les supporte autrement, les gouverne et les contient : le brave souffre comme le lâche, et le héros comme la faible femme. Ni l'étude, ni la sagesse, ni la force de l'âme, ni l'exercice assidu de la vertu, ne sauvent personne de l'humiliant partage du plaisir et de la peine avec tout ce qu'il y a de plus dégradé sur la terre. Qu'est-ce donc qu'un sentiment commun aux êtres les plus opposés? Qu'est-ce autre chose, encore une fois, qu'un misérable phénomène sans caractère propre, résultat nécessaire de l'enveloppe commune à tous, de cette enveloppe qui cache l'homme et ne le constitue pas ? Et supposez qu'elle le constitue, supposez que le plaisir soit le bien et la douleur le mal, il s'ensuivrait que quiconque a du plaisir est bon, et quiconque souffre, méchant; que le brave qui souffre, et qui est bon en tant que brave, page 162 est méchant par cela seul qu'il souffre, et que le méchant, parce qu'il jouit, devient bon ; conséquence nécessaire et extravagante qui soulève la conscience du genre humain. 3° Recule-t-on ? distingue-t-on entre les plaisirs, et convient-on que tout plaisir comme tel n'est pas le bien, mais qu'il y a des plaisirs bons, et d'autres mauvais ? Cette concession est la ruine du système entier; car c'est admettre le bien et le mal comme distincts du plaisir et de la peine, et mesurer la quotité morale du plaisir, non plus sur son intensité ou sa durée, c'est-à-dire sur lui-même, mais sur un modèle étranger et indépendant, qui est le bien ; c'est consentir à ce principe que l'agréable en lui-même n'est ni bon ni mauvais, mais qu'il le devient par son rapport au bien ou au mal ; principe qui, dans la déduction et dans la pratique, engendre celui-ci, qu'il faut mettre l'agréable au service du bien, et non le bien au service de l'agréable. page 163 Or, ce dernier principe ramène et résout la question fondamentale du Gorgias ; il divise les arts en deux classes : les uns qui s'arrêtent à l'agréable, sans le rapporter au bien ; les autres qui ne l'emploient que sous la condition de ce rapport. Ceux-là seuls sont des arts véritables; les autres ne sont pas des arts, mais, comme on l'a déjà vu, des métiers sans principes fixes, qui tous peuvent se résumer sous le titre général de flatterie. L'habileté à jouer de la flûte ou de la lyre est aussi étrangère à l'art que la profession la plus vulgaire; et, selon Platon, il en est ainsi de la poésie lyrique et dramatique, quand elle se propose de plaire à la multitude en lui procurant des émotions agréables qui ne font qu'amollir les âmes au lieu de les épurer et de les fortifier. Or, quelle différence y a-t-il entre la poésie et la rhétorique, sinon que l'une est une rhétorique populaire à l'aide du chant, du rythme et de la mesure, tandis que l'autre s'adresse à un auditoire moins nombreux page 164 avec la parole toute seule ? Mais si leurs moyens diffèrent, leur caractère et leur but se confondent ordinairement; et la rhétorique, comme la poésie, ne se propose guère que de plaire au peuple, et non de le servir, ou de servir les intérêts de ses passions, et non pas ses intérêts moraux. Jusqu'ici l'orateur a-t-il été autre chose qu'un courtisan, et la rhétorique qu'une espèce particulière de la flatterie ? Le vrai orateur et la vraie rhétorique ont devant les yeux un autre but. Le vrai orateur ne veut que le bien ; il cherche à être utile, il ne songe pas à plaire ; il aime et sert le peuple, il ne le flatte pas. Comme il voit les choses de haut et dans leur ensemble, et que des lumières supérieures lui ont appris les conséquences inévitables du vice, c'est dans leur source qu'il attaque ces conséquences, et sa pensée est toujours avec l'ordre ; l'ordre est sa loi suprême, la sphère où lui-même habite sans cesse, et vers laquelle il page 165 élève perpétuellement ses semblables. Convaincu que les choses sont ce que les hommes les font être, et que là où les âmes vont bien ou mal, il est impossible que tout le reste n'aille pas de même, il fait de la force morale de l'état la base de sa force politique. En effet, qu'on y songe sans préjugés; d'où peut venir la faiblesse et la décadence d'un état, sinon de la prédominance des intérêts particuliers sur l'idée du tout que l'état représente? et qu'est-ce que la prédominance des intérêts particuliers, sinon l'égoïsme ? et qu'est-ce que l'égoïsme, sinon le vice lui-même et le symptôme manifeste de la corruption intérieure ? Le vrai politique, le vrai orateur est donc, avant tout, moraliste ; et, après s'être efforcé d'établir les meilleures lois, sa tâche est de les maintenir en mettant en harmonie avec elles les âmes des citoyens par les mœurs et l'éducation. Enseigner et répandre la vertu, c'est donc travailler à la puissance publique; et l'ordre politique n'est page 166 qu'un reflet de l'ordre moral. Or, nulle âme n'est dans l'ordre moral, qui ne sait se gouverner et se tempérer elle-même. La tempérance est la condition de toutes les vertus. Dans cette longue lutte des passions contre le devoir, qui ne finit qu'avec la vie, l'homme tempérant est seul capable de remplir habituellement ses devoirs envers ses semblables et envers les dieux. Être tempérant vis-à-vis ses semblables, c'est être juste ; envers les dieux, c'est être pieux et saint. C'est être aussi courageux, car l'instrument de la tempérance ou de l'empire sur soi-même est le courage. La complaisance pour soi-même, la faiblesse est la route par laquelle tous les désordres envahissent l'âme; et ce qu'il faut d'abord inculquer à l'homme, c'est la mâle habitude de se porter toujours pour ainsi dire en avant du devoir et de l'honneur, advienne ensuite que pourra. La tempérance appuyée sur le courage fonde et maintient la justice et la piété, c'est-à-dire la vertu tout entière, c'est- page 167 à-dire encore le bonheur ; car le bonheur pour une âme ne peut être que dans le bien et dans l'ordre. La première loi de l'ordre, nous l'avons vu, est d'être fidèle à la vertu, et à cette partie de la vertu qui se rapporte à la société, savoir la justice. Mais si l'on y manque la seconde loi de l'ordre est d'expier sa faute; et on ne l'expie que par la punition. Les publicistes cherchent encore le fondement de la pénalité. Ceux-ci, qui se croient de grands politiques, le trouvent dans l'utilité de la peine pour ceux qui en sont les témoins, et qu'elle détourne du crime par la terreur de sa menace et sa vertu préventive. Et c'est bien là, il est vrai, un des effets de la pénalité- mais ce n'est pas là son fondement; car la peine, en frappant l'innocent, produirait autant et plus de terreur encore, et serait tout aussi préventive. Ceux-là, dans leurs prétentions à l'humanité, ne veulent voir la légitimité de la peine que dans son page 168 utilité pour celui qui la subit, dans sa vertu corrective : et c'est encore là, il est vrai, un des effets possibles de la peine, mais non pas son fondement; car pour que la peine corrige, il faut qu'elle soit acceptée comme juste. Il faut donc toujours en revenir à la justice. La justice, voilà le fondement véritable de la peine : l'utilité personnelle et sociale n'en est que la conséquence. C'est un fait incontestable, qu'à la suite de tout acte injuste l'homme pense, et ne peut pas ne pas penser qu'il a démérité, c'est-à-dire mérité une punition. Dans l'intelligence, à l'idée d'injustice correspond celle de peine; et quand l'injustice a eu lieu dans la sphère sociale, la punition méritée doit être infligée par la société. La société ne le peut que parce qu'elle le doit. Le droit ici n'a d'autre source que le devoir, le devoir le plus étroit, le plus évident et le plus sacré, sans quoi ce prétendu droit ne serait que celui de la force, c'est-à-dire une atroce injustice, quand page 169 même elle tournerait au profit moral de qui la subit, et en un spectacle salutaire pour le peuple : ce qui ne serait point alors; car alors la peine ne tromperait aucune sympathie, aucun écho, ni dans la conscience publique, ni dans celle du condamné. La peine n'est pas juste parce qu'elle est utile préventivement ou correctivement, mais elle est utile et de l'une et de l'autre manière parce qu'elle est juste. Cette théorie de la pénalité, en démontrant la fausseté, le caractère incomplet et exclusif des deux théories qui partagent les publicistes, les achève et les explique, et leur donne à toutes deux un centre et une base légitime. Elle n'est sans doute qu'indiquée dans Platon, mais elle s'y rencontre en plusieurs endroits, brièvement, mais positivement exprimée; et c'est sur elle que repose la théorie sublime de l'expiation. Puisque c'est une loi de l'ordre que toute injustice ait son châtiment, après s'être écarté de l'ordre en commettant une injustice, ce serait page 170 s'en écarter plus encore que de ne pas subir la punition qu'il nous impose; ce serait aggraver le désordre, et par conséquent la misère, tout désordre étant misère, comme tout ordre est bonheur. En maintenant donc la justice distributive, la loi qui attache la peine à toute infraction à l'ordre, l'homme d'état donne au peuple une leçon salutaire, et travaille au bonheur même de celui qui est puni, puisqu'il le réconcilie avec lui-même, avec la société et la raison universelle. Il est son ami, son bienfaiteur, sa providence, et il est celle de l'état, puisqu'il y fait régner l'ordre légal et moral, qui représente l'ordre essentiel des choses. En effet, Dieu lui-même n'est que l'ordre pris substantiellement : ce monde, en apparence livré à une révolution perpétuelle, suit une marche régulière, et son nom divin est l'ordre, ὁ κόσμος. Une géométrie sublime préside à l'harmonie des êtres; l'égalité géométrique, pour parler comme Platon, est la loi de l'existence universelle, page 171 de la société humaine comme de la nature ; dans les sociétés humaines, l'égalité géométrique est la justice. Mais c'est dans Platon lui-même qu'il faut chercher le développement et suivre l'enchaînement de ces grandes vérités toujours anciennes et toujours nouvelles, qui, après avoir servi de berceau à la société naissante, la soutiennent dans sa course et ne l'abandonneront jamais ; qui ne s'éclipsent un moment dans la dissolution des empires, que pour reparaître avec plus de majesté dans les fondements des empires nouveaux; que nul sage n'a faites, que nul sophiste ne peut détruire ; que Platon reçut de Pythagore, qui lui-même les avait puisées aux sources même de la civilisation humaine, que l'Orient légua à l'antique Grèce, la Grèce à Rome, Rome à la société moderne, comme la base et la condition de toute existence sociale, et qui enfin, soit dans le monde réel, soit dans le monde des idées, forment, à travers les siècles et dans page 172 la pensée, une tradition non interrompue et une théorie indestructible dont tous les points comme lé dit Platon, sont enchaînés et attachés l'un à l'autre par des liens de fer et de diamant. Chaque dialogue de Platon est une philosophie tout entière; et le caractère de tout vrai dialogue de ce grand homme est de jeter l'esprit du lecteur qui peut le suivre à travers l'infini en tout sens, et d'entourer chaque sujet particulier de toute la grandeur des principes auxquels l'auteur le rattache. C'est ainsi que dans le Gorgias Platon ne perd jamais de vue son sujet, qui est la rhétorique, mais il l'emporte avec lui pour ainsi dire dans les régions supérieures, et jusqu'au sommet des idées. Il s'agit maintenant d'en redescendre. Or, comme le propre des vérités qui ne sont pas de convention est d'être à-la-fois très idéales et très réelles, spéculatives et pratiques tout ensemble, en un moment elles élèvent dans les cieux, en page 173
un moment elles ramènent sur la terre. En
effet il suffit de rappeler dans leur simplicité les deux vérités qui résultent
de la polémique précédente, savoir, que c'est un mal de commettre une injustice,
et un plus grand mal d'en chercher ou d'en procurer l'impunité, pour revenir
naturellement à cette malheureuse rhétorique qui, prenant l'apparence pour la
réalité, croit faire merveille d'éviter au coupable la punition qui Si le but de la rhétorique est le succès, l'orateur est un courtisan qui ne peut trop flatter celui auquel il veut plaire, peuple ou tyran, sans s'arrêter devant aucune limite, car où commence la limite de la flatterie, décroît la faveur, et le but est manqué. Il faut donc, pour être conséquent, ou le poursuivre exclusivement, ou le rejeter totale- page 174 ment, et entrer dans les voies de cette autre rhétorique qui a pour but d'améliorer l'homme, et non de lui faire plaisir. Or, pour améliorer les autres, il faut d'abord être bon soi-même. La vertu est donc la condition de la vraie rhétorique, c'est-à-dire de la vraie politique, comme son but et l'utilité morale de l'auditoire ou du pays auquel elle s'adresse. De là la témérité de ceux qui, sans s'être exercés à se gouverner eux-mêmes, osent se porter comme orateurs et hommes d'état, et entreprendre de diriger et de conseiller les autres ; et le délire de la renommée, qui donne le titre de politiques à des hommes qui, loin d'avoir amélioré leurs semblables, les ont corrompus autant qu'il était en eux, ne songeant qu'aux intérêts matériels de la société, prenant la grandeur apparente pour la véritable grandeur, l'éclat d'un jour pour la puissance, serviteurs de ceux dont ils se croient les maîtres, et se perdant souvent par les vices mêmes qu'ils page 175 ont nourris et caressés. Après avoir enseigné au peuple le mépris de l'ordre, la cupidité, la vanité, la paresse et la lâcheté, la corruption qui a servi de marche-pied à leur puissance, se retourne contre eux et les précipite. Ils se récrient alors ; ils accusent l'ingratitude de leurs contemporains, comme s'ils ne recueillaient pas ce qu'ils ont semé, comme si le maître était reçu à se plaindre de l'élève qu'il a formé, et comme si l'accuser n'était pas s'accuser soi-même! Par tous ces motifs, Socrate rejette la fausse rhétorique, et se décide pour la vraie, avec laquelle il pourra faire quelque bien, sauver quelques âmes et la sienne : mais il ne se dissimule pas qu'avec celle-là il faut que tôt ou tard il succombe ; car il est impossible de faire du bien aux hommes sans se perdre soi-même. Les hommes ne connaissent pas leurs vrais intérêts, et ne sont pas plus capables de préférer qui les aime à qui les flatte, qu'un enfant mal élevé n'est page 176 capable de préférer un sage médecin à un cuisinier habile. Les ennemis de Socrate l'emporteront donc; on mettra Socrate en jugement, et il sera hors d'état de se défendre; car la vraie rhétorique ne fera qu'indisposer davantage ses juges ; comme il ne pourra prouver qu'il a cherché à faire plaisir à ses concitoyens, puisque en effet il n'a cherché qu'à leur faire du bien, inévitablement il sera condamné. Il connaît son sort et s'y résigne n'ayant commis aucune injustice, il n'en a aucune à expier ; il est donc dans l'ordre, et par conséquent heureux, content de la mort comme de la vie. Jusqu'ici Platon ne s'est appuyé que sur des arguments tirés de la seule raison, car l'ordre c'est la raison; c'est une loi de la raison qui nous impose l'obligation d'être justes; et c'est une loi de la raison encore qui attache à toute injustice sa punition, punition qui doit être recherchée et acceptée avec des sentiments convenables pour être page 177 expiatoire, c'est-à-dire pour opérer le retour à l'ordre, et par conséquent au bonheur. Mais on ne détruit pas la loi en la violant ou en l'éludant ; où manque l'expiation, subsiste encore la loi, qui veut que toute infraction à l'ordre soit punie pour être réparée ; et l'on peut bien ne pas accepter la peine avec la disposition convenable, mais on n'y peut pas échapper. Car si les lois de l'ordre sont celles de la raison, les lois de la raison sont celles de la nature des choses, qui est la raison elle-même, et comme la nature des choses ne fléchit jamais, et que son action est nécessaire et universelle, la punition du mal ne rencontre aucun obstacle ; elle commence avec lui, se mesure sur lui, dure autant que lui, et ne cesse qu'avec lui. La punition du crime est donc irrésistible ; et si elle manque ou paraît manquer en ce monde, elle trouve sa place ailleurs; car le mal, le désordre, doit être vaincu et ramené à l'ordre et au bien qui seul existe. De là, page 178 le Gorgias, comme dans le Phédon et la République, un appel à la mythologie du temps, qui couronne l'argumentation rationnelle, et présente la vérité sous le reflet du symbole, sous cette forme populaire que l'énergie spontanée du genre humain s'est suscitée à elle-même et pour son usage, avant que la réflexion fût née et eût créé pour l'élite des esprits cette forme de la pensée plus pure et plus élevée qu'on appelle la philosophie. Platon comprend, respecte et aime trop l'humanité pour en rejeter les inspirations primitives; et loin de mettre aux prises la religion et la philosophie, il essaie partout de les concilier ; partout il tire ou il autorise les soupçons et les pressentiments sublimes de sa propre pensée, des convictions du genre humain, déposées dans les traditions religieuses des peuples. Personne n'a mieux saisi l'alliance intime du sens commun et de la science, de la religion et de la philosophie, des croyances populaires et des conceptions page 179 métaphysiques. Indépendant comme un élève de Socrate, mais d'un esprit trop étendu pour n'être pas conciliant, sa philosophie, toujours si haute, semble toujours heureuse de se rencontrer avec les croyances les plus vulgaires de ses semblables, La fin du Gorgias est donc tout-à-fait mythologique. Platon rappelle que si le coupable échappe à l'aréopage, il n'échappera pas aux trois grands juges Éaque, Minos et Rhadamanthe, qui, dans l'autre monde, discernent les coupables et les innocents, envoient les uns dans l'Élysée, les autres dans le Tartare pour y subir la punition qui doit les purifier et les réconcilier avec l'ordre. Mais cette conclusion mythologique n'est point un hors-d'œuvre, et se rapporte encore, comme les autres parties du Gorgias, au but fondamental du dialogue, savoir, que la rhétorique qui cherche à sauver l'homme injuste, le perd au lieu de le sauver; qu'en général la rhétorique qui ne songe qu'à plaire est une fausse rhétorique ; page 180 et que la vraie est celle dont le but est de faire du bien aux hommes en leur disant la vérité, en améliorant les âmes, en les élevant sans cesse ou en les rappelant à l'ordre, comme à la seule règle de la vie, à l'unique fin de la vraie existence. page 181 GORGIAS, ou DE LA RHÉTORIQUE. Interlocuteurs, CALLICLÈS, SOCRATE, CHÉRÉPHON, GORGIAS, POLUS. [447a] CALLICLÈS. C'EST à la guerre et à la bataille, Socrate, qu'il faut, dit-on, se trouver ainsi après coup. SOCRATE. Est-ce que nous venons, comme on dit, après la fête, et arrivons-nous trop tard? CALLICLÈS. Oui, et après une fête tout-à-fait charmante ; car Gorgias, il n'y a qu'un instant, vient de nous dire une infinité de belles choses. SOCRATE. Chéréphon, que voici, est la cause de ce retard, Calliclès; il nous a forcés de nous arrêter sur la place. page 182 [447b] CHÉRÉPHON. Il n'y a point de mal, Socrate : en tout cas, j'y remédierai. Gorgias est mon ami : ainsi il nous répétera les mêmes choses à présent, si tu veux ; ou, si tu l'aimes mieux, se sera pour une autre fois. CALLICLÈS. Quoi donc, Chéréphon? Socrate est-il curieux d'entendre Gorgias ? CHÉRÉPHON. Nous sommes venus tout exprès. CALLICLÈS. Eh bien, quand vous voudrez venir chez moi, Gorgias y loge (02), vous l'entendrez. page 183 SOCRATE. Je te suis obligé, Calliclès; mais serait-il d'humeur [447c] à s'entretenir avec nous? Je voudrais apprendre de lui quelle est la vertu de son art, ce qu'il prétend savoir et ce qu'il enseigne. Pour le reste, il en fera, comme tu dis, l'exposition une autre fois. CALLICLÈS. Rien n'est tel que de l'interroger lui-même, Socrate; car c'est là précisément un des points de la leçon qu'il vient de nous faire. Il disait tout-à-l'heure à ceux qui étaient présents de l'interroger sur ce qu'ils voudraient, se faisant fort de les satisfaire sur tout. page 184 SOCRATE. Voilà qui est fort beau. Chéréphon, interroge-le. CHÉRÉPHON. Que lui demanderai-je? [447d] SOCRATE. Ce qu'il est. CHÉRÉPHON. Que veux-tu dire? SOCRATE. Par exemple, si son métier était de faire des souliers, il te répondrait qu'il est cordonnier. Ne comprends-tu pas ma pensée? CHÉRÉPHON. Je comprends, et je vais l'interroger. Dis-moi Gorgias, ce que dit Calliclès est-il vrai, que tu te fais fort de répondre à toutes les questions qu'on peut te proposer ? [448a] GORGIAS.
Oui, Chéréphon ; c'est ce que je
déclarais tout-à-l'heure, et j'ajoute que depuis bien des années personne ne
m'a proposé aucune question CHÉRÉPHON. A ce compte, tu dois répondre avec bien de l'aisance, Gorgias. page 185 GORGIAS. Il ne tient qu'à toi, Chéréphon, d'en faire l'essai. POLUS. Assurément ; mais fais-le sur moi, si tu le veux bien, Chéréphon : car Gorgias me paraît fatigué; il vient de discourir bien longtemps. CHÉRÉPHON. Quoi donc, Polus? te flattes-tu de mieux répondre que Gorgias ? [448b] POLUS. Qu'importe, pourvu que je réponde assez bien pour toi? CHÉRÉPHON. Cela n'y fait rien. Réponds donc puisque tu le veux. POLUS. Interroge. CHÉRÉPHON. C'est ce que je vais faire. Si Gorgias était habile dans le même art que son frère Hérodicus (03), quel nom aurions-nous raison de lui donner? Le même qu'à Hérodicus, n'est-ce pas? POLUS. Sans doute. page 186 CHÉRÉPHON. Nous aurions donc raison de l'appeler médecin. POLUS. Oui. CHÉRÉPHON. Et s'il était versé dans le même art qu'Aristophon, fils d'Aglaophon, ou que son frère (04), de quel nom conviendrait-il de l'appeler? [448c] POLUS. Du nom de peintre, évidemment. CHÉRÉPHON. Puisqu'il est habile dans un certain art, quel nom faut-il lui donner ? POLUS. Chéréphon, il y a, parmi les hommes, un grand nombre d'arts qu'à force d'expériences l'expérience a découverts : car l'expérience fait que notre vie marche avec ordre, et l'inexpérience, au hasard. Les hommes se sont donc partagés les arts : les uns ont pris ceux-ci, les autres ceux-là, chacun à sa manière ; les meilleurs ont pris les meilleurs (05); Gorgias est de ce nom- page 187 bre, et l'art qu'il possède est le plus beau de tous. [448d] SOCRATE. Il me paraît,Gorgias, que Polus est très exercé à discourir ; mais il ne tient pas la parole qu'il a donnée à Chéréphon. GORGIAS. Pourquoi donc, Socrate? SOCRATE. Il ne répond pas, ce me semble, à ce qu'on lui demande. GORGIAS. Interroge-le toi-même, si tu le trouves bon. SOCRATE. Non, mais s'il te plaisait de répondre, je t'interrogerais bien plus volontiers ; d'autant que, sur ce que Polus vient de dire, il m'est évident qu'il s'est bien plus appliqué à cet art qu'on appelle la rhétorique, qu'à celui de la conversation. [448e] POLUS. Pour quelle raison, Socrate? SOCRATE. Par la raison, Polus, que Chéréphon t'ayant demandé dans quel art Gorgias est habile, tu page 188 fais l'éloge de son art, comme si quelqu'un le méprisait, et tu ne dis point ce qu'il est. POLUS. N'ai-je pas répondu que c'était le plus beau de tous les arts? SOCRATE. J'en conviens; mais personne ne t'interroge sur la qualité de l'art de Gorgias : on te demande seulement ce qu'il est, et de quel nom on doit appeler Gorgias. Chéréphon [449a] t'a mis sur la voie par des exemples, et tu lui avais d'abord bien répondu et en peu de mots. Dis-nous donc de même maintenant quel art professe Gorgias, et quel nom nous devons lui donner. Ou plutôt, Gorgias, dis-nous toi-même de quel nom il faut t'appeler, et quel art tu possèdes. GORGIAS. La rhétorique, Socrate. SOCRATE. Il faut donc t'appeler rhéteur ? GORGIAS. Et bon rhéteur, Socrate, si tu veux m'appeler ce que je me glorifie d'être (06), pour me servir de l'expression d'Homère. page 189 SOCRATE. J'y consens. GORGIAS. Hé bien! appelle-moi ainsi. [449b] SOCRATE. Et ne dirons-nous pas que tu es capable d'enseigner cet art aux autres ? GORGIAS. C'est de quoi je fais profession, non-seulement ici, mais ailleurs. SOCRATE. Voudrais-tu bien, Gorgias, continuer en partie à interroger, en partie à répondre, comme nous faisons maintenant, et remettre à un autre temps les longs discours, comme celui que Polus avait commencé ? Mais, de grâce, tiens ta promesse, et réduis-toi à faire des réponses courtes à chaque question. GORGIAS. Socrate, il y a des réponses qui exigent nécessairement quelque étendue. Néanmoins [449c] je ferai en sorte qu'elles soient aussi courtes qu'il est possible. Car une des choses dont je me vante est que personne ne dira les mêmes choses en moins de paroles que moi. SOCRATE. C'est ce qu'il faut ici, Gorgias. Montre-moi page 190 aujourd'hui ta précision ; tu nous déploieras une autre fois ton abondance. GORGIAS. Je le ferai, et tu conviendras que tu n'as jamais entendu parler plus brièvement. SOCRATE. Puisque tu te vantes d'être habile dans l'art de la rhétorique, [449d] et capable d'enseigner cet art à un autre, apprends-moi quel est son objet: comme, par exemple, l'art du tisserand a pour objet de faire des habits, n'est-ce pas? GORGIAS. Oui. SOCRATE. Et la musique de composer des chants? GORGIAS. Oui. SOCRATE. Par Junon, Gorgias, j'admire tes réponses : il n'est pas possible d'en faire de plus courtes. GORGIAS. Je me flatte, Socrate, que tu ne seras pas mécontent de moi sous ce rapport. SOCRATE. Fort bien. Réponds-moi, je te prie, de même sur la rhétorique, et dis-moi quel est son objet. [449e] GORGIAS. Les discours. page 191 SOCRATE. Quels discours, Gorgias ? Ceux avec lesquels le médecin explique au malade le régime qu'il doit observer pour se rétablir ? GORGIAS. Non. SOCRATE. La rhétorique n'a donc pas pour objet toute espèce de discours? GORGIAS. Non, sans doute. SOCRATE. Elle apprend à parler. GORGIAS. Oui. SOCRATE. Et n'apprend-elle pas à penser aussi sur les mêmes choses, sur lesquelles elle apprend à parler ? GORGIAS. Sans contredit. SOCRATE. Mais la médecine, [450a] que nous venons d'apporter en exemple, ne met-elle pas en état de penser et de parler sur les malades? GORGIAS. Nécessairement. page 192 SOCRATE. La médecine, à ce qu'il paraît, a donc aussi pour objet les discours. GORGIAS. Oui. SOCRATE. Ceux qui concernent les maladies ? GORGIAS. Précisément. SOCRATE. La gymnastique a de même pour objet les discours sur la bonne et la mauvaise disposition du corps. GORGIAS. Tout-à-fait. SOCRATE. Et il en est ainsi, Gorgias, des autres arts: [450b] chacun d'eux a pour objet les discours relatifs à la chose sur laquelle il s'exerce. GORGIAS. Il paraît qu'oui. SOCRATE. Pourquoi donc n'appelles-tu pas rhétorique les autres arts qui ont aussi pour objet les discours, puisque tu donnes ce nom à un art dont les discours sont l'objet ? page 193 GORGIAS. C'est, Socrate, que tous les arts ne s'occupent presque que d'ouvrages de main et d'autres semblables ; au lieu que la rhétorique ne produit rien de pareil, et que tout son effet, toute sa force (07) est dans [450c] les discours. Voilà pourquoi je dis que la rhétorique a les discours pour objet ; et je prétends que je dis vrai en cela. SOCRATE. Je crois comprendre ce que tu veux désigner par cet art ; mais je verrai la chose plus clairement tout-à-l'heure. Réponds-moi ; il y a des arts, n'est-ce pas ? GORGIAS. Oui. SOCRATE. Parmi tous les arts, les uns consistent, je pense, principalement dans l'action, et n'ont besoin que de très peu de discours ; quelques-uns même n'en ont que faire du tout : mais leur ouvrage peut s'achever en silence, comme la peinture, la sculpture et beaucoup d'autres. Tels sont, page 194 à ce qu'il me paraît, [450d] les arts que tu dis n'avoir aucun rapport à la rhétorique. GORGIAS. Tu saisis parfaitement ma pensée, Socrate. SOCRATE. Il y à, au contraire, d'autres arts qui exécutent tout ce qui est de leur ressort par le discours, et qui d'ailleurs n'ont besoin d'aucune ou de presque aucune action. Tels sont la numération et le calcul dans l'arithmétique, la géométrie, le jeu de dés, et beaucoup d'autres arts, dont quelques-uns demandent autant de paroles que d'action, et la plupart davantage, et dont tout l'effet et [450e] toute la force est dans le discours. C'est de ce nombre que tu dis, ce me semble, qu'est la rhétorique. GORGIAS. A merveille. SOCRATE. Ton intention n'est pourtant pas, je pense, de donner le nom de rhétorique à aucun de ces arts, si ce n'est peut-être que, comme tu as dit en termes exprès que la rhétorique est un art dont la force est tout entière dans le discours, quelqu'un voulût chicaner sur les mots, et en tirer cette conclusion : Gorgias, tu donnes donc le nom de rhétorique à l'arithmétique. Mais je ne page 195 pense pas que tu appelles ainsi ni l'arithmétique, ni la géométrie. [451a] GORGIAS. Tu ne te trompes point, Socrate, et tu prends ma pensée comme il faut la prendre. SOCRATE. Allons, achève ta réponse à ma question. Puisque la rhétorique est un de ces arts qui font un grand usage du discours, et que beaucoup d'autres sont dans le même cas, tâche de me dire par rapport à quoi toute la force de la rhétorique consiste dans le discours. Si quelqu'un me demandait au sujet d'un des arts que je viens de nommer : Socrate, qu'est-ce [451b] que la numération? je lui répondrais, comme tu as fait tout-à-l'heure, que c'est un des arts dont toute la force est dans le discours. Et s'il me demandait de nouveau: Par rapport à quoi ? je lui dirais que c'est par rapport à la connaissance du pair et de l'impair, pour savoir combien il y a d'unités dans l'un et dans l'autre. Pareillement, s'il me demandait : Qu'entends tu par le calcul ? je lui dirais aussi que c'est un des arts dont toute la force consiste dans le discours. Et s'il continuait à me demander: Par rapport à quoi? je lui répondrais, comme ceux qui recueillent les suffrages page 196
GORGIAS. Tu répondrais très bien, Socrate. [451d] SOCRATE. Réponds-moi de même, Gorgias. La rhéto- page 197 rique est un de ces arts qui achèvent et exécutent tout par le discours, n'est-ce pas ? GORGIAS. Cela est vrai. SOCRATE. Dis-moi donc quel est le sujet auquel se rapportent ces discours dont la rhétorique fait usage. GORGIAS. Ce sont les plus grandes de toutes les affaires humaines, Socrate, et les plus importantes. SOCRATE. Ce que tu dis là, Gorgias, est une chose controversée, [451e] sur laquelle il n'y a encore rien de décidé : car tu as, je pense, entendu chanter dans les banquets la chanson, où les convives, faisant rémunération des biens de la vie, disent que le premier est la santé ; le second, la beauté ; le troisième, la richesse acquise sans injustice, comme parle l'auteur de la chanson (09). GORGIAS. Je l'ai entendu; mais à quel propos dis-tu cela? [452a] SOCRATE. C'est que les artisans de ces biens, chantés par page 198 le poète, savoir, le médecin, le maître de gymnase, l'économe, se mettront aussitôt avec toi sur les rangs, et que le médecin me dira le premier : Socrate, Gorgias, te trompe. Son art n'a point pour objet le plus grand des biens de l'homme ; c'est le mien. Si je lui demandais: Toi, qui parles de la sorte, qui es-tu ? Je sois médecin, nie répondra-t-il. Et que prétends-tu ? que le plus grand des biens est celui que produit ton art ? Peut-on le contester, Socrate, me dira-t-il peut-être, puisqu'il produit la santé ? Est-il un bien préférable [452b] pour les hommes à la santé ? Après celui-ci, le maître de gymnase pourrait bien dire : Socrate, je serais très surpris que Gorgias pût te montrer quelque bien résultant de son art, plus grand que celui qui résulte du mien. Et toi, mon ami, répliquerai-je, qui es-tu? quelle est ta profession ? Je suis maître de gymnase, répondrait-il; ma profession est de rendre le corps humain beau et robuste. Après le maître de gymnase viendrait l'économe, qui, méprisant toutes les autres professions, me dirait, à ce que je m'imagine : [452c] Juge toi-même, Socrate, si Gorgias ou quelque autre peut produire un bien plus grand que la richesse. Quoi donc ! lui dirions-nous, est-ce toi qui fais la richesse? Sans doute, répondrait-il. Qui es-tu donc ? Je suis économe. Et quoi ! est-ce que tu regardes la richesse comme page 199 le plus grand de tous les biens ? Assurément, dira-t-il. Cependant, Gorgias que voici, prétend que son art produit un plus grand bien que le tien. Il est clair qu'il demanderait après cela : Quel est donc [452d] ce plus grand bien ? Que Gorgias s'explique. Imagine-toi, Gorgias, que la même question t'est faite par eux et par moi ; et dis-moi en quoi consiste ce que tu appelles le plus grand bien de l'homme, celui que tu te vantes de produire. GORGIAS. C'est en effet, Socrate, le plus grand de tous les biens, qui rend libre et même puissant dans chaque ville. SOCRATE. Mais encore quel est-il ? [452e] GORGIAS. C'est, selon moi, d'être en état de persuader par ses discours les juges dans les tribunaux, les sénateurs dans le sénat, le peuple dans les assemblées, en un mot tous ceux qui composent toute espèce de réunion politique. Or, ce talent mettra à tes pieds le médecin et le maître de gymnase : et l'on verra que l'économe s'est enrichi, non pour lui, mais pour un autre, pour toi qui possèdes l'art de parler et de gagner l'esprit de la multitude. page 200 SOCRATE. Enfin, Gorgias, il me paraît que tu m'as montré, d'aussi près [453a] qu'il est possible, quel art est la rhétorique. Si j'ai bien compris, tu dis qu'elle est l'ouvrière de la persuasion, que tel est le but de toutes ses opérations, et qu'en somme elle se termine là. Pourrais-tu en effet me prouver que le pouvoir de la rhétorique aille plus loin que de faire naître la persuasion dans l'âme des auditeurs ? GORGIAS. Nullement, Socrate, et tu l'as, à mon avis, bien définie; car c'est à cela véritablement qu'elle se réduit. SOCRATE. Écoute-moi, Gorgias. S'il est quelqu'un qui, [453b] en conversant avec un autre, soit jaloux de bien comprendre quelle est la chose dont on parle, sois assuré que je me flatte d'être un de ceux-là, et je pense que tu en es aussi. GORGIAS. A quoi tend ceci, Socrate? SOCRATE. Le voici : tu sauras que je ne conçois en aucune façon de quelle nature est la persuasion que tu attribues à la rhétorique, ni relativement à quoi cette persuasion a lieu. Ce n'est pas que page 201 je ne soupçonne ce que tu veux dire ; mais je ne t'en demanderai pas moins quelle persuasion [453c] la rhétorique fait naître, et sur quoi. Si je t'interroge, au lieu de te faire part de mes soupçons, ce n'est point à cause de toi, mais de cet entretien, afin qu'il aille de manière que nous sachions clairement ce dont il est question entre nous. Vois toi-même si j'ai raison de t'interroger. Si je te demandais dans quelle classe de peintres est Zeuxis, et si tu me répondais qu'il peint des animaux, n'aurai-je pas raison de te demander encore quels animaux il peint, et sur quoi ? (10) GORGIAS. Sans doute. [453d] SOCRATE. N'est-ce point parce qu'il y a d'autres peintres qui peignent aussi des animaux ? GORGIAS. Oui. SOCRATE. Au lieu que si Zeuxis était le seul qui en peignît, alors tu aurais bien répondu. GORGIAS. Assurément. SOCRATE. Dis-moi donc, par rapport à la rhétorique : te page 202 semble-t-il qu'elle produise seule la persuasion, au qu'il y a d'autres arts qui en font autant? Voici quelle est ma pensée : quiconque enseigne quoi que ce soit, persuade-t-il ou non ce qu'il enseigne ? GORGIAS. Il le persuade sans contredit, Socrate. [453e] SOCRATE. Pour revenir donc aux mêmes arts dont il a déjà été fait mention, l'arithmétique et l'arithméticien ne nous enseignent-ils pas ce qui concerne les nombres ? GORGIAS. Oui. SOCRATE. Et en même temps ne persuadent-ils pas? GORGIAS. Oui. SOCRATE. L'arithmétique est donc aussi ouvrière de la persuasion ? GORGIAS. Il y a apparence. SOCRATE. Si on nous demandait : De quelle persuasion, et sur quoi ? nous dirions que c'est celle qui ap- page 203 prend la quantité du nombre, soit [454a] pair, soit impair. Appliquant la même réponse aux autres arts dont nous parlions, il nous sera aisé de montrer qu'ils produisent la persuasion, et d'en marquer l'espèce et l'objet ; n'est-il pas vrai. GORGIAS. Oui. SOCRATE. La rhétorique n'est donc pas le seul art dont la persuasion soit l'ouvrage. GORGIAS. Tu dis vrai. SOCRATE. Par conséquent, puisqu'elle n'est pas la seule qui la produise, et que d'autres arts en font autant, nous sommes en droit, comme au sujet du peintre, de demander en outre de quelle persuasion la rhétorique est l'art, et sur quoi roule cette persuasion. Ne penses-tu pas que cette question [454b] est à sa place ? GORGIAS. Si fait. SOCRATE. Réponds donc, Gorgias, puisque tu penses ainsi. GORGIAS. Je parle, Socrate, de cette persuasion qui a page 204 lieu dans les tribunaux et les assemblées publiques, comme je disais tout-à-l'heure, et qui roule sur ce qui est juste ou injuste. SOCRATE. Je soupçonnais que tu avais en vue cette persuasion et ces objets, Gorgias, mais je n'en ai rien dit, afin que tu ne fusses pas surpris, si, dans la suite de cet entretien, je t'interroge sur des choses qui paraissent évidentes; [454c] car ce n'est point à cause de toi, comme je t'ai déjà dit, que j'en agis de la sorte, mais à cause de la conversation, pour qu'elle marche régulièrement, et que sur de simples conjectures nous ne prenions point l'habitude de prévenir et de deviner nos pensées de part et d'autre ; mais que tu achèves comme il te plaira ton discours, selon les principes que tu auras établis toi-même. GORGIAS. Socrate, à mon avis, rien n'est plus sensé que cette conduite. SOCRATE. Allons en avant, et examinons encore ceci. Admets-tu ce qu'on appelle savoir ? GORGIAS. Oui. SOCRATE. Et ce qu'on nomme croire? page 205 [454d] GORGIAS. Je l'admets aussi. SOCRATE. Te semble-t-il que savoir et croire, la science et la croyance soient la même chose, ou bien deux choses différentes? GORGIAS. Je pense, Socrate, que ce sont deux choses différentes. SOCRATE. Tu penses juste, et tu pourrais en juger à cette marque. Si on te demandait : Gorgias, y a-t-il une croyance fausse et une croyance vraie ? tu en conviendrais sans doute. GORGIAS. Oui. SOCRATE. Mais quoi ! y a-t-il de même une science fausse et une science vraie ? GORGIAS. Non, certes. SOCRATE. Il est donc évident que savoir et croire n'est pas la même chose. GORGIAS. Cela est vrai. page 206 SOCRATE. [454e] Cependant ceux qui savent sont persuadés, comme ceux qui croient. GORGIAS. J'en conviens. SOCRATE.
Veux-tu qu'en conséquence nous mettions
deux espèces de persuasions, dont l'une produit la croyance sans la science, et
l'autre la GORGIAS. Sans doute. SOCRATE. De ces deux persuasions, quelle est celle que la rhétorique opère dans les tribunaux et les autres assemblées, au sujet du juste et de l'injuste? Est-ce celle d'où naît la croyance sans la science, ou celle qui engendre la science ? GORGIAS. Il est évident, Socrate, que c'est celle d'où naît la croyance. SOCRATE. La rhétorique, à ce qu'il paraît, est donc ouvrière de la persuasion [455a] qui fait croire, et non de celle qui fait savoir, relativement au juste et à l'injuste. page 207 GORGIAS. Oui. SOCRATE. Ainsi l'orateur ne se propose point d'instruire les tribunaux et les autres assemblées sur le juste et l'injuste, mais uniquement de les amener à croire. Aussi bien ne pourrait-il jamais, en si peu de temps, instruire tant de personnes à-la-fois sur de si grands objets. GORGIAS. Non, sans doute. SOCRATE. Cela posé, voyons, je te prie, ce que nous devons penser [455b] de la rhétorique. Pour moi, je ne puis encore me former une idée précise de ce que j'en dois dire. Lorsqu'une ville s'assemble pour faire choix de médecins, de constructeurs de vaisseaux, ou de toute autre espèce d'ouvriers, n'est-il pas vrai que l'orateur n'aura point alors de conseil à donner, puisqu'il est évident que, dans chacun de ces cas, il faut choisir le plus instruit ? Ni lorsqu'il s'agira de la construction des murs, des ports, ou des arsenaux; mais que l'on consultera là-dessus les architectes : ni lorsqu'on délibérera sur le choix d'un général, sur l'ordre dans lequel on marchera à l'ennemi, [455c] sur les postes dont on doit s'emparer ; mais qu'en ces circon- page 208 stances les gens de guerre diront leur avis, et les orateurs ne seront pas consultés. Qu'en penses-tu, Gorgias ? Puisque tu te dis orateur, et capable de former d'autres orateurs, on ne peut mieux s'adresser qu'à toi pour connaître à fond ton art. Figure-toi d'ailleurs que je travaille ici dans tes intérêts. Peut-être parmi ceux qui sont ici (11) y en a-t-il qui désirent d'être de tes disciples, comme j'en sais quelques-uns et même beaucoup, qui ont cette envie, et qui n'osent pas t'interroger. [455d] Persuade-toi donc que, quand je t'interroge, c'est comme s'ils te demandaient eux-mêmes : Gorgias, que nous en reviendra-t-il, si nous prenons tes leçons ? sur quoi serons-nous en état de conseiller nos concitoyens ? Sera-ce seulement sur le juste et l'injuste, ou, en outre, sur les objets dont Socrate vient de parler ? Essaie de leur répondre. GORGIAS. Je vais, Socrate, essayer de te développer en son entier toute la vertu de la rhétorique ; car tu m'as mis parfaitement sur la voie. Tu sais sans doute [455e] que les arsenaux des Athéniens, leurs murailles, leurs ports, ont été construits, en par- page 209 tie sur les conseils de Thémistocle, en partie sur ceux de Périclès, et non sur ceux des ouvriers. SOCRATE. Je sais, Gorgias, qu'on le dit de Thémistocle. A l'égard de Périclès, je l'ai entendu moi-même, lorsqu'il conseilla aux Athéniens d'élever la muraille qui sépare Athènes du Pirée (12). [456a] GORGIAS. Ainsi tu vois, Socrate, que quand il s'agit de prendre un parti sur les objets dont tu parlais, les orateurs sont ceux qui conseillent, et dont l'avis l'emporte. SOCRATE. C'est aussi ce qui m'étonne, Gorgias, et ce qui est cause que je t'interroge depuis si longtemps sur la vertu de la rhétorique. A le prendre ainsi, elle me paraît merveilleusement grande. GORGIAS. Et si tu savais tout, Socrate, si tu savais que la rhétorique embrasse, pour ainsi dire, la vertu de tous les autres arts ! [456b] Je vais t'en donner une preuve bien frappante. Je suis souvent entré, avec mon frère (13) et d'autres médecins, chez certains page 210 malades qui ne voulaient point ou prendre une potion, ou souffrir qu'on leur appliquât le fer ou le feu. Le médecin ne pouvant rien gagner sur leur esprit, j'en suis venu à bout, moi, sans le secours d'aucun autre art que de la rhétorique. J'ajoute que, si un orateur et un médecin se présentent dans une ville, et qu'il soit question de disputer de vive voix devant le peuple, ou devant quelque autre assemblée, sur la préférence entre l'orateur et le médecin, [456c] on ne fera nulle attention à celui-ci, et l'homme qui a le talent de la parole sera choisi, s'il entreprend de l'être. Pareillement, dans la concurrence avec un homme de toute autre profession, l'orateur se fera choisir préférablement à qui que ce soit, parce qu'il n'est aucune matière sur laquelle il ne parle en présence de la multitude d'une manière plus persuasive que tout autre artisan, quel qu'il soit. Telle est l'étendue et la puissance de la rhétorique. Il faut cependant, Socrate, user de la rhétorique, comme on use des autres exercices: car, parce [456d] qu'on a appris le pugilat, le pancrace, le combat avec des armes véritables, de manière à pouvoir vaincre également ses amis et ses ennemis, on ne doit pas pour cela frapper ses amis, les percer ni les tuer ; mais, certes, il ne faut pas non plus, parce que quelqu'un ayant fréquenté les gymnases, s'y étant fait un corps ro- page 211 buste, et étant devenu bon lutteur, aura frappé son père ou sa mère, ou quelque autre de ses parents ou de ses amis, prendre pour cela en aversion et chasser des villes les maîtres [456e] de gymnase et d'escrime ; car ils n'ont dressé leurs élèves à ces exercices qu'afin qu'ils en fissent un bon usage contre les ennemis et les médians, pour la défense, et non pour l'attaque, [457a] et ce sont leurs élèves qui, contre leur intention, usent mal de leur force et de leur adresse; il ne s'ensuit donc pas que les maîtres soient mauvais, non plus que l'art qu'ils professent, ni qu'il en faille rejeter la faute sur lui; mais elle retombe, ce me semble, sur ceux qui en abusent. On doit porter le même jugement de la rhétorique. L'orateur est, à la vérité, en état de parler contre tous et sur toute chose ; en sorte qu'il sera plus propre que personne à persuader en un instant la multitude [457b] sur tel sujet qu'il lui plaira; mais ce n'est pas une raison pour lui d'enlever aux médecins ni aux autres artisans leur réputation, parce qu'il est en son pouvoir de le faire. Au contraire, on doit user de la rhétorique comme des autres exercices, selon les règles de la justice. Et si quelqu'un, s'étant formé à l'art oratoire, abuse de cette faculté et de cet art pour commettre une action injuste, on n'est pas, je pense, en droit pour cela de haïr et de bannir des villes le maître qui page 212 lui a donné des leçons : car il ne lui a mis son art entre les mains [457c] qu'afin qu'il s'en servît pour de justes causes; et l'autre en fait un usage tout opposé. C'est donc le disciple qui abuse de l'art qu'on doit haïr, chasser, faire mourir, et non pas le maître. SOCRATE. Tu as, je pense, Gorgias, assisté comme moi à bien des disputes, et tu y as sans doute remarqué une chose, savoir que, sur quelque sujet que les hommes entreprennent de converser, ils ont bien de la peine à fixer, de part et d'autre leurs idées, et à terminer l'entretien, [457d] après s'être instruits et avoir instruit les autres. Mais s'élève-t-il entre eux quelque controverse, et l'un prétend-il que l'autre parle avec peu de justesse ou de clarté? ils se fâchent, et s'imaginent que c'est par envie qu'on les contredit, qu'on parle pour disputer, et non pour éclaircir le sujet. Quelques-uns finissent par les injures les plus grossières, et se séparent après avoir dit et entendu des personnalités si odieuses, que les assistants se veulent du mal de s'être trouvés présents [457e] à de pareilles conversations. A quel propos te préviens-je là-dessus? C'est qu'il me paraît que tu ne parles point à présent d'une manière conséquente, ni bien assortie à ce que tu as dit précédemment sur la rhétorique; et j'ap- page 213 prébende, si je te réfute, que tu n'ailles te mettre dans l'esprit que mon intention n'est pas de disputer sur la chose même, pour l'éclaircir, mais contre toi. [458a] Si tu es donc du même caractère que moi, je t'interrogerai avec plaisir; sinon, je n'irai pas plus loin. Mais quel est mon caractère? Je suis de ces gens qui aiment qu'on les réfute, lorsqu'ils ne disent pas la vérité, qui aiment aussi à réfuter les autres, quand ils s'écartent du vrai, et qui, du reste, ne prennent pas moins de plaisir à se voir réfutés qu'à réfuter. Je tiens en effet pour un bien d'autant plus grand d'être réfuté, qu'il est véritablement plus avantageux d'être délivré du plus grand des maux, que d'en délivrer un autre; et je ne connais, pour l'homme, aucun mal égal à celui d'avoir des idées [458b] fausses sur la matière que nous traitons. Si donc tu m'assures que tu es dans les mêmes dispositions que moi, continuons la conversation; ou, si tu crois devoir la laisser là, j'y consens, terminons ici l'entretien. GORGIAS. J'espère, Socrate, être des gens dont tu as fait le portrait. Il nous faut aussi pourtant avoir égard à ceux qui nous écoutent. Longtemps avant que tu vinsses, je leur ai déjà expliqué bien des choses ; [458c] et, si nous reprenons la conversation, peut-être nous mènera-t-elle loin. Il con- page 214 vient donc de penser aussi aux assistants, et de n'en retenir aucun qui aurait quelque autre chose à faire. CHÉRÉPHON. Vous entendez, Gorgias et Socrate, le bruit que font tous ceux qui sont présents, pour témoigner le désir qu'il ont de vous entendre, si vous continuez à parler. Pour moi, aux dieux ne plaise que j'ai jamais des affaires si pressées, qu'elles m'obligent à quitter une dispute aussi intéressante et aussi bien dirigée, pour vaquer à quelque chose de plus nécessaire. [458d] CALLICLÈS. Par tous les dieux, Chéréphon, tu as raison. J'ai déjà assisté à bien des entretiens, mais je ne sais si aucun m'a causé autant de plaisir que celui-ci, et vous m'obligeriez fort, si vous vouliez converser ainsi toute la journée (14). SOCRATE. Si Gorgias y consens, tu ne trouveras, Calliclès, nul obstacle de ma part. GORGIAS. Il serait désormais honteux pour moi de n'y page 215 pas consentir, Socrate, surtout après m'être engagé à répondre à quiconque voudra m'interroger. Reprends donc l'entretien, si cela plaît à la compagnie, [458e] et propose-moi ce que tu jugeras à propos. SOCRATE. Écoute, Gorgias, ce qui me surprend dans ton discours. Peut-être n'as tu rien dit que de vrai, et t'ai-je mal compris. Tu es, dis-tu, en état de former un homme à l'art oratoire, s'il veut prendre tes leçons. GORGIAS. Oui. SOCRATE. C'est-à-dire, n'est-il pas vrai, que tu le rendras capable de parler sur toute chose d'une manière plausible devant la multitude, non en enseignant, mais [459a] en persuadant? GORGIAS. Justement. SOCRATE. Tu as ajouté, en conséquence, que, pour ce qui regarde la santé, l'orateur s'attirera plus de croyance que le médecin. GORGIAS. Oui, pourvu qu'il ait affaire à la multitude. page 216 SOCRATE. Par la multitude tu entends sans doute les ignorants; car apparemment l'orateur n'aura pas d'avantage sur le médecin, devant des personnes instruites. GORGIAS. Tu dis vrai. SOCRATE. Si donc il est plus propre à persuader que le médecin, n'est-il pas plus propre à persuader que celui qui suit? GORGIAS. [459b] Tout-à-fait. SOCRATE. Quoique lui-même ne soit pas médecin, n'est-ce pas? GORGIAS. Oui. SOCRATE. Mais celui qui n'est pas médecin n'est-il point ignorant dans les choses où le médecin est savant? GORGIAS. Sans doute. SOCRATE. Ainsi l'ignorant sera plus propre à persuader page 217 que le savant vis-à-vis des ignorants, s'il est vrai que l'orateur soit plus propre à persuader que le médecin. N'est-ce point ce qui résulte de là, ou s'ensuit-il autre chose ? GORGIAS. Oui, c'est bien ici ce qui en résulte. SOCRATE. Cet avantage de l'orateur et de la rhétorique n'est-il pas le même par rapport aux autres arts? je veux dire qu'il n'est pas nécessaire qu'elle s'instruise de la nature des choses, et qu'il suffit qu'elle invente quelque moyen [459c] de persuasion, de manière à paraître aux yeux des ignorants plus savante que ceux qui savent. GORGIAS. N'est-ce pas une chose bien commode, Socrate, de n'avoir pas besoin d'apprendre d'autre art que celui-là, pour ne le céder en rien aux artisans? SOCRATE. Si en cette qualité l'orateur le cède ou ne le cède point aux autres, c'est ce que nous examinerons tout-à-l'heure, si notre sujet le demande. Mais auparavant voyons si par rapport [459d] au juste et à l'injuste, au beau et au laid, au bon et au mauvais, l'orateur est dans le même cas que par rapport à la santé et aux objets des page 218 autres arts, et qu'ignorant ce qui est bon ou mauvais, beau ou laid, juste ou injuste, il ait seulement imaginé là-dessus quelque expédient pour persuader, et paraître vis-à-vis des ignorants mieux instruit que les savants, [459e] quoiqu'il soit ignorant lui-même : ou bien voyons si c'est une nécessité que celui qui veut apprendre la rhétorique sache tout cela et s'y soit rendu habile avant de prendre tes leçons; ou si, au cas qu'il n'en ait aucune connaissance, toi qui es maître de rhétorique, tu ne lui enseigneras point du tout ces choses, parce que ce n'est pas ton affaire, mais si tu feras d'ailleurs en sorte que ne les sachant point, il paraisse les savoir, et qu'il passe pour homme de bien, sans l'être ; ou si tu ne pourras point absolument lui enseigner la rhétorique, à moins qu'il n'ait appris d'avance la vérité sur ces matières. Que penses-tu là-dessus, Gorgias? [460a] Au nom de Jupiter, développe-nous, comme tu l'as promis il n'y a qu'un moment, toute la vertu de la rhétorique. GORGIAS. Je pense, Socrate, que quand il ne saurait rien de tout cela, il l'apprendrait auprès de moi. SOCRATE. Arrête, je te prie. Tu réponds très bien. Afin donc que tu puisses faire de quelqu'un un ora- page 219 teur, il faut, de toute nécessité, qu'il connaisse ce que c'est que le juste et l'injuste, soit qu'il l'ait appris avant d'aller à ton école, soit qu'il l'apprenne de toi. [460b] GORGIAS. Sans contredit. SOCRATE. Mais quoi? celui qui a appris le métier de charpentier est-il charpentier, ou non? GORGIAS. Il l'est. SOCRATE. Et quand on a appris la musique, n'est-on pas musicien ? GORGIAS. Oui. SOCRATE. Et quand on a appris la médecine, n'est-on pas médecin? En un mot, par rapport à tous les autres arts, quand on a appris ce qui leur appartient, n'est-on pas tel que doit être l'élève de chacun de ces arts? GORGIAS. J'en conviens. page 220 SOCRATE. Ainsi, par la même raison, celui qui a appris ce qui appartient à la justice est juste. GORGIAS. Nul doute. SOCRATE. Mais l'homme juste fait des actions justes. GORGIAS. Oui. [460c] SOCRATE. C'est donc une nécessité que l'orateur soit juste, et que l'homme juste veuille faire des actions justes. GORGIAS. Du moins la chose paraît telle. SOCRATE. L'homme juste ne voudra donc jamais commettre une injustice? GORGIAS. La conclusion est nécessaire. SOCRATE. Ne suit-il pas nécessairement de ce qui a été dit, que l'orateur est juste? GORGIAS. Oui. page 221 SOCRATE. Jamais, par conséquent, l'orateur ne voudra commettre une injustice. GORGIAS. Il paraît que non. SOCRATE. Te rappelles-tu d'avoir dit, un peu plus haut, qu'il ne fallait pas s'en prendre [460d] aux maîtres de gymnase, ni les chasser des villes, parce qu'un athlète aura abusé du pugilat, et fait quelque action injuste? et pareillement que, si quelque orateur fait un usage injuste de la rhétorique, on ne doit point en faire tomber la faute sur son maître, ni le bannir de l'État, mais qu'il faut la rejeter sur l'auteur même de l'injustice, qui n'a point usé de la rhétorique comme il devait? As-tu dit cela, ou non? GORGIAS. Je l'ai dit. SOCRATE. Et [460e] ne venons-nous pas de voir que ce même orateur est incapable de commettre aucune injustice ? GORGIAS. Nous venons de le voir. SOCRATE. Et ne disais-tu pas dès le commencement, page 222 Gorgias, que la rhétorique a pour objet les discours qui traitent, non du pair et de l'impair, mais du juste et de l'injuste ? N'est-il pas vrai ? GORGIAS. Oui. SOCRATE. Lors donc que tu parlais de la sorte, je supposais que la rhétorique ne pouvait jamais être une chose injuste, puisque ses discours roulent toujours sur la justice. Mais quand je t'ai entendu dire un peu après que l'orateur [461a] pouvait faire un usage injuste de la rhétorique, j'ai été bien surpris, et j'ai cru que tes deux discours ne s'accordaient pas; c'est ce qui m'a fait dire que si tu regardais, ainsi que moi, comme un avantage d'être réfuté, nous pouvions continuer l'entretien ; sinon, qu'il fallait le laisser là. Nous étant mis ensuite à examiner la chose, tu vois toi-même qu'il a été accordé que l'orateur ne peut user injustement de la rhétorique, ni vouloir commettre une injustice. Et par [461b] le chien (15), Gorgias, ce n'est pas la matière d'un petit entretien, que d'examiner à fond ce qu'il faut penser à cet égard. POLUS. Quoi donc, Socrate, as-tu réellement de la page 223 rhétorique l'opinion que tu viens de dire ? ou ne crois-tu pas plutôt que c'est par pudeur que Gorgias t'a avoué que l'orateur connaît le juste, le beau, le bon, et que si on venait chez lui sans être instruit de ces choses, il les enseignerait ? C'est cet aveu, probablement, qui est cause de la contradiction [461c] où il est tombé, et dont tu t'applaudis, l'ayant jeté dans ces sortes de questions. Mais penses-tu qu'il y ait quelqu'un au monde qui reconnaisse qu'il n'a aucune connaissance de la justice, et qu'il n'est pas en état d'en instruire les autres? En vérité, il faut être bien étrange pour faire descendre le discours à de pareilles bagatelles. SOCRATE. Mon bel ami, nous nous procurons des amis et des enfants tout exprès, afin que si nous venons à faire quelque faux pas étant devenus vieux, vous autres jeunes gens vous redressiez et nos actions et nos discours. Si donc nous nous sommes trompés dans ce que nous avons dit, Gorgias [461d] et moi, toi, qui as tout entendu, relève-nous. Tu le dois. Parmi tous nos aveux, s'il y en a quelqu'un qui te paraisse mal accordé, je te permets de revenir dessus, et de le réformer à ta guise, pourvu seulement que tu prennes garde à une chose. page 224 POLUS. A quoi donc? SOCRATE. A réprimer, Polus, cette démangeaison de faire de longs discours, à laquelle tu étais sur le point de te livrer au commencement de cet entretien. POLUS. Quoi! ne pourrai-je donc point parler aussi longtemps qu'il me plaira? [461e] SOCRATE. Ce serait en user bien mal avec toi, mon cher, si étant venu à Athènes, l'endroit de la Grèce où l'on a la plus grande liberté de parler, tu étais le seul que l'on privât de ce droit. Mais mets-toi aussi à ma place. Si tu parles à ton aise, et que tu refuses de répondre avec précision à ce qu'on te propose, ne serais-je pas bien à plaindre à mon tour, s'il ne m'était point permis [462a] de m'en aller, et de ne pas t'écouter? Si donc tu prends quelque intérêt à la dispute précédente, et que tu veuilles la rectifier, reviens, ainsi que j'ai dit, sur tel endroit qu'il te plaira,interrogeant et répondant à ton tour, comme nous avons fait, Gorgias et moi, combattant mes raisons, et me permettant de combattre les tiennes. Tu te donnes sans doute pour page 225 savoir les mêmes choses que Gorgias : n'est-ce pas? POLUS. Oui. SOCRATE. Par conséquent, tu te livres aussi à quiconque veut t'interroger sur quelque sujet que ce soit, comme étant en état de le satisfaire. POLUS. Assurément. [462b] SOCRATE. Eh bien, choisis lequel des deux il te plaira, d'interroger ou de répondre. POLUS. J'accepte la proposition : réponds-moi, Socrate. Puisque Gorgias te paraît embarrassé à expliquer ce que c'est que la rhétorique, dis-nous ce que tu en penses. SOCRATE. Me demandes-tu quelle espèce d'art c'est, selon moi ? POLUS. Oui. SOCRATE. A te dire la vérité, Polus, je ne la regarde pas comme un art. page 226 POLUS. Comment donc la regardes-tu ? SOCRATE. Comme une chose que tu te vantes d'avoir réduite en art dans un écrit [462c] que j'ai lu depuis peu. POLUS. Quelle chose encore ? SOCRATE. Une espèce de routine. POLUS. La rhétorique est donc une routine, à ton avis? SOCRATE. Oui, à moins que tu ne sois d'un autre sentiment. POLUS. Et quel est l'objet de cette routine ? SOCRATE. De procurer de l'agrément et du plaisir. POLUS. Ne juges-tu pas que la rhétorique est une belle chose, puisqu'elle met en état de plaire aux hommes ? page 227 SOCRATE. Quoi donc, Polus, t'ai-je déjà expliqué ce que j'entends [462d] par la rhétorique, pour me demander, comme tu fais, si je ne la trouve pas belle? POLUS. Ne t'ai- je point entendu dire que c'est une certaine routine ? SOCRATE. Puisque faire plaisir a tant de prix à tes yeux, voudrais-tu bien me faire un petit plaisir ? POLUS. Volontiers. SOCRATE. Demande-moi un peu quel art est, à mon avis, la cuisine. POLUS. J'y consens. Quel art est-ce que la cuisine? SOCRATE. Ce n'en est point un, Polus. POLUS. Qu'est-ce donc? parle. SOCRATE. Le voici. C'est une espèce de routine. POLUS. Quel est son objet ? parle. page 228 SOCRATE. Le voici. C'est, Polus, de procurer [462e] de l'agrément et du plaisir. POLUS. La cuisine et la rhétorique sont-elles la même chose ? SOCRATE. Point du tout ; mais elles font partie l'une et l'autre de la même profession. POLUS. De quelle profession, s'il te plaît? SOCRATE. Je crains qu'il ne soit pas trop poli de dire ce qui en est, et je n'ose le faire à cause de Gorgias, de peur qu'il ne s'imagine que je veux tourner en ridicule sa profession. Pour moi, j'ignore si la rhétorique que Gorgias [463a] professe est ce que j'ai en vue ; d'autant plus que la discussion précédente ne nous a pas découvert clairement ce qu'il pense. Quant à ce que j'appelle rhétorique, c'est une partie d'une certaine chose qui n'est pas du tout belle. GORGIAS. De quelle chose, Socrate ? dis, et ne crains point de m'offenser. page 229 SOCRATE. Il me paraît donc, Gorgias, que c'est une profession, où l'art n'entre à la vérité pour rien, mais qui suppose dans une âme du tact, de l'audace, et de grandes dispositions naturelles à converser avec les hommes. J'appelle [463b] flatterie le genre auquel cette profession se rapporte. Ce genre me paraît se diviser en je ne sais combien de parties, du nombre desquelles est la cuisine. On croit communément que c'est un art ; mais, à mon avis, ce n'en est point un : c'est seulement un usage, une routine. Je compte aussi parmi les parties de la flatterie la rhétorique, ainsi que la toilette et la sophistique, et j'attribue à ces quatre parties quatre objets différents. Maintenant, si Polus veut m'interroger, qu'il interroge ; car je ne lui [463c] ai pas encore expliqué quelle partie de la flatterie est, selon moi, la rhétorique. Il ne s'aperçoit pas que n'ai point achevé ma réponse ; et, comme si elle était achevée, il me demande si je ne tiens point la rhétorique pour une belle chose. Pour moi, je ne lui dirai pas si je la tiens pour belle ou pour laide, qu'auparavant je ne lui aie répondu ce que c'est. Cela ne serait pas dans l'ordre, Polus. Demande-moi donc, si tu veux l'entendre, quelle partie de la flatterie est, selon moi, la rhétorique. page 230 POLUS. Soit : je te le demande. Dis-moi quelle partie c'est. [463d] SOCRATE. Comprendras-tu ma réponse ? La rhétorique est, selon moi, le simulacre d'une partie de la politique. POLUS. Mais encore, est-elle belle ou laide ? SOCRATE. Je dis qu'elle est laide ; car j'appelle laid tout ce qui est mauvais, puisqu'il faut te répondre comme si tu comprenais déjà ma pensée. GORGIAS. Par Jupiter, Socrate, je ne conçois pas moi-même ce que tu veux dire. [463e] SOCRATE. Je n'en suis pas surpris, Gorgias; je n'ai encore rien développé. Mais Polus est jeune et ardent GORGIAS. Laisse-le là, et explique-moi en quel sens tu dis que la rhétorique est le simulacre d'une partie de la politique. SOCRATE. Je vais essayer de t'exposer sur cela ma pen- page 231 sée. Si la chose n'est point telle que je dis, Polus me [464a] réfutera. N'y a-t-il pas une chose que tu appelles corps, et une autre que tu appelles âme ? GORGIAS. Sans contredit. SOCRATE. Ne juges-tu pas qu'il y a une bonne constitution de l'un et de l'autre ? GORGIAS. Oui. SOCRATE. Ne reconnais-tu pas aussi à leur égard une constitution qui paraît bonne, et qui ne l'est pas ? Je m'explique. Plusieurs paraissent avoir le corps bien constitué ; et tout autre qu'un médecin ou qu'un maître de gymnase ne s'apercevrait pas aisément qu'il est en mauvais état. GORGIAS. Tu as raison. SOCRATE. Je dis donc qu'il y a dans le corps et dans l'âme je ne sais quoi, qui fait juger qu'ils sont l'un et l'autre en bon état, [464b] quoiqu'ils ne s'en portent pas mieux pour cela. GORGIAS. Soit. SOCRATE. Voyons si je pourrai te faire entendre plus page 232 clairement ce que je veux dire. Je dis qu'il y a deux arts qui se rapportent au corps et à l'âme. Celui qui répond à l'âme, je l'appelle politique. Pour l'autre, qui regarde le corps, je ne saurais le désigner d'abord par un seul nom. Mais quoique la culture du corps soit une, j'en fais deux parties, dont l'une est la gymnastique, et l'autre la médecine. En divisant de même la politique en deux, je mets la puissance législative vis-à-vis de la gymnastique, et la puissance judiciaire vis-à-vis de la médecine. Car la gymnastique et la médecine d'un côté, et de l'autre la puissance législative et la judiciaire [464c] ont beaucoup de rapport entre elles, car elles s'exercent sur le même objet ; mais elles ont entre elles aussi quelques différences. Ces quatre arts étant tels que j'ai dit, et ayant toujours pour but le meilleur état possible, les uns du corps, les autres de l'âme, la flatterie s'en est aperçue, non point par réflexion, mais par un certain tact, et, s'étant partagée en quatre, elle s'est insinuée sous chacun de ses arts, [464d] et s'est donnée pour celui sous lequel elle s'est glissée. Elle ne se met nullement en peine du bien ; mais par l'appât du plaisir, elle attire et séduit la folie, et s'en fait adorer. La cuisine s'est glissée sous la médecine, et s'attribue le discernement des aliments les plus salutaires au corps; de façon que si le médecin et le cuisinier avaient page 233 à disputer ensemble devant des enfants, ou devant des hommes aussi peu raisonnables que les enfants, pour savoir qui des deux, du cuisinier ou du médecin, connaît mieux les qualités bonnes et mauvaises de la nourriture, le médecin mourrait de faim. Voilà donc ce que j'appelle flatterie, et c'est une chose que je dis laide, [465a] Polus, car c'est à toi que j'adresse ceci, parce qu'elle ne vise qu'à l'agréable et néglige le bien. J'ajoute que ce n'est point un art, mais une routine, d'autant qu'elle n'a aucun principe certain sur la nature des choses dont elle s'occupe, et qu'elle ne peut rendre raison de rien. Or, je n'appelle point art toute chose qui est dépourvue de raison. Si tu prétends me contester ceci, je suis prêt à te répondre. [465b] La flatterie en fait de ragoûts s'est donc cachée sous la médecine, comme je l'ai dit. Sous la gymnastique s'est glissée de la même manière la toilette, pratique frauduleuse, trompeuse, ignoble et lâche, qui emploie pour séduire les airs, les couleurs, le poli, les vêtements, et substitue le goût d'une beauté empruntée à celui de la beauté naturelle que donne la gymnastique. Et, pour ne pas m'étendre, je te dirai, comme les géomètres (peut-être ainsi [465c] me comprendras-tu mieux) que ce que la toilette est à la gymnastique, la cuisine l'est page 234 à la médecine ; ou plutôt de cette manière : ce que la toilette est à la gymnastique, la sophistique l'est à la puissance législative ; et ce que la cuisine est à la médecine, la rhétorique l'est à la puissance judiciaire. Telles sont les différences naturelles de ces choses ; mais comme elles ont aussi des rapports ensemble, les sophistes et les rhéteurs se confondent avec les législateurs et les juges, s'appliquent aux mêmes objets, et ne savent pas eux-mêmes quel est leur véritable emploi, ni les autres hommes non plus. Si l'âme, en effet, ne commandait point [465d] au corps, et que le corps se gouvernât lui-même ; si l'âme n'examinait point par elle-même, et ne discernait pas la différence de la cuisine et de la médecine, mais que le corps en fût juge et qu'il les estimât par le plaisir qu'elles lui procurent, rien ne serait plus commun, mon cher Polus, que ce que dit Anaxagoras (et tu connais cela, assurément) : toutes choses seraient confondues (16), on ne pourrait distinguer ce qui est salutaire en fait de médecine et de cuisine. Tu as donc entendu ce que je pense de la rhétorique : elle est par rapport [465e] à l'âme ce que la cuisine est par rapport au corps. Peut-être est-ce une inconséquence de page 235 ma part d'avoir fait un long discours, après te les avoir interdits. Mais je mérite d'être excusé ; car lorsque je me suis expliqué en peu de mots tu ne m'as pas compris, tu ne savais quel parti tirer de mes réponses, et il me fallait me développer. Lors donc que tu répondras, [466a] si je me trouve dans le même embarras à l'égard de tes réponses, je te permets de t'étendre à ton tour. Mais tant que je pourrai en tirer parti, laisse-moi faire : rien n'est plus juste. Et maintenant, si tu peux faire quelque chose de cette réponse, vois, je te la livre. POLUS. Qu'est - ce que tu dis ? La rhétorique est, à ton avis, la même chose que la flatterie ? SOCRATE. J'ai dit seulement qu'elle en était une partie. Eh quoi, Polus ! à ton âge tu manques déjà de mémoire ? que sera-ce donc quand tu seras vieux? POLUS. Te semble-t-il que dans les états les bons orateurs soient regardés comme de vils flatteurs ? [466b] SOCRATE. Est-ce une question que tu me fais, ou un discours que tu entames ? POLUS. C'est une question. page 236 SOCRATE. Eh ! bien, il me paraît qu'on ne les regarde pas même. POLUS. Comment ! on ne les regarde pas ? De tous les citoyens, ne sont-ils pas ceux qui ont le plus de pouvoir? SOCRATE. Non, si tu entends que le pouvoir est un bien pour celui qui l'a. POLUS. C'est ainsi que je l'entends. SOCRATE. A ce compte, je dis que les orateurs sont de tous les citoyens ceux qui ont le moins de pouvoir. POLUS.
Quoi ! Semblables aux tyrans, ne font-ils
pas mourir [466c] celui qu'ils
veulent ? ne dépouillent-ils pas de ses biens, et ne bannissent-ils pas qui SOCRATE. En vérité, je suis incertain, Polus, à chaque chose que tu dis, si tu parles de ton chef page 237 et si tu m'exposes ta façon de penser, ou si tu me demandes la mienne. POLUS. Je te demande la tienne. SOCRATE. A la bonne heure, mon cher ami. Pourquoi donc me fais-tu deux questions à-la-fois? POLUS. Comment, deux questions? SOCRATE. Ne me disais-tu pas à ce moment que [466d] les orateurs, tels que les tyrans, mettent à mort qui ils veulent ; qu'ils dépouillent de ses biens et bannissent qui il leur plaît ? POLUS. Oui. SOCRATE. Eh bien, je te dis que ce sont deux questions, et je vais te satisfaire sur l'une et sur l'autre. Je soutiens, Polus, que les orateurs et les tyrans ont très peu de pouvoir dans les villes, comme je disais tout-à-l'heure ; et qu'ils ne font presque rien [466e] de ce qu'ils veulent, quoiqu'ils fassent ce qui leur paraît le plus avantageux. POLUS. Mais n'est-ce point là avoir un grand pouvoir? page 238 SOCRATE. Non, à ce que prétend Polus. POLUS. Moi, je prétends cela ? c'est tout le contraire. SOCRATE. Oui, tu le prétends, si tu dis qu'un grand pouvoir est un bien pour celui qui en est revêtu? POLUS. Je le dis encore. SOCRATE. Crois-tu que ce soit un bien pour quelqu'un de faire ce qui lui paraît être le plus avantageux, lorsqu'il est dépourvu de bon sens? et appelles-tu cela avoir un grand pouvoir ? POLUS. Nullement. SOCRATE. Prouve-moi donc que les orateurs ont du bon sens, [467a] et que la rhétorique est un art, et non une flatterie, et tu m'auras réfuté. Mais tant que tu ne l'auras pas fait, il demeurera toujours vrai que ce n'est point un bien pour les orateurs, ni pour les tyrans, de faire dans un état ce qui leur plaît Le pouvoir est à la vérité un bien, comme tu dis. Mais tu conviens toi-même que page 239 faire ce qu'on juge à propos, lorsqu'on est dépourvu de bon sens, est un mal. N'est-il pas vrai? POLUS. Oui. SOCRATE. Comment donc les orateurs et les tyrans auraient-ils un grand pouvoir dans un état, à moins que Polus ne réduise Socrate à avouer qu'ils font ce qu'ils veulent ? [467b] POLUS. Quel homme ! SOCRATE. Je dis qu'ils ne font pas ce qu'ils veulent : réfute-moi. POLUS. Ne viens-tu pas d'accorder qu'ils font ce qu'ils croient le plus avantageux pour eux ? SOCRATE. Je le répète. POLUS. Ils font donc ce qu'ils veulent. SOCRATE. Je le nie. POLUS. Quoi ? lorsqu'ils font ce qu'ils jugent à propos ! page 240 SOCRATE. Sans doute. POLUS. En vérité, Socrate, tu avances des choses pitoyables et insoutenables. SOCRATE.
Ne me condamne pas si vite, charmant
Polus, pour parler [467c] comme
toi (17). Mais si tu as encore quelque question à
me faire, prouve-moi que je POLUS. Je consens à te répondre, afin de voir clair dans ce que tu viens de dire. SOCRATE. Juges-tu que les hommes veulent les actions mêmes qu'ils font habituellement, ou la chose en vue de laquelle ils font ces actions ? Par exemple, ceux qui prennent une potion de la main des médecins, veulent-ils, à ton avis, ce qu'ils font, c'est-à-dire, avaler une potion et ressentir de la douleur ? ou bien veulent-ils la page 241 santé, en vue de laquelle ils prennent la médecine? POLUS. Il est évident qu'ils veulent la santé, [467d] en vue de laquelle ils prennent la médecine. SOCRATE. Pareillement ceux qui vont sur mer, et qui font toute autre espèce de commerce, ne veulent pas ce qu'ils font journellement : car quel est l'homme qui veut aller sur mer s'exposer à mille dangers, et avoir mille embarras ? Mais ils veulent, ce me semble, la chose en vue de laquelle ils vont sur mer, c'est-à-dire, la richesse: la richesse en effet est le but de ces voyages maritimes. POLUS. J'en conviens. SOCRATE. N'en est-il pas de même par rapport à tout le reste ? de façon que quiconque fait une chose en vue d'une autre, ne veut point la chose même qu'il fait, mais celle [467e] en vue de laquelle il la fait. POLUS. Oui. SOCRATE. T'a-t-il quoi que ce soit au moins qui ni ne soit page 242 bon ou mauvais, ou tenant le milieu cuire le bon et le mauvais, sans être ni l'un ni l'autre ? POLUS. Cela ne saurait être autrement, Socrate. SOCRATE. Ne mets-tu pas au rang des bonnes choses, la sagesse, la santé, la richesse et toutes les autres semblables ; et leurs contraires, au rang des mauvaises? POLUS. Oui. SOCRATE. Et par les choses qui ne sont ni bonnes ni mauvaises n'entends-tu pas celles qui [468a] tantôt tiennent du bien, tantôt du mal, et tantôt ne tiennent ni de l'un ni de l'autre ? par exemple, être assis, marcher, courir, naviguer : et encore, les pierres, les bois, et les autres choses de cette nature. N'est-ce pas là ce que tu conçois par ce qui n'est ni bon ni mauvais f ou bien est-ce autre chose ? POLUS. Non, c'est cela même. SOCRATE. Lorsque les hommes font ces choses indifférentes, les font-ils en vue des bonnes, ou font-ils les bonnes en vue de celles-là? POLUS. Ils font les [468b] indifférentes en vue des bonnes. page 243 SOCRATE. C'est donc toujours le bien que nous poursuivons ; lorsque nous marchons, c'est dans la pensée que cela nous sera plus avantageux ; et c'est encore en vue du bien que nous nous arrêtons, lorsque nous nous arrêtons. N'est-ce pas? POLUS. Oui. SOCRATE. Et soit qu'on mette quelqu'un à mort, qu'on le bannisse, ou qu'on lui ravisse ses biens, ne se porte-t-on point à ces actions, dans la persuasion que c'est ce qu'il y a de mieux à faire ? N'est-il pas vrai? POLUS. Assurément. SOCRATE. Tout ce qu'on fait en ce genre, c'est donc en vue du bien qu'on le fait. POLUS. J'en conviens. SOCRATE. Ne sommes-nous pas convenus que l'on ne veut point la chose qu'on fait en vue d'une autre, [468c] mais celle en vue de laquelle on la fait? POLUS. Sans contredit. page 244 SOCRATE. Ainsi on ne veut pas simplement tuer quelqu'un, le bannir, lui enlever ses biens : mais si cela est avantageux, on veut le faire; si cela est nuisible, on ne le veut pas. Car, comme tu l'avoues, on veut les choses qui sont bonnes : et celles qui ne sont ni bonnes ni mauvaises ou tout-à-fait mauvaises, on ne les veut pas. Ce que je dis, Polus, te paraît-il vrai, ou non? Pourquoi ne réponds-tu pas? POLUS. Cela me semble vrai. [468d] SOCRATE. Puisque nous sommes d'accord là-dessus, quand un tyran ou un orateur fait mourir quelqu'un, le condamne au bannissement, ou à la perte de ses biens, croyant que c'est le parti le plus avantageux pour lui-même, quoique ce soit en effet le plus mauvais; il fait alors ce qui lui plaît: n'est-ce pas? POLUS. Oui. SOCRATE. Fait-il pour cela ce qu'il veut, s'il est vrai que ce qu'il fait est mauvais? que ne réponds-tu? POLUS. Il ne me paraît pas qu'il fasse ce qu'il veut. page 245 SOCRATE. Se peut-il donc qu'un tel homme [468e] ait un grand pouvoir dans sa ville, si toutefois, de ton aveu, c'est un bien d'être revêtu d'un grand pouvoir? POLUS. Cela ne se peut. SOCRATE. Par conséquent, j'avais raison de dire qu'il est possible qu'un homme fasse dans une ville ce qui lui plaît, sans avoir néanmoins un grand pouvoir, ni faire ce qu'il veut. POLUS. Comme si toi-même, Socrate, tu n'aimerais pas mieux avoir la liberté de faire dans une ville tout ce qui te plaît, que de ne pas l'avoir ; et comme si, lorsque tu vois quelqu'un qui fait mourir celui qu'il juge à propos, le dépouille de ses biens, le met dans les fers, tu ne lui portais pas envie ? SOCRATE. Supposes-tu qu'il agisse en cela justement ou injustement? [469a] POLUS. De quelque manière qu'il agisse, n'est-ce pas toujours une chose digne d'envie? SOCRATE. Parle mieux, Polus. page 246 POLUS. Pourquoi donc? SOCRATE. Parce qu'il ne faut point porter envie à ceux dont le sort n'en doit exciter aucune, ni aux malheureux, mais en avoir pitié, POLUS. Quoi ! penses-tu que telle est la condition de ceux dont je parle ? SOCRATE. Quelle autre idée pourrais-je en avoir? POLUS. Tu regardes donc comme malheureux et digne de compassion, quiconque fait mourir celui qu'il juge à propos, lors même qu'il le condamne justement à la mort. SOCRATE. Point du tout : mais aussi il ne me paraît pas digne d'envie. POLUS. N'as-tu pas dit tout-à-l'heure qu'il est malheureux? [469b] SOCRATE. Oui, mon cher, je l'ai dit de celui qui met à mort injustement, et de plus j'ai dit qu'il est digne de pitié. Pour celui qui ôte la vie justement à un autre, je dis qu'il ne doit point faire envie. page 247 POLUS. L'homme qui est injustement mis à mort, n'est-il pas en même temps malheureux et à plaindre? SOCRATE. Moins que l'auteur de sa mort, Polus, et moins encore que celui qui a mérité de mourir. POLUS. Comment cela ? Socrate ? SOCRATE. Le voici. C'est que le plus grand de tous les maux est de commettre l'injustice. POLUS. Est-ce là le plus grand mal? Souffrir une injustice, n'en est-ce pas un plus grand? SOCRATE. Nullement. POLUS. Aimerais-tu donc mieux recevoir une injustice que de la faire? [469c] SOCRATE. Je ne voudrais ni l'un ni l'autre; mais s'il fallait absolument commettre une injustice ou la souffrir, j'aimerais mieux la souffrir que la commettre. POLUS. Est-ce que tu n'accepterais pas la condition de tyran? page 248 SOCRATE. Non, si par être tyran tu entends la même chose que moi. POLUS. J'entends par là ce que je disais tout-à-l'heure, avoir le pouvoir de faire dans une ville tout ce qu'on juge à propos, de tuer, de bannir, en un mot, d'agir en tout à sa fantaisie. SOCRATE. Mon cher ami, fais réflexion à ce que je vais dire. [469d] Si lorsque la place publique est pleine de monde, tenant un poignard caché sous mon bras, je te disais : J'ai en ce moment, Polus, un pouvoir merveilleux et égal à celui d'un tyran. De tous ces hommes que tu vois, celui qu'il me plaira de faire mourir, mourra tout-à-l'heure ; s'il me semble que je doive casser la tête à quelqu'un, il l'aura cassée à l'instant ; si je veux déchirer son habit, il sera déchiré : tant est grand le pouvoir [469e] que j'ai dans cette ville. Si tu refusais de me croire, et que je te montrasse mon poignard, peut-être dirais-tu en le voyant : Socrate,il n'est personne à ce compte qui n'eût un grand pouvoir : tu pourrais de la même façon brûler la maison de tel citoyen qu'il te plairait, mettre le feu aux arsenaux des Athéniens, à leurs galères, et à page 249 tous les vaisseaux appartenant à l'état ou aux particuliers. Mais la grandeur du pouvoir ne consiste point précisément à faire ce qui plaît. Que t'en semble? POLUS. Non, assurément, de la manière que tu viens de dire. [470a] SOCRATE. Me dirais-tu bien la raison pour laquelle tu rejettes un semblable pouvoir? POLUS. Oui. SOCRATE. Dis-la donc. POLUS. C'est qu'il est inévitable que quiconque en agit ainsi, soit puni. SOCRATE. Être puni n'est-ce point un mal? POLUS. Sans doute. SOCRATE. Ainsi, mon cher, tu juges donc de nouveau, que l'on a un grand pouvoir, lorsque, faisant ce qui plaît, on ne fait rien que d'avantageux, et qu'alors c'est une bonne chose. C'est page 250 en cela que consiste en effet le grand pouvoir : hors de là, il n'y a que mal et faiblesse. [470b] Examinons encore ceci. Ne convenons-nous point qu'il est bien quelquefois de faire ce que nous disions à l'instant, de mettre à mort, de bannir, de dépouiller de ses biens; et que quelquefois il ne l'est point? POLUS. Tout-à-fait. SOCRATE. Nous sommes donc, à ce qu'il paraît, d'accord sur ce point, toi et moi. POLUS. Oui. SOCRATE. Dans quel cas dis-tu qu'il est bien de faire ces sortes de choses? Assigne-moi les bornes que tu y mets. POLUS. Réponds toi-même à cette question, Socrate ? [470c] SOCRATE. Eh bien, Polus, puisque tu préfères m'interroger, je dis qu'il est bien de les faire, lorsqu'on les fait justement, et mal, lorsqu'on les fait injustement. page 251 POLUS. Il est vraiment bien difficile de te réfuter, Socrate. Un enfant même ne te prouverait-il pas que tu ne dis point la vérité ? SOCRATE. Je serai fort redevable à cet enfant, et je ne te le serai pas moins, si tu me réfutes, et si tu me délivres de mes extravagances. Ne te lasse point d'obliger un homme qui t'aime: de grâce, montre-moi que j'ai tort. POLUS. Il n'est pas besoin, Socrate, de recourir pour cela à des exemples anciens. [470d] Ce qui s'est passé hier et avant-hier (18) suffit pour te confondre, et pour démontrer que beaucoup d'hommes injustes sont heureux. SOCRATE. Qu'est-ce donc? POLUS. Tu vois cet Archélaüs, fils de Perdiccas, roi de Macédoine. SOCRATE. Si je ne le vois pas, du moins j'en entends parler? page 252 POLUS. Qu'en penses-tu? est-il heureux ou malheureux? SOCRATE. Je n'en sais rien, Polus. Je n'ai point encore eu d'entretien avec lui. [470e] POLUS. Quoi donc! Tu saurais ce qui en est,si tu avais conversé avec lui; et tu ne peux connaître d'ici même, par une autre voie, s'il est heureux? SOCRATE. Non, certes. POLUS. Évidemment, Socrate, tu diras aussi que tu ignores si le grand roi est heureux. SOCRATE. Et je dirai vrai : car j'ignore quel est l'état de son âme par rapport à la science et à la justice. POLUS. Et quoi ! Est-ce que tout le bonheur consiste en cela? SOCRATE. Oui, selon moi, Polus. Je prétends que quiconque est honnête et vertueux, homme ou femme, est heureux; et quiconque est injuste ou méchant, malheureux. page 253 [471a] POLUS. Cet Archelaüs est donc malheureux, à ton compte. SOCRATE. Oui, mon cher, s'il est injuste. POLUS. Et comment ne serait-il pas injuste? Il n'avait aucun droit au trône qu'il occupe, étant fils d'une esclave d'Alcétas, frère de Perdiccas ; selon la justice, il était esclave d'Alcétas ; il aurait dû le servir, s'il eût voulu être juste, et en conséquence il aurait été heureux, à ce que tu prétends ; au lieu qu'aujourd'hui le voilà devenu souverainement malheureux, puisqu'il a commis les plus grands forfaits ; [471b] car ayant d'abord envoyé chercher Alcétas, son maître et son oncle, comme pour lui remettre l'autorité dont Perdiccas l'avait dépouillé, il le reçut chez lui, l'enivra lui et son fils Alexandre, qui était son cousin et à-peu-près du même âge, et les ayant mis dans un chariot, et transportés de nuit hors du palais, il les fit égorger tous deux, et s'en débarrassa ainsi. Cela fait, il ne s'aperçut point du malheur extrême où il était tombé, il ne conçut nul repentir ; et peu de temps [471c] après, au lieu de consentir à devenir heureux, en prenant soin, page 254 comme la justice l'exigeait, de l'éducation de son frère, fils légitime de Perdiccas, âgé d'environ sept ans, à qui la couronne appartenait de droit, et en la lui rendant, il le jeta dans un puits après l'avoir fait étouffer, et dit à Cléopâtre, mère de l'enfant, qu'il était tombé dans ce puits en poursuivant une oie, et qu'il y était mort. Aussi s'étant rendu coupable de plus de crimes qu'aucun homme de Macédoine, est-il aujourd'hui, non le plus heureux, mais lé plus malheureux de tous les Macédoniens. Et peut-être y a-t-il plus d'un Athénien, à commencer par toi, [471d] qui préférerait la condition de tout autre Macédonien à celle d'Archélaüs. SOCRATE. Dès le commencement de cet entretien, Polus, je t'ai fait compliment sur ce que tu me paraissais fort versé dans la rhétorique, mais je t'ai dit que tu avais négligé l'art de discuter. Voilà donc ces raisons avec lesquelles un enfant me réfuterait? Et, à t'entendre, tu as détruit avec ces raisons ma proposition que l'homme injuste n'est point heureux. Par où, mon cher? puisque je ne t'accorde absolument rien de ce que tu as dit. [471e] POLUS. C'est que tu ne le veux pas : car du reste tu penses comme moi. page 255 SOCRATE. Tu es admirable de prétendre me réfuter avec des arguments de rhétorique, comme ceux qui croient faire la même chose devant les tribunaux. Là en effet un avocat s'imagine en avoir réfuté un autre, lorsqu'il a produit un grand nombre de témoins distingués pour appuyer ce qu'il avance, et que sa partie adverse n'en a produit qu'un seul, ou point du tout. Mais ce mode de réfutation ne sert de rien pour découvrir [472a] la vérité. Car quelquefois un accusé peut être condamné à tort sur la déposition d'un grand nombre de témoins, qui paraissent de quelque poids. Et, dans le cas présent, presque tous les Athéniens et les étrangers seront de ton avis ; et si tu veux produire contre moi des témoignages pour me prouver que la vérité n'est pas de mon côté, tu auras, quand il te plaira, pour témoins Nicias (19), fils de Nicérate, et ses frères, qui ont donné tous ces trépieds qu'on voit rangés dans te temple de Bacchus ; tu auras encore, si tu veux, Aristocrate, [472b] fils de Scellios (20), de qui est cette belle offrande dans le temple d'Apollon pythien ; tu auras aussi page 256 toute la famille de Périclès; et telle autre famille d'Athènes qu'il te plaira de choisir. Mais je suis, quoique seul, d'un autre avis : car tu ne dis rien qui m'oblige d'en changer, et tu ne fais que produire contre moi une foule de faux témoins pour me déposséder de mon bien et de la vérité. Pour moi, à moins que je ne te réduise à rendre toi-même témoignage à la vérité de ce que je dis, je n'ai, à mon sens, [472c] rien gagné contre toi, ni toi, je pense, contre moi, à moins que je ne dépose, quoique seul, en ta faveur, et que tu ne comptes absolument pour rien le témoignage des autres. Voilà donc deux manières de réfuter, l'une que tu crois bonne, ainsi que bien d'autres ; l'autre, que je juge telle aussi de mon côté. Comparons-les ensemble, et voyons si elles ne diffèrent en rien ; car les objets sur lesquels nous ne sommes point d'accord, ne sont pas de petite conséquence : au contraire, il n'y en a peut-être point qu'il soit plus beau de connaître, et plus honteux d'ignorer, puisqu'ils aboutissent à ceci, de savoir ou d'ignorer qui est heureux ou [472d] malheureux. Et pour en venir à la question qui nous occupe, tu prétends en premier lieu qu'il est possible qu'on soit heureux étant injuste, et au milieu même de l'injustice; puisque tu crois qu'Archélaüs, quoique page 257 injuste, n'en est pas moins heureux. N'est-ce pas là l'idée que nous devons prendre de ta manière de penser? POLUS. Oui. SOCRATE. Et moi, je soutiens que la chose est impossible. Voilà un premier point sur lequel nous ne nous accordons pas. Soit. Mais le coupable sera-t-il heureux, si on lui fait justice, et s'il est puni? POLUS. Point du tout; au contraire, dans ce cas, il serait très malheureux. [472e] SOCRATE. Si le coupable échappe à la punition qu'il mérite, il sera donc heureux, à ton compte? POLUS. Assurément. SOCRATE. Et moi, je pense, Polus, que l'homme injuste et criminel est malheureux de toute manière ; mais qu'il l'est encore davantage, s'il ne subit aucun châtiment, et si ses crimes demeurent impunis; et qu'il l'est moins, s'il reçoit des hommes et des dieux la juste punition de ses fautes. page 258 [473a] POLUS. Tu avances là d'étranges paradoxes, Socrate. SOCRATE. Je vais essayer, mon cher, de te faire dire les mêmes choses que moi : car je te tiens pour mon ami. Voilà donc les objets sur lesquels nous sommes divisés. Juges-en toi-même. J'ai dit tout-à-l'heure que commettre une injustice est un plus grand mal que la souffrir. POLUS. Cela est vrai. SOCRATE. Et toi, que c'est un plus grand mal de la souffrir. POLUS. Oui. SOCRATE. J'ai dit que ceux qui agissent injustement sont malheureux ; et tu m'as réfuté là-dessus. POLUS. Oui, par Jupiter. [473b] SOCRATE. A ce que tu crois, Polus. POLUS. Et probablement j'ai raison de le croire. page 259 SOCRATE. De ton côté, tu tiens les méchants pour heureux, lorsqu'ils ne portent pas la peine de leur injustice. POLUS. Sans contredit. SOCRATE. Et moi, je dis qu'ils sont très malheureux, et que ceux qui subissent le châtiment qu'ils méritent, le sont moins. Veux- tu aussi réfuter cette maxime? POLUS. Elle est encore plus difficile à réfuter que la précédente, Socrate. SOCRATE. Point du tout, Polus : mais impossible; car le vrai ne se réfute pas. POLUS. Comment dis-tu ? Quoi ? un homme que l'on surprend dans quelque forfait, comme celui d'aspirer à la tyrannie, [473c] qu'on met ensuite à la torture, qu'on déchire, à qui l'on brûle les yeux; qui, après avoir souffert en sa personne des tourments sans mesure, sans nombre et de toute espèce, et en avoir vu souffrir autant à ses enfants et à sa femme, est enfin mis en croix, ou enduit de poix et brûlé vif : cet homme sera plus page 260 heureux que si, échappant à ces supplices, il devenait tyran, passait sa vie entière, maître dans sa ville, libre de faire tout ce qui lui plaît, objet d'envie pour ses [473d] concitoyens et pour les étrangers, et regardé comme heureux par tout le monde? Et tu prétends qu'il est impossible de réfuter de pareilles absurdités? SOCRATE. Tu cherches de nouveau à m'épouvanter, brave Polus ; mais tu ne me réfutes point : tout-à-l'heure tu appelais des témoins à ton secours. Quoi qu'il en soit, rappelle-moi une petite chose : as-tu supposé que cet homme aspirât injustement à la tyrannie? POLUS. Oui. SOCRATE. Cela étant, l'un ne sera pas plus heureux que l'autre, ni celui qui a réussi à s'emparer injustement de la tyrannie, ni celui qui a été puni; car il ne saurait se faire que de deux malheureux l'un soit plus heureux [473e] que l'autre. Mais le plus malheureux des deux est celui qui a échappé au châtiment, et s'est mis en possession de la tyrannie. Qu'est ceci, Polus ? Tu ris ? C'est sans doute encore une nouvelle manière de réfuter, que de rire au nez d'un homme, sans alléguer aucune raison contre ce qu'il dit. page 261 POLUS. Ne crois-tu pas être réfuté suffisamment, Socrate, en avançant ainsi des choses qu'aucun homme ne soutiendra jamais ? Interroge plutôt qui tu voudras des assistants. SOCRATE. Je ne suis point du nombre des politiques, Polus ; et l'an passé le sort m'ayant fait sénateur, lorsque ma tribu présida à son tour aux assemblées du peuple, et qu'il me fallut recueillir les suffrages, [474a] je me rendis ridicule, parce que je ne savais comment m'y prendre. Ne me parle donc point de recueillir les suffrages des assistants, et si, comme je l'ai déjà dit, tu n'as point de meilleurs arguments à m'opposer, laisse-moi t'interroger à mon tour, et fais l'essai de ma façon de réfuter, que je crois la bonne. Je ne sais produire qu'un seul témoin en faveur de ce que je dis, celui-là même avec qui je discute; et je ne tiens nul compte du grand nombre. Je ne recueille d'autre suffrage que le sien ; pour [474b] la foule, je ne lui adresse pas même la parole. Vois donc si tu veux souffrir à ton tour que je te réfute, en t'engageant à répondre à mes questions. Car je suis convaincu que toi et moi et les autres hommes, nous pensons tous que c'est un plus grand mal de com- page 262 mettre l'injustice que de la souffrir, et de n'être point puni de ses crimes que d'en être puni. POLUS. Je soutiens, au contraire, que ce n'est ni mon sentiment, ni celui d'aucun autre. Toi-même, aimerais-tu mieux qu'on te fît injustice, que de faire injustice à autrui? SOCRATE. Oui, et toi aussi, et tout le monde. POLUS. Il s'en faut bien : ni toi, ni moi, ni qui que ce soit n'est dans cette disposition. [474c] SOCRATE. Eh bien, répondras-tu ? POLUS. J'y consens; car je suis extrêmement curieux de savoir ce que tu diras. SOCRATE. Afin de l'apprendre, réponds-moi, Polus, comme si je commençais pour la première fois à t'interroger. Quel est le plus grand mal, à ton avis, de faire une injustice, ou de la recevoir ? POLUS. De la recevoir, selon moi. SOCRATE. Et quel est le plus laid de faire une injustice, ou de la recevoir ? Réponds. page 263 POLUS. De la faire. SOCRATE. Si cela est plus laid, c'est donc aussi un plus grand mal. POLUS. Point du tout. SOCRATE. J'entends. Tu ne [474d] crois pas, à ce qu'il paraît, que le beau et le bon, le mauvais et le honteux soient la même chose. POLUS. Non, certes. SOCRATE. Et que dis-tu à ceci? Toutes les belles choses eh fait de corps, de couleur, de figures, de sons, de genres de vie, les appelles-tu belles sans aucun motif? Et pour commencer par les beaux corps, quand tu dis qu'ils sont beaux, n'est-ce point ou par rapport à leur usage, à cause de l'utilité qu'on en peut tirer, ou en vue d'un certain plaisir, parce que leur aspect fait naître un sentiment de joie dans l'âme de ceux qui les regardent? Est-il hors de là quelque autre raison qui te fasse dire qu'un corps est beau ? page 264 [474e] POLUS. Je n'en connais point. SOCRATE. N'appelles-tu pas belles de même toutes les autres choses, soit figures, soit couleurs, pour le plaisir ou l'utilité qui en revient, ou pour l'un et l'autre à-la-fois? POLUS. Oui. SOCRATE. N'en est-il pas ainsi des sons, et de tout ce qui appartient à la musique? POLUS. Oui. SOCRATE.
Pareillement, ce qui est beau en fait de
lois et de genres de vie ne l'est pas sans doute pour une autre raison que parce
qu'il est ou utile ou [475a] POLUS. Apparemment. SOCRATE. N'en est-il point de même de la beauté des sciences ? POLUS. Sans contredit ; et c'est bien définir le beau, page 265 Socrate, que de le définir comme tu fais, ce qui est bon ou agréable. SOCRATE. Le laid est donc bien défini par les deux contraires, le douloureux et le mauvais? POLUS. Nécessairement. SOCRATE. De deux belles choses, si l'une est plus belle que l'autre, n'est-ce point parce qu'elle la surpasse ou en agrément, ou en utilité, ou dans tous les deux ? POLUS. Sans doute. SOCRATE. Et de deux choses laides, [475b] si l'une est plus laide que l'autre, ce sera parce qu'elle cause ou plus de douleur, ou plus de mal, ou l'un et l'autre. N'est-ce pas une nécessité? POLUS. Oui. SOCRATE. Voyons à présent. Que disions - nous tout-à-l'heure touchant l'injustice faite ou reçue ? Ne disais-tu pas qu'il est plus mauvais de souffrir l'injustice, et plus laid de la commettre? page 266 POLUS. Cela est vrai. SOCRATE. Si donc il est plus laid de faire une injustice que de la recevoir, c'est ou parce que cela est plus fâcheux et plus douloureux, ou parce que c'est un plus grand mal, ou l'un et l'autre à-la-fois. N'est-ce pas là encore une nécessité ? POLUS. J'en conviens. SOCRATE. Examinons, [475c] en premier lieu, s'il est plus douloureux de commettre une injustice que de la souffrir, et si ceux qui la font ressentent plus de douleur que ceux qui la reçoivent. POLUS. Nullement, Socrate. SOCRATE. L'action de commettre une injustice né l'emporte donc pas du côté de la douleur. POLUS. Non. SOCRATE. Cela étant, elle ne l'emporte pas, par conséquent, pour la douleur et le mal tout à-la-fois. page 267 POLUS. Il n'y a pas d'apparence. SOCRATE. Il reste donc qu'elle l'emporte par l'autre endroit. POLUS. Oui. SOCRATE. Par l'endroit du mal, n'est-ce pas? POLUS. Vraisemblablement. SOCRATE. Puisque faire une injustice l'emporte du côté du mal, la faire est donc plus mauvais que la recevoir. POLUS. Cela est évident. [475d] SOCRATE.
La plupart des hommes ne
reconnaissent-ils point, et n'as-tu pas toi-même avoué précédemment qu'il est
plus laid de commettre une injustice POLUS. Oui. SOCRATE. Et ne venons-nous pas de voir que c'est une chose plus mauvaise ? page 268 POLUS. Il paraît que oui. SOCRATE. Préférerais-tu ce qui est plus laid et plus mauvais à ce qui l'est moins? N'aie pas honte de répondre, Polus; il ne t'en arrivera aucun mal. Mais livre-toi sans crainte à la discussion, comme à un médecin; réponds, et [475e] accorde ou nie ce que je te demande. POLUS. Non, je ne le préférerais pas, Socrate. SOCRATE. Est-il quelqu'un au monde qui le préférât? POLUS. Il me semble que non, du moins d'après ce qui vient d'être dit. SOCRATE. Ainsi, j'avais raison de dire que ni moi, ni toi, ni qui que ce soit n'aimerait mieux faire une injustice que la recevoir, parce que c'est une chose plus mauvaise. POLUS. Il y a apparence. SOCRATE. Vois-tu présentement, Polus, que ma manière de réfuter et la tienne ne se ressemblent en page 269 rien? Tous les autres t'accordent ce que tu avances, excepté moi. Pour moi, il me suffit de ton [476a] seul aveu, de ton seul témoignage ; je ne recueille point d'autre suffrage que le tien, et je me mets peu en peine de ce que les autres pensent. — Que ce point demeure donc arrêté entre nous. Passons à l'examen de l'autre, sur lequel nous n'étions pas d'accord, savoir, si être puni pour les injustices qu'on a commises est le plus grand des maux, comme tu le pensais, ou si c'est un plus grand mal de n'être pas puni, comme je le croyais. Procédons de cette manière. Porter la peine de son injustice, et être châtié à juste titre, n'est-ce pas la même chose, selon toi? POLUS. Oui. [476b] SOCRATE. Pourrais-tu me nier que tout ce qui est juste, en tant que juste, est beau ? fais-y réflexion avant de répondre. POLUS. Il me paraît bien que cela est ainsi, Socrate. SOCRATE. Considère encore ceci. Lorsque quelqu'un fait une chose, n'est-il pas nécessaire qu'il y ait un patient qui corresponde à l'agent (21)? page 270 POLUS. Je le pense. SOCRATE. Ce que le patient souffre n'est-il pas la même chose que ce que fait l'agent ? Voici ce que je veux dire. Si quelqu'un frappe, n'est-ce pas une nécessité qu'une chose soit frappée ? POLUS. Assurément. SOCRATE. Et s'il frappe fort ou vite, [476c] que la chose soit frappée de même? POLUS. Oui. SOCRATE. Ce qui est frappé éprouve donc une passion de même nature que l'action de qui frappe. POLUS. Sans doute. SOCRATE. Pareillement, si quelqu'un brûle, il est nécessaire qu'une chose soit brûlée. POLUS. Cela ne peut être autrement. SOCRATE. Et s'il brûle fort ou d'une manière doulou- page 271 reuse, que la chose soit brûlée précisément de la façon dont on la brûle. POLUS. Sans difficulté. SOCRATE. Il en est de même si une chose coupe ; une autre est coupée. POLUS. Oui. SOCRATE. Et si la coupure est grande, ou profonde, ou douloureuse, la chose coupée [476d] l'est exactement de la manière dont on la coupe. POLUS. Tout-à-fait. SOCRATE. En un mot, vois si tu m'accordes en général ce que je viens de dire, que ce que fait l'agent, le patient le souffre tel que l'agent le fait. POLUS. Je l'accorde. SOCRATE. Cela convenu, dis-moi si être puni c'est pâtir ou agir. POLUS. Évidemment, c'est pâtir, Socrate. page 272 SOCRATE. De la part de quelque agent, sans doute. POLUS. Cela va sans dire : de la part de celui qui châtie. SOCRATE. Quiconque châtie à bon droit [476e] ne châtie-t-il point justement? POLUS. Oui. SOCRATE. Fait-il en cela une action juste, ou non? POLUS. Il fait une action juste. SOCRATE. Ainsi celui qui est châtié, lorsqu'on le punit d'une faute, pâtit justement. POLUS. Apparemment. SOCRATE. N'avons-nous pas avoué que tout ce qui est juste est beau? POLUS. Sans contredit. SOCRATE. Ce que fait la personne qui châtie et ce que souffre la personne châtiée est donc beau. page 273 POLUS. Oui. [477a] SOCRATE. Mais si c'est beau, c'est en même temps bon ; car le beau est ou agréable, ou utile. POLUS. Nécessairement. SOCRATE. Ainsi ce que souffre celui qui est puni est bon. POLUS. Il paraît qu'oui. SOCRATE. Il lui en revient par conséquent quelque utilité. POLUS. Oui. SOCRATE. Est-ce l'utilité que je conçois, savoir, de devenir meilleur quant à l'âme, s'il est vrai qu'il soit châtié à juste titre? POLUS. Cela est vraisemblable. SOCRATE. Ainsi, celui qui est puni est délivré du mal de l'âme. POLUS. Oui. page 274 SOCRATE. N'est-il pas délivré par là du plus grand [477b] des maux? Envisage la chose de cette manière. Connais-tu, pour qui veut faire fortune, quelque autre mal que la pauvreté? POLUS. Non, je ne connais que celui-là. SOCRATE. Et par rapport au corps, n'appelles-tu point mal la faiblesse, la maladie, la laideur, et ainsi du reste? POLUS. Oui. SOCRATE. Tu penses sans doute que l'âme a aussi son mal? POLUS. Sans contredit. SOCRATE. N'est-ce pas ce que tu nommes injustice, ignorance, lâcheté, et les autres vices semblables? POLUS. Assurément. SOCRATE. A ces trois choses donc, fortune, [477c] corps et âme, répondent, selon toi, trois maux, pauvreté, maladie? injustice? page 275 POLUS. Oui. SOCRATE. De ces trois maux, quel est le plus laid ? N'est-ce pas l'injustice, et, pour le dire en un mot, le mal de l'âme? POLUS. Sans comparaison. SOCRATE. Si c'est le plus laid, n'est-ce pas aussi le plus mauvais ? POLUS. Comment entends-tu ceci, Socrate? SOCRATE. Le voici. En conséquence de nos aveux précédents, ce qui est le plus laid est toujours tel ? parce qu'il cause la plus grande douleur ou le plus grand dommage, ou l'un et l'autre ensemble. POLUS. A merveille. SOCRATE. Or, ne venons-nous pas de reconnaître que l'injustice et tout mal de l'âme [477d] est ce qu'il y a de plus laid? POLUS. Nous l'avons reconnu en effet. page 276 SOCRATE. Et le plus laid n'est-il point tel, ou parce que rien n'est plus douloureux, ou parce que rien n'est plus dommageable, ou à cause de l'un et de l'autre? POLUS. De toute nécessité. SOCRATE. Or, est-il plus douloureux d'être injuste, intempérant, lâche, ignorant, que d'être indigent ou malade? POLUS. Il me paraît que non, Socrate, d'après tout cela. SOCRATE. Le mal de l'âme n'est donc le plus laid que parce qu'il l'emporte en dommage [477e] sur tous les autres, d'une manière extraordinaire et merveilleuse, puisque de ton aveu il ne l'emporte point du côté de la douleur. POLUS. Il le faut bien. SOCRATE. Mais ce qui l'emporte par l'excès du dommage est le plus grand de tous les maux. page 277 POLUS. Oui. SOCRATE. Donc l'injustice, l'intempérance, et en général les maux de l'âme sont de tous les maux les plus grands. POLOS. Il paraît qu'oui. SOCRATE. Quel art nous délivre de la pauvreté ? N'est-ce pas l'économie? POLUS. Oui. SOCRATE. Et de la maladie? N'est-ce pas la médecine? [478a] POLUS. Sans difficulté. SOCRATE. Et des maux de l'âme et de l'injustice? Si tu ne trouves pas de réponse de cette manière, vois de celle-ci. Où et chez qui conduisons-nous ceux dont le corps est malade ? POLUS. Chez les médecins, Socrate. page 268 SOCRATE. Où conduit-on ceux qui s'abandonnent à l'injustice et à l'intempérance? POLUS. Tu veux dire apparemment chez les juges. SOCRATE. N'est-ce pas pour y être punis? POLUS. Sans doute. SOCRATE. Ceux qui châtient avec raison ne suivent-ils point en cela une certaine justice? POLUS. Cela est évident. SOCRATE. Ainsi l'économie délivre de l'indigence, [478b] la médecine de la maladie, et la justice de l'intempérance et de l'injustice. POLUS. Je le pense ainsi. SOCRATE. Mais de ces trois choses dont tu parles, quelle est la plus belle ? POLUS. De quelles choses ? page 279 SOCRATE. L'économie, la médecine et la justice. POLUS. La justice l'emporte de beaucoup, Socrate. SOCRATE. Puisqu'elle est la plus belle, c'est donc parce qu'elle procure le plus grand plaisir, ou la plus grande utilité, ou l'un et l'autre. POLUS. Oui. SOCRATE. Est-ce une chose agréable d'être entre les mains des médecins ; et le traitement qu'on fait aux malades leur cause-t-il du plaisir? POLUS. Je ne le crois pas. SOCRATE. Mais c'est une chose utile, n'est-ce pas? POLUS. [478c] Oui. SOCRATE. Car elle délivre d'un grand mal : en sorte qu'il est avantageux de souffrir la douleur pour recouvrer la santé. page 280 POLUS. Sans contredit. SOCRATE. L'homme qui est ainsi entre les mains des médecins est-il dans la situation la plus heureuse par rapport au corps, ou bien est-ce celui qui n'a point été malade? POLUS. Il est évident que c'est celui-ci. SOCRATE. En effet, le bonheur ne consiste pas, ce semble, à être soulagé du mal, mais à n'en pas avoir eu. POLUS. Cela est vrai. [478d] SOCRATE. Mais quoi ! de deux hommes malades, quant au corps ou quant à l'âme, quel est le plus malheureux, de celui qu'on traite et qu'on délivre de son mal, ou de celui qu'on ne traite point, et qui garde son mal? POLUS. Il me paraît que c'est celui qu'on ne traite point. SOCRATE. Ainsi la punition procure la délivrance du plus grand des maux, du mal de l'âme. page 281 POLUS. J'en conviens. SOCRATE. Car elle rend sage, elle oblige à devenir plus juste, et elle est une sorte de médecine morale. POLUS. Oui. SOCRATE. Le plus heureux, par conséquent, est celui qui n'a admis dans son âme aucun mal, puisque nous avons vu que le mal de l'âme [478e] est le plus grand de tous. POLUS. Sans difficulté. SOCRATE. Le second est celui qu'on en a délivré. POLUS. Il y a apparence. SOCRATE. C'est-à-dire, celui qui a reçu des avis, des réprimandes, qui a subi la punition. POLUS. Oui. SOCRATE. Ainsi, celui qui est malade de l'injustice, et qui n'en a pas été délivré, mène la vie la plus mal heureuse. page 282 POLUS. Selon toute vraisemblance. SOCRATE. Eh bien ! cet homme, n'est-ce pas celui qui, s'étant rendu coupable des plus grands crimes, et tout rempli d'injustice, parvient à se mettre au-dessus des réprimandes, [479a] des corrections, des punitions?Telle est, comme tu le dis toi-même, la situation d'Archélaüs, et celle des autres tyrans, des orateurs et de tous ceux qui jouissent d'un grand pouvoir. POLUS. Il paraît qu'oui. SOCRATE. Et véritablement, mon cher, tous ces gens-là ont fait à-peu-près la même chose que celui qui, étant attaqué des plus grandes maladies, trouverait le moyen de ne point faire corriger par les médecins les affections vicieuses qui le travaillent, et de ne point faire de traitement, craignant, comme un enfant, qu'on ne lui applique le fer et le feu, parce que [479b] cela fait mal. Ne te semble-t-il pas que la chose est ainsi? POLUS. Oui. SOCRATE. Ce serait sans doute par ignorance des avantages de la santé et de la bonne habitude du page 283 corps. D'après nos aveux précédents, ceux qui fuient la punition ont bien l'air de se conduire de la même manière, mon cher Polus. Ils voient ce qu'elle a de douloureux; mais ils sont aveugles sur son utilité ; ils ignorent combien on est plus à plaindre d'habiter avec une âme qui n'est pas saine, mais qui est corrompue, injuste et impie, [479c] qu'avec un corps malade. C'est pourquoi ils mettent tout en œuvre pour échapper à la punition, et n'être point délivrés du plus grand des maux, et ils ne songent qu'à amasser des richesses, à se faire des amis, et à acquérir le talent de la parole et de la persuasion. Mais si les choses dont nous sommes convenus sont vraies, Polus, vois-tu ce qui résulte de ce discours? ou veux-tu que nous en tirions ensemble les conclusions? POLUS. J'y consens, à moins que tu ne sois d'un autre avis. SOCRATE. Ne suit-il pas de là que l'injustice est [479d] le plus grand des maux? POLUS. Il me le semble, du moins. SOCRATE. N'avons-nous pas vu que la punition procure la délivrance de ce mal? page 284 POLUS. Vraisemblablement. SOCRATE. Et que l'impunité ne fait que l'entretenir ? POLUS. Oui. SOCRATE. L'injustice n'est donc que le second mal pour la grandeur ; mais l'injustice impunie est le premier et le plus grand de tous les maux. POLUS. Tu as bien l'air d'avoir raison. SOCRATE. Mon cher ami, n'est-ce point sur ceci que nous étions partagés de sentiment? Tu regardais comme heureux Archélaüs, parce que, s'étant rendu coupable des plus grands crimes, [479e] il n'en subissait aucune punition; et moi je soutenais, au contraire, qu'Archélaüs, et tout autre, quel qu'il soit, qui ne porte pas la peine des injustices qu'il a commises, doit passer pour infiniment plus malheureux que personne ; que l'auteur d'une injustice est toujours plus malheureux que celui qui la souffre, et le méchant qui demeure impuni, plus que celui que l'on châtie. N'est-ce pas là ce que je disais? page 285 POLUS. Oui. SOCRATE. N'est-il pas démontré que j'avais la vérité pour moi ? POLUS. J'en conviens. [480a] SOCRATE. A la bonne heure. Mais si cela est vrai, Polus, quelle est donc la grande utilité de la rhétorique ? Car c'est une conséquence de nos aveux; qu'il faut avant toutes choses se préserver de toute action injuste, parce qu'elle ne nous rapporterait que du mal. N'est-ce pas? POLUS. Assurément. SOCRATE. Et que si on a commis une injustice ou soi-même, ou quelque autre personne à qui l'on s'intéresse, il faut aller se présenter là où l'on recevra au plus tôt la correction convenable, et s'empresser de se rendre auprès du juge comme auprès d'un médecin, [480b] de peur que la maladie de l'injustice venant à séjourner dans l'âme, n'y engendre une corruption secrète, qui devienne incurable. Que pouvons-nous dire autre chose, Polus, si nos premiers aveux subsistent ? N'est- page 286 ce pas la seule manière d'accorder ce que nous disons avec ce que nous avons établi précédemment? POLUS. Comment en effet tenir un autre langage, Socrate ? SOCRATE. La rhétorique, Polus, ne nous est donc d'aucun usage pour nous défendre contre l'injustice, nous, nos parents, nos amis, nos enfants, notre patrie ; je ne vois guère [480c] qu'un moyen de la rendre utile, c'est de s'accuser soi-même avant tout autre, ensuite ses proches et ses amis, dès qu'on a commis quelque injustice, de ne point tenir le crime secret, mais de l'exposer au grand jour, afin qu'il soit puni et réparé; c'est de se faire violence à soi ainsi qu'aux autres pour s'élever au-dessus de toute crainte, et de s'offrir à la justice les yeux fermés et de grand cœur, comme on s'offre au médecin pour souffrir les incisions et les brûlures, s'attachant au bon et au beau, sans tenir compte de la douleur; en sorte que si, par exemple, la faute qu'on a faite mérite des coups de fouet, [480d] on se présente pour les recevoir ; si les fers, on leur tende les mains; une amende, on la paie; le bannissement, on s'y condamne; la mort, on la subisse; c'est enfin d'être le premier à dépo- page 287 ser contre soi-même et contre ses proches, de ne pas s'épargner, et pour cela de mettre en œuvre toutes les ressources de la rhétorique, afin de parvenir, par la manifestation de ses crimes, à être délivré du plus grand des maux, de l'injustice. Accorderons-nous cela, Polus, ou le nierons-nous? [480e] POLUS. Cela me paraît bien étrange, Socrate. Toutefois peut-être est-ce une conséquence de ce que nous avons dit plus haut. SOCRATE. Ainsi, il faut ou renverser nos discours précédons, ou convenir que ceci en résulte nécessairement. POLUS. Oui. La chose est ainsi. SOCRATE. Et l'on fera tout le contraire, lorsqu'on voudra faire du mal à quelqu'un, soit à son ennemi, soit à tout autre; il faut seulement n'avoir rien à souffrir soi-même de son ennemi ; on doit bien y prendre garde ; mais s'il commet une injustice envers un autre, il faut s'efforcer de toute manière, et [481a] d'action et de paroles, de le soustraire au châtiment, et empêcher qu'il ne paraisse devant les juges; et au cas qu'il y paraisse, il faut page 288 tout mettre en œuvre pour qu'il échappe, et ne soit pas puni ; de façon que s'il a volé une grande quantité d'argent, il ne le rende pas, mais qu'il le garde, et l'emploie en dépenses injustes et impies pour son usage et celui de ses amis; que si son crime mérite la mort, il ne la subisse point, et, s'il se peut, qu'il ne meure jamais, et soit immortel dans le crime, ou du moins [481b] qu'il y vive le plus longtemps possible. Voilà, Polus, à quoi la rhétorique me semble utile ; car pour celui qui ne commet aucune injustice, je ne vois pas qu'elle puisse lui être d'une grande utilité, s'il est vrai même qu'elle lui en soit d'aucune, comme en effet nous avons vu plus haut qu'elle n'est bonne à rien. CALLICLÈS. Dis-moi, Chéréphon, Socrate parle-t-il sérieusement, ou badine-t-il ? CHÉRÉPHON. Il me paraît, Calliclès, qu'il parle très sérieusement; mais rien n'est tel que de l'interroger lui-même. CALLICLÈS. Par tous les dieux, tu as raison ; c'est ce que j'ai envie de faire. Socrate, [481c] dis-moi, croirons-nous que tout ceci est sérieux de ta part, ou page 289 que ce n'est qu'un badinage ? Car si c'est tout de bon que tu parles, et si ce que tu dis est vrai, la conduite que nous tenons tous tant que nous sommes, qu'est-ce autre chose qu'un renversement de l'ordre, et une suite d'actions toutes contraires, ce semble, à nos devoirs? SOCRATE. Si les hommes, Calliclès, n'étaient pas sujets aux mêmes passions, ceux-ci d'une façon, ceux-là d'une autre ; mais que chacun de nous eût sa passion qui lui fût propre, il ne serait point aisé [481d] de faire connaître à autrui ce qu'on éprouve soi-même. Je parle ainsi, en faisant réflexion que nous sommes actuellement toi et moi dans le même cas, et que tous deux nous aimons deux choses ; moi, Alcibiade fils de Clinias et la philosophie ; toi, le peuple d'Athènes et le fils de Pyrilampe (22). Je remarque tous les jours que, tout éloquent que tu es, lorsque les objets de ton amour sont d'un autre avis que toi, quelle que soit leur façon de penser, tu n'as pas la force de les contredire, et que tu passes comme il leur plaît [481e] du blanc au noir. En effet, quand tu parles au peuple assemblé, s'il soutient que les choses ne sont pas telles que tu dis, tu changes aussitôt page 290 de sentiment, pour te conformer à ses intentions. La même chose t'arrive vis-à-vis de ce beau garçon, le fils de Pyrilampe. Tu ne saurais résister aux volontés ni aux discours de ce que tu aimes ; et si quelqu'un, témoin du langage que tu prends ordinairement pour leur complaire, en paraissait surpris, et Je trouvait absurde, tu lui répondrais probablement, si tu voulais dire la vérité, qu'à moins qu'on ne vienne à bout d'empêcher tes [482a] amours de parler comme ils font, tu ne peux t'empêcher toi-même de parler comme tu fais. Figure-toi donc que tu as la même réponse à entendre de ma part, et ne t'étonne point des discours que je tiens ; mais engage la philosophie, mes amours, à ne plus parler de même ; car c'est elle, mon cher, qui dit ce que tu as entendu ; et elle est beaucoup moins étourdie que mes autres amours. Le fils de Clinias parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre ; mais la philosophie a toujours [482b] le même langage. Ça qui te paraît à ce moment si étrange, est d'elle : tu viens de l'entendre. Ainsi, ou réfute ce qu'elle disait tout-à-l'heure par ma bouche, et prouve-lui que commettre l'injustice et vivre dans l'impunité après l'avoir commise, n'est pas le comble de tous les maux, ou si tu laisses cette vérité subsister dans toute sa force, je te jure, Calliclès, par le dieu des page 291 Égyptiens (23), que Calliclès ne s'accordera point avec lui - même, et sera toute sa vie dans une contradiction perpétuelle. Cependant il vaudrait beaucoup mieux pour moi,ce me semble, que la lyre dont j'aurais à me servir fût mal montée et discordante, que le chœur dont j'aurais fait les frais détonnât, [482c] et que la plupart des hommes fussent d'un sentiment opposé au mien, que si j'étais pour mon compte mal d'accord avec moi-même, et réduit à me contredire. CALLICLÈS. En vérité, Socrate, tes discours sont pleins de prestiges, comme ceux d'un orateur populaire; et ce qui autorise tes déclamations, c'est qu'il est arrivé à Polus la même chose qu'il a prétendu être arrivé à Gorgias vis-à-vis de toi. Polus disait en effet que Gorgias, lorsque tu lui as demandé si, au cas qu'on se rendît auprès de lui pour apprendre la rhétorique [482d] sans avoir aucune connaissance de la justice, il en donnerait des leçons, avait répondu qu'il l'enseignerait, par mauvaise honte et à cause des préjugés, qui trouveraient mauvais qu'on fît une réponse contraire ; cet aveu, selon Polus, avait réduit Gorgias à tomber en contradiction avec lui-même, et tu en avais profité. Il s'est moqué de toi page 292 avec raison en cette rencontre, autant qu'il m'a paru. Mais voilà qu'il se trouve à présent dans le même cas que Gorgias. Je t'avoue pour moi, que je ne suis nullement satisfait que Polus t'ait accordé qu'il est plus laid de faire une injustice que de la recevoir. [482e] Car c'est pour t'avoir passé ce point, qu'il s'est embarrassé dans la dispute, et que tu lui as fermé la bouche, parce qu'il a eu honte de parler suivant sa pensée. En effet, Socrate, tout en disant que tu cherches la vérité, tu en agis comme le plus fatigant déclamateur, et tu mets la conversation sur ce qui est beau non selon la nature, mais selon la loi. Or, dans la plupart des choses, la nature et la loi sont opposées entre elles ; d'où il arrive que, si on se laisse aller à la honte, [483a] et que l'on n'ose dire ce qu'on pense, on est forcé à se contredire. Tu as aperçu cette subtile distinction, et tu t'en sers pour dresser des pièges dans la dispute. Si quelqu'un parle de ce qui appartient à la loi, tu l'interroges sur ce qui regarde la nature, et s'il parle de ce qui est dans l'ordre de la nature, tu l'interroges sur ce qui est dans l'ordre de la loi. C'est ce que tu viens de faire pour l'injustice commise et reçue. Polus parlait de ce qui est plus laid en ce genre, selon la loi; toi, au contraire, tu as pris la loi pour la nature; car, selon la nature, tout ce qui est plus page 293 mauvais est aussi plus laid, c'est-à-dire souffrir l'injustice ; tandis que, selon la loi, c'est la commettre. Et en effet, [483b] succomber sous l'injustice d'autrui n'est pas le fait d'un homme, mais d'un esclave, à qui il est meilleur de mourir que de vivre, quand, souffrant des injustices et des affronts, il n'est pas en état de se défendre soi-même, ni ceux pour qui il s'intéresse. Les lois sont, à ce que je pense, l'ouvrage des plus faibles et des plus nombreux ; en les faisant ils n'ont donc pensé qu'à eux-mêmes et à leurs intérêts : s'ils approuvent, s'ils blâment [483c] quelque chose, ce n'est que dans cette vue ; et pour effrayer les plus forts, qui pourraient acquérir de l'ascendant sur les autres, et les empêcher d'en venir là, ils disent que la supériorité est une chose laide et injuste, et que travailler à devenir plus puissant, c'est se rendre coupable d'injustice ; car, étant les plus faibles, ils se tiennent, je crois, trop heureux que tout soit égal. Voilà pourquoi, dans l'ordre de la loi, il est injuste et laid de chercher à l'emporter sur les autres, et ce qui fait qu'on a donné à cela le nom d'injustice. Mais la nature démontre, ce me semble, [483d] qu'il est juste que celui qui vaut mieux ait plus qu'un autre qui vaut moins, et le plus fort plus que le plus faible. Elle fait voir en mille rencontres qu'il en est ainsi, tant en ce page 294 qui concerne les animaux que les hommes eux-mêmes, parmi lesquels nous voyons des états et des nations entières où la règle du juste est que le plus fort commande au plus faible, et soit mieux partagé. De quel droit en effet Xerxès fit-il la guerre à la Grèce, et son père aux Scythes ? Sans parler [483e] d'une inanité d'autres exemples qu'on pourrait citer. Dans ces sortes d'entreprises, on agit, je pense, selon la nature, selon la loi de la nature, si ce n'est pas selon celle que les hommes ont établie. Nous prenons dès l'enfance les meilleurs et les plus forts d'entre nous ; nous les formons et les domptons comme des lionceaux, par des enchantements et des prestiges, et nous leur enseignons [484a] qu'il faut respecter l'égalité, et qu'en cela consiste le beau et le juste. Mais qu'il paraisse un homme d'une nature puissante, qui secoue et brise toutes ces entraves, foule aux pieds nos écritures, nos prestiges, nos enchantements et nos lois contraires à la nature, et s'élève au-dessus de tous, comme un maître, lui dont nous avions fait un esclave, c'est alors [484b] qu'on verra briller la justice telle qu'elle est selon l'institution de la nature. Pindare me paraît appuyer ce sentiment dans l'ode où il dit que la loi est la reine des mortels et des immortels. Elle traîne après elle, poursuit- page 295 il, la violence d'une main puissante, et elle la légitime. J'en juge par les actions d'Hercule, qui, sans les avoir achetés... (24) Ce sont à-peu- près les paroles de Pindare ; car je ne sais point cette ode par cœur. Mais le sens est qu'Hercule emmena avec lui les bœufs de Géryon, [484c] sans qu'il les eût achetés ou qu'on les lui eût donnés ; donnant à entendre que cette action était juste, à consulter la nature, et que les bœufs et tous les autres biens des faibles et des petits appartiennent de droit au plus fort et au meilleur. La vérité est donc telle que je dis : tu le reconnaîtras toi-même si, laissant là la philosophie, tu t'appliques à de plus grands objets. J'avoue, Socrate, que la philosophie est une chose amusante, lorsqu'on l'étudie avec modération dans la jeunesse. Mais si on si arrête trop longtemps, c'est un fléau. Quelque beau naturel que l'on ait, si on pousse ses études en ce genre jusque dans un âge avancé, on reste nécessairement neuf en toutes les choses [484d] qu'on ne peut se dispenser de savoir, si l'on veut devenir un homme comme il faut, et se faire une réputation. Les philosophes n'ont en effet aucune connaissance des lois qui s'observent dans une ville ; ils ignorent comment il page 296 faut traiter avec les hommes dans les rapports publics ou particuliers qu'on a avec eux ; ils n'ont nulle expérience des plaisirs et des passions humaines, ni en un mot de ce qu'on appelle la vie. Aussi, lorsqu'ils se trouvent chargés de quelque affaire domestique ou civile, [484e] ils se rendent ridicules à peu près comme les politiques, quand ils assistent à vos assemblées et à vos disputes. Car rien n'est plus vrai que ce que dit Euripide :
Chacun s'applique aux choses où il excelle, [485a] Au contraire, on s'éloigne des choses où l'on réussit mal, et on en parle avec mépris ; tandis que par amour-propre on vante les premières, croyant par là se vanter soi-même. Mais le mieux est, à mon avis, d'avoir quelque connaissance des unes et des autres. Il est bon d'avoir une teinture de philosophie, autant qu'il en faut pour que l'esprit soit cultivé; et il n'est pas honteux à un jeune homme d'étudier la philosophie. Mais lorsqu'on est sur le retour de l'âge, et qu'on philosophe encore, la chose de- page 297 vient alors ridicule, Socrate. [485b] Pour moi, je suis, par rapport à ceux qui s'appliquent à la philosophie, dans la même disposition d'esprit qu'à l'égard de ceux qui bégaient et s'amusent à jouer. Quand je vois un enfant à qui cela convient encore, bégayer ainsi en parlant et badiner, j'en suis fort aise, je trouve cela gracieux, noble, et séant à cet âge ; tandis que si j'entends un enfant articuler avec précision, cela me choque, me blesse l'oreille, et me paraît sentir l'esclave. Mais si c'est un homme que l'on entend ainsi bégayer ou qu'on voit jouer, la chose paraît ridicule, indécente à cet âge, et digne du fouet. Voilà ce que je pense de ceux qui s'occupent de philosophie. Quand je vois un [485c] jeune homme s'y adonner, j'en suis charmé, cela me semble à sa place, et je juge que ce jeune homme a de la noblesse dans les sentiments. S'il la néglige au contraire, je le regarde comme une âme basse, qui ne se croira jamais capable d'une action belle [485d] et généreuse. Mais lorsque je vois un vieillard qui philosophe encore, et n'a point renoncé à cette étude, je le tiens digne du fouet, Socrate. Comme je disais en effet tout-à-l'heure, quelque beau naturel qu'ait un pareil homme, il ne peut manquer de tomber au-dessous de lui-même, en évitant les endroits fréquentés de la ville, et les places publiques, où page 298 les hommes, selon le poète (26), acquièrent de la célébrité : et il passe ainsi caché le reste de ses jours à jaser dans un coin avec trois ou [485e] quatre enfants, sans que jamais il sorte de sa bouche aucun discours noble, grand, et qui vaille quelque chose. Socrate, je suis de tes bons amis; voilà pourquoi je suis à ce moment à ton égard dans les mêmes sentiments que Zéthus vis-à-vis de l'Amphion d'Euripide, dont j'ai déjà fait mention : et il me vient à la pensée de t'adresser un discours semblable à celui que Zéthus tenait à son frère. Tu négliges, Socrate (27), ce qui devrait faire ta principale occupation, et tu avilis dans un rôle d'enfant une âme [486a] aussi bien faite que la tienne. Tu ne saurais proposer un avis dans les délibérations relatives à la justice, ni saisir dans une affaire ce qu'elle a de plausible et de vraisemblable, ni suggérer aux autres un conseil généreux. Cependant, mon cher Socrate (ne t'offense point de ce que je vais dire; c'est par bienveillance que je te parle ainsi), ne trouves-tu pas qu'il est honteux pour toi d'être dans l'état où je suis persuadé que tu es, ainsi que tous ceux qui passent leur vie à page 299 parcourir le carrière philosophique ? Si quelqu'un mettait actuellement la main sur toi, ou sur un de ceux qui te ressemblent, et te conduisait en prison, disant que tu lui as fait tort, quoiqu'il n'en soit rien, tu sais que tu serais [486b] fort embarrassé de ta personne, que la tête te tournerait, et que tu ouvrirais la bouche toute grande, sans savoir que dire. Lorsque tu paraîtrais devant les juges, quelque vil et méprisable que fût ton accusateur, tu serais mis à mort, s'il lui plaisait de demander contre toi cette peine. Or, quelle estime, Socrate peut-on faire d'un art qui trouvant un homme bien né le rend plus mauvais, le met hors d'état de se secourir lui-même, et de se tirer ou de tirer les autres des plus grands dangers, qui l'expose à se voir dépouiller de tous ses biens [486c] par ses ennemis, et à traîner dans sa patrie une vie sans honneur ? La chose est un peu forte à dire ; mais enfin on peut impunément frapper sur la figure un homme de ce caractère. Ainsi, crois-moi, mon cher, laisse là tes arguments, cultive les belles choses, exerce-toi à ce qui te donnera la réputation d'homme habile ; abandonne cet appareil d'extravagances ou de puérilités, qui finiront par te ruiner et te faire une maison déserte, et propose-toi pour modèles, non ceux qui disputent sur ces [486d] bagatelles, mais ceux page 300 qui ont du bien, du crédit, et qui jouissent des avantages de la vie. SOCRATE. Si mon âme était d'or, Calliclès, ne penses-tu pas que se serait une grande joie pour moi d'avoir trouvé quelque pierre excellente, de celles dont on se sert pour éprouver l'or; de façon qu'approchant mon âme de cette pierre, si elle me rendait un témoignage satisfaisant de mon âme, je susse à n'en pouvoir douter que je suis en bon état et n'ai plus besoin d'aucune épreuve? [486e] CALLICLÈS. A quel propos me demandes-tu cela, Socrate ? SOCRATE. Je vais te le dire : je crois avoir fait en ta personne cette heureuse rencontre. CALLICLÈS. Pourquoi cela? SOCRATE. Je suis bien assuré que si tu tombes d'accord avec moi sur les principes que j'ai dans l'âme, ces principes sont vrais. Je remarque en effet [487a] que pour examiner comme il faut si une âme est bien ou mal, il faut avoir trois qualités, que tu réunis toutes, la science, la bienveillance et la franchise. Je me trouves avec bien des gens qui page 301 ne sont pas capables de me sonder, parce qu'ils ne sont pas savanτs comme toi. Il en est d'autres qui sont savanτs; mais comme ils ne s'intéressent pas à moi, ainsi que tu le fais, ils ne veulent pas me dire la vérité. Quant à ces deux étrangers, Gorgias et Polus, ils sont habiles l'un et l'autre et [487b] de mes amis : mais ils manquent d'une certaine hardiesse à parler, et ils sont plus timides qu'il ne convient de l'être. Je n'exagère pas, puisqu'ils ont porté la timidité au point de se contredire par une mauvaise honte l'un et l'autre en présence de tant de personnes, et cela sur les objets les plus importanτs. Pour toi, tu as d'abord tous les avantages des autres. Tu es grandement habile, comme la plupart des Athéniens en conviendront, et de plus tu as de la bienveillance pour moi. [487c] Voici par où j'en juge. Je sais, Calliclès, que vous êtes quatre, qui avez étudié ensemble la philosophie, toi, Tisandre d'Aphidne (28), Andron fils d'Androtion, et Nausicyde de Cholarges (29). Je vous ai entendus un jour délibérer jusqu'à quel point il fallait cultiver la sagesse ; et je sais que l'avis qui l'emporta, fut qu'on ne devait pas se proposer de devenir un philosophe à la rigueur, et que vous vous conseillâtes page 302 [487d] mutuellement de bien prendre garde de vous faire tort sans le vouloir en vous appliquant à l'étude plus qu'il ne faut. Aujourd'hui donc que je t'entends me donner le même conseil qu'à tes plus intimes amis, c'est une preuve décisive pour moi de la sincérité de ton affection. D'ailleurs, que tu saches me parler avec toute liberté, et ne me rien déguiser, tu le dis toi-même, et le discours que tu viens de m'adresser en fait foi. [487e] Puisqu'il en est évidemment ainsi, ce que tu m'accorderas dans la discussion aura passé par une épreuve suffisante de ta part et de la mienne, et il ne sera plus nécessaire de le soumettre à un nouvel examen. Car tu ne me l'auras laissé passer ni par défaut de lumières, ni par timidité : tu ne feras non plus aucune concession à dessein de me tromper, étant mon ami, comme tu le dis. Ainsi le résultat dont nous serons convenus sera la pleine et entière vérité. Or, de tous les sujets de discussion, Calliclès, le plus beau est sans doute celui sur lequel tu m'as fait une leçon : ce que l'homme doit être, [488a] à quoi il doit s'appliquer, et jusqu'à quel point, soit dans la vieillesse, soit dans la jeunesse. Le genre de vie que je mène peut être répréhensible à quelques égards ; mais sois persuadé que la faute n'est pas volontaire de ma part, et que l'ignorance seule en est la cause. Continue donc page 303 à me donner des avis, comme tu as si bien commencé; et explique-moi à fond quel est le genre de vie que je dois embrasser, et comment je dois m;y prendre pour l'exercer : et si après que la chose aura été arrêtée entre nous, tu découvres dans la suite que je ne suis pas fidèle à mes conventions, tiens-moi pour un homme sans cœur, et [488b] désormais ne me fais plus part de tes conseils, comme en étant absolument indigne. Expose-moi donc de nouveau, je t'en prie, ce que tu entends, toi et Pindare, par le juste selon l'ordre de la nature ? N'est-ce pas le droit qu'aurait le plus puissant de s'emparer de ce qui appartient au plus faible, le meilleur de commander au moins bon, et celui qui vaut davantage d'avoir plus que celui qui vaut moins? As-tu quelque autre idée du juste ? ou ma mémoire ne me trompe-t-elle pas ? CALLICLÈS. C'est ce que j'ai dit alors et ce que je dis encore. SOCRATE. Est-ce le même homme que tu appelles meilleur et plus puissant ? [488c] car je t'avoue que je n'ai pu comprendre ce que tu voulais dire. Par les plus puissants, entends-tu les plus forts; et faut-il que les plus faibles soient soumis au plus fort, comme tu l'as, ce me semble, insinué, en disant que page 304 les grands états attaquent les petits d'après la justice naturelle, parce qu'ils sont plus puissants et plus forts; ce qui suppose que plus puissant, plus fort et meilleur sont la même chose : ou peut-on être meilleur, et en même temps plus petit et plus faible; plus puissant, et aussi plus méchant ? ou meilleur et plus puissant sont-ils compris sous la même [488d] définition ? Donne-moi une définition nette, et dis-moi si plus puissant, meilleur, et plus fort, expriment la même idée, ou des idées différentes. CALLICLÈS. Je te déclare donc nettement que ces trois mots expriment la même idée. SOCRATE. Dans l'ordre de la nature le grand nombre n'est-il pas plus puissant que l'individu, le grand nombre, qui fait des lois contre l'individu, comme tu disais tout-à-l'heure ? CALLICLÈS. Qui en doute ? SOCRATE. Les lois du plus grand nombre sont donc celles des plus puissants. CALLICLÈS. Assurément. [488e] SOCRATE. Et par conséquent des meilleurs, puisque, page 305 selon toi, les plus puissants sont aussi les meilleurs de beaucoup. CALLICLÈS. Oui. SOCRATE. Leurs lois sont donc belles suivant la nature, étant celles des plus puissants. CALLICLÈS. J'en conviens. SOCRATE. Or le grand nombre ne pense-t-il pas que la justice consiste, ainsi que tu le disais il n'y a qu'un moment, dans l'égalité, et qu'il est plus laid de commettre une injustice [489a] que de la souffrir ? Cela est-il vrai, ou non ? Et prends garde d'aller montrer ici une mauvaise honte. Le grand nombre pense-t-il, ou non, qu'il est juste d'avoir autant et pas plus que les autres, et que faire une injustice est une chose plus laide que de la recevoir ? Ne me refuse pas une réponse là-dessus, Calliclès, afin que, si tu en conviens, je m'affermisse dans mon sentiment, le voyant appuyé du suffrage d'un homme capable d'en juger. CALLICLÈS. Eh bien, oui ; le grand nombre est dans cette persuasion. page 306 SOCRATE. Ainsi ce n'est pas suivant la loi seulement, mais encore suivant la nature, qu'il est plus laid de faire une injustice [489b] que de la recevoir, et que la justice consiste dans l'égalité; et, à ce qu'il paraît, tu ne disais pas la vérité tout-à-l'heure, et tu avais tort de m'accuser et de soutenir que la nature et la loi sont opposées l'une à l'autre, que je le savais fort bien, et que je me servais de cette connaissance pour embarrasser la discussion en faisant tomber la dispute sur la loi, lorsqu'on parlait de la nature, et sur la nature, lorsqu'on parlait de la loi. CALLICLÈS. Cet homme-là ne cessera pas de dire des pauvretés. Socrate, réponds-moi : n'as-tu pas honte à ton âge d'éplucher ainsi les mots, et de croire [489c] que tu as cause gagnée, lorsqu'on s'est mépris sur une expression? Penses-tu que par les plus puissants, j'entende autre chose que les meilleurs ? Ne te dis-je pas depuis longtemps que je prends ces termes de meilleur et de plus puissant dans la même acception ? T'imagines-tu que ma pensée est qu'on doit tenir pour des lois ce qui aura été arrêté dans une assemblée composée d'un ramas d'esclaves et de gens de toute espèce, qui n'ont d'autre mérite peut-être que la forte du corps? page 307 SOCRATE. A la bonne heure, très sage Calliclès. C'est donc ainsi que tu l'entends ? CALLICLÈS. Sans doute. [489d] SOCRATE.
Je soupçonnais aussi depuis longtemps,
mon cher, que tu prenais le mot plus puissant en ce sens, et je ne t'interroge
que par l'envie de connaître clairement ta pensée ; car tu ne crois pas
apparemment que deux soient meilleurs qu'un, ni tes esclaves meilleurs que toi,
parce qu'ils sont plus forts. Dis-moi donc de nouveau qui sont ceux que tu
appelles les meilleurs, puisque ce ne sont point les plus forts, et, de grâce,
tâche de m'instruire d'une manière plus douce, afin que je ne m'enfuie point de
[489e] CALLICLÈS. Tu railles, Socrate. SOCRATE. Non, Calliclès, non par Zéthus, sous le nom duquel tu m'as raillé tout-à-heure assez longtemps. Allons, dis-moi qui sont ceux que tu appelles les meilleurs. CALLICLÈS. Ceux qui valent mieux. page 308 SOCRATE. Tu vois que tu ne dis toi-même que des mots, et que tu n'expliques rien. Ne me diras-tu point si par les meilleurs et les plus puissants tu entends les plus sages, ou d'autres semblables? CALLICLÈS. Oui, par Jupiter, ce sont ceux-là que j'entends, et très fort. [490a] SOCRATE. Ainsi, souvent un seul homme sage est meilleur, à ton avis, que dix mille qui ne le sont pas ; c'est à lui qu'il appartient de commander, et aux autres d'obéir, et, en qualité de maître, il doit avoir plus que ses sujets. Voilà, ce me semble, ce que tu veux dire, s'il est vrai qu'un seul soit meilleur que dix mille; et je n'épluche point les mots. CALLICLÈS. C'est justement ce que je dis, et mon sentiment est que, selon la nature, il est juste que le meilleur et le plus sage commande, et soit mieux partagé que ceux qui n'ont aucun mérite. [490b] SOCRATE. Tiens-t'en donc là. Que réponds-tu maintenant à ceci? Si nous étions plusieurs dans un page 309 même lieu, comme nous sommes ici, et que nous eussions en commun différents mets et différents breuvages ; que notre assemblée fût composée de toutes sortes de gens, les uns forts, les autres faibles, et qu'un d'entre nous, en qualité de médecin, eût plus de sagesse que les autres touchant l'usage de ces aliments ; que d'ailleurs il fût, comme il est vraisemblable, plus fort que les uns et plus faible que les autres : n'est-il pas vrai que cet homme, étant plus sage que nous, sera aussi meilleur et plus puissant par rapport à ces choses? CALLICLÈS. Sans contredit. [490c] SOCRATE.
Faudra-t-il parce qu'il est meilleur,
qu'il ait une plus forte part d'aliments que les autres? Ou plutôt, en qualité
de chef, ne doit-il pas être page 310 CALLICLÈS. Tu me parles d'aliments, de breuvages, de médecins, et d'autres sottises semblables. Ce n'est point [490d] là ce que je veux dire. SOCRATE. N'avoues-tu pas que le plus sage est le meilleur? Accorde ou nie. CALLICLÈS. Je l'accorde. SOCRATE. Et que le meilleur doit avoir davantage? CALLICLÈS. Oui, mais non pas en fait d'aliments et de breuvages. SOCRATE. J'entends : peut-être en fait d'habits; et il faut que le [490e] plus habile à fabriquer des étoffes, porte l'habit le plus grand, et marche chargé d'un plus grand nombre de vêtements et des plus beaux. CALLICLÈS. De quels habits me parles-tu ? SOCRATE. Et en fait de chaussures, apparemment il faut que le plus entendu et le meilleur en ce genre, en ait plus que les autres; et le cordonnier doit peut-être aller par les rues portant page 311 les plus grands souliers et en plus grand nombre. CALLICLÈS. Quels souliers? Radotes-tu ? SOCRATE. Si ce n'est point cela que tu as en vue, peut-être est-ce ceci : par exemple, que le laboureur entendu, sage et habile dans la culture de la terre, doit avoir plus de semences, et en jeter dans son champ beaucoup plus que les autres. CALLICLÈS. Tu rebats toujours les mêmes choses, Socrate. SOCRATE. Non seulement les mêmes choses, Calliclès, mais sur le même sujet. [491a] CALLICLÈS. Oui, par tous les dieux, tu as sans cesse à la bouche des cordonniers, des foulons, des cuisiniers et des médecins, comme s'il était ici question d'eux. SOCRATE. Ne me diras-tu pas enfin en quoi doit être plus puissant et plus sage celui que la justice autorise à avoir plus que les autres? Ou ne souffriras-tu pas que je te le suggère, si tu ne veux pas le dire toi-même? page 312 CALLICLÈS. Je te le dis depuis longtemps. D'abord, par les plus puissants, je n'entends ni les cordonniers, ni les cuisiniers, mais [491b] ceux qui sont entendus dans les affaires publiques et la bonne administration d'un état, et non seulement entendus, mais courageux, capables d'exécuter les projets qu'ils ont conçus, et d'une âme trop ferme pour se laisser rebuter. SOCRATE. Tu le vois, mon cher Calliclès; nous ne nous faisons pas l'un à l'autre les mêmes reproches. Tu me reproches de dire toujours les mêmes choses, et tu m'en fais un crime. Je me plains au contraire de ce que tu ne parles jamais d'une manière uniforme sur les mêmes objets, et de ce que, par les [491c] meilleurs et les plus puissants, tu entends tantôt les plus forts, et tantôt les plus sages. Voilà maintenant que tu en donnes une troisième définition, et les plus puissants et les meilleurs sont, selon toi', les plus courageux. Mon cher, dis-moi une fois pour toutes qui sont ceux que tu appelles les meilleurs et les plus puissants, et relativement à quoi. CALLICLÈS. J'ai déjà dit que ce sont les hommes habiles dans les affaires politiques, et courageux : c'est à page 313 eux [491d] qu'appartient le gouvernement des états, et il est juste qu'ils aient plus que les autres, ceux qui commandent plus que ceux qui obéissent. SOCRATE. Et relativement à quoi ? est-ce relativement à eux-mêmes, mon cher ami? ou relativement à quoi est-ce qu'ils commandent ou obéissent? CALLICLÈS. Que veux-tu dire? SOCRATE. Je dis que chaque individu commande à soi-même. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on commande à soi-même, mais seulement aux autres? CALLICLÈS. Qu'entends-tu par commander à soi-même? SOCRATE. Rien d'extraordinaire, mais ce que tout le monde entend; savoir, être tempérant, maître de soi-même, et commander [491e] aux passions et désirs qui sont en nous. CALLICLÈS. Que tu es charmant! tu nous parles d'imbéciles sous le nom de tempérants. Qui ne le sent? SOCRATE. Il n'est personne, au contraire, qui ne comprenne que ce n'est pas là ce que je veux dire. page 314 CALLICLÈS. C'est cela même, Socrate. Comment, en effet, un homme serait-il heureux, s'il est asservi à quoi que ce soit? Mais je vais te dire avec toute liberté ce que c'est que le beau et le juste dans l'ordre de la nature. Pour mener une vie heureuse, il faut laisser prendre à ses passions tout l'accroissement possible, et ne point les réprimer; [492a] et lorsqu'elles sont ainsi parvenues à leur comble, il faut être en état de les satisfaire par son courage et son habileté, et de remplir chaque désir à mesure qu'il naît. C'est ce que la plupart des hommes ne sauraient faire, à ce que je pense ; et de là vient qu'ils condamnent ceux qui en viennent à bout, cachant par honte leur propre impuissance. Ils disent donc que l'intempérance est une chose laide, comme je l'ai remarqué plus haut, ils enchaînent ceux qui ont une meilleure nature, et, ne pouvant fournir à leurs passions de quoi les contenter, ils font, par pure lâcheté, l'éloge de la tempérance [492b] et de la justice. Et, dans le vrai, pour ceux qui ont eu le bonheur de naître d'une famille de rois, ou que la nature a faits capables de devenir chefs, tyrans ou rois, y aurait-il rien de plus honteux et de plus dommageable que la tempérance? Tandis page 315 qu'ils peuvent jouir de tous les biens de la vie, sans que personne les en empêche, ils se donneraient eux-mêmes pour maîtres les lois, les discours et la censure du vulgaire? Comment cette beauté prétendue de la justice et de la tempérance [492c] ne les rendrait-elle pas malheureux, puisqu'elle leur ôterait la liberté de donner plus à leurs amis qu'à leurs ennemis, et cela tout souverains qu'ils sont dans leur propre ville? telle est, Socrate, la vérité des choses, que tu cherches, dis-tu. La volupté, l'intempérance, la licence, pourvu qu'elles aient des garanties, voilà la vertu et la félicité. Toutes ces autres belles idées, ces conventions contraires à la nature, ne sont que des extravagances humaines, auxquelles il ne faut avoir nul égard. [492d] SOCRATE. Tu viens, Calliclès, d'exposer ton sentiment avec beaucoup de courage et de liberté : tu t'expliques nettement sur des choses que les autres pensent, il est vrai, mais qu'ils n'osent pas dire. Je te conjure donc de ne te relâcher en aucune manière, afin que nous voyions clairement quel genre de vie il faut embrasser. Et dis-moi, tu soutiens que, pour être tel qu'on doit être, il ne faut point gourmander ses passions, mais leur lâcher la bride, et se ménager d'ailleurs page 316 de quoi les satisfaire ; et [492e] qu'en cela consiste la vertu. CALLICLÈS. Oui, je le soutiens. SOCRATE. Cela posé, on a donc grand tort de dire que ceux qui n'ont besoin de rien sont heureux. CALLICLÈS. A ce compte, il n'y aurait rien de plus heureux que les pierres et les cadavres. SOCRATE. Mais aussi ce serait une terrible vie que celle dont tu parles. En vérité, je ne serais pas surpris que ce que dit Euripide fût vrai :
Qui sait si la vie n'est pas pour nous une mort,
[493a] Peut-être mourons-nous réellement nous autres, comme je l'ai ouï dire à un sage qui prétendait que notre vie actuelle est une mort, notre corps un tombeau, et que cette partie de l'âme, où résident les passions, est de nature à changer de sentiment, et à passer d'une extrémité à l'autre (31); et un homme habile dans l'art des page 317 fables, Sicilien peut-être ou Italien (32), appelait par une allusion de nom cette partie de l'âme un tonneau, à cause de sa facilité à croire et à se laisser persuader (33), et les insensés des hommes qui ne sont pas initiés aux saints mystères. I[493b] l comparait la partie de l'âme de ces hommes non initiés, dans laquelle résident les passions, en tant qu'elle est intempérante et ne saurait rien retenir, à un tonneau percé, à cause de son insatiable avidité (34). Il pensait tout au contraire de toi, Calliclès, que de tous ceux qui sont dans l'autre monde (entendant par là le monde invisible (35)) les plus malheureux sont les hommes que l'initiation n'a pas purifiés, et qu'ils portent dans un tonneau percé de l'eau qu'ils puisent avec un crible également percé. Ce crible, disait-il en m'expliquant [493c] sa pensée, c'est l'âme; et il désignait par crible l'âme des insensés, pour marquer qu'elle est percée, et que la défiance et l'oubli ne lui permettent de rien retenir. Toute cette explication est assez bizarre; néanmoins elle fait entendre ce que je veux te donner à connaître, si je puis réussir à te faire changer d'avis, et préférer à une vie insatiable et dissolue une vie réglée, qui se contente de ce qu'elle a sous la main, et n'en désire pas davantage. Ai-je gagné en effet [493d] quelque chose sur ton esprit? et revenant sur tes pas, admets-tu que les tempérants sont plus heureux que les déréglés? ou n'ai-je rien fait, et quand j'emploierais encore bien des fables semblables, n'en serais-tu pas plus disposé à changer d'avis? CALLICLÈS. Tu dis vrai pour le dernier point, Socrate. SOCRATE. Souffre que je te propose un nouvel emblème sorti de la même école que le précédent. Vois si ce que tu dis de ces deux vies, la tempérante et la déréglée, n'est pas comme si tu supposais que deux hommes ont chacun un grand nombre de tonneaux; que les tonneaux de l'un sont en [493e] bon état et remplis, celui-ci de vin, celui-là de miel, un troisième de lait, et d'autres de plusieurs autres liqueurs; que d'ailleurs les liqueurs page 319 de chaque tonneau sont rares, malaisées à avoir, et qu'on ne peut se les procurer qu'avec des peines infinies ; que l'un de ces hommes ayant une fois rempli ses tonneaux, n'y verse plus rien désormais, n'a plus aucune inquiétude, et est parfaitement tranquille à cet égard : que l'autre peut, à la vérité, comme le premier; se procurer les mêmes liqueurs, quoique difficilement, mais que, du reste, ses tonneaux étant percés et gâtés, il est obligé de les remplir sans cesse jour et [494a] nuit, sous peine de s'attirer les derniers chagrins. Ce tableau étant l'image de l'une et de l'autre vie, dis-tu que la vie de l'homme déréglé est plus heureuse que celle du tempérant? Ce discours t'engage-t-il à convenir que la condition du second est préférable à celle de l'autre, ou ne fait-il aucune impression sur ton esprit? CALLICLÈS. Aucune, Socrate; car cet homme dont les tonneaux demeurent remplis ne goûte plus aucun plaisir, et il est dans le cas dont je parlais tout-à-l'heure, il vit comme une pierre, dès qu'une fois [494b] ils sont pleins, sans plaisir ni douleur. Mais la douceur de la vie consiste à y verser le plus qu'on peut. SOCRATE. N'est-ce pas une nécessité, que plus on y verse, page 320 plus il s'en écoule, et qu'il y ait de grands trous pour ces écoulements? CALLICLÈS. Sans doute. SOCRATE. La condition dont tu parles n'est point, à la vérité, celle d'un cadavre ni d'une pierre, mais celle d'une cane (36). De plus, dis-moi, ne reconnais-tu point ce qu'on appelle avoir faim, et manger ayant faim? CALLICLÈS. Oui. [494c] SOCRATE. Ainsi qu'avoir soif et boire ayant soif? CALLICLÈS. Oui; et je soutiens que c'est vivre heureux que d'éprouver ces désirs et les autres semblables, et d'être en état de les remplir. SOCRATE. Fort bien, mon cher ; continue comme tu as commencé, et prends garde que la honte ne s'empare de toi. Mais il faut, ce me semble, que page 321 je ne sois pas honteux de mon côté. Et d'abord dis-moi si c'est vivre heureux que d'avoir la gale et des démangeaisons, d'être à même de se gratter à son aise, et de passer toute sa vie à se gratter. [494d] CALLICLÈS. Que tu es absurde, Socrate, et un vrai bavard! SOCRATE. Aussi, Calliclès, ai-je déconcerté et Polus et Gorgias. Pour toi, je n'ai pas peur que tu te troubles, ni que tu rougisses; tu es trop courageux : mais réponds seulement à ma question. CALLICLÈS. Je dis donc que celui qui se gratte vit agréablement. SOCRATE. Et si sa vie est agréable, n'est-elle pas heureuse? CALLICLÈS. Sans contredit. [494e] SOCRATE. Est-ce assez qu'il éprouve des démangeaisons à la tête seulement? ou faut-il qu'il en sente encore quelque autre part? je te le demande. Vois, Calliclès, ce que tu répondras, si on pousse les page 322 questions en ce genre aussi loin qu'elles peuvent aller. Et, pour tout dire, en un mot, la vie du débauché n'est-elle point triste, honteuse et misérable ? Oseras-tu soutenir que de pareils hommes sont heureux, s'ils ont abondamment de quoi se satisfaire? CALLICLÈS. Ne rougis-tu point, Socrate, de faire tomber la conversation sur de pareils propos? SOCRATE. Est-ce moi, mon cher, qui y donne occasion, ou celui qui avance sans façon que quiconque ressent du plaisir, de quelque nature qu'il soit, est [495a] heureux, sans mettre aucune distinction entre les plaisirs honnêtes et les déshonnêtes? Explique-moi donc encore ceci. Prétends-tu que l'agréable et le bon sont la même chose? ou admets-tu des choses agréables qui ne sont pas bonnes? CALLICLÈS. Afin qu'il n'y ait pas de contradiction dans mon discours, si je dis que l'un est différent de l'autre, je réponds que c'est la même chose. SOCRATE. Tu gâtes ce que tu as dit précédemment, et nous ne cherchons plus ensemble la vérité comme il faut, si tu réponds autrement que selon ta pensée, mon cher Calliclès. page 323 [495b] CALLICLÈS. Tu m'en donnes l'exemple, Socrate. SOCRATE. Si cela est, je ne fais pas bien, non plus que toi. Mais vois, mon cher, si le bien ne consiste point en toute autre chose que dans le plaisir, quel qu'il soit : car, s'il en est ainsi, il en résulte toutes les conséquences honteuses que je viens de t'indiquer à demi-mot, et beaucoup d'autres semblables. CALLICLÈS. Oui, à ce que tu crois, Socrate. SOCRATE. Et toi, Calliclès, soutiens-tu tout de bon qu'il en est ainsi. CALLICLÈS. Certainement. [495c] SOCRATE. Attaquerai-je ce discours, comme étant sérieux de ta part? CALLICLÈS. Très sérieux. SOCRATE. A la bonne heure. Puisque telle est ta manière de penser, explique-moi ceci. N'y a-t-il point une chose quelque part que tu appelles science? page 324 CALLICLÈS. Oui. SOCRATE. Et avec la science, ne parlais-tu pas aussi du courage? CALLICLÈS. Cela est vrai. SOCRATE. N'as-tu pas parlé de ces deux choses, comme étant différentes? CALLICLÈS. Assurément. SOCRATE. Mais quoi! le plaisir est-il la même chose que la science? ou en diffère-t-il? [495d] CALLICLÈS. Il en diffère, très sage Socrate. SOCRATE. Et le courage est-il différent du plaisir? CALLICLÈS. Sans contredit. SOCRATE. Attends, pour que nous nous en souvenions bien. Calliclès d'Acharnée (37) dit que l'agréable et page 325 le bon sont la même chose, et que la science et le courage sont différents l'un de l'autre et du bon : Socrate d'Alopèce (38) n'en convient pas. Ou peut-être en convient-il? CALLICLÈS. Non, il n'en convient pas. [495e] SOCRATE. Je ne pense pas non plus que Calliclès en convienne, lorsqu'il s'examinera sérieusement lui-même. Car, dis-moi, ne crois-tu pas que le bonheur est une affection contraire au malheur ? CALLICLÈS. Sans doute. SOCRATE. Puisque ces deux choses sont opposées, n'est-ce pas une nécessité qu'il en soit d'elles comme de la santé et de la maladie? Car le même homme n'est point à la fois sain et malade, ni ne quitte la santé en même temps que la maladie. CALLICLÈS. Que veux-tu dire ? SOCRATE. Le voici : prenons pour exemple telle partie page 326 du corps [496a] qu'il te plaira. N'a-t-on pas quelquefois une maladie d'yeux, qu'on appelle ophtalmie? CALLICLÈS. Qui en doute ? SOCRATE. On n'a pas apparemment dans le même temps les yeux sains. CALLICLÈS. En aucune manière. SOCRATE. Mais quoi ! lorsqu'on est guéri de l'ophtalmie, perd-on la santé des yeux, et est-on enfin privé à-la-fois et de l'un et de l'autre ? CALLICLÈS. Non, certes. SOCRATE. Car ce serait, je pense, [496b] une chose prodigieuse et absurde; n'est-ce pas? CALLICLÈS. Assurément. SOCRATE. Mais, autant qu'il me semble, l'un vient et l'autre s'en va successivement. CALLICLÈS. J'en conviens. page 327 SOCRATE. N'en faut-il pas dire autant de la force et de la faiblesse? CALLICLÈS. Oui. SOCRATE. Et encore de la vitesse et de la lenteur ? CALLICLÈS. Nul doute. SOCRATE. Et pour le bien et le mal, la félicité et la misère, les acquiert-on et les perd-on successivement ? CALLICLÈS. Oui, certes. [496c] SOCRATE. Si nous découvrons donc de certaines choses que l'on perd et que l'on possède en même temps, ne sera-t-il pas évident qu'elles ne sont ni un bien ni un mal? Avouons-nous cela? Examine bien avant de répondre. CALLICLÈS. Je l'avoue parfaitement. SOCRATE. Revenons maintenant à ce qui a été accordé d'abord. As-tu dit de la faim que ce fût un sen- page 328 timent agréable ou douloureux? Je parle de la faim prise en elle-même. CALLICLÈS. Oui, c'est un sentiment douloureux; et manger ayant faim est une chose [496d] agréable. SOCRATE. J'entends; mais la faim en elle-même est-elle douloureuse, ou non ? CALLICLÈS. Je dis qu'elle l'est. SOCRATE. Et la soif aussi, par conséquent? CALLICLÈS. Oui. SOCRATE. Est-il besoin que je te fasse de nouvelles questions? ou conviens-tu que tout besoin, tout désir est douloureux ? CALLICLÈS. J'en conviens : n'interroge pas davantage. SOCRATE. A la bonne heure. Boire ayant soif n'est-ce pas, selon toi, une chose agréable? CALLICLÈS. Oui. page 329 SOCRATE. Eh bien, avoir soif, n'est-ce pas avoir de la douleur? [496e] CALLICLÈS. Oui. SOCRATE. Et boire, n'est-ce pas l'accomplissement d'un besoin, et un plaisir? CALLICLÈS. Oui. SOCRATE. Ainsi, boire, c'est avoir du plaisir? CALLICLÈS. Sans doute. SOCRATE. Parce qu'on a soif ? CALLICLÈS. Précisément. SOCRATE. C'est-à-dire, parce qu'on a de la douleur ? CALLICLÈS. Oui. SOCRATE. Vois-tu qu'il résulte de là que, quand tu dis, boire ayant soif, c'est comme si tu disais avoir du plaisir en ayant de la douleur? Ces deux sentiments ne concourent-ils pas dans le même temps et dans le même lieu, soit de l'âme, soit du corps, page 330 comme il te plaira; car il n'importe pas, à mon avis? Cela est-il vrai, ou non? CALLICLÈS. Cela est vrai. SOCRATE. Mais n'es-tu pas convenu qu'il est impossible [497a] d'être malheureux en même temps qu'on est heureux? CALLICLÈS. Je le dis encore. SOCRATE. Tu viens aussi de reconnaître qu'on peut avoir du plaisir en ayant de la douleur. CALLICLÈS Il y a apparence. SOCRATE. Donc avoir du plaisir n'est point être heureux, ni avoir de la douleur être malheureux ; et par conséquent l'agréable est autre que le bon. CALLICLÈS. Je ne sais quels raisonnements captieux tu emploies, Socrate. SOCRATE. Tu le sais très bien ; mais tu dissimules, Calliclès, assurément. Avançons, car tout ceci n'est qu'un badinage de ta part; il faut que tu voies combien en effet ta sagesse [497b] te donne le droit de page 331 me reprendre. Ne cesse-t-on pas en même temps d'avoir soif et de sentir le plaisir qu'il y a à boire? CALLICLÈS. Je n'entends rien à ce que tu dis. GORGIAS. Ne parle point de la sorte, Calliclès; réponds du moins à cause de nous, afin d'achever cette dispute. CALLICLÈS. Socrate est toujours ainsi, Gorgias. Il fait de petites questions, qui ne sont de mille importance, et puis il vous réfute. GORGIAS. Que t'importe? Après tout, ce n'est point ton affaire, Calliclès. Laisse Socrate argumenter à sa guise. [497c] CALLICLÈS. Continue donc tes minutieuses et petites interrogations, puisque tel est l'avis de Gorgias. SOCRATE. Tu es heureux, Calliclès, d'avoir été initié aux grands mystères avant de l'avoir été aux petits : pour moi, je n'aurais pas cru que cela fût permis (39). Reviens donc à l'endroit où tu en es resté, page 332 et dis-moi si on ne cesse point en même temps d'avoir soif et de sentir du plaisir. CALLICLÈS. Je l'avoue. SOCRATE. Ne perd-on pas de même à-la-fois le sentiment de la faim et des autres désirs, et celui du plaisir? CALLICLÈS. Cela est vrai. SOCRATE. On cesse donc en même temps [497d] d'avoir de la douleur et du plaisir? CALLICLÈS. Oui. SOCRATE. Or, oh ne peut pas, comme tu en es convenu, perdre à-la-fois le bien et le mal. N'en conviens-tu pas encore ? CALLICLÈS. Sans doute : que s'ensuit-il ? SOCRATE. Il s'ensuit, mon cher ami, que le bon et l'agréable, le mauvais et le douloureux ne sont pas la même chose, puisqu'on cesse en même temps d'éprouver les uns, et non les autres; ce qui en montre la différence. Comment en effet l'agréable serait-il la même chose que le bon, et le douloureux que le mauvais ? Examine encore ceci, si page 333 tu veux, de cette autre manière ; car je ne crois pas que tu sois mieux d'accord [497e] avec toi-même. Vois donc; n'appelles-tu pas bons ceux qui sont bons, à cause du bien qui est en eux, comme tu appelles beaux ceux en qui se trouve la beauté ? CALLICLÈS. Oui. SOCRATE. Mais quoi ! appelles-tu gens de bien les insensés et les lâches ? Tu ne le faisais pas tout-à-l'heure ; mais tu donnais ce nom aux hommes courageux et intelligents. Ne dis-tu pas encore que ceux-là sont les gens de bien ? CALLICLÈS. Assurément. SOCRATE. N'as-tu pas vu, dans la joie, des enfants dépourvus de raison ? CALLICLÈS. Eh bien ? SOCRATE. N'as-tu vu aussi, dans la joie, des hommes faits qui étaient insensés? CALLICLÈS. Je le pense. Mais à quoi tendent ces questions ? [498a] SOCRATE. A rien ; réponds toujours. page 334 CALLICLÈS. J'en ai vu. SOCRATE. Et des hommes raisonnables dans la tristesse et dans la joie, n'en as-tu pas vu ? CALLICLÈS. Oui. SOCRATE. Lesquels ressentent plus vivement la joie et la douleur, des sages ou des insensés? CALLICLÈS. Je ne crois pas qu'il y ait grande différence. SOCRATE. Cela me suffit. N'as-tu pas vu à la guerre des hommes lâches? CALLICLÈS. Impossible autrement. SOCRATE. Lorsque les ennemis se retiraient, lesquels t'ont paru témoigner plus de joie, des lâches ou des courageux? CALLICLÈS. Il m'a semblé que tantôt les uns et tantôt les autres s'en réjouissaient davantage, [498b] ou du moins à-peu-près également. page 335 SOCRATE. Cela n'y fait rien. Les lâches ressentent donc aussi de la joie ? CALLICLÈS. Très fort. SOCRATE. Et les insensés de même, à ce qu'il paraît. CALLICLÈS. Oui. SOCRATE. Quand l'ennemi s'avance, les lâches seuls en sont-ils attristés, ou les courageux le sont-ils aussi ? CALLICLÈS. Les uns et les autres. SOCRATE. Le sont-ils également ? CALLICLÈS. Les lâches le sont peut-être davantage. SOCRATE. Et quand l'ennemi se retire, ne sont-ils pas aussi plus joyeux ? CALLICLÈS. Peut-être. SOCRATE. Ainsi les insensés et les sages, les lâches et les page 336 courageux ressentent la douleur et le plaisir à-peu-près également, [498c] à ce que tu dis, et les lâches plus que les courageux. CALLICLÈS. Je le soutiens. SOCRATE. Mais les sages et les courageux sont bons; les lâches et les insensés sont médians. CALLICLÈS. Oui. SOCRATE. Les bons et les méchants éprouvent donc la joie et la douleur à-peu-près également? CALLICLÈS. Je le prétends. SOCRATE. Mais les bons et les méchants sont-ils à-peu-près également bons ou méchants? ou les méchants ne sont-ils pas même à-la-fois et meilleurs et pires? [498d] CALLICLÈS. Par Jupiter, je ne sais ce que tu dis. SOCRATE. Ne sais-tu pas que tu as dit que les bons sont bons par la présence du bien? et les méchants, méchants par celle du mal ; et que le plaisir est un bien, et la douleur un mal? page 337 CALLICLÈS. Oui. SOCRATE. Le bien ou le plaisir se rencontre donc en ceux qui ressentent de la joie, dans le temps qu'ils en ressentent. CALLICLÈS. Est-il possible autrement? SOCRATE. Ceux qui ressentent de la joie sont donc bons par la présence du bien? CALLICLÈS. Oui. SOCRATE. Et quoi ! le mal ou la douleur ne se rencontre-t-il pas en ceux qui ressentent de la peine ? CALLICLÈS. Il s'y rencontre. [498e] SOCRATE. Dis-tu encore, ou ne dis-tu plus que les médians sont méchants par la présence du mal? CALLICLÈS. Je le dis encore. SOCRATE. Ainsi ceux qui goûtent de la joie sont bons, et ceux qui éprouvent de la peine méchants. page 338 CALLICLÈS. Tout-à-fait. SOCRATE. Et ils le sont davantage, si ces sentiments sont plus vifs; moins, s'ils sont plus faibles, également, s'ils sont égaux. CALLICLÈS. Oui. SOCRATE. Ne prétends-tu pas que les sages et les insensés, les lâches et les courageux ressentent la joie et la douleur à-peu-près également, et même les lâches davantage ? CALLICLÈS. C'est mon avis. SOCRATE. Tire en commun avec moi les conclusions qui résultent de ces aveux; car il est beau, dit-on, de répéter et de considérer jusqu'à deux et trois [499a] fois les belles choses. Nous avouons que le sage et le courageux sont bons, n'est-ce pas? CALLICLÈS. Oui. SOCRATE. Et que l'insensé et le lâche sont méchants ? CALLICLÈS. Sans doute. page 339 SOCRATE De plus, que celui qui goûte de la joie est bon. CALLICLÈS. Oui. SOCRATE. Et celui qui ressent de la douleur méchant. CALLICLÈS. Nécessairement. SOCRATE. Enfin, que le bon et le méchant éprouvent également de la joie et de la douleur, et le méchant peut-être davantage. CALLICLÈS. Oui. SOCRATE. Donc le méchant devient aussi bon et même meilleur que le bon. [499b] Ceci, et ce qui a été dit tout-à-l'heure, ne suit-il pas de ce que l'on confond ensemble le bon et l'agréable? Ces conséquences ne sont-elles pas inévitables, Calliclès? CALLICLÈS. Il y a longtemps, Socrate, que je t' écoute et t'accorde bien des choses, faisant réflexion en même temps que si on te donne quoi que ce soit en badinant, tu le saisis avec le même empressement que les enfants. Penses-tu donc que mon page 340 sentiment, ou celui de tout autre homme, n'est point que les plaisirs sont les uns meilleurs, les autres plus mauvais? SOCRATE. Ha! ha! Calliclès, que tu es rusé ! Tu me traites [499c] comme un enfant, en me disant tantôt que les choses sont d'une façon, tantôt qu'elles sont d'une autre ; et tu cherches ainsi à me tromper. Je ne croyais pas pourtant, au commencement, que tu pusses consentir à me tromper, parce que je te croyais mon ami : mais je me suis abusé, et je vois bien qu'il faut me contenter, selon le vieux proverbe, des choses telles qu'elles sont, et de prendre ce que tu me donnes. Tu dis donc présentement, à ce qu'il paraît, que les plaisirs sont, les uns bons, les autres mauvais, n'est-ce pas? [499d] CALLICLÈS. Oui. SOCRATE. Les bons ne sont-ce pas les avantageux, et les mauvais, ceux qui sont nuisibles? CALLICLÈS. Je le crois. SOCRATE. Les avantageux sont apparemment ceux qui page 341 procurent quelque bien, et les mauvais, ceux qui font du mal. CALLICLÈS. Nul doute. SOCRATE. Ne parles-tu point des plaisirs que je vais dire; à l'égard du corps, par exemple, de ceux qui se rencontrent, comme nous avons dit, dans le manger et le boire? Et ne tiens-tu pas pour bons ceux qui procurent au corps la santé, la force, ou quelque autre bonne qualité semblable; et pour mauvais ceux qui engendrent les qualités [499e] contraires? CALLICLÈS. Assurément. SOCRATE. N'en est-il pas ainsi des douleurs? et les unes ne sont-elles pas bienfaisantes, et les autres malfaisantes? CALLICLÈS. Sans contredit. SOCRATE. Ne faut-il pas choisir et se donner les plaisirs et les douceurs qui font du bien ? CALLICLÈS. Oui, certes. page 342 SOCRATE. Et nullement les plaisirs et les douleurs qui font du mal? CALLICLÈS. Cela est évident. SOCRATE. Car, s'il t'en souvient, nous sommes convenus, Polus et moi, qu'en toutes choses on doit agir dans la vue du bien. Penses-tu aussi, comme nous, que le bien est la fin de toutes les actions; que tout le reste doit se rapporter à lui, [500a] et non pas lui aux autres choses? Donnes-tu aussi ton suffrage en tiers avec le nôtre? CALLICLÈS. Oui. SOCRATE. Ainsi, il faut tout faire, même l'agréable, en vue du bien, et non le bien en vue de l'agréable. CALLICLÈS. J'en tombe d'accord. SOCRATE. Le premier venu est-il en état de discerner parmi les choses agréables les bonnes d'avec les mauvaises? Ou bien est-il besoin pour cela d'un expert en chaque genre? CALLICLÈS. Il en est besoin. page 343 SOCRATE. Rappelons ici ce que j'ai dit sur ce sujet à Polus et à Gorgias. Je disais, s'il t'en souvient, [500b] qu'il y a certaines industries qui ne vont que jusqu'au plaisir, ne procurent que lui, et ignorent ce qui est bon et ce qui est mauvais; et qu'il y en a d'autres qui connaissent le bien et le mal. Du nombre des industries qui ont pour objet le plaisir, j'ai mis la cuisine, non comme un art, mais comme une routine relative au corps; et j'ai compté la médecine parmi les arts qui ont le bien pour objet. Et, au nom de Jupiter, qui préside à l'amitié, ne crois pas, Calliclès, qu'il te faille badiner ici vis-à-vis de moi, et me répondre contre ta pensée tout ce qui te vient à la bouche, [500c] encore moins supposer que je badine moi-même. Tu vois que la matière dont nous nous entretenons est une des plus sérieuses qui puissent occuper tout homme doué du moindre bon sens, puisqu'il s'agit de savoir de quelle manière il doit vivre; s'il faut embrasser la vie à laquelle tu m'invites, agir en homme, c'est-à-dire, parler devant le peuple assemblée, s'exercer à l'art oratoire, et faire de la politique comme on en fait aujourd'hui; ou bien s'il faut vivre en philosophe; et en quoi ce genre de vie diffère du précédent. Peut-être [500d] est-il plus à propos de les distinguer l'un de l'autre, page 344 comme je tâchais tout-à-l'heure de le faire; et après les avoir séparés et être convenus entre nous que ce sont bien les deux systèmes de vie, d'examiner en quoi cette différence consiste, et lequel des deux mérite d'être préféré. Tu ne comprends peut-être pas encore ce que je veux dire? CALLICLÈS. Non, vraiment. SOCRATE. Je vais donc te l'expliquer plus clairement. Nous sommes demeurés d'accord, toi et moi, qu'il y a un bon et un agréable, et que l'agréable est autre que le bon; de plus, qu'il y a de certaines industries et de certaines manières de se les procurer, qui tendent les unes à l'agréable, les autres au bon. Commence avant tout par m'accorder [500e] ou me nier ce point. CALLICLÈS. Je l'accorde. SOCRATE. Voyons; accorde-moi aussi ce que je disais à Polus et à Gorgias, si ce que je disais t'a paru véritable. Je soutenais que l'adresse du cuisinier n'est pas un art, mais une routine; [501a] qu'au contraire, la médecine est un art : me fondant sur ce que la médecine a étudié la nature du page 345 sujet sur lequel elle travaille, connaît les causes de ce qu'elle fait, et peut rendre raison de chacune de ses opérations : au lieu que la cuisine, appliquée tout entière à l'apprêt du plaisir, tend à ce but sans s'appuyer sur aucun principe, n'ayant examiné ni la nature du plaisir, ni les motifs de ses opérations; pratique et routine tout-à-fait dépourvue de raison, incapable de se rendre, pour ainsi dire, compte de rien, simple souvenir [501b] de ce qu'on a coutume de faire; voilà comment elle procure du plaisir. Considère d'abord si cela te paraît juste, et ensuite s'il y a, par rapport à l'âme, des professions du même genre, dont les unes marchent suivant les règles de l'art, ménagent à l'âme ce qui lui est avantageux; tandis que les autres le négligent, et, comme dans mon dernier exemple, s'occupent uniquement des plaisirs de l'âme, et des moyens de lui en procurer, n'examinant, du reste, en aucune manière quels sont les bons plaisirs et les mauvais, et ne se mettant en peine d'autre chose que d'affecter [501c] l'âme agréablement, que ce soit son avantage, ou non. Pour moi, je pense, Calliclès, qu'il y a de pareilles professions, et je dis que telle est la flatterie, tant par rapport au corps que par rapport à l'âme, et à toute autre chose dont on veut procurer le plaisir, sans avoir le moindre égard page 346 à ce qui lui est utile ou préjudiciable. Es-tu du même avis que moi là-dessus, ou d'un avis contraire ? CALLICLÈS. Non; mais je te passe ce point, afin que tu puisses terminer cette discussion, et par complaisance pour Gorgias. [501d] SOCRATE. La flatterie dont je parle a-t-elle lieu à l'égard d'une âme, et non pas à l'égard de deux et de plusieurs? CALLICLÈS. Elle a lieu à l'égard de deux et de plusieurs âmes. SOCRATE. Ainsi on peut chercher à complaire à une foule d'âmes assemblées, sans s'embarrasser de ce qui est le plus avantageux pour elles. CALLICLÈS. Je le pense. SOCRATE. Pourrais-tu me dire quelles sont les professions qui produisent cet effet? On plutôt, si tu l'aimes mieux, je t'interrogerai, et à mesure qu'il te paraîtra qu'une profession est de ce genre, tu page 347 l'accorderas; si tu ne juges pas qu'elle en soit, tu le nieras. [501e] Commençons par la profession de joueur de flûte. Ne te semble-t-il point, Calliclès, qu'elle vise uniquement à nous procurer du plaisir, et qu'elle ne se met point en peine d'autre chose? CALLICLÈS. Il me le semble. SOCRATE. Ne portes-tu pas le même jugement de toutes les autres semblables, telle que celle de jouer de la lyre dans les jeux publics? (40) CALLICLÈS. Oui. SOCRATE. Mais quoi! n'en dis-tu pas autant des représentations des chœurs, et de la composition des dithyrambes? Crois-tu que Cinésias (41), fils de Melés, se soucie beaucoup que ses chants soient propres à rendre meilleurs ceux qui les enten- page 348 dent, et qu'il vise à autre chose [502a] qu'à plaire à la foule? CALLICLÈS. Cela est évident, Socrate, pour Cinésias. SOCRATE. Et son père Mêlés? penses-tu que quand il chantait sur la lyre, il eût en vue le bien? Est-ce que celui-là par hasard ne visait pas au plus agréable, parce que son chant assommait d'ennui les auditeurs? Examine bien, ne penses-tu pas que toute espèce de chant sur la lyre et toute composition dithyrambique a été inventée en vue du plaisir? CALLICLÈS. Oui. [502b] SOCRATE. Et la tragédie, ce poème imposant et magnifique, à quoi tend-elle? Son but, sa grande affaire est-elle uniquement de plaire aux spectateurs, comme tu le crois? ou lorsqu'il se présente quelque chose d'agréable, mais en même temps de mauvais, prend-elle sur soi de le supprimer, et de déclamer et chanter ce qui est désagréable, mais utile, que les spectateurs y trouvent du plaisir ou non? De ces deux dispositions quelle est, dis-moi, celle de la tragédie? page 349 CALLICLÈS. Il est clair, Socrate, qu'elle va davantage du côté du [502c] plaisir et de l'agrément du public. SOCRATE. N'avons-nous pas vil tout-à-1'heure, Calliclès, que tout cela n'est que flatterie? CALLICLÈS. Assurément. SOCRATE. Mais si on ôtait de quelque poésie que ce soit le chant, le rhythme et la mesure, resterait-il autre chose que les paroles? CALLICLÈS. Non. SOCRATE. Ces paroles ne s'adressent-elfes pas à la multitude et au peuple assemblé? CALLICLÈS. Sans doute. SOCRATE. La poésie est donc une manière de parler au peuple? CALLICLÈS. Il y a apparence. SOCRATE. Mais si c'est une manière de parler au peuple, page 350 c'est donc une rhétorique. En effet, ne te semble-t-il pas que les poètes font les orateurs sur les théâtres ? [502d] CALLICLÈS. Oui. SOCRATE. Nous avons donc trouvé une rhétorique pour ce peuple, composé d'enfans, de femmes et d'hommes, de citoyens libres et d'esclaves (42), confondus ensemble, rhétorique dont nous ne faisons pas grand cas, puisque nous l'avons appelée flatterie. CALLICLÈS. Cela est vrai. SOCRATE. Fort bien. Et que nous semble de cette rhétorique faite pour le peuple d'Athènes [502e] et les peuples des autres cités, tous composés de personnes libres? Te paraît-il que les orateurs fassent toujours leurs harangues en vue du plus grand bien, et se proposent pour but de rendre par leurs discours leurs concitoyens aussi vertueux qu'il est possible? Ou bien les Orateurs eux-mêmes, cherchant à plaire à leurs concitoyens, et négligeant l'intérêt public pour ne page 351 s'occuper que de leur intérêt personnel, ne se conduisent-ils point arec les peuples comme avec des enfans, s'appliquant uniquement à leur foire plaisir, sans s'inquiéter [503a] s'ils deviendront par là meilleurs ou pires? CALLICLÈS. Cette question n'est plus aussi simple. Certains orateurs, dans leurs discours, s'intéressent réellement à l'utilité publique ; d'autres sont tels que tu viens de le dire. SOCRATE. Cela me suffit : car s'il y a deux manières de parler au peuple, l'une des deux est une flatterie et une menée honteuse, et l'autre est honnête; j'entends celle qui travaille à rendre meilleures les âmes des citoyens, et qui s'applique en toute rencontre à dire ce qui est le plus avantageux, que cela doive être agréable ou fâcheuse aux auditeurs. [503b] Mais tu n'as jamais vu de rhétorique semblable ; ou si tu connais quelque orateur de ce caractère, pourquoi ne me le nommes-tu point? CÀLLICLÈS. Par Jupiter, je n'en saurais citer aucun entre tous ceux d'aujourd'hui. SOCRATE. Eh bien ! en connais-tu quelqu'un parmi les page 352 anciens, auquel les Athéniens aient l'obligation d'être devenus meilleurs depuis qu'il a commencé à les haranguer, de moins bons qu'ils étaient auparavant? Car, pour moi, je ne vois pas qui ce pourrait être. [503c] CALLICLÈS. Quoi donc, Socrate? N'entends-tu pas dire que Thémistocle fut un homme de bien, ainsi que Cimon et Miltiade, et ce Périclès mort depuis peu, que tu as entendu toi-même? SOCRATE. Si la véritable vertu consiste, comme tu l'as dit, Calliclès, à contenter ses passions et celles des autres, tu as raison : mais si ce n'est pas cela; si, comme nous avons été forcés d'en convenir dans le cours de cet entretien, la vertu consiste à satisfaire ceux de nos desirs qui, étant remplis, rendent l'homme meilleur, [503d] et à ne rien accorder à ceux qui le rendent pire ; et si d'ailleurs il y a un art pour cela, peux-tu me dire qu'aucun de ceux que tu viens de nommer ait été de ce caractère? CALLICLÈS. Je ne sais quelle réponse te donner. SOCRATE. Tu la trouveras, si tu la cherches bien. Examinons donc ainsi paisiblement si quelqu'un d'entre page 353 eux a été tel. N'est-il pas vrai que l'homme vertueux qui, dans tous ses discours, a le plus grand bien en vue, ne parlera point à l'aventure, et se proposera [503e] un but ? Voyez tous les artistes ; ils considèrent ce qu'ils veulent faire, et ne prennent point au hasard les premiers moyens venus pour exécuter leur ouvrage, mais ils choisissent ce qui peut lui donner la forme qu'il doit avoir. Par exemple, jette les yeux sur les peintres, les architectes, les constructeurs de vaisseaux, en un mot, sur tel ouvrier qu'il te plaira, tu verras que chacun deux place dans un certain ordre tout ce qu'il emploie, et qu'il force chaque partie de s'adapter et de s'arranger avec les autres, jusqu'à ce que le [504a] tout ait l'ensemble, l'arrangement et l'ordre convenables. Ce que les autres ouvriers font par rapport à leur ouvrage, ceux dont nous parlions auparavant, je veux dire les maîtres de gymnase et les médecins, le font à l'égard du corps, ils l'ordonnent et le règlent. Reconnaissons-nous ou non que la chose est ainsi ? CALLICLÈS. A la bonne heure ; d'accord. SOCRATE. Une maison où règne l'ordre et la règle n'est-elle pas bonne ? Et si le désordre y est, n'est-elle pas mauvaise? page 354 CALLICLÈS. Oui. SOCRATE. N'en faut-il pas dire autant d'un vaisseau ? [504b] CALLICLÈS. Oui. SOCRATE. Nous tenons le même langage au sujet de nos corps. CALLICLÈS. Sans contredit. SOCRATE. Et notre âme sera-t-elle bonne, si elle est déréglée ? Ne le sera-t-elle pas plutôt, si tout y est dans l'ordre et dans la règle ? CALLICLÈS. C'est ce qu'on ne saurait nier, après les aveux précédants. SOCRATE. Quel nom donne-t-on à l'effet que produisent la règle et l'ordre, par rapport au corps ? Tu l'appelles probablement santé et force. CALLICLÈS. Oui. [504c] SOCRATE. Essaie à présent de trouver et de me dire pa- page 355 reillement le nom de l'effet que la règle et l'ordre produisent dans l'âme. CALLICLÈS. Pourquoi ne le dis-tu pas toi-même, Socrate? SOCRATE. Si tu l'aimes mieux, je le dirai : seulement si tu juges que j'ai raison, conviens-en ; sinon, réfute-moi, et ne me laisse rien passer. Il me semble donc que l'on appelle salutaire tout ce qui entretient l'ordre dans le corps, d'où naît la santé et les autres bonnes qualités corporelles. Cela est-il vrai, ou non ? CALLICLÈS. Cela est vrai. [504d] SOCRATE. Et qu'on appelle légitime et loi tout ce qui met de l'ordre et de la règle dans l'âme, d'où se forment les hommes justes et réglés. L'effet produit, c'est ici la justice et la tempérance. Est-ce bien cela? CALLICLÈS. Soit. SOCRATE. C'est donc à cet effet que le bon orateur, celui qui se conduit selon les règles de l'art, visera toujours dans les discours qu'il adressera aux page 356 âmes, et dans toutes ses actions; s'il accorde au peuple, ou s'il lui ôte quelque chose, ce sera par le même motif : son esprit sera sans cesse occupé des moyens de faire naître la justice dans l'âme de ses concitoyens, [504e] et d'en bannir l'injustice; d'y faire germer la tempérance, et d'en écarter l'intempérance ; d'y introduire enfin toutes les vertus, et d'en exclure tous les vices. Conviens-tu de cela, ou non? CALLICLÈS. J'en conviens. SOCRATE. Car que sert-il, Calliclès, à un corps malade et mal disposé, qu'on lui présente des mets en abondance et les breuvages les plus exquis, ou toute autre chose qui ne lui sera pas plus avantageuse que dommageable, et même moins, à le bien prendre? N'est-il pas vrai ? [505a] CALLICLÈS. A la bonne heure. SOCRATE. Ce n'est point, je pense, un avantage pour un homme de vivre avec un corps mal sain, puisqu'il est forcé à traîner en conséquence une vie malheureuse, n'est-ce pas? CALLICLÈS. Oui. page 357 SOCRATE. Aussi les médecins laissent-ils pour l'ordinaire à ceux qui se portent bien la liberté de satisfaire leurs appétits, comme de manger autant qu'ils veulent, lorsqu'ils ont faim, et de boire de même, lorsqu'ils ont soif; mais ils ne permettent presque jamais aux malades de se rassasier de ce qu'ils désirent. Accordes-tu cela aussi? CALLICLÈS. Oui. [505b] SOCRATE. Mais, mon cher, ne faut-il pas tenir la même conduite à l'égard de l'âme? Je veux dire que, tant qu'elle est en mauvais état, parce qu'elle est déraisonnable, déréglée, injuste et impie, on doit l'éloigner de ce qu'elle désire, et ne lui rien en permettre que ce qui peut la rendre meilleure. Est-ce ton avis, ou non? CALLICLÈS. C'est mon avis. SOCRATE. C'est en effet le parti le plus avantageux pour l'âme. CALLICLÈS. Sans doute. SOCRATE. Mais tenir quelqu'un éloigné de ce qu'il désire, n'est-ce pas lui infliger une correction? page 358 CALLICLÈS. Oui. SOCRATE. Il vaut donc mieux pour l'âme d'être corrigée, que de vivre dans la licence, comme tu le pensais tout-à-l'heure. [505c] CALLICLÈS. Je ne sais ce que tu veux dire, Socrate. Interroge quelque autre. SOCRATE. Voilà un homme qui ne saurait souffrir ce qu'on fait pour lui, ni endurer la chose même dont nous parlons, c'est-à-dire, la correction. CALLICLÈS. Je me soucie bien de tous tes discours! Je ne t'ai répondu que par complaisance pour Gorgias. SOCRATE. Soit. Que ferons-nous donc ? Laisserons-nous cette discussion imparfaite? CALLICLÈS. Tout ce qu'il te plaira. SOCRATE. Mais on dit communément qu'il n'est pas permis [505d] de laisser ainsi tronqués même les contes, et qu'il faut y mettre une tête, afin qu'ils ne courent point sans tête de côté et d'autre. Ré- page 359 ponds donc à ce qui reste, pour donner une tête à cet entretien. CALLICLÈS. Que tu es pressant, Socrate! Si tu m'en crois, lu laisseras là cette dispute, ou tu l'achèveras avec quelque autre. SOCRATE. Et quel autre le voudra? Allons, ne quittons pas ce discours sans l'achever. CALLICLÈS. Ne pourrais-tu point l'achever seul, soit en parlant de suite, ou en te répondant toi-même? [505e] SOCRATE. Bon, pour qu'il m'arrive ce que dit Épicharme, et que je sois seul à dire ce que deux hommes disaient auparavant (43). Je vois bien pourtant que de toute nécessité il faudra en venir là : mais, si nous prenons ce parti, je pense que du moins nous devons tous, tant que nous sommes, être jaloux de connaître ce qu'il y a de vrai et de faux dans le sujet que nous traitons ; car il est de notre intérêt commun que la chose soit page 360 mise en évidence. Je vais donc exposer [506a] ce que je pense là-dessus, et si quelqu'un trouve que je reconnaisse pour vraies des choses qui ne le sont pas, qu'il ne manque pas de m'arrêter et de me réfuter. Aussi bien je ne parle pas comme un homme sûr de ce qu'il dit ; mais je cherche en commun avec vous. C'est pourquoi, si celui qui m'arrêtera me paraît avoir raison, je serai le premier à en tomber d'accord. Au reste, je ne vous propose ceci qu'autant que vous jugerez qu'il faut achever cette dispute : si vous n'en êtes pas d'avis, laissons-la pour ce qu'elle est, et allons-nous-en. GORGIAS. Pour moi, Socrate, mon avis n'est pas que nous nous retirions, [506b] mais que tu finisses ce discours ; et il me paraît que les autres pensent de même. Je serai charmé de t'entendre exposer ce qui te reste à dire. SOCRATE. Et moi, Gorgias, je reprendrais de tout mon cœur la conversation avec Calliclès, jusqu'à ce que je lui eusse rendu le morceau d'Amphion pour celui de Zéthus (44). Mais, puisque tu ne veux page 361 pas, Calliclès, achever à nous deux cette dispute, écoute-moi du moins, et lorsqu'il m'échappera quelque chose qui ne te paraîtra [506c] pas bien dit, arrête-moi. Si tu me prouves que j'ai tort, je ne me fâcherai pas contre toi, comme tu viens de faire, loin de là, je te tiendrai pour mon plus grand bienfaiteur. CALLICLÈS. Eh bien ! mon cher, parle toi-même, et achève. SOCRATE. Écoute donc: je vais reprendre notre discours dès le commencement. L'agréable et le bon sont-ils la même chose ? Non, comme nous en sommes convenus, Calliclès et moi. Faut-il faire l'agréable en vue du bon, ou le bon en vue de l'agréable? Il faut faire l'agréable en vue du bon. L'agréable n'est-ce point ce qui, [506d] lorsque nous l'avons, nous fait avoir de l'agrément? et le bon, ce qui, étant en nous, fait que nous sommes bons? Sans contredit. Or, nous sommes bons, nous et toutes les autres choses qui sont bonnes, par la présence de quelque propriété. Cela me paraît incontestable, Calliclès. Mais la vertu d'une chose, quelle qu'elle soit, meuble, corps, âme, animal, ne se rencontre pas ainsi en elle à l'aventure d'une manière parfaite ; elle doit sa naissance à un certain arrangement, disposi- page 362 tion et art qui convient à cette chose. Cela est-il vrai? Pour moi, je dis qu'oui. [506e] La vertu de chaque chose est donc réglée et arrangée avec ordre. J'en conviendrais. Ainsi, un certain ordre propre de chaque chose est ce qui la rend bonne, lorsqu'il se trouve en elle. C'est mon avis. Par conséquent l'âme en qui se trouve l'ordre qui lui convient, est meilleure que celle où il n'y a aucun ordre. Nécessairement. Mais l'âme en qui l'ordre règne est réglée. Comment ne le serait-elle pas? [507a] L'âme réglée est tempérante. De toute nécessité. Donc l'âme tempérante est bonne. Je ne saurai l'entendre autrement, mon cher Calliclès : pour toi, si tu as quelque chose à opposer, apprends-le-moi. CALLICLÈS. Poursuis, Socrate. SOCRATE. Je dis donc que si l'âme tempérante est bonne, celle qui est dans une disposition contraire est mauvaise. Cette âme, c'est l'âme insensée et déréglée. CALLICLÈS. Sans contredit. SOCRATE. L'homme tempérant s'acquitte de tous ses devoirs envers les dieux et envers ses semblables ; page 363 car il ne serait plus tempérant, s'il ne les remplissait pas. [507b] Il est nécessaire que cela soit ainsi. En s'acquittant de ses devoirs vis-à-vis de ses semblables, il fait des actions justes; et en les remplissant envers les dieux, il fait des actions saintes. Or, quiconque fait des actions justes et saintes est nécessairement juste et saint. Cela est vrai. Nécessairement encore il est courageux: car il n'est pas d'un homme tempérant ni de rechercher ni de fuir ce qu'il ne convient pas qu'il recherche ou qu'il fuie, mais il faut qu'il recherche ou qu'il fuie ce que le devoir lui prescrit de fuir ou de rechercher, choses et personnes, plaisir et douleur, et qu'il supporte tout avec constance. De sorte qu'il est de toute nécessité, [507c] Calliclès, que l'homme tempérant étant, comme on l'a vu, juste, courageux et saint, soit parfaitement homme de bien ; qu'étant homme de bien, toutes ses actions soient bonnes et belles, et que, vivant bien (45), il soit heureux : qu'au contraire, le méchant, qui vit mal, soit malheureux ; et le méchant, c'est celui qui est dans une disposition contraire à celle-là, page 364 c'est l'homme déréglé dont tu vantes la condition. Quant à moi, voilà ce que je pose pour certain, ce que j'assure être vrai. Mais, si cela est vrai, il n'y a point, ce me semble, d'autre parti à prendre pour quiconque veut être [507d] heureux, que de s'attacher et de s'exercer à la tempérance, et de fuir de toutes ses forces la vie licencieuse ; il doit par dessus tout faire en sorte de n'avoir aucun besoin de correction : mais s'il en a besoin ou lui-même ou quelqu'un de ses proches, soit un simple particulier, soit tout un état, il faut qu'on lui fasse subir un châtiment, et qu'on le corrige, si l'on veut qu'il soit heureux. Tel est, à mon avis, le principe qui doit diriger notre conduite ; il faut rapporter toutes ses actions individuelles et celles de l'état à cette fin, que la justice et la tempérance [507e] règnent en celui qui aspire à être heureux ; et se bien garder de donner une libre carrière à ses passions, et de chercher à les satisfaire, ce qui est un mal sans remède, et de mener ainsi une vie de brigand. Un tel homme en effet ne saurait être ami des hommes, ni de Dieu : car il est impossible qu'il ait aucun rapport avec eux, et où il n'y a point de rapport, l'amitié ne peut avoir lieu. Les sages (46), Calliclès, disent que page 365 le ciel [508a] et la terre, les dieux et les hommes sont unis par des rapports d'amitié, de convenance, d'ordre, de tempérance et de justice; et c'est pour cette raison, mon cher, qu'ils donnent à cet univers le nom d'ordre (47), et non celui de désordre ou de licence. Mais, tout sage que tu es, il me paraît que tu ne fais point attention à cela, et que tu ne vois pas que l'égalité géométrique (48) a beaucoup de pouvoir chez les dieux et chez les hommes. Ainsi, tu crois qu'il faut chercher à avoir plus que les autres, et négliger la géométrie. A la bonne heure. Il nous faut donc réfuter ce que je viens de dire, [508b] et montrer que les heureux ne le sont point par la possession de la justice et de la tempérance, et les malheureux par celle du vice; ou, si ce discours est vrai, il faut examiner ce qui en résulte. Or, il en résulte, Calliclès, tout ce que j'ai dit plus haut, et sur quoi tu m'as demandé si je parlais sérieusement, lorsque j'ai avancé qu'il fallait en cas d'injustice s'accuser soi-même, son fils, son ami, et se servir de la rhétorique à cette fin. Et ce que tu as cru que Polus m'accordait par honte était vrai, savoir, [508c] qu'il est plus laid, et par conséquent plus mauvais de faire une injustice, que page 366 de la recevoir. Il n'est pas moins vrai que, pour être un bon orateur, il faut être juste et versé dans la science des choses justes; ce que Polus a dit pareillement que Gorgias m'avait accordé par honte. Les choses étant ainsi, examinons un peu les reproches que tu me fais, et si tu as raison, ou non, de me dire que je ne suis pas en état de me secourir moi-même, ni aucun de mes amis ou de mes proches, et de me tirer des plus grands dangers; que je suis comme les hommes déclarés infâmes, [508d] à la merci du premier venu, soit qu'on veuille, pour me servir de tes expressions, me frapper au visage, ou me ravir mes biens, ou me bannir de la ville, ou enfin me faire mourir ; et qu'être dans une pareille situation, c'est la chose du monde la plus laide. Tel était ton sentiment. Voici le mien : je l'ai déjà dit plus d'une fois ; mais rien n'empêche de le répéter. Je soutiens, Calliclès, que ce qu'il y a de plus laid n'est pas d'être frappé injustement au visage, [508e] ni de se voir couper le corps ou la bourse ; mais que me frapper injustement moi et les miens, et me mutiler, voilà ce qui est laid et mauvais ; et que me voler, m'entraîner en esclavage, percer ma muraille, commettre en un mot quelque espèce d'injustice que ce soit envers moi ou ce qui est à moi, est une chose plus mauvaise et plus laide pour page 367 l'auteur de l'injustice que pour moi, qui la souffre. Ces maximes, qui, selon moi, ont été démontrées dans toute la suite de cet entretien, sont, autant qu'il me semble, attachées et liées entre elles, [509a] si on peut parler avec cette rudesse, par des raisons de fer et de diamant. Si tu ne parviens à les rompre, toi ou quelque autre plus vigoureux que toi, je tiens que c'est là ce que dit le sens commun sur ces matières. Pour moi, je le répète, je se sais point ce qui en est en réalité ; mais de tous ceux avec qui j'ai conversé, comme je le fais maintenant avec toi, il n'en est aucun qui ait pu éviter de se rendre ridicule, en soutenant une autre opinion. [509b] Ainsi, je suppose que cette manière de voir est la véritable ; mais si elle l'est, si l'injustice est le plus grand de tous les maux pour celui qui la commet, et si, tout grand qu'est ce mal, c'en est un plus grand encore, s'il se peut, de n'être point puni des injustices qu'on a commises, quel est le genre de secours qu'on ne peut être incapable de se procurer à soi-même, sans être véritablement digne de risée ? N'est-ce pas le secours dont l'effet serait de détourner de nous le plus grand dommage ? Oui ; ce qu'il y a incontestablement de plus laid est de ne pouvoir se ménager ce secours à soi-même, ni à ses amis, ni à ses proches. Il faut mettre au page 368 [509c] second rang l'impuissance d'éviter le second mal ; au troisième, l'impuissance d'éviter le troisième, et ainsi de suite, à proportion de la grandeur du mal. Ainsi, autant il est beau de pouvoir se garantir de chacun de ces maux, autant il est contraire au beau de ne pouvoir le faire. Cela est-il comme je le dis, Calliclès, ou autrement. CALLICLÈS. Cela est comme tu le dis. SOCRATE. De ces deux choses, commettre l'injustice et la recevoir, la première étant, selon nous, un plus grand mal, et la seconde un moindre, que faut-il donc que l'homme se procure pour être à portée de se secourir, [509d] et pour jouir du double avantage de ne commettre et de ne recevoir aucune injustice ? Est-ce la puissance, ou la volonté ? Voici ce que je veux dire. Je demande si pour ne recevoir aucune injustice, il suffit qu'on ne veuille pas en recevoir, ou s'il faut se rendre assez puissant pour se mette à l'abri de toute injustice. CALLICLÈS. Il est clair qu'on n'y parviendra qu'en se rendant puissant. page 369 SOCRATE. Et par rapport à l'autre point, qui est de commettre l'injustice, est-ce assez de ne le pas vouloir, pour n'en point commettre, et de cette manière en effet n'en commettra-t-on point? ou faut-il [509e] de plus acquérir pour cela une certaine puissance, un certain art, faute duquel, si on ne l'apprend et si on ne le pratique, on tombera dans l'injustice? Pourquoi ne me réponds-tu pas là-dessus, Calliclès? Penses-tu que, quand nous sommes convenus, Polus et moi, que personne ne commet l'injustice volontairement, mais que tous les médians sont tels malgré eux, nous ayons été forcés à cet aveu par de bonnes raisons ou non ? [510a] CALLICLÈS. Je te passe ce point, Socrate, afin que tu arrives à ta conclusion. SOCRATE. Il faut donc, à ce qu'il paraît, se procurer aussi une certaine puissance, un certain art pour ne point faire d'injustice. CALLICLÈS. Sans doute. SOCRATE. Mais quel est le moyen de se garantir de toute ou de presque toute injustice de la part d'autrui? Vois si tu es sur cela de mon avis. Je pense qu'il page 370 faut avoir dans sa ville l'autorité et la tyrannie, ou être ami de ceux qui gouvernent. CALLICLÈS. Vois, Socrate, combien je suis disposé à t'approuver [510b] quand tu dis bien. Ceci me paraît tout-à-fait bien dit. SOCRATE. Examine si ce que j'ajoute est moins vrai. Il me semble, comme l'ont dit d'anciens et sages personnages, que la plus grande amitié est celle qui unit le semblable à son semblable. Ne penses-tu pas de même? CALLICLÈS. Oui. SOCRATE. Ainsi partout où il se trouve un tyran farouche et sans éducation, s'il y a dans sa ville quelque citoyen beaucoup meilleur que lui, il le craindra, et ne pourra jamais lui être attaché [510c] de toute son âme. CALLICLÈS. Cela est vrai. SOCRATE. Ce tyran n'aimera pas non plus un citoyen d'un caractère fort inférieur au sien : car il le méprisera, et n'aura jamais pour lui l'affection qu'on a pour un ami. page 371 CALLICLÈS. Cela est encore vrai. SOCRATE. Le seul ami qui lui reste par conséquent, le seul à qui il donnera sa confiance, est celui qui étant du même caractère, approuvant et blâmant les mêmes choses, consentira à lui obéir et à être soumis à ses volontés. Cet homme jouira [510d] d'un grand crédit dans la ville; personne ne lui nuira impunément. N'est-ce pas? CALLICLÈS. Oui. SOCRATE. Si quelqu'un des jeunes gens de cette ville se disait à lui-même : de quelle manière pourrai-je m'élever à un grand pouvoir, et me mettre à l'abri de toute injustice? le moyen d'y parvenir est, ce me semble, de s'accoutumer de bonne heure à se plaire et à se déplaire aux mêmes choses que le despote, et à faire en sorte d'acquérir la plus parfaite ressemblance avec lui. N'est-il pas vrai? CALLICLÈS. Tout-à-fait. SOCRATE. Par là, il se mettra, disons-nous, au-dessus page 372 des atteintes de l'injustice, et [510e] se rendra puissant parmi ses concitoyens. CALLICLÈS. Je le crois. SOCRATE. Mais se garantira-t-il également de commettre l'injustice? ou s'en faut-il de beaucoup, en supposant qu'il ressemble à son maître qui est injuste, et qu'il ait un grand pouvoir auprès de lui ? Pour moi, je pense au contraire que toutes ses démarches tendront à se mettre en état de commettre les plus grandes injustices, et de n'avoir aucun châtiment à redouter. Qu'en dis-tu? CALLICLÈS. Il y a apparence. [511a] SOCRATE. Il aura donc en lui-même le plus grand des maux, son âme étant pervertie et dégradée par l'imitation de son maître, et par sa puissance. CALLICLÈS. Je ne sais, Socrate, quel secret tu as de tourner et de retourner le discours en tous sens. Ignores-tu que cet homme qui imite le tyran fera mourir, s'il lui plaît, et dépouillera de ses biens celui qui ne l'imite pas? [511b] SOCRATE. Je le sais, mon cher Calliclès : il faudrait que page 373 je fusse sourd pour l'ignorer, après l'avoir entendu tout-à-1'heure plus d'une fois de ta bouche, de celle de Polus, et de presque tous les habitants de cette ville. Mais écoute-moi à mon tour. Je conviens qu'il mettra à mort qui il voudra : mais il sera méchant, et celui qu'il fera mourir, homme de bien. CALLICLÈS. N'est-ce pas précisément ce qu'il y a de plus fâcheux? SOCRATE. Non, du moins pour l'homme sensé, comme ce discours le prouve. Crois-tu donc qu'on doive s'appliquer à vivre le plus longtemps qu'il est possible, et apprendre les arts qui nous sauvent [511c] de péril en toute rencontre, comme la rhétorique que tu me conseilles d'étudier et qui fait notre sûreté devant les tribunaux? CALLICLÈS. Et, par Jupiter, je te donne là un très bon conseil. SOCRATE. Et quoi, mon cher, l'art de nager te paraît-il bien sublime? CALLICLÈS. Non, certes. page 374 SOCRATE. Cependant il sauve les hommes de la mort, lorsqu'ils se trouvent dans les circonstances où l'on a besoin de cet art. Mais si celui-ci te paraît méprisable, je vais t'en nommer [511d] un plus important, l'art de conduire les vaisseaux, qui ne préserve pas seulement les âmes, mais aussi les corps et les biens des plus grands dangers, comme la rhétorique. Cet art est modeste et sans pompe; il ne fait point grand étalage, et ne se pavane pas, comme procurant des résultats merveilleux : eh bien, quoiqu'il nous procure justement les mêmes avantages que l'art oratoire, il ne prend, je crois, que deux oboles, pour nous ramener sains et saufs d'Égine ici; si c'est de l'Égypte on du Pont, [511e] pour un si grand bienfait, et pour avoir conservé tout ce que je viens de dire, notre personne et nos biens, nos enfants et nos femmes, lorsqu'il nous a mis à terre sur le port, c'est deux drachmes qu'il lui faut. Quant à celui qui possède cet art et nous a rendu un si grand service, dès qu'il est débarqué, il se promène modestement le long du rivage et de son vaisseau. Car il sait, à ce que je m'imagine, [512a] se dire à lui-même qu'il est difficile de connaître quels sont les passagers à qui il a fait du bien, en les préservant d'être submergés, et ceux à qui il a fait tort, sachant bien qu'ils ne sont pas page 375 sortis meilleurs de son vaisseau qu'ils n'y sont entrés, ni pour le corps, ni pour l'âme. Il raisonne de la sorte : si quelqu'un dont le corps est travaillé de maladies considérables et sans remède ne s'est pas noyé, c'est un malheur pour lui de n'être pas mort, et il ne m'a aucune obligation. Et si quelqu'un a dans son âme, qui est beaucoup plus précieuse que son corps, une foule de maux incurables, est-ce un bien pour lui de vivre, et rend-on service à un tel homme, en le sauvant de la mer, ou des mains de la justice, ou de tout autre [512b] danger? Au contraire, il sait que ce n'est pas pour le méchant un avantage de vivre, parce que c'est une nécessité qu'il vive malheureux. Voilà pourquoi il n'est point d'usage que le pilote tire vanité de son art, quoique nous lui devions notre salut, non plus, .mon cher ami, que le machiniste qui dans certains cas peut sauver autant de choses, je ne dis que le pilote, mais que le général d'armée, et tout autre, quel qu'il soit, puisqu'il est telle circonstance où il préserve des villes entières. Prétendrais-tu le mettre en comparaison avec l'avocat? Cependant, Calliclès, s'il voulait tenir le même langage que vous autres et vanter [512c] son art, il vous écraserait par ses raisons, en vous prouvant que vous devez vous faire machinistes, et en vous y exhortant, parce que les page 376 autres arts ne sont rien auprès de celui-là : et il aurait belle matière à discourir. Tu ne l'en méprises pas moins toutefois lui et son art, et tu lui dirais comme une injure qu'il n'est qu'un machiniste; tu ne voudrais ni donner ta fille en mariage à son fils, ni prendre sa fille pour bru. Néanmoins à examiner les raisons qui élèvent si fort ton art à tes yeux, de quel droit méprises-tu le machiniste [512d] et les autres dont j'ai parlé? Je sais bien que tu vas me dire que tu es meilleur qu'eux, et de meilleure famille. Mais si par meilleur il ne faut pas entendre ce que j'entends, et si toute la vertu consiste à mettre en sûreté sa personne et ses biens, ton mépris pour le machiniste, le médecin, et les autres arts qui se rapportent à notre conservation, est digne de risée. Mon cher, prends garde qu'être vertueux et bon ne soit autre chose que de se tirer d'affaire soi et les autres; vois si celui qui est vraiment homme ne doit point négliger le plus ou le moins [512e] de temps qu'il pourra vivre, et se montrer peu amoureux de l'existence, et s'il ne faut pas, laissant à Dieu le soin de tout cela, et ajoutant foi à ce que disent les femmes, que personne n'a jamais échappé à son heure fatale, s'occuper de quelle manière on s'y prendra pour passer le mieux qu'il est possible le temps qu'on a à vivre. Est-ce en se page 377 conformant [513a] aux mœurs du gouvernement sous lequel on se trouve? Il faut donc que dès ce moment tu t'efforces de ressembler le plus qu'il se peut au peuple d'Athènes, si tu veux lui être cher et avoir un grand crédit dans cette ville. Vois si c'est là ton avantage et le mien. Mais il est à craindre, mon cher ami, qu'il ne nous arrive la même chose qui arrive, dit-on, aux femmes de Thessalie (49), lorsqu'elles attirent la lune, et que nous ne puissions attirer à nous une telle puissance dans Athènes, qu'aux dépens de ce que nous avons de plus précieux. Et si tu crois que quelqu'un au monde t'apprendra le secret [513b] de devenir puissant auprès des Athéniens en différant d'eux, soit en mieux soit en pis, mon avis est que tu te trompes, Calliclès. Car il ne suffit pas de contrefaire les Athéniens, il faut être né avec un caractère tel que le leur, pour contracter une amitié réelle avec ce peuple, comme avec le fils de Pyrilampe. Ainsi quiconque te donnera une parfaite conformité avec eux, fera de toi un politique et un orateur, tel que tu désires de l'être. Les hommes [513c] en effet se plaisent aux discours qui se rapportent à leur caractère; et tout ce qui y est étranger page 378 les offense. Mais peut-être, mon cher ami, tu es d'un autre avis. Avons-nous quelque chose à opposer à cela, Calliclès? CALLICLÈS. Je ne sais trop comment, Socrate, il me paraît que tu as raison : mais avec tout cela je suis dans le même cas que la plupart de ceux qui t'écoutent; je ne te crois pas entièrement. SOCRATE. C'est que le double (50) amour enraciné dans ton âme, Calliclès, combat mes raisons. Mais si nous réfléchissons ensemble plus souvent [513d] et plus à fond sur les mêmes objets, peut-être te rendras-tu. Rappelle-toi ce que nous avons dit qu'il y a deux façons de cultiver le corps et l'âme : l'une qui a pour but leur plaisir, l'autre leur bien, et qui, loin de caresser leurs penchants et de les flatter, combat au contraire leurs inclinations. N'est-ce pas là ce que nous avons établi ci-dessus ? CALLICLÈS. Oui. SOCRATE. Celle qui ne vise qu'au plaisir est basse, et n'est autre chose qu'une flatterie. N'est-ce pas? page 379 [513e] CALLICLÈS. A la bonne heure, puisque tu le veux. SOCRATE. Au lieu que l'autre ne pense qu'à rendre meilleur l'objet de nos soins, le corps ou l'âme. CALLICLÈS. Soit. SOCRATE. N'est-ce pas ainsi que nous devons entreprendre la culture de l'état et des citoyens, et travailler à les rendre aussi bons qu'il est possible? puisque sans cela, comme nous l'avons vu plus haut, tout autre service qu'on leur rendrait ne leur serait [514a] d'aucune utilité; à moins que l'âme de ceux à qui on procurera de grandes richesses ou un accroissement de domaine, ou quelque autre genre de puissance, ne soit belle et bonne. Poserons-nous cela pour certain? CALLICLÈS. Je le veux bien, si cela te fait plaisir. SOCRATE. Si nous nous excitions mutuellement, Calliclès, à nous charger de quelque entreprise publique, par exemple, de la construction des murs, des arsenaux, des temples, des édifices les plus considérables, ne serait-il point à propos de nous sonder nous-mêmes, [514b] et d'examiner en premier page 380 lieu si nous sommes habiles ou non dans l'architecture, et de qui nous avons appris cet art? Cela serait-il nécessaire, ou non? CALLICLÈS. Sans contredit. SOCRATE. La seconde chose qu'il faudrait examiner, n'est-ce pas si nous avons déjà bâti de nous-mêmes quelque maison pour nous ou pour nos amis, et si cette maison est bien ou mal construite? Et cet examen fait, si nous trouvions que nous avons eu des maîtres habiles et [514c] célèbres, que sous leur direction nous avons bâti un grand nombre de beaux édifices, et beaucoup d'autres aussi de nous-mêmes, depuis que nous avons quitté nos maîtres; les choses étant ainsi, il n'y aurait que de la prudence à nous charger des ouvrages publics; si au contraire nous ne pouvions dire quels ont été nos maîtres, ni montrer aucun bâtiment de notre façon, ou si nous en montrions plusieurs, mais mal entendus, ce serait une folie de notre part d'entreprendre aucun ouvrage public, et de nous y encourager l'un l'autre. Avouerons-nous [514d] que cela soit bien dit? CALLICLÈS. Assurément. SOCRATE. N'en est-il pas de même de toutes les autres page 381 choses? par exemple, si nous avions dessein de servir le public en qualité de médecins, et que nous nous y exhortassions mutuellement, comme étant suffisamment versés dans cet art; ne nous examinerions-nous point de part et d'autre toi et moi? Au nom du ciel, voyons d'abord, dirais-tu, comment Socrate lui-même se porte, et si quelque autre homme, libre ou esclave, a été guéri de quelque maladie par les soins de Socrate. Autant en voudrais-je savoir sans doute par rapport à toi. Et s'il se trouvait [514e] que nous n'avons rendu la santé à personne, ni étranger, ni concitoyen, ni homme, ni femme, par Jupiter, Calliclès, ne serait-ce pas réellement une chose ridicule que des hommes en vinssent à cet excès d'extravagance, de vouloir, comme on dit, commencer le métier de potier par la cruche d'argile, de se consacrer au service du public et d'exhorter les autres à en faire autant, avant d'avoir fait en particulier plusieurs coups d'essai passables, d'avoir réussi un certain nombre de fois, et d'avoir suffisamment exercé leur art? Ne penses-tu pas qu'une pareille conduite serait insensée? CALLICLÈS. Oui. [515a] SOCRATE. Maintenant donc, ô le meilleur des hommes, page 382 que tu commences depuis peu à te mêler des affaires publiques, que tu m'engages à t'imiter, et que tu me reproches de n'y prendre aucune part, ne nous examinerons-nous point l'un l'autre? Voyons un peu : Calliclès a-t-il par le passé rendu quelque citoyen meilleur? Est-il quelqu'un qui étant auparavant méchant, injuste, libertin, et insensé, soit devenu honnête homme par les soins de Calliclès, étranger ou citoyen, esclave ou libre? Dis-moi, [515b] Calliclès, si on te questionnait là-dessus, que répondrais-tu? Diras-tu que ton commerce a rendu quelqu'un meilleur? As-tu honte de me déclarer si, n'étant que simple particulier, et avant de t'immiscer dans le gouvernement de l'état, tu as fait quelque chose de semblable? CALLICLÈS. Tu es bien disputeur, Socrate. SOCRATE. Ce n'est point pour disputer que je t'interroge, mais dans le désir sincère d'apprendre comment, selon toi, on doit se conduire chez nous dans l'administration de la chose publique; et si, en te mêlant des affaires [515c] de l'état, tu te proposeras un autre but que de faire de nous des citoyens accomplis. Ne sommes-nous pas convenus plusieurs fois, que tel doit être le but du politique? page 383 En sommes-nous tombés d'accord, ou non? Réponds. Oui, nous en sommes tombés d'accord, puisqu'il faut que je réponde pour toi. Si donc tel est l'avantage que l'homme de bien doit tâcher de procurer à sa patrie, réfléchis un peu, et dis-moi s'il te semble encore que ces personnages dont tu parlais il y a quelque temps, [515d] Périclès, et Cimon, et Miltiade, et Thémistocle, ont été de bons citoyens? CALLICLÈS. Sans doute. SOCRATE. Si donc ils ont été bons citoyens, il est évident qu'ils ont rendu leurs compatriotes meilleurs, de plus mauvais qu'ils étaient auparavant. L'ont-ils fait, ou non? CALLICLÈS. Ils l'ont fait. SOCRATE. Lorsque Périclès commença à parler en public, les Athéniens étaient donc plus mauvais que quand il les harangua pour la dernière fois. CALLICLÈS. Peut-être. SOCRATE. Il ne faut pas dire peut-être, mon cher, mais page 384 nécessairement, d'après les principes dont nous sommes convenus, s'il est vrai que Périclès fut un bon citoyen. [515e] CALLICLÈS. Eh bien, qu'en veux-tu conclure? SOCRATE. Rien. Mais dis-moi de plus, est-ce l'opinion commune que les Athéniens sont devenus meilleurs par les soins de Périclès? ou tout au contraire qu'il les a corrompus? J'entends dire en effet que Périclès a rendu les Athéniens paresseux, lâches, babillards et intéressés, ayant le premier soudoyé les troupes. (51) CALLICLÈS. Tu entends tenir ce langage, Socrate, à ceux qui ont les oreilles déchirées. (52) SOCRATE. Du moins ce qui suit n'est pas un ouï-dire. Je sais certainement, et tu sais toi-même que Périclès s'acquit au commencement une grande page 385 réputation, et que les Athéniens, dans le temps qu'ils étaient plus méchants, ne rendirent contre lui aucune sentence infamante; mais que sur la fin de la vie de Périclès, après qu'ils furent devenus bons et vertueux [516a] par ses soins, ils le condamnèrent pour cause de péculat, et que peu s'en fallut qu'ils ne le jugeassent à mort, sans doute comme un mauvais citoyen. CALLICLÈS. Eh bien! que fait cela contre Périclès? SOCRATE. On tiendrait pour un très mauvais gardien tout homme qui aurait des ânes, des chevaux, des bœufs à soigner, s'il faisait comme Périclès, et si ces animaux, devenus féroces entre ses mains, ruaient, frappaient de la corne, mordaient, quoiqu ils ne fissent rien de semblable lorsqu'on les lui a confiés. Ne penses-tu pas [516b] en effet qu'on s'entend mal à gouverner quelque animal que ce soit, quand on l'a reçu doux, et qu'on le rend plus intraitable qu'on ne l'a reçu ? Est-ce ton avis, ou non ? CALLICLÈS. Je le veux bien, pour te faire plaisir. SOCRATE. Fais-moi donc encore le plaisir de me dire si l'homme est ou n'est pas dans la classe des animaux. page 386 CALLICLÈS. Comment n'en serait-il pas? SOCRATE. N'est-ce point des hommes que Périclès avait à conduire? CALLICLÈS. Assurément. SOCRATE. Quoi, ne fallait-il pas, comme nous en sommes convenus, que d'injustes qu'ils étaient, ils devinssent plus justes sous sa conduite, puisqu'il [516c] en prenait soin, s'il eût été réellement bon politique ? CALLICLÈS. A la bonne heure. SOCRATE. Mais les justes sont doux, comme dit Homère (53), et toi, qu'en dis-tu? ne penses-tu pas de même? CALLICLÈS. Oui. SOCRATE. Or, Périclès les a rendus plus féroces qu'ils n'étaient quand il s'en est chargé, et cela contre lui-même, la chose du monde la plus contraire à ses intentions. page 387 CALLICLÈS. Veux-tu que je te l'accorde? SOCRATE. Oui, si tu trouves que je dis vrai. CALLICLÈS. Soit donc. SOCRATE. Et les rendant plus féroces, ne les a-t-il pas conséquemment rendus plus injustes et plus méchants? [516d] CALLICLÈS. Soit. SOCRATE. Ainsi Périclès n'était point à ce compte un bon politique. CALLICLÈS. Tu le dis. SOCRATE. Et toi aussi assurément, si on en juge par tes aveux. Dis-moi encore au sujet de Cimon ; ceux dont il prenait soin ne lui firent-ils pas subir la peine de l'ostracisme, afin d'être dix ans entiers sans entendre sa voix ? Ne tinrent-ils pas la même conduite à l'égard de Thémistocle, et de plus ne le condamnèrent-ils point au bannissement? Pour Miltiade, le vainqueur de Marathon, ils le condamnèrent à être précipité page 388 dans la fosse, [516e] et sans le premier prytane, il y eût été jeté (54). Cependant, s'ils avaient tous été de bons citoyens, comme tu le prétends, il ne leur serait jamais arrivé rien de semblable. Il n'est pas naturel que les habiles conducteurs de chars ne tombent point de leurs chevaux dans les commencements, et qu'ils en tombent après avoir rendu leurs chevaux plus dociles, et être devenus eux-mêmes meilleurs cochers. C'est ce qui n'arrive ni dans la conduite des chars, ni dans aucune autre chose. Qu'en penses-tu ? CALLICLÈS. Je pense comme toi. SOCRATE. Ce qui a été dit précédemment était donc vrai, à ce qu'il paraît, [517a] que nous ne connaissons aucun homme de cette ville qui ait été bon politique. Tu avouais toi-même qu'il n'y en a point aujourd'hui ; mais tu soutenais qu'il y en a eu autrefois ; et tu as nommé de préférence ceux dont je viens de parler. Or, nous avons vu qu'ils n'ont aucun avantage sur ceux de nos jours. C'est pourquoi, s'ils étaient orateurs, ils n'ont fait usage ni de la véritable rhétorique, car ja- page 389 mais alors ils ne seraient tombés de leur puissance, ni de la rhétorique flatteuse. CALLICLÈS. Cependant, Socrate, il s'en faut de beaucoup qu'aucun des politiques d'aujourd'hui exécute d'aussi grandes choses [517b] qu'aucun de ceux-là. SOCRATE. Aussi, mon cher, je ne les méprise pas comme serviteurs du peuple : il me paraît au contraire qu'à ce titre ils l'emportent sur ceux de nos jours, et qu'ils ont montré plus d'habileté à procurer au peuple ce qu'il désirait. Mais pour ce qui est de. faire changer d'objet à ses désirs, de ne pas lui permettre de les satisfaire, et de tourner les citoyens, soit par persuasion, soit par contrainte, vers ce qui pouvait les rendre meilleurs, c'est en quoi il n'y a, pour ainsi dire, aucune différence [517c] entre eux et ceux d'à présent ; et c'est pourtant la tâche véritable d'un bon citoyen. A l'égard des vaisseaux, des murailles, des arsenaux, et de beaucoup d'autres choses semblables, je conviens avec toi que ceux du temps passé s'entendaient mieux à nous procurer tout cela que ceux de nos jours. Mais il nous arrive à toi et à moi une chose plaisante dans cette dispute. Depuis le temps que nous conversons, nous n'avons pas page 390 cessé de tourner autour du même objet, et nous ne nous entendons pas l'un l'autre. Il me semble que tu as souvent avoué et reconnu que par rapport [517d] au corps et à l'âme il y a deux manières de les soigner : l'une servile, qui se propose de procurer par tous les moyens possibles des aliments au corps lorsqu'il a faim, de la boisson lorsqu'il a soif, des vêtements pour le jour et la nuit, et des chaussures lorsqu'il fait froid, en un mot toutes les autres choses dont le corps peut avoir besoin. Je me sers exprès de ces images, afin que tu comprennes mieux ma pensée. Lorsqu'on est en état de fournir à ces besoins, comme marchand à poste fixe ou comme marchand forain, [517e] comme artisan de quelqu'une de ces choses, boulanger, cuisinier, tisserand, cordonnier, tanneur, il n'est pas surprenant qu'en ce cas on se regarde soi-même et on soit regardé par les autres comme chargé du soin du corps; mais c'est ignorer qu'outre tous ces arts, il y en a un dont les parties sont la gymnastique et la médecine, auquel la culture du corps appartient véritablement ; que c'est à lui qu'il convient de commander à tous les autres arts, et de se servir de ce qu'ils font, parce qu'il sait ce qu'il y a dans le boire et le manger de salutaire et de nuisible [518a] à la page 391 santé, et que les autres arts ne le savent pas. C'est pourquoi il faut qu'en ce qui concerne le soin du corps, les autres arts soient réputés des fonctions serviles et basses ; et que la gymnastique et la médecine aient le premier rang. Les mêmes choses ont lieu à l'égard de l'âme ; et il me paraît quelquefois que tu comprends que telle est ma pensée, et tu me fais des aveux comme un homme qui entend parfaitement ce que je dis ; puis tu me viens ajouter un moment après qu'il y a eu dans cette ville [518b] d'excellents hommes d'état ; et quand je te demande qui c'est, tu me présentes des hommes qui, pour les affaires politiques, sont précisément tels que, si, te demandant quels ont été ou quels sont les gens habiles dans la gymnastique et capables de dresser le corps, tu me nommais très sérieusement Théarion le boulanger, Mithécos qui a écrit sur la cuisine sicilienne, et Sarambos le marchand de vin; prétendant qu'ils s'entendaient merveilleusement dans l'art de prendre soin du corps, parce qu'ils savaient apprêter admirablement, [518c] l'un le pain, l'autre les ragoûts, le troisième le vin. Peut-être te fâcherais-tu contre moi, si je te disais à ce sujet : tu n'as, mon ami, nulle idée de la gymnastique ; tu me nommes des serviteurs page 392 de nos besoins, dont tonte l'occupation est de les satisfaire, mais qui ne connaissent point ce qu'il y a de bon et de convenable en ce genre; qui après avoir rempli de toutes sortes d'aliments, et engraissé le corps de leurs concitoyens, et en avoir reçu des éloges, finissent par ruiner jusqu'it leur santé première. Ceux-ci, [518d] vu leur ignorance, n'accuseront point ces pourvoyeurs de leur gourmandise d'être cause des maladies qui leur surviennent, tt de la perte de leur premier embonpoint : non, ils rejetteront la faute sur ceux qui pour lors se trouvent présents, et leur donnent quelques conseils ; et lorsque les excès qu'ils ont faits sans aucun égard pour leur santé auront amené longtemps après les maladies, ils s'en prendront à ces derniers, ils les blâmeront, et leur feront du mal, s'ils le peuvent : pour les premiers, au contraire, qui sont la vraie cause de leurs maux, [518e] ils les combleront de louanges. Voilà précisément la conduite que tu tiens à présent, Calliclès. Tu exaltes des hommes qui ont fait faire bonne chère aux Athéniens, en leur servant tout ce qu'ils désiraient. Ils ont agrandi l'état, disent les Athéniens ; mais ils ne s'aperçoivent pas que cet agrandissement n'est qu'une enflure, [519a] une tumeur pleine de corruption, et que c'est là tout ce qu'ont fait ces anciens politiques, pour avoir page 393 rempli la république de ports, d'arsenaux, de murailles, de tributs, et d'autres bagatelles semblables, sans y joindre la tempérance et la justice. Quand donc la crise viendra, il s'en prendront à ceux qui se mêleront pour lors de leur donner des conseils, et ils n'auront que des éloges pour Thémistocle, Cimon et Périclès, les vrais auteurs de leurs maux. Peut-être même se saisiront-ils de toi, si tu n'es sur tes gardes, et de mon ami Alcibiade, quand avec leurs acquisitions ils auront perdu [519b] ce qu'ils possédaient autrefois, quoique vous ne soyez point les premiers auteurs, mais peut-être les complices de leur ruine. Au reste, je vois qu'il se passe aujourd'hui une chose tout-à-fait déraisonnable, et j'en entends dire autant de ceux qui nous ont précédés. Je remarque en effet que, quand on punit quelqu'un des hommes qui se mêlent des affaires publiques, comme coupables de malversation, ils s'emportent et se plaignent amèrement des mauvais traitements qu'on leur fait, après les services sans nombre qu'ils ont rendus à l'état. Est-ce donc injustement, comme ils le prétendent, que le peuple les fait périr? Non, rien n'est plus faux. Jamais un homme [519c] à la tête d'un état ne peut être injustement opprimé par l'état qu'il gouverne. Mais il paraît qu'il en est de ceux qui se donnent pour politiques, comme des so- page 394 phistes ; car les sophistes, gens habiles d'ailleurs, tiennent à certain égard une conduite dépourvue de bon sens. En même temps qu'ils font profession d'enseigner la vertu, ils accusent souvent leurs élèves d'être coupables envers eux d'injustice, en ce qu'ils les frustrent de l'argent qui leur est dû, et ne témoignent pour eux aucune reconnaissance [519d] des bienfaits qu'ils en ont reçus. Or, y a-t-il rien de plus inconséquent qu'un pareil discours ? Des hommes devenus bons et justes, auxquels leur maître a ôté l'injustice et donné la justice, agir injustement par un vice qui n'est plus en eux ! Ne juges-tu pas cela tout-à-fait absurde, mon cher? — Tu m'as réduit, Calliclès, à faire une harangue dans les formes, en refusant de me répondre. CALLICLÈS. Quoi donc ! ne pourrais-tu point parler, à moins qu'on ne te réponde ? [519e] SOCRATE. Il y a apparence que je le puis, puisque je m'étends à présent en longs discours, depuis que tu ne veux plus me répondre. Mais, mon cher, au nom de Jupiter qui préside à l'amitié, dis-moi, ne trouves-tu point absurde, qu'un homme qui se vante d'en avoir rendu un autre vertueux, se plaigne de lui comme d'un mé- page 395 chant, quand par ses soins il est devenu et il est réellement bon ? CALLICLÈS. Cela me paraît absurde. SOCRATE. N'est-ce pas pourtant le langage que tu entends tenir à ceux qui font profession de former les hommes à la vertu ? [520a] CALLICLÈS. Il est vrai : mais que peut-on attendre autre chose de gens méprisables, tels que les sophistes ? SOCRATE. Eh bien, que diras-tu de ceux qui se vantant d'être à la tête d'un état, et de mettre tous leurs soins à le rendre le meilleur possible, l'accusent ensuite à la première occasion, comme étant très corrompu? Crois-tu qu'il y ait quelque différence entre eux et les précédents ? Le sophiste et l'orateur, mon cher, sont la même chose, ou deux choses très ressemblantes, comme je le disais à Polus. Mais faute de connaître cette ressemblance, [520b] tu penses que la rhétorique est ce qu'il y a de plus beau au monde, et tu méprises la profession de sophiste. Dans la vérité cependant la sophistique est autant plus belle que la rhétorique, que la fonction de législateur l'emporte sur celle de juge, et la gymnastique page 396 sur la médecine. Et je croyais pour moi que les sophistes et les orateurs étaient les seuls qui n'eussent aucun droit de reprocher à celui qu'ils forment d'être mauvais à leur égard ; ou qu'en l'accusant, ils s'accusaient eux-mêmes de n'avoir fait aucun bien à ceux qu'ils se vantent de rendre meilleurs. Cela n'est-il pas vrai? [520c] CALLICLÈS. Oui. SOCRATE. Ce sont aussi les seuls qui pourraient n'exiger aucun salaire des avantages qu'ils procurent, si ce qu'ils disent était vrai. En effet, quelqu'un qui aurait reçu toute autre espèce de bienfait, qui serait devenu, par exemple, léger à la course par les soins d'un maître de gymnase, serait peut-être capable de le frustrer de la reconnaissance qu'il lui doit, si le maître de gymnase la laissait à sa discrétion, et qu'il n'eût pas fait avec lui une convention pour le prix, en vertu de laquelle il reçoit de l'argent [520d] en même temps qu'il lui donne l'agilité. Car ce n'est pas, je pense, la lenteur à la course, mais l'injustice qui fait les hommes mauvais. N'est-ce pas? CALLICLÈS. Sans doute. page 397 SOCRATE. Si donc quelqu'un détruisait ce principe du mal, je veux dire l'injustice, il n'aurait point à craindre qu'on se comportât injustement à son égard ; et il serait le seul qui pourrait en sûreté placer son bienfait sans condition, s'il était réellement en son pouvoir de faire des hommes vertueux. N'en conviens-tu pas ? CALLICLÈS. Soit. SOCRATE. C'est probablement pour cette raison qu'il n'y a nulle honte à recevoir un salaire pour les autres conseils que l'on donne, sur l'architecture, par exemple» ou tout autre art semblable. [520e] CALLICLÈS. Il y a apparence. SOCRATE. Au lieu que s'il s'agit d'inspirer à un homme la vertu, et de lui apprendre à gouverner parfaitement sa famille ou sa patrie, on tient pour une chose honteuse de refuser ses conseils, à moins qu'on ne nous donne de l'argent. N'est-ce pas ? CALLICLÈS. Oui page 398 SOCRATE. La raison de cette différence est évidemment que, de tous les bienfaits, celui-là est le seul qui porte la personne qui l'a reçu à faire du bien à son tour à son bienfaiteur ; et l'on regarde comme un bon signe lorsqu'on donne à l'auteur d'un tel bienfait des marques de sa reconnaissance, et comme un mauvais signe, lorsqu'on ne lui en donne aucune. La chose n'est-elle pas ainsi ? [521a] CALLICLÈS. Tout-à-fait. SOCRATE. Explique-moi donc nettement à laquelle de ces deux manières de prendre soin de l'état tu m'invites, si c'est à combattre les penchants des Athéniens, dans la vue d'en faire d'excellents citoyens, et comme un médecin ; ou à les servir, et à traiter avec eux comme un flatteur. Dis-moi là-dessus la vérité, Calliclès. Il est juste qu'ayant débuté par me parler avec franchise, tu continues jusqu'au bout à me dire ce que tu penses. Ainsi, réponds-moi brièvement. CALLICLÈS. Je dis donc que je t'invite à les servir. page 399 [521b] SOCRATE. C'est-à-dire, brave Calliclès, que tu m'exhortes à les flatter. CALLICLÈS. A moins que tu ne préfères être traité comme un Mysien, Socrate ; car si tu ne prends le parti de les flatter... SOCRATE. Ne me répète point ce que tu m'as déjà dit souvent, que le premier venu me mettra à mort, si tu ne veux que je te répète à mon tour que ce sera un méchant qui fera mourir un homme de bien : ni qu'il me ravira ce que je possède, pour que je ne te dise point que, m'ayant dépouillé de mes biens, il ne saura quel usage en faire : mais que comme il me les aura ravis [521c] injustement, il en usera de même injustement; et par conséquent d'une manière contraire au beau, et par conséquent encore, au bien. CALLICLÈS. Tu me parais, Socrate, être dans la ferme confiance qu'il ne t'arrivera rien de semblable, comme si tu étais éloigné de tout danger, et qu'aucun homme, très méchant peut-être très méprisable, ne pût te traîner devant un tribunal. page 400 SOCRATE. Je serais à coup sûr un insensé, Calliclès, si je croyais que dans une ville comme Athènes il n'est personne qui ne soit exposé à toutes sortes d'accidents. Mais ce que je sais, c'est que si je parais devant un tribunal, et si j'y cours [521d] quelqu'un des périls dont tu parles, celui qui m'y citera sera un méchant homme : car jamais homme de bien n'accusera un innocent. Et il ne serait pas étonnant que je fusse condamnée mort. Veux-tu savoir pourquoi je m'y attends? CALLICLÈS. Je le veux bien. SOCRATE. Je pense que je m'applique à la véritable politique avec un très petit nombre d'Athéniens, pour ne pas dire seul, et que seul je remplis aujourd'hui les devoirs de citoyen. Et comme je ne cherche point à flatter ceux avec qui je m'entretiens chaque jour, que je vise au plus utile [521e] et non au plus agréable, et que je ne veux rien faire de toutes ces belles choses que tu me conseilles, je ne saurai que dire, lorsque je me trouverai devant les juges : et ce que je disais à Polus revient fort bien ici ; je serai jugé comme le serait un médecin accusé devant des enfants par un cuisinier. Examine en effet ce qu'un médecin au milieu de pareils page 401 juges aurait à dire pour sa défense, si on l'accusait en ces termes : Enfants, cet homme vous a fait beaucoup de mal : il vous perd vous et ceux qui sont plus jeunes que vous, et vous jette dans le désespoir, vous coupant, vous brûlant, [522a] vous amaigrissant et vous étouffant ; il vous donne des potions très amères, et vous fait mourir de faim et de soif, au lieu de vous servir, comme moi, des mets de toute espèce, en grand nombre et flatteurs au goût. Que penses-tu que dirait un médecin dans une pareille extrémité? Dirait-il ce qui est vrai? Enfants, je n'ai fait tout cela que pour vous conserver la santé. Comment crois-tu que de tels juges se récrieront à cette réponse ? de toutes leurs forces, n'est-ce pas ? CALLICLÈS. Il y a tout lieu de le croire. SOCRATE. Ce médecin donc ne se trouvera-t-il pas, à ton avis, dans le plus grand embarras sur ce [522b] qu'il doit dire? CALLICLÈS. Assurément. SOCRATE. Je sais bien que la même chose m'arriverait, si je comparaissais devant un tribunal. Je ne pourrai parler aux juges des plaisirs que je leur ai pro- page 402 curés, car voilà ce qu'Us appellent des bienfaits et des services : et je ne porte envie ni à ceux qui les procurent, ni à ceux qui les reçoivent. Si on m'accuse, ou de corrompre la jeunesse, en lui apprenant à douter, ou de parler niai des citoyens d'un âge plus avancé, en tenant sur leur compte des discours sévères, soit en particulier, soit en public, je ne pourrai pas dire la vérité, savoir, que si je parle de la sorte c'est avec justice, [522c] ayant en vue votre avantage, ô juges, et rien autre chose. Ainsi, je dois m'attendre à tout ce qu'il plaira au sort d'ordonner. CALLICLÈS. Et penses-tu, Socrate, qu'il soit beau pour un citoyen d'être dans une semblable position, qui le met hors d'état de se secourir lui-même ? SOCRATE. Oui, Calliclès, pourvu qu'il ne lui manque pas une chose que tu lui as plus d'une fois accordée; pourvu qu'il puisse se donner à lui-même ce secours, qu'il n'a aucun discours, [522d] aucune action injuste à se reprocher, ni envers les dieux, ni envers les hommes. Car nous sommes convenus souvent qu'il n'y a pas de secours meilleur. Si l'on me prouvait donc que je suis incapable de me donner ce secours à moi-même, ou à quelque autre, je rougirais d'être pris en défaut page 403 sur ce point, devant peu comme devant beaucoup de personnes, et même vis à vis de moi seul, et je serais au désespoir qu'une pareille impuissance fut cause de ma mort. Mais si je perdais la vie faute d'avoir quelque usage de la rhétorique flatteuse, je suis bien sûr que tu me verrais supporter [522e] la mort de bonne grâce. Aussi bien personne ne craint-il la mort, à moins qu'il ne soit tout-à-fait insensé et lâche. Ce qui fait peur, c'est de commettre l'injustice, puisque le plus grand des malheurs est de descendre dans l'autre monde avec une âme chargée de crimes. Je veux, si tu le trouves bon, te prouver par un récit que la chose est ainsi. CALLICLÈS. Puisque tu as achevé tout le reste, achève encore ceci. [523a] SOCRATE. Écoute donc, comme on dit, un beau récit, que tu prendras, à ce que j'imagine, pour une fable et que je crois être un récit très véritable ; je te donne pour certain ce que je vais dire. Jupiter, Neptune et Pluton partagèrent ensemble, comme Homère le rapporte (55), l'empire qu'ils tenaient des mains de leur père. Or, du temps de Saturne, il y avait sur les hommes une loi, page 404 qui a toujours subsisté et subsiste encore parmi les dieux, que celui des mortels qui avait mené une vie juste et [523b] sainte allait après sa mort dans les îles fortunées, où il jouissait d'un bonheur parfait, à l'abri de tous les maux ; qu'au contraire celui allait dans un séjour de punition et de supplice, appelé Tartare. Sous le règne de Saturne, et dans les premières années de celui de Jupiter, ces hommes étaient jugés vivants par des juges vivants, qui prononçaient sur leur sort le jour même qu'ils devaient mourir. Aussi ces jugements se rendaient-ils mal. C'est pourquoi Pluton et les gardiens des îles fortunées étant allés trouver Jupiter lui dirent qu'on lui envoyait [523c] des hommes qui ne méritaient ni les récompenses, ni les châtiments qu'on leur avait assignés. Je ferai cesser cette injustice, répondit Jupiter. Ce qui fait que les jugements se rendent mal aujourd'hui, c'est qu'on juge les hommes tout vêtus; car on les juge lorsqu'ils sont encore en vie. Plusieurs, poursuivit-il, dont l'âme est corrompue, sont revêtus de beaux corps, de noblesse et de richesses ; et lorsqu'il est question de prononcer la sentence, il se présente une foule de témoins en leur faveur, prêts à attester qu'ils ont bien vécu. [523d] Les juges se laissent éblouir par tout cela; et de plus eux-mêmes jugent vêtus, ayant devant leur âme des page 405 yeux, des oreilles, et toute la masse du corps qui les enveloppe. Cet appareil, qui les couvre eux et ceux qu'ils ont à juger, est pour eux un obstacle. Il faut commencer par ôter aux hommes la prescience de leur dernière heure ; car maintenant ils la connaissent d'avance. Aussi déjà l'ordre est donné à Prométhée [523e] qu'il change cela. En outre, je veux qu'on les juge entièrement dépouillés de ce qui les environne, et qu'à cet effet ils ne soient jugés qu'après leur mort ; il faut aussi que le juge lui-même soit nu, qu'il soit mort, et qu'il examine immédiatement avec son âme l'âme de chacun, dès qu'il sera mort, séparée de tous ses proches, et ayant laissé sur la terre l'attirail qui l'environnait, de sorte que le jugement soit équitable. J'étais instruit de ce désordre avant vous : en conséquence j'ai établi pour juges trois de mes fils, deux d'Asie, Minos et Rhadamanthe, [524a] et un d'Europe, savoir, Éaque. Lorsqu'ils seront morts, ils rendront leurs jugemens dans la prairie (56), à un endroit d'où partent deux chemins, dont un conduit aux îles fortunées, et un autre au Tartare. Rhadamanthe jugera les hommes de l'Asie, Éaque ceux de l'Europe : je donnerai à Minos l'autorité suprême page 406 pour décider en dernier ressort dans les cas où ils se trouveraient embarrassés l'un ou l'autre ; ainsi une justice parfaite dictera la sentence qui sera portée sur la route que les hommes doivent prendre. Tel est, Calliclès, le récit que j'ai entendu, et que je tiens [524b] pour véritable. En raisonnant sur ce discours, voici ce qui me paraît en résulter. La mort n'est rien, à mon avis, que la séparation de deux choses, l'âme et le corps. Au moment où elles sont séparées l'une de l'autre, chacune d'elles n'est pas beaucoup différente de ce qu'elle était du vivant de l'homme. Le corps garde son caractère, et les vestiges bien marqués des soins qu'on a pris de lui, ou des accidents [524c] qu'il a éprouvés : par exemple, si quelqu'un étant en vie avait un grand corps, qu'il le tint de la nature ou de l'éducation, ou de l'une et de l'autre, après sa mort son cadavre est grand : s'il avait de l'embonpoint, son cadavre en a aussi ; et ainsi du reste. S'il avait pris plaisir à cultiver sa chevelure, il conserve beaucoup de cheveux. Si c'était un homme à étrivières, qui de son vivant portât sur son corps les cicatrices de coups de fouet ou de toute autre blessure, on y retrouve tout cela après la mort. S'il avait quelque membre rompu ou disloqué durant sa vie, mort, [524d] ces défauts sont encore visibles. En un mot, tel page 407 qu'on s'est étudié à être pendant la vie pour ce qui concerne le corps, tel on est après sa mort, eu tout ou en grande partie, pendant un certain temps. Or, il me paraît, Calliclès, qu'il en est de même à l'égard de l'âme ; et que quand elle est dépouillée de son corps, elle garde les marques évidentes de son caractère, et des accidents que chaque âme a éprouvés, en conséquence du genre de vie qu'elle a embrassé. Lors donc que les hommes arrivent devant leur juge, par exemple ceux d'Asie [524e] devant Rhadamanthe, Rhadamanthe les faisant approcher, examine l'âme d'un chacun, sans savoir de qui elle est; et souvent ayant entre les mains le grand roi, ou quelque autre roi ou potentat, il ne découvre rien de sain en son âme ; il la voit toute cicatrisée de parjures et d'injustices [525a] par les empreintes que chaque action y a gravées : ici les détours du mensonge et de la vanité, et rien de droit, parce qu'elle a été nourrie loin de la vérité ; là les monstruosités et toute la laideur du pouvoir absolu, de la mollesse, de la licence, et du désordre. Il la voit ainsi, et de suite il l'envoie ignominieusement à la prison, où elle ne sera pas plus tôt arrivée, qu'elle éprouvera les châtiments convenables. [525b] Or quiconque subit une peine, et est châtié d'une manière raisonnable, en devient meilleur, et gagne à la punition, ou il sert d'exemple aux page 408 autres, qui, témoins des tourments qu'il souffre, en craignent autant pour eux, et s'améliorent. Mais pour gagner à la punition et satisfaire aux dieux et aux hommes, les fautes doivent être de nature à pouvoir s'expier. Toutefois, même alors, ce n'est que par les douleurs et les souffrances que l'expiation s'accomplit et profite, ici ou dans l'autre monde : car il n'est pas possible d'être délivré autrement de l'injustice. [525c] Pour ceux qui ont commis les derniers crimes, et qui pour cette raison sont incurables, on fait sur eux des exemples. Leur supplice ne leur est d'aucune utilité, parce qu'ils sont incapables de guérison ; mais il est utile aux autres, qui contemplent les tourments douloureux et effroyables qu'ils souffrent à jamais pour leurs crimes, en quelque sorte suspendus dans la prison des enfers, et servant tout à-la-fois de spectacle et d'instruction à tous les criminels qui y abordent sans cesse. [525d] Je soutiens qu'Archélaüs sera de ce nombre, si ce que Polus a dit de lui est vrai, ainsi que tout autre tyran qui lui ressemblera. Je crois même que la plupart de ceux qui sont ainsi donnés en spectacle sont des tyrans, des rois, des potentats, des politiques. Car ce sont eux qui, à cause du pouvoir dont ils sont revêtus, commettent les actions les plus injustes et les plus impies. Homère est ici pour moi. Ceux page 409 qu'il représente comme tourmentés pour toujours aux enfers (57), sont [525e] des rois et des potentats, comme Tantale, Sisyphe et Titye. Quant à Thersite et aux autres méchants qui ont vécu dans une condition privée, aucun poète ne l'a représenté souffrant les plus grands supplices comme ayant commis des crimes inexpiables, sans doute parce qu'il n'avait pas tout pouvoir; en quoi il était plus heureux que ceux qui pouvaient tout. En effet, mon cher Calliclès, c'est des [526a] puissants que viennent les plus grands criminels. Rien n'empêche pourtant qu'il ne se rencontre parmi eux des hommes vertueux, et on ne saurait assez les admirer. Car c'est une chose bien difficile, Calliclès, et digne des plus grandes louanges, de vivre longtemps dans la justice, lorsqu'on a une pleine liberté de mal faire ; et il se trouve très peu de caractères de cette trempe. Il y a eu néanmoins, et dans cette ville et ailleurs, et il y aura sans doute encore des personnages excellents en ce genre de vertu, qui consiste à administrer suivant les règles de la justice [526b] ce qui leur est confié. De ce nombre a été Aristide, fils de Lysimaque, qui s'est acquis par là tant de célébrité dans toute la Grèce (58); mais la plupart des hom- page 410 CETTE PAGE ET LA PAGE 411 MANQUENT DANS LE LIVRE. COMME VICTOR COUSIN REPREND DACIER ET GROU, JE PREND LEUR TRADUCTION. (mes au pouvoir, mon cher, deviennent méchants. Pour revenir donc à ce que je disais, lorsque quelqu'un d'eux tombe entre les mains de ce Rhadamanthe, il ne connaît nulle autre chose de lui, ni quel il est, ni quels sont ses parents, sinon qu'il est méchant ; et l'ayant connu pour tel, il le relègue au Tartare, après lui avoir mis un certain signe, selon qu'il le juge susceptible ou incapable de guérison. Arrivé au Tartare, [526c] le coupable est puni comme il mérite de l'être. D'autres fois, voyant une âme qui a vécu saintement et dans la vérité, l'âme d'un particulier, ou de quelque autre, mais surtout, comme je le pense, Calliclès, celle d'un philosophe uniquement occupé de lui-même, et qui durant sa vie a évité l'embarras des affaires, il en est ravi, et l'envoie aux îles Fortunées. Éaque en fait autant de son côté. L'un et l'autre exerce ses jugements tenant une baguette en main. Pour Minos, il est seul assis, et a inspection sur eux : il a un sceptre d'or, comme Ulysse dans Homère rapporte qu'il l'a vu, tenant un [526d] sceptre d'or, et rendant la justice aux morts. J'ajoute donc, Calliclès, une foi entière à ces discours ; et je m'étudie à paraître devant le juge avec l'âme la plus intègre. page 411 Ainsi, méprisant ce que la plupart des hommes estiment, et ne visant qu'à la vérité, je ferai mes efforts pour vivre et pour mourir, [526e] lorsque le temps en sera venu, aussi vertueux qu'il dépendra de moi. J'invite tous les autres hommes, autant que je puis, et je t'invite toi-même, à mon tour, à embrasser ce genre de vie, et à t'exercer à ce combat, le plus intéressant, à mon avis, de tous ceux d'ici-bas. Je te fais un reproche de ce que tu ne seras point en état de te secourir toi-même, lorsqu'il faudra comparaître et subir le jugement dont je parle ; de ce que, quand tu seras en présence de ton juge, [527a] le fils d'Égine, et qu'il t'aura pris et amené devant son tribunal, tu ouvriras la bouche toute grande, et perdras la tête ni plus ni moins que moi devant les juges de cette ville. Peut-être qu'alors on le frappera ignominieusement sur la joue, et que l'on te fera toutes sortes d'outrages. Tu regardes apparemment tout cela comme des contes de vieille femme et tu n'en fais nul cas. Il ne serait pas surprenant que nous n'en tinssions aucun compte, si, après bien des recherches, nous pouvions trouver quelque chose de meilleur et de plus vrai. Mais tu vois que vous trois, qui êtes les plus savants des Grecs d'aujour- page 412 d'hui, toi, Polus, [527b] et Gorgias, vous ne sauriez prouver qu'on doive mener une autre vie que celle qui nous sera utile quand nous serons là-bas ; au contraire, de tant d'opinions que nous avons discutées, toutes les autres ont été réfutées ; et la seule qui demeure inébranlable, est celle-ci, qu'on doit plutôt prendre garde de faire une injustice que d'en recevoir, et qu'avant toutes choses il faut s'appliquer, non à paraître homme de bien, mais à l'être, tant en public qu'en particulier; que si quelqu'un devient méchant en quelque point, il faut le châtier, et qu'après être juste, le second bien est de le devenir, [527c] et de subir la punition qu'on a méritée ; qu'il ne faut flatter ni soi ni les autres, qu'ils soient en petit ou en grand nombre ; et qu'on ne doit jamais ni parler ni agir qu'en vue de Injustice. Rends-toi donc à mes raisons, et suis-moi dans la route qui te conduira au bonheur et pendant ta vie et après ta mort, comme ce discours vient de le montrer. Souffre qu'on te méprise comme un insensé, qu'on t'insulte, si l'on veut, et même, par Jupiter, laisse-toi frapper volontiers [527d] de cette manière qui te paraît si outrageante ; car il ne t'en arrivera aucun mal, si tu es solidement homme de bien et dévoué à la culture de la vertu. Après que nous l'aurons ainsi cultivée en commun., alors, si nous le jugeons à page 413 propos, nous nous mêlerons de politique ; et sur quoi que nous délibérions, nous serons plus en état de délibérer que nous ne le sommes à présent. En effet, il est honteux pour nous que, dans la situation où nous paraissons être, nous nous en fassions accroire, comme si nous valions quelque chose, nous qui changeons à tout instant de sentiment sur les mêmes objets, et cela, sur ce qu'il y a [527e] de plus important : tant est grande notre ignorance. Servons-nous donc du discours qui nous éclaire aujourd'hui, comme d'un guide qui nous enseigne que le meilleur parti à prendre est de vivre et mourir dans la culture de la justice et des autres vertus. Suivons la route qu'il nous trace, engageons les autres à nous imiter, et n'écoutons pas le discours qui t'a séduit, et auquel tu m'exhortes à me rendre, car il ne vaut rien, Calliclès. FIN DU TROISIÈME VOLUME. page 414 (page blanche) page 426 NOTES SUR LE GORGIAS. J'AI eu sous les yeux l'édition générale de Bekker, les traductions de. Ficin et de Schleiermacher, et les éditions spéciales de Routh, de Heindorf et de Coray, qui ont à-peu-près résolu toutes les difficultés philologiques. — La traduction française de Grou a servi de base à la mienne. PAGE 201. — Quels animaux il peint et sur quoi. J'entends sur quelle matière, sur la toile, ou la pierre. Bekker, avec tous les manuscrits, donne πού. Ficin, qui traduit quo pacto, semble avoir lu πῶς. Heindorf propose πόσου, Coray τοῦ pour τίνος. PAGE 234. — Telles sont les différences naturelles de ces choses.... page 427 Οὕτω διέστηκεν φύσει... BEKKEH, Ile partie, t. I, p. 42. HEINDORF, 61—62. Il y a des différences graves entre les législateurs et les juges d'une part, et les sophistes et les rhéteurs de l'autre ; mais il y a aussi quelques rapports, et c'est en suivant ces rapports que les rhéteurs et les sophistes se sont si bien confondus avec les législateurs et les juges, que ni les uns ni les. autres ne se distinguent pas entre eux, ni le public non plus. Il ne s'agit pas du mélange des sophistes et des rhéteurs entre eux, mais bien de leur mélange avec les législateurs et les juges. L'ancienne leçon, σόφισται καὶ ῥήτορες ne suffit donc pas : il faudrait y ajouter καὶ δικασταὶ καὶ νεμοθέται, ou, comme Bekker, retrancher avec le manuscrit Φ σοφισταὶ καὶ ῥήτορες; éditeur, j'eusse fait comme Bekker ; traducteur, j'ai ajouté δικασταὶ καὶ νομοθέται. Le résultat est le même. PAGE. 238. — Ne viens-tu pas d'accorder.... Je retranche avec Bekker, p. 44, et Schleiermacher, τούτου πρόσθεν, comme aussi plus bas, p. 294 « selon la nature... » je retranche encore avec l'un et l'autre (Bekker p. 81) τὴν τοῦ δικαίου. page 428 PAGE 239.... — Puissance judiciaire... et s'en fait adorer.... Je lis avec Bekker (p. 3g9 contre Schleiermacher, δικαστικὴ au lieu de δικαιοσύνη, et ἄνοιαν au lieu de εὔνοιαν. PAGE. 313. — Et relativement à quoi ? Τί δέ αὐτῶν. BEKKER, p. 97. J'ai lu comme Heindorf et comme la plus grande partie des manuscrits et le Scholiaste, le sens qui résulte de cette leçon étant satisfaisant. Sans doute, les retranchements de Bekker simplifient la chose, mais ils ne m'ont pas paru indispensables, et ils ne s'appuient sur aucune autorité. PAGE 399. — A moins que tu n'aimes mieux être traité comme un Mysien. J'adopte avec Coraï, p. 361, la correction de Casaubon Μυσῶν λεία λέγεσθαιi. Schleiermacher hésite entre cette correction, qui lui paraît raisonnable, et l'autorité de l'ancien texte que maintient Bekker. On ne peut savoir comment a lu Olympiodore, qui ne cite que le commencement de la phrase et s'arrête à page 429 qui pourtant démontre qu'il n'a pas lu Μυσῶν λεία. Quant à l'expression Μυσῶν λεία, elle est assez claire. Les Mysiens étaient des lâches que tout le monde pillait et maltraitait, et dont le nom était devenu synonyme d'homme de rien. Voyez HEINDORF, p. 256. Au lieu d'insister davantage sur des détails aussi insignifiants, j'ai préféré citer quelques morceaux du commentaire inédit d'Olympiodore, qui éclairent plusieurs points importants du Gorgias. La Bibliothèque royale de Paris possède deux manuscrits de ce commentaire, l'un coté 1822, l'autre de l'ancienne bibliothèque de Saint-Germain. C'est d'après ces deux manuscrits que Routh a publié le texte de l'introduction du commentaire d'Olympiodore, le seul morceau qui en soit connu jusqu'ici. Nous en donnerons un long extrait, avec deux autres passages qui nous ont paru d'un assez grand intérêt pour l'intelligence de la mythologie de Platon, ou plutôt des Alexandrins. Olympiodore commence par défendre Platon d'une contradiction apparente. Platon, qui, dans la République, exile la tragédie et la comédie et toute espèce de drame, présente, dans ses dialogues, sa philosophie sous une forme dramatique. Olympiodore répond que si Platon eût vécu dans la République de Platon, on pourrait lui faire ce reproche; mais que, dans l'état page 430 présent des choses, il lui était permis de prêter à des discussions philosophiques l'attrait d'une forme dramatique. Il indique ensuite les points généraux qu'il veut toucher dans son introduction. Ce sont : 1° la disposition dramatique du dialogue; 2° son but; 3° sa division ; 4° les personnages et les idées qu'ils représentent; 5° une question assez futile négligée par les anciens, mais fort agitée par la plupart des commentateurs : savoir pourquoi Platon, qui ordinairement introduit dans ses dialogues des contemporains, met en scène Gorgias qui lui est très antérieur. 1° Il est fâcheux qu'Olympiodore ne nous donne pas plus de détails su ries personnages du Gorgias, à l'occasion de la disposition dramatique. Il ne dit que ce qui était parfaitement connu, savoir, que Gorgias de Léontium en Sicile était venu à Athènes, chargé d'une mission relative à la guerre contre les Syracusains, ayant avec lui le rhéteur Polus d'Agrigente. A Athènes, il logea chez l'orateur Calliclès, flatteur du peuple, envers lequel, à ce que dit Olympiodore, Calliclès descendait à de lâches complaisances. Gorgias fit plusieurs fois montre de son talent, et ravit tellement le peuple athénien, que les jours où il parlait s'appelaient des fêtes, et ses phrases des flambeaux (ἡμέρας ἐορτὰς, κῶλα λαμπάδας. Le Chéréphon dont il est ici question est celui de la page 431 comédie, où il est représenté comme tout-à-fait livré aux spéculations philosophiques. La scène se passe dans la maison de Calliclès. 2° Les commentateurs diffèrent sur le but du Gorgias; les uns disent que son but est la rhétorique, et voilà pourquoi ils intitulent ce dialogue, Gorgias, ou sur la Rhétorique : en quoi ils ont tort ; car ils caractérisent le tout par une seule de ses parties. En effet, ils n'ont pas d'autres motifs, sinon qu'avec Gorgias, Socrate parle de la rhétorique, et encore assez peu de temps. D'autres prétendent que le sujet du dialogue est la justice et l'injustice, sur ce qu'il y est dit en effet, que l'homme juste est heureux et l'homme injuste misérable, et d'autant plus misérable qu'il est plus injuste, qu'il l'est plus longtemps, et que l'immortalité dans l'injustice serait le comble de la misère, ne s'apercevant pas que ce point de vue est partiel et ne se rapporte qu'à la discussion avec Polus. D'autres enfin prétendent que le but du Gorgias est théologique, point de vue fondé seulement sur la partie mythique qui termine le Gorgias, et encore plus faux que les autres. Pour nous (59), nous disons que le but page 432 du Gorgias est de traiter des principes qui conduisent les états à la félicité, φαμὲν τοίνυν ὅτι σκοπὸς αὔτῶ περὶ τῶν ἀρχῶν διαλεχθῆναι τῶν φερουσῶν ἡμᾶς ἐπὶ τὴν πολιτικήν εὐδαιμονίαν. Il est fâcheux qu'Olympiodore, au lieu de développer cette proposition, se perde dans des subtilités scolastiques sur les principes en général; qu'il y a six principes, savoir : la matière, ὕλη; la forme, εἶδος l'agent, ποιητικὸν; le modèle, παράδειγμα; l'instrument, ὄργανον; la fin, τέλος; à l'occasion desquels arrivent des subtilités insignifiantes. 3° Le dialogue se divise en trois parties, l'une relative à Gorgias, l'autre à Polus, l'autre à Calliclès. Ici sont quelques mots intéressants sur l'ordre des dialogues de Platon. Dans l'Alclbiade, dit Olympiodore, nous apprenons que l'homme c'est l'âme, et l'âme raisonnable. Reste à régler ses vertus politiques et morales, πολιτικὰς αὐτῆς ἀρετὰς καὶ καθαρτικάς. Or, comme les vertus politiques sont d'un ordre inférieur aux autres, et doivent les précéder dans l'enseignement, il s'ensuit qu'après l'Alcibiade, le Gorgias doit venir immédiatement, puisque le Gorgias traite des vertus politiques, et après le Gorgias le Phédon, qui traite des vertus καθαρτικάς. Par καθαρτικάς, il faut entendre purifiantes, qui élèvent l'âme de la sphère de ce monde à la sphère supérieure, les vertus religieuses. 4° Quant aux idées que représentent les person- page 433 nages, Socrate représente la science; Chéréphon, l'opinion et la vraisemblance ; Gorgias, la faiblesse et la demi-corruption; Polus, l'iniquité consommée et l'orgueil; Calliclès, la volupté. Il paraît que dans l'oisiveté et la subtilité de l'école, et selon l'esprit de ce temps, on était tombé dans des questions d'une minutie extravagante sur le nombre des personnages du Gorgias, et qu'on avait institué la question de savoir pourquoi, sur cinq personnages, il y avait trois rhéteurs et deux philosophes; question à laquelle on avait répondu que le nombre des rhéteurs devait être impair, ἀδιαίρετος, et celui des philosophes, pair, διαίρετος, le nombre pair étant probablement plus accommodé à la dignité philosophique. Olympiodore réfute cette réponse assez gravement. 5° Quant à l'objection sur la différence d'âge de Gorgias et de Platon, Olympiodore répond que d'abord il n'y a rien en soi d'absurde à introduire des personnages que l'on n'a pas connus, et de les faire converser ensemble ; ensuite que Gorgias et Platon étaient réellement contemporains : car Socrate est de la 77e olympiade, 3e année; Empédocle le pythagoricien, le maître de Gorgias, est élève de Parménide, et Gorgias a écrit son livre sarant sur la nature, dans la 85e olympiade; de sorte que, d'après ce calcul, Socrate serait né vingt-huit ans, ou un peu plus, avant la publication page 434 du livre de Gorgias. D'autre part, Platon dit, dans le Théétète, que « Socrate, étant très jeune, rencontra Parménide, très âgé, et le trouva un homme très profond. » Parménide avait été maître d'Empédocle, qui avait été maître de Gorgias; Gorgias vécut très longtemps ; on dit jusqu'à cent neuf ans. Gorgias et Socrate ont donc été contemporains. Il y a sur ce passage plusieurs observations à faire. D'abord il est la preuve, ou plutôt la base, de la rectification de Corsini, qui rapporte à la troisième année de la 77e olympiade la naissance de Socrate, que jusqu'alors on rapportait à la 4e, erreur légère reproduite dans la plupart des tables chronologiques de l'histoire de la philosophie, et, par exemple, dans celle de Tennemann, tome 1er. Ensuite il devient ainsi très facile de fixer positivement la chronologie de Socrate. Né 28 ans avant la 84e olympiade, c'est-à-dire la troisième année de la 77e, on voit, par le Criton, qu'il est mort à 71 ans, c'est-à-dire, en ajoutant 71 ans à la troisième année de la 77e olympiade, à-peu-près la 95e olympiade; ce qui est en effet la date admise de sa mort. Il n'est pas moins facile de comprendre de cette, manière la contemporanéité de Socrate et de Gorgias. Parménide est la maître d'Empédocle, qui est le maître de Gorgias. Socrate peut avoir vu le premier et le dernier, à deux conditions, l'une qu'il page 435 aura vu Parménide dans une vieillesse très avancée, lui étant très jeune; l'autre, que Gorgias sera mort très tard; or ces deux conditions sont remplies par l'histoire. Nous trouvons dans ce morceau une phrase si étrange, que nous croyons devoir la rapporter textuellement : « Ὁ δὲ Ἐμπεδοκλῆς ὁ Πυθαγόρειος, ὁ διδάσκαλος Γοργίου, ἐφοίτησε παρ' αὐτῷ. Ἀμέλει καὶ γράφει ὁ Γοργίας περὶ φύσεως σύγγραμμα οὐκ ἄκομψον τῇ 84 ὀλύμπιαδι. » Ἐφοίτησε παρ' αὐτῷ, « a été disciple de Socrate », est totalement inadmissible. Routh dit à ce sujet : « Dum autem discipulum Socratis noster Empedoclem facit, nescio cujus fide nitatur. » En effet, personne ne parle d'un voyage d'Empédocle à Athènes ; puis l'expression ἐφοίτησε, qui désignerait une école positive, un enseignement spécial, ne peut s'appliquer à Socrate. Enfin, cette hypothèse est presque contre le calcul que l'auteur veut établir; car si Socrate a été le maître d'Empédocle, qui a été le maître de Gorgias, la contemporanéïté de Gorgias et de Socrate serait un peu compromise. On arrive ainsi à supposer quelque erreur de copiste dans παρ' αὐτῷ; et si l'on considère que le ἀμέλει de la phrase suivante, sans être vicieux, est insignifiant, on conçoit que la rectification peut tomber à la fois sur αὐτῷ et ἀμέλει. Nous proposons donc de lire : παρὰ τῷ Παρμενίδει, leçon à laquelle se page 436 prête l'espace matériel occupé par παρ' αὐτῷ, Ἀμέλει, et le point qui les sépare. Si elle était admise, elle éclaircirait tout le passage et la filiation que, plus tard, Olympiodore lui-même établit, lorsqu'il dit : οὗτος δὲ ὁ Παρμενίδης διδάσκαλος ἐγένετο Ἐμπεδοκλέους τοῦ διδασκάλου Γοργίου. Les deux manuscrits portent il est vrai παρ' αὐτῷ, ἀμέλει; Routh a lu ainsi; et Findeisen, qui, en réimprimant ce morceau d'Olympiodore, publié pour la première fois par Routh, n'ajoute à la première édition que des fautes graves, se garde bien de proposer ici aucune conjecture. Nous nous hasardons à proposer la nôtre, plutôt que de nous résigner à tous les inconvénients de la leçon des manuscrits. Après cette introduction, vient un commentaire régulier, divisé en articles plus ou moins longs, appelés πράξεις. Il y en a 5o, qui forment en tout, dans le manuscrit 1822, 82 feuilles. Le morceau suivant est extrait des πράξεις 29 et 30. Socrate oppose à Calliclès six arguments : trois probables (ἐκ τῶν ἐνδοξῶν), et trois plus réels et plus démonstratifs (ἐκ τῶν πραγματειωδεστέρων). Le premier argument probable est pris dans l'opinion de la plupart des hommes; le second, chez les poètes; le troisième, chez les pythagoriciens. Premier argument probable: La plupart des hommes page 437 appellent heureux celui qui n'a besoin de rien. Second argument tiré des poêles : Vivre, c'est mourir; mourir, c'est vivre. L'âme, tout en donnant la vie au corps, participe aussi, en quelque sorte, à son état de mort (ἀξωία). Le troisième, l'argument pythagoricien, est symbolique. Socrate rapporte un mythe (μυθάριον), et dit que dans cette vie nous sommes morts, et que nous avons un tombeau ; que dans l'autre vie est l'enfer (ᾅδης), et que dans l'enfer sont deux tonneaux, l'un percé, l'autre qui ne l'est pas; que ceux qui n'ont pas été initiés et purifiés (ἀμυηθέντες καὶ ἀτελεσθέντες), puisent de l'eau dans un crible, et la versent dans le tonneau percé, souffrant ainsi des maux infinis et sans remède. En effet, comment pourraient-ils transporter l'eau dans un crible? et quand ils le pourraient, le tonneau percé ne s'emplirait pas. Il ne faut pas s'arrêter à l'apparence, mais se demander ce qu'entend Platon, en disant que nous sommes morts; ce que c'est que ce tombeau, ces initiés, cet enfer, ces deux tonneaux, cette eau, ce crible. — L'homme est dit mort, lorsque l'âme participe à l'état inanimé (ἀξωία) ; le tombeau que nous portons avec nous est, comme l'explique Socrate lui-même, le corps (σῆμα - σῶμα); l'enfer (ᾅδης), c'est l'obscur, parce que nous sommes dans les ténèbres, page 438 tant que l'âme est asservie au corps, les tonneaux, ce sont les passions, parce que nous cherchons à les satisfaire, comme à remplir des tonneaux, ou parce que nous nous persuadons que nos passions sont belles (60). Le tonneau non percé appartient aux initiés (τετελεσμένοι), c'est-à-dire à ceux qui ont une connaissance parfaite (τελείαν γνῶσιν) : ceux-là ont le tonneau rempli, c'est-à-dire possèdent une vertu parfaite. Ceux qui ne sont point initiés, c'est-à-dire, ceux qui sont loin de toute perfection,ont les tonneaux percés, parce que ceux qu'asservit la passion veulent incessamment la satisfaire, et en sont de plus en plus consumés ; ils ont donc des tonneaux percés, qu'ils ne remplissent jamais. Le crible, c'est l'âme raisonnable mêlée à l'âme non raisonnable. Il faut savoir que l'âme est appelée cercle, parce qu'elle cherche et qu'elle est elle-même ce qu'elle cherche ; parce qu'elle trouve, et qu'elle est elle-même ce qu'elle trouve; au contraire, l'âme non raisonnable imite la ligne droite; elle ne revient pas sur elle-même comme le cercle; or le crible, étant circulaire, est page 439 pris pour l'âme ; et comme le fond du crible se compose de lignes droites formées par les trous dont il est percé, il se prend aussi pour l'âme non raisonnable, les intervalles des trous étant des lignes droites; donc pat le crible il entend l'âme raisonnable ayant pour base l'âme non raisonnable (ὑπερστρωμμένην τῇ ἀλόγῳ). L'eau, c'est la partie passagère de la nature ( τὸ ῥευστὸν τῆς φύσεως) ; car, comme le dit Héraclite, l'humidité est la mort de l'âme (ψυχῆς ἐστι θάνατος ἡ ὑγρασία). Socrate dit que ces mythes ne sont pas tout-à-fait absurdes : ταὐτ' ἐπιεικῶς μέν ἐστιν ὑπό τι ἄτοπα; si on les compare aux mythes des poètes. Ceux-ci sont nuisibles; les autres, au contraire, sont utiles à ceux qui pensent. Voici maintenant la fin du commentaire relative au mythe qui termine le Gorgias. Elle comprend les πράξεις 47, 48, 49 et 50. Puisque Platon raconte un mythe, cherchons 1° ce qui porta tes anciens à l'invention des mythes. 2°Quelle est la différence entre les mythes philosophiques et les mythes poétiques. 3° Quel est le but de celui qu'expose Platon. 1° Les mythes se rapportent d'un côté à la nature, de l'autre à notre âme. Le mythe est fondé sur la nature : les choses invi- page 440 sibles se concluent des choses visibles; les incorporelles des corporelles. Nous voyons les corps soumis à des lois, et nous concevons qu'une puissance incorporelle y préside; aux corps célestes nous supposons une puissance motrice; nous voyons que maintenant notre corps se meut, et ensuite, après la mort, qu'il ne se meut plus ; nous comprenons par là qu'une puissance incorporelle était la cause de ses mouvements. Ainsi nous sommes conduits par les choses visibles et corporelles aux choses invisibles et incorporelles. Or les mythes ont été inventés pour que nous allions de ce qui est apparent à ce qui est obscur. Quand on nous parle, par exemple, des adultères, de la captivité, des blessures des dieux, de la mutilation d'Uranus,etc., nous ne devons point nous arrêter à ces dehors, mais pénétrer jusqu'à la vérité qu'ils enveloppent. Les mythes se rapportent aussi à notre âme. Dans notre enfance, nous vivons selon l'imagination, et l'imagination se prend aux formes (τύποις). L'emploi des mythes est destiné à satisfaire cette faculté. Au reste, le mythe n'est autre chose qu'une fiction qui représente la vérité. Si donc le mythe est l'image de la vérité, et si l'âme est l'image de ce qui est au- dessus d'elle (πρὸ αὐτῆς) dans l'ordre des êtres, c'est avec raison que l'âme aime les mythes ; c'est l'image qui appelle l'image. page 441 2° Quelle est la différence entre les mythes philosophiques et les mythes poétiques?
Les uns et les autres sont réciproquement
inférieurs sous un rapport, et supérieurs sous un autre. Le mythe poétique est
supérieur en ce que personne ne peut s'y tromper, et qu'on est comme forcé
d'écarter l'enveloppe pour pénétrer jusqu'à la vérité qu'il contient. Son
absurdité empêche qu'on s'arrête à ce qui est apparent, et oblige à chercher la
vérité cachée. Le mythe poétique est inférieur en ce que l'homme qui ne
regarderait que l'apparence, et ne chercherait pas ce qui est caché au fond du
mythe, serait induit en erreur; le mythe poétique peut tromper une âme sans
expérience. Aussi Platon a-t-il banni Homère de sa République, à cause de cette
sorte de mythes. Les jeunes gens, dit-il, ne peuvent entendre sainement de
telles fables : car les jeunes gens ne savent point distinguer ce qui est
allégorique de ce qui ne l'est pas, et ce qu'ils ont une fois mis dans leur
mémoire est ineffaçable. Platon veut donc qu'on leur enseigne d'autres mythes.
Dans les mythes philosophiques, au contraire, même en s'arrêtant aux apparences,
l'esprit page 442 mythes consiste en ce que l'on se contente souvent de leurs dehors, parce qu'ils ne sont pas absurdes et qu'on n'en cherche pas le vrai sens. Telles sont les différences des mythes. On les emploie encore pour ne pas divulguer ce qui ne pourrait être compris. Comme dans les cérémonies religieuses on voile les instrument sacrés et les choses mystérieuses, afin de les dérober aux regards des hommes indignes; ainsi les mythes enveloppent la doctrine, afin qu'elle ne soit pas livrée au premier venu. En outre, les mythes philosophiques se rapportent aux trois puissances de l'âme. Si nous étions une pure intelligence sans imagination, l'esprit, uniquement occupé des choses intelligibles, n'aurait pas besoin de mythes. Si, au contraire, nous étions tout-à-fait privés d'intelligence, si notre vie était toute livrée à imagination, sans rien chercher au-delà (ταύτην μόνον προβολὴν ἔχοντες, les mythes suffiraient à tous nos besoins ; mais nous avons en nous l'intelligence, l'opinion, l'imagination. « Voulez-vous, dit Platon, vous conduire d'après l'intelligence ? vous avez la voie de la démonstration. D'après l'opinion? vous avez celle du témoignage. Par l'imagination ? vous avez les mythes. Ainsi tous les besoins sont satisfaits. » 3° Quel est le but du mythe du Gorgias ? Platon rapporte des mythes en plusieurs endroits : page 443 on en trouve un dans le Politique, dont le sens est que jadis, dans l'âge d'or, le mouvement des corps célestes n'était point tel qu'aujourd'hui ; celui des planètes était contraire à celui des étoiles fixes; il n'y avait ni été ni hiver. C'est, sans contredit, un mythe dont le sens est enveloppé (διὰ τούτων αἰνιττόμενος). Il y a un mythe sur l'amour dans le Banquet; il y en a un dans la République, un dans le Phédon ; un autre plus haut, dans le dialogue qui nous occupe. Enfin, en voici encore un. Tout mythe (μυθοποιία) n'est pas un traité sur l'autre vie (νεκυία); on n'appelle ainsi que les mythes qui s'occupent spécialement de l'âme. Celui du Politique n'est pas de ce genre; il parle seulement des corps célestes. Celui du Banquet n'en est pas non plus. Trois seulement se rangent sous ce titre : celui de la République, car le mythe de la République traite des âmes; celui du Phédon et celui du Gorgias. Dans le Phédon, Platon parle des lieux où se subissent les châtiments; dans la République, des âmes qui sont jugées; ici, des juges eux-mêmes. Mais, puisqu'il y a dans Platon trois traités sur l'autre vie, pourquoi lamblique, dans l'une de ses lettres, n'en cite-t-il que deux : celui du Phédon et celui de la République? Peut-être celui à qui est adressée la lettre ne l'avait-il consulté que sur ces deux derniers ; page 444 car un si grand philosophe ne pouvait ignorer celui du Gorgias. «Ἄκουε δὴ, φασὶ, μάλα καλοῦ λόγου. » Socrate, qui s'attache au fond des mythes sans s'arrêter à l'extérieur, dit que, dans sa pensée, ce récit est vrai, mais que pour Calliclès ce n'est qu'une fable. Les philosophes ne reconnaissent qu'une cause suprême de toutes choses, qui a donné naissance à toute la nature, et à laquelle ils n'ont pu imposer un nom. Mais cette cause unique ne dirige pas immédiatement les choses de ce monde ; il serait contre l'ordre que nous fussions gouvernés par la cause première elle-même. Autant la cause est supérieure à l'effet, autant l'effet est inférieur à la cause. Il faut donc que la cause première agisse sur des puissances supérieures à l'humanité, et qu'à leur tour celles-ci nous atteignent; car nous sommes le dernier degré de l'univers. Il devait en être ainsi, afin que le monde ne fût pas imparfait. Il y a donc d'autres puissances supérieures que les poètes appellent chaîne d'or, à cause de leur continuité. La puissance première est l'intelligence ; après elle vient la puissance qui donne et entretient la vie, et ensuite toutes celles qu'on désigne par des noms symboliques. Il ne faut pas se troubler de ces noms page 445 de Saturne et de Jupiter (Κρονίαν δύναμιν καὶ Διίαν, etc.) mais s'occuper du sens de ces mots. On peut ne pas croire que ces puissances aient des essences propres, et qu'elles soient distinctes les unes des autres, mais les placer dans la cause première, comme ses divers points de vue, et dire qu'il y a en elle des puissances intelligentes et vitales. Quand nous parlons de Saturne, que ce nom ne nous trouble pas, pénétrons- en le sens. Saturne (Κρόνος) est l'intelligence pure (ὁ κόρος νοῦς, ὅ ἐστιν ὁ καθαρός). Ce nom désigne donc la puissance intelligente. C'est pourquoi les poètes disent qu'il dévore ses enfants et les vomit ensuite. En effet, l'intelligence se replie sur elle-même, elle cherche (61), et elle est elle-même ce qu'elle cherche». Voilà pourquoi Saturne dévore ses enfants. Il les vomit, parce que non seulement l'intelligence conçoit et enfante, mais parce qu'elle produit (προάγει) et forme (ὠφέλει (62)). C'est ce qui fait donner à Saturne l'épithète de ἀγκυλόμητις, parce que le crochet se replie sur lui-même. Comme il n'y a rien d'irrégulier (ἄτακτον), rien de nouveau (νεώτερον) dans l'intelligence, on la représente comme un vieillard. Voilà pourquoi les astrologues disent que ceux à qui Saturne est favorable naissent sages et prudents. Jupiter est appelé Ζεὺς en tant que page 446 puissance vitale (de ζῇν), et Διὸς, parce qu'il donne (δίδωσι) la vie par lui-même. Le soleil est porté par quatre coursiers qui représentent les deux équinoxes et les deux solstices. Il est jeune à cause de la force de ses rayons. La lune est traînée par deux taureaux : ils sont deux à cause de sa croissance et de son décroissement. Ce sont des taureaux, parce que de même que les taureaux labourent la terre, de même la lune gouverne le monde terrestre. Le soleil est mâle, la lune femelle, parce qu'il appartient an mâle de donner, à la femelle de recevoir; le soleil donne la lumière, la lune la reçoit. Il ne faut point se troubler de ces récits des poètes. Platon dit que Jupiter, Neptune et Pluton se partagèrent l'empire qu'ils avaient reçu de Saturne. Il n'emploie pas un mythe poétique, mais un mythe philosophique; aussi ne dit-il pas comme les poètes, qu'ils ravirent l'empire à Saturne, mais qu'ils le partagèrent. Partage ou loi, même chose (νόμος, de νέμω). La loi, c'est le partage fait par l'intelligence. Or Saturne signifiant, comme on l'a dit, l'intelligence, de lui vient la loi. L'univers se compose de trois choses : les célestes, les terrestres et les intermédiaires, c'est-à-dire le feu, l'air, l'eau. Jupiter préside aux choses célestes, Pluton aux choses de la terre, le règne intermédiaire page 447 est soumis à Neptune. Ces noms désignent les puissances préposées à ces différentes natures. Jupiter tient un sceptre, signe de ses fonctions de juge; Neptune est armé du trident, comme présidant aux trois éléments intermédiaires; Pluton porte un casque, à cause des ténèbres de son empire. Comme le casque cache la tête, ainsi Pluton est la puissance qui préside aux choses obscures. Ne croyez pas que les philosophes adorent des pierres, des idoles, comme des divinités ; mais comme l'humanité soumise aux conditions de la sensibilité ne peut atteindre aisément à la puissance incorporelle et immatérielle, ni s'occuper sans cesse des idées, les images ont été inventées pour en éveiller ou en rappeler le souvenir; en regardant ces images naturelles, en, leur rendant hommage, nous pensons aux puissances qui échappent à nos; sens. Les poètes disent encore que, Jupiter eut de Thétis trois filles, Eunomie, Dicé, Irène. Eunomie règne dans le ciel, fixe; là le mouvement est continu et toujours le même, il n'y a point de diversité (οὐδὲν δεῄρημοίον). Dans la région des planètes habite Dicé. Là il y a distinction entre les astres, et la distinction appelle la justice distributive, qui rend à chacun ce qui lui appartient. Dans cette même région habite Irène; car il y a combat, et par conséquent la paix est nécessaire ; il y a combat entre le chaud et le froid, page 448 l'humide et le sec; mais quoiqu'il y ait combat, il y a harmonie. Voilà ce que disent les poètes. C'est pourquoi ils nous montrent Ulysse errant sur les mers par la volonté de Neptune ; ils veulent dire que la manière d'être d'Ulysse n'était ni terrestre, ni céleste, mais mitoyenne ; car Neptune préside à l'ordre intermédiaire. Ainsi, nous appelons fils de Jupiter celui qui ordonne son âme selon le ciel; fils de Pluton, celui qui vit d'une vie terrestre ; fils de Neptune, celui qui suit les lois de l'ordre intermédiaire. — Vulcain est une puissance préposée aux corps. C'est pour cela qu'il travaille avec des soufflets, ἐν φύσαις, c'est-à-dire, ἐν ταῖς φύσεσιν, avec les productions de la nature. Puisqu'il est ici question des îles fortunées, de la justice, du châtiment, de la prison, faisons connaître chacune de ces choses. Il faut savoir que les philosophes comparent la vie humaine à la mer ; comme la mer, elle est sujette au trouble, elle est féconde, amère et semée de difficultés. Les îles dominent la mer et s'élèvent au-dessus d'elle; aussi les poètes donnent le nom d'îles fortunées à cette manière d'être qui s'élève au-dessus de cette vie et de la création. Il en est de même des champs Elysées ; c'est pourquoi Hercule exécuta le dernier de ses travaux dans les régions de l'occident, c'est-à-dire qu'après avoir achevé page 449 cette vie ténébreuse et terrestre, il vécut ensuite à la lumière du jour, au sein de la vérité. « Τούτων δὲ δικασταὶ ἐπὶ Κρόνου. » Pluton se plaint à Jupiter de l'injustice des premiers jugements; Jupiter promet d'y remédier à l'avenir. Il est dans l'essence du mythe, d'établir l'antériorité et la postériorité, là où il y a toujours simultanéité. L'ordre imparfait, le mythe le suppose antérieur ; l'ordre parfait, il le donne comme ayant succédé au premier; car il faut aller de l'imparfait au parfait. Toujours les juges et ceux qu'ils jugent ont été à-la- fois nus et revêtus de corps; toujours les jugements ont été mauvais et bons ; car les mauvais jugements, ce sont ceux de cette vie, dictés par la passion ou par l'erreur; les bons jugements, ce sont ceux de l'autre vie, des juges divins, de la sagesse et de la raison : ces deux sortes de jugements ont toujours existé simultanément. Le mythe change le rapport d'infériorité et de supériorité en rapport d'antériorité et de postériorité. C'est ainsi qu'il faut entendre ces mots : autrefois on jugeait et on était jugé revêtu de corps, et maintenant on juge et l'on est jugé nu. La diversité des temps est substituée à celle du rang. Les interprètes n'ont pu parvenir à expliquer ceci, rebutés par la profondeur des expressions de Platon (ταῦτα page 450 δὲ οἱ ἐξηγτοὶ ἠδυνήθησαν ἑλεῖν διὰ βάθους χωρήσαντες τῶν πλατωνικῶν λέξεων.) Jupiter ordonne à Prométhée d'ôter à l'homme la prévision de la mort : expliquons le mythe poétique de Prométhée. Prométhée est la puissance qui préside à la descente (καθόδου) des âmes raisonnables. C'est le propre de l'âme raisonnable de savoir antérieurement (προμηθεῖσθαι) et de se connaître elle-même avant toutes choses. Le feu, c'est l'âme raisonnable elle-même; comme le feu, elle tend à s'élever et s'arrache aux choses d'ici-bas. Pourquoi dérobe-t-il le feu? Ce qui est dérobé passe du lieu qui lui est propre à un lieu étranger. L'âme raisonnable descend de sa patrie pour s'exiler sur la terre; c'est le feu dérobé. Pourquoi l'enferme-t-il dans une férule ? la férule est creuse ; c'est le corps périssable dans lequel l'âme est introduite. Pourquoi a-t-il dérobé le feu contre la volonté de Jupiter. Ici encore se retrouve le langage propre aux mythes. Prométhée et Jupiter voulaient l'un et l'autre que l'âme restât dans la région supérieure; mais comme il fallait qu'elle en descendît, le mythe conservant les caractères des personnes, montre l'être supérieur, c'est-à-dire Jupiter, comme ne voulant pas que l'âme s'abaisse. Mais l'être inférieur la force de descendre; il lui donne Pandore, ou le sexe féminin (τὸ θηλυπρεπὲς), c'est-à- dire l'âme pri- page 451 vée de raison. L'âme tombée sur la terre ne peut comme incorporelle et divine s'unir immédiatement au corps ; l'âme irraisonnable devient le lien de cette union. Elle s'appelle Pandore, parce que chacun des dieux lui fit un don; Ainsi les choses de la terre sont illuminées par le milieu des corps célestes. « Ἐγὼ μὲν οὖν πάντα ἐγνωκὼς πρότερον ἢ ἡμεῖς... » Pourquoi les trois juges sont-ils appelés fils de Jupiter? Pourquoi les uns jugent-ils les Asiatiques, l'autre les Européens ? Voici la vérité : chacun est dit symboliquement fils d'un dieu, selon sa manière d'être. Celui qui mène une vie conforme aux lois de l'intelligence, est fils de Saturne, parce qu'il agit comme un dieu. Celui qui pratique la justice est fils de Jupiter. Comme ces trois hommes (Minos, Rhadamanthe, Éaque) ont mené une vie juste, on les appelle fils de Jupiter, et le mythe suppose qu'ils jugent dans l'autre vie. Que signifie l'Asie et l'Europe? L'Asie, contrée orientale, patrie de la lumière, représente les choses célestes; l'Europe, située à l'occident et plongée dans l'ombre, représente les choses terrestres. L'Asie et l'Europe désignent, dans le mythe, la vie du ciel et la vie de la terre. Les juges siègent dans une prairie, et jugent dans vin carrefour où aboutissent trois chemins. Qu'est-ce page 452 que cette prairie? Les anciens donnent à la génération le nom de humide. On l'appelle une prairie à cause de l'humidité et de la variété. Trois chemins y aboutissent, parce que, entre les âmes qui sortent de ce lieu, les unes s'élèvent, étant dignes de monter vers les cieux ; les autres sont précipitées vers la terre ; d'autres, enfin, se rendent dans un lieu intermédiaire. On trouve plus souvent dans les mythes des philosophes que dans ceux des poètes, des démonstrations jetées au milieu du mythe, semblables à l'affabulation des fables d'Ésope. Ainsi l'on pourrait demander comment les juges, habitant toujours l'autre monde, savent ce qui se passe dans celui-ci. Platon répond que la mort n'est que la séparation de l'âme d'avec le corps. Comme le corps conserve quelque temps après la mort les traces de ce qu'il a éprouvé pendant la vie, de même l'âme porte l'empreinte de sa vie passée, c'est-à-dire, la conscience. Les juges, en voyant ces traces, apprennent quelles furent ses actions. Il emploie cette démonstration pour le mythe vulgaire. « Ἐπειδὰν οὖν ἀφίκωνται παρὰ τὸν δικαστήν... » Platon ôte au mythe son caractère poétique, en y ajoutant des démonstrations qui appartiennent proprement au mythe philosophique. Après avoir dit que les juges sont nus et que les morts gardent leur page 453 conscience, il ajoute que les rois sont juges plus sévèrement. Il cite Tantale, Sisyphe et Titye. Ce dernier est étendu sur la terre et un vautour lui ronge le foie. Le foie signifie qu'il a vécu selon la concupiscence; la terre exprime ses sentiments terrestres. Sisyphe, qui a vécu selon la faculté irascible et ambitieuse, roule une pierre, et ensuite la laisse retomber ; car l'âme mat réglée tourne toujours autour des mêmes objets; il roule une pierre, corps dur, image de la vie. Tantale est au milieu des eaux; des fruits sont suspendus au-dessus de sa tête ; il veut les cueillir, ils disparaissent : emblème de la vie dominée par l'imagination ; c'est ce qu'exprime le fruit qui s'enfuit sans cesse. Les âmes qui n'ont commis que des fautes légères, ne sont condamnées que pour peu de temps, et une fois purifiées, elles s'élèvent, non relativement au lieu, mais par rapport à leur manière d'être. Platon dit ailleurs : ἀνάγεται ἡ ψυχὴ, οὐ ποδὶ, ἀλλὰ ζωῇ. Mais les âmes coupables de grands crimes sont condamnées à toujours, n'étant jamais purifiées. Quoi donc? le châtiment ne cesse-t-il jamais? Il faut sans doute que la douleur passe sur les souillures contractées par le plaisir; mais le châtiment n'est pas éternel : mieux vaudrait dire que l'âme est périssable. Un châtiment éternel suppose une éternelle méchanceté. Alors quel est son but? il n'en a point; il est page 454 inutile, et Dieu et la nature ne font rien en vain. Qu'entend donc Platon par toujours, aie? Il y a sept sphères : celles de la lune, celle du soleil, etc. Il y a de plus celle du ciel fixe. Celle de la lune se retrouve à son état primitif plus promptement que les autres; la révolution de cette planète s'opère en trente jours. La révolution du soleil est plus lente; elle dure une année; celle de Jupiter l'est encore plus, elle s'achève en douze ans; celle de Saturne ne s'accomplit qu'en trente ans. Ainsi les astres ne se retrouvent simultanément à leur point de départ que rarement. Par exemple, Jupiter et Saturne ne se retrouvent simultanément au même point que tous les soixante ans. En effet, Jupiter revenant au même point en douze ans, et Saturne en trente ans, il est évident que pendant que Jupiter accomplit cinq fois sa révolution, Saturne achève deux fois la sienne. Or, trente multiplié par deux égale douze multiplié par cinq, égale soixante. C'est pendant de semblables périodes que les âmes subissent le châtiment. Les sept sphères finissent aussi par se retrouver dans la même situation par rapport au ciel fixe, mais seulement après plusieurs myriades d'années. Par le mot toujours, Platon entend la période de temps qu'elles emploient à cette grande révolution. Les âmes des parricides et celles des autres grands criminels sont punies à toujours, c'est-à-dire pendant toute la durée page 455 de cette période. Mais, dit-on, si un parricide mourait aujourd'hui, et que la grande révolution des sept sphères s'achevât dans six ans, ou dans six mois, ou dans six jours, ne serait-il puni que pendant cet intervalle? Non; mais si la période est de mille ans, il souffre pendant mille ans à compter du jour de sa mort. L'âme elle-même se corrige, mais peu-à-peu, et ensuite, selon son mérite propre, elle reprend de nouveau ses organes sur cette terre dans l'état où les a mis sa première vie. — On peut dire aussi que les âmes souffrent ces supplices par l'imagination, et qu'elles s'épouvantent à l'aspect des filles aux yeux sanglants, comme parle le tragique. — Sachez aussi que les âmes qui doivent être purifiées ne sont pas seulement châtiées dans l'autre monde, mais encore dans celui-ci: quelquefois même, n'ayant pas été purifiées dans le premier, elles le sont sur la terre. Le châtiment les améliore et les rend plus susceptibles de purification. Car, au fond, rien ne purifie l'âme, si ce n'est la reconnaissance intérieure de ses fautes, reconnaissance qui ne s'accomplit que par la vertu. Et celle-ci n'a reçu son nom (ἀρετὴ), que parce qu'elle doit être embrassée (αἱρετὴ) pour elle-même. Ce n'est donc pas le châtiment qui purifie l'âme, mais son amendement; de même que le médecin ne peut seul opérer la guérison, si le malade ne suit le régime qu'il lui page 456 prescrit. L'âme, en arrivant sur la terre, oublie les châtiments de l'autre monde ; car si elle conservait toujours ses souvenirs, elle ne pourrait pécher. Or, l'oubli lui a été donné pour son bien, car autrement elle pratiquerait la vertu sans désintéressement et sans liberté. — L'âme est donc châtiée, même dans ce monde ; mais elle paraît surtout se purifier dans l'autre, car la vie incorporelle, dont elle jouit alors, est plus propre à sa nature. « Ῥάβδον ἔχων. » La baguette signifie la marche droite et égale de la justice. « Χρυσοῦν σκῆπρον. » Le sceptre, signe d'égalité; il est d'or, c'est-à-dire, immatériel, car l'égalité est immatérielle, dégagée de tout intérêt. L'or désigne ce qui est immatériel, parce que seul, de tous les corps, il est incorruptible. page 457
TABLE DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE TOME
TROISIÈME. (01) Φαμὲν τοίνυν ὅτι σκοπὸς αὐτῳ περὶ τῶν ἀρχῶν διαλεχθῆναι τῶν φερουσῶν ἡμᾶς ἐπὶ τὴν πολιτικὴν εὐδαμονίαν. OLYMPIOD. introduction. Voyez le Gorgias de Ronth, p. 565. (02) Il parait que tout ce préambule se passe devant la maison de Calliclès, qui cause un moment avec Socrate et Chéréphon avant de les introduire et de les présenter à Gorgias. C'est là l'opinion d'Olympiodore, du Scholiaste, de Heindorf, et de tous les critiques, excepté Schleiermacher, qui place le lieu de la scène sur une place publique, ou peut-être au Lycée. Mais, dans ce cas, il y aurait quelque allusion directe on indirecte. Il ne faut pas oublier non plus que c'était surtout dans des maisons particulières que parlait Gorgias, étranger et chargé d'une mission diplomatique. Platon le dit expressément dans le grand Hippias. Schleiermacher trouve qu'il serait assez peu poli à Calliclès de laisser là ses hôtes Gorgias et Polus, pour venir causer avec Socrate : mais rien de plus naturel que d'aller au-devant de gens qui vous font visite, et qu'on va recevoir à l'entrée de sa maison. C'est l'affaire de quelques minutes, un simple échange de compliments. La plus forte objection de Schleiermacher est tirée de cette phrase de Calliclès, quand vous voudrez venir chez moi, qui ne suppose guère en effet que le lieu de la conversation est la maison ou la porte de Calliclès ; car on n'invite pas les gens à venir où ils sont. Mais à la réflexion, on trouve que chez lui ou près de chez lui Calliclès peut très bien parler ainsi, et dire à Socrate et à Chéréphon, qu'il n'ose pour cette fois engager Gorgias à se répéter, mais que Gorgias loge dans sa maison, et qu'ils sont avertis une fois pour toutes que, quand ils voudront y venir, c'est-à-dire y revenir, ils y entendront Gorgias. Cela est si vrai, que Socrate répond à Calliclès., je ne veux aujourd'hui que lui dire un mot sur son art ; pour le reste, il en fera, comme tu dis, l'exposition une autre fois. (03) Il ne faut pas confondre cet Hérodicus, médecin, de Léontium, avec l'Hérodicus de Sélymbric, dont il est question dans le Protagoras, p. 26, et dans la République, l. III. (04) Polygnote, statuaire, et surtout peintre fameux. PLINE, Hist. Natur. XXXV, 35. (05) Il y a, dans cette tirade de Polus, une symétrie de tours et de désinences qu'il n'a pas toujours été possible de bien rendre. On conjecture, d'après ce passage et un autre du même dialogue, et l'endroit d'Aristote, Métaphysique, l, I, que ce sont les propres termes de Polus, tirés d'un de ses ouvrages. (06) HOM. Iliad. liv. VI, v. 211. — Et aussi liv. I, v. 91 ; liv. II, v. 82 ; liv. IV, v. 264. (07) Toute sa force. Il y a dans le texte κύρωσις, qui appartient au dialecte sicilien, tandis que plus bas Socrate se sert du mot attique κῦρος. Cette nuance échappe à la traduction. (08) Le scholiaste : Dans les assemblées pour la discussion des lois, l'huissier nomme d'abord le nom du votant, celui de son père et de son dème, lorsqu'il vote pour la première fois par exemple : Démosthène, fils de Démosthène, de Paeanée, vote ainsi. Si le même votant veut ajouter quelque chose, l'huissier, pour être court, dit : Un tel, pour tout le reste comme auparavant ; il ajoute ceci ... (09) Simonide, ou Épicharme, selon le Scholiaste. Voyez BRUNCK, Annal. I, 122. (10) Sur quelle matière, la toile ou la pierre. (11) Τῶν ἔνδον ὄντων. Expression qui prouve bien que cette conversation a lieu dans la maison et non suc la place publique. (12) A la mort de Périclès Socrate avait 40 ans. (13) Hérodicus. (14) Il est aisé de reconnaître ici le ton du maître de la maison. Les assistants dont parle Chéréphon sont des invités de Calliclès, arrivés avant Chéréphon et Socrate, et qui ont déjà entendu Gorgias. (15) Voyez la note de l'Apologie, t.1, p. 73. (16) Moitié de vers d'Anaxagore. Voyez le Phédon, tome I, page 218. (17) Le sophiste Polus affectait d'employer des mots d'un nombre égal de syllabes, et qui se terminaient de même, comme on voit par le discours que Platon lui prête au commencement du Gorgias. Socrate, en imitant sa façon de parler, l'appelle ici ὦ λῴσε Πῶλε : raillerie qu'il n'a pas été possible de faire passer dans la traduction. (18) Pour dire récemment. Voyez le second Alcibiade, t. V, p. 151. (19) Voyez la Vie de Nicias, par Plutarque. (20) THUCYDIDE, liv. VIII, 89. (21) Discussion qui se retrouve dans l'Euthyphron, t.1, p. 32. (22) Il y a ici un jeu de mots. Le fils de Pyrilampe se nommait Δῆμος, comme le peuple d'Athènes. Voy. Aristophane, les Guêpes, v. 98. (23) Le chien Anubis. (24) Voyez les Fragments de Pindare de Schneider, p. 108. (25) Vers de l'Antiope d'Euripide. WALKENAER. Diatrib. in Euripidis Reliquias, p. 76. (26) HOMÈRE, Iliade, IX, 441. (27) Voyez Walkenaer, pour le rétablissement du texte d'Euripide et l'arrangement des vers. (28) Dème de la tribu Eantide. (29) Dème de la tribu Acamantide. (30) L'un tire ces vers de Phryxus, l'autre de Polyide, drames d'Euripide. Walkenaer ne dit rien de ces fragments. (31) Quel est ce sage? SEXTUS ( liv. III, 24 ) cite une pareille pensée d'Héraclite. CLÉMENT d'Axandrie ( Stromat. III, V, p. 434 ) la cite du même Héraclite et de Pythagore, et rapporte cet endroit du Gorgias. ROUTH cite un passage de Théodoret ( Affect. curat. p. 544 ), où cette pensée est attribuée à Philolaüs.(32) Le Scholiaste : Peut-être Empédocle, qui était pythagoricien. (33) Πίθος; signifie un tonneau, πιθανὸς, qui est facile à persuader ; jeu de mots qu'on ne saurait rendre en notre langue. (34) Ἀμυήτους, profanes, non initiés, et en même temps qui ne peuvent rien garder, rimosi. Jeu de mot intraduisible. (35) Ἅδης est en effet formé d'αἐιδής;, invisible. Voyez le Phédon, et le Cratyle. (36) Χαραδριός. Voyez le Scholiaste et Timée, la note de Coray et celle de Schleiermacher. Ne connaissant pas le nom français du χαραδρόις j'ai substitué, comme Schleiermacher, celui de l'oiseau qui passe pour se remplir vite, et digérer vite. (37) Dème de la tribu Oeneide. (38) Dème de la tribu Antiochide. (39) Le Scholiaste : Les petits mystères se célébraient à Athènes; les grands à Éleusis, et on ne pouvait être admis à ces derniers qu'après avoir passé par les premiers. (40) Scholiaste : Platon rejetait absolument la flûte ; mais pour la lyre, il ne la bannissait que des jeux publics. (41) Le Scholiaste d'Aristophane le dit Thébain. Grenouilles, v. 153. — Plutarque (sur la musique) l'appelle le maudit Athénien. Ses mœurs, suivant Suidas, étaient fort décriées. Voyez aussi ce qu'en dit Harpocration. (42) Ce passage prouve qu'à cette époque les femmes et les esclaves n'étaient pas exclus des représentations scéniques. (43) ATHÉN. Deipnos. VII, ed. Schweigh. III, p. 128, cite ce vers dans une occasion semblable. — Le Scholiaste suppose qu'il s'agit d'un drame d'Épicharme, où, sur la fin, un acteur se charge de deux rôles. (44) Ceci se rapporte à une scène de l'Antiope d'Euripide qui ne nous a pas été conservée. (45) Εὖ καὶ καλῶς πράττειν (voyez le Premier Alcibiade et le Charmide) signifie à-la-fois bien agir et être heureux. Socrate fit préférer, dans son école, cette formule de salut à celles de χαίρειν, se réjouir, ὑγιαίνειν, se bien porter. (46) Le Scholiaste : Les Pythagoriciens, et particulièrement Empédocle. (47) Κόσμος signifie également ordre et univers. (48) Sur l'égalité géométrique, voyez les Lois, VI. (49) Elles finissaient, disait-on, par perdre les yeux et les pieds. (50) Ὁ δήμου ἔρως. Même équivoque que ci-dessus, le peuple s'appelait δῆμος, comme le fils île Pyrilampe. (51) Voyez Plutarque, Vie de Périclès, et UIpien, ad Demosth. Orat. — Aristote dit aussi que Périclès solda les juges. Polit. liv. II. (52) C'est-à-dire, qui laconisent, comme on l'a vu dans le Protagoras, p. 82, et qui sont par conséquent ennemis du gouvernement d'Athènes. (53) C'est le sens plutôt que les expressions de quelques passages d'Homère, tels que l'Odyssée, liv. VI, v. 120. (54) L'histoire ne dit rien de cette circonstance. — Le premier prytane avait le droit d'annuler un jugement déjà prononcé. (55) HOM. Iliad., liv. XV, v. 187. (56) Voyez la République, liv. X, et l'Axiochus, où cette prairie est appelée le Champ de la Vérité. (57) HOM. Odyss., liv. XI, v. 581, sqq. (58) Quand les Grecs se préparèrent à faire les frais d'une... (59) Le Scholiaste semble se ranger à l'opinion d'Olympiodore. Car aussitôt que commence la discussion avec Gorgias, il dit : Ἀρχή τις αὕτη τῶν ἐν τῷ διαλόγῳ προκειμένων τοῦ πρώτου μέρους, ὅ ἐστι τὸ περὶ τῆς ποιητικῆς αἰτίας τῶν ἠθικῶν ἀρχῶν. On voit presque partout que le Scholiaste a puisé dans le commentaire d'Olympiodore. (60) Ceci prouve bien qu'il s'agit de vases et non de tonneaux comme les nôtres, qui serviraient ma] de symbole à la beauté de la passion. Πίθος signifie proprement une cruche, une jarre, une espèce de vase large qui pouvait être travaillé avec plus ou moins d'art. Mais les deux tonneaux sont devenus chez nous, par le vice d'une première traduction, un des meubles convenus de l'enfer mythologique, tel que nous l'avons fait. (61) Elle est, en langage moderne, l'identité du sujet et de l'objet. (62) Non seulement elle est substance, mais elle est cause. |