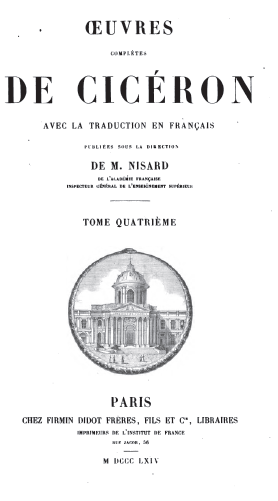|
LIBER TERTIUS
1. P. Scipionem, M. fili, eum, qui primus
Africanus appellatus est, dicere solitum scripsit Cato, qui fuit eius fere
aequalis, numquam se minus otiosum esse, quam cum otiosus, nec minus solum, quam
cum solus esset. Magnifica vero vox et magno viro ac sapiente digna; quae
declarat illum et in otio de negotiis cogitare et in solitudine secum loqui
solitum, ut neque cessaret umquam et interdum colloquio alterius non egeret. Ita
duae res, quae languorem afferunt ceteris, illum acuebant, otium et solitudo.
Vellem nobis hoc idem vere dicere liceret; sed si minus imitatione tantam
ingenii praestantiam consequi possumus, voluntate certe proxime accedirnus; nam
et a re publica forensibusque negotiis
armis impiis vique prohibiti otium persequimur et ob eam causam urbe relicta
rura peragrantes saepe soli sumus. Sed nec hoc otium cum Africani otio nec
haec solitudo cum illa comparanda est. Ille enim requiescens a rei publicae
pulcherrimis muneribus otium sibi sumebat aliquando et e coetu hominum
frequentiaque interdum tamquam in portum se in solitudinem recipiebat,
nostrum autem otium negotii inopia, non requiescendi studio constitutum est.
Exstincto enim senatu deletisque iudiciis quid est quod dignum nobis aut in
curia aut in foro agere possimus? Ita, qui in maxima celebritate atque in
oculis civium quondam vixerimus, nunc fugientes conspectum sceleratorum, quibus
omnia redundant, abdimus nos, quantum licet, et saepe soli sumus. Sed quia sic
ab hominibus doctis accepimus, non solum ex malis eligere minima oportere, sed
etiam excerpere ex his ipsis, si quid inesset boni, propterea et otio fruor, non
illo quidem, quo debebat is, qui quondam peperisset otium civitati, nec eam
solitudinem languere patior, quam mihi affert necessitas, non voluntas.
Quamquam Africanus maiorem laudem meo iudicio assequebatur. Nulla enim eius
ingenii monumenta mandata litteris, nullum opus otii, nullum solitudinis munus
exstat; ex quo intellegi debet illum mentis agitatione investigationeque earum
rerum, quas cogitando consequebatur, nec otiosum nec solum umquam fuisse; nos
autem, qui non tantum roboris habemus, ut cogitatione tacita a solitudine
abstrahamur, ad hanc scribendi operam omne studium curamque convertimus. Itaque
plura brevi tempore eversa quam multis annis stante re publica scripsimus.
2. Sed cum tota philosophia, mi Cicero,
frugifera et fructuosa nec ulla pars eius inculta ac deserta sit, turn nullus
feracior in ea locus est nec uberior quam de officiis, a quibus constanter
honesteque vivendi praecepta ducuntur. Quare, quamquam a Cratippo nostro,
principe huius memoriae philosophorum, haec te assidue audire atque accipere
confido, tamen conducere arbitror talibus aures tuas vocibus undique
circumsonare, nec eas, si fieri possit, quicquam aliud audire. Quod cum
omnibus est faciendum, qui vitam honestam ingredi cogitant, turn haud scio an
nemini potius quam tibi; sustines enim non parvam exspectationem imitandae
industriae nostrae, magnam honorum, non nullam fortasse nominis. Suscepisti onus
praeterea grave et Athenarum et Cratippi; ad quos cum tamquam ad mercaturam
bonarum artium sis profectus, inanem redire turpissimum est dedecorantem et
urbis auctoritatem et magistri. Quare, quantum coniti animo potes, quantum
labore contendere, si discendi labor est potius quam voluptas, tantum fac ut
efficias neve committas, ut, cum omnia suppeditata sint a nobis, tute tibi
defuisse videare. Sed haec hactenus; multa enim saepe ad te cohortandi
gratia scripsimus; nune ad reliquam partem propositae divisionis revertamur.
Panaetius igitur, qui sine controversia de officiis accuratissime disputavit,
quemque nos correctione quadam adhibita potissimum secuti sumus, tribus
generibus propositis, in quibus deliberare homines et consultare de officio
solerent, uno, cum dubitarent, honestumne id esset, de quo ageretur, an turpe,
altero, utilene esset an inutile, tertio, si id, quod speciem haberet honesti,
pugnaret cum eo, quod utile videretur, quo modo ea discerni oporteret, de duobus
generibus primis tribus libris explicavit, de tertio autem genere deinceps se
scripsit dicturum nec exsolvit id, quod promiserat. Quod eo magis miror,
quia scriptum a discipulo eius Posidonio est triginta annis vixisse Panaetium,
posteaquam illos libros edidisset. Quen locum miror a Posidonio breviter esse
tactum in quibusdam commentariis, praesertim cum scribat nullum esse locum in
tota philosophia tam necessarium. Minime vero assentior iis, qui negant
eum locum a Panaetio praetermissum, sed consulto relictum, nec omnino scribendum
fuisse, quia numquam posset utilitas cum honestate pugnare. De quo alterum
potest habere dubitationem, adhibendumne fuerit hoc genus, quod in divisione
Panaeti tertium est, an plane omittendum, alterum dubitari non potest, quin
a Panaetio susceptum sit, sed relictum. Nam qui e divisione tripertita duas
partes absolverit, huic necesse est restare tertiam; praeterea in extremo libro
tertio de hac parte pollicetur se deinceps esse dicturum. Accedit eodem
testis locuples Posidonius, qui etiam scribit in quadarn epistula
P. Rutilium Rufum dicere solere,
qui Panaetium audierat, ut nemo pictor esset inventus, qui in Coa Venere earn
partem, quam Apelles inchoatam reliquisset, absolveret (oris enim pulchritudo
reliqui corporis imitandi spem auferebat), sic ea, quae Panaetius
praetermisisset [et non perfecisset] propter eorum, quae perfecisset,
praestantiam neminem persecutum.
3. Quam ob rem de iudicio Panaeti dubitari
non potest; rectene autem hanc tertiam partem ad exquirendum officium adiunxerit
an secus, de eo fortasse disputari potest. Nam, sive honestum solum bonum est,
ut Stoicis placet, sive, quod honestum est, id ita summum bonum est, quem ad
modum Peripateticis vestris videtur, ut omnia ex altera parte collocata vix
minimi momenti instar habeant, dubitandum non est, quin numquam possit utilitas
cum honestate contendere. Itaque accepimus Socratem exsecrari solitum eos, qui
primum haec natura cohaerentia opinione distraxissent. Cui quidem ita sunt
Stoici assensi, ut et, quicquid honestum esset, id utile esse censerent
nec utile quicquam, quod non honestum. Quodsi is esset Panaetius, qui
virtutem propterea colendam diceret, quod ea efficiens utilitatis esset, ut ii,
qui res expetendas vel voluptate vel indolentia metiuntur, liceret ei dicere
utilitatem aliquando cum honestate pugnare; sed cum sit is, qui id solum bonum
iudicet, quod honestum sit, quae autem huic repugnent specie quadam utilitatis,
eorum neque accessione meliorem vitam fieri nec decessione peiorem, non videtur
debuisse eius modi deliberationem introducere, in qua, quod utile videretur, cum
eo, quod honestum est, compararetur. Etenim quod summum bonum a Stoicis
dicitur, convenienter naturae vivere, id habet hanc, ut opinor, sententiam: cum
virtute congruere semper, cetera autem, quae secundum naturam essent, ita
legere, si ea virtuti non repugnarent. Quod cum ita sit, putant quidam hanc
comparationem non recte introductam, nec omnino de eo genere quicquam
praecipiendum fuisse. Atque illud quidem honestum, quod proprie vereque dicitur,
id in sapientibus est solis neque a virtute divelli umquam potest; in iis autem,
in quibus sapientia perfecta non est, ipsum illud quidem perfectum honestum
nullo modo, similitudines honesti esse possunt. Haec enim officia, de
quibus his libris disputamus, media Stoici appellant; ea communia sunt et late
patent; quae et ingenii bonitate multi assequuntur et progressione
discendi. Illud autem officium, quod rectum idem appellant, perfectum atque
absolutum est et, ut idem dicunt, omnes numeros habet nec praeter sapientem
cadere in quemquam potest. Cum autem aliquid actum est, in quo media
officia compareant, id cumulate videtur esse perfectum, propterea quod volgus
quid absit a perfecto, non fere intellegit; quatenus autem intellegit, nihil
putat praetermissum; quod idem in poematis, in picturis usu venit in aliisque
compluribus, ut delectentur imperiti laudentque ea, quae laudanda non sint, ob
eam, credo, causam, quod insit in iis aliquid probi, quod capiat ignaros, qui
quidem, quid in una quaque re vitii sit, nequeant iudicare; itaque, cum sunt
docti a peritis, desistunt facile sententia.
4. Haec igitur officia, de quibus his libris
disserimus, quasi secunda quaedam honesta esse dicunt, non sapientium modo
propria, sed cum omni hominum genere communia. Itaque iis omnes, in quibus
est virtutis indoles, commoventur. Nec vero, cum duo Decii aut duo Scipiones
fortes viri commemorantur, aut cum Fabricius [aut Aristides] iustus nominatur,
aut ab illis fortitudinis aut ab hoc iustitiae tamquam a sapiente petitur
exemplum; nemo enim horum sic sapiens, ut sapientem volumus intellegi, nec
ii, qui sapientes habiti et nominati, M. Cato et C. Laelius, sapientes fuerunt,
ne illi quidem septem, sed ex mediorum officiorum frequentia similitudinem
quandam gerebant speciemque sapientium. Quocirca nec id, quod vere
honestum est, fas est cum utilitatis repugnantia comparari, nec id, quod
communiter appellamus honestum, quod colitur ab iis, qui bonos se viros haberi
volunt, cum emolumentis umquam est comparandum, tamque id honestum, quod in
nostram intellegentiam cadit, tuendum conservandumque nobis est quam illud, quod
proprie dicitur vereque est honestum, sapientibus; aliter enim teneri non
potest, si qua ad virtutem est facta progressio. Sed haec quidem de iis, qui
conservatione officiorum existimantur boni. Qui autem omnia metiuntur
emolumentis et commodis neque ea volunt praeponderari honestate, ii solent in
deliberando honestum cum eo, quod utile putant, comparare, boni viri non solent.
Itaque existimo Panaetium, cum dixerit homines solere in hac comparatione
dubitare, hoc ipsum sensisse, quod dixerit, “solere” modo, non etiam “oportere.”
Etenim non modo pluris putare, quod utile videatur, quam quod honestum
sit, sed etiam haec inter se comparare et in his addubitare turpissimum est.
Quid ergo est, quod non numquam dubitationem afferre soleat considerandumque
videatur? Credo, si quando dubitatio accidit, quale sit id, de quo consideretur.
Saepe enim tempore fit, ut, quod turpe plerumque haberi soleat, inveniatur non
esse turpe; exempli causa ponatur aliquid, quod pateat latius: Quod potest maius
esse scelus quam non modo hominem, sed etiam familiarem hominem occidere? Num
igitur se astrinxit scelere, si qui tyrannum occidit quamvis familiarem? Populo
quidem Romano non videtur, qui ex
omnibus praeclaris factis illud pulcherrimum existimat. Vicit ergo utilitas
honestatem? Immo vero honestas utilitatem secuta est. Itaque, ut sine ullo
errore diiudicare possimus, si quando cum illo, quod honestum intellegimus,
pugnare id videbitur, quod appellamus utile, formula quaedam constituenda est;
quam si sequemur in comparatione rerum, ab officio numquam recedemus. Erit
autem haec formula Stoicorum rationi disciplinaeque maxime consentanea; quam
quidem his libris propterea sequimur, quod, quamquam et a veteribus Academicis
et a Peripateticis vestris, qui quondam idem erant, qui Academici, quae honesta
sunt, anteponuntur iis, quae videntur utilia, tamen splendidius haec ab
eis disseruntur, quibus, quicquid honestum est, idem utile videtur nec utile
quicquam, quod non honestum, quam ab iis, quibus et honestum aliquid non utile
et utile non honestum. Nobis autem nostra Academia magnam licentiam dat, ut,
quodcumque maxime probabile occurrat, id nostro iure liceat defendere. Sed redeo
ad formulam.
5. Detrahere igitur alteri aliquid et
hominem hominis incommodo suum commodum augere magis est contra naturam quam
mors, quam paupertas, quam dolor, quam cetera, quae possunt aut corpori accidere
aut rebus externis. Nam principio tollit convictum humanum et societatem. Si
enim sic erimus affecti, ut propter suum quisque emolumentum spoliet aut violet
alterum, disrumpi necesse est, eam quae maxime est secundum naturam, humani
generis societatem. Ut, si unum quodque membrum sensum hunc haberet, ut
posse putaret se valere, si proximi membri valetudinem ad se traduxisset,
debilitari et interire totum corpus necesse esset, sic, si unus quisque nostrum
ad se rapiat commoda aliorum detrahatque, quod cuique possit, emolumenti sui
gratia, societas hominum et communitas evertatur necesse est. Nam sibi ut
quisque malit, quod ad usum vitae pertineat, quam alteri acquirere, concessum
est non repugnante natura, illud natura non patitur, ut aliorum spoliis
nostras facultates, copias, opes augeamus. Neque vero hoc solum natura, id
est iure gentium, sed etiam legibus populorum, quibus in singulis civitatibus
res publica continetur, eodem modo constitutum est, ut non liceat sui commodi
causa nocere alteri; hoc enim spectant leges, hoc volunt, incolumem esse civium
coniunctionem; quam qui dirimunt, eos morte, exsilio, vinclis, damno coërcent.
Atque hoc multo magis efficit ipsa naturae ratio, quae est lex divina et humana;
cui parere qui velit (omnes autem parebunt, qui secundum naturam volent vivere),
numquam committet, ut alienum appetat et id, quod alteri detraxerit, sibi
adsumat. Etenim multo magis est secundum naturam excelsitas animi et
magnitudo itemque comitas, iustitia, liberalitas quam voluptas, quam vita, quam
divitiae; quae quidem contemnere et pro nihilo ducere comparantem cum utilitate
communi magni animi et excelsi est. [Detrahere autem de altero sui commodi causa
magis est contra naturam quam mors, quam dolor, quam cetera generis eiusdem.]
Itemque magis est secundum naturam pro omnibus gentibus, si fieri possit,
conservandis aut iuvandis maximos labores molestiasque suscipere imitantem
Herculem illum, quem hominum fama beneficiorum memor in concilio caelestium
collocavit, quam vivere in solitudine non modo sine ullis molestiis, sed
etiam in maximis voluptatibus abundantem omnibus copiis, ut excellas etiam
pulchritudine et viribus. Quocirca optimo quisque et splendidissimo ingenio
longe illam vitam huic anteponit. Ex quo efficitur hominem naturae oboedientem
homini nocere non posse. Deinde, qui alterum violat, ut ipse aliquid
commodi consequatur, aut nihil existimat se facere contra naturam aut magis
fugiendam censet mortem, paupertatem, dolorem, amissionem etiam liberorum,
propinquorum, amicorum quam facere cuiquam iniuriam. Si nihil existimat contra
naturam fieri hominibus violandis, quid cum eo disseras, qui omnino hominem ex
homine tollat? sin fugiendum id quidem censet, sed multo illa peiora, mortem,
paupertatem, dolorem, errat in eo, quod ullum aut corporis aut fortunae vitium
vitiis animi gravius existimat.
6. Ergo unum debet esse omnibus propositum, ut
eadem sit utilitas unius cuiusque et universorum; quam si ad se quisque rapiet,
dissolvetur omnis humana consortio. Atque etiam, si hoc natura
praescribit, ut homo homini, quicumque sit, ob eam ipsam causam, quod is
homo sit, consultum velit, necesse est secundum eandem naturam omnium utilitatem
esse communem. Quod si ita est, una continemur omnes et eadem lege naturae,
idque ipsum si ita est, certe violare alterum naturae lege prohibemur. Verum
autem primum; verum igitur extremum. Nam illud quidem absurdum est, quod
quidam dicunt, parenti se aut fratri nihil detracturos sui commodi causa, aliam
rationem esse civium reliquorum. Hi sibi nihil iuris, nullam societatem communis
utilitatis causa statuunt esse cum civibus, quae sententia omnem societatem
distrahit civitatis. Qui autem civium rationem dicunt habendam, externorum
negant, ii dirimunt communem humani generis societatem; qua sublata
beneficentia, liberalitas, bonitas, iustitia funditus tollitur; quae qui
tollunt, etiam adversus deos immortales impii iudicandi sunt. Ab iis enim
constitutam inter homines societatem evertunt, cuius societatis artissimum
vinculum est magis arbitrari esse contra naturam hominem homini detrahere sui
commodi causa quam omnia incommoda subire vel externa vel corporis . . . vel
etiam ipsius animi, quae vacent iustitia; haec enim una virtus omnium est domina
et regina virtutum. Forsitan quispiam dixerit: Nonne igitur sapiens,
si fame ipse conficiatur, abstulerit cibum alteri homini ad nullam rem utili?
[Minime vero; non enim mihi est vita mea utilior quam animi talis affectio,
neminem ut violem commodi mei gratia.] Quid? si Phalarim, crudelem tyrannum et
immanem, vir bonus, ne ipse frigore conficiatur, vestitu spoliare possit, nonne
faciat? Haec ad iudicandum sunt facillima. Nam, si quid ab homine ad
nullam partem utili utilitatis tuae causa detraxeris, inhumane feceris contraque
naturae legem; sin autem is tu sis, qui multam utilitatem rei publicae atque
hominum societati, si in vita remaneas, afferre possis, si quid ob eam causam
alteri detraxeris, non sit reprehendendum. Sin autem id non sit eius modi, suum
cuique incommodum ferendum est potius quam de alterius commodis detrahendum. Non
igitur magis est contra naturam morbus aut egestas aut quid eius modi quam
detractio atque appetitio alieni, sed communis utilitatis derelictio contra
naturam est; est enim iniusta. Itaque lex ipsa naturae, quae utilitatem
hominum conservat et continet, decernet profecto, ut ab homine inerti atque
inutili ad sapientem, bonum, fortem virum transferantur res ad vivendum
necessariae, qui si occiderit, multum de communi utilitate detraxerit, modo hoc
ita faciat, ut ne ipse de se bene existimans seseque diligens hanc causam habeat
ad iniuriam. Ita semper officio fungetur utilitati consulens hominum et
ei, quam saepe commemoro, humanae societati. Nam quod ad Phalarim attinet,
perfacile iudicium est. Nulla est enim societas nobis cum tyrannis, et potius
summa distractio est, neque est contra naturam spoliare eum, si possis, quem est
honestum necare, atque hoc omne genus pestiferum atque impium ex hominum
communitate exterminandum est. Etenim, ut membra quaedam amputantur, si et ipsa
sanguine et tamquam spiritu carere coeperunt et nocent reliquis partibus
corporis, sic ista in figura hominis feritas et immanitas beluae a communi
tamquam humanitatis corpore segreganda est. Huius generis quaestiones sunt omnes
eae, in quibus ex tempore officium exquiritur.
7. Eius modi igitur credo res Panaetium
persecuturum fuisse, nisi aliqui casus aut occupatio eius consilium peremisset.
Ad quas ipsas consultationes superioribus libris satis multa praecepta sunt, ex
quibus perspici possit, quid sit propter turpitudinen fugiendum, quid sit, quod
idcirco fugiendum non sit, quod omnino turpe non sit. Sed quoniam operi
inchoato, prope tamen absoluto tamquam fastigium imponimus, ut geometrae solent
non omnia docere, sed postulare, ut quaedam sibi concedantur, quo facilius, quae
volunt, explicent, sic ego a te postulo, mi Cicero, ut mihi concedas, si
potes, nihil praeter id, quod honestum sit, propter se esse expetendum.
Sin hoc non licet per Cratippum,
at illud certe dabis, quod honestum sit, id esse maxime propter se expetendum.
Mihi utrumvis satis est et turn hoc, tum illud probabilius videtur nec praeterea
quicquam probabile. Ac primum in hoc Panaetius defendendus est, quod non
utilia cum honestis pugnare aliquando posse dixerit (neque enim ei fas erat),
sed ea, quae viderentur utilia. Nihil vero utile, quod non idem honestum, nihil
honestum, quod non idem utile sit, saepe testatur negatque ullam pestem maiorem
in vitam hominum invasisse quam eorum opinionem, qui ista distraxerint. Itaque,
non ut aliquando anteponeremus utilia honestis, sed ut ea sine errore
diiudicaremus, si quando incidissent, induxit earn, quae videretur esse, non
quae esset, repugnantiam. Hanc igitur partem relictam explebimus nullis
adminiculis, sed, ut dicitur, Marte nostro. Neque enim quicquam est de hac parte
post Panaetium explicatum, quod quidem mihi probaretur, de iis, quae in manus
meas venerunt.
8. Cum igitur aliqua species utilitatis
obiecta est, commoveri necesse est; sed si, cum animum attenderis, turpitudinem
videas adiunctam ei rei, quae speciem utilitatis attulerit, turn non utilitas
relinquenda est, sed intellegendum, ubi turpitude sit, ibi utilitatem esse non
posse. Quodsi nihil est tam contra naturam quam turpitudo (recta enim et
convenientia et constantia natura desiderat aspernaturque contraria) nihilque
tam secundum naturam quam utilitas, certe in eadem re utilitas et turpitudo esse
non potest. Itemque, si ad honestatem nati sumus eaque aut sola expetenda est,
ut Zenoni visum est, aut certe omni pondere gravior habenda quam reliqua omnia,
quod Aristoteli placet, necesse est, quod honestum sit, id esse aut solum aut
summum bonum; quod autem bonum, id certe utile; ita, quicquid honestum, id
utile. Quare error hominum non proborum, cum aliquid, quod utile visum
est, arripuit, id continuo secernit ab honesto. Hinc sicae, hinc venena, hinc
falsa testamenta nascuntur, hinc furta, peculatus, expilationes dir-ptionesque
sociorum et civium, hinc opum nimiarum, potentiae non ferendae, postremo etiam
in liberis civitatibus regnandi exsistunt cupiditates, quibus nihil nec taetrius
nec foedius excogitari potest. Emolumenta enim rerum fallacibus iudiciis
vident, poenam non dico legum, quam saepe perrumpunt, sed ipsius turpitudinis,
quae acerbissima est, non vident. Quam ob rem hoc quidem deliberantium
genus pellatur e medio (est enim totum sceleratum et impium), qui deliberant,
utrum id sequantur, quod honestum esse videant, an se scientes scelere
contaminent; in ipsa enim dubitatione facinus inest, etiamsi ad id non
pervenerint. Ergo ea deliberanda omnlino non sunt, in quibus est turpis ipsa
deliberatio. Atque etiam ex omni deliberatione celandi et occultandi spes
opinioque removenda est. Satis enim nobis, si modo in philosophia aliquid
profecimus, persuasum esse debet, si omnes deos hominesque celare possimus,
nihil tamen avare, nihil iniuste, nihil libidinose, nihil incontinenter esse
faciendum.
9. Hinc ille
Gyges inducitur a Platone, qui,
cum terra discessisset magnis quibusdam imbribus, descendit in illum hiatum
aeneumque equum, ut ferunt fabulae, animadvertit, cuius in lateribus fores
essent; quibus apertis corpus hominis mortui vidit magnitudine invisitata
anulumque aureum in digito; quem ut detraxit, ipse induit (erat autem regius
pastor), tum in concilium se pastorum recepit. Ibi cum palam eius anuli ad
palmam converterat, a nullo videbatur, ipse autem omnia videbat; idem rursus
videbatur, cum in locum anulum inverterat. Itaque hac opportunitate anuli usus
reginae stuprum intulit eaque adiutrice regem dominum interemit, sustulit, quos
obstare arbitrabatur, nec in his eum facinoribus quisquam potuit videre. Sic
repente anuli beneficio rex exortus est Lydiae. Hunc igitur ipsum anulum si
habeat sapiens, nihilo plus sibi licere putet peccare, quam si non haberet;
honesta enim bonis viris, non occulta quaeruntur. Atque hoc loco
philosoplis quidam, minime mali illi quidem, sed non satis acuti, fictam et
commenticiam fabulam prolatam dicunt a Platone; quasi vero ille aut factum id
esse aut fieri potuisse defendat! Ilaec est vis huius anuli et huius exempli: si
nemo sciturus, nemo ne suspicaturus quidemn sit, curn aliquid divitiarum,
potentiae, dominationis, libidinis causa feceris, si id dis hominibusque futurum
sit semper ignotuml, sisne facturus. Negant id fieri posse. Nequaquam potest id
quidem; sed quaero, quod negant posse, id si posset, quidnam facerent. Urguent
rustice sane; negant enim posse et in eo perstant; hoc verbum quid valeat, non
vident. Cum enim quaerimus, si celare possint, quid facturi sint, non quaerimus,
possintne celare, sed tamquam tormenta quaedam adhibemus, ut, si responderint se
impunitate proposita facturos, quod expediat, facinorosos se esse fateantur, si
negent, omnia turpia per se ipsa fugienda esse concedant. Sed iam ad propositum
revertamur.
10. Incidunt multae saepe causae, quae
conturbent animos utilitatis specie, non cum hoc deliberetur, relinquendane sit
honestas propter utilitatis magnitudinem (nam id quidem improbum est), sed
illud, possitne id, quod utile videatur, fieri non turpiter. Cum Collatino
collegae Brutus imperium abrogabat, poterat videri facere id iniuste; fuerat
enim in regibus expellendis socius Bruti consiliorum et adiutor. Cum autem
consilium hoc principes cepissent, cognationem Superbi nomenque Tarquiniorum et
memoriam regni esse tollendam, quod erat utile, patriae consulere, id erat ita
honestum, ut etiam ipsi Collatino placere deberet. Itaque utilitas valuit
propter honestatem, sine qua ne utilitas quidem esse potuisset. At in eo rege,
qui urbem condidit, non item; species enim utilitatis animum pepulit eius;
cui cum visum esset utilius solum quam cum altero regnare, fratrem interemit.
Omisit hic et pietatem et humanitatem, ut id, quod utile videbatur neque erat,
assequi posset, et tamen muri
causamopposuit, speciem honestatis nec probabilem nec sane idoneam. Peccavit
igitur, pace vel Quirini vel Romuli dixerim. Nec tamen nostrae nobis
utilitates omittendae sunt aliisque tradendae, cum iis ipsi egeamus, sed suae
cuique utilitati, quod sine alterius iniuria fiat, serviendum est. Scite
Chrysippus, ut multa: “Qui stadium,” inquit, “currit, eniti et contendere debet,
quam maxime possit, ut vincat, supplantare eum, quicum certet, aut manu
depellere nullo modo debet; sic in vita sibi quemque petere, quod pertineat ad
usum, non iniquum est, alteri deripere ius non est.” Maxime autem
perturbantur officia in amicitiis, quibus et non tribuere, quod recte possis, et
tribuere, quod non sit aequum, contra officium est. Sed huius generis totius
breve et non difficile praeceptum est. Quae enim videntur utilia, honores,
divitiae, voluptates, cetera generis eiusdem, haec amicitiae numquam anteponenda
sunt. At neque contra rem publicam neque contra ius iurandum ac fidem amici
causa vir bonus faciet, ne si iudex quidem erit de ipso amico; ponit enim
personam amici, cum induit iudicis. Tantum dabit amicitiae, ut veram amici
causam esse malit, ut orandae litis tempus, quoad per leges liceat, accommodet.
Cum vero iurato sententia dicenda
erit, meminerit deum se adhibere testem, id est, ut ego arbitror, mentem suam,
qua nihil homini dedit deus ipse divinius. Itaque praeclarum a maioribus
accepimus morem rogandi iudicis, si eum teneremus, quae salva fide facere
possit. Haec rogatio ad ea pertinet, quae paulo ante dixi honeste amico a iudice
posse concedi; nam si omnia facienda sint, quae amici velint, non amicitiae
tales, sed coniurationes putandae sint. Loquor autem de communibus
amicitiis; nam in sapientibus viris perfectisque nihil potest esse tale. Damonem
et Phintiam Pythagoreos ferunt hoc animo inter se fuisse, ut, cum eorum alteri
Dionysius tyrannus diem necis destinavisset et is, qui morti addictus esset,
paucos sibi dies commendandorum suorum causa postulavisset, vas factus sit alter
eius sistendi, ut, si ille non revertisset, moriendum esset ipsi. Qui cum ad
diem se recepisset, admiratus eorum fidem tyrannus petivit, ut se ad amicitiam
tertium ascriberent. Cum igitur id, quod utile videtur in amicitia, cum
eo, quod honestum est, comparatur, iaceat utilitatis species, valeat
honestas; cum autem in amicitia, quae honesta non sunt, postulabuntur, religio
et fides anteponatur amicitiae. Sic habebitur is, quem exquirimus, dilectus
officii.
11. Sed utilitatis specie in re publica saepissime
peccatur, ut in Corinthi disturbatione nostri; durius etiam Athenienses, qui
sciverunt, ut Aeginetis, qui classe valebant, pollices praeciderentur. Hoc visum
est utile; nimis enim imminebat propter propinquitatem Aegina Piraeo. Sed nihil,
quod crudele, utile; est enim hominum naturae, quam sequi debemus, maxime
inimica crudelitas. Male etiam, qui peregrinos urbibus uti prohibent
eosque exterminant, ut Pennus apud
patres nostros, Papius nuper. Nam esse pro cive, qui civis non sit, rectum
est non licere; quam legem tulerunt sapientissimi consules Crassus et Scaevola;
usu vero urbis prohibere peregrinos sane inhumanum est. Illa praeclara, in
quibus publicae utilitatis species prae honestate contemnitur. Plena exemplorum
est nostra res publica cum saepe, tum maxime bello Punico secundo; quae
Cannensi calamitate accepta maiores animos habuit quam umquam rebus secundis;
nulla timoris significatio, nulla mentio pacis. Tanta vis est honesti, ut
speciem utilitatis obscuret. Athenienses cum Persarum impetum nullo modo
possent sustinere statuerentque, ut urbe relicta coniugibus et liberis Troezene
depositis naves conscenderent libertatemque Graeciae classe defenderent,
Cyrsilum quendam suadenterm ut in urbe manerent Xerxemque reciperent, lapidibus
obruerunt. Atqui ille utilitatem sequi videbatur; sed ea nulla erat repugnante
honestate. Themistocles post victoriam eius belli, quod cum Persis fuit,
dixit in contione se habere consilium rei publicae salutare, sed id sciri non
opus ese; postulavit, ut aliquem populus daret, quicum communicaret; datus est
Aristides; huic ille, classem Lacedaemoniorum,
quae subducta esset ad Gytheum,
clam incendi posse, quo facto frangi Lacedaemoniorum opes necesse esset. Quod
Aristides cum audisset, in contionem magna exspectatione venit dixitque perutile
esse consilium, quod Themistocles afferret, sed minime honestum. Itaque
Athenienses, quod honestum non esset, id ne utile quidem putaverunt totamque ear
rem, quam ne audierant quidem, auctore Aristide repudiaverunt. Melius hi
quam nos, qui piratas immunes,
socios vectigales habemus.
12. Maneat ergo, quod turpe sit, id numquam esse
utile, ne tur quidem, cum id, quod esse utile putes, adipiscare; hoc enim ipsum,
utile putare, quod turpe sit, calamitosum est. Sed incidunt, ut supra
dixi, saepe causae, cum repugnare utilitas honestati videatur, ut
animadvertendum sit, repugnetne plane an possit cum honestate coniungi. Eius
generis hae sunt quaestiones: si exempli gratia vir bonus Alexandrea Rhodum
magnum frumenti nurerum advexerit in Rhodiorum inopia et fame summaque annonae
caritate, si idem sciat complures mercatores Alexandrea solvisse navesque in
cursu frumento onustas petentes Rhodum viderit, dicturusne sit id Rhodiis an
silentio suum quam plurimo venditurus. Sapientem et bonum virum fingimus; de
eius deliberatione et consultatione quaerimus, qui celaturus Rhodios non sit, si
id turpe iudicet, sed dubitet, an turpe non sit. In huius modi causis
aliud Diogeni Babylonio videri solet, magno et gravi Stoico,
aliud Antipatro, discipulo eius,
homini acutissimo. Antipatro omnia patefacienda, ut ne quid om-nino, quod
venditor norit, emptor ignoret, Diogeni venditorem, quatenus iure civili
constitutum sit, dicere vitia oportere, cetera sine insidiis agere et, quoniam
vendat, velle quam optime vendere. “Advexi, exposui, vendo meum non pluris quain
ceteri, fortasse etiam minoris, cum maior est copia. Cui fit iniuria?”
Exoritur Antipatri ratio ex altera parte: “Quid ais? tu cum horninibus consulere
debeas et servire humanae societati eaque lege natus sis et ea habeas principia
naturae, quibus parere et quae sequi debeas, ut utilitas tua communis sit
utilitas vicissimque communis utilitas tua sit, celabis homines, quid iis adsit
commoditatis et copiae?” Respondebit Diogenes fortasse sic: “Aliud est celare,
aliud tacere; neque ego nune te celo, si tibi non dico, quae natura deorum sit,
qui sit finis bonorum, quae tibi plus prodessent cognita quam tritici vilitas;
sed non, quicquid tibi audire utile est, idern mihi dicere necesse est.”
“Immo vero,” inquiet ille, “necesse est, siquidem [2] meministi esse inter
homines natura coniunctam societatem.” “Memini,” inquiet ille; “sed num ista
societas talis est, ut nihil suum cuiusque sit? Quod si ila est, ne vendendum
quidem quicquam est, sed donandum.”
13. Vides in hac tota disceptatione non illud
dici: “Quamvis hoc turpe sit, tamen, quoniam expedit, faciam,” sed ita expedire,
ut turpe non sit, ex altera autem parte, ea re, quia turpe sit, non esse
faciendum.
Vendat aedes vir bonus propter aliqua vitia, quae ipse norit, ceteri
ignorent, pestilentes sint et habeantur salubres, ignoretur in omnibus cubiculis
apparere serpentes, male materiatae sint, ruinosae, sed hoc praeter dominum nemo
sciat; quaero, si haec emptoribus venditor non dixerit aedesque vendiderit
pluris multo, quam se venditurun putarit, num id iniuste aut improbe fecerit.
“Ille vero,” inquit Antipater; “quid est enim aliud erranti viam non monstrare,
quod Athenis exsecrationibus publicis
sanctum est, si hoc non est, emptorem pati ruere et per errorem in maximam
fraudem incurrere? Plus etiam est quam viam non monstrare; nam est
scientem in errorem alterum inducere.” Diogenes contra: “Num te emere coegit,
qui ne hortatus quidem est? Ille, quod non placebat, proscripsit, tu, quod
placebat, emisti. Quodsi, qui proscribunt
villam bonam beneque aedificatam, non existimantur fefellisse, etiamsi
illa nec bona est nec aedificata ratione, multo minus, qui domum non laudarunt.
Ubi enim iudicium emptoris est, ibi fraus venditoris quae potest esse? Sin autem
dictum non omne praestandum est, quod dictum non est, id praestandum putas? Quid
vero est stultius quam venditorem eius rei, quam vendat, vitia narrare? quid
autem tam absurdum, quam si domini iussu ita praeco praedicet: 'Domum
pestilentem vendo'?” Sic ergo in quibusdam causis dubiis ex altera
parte defenditur honestas, ex altera ita de utilitate dicitur, ut id, quod utile
videatur, non modo facere honestum sit, sed etiam non facere turpe. Haec est
illa, quae videtur utilium fieri cum honestis saepe dissensio. Quae diiudicanda
sunt; non enim, ut quaereremus, exposuimus, sed ut explicaremus. Non
igitur videtur nec frumentarius ille Rhodios nec hic aedium venditor celare
emptores debuisse. Neque enim id est celare, quicquid reticeas, sed cum, quod tu
scias, id ignorare emolumenti tui causa velis eos, quorum intersit id
scire. Hoc autem celandi genus quale sit et cuius hominis, quis non videt? Certe
non aperti, non simplicis, non ingenui, non iusti, non viri boni, versuti
potius, obscuri, astuti, fallacis, malitiosi, callidi, veteratoris, vafri. Haec
tot et alia plura nonne inutile est vitiorum subire nomina?
14. Quodsi vituperandi, qui reticuerunt,
quid de iis existimandum est, qui orationis vanitatem adhibuerunt? C. Canius,
eques Romanus, nec infacetus et satis litteratus, cum se Syracusas otiandi, ut
ipse dicere solebat, non negotiandi causa contulisset, dictitabat se hortulos
aliquos emere velle, quo invitare amicos et ubi se oblectare sine
interpellatoribus posset. Quod cum percrebruisset, Pythius ei quidam, qui
argentariam faceret Syracusis, venales quidem se hortos non habere, sed licere
uti Canio, si vellet, ut suis, et simul ad cenam hominem in hortos invitavit in
posterum diem. Cum ille promisisset, turn Pythius, qui esset ut argentarius apud
omnes ordines gratiosus, piscatores ad se convocavit et ab iis petivit, ut ante
suos hortulos postridie piscarentur, dixitque, quid eos facere vellet. Ad cenam
tempori venit Canius; opipare a Pythio apparatum convivium, cumbarum ante oculos
multitudo; pro se quisque, quod ceperat, afferebat, ante pedes Pythi
pisces abiciebantur. Tum Canius: “Quaeso,” inquit, “quid est hoc, Pythi?
tantumne piscium? tantumne cumbarum?” Et ille: “Quid mirum?” inquit, “hoc loco
est Syracusis quicquid est piscium, hic aquatio, hac villa isti carere non
possunt.” Incensus Canius cupiditate contendit a Pythio, ut venderet; gravate
ille primo; quid multa? impetrat. Emit homo cupidus et locuples tanti, quanti
Pythius voluit, et emit instructos; nomina facit, negotium conficit. Invitat
Canius postridie familiares suos, venit ipse mature; scalmum nullum videt,
quaerit ex proximo vicino, num feriae quaedam piscatorum essent, quod eos nullos
videret. “Nullae, quod sciam,” inquit; “sed hic piscari nulli solent; itaque
heri mirabar, quid accidisset.” Stomachari Canius; sed quid faceret?
nondum enim C. Aquilius, collega et
familiaris meus, protulerat de dolo malo formulas; in quibus ipsis, cum ex
eo quaereretur, quid esset dolus malus, respondebat: cum esset aliud simulatum,
aliud actum. Hoc quidem sane luculente ut ab homine perito definiendi. Ergo et
Pythius et omnes aliud agentes, aliud simulantes perfidi, improbi,
malitiosi. Nullum igitur eorum factum potest utile esse, cum sit tot vitiis
inquinatum.
15. Quodsi Aquiliana definitio vera est, ex
omni vita simulatio dissimulatioque tollenda est. Ita, nec ut emat melius nec ut
vendat, quicquam simulabit aut dissimulabit vir bonus. Atque iste dolus malus et
legibus erat vindicatus, ut tutela duodecim tabulis,
circumscriptio adulescentium lege
Plaetoria, et sine lege iudiciis, in quibus additur “EX FIDE BONA”.
Reliquorum autem iudiciorum haec verba maxime excellunt: in arbitrio rei uxoriae
“MELIUS AEQUIUS”, in fiducia “UT INTER BONOS BENE AGIER.” Quid ergo? aut in eo,
QUOD “MELIUS AEQUIUS”, potest ulla pars inesse fraudis? aut, cum dicitur “INTER
BONOS BENE AGIER”, quicquam agi dolose aut malitiose potest? Dolus autem malus
in simulatione, ut ait Aquilius, continetur. Tollendum est igitur ex rebus
contrahendis omne mendacium; non illicitatorem venditor, non, qui contra se
liceatur, emptor apponet; uterque, si ad eloquendum venerit, non plus quam semel
eloquetur. Q. quidem Scaevola P. f., cum postulasset, ut sibi fundus,
cuius emptor erat, semel indicaretur idque venditor ita fecisset, dixit se
pluris aestimare; addidit centum milia. Nemo est, qui hoc viri boni fuisse
neget, sapientis negant, ut si minoris, quam potuisset, vendidisset. Haec igitur
est illa pernicies, quod alios bonos, alios sapientes existimant. Ex quo Ennius
“nequiquam sapere sapientem, qui ipse sibi prodesse non quiret.” Vere id quidem,
si, quid esset “prodesse,” mihi cum Ennio conveniret. Hecatonem quidem
Rhodium, discipulum Panaeti, video in iis libris, quos de officio scripsit Q.
Tuberoni, dicere “sapientis esse nihil contra mores, leges, instituta facientem
habere rationem rei familiaris. Neque enim solum nobis divites esse volumus, sed
liberis, propinquis, amicis maximeque rei publicae. Singulorum enim facultates
et copiae divitiae sunt civitatis.” Huic Scaevolae factum, de quo paulo ante
dixi, placere nullo modo potest; etenim omnino tantum se negat facturum
compendii sui causa, quod non liceat. Huic nec laus magna tribuenda nec gratia
est. Sed, sive et simulatio et dissimulatio dolus malus est, perpaucae res
sunt, in quibus non dolus malus iste versetur, sive vir bonus est is, qui
prodest, quibus potest, nocet nemini, certe istum virum bonum non facile
reperimus. Numquam igitur est utile peccare, quia semper est turpe, et, quia
semper est honestum virum bonum esse, semper est utile.
16. Ac de iure quidem praediorum sanctum
apud nos est iure civili, ut in iis vendendis vitia dicerentur, quae nota essent
venditori. Nam, cum ex duodecim tabulis satis esset ea praestari, quae essent
lingua nuncupata, quae qui infitiatus esset, dupli poenam subiret, a iuris
consultis etiam reticentiae poena est constituta; quicquid enim esset in praedio
vitii, id statuerunt, si venditor sciret, nisi nominatim dictum esset, praestari
oportere. Ut, cum in arce augurium augures acturi essent iussissentque Ti.
Claudium Centumalum, qui aedes in Caelio monte habebat, demoliri ea, quorum
altitudo officeret auspiciis, Claudius proscripsit insulam [vendidit], emit P.
Calpurnius Lanarius. Huic ab auguribus illud idem denuntiatum est. Itaque
Calpurnius cum demolitus esset cognossetque Claudium aedes postea proscripsisse,
quam esset ab auguribus demoliri iussus, arbitrum ilium adegit, “QUICQUID
SIBI DARE” “FACERE OPORTERET EX FIDE BONA. M.” Cato sententiam dixit, huius
nostri Catonis pater (ut enim ceteri ex patribus, sic hic, qui illud lumen
progenuit, ex filio est nominandus)—is igitur iudex ita pronuntiavit: “cum in
vendendo rem eam scisset et non pronuntiasset, emptori damnum praestari
oportere.” Ergo ad fidem bonam statuit pertinere notum esse emptori
vitium, quod nosset venditor. Quod si recte iudicavit, non recte frumentarius
ille, non recte aedium pestilentium venditor tacuit. Sed huius modi reticentiae
iure civili conlprehendi non possunt; quae autem possunt, diligenter tenentur.
M. Marius Gratidianus, propinquus noster, C. Sergio Oratae vendiderat aedes eas,
quas ab eodem ipse paucis ante annis emerat. Eae serviebant, sed hoc in mancipio
Marius non dixerat. Adducta res in iudicium est. Oratam Crassus, Gratidianum
defendebat Antonius. Ius Crassus urguebat, “quod vitii venditor non dixisset
sciens, id oportere praestari,“aequitatem Antonius,” quoniam id vitium
ignotum Sergio non fuisset, qui illas aedes vendidisset, nihil fuisse necesse
dici, nec eum esse deceptum, qui, id, quod emerat, quo iure esset, teneret.”
Quorsus haec? Ut illud intellegas, non placuisse maioribus nostris astutos.
17. Sed aliter leges, aliter philosophi tollunt
astutias, leges, quatenus manu tenere possunt, philosophi, quatenus ratione et
intellegentia. Ratio ergo hoc postulat, ne quid insidiose, ne quid simulate, ne
quid fallaciter. Suntne igitur insidiae tendere plagas, etiarnsi excitaturus non
sis nec agitaturus? ipsae enim ferae nullo insequente saepe incidunt. Sic tu
aedes proscribas, tabulam tamquam plagam ponas, [domum propter vitia vendas,] in
ear aliquis incurrat imprudens? Hoc quamquam video propter depravationem
consuetudinis neque more turpe haberi neque aut lege sanciri aut iure civili,
tamen naturae lege sanctum est. Societas est enim (quod etsi saepe dictum est,
dicendum est tamen saepius), latissime quidem quae pateat, omnium inter omnes,
interior eorum, qui eiusdem gentis sint, propior eorum, qui eiusdem civitatis.
Itaque maiores aliud ius gentium, aliud ius civile esse voluerunt; quod civile,
non idem continuo gentium, quod autem gentium, idem civile esse debet. Sed
nos veri iuris germanaeque iustitiae solidam et expressam effigiem nullam
tenemus, umbra et imaginibus utimur. Eas ipsas utinam sequeremur! feruntur enim
ex optimis naturae et veritatis exemplis. Nam quanti verba illa: “UTI NE
PROPTER TE FIDEMVE TUAM CAPTUS FRAUDATUSVE SIM!” quam illa aurea: “UT INTER
BONOS BENE AGIER OPORTET ET SINE FRAUDATIONE!” Sed, qui sint “boni,” et quid sit
“bene agi,” magna quaestio est. Q. quidem Scaevola, pontifex maximus, summam vim
esse dicebat in omnibus iis arbitriis, in quibus adderetur EX FIDE BONA,
fideique bonae nomen existimabat manare latissime, idque versari in tutelis
societatibus, fiduciis mandatis, rebus emptis venditis, conductis locatis,
quibus vitae societas contineretur; in iis magni esse iudicis statuere,
praesertim cum in plerisque essent iudicia contraria, quid quemque cuique
praestare oporteret. Quocirca astutiae tollendae sunt eaque malitia, quae
volt illa quidem videri se esse prudentiam, sed abest ab ea distatque plurimum.
Prudentia est enim locata in dilectu bonorum et malorum, malitia, si omnia, quae
turpia sunt, mala sunt, mala bonis ponit ante. Nec vero in praediis solum
ius civile ductum a natura malitiam fraudemque vindicat, sed etiam in
mancipiorum venditione venditoris fraus omnis excluditur. Qui enim scire debuit
de sanitate, de fuga, de furtis,
praestat edicto aedilium. Heredum
alia causa est. Ex quo intellegitur, quoniam iuris natura fons sit,
hoc secundum naturam esse, neminem id agere, ut ex alterius praedetur inscitia.
Nec ulla pernicies vitae maior inveniri potest quam in malitia simulatio
intellegentiae; ex quo ista innumerabilia nascuntur, ut utilia cum honestis
pugnare videantur. Quotus enirn quisque reperietur, qui impunitate et
ignoratione omnium proposita abstinere possit iniuria?
18. Periclitemur, si placet, et in iis
quidem exemplis, in quibus peccari volgus hominum fortasse non putet. Neque enim
de sicariis, veneficis, testamentariis, furibus, peculatoribus hoc loco
disserendum est, qui non verbis sunt et disputatione philosophorum, sed vinclis
et carcere fatigandi, sed haec consideremus, quae faciunt ii, qui habentur boni.
L. Minuci Basili, locupletis hominis, falsum testamentum quidam e Graecia Romamn
attulerunt. Quod quo facilius optinerent, scripserunt heredes secum M.
Crassum et Q. Hortensium, homines eiusdem aetatis potentissimos; qui cum illud
falsum esse suspicarentur, sibi autem nullius essent conscii culpae, alieni
facinoris munusculum non repudiaverunt. Quid ergo? satin est hoc, ut non
deliquisse videantur? Mihi quidem non videtur, quamquam alterum vivum amavi,
alterum non odi mortuum; sed, cum Basilus M. Satrium, sororis filium,
nomen suum ferre voluisset eumque fecisset heredem (hunc dico patronum agri
Piceni et Sabini; o turpem notam temporum [nomen illorum]!), non erat aequum
principes civis rem habere, ad Satrium nihil praeter nomen pervenire. Etenim, si
is, qui non defendit iniuriam neque propulsat, cum potest, iniuste facit, ut in
primo libro disserui, qualis habendus est is, qui non modo non repellit, set
etiam adiuvat iniuriam? Mihi quidem etiam verae hereditates non honestae
videntur, si sunt malitiosis blanditiis, officiorum non veritate, sed
simulatione quaesitae. Atqui in talibus rebus aliud utile interdum, aliud
honestum videri solet. Falso; nam eadem utilitatis, quae honestatis, est
regula. Qui hoc non perviderit, ab hoc nulla fraus aberit, nullum facinus.
Sic enim cogitans: “Est istuc quidem honestum, verum hoc expedit,” res a natura
copulatas audebit errore divellere, qui fons est fraudium, maleficiorum,
scelerum omnium.
19. Itaque, si vir bonus habeat hanc vim, ut, si
digitis concrepuerit, possit in locupletium testamenta nomen eius inrepere, hac
vi non utatur, ne si exploratum quidem habeat id omnino neminem umquam
suspicaturum. At dares hanc vim M. Crasso, ut digitorum percussione heres posset
scriptus esse, qui re vera non esset heres, in foro, mihi crede, saltaret. Homo
autem iustus isque, quem sentimus virum bonum, nihil cuiquam, quod in se
transferat, detrahet. Hoc qui admiratur, is se, quid sit vir bonus, nescire
fateatur. At vero, si qui voluerit animi sui complicatam notionem
evolvere, iam se ipse doceat cum virum bonum esse, qui prosit, quibus possit,
noceat nemini nisi lacessitus iniuria. Quid ergo? hic non noceat, qui quodam
quasi veneno perficiat, ut veros heredes moveat, in eorum locum ipse succedat?
“Non igitur faciat,” dixerit quis, “quod utile sit, quod expediat?” Immo
intellegat nihil nec expedire nec utile esse, quod sit iniustum; hoc qui
non didicerit, bonus vir esse non poterit. C. Fimbriam consularem audiebam
de patre nostro puer iudicem M. Lutatio Pinthiae fuisse, equiti Romano sane
honesto, cum is sponsionem fecisset. “NI VIR BONUS ESSET.” Itaque ei dixisse
Fimbriam se illam rem numquam iudicaturum, ne aut spoliaret fama probatum
hominem, si contra iudicavisset, aut statuisse videretur virum bonurn esse
aliquem, cum ea res innumerabilibus officiis et laudibus contineretur. Huic
igitur viro bono, quem Fimbria etiam, non modo Socrates noverat, nullo modo
videri potest quicquam esse utile, quod non honestum sit. Itaque talis vir non
modo facere, sed ne cogitare quidem quicquam audebit, quod non audeat
praedicare. Haec non turpe est dubitare philosophos, quae ne rustici quidem
dubitent? a quibus natum est id, quod iam contritum est vetustate, proverbium.
Cum enim fidem alicuius bonitatemque laudant, dignum esse dicunt, “quicum
in tenebris mices.” Hoc quam habet vim nisi illam, nihil expedire, quod
non deceat, etiamsi id possis nullo refellente optinere? Videsne hoc
proverbio neque Gygi illi posse veniam dari neque huic, quem paulo ante fingebam
digitorum percussione hereditates omnium posse converrere? Ut enim, quod turpe
est, id, quamvis occultetur, tamen honestum fieri nullo modo potest, sic, quod
honestum non est, id utile ut sit, effici non potest adversante et repugnante
natura.
20. At enim, cum permagna praemia sunt, est
causa peccandi. C. Marius cum a spe consulatus longe abesset et iam septimum
annum post praeturam iaceret, neque petiturus umquam consulatum videretur, Q.
Metellum, cuius legatus erat, summum virum et civem, cum ab eo, imperatore suo,
Romam missus esset, apud populum Romanum criminatus est bellum illum ducere; si
se consulem fecissent, brevi tempore aut vivum aut mortuum Iugurtham se in
potestatem populi Romani redacturum. Itaque factus est ille quidem consul, sed a
fide iustitiaque discessit, qui optimum et gravissimum civem, cuius legatus et a
quo missus esset, in invidiam falso crimine adduxerit. Ne noster quidem
Gratidianus officio viri boni functus est tum, cum praetor esset
collegiumque praetorium tribuni plebi adhibuissent, ut res nummaria de communi
sententia constitueretur; iactabatur enim temporibus illis nummus sic, ut nemo
posset scire, quid haberet. Conscripserunt communiter edictum cum poena atque
iudicio constitueruntque, ut omnes simul in rostra post meridiem escenderent. Et
ceteri quidem alius alio, Marius ab subselliis in rostra recta idque, quod
communiter compositum fuerat, solus edixit. Et ea res, si quaeris, ei magno
honori fuit; omnibus vicis statuae, ad eas tus, cerei; quid multa? nemo umquam
multitudini fuit carior. Haec sunt, quae conturbent in deliberatione non
numquam, cum id, in quo violatur aequitas, non ita magnum, illud autem, quod ex
eo paritur, permagnum videtur, ut Mario praeripere collegis et tribunis plebi
popularem gratiam non ita turpe, consulem ob earn rem fieri, quod sibi turn
proposuerat, valde utile videbatur. Sed omnium una regula est, quam tibi cupio
esse notissimam, aut illud, quod utile videtur, turpe ne sit aut, si turpe est,
ne videatur esse utile. Quod igitur? possumusne aut ilium Marium virum
bonum iudicare aut hunc? Explica atque excute intellegentiam tuam, ut videas,
quae sit in ea [species] forma et notio viri boni. Cadit ergo in virum bonum
mentiri emolumenti sui causa, criminari, praeripere, fallere? Nihil profecto
minus. Est ergo ulla res tanti aut commodum ullum tam expetendum, ut viri
boni et splendorem et nomen amittas? Quid est, quod afferre tantum utilitas
ista, quae dicitur, possit, quantum auferre, si boni viri nomen eripuerit, fidem
iustitiamque detraxerit? Quid enim interest, utrum ex homine se convertat quis
in beluam an hominis figura immanitatem gerat beluae?
21. Quid? qui omnia recta et honesta neglegunt,
dum modo potentiam consequantur, nonne idem faciunt,
quod is, qui etiam socerum
habere voluit eum, cuius ipse audacia potens esset? Utile ei videbatur plurimum
posse alterius invidia; id quam iniustum in patriam et quam turpe esset, non
videbat. Ipse autem socer in ore semper Graecos versus de Phoenissis habebat,
quos dicam, ut potero, incondite fortasse, sed tamen, ut res possit intellegi:
Nam si violandum est Ius, regnandi gratia
Violandum est; aliis rebus pietatem colas.
Capitalis [Eteocles vel potius Euripides], qui id
unum, quod omnum sceleratissimum fuerit, exceperit! Quid igitur minuta
colligimus, hereditates, mercaturas, venditiones fraudulentas? ecce tibi, qui
rex populi Romani dominusque omnium gentium esse concupiverit idque perfecerit!
Hanc cupiditatem si honestam quis esse dicit, amens est; probat enim legum et
libertatis interitum earumque oppressionem taetram et detestabilem gloriosam
putat. Qui autem fatetur honestum non esse in ea civitate, quae libera fuerit
quaeque esse debeat, regnare, sed ei, qui id facere possit, esse utile, qua hunc
obiurgatione aut quo potius convicio a tanto errore coner avellere? Potest enim,
di immortales! cuiquam esse utile foedissimum et taeterrimum parricidium
patriae, quamvis is, qui se eo obstrinxerit, ab oppressis civibus parens
nominetur? Honestate igitur dirigenda utilitas est, et quidem sic, ut haec duo
verbo inter se discrepare, re unum sonare videantur. Non habeo, ad volgi
opinionem quae maior utilitas quam regnandi esse possit; nihil contra inutilius
ei, qui id iniuste consecutus sit,invenio,cum ad veritatem coepi revocare
rationem. Possunt enim cuiquam esse utiles angores, sollicitudines, diurni et
nocturni metus, vita insidiarur periculorumque plenissima?
Multi iniqui atque infideles regno, pauci
benivoli,
inquit Accius. At cui regno? Quod a Tantalo et
Pelope proditum iure optinebatur. Nam quanto pluris ei regi putas, qui exercitu
populi Romani populum ipsum Romanum oppressisset civitatemque non modo liberam,
sed etiam gentibus imperantem servire sibi coëgisset? Hunc tu quas
conscientiae labes in animo censes habuisse, quae vulnera? Cuius autem vita ipsi
potest utilis esse, eum eius vitae ea condicio sit, ut, qui illam eripuerit, in
maxima et gratia futurus sit et gloria? Quodsi haec utilia non sunt, quae maxime
videntur, quia plena sunt dedecoris ac turpitudinis, satis persuasum esse debet
nihil esse utile, quod non honestum sit.
22. Quamquam id quidem cum saepe alias, tum
Pyrrhi bello a C. Fabricio consule iterum et a senatu nostro iudicatum est. Cum
enim rex Pyrrhus populo Romano bellum ultro intulisset, cumque de imperio
certamen esset cum rege generoso ac potenti, perfuga ab eo venit in castra
Fabrici eique est pollicitus, si praemium sibi proposuisset, se, ut clam
venisset, sic clam in Pyrrhi castra rediturum et eum veneno necaturum.
Hunc Fabricius reducendum curavit ad Pyrrhum, idque eius facturr laudatum a
senatu est. Atqui, si speciem utilitatis opinionemque quaerimus, magnum illud
bellum perfuga unus et gravem adversarium imperii sustulisset, sed magnum
dedecus et flagitium, quicum laudis certamen fuisset, eum non virtute, sed
scelere superatum. Utrum igitur utilius vel Fabricio, qui talis in hac
urbe, qualis Aristides Athenis, fuit, vel senatui nostro, qui numquam utilitatem
a dignitate seiunxit, armis cum hoste certare an venenis? Si gloriae causa
imperium expetendum est, scelus absit, in quo non potest esse gloria; sin ipsae
opes expetuntur quoquo modo, non poterunt utiles esse cum infamia. Non igitur
utilis illa L. Philippi Q. f. sententia, quas civitates L. Sulla pecunia accepta
ex senatus consulto liberavisset, ut eae rursus vectigales essent neque iis
pecuniam, quam pro libertate dederant, redderemus. Ei senatus est assensus.
Turpe imperio! piratarum enim melior fides quam senatus. At aucta vectigalia,
utile igitur. Quousque audebunt dicere quicquam utile, quod non honestum?
potest autem ulli imperio, quod gloria debet fultum esse et benivolentia
sociorum, utile esse odium et infamia? Ego etiam cum Catone meo saepe dissensi;
nimis mihi praefracte videbatur aerarium vectigaliaque defendere, omnia
publicanis negare, multa sociis, cum in hos benefici esse deberemus, cum illis
sic agere, ut cum colonis nostris soleremus, eoque magis, quod
illa ordinum coniunctio ad salutem
rei publicae pertinebat. Male etiam Curio,
cum causam Transpadanorum
aequam esse dicebat, semper autem addebat: “Vincat utilitas!” Potius doceret non
esse aequam, quia non esset utilis rei publieae, quam, cum utilem non esse
diceret, esse aequam fateretur.
23. Plenus est sextus liber de officiis
Hecatonis talium quaestionum: “sitne boni viri in maxima caritate annonae
familiam non alere.” In utramque partem disputat, sed tamen ad extremum
utilitate, ut putat, officium dirigit magis quam humanitate. Quaerit, si in mari
iactura facienda sit, equine pretiosi potius iacturam faciat an servoli
vilis. Hic alio res familiaris, alio ducit humanitas. “Si tabulam de naufragio
stultus arripuerit, extorquebitne earn sapiens, si potuerit?” Negat, quia sit
iniurium. “Quid? dominus navis eripietne suum?” “Minime, non plus quam
navigantem in alto eicere de navi velit, quia sua sit. Quoad enim perventum est
eo, quo sumpta navis est, non domini est navis, sed navigantium.” “Quid?
si una tabula sit, duo naufragi, eique sapientes, sibine uterque rapiat, an
alter cedat alteri?” “Cedat vero, sed ei, cuius magis intersit vel sua vel rei
publicae causa vivere.” “Quid, si haec paria in utroque?” “Nullum erit certamen,
sed quasi sorte aut micando victus alteri cedet alter.” “Quid? si pater fana
expilet, cuniculos agat ad aerarium, indicetne id magistratibus filius?” “Nefas
id quidem est, quin etiam defendat patrem, si arguatur.” “Non igitur patria
praestat omnibus officiis?” “Immo vero, sed ipsi patriae conducit pios
habere cives in parentes.” “Quid? si tyrannidem occupare, si patriam prodere
conabitur pater, silebitne filius?” “Immo vero obsecrabit patrem, ne id faciat.
Si nihil proficiet, accusabit, minabitur etiam, ad extremum, si ad perniciem
patriae res spectabit, patriae salutem anteponet saluti patris.” Quaerit
etiam, si sapiens adulterinos nummos acceperit imprudens pro bonis, cum id
rescierit, soluturusne sit eos, si cui debeat, pro bonis. Diogenes ait,
Antipater negat, cui potius assentior. Qui vinum fugiens vendat sciens, debeatne
dicere. Non necesse putat Diogenes, Antipater viri boni existimat. Haec sunt
quasi controversa iura Stoicorum. “In mancipio vendendo dicendane vitia, non ea,
quae nisi dixeris, redhibeatur mancipium iure civili, sed haec, mendacem esse,
aleatorem, furacem, ebriosum?” Alteri dicenda videntur, alteri non videntur.
“Si quis aurum vendens orichalcum se putet vendere, indicetne ei vir bonus aurum
illud esse an emat denario, quod sit mille denarium?” Perspictum est iam, et
quid mihi videatur, et quae sit inter eos philosophos, quos nominavi,
controversia.
24. Pacta et promissa semperne servanda
sint, “QUAE NEC VI NEC DOLO MALO,” ut praetores solent, “FACTA SINT.” Si quis
medicamentum cuipiam dederit ad aquam intercutem pepigeritque, si eo medicamento
sanus factus esset, ne illo medicamento umquam postea uteretur, si eo
medicamento sanus factus sit et annis aliquot post incident in eundem morbum nec
ab eo, quicumpepigerat, impetret,ut iterum eo liccat uti, quid faciendum sit.
Cum sit is inhumanus, qui non concedat, nec ei quicquam fiat iniuriae, vitae et
saluti consulendum. Quid? si qui sapiens rogatus sit ab eo, qui eum
heredem faciat, cum ei testamento sestertium milies relinquatur, ut, ante quam
hereditatem adeat, luce palam in foro saltet, idque se facturum promiserit, quod
aliter heredem eum scripturus ille non esset, faciat, quod promiserit, necne?
Promisisse nollem et id arbitror fuisse gravitatis; quoniam promisit, si saltare
in foro turpe ducet, honestius mentietur, si ex hereditate nihil ceperit, quam
si ceperit, nisi forte eam pecuniam in rei publicae magnum aliquod tempus
contulerit, ut vel saltare, cum patriae consulturus sit, turpe non sit.
25. Ac ne illa quidem promissa servanda
sunt, quae non sunt iis ipsis utilia, quibus illa promiseris. Sol Phaëthonti
filio, ut redeamus ad fabulas, facturum se esse dixit, quicquid optasset;
optavit, ut in currum patris tolleretur; sublatus est. Atque is, ante quam
constitit, ictu fulminis deflagravit. Quanto melius fuerat in hoc promissum
patris non esse servatum! Quid, quod Theseus exegit promissum a Neptuno? cui cum
tres optationes Neptunus dedisset, optavit interitum Hippolyti filii, cum is
patri suspectus esset de noverca; quo optato impetrato Theseus in maximis fuit
luctibus. Quid, quod Agamemnon cum devovisset Dianae, quod in suo regno
pulcherrimum natum esset illo anno, immolavit Iphigeniam, qua nihil erat eo
quidem anno natum pulchrius? Promissum potius non faciendum quam tam taetrum
facinus admittendum fuit. Ergo et promissa non facienda non numquam, neque
semper deposita reddenda. Si gladium quis apud te sana mente deposuerit, repetat
insaniens, reddere peccatum sit, officium non reddere. Quid? si is, qui apud te
pecuniam deposuerit, bellum inferat patriae, reddasne depositum? Non credo;
facias enim contra rem publicam, quae debet esse carissima. Sic multa,
quae honesta natura videntur esse, temporibus fiunt non honesta; facere
promissa, stare conventis, reddere deposita commutata utilitate fiunt non
honesta. Ac de iis quidem, quae videntur esse utilitates contra iustitiam
simulatione prudentiae, satis arbitror dictum. Sed quoniam a quattuor
fontibus honestatis primo libro officia duximus, in eisdem versemur, cum
docebimus ea, quae videantur esse utilia tneque sint, quam sint virtutis
inimica. Ac de prudentia quidem, quam vult imitari malitia, itemque de iustitia,
quae semper est utilis, disputatum est. Reliquae sunt duae partes honestatis,
quarum altera in animi excellentis magnitudine et praestantia cernitur, altera
in conforrnatione et moderatione continentiae et temperantiae.
26. Utile videbatur Ulixi, ut quidem poëtae
tragici prodiderunt (nam apud Homerum, optimum auctorem, talis de Ulixe nulla
suspicio est), sed insimulant eum tragoediae simulatione insaniae militiam
subterfugere voluisse. Non honestum consilium, at utile, ut aliquis fortasse
dixerit, regnare et Ithacae vivere otiose cum parentibus, cum uxore, cum filio.
Ullum tu decus in cotidianis laboribus et periculis cum hac tranquillitate
conferendum putas? Ego vero istam contemnendam et abiciendam, quoniam,
quae honesta non sit, ne utilem quidem esse arbitror. Quid enim auditurum
putas fuisse Ulixem,si in illa simulatione perseveravisset? qui cummaximas res
gesserit in bello, tamen haec audiat ab Aiace:
Cuius
ípse princeps iuris iurandí fuit,
Quod omnes scitis, solus neglexit fidem;
Furere assimulare, ne coiret, institit.
Quodni Palamedi perspicax prudentia
Istius percepset malitiosam audaciam,
Fide sacratae ius perpetuo falleret.
Illi vero non modo cum hostibus, verum etiam cum
fluctibus, id quod fecit, dimicare melius fuit quam deserere consentientem
Graeciam ad bellum barbaris inferendum. Sed omittamus et fabulas et externa; ad
rem factam nostramque veniamus. M. Atilius Regulus cum consul iterum in Africa
ex insidiis captus esset duce Xanthippo Lacedaemonio, imperatore autem patre
Hannibalis Hamilcare, iuratus missus est ad senatum, ut, nisi redditi essent
Poenis captivi nobiles quidam, rediret ipse Carthaginem. Is cum Romam
venisset, utilitatis speciem videbat, sed eam, ut res declarat, falsam
iudicavit; quae erat talis: manere in patria, esse domui suae cum uxore, cum
liberis, quam calamitatem accepisset in bello, communem fortunae bellicae
iudicantem tenere consularis dignitatis gradum. Quis haec negat esse utilia?
quem censes? Magnitudo animi et fortitudo negat.
27. Num locupletiores quaeris auctores? Harum enim
est virtutum proprium nihil extimescere, omnia humana despicere, nihil, quod
homini accidere possit, intolerandum putare. Itaque quid fecit? In senatum
venit, mandata exposuit, sententiam ne diceret recusavit, quam diu iure iurando
hostium teneretur, non esse se senatorem. Atque illud etiam (“O stultum
hominem,” dixerit quispiam, “et repugnantem utilitati suae!”), reddi captivos
negavit esse utile; illos enim adulescentes esse et bonos duces, se iam
confectum senectute. Cuius cum valuisset auctoritas, captivi retenti sunt, ipse
Carthaginem rediit, neque eum caritas patriae retinuit nec suorum. Neque vero
tur ignorabat se ad crudelissimum hostem et ad exquisita supplicia proficisci,
sed ius iurandum conservandum putabat. Itaque turn, cum vigilando necabatur,
erat in meliore causa, quam si domi senex captivus, periurus consularis
remansisset. At stulte, qui non modo non censuerit captivos remittendos,
verum etiam dissuaserit. Quo modo stulte? etiamne, si rei publicae conducebat?
potest autem, quod inutile rei publicae sit, id cuiquam civi utile esse?
28. Pervertunt homines ea, quae sunt fundamenta
naturae, cum utilitatem ab honestate seiungunt. Omnes enim expetimus utilitatem
ad eamque rapimur nec facere aliter ullo modo possumus. Nam quis est, qui utilia
fugiat? aut quis potius, qui ea non studiosissime persequatur? Sed quia nusquam
possumus nisi in laude, decore, honestate utilia reperire, propterea illa prima
et summa habemus, utilitatis nomen non tam splendidum quam necessarium ducimus.
Quid est igitur, dixerit quis, in iure iurando? num iratum timemus lovem? At hoc
quidem commune est omnium philosophorum, non eorum modo, qui deum nihil habere
ipsum negotii dicunt, nihil exhibere alteri, sed eorum etiam, qui deum semper
agere aliquid et moliri volunt, numquam nec irasci deum nec nocere. Quid autem
iratus Iuppiter plus nocere potuisset, quam nocuit sibi ipse Regulus Nulla
igitur vis fuit religionis, quae tantam utilitatem perverteret. An ne turpiter
faceret? Primum minima de malis. Num igitur tantum mali turpitude ista habebat,
quantum ille cruciatus? Deinde illud etiam apud Accium:
Fregistin fidem?
Neque dedi neque do infideli cuiquam
quamquam ab impio rege dicitur, luculente tamen
dicitur. Addunt etiam, quem ad modum nos dicamus videri quaedam utilia,
quae non sint, sic se dicere videri quaedam honesta, quae non sint. “ut hoc
ipsum videtur honestum, conservandi iris iurandi causa ad cruciatum revertisse;
sed fit non honestum, quia, quod per vim hostium esset actum, ratum esse non
debuit.” Addunt etiam, quicquid valde utile sit, id fieri honestum, etiamsi
antea non videretur. Haec fere contra Regulum. Sed prima quaeque videamus.
29. “Non fuit Iuppiter metuendus ne iratus
noceret, qui neque irasci solet nec nocere.” Haec quidem ratio non magis
contra Reguli quam contra omne ius iurandum valet. Sed in iure iurando non qui
metus, sed quae vis sit, debet intellegi; est enim ius iurandum affirmatio
religiosa; quod autem affirmate quasi deo teste promiseris, id tenendum est. Iam
enim non ad iram deorum, quae nulla est, sed ad iustitiam et ad fidem pertinet.
Nam praeclare Ennius:
O Fides alma apta pinnis et ius iurandum Iovis!
Qui ius igitur iurandum violat, is Fidem violat,
quam in Capitolio “vicinam Iovis
optimi maximi,” ut in Catonis oratione est, maiores nostri esse voluerunt.
At enim ne iratus quidem Iuppiter plus Regulo nocuisset, quam sibi nocuit ipse
Regulus. Certe, si nihil malum esset nisi dolere. Id autem non modo [non] summum
malum, sed ne malum quidem esse maxima auctoritate philosophi affirmant. Quorum
quidem testem non mediocrem, sed haud scio an gravissimum Regulum nolite,
quaeso, vituperare. Quem enim locupletiorem quaerimus quam principem populi
Romani, qui retinendi officii causa cruciatum subierit voluntarium? Nam quod
aiunt: “minima de malis,” id est ut turpiter potius quam calamitose, an
est ullum maius malum turpitudine? quae si in deformitate corporis habet aliquid
offensionis, quanta illa depravatio et foeditas turpificati animi debet videri!
Itaque nervosius qui ista disserunt, solum audent malum dicere id, quod turpe
sit, qui autem remissius, ii tamen non dubitant summum malum dicere. Nam illud
quidem:
Neque dedi neque do infideli cuiquam
idcirco recte a poeta, quia, cum tractaretur
Atreus, personae serviendum fuit. Sed si hoc sibi sument, nullam esse fidem,
quae infideli data sit, videant, ne quaeratur latebra periurio. Est autem
ius etiam bellicum fidesque iuris iurandi saepe cum hoste servanda. Quod enim
ita iuratum est, ut mens conciperet fieri oportere, id servandum est; quod
aliter, id si non fecerit, nullum est periurium. Ut, si praedonibus pactum pro
capite pretium non attuleris, nulla fraus sit, ne si iuratus quidem id non
feceris; nam pirata non est ex perduellium nurnero definitus, sed communis
hostis omnium; cum hoc nec fides debet nec ius iurandum esse commune.
Non enim falsum iurare periurare est, sed, quod “EX ANIMI TUI SENTENTIA”
iuraris, sicut verbis concipitur more nostro, id non facere periurium est.
Scite enim Euripides:
Iuravi lingua, mentem iniuratam gero.
Regulus vero non debuit condiciones pactionesque
bellicas et hostiles perturbare periurio. Cum iusto enim et legitimo hoste res
gerebatur, adversus quem et totum ius fetiale et multa sunt iura communia. Quod
ni ita esset, numquam claros viros senatus vinctos hostibus dedidisset.
30. At vero T. Veturius et Sp. Postumius cum
iterum consules essent, quia, cum male pugnatum apud Caudium esset, legionibus
nostris sub iugum missis pacem
cum Samnitibus fecerant, dediti sunt iis; iniussu enim populi senatusque
fecerant. Eodemque tempore Ti. Nurnicius, Q. Maelius, qui tum tribuni pl. erant,
quod eorum auctoritate pax erat facta, dediti sunt, ut pax Samnitium
repudiaretur; atque huius deditionis ipse Postumius, qui dedebatur, suasor et
auctor fuit. Quod idem multis annis post C. Mancinus, qui, ut Numantinis,
quibuscum sine senatus auctoritate foedus fecerat, dederetur, rogationem
suasit ear, quam L. Furius, Sex. Atilius ex senatus consulto ferebant; qua
accepta est hostibus deditus. Honestius hic quam Q. Pompeius, quo, cum in eadem
causa esset, deprecante accepta lex non est. Hic ea, quae videbatur utilitas,
plus valuit quam honestas, apud superiores utilitatis species falsa ab
honestatis auctoritate superata est. At non debuit ratum esse, quod erat
actum per vim.—Quasi vero forti viro vis possit adhiberi. Cur igitur ad senatum
proficiscebatur, cum praesertim de captivis dissuasurus esset? Quod maximum in
eo est, id reprehenditis. Non enim suo iudicio stetit, sed suscepit causam, ut
esset iudicium senatus; cui nisi ipse auctor fuisset, captivi profecto Poenis
redditi essent; ita incolumis in patria Regulus restitisset. Quod quia patriae
non utile putavit, idcirco sibi honestum et sentire illa et pati credidit. Nam
quod aiunt, quod valde utile sit, id fieri ho- nestum, immo vero esse, non
fieri. Est enim nihil utile, quod idem non honestum, nec, quia utile, honestum,
sed, quia honestum, utile. Quare ex multis mirabilibus exemplis haud facile quis
dixerit hoc exemplo aut laudabilius aut praestantius.
31. Sed ex tota hac laude Reguli unum illud
est admiratione dignum, quod captivos retinendos censuit. Nam quod rediit, nobis
nunc mirabile videtur, illis quidem temporibus aliter facere non potuit; itaque
ista laus non est hominis, sed temporum. Nullum enim vinculum ad astringendam
fidem iure iurando maiores artius esse voluerunt. Id indicant leges in duodecim
tabulis, indicant sacratae, indicant foedera, quibus etiam cum hoste devincitur
fides, indicant notiones animadversionesque censorum, qui nulla de re
diligentius quam de iure iurando iudicabant.
L. Manlio A. f., cum dictator fuisset, M. Pomponius tr. pl. diem dixit,
quod is paucos sibi dies ad dictaturam gerendam addidisset; criminabatur etiam,
quod Titum filium, qui postea est Torquatus appellatus, ab hominibus relegasset
et ruri habitare iussisset. Quod cum audivisset adulescens filius,
negotium exhiberi patri, accurrisse Romam et cum primo luci Pomponi domum
venisse dicitur. Cui cum esset nuntiatum, qui illum iratum allaturum ad se
aliquid contra patrem arbitraretur, surrexit e lectulo remotisque arbitris ad se
adulescentem iussit venire. At ille, ut ingressus est, confestim gladium
destrinxit iuravitque se illum statim interfecturum, nisi ius iurandum sibi
dedisset se patrem missum esse facturum. Iuravit hoc terrore coactus Pomponius;
rem ad populum detulit, docuit, cur sibi causa desistere necesse esset, Manlium
missum fecit. Tantum temporibus illis ius iurandum valebat. Atque hic T. Manlius
is est, qui ad Anienem Galli, quem ab eo provocatus occiderat, torque detracto
cognomen invenit, cuius tertio consulatu Latini ad Veserim fusi et fugati,
magnus vir in primis et, qui perindulgens in patrem, idem acerbe severus in
filium.
32. Sed, ut laudandus Regulus in conservando
iure iurando, sic decem illi, quos post Cannensem pugnam iuratos ad senatum
misit Hannibal se in castra redituros ea, quorum erant potiti Poeni, nisi de
redimendis captivis impetravissent, si non redierunt, vituperandi. De
quibus non omnes uno modo; nam Polybius, bonus auctor in primis, ex decem
nobilissimis, qui tum erant missi, novem revertisse dicit re a senatu non
impetrata; unum ex decem, qui paulo post, quam erat egressus e castris,
redisset, quasi aliquid esset oblitus, Romae remansisse; reditu enim in castra
liberatum se esse iure iurando interpretabatur, non recte; fraus enim astringit,
non dissolvit periurium. Fuit igitur stulta calliditas perverse imitata
prudentiam. Itaque decrevit senatus, ut ille veterator et callidus vinctus ad
Hannibalem duceretur. Sed illud maximum: octo hominum milia tenebat
Hannibal, non quos in acie cepisset, aut qui periculo mortis diffugissent, sed
qui relicti in castris fuissent a Paulo et a Varrone consulibus. Eos senatus non
censuit redimendos, cum id parva pecunia fieri posset, ut esset insitum
militibus nostris aut vincere aut emori. Qua quidem re audita fractum animum
Hannibalis scribit idem, quod senatus populusque Romanus rebus afflictis tam
excelso animo fuisset. Sic honestatis comparatione ea, quae videntur utilia,
vincuntur. C. Acilius
autem, qui Graece scripsit historiam, plures ait fuisse, qui in castra
revertissent eadem fraude, ut iure iurando liberarentur, eosque a
censoribus omnibus ignominiis notatos. Sit iam huius loci finis. Perspicuum est
enim ea, quae timido animo, humili, demisso fractoque fiant, quale fuisset
Reguli factum, si aut de captivis, quod ipsi opus esse videretur, non quod rei
publicae, censuisset aut domi remanere voluisset, non esse utilia, quia sint
flagitiosa, foeda, turpia.
33. Restat quarta pars, quae decore,
moderatione, modestia, continentia, temperantia continetur. Potest igitur
quicquam utile esse, quod sit huic talium virtutum choro contrarium? Atqui ab
Aristippo Cyrenaici atque Annicerii
philosophi nominati omne bonum in voluptate posuerunt virtutemque censuerunt
ob earn em esse laudandam, quod efficiens esset voluptatis. Quibus obsoletis
floret Epicurus, eiusdem fere adiutor auctorque sententiae. Cum his “viris
equisque,” ut dicitur, si honestatem tueri ac retinere sententia est,
decertandum est. Nam si non modo utilitas, sed vita omnis beata corporis
firma constitutione eiusque constitutionis spe explorata, ut a Metrodoro
scriptum est, continetur, certe haec utilitas, et quidem summa (sic enim
censent), cum honestate pugnabit. Nam ubi primum prudentiae locus dabitur? an ut
conquirat undique suavitates? Quam miser virtutis famulatus servientis
voluptati! Quod autem munus prudentiae? an legere intellegenter voluptates? Fac
nihil isto esse iucundius, quid cogitari potest turpius? Iam, qui dolorem summum
malum dicat, apud eum quem habet locum fortitudo, quae est dolorum laborumque
contemptio? Quamvis enim multis locis dicat Epicurus, sicuti dicit, satis
fortiter de dolore, tamen non id spectandum est, quid dicat, sed quid
consentaneum sit ei dicere, qui bona voluptate terminaverit, mala dolore. Et, si
illum audiam, de continentia et temperantia dicit ille quidem multa multis
locis, sed aqua haeret, ut aiunt; nam qui potest temperantiam laudare is, qui
ponat summum bonurn in voluptate? est enim temperantia libidinum inimica,
libidines autem consectatrices voluptatis. Atque in his tamen tribus
generibus, quoquo modo possunt, non incallide tergiversantur; prudentiam
introducunt scientiam suppeditantem voluptates. depellentem dolores;
fortitudinem quoque aliquo modo expediunt, cum tradunt rationem neglegendae
mortis, perpetiendi doloris; etiam temperantiam inducunt non facillime illi
quidem, sed tamen quoquo modo possunt; dicunt enim voluptatis magnitudinem
doloris detractione finiri. Iustitia vacillat vel iacet potius omnesque eae
virtutes, quae in communitate cernuntur et in societate generis humani. Neque
enim bonitas nec liberalitas nec comitas esse potest, non plus quam amicitia, si
haec non per se expetantur, sed ad voluptatem utilitatemve referantur.
Conferamus igitur in pauca. Nam ut utilitatem nullam esse docuimus, quae
honestati esset contraria, sic omnem voluptatem dicimus honestati esse
contrariam. Quo magis reprehendendos Calliphontem et Dinomachum iudico, qui se
dirempturos controversiam putaverunt, si cum honestate voluptatem tamquam cum
homine pecudem copulavissent. Non recipit istam coniunctionem honestas,
aspernatur, repellit. Nec vero finis bonorum [et malorum], qui simplex esse
debet, ex dissimillimis rebus misceri et temperari potest.
Sed de hoc (magna enim res est) alio loco pluribus; nunc ad propositum.
Quem ad modum igitur, si quando ea, quae videtur utilitas, honestati repugnat,
diiudicanda res sit, satis est supra disputatum. Sin autem speciem utilitatis
etiam voluptas habere dicetur, nulla potest esse ei cum honestate coniunctio.
Nam, ut tribuamus aliquid voluptati, condimenti fortasse non nihil,
utilitatis certe nihil habebit. Habes a patre munus, Marce fili, mea
quidem sententia magnum, sed perinde erit, ut acceperis. Quamquam hi tibi tres
libri inter Cratippi commentarios tamquam hospites erunt recipiendi; sed, ut, si
ipse venissem Athenas (quod quidem esset factum, nisi me e medio cursu clara
voce patria revocasset), aliquando me quoque audires, sic, quoniam his
voluminibus ad te profecta vox est mea, tribues iis temporis quantum poteris,
poteris autem, quantum voles. Cum vero intellexero te hoc scientiae genere
gaudere, tum et praesens tecum propediem, ut spero, et, dum aberis, absens
loquar. Vale igitur, mi Cicero, tibique persuade esse te quidem mihi carissimum,
sed multo fore cariorem, si talibus monitis praeceptisque laetabere. |
LIVRE TROISIÈME.
L P. Scipion, qui le premier fut surnommé l'Africain , avait
coutume de dire, mon cher fils, à ce que nous apprend Caton, son
contemporain : « qu'il n'était jamais moins oisif que lorsqu'on le
voyait de loisir, et jamais moins seul que dans la solitude ; »
admirable parole, et bien digne d'un grand homme et d'un sage
! Elle
nous montre que dans ses moments de loisir Scipion pensait aux
487 affaires, et qu'il savait s'entretenir avec lui-même dans la
solitude; dételle sorte qu'il n'était jamais oisif, et qu'il pouvait
se passer quelquefois de l'entretien d'autrui. Ainsi deux choses
qui paralysent d'ordinaire l'esprit des hommes éveillaient au
contraire le sien. Je voudrais qu'il me fût permis d'en dire autant
de moi ; mais si je ne puis atteindre jusqu'à la perfection de ce
grand génie, je fais du moins tous mes efforts pour en approcher.
Éloigné des affaires publiques et du barreau par des armes
sacrilèges et par l'empire de la force, je me trouve dans un loisir
continuel. Et par la même raison, vivant loin de la ville,
parcourant les campagnes, je suis souvent seul avec moi-même. Mais
je ne puis comparer mon loisir à celui de l'Africain, ni ma solitude
à la sienne. Lui, qui était élevé aux plus hautes dignités de
l'État, prenait quelquefois du loisir pour se délasser de ses
nobles travaux, et, fuyant la foule et le bruit du monde, il venait
goûter le calme de la solitude, et s'y réfugier comme dans un port
tranquille. Mais moi, ce n'est point le désir du repos, c'est
l'impossibilité d'agir qui m'a conduit où je suis. Le sénat n'est
plus, la justice est anéantie; que trouverais-je au forum ou dans le
palais des Pères qui fût digne de m'occuper? Aussi, moi qui vivais
naguère au milieu du peuple , exposé à tous les regards, je fuis
maintenant la vue des infâmes qui ont tout envahi; je me cache
autant qu'il m'est permis, et je me trouve souvent dans la plus
complète solitude. Toutefois comme j'ai appris des sages que
non-seulement il faut, entre différents maux, choisir les moindres,
mais que nous devons encore recueillir dans nos malheurs le bien
qu'ils peuvent renfermer, je jouis de mon loisir (quoique je sente
bien que ce n'est pas là celui qui devait être réservé au sauveur de la
patrie), et je ne me laisse point aller à une déplorable langueur,
dans cette solitude que je n'ai point cherchée et que la nécessité
m'impose. L'Africain, je l'avoue, se montrait d'une trempe bien plus
vigoureuse que moi; il ne nous a légué aucun monument de son génie,
aucun ouvrage de son loisir, aucun fruit de sa solitude ; et nous
devons conclure que son esprit, toujours occupé et nourri de
grandes et fécondes pensées, ne lui laissait jamais sentir sa
solitude ni son repos. Pour moi, je n'ai pas cette énergie, je ne
puis me distraire de ma solitude par la force de mes méditations, et
j'ai été obligé de recourir à ces travaux littéraires qui
soutiennent et occupent mon esprit. Aussi j'ai plus écrit en
quelques mois, depuis le renversement de la république, que je
n'avais fait en plusieurs années, pendant qu'elle était encore
debout.
II. La philosophie tout entière, mon cher fils, est une terre
fertile et qui porte des fruits abondants; vous n'en trouverez pas
une seule partie qui soit inculte ou stérile; mais de toutes la plus
féconde est celle qui traite de nos devoirs et nous donne les
préceptes d'une vie régulière et honnête. Ce sont là des leçons que
vous recevez tous les jours, j'en ai la ferme confiance, de notre
ami Cratippe, le premier des philosophes de ce siècle ; mais il est
avantageux pour vous qu'elles retentissent de tous côtés à vos
oreilles, et que vous n'entendiez pas d'autre discours, s'il est
possible. C'est ce que doivent faire tous les jeunes gens qui
pensent à s'honorer dans leur vie; et je ne sais trop, mon fils, si
vous n'y êtes pas plus obligé que tout autre. On s'attend de toutes
parts que vous imiterez votre père dans ses travaux, que vous
488 recueillerez la succession de ses
honneurs, et peut-être l'héritage de sa gloire. Songez d'ailleurs
que Ton demandera beaucoup à celui qui a reçu les enseignements de
Cratippe, et les a reçus à Athènes. Vous êtes allé en quelque sorte
acquérir d'eux la sagesse : revenir à vide serait bien honteux ; ce
serait une tache à la gloire de la ville et à la renommée du maître.
Ainsi donc faites tous vos efforts, livrez-vous au travail le plus
opiniâtre (si toutefois c'est un travail que d'apprendre, et non pas
un plaisir), ne négligez rien ; et puisque je vous ai fourni tous
les moyens de vous instruire, ne donnez pas à penser que vous vous
êtes manqué à vous-même. Mais je n'insisterai pas davantage, car
je ne vous adresse guère de lettre où vous ne trouviez de pressantes
exhortations. Revenons maintenant à la dernière partie de notre
sujet Panétius, qui, sans contredit, a traité des devoirs avec le
plus grand soin, et que j'ai principalement suivi dans cet ouvrage,
à quelques exceptions près, a divisé toute la matière en trois
parties, qui correspondent aux diverses sortes de questions que les
hommes s'adressent d'ordinaire à propos des devoirs. Nous avons vu
en effet que l'on peut se demander si le parti à prendre est honnête
ou honteux, s'il est utile ou nuisible; et qu'on délibère souvent
quand l'honnête semble en opposition avec l'utile, pour savoir
lequel des deux il faut choisir. Panétius explique en trois
livres tout ce qui concerne les deux premières parties ; il prit
l'engagement de traiter la troisième dans la suite, mais il n'a
jamais tenu sa promesse. J'en suis d'autant plus étonné que, suivant
le témoignage de Posidonius, son disciple, il vécut encore trente
ans après avoir publié son ouvrage. Ce qui me surprend aussi, c'est
que Posidonius ait à peine effleuré ce sujet dans quelques
fragments, tandis que, de son aveu, il n'est pas dans toute la
philosophie de point plus important. Je suis loin d'ailleurs de me
rendre au sentiment de ceux qui soutiennent que Panétius n'a pas
omis de le traiter, mais qu'il l'a négligé à dessein et par
d'excellentes raisons, attendu que l'utile ne peut jamais être en
opposition avec l'honnête. J'admets volontiers que l'on puisse
discuter sur l'opportunité qu'il y aurait à développer ou non cette
troisième partie de la division de Panétius ; mais ce qui est
incontestable, c'est que Panétius devait s'en occuper, qu'il
en avait formé le dessein, et que plus tard il Va abandonné. Car il me semble
que si un auteur divise son sujet en trois parties, et n'en développe que deux, il lui reste encore la troisième. Ajoutez qu'à
la fin de son troisième livre, Panétius promet de traiter plus tard
cette dernière question. Vous faut-il encore d'autres preuves? Voici
un témoignage d'une grande valeur, celui de Posidonius. Nous lisons
dans une de ses lettres qu'un disciple de Panétius, P.
Rutilius Rufus, disait assez souvent : « que jamais peintre n'avait
voulu se charger de mettre la dernière main à la Vénus de Cos
qu'Apelle avait laissée imparfaite, et dont la tête, d'une
merveilleuse beauté, ôtait tout espoir de faire dignement le reste
; que de même jamais philosophe n'avait entrepris d'achever
l'ouvrage de Panétius, tellement ce qu'il en avait fait était
admirable. »
III. On ne peut donc avoir le moindre doute sur l'intention de
Panétius; mais aurait-il eu raison de joindre cette troisième partie
à son traité des Devoirs? aurait-il eu tort? Voilà une question sur
489
laquelle les esprits peuvent se partager. Que l'honnête soit, en
effet, le seul bien, comme les Stoïciens le prétendent, ou qu'il
soit un bien si excellent, comme le veut votre école
péripatéticienne, quêtons les autres mis en regard ne valent pas la
peine qu'on y songe, il est indubitable que jamais l'utile ne peut
entrer en comparaison avec l'honnête. Aussi nous dit-on que Socrate
maudissait ceux qui les premiers avaient séparé dans leur opinion
ces deux choses, indissolublement unies par la nature. Les Stoïciens ont abondé
dans le sens de Socrate ; selon eux, tout ce qui est honnête est utile, et rien
n'est utile qui ne soit honnête. Si Panétius avait pour maxime que l'on doit cultiver la vertu pour les
avantages qu'elle procure, comme le prétendent ceux qui ne
recherchent au monde que le plaisir ou l'absence de la douleur, il
lui serait permis de soutenir que l'utile est quelquefois en
opposition avec l'honnête. Mais comme il entend et maintient que le
seul bien pour l'homme c'est l'honnête, et que tous les
prétendus
avantages d'où l'honnête est exclu ne sauraient en aucune façon
améliorer la vie qui les possède et laisser un vide dans celle qui
en est privée, il semble qu'un tel philosophe ne pouvait prendre au
sérieux les incertitudes des hommes qui hésitent entre l'honnête et
l'utile, et les comparent entre eux. Quand les Stoïciens disent que
le souverain bien c'est de vivre conformément à la nature, cela
signifie, si je ne me trompe, être toujours fidèle à la vertu, et
quant au reste, choisir ce qui est conforme à la nature, mais à
condition que la vertu n'y mette point obstacle. On déclare donc, au
nom de ces principes, que c'est un tort de vouloir comparer l'utile
avec l'honnête, et que sur cette dernière partie de notre sujet il
n'y a aucun précepte à donner. Mais l'honnête dont parlent les
Stoïciens, le pur et véritable honnête, ne se trouve que dans les
sages et ne peut jamais être séparé de la vertu. Ceux au contraire
qui n'ont pas la sagesse parfaite ne s'élèvent pas à cette
honnêteté suprême, et dans leur conduite vous n'en voyez que
l'image. Tous les devoirs dont nous parlons dans cet ouvrage sont
ceux que les Stoïciens appellent devoirs moyens; ils sont d'une
application générale, et tous les hommes peuvent les remplir :
reconnaissons au moins que beaucoup s'en acquittent ou par la seule
force de leur bon naturel, ou grâce aux lumières de l'éducation.
Mais pour ce devoir que les mêmes philosophes appellent le vrai
bien, c'est la perfection absolue à laquelle il ne manque rien,
comme ils disent, et que personne ne peut atteindre, si ce n'est le
sage. Une action conforme a^x devoirs du second ordre semble être
souverainement parfaite aux yeux du vulgaire, qui ne comprend pas à
quelle distance de la perfection elle se trouve, et, dans la mesure
de son intelligence, n'y voit rien que d'accompli. C'est ce qui
arrive fréquemment lorsqu'il s'agit de juger un poème, un tableau,
ou quelque autre objet d'art; les ignorants trouvent admirable et
délicieux ce qui ne l'est réellement pas; et pourquoi sont-ils
charmés? parce qu'il y a dans l'ouvrage quelque mérite qui fait
impression sur eux, et qu'ils sont entièrement incapables de saisir
et de comprendre les défauts. Mais lorsque leur goût a été formé
par les gens habiles, ils renoncent facilement à leur première
opinion.
IV. Les devoirs que nous expliquons dans ces li-
490
vres forment donc, suivant les Stoïciens, comme une seconde
honnêteté, qui n'est plus seulement l'attribut des sages, mais à
laquelle tout le genre humain est appelé. Il n'est point d'homme
vertueux qui ne cède à l'autorité de ces devoirs. Lorsqu'on parle
de la magnanimité des deux Décius ou des deux Scipions, de la
justice de Fabricius ou d'Aristide, ce n'est pas de la justice ou
de la grandeur d'âme du sage qu'on entend faire l'éloge. Aucun de
ces grands hommes n'était sage dans le sens rigoureux du mot; Caton
et Lélius, qu'on nommait les sages, ne méritaient pas davantage ce
beau titre ; les sept sages de la Grèce ne le méritaient pas non
plus; mais l'accomplissement habituel des devoirs de second ordre
leur donnait une certaine ressemblance avec le sage véritable. Ainsi
donc, s'il est hors de doute qu'on ne peut comparer l'honnêteté
parfaite avec l'utile qui lui semblerait opposé, il n'est pas moins
certain que jamais on ne doit mettre aucun avantage en parallèle
avec cette honnêteté commune que font paraître dans leurs mœurs ceux
qui aspirent au titre d'hommes de bien. Nous devons observer et
maintenir sans cesse dans notre conduite cette honnêteté qui tombe
sous l'intelligence vulgaire, aussi religieusement que les sages
observent l'honnêteté véritable et parfaite ; autrement il n'y
aurait pour nous aucun progrès effectif et durable dans le chemin de
la vertu. Mais jusqu'ici nous n'avons parlé que de ceux qui méritent
le nom d'hommes de bien, en s'acquittent avec fidélité de leurs
devoirs. Ceux au contraire qui rapportent tout à leur propre
intérêt et ne veulent pas que l'honnêteté emporte la balance,
ceux-là comparent souvent, quand il s'agit de faire un choix entre les choses, ce qui est honnête avec ce qu'ils croient utile
; c'est ce que les hommes de bien ne font jamais. J'estime donc que Panétius, en disant que les hommes ont coutume d'hésiter
entre
l'honnête et l'utile, avait en vue précisément ce qu'il disait, que
les hommes ont coutume d'hésiter, et non pas qu'ils dussent hésiter
! C'est ! une grande honte non-seulement de préférer l'utile à
l'honnête, mais même de les comparer et de balancer entre eux.
Comment se fait-il donc que nous puissions quelquefois hésiter, et
qu'il faille recourir à un long examen? c'est, je crois, qu'alors
nous ne sommes pas bien fixés sur la nature des choses que nous
considérons. Il arrive en effet des circonstances où ce qui passe le
plus souvent pour être honteux cesse d'avoir ce caractère. Je vais
vous en donner un exempt e d'une grande portée. Est-il un crime plus
infâme que de tuer non-seulement un homme, mais un ami? Direz-vous
cependant qu'il se soit souillé d'un crime celui qui a tué un tyran,
quoique son ami? Ce n'est pas là du moins le sentiment du peuple
Romain, qui, de toutes les belles actions, regarde celle-là comme la
plus admirable. Est-ce donc que l'utile l'aurait emporté sur
l'honnête? Disons plutôt que l'utile est sorti de l'honnête. Pour
que nous puissions reconnaître le parti le plus sage dans toutes les
circonstances où ce que nous appelons l'utile nous semblera en
opposition avec l'honnête, il nous faut établir une règle générale
que nous suivrons chaque fois qu'un conflit se présentera, et qui
nous donnera la garantie de ne jamais nous écarter de notre devoir.
Cette règle sera conforme aux principes et à la doctrine des
Stoïciens, car ce sont leurs maximes que nous avons adoptées dans
cet ouvrage. Quoi- 491 que je sache bien que l'ancienne Académie et vos
Péripatéticiens, qui autrefois se confondaient dans une même école,
placent l'honnête fort au-dessus de l'utile; cependant je trouve
plus de noblesse dans les sentiments de ceux qui nous apprennent que
tout ce qui est honnête est utile, et que rien n'est utile de ce qui
n'est pas honnête , que dans une doctrine où l'on m'enseigne qu'il
y a quelque chose d'honnête qui n'est pas utile, et quelque chose
d'utile qui n'est pas honnête. Notre Académie nous donne d'ailleurs
pleine et entière liberté d'adopter et de soutenir toute opinion qui
nous parait le plus probable. Mais je reviens à la règle générale.
V. Enlever à autrui ce qui lui appartient, chercher son profit au
détriment de son semblable, c'est là quelque chose de plus
contraire à la nature que la mort, la pauvreté, la douleur, et tout
ce qui nous frappe dans notre corps ou dans nos biens extérieurs.
D'abord une telle action va au renversement de la société et de
toute union entre les hommes. Si nous sommes tout prêts à nous
attaquer et nous dépouiller les uns les autres pour servir nos
intérêts, voilà la société du genre humain, c'est-à-dire ce qu'il y
a au monde de plus conforme à la nature, qui se dissout
nécessairement. Imaginez que les membres de notre corps aient tous
la conscience d'eux-mêmes, et que chacun d'eux vienne à
penser que
le moyen de se bien porter c'est d'attirer à soi la santé et la
force du membre voisin, bientôt le corps tomberait dans un état de
langueur qui l'acheminerait nécessairement à la mort; tout
pareillement, si chacun de nous, ne pensant qu'à son propre
avantage, dépouille son voisin et tire tout ce qu'il peut du bien
d'autrui, la société et l'union
des hommes est infailliblement détruite. Il est permis à tout homme
d'acquérir pour lui-même, de préférence aux autres, les choses
nécessaires à la vie; les lois de la nature ne s'y opposent pas.
Mats ce que la nature ne peut souffrir, c'est que nous augmentions
nos richesses, notre pouvoir, nos ressources, au détriment
d'autrui. Et ce n'est pas seulement la nature ou le droit des gens,
ce sont encore les lois de chaque peuple, ce solide fondement des
cités, qui nous font ce commandement formel de ne point nuire à
autrui pour notre propre avantage. En effet, ce que les lois ont en
vue, ce qu'elles veulent, c'est que la société qu'elles
protègent
se maintienne dans toute son intégrité; et ceux qui travaillent à sa
ruine, elles les condamnent à l'amende, aux fers, à l'exil, à la
mort. Cette règle nous est encore bien plus énergiquement imposée
par la raison naturelle, qui est la loi divine et humaine : ceux qui
obéissent à ses ordres, c'est-à-dire tous les hommes qui veulent
vivre conformément à la nature, ne porteront jamais les mains sur
le bien d'autrui, et auraient horreur de s'approprier ce qui ne leur
appartient pas. L'élévation et la grandeur d'âme, la douceur,
Injustice, la libéralité, sont bien plus conformes à la nature que
les plaisirs, la vie, les richesses, toutes choses qu'une grande âme
méprise et tient à néant, lorsqu'elle les met en balance avec
l'utilité commune. Chercher son avantage au détriment d'autrui est
chose* plus contraire à la nature que la mort, la douleur et tous
les maux de ce genre. Entreprendre de grands travaux, passer par les
plus rude» épreuves, pour servir, pour protéger, s'il est possible,
toutes les nations, à l'exemple de cet
492
Hercule que la reconnaissance des peuples plaça dans rassemblée des
immortels, voilà une vie bien plus conforme à la nature que celle
qui s'écoulerait dans la solitude, non-seulement loin de toute
peine, mais parmi les plus grandes voluptés, dans l'abondance de
tous les biens; ajoutons-y même, avec une beauté et des forces
merveilleuses. Il n'est pas une grande âme, il n'est pas un noble
génie qui ne préférât de beaucoup la première destinée à la seconde.
Dès que l'homme obéit à la nature, on voit donc qu'il ne peut nuire
à son semblable. Celui qui viole les droits d'autrui pour servir ses
propres intérêts croit de deux choses Tune, ou qu'il ne fait rien de
contraire à la nature, ou que la mort, la pauvreté, la douleur, la
perte de ses enfants, de ses proches, de ses amis, sont plus à
redouter que de faire tort à son prochain. S'il pense que l'on peut,
sans offenser la nature, attenter aux droits d'autrui, que
servira-Ml de raisonner avec un homme qui dépouille tout sentiment
humain? S'il croit que c'est une fâcheuse extrémité, mais qu'il est
des choses plus redoutables encore, comme la mort, la pauvreté, la
douleur, son erreur vient de ce qu'il regarde les maux du corps et
ceux de la fortune comme plus terribles que les maux de l'âme.
VI. Tous les hommes doivent donc avoir pour règle constante de ne
point séparer leur utilité particulière de l'utilité générale. Si
chacun ne pense qu'à son propre intérêt, dès lors la société est
dissoute. Il est encore facile d'entendre que si la nature commande
à l'homme de faire du bien à son semblable, quel qu'il soit, par
cela seul qu'il est homme comme lui, il en résulte nécessairement
que, conformément à cette même nature, l'intérêt de chacun se trouve
dans l'intérêt commun. S'il en est ainsi, nous sommes tous sous
l'empire d'une seule et même loi naturelle ; et partant, en vertu de
la loi qui nous régit, nous ne pouvons attenter aux droits de nos
semblables. Le premier principe étant vrai, le dernier est vrai
conséquemment. C'est une absurdité que de dire, comme certains
hommes, qu'ils ne feraient aucun tort à leur père ou à leur frère;
mais qu'ils ne se croient obligés à rien envers le reste de leurs
concitoyens. Us pensent donc que les membres d'une même société ne
se trouvent sous la garantie d'aucun droit, ne sont associe dans
aucun but d'utilité commune ? Cette opinion, je le déclare, conduit
directement au renversement de toute société. Pour ceux qui disent
que l'on doit respecter ses concitoyens, mais nullement les
étrangers, ils détruisent la société générale du genre humain, et
dès lors qu'elle n'existe plus, la bienfaisance, la libéralité, la
bonté, la justice, sont anéanties avec elle ; ceux qui attaquent ces
vertus adressent leur offense jusqu'aux Dieux immortels. Car ce sont
les Dieux qui ont établi entre tous les hommes cette société, dont
le lien le plus puissant est de penser qu'il est plus contraire à la
nature de faire tort à son semblable que de voir la fortune nous
accabler, et de souffrir tous les maux du corps, et même ceux de
l'âme, qui ne portent point atteinte à la justice. Car la justice
est la maîtresse et la reine de toutes les vertus.
Quelqu'un dira peut-être : Est-ce que le sage, se sentant mourir de
faim, ne pourra pas enlever le pain d'un homme qui ne sert à rien
en ce monde? Certainement non, car ma vie ne m'est pas plus
précieuse que cette disposition de mon
493
cœur à ne faire tort à personne pour mon propre intérêt. Mais encore
si un homme de bien, près de mourir de froid, peut enlever le
manteau d'un tyran cruel et inhumain, comme Phalaris, ne
l'enlèvera-t il pas? Toutes ces questions sont très-faciles à
résoudre. Si vous dérobez quoi que ce soit au dernier des hommes,
votre conduite est injuste et vous péchez contre la loi de la
nature. Cependant si l'utilité de la république, si l'intérêt du
genre humain sont intéressés à votre conservation, et que vous
dérobiez quelque chose à autrui pour sauver vos jours, vous ne serez
pas coupable; mais, à cette exception près, vous devez souffrir
tous les maux plutôt que d'entreprendre sur le bien d'autrui. Car
la maladie, la pauvreté et toutes les misères ne sont pas plus
contre la nature que le dommage causé à l'un de nos semblables ; et
rien n'est plus contraire à la nature que de porter atteinte à
l'utilité commune, car rien n'est plus injuste. La loi naturelle,
qui protège surtout l'intérêt public, ordonne sans contredit que les
choses nécessaires à la vie soient, s'il le faut, retirées à f homme
lâche et inutile, pour être données au bon citoyen, à l'homme de
cœur, dont la mort entraînerait un grand dommage pour le pays; mais
elles n'autorisent qui que ce soit à devenir injuste par
amour-propre ou par égoïsme. L'homme de bien s'acquittera toujours
de ses devoirs en songeant à l'utilité commune et en travaillant au
maintien de cette société humaine, sur laquelle on ne peut trop
revenir. Quant à ce qui touche Phalaris, la question n'a rien
d'embarrassant. Entre les tyrans et nous, il n'est aucune société ;
ils se sont séparés violemment de la communauté des hommes. Par conséquent il n'est
point contraire à la nature de dépouiller, quand on le peut, celui
qu'il est honnête de mettre à mort. C'est une race impie et méchante
dont il faut à tout prix purger la société ; car de même que l'on
coupe les membres où le sang et les esprits ne se portent plus et
qui sont nuisibles au reste du corps, il faut, par la même raison,
retrancher du corps social les êtres qui, sous la figure de l'homme,
cachent toute la cruauté des bêtes farouches. Toutes les questions
que l'on peut s'adresser, lorsqu'il s'agit de reconnaître son devoir
dans les circonstances critiques, sont du genre de celles que nous
venons d'examiner.
VIL Je crois que Panétius aurait résolu ces
diverses difficultés,
si quelque conjoncture ou d'autres occupations ne l'avaient empêché
d'exécuter son dessein. Pour s'aidera les résoudre, on trouvera
dans les livres précédents assez de préceptes qui apprendront à
discerner quelles sont les choses à fuir comme interdites par le
devoir, quelles sont celles que l'on peut se permettre comme ne
blessant point l'honnêteté. Notre ouvrage est presque achevé; mais,
pour y mettre la dernière main, il faut que nous recourions à la
méthode des géomètres, qui ne donnent pas la preuve de toutes leurs
propositions, mais demandent qu'on leur accorde certains principes,
pour rendre leurs démonstrations plus faciles : je demande donc,
mon cher enfant, que vous m'accordiez , si vous le pouvez, que rien
au monde n'est désirable si ce n'est l'honnête. Si cette maxime ne
convient pas à Cratippe, vous m'accorderez du moins que de tous les
biens l'honnête est le plus désirable pour son excellence propre.
494
L'un ou l'autre de ces principes me suffira. Pour moi, c'est tantôt
le premier, tantôt le second qui me parait le plus probable; mais,
après eux, aucun autre principe ne m'offre de vraisemblance. Et
d'abord je dois défendre Panétius, qui n'a pas dit et ne pouvait pas
dire que l'honnête fût quelquefois en opposition avec l'utile, mais
seulement avec ce qui semble utile. Il affirme en plusieurs
endroits qu'il n'est rien d'utile qui ne soit honnête, et rien
d'honnête qui ne soit utile; il déclare que rien n'a été plus
pernicieux à la vie de l'homme que l'opinion de ceux qui
séparent
ces deux choses. Ce n'est donc pas pour que nous préférions jamais
l'utile à l'honnête, mais pour que nous puissions en faire un juste
discernement, que Panétius introduit entre l'honnête et l'utile
cette opposition dont toute la force est dans l'apparence, et qui
n'existe point dans la réalité. Mais il n'a point rempli la tâche
qu'il s'était marquée ; nous allons essayer de suppléer à son
silence sans le secours de personne, et, comme on dit, avec notre
propre Minerve. Car je n'ai rien trouvé de satisfaisant dans les
auteurs qui, depuis Panétius, ont voulu traiter cette matière, et
qui sont venus entre mes mains.
VIII. Lorsqu'il nous semble voir l'utile de quelque côté, nous nous y
portons nécessairement; mais si, après examen, nous découvrons
qu'une chose utile en apparence est contraire à l'honnêteté ,
alors il nous faut non-seulement renoncer à l'utilité qu'elle nous
promettait, mais reconnaître que si elle est déshonnête, elle
ne peut être utile en aucune sorte. Car s'il n'est rien de plus
contraire à la nature que ce qui blesse l'honnêteté, puisque la
nature veut partout l'équité la décence, la constance, et repousse
les défauts opposés ; et si d'un autre côté rien n'est plus
conforme à cette même nature que l'utile, il s'ensuit
manifestement qu'une même chose ne peut être à la fois
déshonnête et
utile. Disons encore que si nous sommes nés pour l'honnêteté, et
qu'elle soit au monde la seule chose désirable, comme Zénon
l'affirme, ou au moins la plus désirable de toutes, et
incomparablement au dessus des autres, comme le pense Aristote, il
en résulte nécessairement que l'honnête est ou le bien unique, ou
le souverain bien; or ce qui est un bien est certainement utile;
donc tout ce qui est honnête est utile. Mais les méchants se portent
avec avidité vers le parti qui leur semble avantageux, et voient
souvent, par une erreur fatale, leur utilité où l'honnéte n'est
pas. De là viennent les assassinats, les empoisonnements, les
testaments supposés; de là les vols, les concussions, le pillage des
alliés et des citoyens indignement dépouillés; de là les richesses
scandaleuses et le pouvoir odieux qu'elle donnent; de là la passion
de ces ambitieux qui veulent régner dans un État libre, passion la
plus criminelle et la plus infâme que l'on puisse imaginer. Ils
voient ou plutôt ils croient voir l'avantage que leur rapportera
leur crime, et ils ne voient nullement, je ne dis pas les menaces
des lois qu'ils renversent si souvent, mais le châtiment de
l'infamie, qui est de tous le plus cruel. Il faut donc proscrire ce
genre de délibération, toute criminelle et impie, où l'on se demande
si l'on prendra le parti de l'honnête qui se montre sans difficulté,
ou si l'on se souillera sciemment d'an crime : le doute seul est
coupable, lors même qu'on ne se déciderait pas à faire le mal.
Jamais on ne doit mettre en délibération les choses sur lesquelles
il est honteux de délibérer. Jamais non plus
495 nous ne devons être inclinés vers le mal par
l'espérance que nous concevrions de pouvoir le cacher. Pour peu
que nous ayons retiré de fruit de la philosophie, nous devons être
suffisamment persuadés qu'alors même qu'il nous serait
possible de
dérober nos actions aux regards des Dieux et des hommes, le devoir
nous commanderait toujours de ne nous porter à aucun acte
d'avarice, d'iniquité, d'incontinence ou de débauche.
IX. C'est à ce propos que Platon raconte l'aventure de Gygès, qui
voyant la terre entr'ouverte après une grande pluie, descendit dans
cette ouverture , et y aperçut, suivant la tradition, un cheval
d'airain dans les flancs duquel des portes étaient pratiquées : les
ayant ouvertes, il vit le cadavre d'un homme qui était d'une taille
extraordinaire, et qui avait au doigt un anneau d'or. Gygès tira cet
anneau et le mit à son doigt; puis, comme il était un des bergers du
roi, il revint près de ses compagnons. Se trouvant parmi eux,
lorsqu'il tournait le chaton de son anneau en dedans de la main, il
n'était vu de personne et voyait tout le monde ; et quand il
replaçait l'anneau dans sa position naturelle, il redevenait
visible. A la faveur de ce talisman, il séduisit la reine, fit périr
de complicité avec elle le roi son maître, se débarrassa de tous
ceux qui lui portaient ombrage, et commit tous ces crimes sans être
vu de personne. Ainsi, par la vertu magique de cet anneau, Gygès
devint tout à coup roi de Lydie. Si le sage possédait un tel anneau,
il ne se croirait en aucune façon plus autorisé à faire le mal que
s'il ne l'avait pas; car l'homme de bien recherche la vertu et non
l'impunité. Ici, quelques philosophes, qui sont certainement de
très-honnêtes gens, mais qui n'ont pas toute la pénétration possible, disent que
l'aventure racontée par Platon est controuvée et purement
imaginaire; comme si Platon la donnait pour véritable ou même pour
vraisemblable! Voici ce que signifie l'histoire de l'anneau.
Supposez que vous puissiez acquérir la fortune, la puissance, la
royauté, en commettant un crime qui n'aura nul témoin, ne sera
soupçonné de personne, et n'arrivera jamais à la connaissance des
Dieux ni des hommes, commettrez-vous ce crime? Ces philosophes nient
que la chose soit possible. Je ne pense pas comme eux, mais je leur
dis : Supposez par extraordinaire qu'elle soit possible; que
feriez-vous? Ils s'obstinent ridiculement à en nier la possibilité,
et ils ne voient pas la portée de notre question. Quand nous leur
demandons ce qu'ils feraient s'ils pouvaient commettre le crime
impunément, il ne s'agit pas de savoir s'ils en trouveront
réellement l'occasion, mais nous les mettons en quelque sorte à la
question : s'ils répondent qu'assurés de l'impunité, ils passeraient
outre, ils se reconnaissent tout préparés au crime; s'ils répondent
le contraire, ils avouent que les choses déshonnêtes sont à fuir par
elles-mêmes. Mais revenons à notre sujet.
X. Il se présente beaucoup de circonstances où nous avons à
délibérer sur les partis avantageux qui se présentent ; je ne parle
pas des cas où l'on délibère si l'on commettra un crime qui serait
en apparence d'une grande utilité, car ici le doute seul est
coupable ; mais de ceux où l'or se demande si l'on peut faire ce qui
serait utile sans blesser l'honnêteté. Lorsque Brutus retirait
l'autorité consulaire à son collègue Tarquin Collatin, il pouvait
paraître injuste, car il s'était aidé de ses conseils et de son bras
pour expulser les 496 rois.
Mais les principaux citoyens avaient pris la résolution de proscrire
tout ce qui portait le nom de Tarquin, d'abolir entièrement tout ce
qui rappelait le souvenir de l'autorité royale; et cette
détermination, utile à la patrie, était tellement honnête qu'elle
devait plaire même à Collatin. Ainsi donc ce parti, tout utile qu'il
était, ne fut adopté que parce qu'il était honnête ; je dis plus,
sans ce caractère d'honnêteté il n'eût même pas été utile. Mais il
n'en est pas ainsi de l'action du fondateur de Rome. Séduit par un
avantage apparent, persuadé qu'il lui était plus utile de régner
seul que de partager le pouvoir avec un autre, il donna la mort à
son frère. Il mit donc en oubli et la piété fraternelle et
l'humanité, pour arriver à une fin qui ne pouvait lui tenir
l'utilité qu'elle promettait ; cependant il allégua pour prétexte le
saut des remparts, et couvrit cet acte de barbarie d'une excuse qui
n'était ni sérieuse ni suffisante. Il a donc commis un crime, si je
puis le dire sans offenser Quirinus, ou l'ombre de Romulus. Nous ne
devons pas cependant trahir nos intérêts et les abandonner à autrui
; nos besoins nous font une loi d'y veiller, mais à cette condition
que nous n'offensions jamais nos semblables. Chrysippe a très-bien
dit, entre autres choses : « Celui qui court dans le stade doit
s'efforcer par tous les moyens qui sont en lui de remporter le prix
de la course; mais il lui est interdit d'arrêter du pied ou de la
nain ceux qui le lui disputent. De même, dans la vie, il n'est pas
injuste que chacun pourvoie à ses besoins; l'injustice commence du
moment où l'on fait tort à autrui. » C'est surtout dans l'amitié que
l'on risque le plus souvent de manquer à son devoir; car il est
également contre le devoir de refuser à nos amis le service qu'on
peut leur rendre sans scrupule, et de leur accorder ce que l'honnêteté défend. Mais, pour tout
ce qui concerne les rapports d'amitié, il est une règle bien simple
et facile à retenir. On doit préférer l'amitié à tout ce qui semble
purement utile, comme les honneurs, les richesses, les plaisirs et
autres biens du même genre; mais un homme de bien ne trahira jamais
pour son ami, ni la république, ni la bonne foi, ni son serment; et
s'il est appelé à le juger, il dépouillera alors le caractère d'ami
pour prendre celui de juge. Tout ce qu'il se permettra en faveur de
l'amitié, ce sera de faire des vœux intérieurement pour que la bonne
cause se trouve du côté de son ami, et de lui donner tout le temps
de défendre ses droits devant son tribunal, sans excéder ce¬pendant
la mesure marquée par les lois. Mais lorsqu'après avoir prêté le
serment il lui faudra prononcer la sentence, qu'il se souvienne
alors qu'il a Dieu pour témoin, c'est-à-dire, comme je l'interprète,
sa conscience, qui est le présent le plus divin que Dieu ait fait à
l'homme. Nos ancêtres avaient une fort belle coutume, que nous
aurions dû garder pour le bien de la république : c'était de ne
demander au juge que ce qu'il pouvait faire sans blesser sa
conscience. Cette règle revient parfaitement à ce que nous disions
tout à l'heure des devoirs d'un homme appelé à juger son ami. Si Ton
devait toujours faire ce qui plaît à son ami, il n'y aurait plus
d'amitiés, mais des complots. Je ne parle ici que des amitiés
vulgaires; car la hommes véritablement sages et les grands cœurs ne
donneront jamais de tels embarras à leurs amis. On raconte que
Damon et Phintias, tous deux Pythagoriciens, étaient unis par une si
belle amitié, que l'un d'eux, condamné à mort par Denys le
tyran,
ayant demandé quelques jours pour mettre ordre à ses affaires de
famille, l'autre s'engagea comme caution à demeurer pendant son
absence, 497
et à mourir pour lui s'il n'était pas revenu à l'époque fatale.
Mais le premier se représenta au jour marqué, et cette fidélité
mutuelle inspira une telle admiration au tyran, qu'il leur demanda
d'être admis en tiers dans leur amitié. Lors donc qu'en amitié
l'utilité apparente est en opposition avec l'honnête, méprisons
cette utilité, et rendons-nous au parti le plus noble. Et quand un
ami nous demande un service que l'honneur désapprouve, préférons la
religion et l'équité à l'amitié. C'est ainsi que nous saurons
reconnaître quel est ce véritable devoir que nous cherchons
maintenant à déterminer pour toutes les circonstances difficiles.
XI. C'est aux États surtout que l'apparence de futile fait commettre
des fautes nombreuses, témoin la destruction de Corinthe par le
peuple Romain. Les Athéniens furent encore plus cruels en faisant
couper les pouces aux Éginètes, qui avaient une marine puissante.
Cette barbarie leur paraissait utile ; car Égine était trop près du
Pirée, et par conséquent trop dangereuse. Mais rien de ce qui est
cruel ne peut être utile ; car la nature, dont nous devons suivre
les inspirations, répugne essentiellement à la cruauté. C'est
encore agir très-mal que d'interdire le séjour de nos villes aux
étrangers et de les en chasser, comme fit Pennus du temps de nos
pères, et Papius tout récemment. Sans doute rien n'est plus juste
que de ne pas donner les droits de citoyen à celui qui n'est pas de
la cité; c'est un abus que la loi des deux consuls Crassus et
Scévola a prévenu fort sagement; mais il y a de l'inhumanité à ne
point admettre les étrangers dans la ville. Combien n'admirons-nous
pas, au contraire, ces exemples mémorables où ce qui semblait
l'utilité publique a
été sacrifié à l'honnêteté I Notre histoire en est pleine, mais le
plus beau est celui que notre république a donné pendant la seconde
guerre Punique, lorsque, après la malheureuse journée de Cannes,
elle a fait paraître un plus fier courage qu'à aucune époque de ses
prospérités ; pas le moindre signe de frayeur, nulle démonstration
pacifique. Tel est l'empire de l'honnête, qu'il fait évanouir
l'apparence de l'utile. Les Athéniens, ne pouvant arrêter le flot de
l'invasion des Perses, résolurent d'abandonner leur ville, de
déposer les femmes et les enfants à Trézène, et de se retirer dans
leurs vaisseaux pour défendre sur mer la liberté de la Grèce. Un
certain Cyrsile leur conseillait de demeurer dans la ville et d'y
recevoir la loi de Xerxès ; ils le lapidèrent. Sans doute ce conseil
pouvait paraître utile; mais quand le devoir est d'un côté, la
véritable utilité ne se trouve jamais de l'autre. Après l'heureuse
issue de la guerre contre les Perses, Thémistocle vint déclarer,
dans une assemblée publique, qu'il avait conçu un projet
très-avantageux pour l'État, mais qu'il ne pouvait le divulguer.
Il
demanda au peuple de désigner quelqu'un avec qui il pût eu conférer
: on désigna Aristide. Thémistocle lui dit que l'on pouvait
incendier secrètement la flotte des Lacédémoniens, retirée dans le
golfe de Gythéum, et que cette perte serait un coup fatal pour la
puissance de Lacédémone. Aristide Payant entendu, revint dans
l'assemblée, où tous les esprits étaient dans une grande attente, et
il leur déclara que le projet de Thémistocle était très-utile,
mais nullement honnête. Les Athéniens jugèrent que s'il n'était pas
honnête, il ne pouvait être utile, et le repoussèrent sans en avoir
entendu un seul mot, et sur la seule parole d'Aristide. Ils
498
se conduisirent plus sagement que nous, qui accordons des franchises
aux pirates et accablons d'impôts nos alliés.
XII. Qu'il soit donc bien établi que jamais on ne peut trouver
rutile dans un parti opposé à l'honnête, non pas même quand on
aurait pris possession de ce prétendu avantage acquis malgré
l'honneur. C'est déjà un malheur que de croire utile ce qui est
déshonnête. Mais il arrive des circonstances, comme je l'ai dit, où
l'utile parait en opposition avec l'honnête, et où il faut se
demander si cette opposition est réelle, ou si l'on peut concilier
fun avec l'autre. Voici une difficulté de ce genre. Un honnête
homme est venu d'Alexandrie à Rhodes avec une forte cargaison de
blé; il y a disette dans l'Île et le blé s'y vend très-cher, mais
notre marchand sait qu'un grand nombre de vaisseaux chargés de
grains quittent le port d'Alexandrie pour venir à Rhodes; il en a
rencontré dans sa route plusieurs autres qui prenaient la même
direction : doit-il dire aux Rhodiens ce qu'il sait, ou garder le
silence pour vendre son blé à meilleur compte ? Nous supposons un
homme qui a de la conscience et de l'honneur, un véritable homme de
bien, qui n'hésitera pas à parler s'il voit du mal à se taire, mais
qui se demande si le devoir veut qu'il parle sur les difficultés de
cette nature. Diogène de Babylone, grave et célèbre Stoïcien, est
d'un avis, et Antipater son disciple, esprit très-pénétrant, est de
l'avis opposé. Ce dernier soutient qu'il faut tout déclarer, et que
l'acheteur ne doit rien ignorer de ce que sait le vendeur; Diogène
pense que le vendeur est tenu de faire connaître les défauts de sa
marchandise quand le droit civil l'ordonne, qu'il ne doit d'ailleurs
recourir à aucune fraude;
mais que, dans ces limites, il lui est bien permis, puisqu'il fait
le commerce, de vouloir en retirer le plus de bénéfice possible.
J'ai apporté du blé, je l'expose en vente; je ne le vends pas plus
cher que les autres; je le donne peut-être à meilleur marché qu'eux,
lorsqu'il y a une certaine abondance. A qui fais-je tort? Antipater,
de l'autre côte, vous presse par ces considérations : « Eh quoi,
dit-il, vous qui devez servir les intérêts de vos semblables et ceux
de la société, vous qui n'avez reçu le jour que sous la condition de
suivre les lois de la nature et d'y demeurer fidèle, de confondre
votre propre utilité avec l'utilité commune et de ne trouver votre
bien que dans le bien général, vous cacherez à vos semblables les
richesses et l'abondance qui leur arrivent? Diogène répondra
peut-être : Autre chose est cacher, autre chose se taire. Je ne
crois pas en ce moment vous cacher quelque chose, si je ne vous dis
point quelle est la nature des Dieux, ou en quoi consiste le
souverain bien ; et cependant ce sont là des choses qui vous
intéressent plus encore que le bon marché des grains; mais, en
vérité, je ne suis nullement tenu à vous dire tout ce qui peut vous
être utile. — Vous y êtes tenu, reprend Antipater ; souvenez-vous
donc que la nature a établi entre tous les hommes une étroite
société. — Je m'en souviens parfaitement, répondra Diogène ; mais
cette société m'interdit-elle d'avoir un bien qui m'appartienne en
propre? S'il en est ainsi, il n'est même plus permis de vendre, ; il
faut donner.
XIII. Vous voyez que dans toute cette discussion on ne dit pas :
Quoique la chose soit déshonnête, je la ferai, parce qu'elle
m'est avantageuse. 499
L'un prétend qu'elle est utile, mais ne blesse pas la conscience;
l'autre soutient qu'on ne doit pas la faire, parce que le devoir s'y
oppose. Un honnête homme met en vente une maison; il veut s'en
défaire pour certains défauts qu'il connaît et que le public ignore
; elle est malsaine et passe pour salubre ; on ne sait pas qu'il n'y
a point de chambre qui ne donne asile à des serpents; elle est mal
construite et menace ruine, mais le propriétaire est le seul qui
s'en soit aperçu. Je suppose maintenant qu'il ne dise rien aux
acheteurs, et qu'il vende sa maison beaucoup plus cher qu'il ne
l'estime lui-même, et je demande si, en agissant de la sorte, il se
conduit en malhonnête homme. — Certainement oui, dira Antipater.
N'est-ce pas en effet ne point montrer la route à celui qui s'égare,
chose que les Athéniens flétrissent par des exécrations publiques,
que de laisser l'acheteur tomber dans le piège le plus odieux, et se
casser le cou en quelque façon? C'est plus encore que de ne pas
montrer le chemin; c'est induire sciemment un homme dans une erreur
grave. — Diogène répond : Est-ce que le propriétaire vous a forcé
d'acheter? il ne vous y a pas même exhorté. Il a mis en vente une
maison qui ne lui plaisait pas, et vous l'avez achetée parce qu'elle
vous plaisait. Ceux qui ont fait afficher : Maison de campagne,
belle et bien bâtie, ne sont point taxés de fraude, si en réalité
elle n'est ni bien bâtie, ni belle. A plus forte raison ne doit-on
point accuser celui qui n'a point vanté sa maison. Comment peut-il y
avoir fraude de la part du vendeur, si vous avez vu et jugé par
vous-même ce dont vous faites l'acquisition? Si tout ce que l'on
dit n'engage pas, ce que l'on ne dit pas engagera-t-il? Quoi de plus
insensé qu'un vendeur qui s'en irait racontant tous les
défauts de ce qu'il met en vente? Quoi de plus divertissant qu'un
crieur public qui, par Tordre du propriétaire, crierait : à vendre
une maison malsaine? C'est ainsi que dans certains cas douteux, d'un
côté on défend avec sévérité le parti de l'honnête, de l'autre on
plaide si habilement la cause de l'utile, que non-seulement il
parait honnête de faire ce qui est avantageux, mais qu'il semblerait
même honteux de ne pas le faire. Vous voyez par là comment on peut
croire quelquefois que l'utile et l'honnête sont deux partis
opposés. Il nous faut maintenant prononcer sur ces difficultés ;
car si nous les avons proposées, ce n'est pas pour en montrer la
force, mais pour les résoudre. Il nous semble donc que ni le
marchand de blé ni le vendeur de la maison ne devaient laisser les
acheteurs dans l'ignorance. Sans doute, ce n'est pas celer une chose
que de la taire; mais c'est commettre cette faute, que de laisser
ignorer aux acheteurs, pour en faire votre profit, ce que vous savez
et qu'il serait de leur intérêt de savoir. Qui ne voit ce que
signifie un pareil silence, et à quelle espèce d'homme il convient?
Ce n'est certainement pas à l'homme droit, sincère, loyal, juste et
honnête, mais bien à l'homme faux, dissimulé, astucieux,
trompeur,
méchant, artificieux, rusé, perfide. Ne doit-on compter pour rien le
triste bénéfice qu'il y a à s'attirer ces titres et une foule
d'autres semblables?
XIV. Si l'on doit blâmer ceux qui font de telles réticences, que
penser de l'homme qui a recours aux mensonges? C. Canius, chevalier
romain, qui ne manquait pas d'esprit et qui avait assez de lettres,
étant allé à Syracuse, non pour affaires, mais, comme il le disait,
pour ne rien faire, répétait partout qu'il voulait acheter des
jardins, 300 où il pût inviter ses amis et jouir des douceurs de la
retraite, loin des importuns. Sur ce bruit, un certain Pythius, qui
faisait la banque à Syracuse , vient lui dire qu'il a des jardins
qui ne sont pas à vendre, mais dont il le prie d'user comme des
siens; et en même temps il l'y invite à souper pour le lendemain.
Camus accepte; aussitôt Pythius, qui avait, comme tous les
banquiers, une grande influence sur les gens de toute profession,
assemble des pêcheurs, les prie d'aller faire la pêche le lendemain
devant ses jardins, et leur explique tout ce qu'il désire d'eux. Canius est exact au rendez-vous : il trouve un festin
splendide
préparé par Pythius ; il voit une multitude de barques. Chacun des
pêcheurs apporte le poisson qu'il a pris et le jette aux pieds de
Pythius. Alors Canius : Qu'est-ce donc que tout ceci, Pythius? Quoi
! tant de poissons, tant de barques ! — Vous ne voyez rien
d'extraordinaire, dit Pythius; tout le poisson de Syracuse est ici,
c'est ici que l'on vient prendre de l'eau ; tous ces gens-là ne
sauraient se passer de cette maison. Canius alors s'enflamme ; il
presse Pythius de la lui vendre. Celui-ci fait d'abord des
difficultés; mais enfin il se rend. Le Romain, qui est riche et de
plus amoureux de la maison, en donne le prix que Pythius lui
demande, et l'achète toute meublée. On passe le contrat et l'affaire
est conclue. Canius invite ses amis pour le lendemain ; il vient
lui-même de bonne heure, et ne voit pas un esquif. Il s'informe du
premier voisin si c'était un jour de fête pour les pêcheurs, qu'il
n'y en eût aucun sur l'eau. — Non pas que je sache, répond le voisin
; mais on ne pêche jamais ici, et je ne savais hier ce que tout ce
monde voulait dire. — Canius est furieux; mais que faire? Aquillius, mon collègue et mon
ami, n'avait pas encore établi ses formules sur les actes
frauduleux. Quand y
a-t-il acte frauduleux? lui demandait-on C'est,
répondait-il, lorsqu'on feint une chose et qu'on en fait une autre.
Voilà qui est clairement expliqué, et où Ton reconnaît un homme
habile à définir. Pythius donc, et tous ceux qui font une chose et
en feignent une autre, sont perfides, injustes, méchants. Or, il est
bien certain qu'une conduite souillée de tant de vices ne peut
jamais nous procurer de véritables avantages.
XV. Si la définition d'Aquillius est juste, il faut bannir de la vie
la dissimulation et la ruse. Un homme de bien, pour mieux vendre, ou
pour acheter à meilleur compte, ne feindra et ne dissimulera jamais
rien. La fraude réprimée par Aquillius était déjà punie par quelques
lois, comme celle des douze Tables sur la tutelle, et la loi Létoria
sur la circonvention des mineurs ; en dehors même des lois, elle est
prévenue dans les actes où l'on ajoute ces mots, de bonne foi, et
dans tous ceux qui sont rédigés sous l'empire de certaines formules,
comme dans les conventions matrimoniales, en tout bien tout
honneur; dans les fidéicommis, comme on doit agir entre honnêtes
gens. Or, je le demande, peut-on donner place à la fraude dans un
acte qui porte en tout bien tout honneur? ou, lorsqu'il est dit
comme on doit agir entre honnêtes gens, peut-on se permettre la
moindre ruse, le moindre artifice? Un acte frauduleux consiste
surtout dans la feinte, comme dit Aquillius ; il faut donc bannir
le mensonge de toutes les transactions. L'acheteur et le vendeur
n'auront point de gens apposés pour surenchérir ou faire descendre
le prix des marchandises dans les ventes publiques; et
501
l'un comme l'autre, quand Us en viennent à traiter les affaires à
l'amiable, ne doivent avoir qu'une parole. Q. Scévola, fils de P.,
ayant demandé qu'on lui indiquât au juste le prix d'un fonds de
terre qu'il voulait acheter, le vendeur le lui fit connaître; mais
Scévola déclara qu'il ne le trouvait pas assez élevé, et ajouta cent
mille sesterces. Personne ne contestera que ce ne soit là le trait
d'un honnête homme ; mais on dira que ce n'est pas celui d'un homme
sage, et qu'acheter de cette sorte, c'est comme si l'on vendait son
bien le plus bas prix possible. Le mal est que l'on voie de la
différence entre honnête homme et homme sage. De là vient qu'Ennius
a dit : Que toute la sagesse ne sert de rien au sage, s'il n'en sait
tirer un parti utile. Je souscrirais volontiers à l'opinion
d'Ennius, si nous nous entendions tous deux sur le sens de ces mots
: un parti utile. Hécaton de Rhodes, disciple de Panétius, dit à Q.
Tubéron, dans son Traité des Devoirs : « Le vrai sage, sans rien
commettre contre les mœurs, les lois, les institutions de son pays,
prendra soin de sa fortune ; car ce n'est pas pour nous seuls que
nous voulons être riches, mais pour nos enfants, nos proches, nos
amis, et surtout pour la république. Les facultés et les ressources
des particuliers composent la richesse de l'État. » Celui qui a
écrit ces lignes n'aurait trouvé le trait de Scévola que
médiocrement de son goût. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'on
n'aura pas trop de reconnaissance ni une estime extraordinaire pour
celui qui, de son propre aveu, est prêt à tout faire pour ses
intérêts, sauf ce que les lois défendent expressément. Convenons
cependant que si toute feinte et toute dissimulation constitue une
fraude, il est peu d'actions dans la vie où la fraude ne se glisse
par uelque endroit. Et si l'honnête homme est celui qui rend
à autrui le plus de services possible, et ne nuit à personne,
certainement un tel homme est difficile à trouver. Concluons qu'il
n'est jamais utile de faire le mal, parce qu'une mauvaise
action
est toujours honteuse ; et qu'il est toujours utile d'être homme de
bien, parce que la bonne action est nécessairement honnête.
XVI. Notre droit civil ordonne au propriétaire d'un immeuble de
déclarer tous les défauts qu'il connaît au bien qu'il met en vente.
Les douze Tables avaient trouvé suffisant de rendre le vendeur
garant de tout ce qu'il annonçait et promettait, de condamner celui
qui faisait-une fausse déclaration à une amende qui était le double
du prix soldé; mais nos jurisconsultes ont encore établi une peine
contre la réticence. Ils ont statué que tout vice d'un immeuble,
connu du vendeur, donne recours en garantie contre lui, à moins
toutefois que ce vice n'ait été expressément déclaré. Les augures,
ayant à exercer leurs fonctions sur le Capitale, ordonnèrent à T.
Claudius Centumalus de faire démolir la maison qu'il avait sur le
mont Célius, et dont la hauteur les gênait pour prendre les
auspices. Claudius aussitôt de mettre sa maison en vente; il trouve
un acquéreur; c'est P. Calpurnius Lanarius. Mais les augures
signifient le même ordre à Calpurnius, qui est obligé de raser la
maison, et qui, apprenant que Claudius ne l'a mise en vente qu'à
cause de l'injonction qu'il avait reçue, intente une action en
garantie contre le vendeur, au nom de la règle qu'il ne faut rien
livrer qu'avec bonne foi La cause fut jugée par M. Caton, père de
notre Caton ; si nous faisons connaître les autres par le nom de
leurs pères, celui qui a mis au monde ce grand homme peut bien
recevoir son illus- 502
tration de son fils. Ce juge prononça donc : « Que le vendeur,
sachant l'ordre dus augures et ne l'ayant point déclaré dans l'acte,
devait indemniser l'acheteur. » Par ce jugement il établissait que
la bonne foi est intéressée à ce que l'acheteur soit instruit de
tous les défauts qui sont à la connaissance du vendeur. Si M. Caton
avait raison, le marchand de blé et le vendeur de la maison
malsaine ne pouvaient garder le silence sans blesser la justice.
Mais le droit civil ne saurait prévoir toutes les réticences de ce
genre; on poursuit avec rigueur toutes celles qu'il a prévues. M.
Marius Gratidianus, un de nos proches, avait vendu à C. Sergius Orata
une maison qu'il avait achetée de ce même Sergius quelques
années
auparavant. Cette maison devait une servitude; mais Marius n'en
avait rien dit dans l'acte de vente. L'affaire fut portée en
jugement. Crassus plaida pour Orata, et Antoine pour Gratidianus.
Crassus invoquait la loi, et soutenait que le vendeur, n'ayant point déclaré un
vice qu'il connaissait, devait indemniser l'acquéreur. Antoine se fondait sur
l'équité, et prétendait que Sergius connaissant tout le premier la servitude
d'une maison qu'il avait vendue naguère, il avait été inutile d'en parler dans
le contrat ; et qu'on ne trompe point un homme qui sait parfaitement dans quelle
condition se trouve le bien qu'il achète. Pourquoi ces exemples ?
pour vous faire entendre combien la fraude a toujours déplu à nos
pères.
XVII. Les lois ne sont point armées contre la fraude comme l'est la
philosophie; les lois ne peuvent atteindre l'artifice qu'autant
qu'il est, pour ainsi dire, palpable; la philosophie le poursuit
partout ou la raison et l'intelligence peuvent se faire jour. La
raison demande que nous ne fassions rien d'insidieux, rien
qui sente la dissimulation ou la fourberie. —Mais , direz-vous? si
j'ai tendu des embûches, je n'y pousse personne, je n'y amène point
les gens; on n'a pas toujours besoin de donner la chasse aux bêtes
fauves pour les faire tomber dans le filet. — Ainsi vous allez, en
sûreté de conscience, mettre votre maison en vente. Vous chercherez
à vous en défaire à cause de ses défauts; vous placerez des affiches
qui seront comme autant de pièges où donnera un jour quelque dupe!
Je sais bien que, par suite de la dépravation des mœurs, une telle
conduite n'est point regardée comme déshonnête, et ne tombe point
sous la vindicte des lois ou du droit civil ; mais elle est
condamnée par la loi naturelle. Nous l'avons dit souvent et on ne
peut trop le répéter, il y a une société immense qui s'étend par
tout le monde et réunit tous les hommes par | les mêmes liens ; il y
a une société plus restreinte, celle qui comprend tous les membres
d'une même nation. Il en est une plus réduite encore, et qui se
termine aux murs de la cité. C'est pourquoi nos pères ont toujours
distingué le droit des gens du droit civil : ce qui est commandé par
le droit civil ne l'est pas pour cela par le droit des gens; mais
tout ce que ce dernier prescrit, le droit civil y oblige. Le droit
véritable, la pure justice, n'habitent plus parmi nous; leur
impression divine s'est effacée de nos lois; à peine en avons-nous
conservé une ombre, une image imparfaite; heureux encore si nous la
suivions ! Car nous la devons aux meilleurs enseignements de la
nature et de la vérité. De quel prix n'est pas cette formule
consacrée : Que par vous ou voire foi je ne sois ni pris ni trompé ?
N'est-ce pas une maxime d'orque celle-ci : Comme il faut bien agir
entre honnêtes gens et sans fraude ? Mais la grande
503
question est de savoir ce qu'il faut entendre par bien agir et par
honnêtes gens. Q. Scévola, le grand pontife, disait que cet
engagement d'agir de bonne foi donnait une grande force à tous les
actes où on devait le contracter; qu'il était de l'usage le plus
étendu, et trouvait son lieu dans les tutelles, les associations,
les cautions, les mandats, les ventes, les achats, les fermages,
les locations, en un mot dans les transactions les plus importantes
de la vie civile, et qu'il fallait des juges fort éclairés pour
savoir reconnaître quels sont les droits de chacun dans les diverses
affaires déférées aux tribunaux, et sur la plupart desquelles la
jurisprudence a si souvent varié. Il faut donc proscrire toute
espèce de fraude, et surtout cette méchante habileté qui voudrait
passer pour la prudence, et qui en est si différente et si
éloignée. La prudence est l'art de discerner le bien d'avec le mal.
L'habileté coupable préfère le mal au bien, s'il est vrai toutefois
que tout ce qui est déshonnête est un mal. Et ce n'est pas seulement
en matière d'immeubles que le droit civil, conforme à la loi
naturelle, punit la fourberie et la fraude; il l'interdit encore
formellement dans la vente des esclaves. Celui qui vend un esclave
malade, coupable d'un vol, ou qui a pris la fuite, est tenu à
garantie par l'édit des édiles, quand il est présumé connaître, la
position de l'esclave. Il n'y serait pas tenu, s'il avait reçu
l'esclave en héritage. Puisque la nature est la source du droit,
nous devons entendre que rien n'est moins conforme à la nature que
de bénéficier sur l'ignorance d'autrui. Il n'est rien de plus
pernicieux dans la vie que de confondre une habileté coupable avec
la prudence ; c'est là ce qui donne naissance à ces difficultés
innombrables où l'on nous présente l'utile en opposition apparente avec l'honnête. Combien d'hommes trouverait-on qui
eussent le courage ue s'abstenir d'une injustice, s'ils étaient
assurés un secret et de l'impunité?
XVIII. Pour en faire l'expérience, vous n'avez qu'à examiner
quelqu'une de ces actions où le commun des hommes ne voit peut-être
aucun mal ; nous n'avons pas à parler ici d'assassins,
d'empoisonneurs, de faussaires, de voleurs, de concussionnaires,
sorte de gens qu'il faut envoyer au geôlier et non aux philosophes,
et dont les fers auront plus facilement raison que les arguments
des moralistes. Voyons comment se conduisent ceux qui passent pour
d'honnêtes gens. Quelques intrigants avaient apporté de Grèce à Rome
un faux testament du riche Minucius Basilus. Afin de recueillir
plus facilement la succession, ils s'étaient donné pour cohéritiers
Crassus et Hortensius, deux des hommes les plus puissants de cette
époque. Ceux-ci soupçonnaient bien la fausseté de l'acte; mais
comme ils se sentaient la conscience nette, ils ne se refusèrent
pas à profiter du crime d'autrui. Quoi donc! était-ce assez pour
rendre leur honneur sauf? Je dirai franchement que non, quoique
j'aie été l'ami d'Hortensius, et que je n'aie
nullement envie de
troubler les mânes de Crassus. Mais Basilus ayant légué son nom et
sa fortune au fils de sa sœur, M. Satrius, protecteur du Picénum et
de la terre des Sabins, était-il juste (je le demande à la honte de
cette époque) que deux puissants citoyens recueillissent la fortune,
et que Satrius reçût le nom de son oncle pour tout héritage? Si
l'homme qui n'empêche pas l'injustice et ne protège pas son
semblable, quand il le peut, manque par là à son devoir, comme nous
l'avons établi dans le premier livre,
504
que doit-on penser de celui qui, bien loin de s'opposer au mal, aide
lui-même à le commettre? Selon moi, les héritages véritablement
obtenus ne sont même pas honnêtes, quand on les doit à d'indignes
flatteries, à de fausses marques d'attachement. Or, en pareil cas,
l'utile semble quelquefois d'un côté et l'honnête de l'autre. Mais
c'est là une déplorable erreur; car l'utile et l'honnête sont soumis
à une seule et même règle : si vous n'en êtes pas convaincu, je ne
sache point d'action criminelle que vous ne soyez un Jour capable de
commettre. Vous vous direz sans cesse : « Voilà ce qui serait
honnête, mais voici ce qui est avantageux. » Vous oserez séparer
deux choses que la nature a unies, et tomberez dans une erreur qui
est la source de toutes les fraudes, de tous les crimes, de tous les
forfaits.
XIX. Ainsi donc, quand même un homme de bien n'aurait qu'à claquer
des doigts pour introduire son nom par un pouvoir magique dans les
testaments des riches, il ne s'en donnerait pas la licence, fût-il
assuré qu'aucun soupçon ne dût jamais se porter sur lui. Mais donnez
ce pouvoir à un Crassus, et que, sur un simple signe, les héritages
qui ne lui étaient pas destinés viennent à pleuvoir sur lui,
croyez-moi, vous le verrez sauter de joie au milieu du forum. Mais
l'homme juste, l'homme de bien, tel que nous l'entendons, ne fera
jamais tort à autrui d'une obole pour se l'approprier. Celui qui
trouve une pareille intégrité merveilleuse, confesse qu'il ne sait
ce que c'est qu'un homme de bien : qu'il s'interroge lui-même, il
verra gravé au fond de son esprit que le caractère de l'homme de
bien est de se rendre utile à ses semblables le plus possible, et de
ne nuire à personne, si ce n'est
504 dans le cas d'une légitime défense. Eh bien ! dites-moi si ce ne
serait pas nuire à ses semblables que d'user de je ne sais quel
sortilège pour écarter les véritables héritiers et se substituer à
leur place? Il sera donc interdit, va-t-on m'objecter, de faire ce
qui est utile et avantageux? Bien mieux, on doit comprendre qu'il
n'y a rien d'utile ni d'avantageux en compagnie de l'injustice.
Celui qui ignore cette vérité ne peut être homme de bien. Je me
souviens d'avoir entendu raconter à mon père, dans mon enfance, que
le consulaire Fimbria vit arriver devant son tribunal M. Lutatius
Pinthia, chevalier romain fort considéré, qui s'était engagé à
prouver en justice qu'il était honnête homme. Fimbria déclara qu'il
ne jugerait jamais une telle cause, parce qu'il ne voulait pas
s'exposer à ruiner la bonne réputation d'un homme estimé
généralement , s'il jugeait contre lui ; ou à prononcer qu'il
existe un parfait honnête homme, lorsque la véritable honnêteté
implique tant de vertus et un si prodigieux mérite. Pour l'homme de
bien tel que Fimbria l'entendait et que Socrate l'avait conçu, il
n'est rien d'utile qui ne soit honnête en même temps. Jamais un
homme de cette trempe ne se permettra une action, je dis plus, ne
s'arrêtera à une pensée, qu'il ne soit prêt à dévoiler au monde
entier. N'est-il pas honteux que les philosophes doutent d'une chose
dont ne doute même pas l'esprit grossier du peuple à qui nous devons
un proverbe qui remonte à la plus haute antiquité? Lorsque les gens
du peuple veulent louer la bonne foi et la probité d'un homme ils
disent qu'on pourrait jouer avec ha dans les ténèbres.
Qu'entendent-ils par là, si ce n'est qu'en dehors de l'honnêteté il
n'y a plus 505
rien d'avantageux, lors même que l'on peut arriver à ses fins sans
obstacle? Voyez-vous comment ce proverbe condamne à la fois et le
pasteur Gygès, et l'homme dont je parlais tout-à-l'heure, qui, en
remuant les doigts, s'approprierait tous les héritages? SU est vrai
qu'une chose honteuse, bien que cachée à tout jamais, ne peut en
aucune sorte devenir honnête, il ne l'est pas moins qu'une chose
déshonnête, malgré tous les efforts imaginables, ne peut devenir
utile, car la nature y répugne et s'y oppose.
XX. Mais, dira-t-on, quand il s'agit d'un très-grand avantage, une
légère faute est bien excusable. C. Marius, qui n'avait guère
d'espoir d'arriver au consulat; qui, sept ans après sa préture, se
voyait sans avenir et ne semblait pas promettre un consul à la
république, ayant été envoyé à Rome par Q. Métellus, un de nos
grands hommes et de nos bons citoyens, dont il était le lieutenant,
accusa devant le peuple ce général de traîner la guerre en
longueur, et promit que si on le nommait lui-même consul, il
réduirait bientôt Jugurtha, mort ou vif, sous la puissance du
peuple Romain. De cette manière il arriva au consulat ; mais à quel
prix? en trahissant la justice et la bonne foi, en ruinant par une
calomnie le crédit d'un excellent citoyen, du plus honorable des
hommes, dont il était le lieutenant et l'envoyé. Je vous citerai
encore un trait qui n'est pas celui d'un parfait honnête homme ;
l'auteur en est Gratidianus, notre parent. Pendant sa préture, les
tribuns du peuple se réunirent au collège des préteurs, pour faire
d'un commun accord un règlement sur les monnaies ; car à cette
époque la valeur des monnaies variait tellement, que personne ne
pouvait savoir au juste quelle était sa fortune. Ils rédigèrent en
commun un édit avec les dispositions pénales nécessaires, et ils convinrent de monter tous
ensemble au forum l'après-midi. Sur quoi ils se séparèrent, chacun
allant de son côté ; maie Marius, en quittant le prétoire, se rendit
directement au forum, et porta seul redit qu'ils avaient tous fait
en commun. Qu'en arriva-t-il? me de-manderez-vous. Notre parent y
gagna de grands honneurs; on lui dressa dans toutes les rues des
statues qui furent illuminées et encensées; et jamais citoyen ne
fut plus cher à la multitude. Voilà comment les hommes fléchissent
parfois et sont entraînés, quand ils voient qu'une faute légère peut
leur procurer un très-grand avantage. Gratidianus pensa que ce ne
serait pas commettre un crime de ravir la faveur populaire à ses
collègues et aux tribuns du peuple, et qu'il lui serait fort utile
d'arriver par là au consulat, objet de ses vœux à cette époque. Mais
il est pour toutes les circonstances une seule et même règle, et je
souhaite vivement que vous ne la perdiez jamais de vue : il faut ou
que le parti qui vous semble utile ne soit pas déshonnête, ou s'il
est déshonnête, qu'il ne vous paraisse pas utile. Quoi donc !
pourrions-nous regarder comme honnête la conduite de Marius ou
celle de Gratidianus? Réfléchissez-y, interrogez votre raison, voyez
quelle idée elle se forme de l'homme de bien, quel portrait elle en
trace. Trouvez-vous dans ce portrait qu'un homme de bien puisse
chercher son intérêt dans le mensonge, la calomnie, la fraude,
l'usurpation du bien d'autrui? Rien moins. Comment donc pouvez-vous
penser qu'il y ait un avantage assez précieux, un bien assez
magnifique pour qu'on lui sacrifie le nom d'honnête homme et la
gloire qui s'y attache? L'utilité dont on nous parle a-t-elle une
vertu assez merveilleuse pour compenser tous les trésors qu'elle
nous enlève en nous dépouillant du titre
506
d'honnête homme, en nous ravissant ra justice et ta bonne foi?
Quelle différence mettez-vous entre un homme qui se changerait en
bête féroce, et celui qui cache sous la figure humaine toute la
cruauté des animaux sauvages?
XXI. Et que penser de ceux qui foulent aux pieds tout ce qui est
juste et honnête, pour arriver au pouvoir? N'est-ce pas là ce que
fit un jour celui qui voulut avoir pour beau-père un homme dont
l'audace doublât sa puissance? Il lui semblait utile d'accroître
son pouvoir en laissant à un autre l'odieux du rôle. Mais il ne
voyait pas combien cette conduite était injuste envers sa patrie,
honteuse et funeste à ses vrais intérêts. Pour le beau-père, il
avait toujours à la bouche deux vers grecs des Phéniciennes, que je
vais traduire comme je pourrai, avec peu d'élégance peut-être, mais
de manière à bien faire entendre la pensée : « S'il faut commettre
l'injustice pour arriver au pouvoir, commettons-la ; mais, en toute
autre circonstance, soyons honnêtes gens. » Malédiction sur Étéocle
ou plutôt sur Euripide, qui fait une exception précisément pour le
plus infâme de tous les crimes ! À quoi bon nous arrêter longtemps
sur des vétilles comme des héritages, des marchés, des ventes
frauduleuses? Voilà un homme qui eut l'ambition d'être le roi du
peuple Romain et le maître de toutes les nations, et qui le devint
en effet. Celui qui regarde une telle ambition comme honnête est un
insensé ; car il approuve l'anéantissement de la liberté et des
lois, et tient pour glorieuse l'oppression la plus horrible et la
plus abominable. Fait-on l'aveu que rien n'est moins honnête que de
régner dans un État qui fut libre et devrait toujours l'être, tout en
soutenant qu'une semblable domination est utile à qui peut l'exercer ? Je ne
sais vraiment quels reproches, ou plutôt quelles invectives il ne
serait pas permis d'employer pour arracher les esprits à cette
erreur monstrueuse. Est-il un homme, au nom du ciel, à qui le plus
affreux, le plus exécrable des parricides puisse être utile, quoique
nous ayons vu celui qui s'en était souillé se faire nommer, par ses
concitoyens opprimés, le Père de la patrie? C'est à la lumière de
l'honnête qu'il faut chercher l'utile ; et l'on ne doit jamais
oublier que ces deux mots, en apparence si différents, au fond
n'expriment qu'une même chose. Dans l'opinion du vulgaire, il
n'est rien de plus avantageux que de régner; et si je veux
examiner les choses au jour de la vérité, je trouve au contraire
que rien n'est plus funeste pour celui que l'injustice a porté à ce
rang suprême. Quel avantage peut-on rencontrer dans les soucis, les
angoisses, les terreurs continuelles, les pièges et les périls
dont on est environné de toutes parts? « Un roi est entouré
d'ennemis et de traîtres; bien peu d'hommes lui sont dévoués, » dit
Accius. Et de quel roi parle-t-il ainsi? de celui qui tenait son
autorité légitime de Tantale et de Pélops. Combien plus d ennemis
ne devait-il pas avoir, celui qui s'était servi de l'armée du peuple
Romain pour opprimer le peuple Romain lui-même, et contraindre une
ville qui non-seulement était libre, mais qui commandait aux
nations, à plier sous sa loi ! Quelles tortures secrètes ne
souffrait-il pas ! de quels remords n'était-il point déchiré ! Quels
grands biens peut trouver dans la vie l'homme qui s'est mis dans une
telle condition, que ce sera s'acquérir un des plus beaux titres à
la reconnaissance des peuples et à la gloire, que de lui donner le
coup de la mort? Si donc la souveraine puissance, qui sem-
507 ble promettre les plus
merveilleux avantages, n'en apporte réellement aucun lorsqu'elle est
la compagne de la honte et de l'infamie, il doit être suffisamment
prouvé qu'on ne peut rencontrer l'utile où l'honnête n'est pas.
XXII. Nos ancêtres ont souvent montré qu'ils en étaient convaincus,
et je n'en veux pas de plus belle preuve que l'exemple donné par
Fabricius et par le sénat lors de la guerre de Pyrrhus. Le roi
était venu sans provocation attaquer le peuple Romain; il était
brave et puissant, et nous combattions contre lui pour la liberté et
l'empire : un transfuge de son armée vint dans le camp de
Fabricius, et offrit au consul Romain, s'il voulait lui promettre
une récompense, de retourner dans le camp de Pyrrhus aussi
secrètement qu'il en était sorti, et d'empoisonner son maître Pour
toute réponse Fabricius le fit ramener à Pyrrhus, et sa conduite
fut hautement ap¬prouvée par le sénat. A ne considérer que futilité
apparente cl les préjugés vulgaires, ce seul transfuge délivrait la
république d'une grande guerre et d'un ennemi redoutable ; mais dans
une lutte ou nous combattions pour l'honneur, c'eût été un opprobre
et une infamie de demander la victoire a un lâche attentat et non Λ
notre valeur. Quel était donc le parti le plus utile et pour
Fabricius, qui fut a Rome ce qu'Aristide avait été dans Athènes, et
pour notre sénat, qui ne sépara jamais l'utilité de l'honneur, de
combattre l'ennemi avec nos épées ou de l'attaquer par le poison ?
Si c'est pour la gloire que Ton dispute l'empire, il faut garder ses
mains pures de tout crime, car le crime est fatal a la gloire; si
l'on veut à tout prix acquérir la puissance, entachée d'infamie,
elle nous deviendra funeste. Ce n'était donc pas un conseil utile
que celui de L. Philippus, fils de Q., lequel demandait que Ton
rendit de nouveau tributaires les villes que Sylla avait affranchies
moyennant rançon en vertu d'un sénat us-consulte, et qu'on ne leur
remît point l'argent qu'elles avaient donné pour se racheter. Le
sénat suivit cet avis, mais à la honte de Rome ; car on trouve plus
de bonne foi chez les pirates. — Les revenus de l'État, dira-t-on,
furent augmentés d'autant; c'était donc une résolution utile. —
Jusques à quand osera-t-on nous dire qu'il y a quelque chose d'utile
en opposition avec l'honnête? Comment un empire, qui doit trouver
son principal appui dans sa propre gloire et la bienveillance de ses
alliés, peut-il chercher son avantage dans le déshonneur et la haine
qu'il excite? Aussi me suis-je trouvé plus d'une fois en
dissentiment avec Caton. Il me paraissait défendre avec trop
d'opiniâtreté l'intérêt du trésor public; il ne voulait rien
accorder aux fermiers de l'État, et refusait presque toujours les
demandes de nos alliés, tandis que nous devions nous montrer
généreux pour ceux-ci, et agir avec les autres comme chacun de nous
agit avec le fermier de ses propres biens ; d'autant plus que la
bonne harmonie entre les deux ordres importait singulièrement au
salut de l'État. Je dois aussi blâmer la conduite de Curion, qui,
tout en déclarant que la cause des Transpadans était juste,
ajoutait sans cesse : « Que l'intérêt de l'État l'emporte! » Il
aurait mieux fait de dire que leur cause n'était pas juste
puisqu'elle n'était pas utile à la république, que de soutenir
qu'elle blesserait les intérêts de l'État, et d'avouer cependant
qu'elle était juste.
XXIII. Le sixième livre des Devoirs d'Hécaton est plein de
questions pareilles à celle-ci : Est-
508 il d'un homme de bien de refuser
de la nourriture à ses esclaves dans un temps d'extrême disette? Il
examine le pour et le contre; mais il décide enfin qu'il vaut mieux
se laisser conduire par son intérêt que par l'humanité. Il demande
si, dans une tempête où l'on est réduit à jeter une partie de la
charge à la mer, on sacrifiera plutôt un cheval de prix qu'un
esclave de peu de valeur. — L'intérêt dit non, l'humanité dit oui.
— Si au milieu d'un naufrage un misérable s'empare d'une
planche de
salut, le sage la lui arrachera-t-il, s'il en a la puissance? — Le
sage ne le fera pas, dit Hécaton, parce que cela est injuste. — Et
le maître du vaisseau ne reprendra-t-il pas ce qui lui appartient?
— Point du tout; il n'y serait pas plus autorisé qu'à jeter un
passager dans la mer, sous le prétexte que le vaisseau lui
appartient. Tant qu'on n'est pas arrivé au lieu de
débarquement, le
vaisseau appartient beaucoup moins au propriétaire qu'aux passagers.
— Si deux naufragés trouvent une même planche de salut, et que ces
deux naufragés soient des sages, chacun d'eux devra-t-il la tirer à
soi ou l'abandonner à l'autre? La planche doit être cédée, mais à
celui dont la vie est le plus précieuse, soit pour lui-même, soit
pour la république. — Mais si l'existence de l'un a autant de prix
que celle de l'autre? Les deux sages ne lutteront point, mais ils
tireront au sort à qui devra céder. — Si un fils sait que son père
pille un temple, pratique un souterrain pour voler le trésor public,
ira-t-ii le dénoncer aux magistrats? Ce serait un crime ; le devoir
du fils serait même de défendre son père si on le traduisait en
justice. — Notre premier devoir n'est-il donc pas de veiller à
l'intérêt de la patrie? Certainement oui; mais la patrie est
fort intéressée à ce que les citoyens connaissent la piété filiale. — Mais si le
père aspire à la tyrannie, s'il veut trahir l'Etat, le fils gardera-t-il le
silence? Non pas; il suppliera son père de renoncer à son dessein;
si ses efforts sont vains, il en viendra aux reproches, aux menaces
même ; et à la dernière extrémité, si le pays est véritablement en
danger, il préférera le salut de la patrie à celui de son père.
Hécaton demande encore si le sage qui a reçu par inadvertance de
mauvais écus pour de la bonne monnaie, et qui vient à s apercevoir
qu'ils sont faux, les donnera en payement à son créancier pour
argent comptant Diogène dit oui, Antipater dit non ; et je suis
plutôt de ce dernier avis. — Celui qui met en vente du vin qui n'est
pas de garde, et qui en connaît le défaut, doit-il en prévenir?
Diogène pense qu'il n'y est pas obligé ; Antipater soutient que
c'est le devoir d'un honnête homme. Telles sont les questions de
morale que les Stoïciens ont coutume d'agiter. — En vendant un
esclave, doit-on déclarer les défauts qu'on lui connaît? je ne parle
pas de ceux que le droit civil nous commande de faire connaître,
sous peine de nullité ; mais direz-vous, par exemple, qu'il est
menteur, joueur, voleur, ivrogne? Vous devez le dire, suivant
Antipater. Vous n'y êtes pas tenus, selon Diogène. — Si quelqu'un
veut vendre de l'or, croyant que c'est du clinquant, l'honnête homme
qui achète lui apprendra-t-il que c'est de l'or, ou payera-t-il un
denier ce qui en vaut mille? — Je crois vous avoir fait assez
connaître mon sentiment sur toutes ces questions, et la diversité
d'opinions qui existe entre les philosophes que j'ai nommés.
XXIV. Doit-on tenir toujours les conventions et les promesses qui
n'ont point été arrachées par la violence ou surprises par la ruse,
comme disent les préteurs? Je suppose un homme à qui l'on a donné
un remède contre l'hydropisie, et qui s'est engagé, si ce remède le
guérissait, à 509 n'en faire
usage pour qui que ce soit dans l'avenir : le voilà guéri, mais au
bout de quelques années le mal reparaît ; celui qui a reçu sa
parole ne veut pas lui permettre de se servir du remède une seconde
fois : que fera notre malade ? L'homme au remède est un barbare, ce
n'est point lui faire tort que de sauver sa vie; l'hydropique
prendra donc conseil de sa santé. Imaginons maintenant qu'un sage
soit prié par un testateur qui le fait son héritier, et lui laisse
un million de sesterces, d'aller danser en plein jour sur la place
publique avant d'entrer en possession de l'héritage, et qu'il
promette de remplir cette condition, faute de laquelle il
n'hériterait pas : doit-il faire ou nonce qu'il a promis? J'aimerais
mieux qu'il n'eût pas fait cette promesse, et je crois qu'un tel
engagement ne convenait pas à sa gravité. Mais puisqu'il l'a pris,
je lui conseillerais plutôt de renoncer à l'héritage s'il voit de la
honte à danser dans le forum, à moins qu'il ne trouvât l'occasion de
rendre un service signalé à la république en lui consacrant cette
fortune; car il n'y aurait pas de honte à danser pour le bien de son
pays.
XXV. Il ne faut pas non plus accomplir les promesses qui ne sont pas
utiles à ceux à qui on les a faites. Pour chercher encore nos
exemples dans la fable, le Soleil promit à Phaéthon son fils de toi
accorder tout ce qu'il souhaiterait. Phaéthon demanda de monter sur
le char de son père; il y monta ; mais avant d'y avoir pris place,
il fut frappé d'un coup de foudre. Combien n'eût-il pas mieux valu
pour lui que son père ne tint pas sa promesse! Que dirons-nous de
Thésée, et de la parole de Neptune si malheureusement invoquée? Ce
dieu lui ayant donné trois vœux à former,
Thésée souhaita la mort de son fils Hippolyte, qu'il soupçonnait d'une
passion criminelle pour Phèdre; et l'accomplissement de son vœu le
plongea dans le plus grand deuil. Que penser d'Agamemnon qui avait
fait vœu d'immoler à Diane ce qui naîtrait de plus beau dans son
royaume pendant le cours de l'année, et qui sacrifia Iphigénie,
parce que l'année n'avait rien vu naître de plus beau que sa fille?
Il fallait plutôt ne pas tenir sa promesse, que de commettre un
crime tellement abominable. Il est donc des circonstances où l'on
ne doit point tenir sa parole; il en est aussi où l'on ne doit point
rendre un dépôt. Si un homme, jouissant de sa raison, a remis sou
épée entre vos mains, et qu'il vienne la réclamer étant en
démence,
ce serait une faute que de la lui remettre; c'est un devoir de la
conserver. Un autre vous a confié une somme d'argent; il fait.la
guerre à sa patrie : lui rendrez-vous son dépôt? Je ne vous le
conseillerais pas, car ce serait nuire à la république , qui doit
vous être plus chère que tout au monde. Vous voyez ainsi que
plusieurs actions, qui de leur nature semblent justes, deviennent
injustes dans certaines circonstances. Tenir sa promesse ,
accomplir un engagement, rendre un dépôt, voilà tout autant de
choses qui deviennent injustes quand elles sont nuisibles à nos
semblables. En voilà assez, je pense, sur les actions qui, sous un
faux jour de prudence, paraissent utiles, quoique opposées à la
justice.
Mais comme, dans le premier livre, nous avons fait découler tous les
devoirs des quatre sources de l'honnête, nous serons fidèles à nos
propres maximes en montrant combien tout ce qui semble utile et ne
Test réellement pas est hostile à quelqu'une des vertus. Nous avons
déjà parlé de la 510
prudence que cherche à imiter une méchante t habileté, et nous avons
prouvé que la justice est toujours utile. Il ne reste plus alors
que deux ver-tut fondamentales, dont Tune se manifeste par la
grandeur du caractère et la force de l'âme, et l'autre se produit
dans la modération, la retenue, la tempérance.
XXVI. Il semblait utile à Ulysse, suivant une tradition conservée
par certains poètes tragiques (car Homère, qui est ici la meilleure
des autorités, ne laisse pas planer un tel soupçon sur ce héros);
il lui semblait utile, à entendre ces tragiques, de contrefaire
l'insensé pour ne point aller à la guerre de Troie. L'honneur blâme
une telle conduite. Mais l'intérêt l'approuve, dira-t-on; de cette
sorte, Ulysse eût régné tranquillement à Ithaque, entouré de ses
parents, de son épouse, de son fils. Pensez-vous que les labeurs et
les périls de la guerre puissent donner aucune gloire qui mérite
d'être comparée aux douceurs de cette vie paisible? Pour moi, je
tiens qu'Ulysse devait mépriser et fuir ces douceurs, parce que j'ai
pour maxime qu'où l'honnête n'est pas, l'utile ne se trouve jamais. À
quelle flétrissure Ulysse ne se fût-il pas exposé, s'il eût employé
plus longtemps un pareil subterfuge, lui qui, après avoir fait de si
beaux exploits, entendit pourtant Ajax lui dire :
« Celui qui le premier nous a excités à prêter le serment de guerre,
comme vous le savez tous, celui-là l'a trahi. Il s'est mis à
contrefaire l'insensé pour ne point marcher avec nous ; et si le
coup d'œil pénétrant du sage Palamède n'eût découvert sa ruse
impudente, il trahirait encore une cause qu'il a mise le premier
sous la religion du serment.»
Il valut mieux pour lui combattre non seulement les ennemis, mais
encore les flots soulevés, comme il y fut contraint plus d'une fois,
que de faire défaut à la Grèce, réunie d'un commun accord pour
porter la guerre aux barbares. Mais laissons là les fables et les
nations étrangères, Tenons à la réalité et à notre propre histoire.
M. Atilius Régulus, consul pour la seconde fois, ayant été pris dans
une embuscade, en Afrique , par Xanthippe, général lacédémonien,
qui servait sous les ordres d'Hamilcar, père d'Annibal, fut envoyé
au sénat, après s'être engagé sous serment de revenir à Carthage,
s'il n'obtenait la délivrance de quelques nobles prisonniers. Arrivé
à Rome, un parti d'une utilité bien apparente s'offrit à lui, mais
l'événement s'est chargé de prouver que cette apparence ne lui
faisait point d'illusion : c'était de demeurer dans sa patrie, de
vivre tranquillement chez lui avec sa femme et ses enfants, et,
tout en regardant le malheur qu'il avait éprouvé dans la guerre
comme un de ces coups que frappe indistinctement le sort des armes,
de tenir le rang et de conserver la dignité d'un consulaire. Qui
pourrait nier que ce parti ne présentât de grands avantages? qui le
pourrait, demandez-vous ? Le courage et la grandeur d'âme.
XXVII. Vous faut-il des autorités plus imposantes? Le propre de ces
vertus est de ne rien craindre, d'élever l'âme au-dessus de toutes
les choses humaines, et d'entretenir cette conviction qu'il n'est
sorte d'infortune que l'homme ne puisse supporter. Aussi que fit
Régulus? Il vint au sénat , il exposa l'objet de sa mission, et
déclina d'abord l'honneur de donner son avis. Tant qu'il serait lié
par serment envers les ennemis, disait-il, il n'était plus sénateur.
Mais enfin (ό l'insensé, 511
dira-t-on, qui sacrifiait ses propres intérêts !) il déclare qu'il
ne serait point utile à la république de rendre les captifs ; que
c'étaient des hommes jeunes encore et de bons capitaines; et que,
pour lui, ses forces étaient déjà brisées par la vieillesse. Son
autorité prévalut ; on conserva les prisonniers, et il retourna à
Carthage, sans que l'amour de la patrie ni la tendresse des siens le
pussent retenir. Il n'ignorait pas alors qu'il allait se remettre
dans les mains de l'ennemi le plus cruel, et s'offrir à des
supplices inouïs ; mais il pensait qu'il fallait observer la
religion du serment. Aussi pendant les veilles affreuses et au
milieu des tortures était-il dans une condition meilleure que s'il
eût traîné sa vieillesse à Rome, prisonnier de Carthage et
consulaire parjure. — Mais, dira-t-on, comment, loin d'opiner pour
le rachat des captifs, put-il pousser la démence jusqu'à persuader
au sénat de les retenir? — Eh ! de quelle démence parle-t-on? y en
a-t-il à servir les intérêts de son pays? ce qui serait funeste à la
république peut-il être utile à l'un des citoyens?
XXVIII. C'est renverser les fondements posés par la nature, que de
séparer l'utile de l'honnête. Nous recherchons tous l'utile, nous
sommes tous entraînés vers lui par une impulsion à laquelle nous ne
saurions résister. Quel est l'homme qui méprise ses intérêts? ou
plutôt quel est celui qui ne poursuit pas ses avantages avec une
ardeur extraordinaire? Mais comme nous ne pouvons les trouver que
dans la bienséance, la justice et L'honneur, nous accordons à toutes
ces grandes choses une prééminence et une dignité incomparables; et
nous voyons dans ce qui est utile plutôt un rapport avec nos
nécessités que de la noblesse. Qu'y a-t-il donc de si redoutable
dans le serment, nous demandera-t-on ? Craignez-vous la colère de
Jupiter? Mais tous les philosophes , non-seulement ceux qui
prétendent que Dieu ne fait rien et ne s'occupe de personne, mais
ceux même qui le représentent comme agissant toujours et suivant le
cours de ses desseins, nous enseignent d'un commun accord que Dieu
n'est jamais irrité, jamais malfaisant. Et quand Jupiter se fût offensé,
aurait-il châtié Régulus plus durement que ce consul ne se
frappa lui-même? Il n'y avait donc point de force de religion qui ne
dût céder à de si grands intérêts. Mais Régulus craignait de faire
une chose honteuse. D'abord, entre les maux, il faut choisir le
moindre. Toute la honte dont on nous parle aurait-elle été un mal
aussi grand que le fut son supplice? Ensuite ne pouvait-il pas
répondre, comme dans Accius : « Tu as violé ta foi. Je n'ai pas
donné et je ne donne pas ma foi à qui n'en eut jamais. »1I est vrai
que c'est un roi impie qui parle, mais ce qu'il dit est excellent.
Ceux qui blâment Régulus nous disent encore : Vous soutenez que
certaines choses paraissent utiles, qui réellement ne le sont point
; et nous prétendons, nous, que certaines choses semblent honnêtes
qui ne le sont pas ; et que l'on croit honnête, par exemple, d'aller s'offrir aux tortures par respect pour son serment, mais que
l'honneur n'y est aucunement engagé, car on n'est pas tenu à
accomplir une promesse arrachée par la violence. Enfin nous
déclarons que toute chose qui est à l'homme d'une très-grande
utilité devient honnête par cela seul, lors même qu'auparavant
512
elle ne le paraissait pas. Voilà à peu près toutes les objections
que l'on fait à Régulus; examinons d'abord les premières.
XXIX. « On ne doit pas craindre Jupiter, on ne doit redouter ni sa
colère ni sa vengeance, car un Dieu ne s'irrite jamais et ne fait de
mal à personne. » Cet argument ne porte pas plus contre Régulus que
contre tous les serments en général. Mais ce qu'il faut voir dans un
serment c'est sa force, et non la crainte qu'il doit inspirer. Le
serment est une affirmation religieuse. Or, ce que l'on a promis
affirmativement et comme en prenant Dieu à témoin, il faut le
tenir. Il y va, non pas de la colère des Dieux, qui n'est qu'un vain
mot, mais de la justice et de la bonne Foi. Ennius a fort bien dit
: « Ο Foi, déesse aux blanches ailes, serment sacré de Jupiter. »
Celui donc qui viole son serment viole la Foi, cette divinité que
nos ancêtres ont voulu placer dans le Capitole, à côté du maître des
Dieux, comme nous l'apprend Caton dans un de ses discours. « Mais
Jupiter offensé n'aurait pas châtié Régulus plus durement que
Régulus ne se châtia lui-même. » Cela serait fort bien dit, s'il n'y
avait d'autre mal que la souffrance. La souffrance, au contraire,
bien loin d'être le souverain mal, n'est pas même un mal : tel est
du moins le sentiment de très-graves philosophes. S'il faut un
témoin pour confirmer leur dire, en voilà un et des meilleurs :
c'est Régulus , que je vous prie de ne pas récuser. Pouvez-vous
imaginer un témoignage qui ait plus de poids que celui du plus noble
des Romains, allant chercher les plus cruels supplices pour demeurer
fidèle à son devoir? Vous nous citez l'adage, qu'entre plusieurs
maux il faut choisir le moindre, et vous en tirez cette conclusion :
qu'il vaut mieux vivre dans l'infamie
qu'au milieu des calamités; et moi je vous demande s'il y a un plus
grand mal que l'infamie? Si la difformité du corps a quelque chose
de choquant, concevez donc ce que doit être la dépravation et la
laideur d'une âme toute souillée d'opprobre. Aussi les
philosophes
qui ont traité ces questions avec le plus de nerf ne craignent pas
de soutenir qu'il n'y a d'autre mal que ce qui est honteux ; ceux
qui y mettent plus d'indulgence affirment sans hésitation que c'est
là du moins le plus grand des maux. Quant à la maxime d'Ennius, « Je
n'ai pas donné et je ne donne pas ma foi à qui n'en eut jamais,
elle est bien placée par le poète dans la bouche d'Atrée; car c'est
ainsi que devait s'exprimer un tel personnage. Mais si vous êtes
tout prêts à déclarer, comme Atrée, que la parole donnée à l'homme
de mauvaise foi n'oblige pas, prenez garde d'ouvrir la porte au
parjure. La guerre elle-même a ses lois, et souvent nous nous
engageons envers l'ennemi par des serments qu'il faut respecter.
Toutes les fois que vous donnez votre parole avec cette conviction
que vous serez un jour obligé à la tenir, rien ne peut vous en
délier; autrement il vous sera permis d'y manquer sans parjure. Si
vous n'apportez pas à des pirates la rançon que vous leur avez
promise, vous n'êtes coupable d'aucune fraude, quand même ils
auraient reçu de vous un serment. Car un pirate n'est pas au nombre
de ces ennemis qu'on pourrait en quelque façon appeler
légitimes; c'est l'ennemi commun de tous. Avec lui nous ne devons rien avoir
de commun, ni foi, ni serment. Faire un serment où la conscience ne
s'engage pas, ce n'est point se parjurer ; mais, après avoir juré du
fond de votre âme, comme nous disons,
513
si vous manquez à votre parole, vous êtes un parjure. Euripide ^ pu
dire: « C'est ma langue qui a fait le serment, et non pas ma
conscience. » Régulus ne devait pas rompre par un parjure des
conventions de guerre, un pacte conclu avec l'ennemi ; car il avait
affaire à un de ces ennemis légitimes, envers lesquels nous sommes
liés par le droit fécial et par un grand nombre de règles sacrées.
S'il n'en était ainsi, le sénat n'aurait pas livré aux ennemis tant
d'hommes illustres.
XXX. T. Véturius et Sp. Postumius, tous deux consuls pour la seconde
fois, après avoir essuyé un échec aux Fourches-Caudines, et attiré à
nos légions l'opprobre dépasser sous le joug, firent la paix avec
les Samnites ; mais ils furent livrés aux ennemis, car cette paix
avait été conclue sans l'ordre du sénat et du peuple. On livra en
même temps les tribuns du peuple T. Numicius et Q. Mélius, qui
avaient couvert cette paix de leur autorité; on les livra, pour que
Rome fût entièrement libre envers les Samnites. Postumius lui-même
ouvrit l'avis dont il devait être la première victime. Son exemple
fut imité longues années après par C. Mancinus, qui avait traité
avec les Numantins sans l'agrément du sénat. P. Furius et Sex.
Atilius vinrent proposer au peuple, en vertu d'un sénatus-consulte,
de livrer l'auteur du traité. Mancinus appuya la proposition, qui
fut adoptée, et on le livra aux Numantins. Je trouve sa conduite
plus honorable que celle de Q. Pompée, qui, dans une circonstance
pareille, obtint à force de prières que le peuple rejetât le
sénatus-consulte. L'apparence de l'utilité remporta pour ce dernier
sur l'honnêteté; mais tous ces anciens méprisaient leurs intérêts
dès que l'honneur avait parlé. — Mais Régulus ne devait pas tenir
une promesse qui lui avait été arrachée
par la violence. — Comme si la violence avait prise sur un homme de
cœur ! — Pourquoi donc accepter la mission qu'on lui confiait,
puisqu'il voulait dissuader le sénat de renvoyer les captifs?—Vous
blâmez ici ce qu'il y a de plus admirable dans sa conduite. Ce
n'était pas à lui à prononcer; il venait, soumettre une demande dont
le sénat devait être le juge. Il est vrai que, sans l'autorité de
son avis, les prisonniers eussent été rendus aux Carthaginois. De
cette façon, Régulus serait demeuré dans sa patrie, tranquille et
honoré ; mais convaincu que ce parti n'était pas utile à la
république, il pensa que l'honneur lui commandait d'ouvrir un avis
contraire et de s'exposer à mille maux. On nous dit que ce qui est
très-utile devient honnête; ce qui est honnête l'est toujours, et ne
le devient pas. Ce qui n'est pas honnête ne saurait être utile, et
ce n'est pas parce qu'une chose est utile qu'elle est honnête; mais
parce qu'elle est honnête, en même temps elle est utile. Aussi,
parmi tant de beaux exemples, serait-il difficile d'en trouver un
plus noble et plus glorieux.
XXXI. Mais ce que je trouve de plus admirable dans la conduite de
Régulus, c'est qu'il ait ouvert l'avis de garder les prisonniers.
Car d'être retournée Carthage, cela nous semble aujourd'hui d'un
mérite prodigieux ; mais dans ce temps-là il n'aurait pu faire
autrement, et c'est le mérite de son temps plutôt que le sien. Dans
la pensée de nos pères, il ne pouvait y avoir pour enchaîner la foi
de lien plus fort que le serment. C'est ce que prouvent les lois des
douze Tables, les lois sacrées, les traités qui engagent notre foi à
l'ennemi , les notes et les punitions infligées par les censeurs,
lesquels ne sévissaient jamais avec plus de rigueur que lorsqu'il
s'agissait de serment. Le 514
tribun du peuple M. Pomponius avait intenté une accusation contre
l'ancien dictateur, L. Manlius, fils d'Aulus, qui avait gardé la
dictature quelques jours de plus qu'il ne devait. Pomponius
l'accusait encore d'avoir relégué à la campagne et de tenir éloigné
du commerce des hommes son fils Titus, qui, reçut depuis le surnom
de Torquatus. Le jeune homme ayant appris que son père allait être
poursuivi en justice, accourut à Rome, et se présenta au point du
jour à la demeure de Pomponius. On annonce son arrivée au tribun,
qui s'imaginant que Titus, irrité contre son père, vient lui porter
ses plaintes, se lève aussitôt, éloigne tout témoin, et ordonne
qu'on fasse venir le jeune homme. Celui-ci, à peine introduit, tire
son épée et jure qu'il va en percer Pomponius sur-le-champ, s'il ne
s'engage par serment à se désister de son accusation contre son
père. Pomponius, saisi de terreur, prête le serment; il va ensuite
informer le peuple de l'événement , lui explique par quel motif il
doit renoncer à ses poursuites, et déclare Manlius déchargé de
l'accusation ; tant le serment avait d'empire dans ces âges de la
république ! C'est ce même Manlius qui, provoqué près du Téveron par
un Gaulois, tua cet ennemi et lui ôta ce collier qui lut valut le
surnom de Torquatus. Sous son troisième consulat, les Latins furent
défaits et mis en fuite sur les bords du Véséris. Ce fut un de nos
plus grands hommes; mais il déploya autant de sévérité et de
rigueur contre son fils, qu'il avait témoigné de tendresse pour son
père.
XXXII. Mais tout comme il faut louer Régulus d'avoir été fidèle à
son serment, les dix Romains qu'Annibal envoya au sénat après la
bataille de Cannes, leur
faisant jurer de revenir a son camp s'ils n'obtenaient le rachat des
captifs, doivent être blâmés s'ils manquèrent d'y retourner ; car
tous les historiens ne s'accordent pis sur ce point. Polybe,
l'auteur le plus digne de foi, rapporte que des dix prisonniers,
tous appartenant à de nobles familles, neuf retournèrent près de
celui qui les avait envoyés; qu'un seul resta à Rome, parce qu'un
moment après être sorti du camp, il y était rentré, sous prétexte
d'avoir oublié quelque chose. Il prétendait que son retour dans le
camp l'avait délié de son serment ; mais rien n'était moins juste,
car la fraude resserre encore les liens du serment, au lieu de les
rompre. Il eut donc recours à un artifice misérable , qui n'était
qu'une méchante imitation de la prudence. Aussi le sénat
ordonna-t-il qu'on enchaînât cet homme rusé et fourbe, et qu'on le
reconduisit à Annibal. Voici quelque chose de plus. Annibal avait en
son pouvoir huit mille hommes qui ne s'étaient pas rendus
prisonniers sur le champ de bataille, qui n'avaient pas pris la
fuite pour éviter une mort certaine, mais que les consuls Paulus et
Varron avaient abandonnés dans le camp. Le sénat pouvait les
racheter à peu de frais ; mais il n'y voulut point entendre, pour
que les soldats Romains fussent toujours convaincus qu'il fallait
vaincre ou mourir. Polybe nous apprend qu'Annibal vit avec une sorte
de consternation le sénat et le peuple Romain montrer un cœur si
haut dans une si grande calamité. C'est ainsi qu'au prix de
l'honneur, on savait mépriser ce qui semblait utile. Acilius, qui a
écrit une histoire en grec, dit qu'il y eut plusieurs prisonniers
qui revinrent dans le camp, pour se
515 dégager de leur serment par la même
fraude, et qu'ils furent tous notés d'infamie par les censeurs.
Finissons là ce sujet ; car il est manifeste que toutes les actions
qui partent d'une âme faible, timide, pusillanime et lâche, comme
eût été celle de Régulus s'il eût consulté, pour ouvrir un avis, son
propre avantage et non l'intérêt de la république, ou bien s'il eût
cédé à ceux qui le retenaient à Rome; il est manifeste,
disons-nous, que de telles actions, loin d'être utiles, sont
criminelles, honteuses et infamantes.
XXXIII. Il nous reste à comparer l'utile avec cette quatrième source
de l'honnête d'où viennent la décence, la modération, la modestie,
la retenue, la tempérance. Peut-on trouver quelque chose d'utile
qui soit en opposition avec toute cette famille de vertus?
Cependant les disciples d'Aristippe, qu'on appelle philosophes
Cyrénaïques ou Annicériens, ont prétendu qu'il n'y avait d'autre
bien que la volupté, et que si la vertu avait du prix, c'est à
cause des plaisirs qu'elle procure. Cette doctrine décréditée fut
bientôt relevée avec un certain éclat par Épicure, qui ne soutient
guère d'autres maximes. Avec de telles gens, il faut, comme on dit,
se battre à pied et à cheval, si l'on veut sauver l'honnêteté et en
maintenir les droits. Si, en effet, comme Ta écrit Métrodore,
non-seulement l'utilité, mais tout le bonheur de la vie consiste
dans la bonne constitution du corps et dans l'espoir assuré de la
conserver longtemps; certainement une utilité semblable , et qui
est la première de toutes dans leur doctrine, se trouvera souvent eu
opposition avec l'honnête. Quel sera d'abord l'emploi de la
pru¬dence? sera-ce d'aller de toutes parts à la recherche des
jouissances? Quelle misérable condition pour la vertu, d'être au
service de la volupté!
Mais enfin quel sera le principal office de la prudence? elle
s'exercera sans doute à choisir ingénieusement les voluptés? Ce
peut être là une occupation très-agréable ; mais, pour mon compte,
je n'en vois guère de plus honteuse. D'autre part, si vous regardez
la douleur comme le souverain mal Je ne vois pas comment vous serez
capables de la force d'âme, qui est proprement le mépris des
douleurs et des peines. Sans doute Épicure tient en plusieurs
endroits un langage assez mâle sur la douleur; mais ce que nous
devons chercher surtout, ce η est pas tant ce qu'il dit que ce
qu'il devrait dire conséquemment à ce premier principe, que tous
les biens reviennent à la volupté et tous les maux à la douleur.
J'en dirai tout autant de la modération et de la tempérance : si
nous voulons l'entendre, il nous dira merveilles sur ces vertus ;
mais c'est ce qui s'appelle plaider contre soi-même. Comment est-il
possible de louer la tempérance, quand on met le souverain bien
dans la volupté? La tempérance est l'ennemie des passions, et les
passions n'ont qu'un but, le plaisir. Sur ces trois vertus
cependant
ils se défendent comme ils peuvent, et recourent à des subterfuges
qui ne sont pas maladroits. Ils admettent la prudence, et la
donnent pour l'art de préparer les voluptés et d'éloigner les
douleurs. Pour la force, ils lui réservent aussi un certain emploi;
c'est elle qui doit les rendre indifférents à la mort et capables de
supporter la douleur. Enfin ils font une place à la tempérance
elle-même; ce n'est pas sans un grand embarras, mais ils
parviennent à la loger en disant que la volupté suprême c'est
l'absence de la douleur. Quant à la justice, elle est chez eux
singulièrement compromise, ou plutôt elle est entièrement
sacrifiée, ainsi que toutes les vertus qui ten-
516
dent an maintien de la société humaine. N'est-Il pas vrai que la
bonté, la libéralité, la douceur, et avec elles l'amitié, ne peuvent
exister, si elles ne sont recherchées pour elles-mêmes, et non pour
les plaisirs qu'elles procurent? Résumons-nous en peu de mots. Nous
avons prouvé que l'utile ne peut jamais être en opposition avec
l'honnête; nous établissons maintenant que toute volupté est
contraire à l'honnêteté. Je n'en estime donc que plus blâmables
Calliphon et Dinomaque, qui ont cru vider le différend en
associant la volupté à l'honnêteté, comme si on accouplait la brute
avec l'homme. L'honnêteté ne souffre point cette compagnie; elle la
repousse, elle en a horreur. Le souverain bien, de sa nature, doit
être un et simple; c'est ne point le connaître que de le composer de
pièces si dissemblables. Mais c'est là une grande question que nous
avons traitée ailleurs avec tous les développements convenables.
Revenons à notre objet. Nous avons fait connaître suffisamment, à ce
que je pense, la règle que l'on doit suivre lorsque l'utile semble
en opposition avec l'honnête. Si l'on attribue à la volupté une
apparence d'utilité, il n'en sera pas moins certain qu'entre elle
et l'honnête il
n'est absolument rien de commun. S'il faut cependant lui accorder
quelque chose, disons qu'elle est peut-être comme l'assaisonnement
des autres biens ; mais qu'on ne trouvera jamais en elle d'utilité
véritable.
Recevez, mon cher Marcus, ce présent de votre père; je le crois d'un
grand prix ; mais il tirera principalement sa valeur de l'accueil
que vous lui ferez. Admettez ces trois livres comme des hôtes parmi
les ouvrages de Cratippe. Si j'étais venu à Athènes, ce que j'allais
faire quand la patrie m'a rappelé à grands cris au milieu de ma
course, vous m'auriez entendu quelquefois. Mais je vous ai parlé
dans ces livres ; écoutez ce qu'ils vous diront, donnez-leur le
plus de temps possible ; et à cet égard, vous pourrez tout ce que
vous voudrez. Quand je saurai que ce genre d'instruction vous est
agréable, alors je ne me ferai pas faute de vous entretenir, soit de
près, comme bientôt, je l'espère, soit de loin, tant que nous serons
séparés. Adieu donc, mon fils ; soyez persuadé que je vous aime
tendrement, mais que je vous aimerai bien plus encore si vous prenez
goût à de tels ouvrages et à de semblables leçons. |