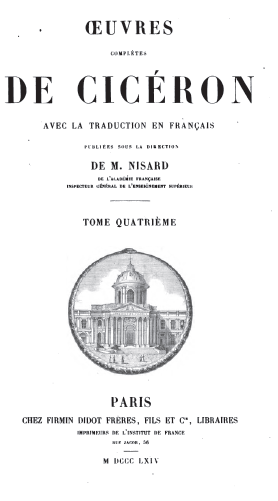|
I. Quamquam te, Marce fili,
annum iam audientem
Cratippum, idque Athenis, abundare oportet praeceptis institutisque philosophiae
propter summam et doctoris auctoritatem et urbis, quorum alter te scientia
augere potest, altera exemplis, tamen, ut ipse ad meam utilitatem semper cum
Graecis Latina coniunxi neque id in philosophia solum, sed etiam in dicendi
exercitatione feci, idem tibi censeo faciendum, ut par sis in utriusque
orationis facultate. Quam quidem ad rem nos, ut videmur, magnum attulimus
adiumentum hominibus nostris, ut non modo Graecarum litterarum rudes, sed etiam
docti aliquantum se arbitrentur adeptos et ad dicendum et ad iudicandum. Quam ob
rem disces tu quidem a principe huius aetatis philosophorum, et disces, quam diu
voles; tam diu autem velle debebis, quoad te, quantum proficias, non paenitebit;
sed tamen nostra legens non multum a Peripateticis dissidentia, quoniam utrique
Socratici et Platonici volumus esse, de rebus ipsis utere tuo iudicio (nihil
enim impedio), orationem autem Latinam efficies profecto legendis nostris
pleniorem. Nec vero hoc arroganter dictum existimari velim. Nam philosophandi
scientiam concedens multis, quod est oratoris proprium, apte, distincte, ornate
dicere, quoniam in eo studio aetatem consumpsi, si id mihi assumo, videor id meo
iure quodam modo vindicare. Quam ob rem magnopere te hortor, mi Cicero, ut non
solum orationes meas, sed hos etiam de philosophia libros, qui iam illis fere se
aequarunt, studiose legas; vis enim maior in illis dicendi, sed hoc quoque
colendum est aequabile et temperatum orationis genus. Et id quidem nemini video
Graecorum adhuc contigisse, ut idem utroque in genere elaboraret sequereturque
et illud forense dicendi et hoc quietum disputandi genus, nisi forte Demetrius
Phalereus in hoc numero haberi potest, disputator subtilis, orator parum
vehemens, dulcis tamen, ut Theophrasti discipulum possis agnoscere. Nos autem
quantum in utroque profecerimus, aliorum sit iudicium, utrumque certe secuti
sumus. Equidem et Platonem existimo, si genus forense dicendi tractare voluisset,
gravissime et copiosissime potuisse dicere, et Demosthenem, si illa, quae a
Platone didicerat, tenuisset et pronuntiare voluisset, ornate splendideque
facere potuisse; eodemque modo de Aristotele et Isocrate iudico, quorum uterque
suo studio delectatus contempsit alterum.
II. Sed cum statuissem scribere ad te aliquid hoc
tempore, multa posthac, ab eo ordiri maxime volui, quod et aetati tuae esset
aptissimum et auctoritati meae. Nam cum multa sint in philosophia et gravia et
utilia accurate copioseque a philosophis disputata, latissime patere videntur ea,
quae de officiis tradita ab illis et praecepta sunt. Nulla enim vitae pars neque
publicis neque privatis neque forensibus neque domesticis in rebus, neque si
tecum agas quid, neque si cum altero contrahas, vacare officio potest, in eoque
et colendo sita vitae est honestas omnis et neglegendo turpitude. Atque haec
quidem quaestio communis est omnium philosophorum; quis est enim, qui nullis
officii praeceptis tradendis philosophum se audeat dicere? Sed sunt non nullae
disciplinae, quae propositis bonorum et malorum finibus officium omne pervertant.
Nam qui summum bonum sic instituit, ut nihil habeat cum virtute coniunctum,
idque suis commodis, non honestate metitur, hic, si sibi ipse consentiat et non
interdum naturae bonitate vincatur neque amicitiam colere possit nec iustitiam
nec liberalitatem; fortis vero dolorem summum malum iudicans aut temperans
voluptatem summum bonum statuens esse certe nullo modo potest. Quae quamquam ita
sunt in promptu, ut res disputatione non egeat, tamen
sunt a nobis alio loco
disputata. Hae disciplinae igitur si sibi consentaneae velint esse, de officio
nihil queant dicere, neque ulla officii praecepta firma, stabilia, coniuncta
naturae tradi possunt nisi aut ab iis, qui solam, aut ab iis, qui maxime
honestatem propter se dicant expetendam. Ita propria est ea praeceptio Stoicorum,
Academicorum, Peripateticorum, quoniam Aristonis, Pyrrhonis, Erilli
iam pridem
explosa sententia est; qui tamen haberent ius suum disputandi de officio, si
rerum aliquem dilectum reliquissent, ut ad officii inventionem aditus esset.
Sequemur igitur hoc quidem tempore et hac in quaestione potissimum Stoicos non
ut interpretes, sed, ut solemus, e fontibus eorum iudicio arbitrioque nostro,
quantum quoque modo videbitur, hauriemus.
Placet igitur, quoniam omnis disputatio de officio
futura est, ante definire, quid sit officium; quod a Panaetio praetermissum esse
miror. Omnis enim, quae a ratione suscipitur de aliqua re institutio, debet a
definitione proficisci, ut intellegatur, quid sit id, de quo disputetur.
III. Omnis de officio duplex est quaestio: unum
genus est, quod pertinet ad finem bonorum, alterum, quod positum est in
praeceptis, quibus in omnis partis usus vitae conformari possit. Superioris
generis huius modi sunt exempla: omniane officia perfecta sint, num quod
officium aliud alio maius sit, et quae sunt generis eiusdem. Quorum autem
officiorum praecepta traduntur, ea quamquam pertinent ad finem bonorum, tamen
minus id apparet, quia magis ad institutionem vitae communis spectare videntur;
de quibus est nobis his libris explicandum. Atque etiam alia divisio est officii.
Nam et medium quoddam officium dicitur et perfectum. Perfectum officium rectum,
opinor, vocemus, quoniam Graeci κατόρθωμα, hoc autem commune officium καθῆκον
vocant. Atque ea sic definiunt, ut, rectum quod sit,
id officium perfectum esse
definiant; medium autem officium id esse dicunt, quod cur factum sit, ratio
probabilis reddi possit. Triplex igitur est, ut Panaetio videtur, consilii
capiendi deliberatio. Nam aut honestumne factu sit an turpe dubitant id, quod in
deliberationem cadit; in quo considerando saepe animi in contraries sententias
distrahuntur. Tum autem aut anquirunt aut consultant, ad vitae commoditatem
iucunditatemque, ad facultates rerum atque copias, ad opes, ad potentiam, quibus
et se possint iuvare et suos, conducat id necne, de quo deliberant; quae
deliberatio omnis in rationem utilitatis cadit. Tertium dubitandi genus est, cum
pugnare videtur cum honesto id, quod videtur esse utile; cum enim utilitas ad se
rapere, honestas contra revocare ad se videtur, fit ut distrahatur in
deliberando animus afferatque ancipitem curam cogitandi. Hac divisione,
cum praeterire aliquid maximum vitium in dividendo sit, duo praetermissa sunt;
nec enim solum utrum honestum an turpe sit, deliberari solet, sed etiam duobus
propositis honestis utrum honestius, itemque duobus propositis utilibus utrum
utilius. Ita, quam ille triplicem putavit esse rationem, in quinque partes
distribui debere reperitur. Primum igitur est de honesto, sed dupliciter, turn
pari ratione de utili, post de comparatione eorum disserendum.
IV. Principio generi animantium omni est a natura
tributum, ut se, vitam corpusque tueatur, declinet ea, quae nocitura videantur,
omniaque, quae sint ad vivendum necessaria, anquirat et paret, ut pastum, ut
latibula, ut alia generis eiusdem. Commune item animantium omnium est
coniunctionis adpetitus procreandi causa et cura quaedam eorum, quae procreata
sint; sed inter hominem et beluam hoc maxime interest, quod haec tantum, quantum
sensu movetur, ad id solum, quod adest quodque praesens est, se accommodat
paulum admodum sentiens praeteritum aut futurum; homo autem, quod rationis est
particeps, per quam consequentia cernit, causas rerum videt earumque praegressus
et quasi antecessiones non ignorat, similitudines comparat rebusque praesentibus
adiungit atque annectit futuras, facile totius vitae cursum videt ad eamque
degendam praeparat res necessarias. Eademque natura vi rationis hominem
conciliat homini et ad orationis et ad vitae societatem ingeneratque in primis
praecipuum quendam amorem in eos, qui procreati sunt, impellitque, ut hominum
coetus et celebrationes et esse et a se obiri velit ob easque causas studeat
parare ea, quae suppeditent ad cultum et ad victum, nec sibi soli, sed coniugi,
liberis ceterisque, quos caros habeat tuerique debeat; quae cura exsuscitat
etiam animos et maiores ad rem gerendam facit. In primisque hominis est propria
veri inquisitio atque investigatio. Itaque cum sumus necessariis negotiis
curisque vacui, tum avemus aliquid videre, audire, addiscere cognitionemque
rerum aut occultarum aut admirabilium ad beate vivendum necessariam ducimus. Ex
quo intellegitur, quod verum, simplex sincerumque sit, id esse naturae hominis
aptissimum. Huic veri videndi cupiditati adiuncta est appetitio quaedam
principatus, ut nemini parere animus bene informatus a natura velit nisi
praecipienti aut docenti aut utilitatis causa iuste et legitime imperanti; ex
quo magnitudo animi exsistit humanarumque rerum contemptio. Nec vero illa parva
vis naturae est rationisque. quod unum hoc animal sentit, quid sit ordo, quid
sit, quod deceat, in factis dictisque qui modus. Itaque eorum ipsorum, quae
aspectu sentiuntur, nullum aliud animal pulchritudinem, venustatem,
convenientiam partium sentit; quam similitudinem natura ratioque ab oculis ad
animum transferens multo etiam magis pulchritudinem, constantiam, ordinem in
consiliis factisque conservandam putat cavetque, ne quid indecore effeminateve
faciat, turn in omnibus et opinionibus et factis ne quid libidinose aut faciat
aut cogitet. Quibus ex rebus conflatur et efficitur id, quod quaerimus, honestum,
quod etiamsi nobilitatum non sit, tamen honestum sit, quodque vere dicimus,
etiamsi a nullo laudetur, natura esse laudabile.
V. Formam quidem ipsam, Marce fili, et tamquam
faciem honesti vides, “quae si oculis cerneretur, mirabiles amores,” ut ait
Plato, “excitaret sapientiae.” Sed omne, quod est honestum, id quattuor partium
oritur ex aliqua: aut enim in perspicientia veri sollertiaque versatur aut in
hominum societate tuenda tribuendoque suum cuique et rerum contractarum fide aut
in animi excelsi atque invicti magnitudine ac robore aut in omnium, quae fiunt
quaeque dicuntur, ordine et modo, in quo inest modestia et temperantia. Quae
quattuor quamquam inter se colligata atque implicata sunt, tamen ex singulis
certa officiorum genera nascuntur, velut ex ea parte, quae prima discripta est,
in qua sapientiam et prudentiam ponimus, inest indagatio atque inventio veri,
eiusque virtutis hoc munus est proprium. Ut enim quisque maxime perspicit, quid
in re quaque verissimum sit. quique acutissime et celerrime potest et videre et
explicare rationem, is prudentissimus et sapientissimus rite haberi solet.
Quocirca huic quasi materia, quam tractet et in qua versetur, subiecta est
veritas. Reliquis autem tribus virtutibus necessitates propositae sunt ad eas
res parandas tuendasque, quibus actio vitae continetur, ut et societas hominum
coniunctioque servetur et animi excellentia magnitudoque cum in augendis opibus
utilitatibusque et sibi et suis comparandis, tum multo magis in his ipsis
despiciendis eluceat. Ordo autem et constantia et moderatio et ea, quae sunt his
similia, versantur in eo genere, ad quod est adhibenda actio quaedam, non solum
mentis agitatio. Iis enim rebus, quae tractantur in vita, modum quendam et
ordinem adhibentes honestatem et decus conservabimus.
VI. Ex quattuor autem locis, in quos honesti
naturam vimque divisimus, primus ille, qui in veri cognitione consistit, maxime
naturam attingit humanam. Omnes enim trahimur et ducimur ad cognitionis et
scientiae cupiditatem, in qua excellere pulchrum putamus, labi autem, errare,
nescire, decipi et malum et turpe ducimus. In hoc genere et naturali et honesto
duo vitia vitanda sunt, unum, ne incognitapro cognitis habeamus iisque temere
assentiamur; quod vitium effugere qui volet (omnes autem velle debent),
adhibebit ad considerandas res et tempus et diligentiam. Alterum est vitium,
quod quidam nimis magnum studium multamque operam in res obscuras atque
difficiles conferunt easdemque non necessarias. Quibus vitiis declinatis quod in
rebus honestis et cognitione dignis operae curaeque ponetur, id iure laudabitur,
ut in astrologia C. Sulpicium audivimus,
in geometria Sex. Pompeium ipsi
cognovimus, multos in dialecticis, plures in iure civili, quae omnes artes in
veri investigatione versantur; cuius studio a rebus gerendis abduci contra
officium est. Virtutis enim laus omnis in actione consistit; a qua tamen fit
intermissio saepe multique dantur ad studia reditus; tum agitatio mentis, quae
numquam acquiescit, potest nos in studiis cognitionis etiam sine opera nostra
continere. Omnis autem cogitatio motusque animi aut in consiliis capiendis de
rebus honestis et pertinentibus ad bene beateque vivendum aut in studiis
scientiae cognitionisque versabitur. Ac de primo quidem officii fonte diximus.
VII. De tribus autem reliquis latissime patet ea
ratio, qua societas hominum inter ipsos et vitae quasi communitas continetur;
cuius partes duae, iustitia, in qua virtutis est splendor maximus, ex qua viri
boni nominantur, et huic coniuncta beneficentia, quam eandem vel benignitatem
vel liberalitatem appellari licet. Sed iustitiae primum munus est, ut ne cui
quis noceat nisi lacessitus iniuria, deinde ut communibus pro communibus utatur,
privatis ut suis. Sunt autem privata nulla natura, sed aut vetere occupatione,
ut qui quondam in vacua venerunt, aut victoria, ut qui bello potiti sunt, aut
lege, pactione, condicione, sorte; ex quo fit, ut ager Arpinas Arpinatium
dicatur, Tusculanus Tusculanorum; similisque est privatarum possessionum
discriptio. Ex quo, quia suum cuiusque fit eorum, quae natura fuerant communia,
quod cuique obtigit, id quisque teneat; e quo si quis sibi appetet, violabit ius
humanae societatis. Sed quoniam, ut praeclare scriptum est a Platone, non nobis
solum nati sumus ortusque nostri partem patria vindicat, partem amici, atque, ut
placet Stoicis, quae in terris gignantur, ad usum hominum omnia creari, homines
autem hominum causa esse generates, ut ipsi inter se aliis alii prodesse
possent, in hoc naturam debemus ducem sequi, communes utilitates in medium
afferre mutatione officiorum, dando accipiendo, tum artibus, tum opera, tum
facultatibus devincire hominum inter homines societatem. Fundamentum autem est
iustitiae fides, id est dictorum conventorumque constantia et veritas. Ex quo,
quamquam hoc videbitur fortasse cuipiam durius, tamen audeamus imitari Stoicos,
qui studiose exquirunt, unde verba sint ducta, credamusque, quia fiat, quod
dictum est, appellatam fidem. Sed iniustitiae genera duo sunt, unum eorum, qui
inferunt, alterum eorum, qui ab iis, quibus infertur, si possunt, non propulsant
iniuriam. Nam qui iniuste impetum in quempiam facit aut ira aut aliqua
perturbatione incitatus, is quasi manus afferre videtur socio; qui autem non
defendit nec obsistit, si potest, iniuriae, tam est in vitio, quam si parentes
aut amicos aut patriam deserat. Atque illae quidem iniuriae, quae nocendi causa
de industria inferuntur, saepe a metu proficiscuntur, cum is, qui nocere alteri
cogitat, timet ne, nisi id fecerit, ipse aliquo afficiatur incommodo. Maximam
autem partem ad iniuriam faciendam aggrediuntur, ut adipiscantur ea, quae
concupiverunt; in quo vitio latissime patet avaritia.
VIII. Expetuntur autem divitiae cum ad usus vitae
necessarios, tum ad perfruendas voluptates. In quibus autem maior est animus, in
iis pecuniae cupiditas spectat ad opes et ad gratificandi facultatem, ut nuper
M. Crassus negabat ullam satis magnam pecuniam esse ei, qui in re publica
princeps vellet esse, cuius fructibus exercitum alere non posset. Delectant
etiam magnifici apparatus vitaeque cultus cum elegantia et copia; quibus rebus
effectum est, ut infinita pecuniae cupiditas esset. Nec vero rei familiaris
amplificatio nemini nocens vituperanda est, sed fugienda semper iniuria est.
Maxime autem adducuntur plerique, ut eos iustitiae capiat oblivio, cum in
imperiorum, honorum, gloriae cupiditatem inciderunt. Quod enim est apud Ennium:
Nulla sancta societas
Nec fides regni est.
id latius patet. Nam quicquid eius modi est, in
quo non possint plures excellere, in eo fit plerumque tanta contentio, ut
difficillimum sit servare “sanctam societatem.” Declaravit id modo temeritas C.
Caesaris, qui omnia iura divina et humana pervertit propter eum, quem sibi ipse
opinionis errore finxerat, principatum. Est autem in hoc genere molestum, quod
in maximis animis splendidissimisque ingeniis plerumque exsistunt honoris,
imperii, potentiae, gloriae cupiditates. Quo magis cavendum est, ne quid in eo
genere peccetur. Sed in omni iniustitia permultum interest, utrum perturbatione
aliqua animi, quae plerumque brevis est et ad tempus, an consulto et cogitata
fiat iniuria. Leviora enim sunt ea, quae repentino aliquo motu accidunt, quam
ea, quae meditata et praeparata inferuntur. Ac de inferenda quidem iniuria satis
dictum est.
IX. Praetermittendae autem defensionis
deserendique officii plures solent esse causae; nam aut inimicitias aut laborem
aut sumptus suscipere nolunt aut etiam neglegentia, pigritia, inertia aut suis
studiis quibusdam occupationibusve sic impediuntur, ut eos, quos tutari debeant,
desertos esse patiantur. Itaque videndum est, ne non satis sit id,
quod apud
Platonem est in philosophos dictum, quod in veri investigatione versentur
quodque ea, quae plerique vehementer expetant, de quibus inter se digladiari
soleant, contemnant et pro nihilo putent, propterea iustos esse. Nam alterum
iustitiae genus assequuntur, ut inferenda ne cui noceant iniuria, in alterum
incidunt; discendi enim studio impediti, quos tueri debent, deserunt. Itaque eos
ne ad rem publicam quidem accessuros putat nisi coactos. Aequius autem erat id
voluntate fieri; namhoc ipsum ita iustum est, quod recte fit, si est
voluntarium. Sunt etiam, qui aut studio rei familiaris tuendae aut odio quodam
hominum suum se negotium agere dicant nec facere cuiquam videantur iniuriam. Qui
altero genere iniustitiae vacant, in alterum incurrunt; deserunt enim vitae
societatem, quia nihil conferunt in eam studii, nihil operae, nihil facultatum.
Quando igitur duobus generibus iniustitiae propositis adiunximus causas
utriusque generis easque res ante constituimus, quibus iustitia contineretur,
facile, quod cuiusque temporis officium sit, poterimus, nisi nosmet ipsos valde
amabimus, iudicare; est enim difficilis cura rerum alienarum. Quamquam
Terentianus ille Chremes “humani nihil a se alienum putat”; sed tamen, quia
magis ea percipimus atque sentimus, quae nobis ipsis aut prospera aut adversa
eveniunt, quam illa, quae ceteris, quae quasi longo intervallo interiecto
videmus, aliter de illis ac de nobis iudicamus. Quocirca bene praecipiunt,
qui vetant quicquam agere, quod dubites aequum sit an iniquum. Aequitas enim lucet
ipsa per se, dubitatio cogitationem significat iniuriae.
X. Sed incidunt saepe tempora, cum ea, quae maxime
videntur digna esse iusto homine eoque, quem virum bonum dicimus, commutantur
fiuntque contraria, ut reddere depositum, facere promissum quaeque pertinent ad
veritatem et ad fidem, ea migrare interdum et non servare fit iustum. Referri
enim decet ad ea, quae posui principio, fundamenta iustitiae, primum ut ne cui
noceatur, deinde ut communi utilitati serviatur. Ea cum tempore commutantur,
commutatur officium et non semper est idem. Potest enim accidere promissum
aliquod et conventum, ut id effici sit inutile vel ei, cui promissum sit, vel
ei, qui promiserit. Nam si, ut in fabulis est, Neptunus, quod Theseo promiserat,
non fecisset, Theseus Hippolyto filio non esset orbatus; ex tribus enim optatis,
ut scribitur, hoc erat tertium, quod de Hippolyti interitu iratus optavit; quo
impetrato in maximos luctus incidit. Nec promissa igitur servanda sunt ea, quae
sint iis, quibus promiseris, inutilia, nec, si plus tibi ea noceant quam illi
prosint, cui promiseris, contra officium est maius anteponi minori; ut, si
constitueris cuipiam te advocatum in rem praesentem esse venturum atque interim
graviter aegrotare filius coeperit, non sit contra officium non facere, quod
dixeris, magisque ille, cui promissum sit, ab officio discedat, si se destitutum
queratur. Iam illis promissis standum non esse quis non videt, quae coactus quis
metu, quae deceptus dolo promiserit? quae quidem pleraque iure praetorio
liberantur, non nulla legibus. Exsistunt etiam saepe iniuriae calumnia quadam et
nimis callida, sed malitiosa iuris interpretatione. Ex quo illud “Summum ius
summa iniuria” factum est iam tritum sermone proverbium. Quo in genere etiam in
re publica multa peccantur, ut ille, qui, cum triginta dierum essent cum hoste
indutiae factae, noctu populabatur agros, quod dierum essent pactae, non noctium
indutiae. Ne noster quidem probandus, si verum est Q. Fabium Labeonem seu quem
alium (nihil enim habeo praeter auditum) arbitrum Nolanis et Neapolitanis de
finibus a senatu datum, cum ad locum venisset, cum utrisque separatim locutum,
ne cupide quid agerent, ne appetenter, atque ut regredi quam progredi mallent.
Id cum utrique fecissent, aliquantum agri in medio relictum est. Itaque illorum
finis sic, ut ipsi dixerant, terminavit; in medio relictum quod erat, populo
Romano adiudicavit. Decipere hoc quidem est, non iudicare. Quocirca in omni est
re fugienda talis sollertia. |
LIVRE PREMIER.
I. Voici un an, mon cher fils, que
vous suivez les leçons de Cratippe, et que vous êtes à Athènes; les
enseignements de la sagesse, les ressources philosophiques ne
doivent pas vous manquer au milieu d'une telle ville et avec un si
grand maître; et quand je pense à la science de l'un et aux exemples
de l'autre, je vous trouve à bonne école: cependant, comme j'ai
toujours, à mon grand profit, réuni les lettres grecques aux lettres
latines, non-seulement en philosophie , mais dans l'exercice de
l'art oratoire, je crois que vous ferez bien de suivre la même
méthode , pour en venir à posséder les deux langues avec une égale
perfection. J'ai rendu, dans cet esprit, d'assez grands services à
mes compatriotes, comme ils veulent bien le reconnaître ; grâce à
mes travaux, ceux qui sont étrangers aux lettres grecques, et même
ceux à qui elles étaient familières, pensent avoir fait beaucoup de
profit et dans l'art de la parole et dans la sagesse. Restez donc le
disciple du premier philosophe de ce siècle, restez-le aussi
longtemps que vous voudrez, et vous devez le vouloir tant que vous
ne vous repentirez pas du temps que vous lui consacrez; mais
cependant lisez mes écrits, que vous ne trouverez pas trop en
désaccord avec la doctrine des Péripatéticiens, puisque je suis le
disciple fidèle de Socrate et de Platon en même temps; lisez-les,
jugez du fond des choses avec la plus parfaite indépendance, je n'y
mets point obstacle : mais soyez certain que le style vous fera
mieux connaître toutes les richesses de notre langue latine. Ce
n'est point par vanité que je parle ainsi ; je cède bien facilement
la palme de la philosophie à beaucoup d'autres plus habiles que moi;
mais en ce qui touche les qualités de l'orateur, la clarté, la
propriété, l'élégance du discours, comme j'en ai fait l'étude de
toute ma vie, si j'en réclame le privilège, il me semble que j'use
d'un droit bien et légitimement acquis. Je vous exhorte donc, mon
fils, à lire avec grand soin non-seulement mes discours, mais encore
mes livres de philosophie, dont le nombre égale presque aujourd'hui
celui de mes harangues. Vous trouverez plus d'éloquence dans les
premiers ; mais il faut cultiver aussi ce genre d'écrire égal et
tempéré. Je ne vois parmi les Grecs aucun auteur qui ait réuni ce
double talent de style, et qui ait su allier la véhémence de
l'orateur à la simplicité calme du philosophe; si ce n'est peut-être
Démétrius de Phalère, dont les ouvrages didactiques sont
ingénieusement écrits, et dont les discours, assez froids, ont cette
douceur qui trahit le disciple de Théophraste. Pour moi, je laisse
aux autres à juger si j'ai réussi dans l'un et l'autre genre; ce
qu'il y a de certain, c'est que je les ai cultivés tous les deux. Je
suis persuadé que Platon, en présence du peuple ou devant les
tribunaux, aurait parlé avec beaucoup de force et d'abondance; et
que Démosthène, retenant les enseignements de Platon, et les voulant
mettre par écrit, aurait composé des livres pleins de beautés et
d'éclat J'en dirai tout 426
autant d'Aristote et d'Isocrate; mais chacun d'eux, entraîné par ses
travaux de prédilection, a méprisé les goûts et le genre de l'autre.
II. M'étant décidé à composer pour
vous un ouvrage en ce moment, et bien d'autres dans la suite, j'ai
voulu commencer par traiter celui de tous les sujets qui convient le
mieux à votre âge, et qui sied le mieux à l'autorité d'un père. Il y
a dans la philosophie un nombre considérable de questions graves et
de grande conséquence, mises en lumière et approfondies par les
maîtres les plus célèbres; mais rien dans leurs doctrines ne me
parait plus important et plus fécond que les enseignements et les
préceptes qu'ils nous out laissés sur les devoirs. La vie entière
est réglée par le devoir; que vous soyez homme public ou privé, dans
le sein de votre maison ou en plein forum, que vous ayez affaire à
vous-même ou h votre semblable, vous êtes soumis à des devoirs : si
vous les respectez, vous êtes honnête homme ; malhonnête homme si
vous les négligez. C'est là une matière traitée par tous les
philosophes. Comment se dire philosophe, si l'on ne parle à l'homme
de ses devoirs? Cependant il est des doctrines qui, par leur
définition du souverain bien et du souverain mal, suppriment tous
les devoirs de la vie. Car si vous établissez un souverain bien qui
n'ait rien de commun avec la vertu, et dont votre propre utilité et
non l'honnêteté soit la mesure, pour peu que vous soyez conséquent
avec vous-même, et que vous sachiez résister à l'entraînement de
votre bon naturel, vous ne connaîtrez ni l'amitié, ni la justice, ni
la générosité. Vous ne pourrez non plus être courageux si vous
regardez la douleur comme le plus grand des maux, ou tempérant si la
volupté est pour vous le souverain bien. Tout ce que je dis
ici est d'une telle évidence, qu'il semble n'avoir pas besoin de
démonstration; cependant je l'ai expliqué fort au long dans un de
mes ouvrages. Je soutiens donc que si de telles doctrines veulent
être conséquentes avec elles-mêmes, il ne leur appartient pas de
parler des devoirs ; nous ne pouvons recevoir de règles de morale,
solides, invariables, conformes à la nature, que de ceux qui pensent
que la vertu seule est â rechercher en ce monde, ou que du moins
elle est supérieure à tous les autres biens. Il convient aux
Stoïciens, aux philosophes de l'Académie et du Lycée de nous
entretenir de nos devoirs : je ne dis rien d'Ariston, de Pyrrhon et
d'Hérillus, car leurs doctrines sont abandonnées depuis longtemps;
eux aussi seraient fondés à nous donner des règles de conduite,
s'ils ne supprimaient la différence naturelle qui existe entre les
choses, et ne rendaient par là impossible la détermination des
devoirs. Aujourd'hui et pour traiter cette question, je suivrai de
préférence les Stoïciens, non pas toutefois en simple interprète,
mais, selon ma méthode favorite, en puisant à leur source avec
discernement, en faisant un choix parmi leurs dogmes, et donnant à
leurs pensées un tour qui me soit propre. La première chose à faire,
puisque tout ce que nous avons à dire doit porter sur les devoirs,
c'est de donner une définition du devoir ; et je m'étonne que
Panétius ait négligé ce soin; car toutes les fois que l'on veut
traiter un sujet complètement et avec méthode, il faut qu'une
définition serve de point de départ, afin que l'on entende bien ce
dont il s'agit dans la discussion.
III. Toute la morale se divise en
deux parties. Dans la première on s'occupe à déterminer le souverain
bien, dans la seconde on donne les pré-
427 ceptes qui doivent
régler toutes les actions de la vie. Dans la première partie, on
résout des questions de ce genre : Tous les devoirs sont-ils
parfaits? N'y a-t-il pas des devoirs plus grands les uns que les
autres?... et toutes celles du même genre. Les préceptes relatifs
aux diverses parties de la conduite se rattachent aussi à la
question du souverain bien, mais moins évidemment, car ils
paraissent surtout destinés a régler et composer la vie ordinaire.
Nous voulons, dans ce traité, faire connaître et expliquer ces
règles de morale. On divise quelquefois les devoirs en devoirs
moyens et parfaits. Le devoir parfait est ce qui constitue une
obligation stricte, les Grecs le nomment κατόρθωμα; ils appellent
καθῆκον le devoir moyen ou devoir de
convenance. Ils les définissent ainsi : Le devoir parfait est tout
ce qui est essentiellement conforme au bien ; le devoir moyen est
une règle d'action dont l'homme peut donner une raison plausible.
Selon Panétius, toute délibération
revient à l'un de ces trois chefs : Ou l'on délibère si ce que l'on
a en vue est honnête ou honteux, et c'est là une première question
sur laquelle les esprits sont souvent partagés ; ou bien l'on
recherche et l'on examine si ce qu'on se propose de faire servira ou
non à augmenter les aises et l'agrément de la vie, à accroître nos
richesses, nos ressources et notre puissance, en un mot, si nous en
pouvons tirer quelque avantage nous ou les nôtres ; ici la
délibération se rapporte tout entière à l'utile. Enfin, on délibère
encore lorsque l'honnête nous semble en contradiction avec l'utile.
D'un côté l'utile nous séduit, de l'autre l'honnête nous rappelle,
et l'esprit partagé entre deux ne sait auquel se rendre. Telle est
la division de Panétius ; mais le premier devoir d'une division est
de ne rien omettre, et je trouve dans celle-ci une double lacune;
car on ne délibère pas seulement pour savoir si une chose est
honnête ou honteuse; mais entre deux partis honnêtes, on se demande
lequel l'est le plus ; et pareillement, entre deux choses utiles,
laquelle est la plus utile. Ainsi, au lieu de trois chefs, Panétius
devait en mettre cinq dans sa division. Nous parlerons d'abord de
l'honnête, et sous un double rapport; nous nous occuperons ensuite
de l'utile sous un double point de vue également; enfin, nous
arriverons à la comparaison de l'utile avec l'honnête.
IV. Et d'abord tous les êtres
animés sont portés par la nature à se défendre, à protéger leur
corps, à éviter ce qui leur paraît nuisible, à rechercher et se
procurer tout ce qui leur est nécessaire pour vivre, comme la
nourriture, une retraite, et les autres choses de même sorte; tous
ressentent aussi cet aiguillon qui pousse les deux sexes l'un vers
l'autre pour perpétuer la race, tous prennent soin de leur
progéniture. Mais entre l'homme et la bête il y a surtout cette
différence que la bête, n'écoutant que ses sensations, est tout
entière absorbée dans le présent ; à peine le passé et l'avenir
existent-ils pour elle; tandis que l'homme, doué de la raison, peut,
à l'aide de la lumière, voir l'enchaînement des choses, la liaison ,
les causes, le principe et la suite des événements , saisir les
ressemblances, nouer l'avenir au présent, et de cette sorte
embrasser d'un coup d'œil le cours entier de sa vie, et préparer
tout ce qui lui sera nécessaire pour arriver heureusement jusqu'au
terme. C'est encore par la 428
puissance de la raison que la nature rapproche les hommes, et les
fait vivre et s'entretenir ensemble. Elle leur inspire avant tout
une vive tendresse pour leurs enfants ; elle les porte ensuite à
former des sociétés, à les maintenir, à s'y plaire. C'est à elle
qu'ils obéissent quand ils rassemblent de toutes parts ce qui est
utile, et que, non contents de travailler pour eux, ils veillent aux
besoins de leurs femmes, de leurs enfants, et de tous ceux qui leur
sont chers et qu'ils doivent protéger. Cette tendresse tient
naturellement leur esprit en éveil et double leurs forces.
Parmi les traits distinctifs de la
nature de l'homme, un des plus saillants est la recherche et la
poursuite de la vérité. Aussi, dès que nous sommes libres des soins
ordinaires de la vie, nous éprouvons le désir de voir, d'entendre,
de nous instruire; et nous regardons la connaissance des secrets et
des merveilles de la nature comme nécessaire au bonheur. Et par là
il devient manifeste que tout ce qui est vrai, pur et simple,
convient admirablement à la nature de l'homme. A ce besoin de
connaître le vrai se joint un goût très-vif pour l'indépendance :
une âme bien née ne veut obéira personne, si ce n'est à ceux qui
l'instruisent ou qui ont reçu un juste et légitime pouvoir dans
l'intérêt de tous; c'est de cette fierté naturelle que naît la
grandeur d'âme et le mépris des choses humaines. Ce n'est pas non
plus une médiocre prérogative pour l'homme que ce bel attribut de la
raison, de comprendre ce que c'est que l'ordre, la décence, quelle
mesure il faut apporter dans les paroles et les actions. Seul parmi
les animaux, l'homme sait goûter la beauté, la grâce, la proportion
de tout ce qu'il voit. Mais la raison l'élève bientôt de ce
spectacle des sens à la conception de la beauté morale; il attache
alors un bien plus grand prix à l'ordre, à la constance dans les
desseins et les actions ; il prend garde à ne rien commettre de
honteux et d'indigne de lui, à ce que rien de vicieux ne
s'introduise dans ses pensées, ne lui échappe dans sa conduite.
C'est de toutes ces choses que se compose et résulte l'honnêteté que
nous cherchons, l'honnêteté qui, inconnue et sans honneur, n'en
conserverait pas moins tout son prix , et dont il est vrai de dire
qu'elle serait digne de toute louange, lors même qu'elle ne serait
louée de personne.
V. Voilà, mon fils, la forme et,
pour ainsi dire, la figure de l'honnêteté; si elle venait
d'elle-même se manifester à nos yeux, elle exciterait en nous, comme
dit Platon, un amour incroyable de la sagesse. Mais tout ce qui est
honnête vient de l'une de ces quatre sources principales :
L'honnêteté consiste ou à découvrir la vérité et former de bons
conseils; ou à maintenir la société humaine, en rendant à chacun ce
qui lui appartient, et en gardant avec fidélité sa parole; ou à
déployer la grandeur et l'énergie d'une âme haut placée et
invincible; ou à mettre dans tout ce que l'on fait et ce que l'on
dit cette convenance et cette mesure, qui est le cachet de la
modération et de la tempérance. Ces quatre sources de l'honnêteté se
mêlent et se pénètrent le plus souvent; toutefois il naît de chacune
d'elle un ordre de devoirs tout particulier. C'est ainsi qu'à la
première que nous avons nommée,
429 et qui est proprement la sagesse ou la prudence,
appartiennent la recherche et la découverte de la vérité; c'est là
en effet le propre de cette vertu. Lorsqu'un homme découvre sûrement
la vérité en toutes choses, lorsqu'il peut la saisir d'un regard
perçant et prompt comme l'éclair, et tout aussitôt la faire
comprendre, on le regarde à bon droit comme un modèle de prudence et
de sagesse. Le véritable objet de la prudence, et en quelque sorte
la matière sur laquelle elle s'exerce, est donc la vérité. Les trois
autres vertus ont ce caractère commun, qu'elles se rapportent toutes
à la vie active, et lui sont en quelque façon consacrées. Une
d'elles fonde et maintient la société humaine ; la seconde fait
paraître l'excellence et la grandeur de l'âme, tantôt chez l'homme
qui conquiert le pouvoir, la richesse, tous les biens du monde pour
lui et pour les siens, tantôt et plus encore chez celui qui les
méprise. L'ordre, la constance, la modération et toutes les qualités
qui s'y rattachent, ne demandent pas seulement on pur travail
d'esprit, mais des efforts et le déploiement de l'action. C'est dans
les affaires de la vie qu'il faut exercer cette vertu de la
modération, sans laquelle il n'est plus ni honnêteté ni dignité pour
l'homme.
VI. Des quatre vertus qui
contiennent en elles le principe de tous les devoirs, la première,
celle qui consiste dans la connaissance de la vérité, semble être la
vertu de l'homme par excellence. Nous éprouvons tous un désir ardent
de connaître et de savoir : exceller dans la science nous parait une
grande gloire ; être dans l'erreur ou dans l'ignorance, se tromper
ou être déçu, nous parait un malheur et une honte. Dans cette
poursuite de la vérité, à la fois si naturelle et si louable, il y a
deux défauts à éviter : le premier est de prendre pour connu ce qui
demeure inconnu, et de donner légèrement son assentiment à ce qui
n'est pas démontré. Celui qui voudra éviter cet écueil (et il n'est
personne qui ne doive le vouloir) mettra à examiner les choses tout
le temps et les soins convenables. L'autre défaut est de s'appliquer
avec un zèle déplacé à l'étude de choses obscures, difficiles, et
qui ne sont d'aucune nécessité. A la condition d'éviter ces deux
défauts, tout ce que l'on emploie de travail et de soins à
recueillir des connaissances nobles et dignes de l'homme, mérite les
plus justes louanges. C'est ainsi que C. Sulpicius se distingua dans
l'astronomie, à ce que nous disent nos pères; Sex. Pompée dans la
géométrie, comme nous en avons été témoins; beaucoup d'autres dans
la dialectique, un plus grand nombre dans l'étude du droit civil.
Toutes ces sciences ont pour but la découverte de la vérité; mais
malgré tout leur prix, celui qui négligerait les affaires pour les
cultiver irait contre le devoir. Car c'est dans l'action, et dans
l'action seule, que la vertu se signale. Cependant l'homme n'a pas
toujours à agir, et il peut revenir souvent à ses études favorites;
souvent aussi l'activité de notre esprit, qui ne se repose jamais,
peut nous retenir, sans que nous y conspirions, au milieu des
préoccupations de la science. Nous voyons donc que l'office de la
pensée est double : ou elle s'emploie à nous faire discerner le
bien, à nous montrer la route de la vertu et du bonheur, ou elle se
livre solitairement aux travaux de la science. Voilà ce que j'avais
à dire de la première source de nos devoirs.
VII. Des trois autres sources, la
plus féconde est celle qui maintient la société humaine, et qui est
en quelque sorte le fondement de l'union des
430 hommes. II faut
distinguer en elle d'abord la Justice, où la vertu éclate dans tout
son lustre, et qui est la qualité par excellence de l'homme de bien;
ensuite, la bienfaisance, sœur de la justice, et que l'on peut aussi
nommer bonté ou générosité. Le premier caractère de l'homme juste
est de ne jamais nuire à personne, à moins qu'il ne soit injustement
attaqué; ensuite, de se servir des biens communs comme appartenant à
tous, et des siens seulement comme lui appartenant en propre.
Primitivement tous les biens étaient communs; ce que l'on nomme
propriété a pour origine et pour titre ou une ancienne occupation,
comme celle des hommes qui vinrent habiter une contrée déserte, ou
la victoire et le droit de la guerre, ou bien une loi, un contrat,
une convention, un partage. C'est ainsi que la campagne d'Arpinum
s'appelle le territoire des Arpinates; celle de Tusculum, la terre
des Tusculans. La propriété privée a la même origine et le même
fondement. De cette façon, les biens que la nature avait mis en
commun étant partagés entre tous les hommes, chacun doit s'en tenir
au lot qui lui est échu ; vouloir entreprendre sur le lot d'autrui,
c'est porter atteinte au principe même de la société des hommes.
Mais comme, suivant les belles paroles de Platon, nous ne sommes pas
nés pour nous seuls, et que notre patrie, nos parents, nos amis ont
tous des droits sur nous; comme, suivant les Stoïciens, tout ce que
la terre produit est créé pour l'usage de l'homme, et l'homme
lui-même pour ses semblables ; comme notre loi est de nous entraider
mutuellement, nous devons demeurer fidèles aux inspirations de la
nature, mettre tous nos avantages en commun par un échange
réciproque de bons offices, donnant et recevant tour à tour,
employant notre esprit, notre travail, nos ressources, à resserrer
les liens qui unissent les hommes dans la société.
Le fondement de la justice est la
bonne foi, c'est-à-dire le respect de notre parole, et l'inviolable
fidélité à nos engagements. Et ici, au risque de rencontrer quelques
incrédules, osons imiter les Stoïciens, qui recherchent avec grand
soin l'étymologie des mots, et affirmer que bonne foi (fides)
vient de faire (quia fiat), parce qu'on fait ce qu'on a dit.
On peut être injuste de deux manières : ou en faisant soi-même du
mal à autrui, ou en laissant faire celui que l'on peut empêcher.
L'homme qui, dans un accès de colère, ou entraîné par la passion,
fait violence à un autre homme, me semble porter la main sur son
frère; et celui qui ne fait pas tous ses efforts pour arrêter les
effets de cet emportement est aussi coupable, selon moi, que s'il
abandonnait sa patrie, ses parents ou ses amis en péril. Souvent,
quand nous faisons du mal à autrui de propos délibéré, c'est la
crainte qui nous pousse; et plus d'un homme se résout à nuire à son
semblable, parce qu'il a peur d'être attaqué, s'il ne devient
agresseur. Mais la plupart du temps, les hommes se portent à
commettre l'injustice pour satisfaire leur cupidité, la plus
insatiable et la plus injuste des passions.
VIII. On poursuit les richesses,
soit pour fournir aux besoins de la vie, soit comme instrument de
plaisirs. Ceux qui ont l'âme un peu relevée veulent être riches pour
devenir puissants et pour faire des largesses. Nous avons entendu
naguère M. Crassus déclarer qu'un homme qui voulait jouer le premier
rôle dans une république n'a- 432
vait jamais assez de fortune, tant qu'il ne pouvait entretenir une
armée à ses frais. L'élégance, le luxe, une vie recherchée, un train
somptueux séduisent bien des hommes; et de là cet amour effréné de
la richesse. Je ne dis pas qu'il faille condamner celui qui
s'enrichit par des moyens légitimes; mais il faut toujours fuir
l'injustice. Où l'on voit surtout Injustice mise en oubli, c'est
quand la passion de la gloire, des honneurs, du pouvoir s'est
emparée de l'âme. Ce qu'Ennius dit des rois : " Que rien ne leur est
sacré, pas même leur propre parole,» peut s'étendre beaucoup plus
loin. Car tous les biens qui de leur nature sont le privilège de
quelques hommes excitent ordinairement de telles rivalités, qu'il
est difficile, dans l'acharnement de la lutte, de conserver un
religieux respect pour la justice. C'est ce que nous a prouvé
dernièrement la conduite criminelle de César qui a mis à ses pieds
toutes les lois divines et humaines , pour arriver à cet empire
qu'il croyait follement être le comble de la grandeur humaine. Mais
ici il faut reconnaître cette triste vérité, que c'est d'ordinaire
dans les plus grandes âmes et les plus brillants génies que s'allume
l'ambition , et cette passion dévorante des honneurs et de la
gloire. Raison de plus pour se mettre en garde contre un tel écueil.
Lorsqu'une injustice est commise,
il importe beaucoup de distinguer si elle vient d'un de ces
mouvements soudains qui le plus souvent ne durent pas, ou, si elle a
été préméditée. Une faute est moins grave quand elle échappe à
l'homme dans un moment d'effervescence, que lorsqu'elle est
réfléchie et faite de sang-froid. Mais en voilà assez sur les
injustices que l'on commet soi-même.
IX. Souvent aussi les hommes
négligent de défendre leurs semblables en péril ; c'est un devoir
que plusieurs causes leur font trahir. Tantôt ils craignent de
s'attirer des ennemis, de prendre trop de peines, d'aventurer leur
argent; tantôt la négligence, la paresse, l'inertie, ou encore les
préoccupations de leur esprit et leurs travaux, les retiennent, et
les forcent à abandonner ceux dont ils devraient être les
protecteurs. Ne pourrait-on pas reprocher à Platon d'avoir trop peu
demandé à des philosophes? Ils auront la parfaite justice, dit-il,
quand ils s'occuperont à rechercher la vérité, et qu'ils mépriseront
en même temps et compteront pour rien tous ces faux biens que le
monde se dispute avec tant de véhémence et d'acharnement. De cette
façon sans doute ils évitent la première espèce d'injustice,
puisqu'ils ne font de tort à personne; mais ils tombent dans
l'autre, puisque, tout absorbés dans leurs études, ils abandonnent
ceux qu'ils devraient protéger. Aussi Platon Va-t-il jusqu'à
déclarer que jamais ils ne se mêleront des affaires publiques, à
moins d'y être contraints. Cependant il vaudrait beaucoup mieux que
leur volonté les y portât; car, à bien voir les choses, il n'est de
bien que celui qui se fait volontairement Il est certains hommes
qui, occupés exclusivement de leurs propres intérêts ou nourrissant
je ne sais quelle haine contre le genre humain, disent qu'ils ne se
mêlent que de leurs affaires, de peur qu'on ne les accuse de faire
tort à autrui ; ces gens-là vraiment ne sont justes qu'à moitié, car
ils abandonnent et trahissent la société humaine, en lui refusant le
tribut de leurs efforts, de leurs ressources et de leurs soins.
Voilà quelles sont les deux espèces
d'injus- 432
tices, et de quels principes elles viennent; nous avons montré
auparavant en quoi consiste la justice ; il nous sera donc facile de
reconnaître notre devoir dans toutes les circonstances de la vie, à
moins que nous ne nous aimions aveuglément nous-mêmes. Il est vrai
que nous nous intéressons ordinairement assez peu à ce qui touche
les autres. Le Chrêmes de Térence dit bien que rien ne lui est
étranger de ce qui touche les hommes; mais cependant il faut avouer
que nous remarquons et sentons mieux nos prospérités et nos
adversités que celles d'autrui, qui nous semblent si fort éloignées
de nous ;et que nous avons, pour juger des intérêts de nos
semblables et des nôtres, deux poids et deux balances. C'est donc un
excellent précepte que celui qui nous défend de faire une chose
quand nous ne savons si elle est juste ou injuste. L'équité brille
assez d'elle-même ; l'incertitude dans la conscience est la marque
de l'injustice.
X. Mais il se présente des
circonstances où la nature des devoirs vient subitement à changer,
où l'homme de bien ne doit plus faire ce qui paraît le plus digne de
lui et le plus conforme à la justice. C'est ainsi que parfois la
justice consistera à ne point rendre un dépôt, à ne pas tenir sa
promesse, à manquer apparemment aux règles de la bonne foi. Il faut,
pour entendre ceci, remonter aux fondements de la justice, tels que
nous les avons établis en commençant. L'essence de la justice est
d'abord de ne nuire à personne ; en second lieu, de veiller à
l'utilité publique. Quand l'intérêt public ou privé vient à changer,
le devoir change et varie avec lui. Il peut arriver que l'exécution
d'une promesse soit nuisible à celui qui l'a reçue comme à celui qui
l'a faite; j'en dirai autant des conventions. La fable nous en
montre un exemple frappant : si Neptune n'avait point accompli la
promesse que Thésée avait reçue de lui, Thésée n'eût point perdu son
fils Hippolyte. Des trois vœux que Neptune devait exaucer, c'était
là le dernier : Thésée dans sa colère lui demande de faire périr son
fils ; son souhait est accompli, et le voilà plongé dans le plus
grand deuil. Vous pouvez donc ne pas tenir votre promesse quand elle
devient nuisible à celui à qui vous l'avez faite, ou même quand elle
vous est plus nuisible qu'elle ne lui est avantageuse; j'entends par
là qu'il faut préférer le plus grand devoir au moindre. Si, par
exemple, vous avez promis à votre client de plaider sa cause un tel
jour, et que cependant votre fils vienne à tomber dangereusement
malade, vous ne manquerez pas à votre devoir en ne tenant point cet
engagement; et celui qui l'a reçu de vous manquerait à son devoir,
en se plaignant que vous l'ayez trompé. Quant aux promesses qui nous
ont été arrachées par les menaces ou par la fraude, qui ne voit
qu'elles ne sauraient être obligatoires? aussi en sommes-nous
relevés le plus souvent par le droit prétorien, et quelquefois même
par les lois. On commet encore bien des injustices en tirant un
parti coupable des lois, qu'on affecte d'interpréter avec une
scrupuleuse exactitude, et dont on dénature l'esprit. De là ce
proverbe : Droit extrême, extrême injustice. Les hommes chargés des
intérêts publics commettent souvent des injustices de ce genre. Je
vous citerai pour exemple ce général qui, ayant conclu avec l'ennemi
une armistice de trente jours, ravageait de nuit leurs campagnes,
alléguant que dans l'armistice il était question des jours et non
des nuits. On cite un 433
trait tout aussi condamnable de Q. Fabius Labéon ou de quelque autre
Romain, car je n'en sais rien que par ouï-dire. Le sénat l'avait
donné pour arbitre aux habitants de Noie et aux Napolitains, en
contestation sur une question de frontière; Labéon, arrivé sur les
lieux, parla séparément aux uns et aux autres, les exhorta à la
modération, au désintéressement Croyez-moi, leur dit-il, il serait
plus sage pour vous de reculer que d'avancer. II persuade ses gens;
des deux côtés on se retire, et voilà un champ qui reste libre au
milieu. Labéon leur déclare alors qu'eux-mêmes ont marqué leurs
frontières, et que le champ laissé entre deux appartient désormais
au peuple romain. Ce n'est pas là juger, c'est tromper. Fuyons en
toutes choses une aussi misérable habileté.
|
|
XI. Sunt autem quaedam officia etiam adversus eos
servanda, a quibus iniuriam acceperis. Est enim ulciscendi et puniendi modus;
atque haud scio an satis sit eum, qui lacessierit, iniuriae suae paenitere, ut
et ipse ne quid tale posthac et ceteri sint ad iniuriam tardiores. Atque in re
publica maxime conservanda sunt iura belli. Nam cum sint duo genera decertandi,
unum per disceptationem, alterum per vim, cumque illud proprium sit hominis, hoc
beluarum, confugiendum est ad posterius, si uti non licet superiore. Quare
suscipienda quidem bella sunt ob earn causam, ut sine iniuria in pace vivatur,
parta autem victoria conservandi ii, qui non crudeles in bello, non immanes
fuerunt, ut maiores nostri Tusculanos, Aequos, Volscos, Sabinos, Hernicos in
civitatem etiam acceperunt, at Carthaginem et Numantiam funditus sustulerunt;
nollem Corinthum, sed credo aliquid secutos, opportunitatem loci maxime, ne
posset aliquando ad bellum faciendum locus ipse adhortari. Mea quidem sententia
paci, quae nihil habitura sit insidiarum, semper est consulendum. In quo si mihi
esset optemperatum, si non optimam, at aliquam rem publicam, quae nunc nulla
est, haberemus. Et cum iis, quos vi deviceris, consulendum est, turn ii, qui
armis positis ad imperatorum fidem confugient, quamvis murum aries percusserit,
recipiendi. In quo tantopere apud nostros iustitia culta est, ut ii, qui
civitates aut nationes devictas bello in fidem recepissent, earum patroni essent
more maiorum. Ac belli quidem aequitas sanctissime fetiali populi Romani iure
perscripta est. Ex quo intellegi potest nullum bellum esse iustum, nisi quod aut
rebus repetitis geratur aut denuntiatum ante sit et indictum. Popilius imperator
tenebat provinciam, in cuius exercitu Catonis filius tiro militabat. Cum autem
Popilio videretur unam dimittere legionem, Catonis quoque filium, qui in eadem
legione militabat, dimisit. Sed cum amore pugnandi in exercitu remansisset, Cato
ad Popilium scripsit, ut, si eum patitur in exercitu remanere, secundo eum
obliget militiae sacramento, quia priore amisso iure cum hostibus pugnare non
poterat. Adeo summa erat observatio in bello movendo. M. quidem Catonis senis
est epistula ad M. filium, in qua scribit se audisse eum missum factum esse a
consule, cum in Macedonia bello Persico miles esset. Monet igitur, ut caveat, ne
proelium ineat; negat enim ius esse, qui miles non sit, cum hoste pugnare.
XII. Equidem etiam illud animadverto, quod, qui
proprio nomine perduellis esset, is hostis vocaretur, lenitate verbi rei
tristitiam mitigatam. Hostis enim apud maiores nostros is dicebatur, quem nunc
peregrinum dicimus. Indicant duodecim tabulae: “aut
status dies cum hoste,” itemque: “adversus
hostem aeterna auctoritas.” Quid ad hanc mansuetudinem addi potest, eum,
quicum bellum geras, tam molli nomine appellare? Quamquam id nomen durius effect
iam vetustas; a peregrino enim recessit et proprie in eo, qui arma contra
ferret, remansit. Cum vero de imperio decertatur belloque quaeritur gloria,
causas omnino subesse tamen oportet easdem, quas dixi paulo ante iustas causas
esse bellorum. Sed ea bella, quibus imperii proposita gloria est, minus acerbe
gerenda sunt Ut enim cum civi aliter contendimus, si est inimicus, aliter, si
competitor (cum altero certamen honoris et dignitatis est, cum altero capitis et
famae), sic cum Celtiberis, cum Cimbris bellum ut cum inimicis gerebatur, uter
esset, non uter imperaret, cum Latinis, Sabinis, Samnitibus, Poenis, Pyrrho de
imperio dimicabatur. Poeni foedifragi, crudelis Hannibal, reliqui iustiores.
Pyrrhi quidem de captivis reddendis illa praeclara:
Nec mi aurum posco nec mi pretium dederitis,
Nec cauponantes bellum, sed belligerantes
Ferro, non auro vitam cernamus utrique.
Vosne velit an me regnare era, quidve ferat Fors,
Virtute experiamur. Et hoc simul accipe dictum:
Quorum virtuti belli fortuna pepercit,
Eorundem libertati me parcere certum est.
Dono, ducite, doque volentibus cum magnis dis.
Regalis sane et digna Aeacidarum genere sententia.
XIII. Atque etiam si quid singuli temporibus
adducti hosti promiserunt, est in eo ipso fides conservanda, ut primo Punico
bello Regulus captus a Poenis cum de captivis commutandis Romam missus esset
iurassetque se rediturum, primum, ut venit, captivos reddendos in senatu non
censuit, deinde, cum retineretur a propinquis et ab amicis, ad supplicium redire
maluit quam fidem hosti datam fallere.
Secundo autem Punico bello post Cannensem
pugnam quos decem Hannibal Romam astrictos misit iure iurando se redituros esse,
nisi de redimendis iis, qui capti erant, impetrassent, eos omnes censores, quoad
quisquc eorum vixit, qui peierassent,
in aerariis reliquerunt nec minus ilium,
qui iuris iurandi fraude culpam invenerat. Cum enim Hannibalis permissu exisset
de castris, rediit paulo post, quod se oblitum nescio quid diceret; deinde
egressus e castris iure iurando se solutum putabat, et erat verbis, re non erat.
Semper autem in fide quid senseris, non quid dixeris, cogitandum. Maximum autem
exemplum est iustitiae in hostem a maioribus nostris constitutum, cum a Pyrrho
perfuga senatui est pollicitus se venenum regi daturum et cum necaturum, senatus
et C. Fabricius perfugam Pyrrho dedidit. Ita ne hostis quidem et potentis et
bellum ultro inferentis interitum cum scelere approbavit. Ac de bellicis quidem
officiis satis dictum est. Meminerimus autem etiam adversus infimos iustitiam
esse servandam. Est autem infima condicio et fortuna servorum, quibus non male
praecipiunt qui ita iubent uti, ut mercennariis: operam exigendam, iusta
praebenda. Cum autem duobus modis, id est aut vi aut fraude, fiat iniuria, fraus
quasi vulpeculae, vis leonis videtur; utrumque homine alienissimum, sed fraus
odio digna maiore. Totius autem iniustitiae nulla capitalior quam eorum, qui
tum, cum maxime fallunt, id agunt, ut viri boni esse videantur. De iustitia
satis dictum.
XIV. Deinceps, ut erat propositum, de beneficentia
ae de liberalitate dicatur, qua quidem nihil est naturae hominis accommodatius,
sed habet multas cautiones. Videndum est enim, primum ne obsit benignitas et iis
ipsis, quibus benigne videbitur fieri et ceteris, deinde ne maior benignitas sit
quam facultates, tum ut pro dignitate cuique tribuatur; id enim est iustitiae
fundamentum, ad quam haec referenda sunt omnia. Nam et qui gratificantur
cuipiam, quod obsit illi, cui prodesse velle videantur, non benefici neque
liberales, sed perniciosi assentatores iudicandi sunt, et qui aliis nocent, ut
in alios liberales sint, in eadem sunt iniustitia, ut si in suam rem aliena
convertant. Sunt autem multi, et quidem cupidi splendoris et gloriae, qui
eripiunt aliis, quod aliis largiantur, iique arbitrantur se beneficos in suos
amicos visum iri, si locupletent eos quacumque ratione. Id autem tantum abest ab
officio, ut nihil magis officio possit esse contrarium. Videndum est igitur, ut
ea liberalitate utamur, quae prosit amicis, noceat nemini. Quare L. Sullae, C.
Caesaris pecuniarum translatio a iustis dominis ad alienos non debet liberalis
videri; nihil est enim liberale, quod non idem iustum. Alter locus erat
cautionis, ne benignitas maior esset quam facultates, quod, qui benigniores
volunt esse, quam res patitur, primum in eo peccant, quod iniuriosi sunt in
proximos; quas enim copias his et suppeditari aequius est et relinqui, eas
transferunt ad alienos. Inest autem in tali liberalitate cupiditas plerumque
rapiendi et auferendi per iniuriam, ut ad largiendum suppetant copiae. Videre
etiam licet plerosque non tam natura liberales quam quadam gloria ductos, ut
benefici videantur, facere multa, quae proficisci ab ostentatione magis quam a
voluntate videantur. Talis autem sinulatio vanitati est coniunctior quam aut
liberalitati aut honestati. Tertium est propositum, ut in beneficentia dilectus
esset dignitatis; in quo et mores eius erunt spectandi, in quem beneficium
conferetur, et animus erga nos et communitas ac societas vitae et ad nostras
utilitates officia ante collata; quae ut concurrant omnia, optabile est; si
minus, plures causae maioresque ponderis plus habebunt.
XV. Quoniam autem vivitur non cum perfectis
hominibus planeque sapientibus, sed cum iis, in quibus praeclare agitur si sunt
simulacra virtutis, etiam hoc intellegendum puto, neminem omnino esse
neglegendum, in quo aliqua significatio virtutis appareat, colendum autem esse
ita quemque maxime, ut quisque maxime virtutibus his lenioribus erit ornatus,
modestia, temperantia, hac ipsa, de qua multa iam dicta sunt, iustitia. Nam
fortis animus et magnus in homine non perfecto nec sapiente ferventior plerumque
est, illae virtutes bonum virum videntur potius attingere. Atque haec in
moribus. De benivolentia autem, quam quisque habeat erga nos, primum illud est
in officio, ut ei plurimum tribuamus, a quo plurimum diligamur, sed
benivolentiam non adulescentulorum more ardore quodam amoris, sed stabilitate
potius et constantia iudicemus. Sin erunt merita, ut non ineunda, sed referenda
sit gratia, maior quaedam cura adhibenda est; nullum enim officium referenda
gratia magis necessarium est. Quodsi ea, quae utenda acceperis,
maiore mensura,
si modo possis, iubet reddere Hesiodus, quidnam beneficio provocati facere
debemus? an imitari agros fertiles, qui multo plus efferunt quam acceperunt?
Etenim si in eos, quos speramus nobis profuturos, non dubitamus officia
conferre, quales in eos esse debemus, qui iam profuerunt? Nam cum duo genera
liberalitatis sint, unum dandi beneficii, alterum reddendi, demus necne, in
nostra potestate est, non reddere viro bono non licet, modo id facere possit
sine iniuria. Acceptorum autem beneficiorum sunt dilectus habendi, nec dubium,
quin maximo cuique plurimum debeatur. In quo tamen in primis, quo quisque animo,
studio, benivolentia fecerit, ponderandum est. Multi enim faciunt multa
temeritate quadam sine iudicio vel morbo in omnes vel repentino quodam quasi
vento impetu animi incitati; quae beneficia aeque magna non sunt habenda atque
ea, quae iudicio, considerate constanterque delata sunt. Sed in collocando
beneficio et in referenda gratia, si cetera paria sunt, hoc maxime officii est,
ut quisque maxime opis indigeat, ita ei potissimum opitulari; quod contra fit a
plerisque; a quo enim plurimum sperant, etiamsi ille iis non eget, tamen ei
potissimum inserviunt.
XVI. Optime autem societas hominum coniunctioque
servabitur, si, ut quisque erit coniunctissimus, ita in eum benignitatis
plurimum conferetur.
Sed, quae naturae principia sint communitatis et societatis humanae, repetendum
videtur altius; est enim primum, quod cernitur in universi generis humani
societate. Eius autem vinculum est ratio et oratio, quae docendo, discendo,
communicando, disceptando, iudicando conciliat inter se homines coniungitque
naturali quadam societate; neque ulla re longius absumus a natura ferarum, in
quibus inesse fortitudinem saepe dicimus, ut in equis, in leonibus, iustitiam,
aequitatem, bonitatem non dicimus; sunt enim rationis et orationis expertes. Ac
latissime quidem patens hominibus inter ipsos, omnibus inter omnes societas haec
est; in qua omnium rerum, quas ad communem hominum usum natura genuit, est
servanda communitas, ut, quae discripta sunt legibus et iure civili, haec ita
teneantur, ut sit constitutum legibus ipsis, cetera sic observentur, ut in
Graecorum proverbio est, amicorum esse communia omnia. Omnium autem communia
hominum videntur ea, quae sunt generis eius, quod ab Ennio positum in una re
transferri in permultas potest:
Homo, qui erranti cómiter monstrat viam,
Quasi lumen de suo lumine accendat, facit.
Nihilo minus ipsi lucet, cum illi accenderit.
Una ex re satis praecipit, ut, quicquid sine
detrimento commodari possit, id tribuatur vel ignoto; ex quo sunt illa communia:
non prohibere aqua profluente, pati ab igne ignem capere, si qui velit,
consilium fidele deliberanti dare, quae sunt iis utilia, qui accipiunt, danti
non molesta. Quare et his utendum est et semper aliquid ad communem utilitatem
afferendum. Sed quoniam copiae parvae singulorum sunt, eorum autem, qui his
egeant, infinita est multitudo, vulgaris liberalitas referenda est ad illum
Ennii finem: “Nihilo minus ipsi lucet,” ut facultas sit, qua in nostros simus
liberales.
XVII. Gradus autem plures sunt societatis hominum.
Ut enim ab illa infinita discedatur, propior est eiusdem gentis, nationis,
linguae, qua maxime homines coniunguntur; interius etiam est eiusdem esse
civitatis; multa enim sunt civibus inter se communia, forum, fana, porticus,
viae, leges, iura: iudicia, suffragia, consuetudines praeterea et familiaritates
multisque cum multis res rationesque contractae. Artior vero colligatio est
societatis propinquorum; ab illa enim immensa societate humani generis in
exiguum angustumque concluditur. Nam cum sit hoc natura commune animantium, ut
habeant libidinem procreandi, prima societas in ipso coniugio est, proxima in
liberis, deinde una domus, communia omnia; id autem est principium urbis et
quasi seminarium rei publicae. Sequuntur fratrum coniunctiones, post
consobrinorum sobrinorumque, qui cum una domo iam capi non possint, in alias
domos tamquam in colonias exeunt. Sequuntur conubia et affinitates, ex quibus
etiam plures propinqui; quae propagatio et suboles origo est rerum publicarum.
Sanguinis autem coniunctio et benivolentia devincit homines et caritate; magnum
est enim eadem habere monumenta maiorum, eisdem uti sacris,
sepulcra habere
communia. Sed omnium societatum nulla praestantior est, nulla firmior, quam cum
viri boni moribus similes sunt familiaritate coniuncti; illud enim honestum quod
saepe dicimus, etiam si in alio cernimus, tamen nos movet atque illi, in quo id
inesse videtur, amicos facit. Et quamquam omnis virtus nos ad se allicit
facitque, ut eos diligamus, in quibus ipsa inesse videatur, tamen iustitia et
liberalitas id maxime efficit. Nihil autem est amabilius nec copulatius quam
morum similitudo bonorum; in quibus enim eadem studia sunt, eaedem voluntates,
in iis fit ut aeque quisque altero delectetur ac se ipso, efficiturque id, quod
Pythagoras vult in amicitia, ut unus fiat ex pluribus. Magna etiam illa
communitas est, quae conficitur ex beneficiis ultro et citro datis acceptis,
quae et mutua et grata dum sunt, inter quos ea sunt, firma devinciuntur
societate. Sed cum omnia ratione animoque lustraris, omnium societatum nulla est
gravior, nulla carior quam ea, quae cum re publica est uni cuique nostrum. Cari
sunt parentes, cari liberi, propinqui, familiars, sed omnes omnium caritates
patria una complexa est, pro qua quis bonus dubitet mortem oppetere, si ei sit
profuturus? Quo est detestabilior istorum immanitas, qui lacerarunt omni scelere
patriam et in ea funditus delenda occupati et sunt et fuerunt. Sed si contentio
quaedam et comparatio fiat, quibus plurimum tribuendum sit officii, principes
sint patria et parentes, quorum beneficiis maximis obligati sumus,proximi liberi
totaque domus, quae spectat in nos solos neque aliud ullum potest habere
perfugium, deinceps bene convenientes propinqui, quibuscum communis etiam
fortuna plerumque est. Quam ob rem necessaria praesidia vitae debentur iis
maxime, quos ante dixi, vita autem victusque communis, consilia, sermones,
cohortationes, consolationes, interdum etiam obiurgationes in amicitiis vigent
maxime, estque ea iucundissima amicitia, quam similitudo morum coniugavit.
XVIII. Sed in his omnibus officiis tribuendis
videndum erit, quid cuique maxime necesse sit, et quid quisque vel sine nobis
aut possit consequi aut non possit. Ita non iidem erunt necessitudinum gradus,
qui temporum; suntque officia, quae aliis magis quam aliis debeantur; ut vicinum
citius adiuveris in fructibus percipiendis quam aut fratrem aut familiarem, at,
si lis in iudicio sit, propinquum potius et amicum quam vicinum defenderis. Haec
igitur et talia circumspicienda sunt in omni officio et consuetudo
exercitatioque capienda, ut boni ratiocinatores officiorum esse possimus et
addendo deducendoque videre, quae reliqui summa fiat, ex quo, quantum cuique
debeatur, intellegas. Sed ut nec medici nec imperatores nec oratores, quamvis
artis praecepta perceperint, quicquam magna laude dignum sine usu et
exercitatione consequi possunt, sic officii conservandi praecepta traduntur illa
quidem, ut facimus ipsi, sed rei magnitude usum quoque exercitationemque
desiderat. Atque ab iis rebus, quae sunt in iure societatis humanae, quem ad
modum ducatur honestum, ex quo aptum est officium, satis fere diximus.
Intelligendum autem est, cum proposita sint genera quattuor, e quibus honestas
officiumque manaret, splendidissimum videri, quod animo magno elatoque
humanasque res despiciente factum sit. Itaque in probris maxime in promptu est
si quid tale dici potest:
Vos enim, iuvenes, animum geritis muliebrem,
“illa” virgo “viri”
et si quid eius modi:
Salmaci, da spolia
sine sudore et sanguine.
Contraque in laudibus, quae magno animo et
fortiter excellenterque gesta sunt, ea nescio quo modo quasi pleniore ore
laudamus. Hinc rhetorum campus de Marathone, Salamine, Plataeis, Thermopylis,
Leuctris, hine noster Cocles, hinc Decii, hinc Cn. et P. Scipiones, hinc M.
Marcellus, innumerabiles alii, maximeque ipse populus Romanus animi magnitudine
excellit. Declaratur autem studium bellicae gloriae, quod statuas quoque videmus
ornatu fere militari.
XIX. Sed ea animi elatio, quae cernitur in
periculis et laboribus, si iustitia vacat pugnatque non pro salute communi, sed
pro suis commodis, in vitio est; non modo enim id virtutis non est, sed est
potius immanitatis omnem humanitatem repellentis. Itaque probe definitur a
Stoicis fortitudo, cum eam virtutem esse dicunt propugnantem pro aequitate.
Quocirca nemo, qui fortitudinis gloriam consecutus est insidiis et malitia,
laudem est adeptus; nihil enim honestum esse potest, quod iustitia vacat.
Praeclarum igitur illud Platonis: “Non,” inquit, “solum scientia, quae est
remota ab iustitia, calliditas potius quam sapientia est appellanda, verum etiam
animus paratus ad periculum, si sua cupiditate, non utilitate communi
impellitur, audaciae potius nomen habeat quam fortitudinis.” Itaque viros fortes
et magnanimnos eosdem bonos et simplices, veritatis amicos minimeque fallaces
esse volumus; quae sunt ex media laude iustitiae. Sed illud odiosum est, quod in
hac elatione et magnitudine animi facillime pertinacia et nimia cupiditas
principatus innascitur. Ut enim apud Platonem est, omnem morem Lacedaemoniorum
inflammatum esse cupiditate vincendi, sic, ut quisque animi magnitudine maxime
excellet, ita maxime vult princeps omnium vel potius solus esse. Difficile autem
est, cum praestare omnibus concupieris, servare aequitatem, quae est iustitiae
maxime propria. Ex quo fit, ut neque disceptatione vinci se nec ullo publico ac
legitimo iure patiantur, exsistuntque in re publica plerumque largitores et
factiosi, ut opes quam maximas consequantur et sint vi potius superiores quam
iustitia pares. Sed quo difficilius, hoc praeclarius; nullum enim est tempus,
quod iustitia vacare debeat. Fortes igitur et magnanimi sunt habendi, non qui
faciunt, sed qui propulsant iniuriam. Vera autem et sapiens animi magnitudo
honestum illud, quod maxime natura sequitur, in factis positum, non in gloria
iudicat principemque se esse mavult quam videri; etenim qui ex errore imperitae
multitudinis pendet, hic in magnis viris non est habendus. Facillime autem ad
res iniustas impellitur, ut quisque altissimo animo est, gloriae cupiditate; qui
locus est sane lubricus, quod vix invenitur, qui laboribus susceptis
periculisque aditis non quasi mercedem rerum gestarum desideret gloriam.
XX. Omnino fortis animus et magnus duabus rebus
maxime cernitur, quarum una in rerum externarum despicientia ponitur, cum
persuasum est nihil hominem, nisi quod honestum decorumque sit, aut admirari aut
optare aut expetere oportere nullique neque homini neque perturbationi animi nec
fortunae succumbere. Altera est res, ut, cum ita sis affectus animo, ut supra
dixi, res geras magnas illas quidem et maxime utiles, sed ut vehementer arduas
plenasque laborum et periculorum cum vitae, tum multarum rerum, quae ad vitam
pertinent. Harum rerum duarum splendor omnis, amplitudo, addo etiam utilitatem,
in posteriore est, causa autem et ratio efficiens magnos viros in priore; in eo
est enim illud, quod excellentes animos et humana contemnentes facit. Id autem
ipsum cernitur in duobus, si et solum id, quod honestum sit, bonum iudices et ab
omni animi perturbatione liber sis. Nam et ea. quae eximia plerisque et
praeclara videntur, parva ducere eaque ratione stabili firmaque contemnere
fortis animi magnique ducendum est, et ea, quae videntur acerba, quae multa et
varia in hominum vita fortunaque versantur, ita ferre, ut nihil a statu naturae
discedas, nihil a dignitate sapientis, robusti animi est magnaeque constantiae.
Non est autem consentaneum, qui metu non frangatur, eum frangi cupiditate nec,
qui invictum se a labore praestiterit, vinci a voluptate. Quam ob rem et haec
vitanda et pecuniae figienda cupiditas; nihil enim est tam angusti animi tamque
parvi quam amare divitias, nihil honestius magnificentiusque quam pecuniam
contemnere, si non habeas, si habeas, ad beneficentiam liberalitatemque
conferre. Cavenda etiam est gloriae cupiditas, ut supra dixi; eripit enim
libertatem, pro qua magnanimis viris omnis debet esse contentio. Nee vero
imperia expetenda ac potius aut non accipienda interdum aut deponenda non
numquam. Vacandum autem omni est animi perturbatione, cum cupiditate et metu,
tum etiam aegritudine et voluptate nimia et iracundia, ut tranquillitas animi et
securitas adsit, quae affert cum constantiam, turn etiam dignitatem. Multi autem
et sunt et fuerunt, qui eam, quam dico, tranquillitatem expetentes a negotiis
publicis se removerint ad otiumque perfugerint; in his et nobilissimi philosophi
longeque principes et quidam homines severi et graves nec populi nec principum
mores ferre potuerunt, vixeruntque non nulli in agris delectati re sua
familiari. His idem propositum fuit, quod regibus, ut ne qua re egerent, ne cui
parerent, libertate uterentur, cuius proprium est sic vivere, ut velis. |
XI. Il y a des devoirs à observer
envers ceux mêmes de qui nous avons reçu quelque offense. La
vengeance et les représailles doivent avoir des bornes ; je ne sais
même si les remords de notre injuste ennemi ne nous vengent pas
assez, et je crois volontiers qu'ils suffisent pour l'arrêter dans
l'avenir, et pour rendre les autres plus circonspects. Une
république doit surtout respecter les droits de la guerre. Il faut
observer que les contestations qui divisent les hommes, pouvant se
soutenir ou par la raison ou par la force, la première voie
appartient en propre à l'homme tandis que la seconde est celle des
animaux ; et qu'ainsi l'on ne doit recourir à la dernière que si
l'autre nous est interdite. Il faut bien entreprendre la guerre,
lorsqu'il n'est plus permis de conserver une paix respectée et
tranquille; mais, après la victoire, on doit épargner ceux qui n'ont
été ni cruels ni barbares dans la lutte. Nos ancêtres ont même
accordé le droit de cité à des peuples vaincus, comme les Tusculans,
les Èques, les Volsques, les Sabins, les Berniques; mais ils ont
ruiné jusqu'aux fondements Carthage et Numance. Pour Corinthe, j'ai
regret de la voir si terriblement châtiée ; j'imagine toutefois que
nos pères avaient leurs raisons, et qu'ils songeaient surtout à
cette situation admirable, qui inspire tant de confiance et semble
d'elle-même provoquer à la guerre. A mon avis, il faut toujours
accepter une paix honorable qui est franchement offerte. Si on m'en
avait cru, nous aurions encore, sinon la plus parfaite république,
du moins une république; au lieu que maintenant il n'en est plus
pour nous. Tout de même qu'on doit se montrer généreux pour ceux
qu'on a vaincus, il faut recevoir en grâce, lors même que la brèche
est déjà ouverte, ceux qui déposent les armes et viennent se
remettre à la merci des généraux. Nos ancêtres avaient tellement en
honneur ce grand acte de justice, que les généraux de la république
devenaient les patrons des villes et des nations qui étaient ainsi
abandonnées à leur foi. Le droit fécial du peuple romain a déterminé
avec soin tout ce qui concerne l'équité de la guerre. Il nous
apprend qu'une guerre ne peut être juste, si elle n'a été précédée
de demande en réparation, et si elle n'est régulièrement déclarée.
Popilius, chargé de soutenir une guerre loin de Rome, avait dans son
armée le fils de Caton, qui faisait alors ses premières armes. Le
général trouve convenable de licencier une légion, et, avec elle, le
fils de Caton, qui se trouvait dans ses rangs ; le jeune Romain, qui
aimait la guerre, reste à l'armée. Caton écrit alors à Popilius, que
s'il veut bien conserver son fils dans son armée, il lui fasse
434 prêter un nouveau
serment militaire, parce que, le premier étant rompu, il ne pourrait
légitimement en venir aux mains avec les ennemis. Tellement nos
ancêtres apportaient de scrupule et de religion dans la guerre I
Nous avons encore la lettre que Caton écrivait alors à son fils
Marcus, qui portait les armes en Macédoine contre Persée. « Je viens
d'apprendre, lui dit-il, que vous avez été licencié parle consul.
Gardez-vous donc bien de combattre l'ennemi, car celui qui n'est
plus soldat n'a point le droit d'en venir aux mains. » XII. Je remarque que celui à qui
l'on devrait proprement donner le nom de perduellis a été
appelé hostis, pour que la douceur du terme diminuât en
quelque façon l'amertume de la chose. Dans les temps anciens on
nommait hostis celui que nous appelons maintenant
peregrinus ( étranger ). Les douze Tables en font foi, quand
elles disent » qu'il y ait jour pris avec l'étranger ( cum hoste
) ; » et encore : « Le droit est éternel contre l'étranger (advenus
hostem). » Y a-t-il rien de plus humain que de donner un nom si
doux a celui avec qui nous sommes en guerre? Cependant l'usage a
donné une couleur plus sombre à l'expression d'hostis; peu à
peu elle a cessé de désigner l'étranger, et a été appliquée à celui
qui porte les armes contre notre pays. Lorsque l'on combat
uniquement pour la suprématie et la gloire, il faut toujours que
l'on se fonde sur les motifs dont nous avons parlé, et qui seuls
peuvent rendre une guerre légitime. Mais quand le but dernier de la
guerre est la gloire d'un peuple, on doit y rapporter plus de
tempéraments. La lutte entre deux concitoyens a un tout autre
caractère, si ce sont des ennemis ou seulement des compétiteurs :
dans le dernier cas, c'est entre eux une rivalité de titres et
d'honneurs; dans le premier, ils ont à défendre leur réputation et
leur tête. Ainsi, nous avons combattu avec les Celtibériens et les
Cimbres comme avec des ennemis; car ce n'est pas seulement notre
suprématie, c'est notre existence qu'ils mettaient en péril. Mais
avec les Latins, les Sabins, les Samnites, les Carthaginois et
Pyrrhus, nous avons lutté pour l'empire. Carthage était sans foi,
Annibal était cruel; les autres montrèrent plus de justice. On
connaît ces belles paroles de Pyrrhus sur la rançon des prisonniers
: « Je ne demande point d'or, et je ne veux point de votre rançon.
Je ne fais point la guerre en marchand, mais en soldat ; c'est le
fer et non pas l'or que je veux vous voir en mains. Demandons au
destin des batailles à qui de vous ou de moi la fortune a réservé
l'empire. Et retenez bien ces paroles de Pyrrhus : Je respecte
toujours la liberté de ceux dont le fer ennemi a respecté les jours.
Emmenez-les, je vous les donne avec l'agrément des Dieux immortels.
» Voilà des sentiments dignes d'un roi et du sang des Éacides.
XIII. Lorsqu'un citoyen est amené
par les circonstances à faire une promesse à l'ennemi, il doit tenir
fidèlement sa parole. Vous savez ce que fit Reçu lus lors de la
première guerre punique. Il était tombé entre les mains des
Carthaginois , qui l'envoyèrent à Rome pour traiter de l'échange des
captifs, et à qui il fit le serment de revenir. Arrivé à Rome, il
soutint dans le I sénat que l'on ne devait point rendre les
prisonniers: puis il aima mieux, malgré les instances de ses amis et
de ses proches, retourner au supplice, que de manquer à la parole
donnée aux ennemis. [Pendant la seconde guerre punique, Annibal
envoya à Rome, après la bataille de Cannes, dix captifs qui
s'étaient engagés par serment à
435 revenir dans son camp, s'ils ne pouvaient obtenir du
sénat l'échange des prisonniers. Ceux d'entre eux qui se parjurèrent
furent relégués par les censeurs dans la classe des tributaires, et
y demeurèrent tout le reste de leur vie. Celui qui avait eu recours
à un subterfuge pour éluder son serment, ne fut pas épargné
davantage. Il était sorti du camp avec la permission d Annibal; un
moment après il y rentre, sous prétexte d'avoir oublié je ne sais
quoi. Bientôt il en ressort, et se prétend pour le coup délié de son
serment. A la lettre il avait raison, mais véritablement il était
toujours captif : quand il s'agit de parole, c'est à ce que Ton a
pensé et non pas à ce que l'on a dit qu'il faut avoir égard. Nos
ancêtres nous ont laissé un très-bel exemple de justice envers un
ennemi. Un transfuge de l'armée de Pyrrhus étant venu offrir au
sénat de faire périr son maître par le poison, le sénat et Fabricius
livrèrent ce traître à Pyrrhus. On ne voulait pas acheter au prix
d'un crime la mort d'un ennemi puissant, et qui était venu de
lui-même attaquer Rome.] En voilà assez sur les devoirs de la
guerre. Rappelons-nous aussi que nous avons des devoirs à remplir
envers les gens de la plus basse condition. Il n'est pas de
condition inférieure à celle des esclaves, et j'approuve beaucoup
ceux qui nous recommandent de les traiter comme on traite les
mercenaires; de leur demander leur travail, mais de leur fournir le
nécessaire. Disons encore que l'injustice se commettant ou par
fraude ou par violence, la fraude semble être l'injustice du renard,
la violence celle du lion; que l'une et l'autre sont tout à fait
indignes de la nature de l'homme ; mais que la fraude a quelque
chose de plus odieux. La pire de toutes les injustices est celle de
Γ homme qui, au moment même où il vous porte le coup le plus
perfide, a Fart de se faire passer pour un homme de bien. Mais nous
avons assez parlé de la justice.
XIV. Je dois maintenant, en suivant
mon dessein, vous entretenir de la bienfaisance et de la générosité.
Il n'y a pas de vertu qui aille mieux à la nature humaine, mais elle
demande à être pratiquée avec de grandes précautions. II faut
prendre garde d'abord à ce que notre bienfaisance ne tourne pas au
préjudice de celui à qui elle s'adresse, ni de personne autre; il
faut veiller ensuite à ne pus être plus libéral que nos moyens ne
nous le permettent; et enfin a ce que chacun reçoive selon son
mérite ; car c'est là le fondement de la justice, à laquelle tous
ces devoirs se rattachent. L'homme qui rend un service nuisible
n'est ni bienfaisant, ni libéral; on doit le regarder comme un
flatteur pernicieux; et celui qui fait tort aux uns pour être utile
aux autres, commet la même injustice que s'il s'emparait à son
bénéfice du bien d'autrui. Il y a beaucoup de gens, et surtout parmi
ceux qui veulent briller et se faire un grand nom, qui dépouillent
les uns pour faire des largesses aux autres; ils se figurent qu'ils
auront la réputation d'être bienfaisants pour leurs amis, s'ils les
enrichissent par quelque moyen que ce soit. Ce n'est pas là remplir
un devoir; bien au contraire, c'est aller contre tous les devoirs.
Il faut donc régler sa libéralité de telle sorte, qu'en obligeant
ses amis on ne fasse tort à personne. Aussi doit-on faire très-bon
marché de la libéralité d'un Sylla et d'un César, qui dépouillaient
les possesseurs légitimes pour faire litière à leurs créatures. On
n'est pas libé- 436 ral
quand on est injuste. Nous avons dit, en second lieu, que notre
générosité ne devait pas excéder nos moyens. Ceux qui veulent être
plus généreux qu'ils ne le peuvent, commettent d'abord la faute de
frustrer leurs proches d'un bien qu'ils auraient dû partager avec
eux ou leur laisser en héritage, plutôt que d'en gratifier des
étrangers. Quand on est généreux de cette façon, le plus souvent on
se trouve tenté d'étendre les mains sur le bien d'autrui, pour
alimenter ses propres largesses. Il y a aussi des hommes, et le
nombre en est grand, qui sont généreux non par bonté de cœur, mais
par fausse gloire; qui veulent en avoir la réputation, et se mettent
en frais de bienfaisance, non pour faire le bien, mais pour qu'on
parle du bien qu'ils font: cette générosité de parade est plutôt de
la vanité que de la libéralité et de la vertu. Nous avons dit qu'il
fallait proportionner ses bienfaits au mérite; quand on veut obliger
un homme, il faut considérer ses mœurs, ses dispositions envers
nous, il faut avoir égard à nos rapports mutuels, aux services qu'il
peut nous avoir rendus. Le mieux est d'adresser nos bienfaits à qui
les mérite à tous les titres, ou du moins à qui peut y prétendre
avec le plus de droits.
XV. Comme nous vivons avec des
hommes qui ne sont ni parfaits ni souverainement sages, mais avec
qui il en va très-bien quand ils ont quelque ombre de vertu, je
crois qu'il ne faut négliger aucun de ceux en qui le bien paraît par
quelque endroit, mais que nous devons toujours montrer plus
d'empressement pour ceux qui sont ornés de ces douces vertus, la
modération, la tempérance, la justice elle-même, dont nous avons
déjà tant parlé. Quant à la force et à la grandeur d'âme, elles sont
d'ordinaire assez voisines de l'emportement chez un homme qui n'a ni
la perfection ni la vraie sagesse; les autres vertus semblent mieux
exprimer le caractère de l'homme de bien. Mais en voilà assez sur
les mœurs. La bienveillance qu'on éprouve pour nous est aussi un
titre à nos services, et nous devons obliger surtout ceux qui nous
aiment le plus; toutefois il ne faut pas, comme les enfants, juger
du dévouement de nos amis par le feu de leurs démonstrations, mais
par la solidité et la constance de leur attachement. Lorsque nous
sommes leurs obligés, et que tous nos services ne peuvent témoigner
que notre reconnaissance, c'est alors même que nous devons redoubler
de zèle ; car la reconnaissance est le premier de tous les devoirs.
Hésiode nous ordonne de rendre avec usure, si faire se peut, ce
qu'on nous a prêté : à quoi donc un bienfait ne nous engage-t-il pas
? Ne devons-nous pas imiter ces champs fertiles, qui rapportent
beaucoup plus qu'ils n'ont reçu ? Si nous n'hésitons pas à rendre
des services à ceux qui peuvent nous être utiles, que ne devons-nous
pas à ceux qui nous ont prévenus? Il y a en tout deux sortes de
libéralités : l'une consiste à donner, et l'autre à rendre. Nous
sommes libres de donner, oui ou non ; mais ne pas rendre, c'est ce
qui n'est point permis à un honnête homme, lorsqu'il peut
s'acquitter sans faire tort à personne. Tous les services rendus ne
nous obligent pas également; il faut savoir distinguer entre eux.
Sans doute, la reconnaissance dort se proportionner à la grandeur du
bienfait; mais quand il s'agit d'apprécier un service, ce qui doit
passer en première ligne, c'est l'esprit dans lequel il nous
437 a été rendu, la
bienveillance, l'affection qu'on nous a témoignée. Il y a tant
de gens qui agissent par caprices, sans règle ni mesure, obligeant
le premier venu, allant par saccades, emportés par le moindre vent!
Leurs services n'ont certainement pas le prix de ceux qui sont
réfléchis, délibérés, rendus avec suite. Mais, toutes choses égales
d'ailleurs, lorsque nous exerçons notre générosité, le devoir veut
que nous secourions surtout ceux dont les besoins sont le plus
pressants. Le plus souvent on fait tout le contraire, et l'on est
perte à obliger avant tous les autres ceux dont on espère le plus,
lors même qu'ils n'ont aucun besoin.
XVI. Le meilleur moyen de maintenir
la société et l'union des hommes, c'est de rendre surtout service à
ceux qui nous touchent de plus près. Mais pour bien entendre quels
sont les premiers fondements de la société humaine, dont nous
parlons, il faut reprendre les choses de plus haut. Le premier
principe de l'union des hommes est dans la société même du genre
humain et la fraternité de tous ses membres. Le lien qui nous réunit
tous dans une même famille, c'est la raison et le langage, deux
instruments qui nous servent à enseigner, à apprendre, à communiquer
nos pensées, à nous éclairer mutuellement, à discerner le vrai, et
qui par là forment entre nous et nos semblables une société étroite
et naturelle. Cest là le trait distinctif de l'humanité; nous
reconnaissons quelquefois dans les animaux un certain courage, comme
dans le cheval ou le lion, mais jamais nous ne leur attribuons ni
justice, ni équité, ni bonté; car ils sont privés de la raison et de
la parole. Voilà donc le premier degré de société entre les hommes,
c'est le lien qui les réunit tous dans une même famille. A ce titre,
la justice nous oblige à maintenir la communauté de toutes les
choses que la nature a faites pour le commun usage des hommes, tout
en observant ce qui est prescrit par les lois et déterminé par le
droit civil. En dehors du cercle tracé par les lois, il faut avoir
pour maxime constante ce qui est exprimé par ce proverbe grec :
Entre amis tout est commun. Il y a beaucoup de choses communes entre
tous les hommes ; Ennius nous en cite un exemple, qui nous peut
faire entendre les autres :
« Montrer poliment le chemin à un
homme dévoyé, c'est comme lui laisser allumer son flambeau au nôtre,
qui ne nous éclaire pas moins, après avoir allumé le sien. »
Cet exemple nous montre assez que
nous devons partager, même avec un inconnu, tout bien qui ne diminue
pas en se communiquant. De là ces maximes vulgaires : Ne disputer à
personne l'usage d'une eau courante ; donner du feu à celui qui en
demande; conseiller de bonne foi celui qui délibère; toutes choses
utiles à qui les reçoit, et ne contant rien à qui les donne. Ce sont
là des biens dont il faut user, mais en les tenant sans cesse à la
disposition de tout le monde. Toutefois , comme chacun les possède
dans une mesure très-bornée, et que le nombre de ceux qui en ont
besoin est infini, il est bon de régler notre générosité sur le
conseil d'Ennius : Que notre flambeau ne nous en éclaire pas moins,
afin de pouvoir toujours rendre service à nos proches.
XVII. Mais la société des hommes a
plusieurs degrés. Après le genre humain, qui corn-
438 pose une seule grande
société, il y a les peuples qui habitent une même contrée et parlent
une même langue; ce sont là des liens qui nous touchent de plus près
: il y a ensuite la cité, où les hommes se trouvent encore plus
intimement unis. Beaucoup de choses sont communes entre des
concitoyens, le forum, les temples, les portiques, la voie publique,
les lois, les droits, les tribunaux, les suffrages; dans une même
cité on se fréquente, on forme amitié, on noue mille relations
d'intérêts et d'affaires : enfin la société la plus étroite de
toutes est celle de la famille; la première était d'une étendue
immense, celle-ci est restreinte au possible. La nature ayant donné
à tous les êtres animés le besoin de se reproduire, le mariage est
la première société; après elle vient, dans l'ordre de la nature, la
société des parents et des enfants, puis le développement de la
famille dans une même maison, l'usage de toutes choses en commun. La
famille est le principe de la cité, et en quelque façon la semence
de la république. La famille se partage tout en demeurant unie : les
frères, leurs enfants, et les enfants de ceux-ci, ne pouvant plus
être contenus dans la maison paternelle, en sortent pour aller
fonder, comme autant de colonies, des maisons nouvelles. Ils forment
des alliances; de là les affinités, et l'accroissement de la
famille. Peu à peu les maisons se multiplient, tout grandit, tout se
développe, et la république prend naissance. Les liens du sang sont
en même temps les liens du cœur; ceux qui tiennent à une même souche
sont tout naturellement portés à s'entr'aider. Ils ont les mêmes
monuments de famille, les mêmes dieux Pénates, un tombeau commun :
n'est-ce pas là le plus solide fondement d'union qui soit au monde ?
Mais la société la plus bielle et
la mieux cimentée est celle qui se forme entre des gens de bien, de
mœurs semblables, et que l'amitié rapproche. Lorsque nous voyons
dans un de nos semblables l'impression de ce lien, dont nous avons
souvent parlé, nous sommes remués et entraînés vers lui par le cœur.
En général, il n'est point de vertu qui n'exerce cet empire sur nous
et qui ne rende aimables ceux en qui elle se montre ; mais entre
toutes, la libéralité et la justice ont un attrait particulier. Rien
ne fait naître et ne consolide les amitiés avec plus de force que la
ressemblance des bonnes mœurs. Lorsqu'il se rencontre des hommes
ayant les mêmes goûts et la même volonté, il arrive bientôt que
chacun d'eux se complaît dans son semblable aussi parfaitement qu'en
lui-même, et que, suivant le vœu de Pythagore, plusieurs êtres n'en
font qu'un seul. Un échange de bienfaits mutuels forme aussi une
belle et durable société ; s'obliger l'un l'autre, c'est se lier
pour la vie. Si vous parcourez en esprit toutes ces diverses
sociétés, vous n'en trouverez point de plus essentielle , de plus
inviolable que celle qui lie chacun de nous à sa patrie. Nous aimons
tendrement nos parents, nos enfants, nos proches, nos amis; mais
l'amour de la patrie renferme à lui seul tous les autres. Est-il un
homme de bien qui hésiterait à donner ses jours pour servir son
pays? A cette pensée, on sent redoubler l'horreur que nous inspirent
ces citoyens infâmes qui ont déchiré la république par leurs
forfaits, et qui n'ont jamais travaillé et ne travaillent encore
439 qu'à la ruiner
jusqu'au dernier fondement. Si nous voulons établir des comparaisons
et nous demander à qui nous devons rendre le plus de devoirs, nous
mettrons en première ligne notre patrie et nos parents, de qui nous
avons reçu les plus grands bienfaits ; après eux, nos enfants et
toute notre famille, qui n'a d'espoir et de ressources qu'en nous
seuls; ensuite nos proches, avec qui nous sommes en relations
constantes, et dont tous les intérêts sont si souvent confondus avec
les nôtres. Voilà ceux aux besoins de qui nous devons veiller sans
cesse; mais pour ce commerce intime, cette communauté de sentiments
et de pensées, cette tendresse qui exhorte, console et reprend
quelquefois, c'est dans l'amitié qu'il faut les chercher; et il n'y
a point d'amitié plus douce que celle qui naît de la sympathie des
caractères.
XVIII. Mais toutes les fois que le
devoir nous commande de servir nos semblables, il nous faut examiner
quels sont surtout les besoins de chacun , et ce que ceux envers qui
nous sommes obligés pourraient faire ou ne pas faire sans nous.
Suivant les temps, nous devrons venir en aide à ceux-ci plutôt qu'à
ceux-là ; il est des services que les uns réclament plutôt que les
autres., S'il s'agit de faire la récolte, vous aiderez votre voisin,
de préférence à votre frère ou à votre ami ; s'il est question d'un
procès, vous défendrez plutôt votre parent ou votre ami que votre
voisin. Vous voyez à quelles sortes de considérations il faut
recourir dans l'accomplissement de ses devoirs ; on ne peut trop
s'exercer à cette appréciation difficile: c'est l'habitude surtout
qui aura la vertu de nous éclairer, et nous apprendre à calculer
exactement ce que nous avons reçu, ce que nous avons rendu, ce que
nous devons encore. Mais s'il est vrai que
439 ni les médecins, ni
les généraux, ni les orateurs, quelque connaissance qu'ils aient des
préceptes de leur art, ne peuvent rien faire de grand et de
glorieux, s'ils ne sont formés par la pratique et l'expérience ;
tout pareillement il est assez facile de donner, comme je le fais
ici, les règles de la morale : mais accomplir le bien est une si
grande chose, qu'on n'y peut arriver non plus sans la pratique et
l'usage, nous avons montré comment l'honnête dérive des principes
qui constituent la société humaine, et comment à sa lumière les
devoirs se déterminent. C'est une question suffisamment traitée.
Parmi les quatre vertus mères, d'où découle le bien dans toutes les
actions, et qui comprennent tous les devoirs, celle qui a le plus
d'éclat est certainement la force de ces grandes âmes, élevées
au-dessus du monde et méprisant toutes les choses humaines. Aussi
quand on veut faire un reproche sanglant, emploie-t-on ordinairement
ce langage : « Vous êtes des hommes, et, au courage, on vous
prendrait pour des femmes ; cette jeune fille a le cœur d'un homme;
» ou bien encore. «Efféminés, rendez-vous, ne résistez point, vous
n'êtes pas faits pour combattre. » Quand nous voulons, au contraire,
louer la grandeur d'âme, l'énergie, la vaillance, nous ne trouvons
pas d'expressions assez magnifiques. De là cette prédilection des
rhéteurs pour célébrer Marathon, Salamine, Platée, les Thermopyles,
Leuctres ; de là tous ces éloges de Coclès, des Décius, de Cn. et de
P. Scipion, de Marcellus, et de tant d'autres qu'on ne saurait
nombrer. Quel peuple a jamais égalé la grandeur d'âme des Romains?
Toutes nos statues couvertes de vêtements militaires ne disent-elles
pas assez quel est notre amour pour la gloire des combats?
XIX. Mais cette fierté d'âme qui
brille dans les 440
travaux et les dangers cesse d'être louable dès qu'elle n'a plus la
justice pour compagne, et ne se met plus au service de la patrie.
Bien loin d'être alors une vertu, elle est plutôt la marque d'un
caractère cruel, et quia dépouillé tout sentiment d'humanité. Les
Stoïciens ont très-bien défini la force d'âme une vertu qui combat
pour l'équité. Aussi f tous ceux qui ont voulu se faire une
réputation de vaillants hommes par des moyens indignes n'ont-ils
réussi qu'à se déshonorer, car sans la justice il n'est point
d'honneur. Voici à ce sujet une belle pensée de Platon : «
Non-seulement, nous dit-il, la science que l'honnêteté n'accompagne
pas est plutôt de l'habileté que de la sagesse; mais on doit tenir
qu'un esprit toujours prêt à affronter les dangers, s'il n'écoute
que ses passions et non l'intérêt commun, a plutôt de l'audace que
de la force. » Nous voulons que l'homme fort et magnanime soit en
même temps bon et simple, ami de la vérité et incapable de tromper;
et ce sont là tout autant de qualités essentielles à la justice.
Mais on ne peut observer sans amertume que l'élévation et la
grandeur d'âme donnent si facilement naissance à une opiniâtreté
blâmable et à une ambition effrénée. Platon nous dit que tout à
Lacédémone respirait le désir ardent de la victoire; en la même
sorte, dès qu'un homme se sent quelque grandeur naturelle , il
aspire aussitôt à dominer sur tous les autres, ou plutôt à remplir
seul le monde. Mais il est difficile, quand on veut s'élever
au-dessus de tous, de respecter l'équité, qui est la première
condition de la justice. Ces ambitieux ne veulent jamais que l'on
ait raison contre eux; ni les droits acquis, ni la majesté des lois
ne les arrêtent; ils corrompent le peuple par des largesses, ils
lèvent la tête en factieux, travaillent par tous les moyens à
étendre leur pouvoir; ce qui leur convient , c'est la domination par
la force, et non la justice dans l'égalité. Mais plus les passions
parlent haut, plus il y a de gloire à les maîtriser. Ce qui est
certain, c'est que la justice est de tous les temps, c'est que le
courage et la magnanimité consistent non pas à faire, mais à
empêcher le mal. La véritable grandeur d'âme, celle que la sagesse
éclaire, comprend que cet honneur qu'elle poursuit sans cesse est
situé en elle quand elle fait le bien, et non dans les discours des
hommes ; elle aspire à mériter et non à occuper le premier rang.
Celui qui est l'esclave de l'opinion insensée de la multitude ne
doit pas être compté parmi les grands hommes. C'est cette passion
pour la gloire qui corrompt souvent les plus grandes âmes ; c'est en
elle que bien des injustices prennent leur source : le pas est
glissant. Où est l'homme, en effet, qui, après de grands travaux et
de grands périls, ne demande pas d'en être récompensé par la gloire?
XX. En dernère analyse, la force et
la grandeur d'âme se reconnaissent surtout à une double marque.
D'abord une grande âme méprise tous les biens extérieurs ; elle est
persuadée que l'homme ne doit rien admirer, souhaiter ou rechercher
que ce qui est honnête et honorable, et que jamais il ne doit
s'incliner ni devant les hommes, ni de¬vant la fortune, ni sous le
joug des passions. Ensuite une âme qui est aussi haut placée se
porte à faire de grandes choses et à servir les hommes : plus les
entreprises sont difficiles et périlleuses, plus son ardeur est
excitée; elle ne tient nul compte ni de la vie ni de tous les biens
qui s'y rattachent. De ces deux parties de la grandeur d'âme, la
dernière est sans contredit la plus éclatante, la plus honorée,
j'ajouterai même la plus utile ; mais la première est la pl us
intime et la plus essentiel le, el le est la grandeur même. C'est
par elle que l'homme est véritablement élevé, et supérieur aux
choses humaines ; car l'élévation consiste surtout à ne reconnaître
pour bien que ce qui est honnête, et à être affranchi de toute
passion. Compter pour peu de chose ce qui paraît excellent et
magnifique aux yeux de la multitude, dédaigner d'une raison ferme et
constante tous les biens vulgaires, c'est là certainement le propre
d'un grand cœur; supporter tous les maux de la vie, les revers et
les injures de la fortune, avec cette tranquillité d'âme qui ne
s'altère jamais et l'inviolable dignité du sage, c'est le signe de
la vraie noblesse et d'une force admirable de caractère. Il serait
honteux que celui sur qui la crainte n'a point de prise fût
l'esclave des passions; et que la volupté vînt à triompher de
l'homme qui est sorti victorieux des plus rudes épreuves. Il faut
donc se mettre en garde contre les plaisirs, et mépriser les
richesses. Rien ne décèle plus une âme misérable et basse que
l'amour de l'or ; rien de plus noble et de plus digne de l'homme que
de mépriser la fortune quand elle nous manque, et de l'employer,
quand nous l'avons, en bienfaits et en libéralités. Il faut se
défier aussi de la passion de la gloire, comme je l'ai dit plus
haut; car elle nous rend esclaves, et une grande âme doit livrer les
plus terribles combats pour conserver sa liberté. Elle ne poursuivra
pas non plus les honneurs et le pouvoir, quelquefois même elle les
refusera; elle s'en dépouillera dans certaines occasions : son
devoir est de ne s'ouvrir à aucune passion, d'être inaccessible aux
désirs immodérés comme à la crainte, aux vains chagrins et à
l'ivresse de la joie, comme à la colère, et de retenir toujours
cette tranquillité et cette sérénité, qui font la constance et la
dignité de la vie. On a vu dans tous les temps, et il existe encore
aujourd'hui des hommes qui se sont éloignés des affaires publiques
et réfugiés dans la retraite, pour y trouver la tranquillité dont je
parle. On compte parmi eux les plus grands et les plus célèbres
philosophes, des personnages graves et austères, qui, n'ayant pu
s'accommoder aux mœurs du peuple ni à celles de la noblesse, se
retirèrent pour la plupart à la campagne, où ils ont trouvé le
bonheur au sein des occupations domestiques. Ils voulaient vivre
comme les rois, sans besoins, sans maître, dans une entière liberté
, et jouissant de ce beau privilège de se conduire en tout à leur
guise.
|
|
XXI. Quare cum hoc commune sit potentiae cupidorum
cum iis, quos dixi, otiosis, alteri se adipisci id posse arbitrantur, si opes
magnas habeant, alteri, si contenti sint et suo et parvo. In quo neutrorum
omnino contemnenda sententia est, sed et facilior et tutior et minus aliis
gravis aut molesta vita est otiosorum, fructuosior autem hominum generi et ad
claritatem amplitudinemque aptior eorum, qui se ad rem publicam et ad magnas res
gerendas accommodaverunt. Quapropter et iis forsitan concedendum sit rem
publicam non capessentibus, qui excellenti ingenio doctrinae sese dediderunt, et
iis, qui aut valetudinis imbecillitate aut aliqua graviore causa impediti a re
publica recesserunt, cum eius administrandae potestatem aliis laudemque
concederent. Quibus autem talis nulla sit causa, si despicere se dicant ea, quae
plerique mirentur, imperia et magistratus, iis non modo non laudi, verum etiam
vitio dandum puto; quorum iudicium in eo, quod gloriam contemnant et pro nihilo
putent, difficile factu est non probare; sed videntur labores et molestias, tum
offensionum et repulsarum quasi quandam ignominiam timere et infamiam. Sunt
enim, qui in rebus contrariis parum sibi constent, voluptatem severissime
contemnant, in dolore sint molliores, gloriam neglegant, frangantur infamia,
atque ea quidem non satis constanter. Sed iis, qui habent a natura adiumenta
rerum gerendarum, abiecta omni cunctatione adipiscendi magistratus et gerenda
res publica est; nec enim aliter aut regi civitas aut declarari animi magnitudo
potest. Capessentibus autem rem publicam nihilo minus quam philosophis, haud
scio an magis etiam et magnificentia et despicientia adhibenda est rerum
humanarum, quam saepe dico, et tranquillitas animi atque securitas, siquidem nec
anxii futuri sunt et cum gravitate constantiaque victuri. Quae faciliora sunt
philosophis, quo minus multa patent in eorum vita, quae fortuna feriat, et quo
minus multis rebus egent, et quia, si quid adversi eveniat, tam graviter cadere
non possunt. Quocirca non sine causa maiores motus animorum concitantur
maioraque studia efficiendi rem publicam gerentibus quam quietis, quo magis iis
et magnitudo est animi adhibenda et vacuitas ab angoribus. Ad rem gerendam autem
qui accedit, caveat, ne id modo consideret, quam illa res honesta sit, sed etiam
ut habeat efficiendi facultatem; in quo ipso considerandum est, ne aut temere
desperet propter ignaviam aut nimis confidat propter cupiditatem. In omnibus
autem negotiis, prius quam aggrediare, adhibenda est praeparatio diligens.
XXII. Sed cum plerique arbitrentur res bellicas
maiores esse quam urbanas, minuenda est haec opinio. Multi enim bella saepe
quaesiverunt propter gloriae cupiditatem, atque id in magnis animis ingeniisque
plerumque contingit, eoque magis, si sunt ad rem militarem apti et cupidi
bellorum gerendorum; vere autem si volumus iudicare, multae res exstiterunt
urbanae maiores clarioresque quam bellicae. Quamvis enim Themistocles iure
laudetur et sit eius nomen quam Solonis illustrius citcturque Salamis
clarissimae testis victoriae, quae anteponatur consilio Solonis ei, quo primum
constituit Areopagitas, non minus praeclarum hoc quam illud iudicandum est;
illud enim semel profuit, hoc semper proderit civitati; hoc consilio leges
Atheniensium, hoc maiorum instituta servantur; et Themistocles quidem nihil
dixerit, in quo ipse Areopagum adiuverit, at ille vere a se adiutum
Themistoclem; est enim bellum gestum consilio senatus eius, qui a Solone erat
constitutus. Licet eadem de Pausania Lysandroque dicere, quorum rebus gestis
quamquam imperium Lacedaemoniis partum putatur, tamen ne minima quidem ex parte
Lycurgi legibus et disciplinae confercndi sunt; quin etiam ob has ipsas causas
et parentiores habuerunt exercitus et fortiores. Mihi quidem neque pueris nobis
M. Scaurus C. Mario neque, cum versaremur in re publica, Q. Catulus Cn. Pompeio
cedere videbatur; parvi enim sunt foris arma, nisi est consilium domi; nec plus
Africanus, singularis et vir et imperator, in exscindenda Numantia rei publicae
profuit quam eodem tempore P. Nasica privatus, cum Ti. Gracchum interemit;
quamquam haec quidem res non solum ex domestica est ratione (attingit etiam
bellicam, quoniam vi manuque confecta est), sed tamen id ipsum est gestum
consilio urbano sine exercitu. Illud autem optimum est, in quod invadi solere ab
improbis et invidis audio:
“Cedant arma togae, concedat laurea laudi.
Ut enim alios omittam, nobis rem publicam
gubernantibus nonne togae arma cesserunt? neque enim periculum in re publica
fuit gravius umquam nec maius otium. Ita consiliis diligentiaque nostra
celeriter de manibus audacissimorum civium delapsa arma ipsa ceciderunt. Quae
res igitur gesta umquam in bello tanta? qui triumphus conferendus? licet enim
mihi, M. fill, apud te gloriari, ad quem et hereditas huius gloriae et factorum
imitatio pertinet. Mihi quidem certe vir abundans bellicis laudibus, Cn.
Pompeius, multis audientibus hoc tribuit, ut diceret
frustra se triumphum
tertium deportaturum fuisse, nisi meo in rem publicam beneficio, ubi
triumpharet, esset habiturus. Sunt igitur domesticae fortitudines non inferiores
militaribus; in quibus plus etiam quam in his operae studiique ponendum est.
XXIII. Omnino illud honestum, quod ex animo
excelso magnificoque quaerimus, animi efficitur, non corporis viribus.
Exercendum tamen corpus et ita afficiendum est, ut oboedire consilio rationique
possit in exsequendis negotiis et in labore tolerando. Honestum autem id, quod
exquirimus, totum est positum in animi cura et cogitatione; in quo non minorem
utilitatem afferunt, qui togati rei publicae praesunt, quam qui bellum gerunt.
Itaque eorum consilio saepe aut non suscepta aut confecta bella sunt, non
numquam etiam illata, ut M. Catonis bellum tertium Punicum, in quo etiam mortui
valuit auctoritas. Quare expetenda quidem magis est decernendi ratio quam
decertandi fortitudo, sed cavendum, ne id bellandi magis fuga quam utilitatis
ratione faciamus. Bellum autem ita suscipiatur, ut nihil aliud nisi pax quaesita
videatur. Fortis vero animi et constantis est non perturbari in rebus asperis
nec tumultuantem de gradu deici, ut dicitur, sed praesenti animo uti et consilio
nec a ratione discedere. Quamquam hoc animi, illud etiam ingenii magni est,
praecipere cogitatione futura et aliquanto ante constituere, quid accidere
possit in utramque partem, et quid agendum sit, cum quid evenerit, nec
committere, ut aliquando dicendum sit: “Non putaram.” Haec sunt opera magni
animi et excelsi et prudentia consilioque fidentis; temere autem in acie versari
et manu cum hoste confligere immane quiddam et beluarum simile est; sed cum
tempus necessitasque postulat, decertandum manu est et mors servituti
turpitudinique anteponenda.
XXIV. De evertendis autem diripiendisque urbibus
valde considerandum est ne quid temere, ne quid crudeliter. Idque est magni
viri, rebus agitatis punire sontes, multitudinem conservare, in omni fortuna
recta atque honesta retinere. Ut enim sunt, quem ad modum supra dixi, qui
urbanis rebus bellicas anteponant, sic reperias multos, quibus periculosa et
calida consilia quietis et cogitatis splendidiora et maiora videantur. Numquam
omnino periculi fuga committendum est, ut imbelles timidique videamur, sed
fugiendum illud etiam, ne offeramus nos periculis sine causa, quo esse nihil
potest stultius. Quapropter in adeundis periculis consuetudo imitanda medicorum
est, qui leviter aegrotantes leniter curant, gravioribus autem morbis
periculosas curationes et ancipites adhibere coguntur. Quare in tranquillo
tempestatem adversam optare dementis est, subvenire autem tempestati quavis
ratione sapientis, eoque magis, si plus adipiscare re explicata boni quam
addubitata mali. Periculosae autem rerum actiones partim iis sunt, qui eas
suscipiunt, partim rei publicae. Itemque alii de vita, alii de gloria et
benivolentia civium in discrimen vocantur. Promptiores igitur debemus esse ad
nostra pericula quam ad communia dimicareque paratius de honore et gloria quam
de ceteris commodis. Inventi autem multi sunt, qui non modo pecuniam, sed etiam
vitam profundere pro patria parati essent, iidem gloriae iacturam ne minimam
quidem facere vellent, ne re publica quidem postulante;
ut Callicratidas, qui,
cum Lacedaemoniorum dux fuisset Peloponnesiaco bello multaque fecisset egregie,
vertit ad extremum omnia, cum consilio non paruit eorum, qui classem ab
Arginusis removendam nec cum Atheniensibus dimicandum putabant; quibus ille
respondit Lacedaemonios classe illa amissa aliam parare posse, se fugere sine
suo dedecore non posse. Atque haec quidem Lacedaemoniis plaga mediocris, illa
pestifera, qua, cum Cleombrotus invidiam timens temere cum Epaminonda
conflixisset, Lacedaemoniorum opes corruerunt. Quanto Q. Maximus melius! de quo
Ennius:
Unus homo nobis cunctando restituit rem.
Non hic rumores ponebat ante salutem.
Ergo postque magisque viri nunc gloria claret.
Quod genus peccandi vitandum est etiam in rebus
urbanis. Sunt enim, qui, quod sentiunt, etsi optimum sit, tamen invidiae metu
non audeant dicere.
XXV. Omnino qui rei publicae praefuturi sunt, duo
Platonis praecepta teneant, unum, ut utilitatem civium sic tueantur, ut,
quaecumque agunt, ad eam referant obliti commodorum suorum, alterum, ut totum
corpus rei publicae curent, ne, dum partem aliquam tuentur, reliquas deserant.
Ut enim tutela, sic procuratio rei publicae ad eorum utilitatem, qui commissi
sunt, non ad eorum, quibus commissa est, gerenda est. Qui autem parti civium
consulunt, partem neglegunt, rem perniciosissimam in civitatem inducunt,
seditionem atque discordiam; ex quo evenit, ut alii populares, alii studiosi
optimi cuiusque videantur, pauci universorum. Hinc apud Atheniensis magnae
discordiae, in nostra re publica non solum seditiones, sed etiam pestifera bella
civilia; quae gravis et fortis civis et in re publica dignus principatu fugiet
atque oderit tradetque se totum rei publicae neque opes aut potentiam
consectabitur totamque eam sic tuebitur, ut omnibus consulat; nec vero
criminibus falsis in odium aut invidiam quemquam vocabit omninoque ita iustitiae
honestatique adhaerescet, ut, dum ea conservet, quamvis graviter offendat
mortemque oppetat potius quam deserat illa, quae dixi. Miserrima omnino est
ambitio honorumque contentio, de qua praeclare apud eundem est Platonem, “similiter
facere eos, qui inter se contenderent, uter potius rem publicam administraret,
ut si nautae certarent, quis eorum potissimum gubernaret.” Idemque
praecipit, ut “eos adversaries existimemus, qui arma contra ferant, non eos, qui
suo iudicio tueri rem publicam velint,” qualis fuit inter P. Africanum et Q.
Metellum sine acerbitate dissensio. Nec vero audiendi, qui graviter inimicis
irascendum putabunt idque magnanimi et fortis viri esse censebunt; nihil enim
laudabilius, nihil magno et praeclaro viro dignius placabilitate atque
clementia. In liberis vero populis et in iuris aequabilitate exercenda etiam est
facilitas et altitudo animi, quae dicitur, ne, si irascamur aut intempestive
accedentibus aut impudenter rogantibus, in morositatem inutilem et odiosam
incidamus. Et tamen ita probanda est mansuetudo atque dementia, ut adhibeatur
rei publicae causa severitas, sine qua administrari civitas non potest. Omnis
autem et animadversio et castigatio contumelia vacare debet neque ad eius, qui
punitur aliquem aut verbis castigat, sed ad rei publicae utilitatem referri.
Cavendum est etiam, ne maior poena quam culpa sit,
et ne isdem de causis alii
plectantur, alii ne appellentur quidem. Prohibenda autem maxime est ira in
puniendo; numquam enim, iratus qui accedet ad poenam, mediocritatem illam
tenebit, quae est inter nimium et parum, quae placet Peripateticis, et recte
placet, modo ne laudarent iracundiam et dicerent utiliter a natura datam. Illa
vero omnibus in rebus repudianda est optandumque, ut ii, qui praesunt rei
publicae, legum similes sint, quae ad puniendum non iracundia, sed aequitate
dicuntur.
XXVI. Atque etiam in rebus prosperis et ad
voluntatem nostram fluentibus superbiam magnopere, fastidium arrogantiamque
fugiamus. Nam ut adversas res, sic secundas immoderate ferre levitatis est,
praeclaraque est aequabilitas in omni vita et idem semper vultus eademque frons,
ut de Socrate itemque de C. Laelio accepimus. Philippum quidem, Macedonum regem,
rebus gestis et gloria superatum a filio, facilitate et humanitate video
superiorem fuisse; itaque alter semper magnus, alter saepe turpissimus; ut recte
praecipere videantur, qui monent, ut, quanto superiores simus, tanto nos geramus
summissius. Panaetius quidem Africanum, auditorem et familiarem suum, solitum
ait dicere, “ut equos propter crebras contentiones proeliorum ferocitate
exsultantes domitoribus tradere soleant, ut iis facilioribus possint uti, sic
homines secundis rebus effrenatos sibique praefidentes tamquam in gyrum rationis
et doctrinae duci oportere, ut perspicerent rerum humanarum imbecillitatem
varietatemque fortunae.” Atque etiam in secundissimis rebus maxime est utendum
consilio amicorum iisque maior etiam quam ante tribuenda auctoritas. Isdemque
temporibus cavendum est, ne assentatoribus patefaciamus auris neve adulari nos
sinamus, in quo falli facile est; tales enim nos esse putamus, ut iure laudemur;
ex quo nascuntur innumerabilia peccata, cum homines inflati opinionibus turpiter
irridentur et in maximis versantur erroribus. Sed haec quidem hactenus. Illud
autem sic est iudicandum, maximas geri res et maximi animi ab iis, qui res
publicas regant, quod earum administratio latissime pateat ad plurimosque
pertineat; esse autem magni animi et fuisse multos etiam in vita otiosa, qui aut
investigarent aut conarentur magna quaedam seseque suarum rerum finibus
continerent aut interiecti inter philosophos et eos, qui rem publicam
administrarent, delectarentur re sua familiari non eam quidem omni ratione
exaggerantes neque excludentes ab eius usu suos potiusque et amicis impertientes
et rei publicae, si quando usus esset. Quae primum bene parta sit nullo neque
turpi quaestu neque odioso, deinde augeatur ratione, diligentia, parsimonia, tum
quam plurimis, modo dignis, se utilem praebeat nec libidini potius luxuriaeque
quam liberalitati et beneficentiae pareat. Haec praescripta servantem licet
magnifice, graviter animoseque vivere atque etiam simpliciter, fideliter, ° vere
hominum amice.
XXVII. Sequitur, ut de una reliqua parte
honestatis dicendum sit, in qua verecundia et quasi quidam ornatus vitae,
temperantia et modestia omnisque sedatio perturbationum animi et rerum modus
cernitur. Hoc loco continetur id, quod dici Latine decorum potest; Graece enim
πρέπον dicitur. Huius vis ea est, ut ab honesto non queat separari; nam et, quod
decet, honestum est et, quod honestum est, decet; qualis autem differentia sit
honesti et decori, facilius intellegi quam explanari potest. Quicquid est enim,
quod deceat, id tum apparet, cum antegressa est honestas. Itaque non solum in
hac parte honestatis, de qua hoc loco disserendum est, sed etiam in tribus
superioribus quid deceat apparet. Nam et ratione uti atque oratione prudenter et
agere, quod agas, considerate omnique in re quid sit veri videre et tueri decet,
contraque falli, errare, labi, decipi tam dedecet quam delirare et mente esse
captum; et iusta omnia decora sunt, iniusta contra, ut turpia, sic indecora.
Similis est ratio fortitudinis. Quod enim viriliter animoque magno fit, id
dignum viro et decorum videtur, quod contra, id ut turpe, sic indecorum. Quare
pertinet quidem ad omnem honestatem hoc, quod dico, decorum, et ita pertinet, ut
non recondita quadam ratione cernatur, sed sit in promptu. Est enim quiddam,
idque intellegitur in omni virtute, quod deceat; quod cogitatione magis a
virtute potest quam re separari. Ut venustas et pulchritudo corporis secerni non
potest a valetudine, sic hoc, de quo loquimur, decorum totum illud quidem est
cum virtute confusum, sed mente et cogitatione distinguitur. Est autem eius
discriptio duplex; nam et generale quoddam decorum intellegimus, quod in omni
honestate versatur, et aliud huic subiectum, quod pertinet ad singulas partes
honestatis. Atque illud superius sic fere definiri solet: decorum id esse, quod
consentaneum sithominis excellentiae in eo, in quo natura eius a reliquis
animantibus differat. Quae autem pars subiecta generi est, earn sic definiunt,
ut id decorum velint esse, quod ita naturae consentaneum sit, ut in eo moderatio
et temperantia appareat cum specie quadam liberali.
XXVIII. Haec ita intellegi possumus existimare ex
eo decoro, quod poetae sequuntur; de quo alio loco plura dici solent. Sed tum
servare illud poë- tas, quod deceat, dicimus, cum id, quod quaque persona dignum
est, et fit et dicitur; ut, si Aeacus aut Minos diceret:
Oderint, dum metuant,
aut:
Natis sepulchre ipse est parens,
indecorum videretur, quod eos fuisse iustos
accepimus; at Atreo dicente plausus excitantur; est enim digna persona oratio.
Sed poëtae, quid quemque deceat, ex persona iudicabunt; nobis autem personam
imposuit ipsa natura magna cum excellentia praestantiaque animantium reliquarum.
Quocirca poëtae in magna varietate personarum, etiam vitiosis quid conveniat et
quid deceat, videbunt, nobis autem cum a natura constantiae, moderationis,
temperantiae, verecundiae partes datae sint, cumque eadem natura doceat non
neglegere, quem ad modum nos adversus homines geramus, efficitur, ut et illud,
quod ad omnem honestatem pertinet, decorum quam late fusum sit, appareat et hoc,
quod spectatur in uno quoque genere virtutis. Ut enim pulchritudo corporis apta
compositione membrorum movet oculos et delectat hoc ipso, quod inter se omnes
partes cum quodam lepore consentiunt, sic hoc decorum, quod elucet in vita,
movet approbationem eorum, quibuscum vivitur, ordine et constantia et
moderatione dictorum omnium atque factorum. Adhibenda est igitur quaedam
reverentia adversus homines et optimi cuiusque et reliquorum. Nam neglegere,
quid de se quisque sentiat, non solum arrogantis est, sed etiam omnino
dissoluti. Est autem, quod differat in hominum ratione habenda inter iustitiam
et verecundiam. Iustitiae partes sunt non violare homines, verecundiae non
offendere; in quo maxime vis perspicitur decori. His igitur expositis, quale sit
id, quod decere dicimus, intellectum puto. Officium autem, quod ab eo ducitur,
hanc primum habet viam, quae deducit ad convenientiam conservationemque naturae;
quam si sequemur ducem, numquam aberrabimus sequemurque et id, quod acutum et
perspicax natura est, et id, quod ad hominum consociationem accommodatum, et id,
quod vehemens atque forte. Sed maxima vis decori in hac inest parte, de qua
disputamus; neque enim solum corporis, qui ad naturam apti sunt, sed multo etiam
magis animi motus probandi, qui item ad naturam accommodati sunt. Duplex est
enim vis animorum atque natura; una pars in appetitu posita est, quae est ὁρμή
Graece, quae hominem huc et illuc rapit, altera in ratione, quae docet et
explanat, quid faciendum fugiendumque sit. Ita fit, ut ratio praesit, appetitus
obtemperet.
XXIX. Omnis autem actio vacare debet temeritate et
neglegentia nec vero agere quicquam, cuius non possit causam probabilem reddere;
haec est enim fere discriptio officii. Efficiendum autem est, ut appetitus
rationi oboediant eamque neque praecurrant nee propter pigritiam aut ignaviam
deserant sintque tranquilli atque omni animi perturbatione careant; ex quo
elucebit omnis constantia omnisque moderatio. Nam qui appetitus longius
evagantur et tamquam exsultantes sive cupiendo sive fugiendo non satis a ratione
retinentur, ii sine dubio finem et modum transeunt; relinquunt enim et abiciunt
oboedientiam nec rationi parent, cui sunt subiecti lege naturae; a quibus non
modo animi perturbantur, sed etiam corpora. Licet ora ipsa cernere iratorum aut
eorum, qui aut libidine aliqua aut metu commoti sunt aut voluptate nimia
gestiunt; quorum omnium voltus, voces, motus statusque mutantur. Ex quibus illud
intellegitur, ut ad officii formam revertamur, appetitus omnes contrahendos
sedandosque esse excitandamque animadversionem et diligentiam, ut ne quid temere
ac fortuito, inconsiderate neglegenterque agamus. Neque enim ita generati a
natura sumus, ut ad ludum et iocum facti esse videamur, ad severitatem potius et
ad quaedam studia graviora atque maiora. Ludo autem et ioco uti illo quidem
licet, sed sicut somno et quietibus ceteris tum, cum gravibus seriisque rebus
satis fecerimus. Ipsumque genus iocandi non profusum nec immodestum, sed
ingenuum et facetum esse debet. Ut enim pueris non omnem ludendi licentiam
damus, sed eam, quae ab honestatis actionibus non sit aliena, sic in ipso ioco
aliquod probi ingenii lumen eluceat. Duplex omnino est iocandi genus, unum
illiberale, petulans, flagitiosum, obscenum, alterum elegans, urbanum,
ingeniosum, facetum. Quo genere non modo Plautus noster et Atticorum antiqua
comoedia, sed etiam philosophorum Socraticorum libri referti sunt, multaque
multorum facete dicta, ut ea, quae a sene Catone collecta sunt, quae vocant
ἀποφθέγματα. Facilis igitur est distinctio ingenui et illiberalis ioci. Alter
est, si tempore fit, ut si remisso animo, gravissimo homine dignus, alter ne
libero quidem, si rerum turpitudini adhibetur verborum obscenitas. Ludendi etiam
est quidam modus retinendus, ut ne nimis omnia profundamus elatique voluptate in
aliquam turpitudinem delabamur. Suppeditant autem et campus noster et studia
venandi honesta exempla ludendi.
XXX. Sed pertinet ad omnem officii quaestionem
semper in promptu habere, quantum natura hominis pecudibus reliquisque beluis
antecedat; illae nihil sentiunt nisi voluptatem ad eamque feruntur omni impetu,
hominis autem mens discendo alitur et cogitando, semper aliquid aut anquirit aut
agit videndique et audiendi delectatione ducitur. Quin etiam, si quis est paulo
ad voluptates propensior, modo ne sit ex pecudum genere (sunt enim quidam
homines non re, sed nomine), sed si quis est paulo erectior, quamvis voluptate
capiatur, occultat et dissimulat appetitum voluptatis propter verecundiam. Ex
quo intellegitur corporis voluptatem non satis esse dignam hominis praestantia,
eamque contemni et reici oportere; sin sit quispiam, qui aliquid tribuat
voluptati, diligenter ei tenendum esse eius fruendae modum. Itaque victus
cultusque corporis ad valetudinem referatur et ad vires, non ad voluptatem.
Atque etiam si considerare volumus, quae sit in natura excellentia et dignitas,
intellegemus, quam sit turpe diffluere luxuria et delicate ac molliter vivere
quamque honestum parce, continenter, severe, sobrie. Intellegendum etiam cst
duabus quasi nos a natura indutos esse personis; quarum una communis est ex eo,
quod omnes participes sumus rationis praestantiaeque eius, qua antecellimus
bestiis, a qua omne honestum decorumque trahitur, et ex qua ratio inveniendi
officii exquiritur, altera autem, quae proprie singulis est tributa. Ut enim in
corporibus magnae dissimilitudines sunt (alios videmus velocitate ad cursum,
alios viribus ad luctandum valere, itemque in formis aliis dignitatem inesse,
aliis venustatem), sic in animis exsistunt maiores etiam varietates. Erat in L.
Crasso, in L. Philippo multus lepos, maior etiam magisque de industria in C.
Caesare L. filio; at isdem temporibus in M. Scauro et in M. Druso adulescente
singularis severitas, in C. Laelio multa hilaritas, in eius familiari Scipione
ambitio maior, vita tristior. De Graecis autem dulcem et facetum festivique
sermonis atque in omni oratione simulatorem, quem εἴρωνα Graeci nominarunt,
Socratem accepimus, contra Pythagoram et Periclem summam auctoritatem consecutos
sine ulla hilaritate. Callidum Hannibalem ex Poenorum, ex nostris ducibus Q.
Maximum accepimus, facile celare, tacere, dissimulare, insidiari, praeripere
hostium consilia. In quo genere Graeci Themistoclem et Pheraeum Iasonem ceteris
anteponunt; in primisque versutum et callidum factum Solonis, qui, quo et tutior
eius vita esset et plus aliquanto rei publicae prodesset, furere se simulavit.
Sunt his alii multum dispares, simplices et aperti. qui nihil ex occulto, nihil
de insidiis agendum putant, veritatis cultores, fraudis inimici, itemque alii,
qui quidvis perpetiantur, cuivis deserviant, dum, quod velint, consequantur, ut
Sullam et M. Crassum videbamus. Quo in genere versutissimum et patientissimum
Lacedaemonium Lysandrum accepimus, contraque Callicratidam, qui praefectus
classis proximus post Lysandrum fuit; itemque in sermonibus alium quemque,
quamvis praepotens sit, efficere, ut unus de multis esse videatur; quod in
Catulo, et in patre et in filio, itemque in Q. Mucio ° Mancia vidimus. Audivi ex
maioribus natu hoc idem fuisse in P. Scipione Nasica, contraque patrem eius,
illum qui Ti. Gracchi conatus perditos vindicavit, nullam comitatem habuisse
sermonis ne Xenocratem quidem, severissimum philosophorum, ob eamque rem ipsam
magnum et clarum fuisse. Innumerabiles aliae dissimilitudines sunt naturae
morumque, minime tamen vituperandorum. |
XXI. Tel est le but commun et à
ceux qui briguent le pouvoir et à ceux dont je parle, qui
s'ensevelissent dans le repos : les uns croient pouvoir l'atteindre
s'ils se font une grande fortune, les autres s'ils se résignent de
bon cœur à leur modeste lot. Il ne faut condamner absolument ni les
uns ni les autres; mais une vie qui s'écoule dans la retraite est
plus facile, plus sûre, plus inoffensive, et fait moins d'ombrage ;
celle au contraire qui est toute vouée aux soins politiques et qui
se passe dans la conduite des grandes affaires, est plus profitable
au genre humain et mieux faite pour donner la grandeur et la gloire.
C'est pourquoi il faudrait peut-être autoriser à se retirer de la
scène du monde ceux qui ont le génie de la science et passent leur
vie dans l'étude, et ceux que la faiblesse de leur santé ou quelque
442 grave empêchement
tiennent éloignés des affaires publiques, et obligent à laisser à
d'autres le soin et la gloire d'administrer les États. Mais les
hommes qui ne peuvent alléguer aucun de ces motifs , et qui se
vantent de dédaigner les honneurs et le pouvoir, qui ont pour tant
d'autres des attraits si magiques, me paraissent bien plutôt dignes
de blâme que d'éloges. Sans doute, il est difficile de ne pas
approuver le jugement qu'ils portent sur la gloire, et le mépris
qu'ils en font; mais il semble qu'ils redoutent les travaux et la
peine, et que leur fierté s'indigne à l'idée des échecs et des refus
qu'ils pourraient essuyer. On trouve en effet des hommes qui
démentent toutes leurs belles maximes dans l'infortune; ils avaient
un mépris austère pour la volupté, la douleur les abat; ils
dédaignaient la gloire, ils sont anéantis par le moindre affront;
heureux encore s'ils avaient toujours ce salutaire effroi de tout ce
qui fait tache à l'honneur! Nous le déclarons donc, tous ceux à qui
la nature ouvre d'elle-même le chemin des affaires doivent, sans
hésiter, s'offrir aux suffrages de leurs concitoyens et se vouer à
la vie politique ; car autrement les États n'auraient point de
chefs, et les grandes âmes ne se montreraient jamais. L'homme qui
est chargé des destinées de l'État, doit avoir, tout autant que le
philosophe, et peut-être plus encore, cette noblesse de sentiment,
ce mépris des choses humaines et surtout cette tranquillité parfaite
sur laquelle j'insiste tant; il ne faut point que le trouble pénètre
dans son esprit, et sa vie doit être un modèle de constance et de
gravité. Tout cela est assez facile au philosophe, dont la vie est
bien moins exposée aux coups du sort, dont les besoins sont
comparativement très-bornés, et qu'un revers de fortune ne peut
précipiter d'aussi haut. Il est tout naturel de ressentir des
épreuves plus violentes et de plus graves soucis à la tête d'un État
que dans une retraite ignorée ; aussi les hommes politiques ont-ils
plus besoin que les autres de calme et de grandeur d'âme. Celui qui
veut prendre sa part du fardeau des affaires ne doit pas songer
seulement à la beauté du rôle qu'il ambitionne, il faut encore qu'il
soit fait pour ce rôle ; et quand il mesure ses forces, il doit se
garder de la défiance honteuse que la lâcheté inspire, et de la
présomption que donne souvent l'ardeur de se distinguer. Enfin, il
ne faut rien entreprendre sans s'y être préparé de longue main. XXII. Mais comme on met d'ordinaire
la gloire des armes au-dessus du mérite civil, nous devons ici
attaquer ce préjugé. Beaucoup n'ont cherché dans la guerre que la
gloire qu'elle donne. C'est ce qui arrive d'habitude aux grands
hommes, surtout quand ils ont des talents militaires et qu'ils
aiment la vie des camps. Cependant, si nous voulons bien voir les
choses, le mérite civil l'emporte souvent sur les plus beaux
exploits des guerriers. La gloire de Thémistocle est certes
très-légitime ; le nom de ce grand capitaine est même plus illustre
que celui de Solon. On cite avec éclat la victoire de Salamine, on
la met au-dessus de l'établissement de l'Aréopage, création du sage
législateur; et cependant l'œuvre de Solon n'est pas moins admirable
que l'exploit de Thémistocle. Salamine a rendu un service signale à
Athènes, l'Aréopage lui en rend de continuels; car c'est lui qui
maintient le dépôt sacré des lois et les institutions des ancêtres.
Thémistocle au¬rait-il pu dire quels secours il avait rendus à
l'Aréopage? N'aurait-il pas avoué au contraire qu'il lui
442 devait beaucoup? car
la guerre fut conduite par , les conseils de ce sénat qu'avait
institué Solon. On en peut dire autant de Pausanias et de Lysandre.
Sans doute leurs victoires ont agrandi l'empire de Lacédémone; mais
tous leurs titres de gloire rassemblés ne soutiendraient pas la
comparaison avec les lois et les institutions de Lycurgue. Bien
plus, c'est grâce à cette belle discipline qu'ils ont eu des années
si obéissantes et si braves. Je n'ai pas vu, pendant ma jeunesse,
que M. Scaurus le cédât à Marius ; et quand j'ai été mêlé aux
affaires publiques, Pompée ne me paraissait nullement l'emporter sur
Q. Catulus. Que peuvent au dehors les plus fortes armées, quand la
sagesse des conseils manque au dedans? L'Africain , cet homme
admirable et ce grand capitaine , n'a pas rendu un service plus
important à la république en détruisant Numance, que P. Nasica, à la
même époque, en mettant à mort Tib. Gracchus de son autorité privée.
Il est vrai que ce n'est pas seulement un mérite civil que celui de
Nasica, puisqu'il fallut employer la force et en venir aux mains;
mais après tout, ce grand acte de civisme ne fut ni résolu par un
homme de guerre, ni exécuté par une armée. Je crois avoir exprimé
une belle maxime dans ce vers que les méchants et que mes envieux
attaquent si vivement : « Que les armes le cèdent à la toge, et les
lauriers à la gloire. Pour ne rien dire des autres, est-ce que
pendant mon consulat les armes ne l'ont point cédé à la toge? Jamais
Rome ne courut de plus grands périls, et jamais le repos public ne
fut plus profond. Notre vigilance et nos sages conseils avaient
pourvu à tout avec la promptitude de l'éclair, et les armes
tombèrent des mains des citoyens les plus audacieux qui furent
jamais. Y a-t-il dans le monde un exploit guerrier, et un triomphe
qui se puisse comparer à cette victoire pacifique? Il m'est permis,
mon fils, de vous parler de ma gloire, à vous qui en hériterez et
qui devrez vous en montrer digne. Un homme tout couvert de lauriers,
Pompée, me rendit publiquement ce témoignage : que c'est en vain
qu'il aurait obtenu les honneurs d'un troisième triomphe, et qu'il
n'eût pas eu où triompher, si je n'avais sauvé la république. Le
courage civil ne le cède donc point au courage militaire, et l'on
peut affirmer qu'il demande plus d'application et d'efforts.
XXIII. La vertu dont nous parlons
maintenant, et dans laquelle se montre toute la grandeur et la
noblesse de l'homme, est située dans la force de l'âme et non dans
celle du corps. Cependant il faut exercer le corps, le plier à
l'empire de la raison dont il doit exécuter les commandements, le
disposer à servir la pensée et à souffrir le travail. Mais le
véritable courage dépend tout entier de la vigilante sagesse de
l'âme. C'est un fruit de raison ; il ne brille donc pas moins dans
les magistrats civils qui gouvernent les républiques, que dans les
généraux qui livrent les batailles. Souvent les premiers décident
par leurs conseils de la paix ou de la guerre, achèvent les guerres
commencées, en font déclarer de nouvelles ; témoin la troisième
guerre Punique, dont le véritable auteur est Caton, qui eut le
crédit même après sa mort d'armer Rome contre Carthage. Il faut donc
préférer la sagesse qui donne les bons conseils à la valeur qui fait
les belles actions; mais il faut que cette préférence soit librement
444 avouée par la
raison et non point déterminée par la crainte des dangers. Quand
nous nous décidons à la guerre, il faut que tout le monde voie
clairement que notre but dernier c'est la paix. Il est d'un homme
ferme et courageux de ne point se troubler dans les périls, de ne
point s'agiter follement, et se démonter, comme on dit; mais d'avoir
toujours la tête présente, d'agir avec sang-froid et réflexion.
Voilà comment devra se montrer une grande âme; mais en même temps un
génie élevé saura prévoir l'avenir, en discuter les chances, se
préparer à tout événement, et veiller à ce qu'un jour il ne lui
faille pas faire ce triste aveu : Je n'y avais point pensé. C'est à
de tels signes que vous pourrez reconnaître une âme noble et élevée,
qui n'agit qu'avec lumière, et guidée par la raison. Mais se
précipiter en aveugle dans la mêlée, et lutter corps à corps avec
l'ennemi, est quelque chose de féroce, qui sent la bête sauvage ;
cependant si la nécessité nous y contraint, il faut bien combattre
de cette façon, car l'homme doit toujours préférer la mort à la
servitude et au déshonneur.
XXIV. Quand on en est réduit à
détruire ou à saccager une ville, il faut apporter le plus grand
soin à ne rien faire avec témérité et cruauté. En temps de sédition,
il est d'un grand homme de ne punir que les coupables, d'épargner le
grand nombre, et dans toutes les phases de sa fortune retenir
scrupuleusement les préceptes du juste et de l'honnête. De même que
l'on trouve beaucoup d'esprits qui mettent la valeur guerrière
au-dessus du courage civil, il en est un grand nombre aux yeux de
qui les avis violents et périlleux paraissent avoir plus de noblesse
et de dignité que les conseils calmes et modérés. Nous devons
prendre garde de fuir les périls comme des gens qui les redoutent ;
mais nous devons prendre garde aussi d'aller nous offrir aux périls
sans motif, car il n'est rien de plus insensé. Quand il est question
de dangers, suivons l'exemple des médecins qui traitent les maladies
légères avec des remèdes légers, et qui n'appliquent les remèdes
violents et incertains qu'aux maladies graves. Quand la mer est
tranquille, il faut être en démence pour souhaiter la tempête; mais
quand la tempête se déclare, le sage lutte contre elle par tous les
moyens. Le meilleur parti est celui de la hardiesse, quand on a plus
de bien à espérer en provoquant l'orage, que de mal à craindre en le
laissant sourdement gronder. Les périls qu'on affronte menacent à la
fois les citoyens qui se jettent tout au travers, et la république.
Les uns combattent pour la vie, les autres pour la gloire et la
popularité. Quand il s'agit des intérêts de la pairie, nous devons y
regarder de plus près avant de les mettre en jeu, que s'il était
question des nôtres ; et en ce qui nous touche, nous devons livrer
des luttes plus ardentes pour l'honneur et la gloire que pour tous
les autres biens. On a vu souvent des hommes tout près à sacrifier
non-seulement leur fortune, mais leur vie, pour les intérêts de leur
pays, et qui ne voulaient pas souffrir la moindre tache à leur
gloire même quand la patrie le réclamait. Tel fut Callicratidas,
général lacédémonien, qui, après s'être illustré par plusieurs
exploits dans la guerre du Péloponnèse, finit par compromettre
très-grièvement les affaires de Sparte, en refusant de déférer aux
conseils de ceux qui voulaient qu'on éloignât la flotte des
Arginuses et qu'on évitât de combattre avec les Athéniens. « Les
Lacédémoniens, leur ré- 445
pondit-il, s'ils perdent cette flotte, peuvent en équiper une autre
; et moi, je ne puis prendre la fuite sans déshonneur. » La défaite
de cette flotte ne fut pas encore un trop grand malheur pour
Lacédémone, mais un échec irréparable; ce fut lorsque Cléombrote,
dans la crainte de donner une mauvaise idée de sa vaillance, engagea
témérairement la bataille avec Épaminondas et ruina à tout jamais la
puissance de Sparte. Mettez en regard notre admirable Fabius, dont
Ennius a dit : « Un seul homme a rétabli la fortune romaine en
temporisant. C'est qu'il ne mettait pas les rumeurs du peuple
au-dessus du salut de l'État; aussi la gloire de ce héros
grandit-elle tous les jours. » Il faut éviter même, dans les
affaires civiles, la faute de Cléombrote. Il y a tant de gens qui
n'osent dire ce qu'ils pensent, alors même qu'ils pourraient rendre
de grands services, dans la crainte où ils sont de se faire des
ennemis !
XXV. Ceux qui sont chargés du
gouvernement des peuples doivent observer fidèlement ces deux
préceptes de Platon : Veiller d'abord aux intérêts de leurs
concitoyens avec un dévouement de tous les instants et un
désintéressement absolu; donner ensuite les mêmes soins à tout le
corps de la république, et ne point témoigner à l'une de ses parties
une prédilection qui tournerait au détriment des autres.
L'administration des États est une véritable tutelle, établie pour
le bien de ceux qui sont gouvernés et non de celui qui gouverne.
D'un autre côté, l'homme public qui est exclusivement dévoué à une
classe de citoyens et néglige toutes les autres introduit dans
l'État le plus pernicieux des fléaux, je veux dire la sédition et la
discorde; on ne compte plus alors que des partisans du peuple ou des
sectateurs des grands ; mais le parti de la république, qu'est-il
devenu? De là toutes ces fameuses discordes qui ont déchiré Athènes,
de là toutes les séditions et les guerres civiles qui ont désolé
Rome. Le grand citoyen, celui qui est vraiment digne de tenir le
premier rang dans l'État, aura en horreur tous ces bouleversements
effroyables ; il se dévouera sans réserve aux intérêts du pays; il
ne cherchera ni la fortune ni l'éclat de la puissance ; il veillera
enfin sur tous les membres de la société, sans acception d'ordres ni
de personnes. Jamais une accusation calomnieuse ne lui échappera,
jamais il n'excitera à la haine ou au mépris de qui que ce soit; les
règles de la justice et de l'honnêteté seront tellement gravées dans
son cœur, qu'il s'exposerait aux plus terribles inimitiés et
souffrirait plutôt mille morts, que de les mettre un seul moment en
oubli. Il n'y a rien de plus misérable que l'ambition et les
rivalités qu'elle fait naître. Platon dit encore avec une raison
supérieure : « Ceux qui luttent entre eux pour en venir à gouverner
l'État ressemblent à des matelots qui se battraient pour s'arracher
le gouvernail. » Platon nous recommande aussi de ne tenir pour
ennemis que ceux qui portent les armes contre notre pays, et non pas
ceux dont les convictions politiques diffèrent des nôtres ; c'est
ainsi que l'on a vu Scipion l'Africain et Q. Métellus se combattre
perpétuellement, sans se haïr jamais. N'écoutons pas les gens qui
veulent qu'on soit accessible aux inimitiés, qu'on les ressente
fortement, et que par là on témoigne de la grandeur d'âme. Rien au
contraire n'est plus louable que le pardon des inju-res et la
clémence; rien n'est plus digne d'une belle
446 âme et d'un noble
cœur. Dans un Etat libre, où tous les citoyens ont les mêmes droits,
il faut montrer beaucoup de facilité et de douceur. Témoigner avec
trop de vivacité sa mauvaise humeur contre les importuns et les
solliciteurs impudents, c'est se faire des ennemis sans nécessité-
Cependant la douceur et la clémence doivent a voir pour correctif
cette juste sévérité de l'homme d'État, sans laquelle on ne peut
gouverner les peuples. Il ne faut jamais ajouter l'injure au
châtiment. Le magistrat qui punit ou réprimande un citoyen ne doit
point songer h sa propre satisfaction , mais à l'intérêt public. Il
faut prendre garde aussi que la peine ne soit plus grande que la
faute, et que, pour les mêmes motifs, les uns soient châtiés, tandis
que les autres ne sont pas même appelés en justice. On doit surtout
éviter de mêler la colère au châtiment; car celui qui inflige une
peine dans l'emportement de la colère ne peut garder cette
modération qui nous tient à égale distance des extrêmes, et dont les
Péripatéticiens font un si grand éloge. Je souscris de bon cœur à
cet éloge, mais je trouve qu'ils le gâtent en y ajoutant celui de la
colère, et en disant qu'elle nous a été donnée à bon escient parla
nature. Jamais la colère n'est permise aux hommes ; et l'on doit
souhaiter que ceux qui gouvernent les républiques soient semblables
aux lois qui châtient les cou¬pables, non par emportement, mais par
équité.
XXVI. Quand la fortune nous seconde
et que le bonheur nous arrive de tous côtés, notre grand soin doit
être de nous défendre contre l'orgueil, l'arrogance, la présomption
hautaine. Qu'on se laisse emporter hors des gonds par les
prospérités ou par l'adversité, c'est toujours la marque d'un pauvre
caractère. Ce qui fait honneur à l'homme, c'est de conserver pendant
toute la vie une parfaite égalité d'âme, d'avoir toujours la même
sévérité, le même visage : tels furent, nous dit-on, Socrate et
Lélius. Les grandes actions et la gloire d'Alexandre l'emportent de
beaucoup sur celles de son père ; mais nous voyons que Philippe
avait plus de douceur et d'humanité. Celui-ci fut toujours grand,
celui-là fut souvent le dernier des hommes ; c'est donc un excellent
précepte que les sages nous donnent, quand ils nous recommandent
d'être d'autant plus modérés que nous sommes plus élevés. Panétius
nous dit que l'Africain, son disciple et ami, répétait souvent : «
Que de même que l'on fait dompter par d'habiles écuyers les chevaux
que l'habitude des combats a rendus trop farouches, ainsi faut-il
conduire les hommes gâtés et enorgueillis par la prospérité, à
l'école de la raison et de la sagesse, qui leur apprendront la
vanité des choses humaines et l'inconstance de la fortune. » C'est
dans la prospérité surtout que nous devons nous entourer des
conseils de nos amis ; c'est alors plus que jamais qu'il faut leur
donner de l'autorité sur nous, et en même temps nous défier des
flatteurs et leur fermer l'oreille. II est si facile de se laisser
prendre à leurs pièges ! Nous avons toujours la faiblesse de nous
croire dignes de louanges; et cette vanité pousse contre des écueils
sans nombre les hommes enflés de leur vain mérite, qui deviennent la
fable et le jouet du monde, et qui commettent les plus grandes
extravagances. Mais en voilà assez sur ce sujet. Ajoutons toutefois
que si les hommes d'Etat ont, par l'importance même de leur rang et
l'étendue des intérêts qu'ils conduisent, le privilège de se mêler
des grandes affaires et de se trouver portés sur le terrain des
grandes âmes, il se rencontre souvent dans la vie privée des génies
éminents, qui, sans sortir de 447
leur cercle modeste, entreprennent aussi de grandes choses. On
trouve encore des hommes de bien, qui, tenant le milieu entre les
philosophes et les politiques, se plaisent à administrer leur
fortune, refusent de l'accroître par des moyens indignes, et, bien
loin d'en concentrer toute la jouissance en eux-mêmes, sont toujours
prêts à servir leurs parents, leurs amis et leur pays. Que votre
fortune soit légitimement acquise; repoussez tout profit honteux ou
odieux; rendez le plus de services possible, pourvu que vous les
adressiez bien ; augmentez vos richesses par un ordre et une
économie bien entendus, et qu'elles ne soient pas dans vos mains un
instrument de débauche, mais plutôt une source de libéralités et de
bienfaits. En gardant ces préceptes , vous vivrez avec dignité,
grandeur, magnificence, et cependant vous serez simple, honnête,
utile aux hommes.
XXVII. Il nous reste à parler de
cette quatrième vertu qui comprend à la fois la modestie, la
modération, la tempérance, tous ces ornements de la vie; qui calme
les passions, et met la mesure en toutes choses. C'est ici que se
rencontre ce que nous pouvons nommer la bienséance, et que les Grecs
appellent πρέπον. Elle est naturellement inséparable de l'honnête,
car ce qui est bienséant est honnête, et ce qui est honnête est
bienséant Cependant il y a entre l'un et l'autre une différence que
l'on comprend bien, mais qu'il est difficile d'expliquer. La
bienséance est comme le reflet de l'honnêteté. Aussi
n'accompagne-t-elle pas seulement la modération, mais apparaît-elle
encore partout où les trois autres vertus se produisent. En effet,
mettre de la prudence dans ses conseils et ses discours, bien savoir
ce que l'on fait, examiner tout avec maturité , saisir le vrai et y
demeurer fidèle, ce sont autant de choses bienséantes ; au
contraire, donner dans l'erreur, faillir, être trompé, sont autant
de choses malséantes. Tout pareillement, la justice est toujours
bienséante, l'injustice est honteuse et déshonorante. J'en dirai
autant de la force d'âme : tout ce qui se fait virilement et avec un
grand cœur est digne de l'homme et bienséant ; toute lâcheté
déshonore. Ainsi, entre le bienséant et l'honnête, il y a un rapport
naturel, qui n'est point caché, mais qui saute aux yeux, pour ainsi
dire. La bienséance est donc comme une certaine fleur de la vertu ;
et si l'on peut les séparer l'une de l'autre par la pensée, en
réalité elles sont inséparables. Comme la grâce et la beauté du
corps ne vont pas sans la santé ; en même sorte la bienséance dont
nous parlons est indissolublement unie à la vertu, et n'en peut être
distinguée que par un effort de l'esprit. La bienséance a un double
caractère : elle est d'abord le signe de la vertu en général ; elle
est ensuite la marque particulière et distinctive de chacune des
vertus. La première espèce de bienséance se définit ordinairement :
«Ce qui maintient dans l'homme l'excellence de sa nature, ce par
quoi il se distingue des autres animaux. » Pour la seconde, qui
paraît dans chaque vertu en particulier, on la définit : « Ce qui
est si parfaitement conforme à la nature, que la modération et la
448 tempérance en
reçoivent comme un nouveau lustre. »
XXVIII. C'est bien là l'idée qu'on
se forme de la bienséance ; ce qui le prouve, ce sont les lois
imposées aux poètes, et dont ce n'est pas ici le lieu de traiter
longuement. Remarquons seulement que l'on dit d'un poète qu'il
conserve les convenances lorsqu'il fait agir et parler chaque
personnage suivant son caractère. Si Éacus ou Minos disait : «
Qu'ils me haïssent, pourvu qu'ils me craignent I » ou bien, « Le
père est lui-même le tombeau de ses enfants ; » les convenances
seraient blessées, car nous savons que, Éacus et Minos étaient des
justes. Mais quand c'est Atrée qui tient ce langage, on applaudit,
parce que de tels sentiments sont bien placés dans sa bouche. Ainsi
les poètes jugent au caractère des personnages ce qui convient à
chacun. Pour cela, la nature, en nous élevant au-dessus de tous les
autres êtres animés, nous a donné un rôle magnifique. Les poètes,
qui ont à mettre en scène tant de personnages variés, doivent
chercher ce qui est bienséant à chacun, et même ce qui convient au
vice; l'homme qui doit être sur la scène du monde le personnage
constant, modéré, réservé, tempérant, plein d'égards pour ses
semblables, voit clairement en quoi consiste cette bienséance qui
est le caractère général de toutes les bonnes actions, et cette
autre bienséance qui est la marque distinctive de chacune des
vertus. Comme un beau corps charme nos yeux par la juste proportion
de ses membres, et par cette harmonie pleine de grâce qui règne
entre toutes ses parties , de même la bienséance qui reluit dans la
conduite se concilie les suffrages de ceux avec qui nous vivons, et
qui admirent l'ordre, la modération et la conséquence de nos paroles
et de nos actions. Il nous faut donc témoigner une certaine
déférence pour nos semblables, d'abord pour les plus dignes, ensuite
pour tous les autres. Il n'y a que les arrogants et même les hommes
sans mœurs qui ne s'inquiètent en aucune façon des jugements que
l'on fait d'eux. En ce qui touche nos semblables, il y a une assez
grande différence entre la justice et la retenue : la justice nous
commande de ne point faire tort aux hommes; la retenue, de ne les
point offenser; et c'est en cela surtout que consiste la bienséance.
Mais je crois que ces explications vous font assez comprendre
l'essence de celte vertu. Les devoirs qui en découlent ont d'abord
pour but de nous régler et de nous faire vivre conformément à notre
nature. Tant que nous prendrons la nature pour guide, nous ne nous
égarerons jamais; c'est elle qui saura nous donner un esprit sur et
pénétrant, cette inflexible équité qui est le plus solide fondement
des sociétés humaines, et cette énergie qui fait les grandes âmes.
Mais la bienséance brille surtout dans la vertu qui nous occupe
maintenant. — Ce ne sont pas seulement les mouvements du corps, mais
aussi et bien plutôt ceux de l'âme, que l'on doit régler suivant la
nature. Notre âme est composée de deux parties : l'une d'elles est
l'appétit animal, que les Grecs nomment ὁρμή,
et qui pousse l'homme dans mille directions différentes; l'autre est
la raison, qui nous enseigne et nous fait comprendre ce qu'il faut
faire et ce qu'il faut éviter. Na-
449 turellement donc In
raison doit commander et l'appétit obéir.
XXIX. Jamais l'homme ne doit agir
avec précipitation et en aveugle; il faut que toujours il puisse
donner une raison plausible de ce qu'il fait. C'est là, en quelque
façon, le sommaire de tous les devoirs. Nos efforts doivent tendre à
réduire nos appétits sous l'empire de la raison, de telle sorte que
jamais ils ne la préviennent, et que jamais aussi ils ne lui fassent
défaut par paresse ou lâcheté, il faut que la tranquillité de l'âme
ne soit troublée en aucun temps par les passions; c'est la condition
première de toute modération et de toute constance. L'émotion qui va
trop loin, le désir ou la crainte qui nous transporte et n'est plus
sous le frein de la raison, excède indubitablement la mesure. Les
appétits qui s émancipent, et n'obéissent plus à cette raison qui
leur doit commander par la loi de nature, mettent le trouble
non-seulement dans l'âme, mais dans le corps. Regardez la
physionomie d'un homme livré à la colère ou à quelque passion,
abattu par la crainte ou enivré par le plaisir; et voyez comme sa
figure, sa voix, ses gestes, sa posture, annoncent le bouleversement
de son âme. Tout cela ne nous fait-il pas comprendre, pou? en
revenir aux règles du devoir, qu'il faut réprimer et calmer nos
passions; employer tous nos soins et une application infinie à ne
rien faire témérairement, au hasard, inconsidérément, sans
réflexion? La nature ne nous a pas formés apparemment pour la
dissipation et les jeux, mais plutôt pour mener une vie grave, et
nourrir des goûts élevés et sévères. Sans doute le jeu et les
amusements ne nous sont pas interdits ; mais il en est d'eux comme
du sommeil et du repos, il ne faut en user qu'après avoir vaqué aux
affaires sérieuses. Les amusements que l'homme se permet ne doivent
être ni excessifs ni licencieux, mais délicats et d'un goût relevé.
Puisque nous ne permettons pas aux enfants de se livrer à toute
espèce de jeux, mais à ceux-là seulement qui ne blessent pas
l'honnêteté, nous devons nous-mêmes n'accepter d'autres
divertissements que ceux qui sont marqués au cachet du bon goût. Il
y a deux sortes de plaisanterie bien distinctes : l'une grossière,
effrontée, cynique, obscène; l'autre élégante, délicate, fine,
piquante. Plaute et les anciennes comédies attiques nous donnent des
modèles de cette dernière; on la trouve à profusion dans les livres
des philosophes socratiques; on en cite une foule d'exemples, que
les Grecs nomment apophtegmes : nous en avons même un recueil
composé par Caton. Il est facile de distinguer la bonne plaisanterie
de la mauvaise. L'une est pleine d'à-propos et cligne d'un galant
homme ; l'autre, qui joint l'obscénité des idées a la saleté de
l'expression, est bonne tout au plus pour dos esclaves. Il faut
toujours apporter une certaine mesure à nos divertissements, de
crainte de nous oublier nous-mêmes, et, dans l'excès du plaisir, de
nous laisser aller à quelque chose de. honteux. Le champ de Mars et
la chasse nous offrent des exemples de divertissements honnêtes.
XXX. Toutes les fois qu'il est
question de devoirs, il est bon de se remettre devant les yeux
l'immense différence qu'il y a entre l'homme et les animaux. Ceux-ci
n'ont de sentiment que pour le plaisir et d'autre impulsion que
celle des besoins physiques; l'esprit de l'homme trouve son aliment
dans la méditation et l'étude, il est tou-
450 jours en mouvement, et
en quête de la vérité; son plaisir est de voir et d'entendre. Bien
mieux, l'homme qui éprouve quelque penchant un peu vif pour la
volupté, dès lors qu'il n'est pas de l'espèce des brutes et qu'il ne
ressemble pas à certains êtres qui n'ont de l'homme que le nom, dès
lors qu'il a un peu d'âme, malgré l'empire de la volupté sur lui, il
cache et dissimule par pudeur l'aiguillon qui le presse. N'est-ce
pas là une preuve convaincante que les voluptés du corps ne sont pas
assez dignes d'un être excellent comme est l'homme, et que nous
devons les mépriser et nous y soustraire? Si quelqu'un de nous veut
cependant accorder un certain prix à la volupté, il devra mettre un
soin scrupuleux à n'en jouir qu'avec mesure. La nourriture et
l'entretien du corps ont pour fin, suivant les bienséances , la
santé et les forces, et non la volupté. Pour peu que l'on veuille
faire réflexion sur l'excellence et la dignité de la nature humaine,
on comprendra facilement combien il est honteux de vivre dans les
délices, la mollesse et toutes les recherches des plaisirs, et
combien il est honorable de mener une vie sobre, retenue, chaste et
austère. Il faut savoir encore que la nature a mis en chacun de
nous, pour ainsi dire, deux personnes ; l'une, qui est la même chez
tous les hommes, parce qu'ils participent tous à la raison et à
cette excellence naturelle qui fait notre supériorité sur les
animaux, contient le principe de toute honnêteté et de toute
bienséance, et nous sert de pierre de touche dans la détermination
des devoirs; l'autre personne varie suivant les hommes et
caractérise chacun d'eux. Il y a de grandes différences entre les
corps : les uns sont plus agiles à la course, les autres plus forts
à la lutte; ceux- ci ont plus de noblesse, ceux-là plus de grâce;
mais l'on voit encore bien plus de diversité dans les esprits. L.
Crassus, L. Philippus avaient beaucoup d'agrément; C. César, le fils
de Lucius, en avait encore davantage, mais où Fart se faisait plus
sentir. À la même époque, on voyait dans M. Scaurus et le jeune M.
Drusus deux hommes d'au caractère très-grave; Lélius était
naturellement fort enjoué, et Scipion, son ami, avec plus
d'ambition, avait l'humeur un peu sombre. Parmi les Grecs, Socrate,
nous dit-on, était d'un commerce agréable, aimait à plaisanter, et
employait perpétuellement dans le discours cet artifice que les
Grecs ont appelé ironie ; Pythagore et Périclès, au contraire, s'ils
ont conquis an grand empire sur les esprits, ce n'a pas été en les
égayant. Nous savons que le plus rusé des généraux carthaginois ce
fut Annibal, et le plus rusé des Romains, Fabius Maximus, experts
l'un et l'autre à cacher, à se taire, à dissimuler, à dresser des
embûches et à éventer les projets de l'ennemi. Pour ces parties de
l'homme de guerre, les Grecs donnent la priorité à Thémistocle et à
Jason de Phères; ils citent surtout comme un modèle de ruse et de
finesse le trait de Solon, qui, pour mettre sa vie plus en sûreté et
mieux servir son pays, contrefit l'insensé. Il y a des caractères
tout opposés à ceux-là, des hommes simples et ouverts, qui
n'entendent rien à la dissimulation et ne veulent pas employer la
ruse, qui ont un respect scrupuleux pour la vérité et ne peuvent
souffrir le mensonge. Il en est d'autres qui se résignent à tout
souffrir, qui se plient à toutes les sujétions, pour arriver à leurs
fins; tels nous avons vu Sylla et Crassus. Le Lacédémonien Lysandre
était l'homme le plus patient,
451
le plus souple du monde, et personne ne lui ressemblait moins que
Callicratidas, qui lui succéda dans le commandement de la flotte. On
voit quelquefois les hommes les plus puissants mettre tant de
simplicité dans leur conversation, qu'on les prendrait pour des
gens ordinaires ; c'est ce dont nous ayons fait l'expérience avec
les deux Catulus, le père et le fils, et Q. Mucius Mancia. J'ai
entendu dire à des vieillards pareille chose de P. Scipion Nasica;
ils ajoutaient que son père, celui qui vengea la république des
complots de Tib. Gracchus, n'avait, au contraire, aucune affabilité,
aucune grâce dans le langage. On faisait le même reproche à
Xénocrate, le plus grave des philosophes , et qui dut à cette
gravité sa considération et bientôt sa célébrité. Il y a enfin un
nombre prodigieux de caractères différents, qui en eux-mêmes sont
loin d'être blâmables.
|
|
XXXI. Admodum autem tenenda sunt sua cuique non
vitiosa, sed tamen propria, quo facilius decorum illud, quod quaerimus,
retineatur. Sic enim est faciendum, ut contra universam naturam nihil
contendamus, ea tamen conservata propriam nostram sequamur, ut, etiamsi sint
alia graviora atque meliora, tamen nos studia nostra nostrae naturae regula
metiamur; neque enim attinet naturae repugnare nec quicquam sequi, quod assequi
non queas. Ex quo magis emergit, quale sit decorum illud, ideo quia nihil decet
invita Minerva, ut aiunt, id est adversante et repugnante natura. Omnino si
quicquam est decorum, nihil est profecto magis quam aequabilitas cum universae
vitae, tum singularum actionum, quam conservare non possis, si aliorum naturam
imitans omittas tuam. Ut enim sermone eo debemus uti, qui innatus est nobis, ne,
ut quidam, Graeca verba inculcantes iure optimo rideamur, sic in actiones
omnemque vitam nullam discrepantiam conferre debemus. Atque haec differentia
naturarum tantam habet vim, ut non numquam mortem sibi ipse consciscere alius
debeat, alius in eadem causa non debeat. Num enim alia in causa M. Cato fuit,
alia ceteri, qui se in Africa Caesari tradiderunt? Atqui ceteris forsitan vitio
datum esset, si se interemissent, propterea quod lenior eorum vita et mores
fuerant faciliores, Catoni cum incredibilem tribuisset natura gravitatem eamque
ipse perpetua constantia roboravisset semperque in proposito susceptoque
consilio permansisset, moriendum potius quam tyranni vultus aspiciendus fuit. Quam multa passus est Ulixes in illo errore diuturno, cum et mulieribus, si
Circe et Calypso mulieres appellandae sunt, inserviret et in omni sermone
omnibus affabilem et iucundum esse se vellet! domi vero etiam contumelias
servorun ancillarumque pertulit, ut ad id aliquando, quod cupiebat, veniret. At
Aiax, quo animo traditur, milies oppetere mortem quam illa perpeti maluisset.
Quae contemplantes expendere oportebit, quid quisque habeat sui, eaque moderari
nee velle experiri, quam se aliena deceant; id enim maxime quemque decet, quod
est cuiusque maxime suum. Suum quisque igitur noscat ingenium acremque se et
bonorum et vitiorum suorum iudicem praebeat, ne scaenici plus quam nos videantur
habere prudentiae. Illi enim non optimas, sed sibi accommodatissimas fabulas
eligunt; qui voce freti sunt, Epigonos Medumque, qui gestu, Melanippam,
Clytemnestram, semper Rupilius, quem ego memini, Antiopam, non saepe Aesopus
Aiacem. Ergo histrio hoc videbit in scaena, non videbit sapiens vir in vita? Ad
quas igitur res aptissimi erimus, in iis potissimum elaborabimus; sin aliquando
necessitas nos ad ea detruserit, quae nostri ingenii non erunt, omnis adhibenda
erit cura, meditatio, diligentia, ut ea si non decore, at quam minime indecore
facere possimus; nec tam est enitendum, ut bona, quae nobis data non sint,
sequamur, quam ut vitia fugiamus.
XXXII. Ac duabus iis personis, quas supra dixi,
tertia adiungitur, quam casus aliqui aut tempus imponit; quarta etiam, quam
nobismet ipsi iudicio nostro accommodamus. Nam regna, imperia, nobilitas,
honores, divitiae, opes eaque, quae sunt his contraria, in casu sita temporibus
gubernantur; ipsi autem gerere quam personam velimus, a nostra voluntate
proficiscitur. Itaque se alii ad philosophiam, alii ad ius civile, alii ad
eloquentiam applicant, ipsarumque virtutum in alia alius mavult excellere.
Quorum vero patres aut maiores aliqua gloria praestiterunt, ii student plerumque
eodem in genere laudis excellere, ut Q. Mucius P. f. in iure civili, Pauli
filius Africanus in re militari. Quidam autem ad eas laudes, quas a patribus
acceperunt, addunt aliquam suam, ut hic idem Africanus eloquentia cumulavit
bellicam gloriam; quod idem fecit Timotheus Cononis filius, qui cum belli laude
non inferior fuisset quam pater, ad eam laudem doctrinae et ingenii gloriam
adiecit. Fit autem interdum, ut non nulli omissa imitatione maiorum suum quoddam
institutum consequantur, maximeque in eo plerumque elaborant ii, qui magna sibi
proponunt obscuris orti maioribus. Haec igitur omnia, cum quaerimus, quid
deceat, complecti animo et cogitatione debemus; in priris autem constituendum
est, quos nos et quales esse velimus et in quo genere vitae, quae deliberatio
est omnium difficillima. Ineunte enim adulescentia, cum est maxima imbecillitas
consilii, tur id sibi quisque genus aetatis degendae constituit, quod maxime
adamavit; itaque ante implicatur aliquo certo genere cursuque vivendi, quam
potuit, quod optimum esset, iudicare. Nam quod Herculem Prodicus dicit, ut est
apud Xenophontem, cum primum pubesceret, quod tempus a natura ad deligendum,
quam quisque viam vivendi sit ingressurus, datum est, exisse in solitudinem
atque ibi sedentem diu secum multumque dubitasse, cum duas cerneret vias, unam
Voluptatis, alteram Virtutis, utram ingredi melius esset, hoc Herculi “Iovis
satu edito” potuit fortasse contingere, nobis non item, qui imitamur, quos
cuique visum est, atque ad eorum studia institutaque impellimur; plerumque autem
parentium praeceptis imbuti ad eorum consuetudinem moremque deducimur; alii
multitudinis iudicio feruntur, quaeque maiori parti pulcherrima videntur, ea
maxime exoptant; non nulli tamen sive felicitate quadam sive bonitate naturae
sine parentium disciplina rectam vitae secuti sunt viam.
XXXIII. Illud autem maxime rarum genus est eorum,
qui aut excellenti ingenii magnitudine aut praeclara eruditione atque doctrina
aut utraque re ornati spatium etiam deliberandi habuerunt, quem potissimum vitae
cursum sequi vellent; in qua deliberatione ad suam cuiusque naturam consilium
est omne revocandum. Nam cum in omnibus, quae aguntur, ex eo, quo modo quisque
natus est, ut supra dictum est, quid deceat, exquirimus, tum in tota vita
constituenda multo est ei rei cura maior adhibenda, ut constare in perpetuitate
vitae possimus nobismet ipsis nec in ullo officio claudicare. Ad hanc autem
rationem quoniam maximam vim natura habet, fortuna proximam, utriusque omnino
habenda ratio est in deligendo genere vitae, sed naturae magis; multo enim et
firmior est et constantior, ut fortuna non numquam tamquam ipsa mortalis cum
immortali natura pugnare videatur. Qui igitur ad naturae suae non vitiosae genus
consilium vivendi omne contulerit, is constantiam teneat (id enim maxime decet),
nisi forte se intellexerit errasse in deligendo genere vitae. Quod si acciderit
(potest autem accidere), facienda morum institutorumque mutatio est. Eam
mutationem si tempora adiuvabunt, facilius commodiusque faciemus; sin minus,
sensim erit pedetemptimque facienda, ut amicitias, quae minus delectent et minus
probentur, magis decere censent sapientes sensim diluere quam repente
praecidere. Commutato autem genere vitae omni ratione curandum est, ut id bono
consilio fecisse videamur. Sed quoniam paulo ante dictum est imitandos esse
maiores, primum illud exceptum sit, ne vitia sint imitanda, deinde si natura non
feret, ut quaedam imitari posit (ut superioris filius Africani, qui hunc Paulo
natum adoptavit, propter infirmitatem valetudinis non tam potuit patris similis
esse, quam ille fuerat sui); si igitur non poterit sive causas defensitare sive
populum contionibus tenere sive bella gerere, illa tamen praestare debebit, quae
erunt in ipsius potestate, iustitiam, fidem, liberalitatem, modestiam,
temperantiam, quo minus ab eo id, quod desit, requiratur. Optima autem hereditas
a patribus traditur liberis omnique patrimonio praestantior gloria virtutis
rerumque gestarum, cui dedecori esse nefas et vitium iudicandum est.
XXXIV. Et quoniam officia non eadem disparibus
aetatibus tribuuntur aliaque sunt iuvenum, alia seniorum, aliquid etiam de hac
distinctione dicendum est. Est igitur adulescentis maiores natu vereri exque iis
deligere optimos et probatissimos, quorum consilio atque auctoritate nitatur;
ineuntis enim aetatis inscitia senum constituenda et regenda prudentia est.
Maxime autem haec aetas a libidinibus arcenda est exercendaque in labore
patientiaque et animi et corporis, ut eorum et in bellicis et in civilibus
officiis vigeat industria. Atque etiam cum relaxare animos et dare se
iucunditati volent, caveant intemperantiam, meminerint verecundiae, quod erit
facilius, si ne in eius modi quidem rebus maiores natu nolent interesse. Senibus
autem labores corporis minuendi, exercitationes animi etiam augendae videntur;
danda vero opera, ut et amicos et iuventutem et maxime rem publicam consilio et
prudentia quam plurimum adiuvent. Nihil autem magis cavendum est senectuti, quam
ne languori se desidiaeque dedat; luxuria vero cum omni aetati turpis, tum
senectuti foedissima est; sin autem etiam libidinum intemperantia accessit,
duplex malum est, quod et ipsa senectus dedecus concipit et facit adulescentium
impudentioren intemperantiarn. Ac ne illud quidem alienum est, de magistratuum,
de privatorum, de civium, de peregrinorum officiis dicere. Est igitur proprium
munus magistratus intellegere se gerere personam civitatis debereque eius
dignitatern et decus sustinere, servare leges, iura discribere, ea fidei suae
commissa meminisse. Privatum autem oportet aequo et pari cum civibus iure vivere
neque summissum et abiectum neque se efferentem, tum in re publica ea velle,
quae tranquilla et honesta sint; talem enim solemus et sentire bonum civem et
dicere. Peregrini autem atque incolae officium est nihil praeter suurn negotium
agere, niihil de alio anquirere minimeque esse in aliena re publica curiosum.
Ita fere officia reperientur, cum quaeretur, quid deceat, et quid aptum sit
personis, temporibus, aetatibus. Nihil est autem, quod tam deceat, quam in omni
re gerenda consilioque capiendo servare constantiam.
XXXV. Sed quoniam decorum il!id in omnibus factis,
dictis, in corporis denique motu et statu cernitur idque positum est in tribus
rebus, formositate, ordine, ornatu ad actionem apto, difficilibus ad eloquendum,
sed satis erit intellegi, in his autem tribus continetur cura etiam illa, ut
probemur iis, quibuscum apud quosque vivamus, his quoque de rebus pauca
dicantur. Principio corporis nostri magnam natura ipsa videtur habuisse
rationem, quae formam nostram reliquamque figuram, in qua esset species honesta,
eam posuit in promptu, quae partes autem corporis ad naturae necessitatem datae
aspectum essent deformem habiturae atque foedum, eas contexit atque abdidit.
Hane naturae tam diligentem fabricam imitata est hominum verecundia. Quae enim
natura occultavit, eadem omnes, qui sana mente sunt, removent ab oculis ipsique
necessitati dant operam ut quam occultissime pareant; quarumque partium corporis
usus sunt necessarii, eas neque partes neque earum usus suis nominibus
appellant; quodque facere turpe non est, modo occulte, id dicere obscenum est.
Itaque nec actio rerum illarum aperta petulantia vacat nec orationis obscenitas.
Nec vero audiendi sunt Cynici, aut si qui filerunt Stoici paene Cynici, qui
reprehendunt et irrident, quod ea, quae turpia non sint, verbis flagitiosa
ducamus, illa autem, quae turpia sint, nominibus appellemus suis. Latrocinari,
fraudare, adulterare re turpe est, sed dicitur non obscene; liberis dare operam
re honestum est, nomine obscenum; pluraque in ear sententiam ab eisdem contra
verecundiam disputantur. Nos autem naturam sequamur et ab omni, quod abhorret ab
oculorum auriumque approbatione, fugiamus; status incessus, sessio accubitio,
vultus oculi manuum motus teneat illud decorum. Quibus in rebus duo maxime sunt
fugienda, ne quid effeminatum aut molle et ne quid durum aut rusticum sit. Nec
vero histrionibus oratoribusque concedendum est, ut iis haec apta sint, nobis
dissoluta. Scaenicorum quidem mos tantam habet vetere disciplina verecundiam, ut
in scaenam sine subligaculo prodeat nemo; verentur enim, ne, si quo casn
evenerit, ut corporis partes quaedam aperiantur, aspiciantur non decore. Nostro
quidem more cum parentibus puberes filii, cum soceris generi non lavantur.
Retinenda igitur est huius generis verecundia, praesertim natura ipsa magistra
et duce.
XXXVI. Cum autem pulchritudinis duo genera sint,
quorum in altero venustas sit, in altero dignitas, venustatem muliebrem ducere
debemus, dignitatem virilem. Ergo et a forma removeatur omnis viro non dignus
ornatus, et huic simile vitium in gestu motuque caveatur. Nam et palaestrici
motus sunt saepe odiosiores, et histrionum non nulli gestus ineptiis non vacant,
et in utroque genere quae sunt recta et simplicia, laudantur. Formae autem
dignitas coloris bonitate tuenda est, color exercitationibus corporis. Adhibenda
praeterea munditia est non odiosa neque exquisita nimis, tantum quae fugiat
agrestem et inhumanam neglegentiam. Eadem ratio est habenda vestitus, in quo,
sicut in plerisque rebus, mediocritas optima est. Cavendum autem est, ne aut
tarditatibus utamur in ingressu mollioribus, ut pomparum ferculis similes esse
videamur, aut in festinationibus suscipiamus nimias celeritates, quae cum fiunt,
anhelitus moventur, vultus mutantur, ora torquentur; ex quibus magna
significatio fit non adesse constantiam. Sed multo etiam magis elaborandum est,
ne animi motus a natura recedant; quod assequemur, si cavebimus, ne in
perturbationes atque exanimationes incidamus, et si attentos animos ad decoris
conservationem tenebimus. Motus autem animorum duplices sunt, alteri
cogitationis, alteri appetitus; cogitatio in vero exquirendo maxime versatur,
appetitus impellit ad agendum. Curandum est igitur, ut cogitatione ad res quam
optimas utamur, appetitum rationi oboedientem praebeamus.
XXXVII. Et quoniam magna vis orationis est, eaque
duplex, altera contentionis, altera sermonis, contentio disceptationibus
tribuatur iudiciorum, contionum, senatus, sermo in circulis, disputationibus,
congressionibus familiarium versetur, sequatur etiam convivia. Contentionis
praecepta rhetorum sunt, nulla sermonis, quamquam haud scio an possint haec
quoque esse. Sed discentium studiis inveniuntur magistri, huic autem qui
studeant, sunt nulli, rhetorum turba referta omnia; quamquam, quae verborum
sententiarumque praecepta sunt, eadem ad sermonem pertinebunt. Sed cum orationis
indicem vocem habeamus, in voce autem duo sequamur, ut clara sit, ut suavis,
utrumque omnino a natura petundum est, verum alterum exercitatio augebit,
alterum imitatio presse loquentium et leniter.
Nihil fuit in Catulis, ut eos
exquisite iudicio putares uti litterarum, quamquam erant litterati; sed et alii;
hi autem optime uti lingua Latina putabantur; sonus erat dulcis, litterae neque
expressae neque oppressae, ne aut obscurum esset aut putidum, sine contentione
vox nec languens nec canora. Uberior oratio L. Crassi nec minus faceta, sed bene
loquendi de Catulis opinio non minor. Sale vero et facetiis
Caesar, Catuli
patris frater, vicit omnes, ut in illo ipso forensi genere dicendi contentiones
aliorum sermone vinceret. In omnibus igitur his elaborandum est, si in omni re
quid deceat exquirimus.
Sit ergo hic sermo, in quo Socratici maxime
excellunt, lenis minimeque pertinax, insit in eo lepos; nec vero, tamquam in
possessionem suam venerit, excludat alios, sed cum reliquis in rebus, turn in
sermone communi vicissitudinem non iniquam putet; ac videat in primis, quibus de
rebus loquatur; si seriis, severitatem adhibeat, si iocosis, leporem; in
primisque provideat, ne sermo vitium aliquod indicet inesse in moribus; quod
maxime tum solet evenire, cum studiose de absentibus detrahendi causa aut per
ridiculum aut severe maledice contumelioseque dicitur. Habentur autem
plerumque sermones aut de domesticis negotiis aut de re publica aut de artium
studiis atque doctrina. Danda igitur opera est, ut, etiamsi aberrare ad alia
coeperit, ad haec revocetur oratio, sed utcumque aderunt; neque enim isdem de
rebus nec omni tempore nec similiter delectamur. Animadvertendum est etiam,
quatenus sermo delectationem habeat, et, ut incipiendi ratio fuerit, ita sit
desinendi modus.
XXXVIII. Sed quo modo in omni vita rectissime
praecipitur, ut perturbationes fugiamus, id est motus animi nimios rationi non
optemperantes, sic eius modi motibus sermo debet vacare, ne aut ira exsistat aut
cupiditas aliqua aut pigritia aut ignavia aut tale aliquid appareat, maximeque
curandum est, ut eos, quibuscum sermonem conferemus, et vereri et diligere
videamur. Obiurgationes etiam non numquam incidunt necessariae, in quibus
utendum est fortasse et vocis contentione maiore et verborum gravitate acriore,
id agendum etiam, ut ea facere videamur irati. Sed, ut ad urendum et secandum,
sic ad hoc genus castigandi raro invitique veniemus nec umquam nisi necessario,
si nulla reperietur alia medicina; sed tamen ira procul absit,cum qua nihil
recte fieri, nihil considerate potest. Magnam autem partem clementi castigatione
licet uti, gravitate tamen adiuncta, ut severitas adhibeaturetcontumelia
repellatur, atque etiam illud ipsum, quod acerbitatis habet obiurgatio,
significandum est, ipsius id causa, qui obiurgetur, esse susceptum. Rectum est
autem etiam in illis contentionibus, quae cum inimicissimis fiunt, etiamsi nobis
indigna audiamus, tamen gravitatem retinere, iracundiam pellere. Quae enim cum
aliqua perturbatione fiunt, ea nec constanter fieri possunt neque iis, qui
adsunt, probari. Deforme etiam est de se ipsum praedicare falsa praesertim et
cum irrisione audientium imitari militem gloriosum.
XXXIX. Et quoniam omnia persequimur, volumus
quidem certe, dicendum est etiam, qualern hominis honorati et principis domum
placeat esse, cuius finis est usus, ad quem accommodanda est aedificandi
descriptio et tamen adhibenda commoditatis dignitatisque diligentia.
Cn.
Octavio, qui primus ex illa familia consul factus est, honori fuisse accepimus,
quod praeclaram aedificasset in Palatio et plenam dignitatis domum; quae cum
vulgo viseretur, suffragata domino, novo homini, ad consulatum putabatur; hanc
Scaurus demolitus accessionem adiunxit aedibus. Itaque ille in suam domum
consulatum primus attulit, hic, summi et clarissimi viri filius, in domum
multiplicatam non repulsam solum rettulit, sed ignominiam etiam et calamitatem.
Ornanda enim est dignitas domo, non ex domo tota quaerenda, nec domo dominus,
sed domino domus honestanda est, et, ut in ceteris habenda ratio non sua solum,
sed etiam aliorum, sic in domo clari hominis, in quam et hospites multi
reeipiendi et admittenda hominum cuiusque modi multitude, adhibenda cura est
laxitatis; aliter ampla domus dedecori saepe domino fit, si est in ea solitudo,
et maxime, si aliquando alio domino solita est frequentari. Odiosum est enim,
cum a praetereuntibus dicitur:
O domus antiqua, heu quam dispari
dominare domino!
Quod quidem his temporibus in multis licet dicere.
Cavendum autem est, praesertim si ipse aedifices, ne extra modum sumptu et
magnificentia prodeas; quo in genere multum mali etiam in exemplo est. Studiose
enim plerique praesertim in hane partem facta principum imitantur, ut L.
Luculli, summi viri, virtutem quis? at quam multi villarum magnificentiam
imitati! quarum quidem certe est adhibendus modus ad mediocritatemque
revocandus. Eademque mediocritas ad omnem usum cultumque vitae transferenda est.
Sed haec hactenus. In omni autem actione suscipienda tria sunt tenenda, primum
ut appetitus rationi pareat, quo nihil est ad officia conservanda accommodatius,
deinde ut animadvertatur, quanta illa res sit, quam efficere velimus, ut neve
maior neve minor cura et opera suscipiatur, quam causa postulet. Tertium est, ut
caveamus, ut ea, quae pertinent ad liberalem speciem et dignitatem, moderata
sint. Modus autem est optimus decus ipsum tenere, de quo ante diximus, nec
progredi longius. Horum tamen trium praestantissimum est appetitum optemperare
rationi.
XL. Deinceps de ordine rerum et de opportunitate
temporum dicendum est. Haec autem scientia continentur ea, quam Graeci εὐταξίαν
nominant, non hanc, quam interpretamur modestiam, quo in verbo modus inest, sed
illa est εὐταξία, in qua intellegitur ordinis conservatio. Itaque, ut eandem nos
modestiam appellemus, sic definitur a Stoicis, ut modestia sit scientia rerum
earum, quae agentur aut dicentur, loco suo collocandarum. Ita videtur eadem vis
ordinis et collocationis fore; nam et ordinem sic definiunt: compositionem rerum
aptis et accommodatis locis; locum autem actionis opportunitatem temporis esse
dicunt; tempus autem actionis opportunum Graece εὐκαιρία Latine appellatur
occasio. Sic fit, ut modestia haec, quam ita interpretamur, ut dixi, scientia
sit opportunitatis idoneorum ad agendum temporum. Sed potest eadem esse
prudentiae definitio, de qua principio diximus; hoc autem loco de moderatione et
temperantia et harum similibus virtutibus quaerimus. Itaque, quae erant
prudentiae propria, suo loco dicta sunt; quae autem harum virtutum, de quibus
iam diu loquimur, quae pertinent ad verecundiam et ad eorum approbationem,
quibuscum vivimus, nunc dicenda sunt. Talis est igitur ordo actionum adhibendus,
ut, quem ad modum in oratione constanti, sic in vita omnia sint apta inter se et
convenientia; turpe enimn valdeque vitiosum in re severa convivio digna aut
delicatum aliquem inferre sermonem. Bene Pericles, cum haberet collegam in
praetura Sophoclem poëtam iique de communi officio convenissent et casu formosus
puer praeteriret dixissetque Sophocles: “O puerum pulchrum, Pericle!” “At enim
praetorem, Sophocle, decet non solum manus, sed etiam oculos abstinentes
habere.” Atqui hoc idem Sophocles si in athletarum probatione dixisset, iusta
reprehensione caruisset. Tanta vis est et loci et temporis. Ut, si qui, cum
causam sit acturus, in itinere aut in ambulatione secum ipse meditetur, aut si
quid aliud attentius cogitet, non reprehendatur, at hoc idem si in convivio
faciat, inhumanus videatur inscitia temporis. Sed ea, quae multum ab humanitate
discrepant, ut si qui in foro cantet, aut si qua est alia magna perversitas,
facile apparet nec magnopere admonitionem et praecepta desiderat; quae autem
parva videntur esse delicta neque a multis intellegi possunt, ab iis est
diligentius declinandum. Ut in fidibus aut tibiis, quamvis paulum discrepent,
tamen id a sciente animadverti solet, sic videndum est in vita ne forte quid
diserepet, vel multo etiam magis, quo maior et melior actionum quam sonorum
concentus est. |
XXXI. Que chacun s'en tienne donc à son génie naturel, quand ce
génie toutefois ne le porte pas au mal; c'est le meilleur moyen de
garder la bienséance dont nous voulons donner les lois. Notre devoir
est d'abord de ne jamais nous mettre en opposition avec cette
première personne dont nous parlions, qui est la même dans tous les
hommes ; mais dès qu'elle est sauve, le mieux pour nous, c'est
d'être nous-mêmes. Laissons aux autres, s'il le faut, la belle part
et les hautes vocations; acceptons le destin qui est à notre taille.
A quoi sert-il de lutter contre la nature et de poursuivre ce qu'on
ne peut pas atteindre? Si vous voulez savoir ce que c'est que la
bienséance, entendez bien le proverbe : // ne faut rien entreprendre
malgré Minerve, c'est-à-dire en dépit de la nature. S'il y a quelque
chose de bienséant, rien ne l'est davantage, sans !aucun doute, que l'égalité de la vie, la
conséquence de toutes les
actions; et comment ne pas vous démentir, si vous cessez d'être
vous-même et prétendez jouer le rôle d'un autre? Quand nous parlons,
la convenance nous engage à nous servir de la langue qui nous est
familière ; celui qui fait entrer du grec dans tout ce qu'il dit est
à bon droit ridicule : eh bien ! il en est de nos actions et de
notre vie entière comme d'un discours ; les disparates y font un
très-mauvais effet. La nature a si diversement trempé nos
caractères, que, dans certaine circonstance, un homme doit se
donner la mort, tandis qu'un autre, dans la même situation, ne le
doit pas. Caton, en Afrique, était-il dans une autre condition que
ses compagnons d'armes qui se rendirent à César? Et cependant si
ces derniers s'étaient donné la mort, on leur en eût peut-être fait
un crime, parce que c'étaient des gens de vie élégante et de mœurs
faciles ; mais Caton qui avait reçu de la nature une incroyable
gravité, qui avait encore fortifié son caractère par l'habitude de
ne varier jamais, qu'on n'avait jamais vu ni reculer ni se démentir,
Caton devait mourir plutôt que de supporter la vue d'un tyran.
Quelles ne fu rent pas les souffrances d'Ulysse dans cette longue
course sur les mers, quand il lui fallut obéir aux caprices de deux
femmes (si toutefois Circé et Calypso doivent être appelées des
femmes), se montrer continuellement affable, et complaire à ses
hôtes dans tous ses discours! De retour chez lui, il supporta les
affronts de ses esclaves et de ses servantes, pour arriver enfin où
il en voulait venir. Mais Ajax, du caractère dont on le représente,
aurait mille fois mieux ! aimé souffrir la mort, que de se plier à
ces né- 452
cessités. Que chacun examine donc comment la nature l'a fait,
s'attache à régler son caractère, et non pas à essayer si celui des
autres lui convient; car rien ne nous va mieux que ce qui nous est
le plus naturel. Apprenons à nous connaître, sachons démêler
sûrement ce qu'il y a de bon et de mauvais en nous; ne mettons pas
dans notre conduite moins de bon sens que les comédiens n'en portent
sur la scène. Ce n'est pas le plus beau rôle qu'ils choisissent,
mais celui qui est le mieux assorti à leur talent; ceux qui ont
beaucoup de voix aiment à jouer les Épigones ou Médus; ceux qui
brillent par le geste préfèrent Mélanippe ou Clytemnestre; Rupilius,
dont je me souviens, avait Antiope pour pièce favorite; Ésopus ne
jouait pas souvent Ajax. Un histrion aura donc au théâtre le tact
qui manquera au sage dans la vie! Ne le souffrons pas, consultons
notre aptitude, et demeurons-y fidèles. Si quelquefois la nécessité
nous force à remplir un rôle qui ne soit pas le nôtre, employons
alors tous nos soins, tous nos efforts, tout notre esprit à nous en
acquitter, je ne dis pas avec un grand succès, mais le moins mal
possible. Nous devons alors bien moins songer à faire montre des
qualités que ne nous a pas données la nature, qu'à nous garder de
tout défaut. XXXII. Nous avons dit qu'il y avait comme deux personnes en chacun
de nous : il faut y joindre le personnage que nous devons faire dans
certaines circonstances et suivant les temps; il faut y joindre
encore celui que nous nous imposons librement à nous-mêmes. La
royauté, le pouvoir, les titres, les honneurs, le crédit, les
richesses, et d'un autre côté l'obscurité et la misère, dépendent de
la fortune et sont soumis aux
fluctuations des temps. Mais il nous appartient de décider quelle
carrière nous embrasserons. Les uns se vouent à la philosophie,
d'autres au droit, d'autres à l'éloquence ; parmi les vertus
elles-mêmes, il y en a toujours une dans laquelle nous voulons
exceller de préférence aux autres. Ceux dont le père et les aïeux se
sont illustrés dans quelque genre de gloire, aiment d'ordinaire à
suivre leurs traces et à s'en montrer les dignes héritiers; c'est
ainsi que Q. Mucius fut un célèbre jurisconsulte comme son père, et
le second Africain un grand guerrier comme Paul-Emile. Quelques-uns
ajoutent à la gloire paternelle une illustration qui leur est
propre; le second Africain, par exemple, réunit la palme de
l'orateur à celle du guerrier; et avant lui Timothée, fils de Conon,
aussi fameux capitaine que son père, avait allié la gloire des armes
à celle de la science et de l'esprit. Quelques autres, au contraire,
renonçant à imiter leurs ancêtres, s'ouvrent une carrière toute
nouvelle; c est ce que font surtout les hommes d'une naissance
obscure, qui se proposent de grandes choses. Il faut avoir devant
les yeux tout ce que je viens de vous rappeler, lorsqu'on cherche ce
que la bienséance demande de nous. En premier lieu, nous devons nous
fixer sur le choix d'une carrière, et il n'est pas de détermination
plus difficile à bien prendre que celle-là. A l'entrée de la
jeunesse, lorsque la raison n'est pas encore formée, chacun choisit
le genre de vie qui lui plaît le plus; et Ton se trouve ainsi engagé
dans une certaine carrière, avant d'avoir pu juger quelle était la
meilleure. Prodicius disait, au rapport de Xénophon, qu'Hercule
arrivé à l'âge de puberté, époque marquée par la nature pour le
choix d'un genre 453
de vie, se retira dans la solitude pour y méditer, et que voyant
devant lui deux chemins, celui de la volupté et celui de la vertu,
il hésita longtemps sur le parti qu'il devait prendre. Je crois
bien qu'un fils de Jupiter put ainsi réfléchir à son aise; mais nous
autres mortels, nous commençons par imiter ceux dont la vie nous
plaît, et nous nous précipitons dans la première voie qui nous
séduit; le plus souvent même, imbus des préceptes de nos parents,
nous prenons leurs goûts et suivons leur exemple. D'autres sont
entraînés par les préjugés de la foule, et ne rêvent que ce qui a le
don de l'éblouir. Quelques-uns cependant, soit par bonheur, soit par
l'ascendant de leur bon naturel, soit par les sages conseils de
leurs parents, sont entrés dans la bonne voie.
XXXIII. L'espèce d'hommes la plus rare, ce sont ceux qui doués d'un
excellent génie, éclairés par une belle éducation, ou réunissant
l'un et l'autre privilège, ont pris du temps pour délibérer sur le
genre de vie qui leur convenait le mieux. Dans une telle
délibération, c'est à sa propre nature que chacun doit demander
conseil. Si dans les diverses circonstances de la vie, pour
découvrir ce qui est bienséant, nous sommes obligés, comme je l'ai
dit, de consulter notre caractère et d'y être fidèles ; à plus forte
raison, quand il s'agit de donner une direction à la vie entière,
devons-nous obéir à ce précepte, si nous voulons être toujours
conséquents avec nous-mêmes, et ne jamais broncher dans l'accomplissement
de nos devoirs. Deux choses doivent influer sur notre destinée, la
nature d'abord, et ensuite la fortune; c'est pourquoi, lorsque nous
choisissons notre carrière, il nous faut tenir compte de l'une et de
l'autre, mais surtout de la nature,
453 dont l'influence est plus forte et plus
constante; souvent, en effet, quand on voit la fortune aux prises
avec la nature, il semble que ce soit une mortelle luttant contre
une immortelle. Celui donc qui, dans cette détermination importante,
a consulté ses dispositions naturelles, pourvu toutefois qu'elles
ne fussent pas vicieuses, doit tenir ferme jusqu'au bout; car rien
ne sied mieux à l'homme que la constance, à moins qu'il ne
découvre
qu'il s'est trompé dans le choix de sa carrière. Dans ce dernier
cas, qui n'est rien moins qu'impossible, il faut changer de façon de
vivre. C'est un changement qui nous sera facile, si les
circonstances nous favorisent ; si elles s'y prêtent mal, nous
devrons l'opérer ' lentement et par degrés insensibles. C'est
ainsi
que les sages nous conseillent d'agir en fait d'amitié : ils veulent
que l'on délie doucement et non pas que l'on coupe brusquement les
nœuds qui nous attachent à des amis peu faits pour nous plaire
longtemps, ou pour garder notre estime. Lorsque l'on change de
carrière, il faut toujours avoir grand soin de ne paraître le faire
que pour d'excellentes raisons. Nous avons dit qu'il était bon de
marcher sur les traces de ses ancêtres : mais d'abord il faut
établir comme première exception qu'on ne doit pas imiter leurs
défauts; ensuite il peut se faire que la nature ne nous permette pas
d'imiter toutes leurs bonnes parties. C'est ainsi que le fils du
premier Africain, celui qui adopta le fils de Paul-Émile, ne put, à
cause de sa faible santé, ressembler à son père aussi parfaitement
que son fils adoptif ressembla au sien. Il y a bien des hommes qui
ne pourraient ni paraître au barreau , ni haranguer le peuple, ni
commander les armées; mais il est toujours en leur pouvoir de
454 pratiquer la justice, la bonne foi, la
libéralité, la modération, la tempérance; et ils doivent s'appliquer
à reproduire ces vertus de leurs pères avec assez d'éclat pour que
l'on regrette moins les qualités qui leur manquent. Le meilleur
héritage et le plus riche patrimoine qu'un père puisse laisser à ses
enfants, c'est la gloire de ses vertus et de ses belles actions;
souiller cette gloire est une impiété et un sacrilège.
XXXIV. Comme les devoirs varient suivant les âges, et que ceux des
jeunes gens ne sont pas ceux des vieillards, il est à propos de dire
quelque chose de cette différence. Le devoir du jeune homme est de
respecter les vieillards, de choisir parmi eux les plus considérés
et les plus dignes de l'être, pour leur demander l'appui de leurs
conseils et de leur autorité; car l'inexpérience du jeune âge a
besoin d'être gouvernée et maintenue par la prudence de la
vieillesse. Il faut surtout garantir les jeunes gens du souffle des
passions, fortifier leur esprit et leur corps, et les exercer à de
rudes labeurs, afin qu'un jour ils puissent remplir avec distinction
les charges civiles et militaires. Lorsqu'ils veulent donner quelque
relâche à leur esprit et se livrer aux divertissements de leur âge,
ils doivent éviter tout excès, et se ressouvenir de la bienséance;
ce qui sera facile, si quelques vieillards prennent le soin
d'assister à leurs jeux. De leur côté, les vieillards doivent donner
du repos à leur corps, mais exercer plus que jamais leur esprit ;
leur principale application doit être de prêter le plus possible le
secours de leurs conseils et de leur expérience à leurs amis, à la
jeunesse, et surtout à la république. Il n'est rien dont la
vieillesse se doive garder avec plus de soin
454 que de tomber dans
l'oisiveté et la langueur. Le goût des plaisirs, qui est honteux à
toutes les autres époques de la vie, est infâme dans la vieillesse.
Si elle y joint encore les passions et la débauche, elle est
doublement coupable; car elle se déshonore elle-même, et autorise
par son exemple les débordements de la jeunesse. Il ne sera pas
étranger à mon sujet de parler des devoirs du magistrat et de
l'homme privé, du citoyen et de l'étranger. Le devoir du magistrat
est de bien entendre qu'il représente la société, qu'il doit dans
sa personne en soutenir la dignité et l'honneur, veiller au maintien
des lois, faire respecter les droits des citoyens, et se souvenir
que c'est là un dépôt sacré confié à sa garde. Le devoir de l'homme
privé est de vivre sur le pied d'égalité parfaite avec ses
concitoyens, de ne point s'humilier et ramper comme de ne point
montrer d'arrogance, d'être toujours dans l'État du parti de la
tranquillité et de l'honnêteté : telle est en effet l'idée que Ton
se fait d'ordinaire du bon citoyen et la définition que l'on en
donne. L'étranger et l'hôte ont le devoir de s'occuper
exclusivement de leurs propres affaires, de ne point s'occuper de
celles d'autrui, et de retenir une curiosité indiscrète dans un pays
qui n'est pas le leur. C'est ainsi que l'on déterminera tous les
devoirs, en recherchant ce qui convient et ce qui est assorti aux
personnes, aux âges, aux circonstances. Mais, en général, rien ne
sied mieux à l'homme que de se montrer conséquent dans tous ses
desseins et dans toutes ses actions.
XXXV. La décence, qui a sa place dans les actions et les paroles, se
remarque aussi dans les mouvements et les attitudes du corps, et ici
elle consiste en trois choses, la grâce, la bien-
455 séance des gestes, et la
tenue. Ce sont là des choses difficiles à bien rendre, mais
l'important est de les sentir ; toutes trois viennent du soin que
nous prenons naturellement de plaire à ceux avec qui et chez qui
nous vivons; et je crois qu'il convient d'en toucher aussi quelque
chose. D'abord la nature elle-même semble avoir pris grand soin de
notre corps; elle a mis en évidence notre figure et ceux de nos
membres dont l'aspect a de la bienséance ; pour les parties qui sont
destinées à satisfaire les nécessités naturelles et dont la vue
aurait été choquante, elle les a couvertes et cachées. La pudeur de
l'homme s'est conformée à cette sage économie de la nature ; ce
qu'elle a caché, tous ceux qui n'ont pas l'esprit renversé le
dérobent à la vue. Ils prennent grand soin de ne satisfaire qu'en
secret aux nécessités du corps, et pour eux les parties réservées
à ces usages et leurs fonctions sont des choses qu'on ne nomme pas;
de telle sorte que ce qu'il n'est pas honteux de faire, pourvu que
ce soit en secret, il est obscène de le dire. C'est pourquoi il y a
une grossière impudence à faire ces sortes de choses publiquement,
et de l'obscénité à en parler. N'écoutons ni les Cyniques, ni
certains Stoïciens presque Cyniques, qui se raillent de nous et nous
reprochent de n'oser appeler par leur nom, sans croire manquer à la
pudeur, des choses qui n'ont rien de honteux, et de nommer au
contraire sans aucun embarras des actions réellement honteuses.
Voler, tromper, commettre un adultère, sont des choses honteuses ,
mais on les nomme sans obscénité ; faire des enfants est chose
très-honnête, et l'on ne peut en parler sans blesser les oreilles.
Ainsi raisonnent- ils, et ce n'est là qu'un échantillon de
leurs arguments contre la pudeur. Pour nous, suivons la nature, et
évitons de montrer et de nommer ce qu'il nous répugne de voir et d'entendre. Que
notre maintien et notre démarche, notre manière de nous asseoir,
notre pose sur le lit de table, nos yeux, notre air, notre geste
expriment toujours la décence. Pour y arriver, il faut éviter deux
excès : l'un qui est la mollesse et l'air efféminé, l'autre la
dureté et la rusticité. Ne donnons pas aux comédiens le privilège
d'être seuls décents ; ne nous abandonnons pas à un laisser aller
peu convenable. Les acteurs sont accoutumés par l'ancienne
discipline du théâtre à un tel soin de la pudeur, qu'ils ne se
montrent jamais sur la scène sans un vêtement de dessous qui leur
sauverait la honte de paraître à découvert, si quelque partie de
leur costume venait à se relever. Nos mœurs ne souffrent pas qu'un
père se baigne avec son fils arrivé à l'âge de puberté, ou un
beau-père avec son gendre. Il faut conserver avec scrupule toutes
ces règles de la pudeur, par l'excellente raison surtout qu'elles
ont été inspirées et dictées par la nature.
XXXVI. lIly a deux sortes de beautés ; l'une a pour expression la
grâce et l'autre la dignité. La grâce appartient à la femme, la
dignité à l'homme. Nous devons donc nous interdire dans la parure
tout ornement qui ne serait pas digne de l'homme ; jamais non plus
nous ne devons manquer de dignité dans nos mouvements et nos gestes.
Souvent les maîtres de gymnase ont des mouvements qui nous choquent,
et les comédiens des gestes que nous trouvons ridicules; mais les
uns et les autres, quand ils joignent la simplicité à la con -
456 venance, enlèvent
tous les suffrages. Il n'y a pas de figure mâle sans de belles
couleurs, et ces couleurs il faut les demander à l'exercice du
corps. La propreté est de rigueur ; il ne faudrait cependant pas
qu'elle dégénérât en une recherche insupportable; ce qui est
bienséant, c'est de ne pas nous négliger grossièrement et nous
montrer dans une tenue de sauvages. On en doit user de même pour les
vêtements : en fait de parure comme de bien d'autres choses, ni trop
ni trop peu, c'est le mieux. Prenons garde aussi de mettre dans
notre démarche trop de mollesse et de lenteur, car nous pourrions
bien ressembler à des gens qui mènent la pompe sacrée; ou de nous
élancer avec trop de précipitation , car alors on perd haleine, le
visage se décompose, les traits sont renversés, et il n'y a pas de
signes plus certains du peu de gravité d'un homme. Mais il faut
apporter bien plus de soin encore à ce que les mouvements de notre
âme ne soient pas contraires à la nature ; nous y parviendrons, si
nous savons nous garantir de toute agitation et des frayeurs
subites, et si perpétuellement nous nous montrons attentifs à
conserver la bienséance. Les mouvements de rame sont de deux sortes,
les pensées et les désirs. La pensée s'emploie surtout à rechercher
la vérité ; le désir nous porte à l'action. Notre devoir est donc de
diriger notre pensée vers les objets les plus excellents, et de
mettre nos désirs sous les lois de la raison.
XXXVII. La parole joue un grand rôle dans la vie humaine; il faut
distinguer à ce sujet le discours soutenu, de la conversation ; le
premier a sa place au barreau, dans l'assemblée du peuple , au
sénat ; la conversation a la sienne dans les cercles, les
discussions, les entretiens familiers ; c'est elle aussi qui
anime les festins. Le discours a les règles que les rhéteurs nous
donnent. On ne trouve nulle part de règles pour la conversation ;
je ne sais trop s'il ne serait pas possible d'en tracer
quelques-unes; mais sans élèves, il n'est pas de maîtres; et
personne n'est curieux d'apprendre à régler ses discours
familiers,
tandis que les rhéteurs abondent entons lieux. Cependant les
préceptes relatifs au choix des expressions et des pensées sont
applicables a la conversation. Mais le discours est impossible sans
la voix, et cet organe doit être à la fois clair et agréable. C'est
à la nature, sans doute, qu'il faut d'abord demander ces deux
qualités; mais nous pouvons développer l'une par l'exercice, et
l'autre en imitant ceux qui prononcent avec netteté et douceur. Il
semble qu'au premier abord rien ne justifie la grande réputation que
s'étaient faite les deux Catulus en matière de goût; ils avaient des
lettres, mais bien d'autres en avaient autant qu'eux ; où était donc
leur mérite? c'est qu'ils parlaient la langue latine avec une rare
perfection. Leur accent était doux, leur prononciation n'était ni
étouffée et obscure, ni affectée et prétentieuse ; leur voix, qui
sortait-sans effort, n'avait rien de sourd ni d'enflé. L.
Crassus
parlait avec plus d'abondance et non moins d'agrément; mais pour le
charme de la parole c'était beaucoup déjà que de disputer le premier
rang aux deux Catulus. César, ronde de Catulus, les surpassa tous
par le sel et les grâces piquantes de ses discours, à tel point
qu'au barreau même, toute l'éloquence des autres venait échouer
contre ses bons mots et son naturel. Ce sont là des qualités qu'il
nous faut acquérir, si nous voulons apporter en toutes choses une
con- 457 venance
parfaite. Le discours familier, dont les disciples de Socrate nous
offrent de délicieux modèles, doit réunir la douceur, l'abandon et
la grâce. Qu'on n'aille pas s'emparer de la conversation comme de
sa propriété exclusive, et réduire au silence tout le reste de la
compagnie; ici, comme en toutes choses, on ne doit pas trouver
mauvais que chacun ait son tour. Voyez, en premier lieu, de quoi
l'on parle ; si c'est de choses sérieuses, mettez-y de la gravité,
et de l'enjouement si c'est de choses plaisantes. Ayez grand soin
que votre langage ne donne pas une mauvaise idée de vous, ce qui
arrive toutes les fois qu'on parle mal des absents, qu'on les veut
mettre eu pièces ou tourner en ridicule, et qu'on se permet la
médisance ou la calomnie. La conversation roule ordinairement ou
sur des affaires de famille, ou sur la politique, ou sur les
sciences et les arts. Si l'on perdait de même le sujet, il
faudrait
essayer d'y revenir, mais avec tact, et sans rien forcer; car il
n'est guère de sujet qui intéresse tout le monde, ou qui plaise
toujours et au même degré à ceux qu'il intéresse. Il faut encore
avoir le tact de saisir le moment où la conversation cesse de
plaire. Elle a eu son à-propos; quand il disparait, le mieux est de
savoir la finir.
XXXVIII. De même qu'il nous est prescrit avec beaucoup de sagesse de
fuir dans tout le cours de la vie les passions violentes,
c'est-à-dire les mouvements emportés d'une âme qui n'obéit plus à la
raison; ainsi est-il dans les bienséances de ne laisser percer dans nos discours aucun
mouvement de ce genre ; on ne doit voir dans
notre langage ni emportements, ni colère, ni indolence, ni lâcheté,
ni rien de semblable. Il faut que no-
457 tre application se tourne à montrer de l'affection et
du respect pour ceux avec qui nous conversons. Quelquefois
cependant il devient nécessaire de faire des reproches; alors le ton
aura quelque chose de plus élevé, les paroles seront empreintes de
sévérité et d'âpreté ; nous irons même jusqu'à témoigner une colère
mêlée d'indignation. Mais c'est là une extrémité à laquelle nous en
viendrons rarement; comme les médecins qui ne se décident pas
facilement à employer le fer et le feu, nous attendrons que la
nécessité nous impose un remède aussi violent; et malgré toutes les
apparences , nous conserverons toujours ce sang-froid sans lequel
on ne peut rien faire avec tempérament et sagesse. Le plus souvent
nos reproches doivent être mêlés de douceur, mais cependant
relevés par un air grave ; ce que nous devons faire paraître, c'est
la sévérité et non pas le mépris. Il faut même faire voir que si
nous mettons de la dureté dans nos reproches, c'est dans l'intérêt
de ceux à qui ils s'adressent. Le devoir veut encore que, dans nos
contestations avec nos plus grands ennemis, nous conservions
toujours notre gravité et soyons inaccessibles a la colère, lors
même que nous nous entendrions traiter indignement. Toutes les fois
que la passion est en jeu, la raison s'éclipse, et ceux qui nous
écoutent cessent de nous approuver. Disons encore qu'il est
indécent de se vanter soi-même, surtout de ce qu'on n'a pas fait, et
d'exciter le rire des auditeurs en imitant le soldat fanfaron.
XXXIX. Puisque nous ne passons rien sous silence (telle est du moins
notre intention), nous dirons ici comment doit être la maison d'un
citoyen considérable et élevé en dignité. Une maison, avant
tout, est faite pour qu'on l'habite ; en
458
la construisant l'architecte ne doit jamais perdre de vue l'usage
auquel elle est destinée ; cependant il songera à rendre celle
d'un noble citoyen digne de son rang et le plus commode possible.
Nous savons que ce fut un titre d'honneur pour Cn. Octavius, le
premier de cette famille qui obtint le consulat, d'avoir fait
élever sur le mont Palatin une maison magnifique et pleine de
dignité ; tout le monde allait la visiter, et on disait qu'elle
n'avait pas peu contribué à porter son maître, homme nouveau, au
consulat. Plus tard, Scaurus la fit démolir, et agrandit d'autant
plus son vaste palais. Ainsi l'un fit entrer le premier les
faisceaux consulaires dans sa maison, tandis que l'autre, fils d'un
grand homme, d'un citoyen illustre, ne put apporter dans la sienne,
ainsi agrandie, que la honte d'un refus, l'opprobre et l'infortune.
Il faut donc chercher un nouveau lustre dans sa maison, mais ne pas
croire que toute notre dignité puisse venir d'elle; c'est le maître
qui doit faire honneur à sa maison, et non la maison à son maître.
Cependant, comme en toutes choses il faut penser aux autres et non
pas seulement à soi-même, un citoyen distingué songera qu'il est
appelé à recevoir des hôtes nombreux , et à donner accès auprès de
lui à une multitude de gens de toute espèce ; et il veillera à ce
que sa maison soit assez vaste pour les contenir. Il est vrai que
souvent une maison spacieuse fait peu d'honneur à son maître quand
il s'y trouve dans la solitude ; surtout lorsqu'elle a été
fréquentée du temps d'un autre maître. C'est un triste compliment
que l'on reçoit de ceux qui passent, quand ils s'écrient : «
Antique demeure, hélas! combien tu as perdu en changeant de maître!
» Et certes, il est aujourd'hui bien des palais auxquels on pourrait
adresser cette apostrophe. Si vous bâtissez vous-même, ayez bien soin de ne pas
pousser le luxe et la magnificence à l'excès; c'est ici encore où le
mauvais exemple devient très-funeste. Nous le voyons, tout le monde
veut se signaler comme la noblesse, mais I en ce point seulement.
Qui songe à reproduire les vertus de Lucullus, ce grand citoyen?
Mais on imite à l'envi la magnificence de ses maisons de campagne.
Il faut renoncer à ces extravagances et revenir à des goûts plus
simples. Cette simplicité d'ailleurs convient en toutes choses, et
il n'est rien que la modération ne doive régler dans la vie. Mais en
voilà assez sur ce sujet. Nous ne devons jamais rien entreprendre
sans observer ces trois préceptes : le premier est de subordonner
nos désirs à la raison, et rien ne nous dispose mieux à accomplir
nos devoirs; le second est d'examiner l'importance de l'action que
nous voulons faire, afin de prendre le soin et la peine que la
circonstance réclame, et de ne pas frapper au delà ou en deçà du
but. Le troisième est de soutenir notre dignité sans exagération,
avec cette juste mesure dont nous parlions, qui consiste dans la
bienséance, et hors de laquelle il n'y a plus qu'excès
répréhensible. De ces trois préceptes le plus important est celui
qui veut que nous soumettions nos désirs à l'autorité de la raison.
XL. Nous allons parler maintenant de
l'ordre et de l'à-propos. C'est
là l'objet d'une science particulière que les Grecs nomment ευταξία,
ce qui ne veut point dire modération ou tempérament mais
conservation de l'ordre. Cependant nous pouvons donner à cet art de
conserver l'ordre le nom de modération; car les Stoïciens
définissent la modération, l'art de mettre chacune de nos actions
et de nos paroles à sa place. Mettre
459
les choses à leur place ou les mettre dans l'ordre, c'est tout un.
L'ordre, suivant les mêmes philoso¬phes, c'est la disposition et
l'arrangement des choses dans les lieux convenables; le lieu d'une
action, ils le nomment l'à-propos. Cet à-propos, les Grecs
l'appellent εὐκαιρία, et nous, occasion. La modération, ainsi
entendue, est donc la science des occasions ou de l'à-propos. Il est
vrai que la même définition pourrait convenir à la prudence, dont
nous avons parlé en premier lieu; tandis que maintenant nous nous
occupons de la modération, de la tempérance, et de toutes les
vertus qui appartiennent à la même famille. Nous avons exposé en son
lieu ce qui est relatif à la prudence; nous parlerons en ce moment
de ce qui concerne les vertus dont nous avons commencé depuis
quelque temps déjà à tracer l'image, et qui reviennent toutes à
nous faire garder les bienséances et à nous concilier l'approbation
d'autrui. Il doit y avoir un ordre parfait dans notre conduite, et
notre vie entière doit ressembler à un de ces discours
admirablement suivis dont toutes les parties sont à leur place et
s'enchaînent à merveille. C'est, par exemple, une chose honteuse et
une grande faute de tenir, dans l'accomplissement d une grave
fonction, des propos de table ou des discours de jeune homme. On
cite une fort belle repartie de Périclès. Il avait Sophocle pour
collègue dans le commandement de l'armée ; pendant qu'ils étaient
réunis pour s'occuper de leurs devoirs communs, un bel esclave vint
à passer; Sophocle de s'écrier : « Ο le bel esclave, Périclès ! — Un
magistrat, Sophocle, doit savoir contenir ses yeux aussi bien que
ses mains, répondit Périclès. » Si la même exclamation eût échappé à
Sophocle au moment de l'examen des athlètes, il n'eût encouru aucun reproche, tant
l'à-propos a de puissance. Qu'un homme, en voyage ou eu promenade,
réfléchisse à une cause qu'il va bientôt plaider, ou se préoccupe
de toute autre pensée, il n'y a là rien d'inconvenant; mais qu'au
milieu d'un festin il se laisse entraîner mal à propos à ses
distractions, il passera pour un personnage impoli. Il y a des
choses d'une inconvenance manifeste, comme serait de chanter au
milieu du forum ou de faire quelque autre extravagance ; celles-là
se dénoncent elles-mêmes, il n'est pas besoin de les faire remarquer
et de prémunir les hommes contre elles. Mais il est des fautes qui
paraissent de peu de conséquence, et que la plupart des hommes
n'aperçoivent pas; c'est contre celles-ci surtout qu'il faut nous
mettre en garde. Jouez de la lyre ou de la flûte, la plus petite
discordance n'échappera pas à l'oreille exercée d'un musicien ; ne
devez-vous donc pas tenir à ce que rien dans votre conduite ne
produise un mauvais effet? L'accord des actions n'est-il pas plus
important et d'un plus grand prix que l'harmonie des sons?
|
|
XLI. Itaque, ut in fidibus musicorum aures vel
minima sentiunt, sic nos, si acres ac diligentes esse volumus animadversoresque
vitiorum, magna saepe intellegemus ex parvis. Ex oculorum optutu, superciliorum
aut remissione aut contractione, ex maestitia, ex hilaritate, ex risu, ex
locutione, ex reticentia, ex contentione vocis, ex summissione, ex ceteris
similibus facile iudicabimus, quid eorum apte fiat, quid ab officio naturaque
discrepet. Quo in genere non est incommodum, quale quidque eorum sit, ex aliis
iudicare, ut, si quid dedeceat in illis, vitemus ipsi; fit enim nescio quo modo,
ut magis in aliis cernamus quam in nobismet ipsis, si quid delinquitur. Itaque
facillime corriguntur in discendo, quorum vitia imitantur emendandi causa
magistri. Nec vero alienum est ad ea eligenda, quae dubitationem afferunt,
adhibere doctos homines vel etiam usu peritos et, quid iis de quoque officii
genere placeat, exquirere. Maior enim pars eo fere deferri solet, quo a natura
ipsa deducitur. In quibus videndum est, non modo quid quisque loquatur, sed
etiam quid quisque sentiat atque etiam de qua causa quisque sentiat. Ut enim
pictores et ii, qui signa fabricantur, et vero etiam poeitae suum quisque opus a
vulgo considerari vult, ut, si quid reprehensum sit a pluribus, id corrigatur,
iique et secum et ab aliis, quid in eo peccatum sit, exquirunt, sic aliorum
iudicio permulta nobis et facienda et non facienda et mutanda et corrigenda
sunt. Quae vero more agentur institutisque civilibus, de iis nihil est
praecipiendum; illa enim ipsa praecepta sunt, nec quemquam hoc errore duci
oportet, ut, si quid Socrates aut Aristippus contra rnorem consuetudinemque
civilem fecerint locutive sint, idem sibi arbitretur licere; magnis illi et
divinis bonis hane licentiam assequebantur. Cynicorum vero ratio tota est
eicienda; est enim inimica verecundiae, sine qua nihil rectum esse potest, nihil
honestum. Eos autem, quorum vita perspecta in rebus honestis atque magnis est,
bene de re publica sentientes ac bene meritos aut merentes sic ut aliquo honore
aut imperio affectos observare et colere debemus, tribuere etiam multum
senectuti, cedere iis, qui magistratum habebunt, habere dilectum civis et
peregrini in ipsoque peregrino, privatimne an publice venerit. Ad summam, ne agam de singulis, communem totius generis hominum conciliationem et
consociationem colere, tueri, servare debemus.
XLII. Iam de artificiis et quaestibus, qui
liberales habendi, qui sordidi sint, haec fere accepimus. Primum improbantur ii
quaestus, qui in odia hominum incurrunt, ut portitorum, ut faeneratorum.
Illiberales autem et sordidi quaestus mercennariorum omnium, quorum operae, non
quorum artes emuntur; est enim in illis ipsa merces auctoramentum servitutis.
Sordidi etiam putandi, qui mercantur a mercatoribus, quod statim vendant; nihil
enim proficiant, nisi admodum mentiantur; nec vero est quicquam turpius
vanitate. Opificesque omnes in sordida arte versantur; nec enim quicquam
ingenuum habere potest officina. Minimeque artes eae probandae, quae ministrae
sunt voluptatum:
Cetarii, lanii, coqui,
fartores, piscatores,
ut ait Terentius; adde hue, si placet,
unguentarios, saltatores totumque ludum talarium. Quibus autem artibus aut
prudentia maior inest aut non mediocris utilitas quaeritur, ut medicina, ut
architectura, ut doctrina rerum honestarum, eae sunt iis, quorum ordini
conveniunt, honestae. Mercatura autem, si tenuis est. sordida putanda est; sin
magna et copiosa, multa undique apportans multisque sine vanitate impertiens,
non est admodum vituperanda, atque etiam, si satiata quaestu vel contenta
potius, ut saepe ex alto in portum, ex ipso portu se in agros possessionesque
contulit, videtur iure optimo posse laudari. Omnium autem rerum, ex quibus
aliquid acquiritur, nihil est agri cultura melius, nihil uberius, nihil dulcius,
nihil homine libero dignius; de qua quoniam in Catone Maiore satis multa
diximus, illim assumes, quae ad hunc locum pertinebunt.
XLIII. Sed ab iis partibus, quae sunt honestatis,
quem ad modum officia ducerentur, satis expositum videtur. Eorum autem ipsorum,
quae honesta sunt, potest incidere saepe contentio et comparatio, de duobus
honestis utrum honestius, qui locus a Panaetio est praetermissus. Nam cum omnis
honestas manet a partibus quattuor, quarum una sit cognitionis, altera
communitatis, tertia magnanimitatis, quarta moderationis, haec in deligendo
officio saepe inter se comparentur necesse est. Placet igitur aptiora esse
naturae ea officia, quae ex communitate, quam ea, quae ex cognitione ducantur,
idque hoc argumento confirmari potest, quod, si contigerit ea vita sapienti, ut
omnium rerum affluentibus copiis quamvis omnia, quae cognitione digna sint,
summo otio secum ipse consideret et contempletur, tamen, si solitudo tanta sit,
ut hominem videre non possit, excedat e vita. Princepsque omnium virtutum illa
sapientia, quam σοφίαν Graeci vocant—prudentiam enim, quam Graeci φρόνησιν
dicunt, aliam quandam intellegimus, quae est rerum expetendarum fugiendarumque
scientia; illa autem sapientia, quam principem dixi, rerum est divinarum et
humanarum scientia, in qua continetur deorum et hominum communitas et societas
inter ipsos; ea si maxima est, ut est certe, necesse est, quod a communitate
ducatur officium, id esse maximum. Etenim cognitio contemplatioque naturae manca
quodam modo atque inchoata sit, si nulla actio rerum consequatur. Ea autem actio
in hominum commodis tuendis maxime cernitur; pertinet igitur ad societatem
generis humani; ergo haec cognition anteponenda est. Atque id optimus quisque re
ipsa ostencit et iudicat. Quis enim est tam cupidus in perspicienda
cognoscendaque rerum natura, ut, si ei tractanti contemplantique res cognitione
dignissimas subito sit allatum periculum discrimenque patriae, cui subvenire
opitularique possit, non illa omnia relinquat atque abiciat, etiamsi dinumerare
se stellas aut metiri mundi magnitudinem posse arbitretur? atque hoc idem in
parentis, in amici re aut periculo fecerit. Quibus rebus intellegitur
studiis officiisque scientiae praeponenda esse officia iustitiae, quae pertinent
ad hominum utilitatem,qua nihil homini esse debet antiquius.
XLIV. Atque illi, quorum studia vitaque omnis in
rerum cognitione versata est, tamen ab augendis hominum utilitatibus et commodis
non recesserunt; nam et erudiverunt multos, quo meliores cives utilioresque
rebus suis publicis essent, ut Thebanum Epaminondam Lysis Pythagoreus,
Syracosium Dionem Plato multique multos, nosque ipsi, quicquid ad rem publicam
attulimus, si modo aliquid attulimus, a doctoribus atque doctrina instructi ad
eam et ornati accessimus. Neque solum vivi atque praesentes studiosos discendi
erudiunt atque docent, sed hoc idem etiam post mortem monumentis litterarum
assequuntur. Nec enim locus ullus est praetermissus ab iis, qui ad leges, qui ad
mores, qui ad disciplinam rei publicae pertineret, ut otium suum ad nostrum
negotium contulisse videantur. Ita illi ipsi doctrinae studiis et sapientiae
dediti ad hominum utilitatem suam prudentiam intellegentiamque potissimum
conferunt; ob eamque etiam causam eloqui copiose, modo prudenter, melius est
quam vel acutissime sine eloquentia cogitare, quod cogitatio in se ipsa
vertitur, eloquentia complectitur eos, quibuscum communitate iuncti sumus. Atque
ut apium examina non fingendorum favorum causa congregantur, sed, cum
congregabilia natura sint, fingunt favos, sic homines, ac multo etiam magis,
natura congregati adhibent agendi cogitandique sollertiam. Itaque, nisi ea
virtus, quae constat ex hominibus tuendis, id est ex societate generis humani,
attingat cognitionem rerum, solivaga cognitio et ieiuna videatur, itemque
magnitudo animi remota communitate coniunctioneque humana feritas sit quaedam et
immanitas. Ita fit, ut vincat cognitionis studium consociatio hominum atque
communitas. Nec verum est, quod dicitur a quibusdam, propter necessitatem vitae,
quod ea, quae natura desideraret, consequi sine aliis atque efficere non
possemus, idcirco initam esse cum hominibus communitatem et societatem; quodsi
omnia nobis, quae ad victum cultumque pertinent, quasi virgula divina, ut aiunt,
suppeditarentur, turn optimo quisque ingenio negotiis omnibus omissis totum se
in cognitione et scientia collocaret. Non est ita; nam et solitudinem fugeret et
socium studii quaereret, tum docere turn discere vellet, turn audire turn
dicere. Ergo omne officium, quod ad coniunctionem hominum et ad societatem
tuendam valet, anteponendum est illi officio, quod cognitione et scientia
continetur.
XLIV. Illud forsitan quaerendum sit, num haec
communitas, quae maxime est apta naturae, sit etiam moderationi modestiaeque
semper anteponenda. Non placet; sunt enim quaedam partim ita foeda, partim ita
flagitiosa, ut ea ne conservandae quidem patriae causa sapiens facturus sit. Ea
Posidonius collegit permulta, sed ita taetra quaedam, ita obscena, ut dictu
quoque videantur turpia. Haec igitur non suscipiet rei publicae causa, ne res
publica quidem pro se suscipi volet. Sed hoc commodius se res habet, quod non
potest accidere tempus, ut intersit rei publicae quicquam illorum facere
sapientem. Quare hoc quidem effectum sit, in officiis deligendis id genus
officiorum excellere, quod teneatur hominum societate. Etenim cognitionem
prudentiamque sequetur considerata actio; ita fit, ut agere considerate pluris
sit quam cogitare prudenter. Atque haec quidem hactenus. Patefactus enim locus
est ipse, ut non difficile sit in exquirendo officio, quid cuique sit
praeponendum, videre. In ipsa autem communitate sunt gradus officiorum, ex
quibus, quid cuique praestet, intellegi possit, ut prima dis immortalibus,
secunda patriae, tertia parentibus, deinceps gradatim reliquis debeantur. Quibus
ex rebus breviter disputatis intellegi potest non solum id homines solere
dubitare, honestumne an turpe sit, sed etiam duobus propositis honestis utrum
honestius sit. Hie locus a Panaetio est, ut supra dixi, praetermissus. Sed iam
ad reliqua pergamus. |
XLI. Si, dans le jeu de la lyre, l'oreille d'un musicien peut sentir
la plus légère imperfection, exerçons-nous à noter attentivement,
sévèrement, toutes les imperfections de la conduite, et notre tact
finira par découvrir dans les moindres choses le signe des plus
grandes qualités ou des plus grands vices. Un regard, un mouvement
du sourcil , un accès de joie ou de tristesse, un sourire, une
parole, une réticence, le ton que Ton élève ou que Ton abaisse,
mille indices de ce genre nous feront juger facilement si l'on se
conforme à la bienséance, ou si l'on s'écarte de son devoir et de la
nature. Il nous sera fort avantageux
460 d'observer ainsi chez les autres ce qui est bien ou mal ;
car nous serons tout disposés à éviter ce que nous trouverons en eux
de contraire à la bienséance. Il arrive en effet, je ne sais
comment, que nous apercevons mieux les défauts d'autrui que les
nôtres. Aussi les élèves ne se corrigent jamais mieux que lorsqu'ils
voient leurs défauts contrefaits par le maître. Lorsqu'on est dans
le doute et que l'on ne sait quel parti prendre, la raison nous
conseille de consulter des hommes instruits ou expérimentés, et de
leur demander quel jugement ils portent sur les diverses difficultés
où nous nous trouvons. La plupart des hommes ont coutume d aller
sans réflexion où leur nature les entraîne. Quand on reçoit les
avis, il ne suffit pas d'écouter ce que l'on nous dit; il faut aller
plus loin, et voir ce que chacun pense et par quels motifs il le
pense. Les peintres, les sculpteurs, les poètes même tiennent à
offrir leurs ouvrages à l'examen du public, pour corriger ce qui
serait généralement blâmé; on les voit s'interroger eux-mêmes et
mettre les autres à contribution pour découvrir les imperfections
qui peuvent s'être glissées dans leurs œuvres; nous devons, a leur
exemple, consulter le jugement d'autrui pour faire ou ne pas faire
certaines choses, les changer ou les corriger. A l'égard des
coutumes et des institutions civiles, nous n'avons aucun précepte à
donner, car eues sont elles-mêmes des préceptes. Qu'aucun de nous
n'aille follement s'imaginer que si Socrate et Aristippe ont,
dit-on, fait quelque chose contre les usages et les coutumes de
leur pays, il lui est bien permis de suivre cet exemple. Faisons
réflexion que ces hommes divins avaient rendu d'assez grands
services pour avoir certains privilèges. Quant aux discours des Cyniques, il leur faut absolument fermer l'oreille; car ils vont au
renversement de la pudeur, sans laquelle il n'est rien de bien, rien
d'honnête. Nous devons encore témoigner de la déférence et du
respect aux hommes dont la vie a été honorable et employée â de
grandes choses ; qui sont dévoués aux intérêts de leur pays, et lui
ont rendu des services ou lui en rendent encore ; à ceux enfin qui
sont revêtus de certains honneurs, ou dépositaires de l'autorité
publique. Nous devons accorder beaucoup de prérogatives à la
vieillesse, reconnaître la suprématie des magistrats ; faire une
différence entre le citoyen et l'étranger, et même des étrangers
entre eux, suivant qu'ils sont venus ou non remplir une mission
publique. En un mot, pour ne pas poursuivre les détails jusqu'à
l'infini, nous devons respecter, maintenir et défendre les liens
qui réunissent tout le genre humain en une seule famille, et
constituent la société universelle.
XLII. Parmi les différents arts, et
relativement aux gains qu'ils
procurent, les uns sont réputés libéraux et les autres mercenaires.
On attache d'abord une idée déshonorante aux gains qui ont par
eux-mêmes quelque chose d'odieux, comme ceux des exacteurs et des
usuriers. On tient pour indignes d'un homme libre ceux de tous les
mercenaires qui louent leurs bras et rien de plus, l'argent qu'où
leur donne est comme le prix de leur servitude. On regarde encore
comme peu honorables les profits de ces gens qui achètent aux
marchands pour revendre immédiatement après; car ils ne peuvent
rien gagner s'ils ne mentent effrontément, et rien n'est plus
honteux que le mensonge. En général, tous les artisans exercent
des professions viles, et la place
461
d'un homme libre n'est pas dans une boutique. Mais les métiers les
plus méprisables sont ceux qui s'occupent exclusivement de nos
jouissances; comme, par exemple, ceux de poissonnier, de boucher, de
cuisinier, de charcutier, de pêcheur, dont parle Térence. Ajoutez-y,
si vous voulez, ceux de parfumeur, de danseur, de joueur de
gobelets. Mais les arts dont la profession demande plus de savoir et
qui sont d'une utilité réelle, comme la médecine, l'architecture, l'enseignement
des sciences ou des lettres, n'ont rien que d'honorable pour ceux
qui se trouvent de condition à les exercer. Le commerce ne convient
qu'aux esclaves, s'il se fait en petit; mais il se relève lorsqu'il
se fait en grand, qu'il apporte dans un môme pays les productions du
monde entier, qu'il les met à la portée du grand nombre et garde
toujours une parfaite loyauté. Si le commerçant, lorsque les
richesses affluent chez lui, ou plutôt lorsqu'il est satisfait de sa
fortune, se retire, du port où son vaisseau l'a si souvent ramené,
dans la campagne et au milieu de ses terres, il me semble alors
mériter de tous points le nom d'homme honorable. Mais, de toutes les
sources de richesses, l'agriculture est incomparablement la
meilleure, la plus abondante, celle où il est le plus doux et où il
convient le mieux à un homme libre de puiser. J'en ai parlé avec
assez de détails dans mon Caton Γ ancien; c'est là que vous devrez
chercher ce qui, sur ce point, a rapport à notre sujet.
XLIII. Je crois vous avoir suffisamment
montré comment tous les
devoirs dérivent des quatre vertus fondamentales. Mais il ne suffit
pas de savoir ce qui est honnête; car il arrive souvent qu'entre
deux choses honnêtes il faille établir une comparaison, et se demander laquelle l'est
davantage; c'est là toute une question négligée par Panétius.
Puisque l'honnête dans les actions dérive de quatre sources, dont
l'une est la connaissance du vrai, l'autre la garantie de la
société humaine, la troisième la grandeur d'âme, et la quatrième la
modération; il devient souvent nécessaire de les comparer entre
elles, pour nous éclairer sur le choix de nos devoirs. C'est ainsi
que l'on découvre que les devoirs relatifs au maintien de la société
humaine sont plus conformes à la nature que ceux dont la recherche
du vrai est le principe; et on le prouve de cette manière. Mettons
par la pensée un sage dans l'abondance de tous les biens, donnons-leur le
pouvoir de contempler, d'entendre, dans un loisir que rien ne
trouble, toutes les choses dignes d'être connues; si cependant nous
le reléguons dans une telle solitude qu'il ne puisse voir un seul
homme, il n'aura dès lors qu'à sortir de la vie. La première de
toutes les vertus est la sagesse, que les Grecs nomment σοφία, et
que l'on ne doit point confondre avec la prudence. Cette dernière
vertu, appelée φρόνησις par les Grecs. est proprement la science des
choses à rechercher et à fuir. Mais la sagesse, qui est la reine de
toutes les vertus, est la science des choses divines et humaines, le
fondement de toute communauté entre les dieux et entre les hommes,
et des deux grandes sociétés qu'ils composent. S'il n'y a rien de
plus excellent au monde que l'union et la communauté des hommes, il
en résulte nécessairement que les devoirs relatifs au maintien de la
société sont les premiers de tous. La contemplation de la nature, la
science, est une vertu en quelque façon mutilée et incomplète, si
elle n'aboutit pas à l'action. Or, l'action qui la
462 peut suivre a surtout pour but l'utilité des
hommes; elle est donc destinée à maintenir la société humaine; d'où
il faut conclure que la connaissance du vrai le cède à la pratique
de la justice. Il n'est pas une belle âme qui ne pense ainsi, et ne
le manifeste au besoin. Trouveriez-vous un homme de bien tellement
avide de connaissances que si, au milieu de ses contemplations les
plus sublimes, on venait lui annoncer que sa patrie est menacée d'un
grand péril, et qu'il pût la secourir, il n'interrompit tout
aussitôt ses recherches et ne rejetât la science loin de lui, quand
même il croirait pouvoir nombrer les étoiles ou mesurer la grandeur
du monde? Et ce n'est pas seulement pour sa patrie, mais pour son
parent ou son ami, que l'on ferait un semblable sacrifice. Tout cela
nous fait entendre que les soins de la justice doivent passer avant
ceux de la science, parce qu'ils concernent directement l'amour que
nous devons avoir pour nos semblables. Aimer les hommes et les
servir, c'est là notre premier devoir.
XLIV. Ceux dont la vie entière s'est passée dans les méditations et
dans la recherche de la vérité n'ont pas laissé, pour cela, de se
rendre utiles aux hommes. Ils ont formé beaucoup de disciples qui
sans eux. n'auraient été ni si bons citoyens, ni d'un si grand
secours à leur pays. Vous savez qu'Épaminondas fut l'élève du
pythagoricien Lysis, et Dion de Syracuse, celui de Platon ; vous
savez combien d'hommes d'État ont été formés par des philosophes; et
nous-mêmes, si nous avons pu rendre quelque service à la république,
c'a été grâces aux leçons de nos maîtres et aux lumières de la
sagesse. Et ce n'est pas seulement pendant leur vie que ces grands
génies peuvent instruire et éclairer ceux qui viennent chercher
leurs doctes enseignements, ils le peuvent, même après leur mort,
par les écrits impérissables qu'ils nous ont légués. Ea effet, ils
n'ont rien omis de ce qui regarde les lois, les mœurs, le
gouvernement des États; et ils semblent ainsi avoir consacré leurs
loisirs à régler et servir nos affaires. Nous voyons donc que les
hommes voués à la science et à la poursuite de la sagesse, ont fait
tourner avec une application toute particulière leurs lumières et
leur prudence à l'utilité du genre humain. On conçoit dès lors
pourquoi le talent de la parole, quand il appartient à un esprit
sage, est préférable à une extrême pénétration d'esprit qui ne
serait pas en compagnie d'un peu d'éloquence. Avec ce don de la
pensée, l'homme serait concentré en lui-même; avec celui de
l'éloquence il se produit au-dehors, et se rend utile à la
société
entière dont il est membre. Les abeilles ne se réunissent pas en
essaims pour faire du miel, mais, réunies par un instinct de leur
nature, elles composent leurs rayons : tout pareillement, les hommes
rassemblés par une impulsion naturelle, bien plus puissante encore,
donnent, une fois en société, l'essor à leur activité et à leur
esprit. Si donc cette vertu, dont la destination est de protéger
les hommes, c'est-à-dire de maintenir la société humaine, ne se mêle
pas à notre amour de la connaissance, cette recherche de la vérité
devient un travail sans but, et perd tout son prix. Il en est de
même de la grandeur d'âme: si l'amour des hommes ne l'inspire, ce
n'est plus qu'une espèce de férocité, assez semblable à la force
brutale des animaux. Il est donc bien démontré que le désir de
savoir doit être subordonné aux intérêts et au maintien de la
société hu- 463 maine. Il n'est pas
vrai, comme certains philosophes le prétendent, que la société
humaine ait été formée uniquement pour satisfaire aux nécessités de
la vie, et parce que l'homme ne pouvait fournir à ses besoins sans
le concours de ses semblables; et que si tout ce qui regarde notre
subsistance et notre entretien nous était constamment donné par
une baguette divine, comme on dit, alors tout esprit un peu relevé,
laissant là les affaires, s'appliquerait sans réserve à l'étude et à
la recherche de la vérité. Il n'en va pas ainsi; l'esprit dont on
nous parle fuirait la solitude et chercherait un compagnon de ses
travaux; il voudrait instruire et être instruit, écouter et parler.
Donc, en dernier résultat, tout devoir qui est relatif au maintien
de la société, de l'union des hommes, l'emporte sur celui que la
prudence ou la recherche du vrai nous impose seule.
XLV. On demandera peut-être si cette vertu qui tend au maintien de
la société, et qui est si conforme à notre nature, doit toujours l'emporter
sur la modération et la pudeur? Ce n'est pas mon avis ; car il est
de telles abominations et de telles infamies, qu'un sage ne les
commettra jamais , même pour sauver sa patrie. Posidonius en citent
grand nombre, et il en est quelques-unes de si odieuses et de si
obscènes, qu'on rougirait de les nommer. Le sage ne se dégradera pas
à ce point-là pour l'amour de son pays ; bien plus, son pays ne lui
demandera jamais de tels services. Ces suppositions désolantes sont
entièrement gratuites; car jamais il ne peut se présenter de
circonstance où il soit de l'intérêt de la république que le sage
commette une infamie. Nous avons montré que, dans la comparaison des
devoirs, il faut mettre au premier rang ceux qui tendent au maintien de la société humaine. La connaissance
du vrai et le bon conseil doivent aboutir à une sage action ; d'où
il résulte que bien agir vaut mieux que bien penser. Mais en voilà
assez sur cette question. Les indications que nous avons données sur
le sujet permettront à chacun de découvrir dans chaque circonstance
quel est le devoir qui l'emporte sur les autres. Parmi les devoirs
qui se rapportent au maintien de la société, on en reconnaîtra
facilement de plus élevés les uns que les autres. Nos premières
obligations sont envers les dieux; les secondes, envers la patrie;
celles envers nos parents viennent en troisième lieu, et les autres
ensuite par degrés d'importance. Cette courte discussion fait voir
clairement que les hommes ne se demandent pas seulement à propos du
devoir si une chose est honnête ou ne l'est pas, mais souvent
encore, de deux choses honnêtes, laquelle Test davantage. Panétius,
comme je l'ai déjà dit, a négligé toute cette question. Mais il est
temps de passer outre.
|