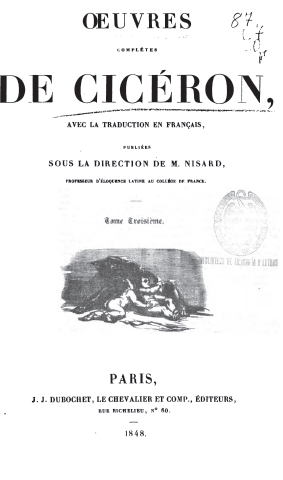|
LIBER TERTIUS
Voluptatem quidem, Brute, si ipsa pro se loquatur nec tam pertinaces habeat
patronos, concessuram arbitror convictam superiore libro dignitati. Etenim sit
inpudens, si virtuti diutius repugnet, aut si honestis iucunda anteponat aut
pluris esse contendat dulcedinem corporis ex eave natam laetitiam quam
gravitatem animi atque constantiam. Quare illam quidem dimittamus et suis se
finibus tenere iubeamus, ne blanditiis eius inlecebrisque impediatur
disputandi severitas. quaerendum est enim, ubi sit illud summum bonum,
quod reperire volumus, quoniam et voluptas ab eo remota est, et eadem fere
contra eos dici possunt, qui vacuitatem doloris finem bonorum esse voluerunt,
nec vero ullum probetur <oportet> summum bonum, quod virtute careat, qua nihil
potest esse praestantius. Itaque quamquam in eo sermone, qui cum Torquato est
habitus, non remissi fuimus, tamen haec acrior est cum Stoicis parata contentio.
Quae enim de voluptate dicuntur, ea nec acutissime nec abscondite disseruntur;
neque enim qui defendunt eam versuti in disserendo sunt nec qui contra dicunt
causam difficilem repellunt. ipse etiam dicit Epicurus ne argumentandum
quidem esse de voluptate, quod sit positum iudicium eius in sensibus, ut
commoneri nos satis sit, nihil attineat doceri. Quare illa nobis simplex fuit in
utramque partem disputatio. Nec enim in Torquati sermone quicquam implicatum aut
tortuosum fuit, nostraque, ut mihi videtur, dilucida oratio. Stoicorum autem non
ignoras quam sit subtile vel spinosum potius disserendi genus, idque cum Graecis
tum magis nobis, quibus etiam verba parienda sunt inponendaque nova rebus novis
nomina. Quod quidem nemo mediocriter doctus mirabitur cogitans in omni arte,
cuius usus vulgaris communisque non sit, multam novitatem nominum esse, cum
constituantur earum rerum vocabula, quae in quaque arte versentur. itaque
et dialectici et physici verbis utuntur iis, quae ipsi Graeciae nota non sint,
geometrae vero et musici, grammatici etiam more quodam loquuntur suo. Ipsae
rhetorum artes, quae sunt totae forenses atque populares, verbis tamen in
docendo quasi privatis utuntur ac suis.
II. Atque ut omittam has artis
elegantes et ingenuas, ne opifices quidem tueri sua artificia possent, nisi
vocabulis uterentur nobis incognitis, usitatis sibi. Quin etiam agri cultura,
quae abhorret ab omni politiore elegantia, tamen eas res, in quibus versatur,
nominibus notavit novis. Quo magis hoc philosopho faciendum est. Ars est enim
philosophia vitae, de qua disserens arripere verba de foro non potest.
Quamquam ex omnibus philosophis Stoici plurima novaverunt, Zenoque, eorum
princeps, non tam rerum inventor fuit quam verborum novorum. Quodsi in ea
lingua, quam plerique uberiorem putant, concessum a Graecia est ut doctissimi
homines de rebus non pervagatis inusitatis verbis uterentur, quanto id nobis
magis est concedendum, qui ea nunc primum audemus attingere? Et quoniam saepe
diximus, et quidem cum aliqua querela non Graecorum modo, sed eorum etiam, qui
se Graecos magis quam nostros haberi volunt, nos non modo non vinci a Graecis
verborum copia, sed esse in ea etiam superiores, elaborandum est ut hoc non in
nostris solum artibus, sed etiam in illorum ipsorum adsequamur. Quamquam ea
verba, quibus instituto veterum utimur pro Latinis, ut ipsa philosophia, ut
rhetorica, dialectica, grammatica, geometria, musica, quamquam Latine ea dici
poterant, tamen, quoniam usu percepta sunt, nostra ducamus.
Atque haec quidem de rerum nominibus. De ipsis rebus autem saepenumero,
Brute, vereor ne reprehendar, cum haec ad te scribam, qui cum in philosophia,
tum in optimo genere philosophiae tantum processeris. Quod si facerem quasi te
erudiens, iure reprehenderer. Sed ab eo plurimum absum neque, ut ea cognoscas,
quae tibi notissima sunt, ad te mitto, sed quia facillime in nomine tuo
adquiesco, et quia te habeo aequissimum eorum studiorum, quae mihi communia
tecum sunt, existimatorem et iudicem. Attendes igitur, ut soles, diligenter
eamque controversiam diiudicabis, quae mihi fuit cum avunculo tuo, divino ac
singulari viro.
Nam in Tusculano cum essem vellemque e bibliotheca pueri
Luculli quibusdam libris uti, veni in eius villam, ut eos ipse, ut solebam,
depromerem. Quo cum venissem, M. Catonem, quem ibi esse nescieram, vidi in
bibliotheca sedentem multis circumfusum Stoicorum libris. Erat enim, ut scis, in
eo aviditas legendi, nec satiari poterat, quippe qui ne reprehensionem quidem
vulgi inanem reformidans in ipsa curia soleret legere saepe, dum senatus
cogeretur, nihil operae rei publicae detrahens. Quo magis tum in summo otio
maximaque copia quasi helluari libris, si hoc verbo in tam clara re utendum est,
videbatur. quod cum accidisset ut alter alterum necopinato videremus,
surrexit statim. Deinde prima illa, quae in congressu solemus: Quid tu, inquit,
huc? A villa enim, credo, et: Si ibi te esse scissem, ad te ipse venissem.
Heri, inquam, ludis commissis ex urbe profectus veni ad vesperum. Causa autem
fuit huc veniendi ut quosdam hinc libros promerem. Et quidem, Cato, hanc totam
copiam iam Lucullo nostro notam esse oportebit; nam his libris eum malo quam
reliquo ornatu villae delectari. Est enim mihi magnae curae—quamquam hoc quidem
proprium tuum munus est—, ut ita erudiatur, ut et patri et
Caepioni nostro et
tibi tam propinquo respondeat. Laboro autem non sine causa; nam et
avi
eius memoria moveor—nec enim ignoras, quanti fecerim Caepionem, qui, ut opinio
mea fert, in principibus iam esset, si viveret—, et Lucullus mihi versatur ante
oculos, vir cum virtutibus omnibus excellens, tum mecum et amicitia et omni
voluntate sententiaque coniunctus.
Praeclare, inquit, facis, cum et eorum memoriam tenes, quorum uterque tibi
testamento liberos suos commendavit, et puerum diligis. Quod autem meum munus
dicis non equidem recuso, sed te adiungo socium. Addo etiam illud, multa iam
mihi dare signa puerum et pudoris et ingenii, sed aetatem vides.
Video equidem, inquam, sed tamen iam infici debet iis artibus, quas si, dum est
tener, conbiberit, ad maiora veniet paratior.
Sic, et quidem diligentius saepiusque ista loquemur inter nos agemusque
communiter. Sed residamus, inquit, si placet. Itaque fecimus.
III. Tum ille: Tu autem cum ipse tantum librorum habeas, quos hic tandem
requiris?
Commentarios quosdam, inquam, Aristotelios, quos hic sciebam esse, veni ut
auferrem, quos legerem, dum essem otiosus; quod quidem nobis non saepe contingit.
-
Quam vellem, inquit, te ad Stoicos inclinavisses! erat enim, si cuiusquam, certe
tuum nihil praeter virtutem in bonis ducere. -
Vide, ne magis, inquam, tuum fuerit, cum re idem tibi, quod mihi, videretur, non
nova te rebus nomina inponere. Ratio enim nostra consentit, pugnat oratio. -
Minime vero, inquit ille, consentit. Quicquid enim praeter id, quod
honestum sit, expetendum esse dixeris in bonisque numeraveris, et honestum ipsum
quasi virtutis lumen extinxeris et virtutem penitus everteris. -
Dicuntur ista, Cato, magnifice, inquam, sed videsne verborum gloriam tibi cum
Pyrrhone et cum Aristone, qui omnia exaequant, esse communem? de quibus
cupio scire quid sentias. -
Egone quaeris, inquit, quid sentiam? Quos bonos viros, fortes, iustos, moderatos
aut audivimus in re publica fuisse aut ipsi vidimus, qui sine ulla doctrina
naturam ipsam secuti multa laudabilia fecerunt, eos melius a natura institutos
fuisse, quam institui potuissent a philosophia, si ullam aliam probavissent
praeter eam, quae nihil aliud in bonis haberet nisi honestum, nihil nisi turpe
in malis; ceterae philosophorum disciplinae, omnino alia magis alia, sed tamen
omnes, quae rem ullam virtutis expertem aut in bonis aut in malis numerent, eas
non modo nihil adiuvare arbitror neque firmare, quo meliores simus, sed ipsam
depravare naturam. Nam nisi hoc optineatur, id solum bonum esse, quod honestum
sit, nullo modo probari possit beatam vitam virtute effici. Quod si ita sit, cur
opera philosophiae sit danda nescio. Si enim sapiens aliquis miser esse possit,
ne ego istam gloriosam memorabilemque virtutem non magno aestimandam putem.
IV. Quae adhuc, Cato, a te dicta sunt, eadem, inquam, dicere posses, si
sequerere Pyrrhonem aut Aristonem. Nec enim ignoras his istud honestum non
summum modo, sed etiam, ut tu vis, solum bonum videri. Quod si ita est,
sequitur id ipsum, quod te velle video, omnes semper beatos esse sapientes.
Hosne igitur laudas et hanc eorum, inquam, sententiam sequi nos censes oportere?
-
Minime vero istorum quidem, inquit. Cum enim virtutis hoc proprium sit, earum
rerum, quae secundum naturam sint, habere delectum, qui omnia sic exaequaverunt,
ut in utramque partem ita paria redderent, uti nulla selectione uterentur, hi
virtutem ipsam sustulerunt. -
Istud quidem, inquam, optime dicis, sed quaero nonne tibi faciendum idem
sit nihil dicenti bonum, quod non rectum honestumque sit, reliquarum rerum
discrimen omne tollenti. -
Si quidem, inquit, tollerem, sed relinquo. -
Quonam modo? inquam. Si una virtus, unum istud, quod honestum appellas,
rectum, laudabile, decorum— erit enim notius quale sit pluribus notatum
vocabulis idem declarantibus—, id ergo, inquam, si solum est bonum, quid habebis
praeterea, quod sequare? Aut, si nihil malum, nisi quod turpe, inhonestum,
indecorum, pravum, flagitiosum, foedum—ut hoc quoque pluribus nominibus insigne
faciamus—, quid praeterea dices esse fugiendum? -
Non ignoranti tibi, inquit, quid sim dicturus, sed aliquid, ut ego suspicor, ex
mea brevi responsione arripere cupienti non respondebo ad singula, explicabo
potius, quoniam otiosi sumus, nisi alienum putas, totam Zenonis Stoicorumque
sententiam. -
Minime id quidem, inquam, alienum, multumque ad ea, quae quaerimus, explicatio
tua ista profecerit. -
Experiamur igitur, inquit, etsi habet haec Stoicorum ratio difficilius
quiddam et obscurius. Nam cum in Graeco sermone haec ipsa quondam rerum nomina
novarum novabantur, quae nunc consuetudo diuturna trivit; quid censes in
Latino fore?
Facillimum id quidem est, inquam. Si enim Zenoni licuit, cum rem aliquam
invenisset inusitatam, inauditum quoque ei rei nomen inponere, cur non liceat
Catoni? Nec tamen exprimi verbum e verbo necesse erit, ut interpretes indiserti
solent, cum sit verbum, quod idem declaret, magis usitatum. Equidem soleo etiam
quod uno Graeci, si aliter non possum, idem pluribus verbis exponere. Et tamen
puto concedi nobis oportere ut Graeco verbo utamur, si quando minus occurret
Latinum, ne hoc ephippiis et acratophoris potius quam proegmenis et apoproegmenis
concedatur; quamquam haec quidem praeposita recte et reiecta dicere licebit. -
Bene facis, inquit, quod me adiuvas, et istis quidem, quae modo dixisti,
utar potius Latinis, in ceteris subvenies, si me haerentem videbis. -
Sedulo, inquam, faciam. Sed 'fortuna fortis'; quare conare, quaeso. Quid enim
possumus hoc agere divinius?
V. Placet his, inquit, quorum ratio mihi probatur, simulatque natum sit animal—hinc
enim est ordiendum—, ipsum sibi conciliari et commendari ad se conservandum et
ad suum statum eaque, quae conservantia sint eius status, diligenda,
alienari autem ab interitu iisque rebus, quae interitum videantur adferre. Id
ita esse sic probant, quod ante, quam voluptas aut dolor attigerit, salutaria
appetant parvi aspernenturque contraria, quod non fieret, nisi statum suum
diligerent, interitum timerent. Fieri autem non posset ut appeterent aliquid,
nisi sensum haberent sui eoque se diligerent. Ex quo intellegi debet principium
ductum esse a se diligendo. in principiis autem naturalibus diligendi sui
plerique Stoici non putant voluptatem esse ponendam. Quibus ego vehementer
adsentior, ne, si voluptatem natura posuisse in iis rebus videatur, quae primae
appetuntur, multa turpia sequantur. Satis esse autem argumenti videtur quam ob
rem illa, quae prima sunt adscita natura, diligamus, quod est nemo, quin, cum
utrumvis liceat, aptas malit et integras omnis partis corporis quam, eodem usu,
inminutas aut detortas habere. Rerum autem cognitiones, quas vel comprehensiones
vel perceptiones vel, si haec verba aut minus placent aut minus intelleguntur,
καταλήψεις appellemus licet, eas igitur ipsas propter se adsciscendas arbitramur,
quod habeant quiddam in se quasi complexum et continens veritatem. Id autem in
parvis intellegi potest, quos delectari videamus, etiamsi eorum nihil intersit,
si quid ratione per se ipsi invenerint. artis etiam ipsas propter se
adsumendas putamus, cum quia sit in iis aliquid dignum adsumptione, tum quod
constent ex cognitionibus et contineant quiddam in se ratione constitutum et
via. A falsa autem adsensione magis nos alienatos esse quam a ceteris rebus,
quae sint contra naturam, arbitrantur. Iam membrorum, id est partium corporis,
alia videntur propter eorum usum a natura esse donata, ut manus, crura, pedes,
ut ea, quae sunt intus in corpore, quorum utilitas quanta sit a medicis
etiam disputatur, alia autem nullam ob utilitatem quasi ad quendam ornatum, ut
cauda pavoni, plumae versicolores columbis, viris mammae atque barba. Haec
dicuntur fortasse ieiunius; sunt enim quasi prima elementa naturae, quibus
ubertas orationis adhiberi vix potest, nec equidem eam cogito consectari. Verum
tamen cum de rebus grandioribus dicas, ipsae res verba rapiunt; ita fit cum
gravior, tum etiam splendidior oratio. -
Est, ut dicis, inquam. Sed tamen omne, quod de re bona dilucide dicitur, mihi
praeclare dici videtur. Istius modi autem res dicere ornate velle puerile est,
plane autem et perspicue expedire posse docti et intellegentis viri.
VI. Progrediamur igitur, quoniam, inquit, ab his principiis naturae
discessimus, quibus congruere debent quae sequuntur. Sequitur autem haec prima
divisio: Aestimabile esse dicunt—sic enim, ut opinor, appellemus— id, quod aut
ipsum secundum naturam sit aut tale quid efficiat, ut selectione dignum
propterea sit, quod aliquod pondus habeat dignum aestimatione, quam illi ἀξίαν
vocant, contraque inaestimabile, quod sit superiori contrarium. Initiis igitur
ita constitutis, ut ea, quae secundum naturam sunt, ipsa propter se sumenda sint
contrariaque item reicienda, primum est officium—id enim appello καθῆκον—, ut se
conservet in naturae statu, deinceps ut ea teneat, quae secundum naturam sint,
pellatque contraria. Qua inventa selectione et item reiectione sequitur deinceps
cum officio selectio, deinde ea perpetua, tum ad extremum constans
consentaneaque naturae, in qua primum inesse incipit et intellegi, quid
sit, quod vere bonum possit dici. prima est enim conciliatio hominis ad ea,
quae sunt secundum naturam. Simul autem cepit intellegentiam vel notionem potius,
quam appellant ἔννοιαν illi, viditque rerum agendarum ordinem et, ut ita dicam,
concordiam, multo eam pluris aestimavit quam omnia illa, quae prima dilexerat,
atque ita cognitione et ratione collegit, ut statueret in eo collocatum summum
illud hominis per se laudandum et expetendum bonum, quod cum positum sit in eo,
quod ὁμολογίαν Stoici, nos appellemus convenientiam, si placet,—cum igitur in eo
sit id bonum, quo omnia referenda sint, honeste facta ipsumque honestum, quod
solum in bonis ducitur, quamquam post oritur, tamen id solum vi sua et dignitate
expetendum est; eorum autem, quae sunt prima naturae, propter se nihil est
expetendum. cum vero illa, quae officia esse dixi, proficiscantur ab
initiis naturae, necesse est ea ad haec referri, ut recte dici possit omnia
officia eo referri, ut adipiscamur principia naturae, nec tamen ut hoc sit
bonorum ultimum, propterea quod non inest in primis naturae conciliationibus
honesta actio; consequens enim est et post oritur, ut dixi. Est tamen ea
secundum naturam multoque nos ad se expetendam magis hortatur quam superiora
omnia. -
Sed ex hoc primum error tollendus est, ne quis sequi existimet, ut duo sint
ultima bonorum. Etenim, si cui propositum sit conliniare hastam aliquo aut
sagittam, sicut nos ultimum in bonis dicimus, sic illi facere omnia, quae possit,
ut conliniet huic in eius modi similitudine omnia sint facienda, ut
conliniet, et tamen, ut omnia faciat, quo propositum adsequatur, sit hoc quasi
ultimum, quale nos summum in vita bonum dicimus, illud autem, ut feriat, quasi
seligendum, non expetendum.
VII. Cum autem omnia officia a principiis naturae proficiscantur, ab isdem
necesse est proficisci ipsam sapientiam. Sed quem ad modum saepe fit, ut is, qui
commendatus sit alicui, pluris eum faciat, cui commendatus sit, quam illum, a
quo, sic minime mirum est primo nos sapientiae commendari ab initiis naturae,
post autem ipsam sapientiam nobis cariorem fieri, quam illa sint, a quibus ad
hanc venerimus. Atque ut membra nobis ita data sunt, ut ad quandam rationem
vivendi data esse appareant, sic appetitio animi, quae ὁρμή Graece vocatur, non
ad quodvis genus vitae, sed ad quandam formam vivendi videtur data, itemque et
ratio et perfecta ratio. ut enim histrioni actio, saltatori motus non
quivis, sed certus quidam est datus, sic vita agenda est certo genere quodam,
non quolibet; quod genus conveniens consentaneumque dicimus. Nec enim
gubernationi aut medicinae similem sapientiam esse arbitramur, sed actioni illi
potius, quam modo dixi, et saltationi, ut in ipsa insit, non foris petatur
extremum, id est artis effectio. Et tamen est etiam aliqua cum his ipsis artibus
sapientiae dissimilitudo, propterea quod in illis quae recte facta sunt non
continent tamen omnes partes, e quibus constant; quae autem nos aut recta aut
recte facta dicamus, si placet, illi autem appellant κατορθώματα, omnes numeros
virtutis continent. Sola enim sapientia in se tota conversa est, quod idem in
ceteris artibus non fit. Inscite autem medicinae et gubernationis ultimum
cum ultimo sapientiae comparatur. Sapientia enim et animi magnitudinem
complectitur et iustitiam, et ut omnia, quae homini accidant, infra se esse
iudicet, quod idem ceteris artibus non contingit. Tenere autem virtutes eas
ipsas, quarum modo feci mentionem, nemo poterit, nisi statuerit nihil esse, quod
intersit aut differat aliud ab alio, praeter honesta et turpia.
Videamus nunc, quam sint praeclare illa his, quae iam posui, consequentia.
Cum enim hoc sit extremum —sentis enim, credo, me iam diu, quod τέλος Graeci
dicant, id dicere tum extremum, tum ultimum, tum summum; licebit etiam finem pro
extremo aut ultimo dicere—, cum igitur hoc sit extremum, congruenter naturae
convenienterque vivere, necessario sequitur omnes sapientes semper feliciter,
absolute, fortunate vivere, nulla re impediri, nulla prohiberi, nulla egere.
Quod autem continet non magis eam disciplinam, de qua loquor, quam vitam
fortunasque nostras, id est ut, quod honestum sit, id solum bonum iudicemus,
potest id quidem fuse et copiose et omnibus electissimis verbis gravissimisque
sententiis rhetorice et augeri et ornari, sed consectaria me Stoicorum brevia et
acuta delectant.
VIII. Concluduntur igitur eorum argumenta sic: Quod est bonum,
omne laudabile est; quod autem laudabile est, omne est honestum; bonum igitur
quod est, honestum est. Satisne hoc conclusum videtur? Certe; quod enim
efficiebatur ex iis duobus, quae erant sumpta, in eo vides esse conclusum.
Duorum autem, e quibus effecta conclusio est, contra superius dici solet non
omne bonum esse laudabile. Nam quod laudabile sit honestum esse conceditur.
Illud autem perabsurdum, bonum esse aliquid, quod non expetendum sit, aut
expetendum, quod non placens, aut, si id, non etiam diligendum; ergo et
probandum; ita etiam laudabile; id autem honestum. ita fit, ut, quod bonum
sit, id etiam honestum sit. Deinde quaero, quis aut de misera vita possit
gloriari aut de non beata. De sola igitur beata. Ex quo efficitur gloriatione,
ut ita dicam, dignam esse beatam vitam, quod non possit nisi honestae vitae iure
contingere. Ita fit, ut honesta vita beata vita sit. Et quoniam is, cui
contingit ut iure laudetur, habet insigne quiddam ad decus et ad gloriam, ut ob
ea, quae tanta sint, beatus dici iure possit, idem de vita talis viri rectissime
dicetur. Ita, si beata vita honestate cernitur, quod honestum est, id bonum
solum habendum est. Quid vero? negarine ullo modo possit <numquam>
quemquam stabili et firmo et magno animo, quem fortem virum dicimus, effici
posse, nisi constitutum sit non esse malum dolorem? ut enim qui mortem in malis
ponit non potest eam non timere, sic nemo ulla in re potest id, quod malum esse
decreverit, non curare idque contemnere. Quo posito et omnium adsensu adprobato
illud adsumitur, eum, qui magno sit animo atque forti, omnia, quae cadere in
hominem possint, despicere ac pro nihilo putare. Quae cum ita sint, effectum est
nihil esse malum, quod turpe non sit. Atque iste vir altus et excellens, magno
animo, vere fortis, infra se omnia humana ducens, is, inquam, quem efficere
volumus, quem quaerimus, certe et confidere sibi debet ac suae vitae et actae et
consequenti et bene de sese iudicare statuens nihil posse mali incidere sapienti.
Ex quo intellegitur idem illud, solum bonum esse, quod honestum sit, idque esse
beate vivere: honeste, id est cum virtute, vivere.
IX. Nec vero ignoro varias philosophorum fuisse sententias, eorum dico, qui
summum bonum, quod ultimum appello, in animo ponerent. Quae quamquam
vitiose quidam secuti sunt, tamen non modo iis tribus, qui virtutem a summo bono
segregaverunt, cum aut voluptatem aut vacuitatem doloris aut prima naturae in
summis bonis ponerent, sed etiam alteris tribus, qui mancam fore putaverunt sine
aliqua accessione virtutem ob eamque rem
trium earum rerum, quas supra dixi,
singuli singulas addiderunt,—his tamen omnibus eos antepono, cuicuimodi sunt,
qui summum bonum in animo atque in virtute posuerunt. sed sunt tamen
perabsurdi et ii, qui cum scientia vivere ultimum bonorum, et qui nullam rerum
differentiam esse dixerunt, atque ita sapientem beatum fore, nihil aliud alii
momento ullo anteponentem, <et qui>, ut quidam Academici constituisse dicuntur,
extremum bonorum et summum munus esse sapientis obsistere visis adsensusque suos
firme sustinere. His singulis copiose responderi solet, sed quae perspicua sunt
longa esse non debent. Quid autem apertius quam, si selectio nulla sit ab iis
rebus, quae contra naturam sint, earum rerum, quae sint secundum naturam, <fore
ut> tollatur omnis ea, quae quaeratur laudeturque, prudentia?
Circumscriptis igitur iis sententiis, quas posui, et iis, si quae similes earum
sunt, relinquitur ut summum bonum sit vivere scientiam adhibentem earum rerum,
quae natura eveniant, seligentem quae secundum naturam et quae contra naturam
sint reicientem, id est convenienter congruenterque naturae vivere.
Sed in ceteris artibus cum dicitur artificiose, posterum quodam modo et
consequens putandum est, quod illi ἐπιγεννηματικόν appellant; cum autem in
quo sapienter dicimus, id a primo rectissime dicitur. Quicquid enim a sapientia
proficiscitur, id continuo debet expletum esse omnibus suis partibus; in eo enim
positum est id, quod dicimus esse expetendum. Nam ut peccatum est patriam
prodere, parentes violare, fana depeculari, quae sunt in effectu, sic
timere, sic maerere, sic in libidine esse peccatum est etiam sine effectu. Verum
ut haec non in posteris et in consequentibus, sed in primis continuo peccata
sunt, sic ea, quae proficiscuntur a virtute, susceptione prima, non perfectione
recta sunt iudicanda.
X. Bonum autem, quod in hoc sermone totiens usurpatum est, id etiam
definitione explicatur. Sed eorum definitiones paulum oppido inter se differunt
et tamen eodem spectant. Ego adsentior Diogeni, qui bonum definierit id, quod
esset natura absolutum. Id autem sequens illud etiam, quod prodesset—ὠφέλημα
enim sic appellemus—, motum aut statum esse dixit
e natura absoluto. Cumque
rerum notiones in animis fiant, si aut usu aliquid cognitum sit aut coniunctione
aut similitudine aut collatione rationis, hoc quarto, quod extremum posui, boni
notitia facta est. Cum enim ab iis rebus, quae sunt secundum naturam, ascendit
animus collatione rationis, tum ad notionem boni pervenit. hoc autem ipsum
bonum non accessione neque crescendo aut cum ceteris comparando, sed propria vi
sua et sentimus et appellamus bonum. Ut enim mel, etsi dulcissimum est, suo
tamen proprio genere saporis, non comparatione cum aliis dulce esse
sentitur, sic bonum hoc, de quo agimus, est illud quidem plurimi aestimandum,
sed ea aestimatio genere valet, non magnitudine. Nam cum aestimatio, quae ἀξία
dicitur, neque in bonis numerata sit nec rursus in malis, quantumcumque eo
addideris, in suo genere manebit. Alia est igitur propria aestimatio virtutis,
quae genere, non crescendo valet. Nec vero perturbationes animorum, quae
vitam insipientium miseram acerbamque reddunt, quas Graeci πάθη appellant—poteram
ego verbum ipsum interpretans morbos appellare, sed non conveniret ad omnia;
quis enim misericordiam aut ipsam iracundiam morbum solet dicere? At illi dicunt
πάθος. Sit igitur perturbatio, quae nomine ipso vitiosa declarari videtur nec
eae perturbationes vi aliqua naturali moventur. Omnesque eae sunt genere
quattuor, partibus plures, aegritudo, formido, libido, quamque Stoici communi
nomine corporis et animi ἡδονήν appellant, ego malo laetitiam appellare, quasi
gestientis animi elationem voluptariam. Perturbationes autem nulla naturae vi
commoventur, omniaque ea sunt opiniones ac iudicia levitatis. Itaque his sapiens
semper vacabit.
XI. Omne autem, quod honestum sit, id esse propter se expetendum commune
nobis est cum multorum aliorum philosophorum sententiis. Praeter enim tres
disciplinas, quae virtutem a summo bono excludunt, ceteris omnibus philosophis
haec est tuenda sententia, maxime tamen his Stoicis, qui nihil aliud in bonorum
numero nisi honestum esse voluerunt. Sed haec quidem est perfacilis et
perexpedita defensio. Quis est enim, aut quis umquam fuit aut avaritia tam
ardenti aut tam effrenatis cupiditatibus, ut eandem illam rem, quam adipisci
scelere quovis velit, non multis partibus malit ad sese etiam omni inpunitate
proposita sine facinore quam illo modo pervenire? quam vero utilitatem aut
quem fructum petentes scire cupimus illa, quae occulta nobis sunt, quo modo
moveantur quibusque de causis ea <quae> versantur in caelo? Quis autem tam
agrestibus institutis vivit, aut quis <se> contra studia naturae tam vehementer
obduravit, ut a rebus cognitione dignis abhorreat easque sine voluptate aut
utilitate aliqua non requirat et pro nihilo putet? Aut quis est, qui maiorum,
aut Africanorum aut eius, quem tu in ore semper habes, proavi mei, ceterorumque
virorum fortium atque omni virtute praestantium facta, dicta, consilia
cognoscens nulla animo afficiatur voluptate? quis autem honesta in familia
institutus et educatus ingenue non ipsa turpitudine, etiamsi eum laesura non sit,
offenditur? Quis animo aequo videt eum, quem inpure ac flagitiose putet vivere?
Quis non odit sordidos, vanos, leves, futtiles? Quid autem dici poterit, si
turpitudinem non ipsam per se fugiendam esse statuemus, quo minus homines
tenebras et solitudinem nacti nullo dedecore se abstineant, nisi eos per se
foeditate sua turpitudo ipsa deterreat? Innumerabilia dici possunt in hanc
sententiam, sed non necesse est. Nihil est enim, de quo minus dubitari possit,
quam et honesta expetenda per se et eodem modo turpia per se esse fugienda.
Constituto autem illo, de quo ante diximus, quod honestum esset, id esse
solum bonum, intellegi necesse est pluris id, quod honestum sit, aestimandum
esse quam illa media, quae ex eo comparentur. Stultitiam autem et timiditatem et
iniustitiam et intemperantiam cum dicimus esse fugiendas propter eas res,
quae ex ipsis eveniant, non ita dicimus, ut cum illo, quod positum est, solum id
esse malum, quod turpe sit, haec pugnare videatur oratio, propterea quod ea non
ad corporis incommodum referuntur, sed ad turpes actiones, quae oriuntur e
vitiis. Quas enim κακίας Graeci appellant, vitia malo quam malitias nominare.
XII. Ne tu, inquam, Cato, verbis illustribus et id, quod vis, declarantibus!
itaque mihi videris Latine docere philosophiam et ei quasi civitatem dare. Quae
quidem adhuc peregrinari Romae videbatur nec offerre sese nostris sermonibus, et
ista maxime propter limatam quandam et rerum et verborum tenuitatem.
Scio enim
esse quosdam, qui quavis lingua philosophari possint; nullis enim partitionibus,
nullis definitionibus utuntur ipsique dicunt ea se modo probare, quibus natura
tacita adsentiatur. Itaque in rebus minime obscuris non multus est apud eos
disserendi labor. Quare attendo te studiose et, quaecumque rebus iis, de quibus
hic sermo est, nomina inponis, memoriae mando; mihi enim erit isdem istis
fortasse iam utendum. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad
consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Quod enim vituperabile
est per se ipsum, id eo ipso vitium nominatum puto, vel etiam a vitio dictum
vituperari. Sin κακίαν malitiam dixisses, ad aliud nos unum certum vitium
consuetudo Latina traduceret. Nunc omni virtuti vitium contrario nomine
opponitur.
Tum ille: His igitur ita positis, inquit, sequitur magna contentio, quam
tractatam a Peripateticis mollius—est enim eorum consuetudo dicendi non satis
acuta propter ignorationem dialecticae—Carneades tuus egregia quadam
exercitatione in dialecticis summaque eloquentia rem in summum discrimen adduxit,
propterea quod pugnare non destitit in omni hac quaestione, quae de bonis et
malis appelletur, non esse rerum Stoicis cum Peripateticis controversiam, sed
nominum. Mihi autem nihil tam perspicuum videtur, quam has sententias eorum
philosophorum re inter se magis quam verbis dissidere; maiorem multo inter
Stoicos et Peripateticos rerum esse aio discrepantiam quam verborum, quippe cum
Peripatetici omnia, quae ipsi bona appellant, pertinere dicant ad beate vivendum,
nostri non ex omni, quod aestimatione aliqua dignum sit, compleri vitam beatam
putent.
XIII. An vero certius quicquam potest esse quam illorum ratione, qui dolorem
in malis ponunt, non posse sapientem beatum esse, cum eculeo torqueatur? Eorum
autem, qui dolorem in malis non habent, ratio certe cogit ut in omnibus
tormentis conservetur beata vita sapienti. Etenim si dolores eosdem tolerabilius
patiuntur qui excipiunt eos pro patria quam qui leviore de causa, opinio facit,
non natura, vim doloris aut maiorem aut minorem. Ne illud quidem est
consentaneum, ut, si, cum tria genera bonorum sint, quae sententia est
Peripateticorum, eo beatior quisque sit, quo sit corporis aut externis bonis
plenior, ut hoc idem adprobandum sit nobis, ut, qui plura habeat ea, quae in
corpore magni aestimantur, sit beatior. Illi enim corporis commodis compleri
vitam beatam putant, nostri nihil minus. Nam cum ita placeat, ne eorum quidem
bonorum, quae nos bona vere appellemus, frequentia beatiorem vitam fieri
aut magis expetendam aut pluris aestimandam, certe minus ad beatam vitam
pertinet multitudo corporis commodorum. etenim, si et sapere expetendum
sit et valere, coniunctum utrumque magis expetendum sit quam sapere solum, neque
tamen, si utrumque sit aestimatione dignum, pluris sit coniunctum quam sapere
ipsum separatim. Nam qui valitudinem aestimatione aliqua dignam iudicamus neque
eam tamen in bonis ponimus, idem censemus nullam esse tantam aestimationem, ut
ea virtuti anteponatur. Quod idem Peripatetici non tenent, quibus dicendum est,
quae et honesta actio sit et sine dolore, eam magis esse expetendam, quam si
esset eadem actio cum dolore. Nobis aliter videtur, recte secusne, postea; sed
potestne rerum maior esse dissensio?
XIV. Ut enim obscuratur et offunditur luce solis lumen lucernae, et ut
interit <in> magnitudine maris Aegaei stilla mellis, et ut in divitiis Croesi
teruncii accessio et gradus unus in ea via, quae est hinc in Indiam, sic, cum
sit is bonorum finis, quem Stoici dicunt, omnis ista rerum corporearum
aestimatio splendore virtutis et magnitudine obscuretur et obruatur atque
intereat necesse est. Et quem ad modum oportunitas—sic enim appellemus εὐκαιρίαν—non
fit maior productione temporis—habent enim suum modum, quae oportuna dicuntur—,
sic recta effectio—κατόρθωσιν enim ita appello, quoniam rectum factum κατόρθωμα—,
recta igitur effectio, item convenientia, denique ipsum bonum, quod in eo
positum est, ut naturae consentiat, crescendi accessionem nullam habet.
ut enim oportunitas illa, sic haec, de quibus dixi, non fiunt temporis
productione maiora, ob eamque causam Stoicis non videtur optabilior nec magis
expetenda beata vita, si sit longa, quam si brevis, utunturque simili: ut, si
cothurni laus illa esset, ad pedem apte convenire, neque multi cothurni paucis
anteponerentur nec maiores minoribus, sic, quorum omne bonum convenientia atque
oportunitate finitur, nec plura paucioribus nec longinquiora brevioribus
anteponent. Nec vero satis acute dicunt: si bona valitudo pluris
aestimanda sit longa quam brevis, sapientiae quoque usus longissimus quisque sit
plurimi. Non intellegunt valitudinis aestimationem spatio iudicari, virtutis
oportunitate, ut videantur qui illud dicant idem hoc esse dicturi, bonam mortem
et bonum partum meliorem longum esse quam brevem. Non vident alia brevitate
pluris aestimari, alia diuturnitate. itaque consentaneum est his, quae
dicta sunt, ratione illorum, qui illum bonorum finem, quod appellamus extremum,
quod ultimum, crescere putent posse—isdem placere esse alium alio et
sapientiorem itemque alium magis alio vel peccare vel recte facere, quod nobis
non licet dicere, qui crescere bonorum finem non putamus. Ut enim qui demersi
sunt in aqua nihilo magis respirare possunt, si non longe absunt a summo, ut iam
iamque possint emergere, quam si etiam tum essent in profundo, nec catulus ille,
qui iam adpropinquat ut videat, plus cernit quam is, qui modo est natus, item
qui processit aliquantum ad virtutis habitum nihilo minus in miseria est quam
ille, qui nihil processit.
XV. Haec mirabilia videri intellego, sed cum certe superiora firma ac vera sint,
his autem ea consentanea et consequentia, ne de horum quidem est veritate
dubitandum. Sed quamquam negant nec virtutes nec vitia crescere, tamen utrumque
eorum fundi quodam modo et quasi dilatari putant. -
Divitias autem Diogenes censet eam modo vim habere, ut quasi duces sint ad
voluptatem et ad valitudinem bonam; sed, etiam uti ea contineant, non idem
facere eas in virtute neque in ceteris artibus, ad quas esse dux pecunia potest,
continere autem non potest, itaque, si voluptas aut si bona valitudo sit in
bonis, divitias quoque in bonis esse ponendas, at, si sapientia bonum sit, non
sequi ut etiam divitias bonum esse dicamus. Neque ab ulla re, quae non sit in
bonis, id, quod sit in bonis, contineri potest, ob eamque causam, quia
cognitiones comprehensionesque rerum, e quibus efficiuntur artes, adpetitionem
movent, cum divitiae non sint in bonis, nulla ars divitiis contineri potest.
quod si de artibus concedamus, virtutis tamen non sit eadem ratio, propterea
quod haec plurimae commentationis et exercitationis indigeat, quod idem in
artibus non sit, et quod virtus stabilitatem, firmitatem, constantiam totius
vitae complectatur, nec haec eadem in artibus esse videamus.
Deinceps explicatur differentia rerum, quam si non ullam esse diceremus,
confunderetur omnis vita, ut ab Aristone, neque ullum sapientiae munus aut opus
inveniretur, cum inter res eas, quae ad vitam degendam pertinerent, nihil omnino
interesset, neque ullum dilectum adhiberi oporteret. Itaque cum esset satis
constitutum id solum esse bonum, quod esset honestum, et id malum solum,
quod turpe, tum inter illa, quae nihil valerent ad beate misereve vivendum,
aliquid tamen, quod differret, esse voluerunt, ut essent eorum alia aestimabilia,
alia contra, alia neutrum. quae autem aestimanda essent, eorum in aliis
satis esse causae, quam ob rem quibusdam anteponerentur, ut in valitudine, ut in
integritate sensuum, ut in doloris vacuitate, ut gloriae, divitiarum, similium
rerum, alia autem non esse eius modi, itemque eorum, quae nulla aestimatione
digna essent, partim satis habere causae, quam ob rem reicerentur, ut dolorem,
morbum, sensuum amissionem, paupertatem, ignominiam, similia horum, partim non
item. Hinc est illud exortum, quod Zeno προηγμένον, contraque quod ἀποπροηγμένον
nominavit, cum uteretur in lingua copiosa factis tamen nominibus ac novis, quod
nobis in hac inopi lingua non conceditur; quamquam tu hanc copiosiorem etiam
soles dicere. Sed non alienum est, quo facilius vis verbi intellegatur, rationem
huius verbi faciendi Zenonis exponere.
XVI. Ut enim, inquit, nemo dicit in regia regem ipsum quasi productum esse ad
dignitatem (id est enim προηγμένον), sed eos, qui in aliquo honore sunt, quorum
ordo proxime accedit, ut secundus sit, ad regium principatum, sic in vita non ea,
quae primo loco sunt, sed ea, quae secundum locum optinent, προηγμένα, id est
producta, nominentur; quae vel ita appellemus—id erit verbum e verbo—vel
promota et remota vel, ut dudum diximus, praeposita vel praecipua, et illa
reiecta. Re enim intellecta in verborum usu faciles esse debemus. quoniam
autem omne, quod est bonum, primum locum tenere dicimus, necesse est nec bonum
esse nec malum hoc, quod praepositum vel praecipuum nominamus. Idque ita
definimus; quod sit indifferens cum aestimatione mediocri; quod enim illi
ἀδιάφορον dicunt, id mihi ita occurrit, ut indifferens dicerem. Neque enim illud
fieri poterat ullo modo, ut nihil relinqueretur in mediis, quod aut secundum
naturam esset aut contra, nec, cum id relinqueretur, nihil in his poni, quod
satis aestimabile esset, nec hoc posito non aliqua esse praeposita. Recte igitur
haec facta distinctio est, atque etiam ab iis, quo facilius res perspici possit,
hoc simile ponitur: Ut enim, inquiunt, si hoc fingamus esse quasi finem et
ultimum, ita iacere talum, ut rectus adsistat, qui ita talus erit iactus, ut
cadat rectus, praepositum quiddam habebit ad finem, qui aliter, contra, neque
tamen illa praepositio tali ad eum, quem dixi, finem pertinebit, sic ea, quae
sunt praeposita, referuntur illa quidem ad finem, sed ad eius vim naturamque
nihil pertinent.
Sequitur illa divisio, ut bonorum alia sint ad illud
ultimum pertinentia (sic enim appello, quae τελικά dicuntur; nam hoc ipsum
instituamus, ut placuit, pluribus verbis dicere, quod uno non poterimus, ut res
intellegatur), alia autem efficientia, quae Graeci ποιητικά, alia utrumque. De
pertinentibus nihil est bonum praeter actiones honestas, de efficientibus nihil
praeter amicum, sed et pertinentem et efficientem sapientiam volunt esse. Nam
quia sapientia est conveniens actio, est <in> illo pertinenti genere, quod
dixi; quod autem honestas actiones adfert et efficit, id efficiens dici potest.
XVII. Haec, quae praeposita dicimus, partim sunt per se ipsa praeposita,
partim quod aliquid efficiunt, partim utrumque, per se, ut quidam habitus oris
et vultus, ut status, ut motus, in quibus sunt et praeponenda quaedam et
reicienda; alia ob eam rem praeposita dicentur, quod ex se aliquid efficiant, ut
pecunia, alia autem ob utramque rem, ut integri sensus, ut bona valitudo.
De bona autem fama—quam enim appellant εὐδοξίαν, aptius est bonam famam hoc loco
appellare quam gloriam—Chrysippus quidem et Diogenes detracta utilitate ne
digitum quidem eius causa porrigendum esse dicebant; quibus ego vehementer
assentior. Qui autem post eos fuerunt, cum Carneadem sustinere non possent, hanc,
quam dixi, bonam famam ipsam propter se praepositam et sumendam esse dixerunt,
esseque hominis ingenui et liberaliter educati velle bene audire a parentibus, a
propinquis, a bonis etiam viris, idque propter rem ipsam, non propter usum,
dicuntque, ut liberis consultum velimus, etiamsi postumi futuri sint, propter
ipsos, sic futurae post mortem famae tamen esse propter rem, etiam detracto usu,
consulendum.
Sed cum, quod honestum sit, id solum bonum esse dicamus, consentaneum
tamen est fungi officio, cum id officium nec in bonis ponamus nec in malis. Est
enim aliquid in his rebus probabile, et quidem ita, ut eius ratio reddi possit,
ergo ut etiam probabiliter acti ratio reddi possit. Est autem officium, quod ita
factum est, ut eius facti probabilis ratio reddi possit. Ex quo intellegitur
officium medium quiddam esse, quod neque in bonis ponatur neque in contrariis.
Quoniamque in iis rebus, quae neque in virtutibus sunt neque in vitiis,
est tamen quiddam, quod usui possit esse, tollendum id non est. Est autem eius
generis actio quoque quaedam, et quidem talis, ut ratio postulet agere aliquid
et facere eorum. Quod autem ratione actum est, id officium appellamus. Est
igitur officium eius generis, quod nec in bonis ponatur nec in contrariis.
XVIII. Atque perspicuum etiam illud est, in istis rebus mediis aliquid agere
sapientem. Iudicat igitur, cum agit, officium illud esse. Quod quoniam numquam
fallitur in iudicando, erit in mediis rebus officium. Quod efficitur hac etiam
conclusione rationis: Quoniam enim videmus esse quiddam, quod recte factum
appellemus, id autem est perfectum officium, erit autem etiam inchoatum, ut, si
iuste depositum reddere in recte factis sit, in officiis ponatur depositum
reddere; illo enim addito “iuste” fit recte factum, per se autem hoc ipsum
reddere in officio ponitur. Quoniamque non dubium est quin in iis, quae media
dicimus, sit aliud sumendum, aliud reiciendum, quicquid ita fit aut dicitur,
omne officio continetur. Ex quo intellegitur, quoniam se ipsi omnes natura
diligant, tam insipientem quam sapientem sumpturum, quae secundum naturam sint,
reiecturumque contraria. Ita est quoddam commune officium sapientis et
insipientis, ex quo efficitur versari in iis, quae media dicamus.
Sed cum ab his omnia proficiscantur officia, non sine causa dicitur ad ea
referri omnes nostras cogitationes, in his et excessum e vita et in vita
mansionem. In quo enim plura sunt quae secundum naturam sunt, huius officium est
in vita manere; in quo autem aut sunt plura contraria aut fore videntur,
huius officium est de vita excedere. Ex quo apparet et sapientis esse aliquando
officium excedere e vita, cum beatus sit, et stulti manere in vita, cum sit
miser. nam bonum illud et malum, quod saepe iam dictum est, postea
consequitur, prima autem illa naturae sive secunda sive contraria sub iudicium
sapientis et dilectum cadunt, estque illa subiecta quasi materia sapientiae.
Itaque et manendi in vita et migrandi ratio omnis iis rebus, quas supra dixi,
metienda. Nam neque virtute retinetur <ille> in vita, nec iis, qui sine virtute
sunt, mors est oppetenda. Et saepe officium est sapientis desciscere a vita, cum
sit beatissimus, si id oportune facere possit, quod est convenienter naturae.
Sic enim censent, oportunitatis esse beate vivere. Itaque a sapientia
praecipitur se ipsam, si usus sit, sapiens ut relinquat. Quam ob rem cum
vitiorum ista vis non sit, ut causam afferant mortis voluntariae, perspicuum est
etiam stultorum, qui idem miseri sint, officium esse manere in vita, si sint in
maiore parte rerum earum, quas secundum naturam esse dicimus. Et quoniam
excedens e vita et manens aeque miser est nec diuturnitas magis ei vitam
fugiendam facit, non sine causa dicitur iis, qui pluribus naturalibus frui
possint, esse in vita manendum.
XIX. Pertinere autem ad rem arbitrantur intellegi natura fieri ut liberi a
parentibus amentur. A quo initio profectam communem humani generis societatem
persequimur. Quod primum intellegi debet figura membrisque corporum, quae ipsa
declarant procreandi a natura habitam esse rationem. Neque vero haec inter se
congruere possent, ut natura et procreari vellet et diligi procreatos non
curaret. Atque etiam in bestiis vis naturae perspici potest; quarum in
fetu et in educatione laborem cum cernimus, naturae ipsius vocem videmur audire.
Quare <ut> perspicuum est natura nos a dolore abhorrere, sic apparet a natura
ipsa, ut eos, quos genuerimus, amemus, inpelli. ex hoc nascitur ut etiam
communis hominum inter homines naturalis sit commendatio, ut oporteat hominem ab
homine ob id ipsum, quod homo sit, non alienum videri. Ut enim in membris alia
sunt tamquam sibi nata, ut oculi, ut aures, alia etiam ceterorum membrorum usum
adiuvant, ut crura, ut manus, sic inmanes quaedam bestiae sibi solum natae sunt,
at illa, quae in concha patula pina dicitur, isque, qui enat e concha, qui, quod
eam custodit, pinoteres vocatur in eandemque cum se recepit includitur, ut
videatur monuisse ut caveret, itemque formicae, apes, ciconiae aliorum etiam
causa quaedam faciunt. Multo haec coniunctius homines. Itaque natura sumus apti
ad coetus, concilia, civitates. mundum autem censent regi numine deorum,
eumque esse quasi communem urbem et civitatem hominum et deorum, et unum quemque
nostrum eius mundi esse partem; ex quo illud natura consequi, ut communem
utilitatem nostrae anteponamus. Ut enim leges omnium salutem singulorum saluti
anteponunt, sic vir bonus et sapiens et legibus parens et civilis officii non
ignarus utilitati omnium plus quam unius alicuius aut suae consulit. Nec magis
est vituperandus proditor patriae quam communis utilitatis aut salutis desertor
propter suam utilitatem aut salutem. Ex quo fit, ut laudandus is sit, qui mortem
oppetat pro re publica, quod deceat cariorem nobis esse patriam quam
nosmet ipsos. Quoniamque illa vox inhumana et scelerata ducitur eorum, qui
negant se recusare quo minus ipsis mortuis terrarum omnium deflagratio
consequatur—quod vulgari quodam versu Graeco pronuntiari solet—, certe verum est
etiam iis, qui aliquando futuri sint, esse propter ipsos consulendum.
XX. Ex
hac animorum affectione testamenta commendationesque morientium natae sunt.
Quodque nemo in summa solitudine vitam agere velit ne cum infinita quidem
voluptatum abundantia, facile intellegitur nos ad coniunctionem
congregationemque hominum et ad naturalem communitatem esse natos. Inpellimur
autem natura, ut prodesse velimus quam plurimis in primisque docendo
rationibusque prudentiae tradendis. itaque non facile est invenire qui
quod sciat ipse non tradat alteri; ita non solum ad discendum propensi sumus,
verum etiam ad docendum. Atque ut tauris natura datum est ut pro vitulis contra
leones summa vi impetuque contendant, sic ii, qui valent opibus atque id facere
possunt, ut de Hercule et de Libero accepimus, ad servandum genus hominum natura
incitantur. Atque etiam Iovem cum Optimum et Maximum dicimus cumque
eundem
Salutarem, Hospitalem, Statorem, hoc intellegi volumus, salutem hominum in eius
esse tutela. Minime autem convenit, cum ipsi inter nos viles neglectique simus,
postulare ut diis inmortalibus cari simus et ab iis diligamur. Quem ad modum
igitur membris utimur prius, quam didicimus, cuius ea causa utilitatis habeamus,
sic inter nos natura ad civilem communitatem coniuncti et consociati sumus. Quod
ni ita se haberet, nec iustitiae ullus esset nec bonitati locus. Et quo
modo hominum inter homines iuris esse vincula putant, sic homini nihil iuris
esse cum bestiis. Praeclare enim Chrysippus, cetera nata esse hominum causa
et deorum, eos autem communitatis et societatis suae, ut bestiis homines uti ad
utilitatem suam possint sine iniuria. Quoniamque ea natura esset hominis, ut ei
cum genere humano quasi civile ius intercederet, qui id conservaret, eum iustum,
qui migraret, iniustum fore. Sed quem ad modum, theatrum cum commune sit, recte
tamen dici potest eius esse eum locum, quem quisque occuparit, sic in urbe
mundove communi non adversatur ius, quo minus suum quidque cuiusque sit.
Cum autem ad tuendos conservandosque homines hominem natum esse videamus,
consentaneum est huic naturae, ut sapiens velit gerere et administrare rem
publicam atque, ut e natura vivat, uxorem adiungere et velle ex ea liberos. Ne
amores quidem sanctos a sapiente alienos esse arbitrantur.
Cynicorum autem
rationem atque vitam alii cadere in sapientem dicunt, si qui eius modi forte
casus inciderit, ut id faciendum sit, alii nullo modo.
XXI. Ut vero conservetur omnis homini erga hominem societas, coniunctio,
caritas, et emolumenta et detrimenta, quae ὠφελήματα et βλάμματα appellant,
communia esse voluerunt; quorum altera prosunt, nocent altera. Neque solum ea
communia, verum etiam paria esse dixerunt. Incommoda autem et commoda—ita enim
εὐχρηστήματα et δυσχρηστήματα appello—communia esse voluerunt, paria noluerunt.
Illa enim, quae prosunt aut quae nocent, aut bona sunt aut mala, quae sint paria
necesse est. Commoda autem et incommoda in eo genere sunt, quae praeposita et
reiecta diximus; ea possunt paria non esse. Sed emolumenta communia esse
dicuntur, recte autem facta et peccata non habentur communia.
Amicitiam autem adhibendam esse censent, quia sit ex eo genere, quae
prosunt. Quamquam autem in amicitia alii dicant aeque caram esse sapienti
rationem amici ac suam, alii autem sibi cuique cariorem suam, tamen hi quoque
posteriores fatentur alienum esse a iustitia, ad quam nati esse videamur,
detrahere quid de aliquo, quod sibi adsumat. Minime vero probatur huic
disciplinae, de qua loquor, aut iustitiam aut amicitiam propter utilitates
adscisci aut probari. Eaedem enim utilitates poterunt eas labefactare atque
pervertere. Etenim nec iustitia nec amicitia esse omnino poterunt, nisi ipsae
per se expetuntur.
Ius autem, quod ita dici appellarique possit, id esse natura, alienumque
esse a sapiente non modo iniuriam cui facere, verum etiam nocere. Nec vero
rectum est cum amicis aut bene meritis consociare aut coniungere iniuriam,
gravissimeque et verissime defenditur numquam aequitatem ab utilitate posse
seiungi, et quicquid aequum iustumque esset, id etiam honestum vicissimque,
quicquid esset honestum, id iustum etiam atque aequum fore.
Ad easque virtutes, de quibus disputatum est, dialecticam etiam adiungunt
et physicam, easque ambas virtutum nomine appellant, alteram, quod habeat
rationem, ne cui falso adsentiamur neve umquam captiosa probabilitate fallamur,
eaque, quae de bonis et malis didicerimus, ut tenere tuerique possimus. Nam sine
hac arte quemvis arbitrantur a vero abduci fallique posse. Recte igitur, si
omnibus in rebus temeritas ignoratioque vitiosa est, ars ea, quae tollit haec,
virtus nominata est.
XXII. Physicae quoque non sine causa tributus idem est
honos, propterea quod, qui convenienter naturae victurus sit, ei
proficiscendum est ab omni mundo atque ab eius procuratione. Nec vero potest
quisquam de bonis et malis vere iudicare nisi omni cognita ratione naturae et
vitae etiam deorum, et utrum conveniat necne natura hominis cum universa.
Quaeque sunt vetera praecepta sapientium, qui iubent tempori parere et sequi
deum et se noscere et nihil nimis, haec sine physicis quam vim habeant—et habent
maximam— videre nemo potest. Atque etiam ad iustitiam colendam, ad tuendas
amicitias et reliquas caritates quid natura valeat haec una cognitio potest
tradere. Nec vero pietas adversus deos nec quanta iis gratia debeatur sine
explicatione naturae intellegi potest.
Sed iam sentio me esse longius provectum, quam proposita ratio postularet.
Verum admirabilis compositio disciplinae incredibilisque rerum me traxit ordo;
quem, per deos inmortales! nonne miraris? Quid enim aut in natura, qua nihil est
aptius, nihil descriptius, aut in operibus manu factis tam compositum tamque
compactum et coagmentatum inveniri potest? Quid posterius priori non convenit?
Quid sequitur, quod non respondeat superiori? Quid non sic aliud ex alio
nectitur, ut, si ullam litteram moveris, labent omnia? Nec tamen quicquam est,
quod moveri possit. quam gravis vero, quam magnifica, quam constans
conficitur persona sapientis! qui, cum ratio docuerit, quod honestum esset, id
esse solum bonum, semper sit necesse est beatus vereque omnia ista nomina
possideat, quae irrideri ab inperitis solent. Rectius enim appellabitur
rex quam Tarquinius, qui nec se nec suos regere potuit, rectius magister populi—is
enim est dictator—quam Sulla, qui trium pestiferorum vitiorum, luxuriae,
avaritiae, crudelitatis, magister fuit, rectius dives quam Crassus, qui nisi
eguisset, numquam Euphraten nulla belli causa transire voluisset. Recte eius
omnia dicentur, qui scit uti solus omnibus, recte etiam pulcher appellabitur—
animi enim liniamenta sunt pulchriora quam corporis—, recte solus liber nec
dominationi cuiusquam parens nec oboediens cupiditati, recte invictus, cuius
etiamsi corpus constringatur, animo tamen vincula inici nulla possint, nec
expectet ullum tempus aetatis, uti tum denique iudicetur beatusne fuerit, cum
extremum vitae diem morte confecerit, quod ille unus e septem sapientibus non
sapienter Croesum monuit; nam si beatus umquam fuisset, beatam vitam usque
ad illum a Cyro extructum rogum pertulisset. Quod si ita est, ut neque quisquam
nisi bonus vir et omnes boni beati sint, quid philosophia magis colendum aut
quid est virtute divinius?
|
540
LIVRE TROISIÈME
I. Je crois, Brutus, que si la volupté plaidait elle-même sa cause,
et n'avait pas de si opiniâtres défenseurs, elle s'avouerait vaincue
par mon dernier livre et s'inclinerait devant la dignité de son
adversaire. Il y aurait en effet trop d'impudence à elle de disputer
davantage contre la vertu, de préférer l'agréable à l'honnête, et de
soutenir que la sensualité des plaisirs du corps est au-dessus de la
noblesse de l'âme et de la dignité de la vie. Mettons-la donc hors
de cause en lui ordonnant de se tenir dans ses bornes, de peur que
par ses caresses et ses charmes, elle ne divertisse notre esprit du
but élevé qu'il poursuit maintenant. Cherchons donc où est ce
souverain bien que nous nous sommes proposé de découvrir, et qui ne
consiste ni dans la volupté, comme nous l'avons fait voir, ni dans
l'absence de la douleur, contre laquelle on pourrait diriger à peu
près les mêmes objections. On ne peut d'ailleurs reconnaître le
souverain bien où la vertu n'est pas, car il n'y a rien de plus
excellent au monde. Or, quoique j'aie employé quelque nerf dans ma
discussion avec Torquatus, il faut encore plus de force et de
vigueur dans la réfutation que je vais entreprendre de la doctrine
stoïcienne. Dans tout ce que l'on peut dire de la volupté, il n'est
rien de bien subtil ni de bien profond; ceux qui en soutiennent la
cause, sont loin d'être rompus dans ces sortes de controverses; et
ceux qui la combattent, s'attaquent à un ennemi peu redoutable.
Épicure dit lui-même qu'il ne faut pas raisonner sur la volupté,
parce que c'est aux sens à en juger et qu'un peu d'expérience nous
en apprend plus sur elle que tous les arguments imaginables. Aussi
notre dispute entre Torquatus et moi a été toute simple; il n'y a
rien eu d'obscur ni d'embarrassé dans ce qu'il a dit, et il me
semble que tout ce que je lui ai répondu est d'une clarté parfaite.
Vous savez combien au contraire la manière de disputer des stoïciens
est obscure ou plutôt épineuse, même pour les Grecs, et à plus forte
raison pour nous autres Romains
541
qui avons de plus l'embarras de faire notre langue et de
donner à de nouvelles choses des noms nouveaux. C'est de quoi
cependant ne s'étonnera aucun esprit un peu cultivé, qui fera
réflexion qu'en toute espèce d'art dont l'usage n'est pas
généralement répandu et populaire, il y a beaucoup de mots nouveaux;
car il faut bien qu'un art donne des noms aux objets dont il traite.
De là vient que les dialecticiens et les physiciens se servent de
termes inconnus au reste des Grecs. Les géomètres, les musiciens et
les grammairiens ont aussi leur langue à part. La rhétorique
elle-même, qui est faite pour descendre dans le forum et parler à
tout le peuple, se sert dans son enseignement de termes qui lui sont
propres.
II. Et sans parler davantage des arts libéraux, les ouvriers
eux-mêmes pourraient-ils faire quelque chose dans leurs métiers,
s'ils ne se servaient de mots que nous ne connaissons point et qui
ne sont en usage que parmi eux? L'agriculture elle-même, qui est si
éloignée de toute espèce d'éloquence, à mesure qu'elle a découvert
quelque chose de nouveau, l'a exprimé par de nouveaux termes. Le
philosophe doit donc avec plus de fondement encore imiter ces
exemples; car la philosophie est l'art de la vie, et pour en bien
traiter, ce n'est certes pas sur la place publique qu'il faut venir
chercher ses expressions. Or, de tous les philosophes, les stoïciens
sont ceux qui ont fait le plus de mots nouveaux; et on peut dire de
Zénon leur chef, qu'il a plutôt inventé des mots que des choses. Que
si dans une langue qui passe pour plus abondante que la nôtre, la
Grèce n'a pas trouvé mauvais que de très savants hommes, ayant à
parler de choses peu connues du vulgaire, se servissent de termes
inusités, à combien plus forte raison doit-on avoir une pareille
indulgence pour nous qui osons traiter pour la première fois de tels
sujets dans notre langue. Cependant je l'ai dit souvent, et cette
déclaration a excité les murmures non seulement des Grecs, mais
encore de ceux qui veulent passer plutôt pour Grecs que pour
Romains. Notre langue, loin d'être inférieure à la langue grecque en
richesse d'expressions, a même la supériorité sur elle. Ce que je
disais, il faut maintenant essayer de le prouver, non plus seulement
dans les arts qui nous appartiennent en propre, mais dans ceux mêmes
que la Grèce revendique. Car à l'égard de certains termes dont nos
ancêtres ont accrédité l'usage parmi nous, comme, par exemple, ceux
de Philosophie, Rhétorique, Dialectique, Géométrie, Musique, quoique
nous eussions pu les rendre par des expressions latines, je les
regarde cependant comme nôtres, parce que le temps les a naturalisés
parmi nous. Voilà ce que j'avais à dire touchant les termes dont je
me sers; quant aux choses mêmes, j'appréhende quelquefois, Brutus,
qu'on ne me blâme de vous écrire sur des matières de philosophie, à
vous qui vous êtes avancé si loin dans la plus parfaite des
philosophies. Et véritablement, si je le faisais dans la vue de vous
apprendre quelque chose, on aurait sujet de me blâmer; mais je suis
bien éloigné de le prétendre; et quand je vous écris sur de telles
matières, ce n'est pas pour vous instruire de ce que vous savez on
ne peut mieux; mais c'est que j'aime à m'entretenir avec vous et que
je vous regarde comme le meilleur juge de tous les travaux qui se
rattachent à 542 nos communes
études. Prêtez-moi donc, comme toujours, votre bienveillante
attention, et prononcez sur une controverse qui s'est élevée un jour
entre moi et votre oncle, cet homme admirable et divin.
J'étais à Tusculum, et désirant me servir de quelques livres du
jeune Lucullus, je vins chez lui pour les prendre dans sa
bibliothèque, comme j'en avais l'usage. J'y trouvai M. Caton que je
ne m'attendais pas à rencontrer; il était assis et tout entouré de
livres stoïciens. Vous savez qu'il avait une avidité insatiable de
lecture, jusque-là que, dans le sénat même et pendant que les
sénateurs s'assemblaient, il se mettait à lire, sans se soucier des
vaines rumeurs qu'il exciterait dans le public, et sans dérober
pourtant un seul des instants qu'il devait aux intérêts de l'État.
Aussi, jouissant alors d'un loisir complet, et se trouvant dans une
si riche bibliothèque, il semblait, si l'on peut se servir d'une
comparaison aussi peu noble, vouloir dévorer les livres. Nous étant
donc ainsi rencontrés tous deux sans y songer, il se leva aussitôt.
Nous échangeâmes ensuite ces premières questions que l'on se fait
d'ordinaire lorsqu'on se revoit. Qui vous amène ici? me dit-il; vous
venez sans doute de votre campagne. Si j'avais pensé que vous y
fussiez, j'aurais certainement été vous y rendre visite. – Hier, lui
dis-je, dès que les jeux furent commencés, je quittai la ville, et
j'arrivai le soir chez moi. Ce qui m'a amené ici, c'est que j'y suis
venu chercher quelques livres; voilà bien des trésors assemblés,
Caton, et il faudra que notre jeune Lucullus les connaisse
parfaitement un jour. Car j'aimerais mieux qu'il prît plaisir à ces
livres qu'à toutes les autres beautés de ce séjour, et j'ai son
éducation fort à cœur, quoiqu'elle vous appartienne plus qu'à
personne, et que ce soit à vous de le rendre digne de son père, de
notre Cépion et de vous-même qui le touchez de si près. Mais ce
n'est pas sans sujet que je m'intéresse à ce qui le regarde; j'y
suis obligé par le souvenir de son aïeul Cépion, que j'ai toujours
tenu en grande estime comme vous le savez, et qui, selon moi, serait
maintenant un des premiers hommes de la république, s'il vivait; et
j'ai continuellement devant les yeux Lucullus, ce modèle accompli, à
qui les liens de l'amitié et une communauté parfaite de sentiments
et de vues m'unissaient si intimement. – Vous faites bien, me dit
Caton, de conserver chèrement la mémoire de deux hommes qui vous ont
recommandé leurs enfants par leurs testaments, et je suis charmé de
voir que vous aimez le jeune Lucullus. Quant au soin de son
éducation qui me regarde tout particulièrement, dites-vous, je m'en
charge avec plaisir, mais il faut que vous le partagiez avec moi. Ce
que je puis ajouter, c'est qu'il me paraît déjà donner beaucoup de
marques d'une belle âme et d'un noble esprit; mais vous voyez
combien son âge est tendre. – Je le vois bien, lui dis-je, et c'est
aussi dans cet âge qu'il faut l'initier à ces études et ouvrir son
âme à ces sentiments qui le prépareront aux grandes choses qui
l'attendent. – C'est à quoi il faut que nous travaillions ensemble,
reprit-il, et de quoi nous nous entretiendrons plus d'une fois.
Cependant asseyons-nous, s'il vous plaît. C'est ce que nous fîmes
aussitôt.
III. Mais vous, continua-t-il, qui avez tant de livres chez vous,
quels sont donc ceux que vous veniez chercher ici? – J'y venais
prendre, lui dis-je, quelques commentateurs d'Aristote, pour les
lire pendant que j'en ai le loisir; ce que vous
543 savez qui ne nous arrive
guère, ni à l'un ni à l'autre. – Que j'aurais bien mieux aimé,
dit-il, que votre goût eût incliné pour les stoïciens! Certes, s'il
appartenait à quelqu'un au monde d'estimer qu'il n'y a de bien que
dans la vertu, c'était à vous. – Voyez au contraire, repartis-je, si
ce n'était pas à vous qu'il eût été convenable, puisqu'au fond nous
sommes d'accord, de ne point donner des noms nouveaux à des
sentiments anciens; car il n'y a entre nos idées nulle différence;
c'est notre langage seul qui est opposé. – Il s'en faut beaucoup,
répliqua-t-il; car tant que vous admettrez au nombre des biens, et
que vous déclarerez digne d'être recherché autre chose que ce qui
est honnête, vous éteindrez en quelque sorte l'honnête lui-même, qui
est le flambeau de la vertu, et vous porterez aux vertus un coup
mortel. – Ce sont là des paroles magnifiques, lui dis-je; mais ne
voyez-vous pas que cette magnificence de langage vous est commune
avec Pyrrhon et Ariston, qui font toutes choses égales, et sur
lesquelles je voudrais bien connaître votre façon de penser? – Ce
que je pense, répondit-il, c'est que les gens de bien, fermes,
justes et modérés, qui ont vécu dans la république, dont nous avons
ouï parler, ou que nous avons vus, et qui ont fait tant de choses
louables sans aucune autre instruction que celle de la nature, ont
été bien mieux instruits par la nature seule qu'ils n'auraient pu
l'être par la philosophie, s'ils en avaient suivi d'autre que celle
qui ne met au nombre des biens que ce qui est honnête, et au nombre
des maux que ce qui est honteux. Pour toutes les autres philosophies
qui parlent de biens où la vertu n'est pas, et de maux qui ne soient
point entachés de vice, les unes plus, les autres moins, mais toutes
sans exception méritent ce reproche de ne point contribuer à nous
rendre meilleurs, mais de corrompre même notre nature. Car si on
n'accorde qu'il n'y a rien de bien que ce qui est honnête, il est
impossible de prouver que le bonheur est dans la vertu, et alors, je
ne sais plus à quoi pourrait servir l'étude de la philosophie. Si le
sage peut jamais être malheureux, je ne vois pas que la vertu, avec
toute la gloire et l'immortalité qu'elle nous donne, mérite qu'on en
fasse tant d'estime.
IV. Tout ce que vous avez dit jusqu'ici, Caton, lui répliquai-je,
vous pourriez le dire de même quand vous suivriez l'opinion de
Pyrrhon ou celle d'Ariston; car vous n'ignorez pas que pour eux
l'honnête était non pas seulement le souverain bien, mais, comme
vous le voulez vous-même, le bien unique; d'où il suit, comme vous
le voulez pareillement, que tous les sages sont toujours heureux.
Approuvez-vous donc leur sentiment, et dites-vous que nous devons le
suivre? Nullement, répondit-il; car le propre de la vertu étant de
savoir faire choix des choses qui sont conformes à la nature, ceux
qui les ont tellement égalées toutes et en ont effacé à tel point
les distinctions, qu'ils ne nous laissent plus aucun lieu de choisir
entre les unes et les autres, ont par cela même anéanti la vertu. –
C'est fort bien dit. Mais, je vous le demande, ne devez-vous pas en
venir aux mêmes extrémités, vous qui déclarez qu'il n'y a d'autre
bien que ce qui est droit et honnête, et qui supprimez toute espèce
de distinction pour tout le reste? – Si je faisais ce que vous
dites, vous auriez raison; mais je ne supprime rien. – Comment cela?
repris-je. Si la vertu seule, si ce que vous appelez l'honnête, si
ce qui est droit, louable, honorable (car je me sers de plusieurs
mots, pour que l'on entende mieux l'objet de ma pensée), si
544 c'est là, disons-nous, le
bien unique, qu'aura-t-on de plus à rechercher? Et s'il n'y a rien
de mal que ce qui est honteux, malhonnête, vicieux, odieux,
déshonorant, infâme, (pour le faire mieux entendre encore par toutes
ces expressions réunies), que peut-il y avoir de plus à éviter? –
Comme vous n'ignorez pas, dit-il, ce que j'aurais à vous répondre,
et que je vous soupçonne de vouloir tirer avantage des courtes
explications que je vous donnerais, je ne vous répondrai pas
séparément sur chaque point de doctrine; mais puisque nous en avons
le loisir, j'aime mieux vous exposer, à moins que vous ne le jugiez
inutile, toute la doctrine de Zénon et ses stoïciens. – Le juger
inutile! rien moins assurément, et ce que vous nous direz là servira
même beaucoup à éclaircir ce que nous cherchons. – Essayons donc,
reprit-il, quoiqu'il y ait dans le système des stoïciens bien des
choses difficiles et obscures. Car si l'on fut obligé jadis, pour
exprimer des choses nouvelles, d'introduire dans la langue grecque
de nouveaux termes que l'usage a rendus familiers, que ne devra-t-on
pas faire dans la langue latine? – Inventez, inventez, lui dis-je;
car s'il a été permis à Zénon de créer de nouvelles expressions pour
faire entendre ce qu'il avait découvert de nouveau, pourquoi
n'accorderait-on pas le même privilège à Caton? Toutefois il ne sera
pas toujours nécessaire de traduire mot pour mot, comme font les
interprètes ignorants, surtout lorsqu'on pourra mieux faire entendre
la pensée par une expression un peu différente, mais usitée. Pour
moi, quand il est question de traduire, si ce que les Grecs disent
en un seul terme, je ne puis pas le rendre de même, je l'exprime en
plusieurs mots. Je crois aussi que l'on doit nous permettre de nous
servir du mot grec, lorsque nous n'en trouvons point dans notre
langue qui puisse y bien répondre, à moins qu'on ne prétende que
c'est un privilège réservé aux termes d'“éphippies” et
d'“acratophores”, et qu'il ne faut point l'étendre à ceux de
“proegmènes” et d'“apoproegmènes”, qu'on pourrait cependant rendre
assez bien en notre langue par ceux de “préférés” et de “rejetés”. –
Je vous suis obligé de me secourir comme vous faites, répondit-il. A
l'égard des termes que vous venez de me fournir, je m'en servirai
plutôt que des expressions grecques, et, pour les autres, vous
m'aiderez, si vous voyez que je sois embarrassé. – Je m'y prêterai
avec le plus grand zèle, lui dis je; mais, courage, la fortune aide
les gens de cœur; tentez donc l'entreprise: nous ne pourrions avoir
d'occupation plus divine.
V. Ceux dont j'ai embrassé la doctrine, reprit alors Caton, tiennent
que dès que l'animal est né, car c'est par là qu'il faut commencer,
il est enclin à s'aimer, à chercher la conservation de son être et
de sa condition naturelle, et à s'attacher à tout ce qui peut servir
ce désir invincible; et qu'au contraire il éprouve une vive aversion
pour la destruction de son être et pour tout ce qui pourrait la
causer. La preuve de ce qu'ils avancent, c'est que les enfants,
avant d'avoir aucun sentiment de plaisir ou de douleur, recherchent
ce qui leur est salutaire et rejettent ce qui leur est nuisible; ce
qu'ils ne feraient pas, s'ils n'aimaient la conservation de leur
être et s'ils n'en craignaient la destruction. Mais, avant
d'éprouver aucun désir, il faut nécessairement qu'ils aient le
sentiment d'eux-mêmes et que par là ils
545 apprennent à s'aimer eux et ce qui est d'eux. On voit
donc par là que le premier principe de toutes nos actions est
l'amour de notre propre conservation. La plupart des Stoïciens ne
pensent pas que parmi les principes naturels d'action, on doive
compter la volupté; et je suis fort de leur sentiment, parce que si
la nature avait mis quelque attrait de volupté dans les premières
choses qu'elle fait désirer, il serait à craindre que de là on ne
pût tirer bien des conséquences honteuses. Du reste, une grande
preuve que la nature ne nous a inspiré primitivement d'autre désir
que de conserver ce qu'elle nous avait donné d'abord, c'est qu'il
n'y a personne qui n'aime mieux, s'il en a le choix, avoir toutes
les parties de son corps dans une parfaite intégrité, que de les
avoir, lors même qu'il en pourrait faire usage, estropiées ou
contrefaites. Quant aux connaissances, et si ce terme n'est pas
assez clair et ne vous plaît pas assez, disons avec les Grecs
καταλήψεις, nous croyons que l'on peut les rechercher pour
elles-mêmes, parce qu'elles ont en elles quelque chose qui embrasse
et contient une vérité. Et cette inclination de la nature se voit
dans les enfants, qui sont ravis, lorsque d'eux-mêmes et par le
propre effort de leur esprit, ils ont découvert quelque chose, qui
d'ailleurs ne leur importe en rien. Selon nous, les arts méritent
aussi d'eux-mêmes que l'on s'y applique, parce qu'ils sont d'abord
de dignes objets de nos efforts, et parce qu'ils sont composés d'un
système de connaissances établi et lié par le raisonnement et la
méthode. Les Stoïciens pensent aussi que parmi toutes les choses
opposées à la nature, il n'en est aucune pour laquelle nous ayons
plus d'aversion, que pour le consentement de l'esprit donné à ce qui
nous parait faux. Quant aux différentes parties dont le corps de
l'animal est composé, les unes semblent avoir été données par la
nature pour un usage déterminé, comme les mains, les pieds, les
jambes, et tout le dedans du corps dont les médecins nous expliquent
les différentes fonctions, les autres paraissent n'avoir été données
pour aucun usage mais pour servir d'ornement, comme la queue aux
paons, aux colombes le plumage aux reflets changeants, aux hommes
les mamelles et la barbe. Et de tout ceci, qui ne regarde que les
premiers éléments de la nature, vous voyez avec quelle sécheresse je
vous en parle; parce que la matière n'est pas susceptible
d'ornements. Quand le sujet qu'on traite est grand de lui-même,
alors la magnificence des choses entraîne celle des paroles, et tout
le discours en a plus de dignité et plus de force. – Vous avez
raison, lui répondis-je. Mais quand on dit de bonnes choses et qu'on
les dit clairement, je trouve que l'on est toujours assez éloquent.
Il y aurait de la puérilité à vouloir traiter élégamment certains
sujets; en parler clairement et intelligiblement, c'est tout ce que
doit faire un homme sage et habile.
VI. Continuons donc, reprit-il, et puisque nous en étions demeurés
aux premiers principes naturels d'action auxquels toute la suite se
doit rapporter; voici d'abord la division qu'on en tire. Les choses
sont ou estimables (car c'est ainsi qu'il faut nommer, je crois, ce
qui est conforme à la nature de ce qui produit quelque chose de tel,
et que l'on juge digne d'être choisi à cause d'une certaine valeur
naturelle, qui mérite l'estime, appelée par Zénon ἀξία);
ou méprisables, c'est-à-dire ayant des caractères précisément
opposés à ceux que nous venons de décrire. Les principes
546 d'action ainsi déterminés, et
ayant établi qu'il faut rechercher ce qui est conforme, et fuir ce
qui est contraire à la nature, le premier devoir (car c'est ainsi
que je traduis καθῆκον), sera de se maintenir dans sa
condition naturelle; ensuite, de s'attacher à ce qui est conforme,
et de repousser ce qui est contraire à sa nature. Lorsqu'on a su
choisir ce qui est bien et rejeter ce qui est mal, on en vient
ensuite à distinguer et à choisir entre les diverses sortes de
devoirs; l'on fait enfin un choix ferme, inébranlable et en parfaite
harmonie avec sa nature; et dès que l'homme se rend fidèle à un tel
choix, il comprend ce que c'est véritablement que le souverain bien.
Car notre première inclination nous porte vers ce qui est conforme à
notre nature; mais du moment que nous commençons à avoir
l'intelligence, ou plutôt la connaissance, que les Grecs nomment
ἔννοιαν, et que nous venons à concevoir l'ordre et, pour
ainsi dire, l'harmonie d'une vie bien réglée, nous en faisons encore
beaucoup plus d'estime que de tout ce que nous avions aimé d'abord;
et le fruit que nous recueillons de notre intelligence et de notre
raison, est de juger que le souverain bien de l'homme, le bien que
l'on doit estimer et rechercher pour lui-même, consiste dans ce que
les Stoïciens nomment ὁμολογίαν, et que nous
appellerons, si vous le voulez, harmonie de la vie. C'est dans cette
harmonie que réside le bien auquel il faut tout rapporter et partant
l'honnête lui-même, que l'on doit placer seul au rang des biens,
quoiqu'il ait dans notre existence morale une origine
comparativement tardive, mais qui seul aussi mérite d'être recherché
pour lui-même et par sa propre dignité: quant aux objets de nos
premiers désirs, aucun d'eux ne mérite d'être recherché pour
lui-même. Ce qu'on nomme proprement les devoirs, ayant leur origine
dans ces premiers désirs de la nature, il faut nécessairement les
rapporter à leur source; et l'on peut dire justement que tous les
devoirs ont pour objet l'acquisition des premiers biens naturels.
Toutefois, on ne peut pas voir là le souverain bien, car dans les
premières inclinations de la nature, il n'y a pas encore d'action
honnête. Ce n'est qu'ensuite, comme je l'ai dit, que l'honnête vient
à se former; mais quoiqu'il ne soit venu qu'après, il est tellement
selon la nature, qu'il nous porte bien plus fortement à le
rechercher que n'avaient fait tous les premiers biens naturels.
Qu'on n'aille pas toutefois s'imaginer que de ce que nous venons de
dire il résulte qu'il y ait deux souverains biens. Mais comme si on
avait dessein de lancer un javelot ou de tirer une flèche en quelque
endroit, et de frapper un but que nous pouvons comparer au souverain
bien dont nous parlons, il faudrait faire tout ce qui serait
possible pour frapper juste; tout pareillement dans la vie faut-il
faire tout ce que l'on peut pour rencontrer le but: mais tout en
faisant ce que l'on peut pour frapper juste, on doit bien entendre
que le véritable objet de nos efforts, c'est le bien suprême, et que
nos efforts eux-mêmes, et les coups que nous portons, sont des
moyens que nous choisissons, et non pas une fin que nous nous
proposions.
VII. Or, tous les devoirs de la vie ayant leur source dans les
premiers devoirs de la nature, il faut aussi que la sagesse y ait la
sienne. Mais comme il arrive souvent que celui qu'on a recommandé à
quelqu'un vient dans la suite à faire plus de cas de la personne à
qui il est recommandé que de celle à qui il doit la recom-
547 mandation, il ne faut pas
s'étonner que les hommes ayant été recommandés à la sagesse par les
premiers désirs de la nature, la sagesse leur devienne ensuite plus
chère que ces désirs, leurs introducteurs près d'elle. De même aussi
que les membres nous ont été visiblement donnés pour certaines
fonctions, de même le désir de l'âme, que les Grecs nomment ὁρμή, nous a été donné, non pour nous appliquer
arbitrairement à tout genre de vie, mais pour en suivre un
particulier et clairement déterminé; j'en dirai autant et de
l'intelligence, et de la droite raison. Comme certains gestes
seulement et non pas tous, certains mouvements et non pas tous
conviennent aux comédiens et aux danseurs, ainsi dans la vie doit-on
se proposer de suivre certaine conduite seulement, conduite qui
n'est nullement arbitraire, mais qui doit être de tous points
convenable et conforme à la nature. Car nous ne croyons pas que la
sagesse soit semblable, ni à l'art de la navigation, ni à celui de
la médecine, mais plutôt aux deux autres dont je viens de parler, en
ce que ceux-ci contiennent en eux la fin dernière de toutes leurs
œuvres. Il faut cependant remarquer cette différence entre la
sagesse et ces deux arts, que tout ce qui est bien fait dans chacun
d'eux ne contient pas toutes les beautés que l'art renferme; tandis
que les actions droites et vertueuses nommées par les Grecs
κατορθώματα, comprennent chacune toutes les richesses de la
vertu; le seul art de la sagesse n'ayant absolument d'autre but que
lui-même, privilège dont les autres arts sont privés. C'est donc mal
à propos que le but de la médecine et de l'art du pilote est comparé
avec celui de la sagesse; car la sagesse comprend la grandeur d'âme,
la justice, et fait mépriser à l'homme tous les accidents de la vie;
parmi les autres arts, en est-il un qui renferme de tels avantages?
Mais on ne pourra jamais parvenir aux vertus que je viens de dire,
si l'on n'est convaincu qu'il n'y a d'autre différence entre les
choses, qu'en ce qu'elles sont honnêtes ou honteuses. Voyez
maintenant comment tout cela suit admirablement des principes que
j'ai d'abord établis. Car le but de la sagesse (j'appelle, comme
vous voyez, ce que les Grecs nomment τέλος, tantôt but
de la sagesse, tantôt dernier terme, souverain bien, et je pourrais
encore le nommer fin des actions), le but de la sagesse étant donc
de vivre convenablement, et conformément à la nature, il s'ensuit
nécessairement que le sage mène toujours une vie parfaitement
heureuse de tous points, que rien ne l'empêche, rien ne l'entrave,
rien ne lui fait défaut. On peut montrer que ce premier principe,
qu'on ne doit juger bien que ce qui est honnête, est non seulement
l'abrégé de toute sagesse, mais encore le plus solide fondement de
la vie et de la fortune des hommes, et c'est ici où la grande
éloquence aurait un beau champ, et où elle pourrait employer
heureusement le choix des paroles et la gravité des sentences; mais
les conclusions courtes et vives des Stoïciens me plaisent
davantage.
VIII. Voici comment ils argumentent: “Tout ce qui est bon est
louable; tout ce qui est louable est honnête; donc tout ce qui est
bon est honnête.” Ne trouvez-vous pas que la conséquence est bien
tirée? Vous le devez; car vous voyez qu'elle est fidèlement déduite
des deux premières propositions. De ces deux propositions qui nous
servent à conclure, c'est ordinairement la première qu'on attaque,
et l'on nie que tout ce
548
qui est bon, soit louable; car on convient universellement que tout
ce qui est louable est honnête; mais il est complètement absurde de
dire qu'il y ait un bien qui ne soit pas désirable, que ce bien soit
désirable et qu'il ne plaise pas, qu'il plaise et ne soit pas digne
d'être choisi; il mérite donc d'être approuvé, il est donc louable,
il est donc honnête, donc enfin tout ce qui est bon est honnête. Je
demande ensuite quel est l'homme qui pourrait se glorifier d'une vie
misérable ou ne pas se glorifier d'une vie heureuse? La vie heureuse
mérite donc seule qu'on s'en glorifie, mais c'est ce qu'on ne peut
faire à bon droit que d'une vie honnête; donc la vie honnête est en
même temps la vie heureuse. De plus, comme il faut qu'un homme, pour
mériter d'être loué, ait quelque chose de si excellent et de si
digne d'éloge, qu'on puisse, à cause de cela même, le dire à bon
droit heureux, il s'ensuit que l'on peut dire parfaitement que la
vie d'un tel homme est heureuse. Ainsi donc, si c'est l'honnêteté de
la vie qui la rend heureuse, il n'y a rien de bien que ce qui est
honnête. Ce qu'il est pareillement impossible de nier, c'est qu'il
puisse y avoir d'homme d'un courage ferme et élevé, d'homme fort
comme nous le disons, s'il n'est établi que la couleur n'est pas un
mal. Celui qui met la mort au nombre des maux, doit nécessairement
la craindre; celui qui voit un mal quelque part, s'en inquiète
nécessairement, et ne peut le mépriser; tout le monde demeure
d'accord de ce que j'avance là, et la conséquence en est que celui
qui a de la force et de l'élévation d'âme, méprise et compte pour
rien tout ce qui lui peut arriver. Dès lors il est manifeste qu'il
n'y a rien de mal que ce qui est honteux. Cet homme noble et
excellent dont je parle, cet homme d'un grand cœur et d'un courage à
toute épreuve, le sage en un mot que nous voulons former et que nous
cherchons, doit avoir une pleine confiance en lui-même, dans son
passé et dans son avenir, et juger assez bien de lui pour croire
fermement que jamais il ne peut arriver de mal au sage. Et par là on
vient encore à comprendre qu'il n'y a rien de bien que ce qui est
honnête, et que vivre honnêtement, c'est-à-dire dans la pratique de
la vertu, c'est mener véritablement une vie heureuse.
IX. Je n'ignore pas que même parmi les philosophes qui mettent le
souverain bien dans l'esprit, il y a beaucoup d'opinions
différentes. Mais quoique souvent leurs doctrines et leurs écoles ne
soient pas exemptes d'erreur, je ne laisse pas de les trouver
préférables non seulement aux trois systèmes qui, séparant la vertu
du souverain bien, ont mis ce bien suprême, ou dans la volupté, ou
dans l'absence de la douleur, ou dans les premiers biens de la
nature, mais encore aux trois autres qui, croyant la vertu boiteuse,
si on ne lui donne quelque appui, l'ont mise chacun en compagnie de
quelqu'une des trois choses que je viens de dire. A toutes ces
théories je préfère sans aucun doute celles qui mettent d'une
manière ou de l'autre le souverain bien dans l'esprit et dans la
vertu. Du reste, je trouve également absurdes et les philosophes qui
font consister le souverain bien dans la science et ceux qui, ne
mettant entre les choses aucune différence, disent que le sage ne
peut être heureux qu'en ne préférant aucune chose à une autre;
semblables 549 à certains
académiciens, qui tiennent, dit-on, que le souverain bien et le
principal devoir du sage est de résister aux apparences et de
suspendre avec fermeté son jugement. On réfute abondamment
d'ordinaire les uns et les autres; mais je ne vois pas qu'il faille
beaucoup de temps pour prouver ce qui est manifeste; car quoi de
plus manifeste que, s'il n'y a point de choix à faire entre ce qui
est conforme et ce qui est contraire à la nature, la prudence, tant
recherchée et tant louée, est anéantie? Après avoir ainsi écarté les
opinions que je viens de rapporter et toutes celles qui y
ressemblent, il ne reste plus que la vraie doctrine, qui fait
consister le souverain bien à vivre avec une telle connaissance de
tout ce que la nature peut produire, que l'on sache choisir ce qui
est conforme et rejeter ce qui est contraire à sa condition
naturelle, et vivre ainsi convenablement et conformément à la
nature. Dans tous les autres arts, lorsque l'on dit que quelque
chose est artistement fait, cela s'entend toujours d'une opération
extérieure de l'art et d'une production au dehors, ce que les Grecs
nomment ἐπιγεννηματικόν ; mais à l'égard du sage, ce
qui est sagement fait est parfait dès l'abord, parce que tout ce qui
part de lui doit être incontinent accompli de tous points; car c'est
en lui que réside le bien suprême qu'il faut rechercher. Et de même
que c'est pécher que de trahir sa patrie, d'outrager ses parents, de
piller les temples, toutes actions produites au dehors, de même
c'est pécher que de craindre, que d'être affligé, d'avoir des
sentiments déréglés, lors même qu'il n'en résulte aucun effet
visible; mais alors évidemment ces fautes ne sont pas dans les
conséquences, mais dans la racine intérieure du mal; ainsi tout ce
qui est selon la vertu, est intérieurement et dès le principe bon et
droit, indépendamment de toute production au dehors.
X. Venons maintenant à la définition du bien dont nous avons déjà
tant parlé. Les définitions qu'en ont données nos divers auteurs
sont un peu différentes, mais elles reviennent toutes à la même
chose. Pour moi, je suis de l'avis de Diogène le stoïcien, qui
définit le bien, ce qui est parfait de sa nature; et qui, suivant ce
principe, appelle l'utile (c'est ainsi que je traduis
ὠφέλημα),
un mouvement ou un état en harmonie avec le bien parfait de sa
nature. Or, comme les notions se forment dans l'esprit, ou par une
simple expérience, ou par le rapprochement des faits, ou par la
ressemblance des choses, ou enfin par les réflexions de la raison,
c'est par cette dernière sorte d'opérations qu'on est parvenu à
connaître ce que c'est que le bien. Lorsque des choses sont
conformes à la nature, l'esprit vient à s'élever par les réflexions
que la raison lui fait faire, c'est alors qu'il parvient à la
connaissance du bien. Ce bien est tel, que ce n'est pas parce qu'il
atteint un certain degré, parce qu'il prend une certaine force, on
qu'on le compare à des choses plus imparfaites, qu'on l'appelle
bien; mais parce que sa propre excellence le décèle. Comme le miel
avec son exquise saveur nous fait de lui-même sentir qu'il est doux,
sans qu'il soit besoin de comparaison pour le reconnaître; ainsi le
bien dont nous parlons mérite d'être souverainement estimé mais
cette estime, c'est à la nature même et non au degré du bien qu'on
la doit. L'estime d'ordinaire n'étant comptée ni parmi les biens ni
parmi les maux, quelque grande qu'elle puisse devenir,
550 elle ne change point de
nature. Mais c'est une estime particulière que mérite la vertu,
excellente par elle-même, et qui n'a point de degrés.
La vie des insensés est remplie de tristesse et d'amertume par les
troubles de l'âme que les Grecs nomment πάθη. Pour
traduire fidèlement, j'aurais dû dire maladies; mais ce terme ne
pourrait convenir à toutes ces diverses affections; car qui a jamais
appelé maladie la compassion ou même la colère? les Grecs les
nomment fort bien du nom général de πάθος. Employons
donc l'expression de trouble qui assez manifestement est prise en
mauvaise part. Mais aucun de ces troubles n'est excité par une
impulsion naturelle. On en compte généralement quatre, qui se
subdivisent en un grand nombre d'autres: la tristesse, la crainte,
la convoitise, et ce que les Stoïciens, d'un terme qui convient à la
fois à l'esprit et au corps nomment ἡδονήν, et que
j'aime mieux appeler joie, comme étant une saillie voluptueuse d'un
esprit qui ne se possède plus. Comme ces troubles, ainsi que je l'ai
dit, ne sont point excités par la nature, mais viennent de faux
jugements et sont l'ouvrage de la légèreté de l'esprit, la sage n'en
sera jamais atteint.
XI. La plupart des philosophes conviennent avec nous que tout ce qui
est honnête mérite d'être recherché pour son excellence propre; car,
à l'exception des trois sectes qui excluent la vertu du souverain
bien, ce dogme doit être soutenu par tous les autres philosophes et
principalement par les Stoïciens qui ne mettent au rang des biens
que l'honnête seul; et rien n'est plus aisé à soutenir. Car peut-on
s'imaginer un homme d'une avidité si grande et d'une licence si
effrénée, qu'il n'aimât beaucoup mieux acquérir sans violence et
sans crime ce qu'il souhaite ardemment de posséder, que de l'obtenir
par un crime, avec une entière assurance d'impunité? Quelle utilité
ou quel fruit nous proposons-nous lorsque nous voulons pénétrer dans
les mystères de la nature, connaître les causes du mouvement des
astres et de tous les phénomènes célestes? Et qui a jamais été élevé
avec tant de rusticité, qui a jamais eu tant d'aversion pour l'étude
de la nature, et un éloignement si farouche pour des connaissances
dignes de l'homme, qu'à moins d'en retirer quelque plaisir ou
quelque intérêt, il ne voulût ni s'en instruire, ni en faire la
moindre-estime? Y a-t-il un homme qui, entendant parler de nos
ancêtres, des deux Africains, de celui de mes aïeux que vous citez
continuellement, et de tant d'autres grands personnages qui ont
excellé en toutes sortes de vertus; y a-t-il un homme qui, venant à
connaître leurs actions, leurs paroles, leurs conseils, ne ressente
un vif contentement en son âme? En est-il un qui, né dans une
famille honnête et formé par une éducation libérale, ne se sente
indigné d'une action honteuse lors même qu'elle ne le blesse en
rien? Peut-on voir sans répugnance un homme que l'on croit vivre
dans le désordre et l'infamie? peut-on ne pas éprouver d'aversion
pour des gens sordides, vains, légers, frivoles? Que si l'on ne
soutenait que tout ce qui est honteux est de soi-même à éviter,
comment les hommes dans la solitude et dans les ténèbres
s'abstiendraient-ils de se souiller des dernières infamies, et que
pourrait-on dire pour les en empêcher, si le vice lui-même, par tout
ce qu'il a de hideux, ne leur inspirait un salutaire effroi? Il y
aurait encore une infinité de preuves à donner en faveur de ce
dogme, mais en voilà assez.
551
Nulle vérité ne convaincrait jamais les esprits, si l'on pouvait
douter que tout ce qui est honnête est de soi-même à rechercher, et
tout ce qui est honteux de soi-même, à fuir.
Après avoir ainsi établi qu'il n'y a rien de bien que ce qui est
honnête, il faut entendre que l'honnête lui-même est beaucoup plus à
estimer que tous les biens secondaires dont il est la source. Ainsi,
quand nous disons qu'il faut éviter la folie, la témérité,
l'injustice et l'intempérance, à cause des inconvénients qui en
arrivent, il ne faut pas croire que ce précepte soit en
contradiction avec notre premier principe qu'il n'y a rien de mal
que ce qui est honteux; car ces inconvénients-là ne se rapportent
point au corps, mais seulement aux actions honteuses qui naissent
des vices. Car j'aime mieux appeler vices que malices les mauvaises
dispositions que les Grecs nomment κακίας .
XII. En vérité, Caton, vous vous servez de termes parfaitement
clairs, et qui font entendre, on ne peut mieux, ce que vous voulez
exprimer. On dirait que vous apprenez à la philosophie à parler
notre langue, et que vous lui donnez en quelque sorte droit de cité
parmi nous, à elle qui jusqu'ici semblait étrangère dans Rome et
n'osait se mêler à nos entretiens; celle-ci surtout à cause de la
sécheresse et de la subtilité de ses dogmes et de son langage. Pour
moi, je connais des gens qui peuvent assez bien philosopher en toute
langue, mais qui ne se servent ni de divisions, ni de définitions,
parce qu'ils disent ne recevoir d'autres dogmes que ceux auxquels la
nature donne d'elle-même un consentement tacite; aussi parlant des
choses les plus claires du monde, il ne leur faut pas grand travail
pour se faire entendre. C'est pourquoi je vous écoute attentivement
et tous les noms que vous donnez aux choses dont vous parlez, je les
retiens avec soin; car peut-être faudra-t-il que je m'en serve après
vous. Il me paraît donc que vous avez très bien opposé les vices aux
vertus, et suivant le génie de notre langue. Tout ce qui de soi-même
est blâmable (“uituperabile”), doit être conséquemment flétri du nom
de vice, ou plutôt on peut dire que c'est de “uitium” que vient
“uituperari”. Si vous aviez traduit κακίαν par malice,
la signification ordinaire de ce mot en latin nous aurait fait
penser à une certaine espèce de vice seulement; mais par le mot de
vice on exprime généralement tout ce qui est contraire à la vertu.
Caton reprit alors: Tous les principes que je viens de rappeler,
ouvrent le champ à une grande controverse, soutenue assez mollement
par les péripatéticiens, lesquels discutent d'ordinaire avec peu de
nerf, parce qu'ils ignorent la dialectique; mais poussée très
vivement et très loin par votre Carnéade, lequel réunissait une
habileté consommée dans la dialectique à une rare éloquence, et ne
cessait de soutenir que, dans toute la question des biens et des
maux, il n'y avait entre les stoïciens et les Péripatéticiens aucune
différence quant au fond des choses, mais seulement quant aux
termes. Pour moi, rien ne me semble plus évident que la diversité de
leurs opinions sur le fond même de la doctrine; et je tiens qu'entre
les Péripatéticiens et les Stoïciens c'est une véritable lutte de
principes, et non pas seulement une querelle de mots. Car les
Péripatéticiens prétendent que tout ce qu'ils appellent du
552 nom de biens, sans exception,
contribue à rendre la vie heureuse; tandis que notre école soutient
que tout ce qui est digne d'une certaine estime, ne suffit pas
cependant pour nous donner le bonheur.
XIII. D'un autre côté, n'est-il pas incontestable que suivant
l'opinion de ceux qui mettent la douleur au nombre des maux, il est
impossible que le sage, déchiré sur le chevalet, soit heureux? Mais
pour ceux qui ne mettent pas la douleur parmi les maux, leur
principe conduit nécessairement à cette conséquence qu'au milieu
même des tourments, le sage est toujours heureux. On voit que ceux
qui souffrent pour leur patrie, supportent les douleurs avec plus de
fermeté que ceux qui souffrent pour une moins belle cause; preuve
bien manifeste que c'est l'opinion et non la nature qui augmente ou
diminue la force de la douleur. Il est encore impossible que nous
soyons d'accord avec les péripatéticiens, qui admettent trois sortes
de biens, et disent que plus un homme est avantagé des biens du
corps ou de ceux de la fortune, plus il est heureux. Non certes,
nous ne conviendrons jamais que plus un homme a de ces qualités
corporelles dont on fait tant de cas, plus il est heureux. Ils
croient que les biens du corps mettent le comble au bonheur de la
vie; nous n'en croyons, nous, absolument rien. Comment, lorsque nous
pensons que ces biens, appelés par nous les premiers dons de la
nature, ne peuvent, par leur concours, rendre la vie ni plus
heureuse, ni plus estimable, ni plus digne d'envie, comment ne
dirions-nous pas que la multitude des avantages du corps contribue
encore moins au bonheur? Il est vrai que si la sagesse est à
rechercher et que la santé le soit aussi, l'une et l'autre ensemble
seront encore plus à rechercher que la sagesse seule; et cependant
si l'une et l'autre sont dignes d'estime, elles n'en seront pas plus
dignes toutes deux ensemble que la sagesse isolée. Car nous qui
jugeons que la sagesse est digne de quelque estime et ne la mettons
pas cependant au rang des biens, nous déclarons en même temps qu'il
n'est rien d'assez estimable pour être préféré à la vertu. Les
péripatéticiens qui professent un autre sentiment, sont obligés de
dire qu'une action honnête, exempte de douleur, doit être plutôt
l'objet de nos vœux que la même action accompagnée de douleur. Nous
sommes d'une tout autre opinion; à tort ou à raison? c'est ce que
nous examinerons dans la suite. Mais, je vous le demande, peut-il y
avoir une plus grande différence sur le fond des choses?
XIV. De même que la lueur d'un flambeau est obscurcie et comme
absorbée par la lumière du soleil, qu'une goutte de saumure se perd
dans l'étendue de la mer Égée, et qu'une obole de plus dans le
trésor de Crésus, un pas de plus ajouté au chemin d'ici aux Indes,
ne sont rien; ainsi le souverain bien étant tel que le disent les
Stoïciens, il faut nécessairement que toute l'estime qu'on fait des
biens du corps soit obscurcie et même anéantie par l'éclat et par la
majesté de la vertu. De même aussi que l'opportunité (car c'est
ainsi que j'appelle l'εὐκαιρίαν des Grecs) ne devient
pas plus grande avec le temps, car l'occasion propice est toujours
renfermée dans de certaines bornes; de même la bonté morale d'une
âme (je traduis ainsi κατόρθωσιν , puisque κατόρθωμα signifie la bonne action), la bonté morale de
l'âme, ou encore, l'harmonie de la vie ou le bien lui-même qui con-
553 siste à vivre conformément
à la nature, ne peut en aucune manière recevoir d'accroissement. De
même que l'opportunité, la vertu dont je parle ne grandit pas avec
le temps; c'est pourquoi les stoïciens ne croient pas qu'une vie
heureuse soit plus à désirer ni plus à rechercher, longue que
courte; et ils se servent ici d'une comparaison. Supposé,
disent-ils, que le mérite d'un cothurne soit de chausser
parfaitement, mille cothurnes ne seront pas préférables à deux
cothurnes bien faits, et les grands n'auront pas par eux-mêmes plus
de valeur que les petits; ainsi tous les biens dont le mérite est
uniquement dans la convenance et l'à-propos n'empruntent aucune
valeur ni de leur nombre ni de leur durée. L'objection que l'on nous
fait ici n'est pas fort redoutable: si la bonne santé, nous dit-on,
est plus estimable quand elle dure longtemps que quand elle dure
peu, on doit faire d'autant plus de cas de la sagesse qu'on en
jouira aussi plus longtemps. Mais ceux qui parlent de la sorte ne
prennent pas garde que si c'est la durée qui fait le mérite de la
santé, c'est l'opportunité qui fait le mérite de la vertu; à ce
compte ils seraient également bien fondés à dire qu'une bonne mort
est d'autant meilleure qu'elle dure davantage, et un accouchement de
même. Ils ne voient pas qu'il y a des choses dont la brièveté fait
le mérite, tandis que pour d'autres, c'est la longueur. Une
conséquence de l'opinion dont nous parlons, et qui admet que le
souverain bien, ou la fin suprême de nos actions comporte des degrés
d'excellence, c'est de juger qu'un sage puisse être plus sage qu'un
autre, et qu'il y ait des degrés dans nos fautes comme dans nos
mérites. Pour nous qui croyons que le souverain bien ne peut
recevoir d'accroissement, il ne nous est pas permis de parler de
cette sorte. Car de même que ceux qui se noient ne sont pas moins
noyés quand ils n'ont que deux doigts d'eau par-dessus la tête, que
quand ils sont au fond de l'eau; et qu'un jeune chien, près du temps
où les chiens commencent à voir, ne voit pas davantage que celui qui
vient de naître; de même un homme qui n'a encore fait que quelque
progrès vers la vertu, est tout aussi profondément misérable que
celui qui ne s'en est aucunement approché.
XV. Je sais bien que ces dogmes peuvent paraître étrangers; mais
comme nos premiers principes sont incontestablement vrais, et que
ceux-ci en sont des conséquences légitimes, il est impossible qu'ils
ne soient pas vrais aussi. Mais, quoique les stoïciens nient qu'il y
ait des degrés dans le vice et la vertu, ils ne laissent pas de
croire que les uns et les autres peuvent s'étendre et en quelque
façon se développer. Quant aux richesses, Diogène estime que non
seulement elles peuvent nous mener à la volupté et à la santé, mais
qu'elles les renferment véritablement toutes deux, tandis que
pouvant nous conduire aussi à la vertu et aux autres arts, il ne
leur est jamais donné de les contenir. Que si l'on compte la volupté
et la santé parmi les biens, il faut que la richesse aussi soit un
bien; mais si la sagesse seule est un bien, on ne peut plus en
conclure que les richesses doivent porter le même titre, rien de ce
qui n'est pas un bien ne pouvant contenir ce qui en est un. Par la
même raison, comme ce sont les connaissances et, les notions claires
des choses qui composent les arts et éveillent la plupart de nos
désirs, il faut avouer que les richesses, exclues du rang des biens,
ne contiennent 554 aucun art.
Mais quand même on leur accorderait de renfermer les arts, on ne
pourrait rien en conclure pour la vertu, qui demande beaucoup plus
de méditation et d'exercice, et qui suppose dans la vie une fermeté,
une égalité et une constance inaltérables, toutes qualités que les
arts n'exigent pas.
Il faut maintenant parler de la différence morale des choses. Si on
niait cette différence, on confondrait tout dans la vie comme l'a
fait Ariston; car la sagesse n'a plus d'office et devient fort
inutile, dès que toute distinction entre les choses relatives à la
vie vient à tomber et qu'il n'y a plus de choix à faire. Ainsi donc
après avoir suffisamment établi qu'il n'y a rien de bien que ce qui
est honnête, et rien de mal que ce qui est honteux, nos maîtres
décidèrent que, parmi les choses qui n'intéressent point le bonheur
ni le malheur de la vie, il y a cependant des distinctions à faire,
les unes étant estimables, les autres méprisables, et d'autres
encore complètement indifférentes. Parmi celles qui sont estimables,
les unes justifient assez la préférence qu'on doit leur accorder,
comme la santé, l'intégrité des sens, l'absence de la douleur, la
gloire, les richesses et autres choses semblables; les autres n'ont
pas les mêmes titres à être préférées. Et pareillement, parmi celles
qui sont méprisables, les unes justifient assez l'éloignement qu'on
doit avoir pour elles, comme la douleur, la maladie, la perte des
sens, la pauvreté, l'ignominie, les afflictions de toutes sortes;
les autres n'ont par elles-mêmes rien de repoussant. Voilà ce qui a
donné lieu aux termes de προηγμένον et d'ἀποπροηγμένον,
expressions nouvelles inventées par Zénon qui disposait cependant
des ressources d'une langue abondante; mais c'est une licence qu'on
nous refuse à nous qui parlons une langue assez pauvre, quoique vous
prétendiez qu'elle est même plus riche que la grecque. En tout cas,
il n'est pas hors de propos, pour faire comprendre la valeur de ces
termes, d'indiquer par quels motifs Zénon fut conduit à les choisir.
XVI. De même, dit Zénon, que, dans la cour d'un roi, ce n'est point
du roi qu'on dit qu'il est élevé en dignité (car c'est là le sens
véritable de προηγμένον), mais bien de ceux qui sont
dans les honneurs, et qui, par leur rang, approchent le plus de la
personne royale; ainsi, dans la vie, ce n'est pas ce qui est au
premier rang, mais bien ce qui occupe le second, que l'on peut
nommer προηγμένα, c'est-à-dire, élevé en dignité. A
toute cette classe de choses, nous pouvons donner ce titre, qui est
une fidèle traduction du terme grec; nous pouvons encore les appeler
approchées ou éloignées; ou, comme nous l'avons déjà fait plusieurs
fois, préférées ou principales, et les autres, rejetées. Car il ne
faut pas être difficile sur les termes, pourvu qu'ils donnent une
idée claire de ce que l'on veut dire. Comme donc nous disons que
tout ce qui est bien tient la première place, il faut nécessairement
que ce que nous nommons ainsi préféré ou principal, ne soit ni bien
ni mal. C'est pourquoi nous disons que c'est quelque chose
d'indifférent, mais qui est digne d'une médiocre estime; car ce
qu'ils appellent ἀδιάφορον , je crois pouvoir le
traduire par indifférent. Il était absolument impossible de ne rien
lais- 555 ser entre le bien et
le mal qui ne fût ou conforme ou contraire à la nature; qui,
partant, n'eût en soi quelque mérite digne d'être apprécié, et qui
enfin ne fût l'objet d'une légitime préférence. Cette distinction
est donc très sagement faite, et nos stoïciens, pour l'éclaircir
davantage, se servent de cette comparaison: Si la fin, disent-ils,
qu'un homme se propose, en jetant un dé, est d'obtenir un certain
point, la manière de le jeter pour faire venir ce point, aura
quelque chose de préférable pour la fin qu'on cherche, mais
cependant ne ressemblera à cette fin en aucune sorte; ainsi, dans la
vie, toutes les choses dignes d'être préférées ont un rapport direct
avec la fin des actions, mais ne participent nullement à l'essence
et à la nature du bien.
Après cette distinction, les stoïciens divisent les biens, en ceux
qu'ils appellent τελικά et que je nommerai appartenant
au souverain bien, pour expliquer en plusieurs mots ce que je ne
puis pas rendre par un seul; en ceux qu'ils appellent ποιητικά
ou “efficiens”, et en ceux qui ont l'un et l'autre caractère à la
fois. Dans la première classe, ils ne mettent que les actions
honnêtes; dans la seconde, l'amitié; enfin la sagesse leur paraît à
la fois contenir et produire le bien; car, d'elle-même, c'est une
action en harmonie avec notre nature et qui par là appartient à la
première classe de biens, et, d'un autre côté, elle provoque et
produit des actions honnêtes, et par là elle rentre dans la seconde
classe établie.
XVII. Parmi les choses que nous appelons préférées, les unes
méritent ce titre par elles-mêmes, les autres par l'effet qu'elles
produisent, d'autres encore par l'une et l'autre raison. Au nombre
des choses qui sont préférables d'elles-mêmes, nous mettons un
certain air de visage, le maintien, le mouvement, toutes choses où
il peut y avoir à préférer et à rejeter. Celles qui ne sont
préférables que par l'effet qu'elles produisent, sont, par exemple,
les richesses. Celles enfin qui réunissent les deux avantages; sont
entre autres l'intégrité des sens et la bonne santé. Quant à la
bonne renommée (car j'aime mieux cette expression que celle de
gloire pour traduire εὐδοξίαν), Chrysippe et Diogène
disaient que si on retranchait l'utilité qui en revient; elle ne
vaudrait pas la peine qu'on remuât pour elle le bout du doigt; et
pour moi je suis fort de leur sentiment. Mais les stoïciens, qui
sont venus après eux, ne pouvant résister aux objections de
Carnéade, ont dit que la bonne renommée méritait par elle-même
d'être préférée et acquise, et qu'il était d'un homme bien né et
libéralement élevé de vouloir être estimé de ses parents, de ses
proches, et même de tous les honnêtes gens, et cela pour l'estime
elle-même, et non pour les avantages qui la suivent. Tout comme nous
voudrions, disent-ils, pourvoir au bien-être de nos enfants, quand
même ils ne verraient le jour qu'après notre mort, uniquement pour
l'amour d'eux; ainsi faut-il avoir soin de notre bonne renommée
après notre mort, pour l'amour seul de la bonne renommée et sans
aucune vue d'utilité.
Mais quoique nous n'admettions aucun autre bien que l'honnête, et
qu'ainsi nous ne mettions ni au rang des biens, ni au rang des maux
ce que nous appelons les devoirs, cependant il convient de s'en
acquitter; car il y a dans tous les devoirs quelque chose de
probable et dont on peut rendre raison, de façon qu'il est toujours
possible de rendre raison d'une ac-
556
tion faite suivant ces probabilités. Or, nous définissons
le devoir, une action dont on peut rendre une raison probable. D'où
il suit que le devoir est quelque chose d'intermédiaire qu'on ne
compte ni parmi les biens, ni parmi les maux; et, comme dans ce qui
n'appartient ni aux vertus ni aux vices il peut y avoir quelque
chose qui nous soit d'un secours véritable, on doit se garder de le
retrancher. Mais il y a dans cette classe intermédiaire telle action
que la raison veut qu'on fasse; or, ce qui est fait avec raison,
c'est ce que nous appelons devoir. On voit donc comment le devoir
est du genre des choses qui ne doivent être mises ni parmi les biens
ni parmi les maux.
XVIII. Il est manifeste d'ailleurs que, dans cette sphère
intermédiaire, le sage agit quelquefois; mais le sage juge donc
alors que c'est un devoir pour lui d'agir, et comme il ne se trompe
jamais dans ses jugements, il faut que le devoir se trouve parmi les
choses intermédiaires; ce qui se prouve encore démonstrativement de
cette manière: puisqu'il y a certaines actions que nous déclarons
bonnes et qui sont proprement la perfection du devoir, il y aura
aussi d'autres actions moins parfaites et qui seront des devoirs en
quelque façon ébauchés. Si, par exemple, c'est une bonne action que
de rendre un dépôt avec justice, ce sera un devoir que de rendre
simplement un dépôt; car l'addition avec justice étant ce qui fait
la bonne action, rendre simplement un dépôt, n'est rien de plus
qu'un devoir. Et comme parmi les choses que nous appelons
intermédiaires, les unes sont à prendre, les autres à rejeter, toute
cette première classe, comprend les devoirs généraux ou communs.
Mais tous les hommes s'aiment naturellement, et l'on comprend que le
fou aussi bien que le sage est porté à prendre ce qui est conforme,
et à rejeter ce qui est contraire à sa nature, d'où l'on voit qu'il
y a certains devoirs communs au sage et à celui qui ne l'est pas. Ce
qui prouve encore que le devoir appartient à la classe
intermédiaire. Or, comme ce sont des choses de ce genre qui fondent
tous les devoirs, ce n'est pas sans sujet que l'on dit que toutes
nos pensées s'y rapportent, et que c'est de là que doit nous venir
la résolution de sortir de la vie ou d'y demeurer. Lorsqu'un homme
voit dominer dans la mesure de ses destins les choses conformes à la
nature, son devoir est de vivre; mais lorsqu'il voit dominer les
choses contraires à la nature, ou lorsqu'il pressent leur triomphe
dans l'avenir, son devoir est de sortir de la vie. On voit par là
qu'il est quelquefois d'un sage de quitter la vie, quoiqu'il soit
toujours heureux, et que le fou doit y demeurer quelquefois,
quoiqu'il soit toujours misérable. On ne débute, comme nous l'avons
dit souvent, ni par le bien ni par le mal; mais d'abord toute cette
classe de choses, conformes ou contraires à la nature, tombe sous le
jugement et le choix du sage; et c'est là en quelque façon la
matière de la sagesse. Les raisons de demeurer dans la vie ou d'en
sortir doivent donc se régler sur tout ce que je viens de dire. Ni
ceux que la vertu retient dans la vie, ni ceux qui vivent sans
vertu, ne doivent point pour cela courir à la mort. Mais il est
souvent du devoir d'un sage, quoique toujours parfaitement heureux,
de quitter la vie, s'il peut le faire à propos; puisque alors c'est
avoir vécu conformément à la nature, en quoi consiste tout le
bonheur. Et c'est ainsi que la sagesse va jusqu'à ordonner au sage
de la quitter elle-même, si la convenance le demande. Mais, d'un
autre côté, comme les vices ne peuvent par eux-mêmes
557 légitimer une mort
volontaire, il est manifeste que le devoir des fous, quoique
toujours misérables, est de demeurer dans la vie, s'ils voient
dominer dans la mesure de leurs destins les choses que nous appelons
conformes à la nature. Car puisqu'ils sont également misérables,
soit en vivant, soit en quittant la vie, et que ce n'est pas la
durée du temps qui fait leur misère, on a raison de dire que
lorsqu'ils ont beaucoup d'avantages naturels dont ils peuvent jouir,
il leur faut demeurer dans la vie.
XIX. Il est encore nécessaire d'entendre, disent les stoïciens, que
c'est la nature qui fait que les pères aiment leurs enfants, et que
cette première affection est le berceau de toute société humaine.
L'organisation et la disposition même des parties du corps font bien
voir qu'elle a apporté une grande attention à tout ce qui concerne
la génération; et il serait inconcevable qu'elle eût pris tant de
soin de la formation des enfants, et qu'elle se fut peu souciée
qu'une fois créés on les aimât. La force de la nature se fait
remarquer en cela même dans les bêtes; lorsque nous voyons les
peines qu'elles se donnent pour mettre au monde leur fruit et pour
l'élever, n'est-ce pas le cri de la nature qu'il nous semble
entendre? Comme il est certain que c'est elle qui nous donne de
l'aversion pour la douleur, évidemment aussi c'est elle qui nous
fait aimer ceux qui sont sortis de nous. De ces premières affections
on voit naître le lien qui rattache tous les hommes les uns aux
autres, en sorte que tout homme, par cela seul qu'il est homme, ne
doit point être étranger pour son semblable. De même que, dans le
corps, il y a des membres qui ne semblent faits que pour eux, comme
les yeux, les oreilles, il y en a qui servent à l'usage des autres
membres, comme les pieds, les mains; de même il y a de certaines
bêtes féroces qui semblent n'être nées que pour elles seules: mais
ce petit poisson qu'on appelle “pinne”, qui demeure toujours dans
une large coquille, et celui qui en sort de temps en temps comme
pour aller à la découverte, qui y rentre comme pour avertir, et que
par cette raison on appelle “pinnothère”, et les fourmis, les
abeilles, les cigognes, tous ces animaux ne font-ils pas sans cesse
quelque chose les uns pour les autres? Ces liens sont beaucoup plus
resserrés entre les hommes, que la nature a disposés pour
s'assembler, s'entendre, former des cités. Les stoïciens pensent
aussi que tout l'univers est régi par la providence des Dieux, que
le monde entier est en quelque sorte la cité commune des Dieux et
des hommes, et que chacun de nous est membre de cette grande
société, d'où il suit naturellement que nous devons préférer
l'utilité commune à la nôtre. Car de même que les lois préfèrent le
salut public à celui des particuliers, ainsi un homme de bien, un
sage soumis aux lois et qui connaît les devoirs du citoyen, a plus
de soin de l'intérêt de tous que de celui d'un seul homme ou du sien
propre; et l'on ne doit pas trouver moins condamnable celui qui,
pour sa propre utilité et pour son salut, abandonne la cause
publique, que celui qui trahit ouvertement son pays. C'est pourquoi
il faut louer ceux qui courent à la mort pour la république, puisque
notre patrie doit nous être plus chère que nous-mêmes; au lieu qu'on
doit avoir en abomination le sentiment de ceux qui, disent-ils, ne
se soucient pas qu'après leur mort les flammes dévorent toute la
terre, ce que l'on 558 exprime
d'ordinaire par un vers grec bien connu. Il est donc certain qu'il
faut s'intéresser à l'avance à ceux qui ne sont pas encore, et
travailler pour eux.
XX. De cette propension générale des esprits sont venus les
testaments et les dernières dispositions des mourants. N'est-il pas
vrai d'ailleurs qu'il n'est pas un homme qui voulût vivre dans une
complète solitude, même au milieu de tous les plaisirs imaginables,
et n'est-ce pas une nouvelle preuve que nous sommes nés pour vivre
réunis en société sous le lien d'une communauté naturelle? La nature
nous porte encore à vouloir servir le plus possible nos semblables,
surtout en les instruisant et en les initiant à la sagesse. Il
serait difficile de trouver un homme qui ne voulût faire part à
personne de ce qu'il sait, tant nous sommes enclins non seulement à
apprendre, mais encore à instruire nos semblables. De même que la
nature porte les taureaux à combattre avec une vigueur et une
impétuosité extrêmes pour défendre le troupeau contre l'attaque des
lions, de même ceux qui ont reçu d'elle de plus grandes forces que
les autres hommes, comme nous avons ouï dire d'Hercule et de
Bacchus, sont naturellement portés à protéger le reste des hommes.
Lorsque nous appelons Jupiter lui-même non seulement Très bon et
Très Grand, mais encore Sauveur, Hospitalier, Protecteur, nous
voulons faire entendre que le salut des hommes est en sa garde. Mais
si nous-mêmes nous nous abandonnons lâchement, comment pouvons-nous
demander aux Dieux qu'ils nous aiment et prennent soin de nous? Tout
comme nous nous servons de nos membres, avant d'avoir appris pour
quel usage ils nous ont été donnés, ainsi la nature, sans que nous y
pensions, nous engage dans les liens de la société des hommes. Que
s'il n'en était pas ainsi, il n'y aurait en ce monde ni justice ni
bonté. Si nous affirmons qu'il y a des liens de droit naturel entre
les hommes, nous n'admettons pas qu'il y en ait entre les hommes et
les bêtes. C'est pourquoi Chrysippe a très bien dit que tout dans le
monde a été fait pour les hommes et pour les Dieux; mais qu'eux ils
n'ont d'autre destination que de vivre en société et de s'entr'aider
mutuellement; que les hommes pour leur usage peuvent se servir des
bêtes sans injustice; mais qu'il y a naturellement entre tous les
membres du genre humain une sorte de contrat civil, et que celui qui
le garde est juste, celui qui le viole, injuste. Mais comme dans un
théâtre, quoique ce soit un lieu public, on ne laisse pas de dire
que la place que chacun y occupe est sa place, ainsi le droit
naturel dont je viens de parler, n'empêche pas que dans une cité ou
dans le monde commun à tous, chacun n'ait quelque chose de
particulier qui lui appartienne. L'homme cependant étant né pour
veiller à la défense et à la conservation des autres hommes, il est
de l'ordre de la nature que le sage consente à conduire et
administrer les États, et pour vivre selon nos préceptes, il faut
aussi qu'il prenne une femme et qu'il veuille en avoir des enfants.
Quelques-uns même ont cru que des amours saintement réglés n'étaient
pas contraires à la vie du sage. Certains stoïciens ont pensé que le
sage pourrait, dans l'occasion, s'accommoder de la doctrine et de la
vie de cyniques; mais d'autres ont repoussé complètement cette idée.
XXI. Mais pour faire que l'esprit d'union et de société
s'entretienne parmi les hommes, les
559
stoïciens conviennent que les avantages et les
désavantages qu'ils nomment ὠφελήματα et βλάμματα et dont les uns nous servent et les autres nous
nuisent, sont communs entre tous, et non seulement communs, mais
égaux. Pour les commodités et les incommodités (en grec εὐχρηστήματα et
δυσχρηστήματα), ils conviennent
qu'elles doivent être communes, mais non pas égales. En effet les
choses qui servent ou qui nuisent, sont des biens et des maux, et
partant, sont nécessairement égales. Mais les commodités et les
incommodités appartiennent à la classe des choses préférées et
rejetées, et peuvent ne pas être égales. Cependant, si nous disons
que les avantages sont communs à tous, nous n'entendons nullement
que les bonnes et les mauvaises actions soient pareillement
communes. Nous voulons qu'on cultive l'amitié, parce, qu'elle est de
la nature des choses avantageuses. Quoique les uns disent que le
sage doit aimer son ami autant que lui-même, et les autres, qu'il
est naturel que chacun s'aime d'abord préférablement à tout autre,
tous s'accordent en ce point que rien n'est plus contraire à la
justice naturelle que de dépouiller autrui d'un avantage pour s'en
emparer. Ils conviennent tous aussi que ce n'est point dans une vue
d'utilité qu'on doit cultiver l'amitié et la justice, car alors
quelque autre vue d'utilité pourrait ébranler et détruire l'une et
l'autre; et qu'il n'y a plus d'amitié ni de justice, si ce n'est pas
pour elles-mêmes qu'on les aime. Au surplus ce qui mérite d'être
appelé le droit, est fondé sur la nature, et rien ne convient moins
au sage non seulement que d'offenser ses semblables, mais même de
leur nuire le plus légèrement du monde. Nous ne croyons pas non plus
qu'il soit permis de faire avec ses amis ou ceux qui vous ont
obligé, des associations et des complots de haine et d'inimitié
contre personne; et ce que nous soutenons fortement et excellemment,
c'est que l'équité ne peut jamais être séparée de l'utilité; que
tout ce qui est équitable et juste, est toujours honnête, et
réciproquement que tout ce qui est honnête est toujours équitable et
juste. Aux vertus dont je viens de parler, les stoïciens ajoutent la
dialectique et la physique; et ils leur donnent même le nom de
vertus. Ce qui fait le mérite de la dialectique, c'est qu'elle nous
empêche de donner notre consentement à rien de faux, de nous laisser
tromper par des probabilités décevantes, et qu'elle nous met en état
de soutenir fortement nos sentiments touchant les biens et les maux.
Nous pensons que, sans la dialectique, tout esprit peut être écarté
de la vérité et jeté dans l'erreur. Si c'est à bon droit qu'en
toutes choses la témérité et l'ignorance sont regardées comme
vicieuses, l'art qui nous en délivre est donc très justement nommé
vertu.
XXII. Ce n'est pas non plus sans raison qu'on a rendu le même
honneur à la physique; car celui qui veut vivre conformément à la
nature doit connaître d'abord les lois et l'économie du morde. On ne
peut juger sainement des biens et des maux si l'on n'a une entière
connaissance de la nature et de la vie des Dieux; si l'on ne sait
qu'il y a ou qu'il n'y a pas d'harmonie entre l'homme et l'univers,
et si l'on ne possède bien les anciens préceptes des sages, qui
ordonnent “d'obéir au temps, de prendre Dieu pour modèle, de se
connaître soi-même, d'éviter tout excès.” Sans le secours de la
physique, on ne 560 peut bien
comprendre tout ce que signifient ces excellentes maximes. Ce n'est
aussi qu'en la connaissant à fond qu'on peut savoir combien la
nature conspire au maintien de la justice et à l'entretien des
amitiés et de toutes les affections qui lient les hommes. Ce n'est
enfin que par une étude approfondie de la nature qu'on peut parvenir
à comprendre, quelle doit être notre piété envers les Dieux, et
quelles grâces nous leur devons rendre. Mais je sens que je me suis
laissé aller plus loin que je ne m'étais proposé. C'est que
l'admirable tissu de cette doctrine, et l'ordre inconcevable des
choses qu'elle contient, m'ont entraîné. Vous-même, par les dieux
immortels! n'en êtes-vous pas charmé? Dites-moi si, dans les
ouvrages de la nature, cette ouvrière admirable et accomplie, et
dans les productions de l'art, il y a rien qui soit ni si bien
composé, ni si bien arrangé, ni qui se tienne si parfaitement
ensemble? y a-t-il à la fin du système une maxime qui ne s'accorde
pas avec les principes? et dans ce qui suit, quelque chose qui ne
réponde pas à ce qui précède? Toutes les parties n'en sont-elles pas
tellement liées les unes aux autres, qu'on ne pourrait en ôter une
seule lettre sans tout ébranler? et qu'en même temps, on n'en peut
ôter quoi que ce soit? Et quelle belle figure que celle du sage
stoïcien! quelle gaieté, quelle fermeté, quelle grandeur! Dès que la
raison lui a fait connaître que ce qui est honnête est le seul et
unique bien, il est assuré d'être toujours heureux, et il mérite
véritablement tous ces titres dont les ignorants se raillent
d'ordinaire. On peut l'appeler roi plus justement que Tarquin, qui
n'a su régner ni sur lui, ni sur les autres; maître du peuple ou
dictateur, plus justement que Sylla, qui ne fut autre chose que le
maître de trois vices effroyables, la luxure, l'avarice et la
cruauté; riche et fortuné, à plus juste titre que Crassus, qui
n'aurait jamais songé à porter sans motif la guerre au delà de
l'Euphrate, s'il ne se fût trouvé dans l'indigence au milieu de ses
richesses. C'est à juste titre que l'on dit encore que tout
appartient au sage, puisque seul il sait se servir de tout; à juste
titre qu'on l'appelle beau; car les traits de l'esprit sont fort
au-dessus de ceux du visage; qu'on dit que seul il est libre,
puisqu'il n'est soumis à l'empire de personne, et n'obéit jamais aux
passions; enfin qu'on le nomme invincible, puisque c'est en vain
qu'on mettra son corps dans les fers, jamais on ne pourra enchaîner
son âme. Il n'a pas non plus besoin d'attendre la fin de ses jours
pour que l'on juge s'il a été heureux, alors que ses destins seront
accomplis; comme l'un des sept sages le disait autrefois peu
sagement à Crésus. Car si Crésus avait jamais été effectivement
heureux, il aurait porté son bonheur jusque sur le bûcher que lui
fit dresser Cyrus. Si donc il n'y a que l'homme de bien qui puisse
être heureux, si tous les gens de bien sont véritablement heureux,
quoi de plus digne d'être cultivé que la philosophie, et de plus
divin que la vertu!
|