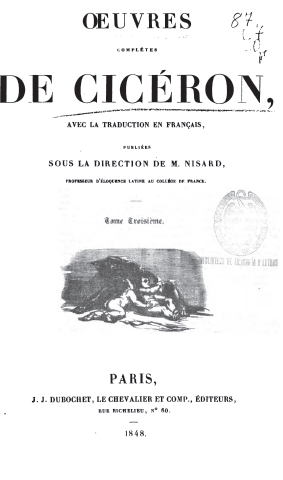|
I. Magnum ingenium L. Luculli magnumque optimarum
artium studium, tum omnis liberalis et digna homine nobili ab eo percepta
doctrina quibus temporibus florere in foro maxume potuit caruit omnino rebus
urbanis. Ut enim [urbanis] admodum adulescens cum fratre pari pietate et
industria praedito paternas inimicitias magna cum gloria est persecutus, in
Asiam quaestor profectus ibi permultos annos admirabili quadam laude provinciae
praefuit ; deinde absens factus aedilis, continuo praetor (licebat enim celerius
legis praemio), post in Africam, inde ad consulatum ; quem ita gessit ut
diligentiam admirarentur omnes ingenium agnoscerent. Post ad Mithridaticum
bellum missus a senatu non modo opinionem vicit omnium quae de virtute eius erat
sed etiam gloriam superiorum ; idque eo fuit mirabilius quod ab eo laus
imperatoria non admodum expectabatur, qui adulescentiam in forensi opera,
quaesturae diuturnum tempus Murena bellum in Ponto gerente in Asiae pace
consumpserat. Sed incredibilis quaedam ingenii magnitudo non desideravit
indocilem usus disciplinam. Itaque cum totum iter et navigationem consumpsisset
partim in percontando a peritis partim in rebus gestis legendis, in Asiam factus
imperator venit, cum esset Roma profectus rei militaris rudis. Habuit enim
divinam quandam memoriam rerum – verborum maiorem Hortensius ; sed quo plus in
negotiis gerendis res quam verba prosunt, hoc erat memoria illa praestantior.
Quam fuisse in Themistocle, quem facile Graeciae principem ponimus, singularem
ferunt ; qui quidem etiam pollicenti cuidam se artem ei memoriae, quae tum primum
proferebatur, traditurum respondisse dicitur oblivisci se malle discere, credo
quod haerebant in memoria quaecumque audierat et viderat. Tali ingenio praeditus
Lucullus adiunxerat etiam illam quam Themistocles spreverat disciplinam ; itaque
ut litteris consignamus quae monimentis mandare volumus sic ille in animo res
insculptas habebat. Tantus ergo imperator in omni genere belli fuit, proeliis
oppugnationibus navalibus pugnis totiusque belli instrumento et adparatu, ut
ille rex post Alexandrum maxumus hunc a se maiorem ducem cognitum quam quemquam
eorum quos legisset fateretur. In eodem tanta prudentia fuit in constituendis
temperandisque civitatibus, tanta aequitas, ut hodie stet Asia Luculli
institutis servandis et quasi vestigiis persequendis. Sed etsi magna cum
utilitate rei publicae, tamen diutius quam vellem tanta vis virtutis atque
ingenii peregrinata afuit ab oculis et fori et curiae. Quin etiam cum victor a
Mithridatico bello revertisset,
inimicorum calumnia triennio tardius quam
debuerat triumphavit ; nos enim consules introduximus paene in urbem currum
clarissimi viri. Cuius mihi consilium et auctoritas quid tum in maximis rebus
profuisset dicerem, nisi de me ipso dicendum esset, quod hoc tempore non est
necesse ; ita privabo potius illum debito testimonio quam id cum mea laude
communicem.
II. Sed quae populari gloria decorari in Lucullo
debuerunt, ea fere sunt et Graecis litteris celebrata et Latinis. Nos autem illa
externa cum multis, haec interiora cum paucis ex ipso saepe cognovimus. Maiore
enim studio Lucullus cum omni litterarum generi tum philosophiae deditus fuit
quam qui illum ignorabant arbitrabantur, nec vero ineunte aetate solum sed et
pro quaestore aliquot annos et in ipso bello, in quo ita magna rei militaris
esse occupatio solet ut non multum imperatori sub ipsis pellibus otii
relinquatur. Cum autem e philosophis ingenio scientiaque putaretur Antiochus
Philonis auditor excellere, eum secum et quaestor habuit et post aliquot annos
imperator, quique esset ea memoria quam ante dixi ea saepe audiendo facile
cognovit quae vel semel audita meminisse potuisset. Delectabatur autem mirifice
lectione librorum de quibus audiebat. Ac vereor interdum ne talium personarum
cum amplificare velim minuam etiam gloriam. Sunt enim multi qui omnino Graecas
non ament litteras, plures qui philosophiam, reliqui qui etiam si haec non
inprobent tamen earum rerum disputationem principibus civitatis non ita decoram
putent. Ego autem cum Graecas litteras M. Catonem in senectute didicisse
acceperim, P. Autem Africani historiae loquantur in legatione illa nobili, quam
ante censuram obiit, Panaetium unum omnino comitem fuisse, nec litterarum
Graecarum nec philosophiae iam ullum auctorem requiro. Restat ut iis respondeam
qui sermonibus eius modi nolint personas tam graves inligari. Quasi vero
clarorum virorum aut tacitos congressus esse oporteat aut ludicros sermones aut
rerum conloquia leviorum. Etenim
si quodam in libro vere est a nobis philosophia
laudata, profecto eius tractatio optimo atque amplissimo quoque dignissima est,
nec quicquam aliud [ut] videndum est nobis, quos populus Romanus hoc in gradu
conlocavit, nisi ne quid privatis studiis de opera publica detrahamus. Quod si
cum fungi munere debebamus non modo operam nostram umquam a populari coetu
removimus sed ne litteram quidem ullam fecimus nisi forensem, quis reprendet
otium nostrum, qui in eo non modo nosmet ipsos hebescere et languere nolumus sed
etiam ut plurimis prosimus enitimur. Gloriam vero non modo non minui sed etiam
augeri arbitramur eorum quorum ad populares inlustrisque laudes has etiam minus
notas minusque pervolgatas adiungimus. Sunt etiam, qui negent in is qui <in>
nostris libris disputent fuisse earum rerum de quibus disputatur scientiam. Qui
mihi videntur non solum vivis sed etiam mortuis invidere.
III. Restat unum genus reprehensorum, quibus
Academiae ratio non probatur. Quod gravius ferremus, si quisquam ullam
disciplinam philosophiae probaret praeter eam quam ipse sequeretur ; nos autem
quoniam contra omnes dicere qui scire sibi videntur solemus, non possumus quin
alii a nobis dissentiant recusare. Quamquam nostra quidem causa facilis est, qui
verum invenire sine ulla contentione volumus idque summa cura studioque
conquirimus. Etsi enim omnis cognitio multis est obstructa difficultatibus eaque
est et in ipsis rebus obscuritas et in iudiciis nostris infirmitas, ut non sine
causa antiquissimi et doctissimi invenire se posse quod cuperent diffisi sint,
tamen nec illi defecerunt neque nos studium exquirendi defatigati relinquemus.
Neque nostrae disputationes quicquam aliud agunt nisi ut in utramque partem
dicendo et audiendo eliciant et tamquam exprimant aliquid quod aut verum sit aut
ad id quam proxime accedat ; nec inter nos et eos qui se scire arbitrantur
quicquam interest nisi quod illi non dubitant quin ea vera sint quae defendunt,
nos probabilia multa habemus, quae sequi facile, adfirmare vix possumus. Hoc
autem liberiores et solutiores sumus, quod integra nobis est iudicandi potestas
nec ut omnia quae praescripta [et quibus] et quasi imperata sint defendamus
necessitate ulla cogimur. Nam ceteri primum ante tenentur adstricti quam quid
esset optimum iudicare potuerunt ; deinde infirmissimo tempore aetatis aut
obsecuti amico cuidam aut una aliquoius quem primum audierunt oratione capti de
rebus incognitis iudicant et ad quamcumque sunt disciplinam quasi tempestate
delati ad eam tamquam ad saxum adhaerescunt. Nam quod dicunt omnia se credere ei
quem iudicent fuisse sapientem, probarem, si id ipsum rudes et indocti iudicare
potuissent (statuere enim qui sit sapiens vel maxime videtur esse sapientis).
Sed ut potuerint, <aut> omnibus rebus auditis, cognitis etiam reliquorum
sententiis iudicaverunt, aut re semel audita ad unius se auctoritatem
contulerunt ; sed nescio quo modo plerique errare malunt eamque sententiam quam
adamaverunt pugnacissime defendere quam sine pertinacia quid constantissime
dicatur exquirere. Quibus de rebus et alias saepe nobis multa quaesita et disputata sunt et quondam
in Hortensi villa quae est ad Baulos, cum eo Catulus et Lucullus nosque ipsi
postridie venissemus quam apud Catulum fuissemus. Quo quidem etiam maturius
venimus, quod erat constitutum si ventus esset Lucullo in Neapolitanum mihi in
Pompeianum navigare. Cum igitur pauca
in xysto locuti essemus, tum eodem in
spatio consedimus.
IV. Hic Catulus, Etsi heri, inquit, id quod
quaerebatur paene explicatum est, ut tota fere quaestio tractata videatur, tamen
expecto ea quae te pollicitus es Luculle ab Antiocho audita dicturum. Equidem,
inquit Hortensius, feci plus quam vellem ; totam enim rem Catule Lucullo integram
servatam oportuit. Et tamen fortasse servata est ; a me enim ea quae in promptu
erant dicta sunt, a Lucullo autem reconditiora desidero. Tum ille ‹Non sane,
inquit, Hortensi conturbat me expectatio tua, etsi nihil est iis qui placere
volunt tam adversarium ; sed quia non laboro quam [quam] valde ea quae dico
probaturus sim, eo minus conturbor. Dicam enim nec mea nec ea, in quibus non si
non fuerint vinci me malim quam vincere. Sed mehercule, ut quidem nunc se causa
habet, etsi hesterno sermone labefacta est, mihi tamen videtur esse verissima.
Agam igitur sicut Antiochus agebat. Nota enim mihi res est ; nam et vacuo animo
illum audiebam et magno studio, eadem de re etiam saepius : ut etiam maiorem
expectationem mei faciam quam modo fecit Hortensius. Cum ita esset exorsus, ad
audiendum animos ereximus. At ille, Cum Alexandriae pro quaestore, inquit,
essem, fuit Antiochus mecum, et erat iam antea Alexandriae
familiaris Antiochi
Heraclitus Tyrius, qui et Clitomachum multos annos et
Philonem audierat, homo
sane in ista philosophia, quae nunc prope dimissa revocatur, probatus et
nobilis ; cum quo et Antiochum saepe disputantem audiebam – sed utrumque leniter
;
et quidem isti libri duo Philonis, de quibus heri dictum a Catulo est, tum erant
allati Alexandriam tumque primum in Antiochi manus venerant ; et homo natura
lenissumus (nihil enim poterat fieri illo mitius) stomachari tamen coepit.
Mirabar ; nec enim umquam ante videram. At ille Heracliti memoriam inplorans
quaerere ex eo viderenturne illa Philonis aut ea num vel e Philone vel ex ullo
Academico audivisset aliquando. Negabat, Philonis tamen scriptum agnoscebat ; nec
id quidem dubitari poterat, nam aderant mei familiares docti homines P. Et C.
Selii et Tetrilius Rogus, qui se illa audivisse Romae de Philone et ab eo ipso
duo illos libros dicerent descripsisse. Tum et illi dixit Antiochus quae heri
Catulus commemoravit a patre suo dicta Philoni et alia plura ; nec se tenuit quin
contra suum doctorem librum etiam ederet, qui Sosus inscribitur. Tum igitur et
cum Heraclitum studiose audirem contra Antiochum disserentem et item Antiochum
contra Academicos, dedi Antiocho operam diligentius, ut causam ex eo totam
cognoscerem. Itaque conplures dies adhibito Heraclito doctisque conpluribus et
in is Antiochi fratre Aristo et praeterea Aristone et Dione, quibus ille
secundum fratrem plurumum tribuebat, multum temporis in ista una disputatione
consumpsimus. Sed ea pars quae contra Philonem erat praetermittenda est ; minus
enim acer est adversarius is qui ista quae sunt heri defensa negat Academicos
omnino dicere ; etsi enim mentitur, tamen est adversarius lenior. Ad Arcesilan
Carneademque veniamus.
V. Quae cum dixisset, sic rursus exorsus est :
Primum mihi videmini (me autem nomine appellabat) cum
veteres physicos nominatis facere idem quod seditiosi cives solent cum aliquos ex antiquis claros viros
proferunt quos dicant fuisse populares, ut eorum ipsi similes esse videantur.
Repetunt a P. Valerio qui exactis regibus primo anno consul fuit, commemorant
reliquos qui leges populares de provocationibus tulerint cum consules essent ;
tum ad hos notiores, C. Flaminium qui legem agrariam aliquot annis ante secundum
Punicum bellum tribunus plebis tulerit invito senatu et postea bis consul factus
sit, L. Cassium Q. Pompeium. Illi quidem etiam P. Africanum referre in eundem
numerum solent ; duo vero sapientissimos et clarissimos fratres P. Crassum et P.
Scaevolam aiunt Tib. Graccho legum auctores fuisse, alterum quidem ut videmus
palam, alterum ut suspicantur obscurius. Addunt etiam C. Marium ; et de hoc
quidem nihil mentiuntur. Horum nominibus tot virorum atque tantorum expositis
eorum se institutum sequi dicunt. Similiter vos cum perturbare ut illi rem
publicam sic vos philosophiam bene iam constitutam velitis, Empedoclen
Anaxagoran Democritum Parmeniden Xenophanen, Platonem etiam et Socratem
profertis. Sed neque Saturninus, ut nostrum inimicum potissimum nominem, simile
quicquam habuit veterum illorum, nec Arcesilae calumnia conferenda est cum
Democriti verecundia. Et tamen isti physici raro admodum, cum haerent aliquo
loco, exclamant quasi mente incitati, Empedocles quidem ut interdum mihi furere
videatur, abstrusa esse omnia, nihil nos sentire nihil cernere nihil omnino
quale sit posse reperire ; maiorem autem partem mihi quidem omnes isti videntur
nimis etiam quaedam adfirmare plusque profiteri se scire quam sciant. Quod si
illi tum in novis rebus quasi modo nascentes haesitaverunt, nihilne tot saeculis
summis ingeniis maxumis studiis explicatum putamus ? nonne cum iam philosophorum
disciplinae gravissimae constitissent tum exortus est <ut> in optuma re publica
Tib. Gracchus qui otium perturbaret sic Arcesilas qui constitutam philosophiam
everteret et in eorum auctoritate delitisceret qui negavissent quicquam sciri
aut percipi posse. Quorum e numero tollendus est et Plato et Socrates, alter
quia reliquit perfectissimam disciplinam, Peripateticos et Academicos nominibus
differentes re congruentes, a quibus Stoici ipsi verbis magis quam sententiis
dissenserunt, – Socrates autem de se ipse detrahens in disputatione plus
tribuebat is quos volebat refellere ; ita cum aliud diceret atque sentiret,
libenter uti solitus est ea dissimulatione quam Graeci εἰρωνείαν vocant ; quam
ait etiam in Africano fuisse Fannius, idque propterea vitiosum in illo non
putandum quod idem fuerit in Socrate.
VI.
Sed fuerint illa vetera si voltis
incognita : nihilne est igitur actum, quod investigata sunt, postea quam
Arcesilas Zenoni ut putatur obtrectans nihil novi reperienti sed emendanti
superiores inmutatione verborum, dum huius definitiones labefactare volt,
conatus est clarissimis rebus tenebras obducere. Cuius primo non admodum probata
ratio (quamquam floruit cum acumine ingeni tum admirabili quodam lepore dicendi)
proxime a Lacyde solo retenta est, post autem confecta a Carneade. Qui est
quartus ab Arcesila ; audivit enim Hegesinum, qui Euandrum audierat Lacydi
discipulum, cum Arcesilae Lacydes fuisset. Sed ipse Carneades diu tenuit, nam
nonaginta vixit annos, et qui illum audierant admodum floruerunt. E quibus
industriae plurimum in Clitomacho fuit (declarat multitudo librorum), ingenii
non minus in Hagnone, in Charmada eloquentiae, in Melanthio Rhodio suavitatis
;
bene autem nosse Carneaden Stratoniceus Metrodorus putabatur. Iam Clitomacho
Philo vester operam multos annos dedit. Philone autem vivo patrocinium Academiae
non defuit. Sed, quod nos facere nunc ingredimur, ut contra Academicos
disseramus, id quidam e philosophis et quidem non mediocres faciundum omnino
non putabant, nec vero esse ullam rationem disputare cum is qui nihil probarent,
Antipatrumque Stoicum qui multus in eo fuisset reprehendebant
; nec definiri
aiebant necesse esse quid esset cognitio aut perceptio aut, si verbum e verbo
volumus, conprehensio, quam κατάλημψιν illi vocant ; eosque qui persuadere
vellent esse aliquid quod conprehendi et percipi posset inscienter facere
dicebant, propterea quod nihil esset clarius ἐναργείαι – ut Graeci,
perspicuitatem aut evidentiam nos si placet nominemus fabricemurque si opus erit
verba, nec hic sibi› (me appellabat iocans) ‹hoc licere soli putet – sed tamen
orationem nullam putabant inlustriorem ipsa evidentia reperiri posse, nec ea
quae tam clara essent definienda censebant. Alii autem negabant se pro hac
evidentia quicquam priores fuisse dicturos, sed ad ea quae contra dicerentur
dici oportere putabant, ne qui fallerentur. Plerique
tamen et definitiones ipsarum etiam evidentium rerum non inprobant et rem
idoneam de qua quaeratur et homines dignos quibuscum disseratur putant.
Philo autem dum nova quaedam commovet, quod ea sustinere vix poterat quae
contra Academicorum pertinaciam dicebantur, et aperte mentitur ut est
reprehensus a patre Catulo, et ut docuit Antiochus in id ipsum se induit quod
timebat. Cum enim ita negaret quicquam esse quod conprehendi posset (id enim
volumus esse ἀκατάλημπτον), si illud esset, sicut Zeno definiret, tale visum
(iam enim hoc pro φαντασίαι verbum satis hesterno sermone trivimus) – visum
igitur inpressum effictumque ex eo unde esset quale esse non posset ex eo unde
non esset (id nos a Zenone definitum rectissime dicimus ; qui enim potest
quicquam conprehendi, ut plane confidas perceptum id cognitumque esse, quod est
tale quale vel falsum esse possit ?) – hoc cum infirmat tollitque Philo, iudicium
tollit incogniti et cogniti ; ex quo efficitur nihil posse conprehendi. Ita
inprudens eo quo minime volt revolvitur. Quare omnis oratio contra Academiam
suscipitur a nobis, ut retineamus eam definitionem quam Philo voluit evertere ;
quam nisi optinemus, percipi nihil posse concedimus.
VII. Ordiamur igitur a sensibus. Quorum ita clara
iudicia et certa sunt, ut, si optio naturae nostrae detur et ab ea deus aliqui
requirat contentane sit suis integris incorruptisque sensibus an postulet melius
aliquid, non videam quid quaerat amplius. Nec vero hoc loco expectandum est dum
de remo inflexo aut de collo columbae respondeam
; non enim is sum qui quidquid
videtur tale dicam esse quale videatur ; Epicurus hoc viderit et alia multa. Meo
autem iudicio ita est maxima in sensibus veritas, si et sani sunt ac valentes et
omnia removentur quae obstant et inpediunt. Itaque et lumen mutari saepe volumus
et situs earum rerum quas intuemur, et intervalla aut contrahimus aut diducimus,
multaque facimus usque eo dum aspectus ipse fidem faciat sui iudicii. Quod idem
fit in vocibus in odore in sapore, ut nemo sit nostrum qui in sensibus sui
cuiusque generis iudicium requirat acrius. Adhibita vero exercitatione et arte,
ut oculi pictura teneantur aures cantibus, quis est quin cernat quanta vis sit
in sensibus. Quam multa vident pictores in umbris et in eminentia quae nos non
videmus ; quam multa quae nos fugiunt in cantu exaudiunt in eo genere exercitati,
qui primo inflatu tibicinis Antiopam esse aiunt aut Andromacham, cum id nos ne
suspicemur quidem. Nihil necesse est de gustatu et odoratu loqui, in quibus
intellegentia etsi vitiosa est quaedam tamen. Quid de tactu et eo quidem quem
philosophi interiorem vocant aut doloris aut voluptatis,
in quo Cyrenaici solo
putant veri esse iudicium, quia sentiatur – potestne igitur quisquam dicere
inter eum qui doleat et inter eum qui in voluptate sit nihil interesse, aut ita
qui sentiet non apertissime insaniat ? Atqui qualia sunt haec quae sensibus
percipi dicimus talia secuntur ea quae non sensibus ipsis percipi dicuntur sed
quodam modo sensibus, ut haec : «illud est album, hoc dulce, canorum illud, hoc
bene olens. Hoc asperum» : animo iam haec tenemus conprehensa non sensibus.
«ille» deinceps «equus est, ille canis». Cetera series deinde sequitur maiora
nectens, ut haec quae quasi expletam rerum conprehensionem amplectuntur : «si
homo est, animal est mortale rationis particeps». Quo e genere nobis notitiae
rerum inprimuntur, sine quibus nec intellegi quicquam nec quaeri <nec> disputari
potest. [22] quod si essent falsae notitiae (ἐννοίας enim notitias appellare tu
videbare) – si igitur essent eae falsae aut eius modi visis inpressae qualia
visa a falsis discerni non possent, quo tandem his modo uteremur, quo modo autem
quid cuique rei consentaneum esset quid repugnaret videremus ? Memoriae quidem
certe, quae non modo philosophiam sed omnis vitae usum omnesque artes una maxime
continet, nihil omnino loci relinquitur. Quae potest enim esse memoria falsorum,
aut quid quisquam meminit quod non animo conprehendit et tenet ? Ars vero quae
potest esse nisi quae non ex una aut duabus sed ex multis animi perceptionibus
constat ? quam si subtraxeris, qui distingues artificem ab inscio : non enim
fortuito hunc artificem dicemus esse illum negabimus, sed cum alterum percepta
et conprehensa tenere videmus alterum non item. Cumque artium aliud eius modi
genus sit ut tantum modo animo rem cernat, aliud ut moliatur aliquid et faciat,
quo modo aut geometres cernere ea potest quae aut nulla sunt aut internosci a
falsis non possunt, aut is qui fidibus utitur explere numeros et conficere
versus ; quod idem in similibus quoque artibus continget, quarum omne opus est
in faciendo atque agendo. Quid enim est quod arte effici possit nisi is qui
artem tractabit multa perceperit ?
VIII. Maxime vero virtutum cognitio confirmat
percipi et conprendi multa posse. In quibus solis inesse etiam scientiam
dicimus, quam nos non conprehensionem modo rerum sed eam stabilem quoque et
immutabilem esse censemus, itemque sapientiam artem vivendi, quae ipsa ex sese
habeat constantiam ; ea autem constantia si nihil habeat percepti et cogniti,
quaero unde nata sit aut quo modo. Quaero etiam, ille vir bonus, qui statuit
omnem cruciatum perferre, intolerabili dolore lacerari potius quam aut officium
prodat aut fidem, cur has sibi tam graves leges inposuerit, cum quam ob rem ita
oporteret nihil haberet conprehensi percepti cogniti constituti. Nullo igitur
modo fieri potest ut quisquam tanti aestimet aequitatem et fidem ut eius
conservandae causa nullum supplicium recuset, nisi is rebus adsensus sit quae
falsae esse non possint. Ipsa vero sapientia si se ignorabit sapientia sit
necne, quo modo primum obtinebit nomen sapientiae ? Deinde quo modo suscipere
aliquam rem aut agere fidenter audebit, cum certi nihil erit quod sequatur ? Cum
vero dubitabit quid sit extremum et ultimum bonorum, ignorans quo omnia
referantur, qui poterit esse sapientia ? Atque etiam illud perspicuum est,
constitui necesse esse initium quod sapientia cum quid agere incipiat sequatur,
idque initium esse naturae accommodatum. Nam aliter adpetitio (eam enim volumus
esse ὁρμὴν qua ad agendum impellimur et id adpetimus quod est visum) moveri non
potest. [25] illud autem quod movet prius oportet videri eique credi ; quod fieri
non potest, si id quod visum erit discerni non poterit a falso. Quo modo autem
moveri animus ad adpetendum potest, si id quod videtur non percipitur
adcommodatumne naturae sit an alienum ? Itemque, si quid officii sui sit non
occurrit animo, nihil umquam omnino aget, ad nullam rem umquam inpelletur,
numquam movebitur. Quod si aliquid aliquando acturus est, necesse est id ei
verum quod occurrit videri. Quid quod, si ista vera sunt,
ratio omnis tollitur quasi quaedam lux lumenque vitae : tamenne in ista pravitate
perstabitis ? nam quaerendi initium ratio attulit, quae perfecit virtutem, cum
esset ipsa ratio confirmata quaerendo ; quaestio autem est adpetitio cognitionis
quaestionisque finis inventio ; at nemo invenit falsa, nec ea quae incerta
permanent inventa esse possunt, sed cum ea quae quasi involuta ante fuerunt
aperta sunt, tum inventa dicuntur : sic et initium quaerendi et exitus
percipiundi et conprendendi tenet. Itaque argumenti conclusio, quae est Graece
ἀπόδειξις, ita definitur : «ratio quae ex rebus perceptis ad id quod non
percipiebatur adducit».
IX. Quod si omnia visa eius modi essent qualia
isti dicunt, ut ea vel falsa esse possent neque ea posset ulla notio discernere,
quo modo quemquam aut conclusisse aliquid aut invenisse dicemus, aut quae esset
conclusi argumenti fides ? Ipsa autem philosophia, quae rationibus progredi
debet, quem habebit exitum ? sapientiae vero quid futurum est, quae neque de se
ipsa dubitare debet neque de suis decretis (quae philosophi vocant δόγματα),
quorum nullum sine scelere prodi poterit ; cum enim decretum proditur, lex veri
rectique proditur, quo e vitio et amicitiarum proditiones et rerum publicarum
nasci solent ; non potest igitur dubitari quin decretum nullum falsum possit esse
sapientis neque satis sit non esse falsum sed etiam stabile fixum ratum esse
debeat, quod movere nulla ratio queat ; talia autem neque esse neque videri
possunt eorum ratione qui illa visa e quibus omnia decreta sunt nata negant
quicquam a falsis interesse. Ex hoc illud est natum, quod postulabat Hortensius,
ut id ipsum saltem perceptum a sapiente diceretis, nihil posse percipi. Sed
Antipatro hoc idem postulanti, cum diceret ei qui adfirmaret nihil posse percipi
[consentaneum esse] unum tamen illud dicere percipi posse consentaneum esse ut
alia non possent, Carneades acutius resistebat. Nam tantum abesse dicebat ut id
consentaneum esset, ut maxime etiam repugnaret. Qui enim negaret quicquam esse
quod perciperetur, eum nihil excipere ; ita necesse esse ne id ipsum quidem quod
exceptum non esset conprendi et percipi ullo modo posse. Antiochus ad istum
locum pressius videbatur accedere. Quoniam enim id haberent Academici decretum
(sentitis enim iam hoc me δόγμα dicere), nihil posse percipi, non debere eos in
suo decreto sicut in ceteris rebus fluctuari, praesertim cum in eo summa
consisteret : hanc enim esse regulam totius philosophiae, constitutionem veri
falsi cogniti incogniti ; quam rationem quoniam susciperent docereque vellent
quae visa accipi oporteret quae repudiari, certe hoc ipsum, ex quo omne veri
falsique iudicium esset, percipere eos debuisse ; etenim duo esse haec maxima in
philosophia, iudicium veri et finem bonorum, nec sapientem posse esse qui aut
cognoscendi esse initium ignoret aut extremum expetendi, ut aut unde
proficiscatur aut quo perveniendum sit nesciat ; haec autem habere dubia nec is
ita confidere ut moveri non possint abhorrere a sapientia plurimum. Hoc igitur
modo potius erat ab his postulandum ut hoc unum saltem, percipi nihil posse,
perceptum esse dicerent. Sed de inconstantia totius illorum sententiae – si ulla
sententia cuiusquam esse potest nihil adprobantis – sit ut opinor dictum satis. |
I. L. Lucullus avait un grand génie,
un goût très-vif pour les belles études ; toutes les connaissances
libérales et dignes d'un homme de sa naissance lui étaient
familières ; malheureusement à l'époque où il aurait pu surtout
demander au forum des triomphes, Rome et ses affaires lui manquèrent
constamment. Tout jeune encore, de concert avec un frère, son émule
en piété filiale et en talent, il tenta l'entreprise de venger les
injures paternelles, et s'y couvrit de gloire : bientôt après,
envoyé questeur en Asie, il y remplit pendant plusieurs années cette
charge avec toute la distinction imaginable ; nommé ensuite édile,
quoique absent, il fut aussitôt après promu à la préture, car il
pouvait être affranchi des délais par le bénéfice de la loi ; il
partit pour l'Afrique, en revint pour exercer le consulat, et s'y
comporta si bien que tout le monde admira son zèle et fut frappé de
sa vive intelligence. Envoyé ensuite par le sénat contre Mithridate,
il déploya dans cette guerre une telle valeur, que non-seulement il
surpassa les espérances qu'il avait données de son mérite, mais
laissa derrière lui tous ces anciens capitaines, si renommés ; ce
qui fut d'autant plus admirable, qu'il ne pouvait guère compter sur
cette gloire militaire, lui dont la jeunesse s'était écoulée à
l'ombre des tribunaux, et qui avait consumé en Asie, au sein de la
paix, les longues années de sa questure, pendant que Murena faisait
la guerre dans le Pont : mais la prodigieuse pénétration de son
esprit suppléa parfaitement à cette expérience des camps qui ne se
peut enseigner. Il employa tout le temps de son voyage à interroger
les hommes expérimentés, et à lire l'histoire des anciennes guerres.
Parti de Rome encore novice dans l'art militaire, quand il aborda en
Asie c'était un général consommé. Il avait une mémoire divine des
choses, quoiqu'il le cédât à Hortensius pour la mémoire des mots.
Mais, comme pour un homme d'action les choses ont plus d'importance
que les mots, la mémoire de Lucullus était bien préférable.
Thémistocle, que nous reconnaîtrons facilement comme le premier de
tous les Grecs, avait aussi, dit-on, une mémoire extraordinaire des
choses. Quelqu'un lui promettait de lui apprendre l'art, tout
récemment découvert, de perfectionner la mémoire ; j'aimerais mieux,
répondit-il, apprendre l'art d'oublier ; parce que, j'imagine, tout
ce qu'il entendait et voyait restait gravé dans son souvenir. Avec
les mêmes dons naturels, Lucullus avait invoqué le secours de cet
art, que méprisa Thémistocle. Ainsi, tout comme nous fixons par
l'écriture ce dont nous voulons
436 faire des monuments durables, il gravait en traits
ineffaçables les choses dans son esprit. Il se montra donc si grand
général dans toutes les parties de la guerre, combats, sièges,
batailles navales, administration des armées, équipement, appareil
militaire, que ce roi, le plus grand de tous depuis Alexandre, avoua
qu'il avait eu à faire à un plus grand capitaine qu'aucun de ceux
dont il avait lu les exploits. II déploya aussi tant d'habileté et
d'équité dans les constitutions et les lois que les cités reçurent
de lui, qu'aujourd'hui encore l'Asie repose sur les institutions de
Lucullus, et se soutient en suivant ses traces. Mais, quoique c'ait
été pour le plus grand intérêt de la république, je ne puis
m'empêcher de regretter qu'un si grand cœur et un si grand génie,
par son absence prolongée, ait manqué si longtemps au forum et au
sénat. Bien plus, revenu vainqueur de sa guerre contre Mithridate,
la calomnie de ses ennemis retarda de trois ans le triomphe qui lui
était dû. C'est nous consuls qui avons presque introduit dans Rome
le char de cet homme illustre. Combien ses conseils et sa légitime
influence sur mon esprit me servirent dans les circonstances les
plus graves, c'est ce que j'aimerais à dire, s'il ne me fallait en
même temps parler de moi, ce qui maintenant n'est pas nécessaire.
J'aime mieux le priver d'un hommage qui lui est dû que d'y mêler le
souvenir de mon propre mérite.
II. Mais à peu près tout ce qui chez
Lucullus méritait une gloire populaire, a été célébré par les muses
grecques et latines ; tout le monde a connu comme moi ces avantages
extérieurs ; mais en voici de plus secrets dont je n'ai partagé la
connaissance qu'avec un petit nombre de ses amis. Lucullus cultiva
tous les genres de littérature, et en particulier la philosophie,
avec beaucoup plus de soin que ne le pensaient ceux dont il n'était
pas bien connu, non-seulement pendant sa jeunesse, mais plusieurs
années encore lorsqu'il fut proquesteur, et même jusqu'au milieu des
camps, où d'ordinaire les soucis de la guerre absorbent tellement
l'esprit qu'ils ne laissent pas beaucoup de loisir au général sous
sa tente. Antiochus, disciple de Philon, ayant la réputation d'être
le premier des philosophes d'alors, par l'esprit et par la science,
Lucullus l'attira près de lui pendant sa questure, et quelques
années après lorsqu'il commandait les armées. Avec la prodigieuse
mémoire dont nous avons parlé, il lui fut facile de connaître par
des leçons répétées, ce dont une simple audition lui eût permis de
conserver le souvenir. Il éprouvait un vif plaisir à lire les
auteurs qu'il entendait citer. Mais je crains qu'en voulant ajouter
à la gloire de tels hommes, je n'arrive qu'à la ternir. Il est en
effet beaucoup de gens qui n'aiment pas les lettres grecques ;
d'autres qui montrent peu de bienveillance pour la philosophie ;
d'autres encore qui, sans proscrire ces études, pensent qu'il n'est
point de la dignité des chefs de l'État de descendre à discuter ces
questions oiseuses. Pour moi, lorsque je sais que M. Caton apprit
les lettres grecques dans sa vieillesse ; lorsque je lis dans nos
annales que P. L'Africain, dans cette célèbre ambassade dont on le
chargea avant qu'il fût censeur, n'emmena absolument d'autre
compagnon que Panétius : je ne cherche plus aucun patronage pour les
lettres grecques ni pour la philosophie. Je dois encore répondre à
ceux qui ne veulent point que des hommes aussi graves se commettent
dans de 437 tels
entretiens. Faut-il donc que les réunions d'hommes célèbres soient
muettes, ou le sérieux doit-il en être banni, et leurs conversations
ne porter que sur des objets frivoles ? Certes, si l'éloge que nous
avons fait de la philosophie dans un de nos livres est vrai, c'est
une étude digne d'occuper les meilleurs et les plus considérables
des hommes ; tout ce dont nous devons nous préoccuper, nous que le
peuple romain a élevés à un si haut rang, c'est de ne point donner à
nos études privées un temps que nous déroberions aux intérêts
publics. Que si, lorsque nous avons une charge à remplir,
non-seulement nous nous consacrons tout entiers aux affaires du
peuple, mais même nous n'écrivons pas une seule ligne qui n'y ait
rapport, comment pourrait-on critiquer nos loisirs, lorsque nous ne
nous contentons pas d'en bannir toute langueur et mollesse, mais
nous nous y efforçons encore d'être utiles à notre pays ? Nous
pensons donc ne rien ôter, mais ajouter encore à la gloire de ceux
dont nous montrons que les mérites populaires et éclatants allaient
en compagnie de ces mérites moins connus et plus secrets. Il est
aussi des gens qui contestent que les personnages introduits dans
nos livres aient été versés dans les sujets que nous y traitons.
C'est, ce me semble, porter envie non-seulement aux vivants, mais
aux morts.
III. Reste une dernière espèce
d'objections, celles des esprits qui n'approuvent point la méthode
de l'Académie. Elles me toucheraient beaucoup plus, s'il était
quelqu'un qui pût faire cas d'un autre système de philosophie que le
sien. Pour nous, dont l'habitude est d'attaquer tous ceux qui
croient avoir une science certaine, il faut bien que nous admettions
que les autres pensent différemment de nous. Cependant la cause la
plus facile à défendre, c'est la nôtre ; car nous voulons arriver à
la découverte de la vérité sans aucune opiniâtreté, et nous la
recherchons avec tout le zèle et tous les soins possibles. Quoique
le chemin de la vérité soit partout hérissé d'obstacles, quoiqu'il y
ait dans les choses une telle obscurité, et une telle infirmité dans
nos jugements, que ce ne soit pas sans raison que les plus doctes et
les plus anciens aient perdu l'espoir de découvrir ce qu'ils
souhaitaient connaître ; toutefois, de même que leur courage n'a pas
défailli, le nôtre non plus ne faiblit pas dans l'ardeur de nos
recherches. Tout le but de nos discussions, c'est, en soutenant tour
à tour les deux opinions contraires, de faire jaillir, et en quelque
sorte d'exprimer de cette lutte ou ce qui est le vrai ou ce qui en
approche le plus. Et il n'y a entre nous et ceux qui pensent avoir
une science certaine d'autre différence, si ce n'est qu'ils ne
doutent point que ce qu'ils soutiennent ne soit la vérité, tandis
que nous avons beaucoup d'opinions probables, qu'il est commode de
suivre, mais que nous ne voudrions pas affirmer. Ce qui précisément
nous donne plus de liberté et d'indépendance, c'est que nous avons
la pleine et entière disposition de notre jugement, et ne sommes
nullement contraints de soutenir des préceptes qui nous auraient été
en quelque façon imposés. Les autres sont liés avant d'avoir pu
juger par eux-mêmes du meilleur parti à prendre ; dans l'âge où
l'esprit est le plus faible, entraînés par un ami, séduits par le
premier discours qu'ils 438
entendent, il portent un jugement sur des choses qu'ils ne
connaissent pas, et s'attachent comme à un rocher à la doctrine où
les a poussés le vent. Quant à ce qu'ils disent, qu'ils s'en fient à
celui qu'ils ont reconnu pour sage, je le leur accorderai, si
l'ignorance et l'inexpérience pouvaient avoir un tel discernement
(car il semble qu'il ne faille jamais plus de sagesse que pour
savoir distinguer les sages) ; ce discernement, ils l'auraient eu,
après avoir tout entendu et pris connaissance des autres systèmes ;
mais à peine ont-ils entendu un parti, qu'ils se prononcent et
s'abandonnent à lui sans réserve. Je ne sais comment il se fait que
la plupart aiment mieux se tromper et défendre avec le dernier
acharnement l'opinion qu'ils ont embrassée, que de rechercher, sans
obstination, quelles idées se peuvent soutenir avec le plus de
conséquence. Ce sont là des questions que j'ai agitées et discutées
en plus d'une rencontre, et entre autres dans la villa d'Hortensius,
voisine de Baules, ou nous nous rendîmes, Catulus, Lucullus et moi,
le lendemain du jour que nous avions passé chez Catulus. Nous y
étions arrivés de meilleure heure encore, ayant décidé que, si le
vent le permettait, nous nous rendrions par mer, Lucullus à sa
campagne de Naples, et moi, à ma terre de Pompéi. Après un moment de
conversation dans la palestre, nous nous y assîmes tous les quatre.
IV. Catulus nous dit alors : Quoique
le sujet de notre entretien d'hier ait été assez complètement traité
pour qu'il puisse nous sembler à peu près épuisé, cependant,
Lucullus, j'espère que vous tiendrez votre promesse, et que vous
direz ce que vous avez appris d'Antiochus. —J'ai été plus loin que
je ne voulais, dit Hortensius ; il fallait réserver le sujet tout
entier à Lucullus ; et peut-être lui est-il réservé, car je n'ai pu
vous dire que ce qui me venait à l'esprit, et j'attends de Lucullus
des choses plus approfondies. — Cette attente, Hortensius, n'a rien
qui me trouble, lui répondit Lucullus, quoique d'ordinaire elle soit
l'échec de ceux qui veulent plaire ; mais comme je n'attache pas un
très-grand prix à convaincre les autres de la vérité des opinions
que j'exprime, je conserve toujours ma tranquillité. Je ne suis pas
l'auteur de la doctrine que je vais soutenir, et j'avoue que si elle
contient des erreurs, j'aime mieux être réfuté que de persuader les
autres. Mais, par Hercule, au point où en est maintenant notre
cause, quoique la journée d'hier ne lui ait pas été favorable, elle
me semble cependant la meilleure de toutes. Je suivrai donc de tous
points la méthode d'Antiochus, qui m'est parfaitement connue ; car
je l'écoutais avec l'esprit le plus libre du monde et une grande
application, et je l'entendis plusieurs fois traiter les mêmes
questions ; vous voyez bien que je vous promets encore plus
qu'Hortensius n'espérait de moi. Ce début de Lucullus excita en nous
la plus vive attention. Il reprit : Lorsque je remplissais à
Alexandrie les fonctions de proquesteur, Antiochus était près de moi
; mais auparavant déjà il avait à Alexandrie même lié amitié avec
Héraclite de Tyr, auditeur assidu de Clitomaque et de Philon pendant
plusieurs années, et qui s'était fait un renom mérité dans cette
philosophie que l'on remet en honneur aujourd'hui, après l'avoir
presque abandonnée. J'entendis souvent Antiochus discuter avec son
ami ; tous deux y mettaient beaucoup de douceur. Ce fut à cette
époque que les deux livres de Philon, dont nous parlait hier
Catulus, arrivèrent 439
à Alexandrie et tombèrent pour la première fois dans les mains
d'Antiochus : et cet homme, naturellement si calme (car on ne
saurait rien imaginer de plus doux que lui), ne put les lire sans
colère. J'en fus tout surpris ; je ne l'avais jamais vu dans cet
état. Il fait appel à la mémoire d'Héraclite ; il lui demande si
c'est bien là le langage de Philon, s'il a jamais entendu dire à
Philon ou à tout autre académicien quelque chose de semblable.
Héraclite assure que non. Cependant on reconnaissait le style de
Philon ; il ne pouvait y avoir de doute sur l'authenticité de
l'écrit : car j'avais là trois de mes amis, hommes instruits, P. Et
C. Lélius, et Tétrilius Rogus, qui affirmaient avoir entendu à Rome
Philon lui-même tenir ce langage, et copié de leurs mains les deux
livres sur l'écrit original. Antiochus fit alors toutes les
objections que Catulus nous disait hier avoir été adressées à Philon
par son père, et bien d'autres encore ; et il n'eut point de repos,
qu'il n'eût publié contre son maitre le livre intitulé Sosus.
Entendant alors avec beaucoup d'intérêt Héraclite discuter contre
Antiochus, et celui-ci contre les académiciens, je voulus connaître
avec le dernier soin, d'Antiochus lui-même, tout l'ensemble de la
controverse. C'est pourquoi, pendant plusieurs jours de suite, en
compagnie d'Héraclite et d'autres savants, parmi lesquels étaient
Aristus, le frère d'Anutiochus, Ariston et Dion, dont notre ami
faisait le plus d'estime après son frère, nous employâmes beaucoup
de temps à épuiser toute cette discussion. Je ne dis rien des
attaques dirigées contre Philon ; ce ne peut être un adversaire bien
rude, celui qui déclare que la doctrine dont on a présenté hier la
défense, n'est pas avouée par l'Académie. Quoiqu'il s'embarrasse peu
de la vérité, ce n'est pas toutefois un adversaire redoutable.
Venons à Arcésilas et Carnéade.
V. Voilà ce que nous dit Lucullus ; et
bientôt il poursuivit en ces termes : D'abord vous me semblez (et il
s'adressait à moi en me nommant), lorsque vous invoquez les anciens
physiciens, agir comme ces citoyens séditieux, qui mettent en avant
quelques hommes illustres des anciens âges, et vantent leur amour
pour le peuple, afin de paraître ressembler à ces modèles. Ils
remontent jusqu'à P. Valérius, qui fut consul la première année de
l'expulsion des rois ; ils citent les consuls qui proposèrent les
lois populaires sur les appels ; ils en viennent ensuite à ces
partisans du peuple mieux connus, un C. Flaminius, qui pendant son
tribunal, quelques années avant la seconde guerre punique, porta une
loi agraire malgré le sénat, et fut dans la suite nommé deux fois
consul ; un L. Cassius, un Q. Pompée ; ils mettent dans ce nombre
jusqu'à P. L'Africain ; ils affirment que Tib. Gracchus agissait
sous l'inspiration de deux frères aussi sages qu'illustres, P.
Crassus et P. Scévola, dont l'un le conseillait ouvertement, comme
nous le savons, et l'autre en secret, comme nous pouvons le
soupçonner ; ils ajoutent C. Marius à cette liste, et, sur celui-ci,
ils disent vrai ; après avoir étalé les noms de tant et de si grands
hommes, ils déclarent qu'ils ne font que marcher sur leurs traces.
Tout pareillement, lorsque vous voulez mettre la perturbation, non
pas dans une république, mais dans une philosophie bien constituée,
vous produisez Empédocle, Anaxagore, Démocrite, Parménide,
440 Xénophane, Platon
lui-même et Socrate. Mais ni Saturninus (pour citer de préférence
mon ennemi personnel) ne ressemble en rien à ces grands hommes des
temps passés ; ni les artifices d'Arcésilas ne peuvent être comparés
à la sage retenue de Démocrite. Cependant il arrive bien rarement
que ces physiciens, embarrassés par quelque grande difficulté,
s'écrient, comme s'ils n'étaient plus maîtres de leur esprit (ce qui
arrive parfois à Empédocle, à un tel point qu'il me semble en
démence) : Que tout est couvert de ténèbres ; que nous ne comprenons
rien, ne voyons rien ; que nous ne pouvons avoir de rien une
véritable connaissance. Mais la plupart du temps tous ces esprits
défiants me paraissent au contraire pousser trop loin leurs
affirmations, et faire plus montre de science qu'ils n'ont de fonds.
Que si dans des matières toutes neuves, et comme à la naissance de
la philosophie, ils ont pu se trouver quelquefois arrêtés,
pensons-nous que tant de siècles, tant d'efforts et de si beaux
génies n'aient rien produit ? N'est-il pas vrai que lorsque les
doctrines les plus graves se furent solidement établies, comme
naguère au sein d'une république excellemment organisée s'était
élevé Tib. Gracchus pour troubler le repos de l'État, alors s'élève
Arcésilas pour renverser toute la constitution de la philosophie, en
se couvrant du manteau de ceux qui avaient affirmé qu'on ne peut
rien connaître et rien savoir ? Mais de ce nombre il ne faut mettre
ni Platon, ni Socrate ; le premier a laissé la plus parfaite de
toutes les doctrines, celle des académiciens et des péripatéticiens,
qui diffèrent sur les termes et sont d'accord sur les choses ; et
dont les stoïciens eux-mêmes sont plutôt séparés par des mots que
par des principes. Pour Socrate, il avait l'habitude de s'effacer
dans une discussion, pour laisser plus d'avantages à ceux qu'il
voulait réfuter ; c'est pourquoi, accordant volontiers ce qu'il ne
pensait nullement, il aimait à se servir de cet artifice que les
Grecs nomment εἰρωνείαν, ironie, qui, au rapport de Fannius, était
aussi familière à l'Africain ; et pour le dire en passant, nous ne
pouvons regarder comme un défaut en lui ce qui lui est commun avec
Socrate.
VI. Mais admettons que la philosophie
ait été lettre close pour les anciens, condamnerez-vous également
toutes les recherches que l'on a faites depuis qu'Arcésilas accusant
Zénon de ne rien inventer de nouveau, mais de faire tout simplement
une réforme de mots dans les anciennes doctrines, et voulant ruiner
ses définitions, s'efforça de couvrir de ténèbres les choses du
monde les plus claires ? Malgré toute la finesse de son esprit et le
charme merveilleux de sa parole, son système, qui n'eut d'abord pas
grand succès, fut recueilli dans les premiers temps par le seul
Lacyde, puis dans la suite perfectionné par Carnéade, le quatrième
successeur d'Arcésilas. Carnéade en effet eut pour maître Égésine,
qui avait reçu les leçons d'Ëvandre, disciple de Lacyde, dont le
maître fut Arcésilas. Carnéade fut longtemps à la tête de cette
école, car il vécut quatre-vingt dix ans. Ses disciples eurent
beaucoup de renommée. Entre eux Clitomaque se distingua par son
activité, comme l'atteste la multitude de ses livres : il avait
autant d'esprit que Charmadas d'éloquence, et le Rhodien Mélanthius
de suavité. Métrodore de Stratonice avait la réputation de bien
connaître toute la pensée de Carnéade. Votre Philon avait entendu
Clitomaque pendant plusieurs années ; et tant que Philon vécut,
l'Académie eut un chaud défenseur. Quant à la tâche
441 que nous entreprenons
maintenant, de réfuter les académiciens, plusieurs philosophes, et
des meilleurs, pensaient qu'on ne devait point s'y engager ; qu'il
n'est point raisonnable de discuter avec ceux qui ne sont d'aucun
avis ; ils blâmaient Antipater le stoïcien qui s'était fort avancé
contre eux ; et disaient qu'il n'est point nécessaire de définir la
connaissance, ou la perception, ou, si nous voulons rendre mot pour
mot, la compréhension, que les Grecs nomment κατάληψιν. Ceux qui
veulent prouver, ajoutaient-ils, qu'il est des objets capables
d'être compris et perçus par l'esprit humain, ne savent ce qu'ils
font, attendu que rien n'est plus clair que l'ἐναργεία, comme disent
les Grecs, ce que nous pouvons nommer, si nous voulons, clarté ou
évidence ; et, s'il le faut, nous fabriquerons des mots nouveaux,
pour que Cicéron ne croie pas (ajouta-t-il eu plaisantant) que lui
seul ait cette licence. Ils pensaient donc qu'aucun discours ne peut
être plus clair que l'évidence, et disaient qu'on ne doit pas
définir ce qui de soi est si lumineux. D'autres répondaient qu'ils
se garderaient bien de parler les premiers en faveur de l'évidence,
mais qu'ils estimaient nécessaire de réfuter ce qu'on dirait contre
elle, et qui pourrait mener certains esprits à l'erreur. Le plus
grand nombre cependant ne s'oppose pas à ce qu'on définisse même les
choses évidentes, et pense qu'il y a là un problème digne d'occuper
l'esprit, et que les académiciens méritent que l'on discute avec
eux. Mais Philon dressant de nouvelles batteries pour échapper à la
critique que l'on faisait aux académiciens d'être obstinés comme les
autres, insulte d'abord ouvertement à la vérité, ainsi que le lui a
reproché le père de Catulus, et se jette lui-même dans le piège
qu'il redoutait. Il déclare que l'on ne peut rien comprendre
(c'est-à-dire que tout est acataleptique, à ἀκατάληπτον), si la
compréhension a pour fondement, comme le dit Zénon, une certaine
représentation (je crois que nous nous sommes familiarisés dans
notre entretien d'hier avec cette traduction du grec φαντασία), une
représentation formée et moulée d'après l'objet dont elle émane, et
telle que toute autre représentation qui ne viendrait pas de ce même
objet ne pourrait lui être semblable : définition excellente, selon
moi ; car comment nous fier à une perception et la croire fidèle, si
le mensonge peut prendre à nos yeux la même figure que la vérité ?
Ainsi Philon, en attaquant le principe de Zénon, nous ôte tout moyen
de distinguer le faux du vrai ; d'où il résulte qu'il n'y a aucune
connaissance possible, et que, sans y prendre garde, il retombe dans
une extrémité qu'il voulait fuir. Nous entreprenons donc notre
discussion contre l'Académie pour sauver cette définition de Zénon,
que Philon voulait ruiner. Si nous n'en venons à bout, nous devrons
accorder qu'on ne peut rien connaître.
VII. Commençons donc par les sens.
Leurs jugements sont si clairs et si certains, que si l'on donnait
le choix à notre nature, et qu'un dieu lui demandât si l'entière et
parfaite possession de ses sens la satisfait pleinement, ou si elle
désire quelque chose de mieux encore, je ne vois trop ce qu'elle
pourrait demander. Il ne faut pas attendre ici que je réponde aux
objections de la rame rompue et du cou de la colombe. Je ne suis pas
homme 442 à déclarer
que tout ce qui frappe nos yeux est tel qu'il nous paraît ; c'est à
Épicure à se tirer de cette difficulté, et de bien d'autres. A mon
avis, le témoignage des sens est excellent lorsqu'ils sont sains et
en bon état, et que tous les embarras et obstacles du dehors sont
levés. C'est ainsi que nous voulons souvent que les objets
contemplés par nous soient éclairés et situés d'une autre façon ;
que nous les approchons et les éloignons ; que nous opérons enfin
vingt changements, jusqu'à ce que leur aspect nous soit de lui-même
un sûr garant de l'exactitude de nos perceptions. Il en est de même
pour la voix, pour l'odeur, la saveur, et vous ne trouverez personne
d'entre vous qui demande pour nos sens, chacun dans sa sphère, un
jugement plus pénétrant. Mais qui ne voit quelle perfection
l'exercice et la culture de l'art peuvent donner à nos sens ? quels
instruments la peinture ne fait-elle pas de nos yeux et la musique
de nos oreilles ? Combien, dans les ombres et les saillies, un
peintre ne sait-il pas découvrir de nuances qui nous échappent ?
Combien dans un chant ne perdons-nous pas de détails et de beautés
qu'entendent les gens habiles ? Au premier son de la flûte, ils
savent ce que l'on joue ; c'est l'Antiope, c'est l'Andromaque ;
tandis que nous n'en avons pas même le soupçon. Il n'est pas
nécessaire de parler du goût et de l'odorat ; ils servent à nous
instruire, quoique imparfaitement, il est vrai. Que dire du tact, et
surtout de celui que les philosophes nomment intérieur, de ce sens
de la douleur et de la volupté que les Cyrénaîques regardent comme
le seul juge de la vérité, parce qu'il nous donne des émotions
indubitables ? Quelqu'un peut-il dire qu'entre celui qui souffre et
celui qui est dans la volupté, il n'est pas de différence ? Celui
qui soutiendrait une telle opinion, ne serait-il pas manifestement
en démence ? Telles sont les représentations que perçoivent
directement nos sens ; telles sont ces notions que l'on n'attribue
pas précisément aux sens, mais qui leur appartiennent en quelque
façon, comme par exemple : Cet objet est blanc, cet autre est doux,
ceci est sonore, ce corps sent bon, celui-là est rude ; car se sont
là déjà des appréhensions de l'esprit et non plus des sens. Viennent
ensuite des propositions de ce genre : Cet animal est un cheval,
celui-ci est un chien. Puis celles où se trouvent unis des termes
plus importants, et qui renferment comme une idée accomplie de
l'objet : telle est celle-ci, par exemple : Si l'homme existe, c'est
un animal mortel et raisonnable. Ce sont elles qui fixent dans nos
esprits les notions des choses, notions sans lesquelles on ne peut
rien comprendre, rien étudier, raisonner sur rien. Mais si ces
notions étaient fausses (vous traduisiez, je crois, ἐννοίας par
notions] ; si elles étaient fausses, ou imprimées dans notre esprit
par des représentations telles qu'on ne saurait distinguer les
fausses des vraies, à quoi pourraient-elles nous servir ? Comment
pourrions nous reconnaître ce qui est conforme ou contraire à la
nature de chaque chose ? Non-seulement la philosophie, mais tous les
arts utiles à la vie, tous les travaux de l'esprit dépendent surtout
de la mémoire ; mais la mémoire avec une telle supposition ne
s'évanouit-elle pas ? Qu'est-ce qu'une mémoire de mensonges ? Et
comment se souvenir de ce que l'esprit ne saisit et ne possède pas ?
Qu'est-ce qui constitue un art ? Ce n'est pas une ou deux notions,
mais un grand nombre de perceptions de l'esprit. Si vous mettez
443 ces perceptions au
néant, comment distinguerez-vous l'ignorant de l'artiste ? Ce n'est
pas au hasard que nous déclarons tel homme un artiste, et nions que
tel autre le soit ; c'est parce que nous voyons l'un riche de
perceptions et de notions, et l'autre, pauvre. Et comme il y a deux
espèces d'arts, les uns qui consistent seulement dans la
connaissance spéculative des choses, les autres qui vont à l'action
et sont pratiques ; comment le géomètre, par exemple, pourra-t-il
contempler des objets qui n'existent pas ou que l'on ne peut
distinguer de vaines apparences ? ou comment le joueur de lyre
pourra-t-il suivre la mélodie et dérouler tout l'ensemble du poème ?
La même impossibilité se manifestera pour tous les arts du même
genre, renfermés dans l'exécution et l'action. Que faire par art, à
moins que celui qui l'exerce n'ait rassemblé un grand nombre de
notions ?
VIII. L'idée des vertus nous prouve
mieux que tout le reste que l'on peut percevoir et comprendre
beaucoup de choses. C'est dans les vertus seules que nous plaçons la
science, qui pour nous n'est pas seulement l'intelligence des
choses, mais qui possède le double caractère de stabilité et
d'immutabilité, et se confond avec la sagesse, ou l'art de la vie,
dont le propre est l'inébranlable égalité. Mais si ce beau caractère
de la sagesse n'est pas une conséquence des lumières, je demande où
il a pris naissance et d'où il peut venir ? Je demande encore
pourquoi l'homme de bien qui s'est résolu à souffrir tous les
tourments, à se laisser déchirer par les plus intolérables tortures
plutôt que de trahir son devoir ou sa foi, je demande pourquoi il
s'est imposé de si dures lois, lorsqu'il n'avait pour s'immoler
ainsi ni motif, ni raison, ni fondement ? Il est cent fois
impossible qu'un homme fasse de l'équité et de l'honneur un tel prix
qu'il ne recule pour les respecter devant aucun supplice, s'il n'a
reconnu avec évidence des choses qui ne peuvent être fausses. Une
sagesse qui s'ignore, est-elle la sagesse, oui ou non ? Et d'abord
comment mériterait-elle de s'appeler sagesse ? Comment ensuite
oserait-elle prendre résolument et poursuivre énergiquement un
parti, s'il n'est point de règles certaines qui la guident ? Et si
elle ne sait quel est le bien suprême et par excellence, ignorant à
quelle fin tout doit se rapporter, comment serait-ce la sagesse ? De
plus, il est manifeste qu'il faut établir un principe que suive le
sage, lorsqu'il passe à l'action, et que ce principe doit être
accommodé à la nature. Car autrement l'appétit, c'est ainsi que nous
traduisons ὁρμήν, qui nous incite à agir, et par lequel nous
aspirons à ce qui nous est représenté, ne pourrait être mis en
mouvement. Mais qu'est-ce qui peut déterminer ce mouvement, si ce
n'est la vue d'un objet et la conviction de sa réalité ? Deux
conditions impossibles, si l'on ne peut distinguer les fausses
représentations des vraies. D'un autre côté, comment les désirs de
l'esprit seraient-ils éveillés, quand il ne peut distinguer si
l'objet qu'il voit est conforme ou contraire à la nature ? Et par la
même raison, si l'homme ne peut connaître quels sont ses devoirs, il
n'agira jamais, n'éprouvera de penchant pour rien, et ne sentira
aucune impulsion s'élever en lui. S'il se résout jamais à agir,
c'est que nécessairement il aura vu luire la vérité devant lui. Eh
quoi! si l'on vous prouve que votre opinion anéantit la raison,
cette lumière et ce flambeau de la vie, persisterez-vous dans une
thèse aussi déplorable ? C'est la raison
444 qui provoque toutes
les recherches ; c'est elle qui, se fortifiant dans ce rude travail,
donne enfin à la vertu toute sa perfection. Une question exprime le
désir de connaître ; le but d'une question, c'est une découverte.
Mais personne ne découvre ce qui n'est point ; ce qui demeure dans
le doute ne peut être découvert non plus ; mais lorsque ce qui était
comme enveloppé dans l'ombre est mis en lumière, on dit alors qu'il
y a découverte. C'est ainsi que le principe et la fin de toute
recherche, qui aboutit à la connaissance et à l'intelligence,
dépendent de la raison. C'est pourquoi on définit l'argument
concluant (que les Grecs nomment ἀπόδειξις) : la raison qui conduit
l'esprit de choses connues comme vraies à ce qui était encore
douteux.
IX. Que si toutes les représentations
étaient, comme ils le disent, confusément vraies ou fausses, sans
qu'il y eût aucun moyen de les distinguer, comment pourrions-nous
dire que quelqu'un a fait une démonstration ou une découverte ?
Comment se fier à la conséquence d'un raisonnement ? à quoi la
philosophie, qui n'est qu'une série de raisonnements, pourra-t-elle
aboutir ? que deviendra la sagesse, qui ne doit douter ni
d'elle-même, ni de ses décrets, que les philosophes nomment des
dogmes, δόγματα, dont aucun ne peut être trahi sans crime ? Car
lorsqu'on trahit un décret de la sagesse, c'est la loi du vrai et du
bien que l'on met sous ses pieds. Après une telle profanation, les
intérêts les plus sacrés de l'amitié et de la société sont bientôt
immolés. Il est donc indubitable que la sagesse ne peut recevoir de
faux décrets ; et ce n'est pas assez pour le sage ; il lui faut des
règles stables, fixes, démontrées, inattaquables. Mais c'est ce qui
ne se peut rencontrer, et est incompatible avec le système de ceux
qui ne veulent admettre aucune différence entre les représentations
d'où sont nés ces décrets et les vains fantômes. Dans cette
extrémité, qu'on accorde au moins-au sage, comme le demandait
Hortensius, de connaître véritablement qu'on ne peut rien connaître.
Antipater le demandait aussi, lorsqu'il disait qu'affirmer que l'on
ne peut rien connaître, c'est affirmer par conséquent qu'il est une
chose que l'on peut parfaitement connaître, à savoir, que toutes les
autres nous seront toujours inconnues. Mais Carnéade le réfuta avec
une extrême subtilité : Tant s'en fallait, disait-il, que ce fût là
une conséquence légitime, qu'au contraire c'était une contradiction
formelle. Quand on nie qu'on puisse rien connaître, c'est sans
restriction ; il est donc nécessaire que cette connaissance, tombant
sous la loi générale, soit refusée à l'homme comme toutes les
autres. C'est contre cette prétention surtout qu'Antiochus dirigeait
ses coups. Puisque, disait-il, les académiciens ont pour dogme qu'on
ne peut rien connaître, il ne faut pas qu'ils témoignent sur ce
dogme la même indécision que sur tout le reste, d'autant plus que
c'est là la pierre angulaire de leur doctrine. C'est bien là en
effet la règle fondamentale de toute leur philosophie, la pierre de
touche du vrai et du faux, du connu et de l'inconnu. Puisque tel est
leur système, puisqu'ils veulent apprendre à tout homme ce qu'il
doit admettre et ce qu'il doit rejeter incontestablement, ils ont dû
reconnaître la certitude de ce principe dont ils font le juge
souverain du vrai et 445
du faux Les deux points les plus graves de la philosophie, sont le
critérium de la vérité et le souverain bien ; le sage ne peut
ignorer quel est le fondement de la certitude et le terme légitime
de tous les désirs, d'où il doit partir et où il doit arriver. Avoir
sur ce double objet des doutes au lieu de croyances, ou des
croyances molles et chancelantes, c'est ce qui répugne tout à fait à
la sagesse. Il était donc bien plus raisonnable de leur demander
d'avouer que l'on peut au moins connaître l'impossibilité de la
connaissance. Mais en voilà assez, à ce que je pense, sur
l'inconséquence de leur doctrine, si toutefois on peut dire que des
gens qui doutent de tout aient une doctrine.
|
|
X. Sequitur disputatio copiosa illa quidem sed
paulo abstrusior – habet enim aliquantum a physicis, ut verear ne maiorem
largiar ei qui contra dicturus est libertatem et licentiam ; nam quid eum
facturum putem de abditis rebus et obscuris, qui lucem eripere conetur ? – sed
disputari poterat subtiliter quanto quasi artificio natura fabricata esset
primum animal omne deinde hominem maxime, quae vis esset in sensibus, quem ad
modum prima visa nos pellerent, deinde adpetitio ab his pulsa sequeretur, tum ut
sensus ad res percipiendas intenderemus. Mens enim ipsa, quae sensuum fons est
atque etiam ipsa sensus est, naturalem vim habet, quam intendit ad ea quibus
movetur. Itaque alia visa sic arripit ut iis statim utatur, alia quasi recondit,
e quibus memoria oritur ; cetera autem similitudinibus construit, ex quibus
efficiuntur notitiae rerum, quas Graeci tum ἐννοίας tum προλήμψεις vocant ; eo
cum accessit ratio argumentique conclusio rerumque innumerabilium multitudo, tum
et perceptio eorum omnium apparet et eadem ratio perfecta is gradibus ad
sapientiam pervenit. Ad rerum igitur scientiam vitaeque constantiam aptissima
cum sit mens hominis amplectitur maxime cognitionem et istam κατάλημψιν, quam ut
dixi verbum e verbo exprimentes conprensionem dicemus, cum ipsam per se amat
(nihil enim est ei veritatis luce dulcius) tum etiam propter usum. Quocirca et
sensibus utitur et artes efficit quasi sensus alteros et usque eo philosophiam
ipsam corroborat ut virtutem efficiat, ex qua re una vita omnis apta sit. Ergo i
qui negant quicquam posse conprendi haec ipsa eripiunt vel instrumenta vel
ornamenta vitae, vel potius etiam totam vitam evertunt funditus ipsumque animal
orbant animo, ut difficile sit de temeritate eorum perinde ut causa postulat
dicere. Nec vero satis constituere possum quod sit eorum consilium aut quid
velint. Interdum enim cum adhibemus ad eos orationem eius modi, si ea quae
disputentur vera sint tum omnia fore incerta, respondent : «quid ergo istud ad
nos ? num nostra culpa est ? naturam accusa, quae in profundo veritatem ut ait
Democritus penitus abstruserit». Alii autem elegantius, qui etiam queruntur quod
eos insimulemus omnia incerta dicere, quantumque intersit inter incertum et id
quod percipi non possit docere conantur eaque distinguere. Cum his igitur
agamus, qui haec distingunt, illos, qui omnia sic incerta dicunt ut stellarum
numerus par an impar sit, quasi desperatos aliquos relinquamus. Volunt enim (et
hoc quidem vel maxime vos animadvertebam moveri) probabile aliquid esse et quasi
veri simile, eaque se uti regula et in agenda vita et in quaerendo ac
disserendo.
XI. Quae ista regula est veri et falsi, si
notionem veri et falsi propterea quod ea non possunt internosci nullam habemus ?
nam si habemus, interesse oportet ut inter rectum et pravum sic inter verum et
falsum. Si nihil interest, nulla regula est, nec potest is cui est visio veri
falsique communis ullum habere iudicium aut ullam omnino veritatis notam. Nam
cum dicunt hoc se unum tollere, ut quicquam possit ita <verum> videri ut non
eodem modo falsum etiam possit [ita] videri, cetera autem concedere, faciunt
pueriliter. Quo enim omnia iudicantur sublato reliqua se negant tollere ; ut si
quis quem oculis privaverit dicat ea quae cerni possent se ei non ademisse. Ut
enim illa oculis modo agnoscuntur sic reliqua visis, sed propria veri non
communi veri et falsi nota. Quam ob rem sive tu probabilem visionem sive probabilem et quae non inpediatur, ut Carneades volebat, sive aliud quid
proferes quod sequare, ad visum illud de quo agimus tibi erit revertendum. In eo
autem si erit communitas cum falso, nullum erit iudicium, quia proprium in
communi signo notari non potest. Sin autem commune nihil erit, habeo quod volo ;
id enim quaero quod ita mihi videatur verum <ut> non possit item falsum videri.
Simili in errore versantur cum convicio veritatis coacti perspicua a perceptis
volunt distinguere et conantur ostendere esse aliquid perspicui, verum illud
quidem et inpressum in animo atque mente, neque tamen id percipi ac conprendi
posse. Quo enim modo perspicue dixeris album esse aliquid, cum possit accidere
ut id quod nigrum sit album esse videatur, aut quo modo ista aut perspicua
dicemus aut inpressa subtiliter, cum sit incertum vere inaniterne moveatur : ita
neque color neque corpus nec veritas nec argumentum nec sensus neque perspicuum
ullum relinquitur. Ex hoc illud is usu venire solet, ut quicquid dixerint a
quibusdam interrogentur «ergo istuc quidem percipis ?». Sed qui ita interrogant
ab iis inridentur. Non enim urguent ut coarguant neminem ulla de re posse
contendere nec adseverare sine aliqua eius rei quam sibi quisque placere dicit
certa et propria nota. Quod est igitur istuc vestrum probabile ? nam si quod
cuique occurrit et primo quasi aspectu probabile videtur id confirmatur, quid eo
levius ; sin ex circumspectione aliqua et accurata consideratione quod visum
sit id se dicent sequi, tamen exitum non habebunt, primum quia is visis inter
quae nihil interest aequaliter omnibus abrogatur fides ; deinde, cum dicant posse
accidere sapienti ut cum omnia fecerit diligentissimeque circumspexerit existat
aliquid quod et veri simile videatur et absit longissime <a> vero, <ne> si
magnam partem quidem, ut solent dicere, ad verum ipsum aut quam proxime accedant
confidere sibi poterunt. Ut enim confidant, notum iis esse debebit insigne veri
;
quo obscuro et oppresso quod tandem verum sibi videbuntur attingere ? quid autem
tam absurde dici potest quam cum ita locuntur : «est hoc quidem illius rei signum
aut argumentum, et ea re id sequor, sed fieri potest ut id quod significatur aut
falsum sit aut nihil sit omnino».
Sed de perceptione hactenus ; si quis enim ea quae dicta sunt labefactare volet,
facile etiam absentibus nobis veritas se ipsa defendet.
XII. His satis cognitis quae iam explicata sunt
nunc de adsensione atque adprobatione, quam Graeci συγκατάθεσιν vocant, pauca
dicemus, non quo non latus locus sit, sed paulo ante iacta sunt fundamenta. Nam
cum vim quae esset in sensibus explicabamus, simul illud aperiebatur, conprendi
multa et percipi sensibus, quod fieri sine adsensione non potest. Deinde cum
inter inanimum et animal hoc maxime intersit, quod animal agit aliquid (nihil
enim agens ne cogitari quidem potest quale sit), aut ei sensus adimendus est aut
ea quae est in nostra potestate sita reddenda adsensio. [38] et vero animus
quodam modo eripitur iis quos neque sentire neque adsentiri volunt. Ut enim
necesse est lancem in libram ponderibus inpositis deprimi sic animum perspicuis
cedere. Nam quo modo non potest animal ullum non adpetere id quod adcommodatum
ad naturam adpareat (Graeci id οἰκεῖον appellant), sic non potest obiectam rem
perspicuam non adprobare. Quamquam si illa de quibus disputatum est vera sunt,
nihil attinet de adsensione omnino loqui ; qui enim quid percipit adsentitur
statim. Sed haec etiam secuntur, nec memoriam sine adsensione posse constare nec
notitias rerum nec artes ; idque quod maximum est, ut sit aliquid in nostra
potestate, in eo qui rei nulli adsentietur non erit. Ubi igitur virtus, si nihil
situm est in ipsis nobis ? Maxime autem absurdum vitia in ipsorum esse potestate
neque peccare quemquam nisi adsensione, hoc idem in virtute non esse, cuius
omnis constantia et firmitas ex is rebus constat quibus adsensa est et quas
adprobavit. Omninoque ante videri aliquid quam agamus necesse est eique quod
visum sit adsentiatur. Quare qui aut visum aut adsensum tollit is omnem actionem
tollit e vita.
XIII. Nunc ea videamus quae contra ab his
disputari solent. Sed prius potestis totius eorum rationis quasi fundamenta
cognoscere. Conponunt igitur primum artem quandam de his quae visa dicimus,
eorumque et vim et genera definiunt, in his quale sit id quod percipi et
conprendi possit, totidem verbis quot Stoici. Deinde illa exponunt duo, quae
quasi contineant omnem hanc quaestionem : quae ita videantur ut etiam alia eodem
modo videri possint nec in is quicquam intersit, non posse eorum alia percipi
alia non percipi ; nihil interesse autem non modo si omni ex parte eiusdem modi
sint sed etiam si discerni non possint. Quibus positis unius argumenti
conclusione tota ab his causa conprenditur. Conposita autem ea conclusio sic
est : «eorum quae videntur alia vera sunt alia falsa ; et quod falsum est id
percipi non potest, quod autem verum visum est, id omne tale est ut eiusdem modi
falsum etiam possit videri» ; et quae visa sint eius modi ut in is nihil
intersit, non posse accidere ut eorum alia percipi possint alia non possint ;
«nullum igitur est visum quod percipi possit». Quae autem sumunt ut concludant
id quod volunt, ex his duo sibi putant concedi (neque enim quisquam repugnat) ;
ea sunt haec : quae visa falsa sint ea percipi non posse ; et alterum : inter quae
visa nihil intersit, ex is non posse alia talia esse ut percipi possint alia ut
non possint. Reliqua vero multa et varia oratione defendunt, quae sunt item duo
:
unum, quae videantur eorum alia vera esse alia falsa ; alterum, omne visum quod
sit a vero tale esse quale etiam a falso possit esse. Haec duo proposita non
praetervolant sed ita dilatant ut non mediocrem curam adhibeant et diligentiam.
Dividunt enim in partes et eas quidem magnas, primum in sensus, deinde in ea
quae ducuntur a sensibus et ab omni consuetudine, quam obscurari volunt ; tum
perveniunt ad eam partem ut ne ratione quidem et coniectura ulla res percipi
possit. Haec autem universa concidunt etiam minutius. Ut enim de sensibus
hesterno sermone vidistis item faciunt de reliquis, in singulisque rebus, quas
in minima dispertiunt, volunt efficere iis omnibus quae visa sint veris adiuncta
esse falsa quae a veris nihil differant ; ea cum talia sint non posse conprendi.
XIV. Hanc ego subtilitatem philosophia quidem
dignissimam iudico sed ab eorum causa qui ita disserunt remotissimam.
Definitiones enim et partitiones et horum luminibus utens oratio, tum
similitudines dissimilitudinesque et earum tenuis et acuta distinctio fidentium
est hominum illa vera et firma et certa esse quae tutentur, non eorum qui
clament nihilo magis vera illa esse quam falsa. Quid enim agant, si cum aliquid
definierint roget eos quispiam num illa definitio possit in aliam rem transferri
quamlubet : si posse dixerint, quid [enim] dicere habeant cur illa vera definitio
sit ; si negaverint, fatendum sit, quoniam †vel illa vera† definitio transferri
non possit in falsum, quod ea definitione explicetur id percipi posse ; quod
minime illi volunt. Eadem dici poterunt in omnibus partibus. Si enim dicent ea
de quibus disserent se dilucide perspicere nec ulla communione visorum inpediri,
conprendere ea se fatebuntur ; sin autem negabunt vera visa a falsis posse
distingui, qui poterunt longius progredi : occurretur enim, sicut occursum est.
Nam concludi argumentum non potest nisi is quae ad concludendum sumpta erunt ita
probatis ut falsa eiusdem modi nulla possint esse. Ergo si rebus conprensis et
perceptis nisa et progressa ratio hoc efficiet, nihil posse conprendi, quid
potest reperiri quod ipsum sibi repugnet magis ? Cumque ipsa natura accuratae
orationis hoc profiteatur, se aliquid patefacturam quod non appareat, et quo id
facilius adsequatur adhibituram et sensus et ea quae perspicua sint, qualis est
istorum oratio qui omnia non tam esse quam videri volunt ? Maxime autem
convincuntur cum haec duo pro congruentibus sumunt tam vehementer repugnantia,
primum esse quaedam falsa visa (quod cum volunt, declarant quaedam esse vera),
deinde ibidem, inter falsa visa et vera nihil interesse. At primum sumpseras
tamquam interesset : ita priore posterius, posteriore superius convincitur. Sed
progrediamur longius et ita agamus ut nihil nobis adsentati esse videamur,
quaeque ab iis dicuntur sic persequamur ut nihil in praeteritis relinquamus.
Primum igitur perspicuitas illa quam diximus satis magnam habet vim, ut ipsa per
sese ea quae sint nobis ita ut sint indicet. Sed tamen ut maneamus in perspicuis
firmius et constantius, maiore quadam opus est vel arte vel diligentia, ne ab is
quae clara sint ipsa per sese quasi praestrigiis quibusdam et captionibus
depellamur. Nam qui voluit subvenire erroribus Epicurus iis qui videntur
conturbare veri cognitionem dixitque sapientis esse opinionem a perspicuitate
seiungere nihil profecit ; ipsius enim opinionis errorem nullo modo sustulit.
XV. Quam ob rem cum duae causae perspicuis et
evidentibus rebus adversentur, auxilia totidem sunt contra conparanda.
Adversantur enim primum quod parum defigunt animos et intendunt in ea quae
perspicua sunt, ut quanta luce ea circumfusa sint possint agnoscere ; alterum est
quod fallacibus et captiosis interrogationibus circumscripti atque decepti
quidam cum eas dissolvere non possunt desciscunt a veritate. Oportet igitur et
ea quae pro perspicuitate responderi possunt in promptu habere, de quibus iam
diximus, et esse armatos ut occurrere possimus interrogationibus eorum
captionesque discutere, quod deinceps facere constitui. Exponam igitur generatim
argumenta eorum, quoniam ipsi etiam illi solent non confuse loqui. Primum
conantur ostendere multa posse videri esse quae omnino nulla sint, cum animi
inaniter moveantur, eodem modo rebus iis quae nullae sint ut is quae sint. «nam
cum dicatis» inquiunt «visa quaedam mitti a deo, velut ea quae in somnis
videantur quaeque oraculis auspiciis extis declarentur» (haec enim aiunt probari
a Stoicis, quos contra disputant) – quaerunt quonam modo falsa visa quae sint ea
deus efficere possit probabilia, quae autem plane proxume ad verum accedant
efficere non possit, aut si ea quoque possit cur illa non possit quae
perdifficiliter internoscantur tamen, et si haec, cur non inter quae nihil sit
omnino. «Deinde cum mens moveatur ipsa per sese, ut et ea declarant quae
cogitatione depingimus et ea quae vel dormientibus vel furiosis videntur non
†inquam veri simile sit sic etiam mentem moveri, ut non modo non internoscat
vera illa visa sint anne falsa, sed ut in is nihil intersit omnino», ut si qui
tremerent et exalbescerent vel ipsi per se motu mentis aliquo vel obiecta
terribili re extrinsecus, nihil ut esset qui distingueretur tremor ille et
pallor, neque ut quicquam interesset <inter> intestinum et oblatum. «Postremo si
nulla visa sunt probabilia quae falsa sint, alia ratio est ; sin autem sunt, cur
non etiam quae non facile internoscantur, cur non ut plane nihil intersit,
praesertim cum ipsi dicatis sapientem in furore sustinere se ab omni adsensu,
quia nulla in visis distinctio appareat.» |
X. Vient ensuite une partie de la
discussion, abondante en arguments, mais abstraite, parce qu'elle
touche à la physique, et je dois craindre ici d'accorder à mon
adversaire trop de liberté et même de licence. Car dans des sujets
aussi épineux qu'embarrassés, que ne doit-on pas attendre de celui
qui s'efforce d'obscurcir la lumière elle-même ? On pourrait
cependant montrer par une discussion ingénieuse, avec quel art
admirable la nature forme d'abord tous les animaux et ensuite
l'homme, le plus parfait de tous ; quelle est la vertu des sens ;
comment les représentations nous frappent d'abord, puis ensuite
l'appétit qu'elles excitent s'éveille en nous ; comment alors nous
dressons nos sens pour saisir les choses. Car l'intelligence qui est
la source des sens et en quelque façon un sens elle-même, a une
puissance naturelle d'attention qu'elle dirige vers les objets qui
la frappent. Parmi les représentations qu'elle saisit, les unes lui
sont d'un emploi immédiat, certaines sont mises comme en dépôt, et
c'est l'origine de la mémoire. Elle se forme d'autres notions par
l'examen des ressemblances, et de ces notions sortent les vraies
idées des choses, que les Grecs nomment tantôt ἐννοίας, tantôt
προλήψεις. Qu'à cela vienne se joindre la raison, l'art des
démonstrations, et l'immense multitude des objets que le monde nous
présente, et vous voyez naître la véritable science, et la raison
perfectionnée par tout ce travail successif atteint enfin à la
sagesse. L'intelligence donc étant faite pour donner à l'homme la
science et l'égalité de la vie, elle aspire surtout à la
connaissance ; elle aime la compréhension (car c'est ainsi,
avons-nous dit, que l'on peut rendre exactement le κατάληψις des
Grecs), pour elle-même d'abord, car rien n'est plus délicieux pour
l'esprit que la lumière de la vérité, et ensuite pour ses
conséquences pratiques. C'est pourquoi l'intelligence exerce les
sens, invente les arts comme des sens nouveaux, et donne assez de
force à la philosophie pour produire enfin la vertu, cette chose
excellente qui met l'ordre dans toute la vie. Ainsi donc, ceux qui
soutiennent qu'on ne peut rien comprendre, détruisent d'un coup tous
ces instruments et tous ces ornements de la vie, ou plutôt ils
détruisent et ruinent la vie elle-même, et retirent à l'être animé
le foyer de l'animation ; en telle façon qu'il serait difficile de
faire ressortir assez toute la témérité de leur doctrine. J'avoue
que je ne puis comprendre leur dessein, ni deviner ce qu'ils
veulent. Quand parfois nous leur proposons cette réflexion : Si ce
que vous dites est vrai, alors il n'y a rien de certain ; ils
répondent : Qu'y pouvons-nous faire ? Est-ce notre faute ? Accusez
la nature qui a caché, comme le disait Démocrite,
446 la vérité au fond d'un
abîme. D'autres y mettent plus d'esprit, ils se plaignent que nous
les accusions de professer l'incertitude universelle, et s'efforcent
d'établir une grande différence entre l'incertain et ce qu'on ne
peut connaître, et de nous montrer en quoi cette différence
consiste. Adressons-nous donc à ceux qui font cette distinction ;
pour ceux qui prétendent qu'il règne sur toutes les questions la
même incertitude que sur celle-ci : Le nombre des étoiles est-il
pair ou impair ? pour ceux-là, le mieux est de renoncer à guérir
leur folie. Les autres accordent au moins (et j'ai remarqué que vous
en étiez frappés) qu'il y a des probabilités et des vraisemblances,
et disent qu'ils trouvent là une règle à suivre pour la conduite de
la vie, pour l'ordre des recherches et pour les discussions.
XI. Mais quelle peut être cette règle,
quand nous n'avons aucune idée nette du vrai et du feux, puisque
nous sommes dans l'impuissance de les distinguer l'un de l'autre ?
Si nous avons une telle règle, il faut nécessairement qu'il y ait
une différence non-seulement entre le bien et le mot, mais entre le
vrai et le faux. Si cette différence n'existe pas, il n'y a pas de
règle, et celui aux yeux de qui l'erreur et la vérité paraissent
sous les mêmes traits, ne peut porter aucun jugement, ni reconnaître
la vérité à aucune marque. Dire que l'on ne conteste qu'une chose, à
savoir, qu'il y ait des perceptions vraies dont certaines illusions
ne puissent prendre la figure, et que l'on accorde tout le reste,
c'est tenir un langage puéril. Ils nous ôtent la condition même de
nos jugements, et prétendent ne touchera rien du reste ; c'est comme
si, après avoir crevé les yeux à un homme, on lui disait pour
consolation qu'on le laisse au milieu des objets visibles. Ce n'est
que par les yeux qu'on voit, et qu'au moyen des représentations
qu'on connaît ; mais il faut, pour connaître, que la vérité nous ait
donné d'elle-même un signe qui ne lui soit pas commun avec l'erreur.
Aussi, soit que vous preniez parti pour la vision probable, ou,
comme Carnéade, pour la vision probable et qui n'est point
embarrassée, soit que vous imaginiez quelque autre terme moyen qui
vous règle, il faudra toujours que vous en reveniez à la
représentation en question. Et si les caractères de cette
représentation ne peuvent la distinguer des vains fantômes, tout
jugement est interdit à l'intelligence, parce qu'au milieu de cette
confusion on ne peut reconnaître le signe propre de la vérité. Si au
contraire elle n'a rien de commun avec l'erreur, j'ai ce que je
demande ; car tout ce que je veux, c'est que le vrai m'apparaisse de
telle façon que je ne puisse pas le confondre avec le faux. Ils
n'échappent donc pas à l'erreur, lorsque, contraints en quelque
façon par le cri de la vérité, ils veulent distinguer ce qui est
manifeste de ce qui est connu, et disent qu'il y a certaines choses
dont l'esprit est frappé manifestement, mais que l'on ne peut ni
comprendre ni véritablement connaître. Comment dire qu'une chose est
manifestement blanche, s'il peut arriver que ce qui est noir
paraisse blanc ? Comment déclarer que certaines notions sont
manifestes ou fidèlement imprimées dans l'esprit, lorsque nous ne
pouvons savoir si l'esprit est frappé par la réalité ou par des
fantômes ? Ainsi donc il ne reste ni couleur, ni corps, ni vérité,
ni raisonnement, ni sens, ni quoi que ce soit de manifeste. Aussi
les académiciens sont-ils habitués à s'entendre demander atout
propos lorsqu'ils disent quelque chose : Vous savez donc ce que vous
dites là ? Mais ils se moquent de ceux qui leur font
447 cette question. Le
tort de ceux-ci est de ne pas insister et leur prouver que l'on ne
peut rien affirmer ni soutenir aucune opinion sans avoir reconnu à
une marque certaine et caractéristique que cette opinion mérite la
faveur qu'elle trouve près de nous ? Qu'est-ce, je vous prie, que
votre probable ? Si vous confirmez l'autorité de ce qui s'offre
d'abord à l'esprit et paraît probable au premier aspect, quoi de
plus léger ? Si vous voulez, qu'usant de circonspection, on ne se
rende qu'à ce qui emporte notre consentement après une mûre
considération, vous n'êtes pas plus avancés pour cela. D'abord,
puisque entre les apparences on ne peut établir aucune distinction,
elles perdent toutes également leur droit à notre créance : ensuite,
comme vous avouez qu'après tous les efforts possibles et le plus
scrupuleux examen, il peut se faire que le sage tienne pour
vraisemblable ce qui est très-éloigné de la vérité, comment, en
supposant que vous touchiez souvent à la vérité même (comme vous
vous en vantez), ou qu'au moins vous en approchiez extrêmement,
pouvez-vous avoir confiance dans vos propres pensées ? Pour avoir
confiance dans ses pensées, il faut posséder un signe
caractéristique de la vérité ; mais vous dérobez la lumière et en
étouffez en quelque façon le foyer ; à quelle sorte de vérité
prétendez-vous donc atteindre ? Peut-on tenir un langage plus
absurde que celui-ci : Voilà un signe qui parle à mon esprit en
faveur de telle chose, et c'est pourquoi j'y crois ; mais il peut se
faire que ce signe corresponde tout aussi bien à une erreur, ou même
ne corresponde à rien du tout. Mais en voilà assez sur la
perception. Si quelqu'un veut attaquer ce que nous avons dit, la
vérité, même en notre absence, se défendra facilement elle-même.
XII. Nous avons, ce nous semble, assez
mis en lumière toute cette première partie du sujet ; nous dirons
maintenant quelques mots seulement de l'assentiment et de
l'approbation, que les Grecs nomment συγκατάθσιν ; non pas que ce
soit un point de médiocre importance, mais parce que les principaux
éléments de la question se trouvent dans ce que nous avons déjà dit.
Car en expliquant les fonctions des sens, nous avons montré que
beaucoup de choses sont saisies et perçues par eux, ce qui ne peut
se faire sans un certain assentiment. Ensuite comme ce qui distingue
surtout l'être animé de l'inanimé, c'est que ce dernier n'agit
point, tandis que le premier agit (il est vrai qu'on ne peut se
faire aucune idée d'un être entièrement inactif), il faut ôter le
sens au premier, ou lui rendre le libre assentiment qui nous
appartient. C'est réduire en quelque façon au rôle d'êtres inanimés
ceux à qui on refuse le don de sentir et de croire. De même que le
bassin d'une balance où vous placez des poids, fléchit
nécessairement, ainsi l'évidence doit entraîner l'esprit. Car en
même sorte qu'il est impossible à un être vivant de ne point désirer
ce qui lui paraît conforme à sa nature (ce que les Grec nomment
οἰκεῖον), il est impossible à l'esprit de ne pas croire à la réalité
d'un objet évident. Mais si les principes que nous avons soutenus
dans la première partie de cette discussion sont vrais, il est tout
à fait inutile de parler de l'assentiment. Car il n'y a pas de
perception sans assentiment ; et par la suite, sans assentiment vous
n'avez ni la mémoire, ni les notions des choses, ni les arts ;
448 mais voici plus encore
: ne croire à rien, c'est n'avoir rien en sa puissance, c'est perdre
le plus beau privilège de notre nature. Que devient donc la vertu,
si rien ne dépend de nous ? Mais c'est le comble de l'absurdité, de
dire que nos vices dépendent de nous, et qu'on ne fait le mal
qu'après y avoir consenti ; et de soutenir le contraire pour la
vertu qui doit toute sa constance et sa fermeté aux choses mêmes
dont elle a reconnu l'évidence et confessé la vérité ; car il faut
nécessairement, avant d'agir, voir quelque chose, et croire à ce que
l'on voit. C'est pourquoi, celui qui supprime on la perception ou
l'assentiment bannit toute action de la vie.
XIII. Voyons maintenant comment nos
adversaires se défendent. Mais auparavant vous devez connaître les
points fondamentaux de toute leur doctrine. Ils réduisent d'abord en
théorie ce que disent les stoïciens des perceptions ; ils
définissent la représentation, en distinguant les espèces, et
marquant celles que l'on peut percevoir et comprendre. Ils exposent
ensuite les deux principes qui dominent toute cette question ; l'un
est que lorsque des choses sont telles que d'autres fort diverses
peuvent leur paraître semblables, et que l'on ne trouve aucune
différence entre elles, il est impossible que les unes soient
perçues et que les autres ne le soient pas ; le second, qu'il n'y a
aucune différence entre deux choses, non-seulement quand elles sont
de tout point semblables, mais encore quand on ne peut les
distinguer. Ces principes posés, un seul raisonnement leur suffit
pour établir leur thèse. Voici ce raisonnement en forme : “Des
représentations qui nous frappent, les unes sont vraies, les autres,
fausses ; mais ce qui est faux ne peut être perçu, et ce que nous
voyons de vrai est tel que le faux pourrait nous paraître absolument
semblable ; d'ailleurs lorsque les objets qui frappent nos sens
n'offrent aucune différence, il ne peut se faire que l'on perçoive
les uns et que l'on ne perçoive pas les autres. Donc aucune
représentation ne peut étre perçue.” Des propositions qu'ils
avancent pour arriver à leur conclusion, ils pensent qu'il en est
deux que tout le monde leur accordera ; et personne en effet ne
songe à les contester. Ce sont celles-ci : “Les représentations
fausses ne peuvent être perçues ;” et cette autre : “Entre les
représentations qui n'offrent point de différence, il ne se peut
faire que les unes soient perçues, et les autres non.” Ils donnent
des raisons nombreuses et variées à l'appui de leurs autres
propositions, qui se réduisent aussi à deux ; la première : “Parmi
les apparences des choses, il en est de vraies et de fausses ;” la
seconde : “Toute représentation vraie est telle qu'une fausse puisse
lui être exactement semblable.” Ils n'avancent pas ces deux
propositions en passant, mais ils les développent et les expliquent
avec beaucoup de soin et d'application. Ils établissent dans leur
démonstration de grandes divisions ; ils commencent par les sens et
par les notions qui nous viennent des sens, et en général de
l'expérience, dont ils s'efforcent d'éteindre la lumière. Ils
viennent ensuite à cet autre chef, qu'on ne peut non plus rien
connaître par la raison ni par conjecture. Ils subdivisent encore
ces thèses générales ; vous l'avez vu dans notre entretien d'hier
pour ce qui touche les sens ; c'est une méthode qu'ils suivent
partout ; et après avoir divisé chaque sujet eu ses moindres
parties, ils entreprennent de prouver qu'eu regard de tout ce qui
nous parait vrai, 449
on peut mettre des erreurs qu'on ne saurait distinguer de la vérité
; d'où ils concluent qu'on ne peut rien connaître.
XIV. Toute cette finesse de
dialectique me semble très-digne de la philosophie, mais fort 'peu
en harmonie avec le système qu'on soutient là. Les définitions et
les divisions, et la lumière qu'elles prêtent aux discours, les
ressemblances et les différences, et tous ces rapports finement et
subtilement saisis ; tout cela convient à des hommes convaincus que
tout ce qu'ils soutiennent est vrai, solide et certain, et non pas à
ceux qui crient que leurs opinions n'expriment pas plutôt la vérité
que l'erreur. Que répondraient-ils à celui qui leur demanderait,
quand ils définissent quelque chose, si cette définition peut
s'appliquer indifféremment à toute autre chose ? S'ils disent
qu'elle le peut, comment prouveront-ils que c'est la vraie
définition ? s'ils disent que non, ils doivent avouer que, puisque
cette définition ne peut s'appliquer à ce qui est faux, il est donc
possible de connaître l'objet de cette définition, et c'est ce
qu'ils ne veulent pas. On pourra faire le même raisonnement partout.
Car s'ils disent qu'ils aperçoivent clairement ce dont ils parlent,
et que la confusion des représentations ne les embarrasse point, ils
déclarent par là même qu'ils peuvent connaître ce qu'ils saisissent
ainsi. S'ils affirment au contraire qu'on ne peut distinguer les
vraies représentations des fausses, comment pourront-ils faire un
pas plus loin ? On les arrêtera, comme on les a déjà arrêtés. Car il
est impossible de conclure dans un raisonnement, si les propositions
dont la conclusion doit dépendre ne sont assez bien établies pour
qu'aucune erreur ne puisse être confondue avec elles. Ainsi donc si
la raison, s'appuyant sur une série de notions et de connaissances
évidentes, prouve par leur moyen qu'on ne peut rien connaître,
est-il rien au monde de plus contradictoire ? Et comme la nature
d'un bon raisonnement consiste à mettre en lumière ce qui est caché,
et à employer, pour atteindre plus facilement son but, les données
des sens et les notions évidentes, quels raisonnements peuvent faire
ceux qui veulent trouver partout plutôt des apparences que la
réalité ? Mais où on les prend surtout en contradiction flagrante,
c'est quand ils cherchent à accorder ces deux propositions dont
l'hostilité est manifeste ; la première, “que certaines
représentations sont fausses” (parler ainsi, c'est déclarer que
certaines autres sont vraies) ; et l'autre en même temps, “qu'entre
les représentations vraies et fausses, il n'y a aucune différence.
“Mais la première impliquait précisément qu'il y eût une différence.
Si vous acceptez le premier de ces principes, il faut abandonner le
second ; si vous posez le second, le premier tombe. Mais allons plus
loin, et raisonnons de telle sorte qu'on ne puisse nous accuser
d'être trop complaisants pour nos propres idées, et de négliger
quelqu'une de celles de nos adversaires. D'abord, cette sorte
d'évidence dont nous avons parlé, est bien assez puissante pour nous
montrer par elle-même les choses telles qu'elles sont. Toutefois ce
n'est pas sans beaucoup d'art et de soin que nous saurons nous
maintenir dans ctte région de l'évidence ; car il est à craindre que
nous n'en soyons expulsés par de certains prestiges et d'habiles
artifices. Épicure, qui a voulu porter remède à nos erreurs dont
450 le vice semble
rejaillir sur la connaissance de la vérité, et qui a dit que le sage
doit distinguer l'opinion de l'évidence, n'a rien gagné ; car il ne
nous apprend en aucune manière à purger de l'erreur nos opinions.
XV. On dirige contre l'évidence deux
sortes d'objections ; nous devons donc préparer pour elle une double
défense. On objecte d'abord que les esprits se fixent et se
concentrent trop peu sur les objets évidents, pour pouvoir
reconnaître de quelle clarté ils sont revêtus ; ensuite on tire
argument de ce que certaines intelligences enveloppées et comme
égarées par des questions captieuses, et ne pouvant les résoudre,
trahissent la vérité. Il faut donc avoir présent à l'esprit ce que
l'on peut répondre, et que nous avons déjà exposé en faveur de
l'évidence, et nous armer pour traiter victorieusement toutes ces
questions captieuses, et briser ces pièges ; c'est ce que je me
propose de faire maintenant. J'exposerai avec ordre leurs arguments
; car eux-mêmes apportent dans leurs discussions beaucoup de
méthode. D'abord ils s'efforcent de prouver que beaucoup de choses
peuvent nous paraître réelles, dont l'existence cependant soit
chimérique, parce que de vains fantômes peuvent agir sur notre
esprit de la même manière que des objets positifs. Vous dites, ce
sont eux qui parlent, que certaines représentations nous sont
envoyées par Dieu, comme dans les songes, par exemple, dans les
oracles, les auspices, les entrailles des victimes (car ce sont, là
ajoutent-ils, les opinions des Stoïciens contre qui ils discutent) ;
mais alors comment se fait-il que Dieu puisse donner la
vraisemblance à de fausses représentations et qu'il ne puisse la
donnera celle qui se rapprochent le plus de la vérité ? S'il peut la
donner à ces dernières, pourquoi pas à celles qu'on distingue à
grandpeine, mais qu'on distingue pourtant de la vérité ? S'il le
peut encore, pourquoi pas à celles dont la vérité ne se peut plus
aucunement distinguer ? Ensuite, puisque l'esprit se met de lui-même
en mouvement, comme le manifestent les fantaisies de notre
imagination, les hallucinations des furieux et les rêves ; n'est-il
pas vraisemblable que l'esprit soit mû aussi par des objets
extérieurs, de telle sorte qu'il ne puisse pas distinguer si ce
qu'il voit sont des réalités ou des illusions, et qu'il soit
incapable de reconnaître entre elles aucune différence ? Tout comme
si deux hommes venaient à trembler et à pâlir, l'un spontanément et
par une certaine révolution intérieure, l'autre en présence de
quelque objet terrible, on ne pourrait distinguer ces deux genres de
tremblement et de pâleur, et il n'y aurait aucune différence
sensible entre ces deux résultats de causes opposées. En résumé, y
a-t-il des représentations fausses qui aient de la vraisemblance ?
Si on le nie, c'est une autre discussion ; si on l'accorde, pourquoi
refuser la vraisemblance à celle que l'on distingue difficilement
des représentations vraies ? pourquoi à celles qu'on n'en peut
distinguer ? surtout quand vous dites que le sage en fureur
s'abstient de porter aucun jugement, parce qu'il ne sait plus
démêler les représentations qui le frappent.
|
|
XVI. Ad has omnes visiones inanes Antiochus quidem
et permulta dicebat et erat de hac una re unius diei disputatio. Mihi autem non
idem faciundum puto sed ipsa capita dicenda. Et primum quidem hoc
reprehendendum, quod captiosissimo genere interrogationis utuntur, quod genus
minime in philosophia probari solet, quom aliquid minutatim et gradatim additur
aut demitur : soritas hoc vocant, qui acervum efficiunt uno addito grano,
vitiosum sane et captiosum genus. Sic enim ascenditis : «si tale visum obiectum
est a deo dormienti ut probabile sit, cur non etiam ut valde veri simile ; cur
deinde non ut difficiliter a vero internoscatur, deinde ut ne internoscatur
quidem, postremo ut nihil inter hoc et illud intersit.» huc si perveneris me
tibi primum quidque concedente, meum vitium fuerit, sin ipse tua sponte
processeris, tuum. [50] quis enim tibi dederit aut omnia deum posse aut ita
facturum esse si possit ? quo modo autem sumis ut si quid cui simile esse possit
sequatur ut etiam difficiliter internosci possit, deinde ut ne internosci
quidem, postremo ut eadem sit ? Et si lupi canibus similes, eosdem dices ad
extremum ? Et quidem honestis similia sunt quaedam non honesta et bonis non bona
et artificiosis minime artificiosa : quid dubitamus igitur adfirmare nihil inter
haec interesse ? Ne repugnantia quidem videmus ? nihil est enim quod e suo genere
in aliud genus transferri possit ; at si efficeretur ut inter visa differentium
generum nihil interesset, reperirentur quae et in suo genere essent et in
alieno ; quod fieri qui potest ? Omnium deinde inanium visorum una depulsio est,
sive illa cogitatione informantur, quod fieri solere concedimus, sive in quiete
sive per vinum sive per insaniam. Nam ab omnibus eiusdem modi visis
perspicuitatem, quam mordicus tenere debemus, abesse dicemus. Quis enim, cum
sibi fingit aliquid et cogitatione depingit, non simul ac se ipse commovit atque
ad se revocavit sentit quid intersit inter perspicua et inania ? Eadem ratio est
somniorum. Num censes Ennium, cum in hortis cum Ser. Galba vicino suo
ambulavisset, dixisse «visus sum mihi cum Galba ambulare» ? At cum somniavit ita
narravit
... visus Homerus adesse poeta,
idemque in Epicharmo
Nam videbar somniare med ego esse mortuum.
Itaque simul ut experrecti sumus visa illa
contemnimus neque ita habemus ut ea quae in foro gessimus.
XVII. «At enim dum videntur, eadem est in somnis
species eorum quae vigilantes videmus.» Primum interest, sed id omittamus ; illud
enim dicimus, non eandem esse vim neque integritatem dormientium et vigilantium
nec mente nec sensu. Ne vinulenti quidem quae faciunt eadem adprobatione faciunt
qua sobrii : dubitant haesitant revocant se interdum iisque quae videntur
inbecillius adsentiuntur, cumque edormierunt illa visa quam levia fuerint
intellegunt. Quod idem contingit insanis, ut et incipientes furere sentiant et
dicant aliquid quod non sit id videri sibi, et cum relaxentur sentiant atque
illa dicant Alcmeonis
Ssed mihi neutiquam cor consentit cum oculorum
aspectu».
«At enim ipse sapiens sustinet se in furore ne
adprobet falsa pro veris.» Et alias quidem saepe, si aut in sensibus ipsius est
aliqua forte gravitas aut tarditas, aut obscuriora sunt quae videntur, aut a
perspiciendo temporis brevitate excluditur. Quamquam totum hoc, sapientem
aliquando sustinere adsensionem, contra vos est. Si enim inter visa nihil
interesset, aut semper sustineret aut numquam. Sed ex hoc genere toto perspici
potest levitas orationis eorum qui omnia cupiunt confundere. Quaerimus
gravitatis constantiae firmitatis sapientiae iudicium, utimur exemplis
somniantium furiosorum ebriosorum : illud adtendimus, in hoc omni genere quam
inconstanter loquamur ? non enim proferremus vino aut somno oppressos aut mente
captos tam absurde, ut tum diceremus interesse inter vigilantium visa et
sobriorum et sanorum et eorum qui essent aliter adfecti, tum nihil interesse. Ne
hoc quidem cernunt, omnia se reddere incerta, quod nolunt ? (ea dico incerta quae
ἄδηλα Graeci.) si enim res se ita habeat ut nihil intersit utrum ita cui
videatur ut insano an sano, cui possit exploratum esse de sua sanitate ? quod
velle efficere non mediocris insania est. Similitudines vero aut geminorum aut
signorum anulis inpressorum pueriliter consectantur. Quis enim nostrum
similitudines negat esse, cum eae plurimis in rebus appareant. Sed si satis est
ad tollendam cognitionem similia esse multa multorum, cur eo non estis contenti,
praesertim concedentibus nobis, et cur id potius contenditis quod rerum natura
non patitur, ut non suo quidque genere sit tale quale est, nec sit in duobus aut
pluribus nulla re differens ulla communitas ? ut †sibi sint et ova ovorum et apes
apium simillimae : quid pugnas igitur aut quid tibi vis in geminis ? Conceditur
enim similes esse, quo contentus esse potueras ; [55] tu autem vis eosdem plane
esse non similes, quod fieri nullo modo potest. Dein confugis ad physicos eos
qui maxime in Academia inridentur, a quibus ne tu quidem iam te abstinebis, et
ais Democritum dicere innumerabiles esse mundos, et quidem sic quosdam inter
sese non solum similes sed undique perfecte et absolute ita pares ut inter eos
nihil prorsus intersit, et eo quidem innumerabiles * * itemque homines. Deinde
postulas ut, si mundus ita sit par alteri mundo ut inter eos ne minimum quidem
intersit, concedatur tibi ut in hoc quoque nostro mundo aliquid alicui sic sit
par ut nihil differat nihil intersit. «cur enim» inquies «ex illis individuis,
unde omnia Democritus gigni adfirmat, in reliquis mundis et in iis quidem
innumerabilibus innumerabiles Q. Lutatii Catuli non modo possint esse sed etiam
sint, in hoc tanto mundo Catulus alter non possit effici ?»
XVIII. Primum quidem me ad Democritum vocas ; cui
non adsentior potius †quare fallar† potest id quod dilucide docetur a
politioribus physicis, singularum rerum singulas proprietates
esse. Fac enim
antiquos illos Servilios, qui gemini fuerunt, tam similes quam dicuntur, num
censes etiam eosdem fuisse ? «non cognoscebantur foris» : at domi ; «non ab
alienis» : at a suis. An non videmus hoc usu venire, ut quos numquam putassemus a
nobis internosci posse eos consuetudine adhibita tam facile internosceremus <ut>
ne minimum quidem similes viderentur. Hic pugnes licet, non repugnabo, quin
etiam concedam illum ipsum sapientem, de quo omnis hic sermo est, cum ei res
similes occurrant quas non habeat dinotatas, retenturum adsensum nec umquam ulli
viso adsensurum nisi quod tale fuerit quale falsum esse non possit. Sed et ad
ceteras res habet quandam artem qua vera a falsis possit distinguere, et ad
similitudines istas usus adhibendus est : ut mater geminos internoscit
consuetudine oculorum, sic tu internosces si adsueveris. Videsne ut in proverbio
sit ovorum inter se similitudo : tamen hoc accepimus, Deli fuisse complures
salvis rebus illis, qui gallinas alere permultas quaestus causa solerent
; ii cum
ovum inspexerant quae id gallina peperisset dicere solebant. Neque id est contra
vos ; nam vobis satis esset ova illa non internoscere ; nihilo enim magis
adsentirer hoc illud esse quam si inter illa omnino nihil interesset. Habeo enim
regulam, ut talia visa vera iudicem qualia falsa esse non possint ; ab hac mihi
non licet transversum ut aiunt digitum discedere, ne confundam omnia ; veri enim
et falsi non modo cognitio sed etiam natura tolletur, si nihil erit quod
intersit. Ut etiam illud absurdum sit quod interdum soletis dicere, cum visa in
animos inprimantur, non vos id dicere, inter ipsas inpressiones nihil interesse,
sed inter species et quasdam formas eorum. Quasi vero non specie visa
iudicentur ; quae fidem nullam habebunt sublata veri et falsi nota. Illud vero
perabsurdum quod dicitis, probabilia vos sequi si nulla re inpediamini. Primum
qui potestis non inpediri, cum a veris falsa non distent ? Deinde quod iudicium
est veri, cum sit commune falsi ? Ex his illa necessario nata est ἐποχὴ id est
adsensionis retentio, in qua melius sibi constitit Arcesilas, si vera sunt quae
de Carneade non nulli existimant. Si enim percipi nihil potest, quod utrique
visum est, tollendus adsensus est ; quid enim est tam futtile quam quicquam
adprobare non cognitum ? Carneadem autem etiam heri audiebamus solitum esse <eo>
delabi interdum ut diceret opinaturum id est peccaturum esse sapientem. Mihi
porro non tam certum est esse aliquid quod conprendi possit, de quo iam nimium
etiam diu disputo, quam sapientem nihil opinari id est numquam adsentiri rei vel
falsae vel incognitae. Restat illud quod dicunt veri inveniundi causa contra
omnia dici oportere et pro omnibus. Volo igitur videre quid invenerint. «Non
solemus» inquit «ostendere». Quae sunt tandem ista mysteria, aut cur celatis
quasi turpe aliquid sententiam vestram ? «Ut qui audient» inquit «ratione potius
quam auctoritate ducantur». Quid si utrumque, num peius est ? Unum tamen illud
non celant, nihil esse quod percipi possit. An in eo auctoritas nihil obest ?
Mihi quidem videtur vel plurimum. Quis enim ista tam aperte perspicueque et
perversa et falsa secutus esset, nisi tanta in Arcesila, multo etiam maior in
Carneade et copia rerum et dicendi vis fuisset ?
XIX. Haec Antiochus fere et Alexandreae tum et
multis annis post multo etiam adseverantius, in Syria cum esset mecum paulo ante
quam est mortuus. Sed iam confirmata causa te hominem amicissimum› (me autem
appellabat) ‹et aliquot annis minorem natu non dubitabo monere. Tune, cum tantis
laudibus philosophiam extuleris Hortensiumque nostrum dissentientem commoveris,
eam philosophiam sequere quae confundit vera cum falsis, spoliat nos iudicio,
privat adprobatione omni, orbat sensibus ?
Et Cimmeriis quidem, quibus aspectum
solis sive deus aliquis sive natura ademerat sive eius loci quem incolebant
situs, ignes tamen aderant quorum illis uti lumine licebat : isti autem quos tu
probas tantis offusis tenebris ne scintillam quidem ullam nobis ad dispiciendum
reliquerunt ; quos si sequamur iis vinclis simus astricti ut nos commovere
nequeamus. Sublata enim adsensione omnem et motum animorum et actionem rerum
sustulerunt ; quod non modo recte fieri sed omnino fieri non potest. Provide
etiam ne uni tibi istam sententiam minime liceat defendere.
An tu, cum res
occultissimas aperueris in lucemque protuleris iuratusque dixeris ea te
conperisse (quod mihi quoque licebat qui ex te illa cognoveram), negabis esse
rem ullam quae cognosci conprendi percipi possit ? vide quaeso etiam atque etiam
ne illarum quoque rerum pulcherrimarum a te ipso minuatur auctoritas.› Quae cum
dixisset ille, finem fecit. Hortensius autem vehementer admirans (quod quidem
perpetuo Lucullo loquente fecerat, ut etiam manus saepe tolleret : nec mirum ; nam
numquam arbitror contra Academiam dictum esse subtilius) me quoque, iocansne an
ita sentiens (non enim satis intellegebam), coepit hortari ut sententia
desisterem. Tum mihi Catulus, Si te, inquit, Luculli oratio flexit, quae est
habita memoriter accurate copiose, taceo neque te quo minus si tibi ita videatur
sententiam mutes deterrendum puto. Illud vero non censuerim, ut eius auctoritate
moveare. Tantum enim te [non] modo monuit› inquit adridens, ‹ut caveres ne quis
inprobus tribunus plebis, quorum vides quanta copia semper futura sit, arriperet
te et in contione quaereret qui tibi constares cum idem negares quicquam certi
posse reperiri idem te conperisse dixisses. Hoc quaeso cave ne te terreat. De
causa autem ipsa malim quidem te ab hoc dissentire ; sin cesseris, non magnopere
mirabor : memini enim Antiochum ipsum, cum annos multos alia sensisset, simul ac
visum sit sententia destitisse. Haec cum dixisset Catulus, me omnes intueri.
XX. Tum ego non minus conmotus quam soleo in
causis maioribus huius modi quadam oratione sum exorsus. Me Catule oratio
Luculli de ipsa re ita movit ut docti hominis et copiosi et parati et nihil
praetereuntis eorum quae pro illa causa dici possent, non tamen ut ei respondere
posse diffiderem ; auctoritas autem tanta plane me movebat, nisi tu opposuisses
non minorem tuam. Adgrediar igitur, si pauca ante quasi de fama mea dixero. Ego
enim si aut ostentatione aliqua adductus aut studio certandi ad hanc potissimum
philosophiam me adplicavi, non modo stultitiam meam sed etiam mores et naturam
condemnandam puto. Nam si in minimis rebus pertinacia reprehenditur, calumnia
etiam coercetur, ego de omni statu consilioque totius vitae aut certare cum
aliis pugnaciter aut frustrari cum alios tum etiam me ipsum velim ? Itaque nisi
ineptum putarem in tali disputatione id facere quod cum de re publica
disceptatur fieri interdum solet, iurarem per Iovem deosque penates me et ardere
studio veri reperiendi et ea sentire quae dicerem. Qui enim possum non cupere
verum invenire, cum gaudeam si simile veri quid invenerim ? sed ut hoc
pulcherrimum esse iudico, vera videre, sic pro veris probare falsa turpissimum
est. Nec tamen ego is sum qui nihil umquam falsi adprobem qui numquam adsentiar
qui nihil opiner ; sed quaerimus de sapiente. Ego vero ipse et magnus quidam sum
opinator (non enim sum sapiens) et meas cogitationes sic dirigo, non ad illam
parvulam Cynosuram,
Qua fidunt duce nocturna Phoenices in alto,
ut ait Aratus, eoque directius gubernant quod eam
tenent
Quae cursu interiore brevi convertitur orbe :
sed Helicen et clarissimos Septentriones id est
rationes has latiore specie non ad tenue limatas ; eo fit ut errem et vager
latius. Sed non de me, ut dixi, sed de sapiente quaeritur. Visa enim ista cum
acriter mentem sensumve pepulerunt accipio iisque interdum etiam adsentior. Nec
percipio tamen : nihil enim arbitror posse percipi. Non sum sapiens ; itaque visis
cedo nec possum resistere. Sapientis autem hanc censet Arcesilas vim esse
maximam Zenoni adsentiens, cavere ne capiatur, ne fallatur videre ; nihil est
enim ab ea cogitatione, quam habemus de gravitate sapientis, errore levitate
temeritate diiunctius. Quid [quid] igitur loquar de firmitate sapientis ? quem
quidem nihil opinari tu quoque Luculle concedis. Quod quoniam a te probatur, ut
praepostere tecum agam iam (mox referam me ad ordinem), haec primum conclusio
quam habeat vim considera : |
XVI. Antiochus réfutait abondamment
toutes les objections tirées de ces visions chimériques, et parlait
sur ce sujet seul tout un jour. Je ne veux pas en faire autant ;
j'exposerai simplement les points capitaux de la réponse. Et d'abord
on doit blâmer l'emploi qu'ils font de cette méthode d'interrogation
extrêmement captieuse, que la 451
philosophie réprouve, et qui consiste à s'avancer insensiblement et
par petits degrés ; c'est ce qu'ils nomment sortie ; parce qu'ils
élèvent comme un monceau grain à grain avec cet artifice,
certainement très-blâmable, mais aussi très-embarrassant pour
l'esprit. Voici en effet la marche que vous suivez : “Si Dieu envoie
dans le sommeil des représentations probables, pourquoi ne
pourrait-il pas faire qu'une représentation fausse ressemblât à une
vraie ? puis ensuite, qu'on ne les pût que difficilement distinguer
l'une de l'autre ? puis encore qu'il fût impossible de les
distinguer ? Et enfin qu'il n'y eût aucune différence entre les deux
?” Si vous arrivez là parce que je vous accorde de moi-même chaque
terme de votre série, ce sera ma faute ; si vous vous accordez tout
spontanément, ce sera la vôtre. Comment convenir avec vous que Dieu
puisse tout faire, ou, s'il le peut, qu'il fasse ce que vous dites
là ? Comment pouvez-vous tenir pour indubitable que, si une chose
ressemble à une autre, il en résulte qu'entre les deux on ne puisse
plus trouver que difficilement de différence ? Ensuite, ne plus en
trouver aucune ? Et qu'enfin elles deviennent exactement les mêmes ?
De telle façon que si les loups ressemblent aux chiens, vous finirez
par dire que chiens et loups c'est tout un. Il y a sans doute
plusieurs choses déshonnêtes qui ressemblent aux choses honnêtes,
plusieurs maux qui ressemblent au bien, et plus d'un ouvrage du
hasard, aux œuvres de l'art ? Pourquoi donc hésitons-nous à affirmer
qu'il n'y a entre les uns et les autres aucune différence ? N'est-ce
pas que nous apercevons que leur nature y répugne ? Car il n'est
rien au monde que l'on puisse transporter de son genre dans un autre
genre. Mais s'il arrivait qu'entre des représentations de diverses
espèces, il n'y eût aucune différence, la conséquence en serait que
certains objets se trouveraient être à la fois dans leur genre et
dans un genre étranger ; ce qui est manifestement impossible. En
second lieu, on peut renverser par une seule objection toutes ces
visions chimériques, celles que notre imagination crée à plaisir (et
nous reconnaissons qu'elle ne fait pas défaut dans cette besogne),
comme celles qui se produisent dans le sommeil, dans l'ivresse, dans
la démence. Car nous déclarons qu'aucune des représentations de ce
genre ne présente ce caractère d'évidence auquel nous devons nous
tenir inébranlablement attachés. Quel est l'homme qui, après avoir
donné carrière à son imagination, ne sent pas, lorsqu'il a secoué
son rêve, et qu'il est rentré en lui-même, toute la différence qu'il
y a entre des choses évidentes et des chimères ? J'en dirai tout
autant des songes. Croyez-vous qu'Ennius, après s'être promené dans
des jardins avec Ser. Galba, son voisin, ait dit : “II me semble que
je me promenais avec Galba ?” Mais quand il nous fait le récit d'un
songe, il dit : “Il me semblait que le poète Homère était devant mes
yeux.” Et de même, dans Épicharme : “Je rêvais, et il me semblait
que j'étais mort.” Aussi, dès que nous sommes réveillés,
méprisons-nous ces visions, et sommes-nous loin de les prendre au
sérieux comme les actes de notre vie publique.
XVII. Mais, dit-on, ces objets
chimériques de nos songes ont tous les traits de la réalité. Il s'en
faut beaucoup ; mais je ne veux pas insister sur cette différence ;
qu'il nous suffise de dire que, pendant le sommeil, l'esprit et les
sens n'ont ni la même vigueur, ni la même intégrité que pendant la
veille. Pour les hommes ivres, ils sont loin d'agir avec autant
d'assurance que lorsqu'ils 452
ont les sens rassis : ils sont indécis, ils hésitent, ils se
reprennent par moments ; ils ne prêtent à ce qu'il leur semble voir
qu'une foi chancelante : et après avoir dormi, ils comprennent toute
la vanité de ces visions. La même chose arrive dans la démence : le
furieux, au premier moment de son accès, ne fait que rendre son
impression, en disant qu'il voit des chose qui cependant n'existent
pas mais quand il éprouve quelque relâche, il sent alors et parie
comme Alcméon : “Mon cœur dément le rapport de mes yeux.” — Mais le
sage, dans un accès de fureur, retient son jugement, de crainte de
recevoir l'erreur pour la vérité. — Il le retient encore dans bien
d'autres circonstances ; lorsque ses sens sont appesantis et
alanguis, lorsqu'il trouve de l'obscurité dans les choses, ou
lorsque le temps lui manque de les bien connaître. Mais en toute
circonstance, de cela même, que le sage retient son jugement, il
faut conclure contre vous. Car s'il n'y avait aucune différence
entre les représentations, il s'abstiendrait toujours, ou ne
s'abstiendrait jamais. Tout cet ordre d'objections nous montre bien
avec quelle légèreté raisonnent ceux qui veulent tout confondre.
Nous demandons suivant quelles règles juge l'homme grave, égal,
ferme et sage ; et l'on nous cite pour exemples les rêves, les accès
de fureur et les vapeurs du vin. Ne voyons-nous pas, dans toute
cette argumentation, quelle est l'inconséquence de notre langage ?
N'avons-nous pas scrupule de mettre en avant les hommes plongés dans
le sommeil et dans l'ivresse et ceux dont l'esprit est renversé,
usant d'un procédé si absurde, que nous déclarons tantôt qu'il y a
une différence entre les perceptions de la veille et celles du
sommeil, entre les perceptions d'un esprit sain et rassis, et celles
d'usé intelligence disposée autrement ; tantôt qu'il n'y a aucune
différence ? Ils ne voient pas même que par là ils rendent tout
incertaines ; ce qu'ils ne veulent pas : j'appelle incertaines les
choses que les Grecs nomment ἄδηλα. S'il en est ainsi, qu'entre les
perceptions d'un homme sensé et celles d'un fou il n'y ait aucune
différence, qui pourra être assuré de posséder son bon sens ? Et
vouloir atteindre un tel résultat, n'est pas d'un homme médiocrement
insensé. Insister, comme ils le font, sur les ressemblances des
jumeaux et des empreintes d'un même cachet, c'est une puérilité. Qui
de nous songe à nier les ressemblances quand le monde nous en offre
tant ? Maïs si c'est assez pour détruire toute connaissance qu'il y
ait parmi les choses beaucoup de ressemblances, pourquoi ce point
que nous vous accordons nous-mêmes ne vous suffit-il pas ? Et
pourquoi voulez-vous plutôt, en donnant un démenti à la nature,
établir qu'une chose n'est pas telle en son espèce qu'elle l'est en
effet, et qu'entre deux ou plusieurs êtres, il puisse exister une
identité parfaite ? Deux œufs et deux abeilles présentent une
extrême similitude ; pourquoi donc vous donner tant de mal ? Et que
voulez-vous avec vos jumeaux ? On vous accorde qu'ils sont
semblables ; cela pouvait vous suffire. Vous voulez qu'ils soient
non pas semblables, mais identiquement les mêmes ; ce qui est tout à
fait impossible. Vous recourez ensuite à ces physiciens dont on
s'est tant moqué dans l'Académie (et que vous finirez certainement
par invoquer vous-même), et vous dites que, selon Démocrite, il y a
une infinité de mondes parmi lesquels certains sont non-seulement
semblables, mais de tous points et parfaitement pareils, ne
453 présentant absolument
aucune différence, et que ceux-là même sont innombrables ; qu'il en
est, sous ce rapport, des hommes comme des mondes. Vous demandez
alors que puisque deux mondes peuvent être exactement pareils, à ce
point qu'il n'y ait pas même entre eux la plus légère différence, on
vous accorde qu'il y ait aussi dans notre monde des objets tellement
semblables qu'on ne puisse trouver la moindre différence entre eux.
Pourquoi, dites-vous, tandis que ces atomes, qui, selon Démocrite,
donnent naissance à tout, peuvent produire et produisent en effet
dans les autres mondes, dont le nombre est infini, un nombre infini
de Q. Lutatius Catulus ; pourquoi, dans le monde si vaste, que nous
habitons, un autre Catulus ne pourrait-il pas se rencontrer ?
XVIII. D'abord, vous me parlez au nom
de Démocrite dont je récuse l'autorité ; je veux au contraire vous
opposer celle de bien meilleurs physiciens qui prouvent évidemment
que chaque chose a ses propriétés particulières. Imaginez ces deux
anciens Servilius, frères jumeaux, aussi ressemblants qu'on ledit ;
pensez-vous pour cela qu'ils aient été identiquement les mêmes ? On
ne savait les distinguer dehors, mais on le savait chez eux ; les
étrangers ne l'auraient pu, mais les leurs le pouvaient.
L'expérience ne nous prouve t-elle pas que ceux dont nous n'aurions
jamais pensé pouvoir discerner les traits, nous deviennent avec
l'habitude si facilement reconnaissables, que leur ressemblance
finit par s'évanouir à nos yeux ? Contestez, si vous voulez, je ne
discuterai pas ; j'accorderai que le sage, qui fait l'objet de tout
cet entretien, retiendra son jugement, lorsque des objets semblables
dont il n'aura pas une connaissance exacte se présenteront à ses
yeux ; et que jamais il ne se fiera à d'autre représentation qu'à
celle dont on ne peut craindre que l'erreur prenne les traits il a
pour les cas ordinaires une certaine méthode qui lui apprend à
distinguer le vrai du faux ; et quant à ces ressemblances,
l'habitude est tout ce qu'il faut. Une mère sait bien distinguer ses
deux enfants jumeaux, habituée qu'elle est à les voir ; avec de
l'exercice, vous y parviendrez comme elle. Vous savez combien les
œufs se ressemblent dans le proverbe ? Cependant nous avons appris
qu'à Délos (du temps que cette île florissait) certains individus
nourrissaient un grand nombre de poules pour en faire le commerce,
et à la simple inspection d'un œuf savaient dire quelle poule
l'avait pondu. Vous voyez donc que cette ressemblance ne prouve rien
contre nous ; car il nous suffit qu'on puisse distinguer ces œufs
les uns des autres. Il est vrai que pour moi je ne puis prononcer
avec certitude que c'est bien là tel œuf, pas plus que s'il n'y
avait entre eux tous aucune différence ; car j'ai pour règle de ne
juger vraie une apparence que lorsqu'il est impossible qu'elle soit
fausse : et je ne puis m'écarter de cette règle d'une seule ligne,
comme on dit ; sans quoi je confondrais tout. Car non-seulement la
connaissance, mais même l'essence du vrai et du faux est anéantie,
s'il n'y a point de différence entre eux ; et c'est dire une
absurdité que de prétendre comme vous le faites parfois, que,
lorsque les représentations s'impriment sur l'esprit, ce n'est pas
entre les impressions mêmes que vous contestez qu'il y ait des
différences, mais entre les apparences, et, si on peut le dire, les
figures 454 des objets
représentés : comme si ce n'était pas par ces apparences que l'on
juge les représentations! Vous les dépouillez de toute autorité, en
supprimant la marque distinctive du vrai et du faux. Mais ce qui est
encore plus absurde, c'est de dire que vous suivez les probabilités
lorsque rien ne vous en empêche. D'abord, comment pourriez-vous ne
pas être empêchés, puisque le vrai et le faux n'ont rien qui les
sépare ? En second lieu, quelle est la marque caractéristique du
vrai, si cette marque lui est commune avec le faux ? De tels
principes, il a bien fallu venir à l'ἐποχή, c'est-à-dire a la
suspension du jugement, dans laquelle Arcésilas a su se maintenir
plus fermement que Carnéade, si ce que plusieurs pensent de ce
dernier est vrai. Si l'on ne peut rien connaître, comme ils le
croient l'un et l'autre, il faut renoncer à toute affirmation ; quoi
de plus vain, en effet, que d'affirmer ce qu'on ne connaît pas ? On
vous disait hier encore que Carnéade fléchissait quelquefois jusqu'à
dire que le sage pourrait porter des jugements anticipés, ou, en
propres termes, faire une faute grave. Pour moi, je suis
très-certain qu'il y a quelque chose que l'on peut connaître ; et
voici trop longtemps déjà que je discute pour le prouver : mais je
le suis encore plus, que le sage ne portera jamais de tels
jugements, c'est-à-dire, n'affirmera jamais ce qui est faux, ou ce
qu'il ne connaît pas. Reste ee principe de nos adversaires : Que
pour découvrir la vérité, il faut parler successivement pour et
contre toutes les opinions. Voyons donc ce qu'ils ont découvert.
Nous n'avons pas coutume de le montrer, me répondent-ils. Quels sont
donc ces mystères ? Et pourquoi cacher votre pensée, comme quelque
chose de honteux ? Pour que ceux qui nous écrivent prennent plutôt
pour guide leur raison que notre autorité. Mais pourquoi
n'auraient-ils pas deux guides à la fois ? serait-ce un mal pour eux
? Il est un de leurs dogmes cependant que nos adversaires ne cachent
pas, c'est qu'on ne peut rien connaître. Mais est-ce qu'ici leur
autorité n'a pas d'inconvénient ? Pour moi, je suis persuade qu'elle
en a beaucoup. Qui eût embrassé une doctrine dont la fausseté et le
vice éclatent avec tant d'évidence, si Arcésilas, et bien plus
encore Carnéade, n'avaient fait preuve d'une telle richesse de
connaissances et d'un si beau talent d'expression ?
XIX. Voilà à peu près ce qu'Antiochus
nous dit alors à Alexandrie, et ce que fort longtemps après il
répéta avec encore plus d'insistance en Syrie, où il m'accompagnait,
peu de temps avant sa mort. Maintenant que j'ai prouvé l'excellence
de ma cause, je n'hésiterai pas à vous faire une observation, à vous
pour qui j'éprouve la plus vive amitié (c'est à moi que s'adressait
Lucullus), et qui êtes plus jeune que moi de quelques années.
Comment, vous qui avez fait un si magnifique éloge de la philosophie
et triomphé des répugnances de notre cher Hortensius, comment
pouvez-vous suivre une doctrine qui confond le vrai avec le faux,
qui nous retire notre jugement, nous interdit toute affirmation,
nous dépouille de nos sens ? Les Cimmériens, à qui la vue du soleil
était dérobée ou par un dieu, ou par quelque jeu de la nature, ou
par la position même du lieu qu'ils habitaient, avaient cependant
des feux à la lumière desquels ils pouvaient se conduire ; mais ces
philosophes, dont vous vous faites le partisan, après nous avoir
enveloppés de si épaisses ténèbres, ne nous laissent pas même une
seule étincelle pour guider nos regards. Si nous nous rendons à eux,
ils nous enveloppent 455
de tels liens que nous ne pouvons plus nous mouvoir. Dès lors qu'on
nous interdit toute affirmation, on nous interdit en même temps de
nous résoudre et d'agir ; car non-seulement nous ne pourrions rien
faire de bien, mais tout acte nous devient en réalité impossible.
Prenez garde qu'il ne vous soit moins permis qu'a tout autre de
soutenir une telle doctrine. Comment! vous qui avez découvert les
menées les plus ténébreuses et les avez révélées en plein jour, vous
qui avez affirmé par serment que la certitude vous en était acquise
(ce que je pouvais affirmer aussi, puisque j'étais initié par vous à
cette découverte), vous irez soutenir qu'on ne peut absolument rien
comprendre, rien affirmer, rien connaître! Prenez garde, je vous en
conjure, de porter vous-même atteinte à l'autorité de ces admirables
actions. Lucullus se tut alors. Pour Hortensius, tout ravi
d'admiration (le discours de Lucullus l'avait mis dans un transport
continuel ; il levait souvent les mains au ciel ; et je ne m'en
étonne pas, car je crois qu'on n'a jamais attaqué l'Académie avec
plus de talent), il se mit aussi à m'exhorter de changer de doctrine
: plaisantait-il, ou parlait-il sérieusement, c'est ce que je ne
pouvais trop comprendre. Catulus me dit alors : Si vous avez été
convaincu par ce discours où Lucullus a déployé tant de mémoire, de
méthode et de richesse, je me tais, et ne veux point vous détourner
de changer de système, si vous vous y sentez engagé. Cependant je ne
serais point d'avis qu'il eût tant de crédit sur votre jugement. Peu
s'en faut, ajouta-t-il en souriant, que notre ami ne vous ait
conseillé de prendre garde qu'un méchant tribun (c'est une race qui
ne manquera jamais, comme vous le savez) ne vous saisisse et ne vous
entraîne de force devant le peuple pour vous y accuser
d'inconséquence, vous qui dites qu'on ne peut rien découvrir de
certain, et qui vous êtes vanté naguères d'une découverte certaine.
Que cette menace ne vous épouvante pas trop. Quant au sujet de la
discussion, j'aimerais mieux, je l'avoue, vous voir d'un autre avis
que Lucullus. Cependant, si vous changiez d'opinion, je n'en serais
pas extrêmement surpris. Car je me souviens qu'Antiochus, après
avoir pensé comme vous pendant fort longtemps, au premier revirement
d'idées, changea brusquement de doctrine. — Après ces paroles de
Catulus, tous les regards se fixèrent sur moi.
XX. Ému, comme je le suis d'ordinaire
dans toutes les grandes causes, je commençai à peu près en ces
termes : Catulus, le discours de Lucullus a fait sur moi toute
l'impression que doit produire le langage d'un homme savant,
abondant, qui a médité ce qu'il dit, et n'omet rien de ce qui peut
servir sa cause ; non pas que je désespère de pouvoir y répondre :
l'autorité de ses conseils aurait eu un grand empire sur mon esprit,
si vous ne lui aviez opposé l'autorité tout aussi considérable des
vôtres. J'engagerai donc le combat après avoir dit un mot pour
couvrir ma réputation. Si j'avais embrassé cette philosophie par
ostentation ou par une certaine humeur contentieuse, je livrerais à
la condamnation non seulement une telle folie, mais encore toute ma
conduite, et la nature même de mon esprit. Car si dans les moindres
choses on blâme justement l'obstination, et l'on punit l'imposture,
voudrais-je, par pure opiniâtreté, contester à mes semblables ce
qu'ils pensent de la véritable condition et de la conduite éclairée
de la vie humaine ? voudrais-je, de gaieté de cœur, les plonger dans
les ténèbres, et moi-même avec eux ? C'est pour-
456 quoi, si je ne croyais
ridicule de faire dans une telle discussion, ce que l'on fait
quelquefois lorsqu'il s'agit des intérêts de la république, je
jurerais par Jupiter et par nos dieux pénates que je brûle du désir
de découvrir la vérité, et que je ne dis rien dont je ne sois
convaincu. Comment pourrais-je ne pas souhaiter de découvrir le
vrai, moi qui me réjouis déjà de trouver le vraisemblable ? Mais de
même que, selon moi, rien n'est plus beau que de voir la vérité,
rien aussi ne me paraît plus honteux que de prendre le faux pour le
vrai. Je ne prétends pas pour mon compte ne jamais me tromper, ne
jamais préjuger, ne jamais conjecturer ; mais c'est du sage que nous
parlons. Pour moi, je suis un grand faiseur de conjectures (car je
ne me donne pas pour un sage), et je dirige mes pensées non du côté
de la petite Ourse, “ce guide nocturne des Phéniciens au milieu des
flots” comme dit Aratus, et qui conduit d'autant mieux le pilote que
“dans sa course restreinte, elle décrit un plus petit orbe ;” mais
vers la grande Ourse et l'éclatante région du Nord, c'est-à-dire
vers le champ plus étendu et où l'esprit est plus à l'aise, des
raisons probables ; ce qui fait que j'erre souvent, et vais un peu à
l'aventure. Mais, comme je l'ai dit, ce n'est pas de moi qu'il est
question, c'est du sage. Lorsque ces représentations ont frappé
vivement mon esprit ou mes sens, je les reçois, et quelquefois même
j'y donne mon assentiment ; mais je ne les perçois point, car je
crois qu'on ne peut rien percevoir. Je ne suis pas un sage ; je cède
à ces représentations, je ne puis leur résister. Mais Arcésilas
pense, d'accord en cela avec Zénon, que la plus grande vertu du
sage, c'est de ne point se laisser prendre, et de veiller à n'être
pas trompé. Rien n'est plus opposé à l'idée que nous avons de la
gravité du sage, que l'erreur, la légèreté, la témérité de l'esprit.
Mais pourquoi parler de la fermeté du sage ? n'avouez-vous pas
vous-même, Lucullus, que jamais il ne porte de jugement précipité ?
Puisque vous convenez de ce point important (j'abandonne un instant
l'ordre de la discussion pour y revenir bientôt), voyez d'abord
quelle est la force de ce raisonnement.
|
|
XXI. « Si ulli rei sapiens adsentietur umquam,
aliquando etiam opinabitur ; numquam autem opinabitur ; nulli igitur rei
adsentietur». Hanc conclusionem Arcesilas probabat ; confirmabat enim et primum
et secundum. Carneades non numquam secundum illud dabat, adsentiri aliquando ;
ita sequebatur etiam opinari, quod tu non vis, et recte ut mihi videris. Sed
illud primum, sapientem si adsensurus esset etiam opinaturum, falsum esse Stoici
dicunt et eorum adstipulator Antiochus ; posse enim eum falsa a veris et quae non
possint percipi ab iis quae possint distinguere. Nobis autem primum etiam si
quid percipi possit tamen ipsa consuetudo adsentiendi periculosa esse videtur et
lubrica. Quam ob rem cum tam vitiosum esse constet adsentiri quicquam aut falsum
aut incognitum, sustinenda est potius omnis adsensio, ne praecipitet si temere
processerit. Ita enim finitima sunt falsa veris eaque quae percipi non possunt
<iis quae possunt> (si modo ea sunt quaedam ; iam enim videbimus), ut tam in
praecipitem locum non debeat se sapiens committere. Sin autem omnino nihil esse
quod percipi possit a me sumpsero et quod tu mihi das accepero, sapientem nihil
opinari, effectum illud erit, sapientem adsensus omnes cohibiturum, ut videndum
tibi sit idne malis an aliquid opinaturum esse sapientem. «Neutrum» inquies
«illorum» [nitamur]. Nitamur igitur nihil posse percipi ; etenim de eo omnis est
controversia.
XXII. Sed prius pauca cum Antiocho, qui haec ipsa
quae a me defenduntur et didicit apud Philonem tam diu ut constaret diutius
didicisse neminem, et scripsit de iis rebus acutissime, et idem haec non acrius
accusavit in senectute quam antea defensitaverat. Quamvis igitur fuerit acutus,
ut fuit, tamen inconstantia levatur auctoritas. Quis [quam] enim iste dies
inluxerit quaero, qui illi ostenderit eam quam [quam] multos annos esse
negitavisset veri et falsi notam. Excogitavit aliquid ? Eadem dicit quae Stoici.
Paenituit illa sensisse ? Cur non se transtulit ad alios, et maxime ad Stoicos ?
Eorum enim erat propria ista dissensio. Quid eum Mnesarchi paenitebat, quid
Dardani ; qui erant Athenis tum principes Stoicorum. Numquam a Philone discessit,
nisi postea quam ipse coepit qui se audirent habere. Unde autem subito vetus
Academia revocata est ? nominis dignitatem videtur, cum a re ipsa descisceret,
retinere voluisse. Quod erant qui illum gloriae causa facere dicerent, sperare
etiam fore ut qui se sequerentur Antiochii vocarentur ; mihi autem magis
videtur non potuisse sustinere concursum omnium philosophorum. Etenim de ceteris
sunt inter illos non nulla communia ; haec Academicorum est una sententia quam
reliquorum philosophorum nemo probet. Itaque cessit, et ut ii qui
sub novis
solem non ferunt item ille cum aestuaret veterum ut maenianorum sic Academicorum
umbram secutus est. Quoque solebat uti argumento tum cum ei placebat nihil
posse percipi, cum quaereret, Dionysius ille Heracleotes
utrum conprehendisset
certa illa nota qua adsentiri dicitis oportere, illudne quod multos annos
tenuisset Zenonique magistro credidisset, honestum quod esset id bonum solum
esse, an quod postea defensitavisset, honesti inane nomen esse, voluptatem esse
summum bonum – qui ex illius commutata sententia docere vellet nihil ita signari
in animis nostris a vero posse quod non eodem modo possit a falso, is curavit
quod argumentum ex Dionysio ipse sumpsisset ex eo ceteri sumerent. Sed cum hoc
alio loco plura ; nunc ad ea quae a te Luculle dicta sunt.
XXIII. Et primum quod initio dixisti videamus
quale sit, similiter a nobis de antiquis philosophis commemorari atque seditiosi
solerent claros viros sed tamen populares aliquos nominare. Illi cum res <non>
bonas tractent similes bonorum videri volunt ; nos autem ea dicimus nobis videri
quae vosmet ipsi nobilissimis philosophis placuisse conceditis.
Anaxagoras nivem
nigram dixit esse. Ferres me si ego idem dicerem ? tu ne si dubitarem quidem. At
quis est ? num hic sophistes (sic enim appellabantur ii qui ostentationis aut
quaestus causa philosophantur) ? Maxima fuit et gravitatis et ingeni gloria. Quid
loquar de Democrito ? quem cum eo conferre possumus non modo ingenii magnitudine
sed etiam animi, qui ita sit ausus ordiri «haec loquor de universis» : nihil
excipit de quo non profiteatur, quid enim esse potest extra universa ; quis hunc
philosophum non anteponit Cleanthi Chrysippo reliquis inferioris aetatis,
qui
mihi cum illo collati quintae classis videntur. Atque is non hoc dicit quod nos,
qui veri esse aliquid non negamus, percipi posse negamus ; ille esse verum plane
negat [esse] ; sensus quidem non obscuros dicit sed tenebricosos (sic enim
appellat eos). Is qui hunc maxime est admiratus,
Chius Metrodorus initio libri
qui est de natura «nego» inquit «scire nos sciamusne aliquid an nihil sciamus,
ne id ipsum quidem nescire aut scire nos, nec omnino sitne aliquid an nihil
sit». Furere tibi Empedocles videtur : at mihi dignissimum rebus is de quibus
loquitur sonum fundere. Num ergo is excaecat nos aut orbat sensibus, si parum
magnam vim censet in is esse ad ea quae sub eos subiecta sunt iudicanda ?
Parmenides Xenophanes minus bonis quamquam versibus sed tamen illi versibus
increpant eorum adrogantiam quasi irati, qui cum sciri nihil possit audeant se
scire dicere. Et ab iis aiebat removendum Socratem et Platonem. Cur, an de ullis
certius possum dicere ? vixisse cum iis equidem videor, ita multi sermones
perscripti sunt e quibus dubitari non possit quin Socrati nihil sit visum sciri
posse ; excepit unum tantum, scire se nihil se scire, nihil amplius. Quid dicam
de Platone, qui certe tam multis libris haec persecutus non esset nisi
probavisset ; ironeam enim alterius, perpetuam praesertim, nulla fuit ratio
persequi.
XXIV. Videorne tibi non ut Saturninus nominare
modo inlustres homines, sed etiam imitari numquam nisi clarum nisi nobilem ? Atqui habebam molestos vobis sed minutos,
Stilbonem Diodorum Alexinum, quorum
sunt contorta et aculeata quaedam sophismata (sic enim appellantur fallaces
conclusiunculae). Sed quid eos colligam, cum habeam Chrysippum, qui fulcire
putatur porticum Stoicorum : quam multa ille contra sensus, quam multa contra
omnia quae in consuetudine probantur. «At dissolvit idem.» Mihi quidem non
videtur, sed dissolverit sane : certe tam multa non collegisset quae nos
fallerent probabilitate magna, nisi videret is resisti non facile posse. Quid
Cyrenaei videntur, minime contempti philosophi, qui negant esse quicquam quod
percipi possit extrinsecus, ea se sola percipere quae tactu intumo sentiant, ut
dolorem ut voluptatem ; neque se quo quid colore aut quo sono sit scire, sed
tantum sentire adfici se quodam modo. Satis multa de auctoribus. Quamquam ex me
quaesieras, nonne putarem post illos veteres tot saeculis inveniri verum
potuisse tot ingeniis tantisque studiis quaerentibus. Quid inventum sit paulo
post videro, te ipso quidem iudice. Arcesilan vero non obtrectandi causa cum
Zenone pugnavisse sed verum invenire voluisse sic intellegitur. Nemo umquam
superiorum non modo expresserat sed ne dixerat quidem posse hominem nihil
opinari, nec solum posse sed ita necesse esse sapienti. Visa est Arcesilae cum
vera sententia tum honesta et digna sapienti ; quaesivit de Zenone fortasse quid
futurum esset si nec percipere quicquam posset sapiens nec opinari sapientis
esset. Ille credo nihil opinaturum, quoniam esset quod percipi posset. Quid ergo
id esset. «visum» credo. «quale igitur visum ?» tum illum ita definisse : ex eo
quod esset sicut esset inpressum et signatum et effictum. Post requisitum
etiamne si eius modi esset visum verum quale vel falsum. Hic Zenonem vidisse
acute nullum esse visum quod percipi posset, si id tale esset ab eo quod est
cuius modi ab eo quod non est posset esse. Recte consensit Arcesilas ad
definitionem additum, neque enim falsum percipi posse neque verum si esset tale
quale vel falsum ; incubuit autem in eas disputationes ut doceret nullum tale
esse visum a vero ut non eiusdem modi etiam a falso possit esse. Haec est una
contentio quae adhuc permanserit. Nam illud, nulli rei adsensurum esse
sapientem, nihil ad hanc controversiam pertinebat. Licebat enim «nihil percipere
et tamen opinari» ; quod a Carneade dicitur probatum : equidem Clitomacho plus
quam Philoni aut Metrodoro credens hoc magis ab eo disputatum quam probatum
puto. Sed id omittamus. Illud certe opinatione et perceptione sublata sequitur,
omnium adsensionum retentio, ut si ostendero nihil posse percipi tu concedas
numquam adsensurum esse.
XXV. Quid ergo est quod percipi possit, si ne
sensus quidem vera nuntiant ? quos tu Luculle communi loco defendis. Quod ne id
facere posses, idcirco heri non necessario loco contra sensus tam multa dixeram
;
tu autem te negas infracto remo neque columbae collo commoveri. Primum cur ? nam
et in remo sentio non esse id quod videatur, et in columba pluris videri colores
nec esse plus uno. Deinde nihilne praeterea diximus ? «Maneant illa omnia ;
†lacerat ista causa : veracis suos esse sensus dicit <Epicurus>». Igitur semper
auctorem habes, et eum qui magno suo periculo causam agat ; eo enim rem demittit
Epicurus, si unus sensus semel in vita mentitus sit, nulli umquam esse
credendum. Hoc est verum esse, confidere suis testibus et †inportata insistere ;
itaque Timagoras Epicureus negat sibi umquam cum oculum torsisset duas ex
lucerna flammulas esse visas ; opinionis enim esse mendacium non oculorum : quasi
quaeratur quid sit, non quid videatur. Sic hic quidem, maiorum similis ; tu vero,
qui visa sensibus alia vera dicas esse alia falsa, qui ea distinguis ? Et desine
quaeso communibus locis ; domi nobis ista nascuntur. «Si» inquis «deus te
interroget ‹sanis modo et integris sensibus num amplius quid desideras›, quid
respondeas ?» Utinam quidem roget : audies quam nobiscum male †agerent. Ut enim
vera videamus, quam longe videmus ? Ego Catuli Cumanum ex hoc loco cerno ;
regionem video <Pompeiani, ipsum> Pompeianum non cerno, neque quicquam
interiectum est quod obstet, sed intendi acies longius non potest. O praeclarum
prospectum : Puteolos videmus ; at familiarem nostrum P. Avianium fortasse in
porticu Neptuni ambulantem non videmus. «At
ille nescio qui, qui in scholis
nominari solet, mille et octingenta stadia quod abesset videbat.» Quaedam
volucres longius ; responderem igitur audacter isti vestro deo me plane his
oculis non esse contentum. Dicit me acrius videre quam illos pisces fortasse,
qui neque videntur a nobis (et nunc quidem sub oculis sunt) neque ipsi nos
suspicere possunt ; ergo ut illis aqua sic nobis aer crassus offunditur. «At
amplius non desideramus.» Quid talpam num desiderare lumen putas ? Neque tam
quererer cum deo quod parum longe quam quod falsum viderem. Videsne navem illam
:
stare nobis videtur ; at iis qui in nave sunt moveri haec villa. Quaere rationem
cur ita videatur ; quam ut maxime inveneris, quod haut scio an non possis, non tu
verum testem habere, sed eum non sine causa falsum testimonium dicere
ostenderis.
suite |
XXI. Si le sage affirme jamais quelque
chose, il portera un jugement anticipé ; or le sage ne porte jamais
de jugement précipité ; il n'affirmera donc jamais rien. Arcésilas
établissait solidement celte conclusion ; car il prouvait les deux
premières propositions. Carnéade accordait quelquefois qu'il est des
circonstances ou l'affirmation est permise au sage. Mais il
s'ensuivait qu'il portait alors des jugements précipités ; ce que
vous n'accordez pas, et selon moi avec beaucoup de raison. Mais
cette première proposition, que le sage, s'il affirme, porte un
jugement précipité, est attaquée par les Stoïciens et par Antiochus,
leur tenant, lis disent que le sage peut distinguer le faux du vrai,
et ce que l'on peut connaître, de ce dont la connaissance est
impossible. Nous pensons, nous, que quand même il serait possible de
connaître certaines choses, l'habitude d'affirmer met l'esprit sur
une pente très-dangereuse. En conséquence, puisque l'on convient
qu'il n'est pas plus excusable d'affirmer l'inconnu que le faux, il
vaut donc mieux retenir 457
son jugement, de crainte qu'il ne s'égare, si on le laisse aller à
l'aventure. L'erreur est si voisine de la vérité, et ce qui échappe
à la connaissance tient de si près à ce qu'elle peut saisir (supposé
qu'elle puisse en effet saisir quelque chose, ce que nous
examinerons plus tard), que le sage ne doit point se commettre dans
un lieu si plein d'écueils. Ainsi donc, si je réunis notre maxime,
que rien absolument ne peut être connu, au principe que vous
m'accordez, que le sage ne porte point de jugement précipité, la
conséquence sera, que le sage doit s'interdire toute affirmation ;
et vous aurez alors à voir si vous aimez mieux qu'il en soit ainsi,
ou si vous préférez que le sage se livre quelquefois à ses
conjectures. Vous ne voulez ni l'un ni l'autre, dites-vous. Essayons
donc de prouver qu'on ne peut rien connaître. C'est sur ce point en
effet que roule toute la controverse.
XXII. Mais d'abord occupons-nous un peu
d'Antiochus. La doctrine dont je me fais le défenseur, il l'apprit
dans l'enseignement de Philon, que de l'aveu de tout le monde
personne ne suivit plus longtemps que lui ; il la soutint lui-même
dans des livres pleins de talent, et ne l'attaqua pas ensuite dans
la vieillesse plus vivement qu'il ne l'avait défendue. Malgré tout
son bel esprit, il faut bien avouer que cette circonstance nuit
singulièrement à son autorité. Quel jour subit, je vous prie, lui a
donc révélé cette marque distinctive du vrai et du faux, dont il
avait si longtemps nié l'existence ? Quelque pensée nouvelle
a-t-elle frappé son esprit ? Il répète ce que disent les Stoïciens.
S'est-il repenti de ses premières opinions ? pourquoi alors ne pas
se transporter dans un autre camp, et surtout dans celui des
Stoïciens ? Car ce sont eux avant tous les autres qui faisaient
cette guerre à l'Académie. Quoi donc! aurait-il rougi de Mnésarque
et de Dardanus, qui étaient, dans ce temps, à Athènes, les chefs de
l'école stoïcienne ? Il ne se montra en dissentiment avec Philon que
lorsqu'il eut des auditeurs à son tour. Mais d'où vient tout à coup
ce désir de ressusciter l'ancienne Académie ? Sans doute, trahissant
la cause, il voulait au moins conserver un nom si respectable ;
plusieurs disaient qu'il pensait se faire de cette restauration un
titre de gloire ; peut-être aussi espérait-il que ses disciples
prendraient le nom d'Antiochiens. Pour moi, je crois qu'il n'avait
pu soutenir l'attaque réunie de tous les philosophes ; car ils ont
tous des principes communs sur certains points de philosophie ; mais
les Académiciens seuls soutiennent cette opinion sur la
connaissance, que combattent, sans exception, les autres écoles. Il
céda donc, et comme ceux qui, ne pouvant supporter le soleil des
Boutiques neuves, se réfugient près des anciennes, à l'ombre de la
colonne Ménia, fatigué de la chaleur, il alla chercher l'ombre de
l'ancienne Académie. Du temps qu'il soutenait avec nous qu'on ne
peut rien comprendre, voici l'exemple favori dont il appuyait sa
doctrine ; il demandait où Denis d'Héraclée avait rencontré cette
marque certaine du vrai, dont vous voulez faire la règle de nos
jugements ; était-ce dans sa première opinion, qu'il soutint si
longtemps, répétant, d'après Zénon, son maître, que l'honnête est le
seul bien ? était-ce dans sa nouvelle, quand il déclarait que
l'honnête n'est qu'un vain nom, et que la volupté est le bien
suprême ? Antiochus voulait prouver par cette variation que la
vérité ne peut faire en nos âmes aucune impression que
458 le faux ne produise à
son tour ; mais l'argument que Denis lui avait fourni, il se chargea
lui-même de le fournir aux autres. Au reste, nous nous occuperons
ailleurs d'Antiochus plus longtemps ; j'en viens maintenant à ce que
vous avez dit, Lucullus.
XXIII. Voyons d'abord si ce que vous
disiez en commençant est bien fondé. Vous nous avez comparé, quand
nous rappelons l'exemple des anciens philosophes, à ces citoyens
séditieux, qui invoquent des noms illustres et populaires à la fois,
et qui, tramant de méchantes entreprises, veulent paraître
semblables aux gens de bien. Mais les opinions que nous professons,
vous reconnaissez vous-mêmes qu'elles furent celles des plus
célèbres philosophes. Anaxagore a dit que la neige est noire.
Souffririez-vous que j'en disse autant ? Vous ne me permettriez pas
même le doute à ce sujet. Et cependant, de quelle bouche ce mot
est-il sorti ? Est-ce de celle d'un sophiste ? ou appelait ainsi
ceux qui faisaient de la philosophie une parade ou un métier ; mais
Anaxagore avait la réputation d'un grand et consciencieux esprit.
Que dire de Démocrite ? qui peut-on lui comparer pour la force du
génie et la grandeur d'âme ? C'est lui qui commença un livre en ces
termes : “Je vais parler de tout ce qui existe ; “rien n'est excepté
de cet engagement solennel ; car, en dehors de tout, que pourrait-il
y avoir ? Qui ne préfère ce philosophe à Cléanthe, à Chrysippe, et à
ceux des âges modernes ? Comparés avec lui, ils me paraissent de
pauvres gens de la cinquième classe. Et Démocrite ne dit pas comme
nous, que le vrai existe, mais qu'on ne peut le connaître ; il nie
positivement l'existence de la vérité ; nos sens, pour lui, ne sont
pas obscurs, mais ténébreux ; c'est ainsi qu'il les nomme. Le plus
fervent de ses admirateurs, Métrodore de Chio, s'exprime ainsi au
commencement de son livre sur la nature : “Je nie que nous sachions
si nous savons quelque chose, ou si nous ne savons rien ; cela même,
nous ne l'ignorons ni nous ne le savons ; nous ne savons même pas
s'il existe quelque chose, ou si rien n'existe.” Empédocle vous
paraît hors de son sens ; pour moi, je trouve son langage très-digne
du sujet qu'il traite. Est-ce qu'il nous ôte la vue et nous prive de
tous nos sens, parce qu'il pense qu'ils sont peu capables de juger
des objets que la nature leur présente ? Parménide, Xénophane,
blâment dans des vers médiocres, il est vrai, mais n'en blâment pas
moins avec une certaine indignation, la présomption de ceux qui,
tandis qu'on ne peut rien savoir, osent se vanter de leur science.
Vous disiez qu'il fallait retrancher de cette liste Socrate et
Platon. Pourquoi ? Il n'est personne dont je puisse parler avec plus
d'assurance ; il me semble en effet, que j'ai vécu avec eux, tant il
nous a été conservé d'entretiens où nous apprenons, à n'en pouvoir
douter, que Socrate estimait qu'on ne peut rien savoir. Il exceptait
ceci : “je sais que je ne sais rien.” Rien de plus. Que dire de
Platon ? Eût-il consacré tant de livres à développer cette maxime,
s'il ne l'eût approuvée ? Car quelle autre raison d'employer
perpétuellement l'ironie de Socrate ?
XXIV. Est-ce que je vous semble, comme
Saturninus, n'invoquer des hommes illustres que le nom ? ne
voyez-vous pas plutôt que je ne prends pour modèles que la fleur de
la philosophie et ses i plus nobles organes ? J'avais bien encore
quelques 459 autorités,
embarrassantes pour vous, mais peu considérables, Stilpon, Diodore,
Alexinus, auteurs de certains sophismes (c'est ainsi qu'où nomme les
raisonnements captieux), qui ne manquent ni de subtilité ni d'art.
Mais à quoi bon recueillir leur témoignage, quand j'ai pour moi
Chrysippe, qui passe pour la colonne du Portique ? Combien
d'objections n'a-t-il pas dirigées contre les sens et contre toutes
les idées que l'on reçoit dans la vie pratique ?—Mais il les a
résolues ?—Je ne le pense pas ; mais admettons que cela soit ;
certainement il n'aurait pas réuni tant d'exemples de probabilités
trompeuses, s'il n'avait vu qu'il est difficile d'y résister. Et les
Gyrénaïques ? C'est une école qu'on est loin de mépriser, et qui
affirme que l'homme ne peut rien connaître en dehors de lui : tout
ce que l'on peut connaître, d'après elle, c'est ce que le sens
intérieur nous fait éprouver, comme la douleur, ou la volupté ; de
quel le couleur sont les corps, quels sons rendent-ils ? Elle n'en
sait rien ; elle sent seulement que l'esprit est affecté d'une
certaine façon. En voilà assez sur les autorités ; quoique cependant
vous m'ayez demandé si je ne pensais pas que depuis les anciens, la
vérité cherchée pendant tant de siècles par tant de beaux esprits,
et avec tant d'ardeur, n'ait pu enfin être découverte. J'examinerai
dans quelques instants, en vous prenant vous-même pour juge, ce que
l'on a découvert en effet. Quant à Arcésilas, s'il attaqua Zénon, ce
ne fut pas par une maligne envie, mais par le désir de trouver la
vérité ; et voici ce qui le prouve : aucun des anciens philosophes
n'avait, je ne dis pas démontré avec soin, mais énoncé en deux mots,
que tout homme peut s'abstenir de juger quand la lumière manque, et
que le sage non-seulement le peut, mais le doit. Cette maxime parut
à Arcésilas non seulement très-juste, mais fort louable et digne du
sage. On peut supposer qu'il demanda à Zénon ce qui doit arriver, si
le sage ne peut rien connaître, et s'il est indigne de lui de juger
sans lumière. Zénon répondit, j'imagine, que le sage ne jugera
jamais sans lumière, parce qu'il est des choses que l'on peut
connaître. — Quelles choses ? — Les représentations. — Mais quelles
représentations ? — Celles, aura répondu Zénon, qui viennent d'un
objet réel, et telles qu'elles sont déposées, imprimées et figurées
en nous. — Alors, si telle est la représentation vraie, quel est le
signe de la fausse ? — Ici Zénon vit parfaitement que nulle
représentation ne nous donnera de connaissance, si celles qui
viennent d'objets chimériques peuvent prendre les traits de celles
qui viennent d'objets réels. Arcésilas en tombe d'accord avec raison
; et l'on ajouta ce trait à la définition de la représentation vraie
; car il est clair qu'on ne pourrait connaître ni le faux ni le
vrai, si l'un et l'autre étaient pareils. Mais Arcésilas employa
tous ses efforts à démontrer qu'il n'est aucune représentation vraie
que l'erreur ne puisse exactement imiter. C'est là le véritable et
unique point de la controverse, qui dure encore. Car cette maxime,
que le sage ne doit rien affirmer, n'était pas engagée dans cette
discussion. On pouvait en effet, dans l'impossibilité de la
connaissance, ouvrir la porte à la conjecture ; ce que fit Carnéade,
nous dit-on. Pour moi, m'en fiant à Clitomaque, plus qu'à Philon et
à Métrodore, je crois que Carnéade agita cette question sans la
résoudre dans le sens dont je parlais. Mais laissons cela. Ce qu'il
y a de certain, c'est que la conjecture étant interdite, et la
connaissance impossible, nous arrivons directement à la suspension
de tout jugement, en sorte que, si je
460 prouve qu'on ne peut
rien connaître, vous m'accorderez que le sage n'affirmera jamais
rien.
XXV. Dites-moi donc ce que l'on peut
connaître, si les rapports des sens eux-mêmes sont faux. Vous les
défendez, Lucullus, mais par des lieux communs ; et c'est
précisément pour vous rendre ce genre de défense impossible, que
j'ai accumulé hier, lorsque je n'en avais pas besoin, tant
d'objections contre les sens. Mais vous déclarez que la rame brisée,
et le cou de la colombe n'ont rien qui vous émeuve. Et d'abord, je
vous demanderai pourquoi ? Car, d'un côté, je suis convaincu que la
rame n'est pas telle qu'elle le paraît ; et de l'autre, tout en
voyant plusieurs couleurs sur le cou de la colombe, je sais qu'il
n'y en a qu'une. Ensuite, n'ai-je rien dit de plus ? — Laissons là
tous ces arguments ; abandonnez cette cause. Épicure a fait un dogme
de la véracité de ses sens. — Vous invoquez donc toujours l'autorité
d'un homme dont la cause court de grands périls ; car il va jusqu'à
dire que si un de nos sens nous trompait une seule fois dans la vie,
nous ne devrions jamais nous fier à aucun. C'est là, j'espère, être
franc, se fier à ses propres témoins, et aller sans scrupule
jusqu'au bout de ses idées. Aussi Timagoras l'épicurien affirme-t-il
qu'en clignant l'œil il n'a jamais vu double la flamme d'une lampe ;
car c'est là, selon lui, une erreur du jugement, non des yeux :
comme s'il était ici question de la réalité, et non de l'apparence!
Mais Timagoras suivait naturellement l'exemple de ses maîtres. Pour
vous, qui déclarez que, parmi les représentations sensibles, il y en
a de vraies et de fausses, comment les distinguez-vous ? renoncez,
je vous en prie, à vos lieux communs ; nous n'en manquons pas dans
notre ménage. Si, dites-vous, Dieu me demandait ce que je pourrais
désirer de plus que la jouissance et le parfait état de tous mes
sens, qu'aurais-je à répondre ? Plût au ciel que cette question me
fût adressée! votre Dieu apprendrait de moi quelle misérable
condition il nous a faite. Pour que notre vue ne nous trompe pas,
jusqu'où peut-elle s'étendre ? je vois d'ici la campagne de Catulus
près de Cumes, je ne vois pas celle de Pompéi ; il n'y a pourtant
pas d'obstacle qui nous en cache la vue, mais mon regard ne peut
porter plus loin. N'est-ce pas là vraiment un bel horizon ? Nous
apercevons Pouzzole ; mais notre ami Avianus, qui se promène
peut-être sous le portique de Neptune, nous ne l'apercevons pas. On
cite dans les écoles un je ne sais quel individu qui voyait les
objets éloignés de lui de mille quatre-vingts stades. Certains
oiseaux voient encore plus loin. Je répondrais donc hardiment à
votre dieu, que je ne suis point content des yeux qu'il m'a donnés.
Il me dira que j'ai meilleure vue que ces poissons peut-être, dont
les flots nous dérobent l'aspect quoiqu'ils soient sous nos yeux, et
qui eux-mêmes ne peuvent élever leurs regards jusqu'à nous. Pour
eux, c'est l'eau ; pour nous, c'est un air épais qui nous enveloppe!
— Mais nous ne souhaitons rien de plus. — Eh! croyez-vous donc que
la taupe souhaite la lumière ? Et d'ailleurs je ne me plaindrais pas
tant à votre dieu de voir trop peu loin, que de voir faux.
Voyez-vous ce vaisseau ? Il nous semble immobile ; et à ceux qui le
montent, cette campagne paraît en mouvement. Cherchez la raison de
ces fausses apparences ; quand elle sera découverte (et je ne sais
trop si vous en viendrez à bout), tout ce que vous nous aurez
prouvé, ce n'est pas que vos sens sont de fidèles témoins, mais
qu'ils ne rendent pas de faux témoignages sans motifs.
suite
|