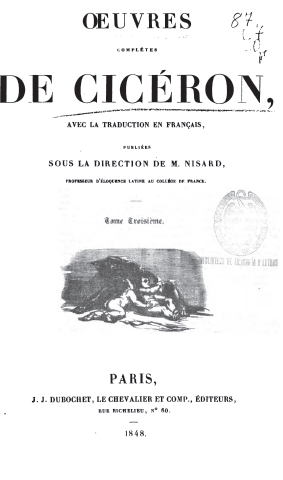|
LIBER PRIMUS
I. In Cumano nuper cum mecum Atticus noster esset,
nuntiatum est nobis a M. Varrone venisse eum Roma pridie vesperi et, nisi de via
fessus esset, continuo ad nos venturum fuisse. Quod cum audissemus, nullam moram
interponendam putavimus quin videremus hominem nobiscum et studiis eisdem et
vetustate amicitiae coniunctum. Itaque confestim ad eum ire perreximus ; paulumque
cum ab eius villa abessemus, ipsum ad nos venientem vidimus ; atque illum
complexi, ut mos amicorum est, satis enim longo intervallo ad suam villam
reduximus. hic pauca primo, atque ea percunctantibus nobis ecquid forte
Roma novi. : Atticus, Omitte ista quae nec percunctari nec audire sine molestia
possumus quaeso, inquit, et quaere potius ecquid ipse novi. Silent enim diutius
Musae Varronis quam solebant, nec tamen istum cessare sed celare quae scribat
existimo. Minime vero, inquit ille ; intemperantis enim arbitror esse scribere
quod occultari velit ; sed habeo
magnum opus in manibus, quae iam pridem ; ad hunc enim ipsum (me autem
dicebat,) quaedam institui, quae et sunt magna sane et limantur a me politius.
Et ego, Ista quidem, inquam, Varro iam diu expectans non audeo tamen flagitare ;
audivi enim e Libone nostro,
cuius nosti studium (nihil enim eius modi celare possumus), non te ea
intermittere, sed accuratius tractare nec de manibus umquam deponere. Illud
autem mihi ante hoc tempus numquam in mentem venit a te requirere. Sed nunc
postea quam sum ingressus res eas quas tecum simul didici mandare monumentis
philosophiamque veterem illam a Socrate ortam Latinis litteris illustrare,
quaero quid sit cur cum multa scribas genus hoc praetermittas, praesertim cum et
ipse in eo excellas et id studium totaque ea res longe ceteris et studiis et
artibus antecedat.
II. Tum ille, Rem a me saepe deliberatam et
multum agitatam requiris. Itaque non haesitans respondebo, sed ea dicam quae
mihi sunt in promptu, quod ista ipsa de re multum ut dixi et diu cogitavi. Nam
cum philosophiam viderem diligentissime Graecis litteris explicatam, existimavi
si qui de nostris eius studio tenerentur, si essent Graecis doctrinis eruditi,
Graeca potius quam nostra lecturos, sin a Graecorum artibus et disciplinis
abhorrerent, ne haec quidem curaturos, quae sine eruditione Graeca intellegi non
possunt. Itaque ea nolui scribere quae nec indocti intellegere possent nec docti
legere curarent. Vides autem eadem ipse ; didicisti enim
non posse nos Amafinii aut Rabirii
similes esse, qui nulla arte adhibita de rebus ante oculos positis vulgari
sermone disputant, nihil definiunt nihil partiuntur nihil apta interrogatione
concludunt, nullam denique artem esse nec dicendi nec disserendi putant ;
nos autem praeceptis dialecticorum et oratorum etiam, quoniam utramque vim
virtutem esse nostri putant, sic parentes ut legibus verbis quoque novis cogimur
uti, quae docti ut dixi a Graecis petere malent, indocti ne a nobis quidem
accipient, ut frustra omnis suscipiatur. Iam vero physica,
si Epicurum id est si Democritum
probarem, possem scribere ita plane ut Amafinius. Quid est enim magnum, cum
causas rerum efficientium sustuleris, de corpusculorum (ita enim appellat atomos)
concursione fortuita loqui ? Nostra tu
physica nosti ; quae cum contineantur ex effectione et ex materia ea quam
fingit et format effectio, adhibenda etiam geometria est ; quam quibusnam
quisquam enuntiare verbis aut quem ad intellegendum poterit adducere ? Haec ipsa
de vita et moribus et de expetendis fugiendisque rebus illi simpliciter, pecudis
enim et hominis idem bonum esse censent ; apud nostros autem non ignoras quae
sit et quanta subtilitas. sive enim Zenonem sequare, magnum est efficere
ut quis intellegat quid sit illud verum et simplex bonum quod non possit ab
honestate seiungi (quod bonum quale sit negat omnino Epicurus sine voluptatibus
sensum moventibus ne suspicari ; si vero Academiam veterem persequemur, quam nos
ut scis probamus, quam erit illa acute explicanda nobis, quam argute quam
obscure etiam contra Stoicos disserendum. Totum igitur illud philosophiae
studium mihi quidem ipse sumo et ad vitae constantiam quantum possum et ad
delectationem animi, nec ullum arbitror, ut apud Platonem est, maius aut melius
a diis datum munus homini ; sed meos amicos in quibus est studium in
Graeciam mitto id est ad Graecos ire iubeo, ut ex a fontibus potius hauriant
quam rivulos consectentur. Quae autem nemo adhuc docuerat nec erat unde studiosi
scire possent, ea quantum potui (nihil enim magnopere meorum miror) feci ut
essent nota nostris ; a Graecis enim peti non poterant ac
post L. Aelii nostri occasum ne a Latinis quidem. Et tamen
in illis veteribus nostris, quae
Menippum imitati non interpretati quadam hilaritate conspersimus, multa
admixta ex intima philosophia, multa dicta dialectice, quae quo facilius minus
docti intellegerent, iucunditate quadam ad legendum invitati ; in laudationibus,
in his ipsis antiquitatum
prooemiis philosophiae scribere voluimus, si modo consecuti sumus.
III. Tum ego, Sunt, inquam, ista Varro. Nam
nos in nostra urbe peregrinantis errantisque tamquam hospites tui libri quasi
domum deduxerunt, ut possemus aliquando qui et ubi essemus agnoscere. Tu aetatem
patriae tu descriptiones temporum, tu sacrorum iura tu sacerdotum, tu domesticam
tu bellicam disciplinam, tu sedum regionum locorum tu omnium divinarum
humanarumque rerum nomina genera officia causas aperuisti ; plurimum quidem
poetis nostris omninoque Latinis et litteris luminis et verbis attulisti atque
ipse varium et elegans omni fere numero poema fecisti, philosophiamque
multis locis inchoasti, ad impellendum satis, ad edocendum parum.
Causam autem probabilem tu quidem affers : aut enim Graeca legere malent qui
erunt eruditi, aut ne haec quidem qui illa nescient. Sed eam mihi non sane
probas ; immo vero et haec qui illa non poterunt, et qui Graeca poterunt non
contemnent sua. Quid enim causae est cur poetas Latinos Graecis litteris eruditi
legant, philosophos non legant ? An quia delectat Ennius Pacuvius Accius multi
alii, qui non verba sed vim Graecorum expresserunt poetarum—quanto magis
philosophi delectabunt, si ut illi Aeschylum Sophoclem Euripidem sic hi Platonem
imitentur Aristotelem Theophrastum. Oratores quidem laudari video si qui e
nostris Hyperidem sint aut Demosthenem imitati. Ego autem Varro (dicam
enim ut res est), dum me ambitio dum honores dum causae, dum rei publicae non
solum cura sed quaedam etiam procuratio multis officiis implicatum et
constrictum tenebat, animo haec inclusa habebam et ne obsolescerent renovabam
cum licebat legendo ; nunc vero et
fortunae gravissimo percussus vulnere et administratione rei publicae
liberatus doloris medicinam a philosophia peto et otii oblectationem hanc
honestissimam iudico. Aut enim huic aetati hoc maxime aptum est, aut his rebus
si quas dignas laude gessimus hoc in primis consentaneum, aut etiam ad nostros
cives erudiendos nihil utilius, aut si haec ita non sunt nihil aliud video quod
agere possimus. Brutus quidem
noster excellens omni genere laudis sic philosophiam Latinis litteris
persequitur nihil ut isdem de rebus Graeca desideres ; et eandem quidem
sententiam sequitur quam tu, nam
Aristum Athenis audivit aliquamdiu, cuius tu fratrem Antiochum. Quam ob rem
da quaeso te huic etiam generi litterarum.
IV. Tum ille, Istuc quidem considerabo, nec vero
sine te. Sed de te ipso quid est, inquit, quod audio ? Quanam, inquam, de re ?
Relictam a te veterem Academiam, inquit, tractari autem novam. Quid ergo,
inquam, Antiocho id magis licuerit nostro familiari, remigrare in domum veterem
e nova, quam nobis in novam e vetere ? Certe enim recentissima quaeque sunt
correcta et emendata maxime. Quamquam
Antiochi magister Philo,
magnus vir ut tu existimas ipse, †negaret in libris, quod coram etiam ex ipso
audiebamus, duas Academias esse, erroremque eorum qui ita putarent coarguit.
Est, inquit, ut dicis ; sed ignorare te non arbitror
quae contra Philonis Antiochus
scripserit. Immo vero et ista et totam veterem Academiam, a qua absum tam
diu, renovari a te nisi molestum est velim, et simul adsidamus, inquam, si
videtur. Sane istuc quidem, inquit, sum enim admodum infirmus. Sed videamus
idemne Attico placeat fieri a me quod te velle video. Mihi vero, ille ; quid est
enim quod malim quam ex Antiocho iam pridem audita recordari et simul videre
satisne ea commode dici possint Latine ?
Quae
cum essent dicta, in conspectu consedimus omnes.
Tum Varro ita exorsus est, Socrates mihi
videtur, id quod constat inter omnes, primus a rebus occultis et ab ipsa natura
involutis, in quibus omnes ante eum philosophi occupati fuerunt, avocavisse
philosophiam et ad vitam communem adduxisse, ut de virtutibus et de vitiis
omninoque de bonis rebus et malis quaereret, caelestia autem vel procul esse a
nostra cognitione censeret vel, si maxime cognita essent, nihil tamen ad bene
vivendum. hic in omnibus fere sermonibus, qui ab is qui illum audierunt
perscripti varie copioseque sunt, ita disputat ut nihil affirmet ipse refellat
alios, nihil se scire dicat nisi id ipsum, eoque praestare ceteris, quod illi
quae nesciant scire se putent, ipse se nihil scire id unum sciat, ob eamque rem
se arbitrari ab Apolline omnium sapientissimum esse dictum, quod haec esset una
hominis sapientia, non arbitrari sese scire quod nesciat. Quae cum diceret
constanter et in ea sententia permaneret, omnis eius oratio tantum in virtute
laudanda et in hominibus ad virtutis studium cohortandis consumebatur, ut e
Socraticorum libris maximeque Platonis intellegi potest. Platonis autem
auctoritate, qui varius et multiplex et copiosus fuit, una et consentiens duobus
vocabulis philosophiae forma instituta est Academicorum et Peripateticorum, qui
rebus congruentes nominibus differebant. Nam
cum Speusippum sororis filium
Plato philosophiae quasi heredem reliquisset, duo autem praestantissimo studio
atque doctrina, Xenocratem Calchedonium et Aristotelem Stagiritem, qui erant cum
Aristotele Peripatetici dicti sunt, quia disputabant inambulantes in
Lycio, illi autem, quia Platonis instituto in Academia, quod est
alterum gymnasium, coetus erant et sermones habere soliti, e loci vocabulo nomen
habuerunt. Sed utrique Platonis ubertate completi certam quandam disciplinae
formulam composuerunt et eam quidem plenam ac refertam, illam autem Socraticam
dubitanter de omnibus rebus et nulla affirmatione adhibita consuetudinem
disserendi reliquerunt. Ita facta est, quod minime Socrates probabat, ars
quaedam philosophiae et rerum ordo et descriptio disciplinae. Quae quidem
erat primo duobus ut dixi nominibus una ; nihil enim inter Peripateticos et
illam veterem Academiam differebat. Abundantia quadam ingenii praestabat, ut
mihi quidem videtur, Aristoteles, sed idem fons erat utrisque et eadem rerum
expetendarum fugiendarumque partitio.
V. Sed quid ago, inquit, aut sumne sanus qui haec
vos doceo ? Nam etsi non sus Minervam ut aiunt, tamen inepte quisquis Minervam
docet. Tum Atticus, Tu vero, inquit, perge Varro ; valde enim amo nostra atque
nostros, meque ista delectant cum Latine dicuntur et isto modo. Quid me, inquam,
putas, qui philosophiam iam professus sim populo nostro me exhibiturum. Pergamus
igitur, inquit, quoniam placet.
Fuit ergo iam accepta a Platone philosophandi
ratio triplex, una de vita et moribus, altera de natura et rebus occultis,
tertia de disserendo et quid verum quid falsum quid rectum in oratione pravumve
quid consentiens quid repugnet iudicando. Ac primum illam partem bene
vivendi a natura petebant eique parendum esse dicebant, neque ulla alia in re
nisi in natura quaerendum esse illud summum bonum quo omnia referrentur,
constituebantque extremum esse rerum expetendarum et finem bonorum adeptum esse
omnia e natura et animo et corpore et vita. Corporis autem alia ponebant esse in
toto alia in partibus, valetudinem vires pulchritudinem in toto, in partibus
autem sensus integros et praestantiam aliquam partium singularum, ut in pedibus
celeritatem, vim in manibus, claritatem in voce, in lingua etiam explanatam
vocum impressionem ; animi autem quae essent ad comprehendendam ingeniis
virtutem idonea, eaque ab his in naturam et mores dividebantur. Naturae
celeritatem ad discendum et memoriam dabant, quorum utrumque mentis esset
proprium et ingenii ; morum autem putabant studia esse et quasi consuetudinem,
quam partim assiduitate exercitationis partim ratione formabant, in quibus erat
ipsa philosophia ; in qua quod inchoatum est neque <absolutum> progressio
quaedam ad virtutem appellatur, quod autem absolutum, id est virtus, quasi
perfectio naturae omniumque rerum quas in animis ponunt una res optima.
ergo haec animorum ; vitae autem (id enim erat tertium) adiuncta esse dicebant
quae ad virtutis usum valerent. Iam virtus in animi bonis et in corporis
cernitur et in quibusdam quae non tam naturae quam beatae vitae adiuncta sunt.
Hominem enim esse censebant quasi partem quandam civitatis et universi generis
humani, eumque esse coniunctum cum hominibus humana quadam societate. Ac de
summo quidem atque naturali bono sic agunt ; cetera autem pertinere ad id
putant aut adaugendum aut ad tenendum, ut divitias ut opes ut gloriam ut gratiam.
Ita tripertita ab his inducitur ratio bonorum.
VI. Atque haec illa sunt tria genera quae putant
plerique Peripateticos dicere. Id quidem non falso ; est enim haec partitio
illorum ; illud imprudenter, si alios esse Academicos qui tum appellarentur
alios Peripateticos arbitrantur. Communis haec ratio, et utrisque hic bonorum
finis videbatur, adipisci quae essent prima in natura quaeque ipsa per sese
expetenda aut omnia aut maxima ; ea sunt autem maxima, quae in ipso animo atque
in ipsa virtute versantur. Itaque omnis illa antiqua philosophia sensit in una
virtute esse positam beatam vitam, nec tamen beatissimam nisi adiungerentur
etiam corporis et cetera quae supra dicta sunt ad virtutis usum idonea. Ex
hac descriptione agendi quoque aliquid in vita et officii ipsius initium
reperiebatur, quod erat in conservatione <sui et in appetitione> earum rerum
quas natura praescriberet. Hinc gignebatur fuga desidiae voluptatumque
contemptio, ex quo laborum dolorumque susceptio multorum magnorum<que> recti
honestique causa et earum rerum quae erant congruentes cum praescriptione
naturae ; unde et amicitia exsistebat et iustitia atque aequitas, eaeque et
voluptatibus et multis vitae commodis anteponebantur. Haec quidem fuit apud eos
morum institutio et eius partis quam primam posui forma atque descriptio.
De natura autem (id enim sequebatur) ita dicebant
ut eam dividerent in res duas, ut altera esset efficiens, altera autem
quasi huic se praebens, eaque efficeretur aliquid. In eo quod efficeret vim esse
censebant, in eo autem quod efficeretur tantum modo materiam quandam ; in
utroque tamen utrumque : neque enim materiam ipsam cohaerere potuisse si nulla
vi contineretur, neque vim sine aliqua materia ; nihil est enim quod non alicubi
esse cogatur. Sed quod ex utroque,
id iam corpus et quasi
qualitatem quandam nominabant ; dabitis enim profecto ut in rebus inusitatis
(quod Graeci ipsi faciunt a quibus haec iam diu tractantur, utamur verbis
interdum inauditis.
VI. Nos vero, inquit Atticus ; quin etiam Graecis
licebit utare cum voles, si te Latina forte deficient.. Bene sane facis ; sed
enitar ut Latine loquar, nisi in huiusce modi verbis ut philosophiam aut
rhetoricam aut physicam aut dialecticam appellem, quibus ut aliis multis
consuetudo iam utitur pro Latinis. Qualitates igitur appellavi quas ποιότητας
Graeci vocant, quod ipsum apud Graecos non est vulgi verbum sed philosophorum,
atque id in multis ; dialecticorum vero verba nulla sunt publica, suis utuntur.
Et id quidem commune omnium fere est artium ; aut enim nova sunt rerum novarum
facienda nomina aut ex aliis transferenda. Quod si Graeci faciunt qui in his
rebus tot iam saecla versantur, quanto id nobis magis concedendum est, qui haec
nunc primum tractare conamur. Tu vero, inquam, Varro bene etiam meriturus
mihi videris de tuis civibus, si eos non modo copia rerum auxeris, ut effecisti,
sed etiam verborum. Audebimus ergo, inquit, novis verbis uti te auctore, si
necesse erit.—earum igitur qualitatum sunt aliae principes aliae ex his
ortae. Principes sunt unius modi et simplices ; ex his autem ortae variae sunt
et quasi multiformes. Itaque aer (hoc quoque utimur enim pro Latino) et ignis et
aqua et terra prima sunt ; ex his autem ortae animantium formae earumque rerum
quae gignuntur e terra. Ergo illa initia et ut e Graeco vertam elementa dicuntur
; e quibus aer et ignis movendi vim habent et efficiendi, reliquae partes
accipiendi et quasi patiendi, aquam dico et terram.
Quintum genus, e quo essent astra
mentesque, singulare eorumque quattuor quae supra dixi dissimile Aristoteles
quoddam esse rebatur. Sed subiectam putant omnibus sine ulla specie atque
carentem omni illa qualitate (faciamus enim tractando usitatius hoc verbum et
tritius) materiam quandam, ex qua omnia expressa atque effecta sint, quae tota
omnia accipere possit omnibusque modis mutari atque ex omni parte eoque etiam
interire, non in nihilum sed in suas partes, quae infinite secari ac dividi
possint, cum sit nihil omnino in rerum natura minimum quod dividi nequeat. Quae
autem moveantur omnia intervallis moveri, quae intervalla item infinite dividi
possint. Et cum ita moveatur illa vis quam qualitatem esse diximus, et cum
sic ultro citroque versetur, et materiam ipsam totam penitus commutari putant et
illa effici quae appellant qualia ; e quibus in omni natura cohaerente et
continuata cum omnibus suis partibus unum effectum esse mundum, extra quem nulla
pars materiae sit nullumque corpus. Partis autem esse mundi omnia quae insint in
eo, quae natura sentiente teneantur, in qua ratio perfecta insit, quae sit
eadem sempiterna (nihil enim valentius esse a quo intereat) ; quam vim
animum esse dicunt mundi, eandemque esse mentem sapientiamque perfectam, quem
deum appellant, omniumque rerum quae sunt ei subiectae quasi prudentiam quandam
procurantem caelestia maxime, deinde in terris ea quae pertineant ad homines ;
quam interdum eandem necessitatem appellant, quia nihil aliter possit atque ab
ea constitutum sit, inter, quasi fatalem et immutabilem continuationem ordinis
sempiterni, non numquam quidem eandem fortunam, quod efficiat multa improvisa et
necopinata nobis propter obscuritatem ignorationemque causarum.
VIII. Tertia deinde philosophiae pars, quae
erat in ratione et in disserendo, sic tractabatur ab utrisque. Quamquam oriretur
a sensibus tamen non esse iudicium veritatis in sensibus. Mentem volebant rerum
esse iudicem, solam censebant idoneam cui crederetur, quia sola cerneret id quod
semper esset simplex et unius modi et tale quale esset (hanc illi ἰδέαν
appellabant, iam a Platone ita nominatam, nos recte speciem possumus dicere).
sensus autem omnis hebetes et tardos esse arbitrabantur nec percipere ullo modo
res eas quae subiectae sensibus viderentur, quod essent aut ita parvae ut sub
sensum cadere non possent, aut ita mobiles et concitatae ut nihil umquam unum
esset constans, ne idem quidem, quia continenter laberentur et fluerent omnia.
Itaque hanc omnem partem rerum opinabilem appellabant ; scientiam
autem nusquam esse censebant nisi in animi notionibus atque rationibus. Qua de
causa definitiones rerum probabant et has ad omnia de quibus disceptabatur
adhibebant ; verborum etiam explicatio probabatur, id est qua de causa quaeque
essent ita nominata, quam ἐτυμολογίαν appellabant ; post argumentis quibusdam et
quasi rerum notis ducibus utebantur ad probandum et ad concludendum id quod
explanari volebant. In qua tradebatur omnis dialecticae disciplina id est
orationis ratione conclusae ; huic quasi ex altera parte oratoria vis dicendi
adhibebatur, explicatrix orationis perpetuae ad persuadendum accommodatae.
Haec forma erat illis prima, a Platone tradita ; cuius quas acceperim
dissupationes si vultis exponam. Nos vero volumus, inquam, ut pro Attico etiam
respondeam.
IX. Et recte quidem, inquit, respondes ; praeclare
enim explicatur Peripateticorum et Academiae veteris auctoritas.
Aristoteles igitur primus species quas paulo ante dixi
labefactavit, quas mirifice Plato erat amplexatus, ut in iis quiddam divinum
esse diceret. Theophrastus autem, vir et oratione suavis et ita moratus ut prae
se probitatem quandam et ingenuitatem ferat, vehementius etiam fregit quodam
modo auctoritatem veteris disciplinae ; spoliavit enim virtutem suo decore
imbecillamque reddidit, quod negavit in ea sola positum esse beate vivere.
Nam Strato eius auditor
quamquam fuit acri ingenio tamen ab ea disciplina omnino semovendus est ;
qui cum maxime necessariam partem philosophiae, quae posita est in virtute et in
moribus, reliquisset totumque se ad investigationem naturae contulisset, in ea
ipsa plurimum dissedit a suis. Speusippus autem et Xenocrates, qui primi
Platonis rationem auctoritatemque susceperant, et post eos Polemo et Crates
unaque Crantor in Academia congregati diligenter ea quae a superioribus
acceperant tuebantur. Iam Polemonem audiverant assidue Zeno et Arcesilas.
sed Zeno, cum Arcesilam anteiret aetate valdeque subtiliter dissereret et
peracute moveretur, corrigere conatus est disciplinam. Eam quoque si videtur
correctionem explicabo, sicut solebat Antiochus. Mihi vero, inquam, videtur,
quod vides idem significare Pomponium.
X. Zeno igitur nullo modo is erat qui ut
Theophrastus nervos virtutis inciderit, sed contra qui omnia quaeque ad beatam
vitam pertinerent in una virtute poneret nec quicquam aliud numeraret in bonis
idque appellaret honestum quod esset simplex quoddam et solum et unum bonum.
cetera autem etsi nec bona nec mala essent tamen alia secundum naturam dicebat
alia naturae esse contraria ; his ipsis alia interiecta et media numerabat. Quae
autem secundum naturam essent ea sumenda et quadam aestimatione dignanda docebat,
contraque contraria ; neutra autem in mediis relinquebat, in quibus ponebat
nihil omnino esse momenti. sed quae essent sumenda, ex iis alia pluris
esse aestimanda alia minoris. Quae pluris ea praeposita appellabat, reiecta
autem quae minoris. Atque ut haec non tam rebus quam vocabulis commutaverat,
sic inter recte factum atque
peccatum officium et contra officium media locabat quaedam, recte facta sola
in bonis actionibus ponens, prave id est peccata in malis ; officia autem
conservata praetermissaque media putabat ut dixi. cumque superiores non
omnem virtutem in ratione esse dicerent sed quasdam virtutes quasi natura aut
more perfectas, hic omnis in ratione ponebat. Cumque illi ea genera virtutum
quae supra dixi seiungi posse arbitrarentur, hic nec id ullo modo fieri posse
disserebat, nec virtutis usum modo ut superiores sed ipsum habitum per se esse
praeclarum, nec tamen virtutem cuiquam adesse quin ea semper uteretur. Cumque
perturbationem animi illi ex homine non tollerent naturaque et condolescere et
concupiscere et extimescere et efferri laetitia dicerent, sed ea contraherent in
angustumque deducerent, hic omnibus his quasi morbis voluit carere sapientem.
cumque eas perturbationes antiqui naturales esse dicerent et rationis expertes
aliaque in parte animi cupiditatem alia rationem collocarent, ne his quidem
assentiebatur ; nam et perturbationes voluntarias esse putabat opinionisque
iudicio suscipi et omnium perturbationum matrem esse arbitrabatur immoderatam
quandam intemperantiam. Haec fere de moribus.
XI. De naturis autem sic sentiebat, primum ut in
quattuor initiis rerum illis quintam hanc naturam, ex qua superiores sensus et
mentem effici rebantur, non adhiberet ;
statuebat enim ignem esse
ipsam naturam quae quidque gigneret et mentem atque sensus. Discrepabat
etiam ab isdem, quod nullo modo arbitrabatur quicquam effici posse ab ea quae
expers esset corporis, cuius generis Xenocrates et superiores etiam animum
esse dixerant, nec vero aut quod efficeret aliquid aut quod efficeretur posse
esse non corpus. Plurima autem in illa tertia philosophiae parte mutavit.
In qua primum de sensibus ipsis quaedam dixit nova, quos iunctos esse censuit e
quadam quasi impulsione oblata extrinsecus, quam ille φαντασίαν, nos visum
appellemus licet, et teramus hoc quidem verbum, erit enim utendum in reliquo
sermone saepius— sed ad haec quae visa sunt et quasi accepta sensibus
assensionem adiungit animorum, quam esse vult in nobis positam et voluntariam.
visis non omnibus adiungebat fidem sed is solum quae propriam quandam haberent
declarationem earum rerum quae viderentur ; id autem visum cum ipsum per se
cerneretur, comprehendibile. (Feretis haec ? Nos vero, inquit ; quonam enim alio
modo καταλημπτὸν diceres ?) Sed cum acceptum iam et approbatum esset,
comprehensionem appellabat, similem is rebus quae manu prenderentur ; ex quo
etiam nomen hoc duxerat at, cum eo verbo antea nemo tali in re usus esset,
plurimisque idem novis verbis (nova enim dicebat) usus est. Quod autem erat
sensu comprensum id ipsum sensum appellabat, et si ita erat comprensum ut
convelli ratione non posset scientiam, sin aliter inscientiam nominabat ; ex qua
existebat etiam opinio, quae esset imbecilla et cum falso incognitoque communis.
sed inter scientiam et inscientiam comprehensionem illam quam dixi collocabat,
eamque neque in rectis neque in pravis numerabat, sed soli credendum esse
dicebat. E quo sensibus etiam fidem tribuebat, quod ut supra dixi comprehensio
facta sensibus et vera esse illi et fidelis videbatur, non quod omnia quae
essent in re comprehenderet, sed quia nihil quod cadere in eam posset
relinqueret, quodque natura quasi normam scientiae et principium sui dedisset
unde postea notiones rerum in animis imprimerentur ; e quibus non principia
solum sed latiores quaedam ad rationem inveniendam viae reperiuntur. Errorem
autem et temeritatem et ignorantiam et opinationem et suspicionem et uno nomine
omnia quae essent aliena firmae et constantis assensionis a virtute sapientiaque
removebat. Atque in his fere commutatio constitit omnis dissensioque Zenonis a
superioribus.
XII. Quae cum dixisset : Et breviter sane
minimeque obscure exposita est, inquam, a te Varro et veteris Academiae ratio et
Stoicorum. Horum esse autem arbitror, ut Antiocho nostro familiari placebat,
correctionem veteris Academiae potius quam aliquam novam disciplinam putandam.
Tum Varro, Tuae sunt nunc partes, inquit, qui ab antiquorum ratione desciscis et
ea quae ab Arcesila novata sunt probas, docere quod et qua de causa discidium
factum sit, ut videamus satisne ista sit iusta defectio. Tum ego, Cum Zenone,
inquam, ut accepimus Arcesilas sibi omne certamen instituit, non pertinacia aut
studio vincendi ut quidem mihi videtur, sed earum rerum obscuritate, quae
ad confessionem ignorationis adduxerant Socratem et vel ut iam ante Socratem
Democritum Anaxagoram Empedoclem omnes paene veteres, qui nihil cognosci nihil
percipi nihil sciri posse dixerunt, angustos sensus imbecillos animos brevia
curricula vitae et ut Democritus in profundo veritatem esse demersam,
opinionibus et institutis omnia teneri, nihil veritati relinqui, deinceps omnia
tenebris circumfusa esse dixerunt. itaque Arcesilas negabat esse quicquam
quod sciri posset, ne illud quidem ipsum quod Socrates sibi reliquisset, ut
nihil scire se sciret ; sic omnia latere censebat in occulto neque esse quicquam
quod cerni aut intellegi posset ; quibus de causis nihil oportere neque
profiteri neque affirmare quemquam neque assensione approbare, cohibereque
semper et ab omni lapsu continere temeritatem, quae tum esset insignis cum aut
falsa aut incognita res approbaretur, neque hoc quicquam esse turpius quam
cognitioni et perceptioni assensionem approbationemque praecurrere. Huic rationi
quod erat consentaneum faciebat, ut contra omnium sententias disserens de sua
plerosque deduceret, ut cum in eadem re paria contrariis in partibus momenta
rationum invenirentur facilius ab utraque parte assensio sustineretur.
Hanc Academiam novam appellant, quae mihi vetus videtur, si quidem Platonem ex
illa vetere numeramus, cuius in libris nihil affirmatur et in utramque partem
multa disseruntur, de omnibus quaeritur nihil certi dicitur—sed tamen illa
quam exposuisti vetus, haec nova nominetur. Quae usque ad Carneadem perducta,
qui quartus ab Arcesila fuit, in eadem Arcesilae ratione permansit. Carneades
autem nullius philosophiae partis ignarus et, ut cognovi ex is qui illum
audierant maximeque ex Epicureo
Zenone, qui cum ab eo plurimum dissentiret unum tamen praeter ceteros
mirabatur, incredibili quadam fuit facultate... |
I. J'étais dans ma campagne de Cumes, en compagnie de mon cher
Atticus, quand M. Varron me fit annoncer qu'il était arrivé de Rome
la veille au soir, et que, n'eût été la fatigue de la route, il
serait venu incontinent nous trouver. A
424 cette nouvelle, nous décidâmes qu'il ne fallait
mettre aucun retard à voir un homme avec qui nous étions liés par la
communauté de nos études et par une vieille amitié. Sur-le-champ,
nous nous mimes en route pour le joindre ; nous étions encore à
quelque distance de sa villa, lorsque nous le, vîmes qui venait à
nous ; nous lui donnâmes le baiser d'amis, et le reconduisîmes chez
lui. Il nous restait à faire un chemin assez long. Je demandai
d'abord à Varron s'il y avait à Rome quelque chose de nouveau
; mais
bientôt Atticus nous interrompit : Laissez là, me dit-il, je vous en
conjure, un sujet sur lequel on ne peut rien demander et rien
apprendre sans douleur ; et que Varron vous dise plutôt ce qu'il y a
de nouveau chez lui. Les muses de notre ami gardent un silence plus
long que de coutume ; et pourtant, à ce que je crois, il n'a pas
cessé d'écrire ; mais il nous cache ce qu'il fait. — Point du tout,
dit Varron ; ce serait, selon moi, une folie que de faire des livres
pour les cacher. Mais j'ai un grand ouvrage sur le métier ; il y a
déjà longtemps que j'ai mis le nom de cet ami (c'est de moi qu'il
parlait) en tête d'un travail assez considérable, et que je tiens à
exécuter avec le plus grand soin. — Il y a longtemps aussi, lui
dis-je, que j'attends cet ouvrage, et cependant je n'ose pas le
réclamer ; car j'ai appris de notre ami Libon, dont vous
connaissez le zèle pour les lettres (ce sont là des choses qu'on ne
peut cacher), que vous n'interrompez pas un seul moment ce travail,
que vous y employez tous vos soins, et que jamais il ne quitte vos
mains. Mais il est une demande que jusqu'ici je n'avais jamais songé
à vous faire, et que je vous ferai, maintenant que j'ai entrepris
d'élever quelque monument à ces études qui m'ont été communes avec
vous, et d'introduire dans notre littérature latine cette ancienne
philosophie, fille de Socrate. Pourquoi, dites-moi, vous qui écrivez
sur tant de sujets, ne traitez-vous pas celui-là, surtout lorsque
vous y excellez, et que ce genre d'études et la philosophie entière
l'emportent tellement sur toutes les autres études et occupations de
l'esprit ?
II. Vous me parlez là, dit Varron, d'une chose sur laquelle j'ai
souvent délibéré, et que j'ai, fort agitée en moi-même. C'est
pourquoi je répondrai sans hésitation ; mais je dirai sans recherche
ce qui me viendra à l'esprit, parce que, je le répète, c'est une
question à laquelle j'ai beaucoup réfléchi. Voyant que la
philosophie était parfaitement traitée par les écrivains grecs, j'ai
pensé que si quelques-uns de nos compatriotes avaient du goût pour
elle, ou ils connaîtraient la langue et la littérature grecques, et
aimeraient mieux lire les ouvrages originaux que les nôtres ; ou ils
éprouveraient de la répugnance pour les arts et l'esprit de la
Grèce, et ne trouveraient aucun intérêt à des livres que l'on ne
pourrait comprendre sans avoir une certaine érudition grecque. Je
n'ai donc pas voulu écrire ce que les ignorants ne pourraient
comprendre, et ce que les doctes ne voudraient pas lire. Vous le
voyez vous-même ; car vous savez que nous ne pouvons ressembler à ces Amafinius, à ces Rabirius, qui, sans aucun art, dissertent sur
toutes choses en style vulgaire, n'emploient ni définitions ni
divisions, argumentent sans aucune rigueur, et croient enfin que
l'art de la parole et celui du raisonnement sont de pures chimères.
Pour nous, qui obéissons aux préceptes des dialecticiens et des
orateurs comme à des lois (car les nôtres tiennent que c'est une
obligation 425 d'y demeurer
fidèles), nous sommes cependant, forcés d'employer des termes
nouveaux, que les gens instruits aimeront mieux aller chercher dans
les écrivains grecs, et que les ignorants ne voudront pas entendre
même de nous ; en sorte que toutes nos peines seraient perdues. En
physique, si je suivais Épicure, c'est-à-dire, Démocrite, je
pourrais écrire tout aussi clairement qu'Amafinius. Quel grand
mérite y a-t-il, lorsque vous avez supprimé les vraies causes
efficientes, à venir parler du concours fortuit des corpuscules
(c'est ainsi qu'ils nomment leurs atomes) ? Vous connaissez notre
physique, et vous savez quels en sont les principes, une cause
efficiente et une matière que cette force motrice moule et forme ; il
y faut de plus employer la géométrie ; mais je vais plus loin, et je
crois qu'il serait très-difficile d'exprimer et de faire comprendre
cette partie de notre doctrine qui concerne les mœurs et la vie
pratique, la détermination des biens et des maux. Les épicuriens
pensent tout simplement que le bien de l'homme et celui de la brute,
c'est tout un ; mais vous savez combien ici les principes de nos
écoles sont relevés et difficiles à entendre. Si vous suivez Zénon,
il ne fait pas un médiocre effort pour faire comprendre ce que c'est
que ce vrai et unique bien que l'on ne peut séparer de la vertu, et
qui, selon Épicure, ne peut même pas être imaginé hors des voluptés
qui chatouillent nos sens. Si vous êtes, comme moi, partisan de
l'ancienne Académie, avec quelle finesse ne devez-vous pas en
développer les principes ? avec quelle subtilité et quelle obscurité
ne vous faudra-t-il pas combattre les Stoïciens ? Je fais donc pour
ma part un grand usage de la philosophie, à laquelle je demande la
force et des jouissances pour mon esprit ; je crois, comme Platon,
que c'est le présent le plus beau et le plus précieux que les
dieux
aient fait aux hommes ; mais quand quelqu'un de mes amis
témoigne du
goût pour cette étude ; je l'envoie en Grèce, je veux dire, aux
écrivains grecs, pour qu'il aille puiser à la source plutôt que de
recueillir les eaux des conduits dérivés. Mais il est des notions
dont personne encore ne s'était fait l'interprète public, et qu'avec
le plus vif désir de s'instruire on ne savait où trouver ; ce sont
ces notions que j'ai essayé, selon mes forces (car je n'attache de
prix extraordinaire à aucun de mes livres), de répandre parmi nous.
On ne pouvait pas les demander aux Grecs, ni aux Latins eux-mêmes
depuis la mort de notre cher L. Ellius. Toutefois, dans ces écrits
de ma jeunesse, où je semai la plaisanterie, comme Ménippe que
j'imitai, sans le traduire, j'avais puisé plus d'une réflexion au
cœur même de la philosophie et pris plus d'une fois le langage de la
dialectique. Après avoir facilité ainsi, par un certain attrait,
l'intelligence de ces idées aux gens d'une instruction médiocre,
j'ai voulu, je ne sais si j'y suis parvenu, introduire la
philosophie dans mes Éloges, et dans les préambules de mes
Antiquités.
III. Vous avez raison, Varron, lui dis-je alors
; nous étions dans
Rome errants et voyageurs comme des étrangers ; grâce à vos livres,
nous nous sommes, en quelque façon, retrouvés chez nous, en
apprenant enfin à connaître où et qui nous étions. Vous avez révélé
l'âge de Rome, l'ordre chronologique de son histoire, le droit
religieux et sacerdotal ; vous nous avez fait connaître ses
426 institutions politiques et
militaires, la distribution de ses quartiers, la situation de ses
monuments ; en un mot, les noms, les espèces, la destination et les
causes de toutes les choses divines et humaines ; vous avez répandu
beaucoup de lumière sur les œuvres de nos poètes, et en général sur
toute la littérature et la langue latines. Vous avez composé
vous-même un poème plein de variété et d'élégance, où vous employez
le jeu de presque tous les rythmes ; enfin, vous avez mis en
beaucoup d'endroits un premier trait de philosophie, qui est bien
capable de nous en donner le goût, mais non la science. Vous nous
dites, il est vrai, d'une façon assez plausible que les gens
instruits aimeraient mieux lire les écrivains originaux, tandis que
ceux qui ne seraient pas versés dans les lettres grecques ne
voudraient pas même lire nos livres. Mais, je vous le demande,
est-ce là une raison sans réplique ? Ne serait-on pas bien plus fondé
à croire que les livres latins seraient lus par ceux qui n'entendent
pas le grec, et ne seraient nullement méprisés par ceux qui
l'entendent ? Pourquoi nos compatriotes, à qui les lettres grecques
sont familières, lisent-ils les poètes latins, et ne liraient-ils
pas les philosophes ? Est-ce parce qu'ils trouvent du charme dans
Ennius, Pacuvius, Accius, et tant d'autres, qui, sans traduire les
poètes grecs, se sont accommodés à leur génie ? Mais combien plus de
charme ne trouverait-on pas dans les philosophes, si à l'émulation
des poètes qui prennent pour modèles Eschyle, Sophocle, Euripide,
ils imitaient Platon, Aristote, Théophraste! Je vois que l'on fait
l'éloge de nos orateurs quand ils imitent Hypcride et Démosthène.
Pour moi (je veux dire les choses telles qu'elles sont), tandis que
l'ambition, les honneurs, le barreau, la politique, et plus encore
ma participation au gouvernement de mon pays, m'enlaçaient dans un
réseau d'affaires et de devoirs, je renfermais en moi mes
connaissances philosophiques ; et pour que le temps ne les ternît
point, je les renouvelais, à mes loisirs, par la lecture. Mais
aujourd'hui que la fortune m'a frappé d'un coup terrible, et que le
fardeau du gouvernement ne pèse plus sur moi, je demande à la
philosophie l'adoucissement de ma douleur, et je la regarde comme
l'occupation de mes loisirs la plus noble et la plus douce à la
fois. Cette occupation sied parfaitement à mon âge ; elle est, plus
que toute autre, en harmonie avec ce que je puis avoir fait de
louable dans ma vie publique : rien de plus utile pour l'instruction
de mon pays ; et quand même ce seraient là des illusions, je ne vois
pas quel autre travail je pourrais entreprendre. Brutus, notre
excellent ami, qui réunit à un si haut degré tous les mérites,
exprime avec tant de perfection la philosophie dans notre langue,
que la Grèce elle-même ne saurait souhaiter mieux. Il est de la même
école que vous ; car il a entendu quelque temps à Athènes Aristus,
frère d'Antiochus, votre maître. Essayez-vous donc, vous aussi, je
vous en conjure, dans ce genre de compositions.
IV. J'y réfléchirai, me dit-il ; et en tout cas je vous consulterai.
Mais qu'est-ce que j'entends dire de vous ? — A quel sujet ? lui
demandai-je. — On prétend que vous abandonnez l'ancienne Académie,
et que vous vous faites l'organe de la nouvelle. — Eh quoi! lui
dis-je, il sera permis à Antiochus, notre ami, de retourner d'une
nouvelle maison dans l'ancienne, et moi je ne pourrais quitter
l'ancienne pour la nouvelle! Est-ce que toujours la dernière édition
n'est pas la plus châtiée et la plus irréprochable ? Et toutefois, le
maître d'Antiochus, Philon, un grand esprit, comme vous
427 le reconnaissez vous-même,
prétend dans ses livres, ce que d'ailleurs nous avons entendu de sa
propre bouche, qu'il n'y a pas deux Académies, et réfute ceux qui
ont introduit cette erreur. — Cela est vrai, repartit Varron ; mais
vous n'ignorez certainement pas ce qu'Antiochus a écrit contre cette
opinion de Pbilon. — Non, sans doute ; et je voudrais, si ce n'est
pas une demande indiscrète, vous entendre développer les raisons
d'Antiochus, et tout le système de l'ancienne Académie, que j'ai
abandonnée depuis si longtemps : mais, si vous le trouvez bon, nous
pourrions nous reposer. — Bien volontiers, reprit-il ; car je me sens
très-faible. Mais il faut voir s'il plaît à Atticus que je fasse ce
dont vous m'exprimez le désir. — Certainement, répondit Atticus
;
rien ne pourrait m'être plus agréable que d'entendre rappeler ce que
je recueillis naguère de la bouche d'Antiochus, et de voir en même
temps si ces idées peuvent être commodément exprimées dans la langue
latine.
Après ces mots, nous nous assîmes tous, en présence les uns des
autres. Alors Varron commença ainsi : Socrate me paraît être le
premier, et tout le monde d'ailleurs en tombe d'accord, qui rappela
la philosophie des nuages et de cette poursuite des mystères de la
nature, où tous les philosophes s'étaient engagés avant lui, pour
s'appliquer à la vie commune, et lui donner pour objet les vertus et
les vices et toute la question des biens et des maux. Il pensait
qu'il ne nous appartient pas d'expliquer les phénomènes célestes, et
que quand même l'homme pourrait s'élever jusqu'à cette science, elle
ne leur servirait de rien pour bien vivre. Dans presque tous
les discours qu'on reproduits avec tant de variété et en si grand
nombre ceux qui l'avaient entendu, nous voyons que sa méthode est
toujours de ne rien affirmer, mais de réfuter les autres ; il
confesse son ignorance, et déclare que c'est là son unique science
;
il ajoute que la supériorité qu'il a sur les autres, c'est qu'ils
pensent savoir ce qu'ils ignorent ; tandis que lui, la seule chose
qu'il sache, c'est qu'il ne sait rien ; c'est là, selon lui, le motif
qui lui a valu d'Apollon l'éloge d'être le plus sage des hommes
; car
toute la sagesse consiste simplement à ne pas estimer que l'on sache
ce que l'on ne sait pas. Ce fut là sa maxime constante et son
opinion invariable ; aussi tourna-t-il tous ses efforts à louer la
vertu, à en inspirer l'amour aux hommes, comme nous le montrent les
livres des Socratiques et surtout ceux de Platon. A l'ombre du génie
de Platon, génie fécond, varié, universel, s'établit une philosophie
unique sous la double bannière des académiciens et des
péripatéticiens, qui, d'accord sur les choses, ne différaient que
sur les termes. Car Platon, qui avait fait en quelque sorte
Speusippe, fils de sa sœur, l'héritier de sa philosophie, laissait
aussi deux disciples de grand talent et d'une rare science,
Xénocrate de Chalcédoine et Aristote de Stagire : ceux qui suivaient
Aristote, forent nommés péripatéticiens, parce qu'ils discouraient
en se promenant dans le Lycée ; tandis que ceux qui, d'après
l'institution de Platon, tenaient leurs assemblées et dissertaient
dans l'Académie, l'autre gymnase d'Athènes, reçurent de ce lieu même
le nom d'Académiciens. Mais les uns et les autres, tous pénétrés du
fécond génie de Platon, formulèrent la philosophie en un certain
système 428 complet et achevé,
et abandonnèrent le doute universel de Socrate, et son habitude de
discuter sur tout sans rien affirmer. Il y eut alors ce que Socrate
désapprouvait entièrement, une science philosophique, avec des
divisions régulières et tout un appareil méthodique. Cette
philosophie, comme je l'ai dit, sous une double dénomination, était
une ; car, entre la doctrine des péripatéticiens et l'ancienne
Académie, il n'y avait aucune différence. Aristote l'emportait, à
mon sens, par la richesse de son génie ; mais les uns et les autres
avaient les mêmes principes, et jugeaient pareillement des biens et
des maux.
V. Mais à quoi donc mon esprit pense-t-il
? n'est-ce pas une folie que
de vous apprendre ces choses ? Car si l'on ne peut pas précisément me
dire ici que je suis l'animal proverbial qui en remontre à Minerve,
cependant c'est toujours une sottise que de lui faire la leçon. —
Continuez, Varron, lui-dit Attlcus ; j'aime beaucoup tout ce qui est
romain, hommes et choses, et j'ai grand plaisir à entendre cette
philosophie parler latin et le parler de cette façon. — Et moi,
dis-je à mon tour, qui ai pris l'engagement de faire connaître la
philosophie à mes compatriotes, que pensez-vous que j'éprouve ? —
Poursuivons donc, puisque vous le voulez, reprit Varron.
C'est à Platon que remonte la division de la philosophie en trois
parties, dont l'une traite de la vie et des mœurs ; la seconde, de la
nature et de ses mystères ; la troisième, du raisonnement de l'art de
distinguer le vrai et le faux, de discerner ce qui est bien ou mal
dans le discours, de saisir la conséquence ou la contradiction dans
le jugement. Relativement aux mœurs, la doctrine de cette école
était de prendre pour règle la nature, et de lui obéir ; on y
établissait qu'il ne fallait chercher nulle part ailleurs que dans
la nature ce souverain bien auquel tous les autres se rapportent, et
que le comble de la fortune et de dernier terme de tous les biens,
était d'avoir reçu de la nature tous les trésors de l'âme, du corps
et de la vie. Les biens du corps étaient, selon ces philosophes, les
uns généraux, les autres particuliers. Parmi les premiers, ils
comptaient la santé, les forces, la beauté ; parmi les seconds,
l'intégrité des sens et une certaine excellence propre à chacun de
ses membres ou de ses organes, telle que la vitesse des pieds, la
vigueur des mains, la clarté de la voix, et, pour la langue
elle-même, l'articulation distincte des sons. Ils appelaient biens
de l'âme ceux qui étaient capables de graver en nous la vertu ; de
ces biens les uns étaient naturels, les autres constituaient les
mœurs. Ils regardaient la facilité d'apprendre et la mémoire comme
des dons naturels, tous deux propres à l'intelligence. Ils
pensaient, au contraire, que les mœurs étaient le fruit de nos
efforts, et reposaient en quelque sorte sur une habitude que
l'exercice et la raison concouraient à former. Un de ces derniers
biens était la philosophie elle-même. Ce qu'il y a d'ébauché et
d'inachevé en elle est appelé un acheminement à la vertu ; ce qu'il y
a d'achevé, c'est-à-dire, la vertu, est regardé comme la perfection
de notre nature, et de tous les biens de l'âme le plus excellent.
Voilà ce qu'ils disaient de ces biens. Quant au troisième genre de
biens, ceux de la vie, ils les considéraient comme des accessoires
utiles à l'exercice de la vertu ; car souvent la vertu brille en de
certaines actions qui ont moins leur condition dans la nature que
dans quelques accessoires 429
d'une vie heureuse. Ils voyaient dans l'homme le membre d'une grande
cité et du genre humain tout entier, et le regardaient comme lié
avec tous les hommes par les liens d'une certaine société
universelle. Voilà ce qu'ils pensaient sur le souverain bien
conforme à la nature ; ils estimaient que les autres avaient pour
effet ou de l'accroître, ou de le maintenir. Et c'est ainsi qu'ils
arrivaient aux trois parties de leur division des biens.
VI. C'est là cette division que l'on attribue d'ordinaire aux
péripatéticiens, et avec raison, car elle leur appartient ; mais une
très-fausse opinion serait de croire que les académiciens, comme on
les nommait alors, et les péripatéticiens, fissent deux écoles. Les
uns et les autres employaient cette division, et tenaient que le
souverain bien est la possession de ces premiers trésors de la
nature que l'on doit rechercher pour eux-mêmes, de tous ou au moins
des principaux. Les principaux sont ceux dont le siège est dans
l'âme et dans la vertu. Ainsi, toute cette ancienne philosophie a
pensé que c'est dans la vertu seule que réside le bonheur, lequel
toutefois ne serait pas complet si l'on ne réunissait eu outre les
biens du corps et les autres dont nous avons parlé plus haut, et qui
donnent tant de facilités à l'exercice de la vertu. De ces principes
découlaient naturellement l'obligation d'agir et la règle des
devoirs, dont l'unique fondement était de conserver ce que la nature
voulait que l'on conservât. De là résultait la fuite de la mollesse
et le mépris des voluptés ; et, en conséquence, on devait s'imposer
beaucoup de labeurs et de souffrances, et supporter de rudes
épreuves pour la cause du bien et de la justice, et de tout ce qui
est conforme à la nature bien entendue ; sortaient l'amitié, la
justice, l'équité, que l'on, mettait bien au-dessus des voluptés et
de tous les, agréments de la vie. Telle était chez ces philosophes
la doctrine des mœurs, la distribution et la teneur de cette partie
de la philosophie que j'ai mise en tête des autres.
Vient ensuite ce qui concerne la nature
; ils y reconnaissaient deux
principes, dont l'un était, la cause efficiente, et l'autre, se
prêtant en quelque façon à la puissance du premier, recevait de son
opération une forme déterminée. Selon eux, le principe actif
contenait une certaine force, et le principe passif, une certaine
matière ; mais chacun d'eux aussi renfermait l'autre ; car il est
impossible qu'il y ait de la cohésion dans la matière, si elle n'est
contenue par aucune force ; tout comme il est impossible qu'il existe
une force en dehors de toute matière ; car rien n'est qui ne doive
occuper un certain lieu. Le composé de matière et de force
constituait le corps, qu'ils nommaient aussi une certaine
qualité. Vous me permettrez, sans doute, d'employer quelquefois
des termes nouveaux pour exprimer des choses qui n'ont jamais été
nommées dans notre langue, comme font les Grecs, qui depuis si
longtemps déjà s'occupent de ces sujets.
VII. —
Bien certainement, dit Atticus. Nous vous permettons même d'employer
les expressions grecques, si les termes latins vous font défaut. —
Je vous en remercie ; mais je ferai tous mes efforts pour parler
toujours notre langue, tout en employant certains mots, comme ceux
de philosophie, rhétorique, physique, dialectique, que la
coutume a déjà naturalisés chez nous, avec une foulé d'autres. J'ai
donc appelé qualité ce que les
430
Grecs nomment ποιότητας ; expression, qui, chez les
Grecs eux-mêmes, ne fait pas partie du langage ordinaire, mais
appartient à la langue philosophique, ainsi que beaucoup d'autres du
même genre. Aucun des termes de la dialectique n'appartient au
domaine public ; elle a sa langue à part : c'est là d'ailleurs la
condition dans laquelle se trouvent presque toutes les sciences. Car
il faut bien pour exprimer des choses nouvelles, créer des mots
nouveaux, ou mettre à contribution les langues étrangères. Et si les
Grecs usent encore de cette licence, eux qui depuis tant de siècles
sont versés dans ce genre d'études, à plus forte raison devons-nous
en jouir, nous qui nous y essayons pour la première. Fois. — Selon
moi, Varron, lui dis-je, vous rendrez encore de grands services à
vos concitoyens si, après les avoir enrichi de tant de connaissances, vous les enrichissez aussi d'expressions nouvelles.
— Nous oserons suivre vos conseils, me répondit-il, et créer, s'il
le faut, des mots nouveaux. De ces qualités dont les unes sont
primordiales, et les autres sortent des premières. Les primordiales
sont uniformes et simples. Leurs dérivées, au contraire, sont
variées, et revêtent mille formes diverses. Ainsi l'air (on peut
recevoir ce mot dans notre langue), le feu, l'eau et la terre, sont
les qualités primitives ; de ces qualités sont sorties les espèces
animales et toutes celles que la terre engendre. Tels sont les
principes, et, suivant la force du grec, les éléments des
choses ; parmi ces éléments, l'air et le feu ont une puissance
motrice et efficiente ; les deux autres, à savoir l'eau et la terre,
ont la capacité d'être modifiés, et en quelque façon de pâtir.
Aristote admettait un cinquième élément tout particulier, distinct
de ceux que j'ai nommés, et dont étaient faits les astres et les
esprits. Mais nos philosophes pensent que tous les êtres ont au fond
de leur substance une même matière qui n'a aucune forme, est
dépouillée de toute qualité (l'emploi fréquent de cette
expression la rendra moins étrange et d'un usage plus commode), mais
avec laquelle tout est composé et formé, qui peut recevoir toutes
les déterminations, subir tous les changements et dans toutes ses
parties, et par là même périr, non par anéantissement, mais par le
retour à ses propres éléments, que l'on peut couper et diviser à
l'infini ; car il n'est pas de si petite particule dans la nature
qu'on ne paisse encore diviser ; et d'ailleurs tout ce qui se ment,
se meut dans l'espace, dont les parties peuvent aussi se diviser à
l'infini. La force, que nous avons appelée qualité, se meut,
se répand de tous côtés sur la matière, qu'elle pénètre, transforme
tout entière, et d'où elle tire ces êtres déterminés et
caractérisés, dont la réunion partante la nature où tout se joint,
et où la continuité n'est jamais rompue, compose le monde, en dehors
duquel il n'y a plus ni matière ni corps. Les parties du monde sont
tout ce qu'il renferme, et qui est contenu par une nature animée,
douée d'une raison parfaite et qui vit éternellement ; car il n'est
rien de plus puissant qui puisse la faire périr. C'est cette force
vivante qu'ils nomment l'âme du monde, et qu'ils appellent aussi un
esprit et une sagesse parfaite ; c'est leur dieu, et en quelque façon
la providence du monde entier, qui lui est soumis ; providence qui
gouverne surtout les corps célestes, et sur cette terre les choses
humaines : tantôt ils la nomment nécessité, parce
431 que rien ne peut se faire
autrement qu'il n'a été réglé par elle, et que ne le demande la
suite immuable et fatale de l'ordre éternel ; quelquefois ils la
nomment fortune, parce qu'elle fait naître beaucoup d'événements
imprévus, et que nous ne pouvions soupçonner, attendu notre
ignorance des causes et leur obscurité.
VIII. Quant à la
troisième partie de la philosophie, qui a pour objet l'intelligence
et ses opérations, voici la doctrine commune aux deux écoles.
Quoique l'esprit débute par la sensation, on n'accorde point aux
sens le droit de juger de la vérité. La raison est l'unique juge des
choses. Seule, elle mérite que l'on se fie à elle, parce qu'elle
voit seule ce qui est toujours simple et uniforme, et le voit tel
qu'il est. C'est cet objet de la raison qu'ils nommaient, et que
Platon avant eux avait nommé idée, ce que nous pouvons assez
bien exprimer par le mot espèce. Ils pensaient que tous les
sens sont des instruments grossiers et lents, qu'ils ne peuvent en
aucune manière percevoir même les objets qui semblent tomber sous
leur prise ; car ces objets sont ou si petits qu'ils échappent à nos
sens, ou si mobiles et agités, qu'aucun d'eux ne garde un seul
instant de fixité, qu'aucun même ne conserve d'identité, parce que
tout est dans une décomposition et un flux continuels. C'est
pourquoi ils appelaient toute cette partie des choses la région des
opinions. Ils n'admettaient pas que la science pût se trouver
ailleurs que dans les notions et les raisonnements de l'esprit : et
ni conséquence, ils établissaient des définitions et les faisaient
intervenir dans tous les sujets soumis à leurs discussions. Ils
donnaient aussi une explication raisonnée des mots, en montrant les
causes diverses de leur acception ; c'est ce qu'ils appelaient
étymologie. S'étant fait par ce travail comme des marques
précises des choses, ils arrivaient, par leur secours et celui des
arguments, à prouver et démontrer ce qu'ils voulaient établir ; c'est
ici qu'étaient expliquées toutes les règles de la dialectique, qui
est l'art du discours terminé par une conclusion logique. En regard
de la dialectique, on plaçait l'art oratoire, qui donne les règles
du discours développé et disposé pour produire la persuasion. Voilà
la philosophie telle qu'ils la reçurent d'abord des mains de Platon
;
je vous exposerai, si vous le voulez, d'après Antiochus, les
vicissitudes qu'elle a subies. — Nous le voulons sans doute, lui
dis-je ; car je puis répondre pour Atticus comme pour moi.
IX. Et vous avez raison, reprit Varron. Antiochus nous fait en effet
une histoire fort intéressante des doctrines des péripatéticiens et
de l'ancienne Académie. Aristote le premier porta une grave atteinte
à la théorie des espèces, dont je parlais il y a un instant, et que
Platon avait embrassée avec tant d'ardeur, qu'il déclarait voir dans
les idées quelque chose de divin. Théophraste, homme d'une douce
éloquence, et de mœurs si pures, qu'il s'exhale de ses écrits comme
un parfum de probité et de candeur, ébranla plus fortement encore
l'autorité de l'ancienne doctrine ; car il dépouilla la vertu de ses
beaux privilèges, et l'énerva en soutenant qu'elle ne pouvait
suffire pour le bonheur. Quant à Straton, son disciple, malgré la
pénétration de son esprit, on ne peut l'admettre dans les rangs de
cette école ; il négligea la partie la plus essentielle de la
philosophie, celle qui a pour objet la vertu et les mœurs ; et se
432 tournant, tout entier vers
l'étude de la nature, il s'écarta, même ici, en beaucoup de points,
des opinions du Lycée. Speusippe et Xénocrate, au contraire, qui les
premiers avaient continué l'enseignement de Platon et reçu
l'héritage de sa doctrine ; et après eux Polémon, Cratès et Crantor,
réunis dans l'Académie, conservèrent avec un soin religieux le dépôt
qui leur fut successivement transmis. Zénon et Arcésilas avaient
suivi assidûment les leçons de Polémon. Mais Zenon, plus âgé qu'Arcésilas,
et qui avait une subtilité d'esprit et une finesse de dialectique
peu communes, entreprit de réformer la philosophie. Si vous le
voulez, je vous expliquerai cette réforme, comme le faisait
Antiochus. — C'est tout à fait mon désir, lui dis-je, et vous voyez
que Pomponius le manifeste comme moi.
X. Zénon n'était pas homme à briser, comme Théophraste, les ressorts
de la vertu, mais à mettre au contraire tous les éléments du bonheur
dans la vertu seule, en refusant à tout ce qui n'est pas elle le
titre de biens ; ce bien simple, unique, sans partage, est ce qu'il
appelait l'honnête. Quoique toutes choses en dehors de la vertu ne
méritassent le titre ni de biens ni de maux, il avouait cependant
que les unes étaient conformes et les autres contraires à la nature
;
entre les deux, il en admettait d'intermédiaires et de neutres. Il
enseignait que celles qui sont conformes à la nature pouvaient être
recueillies, et qu'on en devait faire une certaine estime ; des
opposées, le contraire : quant aux intermédiaires, il les laissait
entre deux : on devait, selon lui, y être parfaitement indifférent.
Dans la première classe, il distinguait des choses plus dignes
d'estime les unes que les autres ; celles qui en méritaient le plus,
il les nommait préférées ; les autres, rejetées. Dans tout
ceci, comme on peut le voir, ce n'est pas tant les choses que les
noms qu'il avait changés ; c'est ainsi encore qu'entre
l'accomplissement du bien et la faute, il plaçait, comme de certains
intermédiaires, l'observation ou la négligence des devoirs. Il
mettait l'accomplissement du bien dans les seules bonnes actions
; le
mal, dans les mauvaises ; et il pensait qu'entre ces extrêmes,
observer les devoirs ou y manquer, formaient comme des degrés
moyens. Les anciennes écoles disaient que toutes les vertus ne sont
pas le fruit de la raison, mais qu'il y en a de naturelles et
d'autres acquises par l'habitude' ; Zénon les ramène toutes à
l'exercice de la raison : elles pensaient que les diverses sortes de
vertus dont nous avons parlé plus haut peuvent se rencontrer les
unes sans les autres ; il démontrait que, d'aucune manière, il ne
peut en être ainsi ; il soutenait que la beauté morale n'est pas
seulement dans la pratique de la vertu, mais dans l'état même de
l'âme vertueuse, quoiqu'il fût impossible d'avoir la vertu sans en
faire un continuel usage. Elles ne proscrivaient pas toutes les
émotions de l'âme ; car elles disaient que le chagrin, les désirs, la
crainte et la joie nous sont inspirés par la nature ; mais elles les
restreignaient et leur laissaient le moins de jeu possible : Zénon
les regarde comme des maladies, et veut que le sage n'en soit jamais
atteint. Considérant ces émotions comme naturelles et
irraisonnables, les anciens en plaçaient le siège dans une partie de
l'âme et mettaient la raison dans une autre ; Zénon pensait tout
différemment ; selon lui, les émotions sont volontaires ; elles nais-
433 sent d'un faux jugement de
notre esprit, et la mère commune de toutes les maladies de l'âme,
c'est un certain dérèglement de la volonté sortie des gonds. Voilà à
peu près toute sa doctrine sur les mœurs.
XI. Dans la philosophie naturelle, il pensait d'abord qu'il ne
fallait point ajouter aux quatre éléments des choses ce cinquième
principe dont les anciens voulaient que les sens et l'esprit fussent
composés. Le feu, selon lui, était cette nature qui engendre tout,
et en particulier l'esprit et les sens. Il différait d'eux encore,
en ce qu'il pensait qu'on ne peut attribuer aucune puissance
affective à une nature tout à fait incorporelle ; car c'est ainsi que
Xénocrate et les philosophes anciens avaient défini l'âme ; mais il
soutenait qu'aucun être ne pouvait produire ou être produit qui ne
fût un corps. Il fit surtout beaucoup d'innovations dans la
troisième partie de la philosophie. Il y dit d'abord plusieurs
choses nouvelles touchant les sens dont l'exercice, selon lui, était
déterminé par l'impulsion extérieure de ce qu'il nomme
φαντασίαν,
et que nous pouvons appeler représentation : retenons cette
expression, car elle nous sera fort utile dans la suite du discours.
A ces objets aperçus, et en quelque façon reçus par les sens,
correspond l'affirmation de l'esprit, affirmation qu'il prétend être
en notre puissance et dépendre de notre volonté. Cet assentiment
n'est pas accordé à toutes les représentations, mais à
celles-là seules qui dénotent, par un certain tour exact, leur
correspondance aux objets réels qu'elles font connaître. Une telle
représentation, considérée en elle-même, est ce qu'il nommait
le compréhensible. Me passerez-vous cette expression ? —Certainement,
dit Atticus. Par quel autre terme pourriez-vous traduire
κατάληπτον ?
Mais reçue et approuvée par l'esprit, elle devenait la
compréhension, parce que nous la possédions alors comme ces objets
que la main a saisis ; c'est même dans cette similitude qu'il faut
chercher l'origine d'une expression que personne, avant
Zénon.,
n'avait employée dans un tel sujet ; il se servit d'ailleurs de
beaucoup de mots nouveaux, car il apportait des idées nouvelles. Ce
qui avait été saisi par les sens, s'appelait sensation ; et si la
compréhension était assez forte pour que la raison n'eût point de
prise sur elle, c'était la science ; sinon, l'incertitude, d'où
naissait l'opinion, dont le caractère est la faiblesse, et qui
ressemble beaucoup à l'ignorance et à l'erreur. Entre la science et
son opposé, il plaçait cette compréhension dont je parlais, qu'il
déclarait n'être, de sa nature, ni bonne ni mauvaise, mais dont il
faisait l'unique fondement de notre créance. C'est pourquoi il
maintenait l'autorité des sens, dont les perceptions, comme je l'ai
dit, lui paraissaient vraies et fidèles ; non pas qu'elles fussent
une représentation complète de leur objet, mais parce qu'elles
comprenaient exactement tout ce qui pouvait entrer en elles, et
parce que la nature nous les avait données comme un type de science
et un premier linéament d'elle-même, d'où les notions des choses
pussent sortir ensuite et se graver dans l'esprit. Ces notions ne
nous apprennent pas seulement quels sont les éléments du monde, mais
nous ouvrent des routes bien plus larges pour en connaître le vrai
système. Quant à l'erreur, aux préjugés, à l'ignorance, aux
opinions, aux soupçons, en un mot à tous les modes de connaissance
qui ne sont pas la ferme et inébranlable conviction, Zénon les
regarde comme inconciliables avec la vertu et la
434 sagesse. Voilà à peu près
tous les changements dont il est l'auteur, et la différence qu'il y
a entre lui et l'ancienne école.
XII. Lorsque Varron eut achevé : Vous nous avez, lui dis-je, exposé
brièvement, et toutefois avec beaucoup de clarté, la doctrine de
l'ancienne Académie et celle des Stoïciens. Mais ce dernier système,
si nous en croyons notre ami Antiochus, c'est plutôt l'ancienne
Académie amendée qu'une doctrine véritablement nouvelle. — Alors
Varron : C'est à vous, qui vous séparez maintenant de l'ancienne
école, et qui vous déclarez partisan des nouveautés introduites par
Arcésilas, à nous apprendre en quoi consiste notre dissentiment,
et sur quels motifs il se fonde, afin que nous voyions si notre
défection était légitime. —Arcésilas, dis-je alors, dirigea toute sa
controverse contre Zénon, non par opiniâtreté ou par le désir de
triompher, à ce qu'il me semble, mais à cause même de l'obscurité de
ces hautes questions qui avaient amené Socrate à confesser son
ignorance ; et déjà avant Socrate, Démocrite, Anaxagore, Empédocle,
presque tous les anciens philosophes, dont l'opinion fut qu'on ne
peut rien connaître, rien entendre, rien savoir ; que les sens sont
bornés ; l'esprit, débile ; la vie, trop promptement écoulée ; et la
vérité (comme le dit Démocrite), profondément enfouie ; que les
opinions et les conventions ont tout envahi ; qu'il n'y a plus de
place pour la vérité ; qu'en un mot, tout est couvert d'épaisses
ténèbres. C'est pourquoi Arcésilas soutenait qu'on ne peut rien
savoir, et non plus seulement qu'on ne sait rien ; où s'en était tenu
Socrate : tant les choses sont profondément cachées. Il n'est rien,
selon lui, que l'on puisse voir ou comprendre ; en conséquence, on
doit ne rien tenir pour certain, ne rien affirmer, ne donner à rien
son assentiment, mais retenir toujours son jugement, et se garder de
toute précipitation fâcheuse et de cette légèreté qui se signale
surtout lorsque l'on donne les mains à l'erreur, ou à des opinions
sans motifs connus, tandis que rien n'est plus honteux que de se
prononcer et d'affirmer avant d'être arrivé à la vue claire et à la
connaissance exacte. Conséquent à ces maximes, il argumentait la
plupart du temps contre tous les systèmes, pour donner, sur une même
question, à chacune des deux thèses opposées, des raisons de même
force, et faciliter par là la suspension de l'esprit entre les deux
affirmations contraires. Voilà ce que l'on nomme la nouvelle
Académie : j'avoue que, pour moi, elle ressemble beaucoup à
l'ancienne, si toutefois l'ancienne comprend Platon, qui dans ses
livres, n'affirme rien, présente des preuves nombreuses à l'appui
des deux opinions opposées, est toujours en quête de la vérité, et
n'arrive à aucune conclusion positive. Appelons cependant, j'y
consens, ancienne Académie cette première école, et nouvelle
Académie, celle-ci, où la doctrine d'Arcisilas s'est fidèlement
maintenue et transmise depuis son fondateur jusqu'à Carnéade,
quatrième successeur d'Arcésilas. Carnéade était versé dans toutes
les parties de la philosophie, et, comme je l'ai appris de ceux qui
l'avaient entendu, surtout de Zénon l'épicurien, qui, tout en
professant une doctrine fort différente de la sienne, l'admirait
cependant plus qu'homme au monde. Il était doué d'un incroyable
génie... |