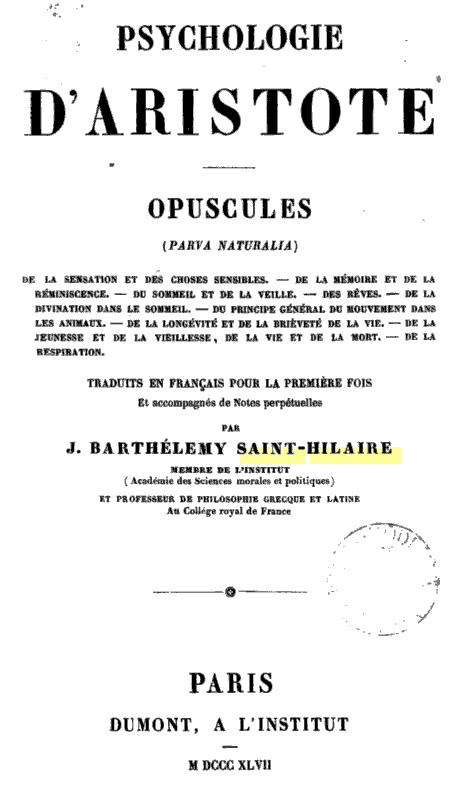
ARISTOTE
OPUSCULES
PREFACE.
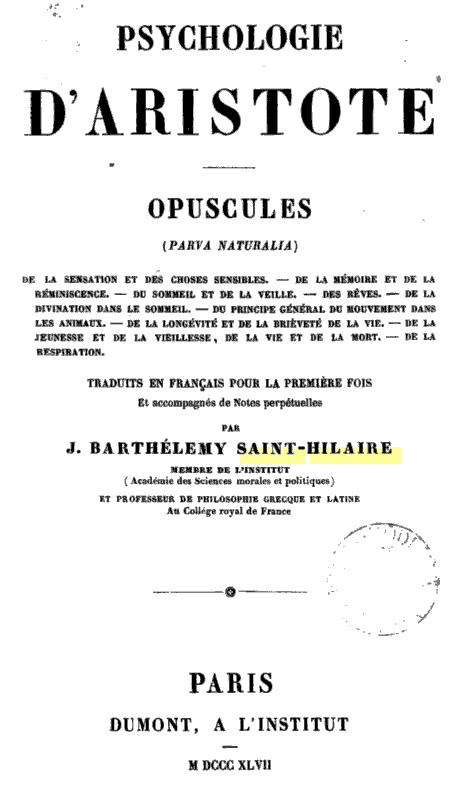
OPUSCULES
PRÉFACE
|
PRÉFACE. Caractère et importance des Opuscules : supériorité du Traité de la Mémoire et de la Réminiscence sur tous les travaux postérieurs, Descartes, Locke, Reid, Dugald Stewart, etc. : hante valeur du Traité de la Respiration, même à côté des travaux de la physiologie moderne; MM. Burdach et Müller. — Composition et style de ces deux Traités. — Méthode d'observation et d'expérimentation dans l'antiquité, et spécialement dans Aristote. — Différence des sciences philosophiques et des sciences naturelles.—Utilité de l'histoire de la philosophie : son rôle dans la philosophie française au xixe siècle. Les Opuscules, au nombre de neuf, qui forment le recueil que les Commentateurs latins ont appelé Parva naturalia, doivent être considérés comme un complément du Traité de l'Ame. On y trouve en partie les mêmes questions, avec des développements tout nouveaux, et avec des détails qui montrent clairement le lien qu'Aristote établit entre la psychologie et l'histoire naturelle. C'est le caractère physiologique qui domine dans les Opuscules: et ces petits traités sont riches surtout en observations et en théories dont la science de la nature profitera plus encore que la science philosophique. C'est dire assez qu'Aristote reprend ici toute sa supériorité; et que cet incomparable génie, dont l'éclat nous avait semblé pâlir dans les questions capitales qui concernent l'essence et la destinée de l'âme, retrouve dans les Opuscules toute sa splendeur et toute sa puissance. En jugeant le système exposé dans le Traité de l'Ame, il nous a fallu, malgré notre admiration, le condamner d'une manière à peu près absolue, au nom de la réalité même trop souvent méconnue, au nom des croyances générales de l'humanité représentées par les religions et détruites par le Péripatétisme, au nom de la philosophie telle que l'ont faite Platon, maître d'Aristote durant vingt années, et Descartes , qui a placé sur une hase désormais inébranlable ces vérités essentielles. Au contraire, pour les Opuscules, la louange sera presque aussi complète que le blâme avait dû l'être sur des problèmes d'un tout autre ordre ; et la critique, si elle doit encore exercer ses droits, n'atteindra que des erreurs qui tiennent à peu près uniquement au temps même où vécut Aristote. L'antiquité, ou plutôt l'esprit humain à son début, ne pouvait éviter des erreurs si faciles; et la science moderne, qui ne les partage plus, doit les comprendre et les excuser, comme on pardonne à d'illustres ancêtres les fautes mêmes qui ont préparé un magnifique et fécond héritage. Pour apprécier la haute valeur des Opuscules, il suffit de voir ce qu'ils renferment : Dans le Traité de la Sensation et des choses sensibles, des théories spéciales sur les couleurs, les saveurs, les odeurs, et sur les rapports profonds de ces divers phénomènes entre eux : puis la discussion de deux questions fort curieuses et encore pendantes, qu'Aristote a soulevées pour la première fois : 1° Nos sensations peuvent-elles se diviser à l'infini comme les corps mêmes ou les mouvements des corps qui les provoquent? 2° Jusqu'à quel point est-il possible de percevoir deux sensations à la fois? Dans le Traité de la Mémoire et de la Réminiscence, des observations psychologiques dont l'exactitude est inattaquable, et qui sont encore supérieures à toutes les analyses faites depuis deux mille ans; Dans le Traité du Sommeil et de la Veille, un système physiologique qui prétend expliquer ces phénomènes mystérieux, et qui est resté exact en très-grande partie; Dans le Traité des Rêves, une explication qui, jusqu'à présent, n'a pas eté remplacée par une meilleure, et qui rattache étroitement cet état bizarre et passager de notre âme à la faculté de la sensibilité; Dans le Traité de la Divination, une réfutation modérée, mais péremptoire, de ce préjugé qu'ont accepté, chez les anciens, les plus graves esprits, et qui subsiste encore de nos jours même chez les peuples les plus civilisés; Dans le Traité sur le Principe général du mouvement dans les Animaux, une profonde théorie qui rattache le principe par lequel se meuvent spontanément certains êtres au principe éternel d'où relève l'univers entier; Enfin, dans le Traité de la Longévité et de la Brièveté de la vie, dans le Traité de la Jeunesse et de la Vieillesse, de la Vie et de la Mort, et dans le Traité de la Respiration, des observations nombreuses, sagaces, vraies, empruntées à la série entière des êtres organisés, et appartenant à cette science déjà pratiquée par Aristote, et qui, de notre temps, a pris le nom spécial de physiologie comparée. Voilà les trésors divers que nous offrent les Opuscules. Nulle part le génie observateur d'Aristote ne s'est montré plus fertile ni plus exact que dans ces petits traités, dont quelques-uns comptent à peine une vingtaine de pages, et qui contiennent cependant parfois autant et plus de vérités que les longues discussions auxquelles les mêmes sujets ont plus tard donné lieu. C'est une louange que l'on peut accorder sans scrupule à plusieurs de ces théories ; toute grande qu'elle est, elle n'exalte point outre mesure la valeur du passé, pas plus qu'elle ne rabaisse injustement les travaux qui ont suivi. Aristote a pu, dans quelques parties de la science, être supérieur à tous ses successeurs, comme il l'était à ses contemporains ; il lui a été donné, par exemple en logique, d'épuiser le sujet, bien qu'il l'eût découvert le premier, et de ne laisser à d'autres que le facile mérite d'expliquer et d'éclaircir ce qu'il avait dit. Dans quelques-unes des questions que présentent les Opuscules, il a eu le même bonheur; et de là l'intérêt considérable qui doit s'y attacher, malgré l'oubli où trop souvent on les a laissées. Il pourra donc être utile d'insister sur un ou deux de ces petits traités, pour démontrer tout ce qu'Aristote, héritier lui-même de savants prédécesseurs, a fait pour la science, et pour signaler les idées qu'il lui a définitivement acquises, ou les germes puissants qu'il a légués à l'étude et à la fécondation des siècles. Je choisirai spécialement le Traité de la Mémoire et de la Réminiscence, et je le comparerai à tout ce que les psychologues les plus illustres ont fait depuis lors sur cette importante question ; ce sera la part de la Psychologie. J'y joindrai le Traité de la Respiration, que j'examinerai au même point de vue ; ce sera la part de la Physiologie. Cet examen et ces comparaisons auront un double résultat : d'abord, de faire une fois de plus briller la gloire d'Aristote et de l'antiquité grecque; et en second lieu, ce qui est plus grave, de nous donner quelques enseignements sur l'histoire de l'esprit humain lui- même, et sur la loi qui préside aux progrès de la science. Voyons la théorie d'Aristote sur la Mémoire : elle est aussi simple et aussi claire qu'elle est exacte et profonde. Aristote distingue d'abord dans la mémoire deux états fort différents l'un de l'autre; et l'observation peut nous les révéler à chaque instant, pour peu que nous y prêtions attention. Tantôt la mémoire se produit en nous d'une manière à peu près spontanée et presque sans aucun effort; le souvenir est complet et direct, et nous le recueillons tel qu'il nous est donné par l'activité naturelle de notre esprit: c'est ce qu'on appelle proprement la mémoire. Tantôt le souvenir est incomplet et indirect: l'esprit alors ne retrouve qu'un fragment de ce qu'il cherche; ou bien pour arriver à l'objet qu'il poursuit, il part d'un autre objet qui est en un rapport quelconque avec celui-là; et nous avons besoin d'un effort plus ou moins considérable de notre volonté pour recomposer le reste du souvenir, ou pour en ressaisir l'objet propre : c'est ce qu'Aristote appelle la réminiscence, mot qu'il n'invente pas, mais qu'il détour ne du sens que Platon lui avait parfois prêté. La distinction de la mémoire et de la réminiscence est essentielle, et elle est parfaitement justifiée par les faits eux-mêmes. Plus tard on a essayé de lui en substituer d'autres, comme on l'a parfois omise ; et l'on s'est également trompé, soit en l'ignorant, soit en prétendant la remplacer. Après cette distinction, qui ressort de la division du traité et même de son titre, Aristote circonscrit et étudie l'objet spécial de la mémoire. Cet objet appartient toujours au passé ; la mémoire n'a pas de prise sur le présent ni sur l'avenir. Aussi, « toutes les fois qu'on fait acte de souvenir, on se dit dans l'âme qu'on a entendu antérieurement la chose dont on se souvient, qu'on l'a sentie ou qu'on l'a pensée. » Par conséquent, la mémoire est toujours accompagnée de la notion du temps, que cette notion d'ailleurs soit précise ou confuse. Or, la notion du temps, liée de si près à celle du mouvement, nous est donnée comme cette dernière par la sensibilité, selon Aristote. La mémoire relève donc directement de la sensibilité, tout comme en relève aussi l'imagination, sans laquelle l'entendement lui-même ne saurait agir. La mémoire ne s'applique qu'indirectement aux choses pensées par l'intelligence ; en soi elle se rapporte au principe sensible. Voila déjà la mémoire parfaitement déterminée par la distinction des espèces qu'elle présente, par l'objet auquel elle s'applique, et par la partie spéciale de l'âme d'où elle dépend. Mais la sagacité d'Aristote est trop éclairée pour ne pas apercevoir le mystère à peu près inexplicable que ce phénomène offre encore. Dans l'acte de la mémoire, il n'y a de vraiment présent pour nous que la modification même de l'esprit ; l'objet dont on se souvient est absent. Comment se fait-il donc que, sentant uniquement l'impression demeurée en nous et faite jadis sur l'esprit par l'objet, nous puissions nous rappeler l'objet absent que nous ne sentons pas? A cette question Aristote répond par une comparaison mille fois employée après lui, mais qu'il a présentée d'une manière plus délicate et plus juste qu'aucun de ses imitateurs. Selon lui, ce double caractère qu'on remarque dans le fait de mémoire, est de tout point analogue au double caractère que nous offre une peinture, un dessin quelconque. Une peinture est à la fois en soi-même quelque chose de réel, indépendamment de l'objet qu'elle reproduit; et de plus, relativement à cet objet, elle est une simple copie. Aristote ne propose cette explication de la mémoire que sous une forme dubitative ; et il ne prétend pas donner cette métaphore pour la réalité même. Mais la comparaison, ainsi limitée, est aussi exacte qu'ingénieuse; elle éclaircit, par un exemple sensible, l'étrange propriété de la mémoire qui, à l'aide d'une modification de notre esprit, dont nous avons actuellement conscience, nous rappelle un objet absent, dont nous avons dès longtemps perdu la perception, et qu'elle fait revivre. Un autre avantage de cette distinction, c'est qu'elle fournit au philosophe une explication non moins vraie de certaines erreurs de l'esprit, comprises sous le nom général d'hallucinations. L'hallucination consiste à considérer en elle-même la modification de l'esprit qui constitue la mémoire, et de la croire une sensation nouvelle, au lieu de la prendre pour une copie ; ou bien, à l'inverse, de prendre un fait original de sensation pour une copie et un souvenir. Il faut ajouter qu'Aristote va plus loin, et que, reprenant la forme de la comparaison, bien qu'elle soit toujours un peu équivoque, il dit expressément, comme il l'a déjà fait dans le Traité de l'Ame, que la sensation empreint sur l'esprit un type, analogue au cachet qu'imprime l'anneau sur la cire ; et la perception de cette impression restée en nous, constitue précisément la mémoire. Cette explication, bien qu'elle ait été attaquée, est encore parfaitement juste; et la preuve, c'est que très- évidemment la mémoire varie avec l'organisation matérielle du corps, ou même avec ses modifications accidentelles, tout comme l'empreinte varie suivant la fluidité ou la dureté de la cire. Aristote n'a pas manqué de remarquer cette influence du tempérament sur la mémoire; et après lui, bien d'autres ont répété ces théories, que l'on peut aisément vérifier par des observations personnelles. Voilà les traits principaux de la mémoire, d'après Aristote. Ceux de la réminiscence ne sont pas moins importants ni moins nets. La réminiscence ne doit être confondue ni avec la mémoire, ni avec la sensation. Pour la sensation, la différence est évidente. Quant à la mémoire, elle vient après la réminiscence lorsque l'effort que la réminiscence exige est heureux; par conséquent, elle ne lui est pas identique. La réminiscence ne demande qu'une partie de la chose pour reconstituer la chose entière et en avoir le vrai souvenir. Ce qui la rend possible, c'est que les mouvements divers produits en nous par les sensations, s'enchaînent les uns aux autres dans notre âme par des liens mystérieux et indissolubles ; et quand un d'eux, par une cause quelconque, se représente à l'esprit, il entraîne à sa suite tous les mouvements qui, de plus ou moins près, se rattachent à lui, et parmi lesquels se trouve plus ou moins loin celui qui correspond à l'objet que la réminiscence recherche. De là vient que les ressouvenirs sont plus faciles, quand les choses ont un certain ordre entre elles, comme sont les mathématiques. Quand les choses n'ont pas d'ordre, l'acte de la réminiscence est plus pénible; et l'esprit, avant d'atteindre la chose même qu'il prétend trouver, est réduit à remuer une foule d'idées, qui sont plus ou moins étrangères à celles-là. « Par exemple de l'idée du lait, l'esprit passe à l'idée du blanc, du blanc à l'air, de l'air à l'humidité; et à l'aide de cette dernière notion, il se rappelle l'automne, saison qui était précisément ce qu'il cherchait. » Dans cette association rapide des idées, l'esprit se porte le plus volontiers à celles qui lui sont le plus ordinaires ; et de là parfois ses erreurs, et parfois aussi le succès de ses efforts. Dans la mémoire et dans la réminiscence, le point capital, c'est le temps. Notre esprit est doué de la faculté de connaître les distances de temps, comme il connaît les distances d'espace: il discerne et retient les proportions des unes et des autres avec une merveilleuse délicatesse, bien que ce ne soit pas toujours avec une parfaite exactitude. Ainsi l'on se rappelle quelquefois qu'on a fait une chose dans un temps passé ; mais l'on ne saurait préciser ce temps : ou bien, au contraire, on se rappelle fort distinctement le temps où l'on a fait quelque chose, et l'on ne se rappelle pas précisément la chose elle-même. L'acte de la mémoire ou de la réminiscence n'est complet que quand le mouvement de l'esprit relatif à l'objet coïncide avec le mouvement relatif au temps. Une différence considérable entre la réminiscence et la mémoire, c'est que la réminiscence étant un acte de volonté ou plutôt de raisonnement, est le privilège exclusif de l'homme, tandis que la mémoire appartient aussi aux animaux. La réminiscence n'est pas d'ailleurs absolument soumise à nos ordres. Ainsi que la mémoire, elle dépend en partie du corps; et ce qui le prouve, c'est que souvent, par suite de l'effort qu'elle demande, on est tellement troublé, qu'on ne peut plus arrêter à son gré l'émotion que cet effort a fait naître ; on voudrait cesser une recherche fatigante, et on ne le peut point. L'esprit, comme un trait qu'on ne peut plus ressaisir une fois lancé, marche de lui-même : « et la réminiscence agit alors sur lui à peu près comme ces mots, ces chants ou ces discours qu'on a eus trop fréquemment à la bouche, et qu'on se surprend longtemps à chanter et à dire, sans même qu'on le veuille. » Enfin, la mémoire et la réminiscence se rattachent de si près à l'organisation physique, qu'on a pu remarquer qu'en général les hommes chez qui les parties supérieures du corps sont trop fortes, ont peu de mémoire. Ce genre de conformation est aussi l'une des causes qui rendent cette faculté si faible dans les enfants durant les premières années de la vie. Ce qui en eux l'affaiblit encore, c'est l'agitation énorme causée par le développement que la nature leur impose, de même que chez les vieillards la mémoire s'oblitère par l'agitation tout opposée que produit le dépérissement qui les emporte. Telle est la théorie de la mémoire et de la réminiscence. On le voit, tous les éléments en sont admirablement choisis; les faits sur lesquels elle s'appuie sont parfaitement vrais ; et les psychologistes postérieurs n'ont pu que les répéter, soit qu'ils aient copié Aristote, soit qu'ils aient confirmé ses observations en les faisant eux-mêmes de nouveau. Mais avant de montrer ce que la postérité a emprunte du philosophe, il est bon de rappeler d'abord ce que lui-même avait emprunté de ses devanciers. Aristote a l'habitude excellente de toujours présenter, avant ses propres idées, celles de ses prédécesseurs. Dans le Traité de l'Ame, dans la Politique, dans la Métaphysique, il a pris ce soin, beaucoup plus impartial et plus désintéressé que ses détracteurs ne l'ont supposé; et c'est ainsi qu'il a contribué à fonder l'histoire de la philosophie, en prouvant par tant d'exemples combien elle est utile. Parmi les Opuscules, il en est un, le Traité de la Respiration, où il s'est fait aussi l'historien des opinions du passé; mais, pour le Traité de la Mémoire et de la Réminiscence, il n'a point parlé des théories antérieures. Pourtant, si elles étaient peu nombreuses, il en était une au moins qui devait lui être aussi bien connue qu'elle peut l'être pour nous, et dont il n'a rien dit : c'est celle de Platon. La réminiscence, dans le système de Platon , tient une place considérable; c'est par elle qu'il explique à la fois la science humaine tout entière et l'état de l'âme en ce monde, où elle ne fait que se rappeler par des images plus ou moins obscures et des recherches plus ou moins heureuses, les divins objets qu'elle a vus et contemplés face à face dans une vie antérieure. Il faut laisser de côté toute la partie allégorique de cette théorie, qui n'a aucun rapport avec celle d'Aristote, et que sans doute il ne prenait point au sérieux , si l'on peut interpréter ainsi le silence à peu près absolu qu'il a gardé à ce sujet (01). Mais cette théorie, soit qu'on la fasse purement allégorique ou qu'on la croie métaphysique, renferme une part de psychologie dont Aristote a certainement beaucoup profité; et il est équi- table de signaler les emprunts qu'il a pu lui faire. Platon a donné à la réminiscence une telle importance, qu'on pourrait soutenir qu'il lui a presque entièrement sacrifié la mémoire, et que de ces deux états si voisins et pourtant si distincts de l'esprit, il n'a guère étudié que l'un aux dépens de .l'autre. La science n'est que réminiscence ; apprendre c'est se ressouvenir : tel est le principe qu'il essaye de démontrer dans le Ménon , et qu'il admet à l'état d'axiome dans le Phédon, dans le Phèdre, et dans d'autres dialogues. Or, la science ne s'acquiert pas sans effort : il faut vouloir pour apprendre ; et c'est précisément cette volonté constante et féconde qui constitue le philosophe. Le vulgaire des hommes, en apercevant dans cette vie, par le ministère des sens, les objets que ce monde lui offre, croit les connaître pour la première fois, bien qu'au fond il ne fasse que se souvenir d'objets tout autres dont ceux-là sont de pâles reflets. Mais le philosophe ne partage pas cette grossière illusion. Il sait qu'ici-bas il n'aperçoit que des ombres; et toute son étude réfléchie, volontaire, énergique, c'est de remonter, à l'aide de ces signes imparfaits, jusqu'aux réelles et splendides essences que son âme a jadis connues et dont elle peut réveiller en elle le divin souvenir. La réminiscence est donc en quelque sorte le privilège du philosophe. Platon ne va pas plus loin : il n'analyse pas le fait psychologique avec l'attention scrupuleuse qu'Aristote y apportera. Mais, tout en poursuivant un but fort supérieur et fort différent , il n'a omis aucun des traits essentiels. L'acte de la volonté appliqué à la mémoire, la puissance que possède l'esprit de refaire, par son effort, des souvenirs incomplets, le procédé qu'il suit pour passer des objets les plus dissemblables à celui qu'il cherche et qui d'abord lui échappait : tels étaient les matériaux que le maître transmettait à son disciple. Aristote les a transformés, sans doute; mais il les a certainement recueillis. A une croyance presque mythologique , il a substitué une théorie scientifique : il a remplacé des indications trop peu précises par des observations positives, des notions éparses par un système, et l'inconsistance du dialogue par une rigueur méthodique. Mais l'idée principale lui avait été fournie par son maître ; et la distinction si grave de la mémoire et de la réminiscence, bien qu'il l'ait beaucoup éclaircie, ne lui appartient pas tout entière. Les théories de Platon l'impliquaient nécessairement, et le disciple n'a guère eu qu'à la dégager. Mais si Aristote a reçu quelque chose du passé, il a donné bien davantage aux temps qui ont suivi : ils lui ont tout emprunté. Je ne parle pas de l'antiquité, où aucune théorie nouvelle , même dans l'école d'Alexandrie, ne vient compléter ou contredire la sienne (02); je ne parle pas du moyen âge qui, pendant six siècles au moins, se fait le docile écho du Péripatétisme. Mais au xviie siècle, à l'époque de la réforme philosophique, quand la domination d'Aristote est renversée, sa théorie de la mémoire reste entière parce qu'elle est vraie. Même au siècle suivant qui s'occupe tant de psychologie, c'est toujours elle qui prévaut et qui est reproduite. L'école écossaise, si exacte, si minutieuse n'a point dépassé Aristote, et sur plusieurs points même elle est moins complète et moins profonde que lui. Descartes qui, si l'on en excepte le Traité des Passions de l'âme, n'a fait de théorie expresse sur aucun point spécial de psychologie, n'en a pas fait davantage sur la mémoire. Les réformateurs comme lui ne peuvent point descendre aux détails. Mais plusieurs passages de sa correspondance, et ses réponses à diverses critiques attestent qu'il avait sur cette question un système dont nous ne pouvons malheureusement entrevoir que des lueurs. Descartes adopte en partie l'explication péripatéticienne; et pour lui aussi la mémoire vient des vestiges que les impressions sensibles ou les modifications de la pensée laissent en nous. Il pousse même ces métaphores toutes matérielles jusqu'à parler des plis de la mémoire dans le cerveau, et des espèces qui sont les intermédiaires indispensables à l'aide desquels elle agit. « C'est, dit-il, par le mouvement de ces particules du cerveau qu'il se fait un vestige duquel dépend le ressouvenir. » (Tom. VIII, p. 271, éd. de M. Cousin. ) Ailleurs il dit plus positivement encore : « Je crois que la mémoire des choses matérielles dépend des vestiges qui demeurent dans le cerveau après que quelque image y a été imprimée; et que celle des choses intellectuelles dépend de quelques autres vestiges qui demeurent en la pensée même. Mais ceux-ci sont d'un tout autre genre que ceux-là ; et je ne les saurais expliquer par aucun exemple des choses corporelles qui n'en soit fort différent, au lieu que les vestiges du cerveau le rendent propre à mouvoir l'âme en la même façon qu'il l'avait mue auparavant, et ainsi à la faire souvenir de quelque chose, tout de même que les plis qui sont dans un morceau de papier ou dans un linge, font qu'il est plus propre à être plié derechef comme il était auparavant que s'il n'avait jamais été ainsi plié. » (Tom. IX, p. 167.) Enfin, s'exprimant à peu près dans les mêmes termes qu'Aristote, il dit : «l\ ne suffit pas, pour nous ressouvenir de quelque chose, que cette chose se soit autrefois présentée à notre esprit, et qu'elle ait laissé quelques vestiges dans le cerveau, à l'occasion desquels la même chose se présente derechef à notre pensée ; mais, de plus, il est requis que nous reconnaissions, lorsqu'elle se présente pour la seconde fois, que cela se fait à cause que nous l'avons auparavant aperçue.» (Tom. X, p. 157.) Le point le plus grave de cette théorie, c'est la distinction que fait Descartes entre la mémoire matérielle et la mémoire intellectuelle. Aristote l'a indiquée également; mais il ne semble pas y avoir attaché l'importance que lui donne le philosophe français. Si je comprends bien la pensée de Descartes; si la mémoire des choses matérielles, suivant lui, est autre chose que « cette mémoire qui, pour le joueur de luth, est en partie dans ses mains, » je dirai que la distinction établie par Aristote entre la mémoire et la réminiscence me semble plus considérable que celle de Descartes. L'âme ne change pas elle-même, parce que la faculté de mémoire dont elle est douée s'applique à un objet intellectuel, au lieu de s'appliquer à un objet sensible. Dans l'un et l'autre cas, l'état de l'esprit reste le même. Le sujet seul qui agit sur lui et qu'il conçoit est autre. Ainsi la différence posée par Descartes, toute vraie qu'elle est, n'est qu'extérieure à l'esprit. Celle d'Aristote, au contraire, tient à ce qu'il y a de plus profond dans l'âme. La réminiscence se distingue de la mémoire par l'intervention de la volonté, faculté suprême qui fait l'homme tout entier, et qui occupe la place souveraine dans la psychologie tout aussi bien que dans la morale. Aristote est donc allé plus loin que Descartes ; sa vue a été à la fois plus perçante et plus juste ; et c'est là un bien magnifique éloge pour qui sait tout ce que vaut le génie psychologique de Descartes, pour qui a tenté de le suivre dans ses délicates et fermes analyses. Dans l'école de Descartes, je ne vois aucune théorie de quelque importance sur la mémoire. On dirait que les disciples ont voulu imiter le laconisme du maître; et Malebranche qui, dans son grand ouvrage, pouvait trouver beaucoup à dire de cette faculté, s'en est à peine occupé. Il décrit la réminiscence sans la nommer : il parle des traces du cerveau qui sont pour lui ce que sont les vestiges pour Descartes. Puis il indique la faculté de la mémoire sans la caractériser nettement; et il s'en remet à la sagacité de son lecteur, «ne voulant pas expliquer ces choses plus au long, parce qu'il est plus à propos que chacun se les explique à soi-même par quelque effort d'esprit. » ( Recherche de la Vérité, liv. II, ch. v, § 3.) Peut-être MaIebranche n'a point fait ici les études qu'exigeait le plan même de son livre. Spinoza n'a dit que quelques mots de la mémoire; et, sans faire de théorie complète, il réduit la mémoire à l'association des idées, qui est fatale et qui résulte nécessairement pour l'homme des impressions que son corps a reçues. (De Mente, Propos. XVIII.) Si l'on devait attendre de quelque cartésien une théorie régulière sur la mémoire, c'était certainement d'un observateur tel que Locke. La nature même de son ouvrage semblait la lui imposer en quelque sorte. Mais Locke, quel que soit d'ailleurs son mérite, est en ceci presque aussi insuffisant que Malebranche. Il a consacré tout un chapitre à ce qu'il appelle la rétention (liv. II, ch. x ) ; et dans la rétention il distingue deux espèces, la contemplation et la mémoire. La distinction n'est pas fort exacte; car du moment que la perception actuelle a cessé, c'est la mémoire qui agit, quelque limité qu'on suppose l'intervalle de temps écoulé. Locke eût beaucoup mieux fait d'accepter le langage ordinaire , et de ne point créer des divisions nouvelles qui sont à la fois et moins claires et moins vraies. Après quelques mots sur la contemplation, il passe à la mémoire: il la caractérise en traits qui doivent paraître bien vagues et bien indécis auprès de ceux qu'a gravés Aristote. Puis, désertant presque aussitôt la question essentielle, il se jette dans les questions secondaires qu'il développe avec trop de complaisance. 11 est bien vrai que l'attention, la répétition, le plaisir et la douleur servent à fixer les idées dans l'esprit; il est bien vrai que les idées s'effacent de la mémoire; que la mémoire peut avoir deux défauts: ou un entier oubli, ou une grande lenteur à rappeler les idées qu'elle a en dépôt. Mais ce ne sont là que des détails, et l'on pourrait presque dire, des curiosités, qui ne touchent pas au fond même du sujet, et dont Locke a donné le trop facile exemple à ses successeurs. Il a distingué aussi la réminiscence de la mémoire ; mais si l'on n'avait point présentes à la pensée les différences profondes qu'Aristote a creusées entre les deux, il serait à peu près impossible de comprendre nettement ce que Locke en a dit. Locke, en sa qualité de médecin, ne pouvait manquer de reconnaître l'influence du corps sur la mémoire. Mais, en ceci même, il est fort loin du philosophe grec : il hésite dans ses affirmations, bien que les faits soient évidents et mille fois observés. Il trouve seulement « probable que la constitution du corps a quelquefois de l'influence sur la mémoire. » Enfin Locke pense que les animaux ont de la mémoire ; et, sans faire aucun discernement , il va presque jusqu'à dire que cette faculté est identique en eux et dans l'homme. Il est à peine besoin de faire remarquer combien cette théorie de Locke est incomplète; mais une chose non moins étrange, c'est que Leibnitz, son antagoniste et son illustre commentateur, ait été aussi concis que lui, et qu'il n'ait donné que quelques lignes à la critique d'un chapitre où l'auteur avait été si loin de remplir la tâche qu'il s'était donnée. En arrivant à l'école écossaise, on pourrait espérer des théories plus satisfaisantes. L'exactitude , la clarté des psychologues écossais sont assez connues ; et la faculté de la mémoire est tellement importante, parmi celles dont est doué l'esprit humain, qu'elle semble mériter, au moins autant que toute autre, l'analyse la plus étendue et la plus attentive. Reid et Dugald Stewart s'en sont occupés tous les deux ; mais, bien que fort supérieurs à Locke, ils suivent ses exemples, et n'ont pas tenu certainement tout ce qu'on pouvait espérer d'eux. Reid a consacré l'un de ses Essais tout entier (le troisième, traduction de Jouffroy, t. IV, p. 51) à la mémoire ; il le divise en sept chapitres. Il intitule le premier chapitre : « Faits incontestables sur la mémoire; » et il débute par une définition. Mais cette définition est si peu un fait incontestable, que M. W. Hamilton l'a complètement réfutée en prouvant que définir la mémoire : «. la connaissance immédiate du passé, » c'était faire une contradiction manifeste, même dans les termes. (Fragments de philosophie, traduits par M. Peisse, p. 70.) A cette exception près, les faits signalés par Reid sont parfaitement exacts. Mais Reid ne s'aperçoit pas que ce sont ceux-là même qu'Aristote a signalés deux mille ans avant lui. C'est ainsi que Reid constate: 1° que la mémoire diffère de la sensation ; 2° que son objet est nécessairement une chose passée et qu'elle ne s'adresse ni au présent, ni à l'avenir; 3° que la mémoire est toujours accompagnée de la croyance à l'existence passée de la chose rappelée; 4° qu'il faut que l'esprit soit troublé pour confondre les souvenirs et les pures imaginations; 5° enfin Reid indique, sans y insister autant qu'Aristote, l'intervention de la notion du temps dans l'acte de la mémoire. Mais il tire de ce dernier fait deux conséquences fort graves, que l'analyse de son prédécesseur n'avait point aperçues : c'est que la mémoire est la faculté qui nous donne la notion de durée et la notion de notre identité personnelle. Reid poursuit et essaye de prouver, dans le second chapitre, que la mémoire est une faculté primitive, inexplicable comme toute autre, et qui ne nous en inspire pas moins une foi aveugle en sa véracité. Il est bien vrai que la mémoire est une sorte de mystère impénétrable ; mais le psychologue écossais n'a pas su nettement montrer en quoi le mystère consiste. Aristote l'avait au contraire mis en pleine lumière ; il n'y a de présent à la pensée que sa propre modification. Comment ce phénomène présent à l'esprit peut- il nous rappeler un objet passé? Telle est la véritable question, la question obscure; et si Reid, malgré la fermeté et la justesse habituelle de son coup d'œil, ne l'a pas assez directement abordée, c'est qu'il est aveuglé par une sorte de préjugé systématique. Il a combattu et détruit l'hypothèse des idées représentatives, et c'est là sa gloire. Mais il a un tel éloignement des mots mêmes qui expriment cette théorie, il a une telle crainte de voir renaître la chimère qu'il a renversée, qu'il ne veut pas reconnaître la nature toute représentative de la mémoire. Aristote, qui n'a point les mêmes scrupules, compare le fait de mémoire à une peinture ; et il a raison dans le sens où nous l'avons expliqué plus haut. M. Hamilton, qui, sur ce point, est plus péripatéticien qu'Ecossais, n'hésite pas à dire que la mémoire, aussi bien que l'imagination, est une faculté de connaissance représentative. Ceci est d'une vérité irréfutable. Il n'est pas nécessaire de suivre Reid dans les quatre chapitres qui viennent après les deux premiers ; il y traite de la durée et de l'identité personnelle, notions qu'il rattache à la mémoire ; et il réfute, avec plus ou moins de succès, les explications de Locke sur ces deux points importants. (Voir M. Cousin, Histoire de la Philosophie moderne, t. IV, p. 438etsuiv.) Dans le dernier chapitre, Reid expose à sa manière les théories antérieures sur la mémoire. Il y parle des anciens avec une légèreté qui est le défaut général de son siècle, bien plus qu'un défaut personnel. Il cite les théories des péripatéticiens ; et, au lieu de les demander au traité spécial qu'a fait Aristote, il va les chercher dans Alexandre d'Aphrodise, qu'il ne consulte même pas directement, et qu'il entrevoit au travers de l'Hermès de Harris. Reid rappelle, en outre, l'observation très-vraie d'Aristote sur la langueur de la mémoire chez les enfants et les vieillards; et, prêtant au philosophe des assertions qu'il n'a jamais avancées sur les rapports du cerveau à cette faculté spéciale, il essaye de prouver que le système des idées représentatives n'explique pas plus la mémoire qu'il n'explique la perception. Puis, après une réfutation assez confuse des opinions de Locke et de Hume, Reid croit devoir rappeler la distinction qu'Aristote a faite entre la mémoire et la réminiscence. Il rend toute justice à cette distinction, qui lui paraît fondée sur les faits ; et, comme Aristote aussi, il croit que les animaux ont la mémoire, mais n'ont pas la réminiscence. Aristote avait donné de cette différence des raisons très-profondes, que le philosophe écossais aurait pu reproduire. Voilà tout ce qu'on trouve dans Reid sur la mémoire; et l'on peut voir que pour cette faculté proprement dite, ses travaux n'ont pas dépassé ceux d'Aristote, qu'il a connus, mais qu'évidemment il n'a point appréciés. Dugald Stewart donne à la mémoire tout un long chapitre, dans son grand ouvrage qu'il a dédié à Reid ; mais les théories du disciple sont moins complètes encore que celles du maître, et son érudition encore plus faible. Après quelques remarques qu'il trouve lui-même un peu subtiles sur les diverses acceptions du mot Mémoire, il divise la mémoire selon qu'elle est spontanée ou volontaire. Cette seconde espèce de mémoire est la réminiscence; mais comme Stewart ne semble pas connaître Aristote, ni se rappeler les travaux de son propre maître, il crée un mot nouveau pour désigner la réminiscence, et il l'appelle recollection. (Eléments de la philosophie de l'esprit humain, troisième édition anglaise, 1808, p. 404.) Il essaye ensuite de distinguer la mémoire des choses et la mémoire des événements ; et, méconnaissant l'essence même de cette faculté, il croit que, dans le premier cas, elle peut n'être point accompagnée de la notion du temps, qui lui paraît nécessaire dans le second. C'est une erreur manifeste. La notion du temps n'est pas moins impliquée dans l'un que dans l'autre; seulement elle est confuse et indistincte dans l'un, tandis que dans l'autre elle est positive et précise. C'est que Stewart ne se pose pas non plus le problème mystérieux que la mémoire soulève, et ne se demande pas plus clairement que ne l'a fait Reid, comment une modification de l'esprit, seule actuellement présente dans la conscience, peut nous donner la notion d'un objet absent et passé. Stewart compare ensuite les rapports que la mémoire établit entre les diverses distances de temps, aux rapports que notre œil établit entre les distances de lieu ; il trouve cette observation fort neuve, ne sachant pas qu'Aristote l'a faite. Puis croyant avoir assez expliqué la nature de la mémoire, il passe aux questions accessoires, et se demande ce qui fait que la mémoire retient certaines choses plutôt que certaines autres, et en quoi elle diffère de l'association des idées. Il forme le vœu que les médecins s'occupent avec plus de soin de l'influence que l'âge ou les maladies exercent sur la mémoire; et il cite un fait assez remarquable observé par lui-même sur un vieillard de sa connaissance, qui avait su combattre par de très-ingénieux moyens les atteintes que les années portent ordinairement à cette faculté. Quant aux théories précédentes, Stewart condamne en une phrase toutes celles qui expliquent la mémoire par des traces ou des impressions sur le sensorium ; et il les déclare trop peu philosophiques pour mériter une réfutation. Il est vrai qu'il cite pour tout spécimen de ces théories celle de Malebranche, la seule qu'il semble connaître. Cette condamnation, un peu dédaigneuse, peut être juste contre Malebranche. Mais Stewart connaît l'histoire beaucoup moins encore que Reid, son maître. Il se contente, du reste, de cette analyse qu'il vient de donner, tout imparfaite qu'elle est, pour une faculté qu'il déclare cependant l'une des plus importantes et des plus claires de toutes celles que possède l'intelligence humaine. Les autres parties du chapitre traitent successivement des variétés de la mémoire dans les différents individus; de la culture de la mémoire propre à accroître ses forces, soif par l'ordre philosophique qu'on introduit dans les idées, soit même par des moyens matériels tels que l'écriture, et toute espèce de moyens artificiels; et enfin des rapports de la mémoire au génie philosophique, sujets sans nul doute intéressants, et sur lesquels Stewart donne d'utiles conseils, mais qui figureraient bien plutôt dans un ouvrage d'éducation que dans un système de psychologie. Ainsi l'école écossaise, à mesure qu'elle se développe, amoindrit ses théories sur la mémoire, loin de les compléter; son érudition, faible dans Reid, est à peu près nulle dans son successeur. Elle néglige les vraies questions pour se jeter dans des recherches purement curieuses ; et elle méconnaît le passé qui pouvait lui tant apprendre. Ce n'est que de nos jours que, par les efforts de M. William Hamilton, elle est revenue à l'étude féconde de l'histoire, que près d'un siècle auparavant lui recommandait Adam Smith. Dans l'excellente édition que M. Hamilton vient de donner des œuvres complètes de Reid, il a traduit, avec les plus précieux commentaires, toute la théorie d'Aristote sur la réminiscence; et il l'a rapprochée de ce que Reid avait dit sur l'association des idées. J'omets Brown, l'infidèle héritier des doctrines écossaises; il n'a rien de nouveau que la prétention mal soutenue de ne point faire de la mémoire une faculté spéciale et distincte. De l'école écossaise nous aurions voulu passer à la philosophie allemande; mais les travaux de nos voisins, qui peut-être ont été féconds à d'autres égards, sont à peu près stériles en psychologie. On ne s'étonnera donc pas de ne point y trouver de théorie importante sur la mémoire. C'est là un ordre des recherches que dédaigne le génie aventureux des penseurs allemands, et sans lesquelles» cependant il n'y a pas de philosophie exacte et utile. La cause de la psychologie est peu en faveur de l'autre côté du Rhin ; et les chutes successives de quatre ou cinq systèmes illustres, tomhant les uns sur les autres en moins de quarante ans, n'ont pu instruire encore les esprits et les ramener à la vraie méthode. Voilà donc toute une branche de la science, et la plus importante, sur laquelle l'Allemagne n'a point d'avis; et ce serait bien en vain que l'histoire voudrait l'interroger. Je ne parle pas de la philosophie française ; elle s'est beaucoup occupée de psychologie, et avec une immense utilité ; mais je ne vo1s rien qui, jusqu'ici, ait fait avancer la question spéciale qui nous intéresse, si ce n'est peut-être les analyses de M. Royer-Collard, sur la notion de durée. (Œuvres de Reid, trad. de M. Jouffroy, t. IV, p. 347 et suiv.) De cette courte revue du passé, nous pouvons donc tirer cette double conséquence : Qu'Aristote a, le premier, étudié scientifiquement la faculté de la mémoire; Et que ses travaux peuvent encore aujourd'hui, après plus de vingt-deux siècles, sembler les plus complets et les plus exacts. Ce sont là des faits irrécusables que nous atteste l'histoire de la philosophie; plus tard, nous en ferons sentir la haute importance ; pour le moment il suffît de les constater. Aristote demeure, pour cette théorie spéciale, le maître de tous les psychologues. Voilà ce qu'il convenait de dire sur le petit Traité de la Mémoire et de la Réminiscence. Passons au Traité de la Respiration. En physiologie, Aristote nous paraîtra moins complet, sans doute; mais il ne sera guère moins grand. Il n'aura pas connu tous les faits de détail qu'une analyse prolongée et plus vaste aura fournis à ses successeurs et spécialement à la science contemporaine; mais aucun des points essentiels de la question ne lui aura échappé, et il aura la gloire d'en avoir vu le premier toute la portée, fixé les limites, et indiqué nettement la méthode. Aristote passe d'abord en revue les travaux antérieurs, et il prend des opinions de ses devanciers un souci que de nos jours on dédaigne, bien qu'à tort, de prendre des siennes. Les physiologistes contemporains se font presque gloire d'ignorer, tout érudits qu'ils se croient, le passé de leur science. Aristote, qui peut-être avait plus de droit à exercer cette hautaine négligence, s'en est bien gardé; et la postérité reconnaissante l'en doit remercier. Il critique donc les théories de ses prédécesseurs, et il s'attache plus particulièrement à Démocrite, Anaxagore, Empédocle, Platon. Ce qu'il leur reproche à tous, c'est de n'avoir point suffisamment observé, et d'avoir hasardé des explications qui ne s'accordent point avec les phénomènes. C'est donc aux phénomènes seuls qu'il s'adressera lui-même, pour connaître et comprendre la nature. En suivant cette méthode, il distingue trois espèces de respirations : celle des insectes, celle des poissons, et celle des animaux supérieurs, ou, comme nous dirions, des mammifères. Les insectes respirent par le contact seul de l'air ambiant, qui vient les toucher sous le corselet (03). Les poissons respirent par les branchies, et reçoivent l'eau et non pas l'air directement; enfin les mammifères respirent par les poumons, et reçoivent l'air dans leur intérieur, où il subit certaines modifications. Tel est, dans sa plus grande généralité, le mécanisme de la fonction. Tous les philosophes qui avaient précédé Aristote ne l'avaient pas comprise dans son ensemble ; et quelques-uns s'étaient bornés à l'étudier soit dans l'homme, soit dans les poissons; aucun ne l'avait étudiée dans la série totale des êtres à qui la nature l'a donnée. Un autre reproche est adressé par Aristote aux naturalistes de son temps; et ce reproche pourrait, jusqu'à un certain point, s'adresser aux naturalistes du nôtre, qui, quelquefois même, sont tout fiers de le mériter. Dans quel but la nature a-t-elle accordé la respiration aux animaux ? C'est ce que les philosophes qui avaient traité cette question n'ont pas assez recherché, si l'on en croit Aristote. Anaxagore, Diogène (d'Apollonie), Empédocle, Démocrite même ont négligé ce point essentiel. Pour sa part, Aristote ne l'oubliera pas; et la solution qu'il donne a dû paraître dans son siècle, et longtemps encore après, aussi vraie qu'ingénieuse. La respiration n'a pour but que de refroidir la chaleur naturelle, indispensable dans tout animal à l'entretien de la vie, et qui, sans un élément extérieur propre à la tempérer, serait bientôt éteinte parce qu'elle se consumerait elle-même. Cette solution du problème n'était peut-être pas aussi neuve qu'Aristote semble le croire ; car elle est exposée dans le Timée de Platon, qu'il a critiqué tout en lui empruntant cette théorie fondamentale ; mais Aristote se l'est rendue propre par les développements dont il a su l'entourer et la soutenir. C'est même cette confusion des deux phénomènes du refroidissement et de la respiration, qui a fait qu'Aristote a pu bien comprendre la fonction dans toute son étendue ; et que, malgré une contradiction apparente, il a pu éviter une grave erreur, tout en paraissant la commettre. Selon lui, tous les animaux ne respirent pas; mais tous ont besoin d'être refroidis. De là vient que, sans connaître peut-être les organes qui chez les insectes constituent la respiration, il n'a point hésité à dire que l'air ambiant suffit à les refroidir en pénétrant sous leur corselet. Cette vue générale et toute rationnelle, Aristote l'emprunte au principe des causes finales, qui n'a jamais eu de partisan ni plus décidé que lui, ni plus circonspect. Elle lui permet de réunir, sous une seule explication, des phénomènes nombreux et importants : la naissance, la vie et la mort, la jeunesse et la vieillesse. Selon Aristote, la naissance est le premier conflit de l'âme nutritive avec la chaleur naturelle, entretenue par le refroidissement ; la vie, c'est la continuité de ce conflit ; la jeunesse, c'est le développement et l'énergie des organes par lesquels le refroidissement a lieu ; la vieillesse en est, au contraire, l'affaiblissement; la mort, enfin, en est l'impuissance. On peut contester la justesse de cette théorie; mais elle a du moins le grand avantage d'être à la fois claire et systématique. Elle est aussi large qu'intelligible. La loi qu'elle établit est à peu près aussi générale qu'elle peut l'être; et la physiologie de notre temps n'a pas toujours su tirer, des matériaux presque innombrables qu'elle a rassemblés, des conclusions aussi nettes et aussi vastes. Tels sont les principaux traits de la théorie d'Aristote sur la respiration. Il est à peine besoin de dire qu'il l'appuie sur des observations nombreuses d'anatomie et de physiologie comparées, et qu'il en fait sortir une foule de conséquences de détail qui sont pleines d'intérêt. L'organisation de la respiration se complique et se perfectionne à mesure que l'animal lui- même s'élève dans l'échelle des êtres; et c'est dans l'homme que cette fonction est à la fois la plus complète et la plus admirable. De plus, il existe des relations constantes et nécessaires entre l'organisation des êtres et le milieu où la nature les a placés. Les uns ont des branchies parce qu'ils vivent dans l'eau et la doivent respirer ; les autres ont des poumons parce qu'ils doivent vivre dans l'air ; et la nature, qui ne fait jamais double emploi, de même que jamais elle ne fait rien en vain, n'a réuni dans aucun animal les branchies et les poumons, quoiqu'elle ait su organiser des amphibies. On pourrait citer bien d'autres considérations du même genre, qui rendent le traité d'Aristote sur la respiration, l'un des plus curieux de son immense encyclopédie. Pour voir les progrès que depuis cette première tentative la physiologie comparée a pu faire, interrogeons deux de ses représentants les plus illustres dans notre siècle, MM. Burdach et Muller. Cet examen pourra nous convaincre que si le physiologiste ancien a su moins de détails que ses doctes héritiers, il a compris tout aussi bien qu'eux les principes vraiment importants de la question. M. Burdach compare d'abord la respiration et la digestion; la première achève ce que la seconde avait commencé, remarque qu'Aristote avait déjà faite, bien qu'il l'eût présentée sous une autre forme. M. Burdach reconnaît ensuite que la respiration n'étant qu'un conflit de l'organisme avec le milieu extérieur, ses formes fondamentales se rapportent, les unes à la nature du milieu agissant, et les autres à l'espèce de substance organique avec laquelle ce milieu entre en conflit. Il y a deux milieux où la respiration peut s'exercer, l'eau et l'air ; et ses deux formes principales sont, ou le contact du milieu avec le corps entier de l'animal, ou le contact avec le sang seulement. Les moyens par lesquels la respiration s'accomplit consistent en dispositions organiques et en mouvements. M. Burdach étudie donc en premier lieu les organes de la respiration, tant ceux qui partent de la peau, comme dans les insectes et les animaux inférieurs, que ceux qui partent du canal digestif et appartiennent aux échelons supérieurs de la vie animale, depuis les holothuries jusqu'aux mammifères. Puis il considère le mouvement respiratoire; et introduisant dans la physiologie les divisions célèbres que Kant avait admises dans sa métaphysique à toute autre intention, M. Burdach explique successivement la qualité, la modalité, la quantité et les relations du mouvement respiratoire. Ces catégories, que la Critique de la Raison pure n'a pu faire accepter à la philosophie, n'ont pas été davantage reçues en physiologie; et loin d'aider à l'exposition de la science, elles ne peuvent guère que la gêner et l'obscurcir. Du mouvement respiratoire, le physiologiste allemand passe aux phénomènes chimiques de la respiration ; et il montre en grand détail les modifications que subissent l'air et le sang dans l'échange de matériaux que cette fonction établit entre eux. C'est là une partie de la physiologie moderne, qui n'a pas d'analogue dans les travaux de l'antiquité; on le comprend sans peine puisque la chimie seule a rendu ces recherches possibles. M. Burdach consacre ensuite un long chapitre à examiner les rapports de la respiration avec la vie ; ces rapports sont ou généraux selon la nature des gaz respirés et selon le besoin plus ou moins énergique de respiration, ou spéciaux selon les connexions intimes des organes avec l'action cérébrale, avec le mouvement volontaire, avec la circulation, avec la nutrition, et avec les appareils sécrétoires. Enfin, dans un chapitre sur l'essence de la respiration, M. Burdach s'attache surtout à expliquer le double mouvement que la respiration présente, c'est-à-dire le rythme de l'inspiration et de l'expiration, phénomène méconnu par quelques philosophes dans l'antiquité et sur lequel Aristote avait insisté beaucoup. Voilà les travaux de M. Burdach dans leur ensemble. Ceux de M. Muller sont presque identiques par le caractère des recherches et par leurs résultats. M. Muller traite d'abord de la respiration en général; mais au lieu de donner les explications que ce titre suppose, l'auteur ne s'occupe guère que des gaz qui peuvent favoriser ou gêner la respiration, sujet fort intéressant, mais qui ne fait pas assez comprendre la respiration en elle-même, et le rôle qu'elle joue dans l'organisation animale. Pour suppléer sans doute à cette lacune, l'auteur dresse dans une note la liste des plus importants travaux qui ont été faits sur la respiration ; mais sa nomenclature ne commence qu'avec Godwin, en 1788. Il n'a pas dit un mot de ceux de l'antiquité. Aristote est passé sous silence, comme si le Traité de la Respiration, origine de la science, n'existait pas ou était sans valeur. Après ces considérations préliminaires, M. Muller décrit l'appareil respiratoire, et il distingue trois formes principales : le poumon, les branchies, et le système trachéal des insectes ou les stigmates ; quelques animaux des classes inférieures semblent respirer par la peau entière. L'auteur explique successivement ces formes diverses de l'appareil, et leurs variétés presque inf1nies, en citant une foule de faits empruntés à tous les ordres d'êtres animés. En traitant ensuite de la respiration de l'homme et des animaux, M. Muller s'est occupé à peu près uniquement des modifications chimiques que l'air subit, soit que la fonction s'accomplisse dans l'air, soit qu'elle s'accomplisse dans l'eau. Dans les recherches de cette espèce, il semble que M. Muller soit allé plus loin que personne , et il les étend à la respiration des œufs d'animaux, depuis les embryons des batraciens jusqu'à l'œuf humain. Il les continue encore, en étudiant les changements que le sang éprouve, soit dans les veines, soit dans les artères, les métamorphoses que subissent les matières animales , et les rapports de la respiration avec la nutrition, sujet dejà traité par Aristote; et M. Muller conclut que l'essence de la respiration, son but final « c'est d'exercer sur les combinaisons organiques, par l'influence de l'oxygène, une action qui les mette dans l'état où elles manifestent leurs forces propres. » Enfin, dans un dernier chapitre, M. Muller a traité des mouvements respiratoires, et de l'influence des nerfs sur la respiration proprement dite, et sur quelques phénomènes sympathiques qui s'y rattachent, la toux, l'éternuement, le bâillement, etc. Il serait inutile de pousser plus loin cette revue de la physiologie contemporaine; les deux physiologistes allemands ont porté la science aussi loin que qui que ce soit, à ce qu'il semble. Leur exemple suffît pour nous instruire. Il nous montre clairement ce qu'on a fait depuis Aristote, et la place considérable qu'il occupe dans le développement de la science. Je ne nie pas que dans l'état où la science est arrivée de nos jours, elle ne présente une masse de faits beaucoup plus considérable; mais je ne crois pas lui faire tort en affirmant que ces faits, si l'on en excepte ceux qui se rapportent à la chimie, sont absolument du même ordre que ceux qu'avait recueillis Aristote pour en faire labhase de sa théorie. Lui aussi a parcouru, autant qu'il lui était donné de le faire sans le secours du microscope, et dans un temps où les observateurs étaient aussi rares que peu instruits, la série entière du règne animal. Il a interrogé la nature et lui a demandé les divers procédés qu'elle emploie pour arriver à une même fin ; il a interrogé les travaux de ses devanciers pour en profiter. Sans doute bien des animaux, et par conséquent bien des variétés d'organismes, lui ont échappé : les uns, il ne pouvait pas les apercevoir ; les autres, habitant des régions éloignées, n'avaient point été observés par des naturalistes dont il pût employer les analyses. Mais Aristote n'en a pas moins suivi la méthode que suivent encore aujourd'hui ses successeurs et ses héritiers. C'est lui, de plus, qui l'a pratiquée le premier; et c'est un avantage qu'il a sur eux. Entre ses mains, cette méthode a si bien produit tout ce qu'elle pouvait produire, que depuis lors les limites mêmes de la science sont restées ce qu'il les avait faites. Les trois formes principales de la respiration, ou plutôt, comme il dirait du refroidissement, sont les trois seules qui existent dans la réalité; il a su les observer et les décrire. On pourra les observer et les décrire avec plus de détails que lui. Mais on ne pourra franchir les bornes qu'il assignait à la question, parce que c'est la nature même, quand elle est bien comprise, qui les impose à la science humaine. Sans savoir directement ce que pense la physiologie moderne de l'idée du refroidissement, puisqu'elle n'a pas discuté les théories d'Aris- tote, on peut assez aisément le supposer en voyant qu'elle fait de la respiration une véritable combustion, qu'alimente sans cesse l'oxygène de l'air. C'est là une théorie absolument contraire, ce semble, à celle d'Aristote, qui fait de la respiration une sorte de refroidissement. Je ne discute point la supériorité de l'une de ces théories sur l'autre. Mais on peut remarquer, qu'à certains égards, l'idée du refroidissement est à la fois plus profonde et plus juste que la simple idée de la respiration. La respiration n'est qu'un fait, quelles que soient les variétés innombrables sous lesquelles le mécanisme s'en opère. Evidemment, ce n'est que par métaphore, qu'on peut dire des insectes et d'animaux encore plus has qu'eux, qu'ils respirent, comme on le dit des animaux supérieurs munis de poumons ou de branchies; évidemment c'est pousser très-loin l'assimilation des phénomènes entre eux, que d'appeler indifféremment du nom d'organes respiratoires, les cils de certains infusoires microscopiques, et les réseaux cellulaires dont l'admirable développement forme les poumons des mammifères. Il paraît difficile de réunir sous une même notion des faits qui matériellement ont une apparence si diverse. Au contraire, cette unité devient aussi facile qu'elle est claire, du moment qu'au lieu de se rapporter aux faits, elle se rapporte à leur cause ; et que la notion est purement rationnelle au lieu d'être sensible. Le refroidissement de la chaleur naturelle, nécessaire à la conservation de la vie, voilà l'idée qu'Aristote se faisait du but de la respiration. C'est là une vue de l'esprit, allant au delà des faits pour les comprendre, et ayant le grand avantage d'être parfaitement intelligible, parce qu'elle ne vient que de l'intelligence seule, et dépasse l'observation. Il est vrai que cet avantage, qu'apprécie beaucoup la philosophie, paraît au contraire un inconvénient et un danger à la plupart des naturalistes. A leurs yeux cette théorie aurait le grand tort d'assigner une cause aux phénomènes, et, qui pis est, une cause finale. La science moderne veut bien constater des faits, les accumuler en nombre de plus en plus considérable ; mais elle craint en général d'en rechercher la cause, c'est-à-dire le véritable sens. Elle se résigne en quelque sorte à satisfaire la curiosité de l'esprit, sans aller jusqu'à satisfaire la raison. Ainsi MM. Burdach et Muller nous ont dit avec une science prodigieuse toutes les variétés de l'appareil respiratoire dans ses plus minces détails ; mais ils ne nous ont pas appris à quoi la respiration servait dans l'organisation de l'animal, ou tout au plus se sont-ils risqués à dire qu'elle contribuait à conserver la vie. Il est vrai que d'autres physiologistes ont été moins scrupuleux, et qu'ils n'ont pas hésité à soutenir que la vie était entretenue par la chaleur que la respiration développe en brûlant de l'oxygène dans les poumons. La science antique avait tenté aussi d'aller jusqu'à l'explication du phénomène. Elle aussi a voulu comprendre comment la nature conserve la vie de l'animal par la respiration, et elle a prétendu que c'est en le refroidissant. Selon toute apparence, cette solution n'est pas vraie. Mais je dis que la science antique a bien fait d'en chercher une ; et que si le physiologiste doit se borner à observer exactement des phénomènes, le philosophe a le devoir de les expliquer, en les rattachant à l'ensemble des choses que la philosophie seule essaye de comprendre. Quoi qu'il en puisse être de cette question délicate et controversable, un avantage évident qu'Aristote a sur les deux physiologistes allemands, c'est la clarté incomparable avec laquelle il expose ses théories. Le Traité de la Respiration, si l'on en excepte les deux ou trois derniers chapitres, qui sont peut-être interpolés, est un chef-d'œuvre de composition. D'abord l'histoire de la science ; puis la science elle-même, développée avec un ordre et une régularité irréprochables, dans trois ou quatre idées fondamentales : nécessité de la chaleur pour que la vie puisse subsister, nécessité d'un refroidissement périodique pour que la chaleur subsiste, division des principales espèces de respiration, et description des appareils dans les différents êtres, insectes, poissons, cétacés, mammifères; enfin, relation de la respiration avec les grands phénomènes de la vie et de la mort, de la naissance, de la jeunesse, et de la vieillesse. Je n'insisterais pas sur ces mérites de la forme, s'ils ne révélaient une connaissance profonde des faits. Ce n'est que quand on sait voir de haut les vrais rapports des choses qu'on peut les mettre en une si pleine lumière. On pourrait croire que cette supériorité d'Aristote sur les physiologistes tient aux habitudes philosophiques de son esprit, et qu'il a puisé dans une science plus générale les règles et les procédés qu'il applique à l'exposition d'une science particulière. Ceci est vrai sans doute en partie; mais on doit ajouter qu'en ceci Aristote n'est pas moins supérieur aux philosophes ordinaires qu'il ne l'est aux physiologistes. On a pu voir par la courte analyse qui a été faite plus haut du Traité de la Mémoire et de la Réminiscence que, par la forme, non moins que par les idées, cette étude surpassait tout ce qui avait été fait depuis Aristote. Reid, Dugald Stewart, tout aussi bien que Locke, nous ont paru très-loin de leur modèle pour le style, comme ils l'étaient pour les faits observés et analysés par lui. C'est qu'il faut se rappeler qu'Aristote n'est pas seulement un philosophe et un penseur, mais qu'il est aussi l'auteur de la Rhétorique et de la Poétique. Il ne s'est pas contenté d'étudier et de connaître le raisonnement humain dans ses lois essentielles et nécessaires; à la théorie du syllogisme et de la démonstration, il a joint des recherches en apparence plus légères, mais également utiles. Le style n'a pas eu plus de secrets pour lui que l'intelligence même. Aristote n'est point un artiste à la manière de Platon; il n'a ni sa liberté ni sa grâce inimitables ; il n'a pas même autant que lui le pouvoir d'éclairer et de convaincre les esprits. Mais ses mérites, pour être moins brillants, n'en sont pas moins réels. L'ordre et la régularité n'ont jamais été portés plus loin ; et c'est l'ordre qui fait la véritable et solide clarté dans les sciences plus encore que dans la philosophie. C'est par là qu'Aristote mérita d'être, au moyen âge, le précepteur de l'esprit humain. La forme du péripatétisme a fait son triomphe et son utilité autant que ses doctrines. Cette forme est austère ; mais la science peut l'être : cette forme est impérieuse même, mais elle recouvre une pensée digne du commandement. Il ne faut pas s'étonner de la domination souveraine qu'Aristote a exercée si longtemps ; tout l'explique et la justifie. Son génie personnel n'a été inférieur à aucun autre; et les instruments qu'il a su se créer n'ont pas été moins puissants ni moins admirables que son génie. Avec de telles armes, il est tout simple qu'il ait vaincu à bien des égards, même sans avoir pour lui le bénéfice des siècles, tant de physiologistes, tant de psychologues, réduits aux seules ressources de leur science spéciale. Nous avons donc constaté, par les deux exemples que nous venons de citer, l'immense valeur des Opuscules. Il ne faudrait pas croire, il est vrai, que tous ces petits ouvrages, sans exception , soient aussi estimables que le Traite de la Mémoire et celui de la Respiration. Mais d'où vient le mérite de ces deux-là? Comment Aristote a-t-il pu à lui seul, et presque au début de la science, recueillir tant de faits exacts et précis ? Quel a été le secret de son génie pour faire tant de découvertes et conquérir tant de vérités ? Ce secret est bien simple; il est tout entier dans la méthode qu'Aristote a suivie. Nous avons dû, en examinant les doctrines du Traité de l'Ame, établir comme un fait incontestable, qu'Aristote n'avait point connu ni pratiqué cette ^méthode fondamentale qui remonte jusqu'à l'origine de la connaissance humaine, et qui découvre les bases sur lesquelles repose toute certitude. Cette méthode, nous l'avons trouvée dans Platon sous le nom équivoque de Dialectique, de même que nous la retrouvons, deux mille ans plus tard, sous son vrai nom, dans Descartes. La méthode, comprise en ce sens élevé et suprême, n'appartient pas au disciple de Platon ; et de là cette grave lacune du péripatétisme, qui a bien pu reconnaître l'unité dans l'univers, mais qui n'a pas su la comprendre dans l'esprit de l'homme, et qui n'a point rattaché à un centre commun la psychologie, la logique, la morale et la théodicée. Mais si la méthode philosophique manque au système d'Aristote, personne mieux que lui n'a compris et appliqué cette méthode secondaire qu'on appelle la méthode d'observation. Ceci peut sembler un paradoxe à ceux qui croient que la méthode d'observation est née vers le début du xviie siècle, à la voix de Bacon ou avec les exemples de Galilée. Pourtant ce paradoxe est une vérité, et c'est ce qu'il sera facile de prouver, sans même recourir à d'autres ouvrages d'Aristote que ceux qui forment les Opuscules. Mais, aux yeux de la philosophie, il ne suffit pas qu'on observe; il faut qu'on sache encore qu'on observe; en d'autres termes, il faut qu'on se rende compte de la méthode qu'on suit, et du but qu'on prétend atteindre en la suivant. Aristote n'a pas plus manqué à cette seconde condition qu'à la première. Empruntons d'abord au Traité sur le Principe général du Mouvement dans les Animaux une phrase capitale, qu'on pourrait croire écrite d'hier, tant elle résume avec précision et justesse le principe même de la méthode d'observation. Il n'est point de nos jours un savant qui puisse parler plus nettement; et jamais Bacon ne s'est exprimé en termes aussi positifs : « II ne suffit pas, dit Aristote, de poser un principe d'une manière universelle, à l'aide de la seule raison ; il faut encore en montrer l'application à tous les faits particuliers et aux faits observables, qui eux-mêmes doivent nous servir à fonder des théories générales, et avec lesquels ces théories doivent, selon nous, toujours s'accorder. » (Ch. i, § 3.) C'est donc des faits qu'il faut partir pour s'élever aux théories; puis, afin de vérifier la vérité du principe, une fois qu'il est admis, on doit voir s'il s'applique aux faits particuliers. Tel est le double mouvement de la méthode d'observation que Platon avait déjà signalé (Rép. vI, p. 62, et Phèdre, p. 97, trad. de M. Cousin), et que le génie de La place croyait le privilège de l'astronomie depuis les découvertes de Newton ( Exposition du Système du Monde , ch. 1 ). Cette méthode, la voilà tout entière dans Aristote, plus claire qu'elle n'est dans Platon, et tout aussi complète qu'elle peut l'être au xixe siècle. Mais Aristote ne s'est pas bonie à proclamer cet excellent principe : il l'applique, et il s'en sert d'abord pour critiquer les doctrines de ses devanciers, avant de s'en servir pour fonder les siennes. Si les philosophes qui ont avant lui essayé d'expliquer la respiration ont commis des erreurs, « c'est qu'ils n'ont pas suffisamment tenu compte des faits que fournit l'observation. » (Traité de la Respiration , ch. i, § 1.) Démocrite d'Abdère, Anaxagore, Diogène (d'Apollonie) et tant d'autres, n'ont pas compris pourquoi la respiration avait été donnée aux animaux : ils n'ont vu les choses qu'à moitié, prenant la respiration pour un fait simple, tandis qu'elle est complexe et qu'elle est formée de deux phénomènes connexes, mais distincts, l'inspiration et l'expiration. « S'ils n'ont pas expliqué convenablement tous ces faits, c'est qu'ils n'ont pas assez connu les organes intérieurs des animaux.... Si l'on avait observé la fonction de la respiration dans les organes qui l'accomplissent, comme les branchies et les poumons, on en eût bien vite reconnu la cause.» (ld., ch. m, §7.) Démocrite a voulu, en expliquant le phénomène de la mort, le rattacher à celui de la respiration ; mais sa théorie contredit des faits certains, et dès lors elle n'est pas acceptable. Si elle etait juste, il faudrait qu'on eût uu plus grand besoin de respirer quand il fait froid que dans la chaleur. « Or, c'est tout le contraire qui arrive.... Ce sont là des faits que nous sommes tous à même d'éprouver ; » et l'explication de Démocrite doit être rejetée au nom même de l'observation, (/rf., ch. 1v, § 7.) C'est encore au même titre qu'il faut repousser celle du Timée de Platon, qui suppose que la respiration est l'entrée de la chaleur en nous. « L'observation montre tout le contraire. L'air qu'on respire est chaud, celui qu'on inspire est froid; quand ce dernier air est chaud, on ne le respire qu'avec peine; et, en effet, par cela seul que l'air qui entre ne refroidit pas assez le corps, il faut tirer son haleine à plusieurs reprises. » (/rf. ch. v, § 6.) Empédocle n'a pas été plus fidèle à l'observation des phénomènes, quand il a cru que la respiration principale se faisait par les narines. Loin de là, les narines ne sont qu'une partie très-secondaire de l'appareil entier. (7rf., ch. vu, §6 et suiv.) L'explication qu'il a donnée des deux mouvements de l'inspiration et de l'expiration n'est pas plus exacte ; et il ne l'aurait point hasardée , toute poétique qu'il a su la faire, s'il eût remarqué que, dans l'inspiration, le corps se soulève, et, qu'au contraire, il se resserre et se comprime dans l'expiration. (id., ib.) Il serait très-facile de multiplier les citations de ce genre, sans sortir des Opuscules où elles sont très-nombreuses. Celles-ci suffisent pour montrer comment Aristote emploie l'observation à réfuter les erreurs de ses devanciers ; et ses propres travaux prouvent assez comment lui-même s'en sert pour découvrir la vérité. Dans ce petit Traité de la Respiration en particulier, il recommande avec insistance la pratique de l'anatomie, seul moyen de bien connaître les procédés de la nature et l'organisation des êtres. Pour sa part il a beaucoup disséqué} et l'on doit s'étonner que, dans des recherches aussi difficiles et aussi délicates, il se soit mépris si rarement. Voilà donc la méthode d'observation dans toute sa rigueur, et dès lors portant ses infaillibles résultats. Sans doute Aristote, tout en usant de cet admirable instrument, n'a pas connu tout ce que des siècles de travaux et d'application nous ont appris. Mais la voie qu'il suit est déjà la vraie. De plus, il le sait; et il appelle es autres à y marcher comme lui, soit par ses conseils, soit par son exemple. La méthode d'observation ne date donc pas du xvne siècle : elle n'est pas une conquête de l'esprit moderne, comme notre orgueil s'est plu trop souvent à le croire. Mais à cette première assertion qui peut nous surprendre, la vérité veut qu'on en ajoute une autre qui nous surprendra davantage encore. Jusqu'à un certain point, on accorderait bien, en présence des travaux d'un Hippocrate et d'un Aristote, et même dans un autre ordre de faits, d'un Platon, que l'antiquité a connu et pratiqué l'observation. Mais on lui refuse complètement, et à ce qu'il semble avec plus de raison, d'avoir compris l'art des expériences. L'expérimentation crée, suivant la volonté de l'homme et suivant les vues de son intelligence, des faits nouveaux : elle interroge la nature en multipliant les phénomènes : elle éclaircit les questions douteuses en posant des questions analogues, pour lesquelles elle est sûre d'avoir des réponses, là où les faits naturels restent muets et impénétrables. Les expériences sont un secours inépuisable que la science humaine s'est donné. Est-il vrai que l'antiquité n'ait point connu l'expérimentation? est-il vrai qu'elle n'ait pas su en faire usage? Ici les Opuscules pourront encore nous répondre aussi clairement qu'ils viennent de le faire pour la méthode d'observation. Dans le Traité de la Jeunesse et de la Vieillesse, Aristote veut prouver que de toutes les parties diverses dont se compose l'animal, celle qui renferme le principe nutritif, avec tous les appareils qui lui sont indispensables, est la plus importante. Quel moyen propose-t-il pour démontrer ce principe ? C'est de faire l'expérience suivante sur certains animaux qui la peuvent supporter : retranchez-leur la partie supérieure du corps et la partie inférieure, ces animaux vivront encore, parce qu'ils conserveront la partie nutritive, la seule par conséquent qui soit vraiment essentielle à la vie. (Traité de la Jeunesse, ch. ii, § 3.) Autre expérience dans le Traité de la Respiration (ch. 11, § 3). Anaxagore et Diogène d'Apollonie ont cru tous les deux, bien qu'à des points de vue différents, que les poissons respiraient l'air atmosphérique. Aristote trouve cette opinion erronée; et il la réfute en lui opposant d'abord des observations de faits qui la contredisent, et ensuite une expérience qui est décisive suivant lui. On a beau tenir les poissons sous l'eau aussi longtemps que l'on veut, ils ne laissent jamais échapper de bulles d'air, preuve certaine qu'ils n'ont en eux aucune parcelle d'air du dehors. Au contraire, les animaux qui respirent laissent échapper de l'air lorsqu'on les tient sous l'eau quelque temps ; et les bulles qui se forment alors à la surface du liquide viennent du poumon qui les renfermait. C'est là un phénomène que ne présenteront jamais les animaux aquatiques, de quelque manière que l'on s'y prenne pour le constater en eux. Veut-on se convaincre que dans certains êtres, le principe du mouvement est en quelque sorte multiple, au lieu d'être unique comme nous le voyons dans tous les autres, on n'a qu'à diviser ces êtres en un ou plusieurs morceaux ; on verra les divers tronçons se mouvoir encore et conserver même une sensibilité à peu près égale à celle de l'animal entier. (Traité de la Respiration, ch. xvii, § 5, et Traité de la Jeunesse, ch. u, § 9.) Le cœur est, suivant Aristote, le principe de la vie, de la sensibilité, du mouvement. C'est la pièce principale de l'animal ; du moins c'est le rôle qu'il joue dans les animaux les plus élevés. Mais, aux degrés inférieurs, l'animal peut s'en passer durant quelques instants ; et cette impulsion essentielle qui semblait ne pouvoir venir que du cœur, se continue sans lui, pour cesser bientôt, il est vrai, mais elle dure sans lui un temps encore assez long. Qu'on enlève, par exemple, le cœur des tortues : on les verra marcher et traîner leur carapace, à peu près comme si cet organe indispensable ne leur manquait pas. (Id., ib.} On pourra s'assurer aisément par cette expérience que, dans les organisations imparfaites, ce viscère n'a pas l'importance souveraine qu'il a dans les organisations supérieures. Je ne prétends pas que ces expériences soient fort remarquables. Quand on sait la place immense que tient aujourd'hui l'expérimentation dans les sciences naturelles, on doit trouver que ces premiers essais sont bien humbles et bien étroits. Mais je ne crois pas que devant ces faits et tant d'autres du même genre, on puisse nier que l'antiquité ait fait des expériences, tout aussi bien qu'elle a fait des observations. Les commencements en toutes choses sont le plus souvent très-faibles : les germes sont en général imperceptibles, quelques développements qu'ils prennent plus tard. L'expérimentation est à l'état de germe dans Aristote et dans les naturalistes anciens ; mais elle existe déjà pour eux : ils s'en servent rarement, si l'on veut, et avec peu d'adresse; mais ils l'emploient, et d'autres, qui venant après eux sauront la mieux employer, auront été instruits par leur exemple. L'expérimentation et l'observation n'ont donc pas plus manqué aux anciens qu'aux modernes; et quand on veut se rendre compte des facultés de notre intelligence, et des procédés nécessaires qui lui sont imposés par la nature des choses, on voit sans peine que l'esprit humain, contraint d'observer les faits par la loi même de sa constitution, est bien vite amené à trouver les voies nouvelles que l'expérimentation lui ouvre. Les premières observations, en s'accumulant, composent assez vite le trésor de la science, trésor bien pauvre au début, dont pourront sourire ensuite des héritiers plus opulents, mais qui n'en est pas moins la véritable source de leur fortune, et l'origine oubliée de leur richesse. L'expérimentation ne vient que plus tard : il faut que déjà la science soit assez avancée pour qu'elle songe à créer des faits, au lieu de les accepter tels que la nature les lui donne. Mais ce pas difficile pour l'intelligence humaine était déjà franchi au temps d'Aristote : les faits qui viennent d'être cités le prouvent évidemment. Tout incomplètes que sont ces expériences, toutes simples qu'on les puisse trouver, elles sont incontestables ; on peut les critiquer, mais on ne les détruira pas. S'il était besoin d'une nouvelle preuve pour mettre ceci hors de doute, il suffirait de se rappeler les progrès qu'avait faits la médecine antérieurement au siècle d'Aristote. Les œuvres d'Hippocrate sont parvenues jusqu'à nous, et nous pouvons juger en pleine connaissance de cause ce qu'étaient dès lors les admirables conquêtes de la science. La médecine est forcée, l'on peut dire, d'observer les faits. C'est la vie même de l'homme qu'elle doit défendre. Elle n'observe point pour satisfaire une curiosité, légitime, sans doute, mais parfois assez stérile; elle observe pour combattre et vaincre la maladie qui tue; et la guérison est au prix d'observations qui bien souvent doivent être aussi rapides qu'infaillibles. L'homme n'ayant pas d'intérêt plus cher que sa propre existence, il n'y a pas de science qui ait dû se constituer plus vite que la médecine sur les véritables hases de toute science, c'est-à-dire sur l'observation exacte des phénomènes. Il faut ajouter que tous les moyens que cette science emploie, et tous les remèdes qu'elle prescrit à ceux qu'elle soulage, sont à peu près autant d'expériences. Les influences innombrables de temps, de lieux, de climats, d'idiosyncrasies, etc., multiplient les faits pour la patiente et sagace analyse qui les interroge ; et ce n'est que par des expérimentations mille fois répétées que la science acquiert cette certitude qui la rend si utile, mais qui lui a tant coûté. « La vie est courte; l'art est long; l'occasion est fugitive; l'expérience, trompeuse; le jugement, difficile,» dit Hippocrate en ouvrant ses Aphorismes ; et ce profond axiome ; qui convient si bien à toutes les sciences humaines , c'était à la médecine la première qu'il appartenait de le promulguer; car c'est elle qui la première en a dû voir toute la justesse. Ainsi donc, ne nous étonnons pas de trouver dans Aristote la méthode d'observation, et même la méthode expérimentale ; il y avait déjà bien des siècles que la médecine les pratiquait l'une et l'autre ; et près de cent ans avant Aristote, Hippocrate en avait formulé les lois. C'était pour une science spéciale, il est vrai; mais il était facile de généraliser ces formules; et le génie d'Aristote, s'il a élargi le champ, n'a pas eu la gloire de le découvrir; la nécessité avait ouvert la route longtemps avant lui. 11 a pu donner d'illustres exemples; mais déjà lui- même pouvait en imiter. En psychologie, et par le Traité de la Mémoire et de la Réminiscence, Aristote nous a paru au-dessus de tous ses successeurs ; en physiologie, et pour le Traité de la Respiration, nous l'avons trouvé inférieur à certains égards, malgré d'immenses mérites. Dans ces deux ouvrages cependant, sa méthode est la même, et il semble que les résultats qu'elle lui donne devraient être de part et d'autre également heureux. D'où vient donc qu'ils sont si dissemblables? Ici une question à peu près épuisée; là un système que l'on doit compléter, malgré toutes les vérités qu'il renferme ; ici un édifice achevé et qui ne laisse plus rien à faire, même aux mains les plus habiles et les plus délicates; là au contraire un édifice qui, tout solide qu'il est dans ses fondements, a été cependant beaucoup accru et s'accroît encore tous les jours. Cette grave différence ne tient qu'à la différence même des matières. Les sciences morales et les sciences physiques ne procèdent point de la même façon, parce que les faits qui les constituent les unes et les autres ne se présentent pas non plus de la même façon à l'esprit humain. Pour la psychologie, l'homme porte en lui-même tous les phénomènes ; il n'a point à sortir de soi pour les connaître et les bien observer. On comprend donc qu'avec le secours d'un heureux génie, il soit possible à un seul observateur de découvrir et de constater tous les faits. C'est ce qu'Aristote a su faire pour l'étude de la mémoire; aucun des points essentiels de la question ne lui a échappé : il les a tous vus, parce qu'il lui suffisait de rentrer en lui-même pour les y trouver tous sans aucune exception. Ce genre d'observation réflexive a sans doute d'immenses difficultés, des difficultés toutes spéciales, que souvent les intelligences les mieux douées sont incapables de vaincre ; mais le champ, une fois qu'on y a pénétré, peut être parcouru par un effort individuel; le premier qui le cultive peut y faire la plus abondante récolte et ne laisser qu'à glaner pour ceux qui l'y suivent. Voilà comment Aristote a pu connaître si parfaitement ce qu'est la mémoire que Locke et Reid au xviiie siècle en ont su peut-être moins que lui. C'est encore ainsi qu'il a pu faire la logique tout entière d'un seul coup, et qu'il a mérité à deux mille ans de distance cette gloire singulière que le génie de Kant se soit retiré devant lui, sans vouloir ni le combattre, ni même le compléter. Dans les sciences naturelles il en est autrement. Pour elles, l'esprit ne porte point dans ses profondeurs les objets de son observation. Il faut que l'homme sorte de lui-même pour connaître la nature. La conscience n'a plus rien à faire sur un domaine qui n'est pas le sien ; c'est la sensibilité seule qui peut agir. Or, les faits dont l'ensemble et les rapports doivent constituer une science distincte, sont en général très nombreux et très dispersés. De plus, ils sont parfois très-subtils; et surtout quand il s'agit de l'organisation des êtres animés, l'analyse devient si délicate que les observateurs les plus attentifs et les plus intelligents risquent de s'y tromper. Nous n'avons qu'à voir où en sont encore de nos jours, malgré la perfection de nos instruments, les difficiles problèmes que soulève la structure intime des organes. Dans une étude comme la physiologie comparée, qui s'adresse à la généralité des êtres vivants, des faits nouveaux viennent presqu'à l'infini s'ajouter aux faits déjà recueillis. Le microscope a révélé un nombre considérable d'êtres et d'organismes dont la science avant ce puissant secours n'avait pas la moindre idée. Les découvertes mêmes de quelques sciences étrangères à la physiologie peuvent lui fournir des richesses inattendues. Les progrès de la géographie, par exemple, ont bouleversé bien des théories; les animaux bizarres que la Nouvelle-Hollande a offerts, il y a moins d'un siècle, à l'examen des naturalistes, n'ont pu rentrer dans les classifications admises jusque-là, et la physiologie a dû pour eux changer quelques-unes de ses lois. Ceci pourrait nous faire très-clairement comprendre comment la science s'est développée depuis l'antiquité jusqu'à nous. Mais il n'est même pas besoin de ces grandes et trop rares découvertes d'êtres inouïs ou de continents jusqu'alors inconnus ; il n'est pas besoin de l'invention d'instruments nouveaux, pour que la science se modifie et pour qu'elle avance. Il suffit que les êtres observés jusque-là le soient par un observateur, si ce n'est plus habile, du moins postérieur, pour que des faits inaperçus soient constatés. Il suffit que le nombre des observations s'accroisse, pour que ces observations soient à la fois plus sûres et plus profondes. C'est une mine inépuisable qui s'étend à mesure qu'on la creuse, et où l'on pénètre en passant dans les chemins frayés dès longtemps par de nombreux devanciers. Les sciences naturelles sont donc un dépôt transmis d'âge en âge, et qui s'enrichit par le nombre même des mains qui se le transmettent. Les sciences morales sont bien soumises à une loi analogue ; elles se développent aussi avec le temps; et la psychologie, par exemple, est de nos jours plus étendue et plus exacte qu'elle ne l'était au temps de Platon et d'Aristote. Mais dans les sciences morales, comme les observations sont plus individuelles, elles sont par cela même moins transmissibles ; et voilà comment l'on a pu si souvent opposer les merveilleux progrès des sciences naturelles à l'immobilité des sciences philosophiques. Pourtant cette immobilité n'est qu'apparente, comme devraient le prouver aux yeux les moins clairvoyants les progrès mêmes des sociétés humaines, et l'amélioration des lois qui les régissent. Pour les esprits éclairés et attentifs, les progrès des sciences morales sont tout aussi réels, tout aussi grands que ceux des sciences physiques. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il se peut en philosophie que, sur quelques points, la vérité soit tout d'abord si pleinement connue, que les siècles n'y puissent plus rien ajouter. Dans l'étude des objets extérieurs, dans l'étude de la nature, la vérité n'est presque jamais aussi définitive; et si elle s'accroît, c'est qu'apparemment elle n'est pas encore entière. Ainsi, Aristote a pu tout ensemble être aussi instruit que qui que ce soit sur une question de psychologie et, dans une question d'histoire naturelle, en savoir bien moins que n'en ont su les physiologistes postérieurs. Il a pu en appliquant à ces deux études le même génie, la même méthode, fonder pour l'une des théories in- ébranlables, et n'obtenir pour l'autre que des résultats incomplets. Il n'y a point en ceci de contradiction; c'est la loi même de l'esprit humain, qui tous les jours en apprend beaucoup sur la nature, et qui a pu, dès l'origine, connaître sur lui-même et sur sa destinée à peu près tout ce qu'il lui importe essentiellement d'en savoir. La méthode qu'a suivie Aristote n'en est pas moins la vraie; il a mis l'observation et l'expérience au service de l'intelligence. Il n'est pas donné à l'homme d'en faire davantage. Tout le progrès des siècles consiste à observer plus et à observer mieux, à imaginer des expériences nouvelles et plus décisives. Bacon avait donc raison quand, au milieu de ses attaques injustes et passionnées contre Aristote, il conseillait cependant de l'imiter : « Vous n'auriez pas ce grand homme, disait-il, si sa doctrine ne l'avait pas emporté sur celles des anciens ; et pourtant vous craignez de faire pour lui ce qu'il a fait pour l'antiquité. » (Redargutio philosophiarum.) Et Bacon conseillait d'en revenir à l'étude des choses avec une persévérante attention , surtout avec indépendance, et de s'en rapporter à l'autorité des faits bien plus qu'à l'autorité des auteurs. Mais ceci ne veut pas dire qu'il faille ignorer ni insulter le passé. Il faut au contraire l'étudier beaucoup, et à côté de cet inépuisable livre de la nature, toujours ouvert sous nos yeux, il est bon de feuilleter aussi les livres de ceux qui l'ont si bien interrogée avant nous. J'ai donc de la peine à comprendre l'oubli à peu près complet où les philosophes, et même les physiologistes, ont laissé des ouvrages aussi vrais et aussi utiles que ces deux traités dont nous venons de parler ; et je me demande si ce dédain injuste est bien profitable à l'esprit humain , et s'il lui fait grand honneur. Sans doute les physiologistes peuvent faire avancer leur science sans connaître les travaux de l'antiquité. Les sciences naturelles ont fait depuis deux siècles d'immenses progrès ; et pourtant elles ignorent en général leur passé, tout illustre que ce passé peut être. Le savant n'est pas obligé d'être érudit pour être utile. Il prend la science au point où il la trouve, sans s'inquiéter d'où elle vient ; tout ce qui le préoccupe, c'est de la porter un peu plus loin. On dirait que les sciences sont comme la monnaie, que chacun emploie, sans que personne songe à savoir qui l'avait avant lui et par quelles mains elle a circulé. En philosophie, il en a été trop souvent de même; et l'on sait de reste que depuis Bacon et Descartes les philosophes n'ont pas fait cas de l'érudition plus que les savants. Mais cette ignorance qui n'est pas sans inconvénient dans les sciences, est bien plus funeste et bien moins excusable en philosophie. Précisément parce que les sciences s'accroissent de siècle en siècle, et qu'elles valent surtout par le nombre des faits constatés, il semble assez naturel que le savant néglige ces antiques ouvrages où les faits sont de toute nécessité moins nombreux et les observations moins exactes, quelque régulière que soit la forme de ces ouvrages, et quelque parfaite que soit la méthode qui les a inspirés. S'il y jette parfois les yeux, c'est par curiosité plutôt que par besoin. En outre, le savant s'occupe peu de la forme sous laquelle il expose ses recherches et même ses théories. Il ne songe guère davantage à la méthode qu'il suit, s'en remettant pour elle au mouvement spontané de l'esprit, ou tout au plus s'appuyant sur quelques principes traditionnels et vulgaires qu'il n'a point approfondis. Que lui apprendraient donc des ouvrages comme ceux d'Aristote? MM. Burdach et Muller n'ont-ils pas très-bien traité de la respiration sans savoir ce que leur devancier en avait écrit? Ont-ils seulement pensé à citer son nom? Pour le philosophe, il n'en est pas de même ; tout lui fait un devoir de connaître et d'apprécier ses prédécesseurs; il ne peut ignorer leurs travaux qu'avec grand préjudice à la fois pour lui-même et pour la science qu'il cultive. Comme les éléments de cette science sont tout individuels , et que chaque observateur doit la refaire presque entièrement pour qu'elle soit vraiment solide entre ses mains, il y a bien plus de chances d'erreur; la connaissance de ce qu'ont pensé les autres est une garantie à peu près indispensable pour qui aime la vérité et prétend penser par soi-même. De plus, quelque original que soit le génie, il doit toujours bien moins à la nature qu'à la société au milieu de laquelle le destin l'a fait naître; cette société a nécessairement beaucoup reçu du passé; et le philosophe, tout indépendant qu'il est, ne date jamais de lui seul, pas plus que le physiologiste. Il doit donc, pour s'entendre parfaitement avec lui-même, savoir distinguer et ce qui lui appartient, et ce qui ne vient pas de lui dans les idées que sa raison approuve, dans les théories qu'il adopte, et dans la forme même sous laquelle il les présente. Ce sont là des soins que le physiologiste n'a point à prendre; mais le philosophe ne les néglige jamais sans péril. S'il les oublie, il court grand risque ou de refaire inutilement ce que d'autres ont mieux fait avant lui, ou de s'exagérer ce qu'il vaut en ne rendant pas assez de justice aux autres, ou de se tromper en s'isolant dans son propre système. Sans les avertissements de l'histoire, ou il fait des efforts stériles, ou il conçoit un fol orgueil, ou il commet d'impardonnables erreurs, n'évitant pas même ces écueils à la condition du génie qui lui aussi a ses lacunes et ses faiblesses. C'était le sentiment confus de ce devoir qui a porté les grandes écoles de la philosophie antique à l'étude de l'histoire. Cette étude n'a point manqué à Platon, comme l'atteste assez la polémique instituée dans la plupart de ses dialogues. Il faut connaître ses devanciers pour les combattre. Les réfuter, c'est montrer encore qu'on sait ce qu'on leur doit. Pour Aristote, l'examen des théories antérieures a toujours fait une partie essentielle de ses propres travaux; et ces controverses, si elles ne sont pas toujours aussi exactes et aussi profondes qu'on l'eût désiré, ont du moins le mérite de donner un exemple excellent. Plus tard, l'Éclectisme alexandrin s'est fait gloire de revenir au passé; sans doute il ne le comprenait pas bien, mais il l'étudiait avec respect; et les Alexandrins, tout mystiques qu'ils étaient, se sont crus les disciples fidèles de maîtres vénérés, qui pourtant n'avaient jamais connu le mysticisme. Ils tenaient à honneur de n'innover qu'en continuant leurs ancêtres. Dans le moyen âge, l'histoire de la philosophie n'a point eu de place, précisément parce que certains ouvrages de l'antiquité en avaient trop. La philosophie moderne n'a pas en général attaché de prix à la tradition; par Bacon, dans les sciences, elle a rompu violemment avec le passé; par Descartes, elle l'a oublié. L'histoire de la philosophie n'existe pas pour la libre école du Cartésianisme. Elle n'existe guère davantage pour l'école écossaise. Il n'y a que Leibnitz qui en sente l'utilité, et il la recommande au xviiie siècle, qui n'entend pas sa voix. Les grandes histoires de la philosophie que ce siècle voit naître ne sont guère appréciées alors que comme des travaux purement littéraires; l'Allemagne qui les a produites ne songe pas à en profiter ; et les écoles qui se succèdent de Kant à Hegel ne semblent avoir lu ni Brucker, ni Tiedemann, ni Tennemann. Hégel même, bien qu'il ait tenté une histoire de la philosophie, satisfait sa curiosité par cet examen du passé, plutôt qu'il ne lui demande des conseils et un appui. Ce n'est vraiment qu'en France et de nos jours, qu'on a compris l'histoire de la philosophie dans toute son importance. Parmi nous on ne s'est pas contenté d'être érudit comme on l'est en Allemagne; on a voulu que cette connaissance des travaux antérieurs servît directement à éclairer les travaux présents; et l'on a demandé à l'histoire de la philosophie des lumières pour la philosophie elle-même. Désormais une partie essentielle de la science, c'est de savoir ce qui a été; et le philosophe ne peut être complet qu'à la condition d'étudier à la fois et sa propre conscience et la conscience du genre humain. Sans doute il doit toujours, et avant tout, se connaître lui-même, comme le lui recommande la sagesse antique, écho d'un oracle divin; mais il doit connaître presque aussi bien l'histoire; et il a désormais pour se guider deux flambeaux à peu près également lumineux, sa propre nature et la tradition. On a pu voir dans le petit Traité de la Mémoire, comparé aux systèmes postérieurs, un exemple frappant, quoique limité. La théorie de la mémoire est sans doute une question secondaire. Mais précisément, parce que la question est étroite et fort nette, nous pouvons y suivre très-distinctement la marche de l'esprit humain. Aristote a tiré presque entièrement de lui-même et de ses observations personnelles, la théorie qu'il donne et qui est admirablement vraie. Il a bien fait aussi quelques emprunts à un système précédent ; mais il ne recevait que des germes imparfaits; et, sans être complètement original, il est le premier toutefois qui ait traité la question d'une manière scientifique et profonde. Voilà ce qui a été fait il y a plus de deux mille ans. Le travail d'Aristote reste la loi de la science dans l'antiquité, qui n'y change rien, et surtout dans le moyen âge, qui commente la pensée antique en écolier plein de zèle et de soumission. Quand l'esprit humain, à la voix des grands réformateurs, reprend son indépendance si longtemps enchaînée par l'Eglise et le Péripatétisme, il a perdu le til d'une tradition qu'il dédaigne; et nous avons vu dans cette question Descartes, Locke, Reid, Dugald-Stewart, oublier le passé à divers degrés, et essayer assez vainement de substituer à des théories vraies et complètes, des théories ou moins solides, ou même moins étendues. N'y aurait-il pas eu grand profit pour les psychologues écossais à reprendre l'œuvre où l'avait laissée leur prédécesseur, puisque cette œuvre était excellente? Et sans parler même de la justice qu'ils lui auraient rendue, ne peut-on pas employer plus utilement ses efforts qu'à refaire ce qui n'a pas besoin d'être refait ? De nos jours, M. W. Hamilton, le digne successeur de Reid et de Dugald-Stewart, a bien compris ce grave défaut de l'école qu'il représente; et en donnant une édition nouvelle des Œuvres de Reid, il n'a pas manqué de joindre à l'Essai sur la Mémoire une traduction et un commentaire du traité presque entier d'Aristote. Mais il faut généraliser cet exemple. Ce qu'on aurait pu faire pour une question comme celle de la mémoire, on doit l'entreprendre encore pour bien d'autres. Il n'en est pas une seule en philosophie qui ne puisse profiter aussi des lumières du passé. Tout le monde convient qu'en logique, il serait absurde et même impossible de suivre d'autre route que celle de l'Organon : on doit en croire la parole de Kant. Dans la science politique, le cadre tracé par Aristote est peut-être encore le meilleur. On en peut dire autant de certaines parties de la Morale, sans parler de la Rhétorique et de la Poétique. Il y a dans tous ces ouvrages des vérités à recueillir, comme dans le Traité de la Mémoire. Mais là où le sujet a été épuisé, qu'y a-t-il à faire si ce n'est de connaître, lorsqu'on prétend aller plus avant, le point même où les autres se sont arrêtés ? Ce qu'on dit ici d'Aristote serait encore plus juste de Platon. Que de faits psychologiques admirablement observés, que d'idées et que de théories inébranlables dans ces dialogues, l'éternel honneur de la philosophie antique, l'inépuisable source des enseignements les plus élevés à la fois et les plus pratiques ! Le Stoïcisme, cette autre école sortie bien qu'indirectement du maître incomparable de Platon, n'a-t-il donc point légué de vérités au monde ? Les Alexandrins eux-mêmes n'ont-ils que des erreurs ? Et dans le monde chrétien, la Scholastique n'a-t-elle été que subtile et vaine ? N'a-t-elle rien ajouté à la pensée antique, et n'a-t-elle point quelquefois heureusement complété ses instituteurs? Aujourd'hui que nous la connaissons un peu mieux, n'y pouvons-nous pas découvrir plus d'or que la sagacité même de Leibnitz n'y sut en voir? Puis dans la philosophie moderne et presque contemporaine , dans Bacon, dans Descartes, Malebranche, Spinoza, Leibnitz, Locke, Reid, Kant, pour ne rappeler que les plus grands noms, la moisson serait-elle moins riche et moins utile ? Ainsi donc ce qu'on a dit de ce petit Traité de la Mémoire et de la Réminiscence, n'est pas moins vrai de l'histoire entière de la philosophie. Il y a en elle comme une masse flottante de vérités que le philosophe doit aujourd'hui connaître, sous peine de se mettre en dehors des traditions du genre humain, ce qui est presque dire en dehors du sens commun. Tel est l'admirable héritage que la philosophie française de nos jours essaye de recueillir par de patients labeurs qui ne sont pas près de finir. Si on les lui a quelquefois reprochés, c'est qu'on ne les a pas assez compris. On craint que dans cette revue du passé, la philosophie ne perde une partie de sa puissance et de son originalité. On lui conseille d'oublier ce qui l'a précédée, pour ne s'en remettre qu'à elle seule. Autant vaudrait conseiller à un fils de famille de se priver de la richesse de ses aïeux pour faire une plus rapide fortune. La philosophie, il est vrai, a souvent marché sans l'appui de l'histoire; elle a fait d'immenses progrès sans demander de guides à la tradition. Mais est-ce à dire pour cela qu'elle ne dût rien à cette tradition qu'elle ignorait, et qu'elle méprisait même quelquefois ? Est-ce à dire que si le hasard l'a jusqu'à présent assez bien servie, la réflexion éclairée par l'expérience des siècles ne la puisse mieux servir encore ? En sera-t-elle moins riche pour savoir ce qui constitue précisement son assuré patrimoine ? En sera-t-elle moins forte pour hériter de la force de ses ancêtres? L'étude du passé est donc utile; elle est donc désormais nécessaire. Certainement je ne veux pas dire que l'histoire renferme la vérité tout entière, et que l'esprit humain n'ait plus rien à créer. Le cercle de la philosophie n'est pas plus limité que celui des sciences; et quand on voit ce que la méthode, telle que l'avaient conçue Platon et Socrate, est devenue, tout en restant au fond la même, entre les mains de Descartes, il n'y a pas à redouter que l'esprit humain s'arrête dans cette carrière plus que dans toute autre. Là aussi il a devant lui l'infini ; il peut y marcher sans craindre de rencontrer de bornes. Mais si le passé ne possède pas toute la vérité, il a des portions de vérité que nous devons prendre toutes faites de lui. C'est la condition même de nos progrès, loin de nous être un obstacle. Pour accroître plus sûrement ce trésor commun de l'humanité, il est bon de savoir ce qu'il contient. Ce sont là des idées tellement évidentes, des principes tellement simples, que vraiment il y serait fort; inutile d'y insister davantage. Mais une conséquence moins directe, quoique tout aussi certaine, c'est que l'étude de l'histoire est le seul moyen de donner à la philosophie cette organisation si souvent réclamée pour elle. « La philosophie, a-t-on dit, n'est pas une science faite, elle est une science à faire ; elle n'est point organisée. Le premier service qu'il faudrait lui rendre, c'est de lui donner une organisation qui lui manque. » Si ces plaintes et ces critiques signifient quelque chose, c'est que la philosophie n'a point encore recueilli, à la manière des sciences naturelles, les faits incontestables sur lesquels elle se fonde. La philosophie, divisée en psychologie, logique, morale et métaphysique ou théodicée, appuyée comme elle l'est sur ces quatre assises inébranlables, n'est pas une science à faire apparemment, en ce sens qu'elle ne sait ni l'objet qu'elle poursuit, ni la méthode qu'elle emploie. Aucune science, sur ces points essentiels, n'en sait et n'en a fait autant qu'elle. Il est, si l'on veut, fort difficile de définir la philosophie, précisément parce qu'elle embrasse tout ; mais la meilleure définition qu'on en puisse donner est encore le nom même qu'elle porte, et que le genre humain comprend très-clairement depuis trois mille ans. 11 s'agit donc uniquement pour elle, si elle veut s'organiser, de coordonner les vérités qu'elle possède. C'est là précisément le fruit que doit porter son histoire, et qui ne nuira point aux fruits nouveaux qu'elle-même ne cessera de porter. Ce qui doit le plus nous surprendre dans ces réclamations un peu tardives, élevées contre l'inconsistance de la philosophie, c'est qu'elles ont été faites au nom de l'école écossaise et par cette école même. Il semble cependant que si le désordre et l'anarchie pouvaient venir de quelque part dans le sein de la philosophie, ce serait de ceux qui, ne connaissant point son passé, s'imaginent, un peu aveuglément et non sans quelque orgueil, que l'édifice entier est à construire, et qui s'en croient les premiers et les plus habiles ouvriers. Nous l'avons vu pour le Traité de l'Ame ; Aristote a fondé la psychologie scientifique bien longtemps avant les Écossais, qui supposaient en être les inventeurs. Il a pu se tromper sur la nature de l'âme et ses véritables facultés; il a pu garder un regrettable silence sur sa destinée. Il a pu même ne point se rendre compte de la méthode qu'il avait suivie à son insu pour constater les faits psychologiques, bien que Platon lui eût enseigné cette méthode. Mais ces erreurs et ces lacunes ne l'ont pas empêché de connaître admirablement les faits, et de les exposer avec une rigueur et une justesse qui n'ont point été même égalées par ses successeurs. Nous venons de voir, pour le Traité de la Mémoire, que les analyses d'Aristote sur cette faculté sont plus exactes que celles de Reid. Si donc les Écossais eussent mieux connu de tels antécédents, nul doute qu'ils n'eussent un peu modifié leur entreprise, et que surtout ils ne l'eussent trouvée un peu moins neuve. Nul doute aussi qu'ils n'eussent poussé plus loin cette entreprise, si elle se fût appuyée sur de plus solides fondements. Ils auraient encore plus fait pour la science, s'ils avaient mieux connu le point où elle en était, et les modèles qu'ils pouvaient suivre. Par là, peut-être, ils auraient évité d'ajouter à cette anarchie philosophique dont ils se plaignaient, et qu'ils prétendaient bien vainement guérir, en en donnant malgré eux un nouvel exemple. Telle est donc, pour nous résumer en quelques mots, la leçon profitable qu'on peut tirer de la juste appréciation du Traité de la Mémoire , sans compter les autres Opuscules : Il faut connaître le passé sous peine de ne point se connaître soi-même ; et dans une science qui, comme la philosophie, a pour objet l'esprit humain, savoir ce que l'esprit humain a pensé est une condition désormais indispensable de justice et de vérité ; Dans les sciences naturelles, cette étude du passé est moins nécessaire, bien que là non plus elle ne soit pas sans profit. 28 Juin 1847. (01) Aristote n'a parlé de la réminiscence de Platon que pour critiquer les théories du Ménon (Derniers Analytiques, liv. I, ch. i, § 7). (02) Saint Augustin a traité de la mémoire au liv. X, ch. viii et suiv. des Confessions. C'est un hymne admirable aux merveilles de notre intelligence et à la bonté de Dieu. Mais l'enthousiasme n'ôte rien à la profondeur des idées, et l'on trouverait presque une théorie entière dans ces élans de cœur.
(03)
L'opinion d'Aristote à cet égard pent paraître quelquefois
contradictoire ; mais il y a un passage décisif, Traité de la
Respiration, ch. ix, §2. |