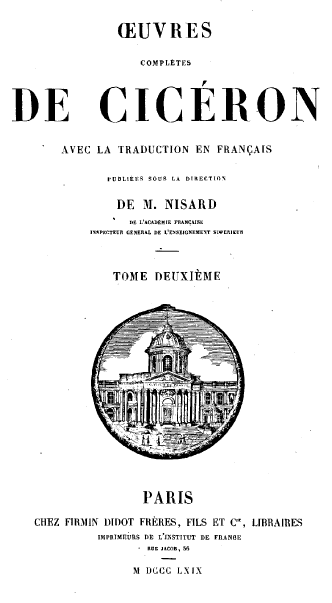|
ALLER à LA TAble des matières de cicéron orateur
Cicéron
Discours
VI
SECONDE ACTION CONTRE VERRÈS.
LIVRE PREMIER.
SUR SA PRÉTURE DE ROME.
PREMIÈRE ACTION CONTRE VERRÈS SECONDE, ACTION CONTRE VERRÈS. II. Sur sa préture en Sicile.
SECONDE ACTION CONTRE VERRÈS. DISCOURS SIXIÈME. ARGUMENT. Dans une première plaidoirie, Cicéron avait fait paraître tous les témoins, en obligeant Hortensius de les interroger. Celui-ci fut déconcerté par celte attaque à laquelle il ne s'attendait pas. Verrès lui-même, effrayé, prit la fuite, et se condamna volontairement à l'exil. Cicéron se proposait, dans une seconde plaidoirie, de faire connaître toutes les rapines et les crimes du préteur; il voulut faire voir qu'il ne lui aurait jamais échappé quand même il n'eût pas prévenu, par l'exil, la sentence du tribunal. Ce premier discours roule sur la questure de Verrès, sa lieutenance et sa préture de Rome. Après un long exorde, où il flétrit l'audace de Verrès, qui ose reparaître en Sicile, Cicéron divise son discours en quatre parties, la questure de Verrès, sa préture de Rome, sa préture de Sicile. Ce discours comprend les trois premières parties. La préture de Sicile est l'objet du discours suivant. La questure est traitée assez brièvement. Verrès, nommé questeur du consul Carbon, part avec la caisse militaire pour aller rejoindre l'armée. Mais à la première occasion favorable, il abandonne son consul, et passe avec la caisse dans le parti de Sylla. L'orateur explique la cause de cette désertion. Il parle ensuite de la lieutenance, montre que Verrès a trahi Dolabella, comme il avait trahi Carbon ; Dolabella dont il était le lieutenant, et qui l'avait choisi pour sou questeur après la mort de Malléolus. Après avoir exposé tous les vols et les rapines de Verrès pendant sa lieutenance, Cicéron raconte comment il a dé¬pouillé son pupille de l'héritage paternel, crime dont il a cherché ensuite à se disculper en accusant Dolabella. La fin du discours est consacrée à la préture de Rome. Cette dernière partie est divisée en deux; la manière de rendre la justice, et l'entretien des édifices publics. L'orateur rappelle tous les jugements odieux rendus par Verrés pendant sa magistrature , et termine en appelant sur l'accusé l'indignation des juges et du peuple romain. LIVRE PREMIER. SUR SA PRÉTURE DE ROME I. Personne de vous, juges, n'ignore sans doute le bruit répandu ces jours derniers, et la persuasion où était le peuple romain, que Verrès ne se présenterait pas une seconde fois pour me répondre. Ce bruit avait circulé non seulement parce que Verrès avait pris ce parti après de longues réflexions, mais aussi parce qu'on n'imaginait pas qu'un homme convaincu de tant de forfaits détestables, et par tant de témoins, eût assez d'audace, assez de démence et d'effronterie pour oser regarder les juges en face, et se montrer au peuple romain. Verrès est aujourd'hui ce qu'il a toujours été; prêt à tout oser et à tout entendre : le voici; il répond, on le défend. Pris sur le fait dans les actions les plus honteuses, s'il gardait au moins le silence et ne reparaissait plus, on pourrait croire qu'il cherche à effacer l'infamie de sa vie. Eh bien ! j'y consens, juges; et je vois sans peine que nous recueillerons le fruit, moi de mes fatigues, vous de votre équité. Car si cet homme eût suivi sa première résolution de ne point comparaître, on ne pourrait pas apprécier, comme je le désire, tout ce qu'il m'a fallu de travail et de persévérance pour préparer et établir cette accusation; et vous, juges, votre gloire serait bien faible et bien obscure. D'ailleurs ce n'est pas là ce qu'attend de vous le peuple romain; il ne saurait être satisfait si vous aviez condamné celui qui n'aurait pas voulu comparaître, et si vous vous étiez montrés courageux contre celui que personne n'aurait osé défendre. Mais, qu'il comparaisse plutôt ; qu'il réponde; qu'il soit défendu par tout le crédit, par tout le zèle des hommes les plus puissants ; que mon activité ait à lutter contre la passion de tous ces adversaires; que votre intégrité ait à se défendre contre l'or de cet homme ; et la fermeté des témoins, contre les menaces et le pouvoir de ses défenseurs : ce n'est qu'après le combat qu'il nous sera permis de nous croire vainqueurs. S'il eût été condamné en son absence, on pourrait penser qu'en se dérobant à votre justice, il a moins songé à sa sûreté, qu'à vous envier la gloire d'être justes. II. Il faut le reconnaître; il n'y a qu'un moyen de salut en ce moment pour la république, c'est de faire comprendre au peuple romain, qu'avec l'attention de l'accusateur à choisir ses juges, nos alliés, nos lois, la république ne peuvent trouver de plus sûrs appuis que dans l'ordre des sénateurs. Rien de plus pernicieux, au contraire, pour les intérêts de tous que de voir cet ordre condamné sans retour par l'opinion du peuple romain, comme incapable de respecter l'intégrité, la bonne foi, l'honneur, la religion. Aussi me semble-t-il que j'ai entrepris de sauver la partie de la république la plus importante et en même temps la plus malade, celle qu'on regarde presque comme incurable; et qu'en cela j'ai travaillé autant pour votre gloire que pour la mienne. Je suis venu en effet délivrer les tribunaux du poids de la haine et des reproches publics, afin que, si cette cause était jugée selon le voeu du peuple romain, mon zèle parût avoir contribué en quelque chose à rétablir l'autorité des jugements; ou qu'au moins votre décision, quelle qu'elle fût, mît un terme à tous ces débats. Telle est, à n'en pas douter, juges, la question que vous avez à résoudre dans cette cause. En effet l'accusé est le plus coupable de tous les hommes. Condamné, on cessera de dire que l'argent peut tout sur les juges actuels; absous, nous cesserons de nous opposer à ce que la justice soit confiée à un autre ordre. L'absolution de cet homme! Mais lui-même il ne l'espère déjà plus, et le peuple romain est loin de la craindre. Quant à l'impudence singulière qu'il a de comparaître, de répondre, il y a des gens qui s'en étonnent : pour moi, qui songe à son audace et à sa démence accoutumées, je ne vois là rien qui me surprenne. Car il a commis contre les dieux et les hommes mille impiétés, mille forfaits. L'idée des supplices réservés aux scélérats le poursuit, et lui ôte le sens et la raison. III. Il est poussé dans l'abîme par les Furies vengeresses des citoyens romains, qu'il a ou frappés de la hache, ou égorgés en prison, ou élevés en croix quand ils imploraient leurs droits d'hommes libres et de citoyens. Il est traîné au supplice par les dieux paternels, lui qu'on a vu arracher les fils aux bras de leurs pères, les conduire au supplice, et faire payer aux parents la sépulture de leurs enfants. Les cultes religieux, les cérémonies de tous les sacrifices et de tous les temples violés par lui, les images des dieux enlevées de leurs temples, et jetées dans les ténèbres où il les a ensevelies et cachées, ne permettent pas à son esprit d'échapper au trouble et à l'égarement qui l'agitent. Il ne vient pas seulement s'offrir à sa condamnation; chargé de tant de crimes, il semble qu'il ne serait passatisfait s'il ne subissait que la punition commune des concussionnaires avares. Il faut une punition à son étrange et monstrueuse perversité. Il ne suffit pas à la haine publique qu'il restitue, après sa condamnation, les biens qu'il a ravis; il faut qu'il expie les outrages faits aux dieux immortels; il faut que les tourments de nos concitoyens, que le sang innocent tant de fois répandu soient vengés par son supplice. Car ce n'est pas un voleur, mais un ravisseur; ce n'est pas un adultère, mais un violateur brutal de la pudicité; ce n'est pas un sacrilège, mais l'ennemi de tout ce qui est saint et religieux; ce n'est pas un assassin, mais le plus cruel bourreau des citoyens et des alliés que nous avons amené devant votre tribunal; enfin c'est, de mémoire d'homme, le seul accusé à qui il eût été, je pense, avantageux d'être condamné. IV. Eh ! qui ne comprend que ce misérable, absous malgré les dieux et les hommes, ne peut, quoi qu'il fasse, être arraché aux mains du peuple romain? Qui ne voit que ce sera un grand bonheur pour nous, si le peuple romain se contente du supplice de ce seul coupable, s'il ne décrète pas qu'après avoir pillé les temples, égorgé tant d'innocents, fait subir à des citoyens romains la mort, la torture, la croix, mis en liberté pour de l'argent des chefs de pirates, il n'a pas commis un plus grand crime que ceux qui, au mépris de leurs serments, ont absous par leurs suffrages un homme souillé de tant de forfaits? Non, juges, il est impossible de faillir, quand il s'agit de juger cet homme : ce n'est pas en faveur d'un tel accusé, ce n'est pas dans ce moment, ce n'est pas devant ce tribunal, qu'il faudrait tenter la séduction. Je crains de paraître trop présomptueux lorsque je parle ainsi devant de tels juges, mais l'accusateur lui-même n'est pas de ceux à qui un accusé si coupable, si désespéré, si convaincu, pourrait être soustrait furtivement, ou arraché impunément. Me sera-t-il impossible de prouver aux juges qui m'écoutent que C. Verrès a pris de l'argent contre les lois? Pourront-ils ne pas croire tant de sénateurs, tant de chevaliers romains, tant de cités, tant de personnes honorables d'une province si renommée, tant d'actes publics et privés? Pourront-ils résister à la volonté si formelle du peuple romain? Eh bien! qu'ils aient ce courage : nous, si nous pouvons conduire cet homme vivant vers un autre tribunal, nous trouverons des juges à qui nous prouverons qu'il a, dans sa questure, détourné les fonds publics accordés au consul Cn. Carbon; à qui nous persuaderons qu'il a, sous de faux prétextes, comme vous l'avez appris dans la première action, tiré de l'argent des questeurs de la ville. Il se trouvera des citoyens qui l'accuseront d'avoir osé retrancher sur le blé des dîmes de quelques débiteurs ce qu'il voulait prendre pour lui. Il s'en trouvera peut-être aussi, juges, qui croiront devoir punir du châtiment le plus exemplaire le crime de péculat commis par cet homme, lorsqu'il ne craignit pas d'enlever des temples les plus révérés, des villes de nos alliés et de nos amis, les monuments de M. Marcellus et de P. Scipion l'Africain, monuments qui, sous le nom de ces grands hommes, étaient en réalité, et de l'aveu de tous, les monuments du peuple romain. V. Supposons qu'il se soit tiré même de cette accusation de péculat; qu'il songe alors à ces chefs ennemis qu'il a mis en liberté pour de l'argent; qu'il voie ce qu'il pourra répondre an sujet de ces hommes substitués à leur place et gardés dans sa maison; qu'il cherche un moyen de guérir le coup mortel que lui a porté notre accusation et plus encore son propre aveu; qu'il se souvienne que, dans la première action, effrayé par les cris d'indignation et de haine du peuple romain, il confessa qu'il n'avait pas fait frapper de la hache les chefs de pirates, et qu'il craignait qu'on ne l'accusât de les avoir relâchés pour de l'argent; il faudra bien qu'il avoue, ce qu'on ne peut nier, que lui, simple particulier, a, depuis son retour à Rome, gardé, sains et saufs dans sa maison, tant que je l'ai laissé faire, des chefs de pirates; et si, dans ce jugement du crime de lèse-majesté, il prouve qu'il lui a été permis d'agir ainsi, moi, je lui accorderai qu'il n'a fait que son devoir. Qu'il échappe encore à ce danger, je cours aussitôt où m'appelle depuis longtemps le peuple romain, car le peuple romain pense, et avec raison, que c'est à lui de juger les crimes contre la liberté et la cité romaine. Que cet homme écrase par son crédit les tribunaux de sénateurs, qu'il échappe à travers les enquêtes de tous les magistrats, qu'il se dérobe à votre sévérité : croyez-moi, il sera retenu par des liens plus forts que ceux qu'il aura rompus. Le peuple romain en croira ces chevaliers qui, déjà cités devant vous comme témoins, ont déposé que cet homme avait, sous leurs yeux, fait mettre en croix un citoyen romain, bien que ce citoyen eût donné pour caution des hommes honorables. Les trente-cinq tribus en croiront M. Annius, homme d'une autorité si imposante et d'une si haute illustration, lequel a déclaré qu'en sa présence un citoyen romain avait été frappé de la hache. On écoutera un de nos premiers citoyens, un chevalier romain, L. Flavius, qui a déposé que son ami Hérennius, négociant venu d'Afrique, fut frappé de la hache à Syracuse, malgré les réclamations de plus de cent citoyens romains qui le défendaient en versant des larmes. On ne doutera pas de la bonne foi, de l'autorité et de la conscience de L. Suétius, personnage doué de tous les genres de mérite, qui a attesté devant vous, avec serment, qu'une multitude de citoyens romains, jetés dans les carrières par l'ordre de ce barbare, avaient péri de mort violente. Lorsque, grâce à la faveur du peuple romain, je plaiderai cette cause du haut de la tribune, je ne crois pas qu'aucune force puisse arracher le coupable au jugement du peuple, ni que je puisse moi-même, dans mon édilité, offrir un spectacle plus magnifique et plus satisfaisant. VI. Qu'on mette donc tout en oeuvre : désormais, juges, personne, dans cette cause, ne peut faillir qu'à vos propres risques. Quant à moi, on sait quelle conduite j'ai tenue jusqu'ici; on doit connaître alors, on doit prévoir celle que je tiendrai dans la suite. J'ai montré mon zèle pour la république dès l'instant où j'ai fait revivre une ancienne coutume depuis longtemps négligée; où, à la prière des alliés et des amis du peuple romain, qui d'ailleurs me sont attachés par des liens particuliers, j'ai déféré à votre justice le plus audacieux des hommes. Cette conduite a été si approuvée par les personnages les plus distingués et les plus illustres, parmi lesquels se trouvaient plusieurs d'entre vous, qu'un ancien questeur de Verrès, devenu son ennemi, malgré de justes sujets de plaintes, n'a point été admis à se porter accusateur, comme il le demandait, ni même à souscrire l'accusation. J'allai en Sicile pour informer contre Verrès : on fut alors convaincu de mon activité par la promptitude de mon retour; de mon zèle par la multitude des pièces et des témoins; enfin de ma délicatesse et de mon désintéressement, par le soin que j'avais pris en arrivant, moi sénateur, chez les alliés du peuple romain, et dans une province où j'avais été questeur, et dont j'allais plaider la cause, de descendre plutôt chez mes hôtes et mes amis que chez ceux qui avaient imploré mon secours. Mon arrivée ne causa ni gène ni dépense à personne, soit en public soit en particulier. Dans mes informations, je pris l'autorité que me donnait la loi, et non celle que je pouvais prendre d'après les dispositions favorables des victimes de l'accusé. De retour à Rome, Verrès lui-même et ses amis, hommes riches et élégants, avaient, pour ralentir l'ardeur des témoins, fait courir le bruit que, gagné par une forte somme d'argent, j'avais renoncé à toute accusation sérieuse. Quoique personne ne les crût, puisque j'avais pour garants les Siciliens qui m'avaient connu questeur dans leur province, et les plus illustres citoyens de Rome qui nous connaissent tout aussi bien que nous les connaissons, je craignis qu'on ne doutât de ma bonne foi et de mon intégrité, jusqu'au moment de la récusation des juges. VII. Je savais que, dans la récusation des juges, quelques-uns n'avaient pu, de nos ,jours, éviter le soupçon de connivence, lorsque dans l'accusation même on approuvait leur zèle et leur fidélité. Pour moi, à la manière dont j'ai exercé ce droit de récusation, il est certain que, depuis l'établissement de l'ordre actuel, aucun tribunal n'a égalé celui-ci en éclat et en dignité. Cet honneur, Verrès prétend le partager avec moi, lui qui a récusé P. Galba pour conserver Lucrétius, et qui, lorsque son défenseur lui demandait pour quelle raison il avait laissé récuser ses plus intimes amis, Sex. Péducéus, Q. Considius, Q. Junius, lui répondit qu'il les connaissait trop indépendants et trop attachés à leurs idées. Je me flattais alors que mon fardeau devenait aussi le vôtre; je pensais avoir donné à ceux qui me connaissent, comme à ceux qui ne me connaissent pas, des preuves de ma droiture et de mon dévouement : mon attente n'a pas été trompée. En effet, dans les comices où devait se décider mon élection, malgré les immenses largesses prodiguées par cet homme pour l'empêcher, le peuple romain a jugé que l'argent, qui n'avait pu triompher de ma fidélité, ne devait pas être un obstacle. Et le premier jour, juges, où, appelés à prononcer sur cet accusé, vous avez pris séance, quel homme, si ennemi de votre ordre, si avide de réformes, de nouveaux tribunaux et de nouveaux juges, n'a été pénétré de respect à la vue de votre assemblée? Grâce à votre intégrité, je recueillais le fruit de mon zèle et je parvenais à mon but. Une heure de plaidoyer avait ravi à un accusé audacieux, riche, prodigue, déterminé, tout espoir de corrompre la justice; le premier jour, le peuple romain était déjà convaincu par le grand nombre de témoins que j'avais cités, que, si cet homme était absous, la république ne pouvait subsister ; le second jour enleva aux amis et aux défenseurs de Verrés non seulement l'espoir de le faire triompher, mais encore la volonté de le défendre; et le troisième jour, il était si accablé, que, feignant d'être malade, il délibérait non plus sur ce qu'il répondrait, mais sur les moyens de ne pas répondre : et enfin, les six derniers jours, ces accusations, ces témoins, venus de tous côtés et de Rome et des provinces, l'avaient tellement anéanti, tellement écrasé, que, dans l'intervalle des dernières fêtes, tout le monde le déclarait non pas ajourné, mais condamné. VIII. Ainsi, juges, pour ce qui me regarde, j'ai gagné ma cause; en effet, je n'ai pas désiré les dépouilles de C. Verrès, mais l'estime du peuple romain. Mon devoir était de n'accuser qu'avec de justes motifs; or, quel droit plus légitime que celui dont j'ai été revêtu par l'illustre province qui m'a proclamé son défenseur ? de servir la république; or quoi de plus important pour sa gloire dans un moment où les tribunaux sont en butte à tant de haines, que d'amener devant eux un homme dont la condamnation puisse rendre à cet ordre l'estime et la faveur du peuple romain? de montrer et de persuader que l'accusé est vraiment coupable? or, quel est le citoyen qui n'ait remporté dès les premières audiences la conviction que les forfaits, les rapines, les infamies de tous ceux qui ont été condamnés précédemment, pourraient à peine, même rassemblés sur une seule tête, être mis en balance et comparés avec la moindre partie des crimes de Verrés? Mais vous, juges, dans ce qui touche à votre renommée, à votre gloire, au salut commun,faites preuve de prévoyance et d'énergie : telle est l'autorité de votre rang que vous ne pouvez commettre une faute sans causer le plus grand dommage, sans porter le coup le plus funeste à la république. Le peuple romain ne peut espérer que d'autres membres du sénat soient capables de bien juger, si vous ne l'êtes pas; et s'il désespérait de vous il faudrait bien qu'il cherchât un autre ordre de citoyens, une autre forme de tribunaux. Si cela vous semble peu de chose, parce que vous regardez comme un fardeau pesant et incommode les fonctions judiciaires, vous devez comprendre quelle est la différence pour vous de rejeter ce fardeau, ou de vous le voir enlever par le peuple romain, que vous n'aurez pu convaincre de votre intégrité et de votre bonne foi. Songez ensuite combien il sera dangereux pour nous de paraître devant ceux que le peuple romain, dans sa haine contre vous, aura établis pour vous juger. Car je dois vous dire ce que j'ai trop bien compris : sachez qu'il y a des hommes dont la haine est si forte contre votre ordre, qu'ils proclament déjà hautement leur désir de voir absoudre Verrès, dont ils connaissent d'ailleurs toute la scélératesse, et cela pour que le pouvoir judiciaire soit enlevé au sénat avec honte et ignominie. Ce qui m'a forcé de vous parler si longtemps sur le même sujet, ce ne sont pas, juges, mes craintes sur votre probité, mais les nouvelles espérances de ces hommes qui, ramenant tout à coup Verrès des portes de la ville au tribunal, ont fait soupçonner à quelques-uns que ce n'était pas sans motif qu'il avait changé de résolution. IX. Maintenant, pour épargner de nouvelles plaintes à Hortensius, pour qu'il ne dise pas qu'un accusé est opprimé quand l'accusateur ne parle pas contre lui; qu'il n'y a rien de si dangereux pour le sort des innocents que le silence de leurs adversaires; pour qu'il ne fasse pas de mes talents un autre éloge que je ne le voudrais, en déclarant que si j'en avais dit davantage, j'aurais adouci la situation de l'accusé, et qu'en ne disant rien je l'ai perdu; je veux bien céder à ses désirs; je parlerai sans interruption, non que cela soit nécessaire, mais pour éprouver s'il aimera mieux mes paroles d'aujourd'hui que mon silence d'hier. Avec quelle attention vous allez me surveiller, Hortensius, pour que je ne perde pas une minute du temps qui m'appartient! et si je n'emploie pas rigoureusement toutes les heures que la loi m'accorde, vous allez vous plaindre, vous allez attester les dieux et les hommes qu'on opprime C. Verrès, parce que l'accusateur n'aura pas voulu parler aussi longtemps qu'il le pourrait. Eh quoi ! ce que la loi m'accorde dans mon intérêt, je ne serai pas libre de n'en point user? car c'est dans l'intérêt de ma cause qu'on m'a donné du temps pour accuser, c'est afin que je puisse développer tous mes chefs d'accusation ; et si je n'en use pas, ce n'est pas à vous que je fais tort, c'est à moi, puisque je me prive d'une partie de mes droits et de mes avantages. Il faut, dit-il, que la cause soit instruite. - Oui, car, sans cela, un accusé, ne pourrait être condamné si coupable qu'il fût. Vous me savez donc mauvais gré d'avoir fait quelque chose qui pût le sauver d'une condamnation? car la connaissance de la cause peut faire absoudre beaucoup d'accusés, et, sans cette connaissance, on ne saurait condamner personne. - Mais, dites-vous encore,je le prive de l'ajournement. - Ce que la loi a de plus pénible, cette obligation de plaider deux fois la cause, a été établi pour moi plutôt que pour vous, ou du moins ne l'a pas été pour vous plutôt que pour moi. Car si c'est un avantage de parler deux fois, cet avantage est commun aux deux parties. S'il est besoin de réfuter celui qui a parlé le second, c'est en faveur de l'accusateur qu'on a permis de plaider deux fois; si je ne me trompe, Glaucia est le premier, qui fit une loi sur l'ajournement : auparavant on pouvait prononcer le jugement dès la première action, ou ordonner un plus ample informé. Quelle loi trouvez-vous donc la plus douce? l'ancienne, je pense, qui permettait d'absoudre sur-le-champ, ou de condamner plus tard. Eh bien! je vous remets sous l'empire de cette loi Acilia, qui servit à faire condamner nombre d'accusés sur une seule accusation, sur une seule défense, sur une seule audition de témoins, pour des crimes bien moins évidents et bien moins odieux que ceux dont vous êtes convaincu. Supposez-vous en cause, non sous la loi actuelle qui paraît si rigoureuse, mais sous la loi ancienne qui est si clémente. J'accuserai, vous répondrez; après avoir fait entendre les témoins, je laisserai les juges aller aux voix, et, quoique la loi permette le plus ample informé, ils croiront compromettre leur honneur en ne jugeant pas sur-le-champ. X. Mais, s'il faut que la cause soit instruite, ne l'est-elle pas assez? Nous dissimulons, Hortensius, ce que nous avons bien des fois éprouvé dans nos plaidoiries. Qui fait jamais grande attention à nos discours, au moins dans ce genre de cause où il s'agit d'objet volés ou détournés? N'est-ce pas des pièces écrites ou des témoins queles juges attendent toutes les lumières? J'ai dit, dans la première action, que j'allais prouver clairement que C. Verrès avait emporté de Sicile quarante millions de sesterces, au mépris des lois. Eh bien! aurais-je été plus clair, si j'avais ainsi raconté les faits? Un certain Dion d'Halèse, au fils duquel un parent avait laissé une succession fort considérable, sous la préture de Sacerdos, la recueillit sans aucune difficulté, sans la moindre contestation. A peine Verrès eut-il mis le pied dans la province, qu'il écrivit à Messine, fit comparaître Dion devant lui, aposta des calomniateurs, choisis parmi ses affidés, pour dire que cette succession était dévolue à Vénus Érycine, et déclara qu'il instruirait lui-même cette affaire. Je puis vous exposer tous les détails et vous dire ce qui arriva : Dion, pour gagner une cause si assurée, fit compter au juge un million de sesterces ; celui-ci eut en outre le soin de faire emmener des troupeaux de cavales, et d'enlever tout ce qui se trouvait d'argenterie et de tapisseries dans la succession. Tout ce que nous dirions, moi pour affirmer ces faits, vous pour les nier, ne ferait pas grande impression. Quand donc le juge prêterait-il l'oreille? Quand serait-il attentif? ce serait lorsque Dion paraîtrait lui-même, ainsi que tous ceux qui auraient pris part à ses affaires; lorsqu'on découvrirait que, pendant les jours même où Dion plaidait sa cause, il contractait des emprunts, retirait ses créances, vendait ses domaines; lorsqu'on produirait les registres de personnes dignes de foi; lorsque ceux qui fournirent les fonds déclareraient avoir appris dès lors que ces emprunts étaient destinés à Verrès; lorsque les amis, les hôtes, les hommes honorables qui protègent Dion affirmeraient qu'ils ont appris les mêmes choses. C'est alors, j'en suis certain, que vous écouteriez comme vous avez fait; c'est alors que se plaiderait réellement la cause. Or, dans la première action, je vous ai présenté tous les chefs d'accusation de manière qu'il n'y en eût aucun sur lequel personne d'entre vous eût besoin de développements. J'affirme que dans tout ce qui a été dit par les témoins, il n'y a rien eu d'obscur pour aucun de vous, rien qui réclamât l'éloquence d'un orateur. XI. Il vous souvient, en effet, que dans l'audition des témoins, mon plan fut toujours de commencer par exposer et développer les griefs, et de n'interroger chaque témoin qu'après avoir expliqué le fait sur lequel je l'interrogeais. Ainsi, non seulement vous qui êtes nos juges, vous vous rappelez nos griefs, mais le peuple romain lui-même connaît toute l'accusation, toute la cause et cependant je parle de ce que j'ai fait, comme si je l'avais fait volontairement, comme si vos manœuvres ne m'y avaient pas obligé! Vous avez aposté un accusateur qui, demanda cent huit jours pour aller en Achaïe, lorsque j'en avais demandé cent dix pour me rendre en Sicile. Avez-vous pensé qu'en m'enlevant trois mois, c'est-à-dire le temps le plus favorable à la cause, j'abandonnerais ce qui resterait de cette année; et que, si j'usais du temps qui m'était accordé, vous profiteriez des deux fêtes qui surviendraient, pour ne répondre qu'au bout de quarante jours; enfin que l'affaire traînant en longueur, nous aurions pour juges, au lieu du préteur M. Glabrion et d'une grande partie de ses assesseurs, un autre préteur et un autre tribunal? Si je n'avais pas déjoué toutes ces manoeuvres, si tous les citoyens, connus et inconnus, ne m'avaient pas averti que l'on songeait, que l'on cherchait, que l'on travaillait à renvoyer l'affaire à l'année suivante, j'aurais pu craindre, en voulant consacrer à l'accusation tout le temps qui m'est accordé, de n'avoir pas assez de griefs, de manquer de paroles, de voix et de forces, pour accuser une seconde fois un homme que personne, dans une première action, n'avait osé défendre. Le parti que j'ai pris, je l'ai fait approuver aux juges, et au peuple romain. Personne ne pense qu'il y ait eu un autre moyen de prévenir les manoeuvres et l'impudence de ces hommes. Jugez quelle eût été ma sottise, si, pouvant éviter le piége qu'on me tendait, je me fusse laissé ajourner au terme fixé par ceux qui, voulant à force d'argent, sauver Verrès de nos mains, avaient eu soin d'insérer cette clause dans leur marché : si le jugement a lieu après les calendes de janvier; mais aujourd'hui que j'ai dessein d'exposer la cause dans toute son étendue, je dois ménager avec soin les moments qui me sont accordés. XII. Je laisserai donc de côté ce premier acte si honteux, si infâme de la vie de Verrès. Il n'entendra de moi rien qui ait trait aux turpitudes et aux crimes de son enfance, rien des impuretés de cette jeunesse que vous vous rappelez sans doute, ou dont vous pouvez retrouver la parfaite image dans ce digne rejeton qu'il a produit. Je passerai sous silence tout ce qui me paraîtra honteux à dire, et je considérerai moins ce qu'il mérite d'entendre, que ce que la décence me permet de dévoiler. Et vous, je vous en prie, accordez-moi, permettez-moi, de pouvoir taire, par pudeur, une partie de ses impudences. Je le tiens quitte de tout le temps qui s'est écoulé avant son entrée dans les charges et dans les affaires publiques. Taisons-nous sur ses bacchanales nocturnes et ses veilles licencieuses ; ne parlons ni de corrupteurs, ni de joueurs, ni d'entremetteurs; qu'il ne soit pas question dans mon discours des pertes et de la honte que sa jeunesse a coûté à son père, qu'il y gagne de ne pas m'entendre révéler ses premières infamies, mais que le reste de sa vie me dédommage de ce que j'abandonne. Vous avez été questeur du consul Cn. Papirius, il y a quatorze ans : c'est pour vos actes depuis ce jour jusqu'à celui-ci, que je vous cite devant ce tribunal. Pas une heure qui n'ait été marquée par un vol, par un crime, une cruauté, une infamie. Ces années vous les avez passées dans votre questure, dans votre lieutenance en Asie, dans vos deux prétures à Rome et en Sicile. Je distribuerai donc en quatre parties mon accusation. XIII. Nommé questeur, vous tirâtes au sort une province d'après le sénatus-consulte : celle qui vous échut fut une province consulaire, où vous eûtes pour consul Cn. Carbon. La division était alors entre les citoyens; je ne dirai pas quelle fut votre opinion à cette époque ; je dis seulement qu'en pareille circonstance, et dans les fonctions où le sort vous avait placé, vous deviez décider lequel des deux partis vous vouliez embrasser et défendre. Carbon voyait avec peine que le sort lui eût donné pour questeur un homme si singulièrement inepte et débauché; cependant il le comblait d'honneurs et de biens. Pour abréger, les fonds accordés furent délivrés;le questeur partit pour sa province; il arriva en Gaule, où il était attendu, à l'armée du consul, avec les fonds. Dès la première occasion (voyez quel fut le début de cet homme, dans les magistratures et dans l'administration publique), le questeur, après avoir détourné les fonds, abandonne le consul, l'armée, ses fonctions et la province. Je vois déjà l'effet de mes paroles; il lève la tête, il espère, sur le fait dont je l'accuse, être secondé par l'esprit de parti, grâce à la bienveillance et aux sympathies de ceux à qui la mémoire de Cn. Carbon est odieuse; il se flatte que cette désertion, cette trahison envers son consul ne peuvent manquer de leur être agréables : comme s'il n'avait agi que par zèle pour la cause de la noblesse ou par intérêt de parti; comme s'il n'avait pas pillé de la maniere la plus scandaleuse le consul, l'armée, la province, et pris la fuite aussitôt, pour éviter les suites de son audacieux brigandage! En effet cette action a été fort secrète, et de nature à faire soupçonner que C. Verrès, ne pouvant supporter les hommes nouveaux, n'a fait, en passant du côté de la noblesse, que, rejoindre les siens sans y être poussé par l'amour de l'argent! Voyons donc comment il a rendu ses comptes. Il va nous montrer lui-même par quel motif il a abandonné Cn. Carbon; il va lui-même se trahir. XIV. Remarquez d'abord son laconisme : J'ai reçu, dit-il, deux millions deux cent trente-cinq mille quatre cent dix-sept sesterces. J'ai donné pour la paye des soldats, pour le blé, pour les lieutenants, les vice-questeurs, la cohorte prétorienne un million six cent trente-cinq mille quatre cent dix-sept sesterces. J'ai laissé à Rimini six cent mille sesterces. Est-ce là rendre des comptes? Nous a-t-on jamais vu, vous et moi, Hortensius, ou quelque autre que Verrès en rendre de cette sorte? Qu'est-ce cela? quelle impudence! quelle audace! Dans tous les comptes rendus par tant de comptables, où trouver un exemple pareil? Cependant, ces six cent mille sesterces dont il n'a pu indiquer l'emploi, même par un mensonge ; qu'il dit avoir, laissés à Rimini, ces six cent mille sesterces qui ont formé son reste de compte, Carbon n'en a rien touché, Sylla n'en a rien vu, rien n'en a été rapporté au trésor public. Il a choisi la ville de Rimini, parce qu'au moment où il rendait ses comptes, cette ville était prise et saccagée : il ne soupçonnait pas, ce qu'il verra bientôt, que, malgré ce désastre, il est resté assez de témoins pour déposer de ce fait. Lisez de nouveau : A P. LENTULUS ET A L. TRIARIUS, QUESTEURS DE ROME, ÉTAT DU COMPTE RENDU. Lisez : EN VERTU DU SÉNATUS-CONSULTE. Ce fut pour avoir le droit de rendre ses comptes de cette manière qu'il se fit tout à coup partisan de Sylla, et non pour aider la noblesse à reconquérir son honneur et ses dignités. Et quand vous auriez fui les mains vides, cette fuite paraîtrait toujours coupable, cette trahison envers votre consul, toujours criminelle. Carbon était un citoyen pervers, un mauvais consul, un séditieux. Oui, pour d'autres; mais pour vous, depuis quand? après qu'il vous eut confié ses finances, ses comptes et son armée. Car si vous aviez eu de lui la même opinion avant cette époque, vous auriez fait ce que fit M. Pison, l'année suivante. Nommé par le sort questeur du consul L. Scipion, il ne voulut pas toucher aux fonds destinés aux troupes, il ne se rendit pas à l'armée : fidèle à ses principes, il les conserva sans porter atteinte ni à sa probité, ni aux usages de nos ancêtres, ni aux obligations que le sort venait de lui imposer. XV. En effet, si nous voulons porter le trouble et la confusion dans toutes ces choses; si le sort ne nous commande plus une soumission religieuse; si les liens qui doivent nous unir dans la bonne et dans la mauvaise fortune ont perdu leur sainteté ; si les moeurs et les maximes de nos ancêtres n'ont plus d'autorité, nous remplissons notre vie de périls, de soupçons et de haines. Celui qui s'est montré l'ennemi des siens est l'ennemi de tous. Jamais homme sage n'a pensé qu'on dût se fier à un traître. Sylla lui-même, qui certes devait se réjouir de l'arrivée de ce transfuge, l'éloigna de sa personne et de son armée. Il lui fixa pour lieu de résidence Bénévent, ville qu'il savait très attachée à son parti, et où cet homme ne pourrait nuire au succès de sa cause. Néanmoins, il le récompensa depuis libéralement: il lui donna dans le territoire de Bénévent quelques biens de proscrits à piller; il lui accorda un salaire comme à un traître, mais non sa confiance, comme à un ami. Quoiqu'il y ait encore des gens qui détestent Cn. Carbon, même après sa mort, ils ne doivent pas considérer ce qu'ils lui souhaitaient pendant sa vie, mais ce qu'ils auraient à craindre dans une position semblable. C'est un mal commun, une crainte commune, un danger qui nous menace tous. Il n'y a pas d'embûches plus secrètes que celles qui se cachent sous les apparences du devoir, ou sous le masque de l'amitié. Car, si l'on a affaire à un ennemi déclaré, on peut aisément lui échapper par la défiance; tandis que ce mal secret, intérieur, domestique, non seulement ne paraît pas au dehors, mais nous accable avant que nous ayons pu l'apercevoir et l'étudier. Eh! n'en est-il pas ainsi? vous avez été envoyé comme questeur à l'armée, vous avez eu le trésor en garde, vous avez même été le confident du consul dans toutes ses affaires, il vous a traité comme un de ses enfants, d'après l'usage de nos ancêtres; et tout à coup, vous le quittez, vous le trahissez, vous passez dans les rangs de ses ennemis! Misérable! monstre digne d'être relégué aux extrémités de la terre ! car un être qui a commis un tel forfait ne saurait se contenter d'un seul crime. C'est une nécessité pour lui d'en méditer de semblables; une nécessité de montrer toujours la même audace, la même perfidie. Aussi ce même homme, que Cn. Dolabella prit pour vice-questeur, après le meurtre de C. Malléolus (je ne sais si ces liens n'étaient pas plus étroits que ceux qui l'attachaient à Cn. Carbon, et si un choix librement fait ne doit pas avoir plus de force que le choix du sort), cet homme, dis-je, fut pour Cn. Dolabella ce qu'il avait été pour Cn. Carbon. Il lui imputa ses propres crimes, et révéla tous les détails de l'affaire à ses ennemis et à ses accusateurs; après avoir été son lieutenant, son vice-questeur, il déposa contre lui de la manière la plus acharnée, la plus infâme. L'infortuné fut la victime, non seulement d'une abominable perfidie et d'un odieux témoignage, mais surtout de la haine qu'avaient inspirée les brigandages et les crimes de Verrès. XVI. Maintenant, que ferez-vous de cet homme? Qui pourrait vous porter à conserver un être aussi affreux, aussi pervers, lui qui n'a respecté ni le choix volontaire dans Cn. Dolabella, ni la loi du sort dans Cn. Carbon; lui qui les a tous deux, je ne dis pas abandonnés, mais trahis, mais accablés? Je vous en supplie, juges, n'appréciez pas ses crimes d'après la brièveté de mon discours, mais d'après leur grandeur : car je suis obligé de me hâter, afin de pouvoir vous exposer tout ce que mon devoir me prescrit. A présent que vous connaissez sa questure, que vous êtes convaincus de ses vols et de sa scélératesse dans l'exercice de cette première charge, écoutez la suite : encore ai-je dessein de passer sous silence cette époque funeste des proscriptions et des brigandages de Sylla, ne voulant pas laisser à l'accusé un moyen de défense dans nos malheurs communs. Je ne lui reprocherai que ses crimes, ceux qui sont avérés. Retranchez donc de l'accusation tout ce temps de la tyrannie de Sylla, et apprenez quelle fut l'admirable lieutenance de Verrès. XVII. Aussitôt que la Cilicie fut assignée à Cn. Dolabella pour son département, avec quelle ardeur, dieux immortels ! et par combien de sollicitations Verrès n'a-t-il pas emporté d'assaut cette lieutenance ! Telle fut la cause des principaux malheurs de Cn. Dolabella. Car, une fois parti de Rome, Verrès, par sa conduite dans toute la route, ne parut pas, aux pays qu'il traversait, un lieutenant du peuple romain, mais un fléau dévastateur. Arrivé en Achaïe, (je me tais sur les crimes moins graves, tels que tout autre en eût pu commettre : je ne veux rien dire qui ne soit extraordinaire et qui ne parût incroyable d'un autre), il demande de l'argent au magistrat de Sicyone. Nous n'en faisons pas un crime à Verrès, d'autres en ont demandé comme lui. Le magistrat n'en donnant pas, il le punit : cela est odieux, mais n'est pas sans exemple. Apprenez le genre de punition, et vous jugerez quel homme est Verrès. Il fait allumer dans un espace étroit un feu de bois vert et humide: il y fait jeter un homme libre, appartenant à une famille noble dans le pays, ami et allié du peuple romain; et quand cet homme est presque étouffé par là fumée, il l'y laisse à demi mort. Quant aux statues, aux tableaux qu'il enleva de l'Achaïe, je n'en dirai rien ici, je me réserve d'exposer ailleurs les effets de cette passion de Verrès. Vous avez entendu parler de la quantité d'or enlevée du temple de Minerve, à Athènes : il en a été question dans le procès de Cn. Dolabella : que dis-je? on a même estimé la somme. Eh bien! vous trouverez que Verrès était non seulement le complice, mais le principal auteur de ce vol. XVIII. II arrive à Délos : là, pendant la nuit, il enlève du temple si révéré d'Apollon les statues les plus belles et les plus antiques, et les fait porter secrètement sur son vaisseau. Le lendemain, à la vue de leur temple dépouillé, les habitants de Délos furent saisis de douleur : car cet édifiée est d'une si haute antiquité, et ces peuples l'ont en si grande vénération qu'ils le regardent comme le lieu même où naquit Apollon : toutefois, ils n'osèrent se plaindre, dans la crainte que Dolabella n'y fût pour quelque chose. Alors, juges, il s'éleva tout à coup des tempêtes si violentes, que Dolabella, pressé de partir, ne pouvait ni se mettre en mer, ni même rester dans la ville, tant les vagues s'y précipitaient avec fureur. Soudain le vaisseau de ce pirate, chargé des images sacrées, vient se briser sur le rivage, lancé par lesflots. On retrouve parmi les débris ces statues d'Apollon; Dolabella les fait replacer : la tempête s'apaise; il s'éloigne de Délos. Non, Verrès, quoiqu'il n'y ait jamais eu en vous aucun des sentiments de l'humanité, que vous n'ayez jamais respecté la religion, je ne doute pas qu'en ce moment, au milieu des craintes et des dangers qui vous environnent, l'idée de vos crimes ne se présente à votre esprit. Pouvez-vous conserver la moindre espérance, quand vous vous rappelez toutes les impiétés, tous les sacrilèges dont vous vous êtes rendu coupable envers les dieux immortels? Vous avez osé dépouiller l'Apollon de Délos ! Vous avez porté vos mains souillées sur ce temple si antique, si auguste, si révéré ! Si, dans votre enfance, vos maîtres ne vous ont pas appris ce que les auteurs en ont dit dans leurs ouvrages, ne pouviez-vous pas, à votre arrivée dans ces lieux, recueillir ce que la tradition et l'histoire nous en ont transmis? Ne pouviez-vous pas savoir que Latone, longtemps errante et fugitive, pressée par la nature d'accoucher, se réfugia dans l'île de Délos, et y mit au monde Apollon et Diane? C'est ce qui a fait croire que Délos leur était consacrée; et tel est le respect que cette tradition inspire et a toujours inspiré, que les Perses eux-mêmes, lorsqu'ils déclarèrent la guerre aux dieux et aux hommes ainsi qu'à toute la Grèce, étant arrivés dans cette île avec mille vaisseaux, n'osèrent y commettre aucune violence. Et c'est là le temple que vous n'avez pas craint de dépouiller, vous le plus méchant, le plus insensé des hommes? Et il s'est trouvé un misérable assez avide pour donner l'exemple d'une pareille profanation? Si vous n'y songiez pas alors, osez nier aujourd'hui qu'il y ait un supplice si terrible que vos crimes ne l'aient pas mérité depuis longtemps. XIX. Enfin il arrive en Asie. Que dirai-je de ses repas, de ses festins, des chevaux, des présents qu'il y reçoit? Mais je ne dois pas m'arrêter à des faits ordinaires en parlant de Verrès. Ce que je dirai, c'est qu'il a enlevé d'admirables statues à Chio, et dans les villes d'Erythres et d'Halicarnasse; c'est qu'à Ténédos, sans parler de l'argent qu'il a pris, Ténès, lui-même, regardé par les Ténédiens comme leur divinité la plus sainte, Ténès, fondateur de leur ville, et qui lui a donné son nom, ce Ténès, chef-d'œuvre de sculpture, et que vous avez vu autrefois dans le Comitium, est devenu aussi la proie de sa rapacité, malgré le désespoir des citoyens. Mais lorsqu'il dépouilla le temple si ancien et si célèbre de Junon samienne, quel deuil pour les habitants de Samos! quelle douleur pour toute l'Asie! quelle nouvelle pour tous les peuples! qui de vous n'en a pas entendu parler? Des députés de Samos s'étant rendus en Asie auprès de Cn. Néron, pour se plaindre de cette spoliation, voici la réponse qu'ils en rapportèrent : que c'était à Rome qu'il fallait porter de pareilles plaintes contre un lieutenant du peuple romain, et non devant le préteur. Sur ce point, vous avez entendu Charidème de Chio déposer qu'étant commandant de vaisseau, et accompagnant Verrès à son départ de l'Asie, il avait été avec lui à Samos par ordre de Dolabella; qu'il savait que le temple de Junon et la ville de Samos avaient alors été pillés; que depuis, accusé par les Samiens, il avait dû se défendre devant ses concitoyens, et qu'il avait été absous, ayant prouvé que les crimes dont les Samiens demandaient justice n'avaient pas été commis par lui, mais par Verrès. Quels tableaux, quelles statues il a enlevés de cette île? je les ai vus, dans ses palais, lorsque je m'y rendis naguères pour y mettre le scellé. Et maintenant, Verrès, ces statues, où sont-elles? Je parle de celles que nous avons vues placées devant toutes les colonnes, et même dans les entre-colonnements, distribuées dans le parc, dans les jardins. Pourquoi donc y sont-elles restées tant que vous avez cru pouvoir compter sur un autre préteur et sur les juges que vous espériez vous choisir à la place de ceux-ci? Pourquoi, depuis que vous nous avez vus nous servir de nos témoins, plutôt que d'attendre l'heure qui pouvait être favorable, n'en avez-vous laissé aucune chez vous, excepté deux, qui elles-mêmes venaient de Samos? Vous n'avez donc pas songé que j'invoquerais ici le témoignage de vos meilleurs amis; de ceux qui se trouvaient le plus souvent chez vous; et que je leur demanderais s'ils n'y ont pas vu des statues qu'on a fait disparaître? Quel jugement attendiez-vous de ce tribunal qui voit que déjà vous ne vous défendez plus contre votre accusateur, mais contre le questeur de Rome et les enchérisseurs de vos biens? XX. On sait qu'il y a en Pamphylie une ville très ancienne et très célèbre, nommée Aspendus, remplie de chefs-d'oeuvre de sculpture. Je ne dirai pas qu'il en fut enlevé telle et telle statue :je dis, Verrès, que vous n'en avez pas laissé une seule. Toutes celles qui se trouvaient dans les temples ou dans les lieux publics ont été emportées sur des chariots, à la vue de tout le monde.Il a enlevé même ce fameux cithariste d'Aspendus dont vous avez souvent entendu parler et qui joue à la sourdine, comme dit certain proverbe grec. Eh bien, Verrès l'a placé dans la partie la plus secrète de sa maison, jaloux de paraître surpasser ce musicien, même dans l'art de jouer à la sourdine. Nous savons aussi que Perga possède un temple de Diane, très ancien et très révéré : vous avez pillé ce temple, Verrès, vous l'avez dépouillé; et j'affirme que vous avez arraché et enlevé à Diane elle-même tout l'or dont elle était couverte. Impie! Quelle est cette audace et cette démence? Si, au lieu d'entrer dans les villes de nos alliés et de nos amis, avec les droits et le titre de lieutenant du peuple romain, vous les aviez envahies les armes à la main, ce n'est pas chez vous, ce n'est pas dans les maisons de plaisance de vos amis, c'est à Rome que vous eussiez transporté les statues et les ornements conquis par vous. XXI. Que dirai-je de M. Marcellus, qui prit Syracuse, cette ville si magnifique? de L. Scipion, qui fit la guerre en Asie, et vainquit Antiochus, ce roi si puissant? de Flamininus, qui soumit le roi Philippe et la Macédoine? de L. Paullus, qui triompha du roi Persée, à force de valeur et de vertu? de L. Mummius, qui prit la ville la plus belle, la plus riche en objets d'art, Corinthe, cette magnifique cité qui réunit à l'empire et à la domination du peuple romain tant de villes d'Achaïe et de Béotie? Les maisons de ces grands hommes, toutes brillantes de leur vertu et de leur gloire, n'avaient ni statues, ni tableaux. Mais la ville entière, les temples des dieux, toutes les parties de l'Italie sont encore aujourd'hui décorés des monuments qu'ils ont offerts en dons. Le mépris du luxe était si général alors, qu'il semblait être moins une vertu particulière à quelques-uns, qu'un mérite commun à tous les citoyens. Si ces exemples paraissent surannés, citons l'illustre P. Servilius, qui s'est signalé par les plus grands exploits, membre de ce tribunal, et lequel prononcera sur votre sort. C'est lui qui, par son habileté, sa prudence et sa valeur, a emporté de vive force Olympe, ville ancienne, remplie de richesses et de chefs-d'oeuvre de tous genres. L'exemple que je cite de ce vaillant capitaine est tout récent; car Servilius, général du peuple romain, n'a pris Olympe, ville ennemie, que depuis le temps où, lieutenant et naguère questeur dans les mêmes lieux, vous avez pillé et ravagé les villes paisibles de nos alliés et de nos amis. Tous ces objets que vous avez arrachés des temples les plus saints d'une manière si odieuse et si criminelle, nous ne pouvons les voir que chez vous et chez vos amis; les statues et les ornements que P. Servilius a conquis dans une ville ennemie, par la force et par la valeur, qu'il en a enlevés en vertu du droit de la guerre, et comme général, ont été apportés à Rome par lui, amenés en triomphe et enregistrés avec soin au trésor publie. Apprenez par ces registres avec quelle exactitude cet illustre citoyen rendit les comptes. Lis: COMPTE RENDU DE P. SERVILIUS. Vous voyez comme on a consigné ici non seulement le nombre des statues, mais encore la grandeur, l'attitude, l'extérieur de chacune. Certes! les jouissances de la vertu et de la victoire sont bien supérieures à cette volupté que produisent les passions et la cupidité satisfaites!Je puis affirmer que Servilius conserve avec plus de soin l'état et la description de toutes ces dépouilles dont il a enrichi le peuple romain, que vous la liste de vos rapines. XXII. Vous direz, peut-être, que vos statues et vos tableaux ont aussi orné la ville et le forum du peuple romain. Oui, je m'en souviens, j'ai vu, ainsi que tout le peuple, le forum et la place des comices décorés d'ornements magnifiques à la vue, mais d'un aspect affligeant et lugubre pour l'âme et la pensée. J'ai vu briller partout vos rapines, le butin fait sur nos provinces, les dépouilles de nos alliés et de nos amis. Et c'est alors, juges, que Verrès conçut l'espérance de faire oublier ses autres crimes. Il vit ces hommes qui voulaient être reconnus comme maîtres des tribunaux, obéir en esclaves aux mêmes passions que lui. Mais c'est alors que les alliés et les nations étrangères commencèrent à désespérer de leurs biens et de leurs fortunes : car le hasard avait alors réuni à Rome un grand nombre de députés de l'Asie et de la Grèce, qui, reconnaissant dans le forum les statues de leurs dieux enlevées des temples, leur rendaient hommage en versant des larmes, et en prononçant ces paroles que nous avons tous entendues : « Il n'y a plus à douter de la ruine des nations alliées et amies, puisque dans le forum du peuple romain, dans ce lieu, où autrefois ceux qui avaient fait quelque injustice à ces nations étaient accusés et condamnés, on étalait à tous les regards les trésors enlevés et arrachés par le crime aux alliés ». XXIII. Verrès n'osera pas nier, je pense, qu'ilait en sa possession une foule de tableaux et de statues; c'est le fruit de ses rapines; mais il dira sans doute, suivant son habitude, qu'il les a achetés. Ainsi nous avions envoyé en Achaïe, en Asie, en Pamphylie, aux frais du trésor public et avec le titre de lieutenant, un marchand de statues et de tableaux ! J'ai entre les mains tous ses registres de recette et ceux de son père; je les ai lus et vérifiés avec la plus grande attention. J'ai, de votre père, les registres de toute sa vie; et de vous, ceux du temps où vous dites en avoir tenu. Car avec cet homme, juges, vous allez découvrir quelque chose de nouveau. Nous entendons dire qu'un homme n'a jamais tenu de registres; et c'est ce qu'on a dit d'Antonius; mais à tort, puisqu'il en a tenu fort exactement; j'accorde cependant qu'il y ait des exemples de cette négligence fort blâmable. On nous a cité un magistrat qui n'avait commencé les siens qu'à une certaine époque; cette conduite peut s'expliquer. Mais, ce qui est aussi nouveau que ridicule, c'est la réponse que nous a faite cet homme quand nous lui avons demandé ses registres. Il nous a dit qu'il en avait tenu jusqu'au consulat de M. Térentius et de C. Cassius; et qu'il avait cessé d'en tenir depuis. Quelle est la valeur de cette réponse? c'est ce que nous examinerons plus tard : peu m'importe en ce moment; car, pour l'époque dont je parle, j'ai entre les mains vos registres et ceux de votre père. Vous avez rapporté des provinces toutes les plus belles statues, les plus admirables tableaux, vous ne pouvez le nier; ou plutôt, que n'osez-vous le nier! Eh bien! montrez-nous par vos registres, ou par ceux de votre père, que vous avez acheté un seul de ces tableaux; et votre cause est gagnée. Vous ne pouvez pas même prouver comment vous avez acquis ces deux statues d'une beauté si parfaite, qui sont aujourd'hui à l'entrée de votre cour, et qui ont orné pendant si longtemps les deux côtés de la porte du temple de Junon samienne; je parle de ces deux statues seul reste de tant de chefs-d'oeuvre que vous avez fait vendre, qui sont encore dans votre palais en attendant l'enchérisseur. XXIV. Peut-être n'avait-il de passion que pour ces seuls objets; peut-être était-il raisonnable et modéré dans ses autres désirs. Mais de combien d'enfants de condition libre, de combien de mères de famille n'a-t-il pas outragé la pudeur durant cette infâme légation? Quelle est la ville où il a mis le pied, sans y laisser plus de traces de ses débauches que de ses pas? Mais je supprimerai tous les faits que l'on pourrait nier ; j'en négligerai même de certains et d'avérés. De tant d'infamies, je n'en choisirai qu'une, afin d'arriver plus promptement à la Sicile, puisque c'est la cause de cette province que je suis chargé de défendre. Sur les bords de l'Hellespont s'élève la ville de Lampsaque, une des plus renommées et des plus célèbres de l'Asie; les habitants, d'ailleurs pleins d'égards et de prévenances pour les citoyens romains, sont naturellement tranquilles et paisibles, plus jaloux que tous les autres Grecs de ce loisir qui fait leurs délices, et qu'ils ont toujours préféré au tumulte et à la violence. Verrès ayant obtenu, à force de prières, de Cn. Dolabella, d'être envoyé vers le roi Nicomède et le roi Sadala, ce qu'il avait sollicité bien plus dans son intérêt que dans celui de la république, arrive à Lampsaque, pour le malheur et presque pour la ruine de cette cité. On le conduit chez un certain Janitor, qui lui donne l'hospitalité; les personnes,de sa suite sont reçues chez d'autres citoyens. Aussitôt, selon sa coutume, et poussé par cet instinct qui le porte toujours au crime, il charge ses dignes compagnons, les plus corrompus et les plus infâmes des hommes, de voir, de chercher s'il n'y aurait pas une jeune fille ou une femme qui méritât de l'arrêter quelques jours à Lampsaque. XXV. Parmi ses compagnons était un certain Rubrius, homme créé tout exprès pour servir les passions de Verrès, et qui, partout où il allait, s'entendait merveilleusement à lui trouver de quoi les satisfaire. Il lui rapporte qu'il existe à Lampsaque un certain Philodamus, que sa naissance, sa réputation, ses richesses, et l'estime publique placent au premier rang dans la ville; que ce Philodamus a une fille qui demeure avec son père, n'étant pas encore mariée; qu'elle est d'une beauté rare, mais qu'elle a la réputation d'être aussi vertueuse que chaste. A ce récit, Verrès s'enflamme tellement pour cette femme qu'il n'a jamais vue, que son affidé lui-même n'a pas vue, qu'il veut, dit-il, aller sur-le-champ loger chez Philodamus. Janitor, son hôte, n'ayant aucun soupçon, mais craignant de lui avoir manqué en quelque chose, fait tous ses efforts pour le retenir : Verrès, ne pouvant trouver de prétexte pour l'abandonner, cherche un autre moyen d'en venir à son but. Il dit que Rubrius, son cher ami, son ministre et son confident pour toutes ces sortes d'affaires, n'est pas assez commodément logé; il le fait conduire chez Philodamus. Dès que Philodamus apprend cette résolution, il va trouver Verrès, ignorant tout le mal qu'on médite contre lui et ses enfants. Il lui représente que ce n'est point à lui de loger Rubrius; que, lorsque son tour vient de recevoir des hôtes, ce sont des consuls et des préteurs qu'il a coutume de recevoir, et non des gens de la suite des lieutenants. Verrès, que sa passion entraîne, ne veut rien entendre; il fait conduire d'autorité Rubrius chez celui qui ne devait pas être son hôte. XXVI. Philodamus, voyant qu'il ne pouvait obtenir justice, ne manqua pas à son urbanité ordinaire. Ayant toujours passé pour l'hôte le plus empressé, pour l'ami le plus dévoué de nos concitoyens, il ne voulut pas laisser croire que Rubrius lui-même eût été reçu malgré lui dans sa maison. Comme il était un des plus riches de la ville, il prépare un festin magnifique, et engage Rubrius à inviter tous ceux qu'il voudra; à ne laisser, si bon lui semble, de place que pour lui : il envoie même son fils, jeune homme fort distingué, souper chez un parent. Rubrius invite les gens de la suite de Verrès, qui les instruit de son dessein. Ils arrivent de bonne heure; on se met à table; la conversation s'engage, on s'excite mutuellement à boire à la grecque. L'hôte s'efforce d'entretenir la gaieté; on demande les grandes coupes; les joyeux propos circulent. Quand Rubrius voit qu'on est assez échauffé : Philodamus, dit-il, pourquoi ne pas faire venir ta fille ici? Philodamus, citoyen respectable par son âge, par ses mœurs, par son titre de père, reste confondu. Rubrius insiste. Philodamus, pour répondre quelque chose, dit qu'il n'est pas dans les moeurs des Grecs que les femmes paraissent dans un festin à côté des hommes. Un autre s'écrie alors: La sotte coutume; voilà qui n'est pas supportable! qu'on fasse venir la jeune femme! Et aussitôt Rubrius ordonne à ses esclaves de fermer la porte et de garder l'entrée de la salle. A cet ordre, le père comprend qu'il s'agit de l'honneur de sa fille; il appelle ses esclaves ; leur dit de la défendre sans s'occuper de lui; qu'un d'entre eux cependant coure avertir son fils du malheur qui menace la famille. Cependant des cris se font entendre dans toute la maison; un combat s'engage entre les esclaves de Rubrius et ceux de son hôte. On frappe, on terrasse dans sa propre maison un homme du premier rang, un personnage des plus honorables : chacun le maltraite à l'envi; enfin Rubrius lui-même inonde Philodamus d'eau bouillante. Le fils apprend ce qui se passe; hors de lui, il accourt défendre la vie de son père et l'honneur de sa soeur. A cette nouvelle, les habitants de Lampsaque sont saisis d'indignation. Ils arrivent en foule au milieu de la nuit, afin de venger l'outrage fait à Philodamus. Là Cornélius, licteur de Verrès, posté avec d'autres esclaves pour enlever la jeune fille, est tué; quelques esclaves sont blessés : Rubrius lui-même est blessé grièvement dans la mêlée. Quant à Verrès, voyant le tumulte excité par son crime, il cherchait partout un moyen de s'évader. XXVII. Le lendemain, dès le matin, on se rend à l'assemblée; on se demande quel est le meilleur parti à prendre; chacun, selon l'autorité dont il jouissait, prend la parole; il n'y eut personne qui ne fût persuadé et qui n'assurât qu'on pouvait être sans crainte; que le sénat et le peuple romain ne voudraient pas punir les habitants de Lampsaque pour avoir tiré vengeance du crime de ce misérable. Que si les lieutenants du peuple romain s'arrogeaient de tels droits sur les alliés et les nations étrangères, qu'il ne fût pas permis à un père de mettre l'honneur de ses enfants à l'abri de leur dépravation, il valait mieux tout souffrir que de vivre sous une tyrannie si odieuse et si violente. L'indignation étant générale, on se précipite vers la maison de Verrès : on commence à battre la porte à coups de pierres, à l'ébranler avec le fer, à y amasser du bois et des matières combustibles, et on y met le feu. Les citoyens romains, que leurs affaires retenaient à Lampsaque, accourent de tous côtés; ils prient les habitants de songer à la dignité de la lieutenance plutôt qu'à l'outrage du lieutenant : qu'ils voyaient bien que c'était un homme impur et exécrable, mais que, n'ayant pas réussi dans ses tentatives, et ne devant pas rester à Lampsaque, ils auraient moins à se repentir d'avoir épargné ce scélérat, que d'avoir tué le lieutenant du préteur. Ainsi cet homme bien plus criminel et bien plus pervers que ce fameux Adrien, fut encore plus heureux que lui. Celui-ci dont les citoyens romains n'avaient pu tolérer l'avarice, fut brûlé vif à Utique, dans son palais, et cette mort parut si méritée qu'on n'en rechercha pas les auteurs: Verrès, au contraire, à demi brûlé par nos alliés, a pourtant échappé aux flammes sans avoir pu nous dire jusqu'ici comment il s'était exposé à un si grand danger, ou quel accident l'y avait jeté. Il ne peut dire en effet que ce soit en voulant réprimer une sédition, en ordonnant une réquisition de blé, en levant une contribution ou en travaillant aux intérêts de la république; que c'est parce qu'il a commandé trop durement, parce qu'il a puni, menacé. S'excusât-il ainsi, il n'en mériterait pas plus d'indulgence, puisque c'est sa cruauté qui l'a précipité dans tous ces périls. XXVIII. Mais non; il n'osera nous dire ni la véritable cause de ce soulèvement, ni en inventer une fausse. En effet, P. Tettius, l'un des hommes les plus considérés de son ordre, et alors huissier de Néron, déclare avoir appris cet événement à Lampsaque; et C. Varron, personnage distingué par tous les genres de mérite, qui servait alors en Asie, comme tribun, dépose avoir entendu le même récit de la bouche de Philodamus. Pouvez-vous douter, d'après cela, qu'en sauvant l'accusé du péril qui le menaçait, la fortune ne l'ait réservé à votre justice? Mais peut-être répétera-t-il ce que disait Hortensius dans la première action, lorsqu'il interrompit la déposition de Tettius. Et Hortensius a bien fait voir dans cette occasion qu'il ne se tait pas quand il a quelque chose à dire, et que s'il garde le silence, c'est qu'il n'a rien à répondre. Il dit donc alors que Philodamus et son fils avaient été condamnés par C. Néron. Oui, mais Néron et son conseil ne se décidèrent que sur un fait constant : la mort de Cornelius. Ils pensèrent qu'aucun homme n'a le droit d'en tuer un autre, même pour se venger d'une injure. Tout ce que je vois par ce jugement, Verrès, c'est que vous n'êtes pas absous du crime qu'on vous reproche, et que Philodamus et son fils sont condamnés comme meurtriers. Cependant, quelle fut sa condamnation? écoutez, juges, je vous en prie; ayez enfin compassion de nos alliés, et montrez qu'ils doivent trouver quelque protection dans votre justice. XXIX. Toute l'Asie regardant comme un acte de justice le meurtre d'un homme soi-disant licteur de Verrès, mais en réalité le ministre de ses débauches, Verrès trembla que Philodamus ne fût acquitté par Néron; il prie, il conjure Dolabella de sortir de sa province et d'aller trouver Néron; il lui représente qu'il est perdu si Philodamus n'est pas condamné, s'il peut une fois venir à Rome. Dolabella fut ému : il commit cette faute, qui lui a attiré beaucoup de reproches. Dans l'intérêt du plus pervers de tous les hommes, il abandonne son gouvernement, une guerre commencée, et se rend en Asie, dans une province commandée par un autre. Arrivé près de Néron, il le presse d'instruire le procès de Philodamus. Il était venu lui-même pour faire partie du tribunal, et dire le premier son avis; il avait aussi amené ses préfets et ses tribuns militaires que Néron appela tous au conseil; on y voyait encore siéger, comme le juge le plus équitable, Verrès lui-même; puis quelques juges en toge, créanciers des Grecs, a qui la faveur du lieutenant était d'autant plus utile pour recouvrer leurs créances, que ce lieutenant était plus corrompu. L'infortuné Philodamus ne pouvait trouver de défenseur. En effet, quel Romain eût bravé le crédit de Dolabella, quel Grec n'eût été intimidé par son autorité? Cependant on charge du rôle d'accusateur un citoyen romain, créancier des habitants de Lampsaque, et qui était sûr d'avoir des licteurs pour se faire payer, s'il parlait au gré de Verrès. Eh bien! malgré l'acharnement qu'on mettait à cette affaire; malgré tous les moyens employés contre un infortuné que tant de gens accusaient et que personne ne défendait; malgré les efforts de Dolabella et de son lieutenant, dans le conseil; malgré Verrès, qui répétait qu'il y allait de sa fortune, qui déposait comme témoin, soutenait l'accusateur qu'il avait mis en avant, et délibérait comme juge; malgré tant de manoeuvres et la certitude d'un meurtre commis, la violence et la perversité de Verrès parurent si monstrueuses qu'on ordonna une nouvelle information. XXX. Rappellerai-je maintenant l'ardeur de Cn. Dolabella dans la seconde action, et les larmes, les supplications de Philodamus? l'embarras de C. Néron, le meilleur et le plus doux des hommes, mais quelquefois trop timide et trop facile? Il n'avait guère d'autre parti à prendre que de conduire l'affaire sans l'intervention de Verrès et de Dolabella, comme on le désirait généralement; toute décision rendue sans leur concours eût été approuvée, tandis qu'on regarda la sentence plutôt comme ayant été arrachée par Dolabella, que prononcée par Néron. En effet, Dolabella était présent, lorsque Philodamus et son fils furent condamnés, à une très faible majorité. Il s'agitait, il pressait, pour qu'ils fussent frappés de la hache avant qu'un trop grand nombre de témoins pût apprendre de la bouche des victimes le forfait de Verrès. On vit alors, sur la place publique de Laodicée, le spectacle le plus cruel, le plus déplorable, le plus propre à effrayer toute la province de l'Asie, un père, respectable par son âge, et son fils conduits au supplice, pour avoir défendu, l'un la pudeur de ses enfants, l'autre la vie de son père et l'honneur de sa soeur. Ils pleuraient tous deux, non pas sur leur propre supplice, mais le père sur la mort de son fils, le fils sur la mort de son père. Que de larmes versa Néron lui même! quelle désolation dans toute l'Asie! quel deuils quels gémissements à Lampsaque! La hache avait donc frappé deux hommes innocents, de condition noble, alliés et amis du peuple romain, sacrifiés à l'étrange perversité, à la brutale passion du plus infâme des hommes. Non, Dolabella, non; désormais on ne peut plus avoir de compassion ni pour vous ni pour vos enfants, que vous avez laissés dans l'infortune, la misère et l'abandon! Mais ce Verrès, qu'était-il donc à vos yeux, pour avoir voulu laver sa honte dans le sang innocent? Pour que vous ayez quitté votre armée, oublié l'ennemi, afin d'enlever au péril, à force d'injustice et de cruauté, le plus méchant de tous les hommes? Parce que vous vous l'étiez donné pour questeur, avez-vous pensé qu'il serait à jamais votre ami? Ne saviez-vous pas que le consul Cn. Carbon, dont il était le véritable questeur, avait été abandonné par lui, dépouillé de secours, d'argent, attaqué et trahi avec indignité? Aussi avez-vous éprouvé vous-même la perfidie de ce misérable, lorsqu'il est passé du côté de vos ennemis, qu'il a porté contre vous le plus violent témoignage, tout coupable qu'il était; lorsqu'il n'a voulu enfin rendre ses comptes qu'après votre condamnation. XXXI. Et vous, Verrès, et vous, vos passions seront-elles si grandes que les provinces romaines, les nations étrangères ne puissent ni les supporter, ni leur suffire? Quoi donc ! dès que vous aurez vu quelque objet, que vous en aurez entendu parler, que vous l'aurez désiré, que vous y aurez pensé, s'il ne se présente au moindre signe, s'il ne s'abandonne à vos désirs, à votre fureur, il faudra que vos satellites soient envoyés, que les maisons soient forcées? que des peuples en paix avec nous, nos alliés et nos amis, aient recours à la force des armes pour écarter de leur personne et de leurs enfants la scélératesse et la brutalité d'un lieutenant du peuple romain? Car, je vous le demande, n'avez-vous pas été assiégé à Lampsaque? Cette multitude ne voulut-elle pas incendier la maison où vous étiez logé? brûler vif un lieutenant du peuple romain? Vous ne pouvez le nier : j'ai entre les mains votre propre témoignage, celui que vous avez rendu devant Néron; j'ai la lettre que vous lui avez envoyée. Lisez cet endroit de la déposition: Déposition de C. Verrès contre Artémidorus. Lisez ce passage de la lettre de Verrès à Néron : Extrait de la lettre de C. Verrès à C. Néron. « Bientôt, dans la maison ... » La population de Lampsaque aurait-elle songé à faire la guerre au peuple romain? à se soustraire à notre empire? Je vois en effet, et je sais par l'histoire, et la tradition, que lorsque un lieutenant du peuple romain a été, je ne dirai pas assiégé, assailli par le fer, par le feu, par des troupes armées, mais seulement insulté dans une ville, la coutume est de déclarer la guerre à cette ville et de la traiter comme rebelle, si elle se refuse à une satisfaction publique. Quel est donc le motif qui porta tous les citoyens de Lampsaque à quitter l'assemblée, comme vous l'avez écrit vous-même, pour courir à votre maison? car, ni dans votre lettre à Néron, ni dans votre déposition, vous n'indiquez le motif d'un si grand tumulte : vous dites que vous avez été assiégé dans votre maison; qu'on y a apporté du feu, que du bois a été amassé à l'entour, que votre licteur a été tué, qu'il ne vous a plus été possible de paraître en public; et vous nous cachez la cause d'une si grande terreur. En effet, ils seraient venus pour se plaindre, et non pour vous assiéger, si Rubrius eût agi de son chef, si ce n'était pas par votre ordre, et pour servir votre passion, qu'il eût commis cette violence. Et maintenant que nos témoins ont révélé la cause de ce tumulte, que faut-il de plus pour croire à mes paroles, que leur déposition et l'opiniâtreté de son silence? XXXII. Juges, épargnerez-vous un homme dont les excès ont été si odieux, que ses victimes n'ont pu attendre le moment légal de la vengeance, ni contenir pour un temps la violence de leur douleur? vous avez apparemment été assiégé! par qui? par des barbares, ou par une nation qui méprisait le nom romain? Non, mais par des peuples que leur naturel, leurs moeurs, leur éducation, ont rendus les plus doux des hommes; les alliés du peuple romain par leur condition, ses sujets par les chances de la fortune, ses suppliants par l'inclination. Il est donc évident que si l'outrage n'eût pas été assez cruel, le crime assez horrible pour que les Lampsaciens préférassent la mort à l'idée d'une pareille tyrannie, ils n'en seraient jamais venus à ce point, que la haine pour le coupable leur fit oublier le respect dû au lieutenant du peuple romain. Au nom des dieux immortels, ne forcez pas les alliés et les nations étrangères à user de ce dernier moyen : car il faut qu'ils y recourent, si vous ne voulez pas leur faire justice. Rien n'aurait apaisé les habitants de Lampsaque, s'ils n'eussent été sûrs que Verrès recevrait à Rome son châtiment. Quoiqu'il n'y ait pas de loi au monde qui puisse venger une pareille injure, cependant ils ont mieux aimé se confier à nos lois et à nos tribunaux que d'écouter leur ressentiment. Répondez-moi, Verrès, quand vous avez forcé les habitants d'une ville si illustre à vous assiéger dans votre maison; quand vous les avez réduits à recourir à la force et à prendre les armes, comme s'ils n'espéraient plus rien de nos lois et de nos tribunaux ; quand vous vous êtes montré dans les villes et les cités de nos amis, non comme un lieutenant du peuple romain, mais comme un tyran débauché et cruel; quand vous avez avili chez les nations étrangères la gloire de l'empire et du nom romain, par votre conduite honteuse et déshonorante; quand vous vous êtes soustrait au glaive de nos amis et aux flammes qu'ils avaient allumées : vous espérez trouver ici un asile. Vous vous trompez. C'est parce qu'ils étaient sûrs que vous devriez y trouver votre perte et non pas le repos, qu'ils vous ont laissé échapper de leurs mains. XXXIII. Mais, dites-vous, il a été prouvé par un jugement que les habitants de Lampsaquem'ont injustement condamné, puisque Philodamus et son fils ont été condamnés; et si je prouve, moi, si je démontre par le témoignage d'un homme méprisable sans doute, mais qui doit être écouté dans cette affaire, je veux dire par votre propre témoignage, que vous avez imputé à d'autres la cause de cet attroupement, que c'est sur d'autres que vous en avez rejeté la faute, que ce ne sont pas ceux-là qui ont été punis; si je prouve cela, dis-je, à quoi vous sert le jugement de Néron? Lisez la lettre qu'il a écrite à Néron : Lettre de C. Verrès à Néron. Thémistagoras et Thessalus ... Vous lui dites que Thémistagoras et Thessalus ont excité le peuple. Quel peuple? celui qui vous a tenu assiégé, celui qui a voulu vous brûler vif. Eh bien! où poursuivez-vous les coupables? où les accusez-vous? où défendez-vous vos droits et votre titre de lieutenant? Vous direz que cela a été traité dans le procès de Philodamus. Lisez le témoignage de Verrès lui-même; voyons ce qu'il a déposé sous la foi du serment. Interrogé par l'accusateur, il a répondu qu'il ne voulait pas occuper ce tribunal de cette affaire, qu'il la poursuivrait dans un autre temps. Qu'y a-t-il donc de favorable pour vous dans le jugement de Néron, dans la condamnation de Philodamus? Ainsi, vous, lieutenant, lorsque vous venez d'être assiégé, lorsqu'on a fait, comme vous l'écrivez vous-même à Néron, un outrage insigne au peuple romain et à tous les lieutenants, vous ne songez pas à poursuivre; votre intention, dites-vous, est d'ajourner cette affaire à un autre temps. Et quel a été cet autre temps? à quelle époque avez-vous poursuivi? Pourquoi avez-vous laissé perdre vos droits de lieutenant? pourquoi avez-vous déserté? pourquoi avez-vous trahi la cause du peuple romain? pourquoi avez-vous négligé vos injures quand il s'y joignait des injures publiques? Ne deviez-vous pas déférer cette cause au sénat; lui demander justice de ces attentats; faire citer devant lui par l'ordre des consuls les agitateurs du peuple? M. Émilius Scaurus ayant écrit dernièrement qu'à Éphèse on l'avait empêché, lui questeur du peuple romain, d'emmener du temple de Diane son esclave qui s'y était réfugié, qu'on avait même usé de violence envers lui, Périclès, noble Éphésien, fut cité à Rome, à la requête du questeur, comme le principal auteur de cette injure. Si vous aviez instruit le sénat de ce qui s'était passé à Lampsaque, des violences qu'on vous avait faites; si vous lui aviez écrit qu'au mépris de votre dignité, les habitants avaient tué votre licteur, blessé ceux qui l'accompagnaient, assiégé votre maison; qu'ils vous avaient presque brûlé vif, et que les instigateurs, les chefs de cette rébellion étaient ceux que vous désignez dans votre lettre, Thémistagoras et Thessalus; qui n'eût été indigné? qui n'eût, en les punissant, pourvu à sa sûreté personnelle? qui n'eût pas vu dans votre cause la cause de tous? En effet, un lieutenant du peuple romain doit être assez respecté pour n'avoir rien à craindre, je ne dirai pas chez des alliés, mais même au milieu des ennemis. XXXIV. Le crime dont vous vous êtes souillé à Lampsaque, par excès de débauche et d'impudeur, est bien grand; mais apprenez un trait qui, dans son genre, ne lui cède en rien. Verrès demande aux citoyens de Milet un vaisseau pour l'escorter jusqu'à Mynde. Les Milésiens choisissent le plus beau brigantin de leur flotte, et le lui donnent tout armé, tout équipé. Il part pour Mynde avec cette escorte : car je ne dirai rien des laines qu'il a enlevées des magasins publics de Milet, ni des frais de réception à son arrivée, ni des injustices, ni des outrages qu'il fit éprouver au magistrat de cette ville, bien qu'on en puisse parler avec toute la force imaginable sans nuire à la vérité. Toutefois je n'en dirai rien, je le répète. Je veux laisser tous ces détails aux témoins. Mais écoutez ce fait, qu'il n'est pas possible de taire, quoiqu'on n'en puisse parler comme il convient. Il ordonne aux soldats et aux rameurs de s'en retourner à pied de Mynde à Milet : quant au vaisseau des Milésiens, le plus beau de leurs dix navires, il le vend à L. Magius et à L. Rabius, qui habitaient à Mynde. Ces deux hommes sont ceux que le sénat a déclarés naguère ennemis de la république; c'est sur ce bâtiment qu'ils allaient et venaient chez tous nos ennemis depuis Dianium, qui est en Espagne, jusqu'à Sinope, qui fait partie du royaume de Pont. Dieux immortels! peut-on croire à une telle avarice, et vit-on jamais une pareille audace? quoi ! vous avez osé vendre un vaisseau de la flotte du peuple romain, un vaisseau que la cité de Milet vous avait donné pour vous conduire! Si l'énormité du crime, si l'opinion publique ne vous ont pas effrayé, vous ne pensiez donc pas qu'un vol aussi effronté, qu'une piraterie aussi abominable seraient attestés par cette noble et illustre ville? Et, parce que Cn. Dolabella voulut, sur votre prière, punir le commandant du brigantin qui avait rendu compte de tout aux Milésiens ; parce qu'il ordonna de faire disparaître ce rapport des registres de la ville où il était inscrit d'après les lois du pays, pensiez vous échapper à cette accusation? XXV. Vous avez été la dupe de cette confiance dans beaucoup d'occasions; car vous avez toujours pensé, surtout en Sicile, qu'il vous suffirait, pour votre sûreté, d'empêcher que certaines choses ne fussent écrites sur les registres publics, ou de les faire disparaître quand elles s'y trouvaient. Quoique vous ayez appris dans la première action, par l'exemple de plusieurs cités de Sicile, combien cette précaution est vaine, apprenez-le encore par l'exemple de Milet. Les Milésiens obéirent, il est vrai, aux magistrats, tant que ceux-ci furent présents; mais les voyant partis, ils inscrivirent sur les registres non seulement ce qu'on leur avait défendu de rapporter, mais encore la raison qui les avait empêchés de l'écrire plus tôt. Ces registres sont à Milet; ils y sont et ils y seront tant que subsistera cette ville. En effet, les Milésiens avaient construit, d'après les ordres de L. Muréna, dix navires à compte sur la contribution qu'ils doivent au peuple romain, comme l'avaient fait les autres cités de l'Asie, chacun suivant le nombre qu'elles avaient à fournir. Ayant perdu un de ces dix navires, non par une attaque soudaine de pirates, mais par le brigandage du lieutenant; non par la violence d'une tempête, mais par la cupidité de cet homme, cupidité plus désastreuse que la tempête pour nos alliés; ils en ont dressé procès-verbal sur leurs registres. Les députés de Milet sont à Rome. Ce sont les citoyens les plus nobles et les premiers de leur ville; et bien qu'ils attendent avec terreur le mois de février et le nom des consuls désignés, ils ne pourront nier un fait si grave lorsqu'ils seront interrogés, encore moins le taire lorsqu'ils paraîtront; ils déclareront, dis-je, par respect pour la religion du serment , et pour les lois de leur pays, ce qu'on a fait de ce brigantin; ils montreront que C. Verrès en a usé comme un pirate à l'égard d'une flotte construite contre les pirates. XXXVI. A la mort de C. Malléolus, questeur de Cn. Dolabella, Verrès crut voir arriver pour lui deux successions : d'abord une questure, car Dolabella le fit aussitôt son proquesteur; puis, une tutelle : se trouvant tuteur du jeune Malléolus, il se hâta d'usurper les biens de son pupille. En effet, le père, en partant pour sa province, avait emporté presque toutes ses richesses; il ne laissait presque rien chez lui; il avait encore placé dans différentes villes de l'argent dont il avait des billets; enfin il avait fait venir toute son argenterie, qui était fort belle; car il partageait avec Verrès, sou ami, ce goût ou plutôt cette passion. Il laissait donc beaucoup d'argent comptant, une maison considérable, et de nombreux esclaves, remarquables les uns par leurs talents, les autres par leur beauté. Celui-ci prit tout l'argent qu'il voulut, emmena les esclaves qui lui plaisaient, fit porter chez lui les vins et les autres objets qu'on se procure aisément en Asie, vendit le reste et s'en fit bien payer. Quoiqu'il fut constant qu'il avait réalisé jusqu'à deux millions cinq mille sesterces, de retour à Rome, il n'en remit aucune reconnaissance ni au pupille, ni à la mère, ni aux tuteurs : ceux des esclaves de son pupille qui avaient des talents, étaient employés dans sa maison; ceux qui avaient de la figure ou de l'instruction, étaient attachés au service de sa personne; il disait qu'ils lui appartenaient, qu'il les avait achetés. L'aïeule et la mère le pressant, puisqu'il ne voulait rendre ni comptes ni argent, de dire au moins quelle somme il avait rapportée des fonds de Malléolus; il finit par répondre : un million; puis au bas d'une page de son registre, à la dernière ligne, sur la rature même, preuve honteuse de sa mauvaise foi, il écrivit qu'il avait dépensé et remis à l'esclave Chrysogonus six cent mille sesterces, reçus au nom de son pupille Malléolus. Comment un million de sesterces se trouve-t-il réduit à six cent mille? Comment six cent mille sesterces formaient-ils juste le montant de la succession, de telle manière que le reste de l'argent destiné à Cn. Carbon fût aussi de six cent mille sesterces? Comment cette somme a-t-elle été délivrée à Chrysogonus? Pourquoi le nom d'un esclave sur ce registre écrit à la dernière ligne, et sur une rature? vous en jugerez. Il reconnaît avoir reçu six cent mille sesterces, et cependant il n'en a pas payé cinq mille. Quant aux esclaves, depuis qu'il est accusé, il a rendu les uns, et retient encore les autres, ainsi que leur pécule et leurs suppléants. XXXVII. Telle est l'admirable tutelle de Verrès ! Voilà l'homme à qui vous pouvez confier vos enfants; voilà comme on se souvient d'un ami après sa mort, et comme on respecte l'opinion des vivants! Quoi! l'Asie entière s'était livrée à vos vexations et à votre cupidité, toute la Pamphylie était ouverte à vos brigandages, et vous ne vous êtes pas contenté de si riches dépouilles! Il vous a fallu encore porter la main sur les biens d'un pupille, du fils d'un ami! Ce ne sont plus les Siciliens, ni les laboureurs, comme vous le dites sans cesse, qui viennent vos assaillir; ce ne sont plus ceux que vos décrets et vos édits ontsoulevés contre vous; c'est Malléolus que je vous cite; c'est sa mère, son aïeule, qui, accablées de douleur, les larmes aux yeux, ont déclaré que vous aviez dépouillé cet enfant des biens de son père. Qu'attendez-vous donc? que Malléolus sorte des enfers, et. réclame de vous les devoirs de la tutelle, de l'amitié, de la confraternité? voyez-le paraître pour vous dire : « Monstre d'avarice, homme infâme, rends au fils d'un collègue les biens de son père, sinon ceux que tu as détournés, au moins ceux que tu as reconnus. Pourquoi réduis-tu le fils de ton ami à ne faire entendre pour la première fois qu'il parle en public que des gémissements et des cris de douleur? Pourquoi forces-tu la veuve de cet ami, sa belle-mère, toute sa maison, à rendre témoignage contre toi? Pourquoi forces-tu des femmes d'une si grande pudeur et d'un rang si élevé à paraître malgré elles, contre leur habitude, au milieu de tant d'hommes assemblés? » Qu'on lise toutes leurs dépositions : Témoignage de la mère et de l'aïeule. XXXVIII. Et comme proquesteur, quelles vexations n'a-t-il pas exercées sur la commune des Milyades? combien n'a-t-il pas écrasé la Lycie, la Pamphylie, la Pisidie, et toute la Phrygie par ses réquisitions de blé, se faisant payer soit en nature soit en argent, d'après ce système d'évaluations qu'il imagina alors, et qu'il a si bien appliqué depuis en Sicile. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans tous ces détails. Sachez seulement que pour ces articles qui passaient par ses mains dans le temps où il obligeait les cités à lui fournir du blé, des cuirs, des sacs, des habits de matelots, ne prenant rien de tous ces objets dont il se faisait donner la valeur; que pour ces seuls articles, dis-je, Cn. Dolabella fut condamné à une amende de trois millions de sesterces. Dans toutes ces affaires, c'était Dolabella qui paraissait ordonner, mais c'était Verrès qui faisait tout. Je m'arrêterai à un article : car il y en a bien d'autres du même genre. Lisez : Sommes réalisées sur les amendes auxquelles a été condamné le préteur Dolabella. Commune des Myliades ... Oui, Verrès, je soutiens que tout cela a été exigé par vous, évalué par vous, payé entre vos mains; que vous avez ravi des sommes immenses, extorquées partout avec la même violence et la même tyrannie, lorsque vous parcouriez votre province comme un ouragan, comme un fléau dévastateur. Aussi M. Scaurus, qui accusa Dolabella, eut-il soin de s'assurer de Verrès. Ce jeune homme qui, dans le cours de ses informations, avait découvert la plupart de ses rapines et de ses infamies, se conduisit avec autant d'adresse que d'habileté : il lui montra un énorme rouleau contenant les preuves de ses vols, et tira de lui tout ce qu'il voulut contre Dolabella; il le fit paraître comme témoin, et Verrès déposa dans le sens qu'il croyait le plus conforme aux désirs de l'accusateur. Si j'avais voulu faire usage de cette espèce de témoins, complices des vols de l'accusé, j'en aurais trouvé un grand nombre qui, pour se soustraire au danger des poursuites ou de la complicité, me promettaient de dire tout ce qui me plairait. Mais j'ai repoussé tous ces auxiliaires si pleins de bonne volonté; je n'ai reçu dans mon camp ni traître ni déserteur. Peut-être ceux qui emploient de pareils moyens passeront-ils pour des accusateurs plus habiles que moi; mais ce que je veux avant tout, c'est qu'on loue le défenseur en ma personne, et non l'accusateur. Avant que Dolabella ait été accusé, Verrès n'ose présenter ses comptes au trésor publie; il obtient du sénat un délai, sous prétexte que ses registres ont été mis sous le scellé par les accusateurs de Dolabella : comme s'il ne lui était pas permis d'en prendre copie. Il est le seul qui ne rende jamais de compte au trésor. XXXIX. Vous avez entendu que le compte de la questure a été rendu en trois lignes; celui de là lieutenance, seulement après la condamnation et l'exil de l'homme qui pouvait le contredire :enfin, celui de la préture qui, d'après un sénatus-consulte, devait être rendu sur-le-champ, ne l'a pas encore été jusqu'ici. Il a dit dans le sénat qu'il attendait un de ses questeurs, comme si, lorsqu'un questeur peut rendre ses comptes sans son préteur, un préteur ne pouvait (ainsi que vous l'avez fait, Hortensius, et tous les autres) rendre les siens sans son questeur. Il a cité l'exemple de Dolabella. Les sénateurs ont trouvé le présage meilleur que la cause; ils ont accordé. Mais les questeurs sont arrivés depuis longtemps; pourquoi n'avez-vous pas tenu votre promesse? Dans ces comptes, qu'il faut examiner à travers la fange de votre lieutenance et de votre questure, se trouvent ces articles qui ont été imputés nécessairement à Dolabella : Sommes réalisées sur l'amende à laquelle Dolabella, préteur du peuple romain, a été condamné. Dolabella déclare dans ses comptes qu'il a reçu de Verrès cinq cent trente-cinq mille sesterces de moins que Verrès, et que Verrès au contraire a reçu de lui deux cent trente-deux mille sesterces de plus que ne le portent les livres; qu'enfin Verrès a perçu en blés un million huit cent mille sesterces de plus que ne l'indiquent les registres. Et voilà comment se sont grossies ces sommes immenses dont la source est ignorée, mais se découvre pourtant par quelques indices; de là ces comptes ouverts chez Quintus et Cnéus Curtius Postumus, sous plusieurs noms dont aucun ne figure sur les registres; de là, ces quatre millions de sesterces comptés à P. Badius, d'Athènes, comme je le prouverai par témoins; de là cette préture si publiquement achetée : à moins qu'on ne demande encore de quelle manière il est devenu préteur. Sans doute c'est par ses talents, ses services, par une grande réputation d'intégrité, ou par son assiduité, ce qui serait la moindre chose; lui qui, avant sa questure, n'avait vécu qu'avec des courtisanes et des entremetteurs; qui depuis s'était conduit comme vous avez vu ; qui, après cette questure abominable, était à peine resté trois jours à Rome où il ne s'était pas fait oublier, quoique absent, se rappelant au souvenir de tout le monde par ses infamies : voilà l'homme qui, de retour, ne pouvait manquer sur-le-champ d'être élevé gratuitement à la préture? D'autres sommes ont encore été données pour qu'on ne l'accusât point : à qui? cela ne fait rien, je pense, ni à moi, ni à la cause; mais qu'elles aient été données, c'est ce dont personne n'a douté dès le commencement de l'affaire. Homme absurde et insensé! Quand vous arrangiez vos comptes, et que vous vouliez éviter d'être poursuivi à cause de ces richesses dont l'origine était si extraordinaire, vous croyiez donc échapper à tous les soupçons en n'inscrivant sur vos registres ni les noms de ceux à qui vous aviez confié vos fonds, ni les reconnaissances qu'ils vous avaient faites, tandis que les Curtius marquaient sur les leurs tant de sommes dont ils se reconnaissaient débiteurs envers vous. Que vous servait-il de ne pas écrire tout cela? vous imaginiez-vous qu'on vous jugerait sur vos seuls registres? XL. Mais venons enfin à cette merveilleuse préture, à ces faits si odieux, plus connus de ceux qui m'entourent que de moi-même, qui ne me présente ici qu'après les avoir examinés avec tant de soin; encore suis-je certain, malgré mon attention, de ne pouvoir éviter le reproche de négligence. Bien des gens s'écrient: « Eh, quoi! il ne parle pas de cette affaire où j'étais présent; il ne dit pas un mot de cette injustice faite à mon ami, à moi-même ! » Je supplie donc tous ceux qui connaissent les indignités de cet homme, c'est-à-dire, tout le peuple romain, de m'excuser et de croire que, si j'omets beaucoup de choses, ce ne sera point par négligence, mais parce que je veux laisser aux témoins le soin de les faire connaître, et que si je parais en oublier beaucoup d'autres, c'est afin de ménager le temps. Je ferai même cet aveu malgré moi : comme il n'y a pas un instant de la vie de Verrès qui ne soit marqué par une mauvaise action, je n'ai pu connaître toutes celles qu'il a commises. Ainsi, en écoutant mon accusation, n'exigez de moi, lorsque je l'attaquerai soit sur la manière dont il a administré la justice, soit sur l'entretien des édifices publics, que des choses dignes d'un accusé à qui l'on ne peut reprocher rien de petit, rien de médiocre. Verrès fut donc élu préteur au moment où il quittait la belle Chélidon, après y avoir pris les auspices, et le sort, plus favorable à ses désirs et à ceux de Chélidon qu'aux voeux du peuple romain, lui fit obtenir le département de la ville. Vous allez juger, par son début, quelle jurisprudence il y établit. XLI. P. Annius Asellus vint à mourir sous la préture de C. Sacerdos. Comme il avait une fille unique, et qu'il n'était point inscrit sur les registres du cens avant sa mort, il fit ce que lui commandait la nature, et ce que ne lui défendait aucune loi; il institua sa fille sa légataire universelle. Elle était héritière naturelle, et avait tout en sa faveur, les lois, l'équité, la volonté d'un père, les édits des préteurs, la jurisprudence en usage à l'époque où mourut Asellus; Verrès était préteur désigné : était-il averti, avait-on voulu l'éprouver, ou n'est-ce que l'effet de cette sagacité odieuse qui, sans guide, sans trace quelconque, l'a conduit naturellement à cet acte inique? je l'ignore; qu'il vous suffise de connaître l'audace et l'aveuglement de cet homme. Il s'adresse à L. Annius, qui devait hériter au défaut de la jeune fille; car on ne me persuadera pas qu'il ait été d'abord sollicité par lui : il le prévient que, par un édit, il peut lui faire présent de la succession, et lui indique la conduite qu'il doit tenir. L'un trouvait la chose bonne à prendre, l'autre, bonne à vendre. Celui-ci, malgré son audace, ne laissait pas d'envoyer en secret chez la mère de la pupille. Il aimait encore mieux recevoir pour ne rien innover dans ses ordonnances que pour porter un édit si odieux et si révoltant. Mais les tuteurs n'osaient donner de l'argent au préteur sur les biens de leur pupille, surtout une somme considérable, ne voyant pas de quelle manière ils pourraient la faire entrer dans leurs comptes, et la distraire de l'héritage sans se compromettre : ils ne pouvaient non plus croire à tant de perversité. Sollicités à diverses reprises, ils persistèrent dans leur refus. Excité alors par celui à qui il abandonnait une succession arrachée à des enfants, il rend ce décret dont vous allez connaître toute l'équité : « Persuadé que la loi Voconia ... » Qui aurait jamais pensé que Verrès se déclarât contre les femmes? Ou s'il a rendu une ordonnance contre elles, ne serait-ce pas pour faire croire que Chélidon ne lui dictait pas tous ses édits? Il veut, dit-il, prévenir la cupidité des hommes. Qui l'a mieux prévenue non seulement de nos jours, mais au temps de nos ancêtres? Qui a montré autant de désintéressement? Lisez , de grâce, tout le reste : j'aime fort la gravité de l'homme, sa science du droit, l'autorité de ses paroles : Quiconque, pendant et depuis la censure d'A. Postumius et de Q. Fulvius, a fait ou fera ... a fait ou fera ! Qui a jamais publié un pareil édit? qui a jamais décrété des peines, pour des crimes antérieurs à l'édit qui les punit et commis dans un temps où il était impossible de les prévoir? XLII. Suivant le droit, les lois, l'autorité des jurisconsultes, P. Annius avait fait un testament qui ne violait ni la justice, ni les devoirs de la nature et de l'humanité. Et quand il eût fait le contraire, était-ce une raison pour rendre un nouvel édit à propos de son testament? La loi Voconia vous plaisait beaucoup, sans doute? que n'avez-vous imité Q. Voconius lui-même, qui ne priva aucune fille, aucune femme des successions qui leur étaient dévolues, et ne permit de tester en leur faveur qu'à ceux qui auraient fait leur déclaration depuis la censure de Postumius ? Dans la loi Voconia, il n'y a point : a fait ou fera; et même dans aucune loi on ne revient sur le passé, si ce n'est pour des actes si criminels et si odieux, qu'en l'absence même de toute loi on doit s'en abstenir. Nous en voyons beaucoup que les lois ont défendus sans rechercher ceux qui s'en étaient rendus coupables auparavant. Ainsi les lois de Sylla sur les testaments, sur, les monnaies, et sur quantité de matières, n'établissent pas une jurisprudence nouvelle; elles ordonnent que toute action coupable, et qui a toujours été considérée comme telle, soit déférée au peuple, à dater d'une certaine époque. Et, pour le civil, celui qui établit une loi nouvelle, voudrait détruire tout ce qui s'est fait auparavant ! Consultez les lois Atinia, Furia, la loi Voconia dont nous parlons, et toutes celles de droit civil; vous trouverez que toutes ces lois ne sont obligatoires que du jour de leur promulgation. Mais ceux qui accordent le plus d'autorité au préteur, déclarent eux-mêmes que ses édits n'ont de force que pendant un an; et vous, vous voudriez que votre édit durât plus que la loi! Si les calendes de janvier mettent fin au pouvoir de l'édit, pourquoi ce pouvoir ne commence-t-il pas aussi aux calendes de janvier? Il n'est pas permis à un préteur d'empiéter par un édit sur l'année de son successeur, et il lui serait permis de revenir sur celle de son prédécesseur! XLIII. Ensuite, si vous n'aviez pas établi cette jurisprudence dans l'intérêt d'un seul, vous auriez rédigé l'édit avec plus de précaution. Vous dites : QUICONQUE A FAIT OU FERA HÉRITIER ... Mais que direz-vous si on a légué à l'héritier ou aux héritiers plus qu'il ne leur revient, bien que la loi Voconia le défende à ceux qui se font inscrire sur le registre des censeurs? Pourquoi n'a-vez-vous pas prévu ce cas, qui est à peu près le même? C'est que vous ne vous êtes pas soucié de l'intérêt général dans votre édit, mais de l'intérêt d'un seul; preuve évidente que l'argent vous faisait parler. Encore cet édit serait-il moins blâmable, si vous l'aviez rendu pour l'avenir, quoiqu'il ne cessât pas d'être injuste; on pourrait l'attaquer, mais on ne suspecterait pas les motifs qui vous l'ont fait rendre ; personne ne s'y exposerait; tandis qu'il suffit de le voir pour comprendre qu'il n'a pas été fait dans l'intérêt du peuple, mais des héritiers substitués de P. Annius. Aussi, malgré cet étalage de paroles dont vous aviez orné le chapitre, malgré ce préambule destiné à cacher vos vues mercenaires, quel est le préteur qui ait voulu l'insérer dans son édit? Non seulement il ne s'en est trouvé aucun, mais personne n'a craint de l'y voir insérer. Car, depuis votre préture, bien des gens ont fait des testaments semblables, entre autres, Annia, cette femme si riche, qui, sans déclaration et de l'avis de tous ses parents, a tout récemment légué ses biens à sa fille. Preuve bien évidente de l'opinion du peuple romain sur l'iniquité de cet homme, que personne n'ait craint de voir un préteur confirmer l'édit qu'il avait plu à Verrès de rendre. Il n'y a que vous seul à qui il ne suffise pas de réformer la volonté des vivants; il faut encore que vous annuliez celle des morts. Vous-même, vous avez supprimé cet article dans votre édit de Sicile: vous vouliez sans doute, en cas de circonstances imprévues, statuer d'après l'édit de Rome. Mais ce moyen de défense que vous vous réserviez n'est qu'un écueil où vous avez échoué : vous avez détruit vous-même par votre édit de Sicile ce que vous aviez fait précédemment. XLIV. Et je ne doute pas que cet édit rendu à Rome, et qui me paraît aussi cruel qu'injuste, à moi qui aime tendrement ma fille, ne vous le paraisse également, à vous qui avez les mêmes sentiments et la même tendresse pour les vôtres. En effet, quelle plus douce consolation, quel trésor plus précieux la nature nous a-t-elle donné? Quel plus digne objet de tous nos soins, de toutes nos affections? Malheureux! comment avez-vous pu outrager ainsi la mémoire de P. Annius? exercer votre cruauté jusque sur ses cendres, en ravissant à ses enfants les biens paternels, ces biens que leur léguaient la volonté d'un père, le droit naturel et les lois, pour les donner, pour les vendre à un étranger? Ces biens, ces propriétés que nous partageons avec nos enfants pendant notre vie, un préteur pourra donc les leur ravir après notre mort? Je n'accorderai, dit-il, ni droit de revendiquer, ni mise en possession. Vous arracherez donc à une orpheline la robe de son âge? vous lui enlèverez non seulement les marques de sa fortune, mais encore celles de sa condition? Et nous sommes étonnés que les habitants de Lampsaque aient pris les armes contre cet homme? Nous sommes étonnés qu'en quittant sa province, il se soit évadé furtivement de Syracuse? Ah! si nous étions sensibles aux malheurs d'autrui comme nous le sommes aux nôtres, cette place ne porterait déjà plus la trace de ses pas. Un père donne à sa fille: vous osez l'en empêcher. Les lois le permettent : vous vous interposez entre lui et les lois. Il ne donne de son bien que ce qu'il lui est permis de donner; qu'y trouvez-vous à reprendre? rien, ce me semble. Mais je veux qu'il ait tort; empêchez-le, si vous le pouvez, si vous trouvez quelqu'un qui obéisse à vos ordres. Vous voulez donc arracher aux morts leur volonté; aux vivants, leurs biens; à tous, leurs droits? Et vous pensez que le peuple romain ne se serait pas vengé lui-même, s'il n'eût abandonné ce soin au tribunal qui vous juge en ce moment! Depuis l'établissement de la jurisprudence prétorienne, il a toujours été de droit parmi nous que c'est le plus proche parent qui hérite et qui est envoyé en possession quand il n'y a pas de testament. Rien de plus juste, comme il serait facile de le prouver. Mais c'est une chose si évidente qu'il suffit de rappeler que tous les préteurs en ont jugé ainsi, et que c'est un ancien édit arrivé jusqu'à nous comme par tradition. XLV. Écoutez maintenant une nouvelle ordonnance de cet homme sur un objet depuis longtemps réglé; tandis que vous avez un si bon maître de droit civil, envoyez vos jeunes gens à son école : le génie du personnage est admirable, et sa science, prodigieuse. Un certain Minucius est mort avant la préture de Verrès : il n'y avait point de testament : d'après la loi , la succession revenait à la famille Minucia. Si Verrès eût conservé un usage toujours suivi par les prêteurs avant et après lui, les Minucius auraient été envoyés en possession. Si quelqu'un se prétendait héritier en vertu du testament, qui n'existait pas alors, il devait réclamer en justice : ou recevant caution du possesseur actuel pour la conservation du bien, donner caution lui-même, afin d'être admis à plaider. Voilà, ce me semble, la règle de droit qui a toujours été observée par nos ancêtres et par nous-mêmes. Voyez comment cet homme l'a réformée. Il rédige son édit de telle manière que tout le monde comprend qu'il est fait en faveur de quelqu'un ; ce quelqu'un, il est vrai, n'est pas nommé, mais sa cause est exposée tout au long; le droit, l'usage, l'équité, les édits antérieurs, il ne tient compte de rien. Extrait de l'édit donné à Rome : Si une succession est en litige, et qu'il y ait un possesseur, il ne donnera pas caution . Qu'importe au préteur lequel des deux est le possesseur actuel? ce qu'il s'agit de savoir, c'est lequel des deux est le possesseur légitime. Ainsi, parce qu'il y a un possesseur, vous n'ôtez pas la possession; s'il n'y avait pas de possesseur, vous ne la donneriez pas; car vous ne l'écrivez nulle part, et vous ne comprenez dans votre édit que la cause pour laquelle vous aviez reçu de l'argent. Mais voici qui est risible : Si une succession est en litige, et que l'on me présente un testament scellé, au moins du nombre de sceaux exigé par la loi, j'enverrai en possession l'héritier testamentaire. C'est l'édit de tradition; examinons la suite : « Si l'on ne présente pas de testament ... Eh bien ! que dit Verrès? qu'il enverra en possession celui qui se prétendra héritier. Qu'importe alors que le testament soit produit ou non? Si on le produit, et qu'il y manque un seul cachet, vous n'ordonnerez pas l'envoi en possession : et si on n'en produit pas du tout, vous l'ordonnerez. Que dirai-je maintenant? que personne après lui n'a rendu d'ordonnance pareille? C'est une chose bien surprenante que personne n'ait voulu être comparé à Verrès! Il y a plus, Verrès lui-même ne conserve pas cette clause dans son édit de Sicile; car, déjà il s'en était fait compter le prix. Il en fut de cet édit comme du précédent, et Verrès publia en Sicile sur l'envoi en possession des héritages un édit absolument semblable à ceux que tous les préteurs avaient publié à Rome, excepté lui. Extrait de l'édit de Sicile: Si une succession est en litige ... XLVI. Au nom des dieux, que peut-on dire d'une telle conduite? Je vous demanderai sur les envois en possession ce que je vous ai demandé tout à l'heure sur l'hérédité des femmes, dans l'affaire d'Annius ; pourquoi n'avez-vous pas voulu transporter ces articles dans l'édit de Sicile? Avez-vous trouvé les habitants de la province plus dignes que nous d'une législation équitable? ou ce qui est équitable à Rome ne l'est-il pas en Sicile? Car on ne peut dire ici qu'il y ait beaucoup de questions sur lesquelles on doive statuer différemment dans les provinces : on ne le peut dire, ni de la possession des héritages, ni de l'hérédité des femmes. Je vois, en effet, que, sur ces deux points, non seulement les autres préteurs, mais vous-même, vous vous êtes expliqué aussi longuement qu'on le fait dans les édits qu'on rend à Rome. J'en conclus qu'après avoir inséré dans l'édit rendu à Rome ces articles dont vous aviez reçu le prix, vous les avez supprimés dans l'édit de Sicile pour ne pas vous déshonorer gratuitement aux yeux d'une province. J'ajouterai même qu'une fois entré en charge, vous n'avez pas eu honte de rendre des décisions toutes contraires à cet édit composé dans les intérêts de ceux qui l'avaient payé lorsque vous n'étiez que préteur désigné. Aussi L. Pison a-t-il rempli vos registres des affaires dans lesquelles il est intervenu, parce que Verrès avait rendu des décisions contraires à son propre édit. Je ne crois pas que vous ayez oublié quel nombre de citoyens, et même de citoyens distingués, environnait chaque jour le tribunal de Pison pendant cette préture : Verrès était infailliblement lapidé s'il n'avait pas eu un collègue tel que lui. Mais ses prévarications paraissaient plus supportables, en ce qu'on avait dans la sagesse et l'équité de Pison, un refuge assuré dont chacun profitait sans peine, sans embarras, sans frais et même sans avocat. Rappelez-vous, juges, la conduite arbitraire de Verrès dans l'administration de la justice; ces arrêts contradictoires, le trafic qu'il en faisait ouvertement; la solitude des maisons des jurisconsultes, dans le temps que celle de Chélidon était toujours pleine de gens qui, sortant de chez cette femme, allaient chez Verrès lui dire à l'oreille quelques mots; sur quoi, tantôt il rappelait les parties dont il venait de juger l'affaire, et changeait sa décision; tantôt il rendait un jugement contraire à celui qu'il avait déjà prononcé dans la précédente affaire. Aussi voyait-on des gens dont la colère s'exhalait en saillies : les uns, vous les avez entendus, disaient qu'il ne fallait pas s'étonner qu'il ne sortit rien de bon d'un animal nommé Verrès; d'autres faisaient des plaisanteries encore plus amères; mais, comme ils n'étaient pas de bonne humeur, on riait de les entendre maudire Sacerdos comme s'il eût été prêtre, pour n'avoir pas sacrifié une bête aussi méchante. Je ne rapporterais pas ces sarcasmes qui ne sont, ni fort plaisants, ni dignes de la majesté de ce lieu, si je ne voulais vous faire souvenir que l'infâme conduite et l'iniquité de Verrès étaient alors dans toutes les bouches et comme passées en proverbe. XLVII. Mais de quoi vous parlerai je d'abord, de son orgueil ou de sa cruauté envers le peuple romain? Sans doute la cruauté a quelque chose de plus odieux et de plus atroce. Croyez-vous que cette foule qui nous écoute ait oublié qu'il lui est arrivé souvent de faire déchirer à coups de verges des citoyens romains; cruauté contre laquelle un tribun du peuple s'éleva avec tant d'énergie dans une assemblée, où il fit paraître devant le peuple romain le citoyen qui venait d'être battu de verges : c'est un fait que je mettrai sous vos yeux dans la suite de cette accusation. Pour son orgueil, qui ne sait à quel excès il l'a porté? De quel dédain, de quel mépris il accablait les citoyens les plus pauvres, ne les regardant jamais comme des hommes libres! P. Trébonius désigna plusieurs héritiers sur son testament, gens honnêtes et qu'il estimait, entre autres un de ses affranchis. Il laissait un frère, A. Trébonius, qui avait été sur les tables de proscription. Voulant lui ménager quelques secours, il avait inséré cette clause, que les héritiers jureraient de faire passer à ce frère au moins la moitié de leur part, bien qu'il fût proscrit. L'affranchi prête ce serment. Les autres héritiers vont trouver Verrès : ils lui font entendre qu'ils ne doivent pas jurer, que ce serait agir contre la loi Cornélia qui défend de donner des secours à un proscrit. Ils obtiennent la dispense du serment et l'envoi en possession. A cela, je ne trouve rien à redire: c'était sans doute une injustice de donner à un proscrit, dans le besoin, quelque partie du bien de son frère; mais cet affranchi craignait de commettre un crime s'il ne jurait selon le testament de son patron. Verrès déclare donc qu'il ne l'enverra pas en possession de l'héritage, afin qu'il ne puisse pas donner des secours à un patron proscrit, et en même temps pour le punir de s'être conformé à la volonté dernière de son patron. Vous adjugez la possession à celui qui n'a pas juré; d'accord : c'est agir en préteur. Vous l'ôtez à celui qui a juré; d'après quel précédent? Il aidait un proscrit. Eh bien! il y a une loi, une peine décernée. Qu'importe au magistrat civil? Que reprochez-vous à cet affranchi? d'aider un patron alors dans la misère? ou de respecter la dernière volonté d'un autre patron dont il avait reçu un si grand bienfait? Lequel des deux? et remarquez que du haut de son tribunal notre homme de bien a ajouté: « Comment ! un chevalier romain, un citoyen si riche aurait un affranchi pour héritier! » Certes les affranchis firent preuve d'une grande modération en le laissant sortir vivant de son siège! Je puis montrer mille décrets dont la singularité et l'injustice proclament, sans que j'aie besoin de le dire, qu'ils ont été obtenus à prix d'argent. Mais, pour juger de tous les autres par l'exemple d'un seul, écoutez un fait qu'on vous a déjà fait connaître dans la première action. XLVIII. Il s'agit de C. Sulpicius Olympus. Il mourut pendant la préture de C. Sacerdos, peut-être même avant que Verrès sollicitât cette dignité. Il nomma pour son héritier M. Octavius Ligur. Celui-ci recueillit la succession, et en jouit sans être inquiété pendant la préture de Sacerdos. Lorsque Verrès fut entré en charge, d'après un article de son édit, qui n'était pas dans celui de Sacerdos, la fille du patron de Sulpicius se mit en devoir de réclamer à Ligur le sixième de la succession. Ligur était absent : Lucius, son frère, soutenait sa cause; ses amis, ses parents comparurent. Verrès disait que si l'on ne s'arrangeait avec cette femme, il l'enverrait en possession. L. Gellius, avocat de Ligur, démontrait que l'édit de Verrès n'avait aucune force pour des successions échues avant sa préture; que si l'édit eût alors existé, peut-être Ligur n'eût-il pas recueilli l'héritage. Ces représentations étaient justes, et appuyées de personnes respectables; mais l'argent l'emportait. Ligur vient à Rome :il ne doutait pas qu'en allant lui-même trouver Verrès, il ne réussît à le fléchir par la justice de sa cause et sa considération personnelle : il se rend chez lui, lui expose l'affaire, lui montre depuis combien de temps cette succession lui est venue; et, ce qui était facile à un homme d'esprit dans une cause si juste, il lui dit beaucoup de choses qui auraient touché tout autre que Verrès ; il finit par le prier de ne pas lui porter un coup aussi cruel, de ne pas mépriser sa personne et dédaigner son crédit à ce point. Verrès reproche à Ligur de se montrer si ardent et si empressé pour une succession inattendue : il lui dit qu'il doit aussi tenir compte des intérêts du préteur; qu'il a besoin de bien des choses pour lui-même et pour la meute qu'il entretient autour de lui. Je ne saurais vous rendre tous ces détails mieux que Ligur ne l'a fait devant vous dans sa déposition. Quoi donc, Verrès! faut-il qu'on ne croie pas de tels témoins? et tout cela est-il étranger à la cause? On n'en croirait ni M. Octavius, ni L. Ligur? Qui donc nous croira? Qui croirons-nous nous-mêmes? Quel fait peut être prouvé par des témoins, si celui-ci ne l'est pas ? Ce qu'ils disent serait-il peu de chose? C'est peu de chose en effet qu'un édit rendu par un préteur de Rome pour déclarer que tous ceux qui héritent doivent partager avec lui ! Aurons-nous des doutes maintenant sur le ton qu'il prenait avec des hommes d'une naissance, d'une considération, d'un ordre inférieurs; sur la manière dont il parlait aux habitants des campagnes latines et celle dont il traitait les affranchis, qu'il n'a jamais regardés que comme des esclaves, lui qui, pour prononcer dans l'affaire de M. Octavius Ligur, personnage si distingué par le rang, l'ordre, la naissance, le mérite, le génie et la fortune, n'a pas hésité à lui demander de l'argent? XLIX. Quant à l'entretien des édifices publics, vous dirai-je quelle a été son administration? plusieurs vous l'ont dit, qui peuvent vous en parler par expérience, et il en est d'autres qui vous le diront encore; on a cité des faits notoires et manifestes, on en citera de nouveaux. C. Fannius, chevalier romain, frère de Q. Titinius, un de vos juges, Verrès, a déclaré vous avoir donné de l'argent. Qu'on lise la déposition de C. Fannius. N'allez pas croire, juges, ce que dit C. Fannius; vous-même, Q. Titinius, gardez-vous de croire C. Fannius votre frère : en effet, ce qu'il dit est incroyable. Il accuse C. Verrès d'avarice et d'impudence : vices qui semblent convenir à tout autre plutôt qu'à lui. Q. Tadius, ami intime du père de Verrès, et presque parent de sa mère par le nom et par la naissance, a dit et a montré par ses registres qu'il avait aussi donné de l'argent. Qu'on lise les registres de Q. Tadius. Qu'on lise sa déposition. Ne croira-t-on ni les registres de Q. Tadius, ni son témoignage? à quoi nous attacherons-nous donc dans les jugements? N'est-ce pas assurer à tous l'impunité de leurs fautes et de leurs crimes que de ne pas croire les témoignages des hommes les plus honorables et les registres présentés par des citoyens d'une probité reconnue? Que dirai-je aussi de ce vol effronté, ou plutôt de ce brigandage inouï et sans exemple, qui est encore un sujet de plaintes et d'entretiens pour le peuple romain? Avoir osé, dans le temple de Castor, cet édifice sacré, si connu, si révéré des nations, que le peuple romain a sans cesse devant les yeux; où le sénat est souvent convoqué, et où l'on se rend en foule chaque jour pour discuter sur les affaires les plus importantes, avoir osé, dis-je, laisser dans ce temple si respecté, dans ce sanctuaire de l'opinion publique un monument éternel de son audace! L. L'entretien du temple de Castor était confié à P. Junius, sous le consulat de L. Sylla et de Q. Métellus. Junius mourut, et laissa un fils en bas âge. Les consuls L. Octavius et C. Aurélius, qui avaient affermé l'entretien des édifices sacrés, n'ayant pas eu le temps de s'assurer si tous les travaux avaient été exécutés comme ils devaient l'être, non plus que les préteurs C. Sacerdos et M. Césius qui en furent chargés depuis, on ordonna par un sénatus-consulte que ceux des édifices dont l'état n'avait pas été vérifié et constaté seraient soumis à la vérification et au jugement des préteurs C. Verrès et P. Célius. Investi de ce pouvoir, comme vous l'ont déclaré C. Fannius et P. Tadius, Verrès, dont les déprédations avaient été partout si publiques et si impudentes, voulut laisser une dernière preuve de son brigandage, la plus éclatante que nous pussions, non pas nous rappeler quelquefois, mais voir tous les jours de nos yeux. Il demanda quel était celui qui avait été chargé des travaux du temple de Castor. Il savait que Junius était mort, mais il voulait savoir qui cela regardait après lui. Il apprend que Junius a laissé un fils en tutelle. Aussitôt ce misérable qui avait dit cent fois que les orphelins et les orphelines étaient une proie assurée pour le prêteur, s'écrie, que la fortune lui met dans les mains une excellente affaire. Ce vaste monument, d'une construction si solide, n'avait à la vérité besoin d'aucune réparation; mais Verrès se flattait bien d'y trouver quelque chose à remuer et à prendre. Le temple de Castor devait être remis à L. Rabonius : or celui-ci se trouvait justement le tuteur du fils de Junius en vertu du testament paternel. Les arrangements étaient déjà pris pour que la remise se fît sans dommage pour les deux parties. Verrès fait venir Rabonius : il lui demande si le pupille a livré tout ce qu'il devait remettre, et s'il ne reste rien qu'on puisse exiger. Rabonius répondait, comme il était vrai, que cette remise était une chose toute simple pour le pupille; que les statues, les offrandes, rien ne manquait dans le temple, que l'édifice n'avait besoin d'aucune réparation. Verrès indigné trouvait fort étrange que dans un si vaste édifice, et d'un travail si considérable, on ne pût tirer quelque riche proie, surtout d'un orphelin. LI. II va lui-même au temple de Castor; il l'examine en entier; il voit partout des plafonds superbes, le reste tout neuf et sans le moindre défaut. Il se tourne en tous sens; il cherche que faire. Un de ces limiers, dont il entretenait, comme il l'avait dit à Ligur, une meute autour de lui, vient à son secours : Verrès, vous n'avez rien à faire ici, à moins d'exiger que ces colonnes soient d'aplomb. Verrès, qui ne sait rien, demande ce que c'est que l'aplomb. On lui dit qu'il n'y a guère de colonnes qui soient exactement perpendiculaires. Eh bien! par tous les dieux, dit-il, faisons cela; que l'on voie si toutes ces colonnes sont d'aplomb. Rabonius, qui connaissait la loi, où il n'est question que du nombre des colonnes et nullement de leur aplomb, et qui d'ailleurs ne croyait pas qu'il fût de son intérêt de recevoir de cette manière, de peur d'être contraint à rendre de même, soutient qu'on ne doit point exiger cette condition. Verrès lui dit de rester tranquille, lui fait entrevoir l'espérance d'une certaine association, ferme enfin la bouche à cet homme qui n'est ni fier ni opiniâtre, et confirme son arrêté sur l'aplomb des colonnes. On annonce aussitôt cette étrange décision et le malheur imprévu du pupille à C. Mustius, son beau-père, mort dernièrement; à M. Junius, son oncle paternel; à P. Potitius, un de ses tuteurs, dont tout le monde connaît la probité. Tous trois en instruisent M. Marcellus, l'un de nos premiers citoyens, personnage aussi vertueux qu'illustre. Il était aussi tuteur de l'enfant. II se rend chez Verrès, lui dit tout ce que le zèle peut inspirer à un homme d'honneur pour l'empêcher de commettre une pareille injustice, de dépouiller un orphelin des biens de son père. Verrès, qui avait dévoré en espérance ce riche butin, n'est ému ni par les paroles ni par l'autorité de Marcellus. Il répond qu'il tiendra à ce qu'il a déclaré. Les tuteurs voyant que toutes les députations étaient inutiles, que tout accès était impraticable ou plutôt fermé auprès d'un homme pour qui le droit,l'équité, l'humanité, les remontrances d'un parent, le zèle d'un ami, l'autorité et le crédit de qui que ce fût n'étaient rien au prix de l'argent, conviennent qu'il n'y a plus qu'un parti à prendre, celui qui aurait dû se présenter d'abord à leur esprit, c'est d'avoir recours à Chélidon, elle qui, sous la préture de Verrès, non seulement dans le droit civil et dans toutes les contestations entre les particuliers fut l'arbitre du peuple romain, mais qui décida encore souverainement dans cette administration des édifices. LII. Chélidon voit arriver chez elle et C. Mustius, chevalier romain, un des fermiers de l'État, citoyen des plus honorables; et M. Junius, oncle paternel du pupille, homme d'une grande sagesse et d'une grande pureté de moeurs, et P. Potitius, un des tuteurs, l'un des personnages les plus distingués de son ordre par ses hautes dignités, la noblesse de ses sentiments et son attachement à ses devoirs. Ah! Verrès, que d'indignités la plupart des citoyens n'ont-ils pas souffertes sous votre administration! Sans parler du reste, avec quelle confusion, quelle douleur ne croyez-vous pas que de tels hommes se présentèrent chez une courtisane? démarche humiliante qu'ils n'auraient jamais faite, si elle ne leur eût été imposée par ce double titre de tuteurs et de parents. Ils viennent donc, comme je l'ai dit, trouver Chélidon. La maison était pleine : c'était à qui demanderait de nouveaux droits, de nouveaux arrêts, de nouveaux jugements. Moi, je demande d'être envoyé en possession; moi, d'y être maintenu; moi, de n'être pas mis en jugement; moi, qu'on m'adjuge ce bien. Les uns comptaient de l'argent; les autres scellaient des obligations : on se serait cru non chez une courtisane, mais chez un préteur. Quand leur tour est venu, les solliciteurs que j'ai nommés se présentent : Mustius porte la parole, expose l'affaire, demande protection, promet de l'argent. Chélidon répond d'un air gracieux, en vraie courtisane, qu'elle fera volontiers ce qu'on lui demande; qu'elle en confèrera avec le préteur, et finit en leur disant de revenir. Ils se retirent, et reviennent le lendemain ; elle déclare qu'il n'y a pas moyen de fléchir le magistrat; cette affaire pouvant lui rapporter, dit-il, des sommes considérables. LIII. Je crains que tous ceux qui n'étaient pas présents, lors de la première accusation, ne s'imaginent que j'invente tous ces détails, si incroyables par leur turpitude. Mais vous, juges, vous les connaissez déjà; vous avez entendu sous la foi du serment P. Potitius, tuteur du pupille Junius; vous avez entendu M. Junius, son tuteur et son oncle paternel; et vous auriez entendu Mustius, s'il eût vécu. Toutefois il a été remplacé par L. Domitius qui vous a dit avoir appris tous ces faits de la bouche de Mustius. Il n'ignorait pas que c'était de Mustius lui-même que je les tenais (car je le voyais souvent depuis ce procès où il s'agissait de toute sa fortune, et qu'il a gagné, n'ayant que moi pour défenseur) : Domitius n'ignorait pas, dis-je, que je savais quelle confiance avait en lui Mustius, lequel m'avait dit qu'il était accoutumé de ne lui rien cacher; cependant il évita tant qu'il put de me parler de Chélidon, détournant toujours la conversation lorsque je lui en parlais. Telle fut la modestie de cet illustre jeune homme, un des plus distingués de la jeunesse romaine, que pendant quelque temps, malgré mes instances, il répondait tout autre chose plutôt que de nommer Chélidon. D'abord il me dit qu'on avait envoyé des amis pour traiter avec le préteur; enfin, pressé par moi, il nomma Chélidon. N'avez-vous pas de honte, Verrès, de vous être laissé gouverner dans votre préture par une femme dont L. Domitius ne croyait pas pouvoir prononcer le nom sans se déshonorer? LIV. Obligés par le refus de Chélidon de se charger de l'affaire, ils se décident à la traiter eux-mêmes. Ils transigent avec Rabonius, cet honnête tuteur, moyennant deux cent mille sesterces, pour un objet qui en valait à peine quarante mille. Rabonius va rendre compte à Verrès; il le prie de trouver la somme assez forte, j'aurais dit le vol assez impudent. Celui-ci, qui s'attendait à mieux, reçoit très mal Rabonius; il lui déclare qu'un pareil marché ne saurait le satisfaire, qu'il va donner l'entreprise à d'autres. Les tuteurs qui ne savent rien, regardent l'arrangement pris avec Rabonius comme une chose conclue; ils ne craignent pas de plus grands malheurs pour leur pupille. Cependant Verrès ne remet point la chose au lendemain; il fait commencer la criée, sans annonce, sans affiche préalable, dans le moment le moins opportun, pendant les Jeux Romains, au milieu des décorations du forum. Rabonius va donc annoncer aux tuteurs que le traité est nul. Ils accourent et arrivent encore à temps : Junius, oncle du pupille, lève la main : Verrès change de couleur, perd contenance; paroles, présence d'esprit, tout lui manque. Il se met à réfléchir : que fera-t-il, si ces travaux sont entrepris par le pupille; s'ils échappent à l'adjudicataire qu'il a lui-même aposté? plus de gain à espérer. II imagine donc ... Quoi? rien de bien ingénieux, rien dont on puisse dire : Cela est méchant, mais fort adroit; n'attendez de lui ni piège caché, ni tour de vieille guerre; effronterie, démence, audace, vous verrez tout à découvert, tout au grand jour. Si l'entreprise est adjugée au pupille, ma proie m'échappe : quel remède à cela? quel remède? c'est de ne pas permettre au pupille de se porter adjudicataire. Mais que devient la coutume suivie dans la vente des biens meubles et immeubles des cautions, par tous les consuls, censeurs, préteurs et questeurs, qui est de traiter plus favorablement le propriétaire, celui qui a répondu à ses risques et périls? Verrès exclut celui-là seul à qui seul peut-être il devait être permis de se présenter. Qui donc a le droit de demander malgré moi à disposer de mes fonds? Pourquoi se présente-t-il? Il s'agit de travaux à faire à mes dépens; je m'engage à les faire; ce sera à vous qui donnez l'adjudication, d'approuver l'ouvrage; il y a des meubles et des immeubles qui en répondent. Et si vous ne trouvez pas la caution suffisante, est-ce une raison pour vous, préteur, de livrer ma fortune à qui vous voudrez sans me permettre de la défendre? LV. Il est bon de connaître les termes du décret : vous allez dire qu'il a été rédigé par l'auteur de l'édit des successions : « Décret sur les travaux à faire pour le compte du pupille Junius ... » Parlez, parlez plus haut, je vous prie. C. Verrès, préteur de la ville, a de plus ordonné ... On va réformer ici les lois des censeurs. Que vois-je, en effet, dans beaucoup de lois anciennes? Cn. Domitius, L. Métellus, L. Cassius, Cn. Servilius, censeurs, ont de plus ordonné: Verrès veut sans doute aussi ajouter quelque chose de semblable. Lisez; qu'a-t-il ajouté? Aucun de ceux qui ont été déclarés adjudicataires depuis la censure de T . Marcius et de M. Perperna n'est admis comme associé dans l'entreprise; il est interdit de la lui céder en partie, ou, de la prendre pour son compte. Pourquoi cela? dans la crainte que l'ouvrage ne fût mal fait? mais vous aviez le droit de le visiter. De peur que le pupille ne fût pas assez riche? Mais il avait donné au peuple romain, en biens meubles et immeubles, des cautions que vous étiez maître de faire augmenter. Et si la chose même, si l'atrocité de votre injustice ne vous touchait pas, si le malheur d'un orphelin, les larmes de sa famille, le danger que courait D. Brutus, dont les biens se trouvaient engagés, l'autorité de M. Marcellus un des tuteurs, ne pouvaient rien sur vous; ne vous aperceviez-vous pas que vous faisiez une faute qu'il vous serait impossible de nier, car vous l'avez consignée sur vos registres, ni même avouer avec l'espoir de vous justifier ? L'entreprise est adjugée pour la somme de cinq cent soixante mille sesterces : tandis que les tuteurs étaient là qui s'écriaient que, pour quatre-vingt mille sesterces, ils l'exécuteraient au gré du plus injuste de tous les hommes. Car enfin quel était l'ouvrage? vous le savez, toutes ces colonnes que vous voyez reblanchies, ont été, à l'aide d'une machine, démolies sans frais, et reconstruites avec les mêmes pierres? Voilà les travaux que vous avez adjugés pour cinq cent soixante mille sesterces. Et encore, parmi ces colonnes, y en a-t-il auxquelles votre entrepreneur n'a pas touché, et d'autres dont il n'a fait qu'enlever l'ancien enduit pour en appliquer un nouveau. Que si j'avais pensé qu'il en coûtât si cher pour reblanchir des colonnes, certes, jamais je n'aurais demandé l'édilité. LVI. Cependant, pour faire croire qu'il n'agissait que dans l'intérêt de l'entreprise et non pas pour dépouiller ce pupille, il ajoute : Si dans le travail vous causez, quelque dommage, vous le réparerez. Que pouvait-il endommager n'ayant qu'à remettre chaque pierre à sa place? L'entrepreneur donnera caution du dommage à celui qui a remplacé l'ancien entrepreneur. N'est-ce pas une dérision, d'obliger Rabonius à se donner caution à lui-même? La somme sera payée comptant. Sur les biens de qui? de celui qui vous a crié qu'il se chargerait de faire pour quatre-vingt mille sesterces ce que vous avez adjugé pour cinq cent soixante mille. Sur les biens de qui? du pupille dont l'âge et l'état d'abandon exigeaient la protection du préteur s'il n'avait pas eu de tuteurs. Et quand ses tuteurs le défendaient, vous vous êtes emparé non seulement de son patrimoine, mais de leurs biens à eux-mêmes. Qu'on ne se serve que de bons matériaux, chacun dans son genre. Il n'a fallu que retailler quelques pierres et les porter à leur place à l'aide de la machine nécessaire : car on n'eut besoin d'y voiturer ni pierre ni bois. Il n'y eut de dépense dans toute l'entreprise que pour le salaire de quelques journées d'ouvriers, et le service d'une machine. Lequel croyez-vous le moins coûteux, ou de construire une colonne entièrement neuve sans aucune pierre retaillée, ou d'en replacer quatre de celles-là ? Personne ne doute que la neuve ne coûte beaucoup plus. Je puis démontrer que, dans des maisons particulières, malgré les frais d'un transport long et difficile, des colonnes de façade, non moins hautes que celles-ci, ont été évaluées chacune à quarante mille sesterces. Mais il y a de la simplicité à s'étendre plus longtemps sur une impudence aussi manifeste, surtout quand on voit Verrès braver ouvertement, dans son ordonnance, l'opinion et les jugements publics au point d'ajouter à la fin : Il aura pour lui les vieux matériaux : comme s'il y avait dans cette entreprise de vieux matériaux à enlever, comme si tout n'était pas fait avec les anciens matériaux. Mais, s'il était défendu au pupille de prendre l'adjudication, il n'était pas nécessaire qu'elle tombât entre les mains du préteur; tout citoyen pouvait se présenter. Non, tous furent exclus aussi ouvertement que le pupille. Les travaux devaient être achevés aux calendes de décembre, et l'adjudication eut lieu vers les ides de septembre : ce court espace de temps exclut tout le monde. LVII. Comment donc Rabonius atteint-il le jour fixé? C'est que personne n'inquiète Rabonius, ni aux calendes, ni aux nones, ni aux ides de décembre; enfin le préteur s'en va même dans son gouvernement avant que l'ouvrage soit achevé. Quand il s'est vu accusé, il a déclaré d'abord ne pouvoir porter sur ses comptes qu'il eût accepté la remise de l'ouvrage; pressé par Rabonius, il a tâché de s'en prendre à moi, disant que j'avais mis le scellé sur son registre. Rabonius m'en demande communication, me fait parler par des amis; je me rends à leurs prières : Verrès ne sait plus que faire. Il croyait se ménager un moyen de défense en n'enregistrant pas la remise. Mais il sentait bien que Rabonius révèlerait toute la manoeuvre : cependant, pouvait-elle être plus manifeste qu'elle ne l'est aujourd'hui, même sans le témoignage de Rabonius? Il enregistre donc l'acceptation de l'ouvrage quatre ans après le terme qu'il avait fixé pour son achèvement. Nul entrepreneur n'auraitjoui du même avantage : d'ailleurs comme tous étaient exclus par la brièveté du temps, aucun d'eux n'avait envie de se mettre à la discrétion d'un magistrat qui penserait qu'on lui aurait ravi sa proie. Qu'avons-nous besoin d'induction pour découvrir à qui l'argent est revenu? Il se dénonce lui-même. D'abord, D. Brutus, qui avait payé de son argent cinq cent soixante mille sesterces, le pressait si vivement que, ne pouvant plus lui résister, il lui remit, après l'adjudication faite et les cautions reçues, cent dix mille sesterces, sur les cinq cent soixante mille; ce qu'il n'aurait pu faire si c'eût été sur les fonds d'autrui. Ensuite, l'argent avait été compté entre les mains de Cornificius, qu'il ne peut nier avoir été son secrétaire. Enfin les registres de Rabonius lui-même publient hautement que Verrès s'était adjugé cette somme : qu'on lise les Articles des registres de Rabonius. LVIII. Rappelons-nous ici qu'Hortensius se plaignit, dans la première action, de ce que le pupille Junius avait paru devant vous, vêtu de sa prétexte, et debout à côté de son oncle qui déposait comme témoin; et qu'il s'écria que je voulais me rendre populaire, et que je cherchais à soulever les esprits en faisant paraître un enfant. Qu'y avait-il donc, Hortensius, de si populaire, de si propre à soulever les esprits dans la présence de cet enfant? Était-ce le fils d'un Gracchus, d'un Saturninus ou de quelque autre personnage de ce rang, que je faisais paraître, pour soulever les esprits en me servant de son nom et de la mémoire de son père? c'était le fils de P. Junius, d'un plébéien, que son père mourant avait cru devoir recommander non seulement à ses tuteurs et à ses parents, mais encore auxlois, à l'équité des magistrats et à la sagesse de vos décisions. Cet enfant, dépouillé de son bien par l'adjudication criminelle et le brigandage abominable de Verrès, s'est présenté devant ses juges, ne fût-ce que pour voir, dans un habillement un peu plus modeste, celui qui, depuis plusieurs années, le réduit lui-même aux tristes vêtements de la misère. Aussi, Hortensius, ce qui vous paraissait populaire, ce n'était pas son âge, mais sa cause; ni ses vêtements, mais l'état de sa fortune; vous étiez moins irrité de ce qu'il avait sa robe prétexte, que de ce qu'il n'avait pas le collier de l'enfance : car personne n'était ému à la vue de cette robe que lui donnaient la coutume et son droit d'enfant libre, mais tout le monde s'indignait de ce qu'un brigand l'eût dépouillé de cet ornement de son âge que son père lui avait donné comme le témoignage et la marque distinctive de sa condition. Ces larmes n'avaient rien de plus populaire que les nôtres, que les vôtres, Hortensius, que les pleurs de ceux qui doivent nous juger. C'est donc parce qu'il s'agit ici de la cause commune, du danger commun, que tous doivent s'entendre pour éteindre l'incendie dont nous menace une telle perversité. En effet, nous avons des enfants en bas âge, et nous ne savons pas combien chacun de nous a encore à vivre : nous devons, dès à présent, veiller et pourvoir à ce que leur abandon et leur faiblesse trouvent après nous une protection. Et qui pourrait défendre nos enfants contre l'iniquité des magistrats? une mère, sans doute. En effet, la mère de la pupille Annia, cette femme du premier rang, lui a été d'un grand secours! et ses supplications, ses prières aux dieux et aux hommes ont empêché Verrès de dépouiller la jeune fille des biens de son père! Mais des tuteurs les défendraient? rien de plus facile sans doute; contre un préteur comme Verrès, lui que n'ont ému, dans l'affaire du pupille Junius, ni les représentations ni les prières, ni l'autorité d'un tuteur tel que M. Marcellus. LIX. Et nous demandons encore ce qu'il a fait au fond de la Phrygie, aux extrémités de la Pamphylie?Quels ont été ses brigandages même dans une guerre contre les brigands? lui encore qui, dans le forum du peuple romain, s'est montré le plus abominable de tous les pirates! Nous doutons de son audace à s'emparer des dépouilles des ennemis, lui qui s'est fait un si riche butin du butin conquis par L. Metellus! lui qui, pour quatre colonnes à blanchir, a osé faire payer plus cher qu'il n'en avait conté à Métellus pour les faire construire toutes ! Nous attendons les dépositions des témoins de Sicile. Mais qui jamais a jeté les yeux sur ce temple, Verrès, sans être le témoin de votre avarice, de votre iniquité, de votre audace ! Qui est jamais venu de la statue de Vertumne au grand cirque, sans voir à chaque pas les marques de votre cupidité. Cette rue où doit passer la pompe de nos chars sacrés, vous l'avez laissée en tel état, que vous n'oseriez y passer vous-même. Qui croira que, séparé de l'Italie par le détroit, vous ayez épargné nos alliés? vous qui avez laissé dans le temple de Castor de telles marques de vos brigandages que le peuple romain et vos juges eux-mêmes peuvent encore les apercevoir au moment où ils vont prononcer sur votre sort. LX. Mais pendant sa préture de Rome, Verrèsa aussi présidé au jugement d'une cause publique, qui ne doit pas non plus être oubliée. Un citoyen, Q. Opimius, fut accusé devant lui sous prétexte qu'étant tribun du peuple il avait proposé une loi contraire à la loi Cornélia, mais en effet parce qu'il avait parlé, durant son tribunat, contre le voeu d'un noble personnage. Si je voulais tout dire sur ce jugement, il me faudrait citer et mécontenter bien du monde; mais je ne le crois pas nécessaire. Je rappellerai seulement que quelques hommes ambitieux, pour ne rien dire de plus, se sont fait un jeu et un amusement, avec l'aide du préteur, de ruiner tout à fait Q. Opimius. Et Verrès se plaindra encore que nous n'ayons consacré que neuf jours à la première action dirigée contre lui, lorsque, devant son tribunal, Q. Opimius, sénateur du peuple romain, a perdu, en trois heures, ses biens, son rang et tous ses titres d'honneur! jugement odieux et qui indigna tellement le sénat, qu'il fut question de supprimer cette forme d'enquêtes et d'amendes. Et lorsqu'il fallut vendre les biens de Q. Opimius, quelles déprédations n'a-t-il pas commises, et avec quelle publicité, quelle scélératesse? Il serait trop long d'entrer dans ce détail. Je ne dis qu'une chose : Si je ne vous prouve tous ces faits jusqu'à l'évidence par les registres des citoyens les plus intègres, croyez alors que j'ai tout inventé dans l'intérêt de ma cause. Mais celui qui, dans la disgrâce d'un sénateur du peuple romain, à la condamnation duquel il avait présidé, a fait emporter chez lui la dépouille de l'accusé comme celle d'un ennemi vaincu, quel malheur celui-là n'a-t-il pas mérité? LXI. Quant au remplacement des juges dans l'affaire d'Oppianicus , je n'en parlerai pas. Eh! qu'oserai-je dire contre les registres que vous avez produits? l'entreprise serait difficile. Votre autorité et celle des juges, et surtout l'anneau d'or de votre secrétaire ne m'en empêchent-ils pas? Je ne parlerai donc pas de ce qu'il me serait impossible de prouver; mais il est une chose dont je fournirai la preuve. N'avez-vous pas dit en effet devant des personnes de la première distinction, qu'on devait vous pardonner d'avoir produit un faux registre, parce que, sans cette précaution, vous auriez succombé vous-même sous la haine publique, dont C. Junius avait été accablé? C'est ainsi que Verrès apprit à pourvoir à sa sûreté en rapportant sur les registres publics et particuliers des faits qui n'existaient pas, en effaçant ce qui existait, en retranchant quelque chose, en changeant, en faisant disparaître les ratures, en interpolant. Les choses sont allées si loin, qu'il lui faut commettre de nouveaux crimes pour pallier les autres. L'insensé s'était flatté de faire remplacer ses juges par les soins de son fidèle ami Q. Curtius, président d'un autre tribunal : et si je ne lui avais résisté à ce dernier, soutenu par les cris et les menaces du peuple, je me serais vu arracher, dans cette décurie dont l'appui m'était si nécessaire, les juges qu'il substituait sans aucun motif, au moindre signe de Verrès, à ceux qui composaient son conseil ... Le reste manque.
|