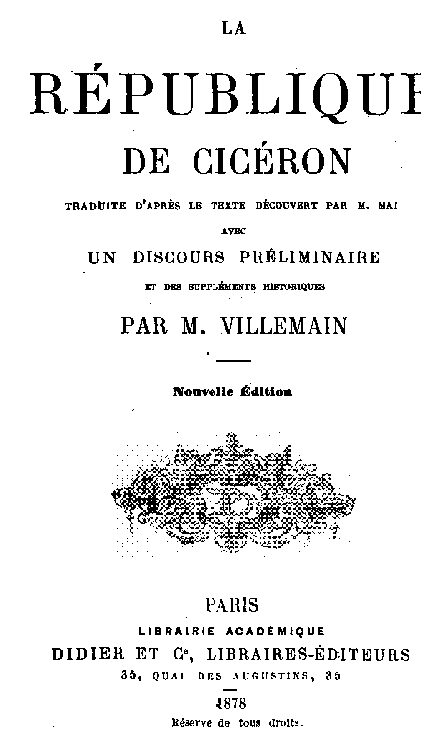|
ALLER A LA TABLE DES MATIÈRES DE CICÉRON
Cicéron Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
CICÉRON
*******************
DE LA RÉPUBLIQUE.livre I - livre II - livre III - livre IV - livre V
*******************
CICERONANALYSE DU SIXIÈME LIVRE.
La découverte de M. Mai n'ajoute rien à l'admirable fragment, qui nous était resté de ce sixième livre ; mais elle en fait mieux connaître le prix, par la comparaison de cet éloquent épisode avec les autres parties de l'ouvrage, dont il était comme le terme et le couronnement. C'est là que Cicéron, en discutant le principe du sentiment religieux, et en posant le dogme de l'immortalité de l'âme, avait cherché le dernier germe de la vie des sociétés. Quel caractère auguste et solennel dans un semblable entretien, prolongé entre les premiers génies de la république romaine, quelques jours avant la mort violente du plus illustre d'entre eux ! Ne devait-il pas sembler que Scipion, en exprimant à ce moment une conviction sublime sur la nature impérissable de l'âme, avait eu le pressentiment de cette fin soudaine, qui allait l'enlever au monde, et que ses paroles empreintes d'une tristesse majestueuse, et bientôt après consacrées par sa mort, étaient restées dans le cœur de ses amis, non seulement comme le dernier conseil d'une si haute sagesse, mais comme la seule consolation égale à la douleur de sa perte et à la gloire de sa vie. C'est là cette belle manière de promulguer les vérités morales qui appartient à l'antiquité. Ce sont là ces rapprochements pathétiques et simples qui lui étaient familiers. Socrate condamné, et près de boire la ciguë, au milieu de quelques disciples en pleurs, s'occupe d'établir avec la raison la plus lumineuse les preuves de l'immortalité de l'âme. Scipion, le premier des Romains par la grandeur de ses actions et de son génie, élevé, à force de gloire, au-dessus même des caprices de l'inconstance populaire, Scipion, discutant avec d'illustres amis, dans la sécurité d'un noble repos, les destinées et les révolutions des Etats, se livre tout à coup à des idées plus hautes, et expose ce dogme de l'immortalité de l'âme, que les religions grossières de l'antiquité n'affirmaient pas, et qu'il avait appris, dans un songe mystérieux, de la bouche de son immortel aïeul, et de son père Paul-Emile. Dans quelques jours Scipion ne sera plus : une main invisible, un crime obscur frappera ce grand homme, dans l'asile de sa maison, au milieu du respect et de l'amour des Romains : mais, tous les sentiments qu'il exprimait naguère, ce dogme sacré, cette foi d'un avenir immortel, en paraîtront plus vraisemblables. N'est-ce pas sur la tombe récente de l'homme vertueux, ou du grand homme, que l'on est plus invinciblement forcé de croire à la céleste origine de l'âme? Telles étaient, ce semble, les impressions nobles et touchantes, dont Cicéron, dans le dessein de son ouvrage, avait voulu entourer celte doctrine qu'il avait reçue de Platon, et qu'il voyait dans son temps attaquée par les sophismes de César et des autres corrupteurs de la République. Si on se souvient en effet que César, dans le sénat romain, pour défendre les complices de Catilina, soutint que les opinions sur la vie future étaient des fables, et que tout finissait à la mort, on sentira combien Cicéron avait besoin de combattre une doctrine qui s'annonçait pour servir de protection aux coupables et d'instrument aux ambitieux. Cicéron a plus d'une fois reproduit cette idée; plus d'une fois il s'est plaint qu'on avait préludé, par l'avilissement des auspices, à la destruction des lois et de la République. Lui-même il remplissait les fonctions d'augure; il en était fier; il les avait vivement souhaitées. Et cependant, tous ses traités philosophiques ne sont qu'une spirituelle et longue dérision du polythéisme : et il a fait exprès son dialogue de Divinatione, pour tourner en ridicule la vanité des augures, et la sotte crédulité du vulgaire. Cette contradiction dans la vie d'un grand homme mérite un examen curieux; elle tient de près à l'histoire même de la civilisation romaine, sur le point si important des croyances religieuses. Montesquieu, dans une courte dissertation, a saisi d'une vue ferme et pénétrante ce qu'il appelle la politique des Romains dans la religion. Il lui semble que, dès l'origine, le culte des dieux avait été dans la main des chefs de l'État, un instrument de pouvoir et d'influence habilement dirigé, un calcul d'ambition et d'adresse fondé sur l'ignorance du peuple. A cette explication viennent se lier les traditions de l'histoire, qui nous représentent Romulus pratiquant déjà la science des augures, Numa pliant le génie des Romains à toutes les cérémonies d'une piété superstitieuse. Mais, si la religion fut, dans Rome païenne, une invention et un ressort de la politique, elle devait y subir des mutations fréquentes, et changer comme cette politique même. Comment supposer en effet que les croyances, qui avaient utilement secondé le pouvoir des rois, aient pu s'allier également aux formes de la république ? Et que veut dire Montesquieu, quand, après avoir montré les premiers souverains de Rome soigneux d'asservir en tout la religion à la politique, il ajoute : « Le culte et les cérémonies qu'ils avaient institués, furent trouvés si sages que, lorsque les rois furent chassés, le joug de la religion fut le seul dont ce peuple, dans sa fureur pour la liberté, n'osa s'affranchir. » L'explication de ce problème embrasse toute l'histoire des premiers temps de la république; là se rattache l'autorité des patriciens sur les plébéiens, la puissance de l'oligarchie sénatoriale, et tout à la fois l'enthousiasme et la docilité du peuple romain. Les patriciens avaient en effet détourné à leur profit tout l'empire de la superstition populaire, par l'établissement de ce principe, que seuls ils avaient droit de consulter les auspices; ils devenaient ainsi une caste sacerdotale qui dominait l'État. Mais cette classe privilégiée était-elle dupe elle-même du pouvoir qu'elle exerçait? ou faut-il supposer, avec Montesquieu, que ces premiers sénateurs qui remplissaient les divers sacerdoces, étaient des fourbes habiles qui se moquaient de la crédulité, dont ils se servaient? Une hypocrisie commune à toute une classe est dé difficile usage. Une association de fraude et de mensonge se trahit toujours par quelque endroit. La superstition est sans doute un grand moyen d'influence : mais, pour être puissante, il faut qu'elle soit sincère, non seulement dans ceux qui lui obéissent, mais dans ceux qui commandent par elle. C'est un instrument que l'on ne fait pas à volonté, que l'on reçoit du temps, des circonstances; c'est une baguette magique dont il faut sentir soi-même la vertu, avant de pouvoir en frapper les autres. La longue domination des augures et des aruspices, dans Rome, prouvé que cette superstition, tout absurde qu'elle paraît, n'agissait pas seulement sur la foule et le vulgaire ignorant. Il semble résulter du traité de Cicéron sur la Divination, que son frère Quintus, homme éclairé, homme savant, était fortement convaincu de toutes ces fables ridicules. Brutus croyait à des visions bizarres. Et sans doute, durant les guerres de Sylla, ce consul, prêtre de Jupiter, qui se donnant la mort, pour échapper au barbare vainqueur, eut soin de constater par un écrit les précautions qu'il avait prises pour ne pas manquer au rituel sacré, et ne pas tacher de sang les bandelettes et le diadème, dont il était revêtu par son sacerdoce, cet homme, d'une superstition si exacte dans un pareil moment, croyait au culte, dont il était le ministre. Que si nous trouvons de tels indices d'une conviction sincère, dans les derniers temps de la république, à l'époque où le changement des mœurs, la philosophie d'Épicure, et tout ensemble les vices et les lumières avaient si fort décrédité, l'ancien polythéisme ; combien n'est-il pas vraisemblable que, plusieurs siècles auparavant, le culte public était pratiqué de bonne foi, par ceux mêmes qui s'en servaient pour dominer les autres? N'est-il pas plus naturel de croire à cette supposition, que d'admettre avec Montesquieu, une dissimulation si ancienne, si générale, si constante, pratiquée par une classe entière de citoyens, pour tromper tout un peuple? Tite-Live, en nous retraçant la piété mystérieuse du premier Africain, en nous le montrant toujours attentif à consulter les dieux dans leurs temples, toujours entouré de révélations nocturnes, de songes merveilleux, dont il paraissait en public faire dépendre ses projets et toute sa conduite; ajoute : « Il agissait ainsi, soit par un instinct de superstition, qui lui était naturel, soit, pour assurer à ses desseins et aux ordres émanés de lui une exécution rapide, comme celle des oracles. » On aurait peine à supposer, dans une si grande âme, un charlatanisme soutenu pendant la vie entière; et il semble plus probable d'admettre ici cet enthousiasme superstitieux, qui peut s'accorder avec le génie, et qui n'est qu'un égarement du principe religieux inné dans le cœur de l'homme. Dans ces diverses suppositions, le polythéisme, si puissant à Rome, à l'époque où Rome avait le plus de gloire et de liberté, devait paraître aux yeux des meilleurs citoyens essentiel à.la constitution de l'Etat; et Cicéron, dans son culte pour le passé, dans son zèle pour l'autorité du sénat, devait invoquer cet antique soutien de tout ce qu'il voulait défendre ou rétablir. D'ailleurs, au temps où il plaçait l'entretien de ses personnages, l'irréligion épicurienne avait encore obtenu peu de crédit dans Rome. A l'époque des guerres de Pyrrhus, les vieux Romains, qui avaient entendu Cynéas expliquer à la fois les doctrines de la volupté et du scepticisme, avaient prié les dieux de laisser de telles maximes aux ennemis des Romains; et le patriotisme s'était gardé longtemps de cette philosophie, comme d'une séduction nuisible au courage. Aussi, Polybe nous rapporte que, de son temps, c'est-à-dire au temps même de Scipion Emilien, la crainte superstitieuse des dieux et des enfers maintenait inviolablement, chez les Romains, la foi du serment oubliée chez les Grecs. Le passage de cet écrivain est assez remarquable pour être fidèlement cité, comme le témoignage le plus authentique sur le siècle, dont Cicéron avait voulu peindre les institutions et l'esprit. « Une chose, dit Polybe, qui est fort blâmée dans les autres hommes, me paraît constituer la force des Romains ; je parle de la superstition : car ce sentiment est porté chez eux, dans la vie publique et particulière, à un excès, au delà duquel il n'est rien. Quelques esprits s'en étonneront beaucoup; moi, je pense que les Romains ont agi ainsi, à cause du peuple. Sans doute, si on pouvait réunir une république de sages, un tel moyen ne serait nullement nécessaire; mais, comme le peuple est léger, plein de passions illégitimes et de violence, il reste de contenir cette foule par d'invisibles terreurs, et par tout cet épouvantail de tragédie. Aussi, dans mon opinion, ce n'est pas légèrement ni sans motif que les anciens ont répandu parmi le peuple les idées, que l'on a sur les dieux et sur les peines de l'enfer; et c'est au contraire à tort et follement que les hommes de ce temps rejettent ces idées. Je n'en donnerai qu'un exemple : chez les Grecs, si vous confiez aux hommes qui manient les fonds publics un seul talent, eussiez-vous appelé dix notaires, et scellé l'acte de dix sceaux, en présence de vingt témoins, ils vous manqueront de foi; chez les Romains, au contraire, des hommes qui manient des trésors, dans les magistratures et les ambassades, gardent une exacte probité, sous la foi d'un simple serment ; et, tandis qu'il est rare ailleurs de trouver un homme qui ne pille pas le public, et dont les mains soient pures, il est rare chez les Romains de surprendre quelqu'un dans de telles pratiques. » Il y a sans doute de la philosophie dans ces réflexions; mais il n'y en a point assez. Recommander la croyance en Dieu, et le dogme sublime de l'immortalité de l'âme comme un frein salutaire et commode, un supplément utile aux lois, c'est une vue courte qui se propose un but trop rapproché, et n'y parvient même pas. Lorsqu'on renvoie la religion au peuple, le peuple ne la reçoit plus. Ce n'est pas sur la base de l'intérêt qu'il faut fonder la religion ; c'est dans le cœur même de l'homme, dans le sentiment de sa dignité qu'on doit chercher et qu'on trouve un point d'appui, pour s'élever aux vérités éternelles. La philosophie grecque avait plus d'une, fois tenté ce noble ouvrage, delà sans doute étaient sorties de sages maximes, qui pouvaient rectifier ce qu'il y avait d'absurde dans les croyances populaires, sans altérer, et même en épurant le germe de vérité morale, que renfermaient quelques-unes de ces croyances. Mais telle ne fut pas la politique des premiers génies de Rome. Le grand-pontife Scévola, et Varron, le plus savant homme de la république, disaient qu'il fallait que le peuple ignorât beaucoup de choses vraies, et qu'il en crut beaucoup de fausses. Cette même pensée présidait sans doute à l'entretien de Scipion et de ses amis. Le traité des Loin, commentaire naturel du traité de la République, renferme un livre entier qui se rapporte à la religion. Bien que les détails de discipline et de cérémonie remplissent presque toute cette législation, on voit que le soin des mœurs s'y trouvait compris : en voici les principales dispositions. « Que l'on s'approche des dieux, avec un cœur pur; que l'on y apporte de la piété; que l'on éloigne les richesses. Dieu lui-même punira celui qui fait mal. Que l'impie n'ose pas offrir des dons, pour apaiser la colère des dieux. » Quelle que fût l'extravagance et l'obscénité des fables qui se mêlaient à un culte, au nom duquel on commandait les maximes que nous venons de lire, on conçoit que les premières atteintes portées à ce culte durent ébranler les mœurs publiques, et que l'on passa du mépris de la superstition à l'oubli des devoirs. Voilà sans doute le motif qui, dans la pensée de Cicéron, avait pu lui inspirer, sur ce point, un langage si différent de son incrédulité personnelle. Un autre intérêt politique venait se joindre à cette première considération : c'était sans doute une invention bien ridicule que les augures et les aruspices ; c'était, comme le dit Montesquieu, les grotesques du paganisme. Mais c'était un beau et puissant privilège que de pouvoir dissoudre une assemblée du peuple romain, annuler une résolution souveraine, faire abdiquer des consuls irrégulièrement nommés. On voit dans le traité des Lois quelle importance Cicéron attachait à de telles prérogatives, quel contrepoids salutaire il croyait y trouver. Cicéron dit ailleurs que la négligence de la noblesse a fait tomber les augures dans le mépris, et qu'il n'en est resté qu'une vaine apparence. Les patriciens se lassèrent donc de cette longue fourberie, que leur attribue Montesquieu ; ou plutôt, ils ne furent plus en état de la soutenir, du moment qu'eux-mêmes ne crurent plus à leur rôle. De quelle époque peut-on dater cette importante innovation? Il semblerait qu'elle a dû commencer, au siècle même de Scipion, au temps où les lettres grecques se répandaient dans Rome. Cependant, nous voyons dans l'histoire que Tibérius Gracchus, s'étant aperçu qu'il avait omis une formalité augurale, en présidant à l'élection des consuls, écrivit à ce sujet au collège des augures, et que sur l'ordre de ce collège, les deux consuls, qui étaient déjà partis l'un pour la Gaule cisalpine, et l'autre pour l'île de Corse, revinrent à Rome, abdiquèrent leur charge et furent remplacés. Ce qui dut favoriser de bonne heure cette insouciance des nobles, à laquelle Cicéron impute la perte et l'avilissement des augures, c'est que les plébéiens furent admis au partage et au mystère de ce singulier sacerdoce. L'an 453 de Rome, les plébéiens qui avaient déjà obtenu de concourir à toutes les dignités civiles, obtinrent aussi d'être reçus dans le collège des augures, où ils eurent même la majorité. Ils furent en effet au nombre de cinq ajoutés à ce collège, anciennement composé de quatre patriciens. Ces augures n'étaient pas le seul corps sacerdotal qui eût, à Rome, de l'influence sur les affaires civiles. Le grand-pontife, chef suprême de la religion, donnant des ordres à tous les autres pontifes, pouvait atteindre, en cette qualité, des hommes qui remplissaient en même temps de grandes fonctions dans l'Etat. Ainsi, l'an 511 de Rome, Posthumius Albinus étant à la fois consul et grand-prêtre de Mars, le grand-pontife Métellus lui défendit, comme à son subordonné dans l'ordre religieux, de quitter l'Italie, et d'aller commander une armée en Sicile. Le grand-pontife exerçait d'ailleurs, avec le concours du collège des pontifes qu'il présidait, une juridiction absolue sur les causes de divorce et sur les adoptions. Mais, ce qui donnait un caractère particulier au sacerdoce romain, c'est qu'il ne formait pas une profession à part, et qu'il était réuni sans cesse à des fonctions militaires et civiles. Ainsi, la religion, toujours représentée par des hommes liés à l'intérêt civil, n'intervenait dans les affaires de l'État qu'avec le même esprit, dont les citoyens étaient eux-mêmes animés. La charge de grand-pontife, quoique donnée par les suffrages du peuple, demeura jusqu'à la fin du cinquième siècle dans le domaine exclusif des patriciens. Cette dignité, et généralement toutes les fonctions religieuses, furent le privilège qu'ils conservèrent le plus longtemps, et le dernier point, sur lequel ils souffrirent le partage et l'égalité. Au reste, et c'est là que se trouve la politique romaine, les Pontifes, quelle que fût l'étendue de leurs privilèges, ne pouvaient rien innover dans les formes et les objets du culte. Cette grave matière était sous la juridiction du sénat et du peuple. On a vu au seizième siècle, dans la lumière du christianisme, le parlement d'un peuple célèbre rédiger des symboles religieux, et non pas seulement les formes du culte, mais les fondements de la croyance. Telle était, s'il n'y avait pas une sorte de profanation dans le parallèle, l'étendue de la puissance qu'exerça le sénat romain. Mais s'il est étonnant, s'il est ridicule, lorsqu'il s'agit des principes d'une religion toute spirituelle, de voir un peuple construire et modifier sa foi par des décrets, et mettre aux voix quelle doit être la conviction des âmes pieuses, on conçoit cette bizarrerie dans l'absurde chaos du polythéisme, au milieu de ces cultes sans morale, au milieu de ces divinités innombrables, dont le monde était inondé. Le pouvoir politique, dans Rome, accordait le droit de cité aux dieux étrangers, comme il le donnait aux peuples voisins. Le culte des Romains fut tout grec, à l'exception de quelques dieux indigènes sortis des traditions de leur histoire ; mais, ce culte n'avait rien eu d'abord de l'élégante idolâtrie de la Grèce. Varron, cité par saint Augustin, disait que les anciens Romains furent 170 ans sans avoir de simulacres consacrés. Nous les voyons successivement recueillir de nouveaux dieux, chez les peuples qu'ils assujettissent, appeler de loin et recevoir avec solennité la déesse Cybèle, repousser au contraire, avec mépris et par des lois rigoureuses, le culte d'Isis et les mystères égyptiens. Au sénat seul appartenait le droit d'autoriser la construction d'un temple nouveau. Souvent, on le voit dans l'histoire donner des ordres, pour rappeler à l'observance du culte ordinaire, et interdire les sacrifices inusités. Mais trouvait-il un grand intérêt politique à paraître associer aux destinées romaines quelque dieu nouveau, il proclamait l'adoption de son culte, avec des solennités singulières et faites pour frapper l'imagination. Ce soin n'était jamais négligé devant les villes assiégées, à l'heure où les Romains allaient s'en rendre maîtres. Macrobe nous a conservé la curieuse formule qui était alors employée : c'était une espèce d'évocation, par laquelle on appelait au dehors des murs de la malheureuse cité tous ses dieux protecteurs. Voici cette formule dans les termes, ou elle fut prononcée au siège de Carthage, par la touche de Scipion : « S'il est un dieu, une déesse, qui protège le peuple et la ville de Carthage, et vous, qui que vous soyez, dieu puissant qui avez reçu sous votre tutelle ce peuple et cette ville, je vous conjure, je vous supplie d'abandonner le peuple et la ville de Carthage, de quitter leurs demeures, leurs temples, leurs sanctuaires, leurs murs, de vous retirer loin d'eux, et de jeter dans ce peuple et dans cette ville la crainte, la terreur et l'oubli : je vous conjure et vous supplie de venir dans Rome, vers moi et les miens, de préférer nos demeurés, nos temples et notre ville, et de servir de guides au peuple romain, à mes soldats, et à moi, afin que nous ayons la lumière et l'intelligence : si vous le faites, je promets par un vœu solennel de vous offrir des temples et des jeux. » Indépendamment de ces dieux, dont Rome victorieuse enrichissait son Olympe, et qu'elle traînait, pour ainsi dire, à la suite de chaque triomphe; sans cesse l'imitation des mœurs étrangères, la superstition, l'ignorance populaire introduisait de nouvelles divinités. Après avoir consacré tous les dieux et tous les héros de la mythologie grecque, Rome adora les passions et les vices personnifiés, sous leurs propres noms. Elle dressa des temples aux maladies, dont elle redoutait la contagieuse influence, sans doute, parle même sentiment de terreur et de haine secrète, qui lui fit plus lard placer dans l'Olympe ses tyrans les plus abhorrés. L'idolâtrie en vint à ce point, que, suivant l'expression d'un ancien, il était plus facile de trouver à Rome un dieu qu'un homme. Les Romains, dont l'orgueilleuse politique tirait parti de tout, voyaient dans ce religieux chaos un gage de leur domination sur tous les peuples. Dignus Roma locus quo deus omnis est ; disait un de leurs poètes. Il leur semblait que Rome devait être le Panthéon de tous les cultes, pour être plus sûrement la capitale de tous les empires. Au temps du premier Africain, l'absurdité de ce système religieux était couverte par une simplicité de mœurs encore assez répandue ; et elle s'ennoblissait par toutes les idées de grandeur et de gloire. Dans la confusion de leur culte, les Romains se sentaient sous la protection de quelque divinité puissante; ils avaient foi à cette protection, à la valeur qu'elle leur inspirait, au génie de la république toujours victorieuse. La pompe des cérémonies, les actions de grâces à la suite d'un triomphe, les sacrifices, les évocations de ces dieux étrangers, qui semblaient toujours obéir à la voix des Romains, en leur livrant les villes assiégées, tous ces spectacles entretenaient dans les âmes la superstition par le patriotisme. Les défaites, quand les Romains en éprouvèrent, fortifiaient ce sentiment, et produisaient un redoublement de ferveur, et de nouvelles offrandes. Ainsi, dans cette émotion de gloire et de péril, où Rome était sans cesse entretenue, le sentiment religieux, quelle que fût l'extravagance de son objet et de ses formes, s'animait d'un perpétuel et véritable enthousiasme. Mais il est manifeste que, dès l'époque de Scipion Emilien, les arts et la philosophie de la Grèce commencèrent à jeter quelque ridicule sur l'idolâtrie. Le poète Lucile, dans un entretien qu'il supposait entre les dieux, les faisait plaisanter eux-mêmes sur ce titre de père, que les hommes leur donnaient à tous indistinctement. Ailleurs ce même poète raillait ceux qui tremblent devant les idoles, comme devant des divinités; et il les comparait à ces enfants qui ont peur d'une statue de marbre ou d'airain, et la prennent pour un homme. Mais ce qui prouve les grands progrès de cette incrédulité, et sa promptitude à devancer même la marche des arts, c'est qu'un siècle après Lucile, Lucrèce choisit pour unique sujet de ses chants le système irréligieux d'Epicure, et attaqua sans réserve les fables du polythéisme. Les idées philosophiques ne tombent jamais dans le domaine du poète, qu'après avoir longtemps occupé les esprits. Lucrèce annonce qu'il a entrepris son ouvrage, pour affranchir les âmes des liens de la superstition; mais on peut croire que ces liens étaient déjà brisés, puisque la poésie, encore à son berceau dans Rome, la poésie naturellement portée vers les traditions religieuses, se donnait à elle-même une tâche si éloignée de sa vocation primitive et naturelle. Le poème de Lucrèce, animé par un génie, que n'a pu vaincre la sécheresse même de l'athéisme, cet ouvrage singulier, écrit à la fois sous l'inspiration d'Homère et d'Epicure, et qui réunit la verve d'une littérature naissante au scepticisme d'une société corrompue, ce monument qui ne pouvait appartenir qu'à un peuple imitateur, comme le furent les Romains, est la plus grande preuve que, dès le septième siècle de Rome, le polythéisme tombait en ruines, et que la même incrédulité s'étendait au dogme sacré de l'immortalité de l'âme. Les magistrats se contentaient de maintenir les rites et les cérémonies du culte. C'est ainsi que paraît avoir raisonné le célèbre Varron, que Montesquieu appelle un des plus grands théologiens de Rome. Dans son ouvrage sur les antiquités, il avait placé à la fin ce qui concernait la religion, parce que, disait-il, les Etats se constituent, avant de se donner une religion. Il divisait ensuite la connaissance des dieux en trois espèces différentes, qu'il nommait mythologique, naturelle et civile. « La première, disait-il, renferme beaucoup de fables contraires à la majesté et à la nature d'êtres immortels : par exemple, qu'ils soient nés de la cuisse ou de la tète d'un dieu, qu'ils aient commis des vols, des adultères. La seconde se compose des systèmes de la philosophie, sur l'essence des dieux. Enfin, la théologie civile se borne à la connaissance des dieux reconnus par le culte public, et aux devoirs des citoyens et des prêtres, pour la célébration des sacrifices. La première de ces théologies, ajoutait Varron, est faite pour le théâtre, la seconde pour l'univers, la troisième pour Rome. » Il paraît que Varron, dans cet ouvrage, expliquait, par des allégories, les plus grandes absurdités du polythéisme, et qu'il le réduisait à des observances légales, dont la politique devait diriger l'usage. Cicéron porta plus loin et le scepticisme et la vraie philosophie : non seulement, il attaqua le principe des théogonies païennes, et répéta ce que les Grecs avaient dit à ce sujet de plus fort et de plus moqueur; mais il s'éleva souvent au dogme d'un seul dieu, d'une suprême et pure intelligence. Deux siècles plus tard, les premiers chrétiens triomphèrent des aveux d'un si grand homme et, dans leurs combats contre le paganisme, ils ne trouvaient pas d'argument plus puissant que le mépris, dont Cicéron avait flétri les traditions mythologiques. Les défenseurs du paganisme au contraire, s'apercevant que les écrits de Cicéron avaient préparé, par l'avilissement des croyances antiques, la victoire d'un culte nouveau, demandaient que le sénat fît détruire de si dangereux ouvrages. A la vérité, on pouvait répondre que ce même Cicéron avait cent fois célébré et embelli de son éloquence le culte des dieux. Ses opinions varient en effet, selon qu'il parle en orateur, qu'il raisonne en politique, ou qu'il conjecture en philosophe. Orateur, il emploie les pieuses croyances, l'intervention miraculeuse des dieux, l'inviolabilité des autels, la sainteté des rites antiques. Poursuit-il Verrès, son ardente prière fait descendre tous les dieux autour du tribunal, pour accabler un spoliateur sacrilège. Défend-il Fonteius, il invoque sur lui les mains tutélaires d'une sœur qui veille à la durée de l'empire et des feux de Vesta. Homme d'Etat, il veut maintenir le culte établi, il le défend, il l'admire comme un monument du passé, comme une tradition de la sagesse antique, comme un gage de la perpétuité de l'empire; il redoute l'irréligion et les superstitions nouvelles, et ne veut permettre aux citoyens qu'un culte formellement admis par l'Etat. Mais dans ses ouvrages philosophiques, Cicéron, libre et ingénieux disciple des Grecs, ne voit plus dans la mythologie vulgaire qu'un tissu de fausses traditions, ou d'allégories mal comprises. Bien que la diversité des opinions qu'il prête à ses interlocuteurs laisse quelquefois une sorte d'incertitude sur sa propre pensée, il est clair qu'il ne croit pas au polythéisme, et qu'il doute de tout le reste. Ses ouvrages ne sont à la vérité que des analyses contradictoires de toutes les opinions déjà répandues dans la Grèce; mais on ne peut douter que Cicéron, leur donnant le crédit de son nom et la popularité de son éloquence, n'ait puissamment contribué à détruire dans sa patrie l'ancien système religieux, dont ces opinions montraient le ridicule et l'inconséquence. A travers quelques précautions qui semblent des égards pour la croyance reçue par l'Etat, les dialogues des Tusculanes et de la Nature des Dieux renversent tout l'édifice du paganisme, et le réduisent à des fables ou à des symboles. Le traité de la Divination, moins spéculatif et moins imité des Grecs, détruit par le ridicule une des parties essentielles du culte public. Toutes les espèces d'oracles et de prédictions, toutes les fourberies des prêtres païens, et toutes les sottises de la crédulité humaine, sont attaquées dans le second livre de ce singulier ouvrage, avec une hardiesse que Cicéron ne cache plus sous le nom d'un interlocuteur étranger, mais qu'il avoue librement. Les paroles, par lesquelles il termine, semblent une profession de déisme opposée aux fables du polythéisme, et aux vaines terreurs du vulgaire. « Parlons avec vérité, dit-il; la superstition répandue chez les peuples, a opprimé presque toutes les âmes, et s'est emparée de la faiblesse humaine. Nous l'avions dit dans l'ouvrage sur la Nature des Dieux, et nous l'avons plus particulièrement démontré dans ce dernier écrit, convaincus comme nous le sommes, que nous aurions fait une chose utile à nos concitoyens et à nous-mêmes., si nous avions extirpé une telle erreur. Cependant (car, sur ce point, je veux que ma pensée soit bien comprise) la chute de la superstition n'est pas la ruine de la religion. Il est d'un sage de conserver les Institutions de nos aïeux, pour l'observance des sacrifices et des cérémonies; et l'existence d'une nature supérieure, éternelle, la nécessité pour l'homme de la reconnaître et de l'adorer, est attestée par la magnificence du monde, et l'ordre des choses célestes. « Ainsi, de même qu'il faut propager la religion qui se lie à la connaissance de la nature, il faut arracher toutes les racines de la superstition. » On ne peut confondre ce langage avec celui de Lucrèce, qui prétendait également délivrer les âmes des terreurs imbéciles de la superstition. Une cause première, une nature divine remplace ici le mouvement inexplicable des atonies d'Epicure. Etait-ce le terme où s'arrêtaient invariablement les pensées de Cicéron ? Son esprit était-il étranger à toutes les croyances superstitieuses, dont nous apercevons quelquefois des traces dans la vie des plus grands hommes de l'antiquité. Il semble que, s'il avait eu ce genre de faiblesse, ses lettres, monument si vrai de tous les mouvements de son âme, offriraient sur ce point quelque révélation ; mais je n'y découvre qu'un passage qui réponde un peu à notre curiosité : c'est dans une lettre familière à sa femme Térentia, en lui annonçant qu'il a été malade et promptement guéri. « J'ai été soulagé si vite, dit-il, qu'il semble que quelque dieu m'ait secouru, aussi ne manquez pas d'offrir, avec le soin pieux et la pureté qui vous est ordinaire, un sacrifice à ce dieu, c'est-à-dire à Apollon et à Esculape. » Mais ce passage est-il sérieux ? n'est-ce pas quelque allusion légèrement ironique, comme celle de Socrate ordonnant d'immoler un coq à Esculape? Voilà ce qu'il est assez difficile de deviner, ou du moins d'affirmer. Un des apologistes du christianisme, pour prouver que Cicéron avait cru que les premiers dieux étaient des hommes divinisés, nous a conservé un passage d'un caractère bien différent, et qui fut inspiré à Cicéron par la plus douloureuse épreuve de sa vie, la perte de sa fille. « Si jamais créature mortelle, écrivait Cicéron dans sa douleur, mérita d'être divinisée, sans doute, c'est Tullie ; si la renommée a placé dans le ciel la postérité de Cadmus, d'Amphion ou de Tyndare, le même honneur doit être dédié à Tullie ; et certes, je le ferai : ô toi, la plus vertueuse et la plus éclairée des femmes, placée parmi les dieux qui te reçoivent, je te consacrerai dans la croyance de tous les mortels. » Mais ce délire d'une imagination vive et tendre, ce paganisme de l'amour paternel ne peut servir à prouver le sentiment réel de Cicéron sur l'efficacité des apothéoses, et sur la vérité du polythéisme. Deux siècles plus tard, lorsque Quintilien invoquait les mânes d'un fils, qu'il avait perdu, et les nommait les divinités de sa douleur, il savait bien que ce dieu nouveau n'existait que pour le cœur d'un père. Il est vraisemblable que Cicéron, dans le traité de la République, avait tenu le milieu entre les opinions toutes païennes, la foi explicite au culte romain qu'il professe dans ses ouvrages oratoires, et le hardi scepticisme, la liberté railleuse, qu'il avait réservée pour ses conférences philosophiques. Quelques siècles plus tard, les mêmes chrétiens qui invoquaient contre les restes du paganisme persécuteur l'autorité de Cicéron, lui reprochaient cependant de n'avoir pas donné assez de force et de franchise à son mépris pour de vaines fables. « O Cicéron, dit Lactance, que n'essayais-tu d'éclairer le peuple? Cette œuvre était digne d'exercer toute ton éloquence: tu ne devais pas craindre que la parole te manquât dans une cause si juste. —Mais, apparemment, tu redoutes le cachot de Socrate, et tu n'oses prendre en main la défense de la vérité : il était plus beau de mourir ainsi ; et les Philippiques n'ont pu te donner autant de gloire que tu en aurais mérité, en dissipant l'erreur du genre humain. Je te vois adorer des statues d'argile, sorties de main d'homme. Tu sais combien elles sont impuissantes et vaines ; mais tu imites dans ton culte ceux dont tu reconnais la folie. Que te sert-il donc d'avoir vu la vérité, si tu ne devais ni la suivre ni la défendre. » Ces vives apostrophes de l'éloquent chrétien n'empochent pas de concevoir l'espèce de réserve que s'imposait Cicéron, et la crainte qu'il avait de porter trop loin le doute philosophique. Ce n'était pas le martyr de Socrate qui l'effrayait. La profanation fut quelquefois punie dans Rome : mais il ne paraît pas que l'irréligion spéculative eût jamais attiré la sévérité des magistrats. Le poème de Lucrèce en est une preuve suffisante. Mais, si l'on songe à l'état imparfait de la société, à l'esclavage domestique, à la rareté des livres, à la difficulté de répandre les connaissances et les lumières, on concevra que Cicéron n'ait pas formé la grande entreprise que lui demande Lactance. Ce dogme sublime de l'unité de Dieu, cette idée d'une suprême intelligence rémunératrice et vengeresse ne pouvait se communiquer à tout un peuple nourri de tant de fables grossières, entouré de tant de dieux matériels et visibles : elle n'eût pas été comprise ; elle n'eût paru qu'un athéisme; et dès lors, elle eût été sans force et sans vertu. L'annonce publique de cette grande vérité devait former une ère toute nouvelle, une rénovation du genre humain. A l'ancienne religion était liée l'ancienne société tout entière, et le livre de Cicéron, les pensées, les efforts de sa vie avaient pour objet de défendre cette ancienne société. Nous voyons en effet, par quelques citations éparses, que même clans ce sixième livre consacré à la religion et au culte, beaucoup de choses se rapportaient directement à la politique et au patriotisme. Cicéron y traçait l'image de l'homme d'État vertueux et éclairé. Il y flétrissait les ambitieux et les corrupteurs qui préparaient l'esclavage public par de funestes dissensions. Il armait les bons citoyens contre les factieux; il établissait la supériorité de la sagesse et de la vertu sur le nombre. A côté de l'ambition séditieuse, il montrait la corruption de mœurs qui lui servait d'auxiliaire ; il accusait ces passions qui, « maîtresses de l'âme, prennent sur elle un empire sans limite; et, ne pouvant être rassasiés ni satisfaites, poussent à tous les crimes ceux qu'elles ont enflammés de leurs séductions. » A ces traits, où l'on reconnaît les complices de Catilina et les amis de César, on voit assez quelle idée préoccupait incessamment Cicéron dans cet ouvrage, et comment il croyait avoir besoin de respecter toutes les croyances antiques, d'invoquer et de maintenir tout ce qui pouvait exister de saint et de sacré, pour opposer ces barrières, aux entreprises de la violence et de l'audace. Catilina, meurtrier d'un proscrit, avait lavé ses mains sanglantes dans la fontaine lustrale d'Apollon, sur la place publique de Rome; et sa fureur avait paru s'accroître de son impiété. César devait un jour, méprisant l'anathème que la politique religieuse du sénat romain avait inscrit sur son passage, pénétrer jusqu'à la ville sacrée, briser les portes du temple de Saturne, et enlever le trésor de la République, placé sous la garde du plus ancien des dieux. Étrange phénomène, qui prouve qu'il y a quelque chose de salutaire dans un culte quelconque! L'homme devint d'abord plus méchant et plus vicieux, en cessant de croire à une religion qui semblait permettre tous les vices. A l'aspect ou dans la prévoyance de tels maux, Cicéron embrassait les images des dieux, ces images qui lui paraissaient protectrices des lois et de la liberté romaines. Il s'efforçait d'oublier les subtils raisonnements du pyrrhonisme grec; et il espérait remonter vers la crédulité des premiers temps de la République, comme s'il eût pu rendre à son siècle les vertus et l'héroïsme de ces temps antiques. D'ailleurs, en abjurant publiquement les traditions religieuses de son pays, quelles vérités pouvait-il y substituer? L'esprit de l'homme, laissé à lui-même, ne suffisait pas pour entreprendre la réforme des croyances humaines. Cicéron, naturellement indécis, avait encore fortifié cette disposition dans les écoles de la secte académique. « Plût aux dieux, disait-il lui-même, qu'il me fût aussi facile de trouver la vérité que de prouver l'erreur ! » Ainsi, dans le doute de son esprit, et dans l'impuissance de l'esprit humain, comme citoyen et même comme philosophe, il était reporté vers ce culte de la vieille Rome, qu'il avait plus d'une fois attaqué par ses railleries : il le louait, il l'admirait comme une sauvegarde publique. Les noms des personnages, qu'il avait mis en scène, rendaient d'ailleurs ce langage vraisemblable et nécessaire. Scipion avait rempli les fonctions de grand pontife; Lælius qui, comme le dit quelque part Cicéron, fut tout ensemble un augure et un sage, avait prononcé sur une question du culte romain un discours célèbre. Nous voyons par un fragment du sixième livre qu'il était fait dans le dialogue allusion à ce discours, où les anciennes cérémonies et les vases sacrés des ancêtres étaient vantés comme les plus agréables aux dieux immortels. Une autre phrase, également conservée par un grammairien, se rapporte à la sainteté, à l'inviolabilité que les anciens Romains donnaient à l'union conjugale, en la plaçant sous l'intervention des auspices. Il suffit de ces faibles indices, pour apprendre quel respect des anciennes coutumes, quelle gravité religieuse devait régner dans ce livre, et comment Cicéron avait dû s'y refuser les saillies de scepticisme, qu'il laisse échapper dans d'autres ouvrages. Mais à côté des fables du polythéisme, il avait placé les belles inspirations de la philosophie platonicienne, et cette croyance de l'immortalité de l'âme, principe d'un culte tout spirituel et tout moral. C'était là le triomphe de son génie ; et heureusement cette partie de son ouvrage s'était conservée jusqu'à nous : le songe de Scipion est un exemple de ce que la raison et l'enthousiasme peuvent faire pour s'élever à l'éternelle vérité, et de ce qui leur manque pour y parvenir : c'est un monument précieux, tout à la fois parce qu'il est sublime, et parce qu'il est insuffisant. Quelle que soit en effet l'élévation et l'éloquence de ce morceau, il semble que la simplicité de la grande vérité qu'il renferme, est souvent altérée par les raisonnements d'une philosophie argutieuse et subtile. Que d'efforts, que d'expressions scolastiques, pour prouver que l'âme est immortelle, parce qu'elle a son mouvement en elle-même! Les descriptions du monde céleste, le bruit harmonieux des sphères, et toute cette théurgie pythagoricienne, dont Cicéron fait un grand usage, forment aussi un bien petit spectacle, à côté de l'immensité réelle de l'univers. Mais l'épisode entier n'en conserve pas moins une singulière magnificence de pensées et d'expressions. Sans doute, depuis Cicéron, le génie de l'homme, aidé par le temps et la science, a prodigieusement agrandi le spectacle de l'univers : il a remplacé toutes les imaginations des philosophes et des poètes sur le système du monde, par des réalités bien autrement merveilleuses : il a calculé l'infini avec une rigueur mathématique, bien plus sublime que toutes les hypothèses de l'enthousiasme ; mais, il n'a fait en cela que donner une nouvelle certitude aux nobles pressentiments de la sagesse antique, sur les destinées de l'homme : il n'a fait que manifester avec plus de puissance la grandeur de Dieu, et la divine origine de l'âme. LIVRE SIXIEME.I. ..... Bien que, pour les sages, la conscience des belles actions soit la plus magnifique récompense de la vertu, cependant celte divine vertu, sans ambitionner ces statues qu'un plomb vil retient sur leurs bases, ou ces triomphes ornés de lauriers qui sèchent si vite, aspire à des couronnes plus vertes et plus durables. Quelles sont ces couronnes? dit Lælius. Souffrez, reprit Scipion, puisque nous sommes libres encore pendant ce troisième[1] jour de fête, que je vous fasse un dernier récit..................... II. Lorsque j'arrivai en Afrique, où j'étais, comme vous le savez, tribun dans la quatrième légion, sous le consul Manilius, mon premier empressement fut de voir le roi Masinissa, que de justes motifs liaient à notre famille par une étroite amitié. Quand je fus devant lui, ce vieillard m'embrassant, versa des larmes ; puis, il leva les yeux au ciel : « Je te rends grâces, dit-il, souverain soleil, et vous tous dieux de l'Olympe ! Avant de sortir de la vie, je vois dans mon royaume, et dans cette demeure, Publius Cornélius Scipion ; et ce nom seul m'a ranimé : tant mon âme conserve toujours le souvenir du vertueux et invincible Scipion ! » Alors, je lui fis des questions sur son royaume ; il m'interrogea sur notre République; et, dans la longueur de ces mutuelles confidences, le jour se consuma pour nous. III. Après un repas d'une magnificence royale, notre entretien continua fort avant dans la nuit. Le vieux roi ne parlait que de Scipion l'Africain ; et il avait présentes à la mémoire toutes ses actions et même ses paroles. Ensuite, lorsque nous fûmes retirés, pour prendre du repos, fatigué du voyage et d'une veille prolongée si tard, un sommeil plus profond que de coutume enveloppa tous mes sens. Alors, je le suppose, par une impression qui me restait de notre entretien (car il arrive souvent que les sujets habituels de nos pensées et de nos discours produisent, dans le sommeil, un effet semblable à ce que raconte Ennius touchant Homère,[2] dont vous concevez bien qu'il était sans cesse occupé, durant le jour), l'Africain m'apparut, avec ces traits, que je connaissais plutôt, pour avoir contemplé ses images que pour l'avoir vu lui-même. A peine l'eussé-je reconnu que je frissonnai; mais, lui : « Reste calme, Scipion, me dit-il, bannis la crainte ; et grave mes paroles dans ton souvenir. IV. « Vois-tu cette ville qui, forcée par moi d'obéir au peuple romain, renouvelle d'anciennes guerres, et ne peut se tenir paisible ? » En même temps, du haut d'un lieu rempli d'étoiles, et tout éclatant de lumières, il me montrait Carthage. « Aujourd'hui, tu viens l'assiéger, presque soldat encore; dans le cours de ces deux années, tu seras consul, pour la détruire; et tu auras conquis par toi-même ce surnom, que maintenant tu tiens de moi par héritage. Lorsque tu auras renversé Carthage, que tu auras été censeur, et que tu auras visité, comme envoyé de Rome, l'Egypte, la Syrie, l'Asie, la Grèce, tu seras de nouveau choisi consul, en ton absence ; tu finiras la plus grande de nos guerres ; tu ruineras Numance. Mais, après que, sur un char de triomphe, tu auras monté au Capitole, tu retomberas au milieu du désordre de la République troublée par les projets de mon petit-fils. V. « Là, Scipion l'Africain, il te faudra faire briller pour la patrie le flambeau de ton âme, de ton génie, de ta prudence. Je vois, à cette époque, la destinée incertaine, pour ainsi dire, de sa route : car, lorsque ta vie mortelle aura vu passer huit fois sept révolutions de soleil, et que ces deux nombres, qui, l'un et l'autre, par des raisons différentes, sont également parfaits,[3] auront, par le cours de la nature, complété pour toi le nombre fatal, Rome entière se tournera vers ton nom et vers toi. C'est toi, que le sénat, toi, que les bons citoyens, toi, que les alliés chercheront de leurs regards ; tu seras l'homme sur qui reposera le salut de la patrie. Enfin, Dictateur, il te faudra de nouveau constituer la République, si tu peux échapper aux mains parricides de tes proches. » Au cri d'effroi que fit alors Lælius, au soudain gémissement de tous les autres, Scipion reprenant avec un sourire gracieux : « Je vous en prie, dit-il, ne me réveillez pas, que tout demeure en paix ; écoutez le reste : VI. « Pour te donner, ô vainqueur de l'Afrique, plus d'ardeur à défendre l'État, sache bien que tous ceux qui auront sauvé, défendu, agrandi leur patrie, ont dans le ciel une place certaine et fixée d'avance, où ils doivent jouir d'une éternité de bonheur : car, il n'est rien, sur la terre, de plus agréable aux regards de ce dieu suprême qui régit l'univers, que ces réunions, ces sociétés d'hommes formées sous l'empire du droit, et que l'on nomme cités. Ceux qui les gouvernent, ceux qui les conservent, sont partis de ce lieu ; c'est dans ce lieu qu'ils reviennent. » VII. A ces mots, malgré le trouble qui m'avait saisi, moins par la crainte de la mort que par l'idée de la trahison des miens, je lui demandai si lui-même, si mon père Paulus vivait encore, ainsi que tous les autres, qui, à nos yeux, ne sont plus. « Dis plutôt, répondit-il ; ceux-là vivent, qui sont échappés des liens du corps et de cette prison. Ce que vous appelez la vie, dans votre langage, c'est la mort. Regarde : Paulus, ton père, vient vers toi. » Quand je l'aperçus, je répandis une grande abondance de larmes ; mais lui, m'embrassant avec tendresse, me défendait de pleurer. VIII. Et moi, sitôt que, retenant mes larmes, j'eus la force de parler : « Je vous en prie, lui dis-je, ô mon «divin et excellent père! puisque c'est ici la vie, comme je l'apprends de Scipion, pourquoi languirais-je sur la terre? pourquoi ne pas me hâter de revenir à vous ? Il n'en est pas ainsi, répondit-il : à moins que le dieu, dont tout ce que tu vois est le temple, ne t'ait délivré des chaînes du corps, l'entrée de ces lieux ne peut s'ouvrir pour toi ; car les hommes sont nés sous la condition d'être les gardiens fidèles du globe que tu vois, au milieu de cet horizon céleste, et qu'on appelle la terre : leur âme est tirée de ces feux éternels, que vous nommez constellations, étoiles, et qui, substances mobiles et sphériques, animées par des esprits divins, fournissent, avec une incroyable célérité, leur course circulaire. Ainsi, Publius, toi, et tous les hommes religieux, vous devez retenir votre âme dans la prison du corps ; et vous ne devez pas quitter la vie, sans l'ordre de celui qui vous l'a donnée, de peur d'avoir l'air de fuir la tâche d'homme, que Dieu vous avait départie. Mais plutôt, comme ce héros, ton aïeul, comme moi qui t'ai donné le jour, cultive la justice et la piété, cette piété, grand et noble devoir envers nos parents et nos proches, mais devoir le plus sacré de tous envers la patrie. Une telle vie est le chemin pour arriver au ciel et dans la réunion de ceux qui ont déjà vécu, et qui, délivrés du corps, habitent le lieu que tu vois. » IX. Il désignait ce cercle lumineux de blancheur qui brille, au milieu des flammes du ciel, et que, d'après une tradition venue des Grecs, vous nommez la Voie lactée. Ensuite, portant de tous côtés mes regards, je voyais dans le reste du monde des choses grandes et merveilleuses : c'étaient des étoiles que, de la terre où nous sommes, nos yeux n'aperçurent jamais; c'étaient partout des distances et des grandeurs, que nous n'avions point soupçonnées. La plus petite de ces étoiles était celle qui, située sur le point le plus extrême des cieux, et le plus rabaissé vers la terre, brillait d'une lumière empruntée : d'ailleurs les globes étoiles surpassaient de beaucoup la grandeur de la terre ; et cette terre elle-même se montrait alors à moi si petite, que j'avais honte de notre empire, qui ne couvre qu'un point de sa surface. X. Comme je la regardais avec plus d'attention : « Jusques à quand, dis-moi, reprit Scipion, ton âme restera-t-elle attachée à la terre? Ne vois-tu pas au milieu de quels temples tu es parvenu? Devant toi, neuf cercles, ou plutôt neuf globes enlacés composent la chaîne universelle : le plus élevé, le plus lointain, celui qui enveloppe tout le reste, est le Souverain Dieu lui-même, qui dirige et qui contient tous les autres. A lui sont attachés ces astres qui roulent, avec lui, d'un mouvement éternel : plus bas, paraissent sept étoiles qui sont emportées d'une course rétrograde, en opposition à celle des cieux. Une d'elles est le globe lumineux que, sur la terre, on appelle Saturne ; ensuite vient cet astre propice et salutaire au genre humain, qu'on nomme Jupiter ; puis cette étoile rougeâtre et redoutée de la terre, que vous appelez Mars; ensuite, presque au centre de cette région domine le soleil, chef, roi, modérateur des autres flambeaux célestes, intelligence et principe régulateur du monde, qui, par son immensité, éclaire et remplit tout de sa lumière. Après lui, et comme à sa suite, Vénus et Mercure. Dans le cercle inférieur, marche la lune enflammée des rayons du soleil. Au-dessous, il n'y a plus rien que de mortel et de corruptible, à l'exception des âmes données à la race humaine par le bienfait des dieux : au-dessus de la lune, toutes les existences sont éternelles : quant à cette terre, qui, placée au centre, forme le neuvième globe, elle est immobile et abaissée; et tous les corps gravitent vers elle par leur propre poids. » XI. Dans la stupeur, où m'avait jeté ce spectacle, lorsque je repris possession de moi-même : « Quel est, dis-je, quel est ce son qui remplit mes oreilles, avec tant de puissance et de douceur ? Vous entendez, me répondit-il, l'harmonie qui, par des intervalles inégaux, mais calculés dans leur différence, résulte de l'impulsion et du mouvement des sphères, et qui, mêlant les tons aigus et les tons graves, produit régulièrement des accents variés : car, de si grands mouvements ne peuvent s'accomplir en silence ; et la nature veut que, si les sons aigus retentissent à l'un des deux extrêmes, les sons graves sortent de l'autre. Ainsi, ce premier monde stellaire, dont la révolution est plus rapide, se meut avec un son aigu et précipité, tandis que le cours inférieur de la lune ne rend qu'un son très grave : car, pour la terre, neuvième globe, dans son immuable station, elle reste toujours fixe au point le plus abaissé, occupant le centre de l'univers. Les huit sphères mobiles, parmi lesquelles deux ont la même portée, Mercure et Vénus, produisent sept tons distincts et séparés ; et il n'est presque aucune chose dont ce nombre ne soit le nœud. Les hommes, qui ont imité cette harmonie par le son des cordes, ou de la voix, se sont ouvert une entrée dans ces lieux, ainsi que tous les autres qui, .par la supériorité de leur génie, ont, dans une vie mortelle, cultivé les sciences divines, mais, les oreilles des hommes sont assourdies par le retentissement de ce bruit ceci leste. Et en effet, le sens de l'ouïe est le plus imparti fait chez vous autres mortels. C'est ainsi qu'aux lieux, où le Nil se précipite du haut des monts vers ceci qu'on nomme les cataractes, la grandeur du bruit a rendu sourds les habitants voisins. Cette harmonie de tout l'univers, dans la rapidité du mouvement qui l'emporte, est telle que l'oreille de l'homme ne ce peut la supporter, de même que vous ne pouvez regarder en face le soleil, et que la force, la sensibilité de vos regards est vaincue par ses rayons. Dans mon admiration de ces merveilles, je reportais cependant quelquefois mes yeux vers la terre. XII. L'Africain me dit alors : « Je vois que, même en ce moment, tu contemples la demeure et la patrie du genre humain. Si elle se montre à toi, dans toute sa petitesse, ramène donc toujours tes regards vers le ciel ; méprise les choses humaines. Quelle étendue de renommée, quelle gloire désirable peux-tu obtenir parmi les hommes ? Tu vois sur la terre leurs habitations disséminées, rares, et n'occupant qu'un étroit espace; tu vois même entre ces petites taches, que forment les points habités, de vastes déserts interposés; tu vois enfin ces peuples divers tellement séparés que rien ne peut se transmettre de l'un à l'autre: tu les vois jetés çà et là, sous d'autres latitudes, dans un autre hémisphère, trop éloignés de vous, pour que vous puissiez attendre d'eux aucune gloire. » XIII. « Tu vois ces espèces de ceintures qui semblent environner et revêtir la terre : les deux d'entre elles qui sont les plus distantes, et dont chacune s'appuie sur un pôle du ciel, tu les vois glacées d'un éternel hiver, tandis que celle qui les sépare, et la plus grande, est brûlée par l'ardeur du soleil. Deux zones sont habitables ; la zone australe, dont les peuples sont vos antipodes, race étrangère à la vôtre; enfin, cette zone septentrionale que vous habitez, vois dans quelle faible proportion elle vous appartient. Toute cette partie de la terre, en effet occupée par vous, resserrée vers les pôles, plus large vers le centre, n'est qu'une petite île, de toutes parts baignée par une mer, qui s'appelle l'Atlantique, la grande mer, l'Océan, comme vous dites sur la terre, et pourtant, avec tous ces grands noms, tu vois quelle est sa petitesse. Mais enfin, partant du point qu'occupent ces terres cultivées et connues, ta gloire, ou celle de quelqu'un des nôtres, a-t-elle pu franchir ce Caucase que tu vois, ou traverser les flots du Gange? Qui jamais, dans le reste de l'orient ou de l'occident, aux bornes du septentrion ou du midi, entendra ton nom? et, tout cela retranché, tu vois dans quelles étroites limites votre gloire cherche une carrière pour s'étendre : « ceux mêmes qui parlent de vous, combien de temps en parleront-ils ? XIV. « Et, quand même les races futures, recevant de leurs aïeux la renommée de chacun d'entre vous, seraient jalouses de la transmettre à la .postérité, ces inondations, ces embrasements de la terre, dont le retour est inévitable, à certaines époques marquées, ne permettraient pas que nous puissions obtenir, je ne dis pas l'éternité, mais seulement la longue durée de la gloire. Et de plus, que t'importe d'être nommé dans les discours des hommes qui naîtront à l'avenir, lorsque tu ne l'as pas été dans ceux des hommes qui sont nés, avant toi; générations non moins nombreuses, et certainement meilleures ? XV. « Surtout enfin, s'il est vrai que, parmi ceux auxquels peut arriver ton nom, nul ne saurait embrasser les souvenirs d'une seule année : car, les hommes calculent vulgairement l'année sur la révolution du soleil, c'est-à-dire d'un seul astre : mais, lorsque tous les astres seront revenus au point, d'où ils étaient partis une première fois, et qu'ils auront, après de longs intervalles, ramené la première position de toutes les parties du ciel, alors seulement, on peut véritablement dire l'année accomplie; et j'ose à peine dire combien une telle année renferme de générations humaines. Le soleil parut jadis s'éclipser et s'éteindre, au moment que l'âme de Romulus entra dans le sanctuaire des cieux : quand le soleil, au même point, éprouvera une seconde éclipse, tous les astres, toutes les planètes étant replacées au même lieu, alors seulement vous aurez une année complète; mais sachez que, d'une telle année, la vingtième partie n'est pas encore révolue. XVI. « Si donc tu avais perdu l'espoir d'être rappelé dans ces lieux, le terme unique des grandes âmes, de quel prix serait enfin cette gloire des hommes, qui peut à peine s'étendre à une faible partie d'une seule année? Donc, si tu veux élever tes regards et les fixer sur cette patrie éternelle, ne dépends plus des discours du vulgaire, ne place plus dans des récompenses humaines le but de tes grandes actions. Que, par son charme puissant, la vertu seule t'entraîne à la véritable gloire ! Laisse aux autres à juger ce qu'ils diront de toi : ils en parleront sans doute ; mais, tout le bruit de leurs entretiens ne retentit pas au delà des régions que tu vois ; il ne se renouvelle éternellement pour personne, il tombe, avec les générations « qui meurent ; il disparaît dans l'oubli de la postérité. » XVII. Lorsqu'il eut ainsi parlé : « O Scipion ! lui dis-je, si les hommes qui ont bien mérité de la patrie trouvent un sentier ouvert, pour les conduire aux cieux, moi qui, dès l'enfance, marchant sur les traces de mon père et sur les tiennes, n'avais point déshonoré votre gloire, je veux cependant aujourd'hui, dans la vue d'un, prix si beau, travailler avec plus de zèle encore. » Il dit : « Travaille en effet ; et sache bien que tu n'es pas mortel, mais ce corps seulement : car, tu n'es pas ce que manifeste cette forme extérieure. « L'individu est tout entier dans l'âme, et non dans cette figure, qu'on peut désigner du doigt, apprends donc que tu es dieu ; car il est dieu celui qui vit, qui sent, qui se souvient, qui prévoit, qui exerce sur ce corps, dont il est le maître, le même empire, le même pouvoir, la même impulsion que Dieu sur l'univers, celui enfin qui fait mouvoir, intelligence immortelle, un corps périssable, comme le Dieu éternel anime lui-même un corps corruptible. XVIII. « En effet, le mouvement éternel, c'est l'éternelle vie. Mais l'être qui communique le mouvement, et qui le reçoit d'ailleurs, doit nécessairement, sitôt qu'il s'arrête, cesser de vivre. Il n'y a donc que l'être doué d'un mouvement spontané, qui ne cesse jamais d'être mû, parce qu'il ne saurait être délaissé par lui-même : bien plus, c'est en lui que tous les autres corps trouvent une cause, un principe d'impulsion. Or, ce qui est principe n'a point d'origine. Car, du principe sort tout le reste ; et lui-même ne peut tenir son être d'aucune chose ; il ne serait pas principe, comme nous l'entendons, s'il émanait du dehors. Si donc il n'a pas d'origine, il n'a pas non plus de fin : car un principe anéanti ne pourrait ni renaître d'un autre principe, ni en créer lui-même un nouveau, puisqu'un principe est nécessairement le premier point de départ de toutes choses. » « Ainsi, le principe du mouvement réside dans l'être qui se meut par lui-même : il ne peut donc ni commencer, ni finir : autrement, le ciel s'écroulerait, la nature resterait en suspens, et ne trouverait aucune force qui lui rendît l'impulsion primitive. XIX. « Or, maintenant qu'il est manifeste que l'immortalité appartient à l'être qui se meut de soi-même, peut-on nier que telle ne soit la nature départie à nos âmes? En effet, tout ce qui reçoit le mouvement d'ailleurs est inanimé. Ce qui est vivant agit par une impulsion intérieure et personnelle : et, telle est la propre nature de l'âme et sa puissance. Si, parmi tous les êtres, seule elle porte en soi le mouvement, dès lors elle n'a pas pris naissance ; dès lors elle est éternelle. Occupe-la, Scipion, des choses les meilleures; il n'en est pas de meilleures que les veilles pour le salut de la patrie. L'âme développée, exercée par ce noble travail, s'envolera plus vite vers cette demeure, sa maison natale. Sa course en sera plus libre et plus légère si, du temps même qu'elle est enfermée dans le corps, elle s'élance au dehors, et par la contemplation s'arrache à la matière. Car les âmes de ceux qui se livrèrent aux plaisirs des sens, qui s'en tirent comme les esclaves et, par l'entraînement des désirs que donne la volupté, violèrent les lois des dieux et des hommes, ces âmes une fois sorties du corps, sont retenues errantes « autour de la terre, et ne rentrent dans ce lieu, qu'après le tourment d'une agitation de plusieurs siècles. » Alors, il disparut; et je m'éveillai.
FRAGMENTS.
A la fin de cet admirable sixième livre, pour la dernière fois nous sommes obligés de reproduire, avec un soin minutieux et désolant, les faibles parcelles, les phrases, les mots, qui ne pouvant s'encadrer dans la précieuse découverte de M. Mai, ou se lier à nos observations générales, appartiennent cependant au traité de la République. Les philologues ne nous pardonneraient pas une omission. Dans l'un de ces passages, Cicéron rapportant la résolution généreuse de Sempronius Gracchus, qui voulut suivre en exil son collègue accusé, disait, avec un choix d'expressions remarqué par Aulu-Gelle : « L'action était d'autant plus noble, que bien qu'ils fussent collègues et dans la même situation, ils n'excitaient pas la même haine ; mais que plutôt la popularité de Gracchus demandait grâce pour la publique défaveur de Claudius. » Mais à quoi bon interpréter ces débris, qui se réduisent quelquefois à un seul mot ? Ceux même qui semblent rappeler quelque souvenir historique, quelque fait, ont été si malheureusement mutilés par les grammairiens qui les ont conservés, que l'on ne peut leur donner aucune importance.
FIN. TABLE ANALYTIQUEDES MATIÈRES CONTENUES DANS CET OUVRAGE.A Acteurs. Manière différente dont les acteurs étaient traités à Rome et dans la Grèce. Agriculture. Le goût pour l'agriculture fut commun aux plus grands citoyens de Rome. — L'agriculture était-elle assujettie à quelque taxe? Conjectures à ce sujet. Alexandre Sévère n'avait pas de lecture plus assidue que le traité des Devoirs et celui de la République par Cicéron. xxiii. Ancus Martius, quatrième roi de Rome. Son règne. Sa mort. — Il fit bâtir, selon tous les historiens, le fameux aqueduc appelé de son nom. Andrieux, poète et professeur. Sa traduction en vers d'un passage du traité de Re Publica. Archytas, de Tarente, philosophe pythagoricien. Ses sentiments sur la colère et les moyens de la réprimer. Aristote. Ses huit livres politiques, qui sont, pour ainsi dire, l'Esprit des Lois de l'antiquité, ont été mis à profit par Cicéron dans son traité de la République. Archimède avait construit une sphère mobile qui représentait le mouvement des astres et des planètes. Astronomie (digression remarquable sur l'). Augustin (S.). On trouve dans ses œuvres plusieurs passages du traité de Re Publica, de Cicéron. Citations à ce sujet. — Analyse du troisième livre, tirée de la Cité de Dieu. — Dans sa Cité de Dieu, il reproduit les idées de Cicéron sur le moyen de concilier les conquêtes et la domination des Romains avec le principe que la politique doit être fondée sur la justice. — Il nous a conservé la preuve que Cicéron blâmait l'abus des représentations de théâtre. Augures. Importance de ce corps sacerdotal, et leur influence sur les affaires civiles. Aulu-Gelle rapporte plusieurs passages des harangues de C. Gracchus. B Beaufort (M.), auteur d'une dissertation sur l'incertitude de l'histoire des premiers siècles de Rome. Bernardi (M.) avait entrepris de recomposer le traité de Re Publica, avec les phrases sur la politique, disséminées dans les ouvrages de Cicéron. C Carnéade, philosophe de Cyrène. Exposition et réfutation de sa fausse doctrine sur le juste et l'injuste. —Cette doctrine renouvelée par Montaigne et l'Anglais Mandeville, détruite par Rousseau. Carthage. Sa fondation a précédé celle de Rome. Son gouvernement avait quelque chose d'analogue à celui de la république romaine. Caton (le vieux). Son éloge. Son opinion sur l'origine et les causes de la prospérité de la république romaine. — Il avait composé un ouvrage de Re Publica, et un livre des Origines. Jugement sur ces deux ouvrages. — Citation du commencement du traité de Re Publica. Censure. Sentiment de Cicéron sur cette magistrature. Chateaubriand (M. de) paraît s'être trompé en avançant que le gouvernement représentatif était une découverte des modernes. Le traité de Re Publica prouve que le gouvernement mixte était connu et désiré par les philosophes grecs et latins. Cicéron (Quintus), frère de l'orateur. Lettre que celui-ci lui adresse, tout entière relative au traité de Re Publica. Comédie latine, lit les plus heureux progrès du temps de Scipion et de Lælius, à qui on attribuait une part dans les ouvrages de Térence. — Elle n'était qu'une imitation exclusive et littérale de la moyenne comédie grecque. — Elle était étrangère à toute intention morale ou politique. — Cicéron censure vivement la comédie grecque. Constitutions politiques. Discussion sur les différentes sortes de pouvoirs de la société. — La constitution politique la meilleure, selon Cicéron, devait être composée du mélange égal de la monarchie, de l'aristocratie et de la démocratie, tempérées l'une par l'autre. Cornélius Népos rapporte une anecdote curieuse qui tendrait à prouver que Lælius travailla effectivement aux comédies de Térence. Cumes, ville d'Italie. Cicéron y commença son traité de Re Publica. D Davy, célèbre chimiste anglais, a fait des essais infructueux pour décomposer les manuscrits d'Herculanum et en séparer les pages. Décemvirs (création des). — Leur tyrannie. — Réflexion de Montesquieu à ce sujet. Définition. Nécessité de bien définir l'objet sur lequel on veut discuter. Définition de la chose publique. Définition de la monarchie, de l'aristocratie et de la démocratie. Dettes. Les lois trop cruelles contre les débiteurs mirent plusieurs fois la république romaine en danger. Variation de la législation à ce sujet. Dialogue de Re Publica trouvé dans la bibliothèque du Vatican, avait été, dans le sixième siècle, recouvert par une nouvelle écriture renfermant des commentaires de saint Augustin sur les psaumes. Dictateur. Étymologie de ce mot. Digression sur les inconvénients politiques du voisinage de la mer. E Éclectique. Nom que l'on donne aux philosophes qui, sans embrasser particulièrement aucun système, prennent de chacun ce qui leur paraît le plus vraisemblable et le mieux fondé. Cicéron semble avoir suivi la méthode éclectique dans son traité de Re Publica. Écoles publiques à Rome de peu d'importance. Éducation. On est obligé de s'en tenir à des conjectures sur l'état de l'éducation à Rome au temps des Scipions. Les fragments du traité de Re Publica ne donnent aucun éclaircissement à ce sujet. — Fragment précieux d'un discours de Scipion Émilien, où il blâme la mollesse de l'éducation des jeunes Romains. — Négligence des Romains à l'égard de l'éducation publique. —Vices de l'éducation, cause principale de la corruption des derniers temps de la république. Égalité (1) absolue devient une extrême injustice. Ennius, ancien poète latin. Vers de ce poète sur la mort d’un roi. F Femmes. Mœurs et éloges des femmes romaines au temps de Scipion. G Gallus, ami de Scipion l'Africain, renommé dans son temps pour ses connaissances astronomiques. Gladiateurs. Jeux sanguinaires. Cicéron, dans aucun de ses ouvrages connus, n'a réprouvé cet affreux spectacle. — Le christianisme seul fit entendre ses réclamations contre ces jeux féroces. Gouvernements. Définition des trois formes de gouvernement, leurs avantages, leurs inconvénients. — Gouvernement mixte semble à Cicéron le meilleur possible. Gracques. Sentiments de Cicéron sur ces deux illustres frères. — Idée que l'on peut se former de leur éloquence. — Fragment d'un discours de C. Gracchus. — Autre passage découvert par M. Angelo Mai. H Harangues. Pourquoi celles de Cicéron paraissent moins politiques que celles de Démosthène. Herculanum. Essais inutiles pour tirer parti des manuscrits trouvés dans les ruines de cette ville, n. Hippodame, philosophe pythagoricien, avait composé un livre sur la république, dont un passage semble prédire le gouvernement britannique. Hobbes, philosophe anglais. Les principes de Cicéron opposés à ceux de ce partisan du despotisme. Homère. Il apparaît à Ennius. I Impôt (l') avait-il besoin d'être sanctionné par le peuple? Les historiens donnent peu de lumière sur cette question. Conjectures à ce sujet. J Jérôme (saint), grand admirateur de Cicéron; connaissait le traité de Re Publica, et en a imité un passage. Justice. De quelle manière était-elle rendue à Rome. Les historiens donnent peu d'éclaircissements à cet égard. Conjectures à ce sujet. — Au temps de Cicéron la dépravation de la justice était portée à l'excès. L Lactance, célèbre écrivain chrétien du troisième siècle. Cite l'un de ces beaux fragments traduits de Platon, que Cicéron avait insérés dans son ouvrage de Re Publica, la comparaison du juste condamné et du coupable triomphant. — Le même cite un fragment précieux du troisième livre du traité de la République. — Il a imité et transcrit de Cicéron quelques-uns des sophismes de Carnéade en faveur de l'injustice dans la politique ; leur réfutation. — Extrait où, à l'imitation de Cicéron, il réfute la république chimérique de Platon. — Nous a conservé un passage de Cicéron où il déplore la mort de sa fille Tullie. Lælius, célèbre Romain, surnommé le sage ; ami de Scipion. Cicéron qui, dans le traité de l'Amitié, avait mis dans sa bouche l'éloge de cette vertu, l'introduit comme principal interlocuteur dans son dialogue de Re Publica. Lampride, historien latin du quatrième siècle, dans la vie d'Alexandre Sévère, remarque que cet empereur n'avait pas de lecture plus assidue que le traité des Devoirs et celui de la République par Cicéron. Larcius (T.) premier dictateur à Rome. Lettre de Cicéron à Quintus, son frère, sur les changements qu'il projetait de faire à son traité de Re Publica. xii. — Lettres de Cicéron à Atticus; jugement sur ces lettres. Lucile fut le premier poète satirique à Rome; fut protégé par Lelius et Scipion. Lucrèce, poète romain, choisit pour unique sujet de ses chants le système irréligieux d'Épicure. — Cité. Lycurgue, législateur de Sparte, forma un conseil de vieillards qui servit de modèle à Romulus pour établir le sénat de Rome. M Macrobe, écrivain célèbre du cinquième siècle, avait transcrit et commenté le songe de Scipion. Épisode du traité sur la République. — Il nous a conservé un morceau précieux d'une harangue de Scipion Émilien, sur les vices de l'éducation des jeunes patriciens. —Nous a conservé la formule employée par Scipion au siège de Carthage, pour évoquer les dieux de la ville assiégée. Mai (M. Angelo), savant d'Italie, a découvert sur un manuscrit palimpseste le dialogue de Cicéron de Re Publica. — Il découvrit et publia, en 1844, des fragments de trois discours de Cicéron. Manuscrits d'Herculanum n'ont satisfait aucune des espérances que l'on avait conçues. Masinissa, roi de Numidie, fut rétabli par Scipion dans ses États dont il avait été dépouillé par Sypbax. Montesquieu établit en principe que la justice est antérieure à toute loi positive. — Ses réflexions sur l'état de Rome, après l'expulsion des rois, conformes à celles de Cicéron. — Sur la puissance des décemvirs. Comparaison sur l'harmonie du corps social, imitée de Cicéron. Monarchie. Impartialité avec laquelle Cicéron, républicain, apprécie la monarchie. — Éloge singulier de la monarchie, que Cicéron place dans la bouche de Scipion. — Elle est préférable aux trois autres gouvernements, mais elle est inférieure au gouvernement mixte. Montfaucon (le Père). Ses observations sur les manuscrits palimpsestes. Musique. Cicéron, dans son quatrième livre du traité de la République, paraît avoir blâmé l'influence de la musique. N Nævius, poète romain, ayant osé, dans des espèces de drames, attaquer le premier Scipion, fut puni par les magistrats et réduit à s'expatrier. Nonius, grammairien, auteur d'un traité de Varia verbomm significatione, a conservé plusieurs phrases du traité de Re Publica, mais seulement sous le rapport grammatical. Passim, dans tout l'ouvrage. Numa, élu second roi de Rome. Son gouvernement religieux et pacifique. — Anecdote sur les livres de Numa, trouvés dans le septième siècle de la république, renfermés dans un coffre de pierre. — Tradition qui faisait Numa contemporain et disciple de Pythagore, regardée comme une fable par Cicéron et Tite-Live. O Origine et cause de la prospérité de la république romaine. P Palimpseste. Ce mot désigne un manuscrit dont on a effacé en tout ou en partie l'écriture pour y copier un nouvel ouvrage. — Ce moyen est fort ancien, comme on le voit par une lettre de Cicéron. Panætius, philosophe stoïcien, né à Rhodes, l'an 38 avant J.-C, fut le maître et l'ami de Scipion l'Africain. Cicéron avait beaucoup étudié les ouvrages de ce philosophe. Parhélie. C'est le nom que les astronomes donnent aux fausses images d'un ou de plusieurs soleils qui paraissent quelquefois autour du véritable. Cicéron prend occasion d'un pareil phénomène, arrivé à Rome du temps de Scipion, pour commencer son dialogue de Re Publica. Paul-Émile envoie demander à Athènes des philosophes pour élever ses enfants. —Ayant porté au trésor public l'immense butin de la victoire sur Persée, le peuple romain cessa de payer l'impôt. Peinture énergique du tyran populaire, s'élevant du milieu de l'anarchie, imitée de Platon. Péloponnèse presque environné de toutes parts par la mer. Inconvénients des villes maritimes plus exposées au luxe, à la corruption, à la cupidité. Périclès dissipe la terreur que les Athéniens avaient conçue d'une éclipse de lune, en leur expliquant la cause de ce phénomène céleste. Peuple. Ce que signifie ce mot relativement à la société. — Tableau d'un peuple qui a tué son roi ou son chef. Photius (passage de), d'après lequel on peut conjecturer que les Grecs de Byzance eurent quelque connaissance du traité de Cicéron sur la République. Platon. Sa république est plutôt un traité d'éducation qu'un système de gouvernement. — Un passage, où il établit l'immortalité de l'âme, a fourni à Cicéron l'épisode du songe de Scipion. Pline le Naturaliste. — Témoignage curieux de cet écrivain, au sujet de l'aqueduc d'Ancus Martius. Politique (la) doit être fondée sur la justice. — Développement de ce principe de Cicéron, par saint Augustin. Polybe. Passage de son traité sur les diverses formes de la République. — Son opinion sur les institutions religieuses des Romains. Pouilly (M. de) a fait une dissertation où il essaye d'ôter toute authenticité aux premiers siècles de l'histoire romaine. — Réfutation de cette opinion. Prologue du troisième livre, mutilé, dont on retrouve des fragments dans les œuvres de saint Augustin. Prudence, poète chrétien du quatrième siècle, presse dans un de ses poèmes Théodose d'abolir les spectacles barbares des gladiateurs. Q Quintilien. Son opinion favorable au poète comique Ménandre. R Religion (la) chrétienne a donné à la puissance une autre base que la force et le nombre. Religion (la) des Romains, appui du gouvernement. — Réfutation d'une opinion de Montesquieu à ce sujet. Romulus, fondateur de Rome, choisit la situation de cette ville avec une merveilleuse convenance. — Il comprit et adopta le principe que l'unité d'empire et la puissance royale se fortifient par l'influence des principaux citoyens. Rousseau donne à la pudeur une autre origine que Cicéron. Rutilius, célèbre Romain, élève de Panætius; ami de Scipion. Cicéron suppose tenir de lui les principes de gouvernement qu'il établit dans son traité de Re Publica. S Sabines enlevées par les soldats de Romulus. Saluer, membre de l'Académie des Belles-Lettres, a réfuté les opinions de M. de Pouilly sur l'authenticité de l'histoire des premiers siècles de Rome. Satire (la). L'invention en est attribuée aux Romains par Quintilien. Scipion l'Africain, fils de Paul-Émile. C'est dans sa maison de campagne que le dialogue de Re Publica, dont il est le principal interlocuteur, est supposé avoir lieu. — Il discute les avantages et les inconvénients des différents gouvernements, et semble préférer le gouvernement mixte à la monarchie tempérée. Raisons de cette préférence. Sénat. Comment se formait-il aux diverses époques de la république? Ce problème historique n'est pas encore tout à fait éclairci. Réflexions à ce sujet. — L'autorité du sénat a toujours été à Rome prépondérante. — Prérogative du sénat. Sénèque cite assez longuement le traité de la République, mais seulement pour quelques curiosités historiques. — Il a imité un passage du traité de la République : le portrait de l'homme public. Servius, sixième roi de Rome. Son origine, ses institutions, sa division du peuple par centuries. — Analyse des lois de Servius. Songe de Scipion, épisode admirable du traité sur la République. — Ce songe fait partie du sixième livre du traité de la République. Spurius Cassius ayant travaillé à s'emparer de la puissance royale, fut mis à mort par son propre père. Stobée, auteur grec, qui vivait vers l'an 400 de Jésus-Christ. On trouve dans le recueil de ses écrits un fragment extrait d'un livre sur la République, du pythagoricien Hippodame, qui semble une prédiction du gouvernement britannique. Suétone donne quelques notions sur les écoles fondées à Rome par des Grecs, plutôt tolérées qu'autorisées par le gouvernement. Syracuse. Tableau du gouvernement de cette ville. T Tableau des malheurs d'un peuple qui a frappé un roi juste ou ses obéis légitimes; traduit et imité de Platon par Cicéron. — Du juste accablé d'ignominie, et du méchant comblé de tous les prix de la vertu; imité de Platon. Tacite, dans ses Annales, liv. IV, chap. 33, fait allusion au premier livre du traité de la République de Cicéron. — Il a imité un passage du même traité dans sa Vie d'Agricola. Tarquin, septième et dernier roi de Rome. Jugement de Cicéron et de Montesquieu sur ce prince. Térence, poète comique, protégé par les Scipions, anecdote à ce sujet. Tertullien attaque les théâtres de son temps, et cite à cette occasion une anecdote curieuse sur le théâtre de Pompée. Théâtres (origine des) romains. — Corruption du théâtre relativement aux fausses idées qu'il donnait des dieux. — Explication des anathèmes terribles lancés par les premiers chrétiens contre les théâtres. Tite-Live exprime avec une fierté de style remarquable les traditions sur la fondation de Rome. Tragédie romaine ; était toute grecque et toute mythologique. — Cicéron, dans les Tusculanes, a blâmé la morale de la tragédie. Tribuns. Occasion de leur création. Tubéron (Quintus Ælius), était petit-fils de Paul-Emile et neveu de Scipion. Cicéron l'introduisit comme interlocuteur dans le dialogue de Re Publica. Tullus-Hostilius, troisième roi de Rome. Il établit des formes légales pour les déclarations de guerre, par l’intervention des féciaux. — Sa mort. Tiran (portrait du). Combien il diffère d'un roi légitime. V Valérius-Publicola, premier consul à Rome. Changements qu'il apporte à la constitution monarchique par différentes lois. — Il maintient fortement la puissance du sénat. Varron, dans son ouvrage sur les antiquités, traite ce qui concerne la religion des Romains. Vertu (la) inspire le désir de sacrifier son propre repos pour la défense du salut commun. Virginius, poussé par les fureurs d'un décemvir à immoler sa fille, fait soulever l'armée. X Xénocrate (belle maxime de). A. W Wilberforce. Une de ses pensées, qui marque la supériorité du principe religieux des sociétés modernes sur les bases fragiles de la société antique. [1] Ce mot prouve que, dans le plan définitivement adopté par Cicéron, le dialogue était supposé n'avoir eu lieu que pendant trois jours. [2] Cette apparition d'Homère à Ennius avait été décrite par le vieux poète latin, en vers que rappelle et qu'a sans doute surpassés Lucrèce : « Comme l'a chanté, dit-il, notre Ennius, qui le premier, du gracieux sommet de l'Hélicon, apporta le feuillage toujours vert d'une couronne fameuse parmi les peuples d'Italie. Ennius d'ailleurs raconte, dans ses vers immortels, qu'il est une région souterraine, où ne pénètrent ni les âmes ni les corps, mais seulement certaines images d'une merveilleuse pâleur. C'est de là que, selon ses récits, lui avait apparu la jeunesse éternelle d'Homère versant des flots de larmes et dévoilant les secrets de la nature. » [3] Le nombre huit était réputé parfait comme nombre pair ; le nombre sept, à cause d'une certaine excellence mathématique et théurgique qu'on lui attribuait.
|