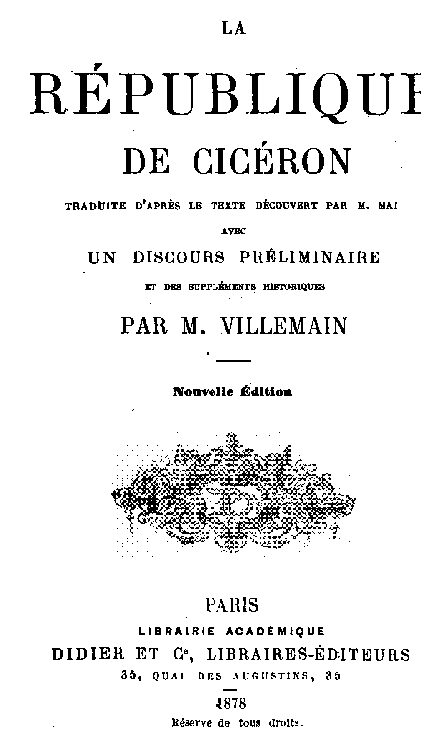|
ALLER A LA TABLE DES MATIÈRES DE CICÉRON
Cicéron Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
CICÉRON
*******************
DE LA RÉPUBLIQUE.livre I - livre II - livre III - livre IV - livre VI
*******************
ANALYSE DU CINQUIÈME LIVRE.
Ce cinquième livre n'a pas moins péri que le précédent; et les fragments nouveaux découverts par le savant éditeur, bien que l'on y retrouve quelques traces du dialogue original, ne présentent que de médiocres indices sur les questions qu'il devait embrasser. Nous sommes donc réduits à des conjectures, faiblement appuyées sur quelques mots, quelques phrases éparses et sur des inductions tirées du plan général de l'ouvrage. Nous n'avons pas même de nombreux débris. A peine pouvons-nous, en rapprochant les diverses questions que Cicéron, avait traitées dans les livres précédents, supposer avec quelque vraisemblance celles qu'il avait dû réserver pour ces derniers livres. Mais, l'importance qu'il donnait à ces questions, le rapport qu'il établissait entre elles, le problème, l'examen, la solution, tout nous échappe, tout nous manque; tout est inaccessible à nos efforts. Essayons cependant de rassembler quelques souvenirs, et de hasarder quelques recherches sur les parties de la politique et de la civilisation romaine, que Cicéron n'a pas traitées dans les premiers livres de la République, et qui pouvaient trouver place dans celui-ci. Le cinquième livre s'ouvrait par un préambule, dont saint Augustin nous a conservé d'admirables traits, et dans lequel Cicéron, avant de ramener ses interlocuteurs sur la scène, exprimait la profonde douleur que lui causait l'affaiblissement des anciennes mœurs, et la décadence de la République. De tels aveux et de telles plaintes, placés à l'entrée de ce livre, font assez naturellement présumer qu'il était consacré à retracer les vertus antiques et les fortes Institutions qui, du temps de Scipion, existaient encore, et se maintenaient contre la corruption naissante, dont nous avons plus liant indiqué les progrès. On ne peut douter, en effet, que, du temps de Scipion, Rome, comme tous les États rapidement agrandis, n'offrît un singulier mélange de luxe et d'austérité, de magnificence et de parcimonie, de vices nouveaux et de vertus antiques, qui n'avaient pas encore eu le temps de céder à la prospérité. Indiquer la source de ces vertus, montrer leur alliance avec la gloire de Rome, les défendre, les prémunir, appeler les lois à leur aide, expliquer enfin les principes de la Constitution romaine, était un texte naturel, dont nous ne pouvons mesurer toute l'étendue, et que nos préjugés modernes ne nous laissent peut-être pas saisir dans toutes ses parties. On a dit, en effet, et souvent répété que ces vertus romaines si célèbres n'étaient qu'un résultat de la nécessité, ne prouvaient que le défaut de civilisation et d'industrie; qu'elles avaient duré précisément autant que la pauvreté, ou plutôt qu'elles n'étaient autre chose que cette pauvreté même parée d'un beau nom. L'esprit philosophique introduit dans l'histoire n'a pas sur ce point épargné les plaisanteries. Une vraie philosophie pourrait cependant trouver autre chose dans ces traditions ; et Cicéron s'était proposé sans doute une telle recherche, afin d'opposer de grands exemples à ces prodiges de luxe et d'avarice qui, de son temps, désolaient la république. Ne perdons pas de vue un premier fait. Le peuple romain fut dès l'origine un peuple agricole autant que guerrier : de là naquirent des habitudes de simplicité, qui subsistèrent longtemps, et se soutinrent au milieu même des richesses. Le pyrrhonisme historique essayera, s'il veut, de plaisanter sur la charrue de Cincinnatus : mais pouvons-nous douter, cependant, que ce genre de modération n'ait été longtemps, à Rome, commun et volontaire, lorsque nous voyons dans Pline un triomphateur célèbre, un consul qui avait ajouté au territoire de la République la plus grande partie de l'Italie, déclarer à la tribune, que tout Romain, à qui sept arpents de terre ne suffisaient pas, était un citoyen pernicieux ? A cette époque cependant, on avait déjà rendu la loi qui défendait seulement de posséder plus de cinq cents arpents; et déjà Licinius Stolo, auteur de cette loi, avait été puni, pour l'avoir transgressée. Ce n'était donc pas, comme on le voit, la matière qui manquait à l'avarice; et les mœurs étaient plus sévères que les lois. Telle était l'influence des premières Institutions et des antiques coutumes de Rome, dont il faut reconnaître partout la trace dans le génie de la république agrandie. Un des premiers établissements de Romulus avait été celui de douze prêtres, nommés les prêtres des champs. Dans le partage des citoyens en tribus, les tribus rurales, formées de ceux qui habitaient la campagne, étaient les plus honorées. Les tribus urbaines, au contraire, peu nombreuses et peu estimées, étaient celles où l'on reléguait les citoyens oisifs et négligents. Les premiers citoyens de la République vivaient aux champs; et de là même le nom et l'usage de ces officiers, appelés viatores, parce qu'ils étaient toujours en route, pour porter à ces illustres Romains, occupés des travaux rustiques, les ordres des Consuls, ou les convocations pour le sénat. En rappelant ces souvenirs, avec une imagination peut-être trop poétique, en montrant la terre du Latium autrefois heureuse et fière de produire sous des mains triomphales, Pline ajoutait, d'ailleurs avec beaucoup de vérité, un fait historique, dont l'importance ne pourrait être contestée. « Maintenant, dit-il, ces mêmes champs sont abandonnés à des esclaves enchaînés, à des mains coupables, à des hommes flétris par la marque. » Dans ce changement qui substituait à une population indépendante, propriétaire et librement laborieuse, des bandes de captifs ou de malfaiteurs travaillant sous le fouet d'un maître, se trouvent en effet toutes les causes de la corruption et de la décadence romaine. Plutarque rapporte que le motif principal des Gracques, dans leur première et généreuse entreprise, avait été l'indignation de voir l'Italie dépeuplée de cultivateurs romains, par les usurpations des grands de Rome, qui livraient à des esclaves les possessions immenses qu'ils avaient envahies. Les hommes les plus attachés à la Constitution romaine pouvaient, sur ce point, éprouver le même sentiment que les Gracques, qui furent accusés d'avoir voulu la détruire. En effet, avec les petites propriétés cultivées par des possesseurs indépendants, disparurent les milices de citoyens attachés aux lois de leur pays : et alors vinrent les armées de prolétaires, d'affranchis, d'étrangers, indifférentes à la patrie, et ne reconnaissant que la voix du général. Salluste observe que ce fut ainsi que Marius, nommé Consul, recruta ses légions ; et dès lors le chemin fut tracé pour tous les ambitieux. Lorsque plus tard, Sylla, prescripteur et spoliateur, voulut rendre ses soldats propriétaires, en leur partageant les terres des condamnés, le remède fut plus funeste que le mal : car ces hommes, introduits par la violence dans le rang des propriétaires, n'en devinrent pas meilleurs citoyens, et n'y furent que les défenseurs du crime et de l'usurpation d'un homme. Ils ne prirent ni le respect des lois, essentiel à la propriété, ni les habitudes d'ordre et d'économie naturelles à la vie agricole. Ils corrompirent les mœurs des campagnes. Regardant leurs domaines et leurs champs, comme le butin d'un jour, ils dissipèrent ces biens dans la débauche, et ils furent prêts pour de nouvelles guerres civiles, parce qu'ils avaient besoin de confiscations nouvelles. Voilà les maux que Cicéron avait vus, contre lesquels il avait lutté avec autant de courage que de génie. Ne devait-il pas se plaire à chercher dans les temps antiques un contraste à ces affligeantes images? et en était-il un plus frappant que le tableau des occupations rustiques des anciens Romains, si bien liées à leurs travaux guerriers, et que tout le détail de cette vie saine, forte et pure, qui préparait de vigoureux soldats, des milices citoyennes, et des généraux incorruptibles ? L'agriculture, comme étant une source de richesse publique, devait attirer l'attention de ce sage politique ; mais je ne doute pas que, suivant la manière habituelle de raisonner des anciens, elle ne lui ait paru plus importante, comme première gardienne des mœurs, du patriotisme et du courage. C'est ainsi que l'envisage le vieux Caton, au commencement de son curieux traité de Re Rustica. « Il n'y aurait rien de mieux, dit-il, que de s'enrichir par le négoce, si cette voie était moins périlleuse, ou que de prêter à usure, si le moyen était plus honnête ; mais telle fut à cet égard l'opinion de nos ancêtres, et les dispositions de leurs lois, qu'ils condamnaient le voleur à restituer le double, et l'usurier à rendre le quadruple. Vous pouvez juger par là combien l'usurier leur paraît un citoyen pire que le voleur. Voulaient-ils, au contraire, louer un homme de bien, ils le nommaient bon laboureur et bon fermier ; et cet éloge paraissait le plus complet qu'on pût recevoir. Quant au marchandée le trouve homme actif et soigneux d'amasser, mais de condition périclitante et calamiteuse. Pour les laboureurs, ils engendrent les hommes les plus courageux, et les soldats les plus robustes ; c'est de leur profession que l'on tire le profit le plus légitime, le plus sûr et le moins attaquable ; et ceux, qui y sont occupés sont le moins sujets à penser à mal. » On voit dans la naïveté un peu grossière de ce langage toute la rudesse des vieilles mœurs romaines, lorsqu'elles n'étaient pas polies par l'urbanité naturelle d'un Scipion ou d'un Lælius. La simplicité de Caton semble bien plus près de l'avarice que de l'héroïsme ; il a l'air de repousser le luxe, surtout parce qu'il coûte cher ; il a peur du commerce, à cause des risques. On le soupçonnerait presque de regretter que les lois aient proscrit un aussi bon moyen de s'enrichir que l'usure ; et ce qui lui plaît dans le labourage, c'est la certitude et la solidité du gain. Cependant l'avantage moral de la vie agricole ne lui échappe pas non plus; et après avoir dit qu'elle fournit les plus vigoureux soldais, il peint l'innocence de cette vie par cet éloge si vrai et si simplement exprimé : « Ceux qui sont adonnés à ce labeur pensent fort peu à mal. » Du reste, Caton, dans ce traité, est uniquement un cultivateur intelligent, économe, âpre au gain. Plutarque lui reproche d'avoir donné le conseil de vendre les bœufs vieillis au service de la charrue ; et il s'attendrit, avec l'expression la plus touchante et la plus gracieuse, sur ce traitement fait à de vieux compagnons de peine et de travail. Caton n'entendait pas ces délicatesses ; il songeait seulement à faire une bonne maison. « Que le maître, dit-il, vende les vieux bœufs, les jeunes veaux, les petites brebis, la peau, la laine; qu'il vende les chariots usés, les ferrements inutiles, l'esclave vieux, l'esclave malade, et tout ce qu'il peut avoir de trop. Je veux qu'un père de famille soit de sa nature vendeur, et nullement acheteur. » Voilà une simplicité de mœurs qui n'est pas celle que notre imagination prête à Régulus et à Cincinnatus. Il faut avouer aussi qu'elle ne rappelle pas ces descriptions si agréables de la vie agricole, cette passion des champs si naïvement et si élégamment retracée, à laquelle Cicéron s'abandonne dans son admirable traité de la Vieillesse, et qu'il exprime par l'organe même de Caton. La politesse du siècle de Cicéron, et le charme de son heureux génie, embellissent fort, dans ce dialogue, l'avare rusticité du vieux Caton, telle qu'il l'a montrée lui-même dans ses propres écrits. Du reste, il est assez naturel de supposer que ce goût du travail et du gain, cette activité avide et parcimonieuse, représentée par Caton, marqua le passage entre la modération véritable, la vertueuse simplicité des premiers temps, ou plutôt des premiers grands hommes de la république, et les excès de faste et de volupté qui suivirent. La vie dure et laborieuse procura les richesses, et servit à les augmenter; puis, quand elles furent portées au comble, le luxe et les vices inventèrent mille moyens de les dissiper; le crime et la violence mille moyens de les reproduire. Ce qui se conserva des anciennes mœurs, ce fut un goût pour l'agriculture, commun aux plus grands citoyens de Rome. Marius, qu'à la vérité son obscure naissance et ses premiers travaux avaient fait laboureur, Marius, sept fois consul, se fit remarquer par l'intelligence et l'étendue de ses exploitations agricoles. On admirait, entre autres travaux, des plants de vignes, qu'il avait distribués sur les coteaux de ses domaines, avec un si habile emploi du terrain, qu'on y reconnaissait, dit Pline, tout l'art du profond tacticien et du grand général. Pompée, simple dans ses mœurs, peu jaloux de vastes possessions, Pompée à qui l'on a donné cette louange, que jamais il n'avait acheté le champ d'un voisin pauvre, aimait et surveillait les travaux de ses terres. Le livre rempli de tous les détails de la culture la plus variée, que Varron écrivit, à quatre-vingts ans, et surtout les admirables Géorgiques de Virgile, nous prouvent que ce vif intérêt pour les objets champêtres subsista longtemps, au milieu du changement de tout le reste. Nous voyons, plus tard, un savant homme, Columelle, écrire sur cette matière, pour rappeler ses contemporains à la pratique d'un art qui avait été la gloire et la force de leurs aïeux. Enfin, dans la suite, l'agriculture, affaiblie depuis longtemps par l'accumulation des propriétés dans la même main, et l'emploi exclusif des esclaves, détruite enfin par les confiscations, les impôts arbitraires et la peste du despotisme, nous montre l'Italie exposée à de continuelles famines, misérable après tant de conquêtes, impuissante au dehors, et ne se suffisant plus à elle-même. On conçoit dès lors comment, aux yeux d'un esprit aussi prévoyant que Cicéron, la prospérité de l'agriculture devait être mise au nombre des premières causes et des plus indispensables appuis de la grandeur romaine. La prédilection habituelle pour l'ancien temps, qui fait le caractère de son ouvrage sur la République, trouvait ici naturellement sa place; et nulle part elle n'était mieux fondée. Sénèque, dans une de ses lettres, nous retrace la maison de campagne du premier Scipion, et le bain étroit et simple, où il lavait son corps fatigué d'un travail rustique et couvert de poussière. Pline nous parle des arbres que ce grand homme avait plantés. Combien de telles allusions et de tels souvenirs devaient-ils animer l'entretien, que Cicéron attribuait au descendant adoptif de Scipion ! L'agriculture, si honorée dans les premiers jours de Rome, était-elle assujettie à quelque redevance, à quelque tribut envers l'État? Ces terres, originairement partagées par Romulus, ou conquises sur les peuples d'Italie, étaient-elles franches et libres ? Cicéron et Pline nous apprennent qu'après la défaite de Persée, Paul Emile ayant apporté dans le trésor de la République l'immense butin de cette victoire et les richesses du monarque prisonnier, depuis cette époque, le peuple romain cessa de payer l'impôt. L'imagination, à ce récit, croirait voir les antiques dépouilles de l'Orient amassées par les Macédoniens, passer aux Romains, comme la succession d'Alexandre, et suffire à l'exemption des charges publiques d'un si grand peuple. Mais Tite-Live nous avertit que ces richesses n'étaient que le produit des mines, et le résultat des impôts accumulés, pendant trente ans, depuis la guerre de Philippe contre les Romains. Scipion, dans le traité de la République, rappelait sans doute, à la gloire de son père Paul-Emile, ce présent, le plus magnifique, dont jamais un général victorieux ait doté ses concitoyens. Mais laissant de côté ce que de tels souvenirs ont de grand et d'extraordinaire, et considérant les choses, d'après la manière froide et positive des modernes, nous conclurons de ce fait, que chaque citoyen romain propriétaire payait un impôt annuel, jusqu'à la mémorable conquête de la Macédoine, que cet impôt était sans doute très léger, puisque le butin d'une seule victoire avait pu suffire à racheter indéfiniment cette dette des particuliers envers l'État. Mais cet impôt était-il unique ou multiplié sous différentes formes? temporaire, ou permanent? Avait-il besoin d'être sanctionné par le peuple? Toutes questions difficiles, sur lesquelles la négligence rapide des historiens nationaux nous donne peu de lumières, au moins pour les premiers temps. Il paraît que, dans l'origine, les rois avaient établi des taxes sur les terres et sur les marchandises. Aux premiers jours de la révolution républicaine, accomplie par les patriciens, ceux-ci, pour retenir et flatter le peuple, supprimèrent les droits d'entrée, et tirent porter l'impôt, dit Tite-Live, sur la classe seule des riches. Le monopole du sel fut également retiré à des fermiers, qui l'exploitaient d'une manière onéreuse pour le peuple. Mais il est vraisemblable que ces mesures de faveur ne se prolongèrent pas au delà des premiers périls de la liberté romaine. Quoi qu'il en soit, un demi-siècle après, nous voyons, dans Tite-Live, le sénat établir un nouvel impôt pour la solde des troupes en campagne, et le peuple acquitter cet impôt, malgré la résistance des tribuns. Tite-Live nous raconte, à ce sujet, que l'usage de l'argent monnayé n'existant pas encore, on amenait au trésor public des chariots tout chargés de cuivre. La censure venait d'être établie; et c'était cette magistrature qui avait l'inspection et la surveillance des revenus publics. Le Cens, d'où elle prenait son nom, était, comme on sait la revue ou le dénombrement des citoyens romains. Là, chaque citoyen déclarait, sous la foi du serment, son nom, son âge, le nombre de ses enfants, et la valeur de ses biens; la taxe lui était appliquée, d'après cette estimation. Ce mode d'imposer se rapprochait, comme on voit, de l'income-tax, quelquefois usité chez les Anglais. Les censeurs avaient de plus le droit de hausser la taxe d'un particulier, en punition de quelques fautes. Mais l'impôt, considéré dans son universalité, était-il établi par les suffrages du peuple? Aucun souvenir historique ne le prouve ; et ce silence semble rendre plus vraisemblable l'induction contraire. Nous voyons dans Tite-Live, que, pendant la seconde guerre punique, la taxe des citoyens romains avait été doublée, et que le sénat, par un décret, la réduisit de moitié. Cette phrase ne fait-elle pas supposer que le pouvoir qui diminuait la taxe, était le même qui en avait ordonné la création ? Ailleurs, il nous dit que les matelots venant à manquer pour une expédition importante, les Consuls, en vertu d'un sénatus-consulte, ordonnèrent une taxe proportionnelle, par laquelle les citoyens inscrits sur le rôle des derniers censeurs, étaient tenus à fournir un ou plusieurs matelots, et la solde qui leur était nécessaire pour six mois ou pour un an. Ces contributions semblent, à la vérité, des faits extraordinaires et accidentels ; mais n'est-il pas manifeste que l'intervention du sénat suffisait pour les établir? Dans un autre passage, Tite-Live dit : « Sur la demande des censeurs, on leur assigna, pour divers travaux publics, le produit d'un impôt établi pour un an. » Mais il ne daigne pas s'arrêter à plus de détails. Au reste, l'impôt qui fut aboli depuis la victoire de Paul-Emile, c'était sans doute et uniquement le cens, la taxe personnelle, imposée d'après l'estimation de la fortune de chaque citoyen. Les droits d'entrée, que Scipion, comme nous l'avons vu plus haut, trouvait mal assortis à la dignité du peuple romain, subsistèrent toujours, et devaient même s'accroître avec le luxe et la richesse publique. Il paraîtrait, d'après quelques mots de Tite-Live, que les censeurs étaient maîtres d'établir des droits de cette espèce, par l'autorité de leurs charges. En parlant d'Emilius et de Licinius, qui remplissaient celte dignité dans l'année 573 de Rome, et qui firent de grands travaux publics, achevés depuis par Scipion Émilien, Tite-Live dit négligemment : « Les censeurs établirent aussi beaucoup de droits de douane, et d'autres taxes. » Le trésor de la république recevait, d'ailleurs, divers tributs des peuples vaincus et alliés ; il avait la dépouille des rois, et quelquefois leur succession testamentaire; mais quant à ce que les citoyens eux-mêmes payaient à l'État, il paraît, nous l'avons dit, que cette contribution, peu considérable, abolie dans ce qui touchait à la taxe personnelle, depuis la victoire de Paul-Emile, était réglée par le sénat. Ainsi, le point principal de la liberté politique chez les peuples modernes, le vote libre de l'impôt, n'était pas compté parmi les droits du peuple romain et les objets habituels de ses délibérations. C'était, pour ainsi dire, un intérêt médiocre et secondaire, abandonné à la prudence des magistrats. Il ne semble pas à présumer que Cicéron eût discuté, dans ce livre, les divers points de la législation romaine qui pouvaient servir de sauvegarde et d'appui à ces mœurs antiques, dont il fait l'éloge exclusif, et dont il déplore la perle irrémédiable. Un si vaste sujet l'aurait entraîné trop loin. Il y consacra, plus tard, un ouvrage entier, le traité des Lois. C'est là que, suivant ses propres expressions, il cherche, il recueille les lois qui lui paraissent le plus convenables et le mieux assorties à la nature et aux formes de cette république, définie par lui, dans un premier ouvrage. C'est là, pour ainsi dire, qu'à l'exemple de Platon, mais avec un but différent, il se propose de rédiger le code de la Cité, qu'il a non pas théoriquement imaginée en philosophe spéculatif, mais décrite en orateur et en panégyriste. Mais s'il avait cru nécessaire de réserver pour un travail particulier la discussion abstraite des lois romaines, nous voyons, dans les nouveaux fragments découverts par M. Mai, qu'il n'avait pas cru pouvoir séparer du traité de la République, tout ce qui touchait à l'administration de la justice et à la puissance judiciaire. Il est, en effet, aussi impossible de concevoir une société sans justice légale, que de la concevoir sans gouvernement. D'ailleurs, dans les républiques de l'antiquité, le droit de juger, souvent exercé par le peuple lui-même, disputé et envahi successivement par les divers corps de l'État, faisait une partie trop essentielle de l'ordre politique, pour en être séparé dans la théorie et dans l'examen. Fidèle à son plan, et toujours respectueux pour les antiques traditions romaines, Cicéron, comme nous le verrons dans un précieux fragment de ce cinquième livre, remonte à l'image de cette première justice, de cette justice paternelle exercée par les rois. Il rapporte même, à ce sujet, que la sagesse des premiers temps assignait aux rois de vastes possessions, des terres, des prairies cultivées et entretenues par le travail du peuple, pour que nul soin ne détournât les rois de la noble fonction de rendre la justice. Mais ces idées, empruntées à une civilisation simple et patriarcale, sont fort loin sans doute de répondre à notre curiosité sur les juridictions romaines, telles que les besoins et les mœurs d'une puissante république avaient dû les établir. On ne peut douter cependant, que Cicéron n'eût traité cette partie sérieuse de la question. La vraisemblance du dialogue, et le nom même de ses interlocuteurs devaient le ramener à cet examen. C'était au temps et sous les yeux de Scipion Émilien, que s'était agité le grand débat sur l'exercice du pouvoir judiciaire, et que Gracchus avait fait une loi, pour transférer à l'ordre des chevaliers le droit de juger, dont les sénateurs étaient investis jusqu'alors. Cette loi, qui fut un changement notable dans la Constitution romaine, avait dû laisser de trop vifs et de trop récents souvenirs, pour ne pas occuper une place dans les entretiens de Scipion, de Lælius, illustres appuis de cette aristocratie sénatoriale, à laquelle C. Gracchus ne porta point de coup plus rude, et plus cruellement ressenti. L'examen de cette innovation devait amener celui des tribunaux romains, question curieuse et difficile, que l'érudition n'a pas encore parfaitement éclaircie. Il faut remarquer, au reste, que les difficultés qui subsistent encore à cet égard, tiennent surtout à la confusion des temps, et aux contradictions apparentes des historiens, dette mobilité dans les Institutions, qui résultait, à Rome, de la lutte violente des partis, est en effet la véritable cause de l'incertitude jetée sur quelques parties du gouvernement romain. Comme un demi-siècle voyait quelquefois s'opérer les changements les plus décisifs, à moins d'une attention minutieuse à la série des faits et des dates, on est exposé à mêler des choses à la fois très diverses et très rapprochées, et à se former de fausses idées, par la réunion de circonstances qui, bien que voisines dans l'histoire, n'appartiennent pas à un même système de gouvernement. Pour nous, nous arrêtant à l'époque où Cicéron plaçait ce dialogue, il nous sera moins difficile de rappeler quelles étaient, jusqu'à cette époque, les variations qu'avaient subies les tribunaux romains, et quelle était enfin l'espèce de juridiction et les formes de justice légale, dont Scipion et ses contemporains avaient dû parler : on retrouve d'abord l'ancienne et très naturelle division du civil et du criminel, ou, comme le dit Cicéron, des jugements publics et des jugements privés. Les rois avaient réuni les deux juridictions. Cicéron nous dit dans un passage de ce cinquième livre : « Les particuliers venaient demander au roi toutes les décisions de justice. » Et Denys d'Halicarnasse nous apprend que les rois prononçaient les sentences de mort. Mais l'antique tradition du jugement d'Horace montre aussi que l'intervention du peuple existait déjà, au moins sous la forme d'appel contre une première sentence. Ce double pouvoir, les rois eux-mêmes avaient été bientôt obligés de le déléguer en partie. Tite-Live compte parmi les actes tyranniques de Tarquin, d'avoir jugé les crimes capitaux personnellement et sans conseil, contre l'usage de ses prédécesseurs. Les consuls, héritiers presque absolus du pouvoir des rois, exercèrent d'abord cette double juridiction; nous voyons en frémissant Brutus juger ses fils à mort, soit comme magistrat, soit peut-être comme père; mais il est certain que dans la même année le consulat perdit cette terrible prérogative, par une loi de Valérius, qui rétablit l'appel au peuple. Dès lors, les accusations criminelles étaient jugées par des commissaires nommés à cet effet, et qui prirent le nom de quœsitores parricidii, d'après l'acception étendue que l'ancienne langue romaine donnait à ce mot de parricidium. C'étaient des espèces de jurés élus par le peuple. Le dictateur avait également, et il conserva le droit du glaive, mais plutôt par une attribution militaire que par une prérogative politique. Ainsi, Manlius donnant un second exemple de l'atrocité de la vertu romaine fait trancher la tête à son fils, pour avoir violé la discipline. Toutefois, ce fut ce même droit dictatorial, dont se prévalut dans la suite le barbare Sylla, pour faire assassiner, au sein de Rome, tant de citoyens paisibles et désarmés. Depuis la loi de Valérius, le droit de juger à mort paraissait d'ailleurs avoir été exclusivement délégué au peuple, qui l'exerçait, soit comme nous l'avons dit, en nommant des commissaires, soit en statuant lui-même dans les Comices assemblés. L'histoire nous montre cette dernière forme employée dans toutes les grandes condamnations politiques : c'est par sentence du peuple que Manlius fut précipité de la roche Tarpéienne : c'était par le peuple qu'avait été jugé Coriolan ; et, pour anticiper sur une époque postérieure à celle de Scipion, c'était en vertu de cet antique privilège du peuple, confirmé par plusieurs lois, que les ennemis de Cicéron lui reprochèrent avec tant d'amertume d'avoir fait périr, par une simple sentence du sénat, les complices de Catilina, ces hommes si criminels et si justement condamnés. Le peuple et les commissaires nommés quœsitores parricidii : voilà quels étaient donc les juges légitimes, qui pouvaient porter des sentences de mort. La loi des Douze Table savait prodiguer avec une barbare rigueur, les cas où cette punition était applicable. Par exemple, elle prononçait la peine capitale contre l'homme, qui avait conduit son troupeau sur une terre ensemencée, ou coupé le blé d'autrui; inhumanité odieuse, mais concevable, dans la barbarie des premières mœurs d'une peuplade agricole et guerrière. Mais cette législation si sanglante s'adoucit beaucoup, dans la suite. La loi Porcia supprima la peine de mort, et permit qu'elle fût remplacée par le bannissement pour tout citoyen romain. Il semblerait naturel de supposer que cette restriction n'était relative qu'aux crimes politiques, et laissait subsister la peine de mort pour beaucoup de crimes privés compris dans les lois anciennes. On ne croira point, par exemple, que la peine portée contre le parricide, dans la loi des Douze Tables, ait été jamais abolie. Il paraît donc qu'à dater d'une époque fort ancienne, depuis la loi Porcia, les jurisconsultes introduisirent une fiction légale, qui détruisait le bénéfice de cette loi pour les meurtriers, les empoisonneurs, pour les criminels proprement dits. Tout Romain convaincu de crime était considéré comme déchu de son rang de citoyen, et tombé dans la classe des esclaves : il devenait, suivant la belle expression des jurisconsultes romains, esclave du châtiment, servus pœnœ : il était puni en cette qualité ; et le privilège du citoyen se maintenait à côté du supplice, que les lois infligeaient au scélérat. Mais cette législation ne s'étendait pas aux hommes accusés pour des crimes d'État : et si l'on songe à l'effrayante mobilité et aux passions furieuses des républiques anciennes, on doit croire que la loi Porcia, qui avait ainsi limité les vengeances et les erreurs populaires, en rendant sacrée la personne d'un Romain, fut un bienfait public, jusqu'au moment où l'excès de la corruption enfantant des crimes inouïs, cette inviolabilité même du citoyen devint un péril pour l'Etat. Ce qu'il y a de certain, c'est que depuis la loi Porcia, une foule de citoyens illustres, accusés par ces animosités de faction si communes dans les États libres, satisfirent par un exil momentané à la haine de leurs ennemis, et à l'aveugle emportement du peuple qui les condamnait. Ainsi, ce vertueux Rutilius, dont le nom est si heureusement rappelé dans le préambule de ce dialogue, Rutilius qui, suivant l'expression de Cicéron, attaqué par de puissants ennemis, se défendit comme s'il eût parlé dans la république de Platon, ne porta point la peine de cette généreuse indifférence, et ne subit le sort, ni de Socrate, ni de Phocion. Par là, Rome évita la honteuse tache qui souille les annales des Athéniens; elle ne prononça la mort d'aucun de ses grands hommes. Sous ce rapport, la loi Porcia semble avoir été le plus heureux correctif aux passions du gouvernement républicain, et à la nature même de ces tribunaux souvent composés de tout un peuple. La juridiction civile, attribuée d'abord aux consuls comme un démembrement de l'autorité royale, resta dans leurs mains ou fut déléguée par eux seuls, jusqu'à l'époque où l'accroissement de la république et la complication des intérêts privés exigèrent la création d'une magistrature nouvelle. Ce fut l'an 380 de Rome qu'on établit un préteur chargé particulièrement de l'administration de la justice. Dans l'intervalle écoulé depuis l'expulsion des rois, jusqu'à l'an 380, les magistratures passagères qui avaient été substituées quelquefois aux consuls, le décemvirat, le tribunal militaire, enfin, le pouvoir public de l'État, avaient constamment exercé la juridiction civile; mais il paraît aussi que, dès l'origine, les sénateurs avaient été dans cette fonction les auxiliaires du premier pouvoir de l'État : et c'était là même qu'ils avaient pris leur principal ascendant et leur plus durable autorité. Denys d'Halicarnasse pense que cet usage de désigner des juges parmi les sénateurs était pratiqué par les rois, pour toutes les affaires qu'ils ne se réservaient pas à eux-mêmes. Les expressions de la loi des Douze Tables indiquent également l'exercice fréquent de cette faculté. Les juges ainsi nommés recevaient une formule, d'après laquelle ils devaient prononcer, en appliquant les termes de la loi : c'étaient pour ainsi dire des jurés de droit pris dans une seule classe, et qui prononçaient dans les limites de la question qui leur était proposée : si paret, condemna. Le préteur hérita du droit de nommer les juges ; et le privilège de ces désignations paraît avoir continué de ne s'appliquer qu'à des membres de l'ordre sénatorial, jusqu'à l'année de Rome 630, c'est-à-dire jusqu'à la fameuse loi de T. Gracchus qui dépouilla les sénateurs de cette grande prérogative, pour la transférer tout entière à l'ordre des chevaliers. Mais ici viennent s'offrir de graves difficultés, que le texte perdu de Cicéron laisse indécises, et qui vont changer nos observations en controverses. Trois cents sénateurs, occupés la plupart de fonctions militaires, pouvaient-ils suffire au jugement de toutes les affaires de Rome? Tout le pouvoir judiciaire était-il en effet renfermé dans les sénateurs? Ne faut-il pas supposer, avec plusieurs érudits, que c'était seulement la juridiction criminelle qui leur était attribuée par privilège, et qui leur fut tour à tour enlevée par Caïus Gracchus, et restituée par Sylla? L'histoire nous montre en effet qu'avant l'époque de Gracchus, de simples citoyens avaient été juges dans des causes civiles ; et Cicéron, parlant sous le régime des lois de Sylla, soutint plusieurs actions civiles, devant des juges choisis dans l'ordre équestre. Cette difficulté pourra peut-être se résoudre par quelques distinctions. Pour tous les crimes publics, il n'y avait eu d'abord d'autre juge que le peuple, lorsque ces crimes intéressaient la sûreté, ou la dignité de l'État; mais lorsqu'ils n'étaient que des attentats contre la vie ou la fortune des citoyens, la connaissance en était quelquefois dévolue au sénat. Ainsi, dans le récit de Tite-Live sur le crime d'empoisonnement commis par un grand nombre de femmes romaines, il paraît manifeste que le jugement de cette affaire fut prononcé par le sénat. Quant à la juridiction civile, on ne peut douter que le sénat ne l'ait exclusivement exercée, aussi longtemps que les consuls, qui seuls avaient le droit de désigner les juges, furent exclusivement choisis dans l'ordre des patriciens. Cela même était une conséquence de cette forte aristocratie, qui embrassait tous les moyens de dominer et de conduire un peuple fier et tumultueux. L'anecdote célèbre du greffier Flavius, qui publia le premier les jours précis des audiences judiciaires, prouve bien que l'application des lois civiles était alors dirigée par les seuls membres du sénat, puisque l'époque même des séances des tribunaux était un mystère d'État, dont la révélation parut aux patriciens un dangereux scandale. Mais lorsque le peuple eut enfin obtenu l'admission au consulat et à toutes les grandes dignités, il est difficile de croire que les consuls plébéiens n'aient pas, dans le nombre des juges qu'ils désignaient, compris des membres du peuple. Au reste, si l'on observe que chaque tribunal se formait par la désignation d'un seul juge, qui choisissait lui-même ses assesseurs, il est naturel de penser que, lors même que cette désignation eût porté toujours sur un sénateur, les auxiliaires qu'il se donnait devaient être souvent choisis dans l'ordre équestre et dans le peuple. Même résultat suivit sans doute l'établissement de la préture : en effet, le préteur continua de désigner pour différentes affaires un juge qui prenait le nom de judex quœstionis, et qui choisissait des conseillers ou assesseurs ; mais il paraît que dans un tribunal, où le préteur présidait lui-même, siégeaient dix conseillers nécessairement choisis dans l'ordre sénatorial. On ne peut croire qu'un second tribunal, également présidé par le préteur, et qui se composait de cent cinq juges, eût été choisi en entier parmi les membres du sénat. C'est ici que l'impossibilité tirée du petit nombre de sénateurs se montre dans toute sa force ; mais les anciens nous apprennent que ce tribunal des centumvirs avait fort peu d'importance sous la république. Ainsi les affaires civiles les plus nombreuses et les plus importantes étaient probablement jugées, soit par les juges de l'ordre sénatorial sous la présidence du préteur, soit par les juges de la question que désignait ce même préteur, et qui formaient chacun leur tribunal. On conçoit dès lors, comment le sénat pouvait suffire à cette juridiction, et sous quel mode les plébéiens étaient admis à en faire partie. Ce juge de la question nommé par le préteur représentait en quelque sorte le juge des assises anglaises et on pouvait considérer les assesseurs comme des jurés choisis dans le peuple. Quant à la juridiction criminelle d'intérêt public, qui, selon quelques savants, aurait seule appartenu au sénat, il est manifeste que dans l'origine elle ne lui était pas attribuée, et qu'elle n'aurait pas formé ce pouvoir judiciaire si exorbitant, qui faisait la force du sénat, et qui lui fut enlevé par Caïus Gracchus. En effet, comme nous l'avons dit, et de l'aveu universel, la plus grande partie des crimes publics était jugée directement par le peuple, ou par des commissaires de son choix. Est-il naturel de supposer qu'il se fût constamment assujetti à ne prendre ces commissaires que dans le sénat ? Mais on peut reporter à une époque plus rapprochée l'influence presque absolue du sénat sur la justice criminelle, et la faire dater du premier établissement des juridictions permanentes, qui furent substituées au jugement même du peuple. Ce fut l'an 609 de Rome, que, pour obvier à la multitude des délits politiques, on institua quatre tribunaux chargés de connaître, le premier, des crimes de lèse-majesté, le second, de la brigue, le troisième, des concussions, le quatrième, du péculat. Comme chacun de ces tribunaux fut placé sous la présidence d'un préteur, la composition des juges fut la même que pour le premier tribunal, originairement composé d'un préteur et de dix sénateurs. C'est ainsi que le sénat, maître de la plus importante partie de la juridiction civile, se trouva saisi de la nouvelle juridiction criminelle qui naissait de la multiplicité des délits politiques. On conçoit aussi les fréquentes collusions, que dut amener la nature des crimes et des coupables qui paraissaient devant ces tribunaux, et comment Gracchus put facilement arracher au sénat cette extension nouvelle d'une immense prérogative. Ces formes de la justice dans Rome, liées de si près aux intérêts réciproques et à la lutte continuelle des pouvoirs de l'Etat, devaient occuper une grande place dans le cinquième livre de la République. Que de réflexions ne faisait pas naître cette justice arbitraire et corrompue, que les partis s'enviaient et s'arrachaient l'un l'autre, comme une arme puissante et un instrument de domination et de vengeance ! Il faut le dire, les peuples de l'antiquité n'ont presque point connu la justice telle qu'on peut la concevoir, impartiale, exacte, impassible. « Aux dieux ne plaise, disait Thémistocle, que je préside au tribunal, où mes amis n'aient pas plus d'avantage que mes ennemis! » Et les anciens, en citant cette parole, y voient presque l'expression d'un vœu naturel et légitime. Toute l'histoire des républiques grecques montre la justice faible, incertaine, arbitraire, assiégée par le génie des orateurs, comme une conquête assurée au plus audacieux et au plus habile. Au temps de Cicéron, la dépravation de cette justice était portée à un excès de scandale et d'impudence, dont ses lettres sont remplies, et qui nous étonne encore. La manière même dont ce grand homme conçoit et enseigne l'éloquence, semble supposer qu'il n'attendait dans le juge que des vices, ou des passions au moins. En admettant que cette corruption des tribunaux publics, dans ce qu'elle avait de plus vil, eût suivi le progrès du luxe romain, et se fût développée, surtout depuis Scipion, il n'est pas moins vraisemblable que dès l'époque de ce grand homme, elle avait déjà ce caractère mobile et passionné que devaient entretenir les Institutions mêmes de Rome. Sans doute, on n'avait pas encore vu ce que Cicéron raconte dans ses lettres, un Clodius, convaincu de profanation, absous à une majorité surabondante, et réclamant tout haut l'argent qu'il avait donné à plusieurs de ses juges, dont le complaisant suffrage avait été superflu pour l'absolution. Cette naïveté de corruption, cette publique vénalité n'appartenait qu'aux derniers temps de la république ; mais l'injustice, la passion, le caprice, avaient marqué souvent les sentences de la justice romaine, dans les plus beaux jours de la république. Scipion, le premier Africain, avait été condamné à l'exil. Toutefois, cette justice inégale et tumultueuse rendue par le peuple, avait une sorte de grandeur et rappelait de beaux souvenirs. Un tribun avait infligé une amende à Scipion l'Asiatique, frère de l'Africain ; et il menaçait de le faire conduire en prison. Sempronius Gracchus, père des deux illustres frères, tribun du peuple et l'adversaire acharné des Scipions, s'oppose à cette violence par le décret suivant : « Attendu que Lucius Cornélius Scipion l'Asiatique a jeté dans les fers des généraux ennemis, dont il avait triomphé, il me paraît contraire à la dignité de la république « de conduire un général du peuple romain dans ce même lieu, où lui-même a jeté nos ennemis vaincus ; ainsi je défends Lucius Cornélius Scipion l'Asiatique, contre la poursuite de mon collègue. » On comprend assez que dans une forme de gouvernement, où tous les pouvoirs et toutes les passions interviennent ainsi dans les jugements publics, aucune justice paisible et régulière ne fut possible; c'était beaucoup qu'elle ne fût troublée du moins que par des passions généreuses : tout fut perdu, lorsque l'arbitraire des jugements fut vénal, au lieu d'être seulement partial et capricieux. Scipion, le grand Scipion, accusé de concussion devant le peuple, qui prononçait encore sur ce genre de délit, ne répondit que par un mot sublime : « Romains, à pareil jour, j'ai vaincu Annibal : allons au Capitole rendre grâces aux dieux ! » Et cette manière de finir une question de comptabilité, qui ne serait point admise aujourd'hui, confondit les accusateurs, les juges, et enleva tous les suffrages. Mais un siècle plus tard, les plus vils prévaricateurs, les plus déhontés concussionnaires s'arrogeaient, par la corruption ou la menace, la même inviolabilité, qu'un grand homme avait obtenue par enthousiasme. Ainsi la justice, à Rome, avait été, jusqu’au temps des Gracques, dans les mains du sénat; les causes politiques étaient seules portées devant le peuple; et dans le sixième siècle, la plupart de ces causes retombaient encore sous la juridiction du sénat, par rétablissement des quatre tribunaux perpétuels, qui furent présidés chacun par un préteur. Mais ce sénat, dont la prérogative était si étendue, comment lui-même se formait-il, aux diverses époques de la république ? Ce problème, souvent agité, aurait besoin d'une solution précise. Il y a plus d'un siècle, un ministre anglais proposa cette question à l'élégant auteur des Révolutions romaines, qui ne s'était nullement occupé d'une telle difficulté dans son ouvrage. Vertot répondit par une ingénieuse dissertation. Middleton écrivit sur le même sujet avec plus de profondeur; et le savant M. de Beaufort a discuté ce même point dans son Histoire du Gouvernement romain. Tant de recherches et de conjectures n'ont pas tout éclairci. Pour les premiers temps de Rome, il paraît bien que les sénateurs étaient choisis par le souverain; mais ensuite la question devient douteuse. D'une part, Tite-Live nous dit que Brutus compléta le nombre de trois cents sénateurs, ce qui semble supposer qu'il les choisit lui-même. Et ailleurs, ce même Tite-Live fait dire au tribun Canuléius que les anciens sénateurs avaient été choisis ou par les rois, ou par l'ordre du peuple, depuis l'expulsion des rois. Mais, cette contradiction n'est qu'apparente; et ces mots, l'ordre du peuple, jussu populi, peuvent désigner un acte consulaire l'ait sous l'autorité du peuple; et en effet, si le peuple avait réellement et directement choisi les sénateurs, serait-il possible que l'histoire n'offrît aucune trace de ces élections, qui auraient dû être si importantes, et si disputées? Les consuls paraissent donc évidemment avoir exercé seuls ce droit de nomination au sénat, jusqu'à l'époque de l'institution de la censure, l'an 310 de Rome. Et tant que le consulat fut le privilège des patriciens, on conçoit comment des patriciens seuls composèrent le sénat. Mais rien ne permet de croire, comme le supposait lord Stanhope, que la naissance donnât de plein droit entrée dans ce premier conseil de la république : elle n'était, pour ainsi dire, qu'une candidature, une condition d'éligibilité. Il paraît qu'à cette époque, la fonction de sénateur n'était pas même à vie. A l'époque du cens quinquennal, les consuls, ou les tribuns militaires alors en charge, dressaient une liste du sénat ; et ils la composaient à leur choix, sans être assujettis à conserver les anciens membres, et sans que l'omission fût déshonorante pour ceux qui n'étaient pas désignés de nouveau. A l'époque de la création de la censure, les censeurs eurent le privilège exclusif de former la liste du sénat. Mais depuis lors, ce fut un déshonneur d'être effacé de la liste. Un passage du grammairien Festus est positif à cet égard : « Autrefois, dit-il, les sénateurs omis sur la liste n'encouraient aucune flétrissure : de même que les rois choisissaient et remplaçaient à leur gré ceux qu'ils voulaient admettre dans le conseil public; ainsi, depuis l'expulsion des rois, les consuls et les tribuns militaires y appelaient leurs plus proches parents parmi les patriciens, et ensuite parmi le peuple : mais la loi tribunitienne Ovinia prescrivit aux censeurs d'admettre au sénat les plus gens de bien dans toutes les curies. De là ceux qui furent, à l'avenir, omis et rayés de la liste passèrent pour flétris. » Tite-Live ne se sert, pour désigner sur ce point le pouvoir des censeurs, que de ces expressions générales, choisir la liste du sénat, lire la liste du sénat. Mais il semble que cette loi Ovinia, citée par Festus, avait dû sans doute prescrire quelques règles, pour l'exercice de ce pouvoir si exorbitant remis aux censeurs. La première était de conserver, lorsqu'il n'y avait pas de motif contraire, les sénateurs anciennement inscrits, et d'admettre ceux qui avaient exercé les magistratures curules. Ces magistratures ne donnaient donc pas directement l'entrée au sénat. Il en était ainsi du moins jusqu'à la troisième guerre punique. Mais, l'an 623 de la fondation de Rome, le tribun Attinius fit adopter un plébiscite, par lequel les tribuns devinrent sénateurs, en vertu de leur charge. L'histoire offre aussi l'exemple d'un dictateur choisi pour recréer, au milieu de la seconde guerre punique, le sénat, dont la plupart des membres avaient péri ; mais cet exemple unique ne déroge pas au droit, dont jouirent constamment les censeurs, de former la liste du sénat, en suivant certaines règles, que même ils oubliaient quelquefois. Les troubles de Rome et la tyrannie de Sylla ayant amené, pendant dix-sept ans, l'interruption de la censure, Cicéron ne fut pas redevable de son entrée dans le sénat à la désignation des censeurs ; mais il y prit place de droit, comme ayant exercé la questure. Toutes les grandes dignités curules entraînaient le même privilège pour ceux qui n'étaient pas déjà sénateurs, avant d'y être appelés. Enfin, les tribuns furent également sénateurs de droit, après l'année de leur tribunat. Ainsi, l'autorité des censeurs se trouva bornée par des exceptions assez nombreuses, en même temps que l'exercice de cette autorité était soumis à certaines traditions, à certains usages, et même à quelques lois positives. Nous voyons d'abord, dans Denys d'Halicarnasse, que l'âge nécessaire pour être choisi sénateur avait été fixé par un règlement ; et l'on peut conjecturer que cet âge était celui de trente ans. La naissance semblait également une condition importante, mais, elle ne fut pas exactement observée. A l'époque de la révolution républicaine, Brutus fit entrer dans le sénat des plébéiens, qui prirent ou reçurent un nom collectif indiquant une infériorité de naissance : Patres minorum gentium. Il paraît que ces nouveaux élus devinrent sénateurs sans être patriciens, et qu'il se conserva entre eux et les anciens sénateurs une différence d'origine, quoiqu'il y eût égalité de prérogative. Eux seuls d'abord portaient ce titre de pères conscrits qui devint, dans la suite, la dénomination commune, pour désigner les membres du sénat. Quoi qu'il en soit, les charges publiques étant la voie naturelle et ordinaire pour arriver au sénat, et cette voie étant, depuis le quatrième siècle de Rome, ouverte à tous les citoyens, l'admission des plébéiens dans le sénat, dont Brutus avait donné l'exemple, dut se renouveler sans cesse; et on peut croire que la distinction primitive entre les sénateurs d'ancienne et de nouvelle origine, ne tarda point à s'affaiblir. C'était surtout l'ordre des chevaliers, classe intermédiaire dans la République, qui servait ainsi à recruter le sénat, et à réveiller l'émulation des familles patriciennes. On voit dans Tite-Live que, du temps de Persée, roi de Macédoine (et c'est l'époque de ce dialogue), l'ordre équestre était appelé le séminaire du sénat. Dans le cinquième siècle de la République, un censeur, le fameux Appius Claudius, s'étant avisé de porter sur la liste du sénat des fils d'affranchis, les consuls déclarèrent au peuple ne tenir aucun compte de cette élection, qui resta comme annulée: et ils rétablirent la liste faite par les censeurs précédents. Une certaine quotité de biens était également exigée, au moins dans les derniers temps de la République : elle se montait alors à huit cent mille sesterces ; mais la condition principale était d'avoir servi l'Etat. Et voilà sans doute ce qui, dans les beaux siècles de Rome, donnait au corps du sénat tant d'expérience et de vigueur. Les fonctions publiques étaient la candidature pour y parvenir; et comme ces fonctions étaient conférées dans les élections des comices, les patriciens mêmes, pour arriver au sénat, étaient obligés de mériter les suffrages de leurs concitoyens : ainsi, les hommes les plus braves et les plus habiles de l'État composaient nécessairement ce conseil de la République. Il avait à la fois quelque chose de permanent et de mobile; il était aristocratique et populaire, immuable dans ses desseins, toujours le même dans sa forme ; représentant tous les antiques souvenirs et tous les noms glorieux de la patrie, il se recrutait sans cesse par les services présents et les illustrations nouvelles. Il offrait tous les avantages de l'hérédité, comme on le voit assez par ces grandes familles, dont les noms s'y reproduisent et s'y perpétuent sans interruption, pendant plusieurs siècles; et il imposait aux héritiers de ces mêmes familles la nécessité d'une continuelle émulation, pour arriver, par l'épreuve des emplois publics, à la dignité sénatoriale. On conçoit dès lors comment le sénat déployait, et tant de persévérance dans ses vues, et tant de sagacité dans sa politique. Il avait constamment le même intérêt ; et il acquérait constamment des forces et des lumières nouvelles. Un corps si fortement organisé devait exercer un grand pouvoir; et ce pouvoir, objet des vœux, des regrets et des théories de Cicéron, était sans doute habilement exposé et défendu dans le cinquième livre de la République. C'est là même que se rattache cette prédilection pour les premiers temps, qui avait dicté tout l'ouvrage. Plus on remonte, en effet, aux premières époques de la liberté romaine, plus on y trouve l'autorité du sénat dominante et paisible. Bien que les maximes de la souveraineté du peuple eussent suivi la chute de Tarquin, cette prétendue souveraineté avait été réellement interceptée par le sénat. En reconnaissant au peuple le droit d'élire les magistrats, et de décider la paix ou la guerre, le sénat s'était réservé le droit exclusif de réunir les assemblées du peuple, et d'approuver, ou de rejeter les résolutions du Forum : il avait seul la convocation, l'initiative et la sanction. Ce pouvoir était une continuation et un accroissement de celui que les sénateurs avaient exercé à l'égard du peuple, du temps même des rois ; ou plutôt c'était la réunion dans un même corps de la juridiction sénatoriale et de la royauté même. Sans doute le sénat ne demeura point dans une possession paisible de cette exorbitante autorité; mais les conquêtes extérieures lui rendirent bien plus en étendue de pouvoir qu'il ne perdit en puissance directe sur le peuple de Rome : et au milieu des réclamations perpétuelles du Tribunat, des séditions fréquentes du peuple, parmi tous les orages de la place publique, le sénat romain exerça, pendant plusieurs siècles, la plus haute et la plus irrésistible autorité que des hommes aient eue sur d'autres hommes. Les principaux appuis de cette autorité tenaient à la grandeur des intérêts qu'il avait à traiter, et dont il disposait souverainement. Il était le gardien suprême de la religion, dont tous les ministres étaient choisis dans son sein et soumis à ses ordres. Aucune innovation ne pouvait s'introduire dans le culte public, sans un sénatus-consulte, quelquefois confirmé par une loi, mais qui la précédait toujours. Cette prérogative chez un peuple superstitieux enfermait de grandes conséquences. On consultait les auspices, avant de procéder aux élections, aux délibérations, enfin à toute affaire publique; et les sénateurs avaient seuls le droit de prendre les auspices. Dès lors ils pouvaient à leur gré interrompre, différer, suspendre les assemblées du peuple. Seuls ils avaient également le dépôt des livres sibyllins, et pouvaient en permettre la lecture et en donner l'interprétation. Le sénat avait d'autres prérogatives, non pas plus puissantes, mais dont la forme se rapporte davantage aux idées modernes. Il recevait les ambassadeurs des rois et des nations étrangères, il nommait également les ambassadeurs de Rome, toujours choisis dans le nombre des sénateurs ; il les dirigeait par ses ordres et par sa politique. Ce droit seul, chez un peuple faisant toujours des guerres et des alliances, était l'instrument d'un immense pouvoir. Ce n'était pas sur la place publique comme dans Athènes, que des envoyés étrangers venaient plaider devant une multitude mobile et passionnée; c'était dans le sénat qu'ils étaient reçus, dans ce sénat que l'éloquent Cynéas prit pour une assemblée de rois. Là souvent les rois eux-mêmes venaient demander grâce, et négocier les débris de leurs États. Le sénat réglait également, avec un pouvoir absolu, l'administration des provinces et le commandement des armées. Il tenait sous sa main tous les capitaines, excepté les consuls; il leur accordait des gouvernements plus ou moins avantageux; il en prolongeait la durée; il disposait de ces prodigieuses récompenses, de ces proies si opulentes, que la conquête de tant d'États offrait, dès le sixième siècle, à l'avidité des préteurs romains. Le sénat seul accordait ce titre d'allié ou d'ami du peuple romain, devenu l'ambition des rois. Il réglait la destinée des nations vaincues; c'est à lui qu'un préteur venait dire après la défaite de la confédération des Latins : « Les Dieux vous ont rendus maîtres si absolus dans cette question, qu'il dépend de vous que le Latium soit anéanti ou conservé. » Le sénat jugeait aussi, à la fin de chaque guerre, les services qu'avaient rendus, les sentiments qu'avaient montrés les peuples alliés ; il leur distribuait des .récompenses ou des châtiments. Il ordonnait les fêtes, les réjouissances publiques, les grands et petits triomphes, et il avait ainsi dans sa main le prix le plus élevé de l'ambition patriotique. Il tenait la couronne de lauriers suspendue sur la tête de ces généraux vainqueurs du monde: il assurait leur soumission par l'espoir d'un glorieux salaire, ou les punissait par un refus. Puissant à Rouie, mais sous la condition d'y trouver les perpétuelles résistances des tribuns, il étendait sur le reste de l'Italie une juridiction incontestée. Il connaissait de tous les crimes qui s'y commettaient; et il se donnait l'attribution plus haute et vraiment impériale déjuger les différends des villes entre elles, et de régler souverainement leurs droits. Il possédait sans contrôle, ce qui dans nos idées modernes est la puissance même, l'administration de tous les deniers publics, dont il était le dépositaire et le dispensateur. Nous avons vu plus haut que souvent les taxes publiques furent établies par la seule autorité d'un sénatus-consulte. Mais indépendamment de cette prérogative singulière, dont l'application était peu fréquente, et ne nous est pas bien nettement connue, le sénat était le premier et suprême inspecteur du trésor public, placé dans le temple de Saturne, sous la garde des questeurs. Le sénat exerçait aussi une haute juridiction sur tous les magistrats à l'exception des consuls et des tribuns. Il pouvait leur infliger une flétrissure, les éloigner de Rome, blâmer et casser leurs actes. Enfin il avait en lui-même, il possédait virtuellement pour ainsi dire, cette dictature, dont l'emploi ne semblait permis à Rome que par intervalle, et pour un temps limité, il pouvait par un seul mot, la simple formule, ne quid detrimenti res publica capiat, revêtir les consuls d'un pouvoir illimité. Tant de prérogatives attaquées sans cesse, et battues pour ainsi dire en brèche par les perpétuels assauts du Tribunat, lurent successivement affaiblies. Le plus ancien et le plus décisif de ces empiétements populaires, fut la création des plébiscites, c'est-à-dire des décrets qui, rendus par le peuple seul, étaient ratifiés d'avance par un sénatus-consulte qui avait précédé la tenue même des comices. Beaucoup d'autres privilèges du sénat lui furent arrachés ; mais, on peut dire cependant, et on voit par tous les ouvrages de Cicéron, que jusqu'à l'usurpation de César, le gouvernement résida dans ce corps illustre, qui l'emportait sur le peuple par la constance et la sagesse des vues, et par l'avantage de tenir et de manier tous les ressorts de l'empire. Cicéron qui avait fondé sa gloire et sa force sur la puissance du sénat, ne trouve point d'expressions assez magnifiques pour le célébrer. Il le nomme le conseil perpétuel, le gardien, le chef de la République ; le juge, le protecteur, le refuge de tous les peuples. Du milieu de cette puissante et habile assemblée, Cicéron faisait sans doute sortir l'homme d'Etat, le grand citoyen qui règne sur tout un peuple par la sagesse et l'éloquence. Cette idée d'une dictature pacifique fondée sur la justice et sur le charme de la parole, cette imitation du pouvoir, que Périclès avait si longtemps exercé dans Athènes, le séduisit toujours : il la rêvait encore, lorsque la République n'était déjà plus, et que le jeune Octave venait paisiblement recueillir l'usurpation de César. Mais, une si haute ambition, dans un temps, où les armes et la force pouvaient seules prendre la première place, le trompa presque toujours, et lui lit successivement adopter la fortune et l'imprudence de Pompée, flatter la victoire de César, et enfin préparer, à son insu, l'élévation d'Octave. Quoi qu'il en soit, Cicéron se formait les idées les plus pures de ce citoyen prédominant, de cet homme d'État par excellence, pour lequel il réclamait une autorité que, dans son cœur, il se déférait à lui-même. Il lui proposait pour récompense et pour soutien la gloire, et pour terme de ses efforts, le bonheur des citoyens, la grandeur et l'illustration de l'État. Il a lui-même rappelé, dans une de ses lettres, les paroles dont il s'était servi pour rendre cette idée, en la révélant de ces vives comparaisons qui sont familières à son génie. « De même, disait-il, que le pilote se propose pour but le succès de la navigation, le médecin la santé, le général la victoire, ainsi cet homme qui conduit la république a devant les yeux le bonheur des citoyens, un bonheur appuyé sur la force, enrichi par l'abondance, illustré par la gloire, ennobli par la vertu : c'est là cette œuvre grande et glorieuse parmi les hommes, dont je veux qu'il assure l'accomplissement. » La nature de ce pouvoir, qui naissait tout entier de la persuasion, était liée de trop près à la pratique et à l'art de l'éloquence, pour que Cicéron n'ait pas dû, dans ce cinquième livre, l'envisager sous ce dernier point de vue. Il avait, dans le livre précédent, considéré l'influence des premiers rhéteurs établis à Rome, sur l'éducation de la jeunesse ; mais ne devait-il pas, ensuite, examiner l'éloquence comme un ressort de l'Etat, tour à tour si dangereux, ou si salutaire ? Parler d'un homme d'État, c'était parler d'un orateur. Scipion, Lælius, Scévola, tous les personnages que Cicéron introduisait sur la scène, avaient exercé, dans leur temps, la puissance de la parole. Les adversaires contre lesquels ils avaient lutté, dans le gouvernement de la République, étaient également célèbres par le talent oratoire. On ne peut donc supposer que l'éloquence n'ait pas occupé quelque place dans cette revue des principes et des effets de la constitution romaine. D'après cette diversité d'opinions, qu'admettait la forme du dialogue, sans doute, l'éloquence était tour à tour, dans ce cinquième livre, attaquée, défendue, justifiée. Quelques mots conservés par les grammairiens, et qui ne peuvent s'appliquer qu'à une discussion de ce genre, nous montrent que Scipion était représenté comme blâmant beaucoup les orateurs, et reproduisant contre eux les arguments et les reproches, dont Platon fait usage dans le Gorgias. Nous voyons, par quelques autres fragments, que la brièveté était recommandée à l'orateur politique; et qu'en remontant aux premières origines de l'éloquence, on la cherchait dans Homère, et qu'on reconnaissait dans Ménélas le premier modèle du genre tempéré. Le paradoxe se mêlait sans doute à cette discussion : un des interlocuteurs se plaignait que l'éloquence exerçât sur les assemblées publiques et survies juges une corruption plus dangereuse et plus inévitable que celle de l'or; et il proposait presque des peines afflictives contre le talent de la parole. Un auteur latin du quatrième siècle nous a conservé ce curieux passage, qu'il mêle dans une longue digression sur la mauvaise foi et la rapacité des orateurs et des avocats de son temps. Voici ce fragment, qui faisait partie sans doute du cinquième livre : « S'il n'est rien dans la république qui doive être plus incorruptible que les suffrages des citoyens, que les votes des juges, je ne puis concevoir par quel motif, tandis que la corruption pécuniaire est punie, celle que l'on exerce par l'éloquence obtient, au contraire, de la gloire. A mes yeux, celui qui corrompt le juge par l'éloquence fait plus de mal que celui qui le corrompt à prix d'or : car, on est le maître de ne passe laisser corrompre par l'argent; on ne l'est point de résister à la séduction de l'éloquence. » Cette exagération, qui ne pouvait être considérée que comme un jeu d'esprit, un sophisme platonique, n'empêchait pas les justes éloges accordés à l'orateur politique et judiciaire. L'époque, où Cicéron plaçait son dialogue, lui interdisait les noms des grands orateurs qu'il a célébrés tant de fois, et qui furent surpassés par lui. Crassus, qui devint si célèbre dans la suite, et qui fut gendre de Scévola, était encore dans la première jeunesse; et on peut croire que c'était à lui que se rapportait une phrase ingénieuse extraite de ce dialogue : « Dans un jeune homme on ne peut louer que « l'espérance, et non la réalité. » Cependant, si nous en croyons Cicéron lui-même, l'éloquence romaine avait eu déjà deux âges de puissance et de gloire : le premier remontait à ce vieux Claudius l'aveugle, qui, dans le sénat romain, combattit la paix proposée par Pyrrhus. Son discours se conservait encore, au temps de Cicéron. Le second âge de l'éloquence romaine, parmi une foule d'orateurs, comptait au premier rang Scipion et Lælius. Cicéron nous apprend ailleurs, que les discours de Scipion étaient plus élégants et d'un style moins vieilli ; mais que l'opinion commune avait donné la préférence à ceux de Lælius, par ce préjugé qui ne veut pas qu'un même homme excelle dans plusieurs choses à la fois. Bien que les siècles suivants aient beaucoup blâmé cette première éloquence et que, du temps de Tacite et de Quintilien, elle fût tout à fait dédaignée, le patriotisme qui l'animait, les grands intérêts, dont elle disposait, ont dû lui donner beaucoup de force et d'élévation. Quelle plus grande puissance exercée par la parole, que celle des Gracques sur le peuple romain ! Dans la même époque, l'éloquence de Caton fut admirable, au rapport de Cicéron, qui n'y blâmait qu'un peu de négligence et de rudesse. Avec quel intérêt n'aurions-nous pas vu, dans l'ingénieuse fiction de ce dialogue, les effets de cette éloquence retracés par le plus illustre contemporain de Caton et des Gracques! Sans doute, dans ce jugement, l'emploi de l'éloquence était apprécié, en même temps que l'éloquence même. Cicéron avait déjà, dans un autre ouvrage, examiné le génie de ces grands orateurs, et tracé l'histoire littéraire de l'éloquence romaine. Mais il restait à considérer comment elle se mêlait à la constitution de l'Etat; quelle était l'influence des accusations publiques; quel était le caractère de la profession du barreau exercée gratuitement par les plus illustres citoyens ; quel patronage, quel lien de clientèle et de reconnaissance elle établissait entre les patriciens et le peuple. La puissance du tribunat, établie tout entière sur le talent de la parole et sur l'art de passionner la multitude, rentrait dans cette question de l'éloquence. Il est facile de conjecturer comment Scipion, qui déclara dans le Forum que la mort violente de Tibérius était légitime, devait juger les entreprises de ce tribun et celles de Caïus, en qui l'amour de la popularité était encore animé par le désir de la vengeance. Pour nous, sans réviser ce grand procès, où l'aristocratie romaine eut le malheur de donner l'exemple de la violence et du meurtre, dans la défense de ce qu'elle appelait la justice et les lois, essayons de recueillir ici les idées qu'on peut se former de l'éloquence des Gracques. Scipion les avait entendus, les avait plus d'une fois combattus l'un et l'autre. Sans doute Cicéron rap-.pelait par sa bouche quelques-unes des puissantes séductions, que prodiguait leur éloquence. Le temps ne nous a transmis aucun monument de Tibérius Gracchus. Cicéron lui-même jugeait de son éloquence, surtout par le souvenir et les traditions qu'elle avait laissées. Les harangues écrites de ce tribun célèbre qui s'étaient conservées, semblaient, aux yeux du maître de l'éloquence romaine trop peu brillantes, mais remplies de finesse et d'habileté. Caïus Gracchus au contraire lui apparaissait avec tous les caractères du grand orateur : et mêlant à de sévères reproches une admiration qui semble un peu les contredire, Cicéron disait : « Quelle perte la grandeur romaine et les lettres « latines ont faite par sa mort prématurée ! » Ailleurs, pour donner une idée du plus haut degré de pathétique et d'éloquence, il cite les paroles de Caïus Gracchus rappelant le meurtre de son frère; il ajoute que ces paroles étaient prononcées avec une expression si véhémente qu'elles arrachaient des larmes aux ennemis mêmes du tribun. « Malheureux, s'écriait-il, où porterai-je mes pas? Dans le Capitole? il est inondé du sang de mon frère: dans ma demeure? j'y trouverai ma malheureuse mère, gémissante et désespérée. » Ce trait si court et si admirable de l'éloquence de Gracchus, et l'idée même qui s'attache à son nom et à ses entreprises, le ferait considérer surtout comme un orateur plein de force et de passion. Plutarque en cite quelques autres passages qui justifient cette opinion : ils respirent toute l'éloquence de l'invective et de la haine. Cependant il parait, contre l'opinion commune, que le caractère habituel de son éloquence était la pureté, la précision, et une simplicité qui dégénérait quelquefois en faiblesse. On nous pardonnera cette digression littéraire, qui pourra servir à faire mieux connaître le génie de l'époque, dont parlait Scipion. S'il faut en croire les réflexions et plus encore les citations faites par Aulu-Gelle, l'éloquence de C. Gracchus se rapprochait de cette brièveté, de cette finesse de langage admirée dans les comédies de son siècle, beaucoup plus que de la richesse et de l'énergie oratoire, dont Cicéron donna le modèle. Comparées aux chefs-d'œuvre de ce grand maître, les narrations, les peintures de Gracchus, dans les sujets les plus touchants et les plus terribles, n'étaient que des esquisses dessinées avec correction. Ce tribun si redoutable, cet ennemi des patriciens retraçait-il quelques-uns des actes d'injustice et de violence reprochés à la jeunesse noble, ses expressions paraissent toutes froides et toutes décolorées, à côté des descriptions véhémentes de Cicéron accusant Verrès. On pourrait tirer de là une réflexion assez juste. C'est que dans les œuvres de l'imagination et du génie, la force même est le produit d'une époque perfectionnée, et qu'elle n'appartient pas aux premiers essais de l'art; ou du moins qu'elle ne s'y montre que par instants, et sous l'inspiration momentanée de la passion : ces éclairs du talent suffisent pour animer la parole improvisée. Mais le stylé n'en reçoit pas celte énergie durable, cette véhémence continue qui, seule, le fait vivre. Voilà sans doute par quelle cause les harangues de C. Gracchus, si puissantes et si admirées de son temps, disparurent dans la suite, devant les génies des Crassus et des Antoine, qui furent eux-mêmes anéantis par Cicéron. Au reste, cette simplicité trop nue était quelquefois fort piquante. Nous en citerons un modèle; c'est le fragment le plus étendu qui soit resté de l'éloquence de C. Gracchus: « Romains ! disait-il dans ce « morceau, si vous voulez user de sagesse et de discernement, et si vous y songez, vous verrez que périt sonne de nous ne vient ici sans intérêt : nous tous qui portons la parole, nous demandons quelque chose; et nul n'approche de vous par un autre motif que celui d'en tirer avantage. Moi-même, qui vous parle pour que vous augmentiez vos revenus, afin de pouvoir plus facilement administrer vos affaires et celles de la République, je ne suis pas sans intérêt : seulement ce n'est pas de l'argent que je vous demande, mais de l'estime et de la considération. Ceux qui viennent pour vous dissuader d'accepter la loi proposée, ne prétendent pas, il est vrai, à votre estime; mais ils en veulent à l'argent de Nicomède. Ceux qui vous conseillent de recevoir cette loi, ne prétendent pas non plus à votre estime; mais ils espèrent obtenir de Mithridate une récompense et un salaire. Enfin ceux qui, placés dans le même lieu et dans les mêmes rangs, gardent le silence, sont les plus actifs de tous dans leur cupidité; car ils se font payer de tous les côtés, et ils trompent tout le monde; et vous qui les supposez étrangers à de telles manœuvres, vous leur accordez votre estime. Cependant les ambassadeurs des rois, qui se croient obligés de leur savoir gré de ce silence, leur font de riches présents. C'est ainsi qu'en Grèce, un acteur tragique, tirant un jour vanité de ce qu'il avait reçu un talent pour une seule représentation, Démades l'homme le plus éloquent d'Athènes, lui répliqua, dit-on : Quoi! tu trouves merveilleux d'avoir gagné un talent, à force de parler ! « Moi, j'ai reçu du grand roi dix talents pour me taire. De même aujourd'hui ces hommes vendent au plus haut prix leur silence. » Ce passage sans doute se rapproche beaucoup plus de certaine ironie amère usitée quelquefois dans le parlement d'Angleterre, que de la véhémence séditieuse, que fait supposer le nom de Gracchus. Nous sommes étonnés que l'on parlât ainsi à ce peuple romain, dont notre imagination se forme une plus haute idée. Sous ce rapport, une telle citation est historique; et elle rentre dans l'objet même du cinquième livre, en nous faisant voir, par une autorité contemporaine, à quel point, dans le siècle de Scipion, les assemblées du peuple romain étaient déjà corrompues, et combien d'influences étrangères y dominaient. Nous devons au savant éditeur de Cicéron, à M. Mai, la découverte récente d'un autre passage de C. Gracchus, qui répond mieux aux souvenirs, que rappelle la fin si tragique des deux fils de Cornélie. Ce passage est beau d'éloquence; et on y voit l'âme de Caïus, ses craintes, ses animosités, et l'hésitation qu'il pu t éprouver dans ses audacieuses entreprises, et dans cette guerre mortelle, où il se sentait engagé. « Romains! disait-il, si je voulais prendre devant vous la parole, et vous demander, moi, le descendant d'une si noble famille, moi qui ai perdu mon frère pour vous, et qui, de la maison de Scipion l'Africain et de Tibérius Gracchus, reste seul avec un enfant, de souffrir que je trouve maintenant le repos, afin que notre famille ne soit pas anéantie tout entière, et qu'il en survive quelque débris, je ne sais si vous ne m'accorderiez pas volontiers cette grâce. » LIVRE CINQUIÈME.I. Ennius a dit : Rome a pour seul appui ses mœurs et ses grands hommes. Et ce vers, par la vérité comme par la précision, me semble un oracle émané du sanctuaire. Ni les hommes en effet, si l'État n'avait eu de telles mœurs, ni les mœurs, s'il ne s'était montré de tels hommes, n'auraient pu fonder ou maintenir, pendant si longtemps, une si grande république, une domination si juste et si étendue. Aussi voyait-on, avant notre siècle, la force des mœurs héréditaires appeler naturellement[1] les hommes supérieurs, et ces hommes éminents retenir les vieilles coutumes et les institutions des aïeux. Notre siècle au contraire, recevant la république comme un admirable tableau, qui déjà commençait à vieillir et à s'effacer, non seulement a négligé d'en renouveler les couleurs, mais ne s'est pas même occupé d'en conserver au moins le dessin et comme les derniers contours. Que reste-t-il, en effet, de ces mœurs antiques, sur lesquelles le poète appuyait la république romaine? Elles sont tellement surannées, et mises en oubli, que loin de les pratiquer, on ne les connaît même plus. Parlerai-je des hommes ? Les mœurs elles-mêmes n'ont péri que par le manque de grands hommes : désastre qu'il ne suffît pas d'expliquer, et dont nous aurions besoin de nous faire absoudre, comme d'un crime capital : car, c'est par nos vices, et non par quelque coup du sort, que, conservant encore la république de nom, nous en avons dès longtemps perdu la réalité.[2] . . II. ... Il n'y avait pas d'œuvre plus royale que la recherche des règles de l'équité : cela comprenait l'interprétation du droit positif. Aussi, les particuliers venaient-ils demander aux rois toutes les décisions de justice. Par ce motif, des terres, des champs, des bois, des pâturages, étaient réservés comme appartenant aux rois, et cultivés pour eux, sans travail ni soin de leur part, afin qu'aucun souci de leurs intérêts personnels ne les détournât des affaires de la nation. Jamais homme privé n'était juge ni arbitre, dans aucun débat. Tout se terminait par les sentences royales. Numa me paraît avoir été celui de nos rois qui conserva le plus cet antique usage des rois de la Grèce. Les autres, en effet, bien qu'ils aient aussi rempli ce devoir, prirent souvent les armes, et pratiquèrent surtout le droit de la guerre. Mais cette longue paix de Numa fut mère de la religion et de la justice dans Rome. Il semble même que Numa avait écrit des lois, qui, vous le savez, subsistent encore ; et ce génie du législateur est précisément le caractère propre au grand citoyen que nous cherchons. . . . III. Scipion..... Qu'un fermier connaisse la nature des plantes et des semences, cela vous choquerait-il ?— Manilius. Nullement, pourvu que l'ouvrage se fasse. — Scipion. Mais croyez-vous que cette étude soit l'œuvre d'un fermier ? — Manilius. Non ; car souvent la culture languirait, faute de travail. — Scipion. Eh bien! de même qu'un fermier connaît la nature d'un champ; de même que l'intendant sait écrire, et que tous deux cherchent dans ces notions, non pas un amusement savant, mais une pratique utile; ainsi notre homme d'Etat peut fort bien s'être livré à la connaissance du droit et de la législation, en avoir approfondi les sources; mais il ne s'embarrasse pas dans un dédale de consultations, de lectures, de discussions écrites. Il s'occupera surtout d'administrer la République en habile intendant, et d'être pour elle en quelque sorte un bon fermier. Il sera très versé dans ce droit primitif et général, sans lequel personne ne saurait être juste; il ne sera pas ignorant du droit civil : mais il en usera comme le pilote use de l'astronomie, et le médecin, des sciences naturelles. L'un et l'autre, en effet, exploitent ces connaissances, au profit de leur art ; mais ils ne négligent pas leur art, et ne s'en laissent pas détourner. IV. Dans ces républiques, les bons ambitionnent la gloire et l'estime, et fuient l'ignominie et le déshonneur. En effet, de tels hommes sont moins effrayés par les menaces et les punitions de la loi, que par Ce sentiment d'honneur, dont la nature a doué l'homme, et qui n'est autre chose que la crainte d'un blâme légitime. Le sage législateur fortifie cet instinct par l'opinion, le perfectionne par les Institutions et les mœurs ; et les citoyens sont éloignés de faillir, plus encore par la honte que par la crainte. Au reste, ceci rentre dans les considérations sur la gloire, qui ont pu être présentées ailleurs avec plus d'étendue. V. Quant à la vie privée, et aux mœurs de la cité, toute chose est disposée par la sainteté des mariages, par la naissance légitime des enfants, par la protection des dieux Pénates et des dieux Lares autour du foyer domestique, de manière à donner à chaque citoyen une participation dans les avantages publics, et une jouissance paisible de ses avantages personnels. D'où il suit qu'on ne peut vivre heureux sans un bon état social et qu'il n'est rien de plus fortuné qu'une république sagement établie............ [1] Montesquieu avait été frappé de cette belle pensée, et il l'a reproduite, en la généralisant, au commencement de la Grandeur et de la Décadence des Romains : « Dans la naissance des sociétés, dit-il, ce sont les chefs des républiques qui font l'institution ; et c'est ensuite l'institution qui forme les chefs des républiques. » [2] Ce passage et ceux qui suivent, isolés entre eux, sont les fragments nouveaux de ce cinquième livre découverts par M. Mai : ils nous aident seulement à conjecturer quelles grandes questions étaient discutées dans cette partie du texte original.
|