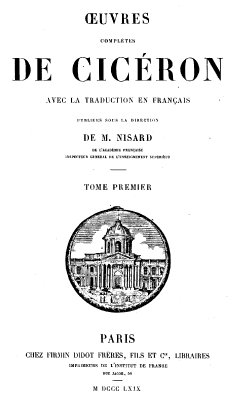|
ALLER A LA TABLE DES MATIÈRES DE CICÉRON
Cicéron
LES PARADOXES
DU MEILLEUR GENRE D'ÉLOQUENCE.
LES PARADOXES DE M. T. CICÉRON, ADRESSÉS A M. BRUTUS.
INTRODUCTION.
Nous avons cru devoir terminer par les Paradoxes le recueil des ouvrages de rhétorique de Cicéron, cet opuscule, comme le remarque judicieusement M.V. Leclerc, étant plutôt une étude oratoire qu'un traité de philosophie. Cicéron lui-même le donne comme un jeu d'esprit, un développement de lieux communs. Les maximes stoïciennes qu'il s'évertue à y exagérer ne convenaient pas à l'esprit souple, facile et sceptique de notre auteur, et la crudité de ces paradoxes jure avec le doux génie et les opinions humaines de celui qui, dans le pro Murena, avait ridiculisé ce qu'il défend ici. Le nom de Paradoxes était donné par les stoïciens eux-mêmes à ces maximes étranges dont ils reconnaissaient les premiers le désaccord avec les opinions vulgaires, et où ils se plaisaient toutefois, pour cette originalité bizarre, qui, au milieu de toutes leurs belles qualités était leur manie. Cicéron en soutient six, dont la plus étrange et la plus insoutenable (3e paradoxe) est que toutes les bonnes actions ont le même mérite, et qu'il n'y a non plus aucune différence entre les mauvaises. Les cinq autres ont un certain fond de vérité qui aurait pu fournir de belles inspirations et de beaux développements mais Cicéron parait n'en avoir fait que des textes de déclamations, où son naturel ne se montre que par d'amères diatribes contre ses ennemis et des éloges trop pompeux de lui-même. Les deux premiers paradoxes se ressemblent beaucoup et n'en sont véritablement qu'un. Le premier établit, que le seul bien, c'est l'honnête et le second, que rien ne manque à l'homme vertueux pour le bonheur. Le premier est traité avec gravité, et reçoit un certain lustre des exemples des vieux Romains. Cicéron glisse sur le second, invective en passant contre Marc Antoine, et prend en lui-même l'exemple de l'homme vertueux. Le troisième est cette incroyable maxime, que toutes les bonnes actions aussi bien que les mauvaises, sont égales. Cicéron la croit ou feint de la croire salutaire aux moeurs, quoique certainement entre le rôle de Solon et celui de Dracon, il eût choisi le premier. Il est triste de le voir se débattre contre cette terrible objection, qu'il a le courage d'aborder c'est donc le même crime, de tuer son esclave ou son père? Le quatrième paradoxe est la formule superbe du mépris du stoïcien pour le commun des hommes. Ne pas avoir l'esprit du sage ou du stoïcien, ce qui revient au même, c'est être en démence. Il y a au début quelques beaux traits; mais Cicéron avait dès le premier mot pris Clodius à partie, et toute la suite est une chaleureuse et tardive invective contre le tribun qui avait envoyé en exil l'énergique consul et le défenseur de Milon. Les deux derniers établissent, non sans raison, que la sagesse donne la liberté et la richesse. Le développement du cinquième est la meilleure partie de tout cet exercice. Cicéron s'y attaque encore à M. Antoine; mais il emprunte à la philosophie morale de la Grèce de grandes pensées, dont il est le digne interprète. Le sixième est solidement défendu, et notre auteur y peut parler de lui avec plus de bienséance. Mais, comme si le principal effet de ces Paradoxes eût été de remuer sa bile il sent encore le besoin de philosopher sur le ton de la satire, et Crassus est traité avec non plus de ménagement que les Antoine et les Clodius. Cicéron, comme il le témoigne lui-même à la fin de sa courte introduction, n'attachait pas grande importance à ces amplifications, qui sentent un peu leur rhéteur. Il a enrichi d'assez beaux ouvrages les lettres et la philosophie, pour que nous laissions les paradoxes au rang très secondaire où l'intention et l'estime de leur auteur les ont placés. Il résulte du préambule même des Paradoxes, que ces petites pièces venaient d'être précédées d'un plus grand ouvrage composé pendant l'hiver, et qui parut sous le nom de Brutus ; in tuo nomine apparuit. S'il s'agit du Brutus ou Dialogue des orateurs illustres écrit à la fin de 706 ou au commencement de 707, les Paradoxes auraient été composés au printemps de 707 s'il s'agit, au contraire, d'un des quatre grands traités adressés à Brutus, l'Orateur, le livre de Fininus, les Tusculanes et la Nature des Dieux, il paraît impossible de fixer la date des Paradoxes. J'ai souvent remarqué, Brutus, que Caton, votre oncle, lorsqu'il prenait la parole dans le sénat, traitait de graves sujets de philosophie, fort étranges pour les oreilles romaines, et parvenait cependant par ses discours à donner à ses thèses la couleur de la vraisemblance. Et pour lui, c'est une plus grande affaire que pour vous ou pour nous; car nous faisons, nous, plus d'usage de cette philosophie, qui ouvre à la parole un champ large, et où ont cours des sentiments assez rapprochés de l'opinion vulgaire. Pour Caton, c'est, à notre avis, un parfait stoïcien, dont les idées ne peuvent avoir grand crédit près de la foule, appartenant d'ailleurs à une secte qui proscrit tout agrément du discours et le veut le plus sec possible, et qui procède toujours par de petites et incisives interrogations. Mais il n'est rien de si incroyable que la parole ne sache rendre probable ; rien de si affreux et de si inculte que l'éloquence ne fasse briller et ne cultive en quelque façon. Tout plein de cette pensée, j'ai été plus audacieux que Caton lui-même. Car il ne parle d'ordinaire que de la grandeur d'âme, de la continence, de la mort, des beautés de la vertu, des dieux immortels, de l'amour de la patrie ; et il donne à ses idées stoïciennes la parure de l'éloquence. Mais moi, j'ai réduit en lieux communs, tout en me jouant, ces principes même que les stoïciens enseignent à peine dans leurs écoles et leurs spéculations. Ce sont ces opinions qu'eux-mêmes, en raison de leur étrangeté, et parce qu'elles blessent les sentiments vulgaires, nomment des paradoxes (παράδοξα); et j'ai voulu essayer s'il était possible de les rendre accessibles à tous en leur donnant du jour et de la vraisemblance, ou si la philosophie parlait décidément une autre langue que le commun des hommes ; et j'ai tenté l'entreprise d'autant plus volontiers, que ces fameux paradoxes, comme on les nomme, me semblent tout à fait socratiques, et parfaitement conformes à la vérité. Vous recevrez donc ce petit livre, oeuvre de mes nuits d'été, car mes longues veilles ont naguère porté des fruits que j'ai fait paraître sous votre invocation. Vous goûterez ce genre d'exercices que je pratique souvent, et par lequel j'accommode à mon style oratoire les thèses des écoles. Je ne veux pas cependant que vous teniez cet ouvrage pour un grand présent; il n'est pas de ceux que l'on expose au milieu d'une citadelle, comme la Minerve de Phidias; mais vous y reconnaîtrez , j'espère, la plume que vous avez quelquefois inspirée. Que le seul bien, c'est l'honnête. I. Je crains fort que ce discours ne paraisse à quelqu'un des vôtres un écho des discussions stoïciennes, plutôt que l'expression de mes propres sentiments; je n'en dirai pas moins ce que je pense, et je le dirai plus brièvement que ne pourrait le comporter un si grand sujet. Je puis prendre le ciel à témoin que jamais richesses, palais, fortune ou puissance, et tous ces plaisirs qui enchaînent la foule, ne m'ont paru mériter qu'on les comptât parmi les biens et qu'on en fît l'objet de ses désirs; car je voyais ceux à qui ils étaient le plus libéralement échus aspirer ardemment à ce dont ils étaient comblés. On ne satisfait et on n'étanche jamais la soif de la cupidité; et les possesseurs de ces objets enviés ne sont pas dévorés seulement par la fureur de les accroître, mais encore par la crainte de les perdre. A ce propos, je me remets souvent en mémoire la sagesse de ces hommes de parfait désintéressement, nos ancêtres, qui donnaient, il est vrai, aux fragiles et périssables fureurs de la fortune le nom de biens, mais par le fait et dans la pratique, en jugeaient tout autrement. Est-ce que le bien peut appartenir à un méchant homme? Est-il possible que, dans l'abondance des biens, on ne soit pas homme de bien? Or, ne voyons-nous pas tous ces prétendus biens se répandre sur les méchants et nuire aux honnêtes gens ? Que l'on me plaisante tant que l'on voudra, la saine raison aura plus de crédit auprès de moi que l'opinion du vulgaire. Je ne dirai jamais qu'en perdant un troupeau ou des meubles on perd des biens, et je citerai souvent avec éloge l'un des sept sages, Bias, à ce que je crois, dont Priène, la patrie, venait de tomber aux mains des ennemis. Tous ses concitoyens fuyaient, emportant avec eux le plus qu'ils pouvaient; on l'engage à suivre leur exemple : «C'est ce que je fais, repart-il, car je porte tous mes biens avec moi.» Il regardait comme des jouets de la fortune, qui ne lui appartenaient, à lui, d'aucune façon, tous ces biens selon notre langage. Qu'est-ce donc, demandera-t-on que le bien? On dit très justement que ce qui est fait avec droiture, honnêteté et vertu, est bien fait; et ce qui est droit, honnête et vertueux, est, selon moi, le seul bien. [ II. Mais ces réflexions, un peu abstraites, peuvent sembler obscures. Il faut leur donner, pour commentaire, la vie et les actions des grands hommes; les paroles seules semblent trop subtiles pour un tel sujet. Je vous le demande, est-ce que les fondateurs de cette belle république vous paraissent avoir songé aux charmes des richesses, à l'agrément des plaisants séjours, aux délices du luxe, aux voluptés des festins? Passez en revue tous les rois. Voulez-vous commencer à Romulus? ou bien avec la république et par ceux-mêmes qui mirent l'État en liberté? Par quels degrés Romulus est-il monté au ciel? est-ce par ces prétendus biens, ou par ses hauts faits et ses vertus? Et Numa Pompilius? pensez-vous que ses urnes et ses vases d'argile aient été moins agréables aux dieux que les coupes ciselées de tant d'autres? Je ne dirai rien des autres rois; ils sont tous égaux entre eux, à l'exception du Superbe. Demandez à Brutus ce qu'il a fait pour affranchir son pays; demandez à tous les compagnons de sa grande entreprise ce qu'ils ambitionnaient et ce qu'ils poursuivaient: en trouverez-vous un seul qui eût en vue les plaisirs et les richesses, et qui se soit proposé autre chose que de remplir la tâche d'un homme de coeur et d'un grand citoyen? Qui arma contre Porsenna le bras de Mucius, sans aucun espoir de salut? Quelle force secrète maintint, au milieu d'un pont, Coclès seul contre toutes les forces ennemies? Quelle puissance inspira les voeux des deux Décius, et les poussa au travers des bataillons armés? Quel mobile avait le désintéressement de Fabricius, et la sobriété de M. Curius? Et ces deux boulevards de Rome dans la guerre Punique, Cn. et P. Scipion, qui voulurent lui faire un rempart de leurs corps contre le débordement des Carthaginois? et les deux Africains? et Caton qui vécut entre les deux? et tant d'autres qu'on ne pourrait nombrer (car, chez nous les exemples domestiques abondent), que pensons-nous qu'ils aient estimé digne de leur ambition, si ce n'est ce qui leur paraissait louable et beau? III. Qu'ils viennent maintenant, les railleurs de ce sentiment et de ce discours, et qu'ils déclarent eux-mêmes à qui ils aimeraient mieux ressembler, de ces riches logés dans des palais de marbre, resplendissants d'or et d'ivoire, au milieu des statues, des tableaux, de l'or et de l'argent ciselé, ou des merveilles corinthiennes; de C. Fabricius, qui de ces prétendus biens n'eut et ne voulut rien avoir? Ils accordent facilement, il est vrai, que tous ces objets brillants, dont la possession est si mobile, ne méritent pas le nom de biens; mais ils maintiennent opiniâtrement, et soutiennent avec chaleur, que la volupté est le souverain bien. C'est là, à mon sens, un langage de brutes, et non d'hommes. Comment! vous, à qui un dieu ou la nature, cette mère universelle, a donné une âme, qui est tout ce qu'il y a au monde de plus excellent et de plus divin, vous vous avilissez et vous ravalez au point de penser qu'il n'est aucune différence entre vous et le premier venu des animaux ? Est-ce qu'il peut y avoir un bien qui ne rende pas meilleur celui qui le possède? Celui à qui le bien est le plus libéralement échu est en même temps le plus estimable des hommes, et il n'est aucun bien dont le maître ne puisse honnêtement se vanter. Voyez-vous aucun de ces caractères dans la volupté? Rend-elle l'homme meilleur ou plus estimable? est-il quelqu'un qui se glorifie de ses plaisirs, et en tire vanité? Or si la volupté, malgré les nombreux avocats qui en défendent la cause, ne peut être comptée parmi les biens; si, plus elle augmente, plus elle entraîne l'âme loin de son rang et de son siége naturel: il est certain que, bien et heureusement vivre, n'est rien autre que vivre honnêtement et droitement. Qu'à l'homme vertueux rien ne manque pour le bonheur. Je n'ai jamais pensé que M. Régulus eût été infortuné, misérable, digue de pitié. Ce que les Carthaginois torturaient en lui, ce n'était ni sa grandeur d'âme, ni sa noblesse, ni sa bonne foi, ni sa fermeté, ni aucune de ses vertus, ni enfin son âme elle-même qui, défendue par ce grand cortége de vertus, n'était certes pas tombée avec son corps au pouvoir des ennemis. J'ai vu C. Marius qui, dans ses prospérités, me parut l'un des plus fortunés, et, dans ses revers, l'un des plus grands hommes; et c'est le sort le plus beau pour un mortel. Tu ne sais pas, insensé, tu ne sais pas quelle est la puissance de la vertu : tu en prononces bien le nom; mais tu ignores ce qu'elle vaut. Celui qui ne relève que de lui-même et met en lui tous ses biens, doit nécessairement être le plus heureux des hommes. Pour celui de qui les espérances, les pensées et la conduite dépendent des jeux de la fortune, il ne peut y avoir rien d'assuré, rien dont il soit certain de jouir tout un jour. Effraye un tel homme, si tu le rencontres, de tes menaces de mort et d'exil. Pour moi, quoi qu'il puisse m'arriver dans cette ingrate cité, je ne m'en affligerai point, et j'y suis prêt. A quoi donc ai-je travaillé, qu'ai-je fait, et à quoi ont abouti mes réflexions et mes efforts, si je n'ai su réussir à me mettre en tel état que je ne pusse donner prise ni à l'aveugle jeu de la fortune, ni à l'iniquité de mes ennemis? Est-ce la mort, dont tu me menaces pour me retrancher de la société des hommes, ou l'exil, pour m'ôter de celle des méchants? La mort est effroyable pour ceux qui perdent tout avec la vie, non pour ceux dont la gloire est immortelle; et l'exil, pour ceux dont la demeure est comme circonscrite dans un étroit canton, non pour ceux qui regardent l'univers entier comme une seule cité. Tu es rongé d'infirmités et de misères, toi qui te crois heureux et florissant; les passions te dévorent; les jours et les nuits sont une torture continuelle pour toi, qui ne te peux assouvir de ce que tu as, et trembles encore de le perdre à chaque moment; le remords de tes crimes te déchire, la terreur de la justice et des lois te glace le sang; de quel côté que tu te tournes, tes iniquités t'apparaissent comme autant de furies, et ne te laissent point respirer. Ainsi, tout comme le méchant, l'insensé et le lâche ne peut goûter le bonheur; de même, l'homme de bien, le courageux et le sage ne peut être misérable. Celui qui a un grand coeur et un beau caractère, doit avoir une belle vie : une belle vie doit être enviée; mais on ne l'envierait pas si elle était misérable. C'est pourquoi l'on doit tenir que tout ce qui est digne d'estime est digne d'envie, et que l'homme vertueux est en même temps heureux et florissant. Que les fautes et les mérites sont tous égaux. I. C'est peu de chose, dites-vous. - Mais la faute est grande. Il ne faut pas juger les mauvaises actions par leur résultat, mais par le vice qu'elles supposent. La matière de la faute peut être plus ou moins considérable, mais la faute en elle-même, de quelque manière que vous l'expliquiez, ne comporte ni le plus ni le moins. Qu'un pilote perde un vaisseau chargé d'or ou de paille ; il y aura quelque légère différence dans la valeur perdue, aucune dans l'impéritie du pilote. On viole une femme du peuple : l'affront en rejaillit moins loin que si c'eût été une vierge de grande famille et d'un noble sang ; mais la faute n'en est pas moindre, si toutefois il en est de faire le mal comme de sortir des bornes : une fois en dehors, la faute est faite; aussi loin que vous allez au delà de la barrière, vous n'ajouterez rien au tort de l'avoir franchie. Il n'est certes permis à personne de faire le mal. Ce que l'on défend n'est interdit qu'à ce titre seul que l'on montre qu'il est illicite. Et comme ce titre n'admet ni le plus, ni le moins (la faute consistant en ce qu'on transgresse une juste prohibition, qui est toujours, sans variation, pleine et entière), il s'ensuit que toutes les actions qui le méconnaissent sont également mauvaises. Que si les vertus sont égales entre elles, il est nécessaire que les vices aussi soient égaux. Or, on peut très facilement concevoir que toutes les vertus sont égales, et qu'il ne peut se trouver un homme meilleur que l'homme de bien, plus tempérant que le tempérant, plus courageux que l'homme de coeur, plus sage que le sage. Appellerez-vous honnête homme celui qui, pouvant retenir impunément dix livres d'or qu'on lui a confiées sans témoins, les rendra et en retiendra dix mille une autre fois? Appellerez-vous tempérant celui qui réprime une passion, et lâche la bride à une autre? Il n'est qu'une vertu, l'obéissance à la raison, inébranlable et perpétuelle. On ne peut rien y ajouter qui l'accroisse, rien en retrancher sans la détruire. Si les bonnes actions sont morales, et si rien n'est plus moral qu'une action morale, on doit déclarer aussi que rien n'est meilleur que le bien. Il en résulte donc que les vices aussi sont tous égaux, s'il est juste d'appeler vices les difformités de l'âme. Or, puisque les vertus sont égales entre elles, les bonnes actions, qui viennent des vertus, doivent être égales; et les mauvaises, qui viennent des vices, ne doivent pas l'être moins. II. Ce sont là, dites-vous, des maximes empruntées aux philosophes. - Vous n'y reconnaissez pas celles des mauvais lieux? J'aurais pu le craindre.- C'est ainsi que raisonnait Socrate. - J'en suis charmé, car il a la réputation d'un homme fort docte et très sage. Mais, je vous le demande, car enfin ce ne sont pas les poings qui doivent jouer dans notre querelle, est-ce des sentiments des portefaix et des manoeuvres que nous devons nous mettre en peine, ou bien de ceux des sages? quand nous observons surtout que cette opinion est non seulement la plus vraie du monde, mais encore la plus salutaire dans la pratique de la vie. Quelle puissance arrêtera plus vivement les hommes sur le seuil du mal que cette conviction qu'il n'y a aucune différence entre les fautes? qu'il y a autant de crime à mettre la main sur un simple citoyen que sur un magistrat ? que porter le déshonneur dans la plus humble des familles, c'est se couvrir du dernier opprobre? Quoi ! dira-t-on, tuer son père ou son esclave, c'est le même crime? - Si vous présentez la question dans ces termes généraux, nous ne pourrons en bien juger. Si ôter la vie à son père est en soi un crime, les Sagontins, qui aimèrent mieux pour leurs pères la mort dans la liberté que la vie dans la servitude, furent des parricides. Ainsi donc on peut quelquefois sans crime ôter la vie à son père, et souvent on ne le peut à son esclave. C'est dans le motif de l'acte et non dans l'acte même qu'il faut chercher des distinctions : le motif fait pencher la balance du côté où il se porte; lorsqu'il se trouve également des deux côtés, il les rend nécessairement égaux. Mais voici, en tout cas, la différence : lorsque vous mettez injustement votre esclave à mort, vous ne commettez qu'un crime; lorsque vous tuez votre père, vous en commettez plusieurs. Vous tuez celui qui vous a engendré, celui qui vous a nourri, celui qui vous a élevé, celui qui vous a donné un état, une famille, un rang dans la république. Dans ce seul crime il y en a donc une foule; c'est pourquoi il mérite un plus terrible châtiment. Mais dans notre conduite, ce que nous devons considérer, ce n'est pas quelle peine mérite chaque faute, mais quelles actions nous sont permises : tout ce qu'il ne faut point faire est une faute; tout ce que la loi défend est un crime : telles doivent être nos maximes. - Quoi! dans les plus petites choses? - Vraiment oui : car disposer du cours des événements, nous ne le pouvons; maintenir notre âme sous le frein, cela dépend de nous. Lorsque dans son jeu un acteur excède la mesure, lorsqu'il fait un vers trop long ou trop court d'une syllabe, il est sifflé et chassé; et vous, acteur dans la vie, qui devez y porter plus de convenance que n'en demande le théâtre, plus de mesure que n'en réclame le vers, direz-vous que vos fautes ne sont que des syllabes de plus ou de moins? Je n'excuse point un poète qui s'est trompé dans des bagatelles, et j'excuserais dans le monde an citoyen qui mesurera ses fautes sur ses doigts! Trouvez-les brèves si vous voulez, mais vous ne pourrez les trouver légères; car toute faute, quelle qu'elle soit, est une perturbation de la raison et de l'ordre; et dès qu'une fois la raison et l'ordre sont troublés, il ne se peut rien ajouter qui augmente la faute. Que, point de sagesse, c'est démence. Ce n'est plus de ta fréquente sottise, ni de ta perpétuelle scélératesse que je veux te convaincre; mais je te prouverai sans réplique que tu es un insensé et un homme en démence. L'âme du sage fortifiée par une exquise prudence, une inébranlable fermeté, le mépris de la fortune, par toutes les vertus en un mot, sera-t-elle jamais forcée et prise d'assaut dans des tels retranchements, quand on ne peut pas même la jeter dans l'exil? Qu'est-ce en effet que la vraie cité? Est-ce toute réunion, même de bêtes féroces? est-ce toute multitude, même de fugitifs et de brigands, rassemblés en un même lieu? Certainement non. Il n'y avait donc pas de cité, alors que les lois y étaient sans autorité, que la justice y était muette, les usages antiques, abolis, et que le fer, après avoir dispersé les magistrats, laissait vide la place du sénat au milieu de la république. Ce ramas de bandits, ce brigandage constitué sous tes enseignes en plein forum, ces débris de la conjuration de Catilina, passant de ses débordements impies à tes abominables fureurs, tout cela n'était point Rome. Je n'ai donc pas été banni d'une cité qui n'existait pas; mais Rome m'appela lorsqu'il y eut un consul dans la république, qui n'en avait plus à cette funeste époque; lorsqu'il y eut un sénat, qui alors avait péri ; lorsque le peuple libre put se faire entendre; lorsque reparurent l'équité et les lois, qui sont les liens de la cité. Vois un peu combien j'ai méprisé les coups de ton ignoble fureur; j'ai toujours pensé, il est vrai, qu'elle se déchaînait contre moi et me poursuivait de ses traits; mais je n'ai jamais estimé qu'ils m'eussent atteint, à moins peut-être que tu n'aies cru, alors que tu portais dans ma maison des torches incendiaires et en renversais les murailles, livrer aux flammes et ruiner quelque chose qui fût à moi. Rien de ce qui m'appartient, rien de ce qui appartient à un homme, ne peut s'enlever, s'arracher, ou se perdre. Si tu m'avais enlevé ma fermeté éprouvée, mes soins, mes veilles, mes conseils, qui ont relevé et maintiennent la république, à ta grande douleur; si tu avais détruit le souvenir impérissable de cet éternel bienfait; bien plus encore, si tu m'avais ravi cet esprit d'où sont sortis tous ces conseils; alors j'avouerais que j'ai éprouvé un vrai dommage. Mais si tu ne m'as fait ni pu faire tout ce mal, ce n'est pas un exil misérable que ton iniquité m'a infligé, mais un retour glorieux qu'elle m'a préparé. Je n'ai donc jamais cesse d'être citoyen; et moins que jamais, alors que le sénat confiait mes jours, comme ceux d'un grand citoyen, à la garde des nations étrangères : tandis que toi, tu ne l'es pas même aujourd'hui; à moins cependant que l'on ne puisse être à la fois citoyen et ennemi. Est-ce la nature et l'origine, et non pas plutôt l'esprit et les actes qui distinguent, selon toi, un citoyen d'un ennemi? Tu as couvert de sang le forum ; tu as fait occuper les temples par des brigands armés; les maisons privées, les édifices sacrés ont été par toi livrés aux flammes. Pourquoi nommer Spartacus un ennemi, situ es un citoyen? Comment serais-tu un citoyen, toi qui pour un temps as anéanti la cité? Et tu m'appelleras exilé, moi dont l'absence a paru à tous l'exit même de la république! O le plus insensé des hommes! tu ne jetteras donc jamais les yeux sur toi? Tu ne songeras donc jamais ni à ce que tu fais, ni à ce que tu dis? Tu ne sais donc pas que l'exil est le châtiment des crimes, et que mes belles actions seules m'ont poussé hors de Rome? Tous les brigands et les sacrilèges dont tu te vantes d'être le chef, et que les lois condamnent à l'exil, sont autant d'exilés, lors même qu'ils n'ont point changé de lieu; et toi, qu'exilent toutes les lois, tu ne seras point un exilé? N'appelle-t-on point ennemi celui que l'on surprend en armes? on a surpris ton poignard à la porte du sénat. Celui qui a commis un meurtre? tu en as commis un grand nombre. L'auteur d'un incendie? c'est ta main qui a mis le feu au temple des Nymphes. Celui qui envahit de force un lieu consacré? tu as campé dans le forum. Mais à quoi bon énumérer les lois ordinaires qui te condamnent toutes à l'exil? Ton meilleur ami a fait rendre contre toi une loi spéciale pour t'exiler si tu pénétrais dans le sanctuaire de la Bonne Déesse. Mais tu te vantes toi-même d'y avoir pénétré. Comment donc, expulsé par tant de lois, ne trembles-tu pas au seul nom d'exil? Je suis à Rome, dis-tu. Tu as bien été dans le sanctuaire. II ne suffit pas d'être dans un lieu pour en avoir les privilèges, lorsque l'on en est exclu par les lois. Que le sage seul est libre, et que hors de la sagesse il n'y a qu'esclavage. I. Que l'on vante ce général, qu'on lui prodigue ce titre, et qu'on l'en croie digne; mais de quelle façon? A quel homme libre commandera celui qui ne peut commander à ses passions? Qu'il les réprime d'abord, qu'il méprise les voluptés, retienne sa colère, mette un frein à son avarice, ferme les autres plaies de son âme, et qu'il commence à commander aux autres, alors que lui–même aura cessé d'obéir à ces abominables maîtres, la turpitude et l'opprobre. Tant qu'il leur obéira, non seulement ce ne sera pas un général, mais on ne devra même pas le tenir pour un homme libre. C'est là une fort belle doctrine des philosophes, dont je n'invoquerais pas l'autorité si je parlais à des ignorants ; mais comme je ne m'adresse ici qu'à des esprits parfaitement cultivés, et à qui ces spéculations ne sont pas étrangères, pourquoi feindrais-je d'avoir perdu toutes les peines que j'ai consacrées à ce genre d'études? De très habiles gens ont donc déclaré, qu'à l'exception du sage, personne n'est libre en ce monde. Qu'est-ce en effet que la liberté? Le pouvoir de vivre comme on veut. Mais quel homme peut conformer sa vie à ses volontés, si ce n'est celui qui suit le droit chemin, se complaît dans son devoir, et n'agit qu'avec maturité et prudence; celui qui n'obéit pas aux lois par crainte, mais s'y attache et les respecte, parce que de tels sentiments lui paraissent les plus salutaires de tous; qui ne dit rien, ne fait rien, ne pense rien, si ce n'est volontiers et librement ; dont tous les desseins et les actions ne viennent que de lui et tendent à la même fin; près de qui rien n'a autant de crédit que sa propre volonté et son jugement ; à qui le cède enfin la fortune elle-même dont on dit que le pouvoir est souverain. Ainsi l'exprime une sage maxime du poète : Chacun se fait une fortune à sa guise. Le sage a donc seul le privilège de ne faire rien malgré lui, rien à regret, rien par contrainte. Et quoiqu'il faille pour le prouver un plus long discours, on doit cependant convenir en deux mots que celui-là seul est libre dont l'âme est ainsi disposée. Tous les méchants sont donc des esclaves. Et ce qu'il y a ici d'étrange et de paradoxal ce n'est pas tant la chose que le mot. Car on ne prétend pas qu'ils soient esclaves comme ceux qu'un maître achète, ou possède à quelque autre titre; mais si la servitude est, comme elle l'est en effet, l'obéissance d'une âme énervée et abjecte, et qui ne jouit pas de son libre arbitre, qui pourrait nier que tous les hommes légers, tous ceux que conduisent leurs passions, tous les méchants en un mot soient des esclaves? II. Est-ce un homme libre, celui à qui commande une femme? à qui elle dicte des lois, impose ses volontés, ordonne, défend ce qu'il lui plaît? qui ne peut désobéir à aucun de ses commandements, et n'ose résister à aucun de ses caprices? Elle demande ? il faut donner; elle appelle? il faut venir; elle remue? il faut s'éloigner; elle menace? il faut trembler. Pour moi, un tel homme n'est pas seulement un esclave, mais le plus vil de tous les esclaves, eût-il le plus illustre sang dans ses veines. Et de même que, dans une grande famille, il est certains esclaves, comme les intendants et les jardiniers, qui s'estiment fort au-dessus des autres, et n'en sont pas moins esclaves; ainsi, et non moins fous, sont ceux qui mettent toutes leurs délices dans les statues, les tableaux, les ouvrages ciselés, les bronzes corinthiens, et les bâtiments magnifiques. Mais nous sommes, disent-ils, les chefs de l'État. Vous n'êtes pas même les chefs de vos compagnons d'esclavage. Et de même que dans une maison ceux à qui le soin de ces objets est confié, qui essuient, parfument, nettoient, arrosent, ne tiennent pas le premier rang parmi les esclaves; ainsi, dans la société, ceux qui se livrent sans partage à des goûts de cette espèce, sont descendus presque au dernier degré de l'esclavage. - J'ai fait de grandes guerres, me diras-tu; j'ai eu de grandes charges et de beaux commandements. - Gouverne donc honorablement ton âme. Te voilà sottement en extase devant un tableau d'Echion, ou une statue de Polyclète. Je ne veux pas rechercher de quelles sources ils te viennent, ni où tu les as enlevés. Lorsque je te vois ébahi, ravi d'admiration, jetant les hauts cris, je te tiens pour l'esclave de toutes ces bagatelles. - Est-ce que ce ne sont pas là des objets charmants? - D'accord; nous aussi n'avons pas l'oeil d'un barbare. Mais, au nom du ciel, que ce charme n'aille pas jusqu'à forger des chaînes aux hommes, et que toutes ces beautés demeurent des jouets d'enfants. A ton avis, que dirait L. Mummius, s'il voyait l'un de ces délicats manier avec amour quelque vase de nuit fait d'airain de Corinthe, lui qui a méprisé Corinthe entière? le prendrait-il pour un des princes de l'État, ou pour un intendant soigneux? Et si la lumière était rendue à M. Curius, ou à quelqu'un de ces anciens qui n'avaient dans leurs maisons de ville et de campagne d'autre ornement, d'autre décoration qu'eux-mêmes; s'il voyait un homme comblé des bienfaits du peuple, appeler ses mulets au bord d'un vivier, et les flatter de sa main, et se vanter du nombre de ses murènes, ne le regarderait-il pas comme tellement esclave qu'il ne voudrait pas même lui confier un service important dans sa maison? Peut-on douter de l'esclavage de ceux qui, par la passion d'augmenter leur pécule, acceptent toutes les conditions du plus dur esclavage? Quelles lourdes chaînes n'impose pas l'espoir d'un héritage ! comme on s'empresse de satisfaire les moindres caprices d'un vieillard riche et sans enfants! On dit ce qu'il veut, on fait tout ce qu'il commande, on lui tient fidèle compagnie, on lui prodigue ses soins, on l'accable de petits cadeaux. Qui pourrait reconnaître là un homme libre, et non pas un esclave fainéant? III. Et cette passion, plus noble en apparence, des honneurs et du pouvoir, quelle dure, impérieuse, et emportée maîtresse n'est-elle pas! elle rend esclaves de Céthégus, d'un homme qui ne jouit pas d'une bien grande estime, ceux mêmes qui se regardent comme les plus considérables de l'État ; elle les contraint à lui envoyer des présents, à le venir trouver de nuit, à l'implorer, à le supplier enfin. Qu'est-ce donc que l'esclavage, si c'est là de la liberté? Et lorsque la tyrannie des passions a cessé, et que de la conscience des fautes commises est né un autre maître, la terreur, quelle misérable et dure servitude c'est là ! Il faut se faire l'esclave de tous les jeunes gens qui aiment à causer, il faut craindre comme des maîtres tous ceux qui font les informés. Et alors quel maître n'est-ce pas qu'un juge? combien les coupables ne tremblent-ils pas devant lui? Et la crainte, n'est-ce pas l'esclavage? Que voulait donc dire l'éloquent Crassus dans ce discours plus abondant que sage? «Arrachez-nous à la servitude.» Qu'est-ce donc que la servitude d'un homme aussi noble et aussi illustre? La servitude, c'est la faiblesse d'une âme abattue, énervée et rampante. «Ne souffrez pas que nous soyons les esclaves de personne.» Il demande donc d'être rendu à la liberté? Non pas; mais il ajoute : «Si ce n'est de vous tous.» C'est un changement de maître , et non la liberté qu'il veut. «De vous tous, que nous pouvons et devons servir.» Pour nous, nous avons l'âme trop grande et trop haut placée par la vertu, pour le devoir et le pouvoir. Dis que tu le peux, puisque tu le peux en effet : mais ne dis pas que tu le dois ; car l'homme n'a d'autre devoir que de s'affranchir de la honte. Mais en voilà assez sur ce sujet. Qu'il voie cependant comment on peut dire qu'il commande aux autres, cet homme que la raison et la vérité convainquent de ne pas même être libre. Que le sage seul est riche. I. Pourquoi vanter ta fortune avec cette insolente ostentation? Es-tu seul riche? Au nom du ciel, est-ce que mes connaissances et mes études n'ont rien dont je puisse être fier? Tu te crois le seul riche? Mais, si tu n'étais pas même riche! Mais si tu étais réellement pauvre ! Comment entendons-nous la richesse, et à qui l'attribuons-nous? à celui, je pense, qui a assez de biens pour les trouver sans peine suffisants à une vie libérale; qui ne demande, ne désire, n'ambitionne rien au delà. C'est ton jugement qui doit te déclarer riche, et non l'opinion publique et la grandeur de tes biens; il faut qu'il trouve que rien ne te manque, et qu'il ne se mette en recherche d'aucun bien nouveau. A ton sens, regorges-tu d'argent, ou même en as-tu ton content? S'il en est ainsi, je l'accorde, tu es riche. Mais si dans ton avidité d'amasser, tu ne réputes honteux aucun gain , tandis qu'aucun ne peut être honnête pour l'ordre dont tu es membre; si tous les jours tu fraudes, tu trompes, tu demandes, tu fais des marchés, tu enlèves, tu prends; si tu dépouilles les alliés et pilles le trésor public; si tu es dans l'attente des testaments de tes amis, ou même, sans les attendre, si tu en produis de faux, sont-ce là des signes d'abondance ou de misère? C'est l'esprit de l'homme que l'on appelle riche, et non ses coffres. Les tiens ont beau être combles, tant que je te trouverai vide, je ne te croirai pas riche. On mesure les richesses à la suffisance des biens. A-t-on une fille? il faut de l'argent. En a-t-on deux? il en faut davantage. Plusieurs? davantage encore. Et si, comme Danaüs, on en compte jusqu'à cinquante, voilà tout autant de belles dots à fournir. Il faut donc, comme j'ai dit, mesurer la fortune à l'étendue des besoins de chacun. Ainsi, celui qui a non pas plusieurs filles, mais des passions innombrables qui peuvent en peu de temps épuiser les plus grands trésors, ne doit en aucune manière être appelé riche, surtout quand lui-même se sent dans le besoin. On t'a souvent ouï dire qu'il n'y a de riche que celui qui peut entretenir une armée à ses frais ; ce que tous nos grands revenus permettent à peine depuis quelque temps au peuple romain. Donc, à ce compte, tu ne seras riche, que le jour où tes épargnes te mettront à même de défrayer six légions et toutes les troupes auxiliaires de fantassins et cavaliers. Mais c'est avouer que tu n'es pas riche, toi dont la fortune est si loin de pouvoir suffire à ce beau rêve. Ainsi, tu n'as jamais fait un secret de ta pauvreté, ou plutôt de ton indigence et de ton extrême misère. II. De même que ceux qui cherchent des gains honnêtes dans le commerce, le travail des mains, et la collecte des impôts, nous font entendre que le besoin les meut; ainsi, quand on voit ta maison remplie d'une troupe confuse d'accusateurs et de juges; et en même temps, des accusés coupables et riches, travaillant sous tes auspices à corrompre leurs juges; quand on voit par quels marchés tu vends ton patronage, les cautions que tu fournis aux brigues des candidats, les affranchis que tu envoies pour rançonner et piller les provinces; tes voisins dépossédés, tes brigandages dans les champs, les sociétés que tu formes avec des esclaves, des affranchis et des clients ; toutes ces propriétés sans maîtres, ces proscriptions des riches, ces massacres dans nos cités, et toute cette moisson du temps de Sylla; quand on songe à ces testaments supposés, à tant d'hommes enlevés; quand ou découvre enfin que tu as mis tout à prix d'argent, l'enrôlement des milices, tes sentences, ton suffrage et celui d'autrui, ton langage et ton silence, et transformé en comptoirs ta maison et le forum : comment ne pas penser que, de ton propre aveu, c'est le besoin qui te pousse? et comment croire qu'un homme, mû par le besoin, soit véritablement riche? Le propre de la richesse est de nous combler de ressources ; et on ne la reconnaît qu'à l'aise et à l'abondance ou l'on se trouve : et comme tu n'y atteindras jamais, jamais tu ne deviendras riche. Puisque tu méprises ma fortune, et avec raison, car au jugement commun elle est médiocre; au tien, nulle; au mien, modique : je ne dirai rien de moi, et je poursuivrai mon sujet. S'il s'agit de fixer notre opinion et notre estime, dis-moi si nous devons estimer davantage l'argent que Pyrrhus offrait à Fabricius, ou le désintéressement de Fabricius qui refusa cet argent? l'or des Samnites, ou la réponse de M. Curius? l'héritage de Paul Émile, ou la générosité de l'Africain qui abandonna à Q. Maximus son frère la part de cet héritage? Bien certainement, ces traits qui partent des plus nobles vertus, ont plus de prix que ces richesses dédaignées. Comment donc, s'il est vrai que la richesse doit se mesurer au prix des biens que l'on possède, comment douter qu'elle ne se trouve dans la vertu? Puisqu'il n'est aucune fortune, aucune montagne d'or ou d'argent dont le prix se puisse comparer à celui de la vertu. III. O dieux immortels ! Les hommes ne veulent pas comprendre quel beau revenu c'est que la modération des goûts; car j'en viens aux somptueux, et laisse là ceux que dévore la passion du lucre. Vous prenez dans votre avoir six cents sesterces, et moi cent dans le mien; mais vous, qui voulez dans vos maisons de campagne des plafonds brillant d'or et des parquets en marbre, qui entassez sans fin statues, tableaux, meubles et vêtements précieux, vous ne trouvez pas dans cette levée de fonds, je ne dis pas de quoi solder vos dépenses, mais de quoi même en payer l'intérêt; ma petite somme, à moi que ne grèvent point des goûts ruineux, me fournira encore du superflu. Lequel donc est le plus riche de celui à qui l'argent manque, ou de celui qui en a de reste? d'un homme qui est dans le besoin, ou d'un autre qui est dans l'abondance? Laquelle est la plus belle, d'une fortune qui, plus elle grandit, plus elle est insuffisante à se maintenir, ou d'une autre qui s'entretient par ses propres forces? Mais pourquoi parler de moi qui, atteint peut-être de la contagion universelle, ne puis tout à fait secouer les préjugés de mon temps? M. Manilius (pour ne pas toujours parler des Curius et des Fabricius) était, au dire de nos pères, un citoyen pauvre; il avait une petite maison aux Carènes, et quelques arpents près de Labicum. Sommes-nous donc plus riches, nous qui avons davantage? Plût au ciel ! Mais ce n'est pas à l'inscription du cens, c'est au train et à l'aise de la vie qu'il faut mesurer la fortune. Ne pas avoir de passions, c'est de l'argent comptant; ne pas aimer la dépense, est un beau revenu; être content de ce que l'on a, c'est la plus grande et la plus solide richesse. Car si les habiles experts donnent un grand prix aux prés et aux champs, parce que ces sortes de propriétés sont celles qui souffrent le moins d'atteinte; quelle estime ne doit-on pas faire de la vertu, qui jamais ne peut nous être enlevée ni dérobée; que l'on ne perd ni dans un naufrage, ni dans un incendie, et que n'altèrent ni la violence des tempêtes ni les ravages du temps? Ceux qui la possèdent, seuls sont riches; car seuls ils ont des biens à la fois productifs et impérissables; et seuls (ce qui est le propre des richesses) ils sont satisfaits de ce qu'ils ont; ils estiment que ce leur est un avoir suffisant. Ils ne désirent rien, n'ont besoin de rien, ne se sentent manquer de rien, ne recherchent rien. Les méchants au contraire et les avares, n'ayant que des biens incertains et qui donnent prise à la fortune, les veulent toujours accroître; il ne s'en est pas encore trouvé un seul qui pût se contenter de ce qu'il avait; aussi doit-on les regarder non comme des gens riches et dans l'abondance, mais comme des pauvres et des indigents. PROOEMIUM. Animadverti Brute. M. Julius Brutus, le meurtrier de César. Servilia, sa mère, était soeur de Caton d'Utique. Ea philosophia plus utimur. Cicéron se rattachait de préférence à la nouvelle académie, et avait d'ailleurs plus de goût pour la doctrine des péripatéticiens que pour celle des stoïciens. Illud majorum vigiliarum munus. Les Tusculanes le traité de Finibus et celui de la Nature des dieux qui avaient aussi été dédiés à Brutus. Illa Minerva. La Minerve de Phidias était placée dans l'Acropolis d'Athènes. PARADOXON I. - I Patriam Prienem. Priène, ville d'lonie. L'ennemi dont il est ici question était Alyatte, père de Crésus. Hérodote I, 26 Diogène Laerce, Vie de Bias; et Valère Maxime, XII, 2. II. Cupedines ac fictiles urnas. Vases dont on se servait dans les sacrifices. On trouve, dans le de Natara deorum, III, c. 17 Cupedunculae Numae. Interjectus Cato. Caton l'Ancien, qui mourut à quatre-vingt-cinq ans, cinq ans avant la ruine de Carthage par le second Africain. III. Corinthiis operibus. Ouvrages d'art faits d'airain de Corinthe. PARADOXON Il. – C. Marium vidimus. Marius était mort l'an de Rome 667. Cicéron a toujours professé pour Marius une grande admiration; il avait fait un poème en son honneur. Nescis, insane. Cet insensé est Marc Antoine; quelques éditions ajoutent : O Marce- Antoni ! PARADOXON III. – I. Parva, inquis. L'auteur se met ici en plein dialogue et va répondre à une sorte d'objection. Transilire lineas. Comparaison empruntée aux règles de la course antique. Il y avait deux lignes tracées dans la carrière, l'une au point de départ, l'autre à l'extrémité. Franchir la première avant le signal était manquer à la règle. Grévius pense que c'est à celle-ci que Cicéron fait allusion, quoiqu'on puisse aussi bien l'entendre de l'autre qu'il ne fallait pas dépasser, et que le reste de la phrase nous fasse incliner pour cette seconde interprétation. Transilire lineas s'emploie fréquemment dans le sens de faire une faute. Il. Ne a lenonibus. Sarcasme qui s'adresse à peu près indistinctement à tous les partisans de la volupté. Saguntini. Lors du siège de Sagonte par Annibal. Tite-Live, XXI, 24. Extra numeros. La mesure dont il est question ici est celle du geste, comme l'indiquent clairement les expressions gestu maderatior que l'on trouve un peu après. Dans l'antiquité, tout ce qui se disait et se faisait sur la scène était réglé et mesuré per numeros. Digitis peccata dimelientem. L'auteur fait allusion à la coutume des poètes de compter sur leurs doigte les pieds de leurs vers. Breviora. Suite de la comparaison des actions avec les vers. PARADOXON IV. – Omnem stultum insanire. L'expression stultum, traducl ion imparfaite du mot grec ἄφρων, n'a point d'équivalent dans notre langue. Être stultus c'est philosophiquement, ne pas être sapiens; et les stoïciens entendaient volontiers par là celui qui n'avait pas leur sagesse, c'est-à-dire, qui n'était pas de leur secte et ne se réglait pas en stoïcien. Ego vero te. Toute cette diatribe est à l'adresse de Clodius, le promoteur de l'exil de Cicéron, et qui n'appelait d'ordinaire le père de la patrie, revenu triomphant à Rome, que l'exilé. Illa tum civitas. Lors du tribunat de Clodius, sous le consulat de L. Pison et A. Gahinius, l'an de Rome 695, Si mihi eripuisses diuturnam. Les principaux manuscrits s'accordent à donner divinam au lieu de diuturnam. Quelle que fût l'autorité de cette leçon, nous n'avons pas hésité à suivre l'exemple d'un grand nombre d'éditions qui ont adopté diuturnam. La pudeur ne permet pas de penser que la vanité d'un grand esprit ait été jusqu'à cet excès. Ob praeclarissimas res. Cicéron avait été exilé, sur la motion de Clodius, pour avoir fait mettre à mort, sans jugement, les complices de Catilina, malgré les injonctions formelles de la loi Sempronia. Ante senatum tua sica. Clodius avait embusqué, dans le vestibule du sénat un esclave armé d'un poignard pour assassiner Pompée. Famillarissimus tuus. A. Papius Pison avait fait porter une loi spéciale contre Clodius, qu'on accusait de s'être introduit, sous des vêtements de femme, dans un sanctuaire dont l'entrée était interdite aux hommes. Il est vrai que ce même Pison fit abroger lui dont il avait eu l'initiative. LETTRES à ATTICUS I, 13. Opertum Bonae deae. Les sacrifices en l'honneur de cette déesse avaient lieu dans la maison du souverain pontife. Jules César était alors revêtu de cette dignité. PARADOXON V. I. Hic imperator. On croit généralement que c'est M. Antoine que Cicéron désigne ici quoique une foule de traits de cette amère critique convienne très bien à Lucullus. Sapiens poeta. Appius ou Plaute. Le premier, cité par Salluste, avait dit « Fabrum esse quemque fortunae. » Et le second, dans le Trinummus, II, 2 : « Sapiens ipse fingit fortunam sibi. » II. Cui mulier imperat. Si l'on veut ici voir une allusion, c'est la célèbre Fulvie que probablement l'auteur avait en vue. On sait quel empire elle exerça sur Antoine. Atrienses... topiarii. Les esclaves atrienses avaient la garde de tous les objets d'art et de luxe. Les topiarii donnaient aux arbres, par la taille et l'agencement, des formes agréables; leur art, fort en vogue à l'époque de Cicéron, s'appelait topiaria. Echionis. Pline parle de ce peintre dans son livre XXXV, 10. L. Mummius. C'est le destructeur de Corinthe. Ce n'est pas par excès de goût qu'il serait tombé dans le travers que blâme Cicéron. On sait qu'il avait déclaré, à ceux qui étaient charges du transport des chef-d'oeuvre des arts de Corinthe à Rome qu'ils seraient tenus s'ils les égaraient d'en rendre de semblables. II. Mullos exceptantem. Ces mulets étaient privés et venaient s'offrir aux caresses. Dans une lettre à Atticus II, 1 où Hortensius et Lucullus sont désignés, Cicéron s'exprime plus explicitement « Nostri principes digito se coelum putant attingere, si multi barbati in piscinis sint, qui ad manum accedant. » III. Cethega... servire. Ce Céthégus fut préteur l'an de Rome 679. Il n'est, à ce qu'il paraît, sorte de bassesses que Lucullus ne fit pour en obtenir un commandement. L. Crassi copiosa... oratio. C'est le discours de Crassus pour la loi Servilia. Cicéron le lui reproche aussi dans le premier livre du de Oratore, où il cite, entre autres, les phrases rapportées ici. PARADOXON VI. I. Quae est ista. C'est à Crassus en particulier que Cicéron s'attaque dans le développement de ce paradoxe. Isti ordini ne honestus. Tout trafic était réputé honteux pour un sénateur. Aerarium expilas. Ce que nous savons certainement, c'est que Crassus enleva au Capitole deux mille livres d'or que Camille avait déposées dans l'intérieur du trône de Jupiter. Pline, XXXIII, I. Il. Pactiones in patrociniis. La loi Cincia défendait à un sénateur de faire marché de son patronage. Intercessiones. C'est ce que Facciolati explique ainsi « Sponsiones, interposita fide sua, se soluturum pro iis candidatis, ni ipsi solvetent, quam promiltebant pecuniam.» Sullani temporis messem. Sylla avait vendu, comme siens les biens d'un grand nombre de citoyens, et Crassus les avait achetés à vil prix. Sylla avait livré aux flammes une partie de la ville, et Crassus avait acquis à très bon compte les terrains sur lesquels ensuite il avait édifié. Toutes ces spéculations lui rapportèrent des sommes énormes. III. M' Manilius. Probablement celui qui fut consul l'an de Rome 604 et dont il est question dans le dialogue de Amictlia cap. 3 et le Songe de Scipion I. Carinis. Région de la ville éloignée du forum. – Labicano. Bourg voisin de Rome, qui avait donné son nom à la campagne des environs. Voyez. Pline. III, 5. |