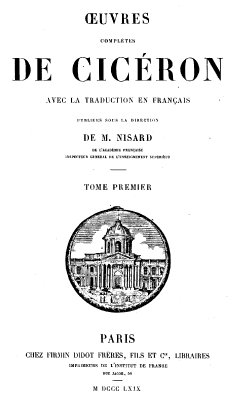|
ALLER A LA TABLE DES MATIÈRES DE CICÉRON
Cicéron
DE L'ORATEUR
LIVRE PREMIER
LES TROIS DIALOGUES DE L'ORATEUR II
LIVRE TROISIÈME. ARGUMENT. Crassus reprend la parole, et traite de l'élocution et de l'action. Le Livre commence par un morceau pathétique sur ta mort de cet orateur, et sur la destinée malheureuse des autres interlocuteurs du Dialogue. Il établit (VII-XIII) que, malgré la diversité des talents, et la différence des genres que l'éloquence embrasse, on peut l'assujettir cependant à des règles fixes et générales. Il indique, comme premières qualités de l'élocution la correction et la clarté, sur lesquelles il ne croit pas devoir insister. Avant de passer aux qualités plus importantes, il considère (XVI-XXIII) l'art de l'orateur sous son point de vue le plus élevé; et dans une digression éloquente, remonte jusqu'au temps où l'on ne séparait pas l'art de bien penser de celui de bien dire, la sagesse, de l'éloquence. Il se plaint de cette injuste séparation, et conseille aux orateurs d'étudier la philosophie. Il recommande ensuite ( XXIV-XXXVI ) à ceux qui veulent donner au discours les ornements convenables de se faire, avant tout, par des études sérieuses, le fonds d'idées le plus riche qu'ils pourront. Il examine(XXXVII-LIV) les mots pris isolément et réunis; il s'étend sur la composition de la phrase, sur le rythme et le nombre; il donne un aperçu rapide des figures de mots et de pensées. Les six derniers chapitres sont consacrés à la convenance du style et à l'action oratoire. I. Comme je me disposais, mon cher Quintus, à rapporter dans ce troisième Livre le discours que tint Crassus, lorsque Antoine eut fini le sien, un pénible souvenir est venu réveiller dans mon coeur des regrets douloureux et un chagrin que le temps n'a point effacés. Ce beau génie qui méritait l'immortalité, cette douceur de moeurs, cette vertu si pure, tout fut éteint par une mort soudaine, dix jours à peine après les entretiens que j'ai cherché à retracer dans ce livre et dans le précédent. Crassus, de retour à Rome, le dernier jour des jeux scéniques, apprit avec indignation que le consul Philippe s'était permis de dire, dans une harangue au peuple, qu'il avait besoin d'un conseil plus sage, et qu'avec un pareil sénat il ne pouvait conduire les affaires publiques. Le matin des ides de septembre, il se rendit au sénat. L'assemblée fut très nombreuse. Drusus, qui l'avait convoquée, après s'être plaint vivement du consul, demanda qu'on délibérât sur l'outrage que le premier magistrat de la république avait fait à cet ordre respectable, en le calomniant auprès du peuple. Toutes les fois que Crassus prononçait un discours préparé avec quelque soin, les hommes les plus éclairés s'accordaient à dire qu'il semblait n'avoir jamais mieux parlé; mais ce jour-là on convint que si jusqu'alors il avait surpassé les autres, cette fois il s'était élevé au-dessus de lui-même. Il déplora le malheur et le triste délaissement du sénat; il éclata contre l'audace du consul, qui, au lieu de remplir à l'égard de cet ordre le devoir d'un bon père, ou d'un fidèle tuteur, venait, comme un infâme brigand, le dépouiller de sa dignité héréditaire : il ne fallait pas s'étonner si celui dont la politique funeste avait bouleversé la république, voulait maintenant lui enlever l'appui et les lumières du sénat. Philippe était violent, accoutumé à manier l'arme de la parole, et à faire tête à ceux qui l'attaquaient : les reproches de Crassus enflammèrent sa fureur, et pour contenir ce redoutable adversaire, il alla, dans le transport de sa colère, jusqu'à ordonner de prendre un gage sur ses biens. Ce fut alors que Crassus déploya un talent plus qu'humain : il déclara qu'il ne voyait plus un consul dans celui qui refusait de voir en lui un sénateur. «Quand tu as regardé l'autorité du sénat tout entier comme un bien confiscable, que tu l'as dégradée, foulée aux pieds devant le peuple, penses-tu m'effrayer par tes indignes outrages! Si tu veux imposer silence à Crassus, ce ne sont pas ses biens, c'est la langue qu'il faut lui arracher; et quand il ne me restera plus que le souffle, mon âme libre saura encore trouver des sons pour combattre ta tyrannie.» II. Il parla longtemps avec cette chaleur et cette véhémence, déployant toute son âme, tout son génie, toutes ses forces; et son avis, adopté par l'assemblée presque entière, forma le décret du sénat conçu dans les termes les plus forts et les plus magnifiques. Il portait que «toutes les fois qu'il s'était agi des intérêts du peuple romain, ni la sagesse, ni la fidélité du sénat, n'avaient manqué à la république.» Crassus revêtit même de son nom la rédaction du décret, comme l'attestent encore les registres. Mais ce fut pour cet homme divin le chant du cygne; ce furent les derniers accents de sa voix; et nous, comme si nous eussions dû l'entendre toujours, nous venions au sénat, après sa mort, contempler encore la place où il avait parlé pour la dernière fois. Il fut saisi pendant son discours même d'une douleur de côté, suivie d'une sueur abondante, et d'un frisson violent; il rentra chez lui avec la fièvre, et au bout de sept jours il n'était plus. O trompeuses espérances de l'homme! ô fragilité de la condition humaine! ô vanité de nos ambitions, si souvent confondues et brisées au milieu même de leur course, et que la tempête vient engloutir à l'instant où l'on découvrait le port! Tant que la vie de Crassus fut occupée à la poursuite pénible des dignités, il eut bien cette gloire que donnent le dévoûment aux intérêts des particuliers, et l'éclat du talent, mais non pas encore le crédit et le rang attachés aux grands emplois; et l'année d'après sa censure, lorsque les suffrages unanimes de ses concitoyens lui décernaient déjà la première place dans la considération publique, la mort vint renverser tous ses projets et toutes ses espérances ! Ce fut sans doute une perte cruelle pour sa famille, douloureuse à la patrie, sensible à tous les gens de bien; mais tel a été après lui le sort de la république, qu'on peut dire que les dieux ne lui ont pas enlevé la vie, mais plutôt qu'ils lui ont fait don de la mort. Il n'a point vu l'Italie déchirée par la guerre, le sénat en butte aux fureurs de la haine, les premiers citoyens de Rome accusés d'un complot sacrilége; il n'a point vu le deuil de sa fille, l'exil de son gendre, la fuite désastreuse de Marius, le carnage et les horreurs qui suivirent son retour; enfin, il n'a pas vu flétrir et dégrader cette république si glorieuse autrefois, lorsque lui-même était monté au comble de la gloire. III. Mais puisque mes réflexions m'ont conduit à parler du pouvoir et de l'inconstance de la fortune, je n'ai pas besoin d'aller chercher plus loin d'autres exemples : il me suffit de rappeler la destinée des interlocuteurs de ce dialogue. Quoique la mort de L. Crassus ait fait couler tant de larmes, qui ne la trouve heureuse, en se rappelant le sort de ceux qui eurent alors avec lui leur dernier entretien? Pouvons-nous oublier que Q. Catulus, revêtu de tous les titres de gloire, et qui implorait pour unique faveur, non la conservation de ses droits, mais l'exil et la liberté de fuir, fut réduit à se donner lui-même la mort? Et M. Antoine, quelle a été sa fin? la tête sanglante de cet homme, à qui tant de citoyens devaient leur salut, fut attachée à cette même tribune, où, pendant son consulat, il avait défendu la république avec tant de fermeté, et qu'il avait ornée, pendant sa censure, des dépouilles de l'ennemi. Bientôt, sur cette même tribune, furent exposées aux outrages la tête de C. César, lâchement trahi par un Toscan son hôte, et celle de son frère Lucius. Ah! celui à qui le spectacle de ces horreurs a été épargné, ne semble-t-il pas avoir vécu et être mort avec la république? Crassus n'a pas vu son proche parent Publius, cet homme d'un si grand courage, forcé de se tuer de sa propre main; ni le grand pontife Scévola, son collègue, rougir de son sang la statue de Vesta : ce coeur généreux, qui ne respirait que l'amour de la patrie, aurait donné des pleurs à la mort même de C. Carbon, son plus grand ennemi, massacré aussi dans cette affreuse journée. Il n'a pas vu la destinée déplorable de ces deux jeunes gens qui s'étaient attachés à lui : Cotta qu'il avait laissé, en mourant, dans une position si heureuse, peu de jours après, exclu, dépossédé du tribunat par la cabale de ses ennemis, fut bientôt obligé de se bannir de Rome. D'abord victime de la même faction, Sulpicius, devenu tribun, entreprit d'humilier ceux même dont il avait été, dans la condition privée, l'ami le plus fidèle; et cet homme, qui croissait pour la gloire de l'éloquence romaine, périt d'une mort sanglante, juste châtiment de sa politique insensée, mais qui n'en causa pas moins à la république une perte irréparable. Pour moi, Crassus, quand je considère l'éclat de ta vie, et l'heureux à propos de ta mort, il me semble que la bonté divine s'est plu à marquer elle-même ta naissance et ta fin. Ta fermeté et ta vertu t'auraient fait tomber sous le glaive des guerres civiles; ou si la fortune avait dérobé tes jours à la fureur des assassins, c'eût été pour te rendre témoin des funérailles de ta patrie; et tu aurais eu, non seulement à gémir sur la tyrannie des méchants, mais encore à pleurer sur la victoire du meilleur parti, souillée par le meurtre de tant de citoyens. IV. Je ne puis songer, mon cher Quintus, à la destinée de ces grands hommes, et aux maux que j'ai soufferts moi-même pour avoir aimé trop tendrement ma patrie, sans reconnaître la vérité et la sagesse de vos conseils, lorsque vous me rappeliez les malheurs, la chute terrible de tant d'hommes illustres, de tant de vertueux citoyens, pour m'engager à ne pas m'exposer aux orages des dissensions publiques. Mais puisqu'il n'est plus temps de revenir sur mes pas, et que la gloire, en couronnant mes travaux, en a fait disparaître l'amertume, livrons-nous à ces douces consolations qui font oublier les douleurs passées, qui charment les douleurs présentes. Achevons de transmettre à la postérité cet entretien de Crassus, et comme les dernières paroles qu'il prononça; et si cet hommage n'est pas proportionné à la grandeur de son génie, il attestera du moins l'ardeur de notre zèle et de notre juste reconnaissance. Lorsqu'on lit ces admirables ouvrages de Platon, où revient presque toujours la figure de Socrate, malgré l'éloquence sublime du disciple, l'imagination se forme du maître une idée plus imposante encore. Telle est la disposition que je demande, non pas à vous, mon frère, dont l'indulgence se plaît à exagérer mes talents, mais à tous ceux qui liront ces dialogues : je les prie, pour apprécier Crassus, d'aller au delà de l'image imparfaite que je pourrai leur offrir. Je n'assistai point à l'entretien que je vais rapporter; mais Cotta m'en a redit la substance et le fond ; et comme je connaissais parfaitement le genre de talent des deux interlocuteurs, je me suis attaché à le reproduire en les faisant parler. Si quelques critiques, trompés par l'opinion commune, me reprochent de donner à Crassus moins d'abondance, à Antoine moins de sécheresse, qu'ils n'en avaient, c'est qu'ils ne les ont pas entendus, ou qu'ils ne sont pas en état de les juger. Chacun d'eux, comme je l'ai dit, doué d'une grande application, d'un heureux génie, et d'une vaste instruction, était parfait dans son genre : le style d'Antoine ne manquait pas d'ornements, et celui de Crassus n'en était pas surchargé. V. On s'était séparé avant midi pour prendre un peu de repos. Cotta m'a raconté que Crassus passa tout ce temps absorbé dans une sérieuse et profonde méditation, avec cet air pensif, ce regard fixe, qui lui étaient ordinaires (il l'avait vu souvent) lorsqu'il se préparait à plaider une grande cause. Cotta, qui connaissait son habitude, était venu, pendant que les autres dormaient, épier Crassus dans la salle où reposait ec grand orateur. Il le trouva couché sur un lit qu'il s'était fait dresser, et le voyant absorbé dans ses méditations, il se retira aussitôt. Deux heures s'écoulèrent dans ce recueillement. Enfin, lorsque la moitié de la journée était déjà écoulée, tout le monde se rassembla auprès de Crassus, et César lui dit: N'est-il pas temps d'aller prendre séance? nous ne venons pas toutefois vous presser de tenir votre parole, mais seulement vous la rappeler. - Me croyez-vous, dit Crassus, d'assez mauvaise foi, pour différer plus longtemps d'acquitter vis-à-vis de vous une dette telle que celle que j'ai contractée? - Quel lieu, reprit César, choisirons-nous? que pensez-vous du milieu de ce bois? nous y jouirons de l'ombre et du frais. - Soit, répondit Crassus; le lieu me paraît convenable à notre entretien. Tout le monde approuvant cet avis, on se rend au milieu du bois, ou chacun prend place, impatient d'entendre Crassus. - L'empire, dit-il, que vous avez sur moi, votre amitié, surtout la complaisance d'Antoine, ne me laissent aucun moyen de vous refuser; et cependant j'en aurais peut-être de justes raisons. Dans le partage qu'il a fait de cette discussion, en se réservant tout ce qui concerne les pensées, et en me laissant à traiter les ornements dont elles sont susceptibles, il a séparé deux choses inséparables. Le discours, en effet, se composant de pensées et de mots, il n'y a plus de place pour les mots, si l'on retranche les pensées, et celles-ci ne peuvent être mises en lumière, si vous faites disparaître les mots. Les anciens avaient, ce me semble, des vues plus élevées, et des idées plus étendues que les nôtres, lorsqu'ils représentaient cet univers qui nous environne, comme un tout immense, dont les parties sont enchaînées par une seule force, et réunies sous une même loi de la nature : chacune de ces parties a besoin, pour que son existence soit durable, de rester fidèlement attachée à toutes les autres, et chacune aussi est nécessaire, à la conservation et à la perpétuité de tout l'ensemble. VI. Mais si un vaste système est au-dessus de notre faible intelligence, c'est au moins un mot bien vrai de Platon, et ce mot, Catulus, n'est assurément pas nouveau pour vous, qu'un lien commun unit tous les arts et toutes les sciences dont l'étude charme ou élève l'esprit de l'homme : ces rapports secrets, cette merveilleuse alliance, frappent tous ceux qui se sont appliqués à approfondir l'enchaînement des causes et des effets. Enfin, si cette idée échappe encore par sa sublimité à nos regards trop attachés à la terre, nous devons au moins connaître toute l'étendue de l'art auquel nous nous sommes consacrés, que nous professons, et qui fait l'occupation de notre vie. Je vous le disais hier, et Antoine l'a répété ce matin plus d'une fois, l'éloquence est une, quelque sujet qu'elle embrasse, dans quelque sphère d'idées qu'on la transporte. Soit qu'elle s'occupe du ciel ou de la terre, des choses divines ou humaines; soit qu'elle s'adresse à des supérieurs, à des égaux ou à des inférieurs; soit qu'elle se propose d'instruire les hommes, soit qu'elle les excite ou qu'elle les arrête, qu'elle les pousse ou qu'elle les ramène, qu'elle enflamme ou qu'elle calme leurs passions; soit qu'elle parle à une grande assemblée, on à un petit nombre d'auditeurs, qu'elle se fasse entendre parmi des étrangers, qu'elle se borne à un cercle intime, ou qu'elle s'entretienne avec elle-même: c'est un fleuve qui se partage en mille branches différentes, mais dont la source est la même; et partout où elle se montre, elle paraît avec les mêmes ornements et le même cortége. Mais puisque nous nous laissons dominer par les opinions du vulgaire, puisque des demi-savants, pour mettre à leur portée ce qu'ils ne pouvaient embrasser en entier, le déchirent et l'arrachent en lambeaux, et qu'en détachant les pensées de l'élocution, ils séparent l'âme du corps, sans considérer que la mort est le résultat de cette séparation, je n'irai pas au delà de la tâche qui m'est imposée : je me contenterai de dire en passant qu'en vain chercherait-on les ornements de l'élocution, si l'on n'a d'abord trouvé et disposé les idées, et que les idées ne sauraient produire d'effet, si l'expression ne les fait ressortir. Mais avant d'en venir aux ornements dont le discours me paraît susceptible, je vous exposerai en peu de mots mon sentiment sur l'éloquence en général. VII. Il me semble qu'il n'existe dans la nature aucun ordre de choses qui ne puisse présenter en lui-même une multitude de combinaisons très diverses, mais toutes également susceptibles de plaire au même titre. Une multitude de sons frappent nos oreilles d'une manière agréable : cependant ils sont souvent très différents entre eux, et le dernier est celui qui nous fait le plus de plaisir. Il en est de même des spectacles dont la nature enchante nos yeux : ils ne se ressemblent point, et ils procurent à un seul sens une multitude de jouissances différentes. On en peut dire autant des autres sens, qui sont affectés d'impressions agréables, mais diverses, sans qu'il soit facile de juger quelle est celle qui l'emporte sur les autres. Ce que je viens de dire des objets de la nature s'applique aux beaux-arts. Il n'y a qu'un art de la sculpture : Myron, Polyclète, Lysippe, y ont excellé; mais ils ne se ressemblent pas l'un à l'autre, et l'on ne voudrait pas qu'aucun d'eux fût différent de lui-même. Il n'y a qu'un art de peindre : cependant Zeuxis, Aglaophon, Apelle, sont tous les trois fort différents entre eux, et il semble que rien ne manque à la perfection de chacun d'eux. Si cette variété singulière et en même temps si réelle, nous étonne dans des arts en quelque sorte muets, combien n'est-elle pas plus surprenante encore dans les arts de la parole? Les écrivains en employant les mêmes pensées et les mêmes expressions, présentent pourtant des diversités infinies. Ce n'est pas que les qualités de l'un fassent tort à la gloire des autres : tous sont dignes des mêmes éloges, mais à des titres différents. C'est ce qu'on peut remarquer d'abord parmi les poètes, qui ont tant d'affinité avec les orateurs. Quelle différence entre Ennius, Pacuvius et Attius, et, chez les Grecs, entre Eschyle, Sophocle et Euripide ! tous cependant ne sont-ils pas à peu près également admirés, malgré la diffférence de leur manière? Si nous considérons maintenant les orateurs, qui font le sujet de cet entretien, nous trouverons la même différence dans le caractère de leur talent. Isocrate se distingue par la suavité; Lysias, par la délicatesse; Hypéride, par une manière pénétrante; Eschine, par l'éclat dessous; Démosthène, par l'énergie. Lequel d'entre eux n'est pas admirable? lequel ressemble à d'autres qu'à lui-même? Scipion l'Africain eut en partage la noblesse; Lélius, la grâce; Galba, la véhémence; Carbon, l'abondance et l'harmonie. Chacun de ces orateurs fut un des premiers de son siècle ; chacun mérita la palme dans un genre différent. VIII. Mais pourquoi recourir à des exemples anciens, lorsque nous en avons de vivants sous les yeux ? Quoi de plus agréable à l'oreille que le style de Catulus? Son élocution est si pure, qu'on dirait que lui seul sait parler la langue des Romains; la noblesse et la dignité n'excluent pas en lui l'urbanité et la grâce; enfin, toutes les fois que je l'entends, je me dis qu'on ne pourrait rien ajouter, rien retrancher, rien changer à ses paroles sans y gâter quelque chose. Et César, n'a-t-il pas introduit dans l'éloquence une manière nouvelle et qui lui est propre? Quel orateur, après lui, sut jamais prêter à des sujets tragiques le piquant de la comédie, aux sujets tristes, de la gaieté, de l'enjouement aux plus sérieux, et transporter au barreau le charme et l'intérêt du théâtre, sans que l'élévation des pensées exclue jamais la plaisanterie, sans que la plaisanterie ôte de la noblesse aux pensées? Voici deux jeunes gens à peu près du même âge, Sulpicius et Cotta. Peut-on se ressembler moins, mais peut-on être plus distingué dans des genres différents! Cotta s'attache au poli et à la perfection du style, à la justesse et à la propriété des expressions; il ne s'écarte jamais de la question; et lorsque sa sagacité lui a fait distinguer ce qui il est essentiel de prouver aux juges, il laisse de côté tout le reste, et porte sur ce seul point tous ses efforts, toute son attention. Sulpicius a de la chaleur, de la véhémence, une voix pleine et forte, une action énergique, animée, un geste noble, un style majestueux et riche, et l'on dirait que la nature s'est plu à réunir sur lui toutes les qualités qui font l'orateur. IX. Je reviens à nous-mêmes, puisque le public s'est toujours plu à nous comparer ensemble, et a fait de nous deux rivaux sur lesquels il prononce. Peut-on se ressembler moins que nous ne ressemblons l'un à l'autre? Antoine est à mes yeux un orateur accompli, et j'ai une très faible idée de mon mérite; mais enfin on s'obstine à me comparer à lui. Ne voyez-vous pas quel est le genre de son talent! Il a pour lui la force, la véhémence, la chaleur, le mouvement. Toujours en garde contre son adversaire, il ne laisse aucune prise à l'attaque; vif, pénétrant, net et lumineux, s'arrêtant habilement sur les points essentiels, faisant sa retraite en bon ordre, poursuivant l'ennemi avec vigueur, il menace, il supplie; il est d'une variété inépuisable; on ne se lasse jamais de l'entendre. Pour moi (puisque vous voulez bien me donner un rang parmi les orateurs), quelle que soit la place que je mérite, mon genre est assurément fort éloigné de celui d'Antoine : ce n'est pas à moi à vous dire quel il est, parce qu'on ne se connaît pas soi-même, et qu'il est difficile de se bien juger; mais on peut reconnaître entre nous plusieurs points de différence. Mes gestes sont simples et modérés; d'un bout à l'autre de mon discours, je ne m'écarte guère de la ligne que je me suis tracée. Je mets plus de soin et d'étude que lui dans le choix des expressions et des pensées, de peur qu'un style trop négligé ne réponde pas à l'attente ou ne fixe pas l'attention de l'auditeur. Puisqu'il existe, même entre nous seulement qui sommes ici réunis, des différences si marquées, et que chacun de nous a des qualités qui lui sont particulières; puisque, dans cette diversité, c'est le degré et non le genre de talent qui détermine la supériorité, et que la perfection, dans quelque genre que ce soit, obtient toujours les suffrages, que serait-ce si nous voulions passer en revue tout ce qu'il y a eu d'hommes éloquents dans tous les pays et dans tous les siècles? ne trouverions-nous pas presque autant de genres d'éloquence que d'orateurs? Peut-être conclura-t-on de ce que je viens de dire, que s'il existe une multitude infinie de formes d'éloquence, toutes différentes les unes des autres, et toutes estimables en elles-mêmes, tant de manières diverses ne peuvent être assujetties aux mêmes règles, ni soumises à une seule théorie. Mais on serait dans l'erreur, et ceux qui se chargent de former des jeunes gens à l'éloquence doivent seulement examiner avec soin vers quel genre la nature porte plus spécialement chacun d'eux. Nous voyons, en effet, sortir des écoles de maîtres fameux et distingués chacun dans un genre particulier, des élèves qui, formés aux mêmes leçons, sans se ressembler aucunement entre eux, ont cependant beaucoup de mérite, parce que le maître a su accommoder ses leçons à la nature des talents. Pour nous borner à un seul art, Isocrate nous fournit ici un exemple remarquable. «J'emploie, disait cet illustre maître, l'aiguillon avec Éphore, et le frein avec Théopompe.» Dans celui-ci, en effet, il réprimait la surabondance trop hardie des mots; dans l'autre, il aiguillonnait une réserve trop timide. Il ne les rendit pas semblables l'un à l'autre; mais en donnant à l'un ce qui lui manquait, en élaguant ce que l'autre avait de trop, il parvint à amener chacun d'eux au genre de talent que sa nature comportait. X. J'ai dû commencer par ces réflexions, pour vous avertir que si les règles que je vais tracer ne se rapportent pas toutes et à votre goût particulier, et au genre d'éloquence que chacun de vous a choisi, elles me semblent du moins convenir à celui que j'ai cru devoir adopter. Après l'invention, dont Antoine nous a entretenus, viennent pour l'orateur l'action et l'élocution. Pour l'élocution (car je parlerai de l'action plus tard), les conditions principales ne sont-elles pas la pureté, la clarté, l'élégance, l'accord du style avec le sujet? Sans doute vous n'attendez pas de moi des préceptes sur les deux qualités que j'ai nommées les premières, la pureté et la clarté. Je n'entreprendrais pas de faire un orateur d'un homme qui ne saurait pas même s'exprimer; je ne pourrais espérer que celui qui ne connaït pas les principes de la langue, sût jamais la manier avec élégance, ni qu'il pût se faire admirer, lorsqu'il ne sait pas même se faire entendre. Laissons donc là ces deux points, qu'il est facile d'acquérir, indispensable de posséder. L'un fait l'objet des études de l'enfance, et s'enseigne dans les écoles; l'autre, qui a pour but de faire, comprendre ce qu'on dit, est d'une nécessité tellement absolue, qu'on ne saurait exiger moins. Je dirai seulement que si l'étude de la grammaire contribue à la correction du langage, on la perfectionne par la lecture des orateurs et des poètes. Nos anciens auteurs, qui ne pouvaient pas encore orner leur élocution, s'exprimaient du moins presque tous avec une pureté parfaite; et si l'on se nourrit de leur style, il sera impossible de parler d'une manière incorrecte. Il faudra cependant se garder des expressions déjà vieillies, à moins qu'on n'en puisse tirer quelque beauté; encore ne doit-on s'en servir qu'avec beaucoup de réserve, comme je le dirai bientôt. Parmi les termes que l'usage n'a pas bannis, on pourra en trouver d'heureux, et les employer avec succès, si l'on a fait une étude approfondie de ces anciens écrivains. XI. Pour parler purement, il ne suffit pas de se servir d'expressions d'une latinité incontestable, d'observer les cas, les temps, le genre et le nombre, de manière à ne blesser ni la régularité, ni la concordance, ni les rapports : il faut encore régler sa langue, sa respiration et le son de sa voix. Je ne veux pas qu'on prononce les mots d'une manière affectée, ni qu'on les laisse tomber négligemment; qu'ils s'échappent avec un ton grèle et mourant, ni qu'on les précipite en sons renflés et haletants. Je ne parle pas encore de la voix, comme faisant partie de l'action : je me borne en ce moment à ce qui regarde le discours même le plus familier. Il y a sur ce point des défauts si sensibles que tout le monde s'attache à les éviter; par exemple, un son de voix mou, comme celui d'une femme, ou bien faux et discordant. Mais il en est une autre dans lequel certains orateurs donnent à dessein : ils prennent un ton rustique et grossier, persuadés qu'ils imitent ainsi la gravité des anciens. Tel est L. Cotta, votre ami, Catulus : il affecte un son de voix rude, une prononciation pesante; il croit que ce ton lourd et agreste donne à ses discours un caractère antique. Au contraire, votre prononciation et votre douceur m'enchantent : je ne parle pas de celle du style, quelque importante qu'elle soit ; c'est une qualité que donne le goût, que dirige l'étude, que perfectionnent l'exercice et la lecture des modèles: je parle de la douceur de l'accent, qui ne se trouve qu'à Athènes chez les Grecs, qu'à Rome pour la langue latine. A Athènes dès longtemps toute vie littéraire a cessé pour les Athéniens; ce n'est plus qu'un séjour de savantes études, devenues indifférentes pour ses habitants eux-mêmes, mais à l'usage des étrangers, qu'attire la célébrité et le nom imposant de cette ville. Cependant l'Athénien le moins instruit l'emportera toujours sur le plus habile des orateurs asiatiques, non par l'élégance et la beauté du style, mais par la douceur et le charme de la prononciation. Il en est de même parmi nous. On étudie moins à Rome que chez les Latins; et pourtant le moins lettré d'entre nous, par la douceur de la voix, par le simple mouvement des lèvres et les sons qu'elles forment, sera bien supérieur à Q. Valérius de Sora, l'homme le plus savant de l'Italie. XII. Puisque les habitants de Rome ont un accent particulier qui les distingue, que cet accent n'a rien qui puisse choquer, surprendre ni déplaire, rien enfin qui sente l'étranger, cherchons à l'adopter, et fuyons avec un égal soin la dureté de l'accent de la campagne, et la prononciation étrangère de la province. Les femmes conservent mieux que nous la pureté de l'ancien accent; comme elles entendent moins parler, il leur est plus facile de garder leurs premières habitudes de langage. Aussi lorsque Lélia, ma belle-mère, ouvre la bouche, je crois entendre Névius ou Plaute; sa prononciation est simple, naturelle, sans affectation; l'imitation ne s'y fait pas sentir : je juge que son père et ses aïeux devaient s'exprimer ainsi; ce ton n'est ni dur, ni grossier, ni agreste, ni rude, comme celui que je blâmais tout à l'heure; mais net, égal, plein de douceur. Ainsi, Sulpicius, lorsque notre ami L. Cotta, dont vous prenez quelquefois la rudesse, fait disparaître les "I" et appuie si fort sur les "E", il n'imite pas l'accent des orateurs anciens, mais celui des paysans. Sulpicius s'étant mis à rire, Vous m'avez contraint de parler, dit Crassus, et je me venge en relevant vos défauts. - C'est ce que je désire, dit Sulpicius ; et si vous me donnez cette marque d'intérêt, il en est plus d'un dont j'espère me corriger aujourd'hui même. - Je ne saurais le faire qu'à mes dépens, reprit Crassus; car Antoine assure que vous me ressemblez beaucoup. - Il nous a conseillé, dit Sulpicius, d'imiter dans chaque orateur ce qu'il a de plus parfait ; et je crains de n'avoir pris de vous que quelques expressions, quelques gestes, et les coups de pied dont vous frappez la terre. - Je me garderai donc bien, poursuivit Crassus, de reprendre ce que vous tenez de moi; ce serait me tourner moi-même en ridicule. Mes défauts sont plus graves et en plus grand nombre que vous ne dites; mais si vous en avez que vous ne teniez que de vous-même, ou qu'un mauvais modèle vous ait fait contracter, je m'engage à vous en avertir, dès que j'en trouverai l'occasion. XIII. Passons donc sous silence la correction du langage; elle s'apprend par les premières études de l'enfance, on s'y fortifie par une connaissance approfondie et raisonnée de la grammaire, et même par l'exercice journalier de la conversation, enfin la lecture des poètes et des orateurs anciens nous y perfectionne. Ne nous arrêtons pas davantage sur les moyens d'acquérir cette clarté de style sans laquelle nous ne nous ferions pas comprendre. Ils consistent à n'employer que des termes corrects, usités, qui expriment bien ce qu'on veut énoncer; à éviter les mots ou les phrases amphibologiques, les périodes à perte de vue, les métaphores trop prolongées, les idées jetées sans liaison, la confusion de temps ou de personnes, et le défaut d'ordre et de symétrie. Est-il besoin d'en dire davantage? tout cela me semble la chose la plus facile, et je m'étonne souvent de voir des avocats s'exprimer d'une manière moins intelligible que ne le ferait le client, s'il plaidait lui-même. Voyez ceux qui viennent nous charger de leur cause : ils exposent presque toujours les faits avec une netteté qui ne laisse rien à désirer. Que Furius, ou votre ami Pomponius, viennent ensuite nous débiter les mêmes faits, j'ai besoin de toute mon attention pour comprendre ce qu'ils veulent dire ; leur discours n'est que confusion et désordre; rien n'y est à sa place; les expressions sont tellement extraordinaires, si irrégulièrement entassées, que le style, destiné à porter la lumière sur les faits, y répand l'obscurité et les ténèbres; il semble qu'ils se plaisent à s'étourdir eux-mêmes en parlant. Mais il est temps de mettre fin à des réflexions qui, j'en suis sûr, paraissent bien fastidieuses, surtout à ceux d'entre vous qui ont plus d'âge et d'expérience. Nous allons passer à d'autres, qui le seront peut-être davantage encore. XIV.- Vous voyez, en effet, dit Antoine, comme nous sommes distraits et inattentifs, comme nous vous écoutons à contre-coeur, nous qui abandonnerions volontiers toutes choses (j'en juge par moi) pour venir vous entendre, pour nous faire vos disciples : tant vous répandez de charme sur les matières les plus ingrates, de fécondité sur les plus stériles, de nouveauté sur les plus communes! - La pureté et la clarté dont je viens de parler, reprit Crassus, ou plutôt sur lesquelles je n'ai fait que passer légèrement, ne présentent rien que de facile ; mais les autres parties sont étendues, compliquées, variées, importantes; ce sont elles qui font admirer le génie, qui constituent la force de l'éloquence. On n'admire point un orateur, parce qu'il s'exprime correctement : s'il manquait à ce devoir indispensable, on se moquerait de lui, on ne le regarderait pas comme un orateur, pas même comme un homme. On n'a jamais non plus donné des éloges à un orateur, parce qu'il savait se faire entendre: le mépris serait le partage de celui qui n'aurait pas même ce faible mérite. Quel est donc l'homme qui frappe de surprise et de terreur ceux qui l'écoutent, qui leur arrache des cris d'admiration, qui présente à leurs esprits étonnés l'image d'un dieu parmi les mortels? C'est celui dont les pensées et les expressions se suivent avec ordre et netteté, celui dont le style élégant, riche, abondant, rappelle à l'oreille la cadence et l'harmonie des poètes : celui, en un mot, qui a ce que j'entends par une élocution ornée. Un tel homme, s'il sait d'ailleurs mesurer son langage d'après le rang des personnes et la dignité du sujet, aura de plus ce genre de talent que j'appelle mérite des convenances. Antoine prétend qu'il n'a pas encore rencontré de semblables orateurs, et que ceux-là pourtant mériteraient seuls le titre d'éloquents. Moquez-vous donc, croyez-moi, de ceux qui pour avoir suivi les leçons de ces hommes à qui l'on donne aujourd'hui le nom de rhéteurs, s'imaginent posséder ce qui fait l'orateur véritable, et en sont encore à comprendre les devoirs qu'impose un titre si beau, la grandeur et la dignité de leur profession. Puisque la vie humaine est la sphère où se meut l'orateur, la matière sur laquelle il a sans cesse à s'exercer, il n'est rien de tout ce qui s'y rattache qu'il ne doive avoir lu, entendu, médité, traité, discuté, approfondi. L'éloquence en effet est une vertu du premier ordre, et bien que toutes les vertus soient égales entre elles, il en est cependant qui ont plus d'éclat et de beauté que les autres. Telle est celle dont nous parlons, qui embrassant la vaste étendue des connaissances, exprime, interprète toutes tes pensées, tous les sentiments de l'âme, entraîne l'auditeur, et le fait mouvoir à son gré. Plus son pouvoir est grand, plus il faut aussi qu'elle soit unie à la probité, à la prudence instruire dans l'art de la parole des hommes dépourvus de ces vertus, ce n'est pas former des orateurs, c'est armer des furieux. XV. Cet art de penser et de s'exprimer, ce talent de la parole, les anciens Grecs l'appelaient du nom de sagesse. Elle fut le partage des Lycurgue, des Pittacus, des Solon, et parmi nous, des Coruncanius, des Fabius, des Caton, des Scipion, moins éclairés peut-être que les premiers, mais n'ayant pas moins de génie et se proposant le même but. D'autres hommes célèbres, doués des mêmes talents, mais dominés par d'autres goûts et préférant la douceur d'un tranquille repos, renoncèrent au gouvernement des États, pour se livrer tout entiers à la recherche de la vérité; tels furent Pythagore, Démocrite, Anaxagore. L'attrait de cette vie paisible, et le plaisir de savoir, ce doux charme de l'existence, ont, trop souvent pour le bonheur des peuples, entraîné les sages dans la retraite. Aussi, lorsque des génies supérieurs eurent consacré à la philosophie les longs loisirs d'une vie indépendante, exempts de tout autre soin, poussés par l'activité de leur imagination, ils multiplièrent leurs recherches, et dans leur ardeur curieuse, embrassèrent beaucoup plus d'objets qu'il n'était nécessaire. Dans les premiers temps, on ne séparait pas la science de bien dire de la science de bien faire, et le même maître, enseignait l'une et l'autre. C'est ainsi que Phénix dit dans Homère, que Pélée, père d'Achille, l'avait placé auprès de ce jeune héros, pour l'accompagner à la guerre, et le former à la fois à l'éloquence et aux belles actions. Mais comme les hommes accoutumés à un travail assidu et journalier, lorsque le mauvais temps les force à l'interrompre, s'amusent à jouer à la paume, aux dés, aux osselets, ou imaginent quelque autre distraction pour occuper leur loisir; de même les philosophes, débarrassés des travaux pénibles de l'administration, soit que les circonstances les en écartassent, ou que leur inclination leur fît préférer la retraite, s'adonnèrent, les uns à la poésie, les autres à la géométrie ou à la musique; d'autres, comme les dialecticiens, se créèrent une sorte de jeu nouveau dans une science de leur invention; et tous ils consumèrent leur vie entière dans la culture de ces arts, inventés seulement pour orner l'esprit des jeunes gens et les former à la vertu. XVl. On vit pourtant des hommes, et même en assez grand nombre, se faire un nom dans l'administration de l'État, en réunissant le talent d'agir et le talent de parler, qui doivent être inséparables; tels furent Thémistocle, Périclès, Théramène. D'autres, comme Thrasymaque, Gorgias, Isocrate, sans se livrer aux soins du gouvernement, enseignèrent cette double science. D'autres enfin, pleins de talent et de savoir, mais qu'une aversion prononcée écartait des affaires, se déclarèrent contre l'éloquence, et en firent l'objet de leur dérision et de leur mépris. Cette nouvelle secte eut Socrate pour chef, Socrate qui, par ses lumières et sa pénétration, par la grâce et la finesse de son esprit, par la variété et la fécondité de son éloquence, quelque sujet qu'embrassât son génie, fut proclamé sans égal au jugement de tous les hommes éclairés et de la Grèce entière. Ce fut lui qui, dans un temps où la connaissance et la pratique de tout ce qu'il y a de beau n'avaient qu'un seul nom, où les hommes qui traitaient des questions telles que celle qui nous occupe en ce moment, qui en faisaient l'objet de leurs discussions, de leur enseignement, étaient tous désignés sous le nom de philosophes, leur enleva ce titre qu'ils avaient possédé jusque-là; et par son ingénieuse dialectique, parvint à séparer deux choses essentiellement unies, la sagesse de la pensée et l'élégance du langage. Socrate n'a laissé aucun écrit; mais Platon, dans ses immortels ouvrages, a consacré à jamais le génie et les idées de son maître. C'est alors qu'éclata cette espèce de divorce entre la langue et le coeur, cette distinction fausse, dangereuse, condamnable, qui veut qu'il y ait un maître pour apprendre à bien penser, un autre pour apprendre à bien dire. Comme l'école de Socrate avait enfanté de nombreux disciples, et que parmi les diverses doctrines comprises dans son vaste enseignement chacun d'eux s'était attaché à un objet différent, on vit naître comme autant de familles distinctes, divisées d'opinions, et opposées les unes aux autres, quoique chacune se prétendit héritière du nom et des principes de son fondateur. XVII. Platon forma Aristote et Xénocrate : l'un fut le chef des péripatéticiens, l'autre donna à son école le nom d'académie. Antisthène, qui, dans les entretiens de son maître, s'était passionné surtout pour les leçons de patience et de fermeté, donna naissance à la secte des cyniques, et ensuite à celle des stoïciens. Aristippe, séduit par ses discours sur la volupté, enseigna la philosophie cyrénaïque, que lui et ses successeurs défendirent avec franchise, tandis que les philosophes de nos jours qui rapportent tout à la volupté, en affectant plus de pudeur, ne font pas encore assez pour la dignité humaine, qu'ils prétendent respecter, et soutiennent mal la cause de la volupté, dont ils se proclament les défenseurs. Il y eut encore d'autres écoles qui presque toutes se disaient sorties de Socrate : telles furent celles des Érétriens, des Hérilliens, des Mégariens, des Pyrrhoniens; mais il y a longtemps que les attaques et les raisonnements des premières les ont fait disparaître. Parmi les sectes qui subsistent encore, celle qui s'est faite l'apologiste de la volupté, en supposant que ses principes soient vrais, est bien loin de l'orateur que nous cherchons, et que nous voulons voir présider aux conseils publics, diriger les affaires, dominer par son ascendant et son éloquence, au sénat, au barreau, dans les assemblées du peuple. Et pourtant nous ne ferons aucun tort à cette philosophie; car nous ne la repousserons pas du but où elle aspire : elle pourra reposer à l'ombre de ses jardins délicieux, si chers à son indolence, où, de la couche voluptueuse qui la retient, elle cherche à nous détourner du barreau, de la tribune et du sénat; sage conseil peut-être, surtout dans le triste état où la république se trouve aujourd'hui réduite. Mais je ne cherche pas en ce moment quel est le système le plus vrai; je cherche celui qui convient le mieux à l'orateur. Écartons donc les disciples d'Épicure, mais doucement et sans les insulter : ce sont de bonnes gens, après tout, et ils sont heureux, puisqu'ils croient l'être. Engageons-les seulement à tenir bien cachée, comme les sacrés mystères, cette doctrine, quelque vraie qu'elle puisse être, que le sage ne doit pas s'occuper des affaires publiques; car s'ils parvenaient à nous la faire adopter, à nous et à tous les gens de bien, ils ne jouiraient pas longtemps de cette tranquillité qui a pour eux tant de charmes. XVIII. Quant aux stoïciens, je suis loin de désapprouver leurs maximes; pourtant je les écarte aussi, et je ne crains pas qu'ils s'en fàchent, car ils ignorent ce que c'est que la colère. Je leur sais gré d'être les seuls qui ne séparent pas l'éloquence de la sagesse et de la vertu. Mais il est deux choses en eux qui ne sauraient convenir à notre orateur : ils donnent à tous ceux qui ne pratiquent pas la sagesse les noms d'esclaves, de brigands, d'ennemis publics, d'insensés ; et ils ajoutent que personne n'est véritablement sage. Or, ce serait une étrange inconséquence, de confier le soin de haranguer le peuple, le sénat, ou toute autre assemblée, à celui qui serait persuadé que, dans son auditoire, il n'y a pas un homme raisonnable, pas un homme libre, pas un citoyen. De plus, leur élocution, souvent juste et précise, toujours ingénieuse, paraîtrait mesquine et bizarre dans la bouche de l'orateur; peu faite pour les oreilles du vulgaire, elle serait obscure, vide et maigre; en un mot, il n'y a pas moyen d'en faire usage auprès du peuple. Ils jugent des biens et des maux autrement que les autres citoyens, ou, pour mieux dire, autrement que tous les peuples du monde; ils voient d'un autre oeil la gloire, l'ignominie, les récompenses, les supplices. Ont-ils tort ou raison, peu importe quant à présent; mais, en suivant de telles maximes, on ne peut se flatter d'aucun succès dans l'éloquence. Restent les péripatéticiens et les académiciens. Ces derniers forment deux sectes sous le même nom : l'une reconnaît pour chefs Speusippe, fils d'une soeur de Platon; Xénocrate, disciple de ce grand homme; Polémon et Crantor, disciples de Xénocrate. Leurs principes ne diffèrent pas beaucoup de ceux d'Aristote, qui lui-même avait eu Platon pour maître; mais ils ont moins d'abondance et de variété que lui. Arcésilas, disciple de Polémon, puisa dans les livres de Platon et dans les discours de Socrate, cette opinion, que l'esprit ni les sens ne nous donnent aucune perception certaine; on dit qu'il avait une élocution pleine de charme, qu'il rejetait tout jugement de l'esprit et des sens, et que le premier il établit cette méthode, qui déjà pourtant avait été familière à Socrate, de s'attacher moins à démontrer son opinion, qu'à réfuter celle des autres. Il fonda la nouvelle académie, dans laquelle Carnéade se distingua par une vivacité de génie et une richesse d'expression admirables. J'ai connu à Athènes plusieurs personnes qui l'avaient entendu ; mais je me bornerai à vous citer deux témoins dignes de foi : Scévola, mon beau-père, lorsqu'il était jeune, suivit ses leçons à Rome; et mon illustre ami, Q. Metellus, fils de Lucius, m'a dit l'avoir aussi, dans sa jeunesse, entendu plusieurs jours à Athènes : il était alors très âgé. XIX. De même que les fleuves se partagent en tombant des sommets de l'Apennin, ainsi, nés aux communes hauteurs de la sagesse, les genres se séparèrent pour suivre des routes différentes : les philosophes descendirent mollement, comme au sein de la mer Ionienne, de cette mer Heureuse et sûre, qui baigne le beau rivage de la Grèce; les orateurs, au contraire, furent jetés sur les flots de la mer de Toscane, à travers les écueils et les périls où s'était égarée la prudence même d'Ulysse. Croire qu'il suffit à l'orateur de savoir nier ce qu'on objecte, ou, si cela est impossible, défendre la conduite de l'accusé; rejeter sa faute sur les torts d'un autre; montrer que son action est conforme aux lois, ou que du moins elle n'y est pas contraire; qu'elle est le résultat de l'erreur ou de la nécessité, et qu'elle ne mérite pas la dénomination qu'on lui donne; enfin que l'accusation n'est pas intentée selon les règles et les formes prescrites; borner ses obligations à connaître les principes qu'enseignent les rhéteurs, et qu'Antoine a développés avec plus d'élégance et de fécondité que ces prétendus maîtres de l'art; s'en tenir à cette doctrine, en y ajoutant même ce que vous avez désiré entendre de ma bouche, c'est renfermer l'éloquence dans un cercle bien étroit, c'est réduire une carrière immense à un bien petit espace. Mais si vous voulez suivre les traces de l'antique Périclès ou de ce Démosthène que le nombre de ses écrits nous a rendu plus familier, si votre coeur s'enflamme à la vue de ce brillant modèle, de cette image sublime de l'orateur parfait, il faut embrasser dans toute son étendue la doctrine de Carnéade ou celle d'Aristote. Avant Socrate, les anciens, comme je l'ai dit, unissaient à l'éloquence toutes les connaissances qui ont rapport aux moeurs, à la vie des hommes, à la vertu, à l'administration publique. Bientôt Socrate, et après lui tous ceux de son école, ayant, ainsi que je l'ai fait voir, séparé la sagesse de l'art du langage, les philosophes dédaignèrent l'éloquence, et les orateurs, la philosophie ; et il n'y eut plus de communication entre eux, si ce n'est lorsqu'ils eurent besoin d'emprunter les uns des autres ce qu'ils auraient puisé dans une source commune, s'ils avaient voulu maintenir leur association primitive. Mais de même que les anciens pontifes, accablés par la multitude des sacrifices, chargèrent trois prêtres de la direction des banquets sacrés, bien que dans l'institution de Numa ce soin dût faire partie de leur emploi; ainsi, quoique les anciens eussent réuni par une alliance admirable l'éloquence et la sagesse, les disciples de Socrate ont éloigné d'eux les orateurs, et les ont dépouillés du nom de philosophes, qui leur appartenait aussi bien qu'à eux-mêmes. XX. Maintenant je vous prierai de m'oublier un peu, et de ne pas croire que je veuille parler de moi, mais de l'orateur. En effet, si dès mes premières années, mon père m'a fait instruire avec le plus grand soin; si j'ai apporté au barreau le peu de dispositions naturelles que je me connais, et non celles que vous me supposez peut-être, je ne puis pas me flatter d'avoir appris ces choses dont je vais vous entretenir avec autant de soin que je recommanderai de le faire. J'ai commencé plus jeune que qui que ce soit à plaider des causes publiques : j'avais à peine vingt et un ans, que j'accusai un homme fameux par son éloquence et par l'éclat de son nom. Je n'ai eu d'autre école que le barreau, d'autres guides que l'expérience, nos lois, les institutions du peuple romain, les coutumes de nos ancêtres. Empressé de connaître la théorie de l'art qui nous occupe, j'ai à peine eu le temps de l'effleurer : ce fut pendant ma questure en Asie, où je trouvai le rhéteur académicien Métrodore, qui était à peu près de mon âge, et dont Antoine nous a cité la surprenante mémoire. J'étudiai ensuite à Athènes, à mon retour d'Asie, et j'y aurais fait un plus long séjour, si je ne m'étais pas brouillé avec les habitants de cette ville, parce qu'ils n'avaient voulu recommencer pour moi la célébration de leurs mystères, que j'avais manqué de deux jours. Ainsi, en exigeant cette étendue de lumières, cette multitude de connaissances, je suis bien loin de plaider ma cause; car il ne s'agit pas de ce que je possède moi-même, mais de ce que doit posséder l'orateur; je me fais au contraire mon procès, comme à tous ces petits rhéteurs, si ridicules avec leur étalage de préceptes sur les différents genres de causes, sur les exordes, sur les narrations. Le domaine de l'éloquence est bien autrement étendu : elle embrasse dans son cercle immense, les vertus, les devoirs, tout ce qui se rattache aux moeurs, à l'âme, à la vie des hommes; elle saisit et développe tous ces différents rapports dans leur origine, leur nature, leurs modifications; elle détermine les droits, la morale, les lois; elle préside au gouvernement des États, et quels que soient les objets auxquels elle s'applique, elle y répand le charme d'une diction riche et brillante. Pour moi, je n'ai pénétré dans cette science que jusqu'où m'a permis d'aller la médiocrité de mes talents et de mes lumières, jointe à l'expérience que j'ai pu acquérir; et cependant je ne craindrais pas de paraître trop inférieur dans la discussion à ceux qui ont fixé leur vie et comme posé leurs tentes dans la philosophie même. XXI. Quel argument pourrait employer mon ami C. Velléius, pour prouver que la volupté est le souverain bien, que je ne pusse, si je le voulais, soutenir ou réfuter avec plus d'abondance et d'éclat, à l'aide de ces lieux communs indiqués par Antoine, et de cette habitude de parler que n'a pas Velléius, et que chacun de nous possède? Et s'il s'agit de parler de la vertu, tout stoïciens qu'ils sont, Sext. Pompée, les deux Balbus, ou mon ami Vigellius, qui a vécu avec Panétius, montreront-ils une supériorité telle, que l'un de vous ou moi-même devions désespérer de les égaler? Il n'en est pas de la philosophie comme des autres sciences. Que dire sur la géométrie ou la musique, si on ne les a pas apprises? Il faut se taire, ou s'exposer à passer pour un insensé. Mais quant aux matières philosophiques, tout esprit vif et pénétrant peut y fouiller pour en tirer ce qu'elles ont de vraisemblable, et l'exprimer ensuite avec élégance, pour peu qu'il soit lui-même exercé à l'art de la parole. Sur de semblables sujets, un orateur ordinaire et médiocrement instruit, mais habitué à parler en public, confondra tous nos philosophes, et leur prouvera qu'il ne mérite pas leurs injurieux dédains. Mais s'il se rencontre un homme qui puisse, suivant la méthode d'Aristote, soutenir le pour et le contre sur toutes sortes de sujets, et, à l'aide de ses préceptes, prononcer dans la même cause deux plaidoyers contradictoires; s'il peut, à la manière d'Arcésilas et de Carnéade, combattre toute espèce de propositions, et qu'à ces avantages il joigne la connaissance de l'art oratoire, l'habitude et l'exercice de la parole, voilà le véritable, le parfait, le seul orateur; car sans la nerveuse éloquence du barreau, l'orateur n'aurait ni assez d'énergie, ni assez de véhémence; et sans cette variété de connaissances que donne la philosophie, il pourrait lui manquer quelque chose du côté de la culture et du savoir. Laissons donc votre Corax couver ses petits corbeaux dans son nid, jusqu'à ce qu'ils prennent leur volée pour nous fatiguer par leurs cris importuns; laissons je ne sais quel Pamphilus mener ses disciples à la lisière, et faire de l'éloquence un jouet d'enfants. Quant à nous, que les limites étroites de la discussion qui nous a occupés hier et aujourd'hui nous suffisent pour exposer tout ce qui se rattache à la profession de l'orateur, en faisant voir toutefois que nous y comprenons les connaissances contenues dans tous les livres des philosophes, et qu'aucun de ces déclamateurs n'a jamais abordées. XXII. - En vérité, dit Catulus, je ne m'étonne plus de remarquer à la fois dans vos discours tant de force, de douceur et d'abondance. J'attribuais aux seules inspirations de la nature ce talent qui vous faisait paraître à mes yeux, non seulement un orateur accompli, mais un homme plein de sagesse. Je comprends maintenant que c'est encore aux études philosophiques que vous avez attaché le plus d'importance, et que c'est à elles que vous devez cette richesse d'élocution. Cependant, quand je me rappelle toutes les époques de votre vie, et les occupations qui les ont remplies, je ne conçois pas comment vous avez eu le temps d'apprendre tant de choses; je n'imagine même pas que vous vous soyez beaucoup adonné à l'étude des livres ni aux leçons des maîtres : aussi je ne saurais dire ce qui m'étonne le plus, ou qu'au milieu de tant d'occupations vous ayez pu acquérir les connaissances dont vous m'avez démontré l'importance et l'utilité, ou que vous puissiez être si éloquent sans les avoir acquises. - Je vous prie d'abord d'être persuadé, répondit Crassus, que je parle de l'orateur, à peu près comme je pourrais le faire du comédien; car pour soutenir qu'un acteur ne peut exceller dans la déclamation, s'il ne s'est exercé à la gymnastique et à la danse, je n'ai pas besoin d'être acteur moi-même; il me suffit de savoir juger avec quelque discernement d'un art qui m'est étranger. C'est ainsi que, pour vous satisfaire, je vous donne mon opinion sur l'orateur : je veux dire, sur l'orateur parfait; car lorsqu'on veut raisonner sur un art ou talent quel qu'il soit, on le considère toujours dans son plus haut degré, dans sa perfection. Si donc vous jugez que je sois un orateur, un orateur passable, et même un bon orateur, j'y consens : aussi bien il y aurait de l'affectation de ma part à ne pas reconnaître que j'ai cette réputation; mais je suis bien éloigné d'être un orateur accompli. Eh ! qu'y a-t-il sur la terre de plus difficile, de plus élevé? quel art demande le secours d'un plus grand nombre de connaissances? Cependant, puisque vous voulez que je traite de l'orateur, il faut bien que ce soit de l'orateur accompli; car comment se faire une idée de la nature et de l'étendue d'un art, si on ne l'envisage dans toute sa perfection ? Pour moi, je l'avoue, Catulus, je n'ai actuellement aucun commerce avec ces philosophes, ni avec leurs écrits; et, comme vous l'avez fort bien observé, il n'y a eu dans ma vie aucune époque exclusivement réservée à l'étude; je n'ai pu y consacrerque les loisirs de ma première jeunesse, et les vacances du barreau. XXIII. Mais si vous me demandez, Catulus, mon sentiment sur la nécessité de toutes ces connaissances, voici quelle sera ma réponse. L'homme de quelque capacité, qui a en vue le forum, le sénat, la plaidoirie, les affaires publiques, n'a pas besoin pour les acquérir d'y consacrer autant de temps que l'ont pu faire ces philosophes que la mort a surpris au milieu de leurs études. Autre chose est, en effet, d'apprendre un art pour la pratique usuelle; autre chose d'en faire une étude de prédilection, une occupation exclusive. Ce maître des gladiateurs samnites a blanchi sous les armes, et sans cesse il médite sur son art; il n'a point d'autre occupation. Q. Vélocius s'était livré à la même étude dans sa jeunesse; mais, doué d'une rare aptitude, il en eut bientôt saisi tous les secrets, et fut, comme dit Lucilius, Un maître en l'art samnite, un rude champion : mais il donnait plus de temps encore au forum, à ses amis, à ses affaires particulières. Valérius passait sa vie à chanter : qu'aurait-il pu faire? il était acteur. Mais notre ami Numérius Furius ne chante que dans l'occasion : c'est un père de famille, un chevalier romain; il a, dans sa jeunesse, appris de la musique ce qu'il convient d'en apprendre. Il en est de même des études philosophiques, tout élevées qu'elles sont. Nous avons vu Q. Tubéron, un de nos Romains les plus distingués par ses lumières et sa vertu, passer les jours et les nuits à entendre les leçons d'un philosophe; mais son oncle, Scipion l'Africain, avait aussi commerce avec la philosophie, et ce commerce était presque inaperçu. Ces études sont faciles quand on se borne aux notions nécessaires, quand on a un bon maître pour vous les enseigner, et qu'on sait soi-même apprendre. Mais veut-on en faire l'unique occupation de sa vie, l'attention qu'on apporte à ces recherches fait naître chaque jour quelques questions nouvelles, et le plaisir de les résoudre charme la curiosité paresseuse de l'esprit. C'est ainsi qu'à mesure qu'on remue les questions on voit s'étendre à l'infini le domaine de la science. Que la pratique vienne à l'appui de la théorie, joignons-y un peu d'étude, et occupons sans relâche notre esprit et notre mémoire. Mais la soif d'apprendre est insatiable; par exemple, je puis désirer de savoir bien jouer aux osselets ou à la paume, même sans avoir l'adresse d'y réussir; d'autres, parce qu'ils y excellent, se livreront à ces puérilités avec une ardeur déraisonnable: ainsi, Titius se passionne pour la paume; Brulla, pour les osselets. N'allons donc pas nous faire une idée trop effrayante de la difficulté des arts, en voyant des vieillards étudier encore : ou ils ont commencé tard à s'y livrer, ou leur goût pour l'étude les y a retenus jusqu'à la vieillesse, ou ils y ont apporté une intelligence faible et bornée. A mon avis, ce qu'on n'apprend pas promptement, on ne l'apprend jamais bien. XXIV. - J'entends votre pensée, dit Catulus, et je suis de votre avis : je vois qu'avec votre conception vive et prompte, vous avez dû avoir assez de temps pour acquérir les connaissances dont vous parlez. - Ne cesserez-vous donc point, reprit Crassus, de m'appliquer à moi-même ce que je dis de l'orateur en général ? Mais, si vous le trouvez bon, je reviens à mon sujet. - Je ne demande pas mieux, répondit Catulus. - Quel peut avoir été mon but, continua Crassus, en m'étendant ainsi, et en reprenant les choses de si haut? Le voici : les deux parties dont il me reste à parler sont celles qui donnent de l'éclat au discours et mettent le comble à l'éloquence : l'un comprend les ornements; l'autre la convenance de la diction. Elles offrent les moyens les plus sûrs de plaire à l'auditeur, de pénétrer jusqu'au fond de son âme, et de donner du poids et de la substance au discours. La langue qu'on parle au barreau, dur et âpre instrument de chicane, empruntée aux idées de la multitude, est bien mesquine et bien pauvre. Ce qu'enseignent ces prétendus maîtres de l'art oratoire n'a guère plus d'élévation ni de grandeur que ce langage vulgaire de nos avocats. Nous, nous avons besoin d'apparat; il nous faut aller chercher, recueillir, amasser de toutes parts de précieuses richesses. C'est ce que vous aurez à faire dans un an, César; c'est ce que j'ai fait moi-même lorsque j'étais édile, dans la pensée que je ne pourrais pas satisfaire la curiosité du peuple, si je n'offrais à ses regards que des productions du pays, que des objets qu'il peut voir tous le jours. Pour le choix et l'arrangement des mots, pour la structure des phrases et des périodes, la méthode est facile, et, à défaut de méthode, l'exercice suffit. Mais le fond des choses est infini : ce fonds manquait déjà aux rhéteurs grecs de nos jours; aussi notre jeunesse désapprenait, pour ainsi dire, à leur école. Mais ce n'était pas assez; voilà que depuis deux ans nous voyons paraître des rhéteurs latins. J'avais fait fermer leurs écoles pendant ma censure, non pas, comme la malveillance s'est plu à le répandre, pour empêcher nos jeunes gens de cultiver leur esprit, mais au contraire pour prévenir les effets d'une instruction vicieuse, qui eût étouffé leur génie naturel en accroissant leur présomption. En effet, quelque insuffisantes que fussent les doctrines des Grecs, je voyais en eux, outre la facilité de la parole, de l'instruction et une certaine culture, qui pouvait être présentée comme modèle. Mais que pouvait-on gagner aux leçons de ces nouveaux docteurs, qu'une excessive confiance en soi-même, défaut insupportable, même lorsqu'il se trouve joint à des qualités réelles ? Comme c'était là tout ce qu'ils enseignaient, et qu'ils tenaient seulement école d'impudence, je crus qu'il était du devoir d'un censeur d'arrêter les progrès du mal. Ce n'est pas que je prétende qu'il faille désespérer de voir traiter avec succès en latin les matières dont il est en ce moment question. Ni la nature des choses, ni le génie de notre langue, ne s'opposent à ce que l'antique et exquise doctrine des Grecs ne soit appropriée à notre usage, à notre caractère; mais il faut pour cela des hommes de talent et de goût, et jusqu'à ce jour nous n'en avons point eu dans ce genre; s'il s'en présente, ils l'emporteront même sur les Grecs. XXV. Le premier ornement du style est dans son ensemble, dans sa couleur générale, et pour ainsi dire dans le fond de sa substance. S'il a de la noblesse, de la douceur, de la grâce; s'il est élégant et de bon goût; si au charme qui saisit, il joint, dans une juste mesure, la sensibilité et le pathétique: ces précieuses qualités ne sont pas le résultat des détails, mais de tout l'ensemble. Quant aux ornements qui résultent d'un certain éclat dans les expressions et les pensées, il ne faut pas les prodiguer partout également, mais les semer à propos, comme, dans la parure, l'art sait employer avec goût les fleurs et les diamants. Choisissons donc un genre de style qui captive l'auditeur, et qui non seulement lui plaise, mais lui plaise sans le fatiguer. Vous n'attendez pas de moi, sans doute, que je vous recommande d'éviter la sécheresse, la négligence, les expressions communes et surannées : je dois à des hommes de votre âge et de votre talent des observations d'un ordre plus élevé. Il est difficile d'expliquer pourquoi les objets qui nous frappent le plus agréablement au premier abord, et qui font naître en nous les sensations les plus vives, sont aussi ceux qui amènent le plus promptement le dégoût et la satiété. Combien, dans les peintures nouvelles, le coloris n'est-il pas plus éclatant, plus fleuri, plus varié que dans les anciennes? Cependant, après quelques moments de séduction, le charme a disparu, et notre oeil revient se fixer avec complaisance sur sur ces vieux tableaux dont il aime les teintes rembrunies et l'antiquité sévère. Les modulations cadencées, les brillants et capricieux artifices de la voix sont d'une mélodie beaucoup plus flatteuse qu'un chant exact et régulier. Et toutefois, non seulement les juges austères mais la multitude elle-même se récrie contre ces agréments, s'ils sont prodigués avec excès. La même remarque peut s'appliquer aux autres sens : l'odorat se lasse bientôt de parfums trop exquis et trop pénétrants, et savoure plus volontiers ceux qui ont moins de force; l'odeur de la cirenous parait meilleure que celle du safran. Le toucher même se fatiguerait de glisser toujours sur des surfaces polies et délicates. Enfin le goût, celui de nos sens qui perçoit le plus de jouissances, et qui se laisse le plus facilement séduire par l'attrait de la douceur, n'est-il pas prompt à la rejetter avec dédain quand elle est excessive? Pourrait-on supporter longtemps un aliment ou un breuvage trop doux? au contraire, ce qui ne flatte que modérément notre palais, est aussi ce qui échappe le plus facilement au dégoût. Si donc la satiété est toujours voisine du plaisir le plus vif, ne nous étonnons point que, soit chez les orateurs, soit chez les poëtes, en prose comme en vers, un style toujours brillant, toujours, poli, toujours paré, où tout est fleur et ornement, d'une perfection continue, sans mélange et sans variété, quel que soit d'ailleurs l'éclat du coloris, ne puisse pas nous charmer longtemps. XXVI. Ici même l'excès et la recherche nous choquent plus promptement encore : dans les impressions physiques, le dégoût des sens provient de la nature, la raison n'y est pour rien ; au lieu que dans les écrits et les discours, ce n'est pas l'oreille seule qui juge : c'est l'âme, c'est l'intelligence qui distingue l'affectation et les faux brillants. Qu'on s'écrie, en nous entendant, Bien, très bien; mais je ne voudrais pas qu'on répétât sans cesse, charmant, délicieux! J'aime, je l'avoue, à entendre souvent cette autre exclamation : On ne peut mieux! Cependant il faut laisser quelque relâche à l'admiration, et mettre adroitement des ombres au tableau, pour que les objets éclairés aient plus de relief et d'éclat. Roscius ne déploie pas toute son énergie en prononçant ce vers : Le prix de la vertu n'est point l'or, mais l'honneur. Il le laisse tomber en quel sorte; mais à celui-ci : Quoi! le fer à la main il envahit nos temples! Il éclate, il tressaille; il joue l'étonnement et l'horreur. Et quand Ésoptis dit : Où chercher un refuge? quelle douceur! quel abandon! quelle tranquillité! il amène ainsi, par le contraste, O mon père! ô Priam ! ô murs de ma patrie ! Il n'atteindrait pas, dans ce vers, à un si haut pathétique, s'il avait usé et épuisé ses forces, en disant ceux qui précèdent. Et c'est ce que les poètes et les musiciens ont senti avant les acteurs : les uns et les autres préludent d'un ton modeste; puis tour à tour l'élèvent, le rabaissent, lui donnent l'éclat, la variété, la modulation. Que l'orateur ait donc la grâce et la douceur, puisqu'il ne peut renoncer à plaire; mais que cette douceur soit mâle, sévère, et ne dégénère pas en mollesse et en fadeur. Ces préceptes ordinaires qu'on donne sur la manière d'orner le discours sont tels, que le plus mauvais orateur peut en présenter l'application. Nous, je le répète, commençons par amasser un ample fonds de choses et d'idées ; c'est ce qu'Antoine nous a développé. L'art façonnera ce fonds, en le répandant sur l'ensemble du discours; les expressions lui donneront l'éclat, et les pensées la variété. XXVII. Le comble et la perfection de l'éloquence, c'est d'employer à propos les richesses de l'amplification oratoire; ce qui consiste à agrandir et à relever les objets, comme à les atténuer et à les rabaisser. L'amplification est nécessaire toutes les fois que, pour convaincre, nous nous servons de ces lieux, dont Antoine nous a parlé, ou lorsque nous voulons éclaircir les faits, ou nous concilier les esprits, ou soulever les passions. Mais c'est dans ce dernier cas qu'elle a le plus de pouvoir, c'est là aussi le grand, le véritable triomphe de l'orateur. Un genre qui comporte encore plus l'éclat et la puissance de l'amplification, c'est celui qu'Antoine rejetait d'abord, et dont j'ai fini par donner les règles, je veux dire, le genre de l'éloge et du blâme. L'un et l'autre en effet, traités d'une manière large et complète, se prêtent merveilleusement à tous les développements, à toute la pompe de l'élocution. Viennent ensuite ces lieux, qui, bien que particuliers à chaque cause, et tenant au fond même de la discussion, se rattachent pourtant à des idées générales, et, pour cette raison, ont été appelés communs par les anciens. Quelquefois ce sont des plaintes ou de violentes invectives développées à grands traits, contre des vices ou des crimes qu'il n'est ni convenable ni possible de. justifier, tels que le péculat, la trahison, le parricide. On ne doit les employer qu'après avoir bien établi les faits; autrement ce ne seraient que de vaines et futiles déclamations. D'autres ont pour objet d'implorer la bienveillance, d'émouvoir la pitié; d'autres enfin, de soutenir le pour et le contre dans des propositions générales, dont la solution douteuse laisse beaucoup à dire de part et d'autre. Ce dernier genre d'exercice paraît maintenant appartenir surtout aux deux sectes de philosophie dont je vous ai parlé : chez les anciens, il était du ressort de ceux qui faisaient profession d'enseigner l'éloquence judiciaire. En effet, dans toutes les questions qui concernent la vertu, le devoir, le juste et le bien, la dignité, l'utilité, l'honneur, l'ignominie, les récompenses, les châtiments, et d'autres points semblables, l'orateur doit être en état de parler dans un sens ou dans le sens opposé avec chaleur, avec force, avec art. Mais puisque nous avons été dépossédés de notre légitime héritage, et relégués dans le petit domaine qu'on nous conteste encore; puisque, défenseurs du bien d'autrui, nous n'avons pu conserver le nôtre; c'est pour nous une triste nécessité d'emprunter ce qui nous manque aux indignes usurpateurs qui ont envahi notre patrimoine. [3,28] XXVIII. Voici donc ce que disent les Péripatéticiens et les Académiciens, ainsi nommés d'un petit quartier de la ville d'Athènes, mais dans des temps moins voisins du nôtre : leurs profondes connaissances dans les matières les plus importantes les avaient fait appeler par les Grecs Philosophes politiques; dénomination tirée de la science même des affaires publiques. Suivant leur système, tout discours politique roule, ou sur un fait particulier déterminé par les circonstances et les personnes; comme : «Devons-nous rendre à Carthage ses prisonniers, pour racheter les nôtres?» ou sur une question générale de principe ; par exemple : «Que doit-on statuer à l'égard des prisonniers de guerre?» Ces philosophes donnent le nom de causes ou controverses aux questions de la première classe; ils en forment trois genres, le judiciaire, le délibératif, et le démonstratif. Les propositions générales de la seconde classe sont désignées par eux sous le nom de consultations. Telle est la division qu'ils emploient encore aujourd'hui dans leurs leçons; mais cet enseignement n'est point pour eux un droit, une propriété, une ancienne possession qu'ils aient recouvrée après l'avoir perdue ; on voit que c'est, comme disent les jurisconsultes, une branche qu'ils ont rompue pour légitimer une usurpation. Ces questions de la première espèce, avec détermination de temps, de lieux et de personnes, malgré leurs prétentions, ne peuvent être réellement leur propriété, quoique Philon, aujourd'hui le plus renommé des Académiciens, à ce que j'entends dire, traite, dans son école, de la connaissance et de la pratique de ces sortes de discussions. Quant à celles de la seconde espèce, ils se contentent d'en faire mention dans les premiers éléments de l'art, et de les compter parmi les attributions de l'orateur; mais ils n'en exposent ni l'essence, ni la nature, ni les parties, ni les genres. Ils auraient mieux fait de n'en pas parler, que de les nommer pour n'en rien dire ; leur silence eût paru l'effet d'un jugement réfléchi, au lieu qu'on ne peut l'attribuer qu'à leur ignorance et à leur incapacité. XXIX. Tout sujet qui donne lieu à la discussion, conserve toujours sa nature douteuse, soit qu'il s'agisse de consultations indéterminées, soit qu'on s'occupe de causes en matière politique ou judiciaire; et il n'en est aucun qui n'ait rapport ou à la connaissance théorique des choses, ou à l'application et à la pratique. C'est la connaissance théorique qu'on a en vue quand on demande «s'il faut aimer la vertu pour elle-même, ou pour les avantages qu'elle procure:» c'est l'application pratique dans cette autre question «Le sage doit-il prendre part à l'administration des affaires publiques?» Il y a trois manières de traiter les questions de théorie, la conjecture, la définition, et ce que j'appellerai la conséquence. Veut-on vérifier l'existence d'un fait, on procède par la question conjecturale: «La sagesse existe-t-elle parmi les hommes?» Veut-on rechercher la nature d'une chose, comme : «Qu'est-ce que la sagesse?» on répond par une définition. Enfin on raisonne par conséquence, lorsqu'on examine ce qui résulte, ce qui découle de telle ou telle chose : «L'honnête homme peut-il quelquefois mentir?» Nos philosophes reviennent ensuite à la question conjecturale, qu'ils subdivisent en quatre espèces; car on peut considérer ce qu'est une chose en elle-même : «Les lois de la société sont-elles fondées sur la nature ou sur l'opinion?» ou rechercher son origine : «Qui a donné naissance aux lois et aux gouvernements?» ou la cause qui la produit : «Pourquoi les hommes éclairés ne sont-ils pas d'accord sur les points les plus importants?» ou enfin les changements qu'elle peut subir : «La vertu peut-elle s'éteindre dans le coeur de l'homme, ou se tourner en vice?» On procède par la définition dans les questions de ce genre, lorsqu'on examine quels sont les principes que la nature a comme gravés dans toutes les âmes. Ainsi: «Ce qui est utile au plus grand nombre est-il juste?» ou lorsqu'on cherche ce qui appartient en propre à une chose ou à une personne : «L'élégance du discours est-elle une propriété exclusive de l'orateur, et quelque autre ne peut-il y prétendre?» ou lorsqu'on divise un sujet en ses diverses parties : «Combien y a-t-il de choses désirables; et ne sont-elles pas de trois espèces, les biens du corps, ceux de l'âme, et ceux de la fortune?» enfin, lorsqu'on trace des caractères, des portraits particuliers; par exemple ceux « de l'avare, du séditieux, du glorieux.» Quant aux rapports de conséquence, deux sortes de questions se présentent. Ou la discussion est simple, comme dans cette question : «La gloire est-elle désirable?» ou elle a lieu par comparaison : «Que doit-on désirer le plus, de la « gloire ou des richesses?» La discussion simple se subdivise en trois espèces; on peut examiner les biens à désirer ou les maux à éviter : «Faut-il rechercher les honneurs? faut-il fuir la pauvreté?» le juste ou l'injuste : «Est-il juste de venger les injures de ses proches?» l'honnête ou le honteux : «Est-il bien d'affronter la mort par amour pour la gloire? » Il y a deux sortes de comparaisons : dans l'une, on recherche en quoi deux choses se ressemblent ou diffèrent, comme une crainte servile et une crainte respectueuse, un roi et un tyran, un flatteur et un ami; dans la seconde, on examine laquelle des deux est préférable à l'autre. Par exemple : «Le sage doit-il régler sa conduite sur les opinions des hommes éclairés, ou sur les applaudissements du vulgaire?» Telles sont à peu près les divisions établies par les savants dans les questions de théorie. XXX. Dans celles qui se rapportent à la pratique, la discussion roule sur le devoir, sur ce qui est bien, sur ce qu'on doit faire; et elles embrassent ainsi tout l'ensemble des vertus et des vices; ou bien il s'agit de quelque passion à soulever, à calmer, à éteindre. Ce genre renferme les exhortations, les consolations, les plaintes qui surprennent la pitié; enfin tout ce qui peut exciter ou apaiser, selon la circonstance, quelque émotion de l'âme. Voilà l'exposition détaillée des genres et des modes de discussions. Vous trouvez peut-être quelque différence entre mes divisions et celles d'Antoine; mais cette différence importe peu : nos deux systèmes sont formés des mêmes éléments distribués dans un autre ordre. Il est temps de voir la suite, et d'achever la tâche que vous m'avez imposée. Ces lieux communs, dont Antoine a développé la théorie, sont une mine féconde d'arguments pour toutes sortes de sujets; il en est cependant qui conviennent mieux à un genre qu'à un autre; c'est ce qu'il est inutile d'expliquer, non parce que cette question nous mènerait trop loin, mais parce que la solution en est évidente. Les discours les plus susceptibles des ornements de l'éloquence sont donc ceux où l'orateur, embrassant un champ plus vaste, et ramenant les questions particulières et personnelles au développement d'une proposition générale, donne à l'auditeur une connaissance approfondie de la nature, du genre et de l'étendue du sujet, et le met ainsi en état de prononcer sur les circonstances particulières à l'accusé, à l'accusation, ou à la cause. Jeunes gens qui m'écoutez, c'est cet exercice qu'Antoine vous a recommandé, en vous exhortant à franchir l'étroite enceinte des contestations ordinaires pour vous lancer, libres d'entraves, dans l'immense carrière des propositions générales. Mais pour cela il ne suffit pas de la lecture d'un petit nombre de traités, comme se l'imaginent les rhéteurs; il ne suffit pas d'une conversation à Tusculum, ou d'une promenade comme celle de ce matin, ou d'un entretien tel que celui qui nous a réunis cette après-midi. Non, ce n'est pas assez d'aiguiser, de façonner sa langue à la parole; il faut encore, il faut remplir et orner son coeur d'un fonds inépuisable de connaissances agréables, riches et variées. XXXI. En effet, reconnaissons nos droits si nous sommes orateurs et défenseurs des intérêts des citoyens; si, dans les délibérations et les dangers publics, nos lumières sont consultées, et nos avis font loi; c'est à nous qu'appartient tout ce vaste domaine de savoir et de doctrine que des discoureurs oisifs, profitant de la multitude de nos occupations, ont envahies comme une propriété abandonnée et sans maître. Ils tournent même l'orateur en ridicule, comme Socrate dans le Gorgias; ou bien ils écrivent sur notre art quelques traités, qu'ils intitulent De l'Art oratoire: comme si tout ce qu'ils enseignent sur la justice, le devoir, sur la fondation ou le gouvernement des États, sur la morale, et même sur les principes de la nature, n'appartenait pas également à l'orateur. Mais puisque nous ne pourrions le trouver ailleurs, allons reprendre notre bien chez ceux mêmes qui nous en ont dépossédés; reprenons-le pour en appliquer l'usage à la science politique, à la science des affaires, à laquelle toutes ces belles théories se rapportent et se rattachent, et n'allons pas, je le répète, consumer notre vie à feuilleter les livres; mais, après avoir découvert ces sources que nous ne connaîtrons jamais bien, s'il nous faut beaucoup de temps pour les connaître, puisons-y autant que nous en aurons besoin. Si l'intelligence humaine ne peut arriver à de telles découvertes sans qu'on lui montre la voie, il n'y a pas là non plus de mystère si obscur qu'un esprit pénétrant ne puisse percer une fois que ses regards s'y seront portés. L'orateur peut donc courir en liberté dans cette immense carrière; et comme partout où il s'arrêtera, il sera sur son propre terrain, il ne sera pas embarrassé d'y trouver toutes les richesses oratoires et tout l'appareil du discours : car l'abondance des choses et des idées produit l'abondance des mots; et s'il y a de l'élévation et de la noblesse dans les choses, leur éclat rejaillira sur l'expression. Que celui qui veut parler ou écrire ait reçu des ses premières années une instruction suffisante, une éducation libérale; qu'il joigne à la passion de l'étude les ressources d'un heureux naturel; qu'il se soit exercé dans le vaste domaine des questions générales, et qu'il ait formé son esprit par la lecture et l'imitation des grands modèles : il n'aura pas besoin d'aller apprendre chez les rhéteurs la construction des périodes, ou l'emploi des figures; et, dans la riche abondance de ses idées, il trouvera sous sa main, sans effort, et sans autre guide qu'une nature exercée, tous les trésors de l'éloquence. XXXII. - Dieux immortels! s'écria Catulus, quelle immense et brillante carrière vous venez, Crassus, d'ouvrir à l'orateur, et comme vous l'avez hardiment tiré de son étroite prison, pour le rétablir dans le noble empire de ses ancêtres. Nous savons, en effet, que ceux qui furent les premiers maîtres et comme les inventeurs de l'art de la parole, regardaient comme leur patrimoine tout ce qui pouvait être discuté, et faisaient profession de traiter toutes sortes de sujets. Un de ces maîtres d'éloquence, Hippias d'Élis, assistant à la solennité de ces jeux qui se célèbrent tous les cinq ans avec tant de pompe à Olympie, se vantait, en présence de presque toute la Grèce, de n'ignorer aucun art, aucune science, de quelque nature qu'elle fût : non seulement il possédait, disait-il, les connaissances les plus nobles et les plus élevées, la géométrie, la musique, la littérature, la poésie, les sciences naturelles, la morale, la politique; mais il avait fait de sa propre main la chaussure qui recouvrait ses jambes, l'habit dont il était vêtu, l'anneau qu'il portait au doigt. Sans doute, il allait trop loin; mais on peut juger par là combien ces anciens orateurs étaient passionnés pour les arts qui ornent et élèvent l'esprit, puisqu'ils ne dédaignaient pas même les connaissances vulgaires de l'artisan. Que dirai-je de Prodicus de Céos, de Thrasymaque de Chalcédoine, de Protagoras d'Abdère, qui, dans ces siècles reculés, ont tant disserté, tant écrit, même sur les sciences naturelles? Voyez encore: ce Gorgias le Léontin, que Platon, dans un de ses dialogues, se fait un plaisir d'opposer à un philosophe, pour donner la victoire à ce dernier. Mais non, il ne fut pas vaincu par Socrate, et le dialogue de Platon n'est qu'une fiction; ou, s'il le fut, il faudrait dire que Socrate avait une éloquence encore plus facile, et, comme vous le dites, était plus fécond et plus habile orateur. Cependant Gorgias, dans ce dialogue même, offre de développer toutes les matières, toutes les questions qu'on pourra proposer; et il est le premier qui ait osé, dans une assemblée, demander sur quel sujet on voulait l'entendre. Aussi la Grèce lui rendit-elle tant d'honneur, que, seul de tous, il eut à Delphes une statue non pas dorée, mais d'or massif. Ceux que je viens de nommer, et beaucoup d'autres maîtres illustres dans l'art de la parole, appartiennent tous à la même époque; d'où l'on peut conclure, Crassus, que vous avez raison, et que dans l'ancienne Grèce la profession de l'orateur embrassait une plus grande étendue de connaissances, et était entourée de plus gloire. Aussi me demandai-je si vous ne méritez pas encore plus d'éloges que les Grecs de nos jours ne méritent de blâme. Né dans un pays différent du leur par les moeurs et le langage, jeté au milieu du mouvement de Rome, et du tourbillon des affaires, partagé entre les soins qu'imposent une innombrable clientèle, l'administration d'un grand empire et le gouvernement du monde entier, vous avez pu cependant embrasser de si vastes connaissances, et les allier aux talents de l'homme d'État et de l'orateur; tandis que ces Grecs, élevés au sein des lettres, passionnés pour ces études, et jouissant d'un profond loisir, non seulement n'ont pas accru, mais n'ont pas même su conserver intact l'héritage qu'on leur avait transmis. XXXIII. - L'éloquence, reprit Crassus, n'est pas le seul art qui ait perdu de sa grandeur par la division et la séparation de ses parties ; il en est de même de beaucoup d'autres. Pensez-vous que, du temps d'Hippocrate de Cos, il y eût des médecins pour les maladies intérieures, d'autres pour les plaies du corps, d'autres pour les ophtalmies? Quand Euclide et Archimède cultivaient la géométrie; Damon et Aristoxène, la musique; Aristophane et Callimaque, la littérature: ces connaissances étaient-elles tellement morcelées qu'un seul homme n'embrassât dans son entier chacune d'elles, et qu'on se bornât à en choisir une partie pour s'y livrer exclusivement? Pour moi, j'ai souvent entendu dire à mon père et à mon beau-père, que ceux de nos Romains qui aspiraient au titre glorieux de sages, réunissaient dans leurs études toutes les connaissances alors répandues dans Rome. Tous deux se souvenaient d'avoir vu Sext. Élius; et nous-mêmes nous avons vu M. Manilius se promener de long en large dans le Forum, ce qui était une manière d'indiquer à ses concitoyens qu'on était prêt à leur donner toutes sortes de conseils; et soit qu'ils se montrassent ainsi en public, soit qu'ils se tinssent chez eux sur leur siège de jurisconsultes, on allait les trouver pour les consulter non seulement sur quelque point du droit civil, mais sur l'établissement d'une fille, sur l'acquisition d'un domaine, sur la culture d'une terre, enfin sur toute espèce d'affaire ou de devoir. Tels furent encore P. Crassus le vieux, Tib. Coruncanius, et le sage Scipion, le bisaïeul de mon gendre, qui tous ont été souverains pontifes, et dont la savante expérience était consultée sur toutes les choses divines et humaines : lumières de la patrie au sénat et à la tribune, soutiens de leurs amis au barreau, en paix comme en guerre, ils étaient là pour donner à tous le secours fidèle de leurs conseils. Caton n'avait pas, il est vrai, cette fleur de politesse et de savoir, production d'outre-mer, née sur un sol étranger; mais d'ailleurs que lui manquait-il? la science du droit civil excluait-elle en lui l'éloquence du barreau? ou son éloquence lui faisait-elle négliger la connaissance des lois? Il cultiva l'une et l'autre avec une égale ardeur et un égal succès. La popularité qu'il acquit en défendant les intérêts des particuliers diminua-t-elle en rien son zèle pour les affaires publiques? Personne ne jouit auprès du peuple d'un crédit plus assuré, personne ne fut meilleur sénateur, sans compter que c'était aussi un excellent général ; enfin, tout ce qu'à cette époque on pouvait apprendre et savoir, il l'apprit, il le sut, et même le consigna dans des écrits. Aujourd'hui la plupart de ceux qui aspirent aux honneurs et aux emplois publics, se présentent pour ainsi dire nus et sans armes; les connaissances, l'instruction, les études leur manquent. S'il s'en rencontre un qui se distingue dans le nombre, tout au plus pourra-t-il se prévaloir d'un seul genre de mérite : ce sera tantôt la bravoure du soldat, ou quelque pratique de l'art militaire; encore ces qualités ont-elles beaucoup perdu de notre temps ou bien ce sera la science du droit, science restreinte et incomplète, puisque personne n'apprend plus le droit pontifical, qui devrait en faire nécessairement partie; ou enfin ce sera l'éloquence, et ils la font consister dans de grands éclats de voix et des paroles jetées avec volubilité. Mais on n'a plus aucune idée de cette alliance, de cette parenté, qui unit toutes les belles connaissances, tous les talents, ainsi que toutes les vertus même. XXXIV. Mais je reviens aux Grecs, dont nous ne pouvons nous passer dans cet entretien; car c'est parmi eux qu'il faut chercher les modèles de la science, comme ceux de la vertu chez nos Romains. La Grèce reconnut et compta dans le même temps sept sages, qui tous gouvernèrent leur patrie, si l'on en excepte Thalès de Milet. Peut-on citer à cette époque un homme plus éclairé que Pisistrate, et dont l'éloquence fût plus nourrie d'instruction? Ce fut lui, dit-on, qui rassembla le premier les poèmes d'Homère épars et sans suite, et les disposa dans l'ordre où nous les voyons aujourd'hui : citoyen, il n'a pas bien mérité de son pays; orateur, il eut la supériorité du génie et des lumières. Et Périclès, ne connaît-on pas les merveilles de son éloquence? Lorsqu'en s'opposant aux volontés des Athéniens, sa voix, animée par l'intérêt de la patrie, prenait le ton sévère de la réprimande, elle savait rendre agréables et populaires les traits qu'elle lançait contre des hommes environnés de la faveur du peuple. L'ancienne comédie, tout en profitant de la licence du théâtre pour l'immoler à sa malignité, avouait que les Grâces habitaient sur ses lèvres, et que l'énergie de ses discours laissait l'aiguillon enfoncé dans l'âme des auditeurs. Aussi n'avait-il pas eu pour maître un de ces déclamateurs qui euseignent à criailler à la clepsydre, mais Anaxagore de Clazomène, mais un sage qui excellait dans les plus sublimes connaissances : par son savoir, par sa sagesse et son éloquence, il gouverna pendant quarante ans les Athéniens dans la guerre et dans la paix. Et Critias, et Alcibiade! Leur patrie ne reçut peut-être pas d'eux de bons services; mais ils réunissaient l'instruction à l'éloquence; et où avaient-ils puisé l'une et l'autre, si ce n'est dans les entretiens de Socrate? Quel maître instruisit Dion de Syracuse dans tous les genres de connaissances? n'est-ce pas Platon? n'est-ce pas ce philosophe qui forma sa bouche à l'éloquence, et son âme à la vertu; qui l'inspira, le dirigea, l'arma pour délivrer sa patrie? L'instruction que Dion reçut de lui était-elle différente de celle qui fut donnée par Isocrate à Timothée, fils du célèbre général Conon, grand capitaine lui-même, et en même temps homme très éclairé; par Lysis, pythagoricien, au Thébain Épaminondas, le plus grand homme peut-être de toute la Grèce; par Xénophon, à Agésilas; par Philolaüs à Archytas de Tarente; enfin, par Pythagore lui-même, à toute cette partie de l'Italie qui fut autrefois appelée la Grande-Grèce? Certes, je ne le pense pas. XXXV. Je vois, en effet, qu'il y avait un ensemble d'instruction et de connaissance convenant également à l'homme qui ne désirait qu'orner son esprit, et à l'homme qui voulait s'élever dans les emplois publics. Ceux qui à cette instruction joignaient le talent nécessaire pour la faire valoir, et qui appliquaient à l'art oratoire d'heureuses dispositions naturelles, ceux-là excellaient dans l'éloquence. Aristote lui-même, témoin du succès d'Isocrate, qui avait fait fleurir son école, et s'était entouré des disciples les plus distingués, en abandonnant dans ses leçons les discussions judiciaires et politiques pour d'oisives et d'élégantes dissertations, changea tout à coup presque entièrement la méthode d'enseignement qu'il avait suivie jusque-là; et il s'appliqua un vers de Philoctète, en y faisant un léger changement. Philoctète dit qu'il a honte de se taire, et de laisser parler les barbares; Aristote disait, et de laisser parler Isocrate. Il para, il embellit toute cette doctrine, et joignit aux études oratoires la connaissance des choses. Son mérite n'échappa point aux yeux éclairés du sage roi Philippe, qui le donna pour instituteur à son fils Alexandre, afin que ce jeune prince apprît à la fois d'un si bon maître la science de bien faire et celle de bien dire. Qu'on donne maintenant, si l'on veut, le nom d'orateur au philosophe qui sait exprimer éloquemment de belles pensées, j'y consens; ou, si on l'aime mieux, qu'on appelle philosophe l'orateur qui réunit à l'éloquence la sagesse et le savoir, j'y consens encore; pourvu qu'il soit bien reconnu que la science impuissante à exprimer ses idées, n'est pas plus à louer que la facilité de parler, dépourvue de toutes connaissances : encore aimerais-je mieux, s'il fallait choisir, les lumières sans l'élocution, que l'élocution avec l'ignorance et la sottise. Mais cherchons-nous quel est celui qui doit emporter la palme ? c'est sans contredit l'orateur qui est en même temps homme instruit: qu'on lui permette encore d'être philosophe, il n'y a plus lieu à discuter. Si l'on veut, au contraire, séparer le philosophe et l'orateur, celui-ci aura l'avantage, parce que l'éloquence dans sa perfection suppose nécessairement les connaissances du philosophe, tandis que la philosophie n'a point pour compagne indispensable l'éloquence. Elle a beau la mépriser; il est un complément qu'elle ne peut recevoir que de l'éloquence seule. Ici, Crassus se tut un instant, et tout le monde garda le silence. XXXVI. Cotta le rompit le premier. En vérité, Crassus, je n'ai pas à me plaindre de cette digression qui vous a fait perdre de vue la question première; car vous avez donné plus que vous n'aviez promis, et outrepassé votre tâche; mais rappelez-vous votre obligation d'indiquer les moyens d'embellir le discours. Déjà même vous étiez entré dans le sujet, et vous aviez fixé à quatre les qualités du style. Ne parlons plus des deux premières, que vous avez, dites-vous, l'égèrement effleurées, mais, à notre avis, suffisamment approfondies : il vous reste à traiter des deux autres; l'ornement du discours, et sa convenance au sujet. Vous alliez y venir, lorsque l'élan de votre imagination, comme un flot impétueux, vous a lancé dans la haute mer, et vous a dérobé à nos faibles regards dans un horizon sans bornes. Vous avez parcouru tout le cercle des connaissances humaines, et vous n'avez pu sans doute, dans un entretien si court, en développer à fond la théorie; mais pour moi du moins, sans connaître encore l'effet de votre discours sur vos auditeurs, je vous dirai qu'il a tourné toutes mes idées vers les leçons de l'Académie; je veux les suivre, en souhaitant, comme vous l'avez dit souvent, qu'il ne soit pas nécessaire d'y consumer toute sa vie, et qu'il suffise d'un coup d'oeil rapide pour en pénétrer tous les secrets. Mais quand même ils auraient encore plus d'obscurité, quand je me sentirais mal secondé par mon intelligence, je ne me découragerai pas, et je suis décidé à ne prendre ni repos, ni relâche, que je ne me sois formé par cette méthode à soutenir le pour et le contre dans toutes les questions. - Une chose, dit César, m'a principalement frappé, Crassus, dans votre discours. Vous assurez que l'homme qui n'apprend pas promptement, n'apprendra jamais. Il doit donc m'en coûter peu de faire l'essai; car, ou je posséderai bientôt ces connaissances dont vous faites un si magnifique éloge; ou, si je ne puis y réussir, je ne m'obstinerai pas à perdre mon temps, puisque nos simples connaissances peuvent au fond nous suffire. - Quant à moi, dit, Sulpicius, je n'ai besoin, ni d'Aristote, ni de Carnéade, ni d'aucun autre philosophe : attribuez, si vous voulez, cette indifférence au peu d'espoir que j'ai de profiter de leurs leçons, ou, ce qui est plus vrai, au peu de cas que j'en fais. La science ordinaire du barreau et la pratique des affaires me suffisent pour arriver au degré d'éloquence que j'ambitionne, et encore me reste-t-il, dans ce genre même, beaucoup de choses à savoir; mais j'attends, pour les étudier, que les causes dont je puis être chargé m'y contraignent. Ainsi donc, Crassus, si vous n'êtes point fatigué, ou si nous ne sommes point trop importuns, revenez à votre sujet, et développez-nous les moyens de donner au style de l'éclat et de la beauté. Quand j'ai désiré vous entendre, c'était pour acquérir quelque instruction nouvelle, et non pour désespérer d'être jamais éloquent. XXXVII. - Vous me demandez, reprit Crassus, des choses que tout le monde sait, et que vous ne pouvez ignorer vous-même. Quel rhéteur ne les a pas développées dans ces leçons ou dans ses ouvrages? J'obéirai pourtant, et je vous exposerai en peu de mots mes idées à ce sujet, tout en vous conseillant de recourir aux auteurs et aux inventeurs des règles, quelque minutieuses qu'elles puissent être. Tout discours est composé de mots que nous devons considérer d'abord en eux-mêmes, puis dans leur rapport avec la phrase. Il y a en effet une sorte d'ornement qui consiste dans les mots pris isolément, et une autre qui résulte de leur ensemble et de leur liaison. Nous emploierons donc les mots propres qui désignent simplement les choses, et qui sont pour ainsi dire, nés en même temps qu'elles; les mots figurés qui sont comme transportés à une autre signification; enfin les mots nouveaux que nous créons et inventons nous-mêmes. S'agit-il des mots propres? le mérite de l'orateur est d'éviter les expressions triviales et hors d'usage, pour n'employer que des termes nobles et choisis dont l'harmonie soit pleine et sonore. Il faut encore faire un choix parmi ceux-ci; l'oreille sert de guide à cet égard; l'habitude de bien parler est aussi d'un grand secours. Les ignorants disent souvent des orateurs: Celui-ci s'exprime en bons termes; celui-là ne s'exprime pas en bons termes. Ils n'en jugent pas d'après les règles, mais d'après un certain sentiment naturel. II n'y a pas une grande gloire à éviter l'impropriété des termes (quoique ce soit cependant un point important), mais l'usage habituel et facile des expressions justes fait en quelque sorte la base et le fondement de tout l'édifice. Quel est cet édifice bâti par l'orateur, quels sont les embellissements que son art y ajoute? c'est là ce que je dois chercher et expliquer. XXXVIII. Les mots simples ou isolés que l'orateur emploie pour orner le discours, sont donc de trois espèces : ceux qui sortent du langage commun, ceux qu'il crée lui-même, ceux qui sont figurés. Les premiers sont les mots anciens, vieillis, et bannis depuis longtemps de l'usage habituel : on les permet plutôt aux poètes, qui peuvent prendre plus de licence que nous. Cependant une expression poétique relève quelquefois la dignité du discours, et je ne me ferais pas scrupule de dire avec Célius : Qua tempestate Poenus in Italiam venit; d'employer les mots de proles, soboles, effiari, nuncupari; ou de dire comme vous, Catulus : Non rebar, non opinabar. Les expressions semblables, hasardées à propos, impriment au style un caractère de grandeur et d'antiquité. Les mots nouveaux sont de deux sortes. Ou l'orateur les forme par la réunion de plusieurs mots :
Tum pavor
sapientiam mihi omnem exanimato expectorat. Vous voyez que versutiloquas et expectorat sont des mots composés de deux autres, et non créés par le poète; ou bien l'orateur les invente lui-même, comme : Ille senius; dii genitales; baccarum ubertate incurvescere. Quant aux expressions figurées, le domaine en est trèsétendu. D'abord le besoin, la pauvreté et l'insuffisance du langage, leur donnèrent naissance; bientôt le plaisir et l'agrément les consacrèrent. Il en fut comme des vêtements, que l'homme imagina d'abord pour se défendre contre la rigueur des saisons, et qu'ensuite l'opulence fit servir à sa parure: ainsi la nécessité produisit les figures, et le goût en répandit l'usage. Aujourd'hui on entend dire, même dans les champs : l'œil de la vigne, le luxe des herbes, de riantes moissons. Quand nous ne trouvons point de mot propre qui soit la fidèle expression de notre idée, nous employons un tour métaphorique, et la comparaison avec l'objet dont la métaphore est tirée fait mieux ressortir la pensée. Ainsi, parmi les métaphores, les unes sont comme des espèces d'emprunts par lesquels nous allons chercher ailleurs ce qui nous manque. D'autres, plus hardies, ne sont pas des signes d'indigence, mais répandent de l'éclat sur le style. Ai-je besoin d'en exposer ici les divers genres, et d'indiquer les moyens de les trouver? XXXIX. La métaphore est une comparaison abrégée, et renfermée dans un mot mis à la place d'un autre : si la ressemblance est exacte, elle fait plaisir; si elle ne l'est pas, l'esprit la repoussera; mais il faut que toute expression métaphorique fasse mieux ressortir la pensée, comme dans cet exemple :
Une
effroyable nuit sur les eaux répandue Le poète a employé presque partout des expressions figurées, qui rendent plus sensibles, au moyen de la comparaison, les objets qu'il décrit. La métaphore exprime aussi avec plus de force un fait ou une intention. C'est ainsi que par deux expressions figurées, un ancien poète nous peint heureusement un homme qui mettait de l'obscurité dans ses discours, pour ne point laisser pénétrer ses desseins : Ses discours sont le voile où se cache sa vie. Souvent même la métaphore est un moyen d'atteindre la concision, comme, si le trait fuit de sa main. Plusieurs mots propres ne pourraient pas rendre d'une manière plus vive que ne le fait une seule expression figurée, l'inattention de celui qui laisse échapper un trait sans le vouloir. XL. Et à ce sujet, je me suis souvent demandé avec étonnement, pourquoi les expressions figurées plaisent toujours plus que les mots propres et simples. Si l'objet n'a pas de dénomination qui lui soit spécialement assignée, comme le pied dans un navire, le lien d'une obligation, le divorce avec une femme, l'emprunt devient indispensable; il faut chercher ailleurs ce qui nous manque; mais lors même que la langue fournit une foule de termes propres, on préfère de beaucoup les expressions figurées, pourvu qu'elles soient choisies avec goût. En voici, je crois, la raison. Il semble d'abord que ce soit faire preuve d'imagination que de dédaigner ce qu'on a devant soi et à ses pieds, pour aller chercher au loin quelque chose de moins commun. On fait voyager ainsi la pensée de l'auditeur, sans l'égarer, et c'est un plaisir qui le charme. En outre, nous aimons à trouver réunis dans un seul mot l'objet et son image. Enfin, toute métaphore, pourvu du moins qu'elle soit juste, s'adresse à nos sens, et principalement à celui de la vue, le plus actif de tous. Ces expressions, ce parfum de l'urbanité, le poli des manières, le murmure des eaux, la douceur du style, s'adresse à nos autres sens; mais les métaphores qui parlent aux yeux ont une magie bien plus puissante, parce qu'elles rendent comme sensible à l'intelligence ce que la vue ne peut apercevoir. Il n'est pas un seul objet dans la nature dont le nom ne puisse être transporté à des idées d'un ordre différent. En effet, tout objet dont on peut tirer une comparaison (et tous, sans exception, en offrent les moyens) fournit une expression figurée, qui, à l'aide de cette comparaison, dont elle renferme l'idée, répand sur le discours de la lumière et de l'éclat. Il faut éviter dans les métaphores toute comparaison inexacte; comme celle-ci d'Ennius : L'arche immense des cieux. Le poète eut beau, dit-on, apporter une sphère sur le théâtre; une sphère ne ressemble pas à une arche.
Vis,
hâte-toi, saisis ce rayon de lumière; Le poète ne dit pas, reçois, prends; ces mots sembleraient annoncer qu'Ulysse peut différer, qu'il a l'espoir de vivre plus longtemps; il dit, saisis, ce qui s'accorde mieux avec cette expression, hâte-toi. XLI. Gardons-nous aussi de tirer les métaphores de trop loin. Je dirais plus volontiers l'écueil, que la syrte d'un patrimoine; l'abîme, que la charybe des biens de quelqu'un : l'intelligence saisit plus aisément les objets qui ont frappé notre vue, que ceux dont nous avons seulement ouï parler. Comme le principal mérite des métaphores est de frapper les sens, bannissons avec le même soin toute comparaison qui fixerait sur des images ignobles l'imagination de l'auditeur. Je ne veux pas qu'on dise que la république a été châtrée par la mort de Scipion l'Africain, ni que Glaucia est l'excrément du sénat; la comparaison peut être juste, mais l'idée qu'elle présente est dégoûtante. Je ne veux pas que l'expression soit au-dessus de l'idée, comme, la tempête de la débauche; ni au-dessous, comme la débauche de la tempête. Je ne veux pas non plus que le mot figuré dise moins que l'expression simple : Quidnam est, obsecro? quid te adiri abnutas? Il eût mieux valu dire : Vetas, prohibes, absterres, puisque Thyeste venait de dire :
...Illico
istic, Craignez-vous que la métaphore ne paraisse forcée, un correctif peut suffire pour la faire passer. Par exemple, si quelqu'un se fût avisé de dire autrefois que la mort de Caton laissait le sénat orphelin, l'expression eût peut-être paru dure et hasardée : on l'adoucirait en ajoutant, pour ainsi dire. La métaphore doit être modeste et réservée; il faut que la place empruntée qu'elle occupe ne paraisse pas une usurpation, une conquête arrachée par la violence, mais un don volontaire, une concession libre et sans contrainte. Parmi les figures qui tiennent à un seul mot, aucune ne donne plus d'éclat au style; car pour l'allégorie, qui naît de la métaphore, elle ne consiste pas dans un mot figuré, mais dans une suite de mots de ce genre, qui semblent présenter une idée, et en font comprendre une autre. Ainsi :
Je ne veux
point deux fois contre le même écueil Ou bien encore :
En vain ton
coeur frémit et se laisse emporter; On emprunte alors, comme je l'ai dit, le nom propre d'une chose, pour l'appliquer à une autre chose qui lui ressemble. XLII. L'allégorie est un grand ornement pour le discours; mais il faut y éviter l'obscurité; car c'est avec ce genre de figure qu'on fait ce qu'on appelle les énigmes. Celle-ci ne consiste pas dans un seul mot, mais dans une phrase, dans l'ensemble des mots. La figure nommée transposition ou métonymie ne résulte pas non plus du changement d'un mot; elle tient au fond même du style : L'Afrique s'épouvante au signal des batailles. L'Afrique est prise ici pour les Africains. Ce n'est pas un mot inventé, comme saxifragis undis; ce n'est pas non plus une métaphore, comme la mer s'adoucit; c'est un mot propre mis à la place d'un autre mot propre, pour produire plus d'effet. De même : Cesse, orgueilleuse Rome, etc. et Témoin ces vastes champs, etc. Ce genre de figure a de l'éclat, et on peut l'employer souvent. Ainsi, le Mars de la guerre est commun; Cérès, pour la moisson; Bacchus, pour le vin; Neptune, pour la mer; la curie, pour le sénat; le Champ de Mars, pour les comices; la toge, pour la paix; les armes ou le glaive, pour la guerre. C'est encore la même figure, lorsqu'on désigne par leurs vertus ou leurs vices les hommes vertueux ou méchants; ainsi l'on dit que le luxe envahit une maison, que l'avarice y pénètre, que la bonne foi a triomphé, que la justice l'emporte. Vous voyez par là en quoi consiste cette figure, qui par le changement d'un mot donne plus d'agrément à la pensée. Il y a d'autres formes, qui approchent de celles-là, et qui moins brillantes, méritent cependant d'être connues. Par exemple, nous employons la partie pour le tout, quand nous disons les murailles, le toit, pour désigner l'édifice entier; ou le tout pour la partie, quand, en parlant d'un seul escadron, nous disons la cavalerie romaine. On met aussi le singulier au lieu du pluriel, comme dans ces vers :
Le Romain
cependant, même après la victoire, Ou le pluriel au lieu du singulier : Rudiens autrefois, et maintenant Romains. Dans tous ces exemples, les mots ont une autre acception que leur acception propre. L'abus d'un mot est une autre figure, moins élégante que la métaphore; mais cette licence n'a cependant rien qui nous puisse blesser. Ainsi nous disons un grand discours pour un long discours; un mince esprit pour un petit esprit. Vous voyez toujours que ces figures, qui se composent, comme je l'ai dit, d'une suite de métaphores, ne consistent pas dans un seul mot, mais dans l'ensemble d'une phrase; et que celles qui résultent d'un changement, et qui font entendre un autre sens que celui qu'elles semblent exprimer, ne sont en quelque sorte que des métaphores. Toute la force et la beauté des mots considérés isolément résulte donc d'une de ces trois circonstances : ou ils ont un peu vieilli sans être encore rejetés par l'usage; ou ils ont été rajeunis par une alliance heureuse, et quelquefois même créés, mais de manière à ne blesser ni l'oreille ni les règles établies; ou enfin, ils contiennent une métaphore, et alors ce sont comme autant d'étoiles qui répandent sur le style un éclat merveilleux. XLIII. Vient ensuite l'ordonnance du style, qui comprend l'arrangement des mots, et la forme particulière qu'il convient de donner à la phrase. Pour que l'arrangement des mots soit convenable, il faut les disposer de telle sorte que leur concours n'ait rien de rude, rien de heurté, mais qu'ils forment un assemblage uni et régulier. Lucilius, qui savait manier si finement la plaisanterie, en a fait une assez piquante à ce sujet, lorsqu'il fait dire à Scévola mon beau-père :
O tes mots
bien rangés! O la rare industrie Après s'être ainsi moqué d'Albucius, il ne m'épargne pas davantage : J'ai pour gendre Crassus, plus grand rhéteur que toi. Hé bien! qu'a donc fait ce Crassus, dont le nom n'a pu échapper à votre censure ? Il a fait ce que voulait faire Albucius, et, j'espère, avec plus de succès; mais Lucilius n'a pas voulu manquer cette occasion de lancer un trait malin. Quoi qu'il en soit, ne négligeons pas de donner à notre style cet arrangement dont je parle, et qui le rendra plus uni, plus égal, plus poli, plus coulant. Nous y parviendrons en ne liant entre eux que des mots qui puissent se joindre naturellement, et qui ne se heurtent pas avec dureté. XLIV. Nous avons à nous occuper ensuite de la forme et de l'harmonie de la phrase. Un soin pareil semblera peut-être puéril à Catulus. Toutefois les anciens ont pensé qu'il devait régner, même dans la prose, une sorte de rythme et de nombre; ils voulaient qu'il y eût dans le discours certains repos, pour que l'orateur pût ménager sa respiration, et prévenir la fatigue, et que ces repos fussent marqués, moins par les signes matériels des copistes, que par la disposition même des expressions et des pensées. Isocrate fut, dit-on, le premier qui assujettit la prose, jusque-là irrégulière, des anciens, à une espèce de rythme, pour flatter agréablement l'oreille : c'est ce que nous apprend Naucrate, son disciple. Les musiciens, qui, dans l'origine, étaient en même temps poètes, inventèrent, pour le charme de l'oreille, et le vers et le chant; afin que le rythme de l'un et la mélodie de l'autre prévinssent la satiété par le plaisir. Ensuite on pensa, qu'autant que la gravité du discours le permettait, les inflexions mesurées de la voix et le rythme des mots pouvaient passer de la poésie dans l'éloquence. Seulement on doit éviter avec soin de réunir les mots de manière à faire des vers dans la prose ; car c'est un défaut choquant ; mais il n'en faut pas moins que la prose ait le nombre, la cadence, la marche régulière et arrêtée des vers. Ce qui, peut-être, distingue le plus l'orateur habile du parleur ignorant, c'est que celui-ci jette pêle-mêle et au hasard le plus de paroles qu'il peut, et ne les mesure pas sur les règles de l'art, mais sur l'étendue de sa respiration ; au lieu que l'orateur, ajustant habilement les mots à la pensée, peut à son gré, ou la soumettre au nombre, ou l'en affranchir ; après s'être astreint au rythme et à la mesure, il s'en débarrasse quand il lui plaît, en changeant l'ordre des mots; de sorte que son style n'offre ni la précision rigoureuse de la versification, ni les écarts irréguliers d'une prose négligée. XLV. Mais par quels moyens parvenir à cette importante qualité, à cette précieuse harmonie du style? La chose n'est pas aussi difficile qu'elle est nécessaire. Il n'est rien en effet de plus souple, de plus flexible que le langage, rien qui se plie avec plus de docilité à tout ce qu'on en exige : on en forme des vers, on en compose des mesures de toutes sortes, et, dans la prose même, on en tire une multitude de combinaisons diverses. Les mêmes mots servent pour la conversation et pour les débats du forum; les mêmes sont employés dans l'usage habituel et familier, et aux pompeuses représentations du théâtre. Ces mots, qui étaient là abandonnés à la disposition de tous, nous les prenons, nous les ramassons pour ainsi dire à nos pieds; ils deviennent entre nos mains comme une cire molle que nous façonnons à notre gré. C'est ainsi que notre style est tantôt noble, tantôt simple, tantôt tient le milieu entre ces deux tons; qu'il suit tous les mouvements de la pensée; qu'il se plie à tous ses besoins; qu'il change sans cesse de forme et d'allure pour charmer l'oreille ou pour pénétrer jusqu'au fond des âmes. Mais pour le discours, comme pour la plupart des choses, la nature, par une oeuvre merveilleuse de son industrie, a voulu que ce qui est le plus utile, fût aussi ce qui offre le plus de grandeur et souvent même de beauté. C'est pour la conservation, et dans l'intérêt de tous les êtres, qu'elle a donné à l'univers la disposition que nous y admirons; que le ciel présente une forme ronde, que la terre est au centre, soutenue et balancée par son propre poids; que le soleil tourne autour, et s'approche ou s'éloigne peu à peu de chacun des tropiques; que la lune, parcourant ses phases diverses, reçoit la lumière de cet astre; qu'enfin les cinq planètes achèvent une révolution semblable avec un mouvement plus ou moins rapide : cet ensemble est si bien ordonné, que la moindre altération détruirait l'harmonie générale; il est si beau, que l'imagination ne peut rien se figurer de plus magnifique. Reportez maintenant votre attention sur la forme et sur la figure des hommes et des animaux eux-mêmes : vous verrez qu'il n'y a dans leur corps aucune partie qui n'ait sa nécessité; et le tout est si parfait, qu'on y reconnaît le chef-d'oeuvre d'un intelligence supérieure, et non l'ouvrage aveugle du hasard. XLVI. Parlerai-je des arbres? le tronc, les rameaux et les feuilles ne semblent destinés qu'à leur conservation : et cependant tout y a son élégante et sa beauté. Laissons les ouvrages de la nature, et passons à ceux de l'art. Dans un navire, qu'y a-t-il de plus indispensable que les flancs avec leurs courbures, la proue, la poupe, les antennes, les voiles, les mâts? mais en même temps il y a une telle grâce dans tout cela, qu'il semble qu'on ait eu en vue le plaisir des yeux non moins que la sûreté du bâtiment. Les colonnes sont faites pour soutenir les temples et les portiques : cependant elles ne sont pas moins élégantes qu'utiles. Ce faîte majestueux qui surmonte le Capitole et les autres édifices sacrés, ce n'est pas le goût du beau, c'est la nécessité elle-même qui en a donné l'idée. Il fallait trouver un moyen de faire écouler les eaux des deux côtés de l'édifice; l'art en a découvert un qui ajoute encore à la beauté du monument : en sorte que si l'on plaçait le Capitole dans les cieux, où il ne peut pleuvoir, ce temple, dépouillé de son magnifique couronnement, paraîtrait avoir perdu toute sa majesté. Il en est de même de tout ce qui constitue le style : la grâce et la beauté y sont inséparables de ce qui est utile ou nécessaire. C'est la nécessité de reprendre haleine qui a établi les repos et les intervalles que nous plaçons entre les mots et les divers membres de la phrase; il en résulte toutefois un si grand charme, que nous ne pourrions souffrir un orateur à qui la force de ses poumons permettrait de parler tout d'une haleine et sans s'arrêter; et il s'est trouvé que ce qui plaît à l'oreille, est en même temps possible, facile même, pour la poitrine de l'orateur. XLVII. La plus longue phrase est donc celle qui peut se prononcer d'une haleine; mais ici la nature a ses règles, et l'art a les siennes. Parmi les différentes mesures, votre Aristote, Catulus, défend à l'orateur d'employer trop souvent ïambe et le trochée. Cependant ils se présentent d'eux-mêmes en parlant; mais ces pieds sont trop courts, et leurs battements réitérés ont un effet trop marqué. Il recommande de préférence les mètres héroïques, tels que le dactyle, l'anapeste et le spondée; et il avertit qu'on ne doit guère employer de suite plus de deux de ces pieds, de peur que la prose ne tombe dans le rythme du vers, ou qu'elle n'en ait la ressemblance. Deux temps, formés de ces mètres, et placés à l'entrée de la période, ont surtout de l'agrément. Mais le pied qu'Aristote approuve le plus, c'est le péon. Il y en a de deux espèces : l'une, où une longue est suivie de trois brèves, comme desinite, incipite, comprimite; et l'autre, où trois brèves sont suivies d'une longue, comme domuerant, sonipedes. Le philosophe conseille de commencer la phrase par le premier péon, et de la finir par le second. Ce dernier, si l'on s'en rapporte moins au nombre de syllabes, qu'au sentiment de l'oreille, le meilleur de tous les juges, est à peu près égal au crétique, qui se compose d'une brève entre deux longues ; par exemple : Quid petam praesidi, aut exsequar? quoue nunc? C'est ainsi que Fannius commence un de ses discours : Si, quirites, minas illius .... Aristote pense que ce pied convient mieux que tout autre la fin des périodes; car il veut qu'on les termine presque toujours par une syllabe longue. XLVIII. Mais nous ne sommes pas astreints à un rythme aussi rigoureux et aussi exact que le sont les poètes. Esclaves du rythme, ils sont contraints de renfermer leur pensée dans un espace déterminé; ils ne peuvent se permettre une mesure plus longue ou plus courte que les règles ne l'exigent. La prose est plus libre : elle est, comme l'indique le nom que nous lui donnons (oratio soluta), dégagée de toute entrave, non qu'elle puisse marcher tout à fait au hasard; mais elle n'a de lois que celles qu'elle s'impose elle-même. Je crois, en effet, avec Théophraste, que l'harmonie d'une prose élégante et soignée, doit avoir de la liberté de et l'abandon. Selon lui, ce fut des mesures qui composent le vers héroïque que se forma l'anapeste, qui a plus d'étendue, et qui donna naissance au dithyrambe, ce genre si libre et si riche, dont les débris se retrouvent, comme le dit encore Théophraste, dans toute composition oratoire abondante et harmonieuse. Si, dans la musique et dans la poésie, l'harmonie résulte de certains effets que produisent sur l'oreille des repos placés à intervalles égaux, cette harmonie peut être introduite avec succès dans le discours, pourvu qu'elle ne soit pas trop continue. Une longue suite de paroles qui se succèdent sans pauses et sans intervalles, nous fatigue et nous rebute. Quelle en peut être la cause, si ce n'est que l'oreille, avertie par un instinct naturel, règle et détermine les modulations de la voix ; ce qui ne peut être qu'autant que la voix reconnaît elle-même un nombre. Or le nombre n'existe pas dans ce qui est continu et sans interruption. Ce qui le constitue, c'est une succession de battements à intervalles égaux, et souvent même inégaux. Ainsi il y a du nombre dans des gouttes d'eau qui tombent à des repos marqués; il n'y en a pas dans le cours non interrompu d'une rivière. Si donc le style a plus de grâce et d'agrément, lorsqu'il est coupé par repos bien placés, que si l'on entassait des phrases continues et prolongées sans fin, il faudra déterminer avec soin les intervalles de ces repos. Si la chute est trop brève, la période, comme disent les Grecs, est brisée et manque de rondeur. Ainsi chaque membre doit être égal à celui qui le précède : le dernier tic doit pas être plus court que le premier; il peut même être plus long, ce qui vaut mieux encore. XLIX. Tels sont les préceptes de ces philosophes grecs que vous aimez, Catulus; je les cite souvent pour me couvrir de leur autorité, et éviter le reproche de vous entretenir de puérilités. - De puérilités! dit Catulus; qu'y a-t-il de plus relevé, de plus ingénieux que ce que nous venons d'entendre?- Mais je crains, reprit Crassus, que ces jeunes gens ne trouvent toutes ces règles obscures; et comme elles n'entrent pas dans l'enseignement ordinaire des écoles, j'ai peur qu'ils ne m'accusent d'en exagérer l'importance et la difficulté. - Vous vous trompez, dit Catulus, si vous croyez que personne ici attende de vous des observations communes et rebattues : ce que vous dites est ce que nous souhaitions d'entendre, et surtout exprimé avec le charme que vous y avez mis. Voilà ce que je puis vous assurer, non seulement en mon nom, mais au nom de tous ceux qui vous écoutent. - Pour moi, dit Antoine, je rétracte ce que j'ai dit dans mon ouvrage, et j'ai enfin trouvé l'homme éloquent que je croyais ne jamais rencontrer; mais je me suis bien gardé de vous interrompre, même pour vous donner les éloges que vous méritez, de peur de nous faire perdre un seul instant du temps trop court que vous consacrez à cet entretien. - Nous parviendrons, poursuivit Crassus, à donner à notre style cette marche nombreuse et périodique que je recommande, par l'exercice de la parole, et par l'habitude d'écrire, si utile pour acquérir toutes les autres parties de l'art, mais surtout celle-ci. La difficulté même n'est pas aussi grande qu'on l'imagine : nous ne sommes pas soumis aux règles sévères des musiciens et des poètes; il suffit que notre style ne coure pas au hasard, qu'il ne s'arrête pas dans sa marche, qu'il ne s'étende pas hors de propos; que les intervalles soient bien ménagés, les périodes, complètes. Il ne faut pas non plus employer toujours la phrase soutenue et la forme périodique; souvent il convient de procéder par petits membres détachés, mais qui devront eux-mêmes être assujettis au nombre et à la mesure. Que le péon et le mètre héroïque ne vous effrayent pas : ils se présenteront d'eux-mêmes, sans que vous preniez la peine de les chercher, si en écrivant ou en parlant, vous contractez l'habitude de donner un tour harmonieux à vos périodes, et si après les avoir commencées par des mesures libres et majestueuses, telles que l'héroïque, le péon de la première espèce, et le crétique, vous avez soin de varier les effets et l'harmonie de vos finales; car c'est surtout aux endroits des repos que l'uniformité blesse l'oreille. Lorsqu'on aura disposé d'après ces règles les mesures qui commencent et terminent la phrase, celles du milieu échapperont à l'attention, pourvu que la période ne trompe pas l'oreille par une chute trop prompte, ou qu'elle ne se prolonge pas au point de gêner la respiration. L. La fin des périodes exige beaucoup plus de soin que les membres qui la précèdent ; car c'est par là surtout qu'on juge de leur perfection. Dans un vers, où tout est également remarqué, le commencement, le milieu et la fin, un défaut choque d'abord, quelque part qu'il se trouve ; mais dans la prose, le dernier membre de la période frappe surtout les auditeurs, et il en est peu qui fassent attention aux premiers. Il faut donc varier habilement la chute de vos phrases, afin de ne rebuter ni l'esprit ni l'oreille. Pourvu que les premiers membres ne soient pas jetés d'une manière trop sèche, il suffira de s'attacher à marquer les deux ou trois dernières mesures qui devront être, ou le chorée, ou l'héroïque, ou tous les deux l'un après l'autre, ou le péon de la seconde espèce, qu'Aristote recommande, ou le crétique, dont le rythme est le même. Cette variété épargne à l'auditeur l'ennui de la monotonie, et en même temps notre style n'a point cet air d'affectation et de soin minutieux qui déplaît. Si Antipater de Sidon, que vous devez vous rappeler, Catulus, était parvenu à composer sur-le-champ des hexamètres, ou des vers de toute autre mesure ; si sa mémoire et son esprit naturel, aidés de l'exercice, le servaient si bien, que dès qu'il se mettait à parler en vers, les mots se présentaient d'eux-mêmes, l'habitude et l'exercice ne pourront-ils pas donner à l'orateur une semblable facilité? Ne nous étonnons point que le vulgaire aperçoive les beautés ou les défauts de ce genre l'instinct naturel, si puissant en toute chose, l'est principalement en ceci. Tous les hommes, par un sentiment secret, et sans connaître les règles de l'art, discernent ce qu'il y a de bon ou de défectueux dans le travail de l'artiste et dans ses procédés; et s'ils jugent sainement du mérite d'un tableau, d'une statue, et des autres ouvrages de cette espèce, qui sont bien moins à leur portée, ils sont meilleurs juges encore en ce qui regarde les mots, le nombre, les tons de la voix. Ce sont là des choses qui dépendent de notre organisation même et d'un certain sentiment dont la nature a voulu que personne ne fût entièrement dépourvu. Ainsi nous sommes tous sensibles, non seulement à l'arrangement plus ou moins habile des mots, mais encore au rythme et à l'harmonie des sons. Il est, sans doute, peu de personnes qui connaissent les secrets de la poésie et de la musique. Cependant, qu'un acteur manque aux règles en faisant une syllabe, ou trop longue, ou trop brève, tout le théâtre se récrie. N'en est-il pas de même dans la musique? Qu'un choeur manque d'accord, ou même qu'un seul chanteur fasse une fausse note; aussitôt la multitude tout entière fait éclater son mécontentement. LI. C'est une chose étonnante qu'il y ait tant de différence entre l'ignorant et l'homme habile, lorsqu'il faut produire, et qu'il y en ait si peu lorsqu'il ne faut que juger. L'art, qui a son principe dans la nature humaine, manque son but s'il ne parvient à émouvoir cette nature et à lui plaire. Or, rien n'a plus de rapport avec nos âmes que le nombre et la mélodie, qui nous animent, nous échauffent, nous calment, nous inspirent de la langueur, de la joie, ou de la tristesse. Leur pouvoir est surtout sensible dans les vers et dans le chant. Cette ressource n'a pas été négligée par nos ancêtres et par Numa, le plus éclairé de nos rois, comme l'indiquent les vers des Saliens, les flûtes et les harpes des banquets solennels; mais la Grèce ancienne en connaissait surtout l'influence; et je voudrais que vous eussiez pris cette intéressante matière pour sujet de cet entretien, plutôt que tous ces détails puérils sur les figures de mots. Le peuple, qui aperçoit une faute de mesure dans un vers, n'est pas moins sensible à un défaut d'harmonie dans la prose ; mais il a pour nous une indulgence qu'il refuse au poète. Toutefois l'auditoire entier s'aperçoit, sans le témoigner, de ce qu'il y a d'imparfait ou de négligé dans notre diction. Les anciens orateurs même, inhabiles dans l'art récemment découvert et pratiqué parmi nous de former et d'arrondir, en quelque sorte, la période, s'étudiaient du moins, comme quelques-uns le font encore aujourd'hui, à jeter les mots trois à trois, deux à deux, ou même un à un ; dans cette ignorance primitive de la parole, ils se conformaient déjà aux exigences de l'oreille en faisant correspondre entre eux des membres de phrase égaux, et en se ménageant ainsi des pauses régulières. LII. Je vous ai exposé, aussi bien que je l'ai pu, ce qui m'a paru appartenir aux ornements du discours : je vous ai parlé de la beauté des mots considérés en eux-mêmes, et dans leurs rapports et leur liaison ; je vous ai parlé du nombre et de la structure de la période. Si vous m'interrogez maintenant sur le caractère général, sur la couleur du style, je répondrai qu'il est ou large et abondant, mais en même temps régulièrement arrondi, ou simple, sans être dépourvu de nerf et de vigueur, ou enfin tempéré, et tenant le milieu entre les deux autres genres. Chacun de ces genres doit avoir une sorte de beauté où le fard n'entre pour rien, et qui soit comme la fraîcheur du teint vivifié par la circulation du sang. Il faut enfin que l'orateur acquière, pour les pensées comme pour les paroles, cette perfection, à laquelle tendent les gladiateurs et les maîtres d'escrime; qui ne pensent pas seulement à porter des coups, ou à parer ceux qu'on leur porte, mais qui cherchent encore à mettre de la grâce dans leurs mouvements. Ainsi l'orateur doit donner au discours, au moyen des mots, la grâce et la régularité; au moyen des pensées, la force et la puissance. Les figures de mots et les figures de pensées sont presque innombrables, et c'est ce que vous savez comme moi. Vous savez aussi qu'il y a entre elles cette différence, que les premières disparaissent, si l'on change les expressions, et que les secondes subsistent toujours, quelques mots qu'on emploie. Vous savez tout cela, vous le pratiquez; pourtant je crois devoir vous le dire, et n'allez pas vous y m'éprendre : tout le fait de l'orateur, en ce qui donne à son oeuvre du relief et l'éclat, se réduit, pour le choix des mots, à se servir fréquemment de termes métaphoriques, quelquefois de termes nouveaux et créés exprès, plus rarement de termes vieillis; pour la composition des phrases, d'abord à donner à l'élocution la douceur et l'harmonie, ensuite à l'embellir en y répandant çà et là les ornements des figures, soit de mots, soit de pensées. LIII. La commoration, par laquelle on insiste sur quelques détails; l'hypotypose, qui les décrit, les développe, et les met, pour ainsi dire, sous les yeux de l'auditeur, sont d'un grand secours pour exposer les faits : elles les présentent avec plus de clarté; elles les agrandissent; elles en donnent la plus haute idée possible à ceux qui nous écoutent. A ces développements sont opposées la précision (sorte de réticence) ; la signification, qui dit moins qu'elle ne donne à entendre; l'abréviation, concise avec netteté; l'atténuation, qui amoindrit les objets; la raillerie, qui en est voisine, et qui rentre dans les matières dont César nous a entretenus. Vient ensuite la digression, qui, après avoir distrait quelque temps l'esprit du sujet, demande qu'on l'y ramène adroitement; la proposition, qui annonce ce qu'on va dire; la séjonction, qui abandonne un point pour passer à un autre; le retour au sujet, et la répétition; la conclusion, qui résume le raisonnement; l'hyperbole, qui exagère ou diminue la vérité, selon qu'on veut agrandir ou rapetisser les objets; l'interrogation, et la question qui s'en rapproche; l'exposition de son sentiment; l'ironie, qui exprime une chose pour en faire entendre une autre : cette figure, qui pénètre si sûrement dans les esprits, et qui produit un effet si agréable lorsqu'on y joint, non la véhémence, mais un ton de familiarité; la dubitation, la distribution, la correction, soit pour modifier ce qu'on a dit, ou ce qu'on va dire, soit pour repousser un reproche; la prémunition, soit que nous préparions les esprits à recevoir nos arguments, soit que nous rejetions sur un adversaire l'imputation dirigée contre nous; la communication, qui est une espèce de délibération avec ceux à qui on s'adresse; l'éthopée, ou imitation des moeurs, soit que l'on mette en scène les personnages, soit qu'on ne les fasse point paraître : cette figure est un des plus riches ornements du discours; elle est surtout propre à disposer favorablement les esprits, souvent même à les émouvoir; la prosopopée, qui répand le plus d'éclat sur l'amplification oratoire; la description; l'induction, qui prouve l'erreur des autres; la facétie (χαριεντισμός); l'antéoccupation; suite ces deux figures, dont l'effet est si grand, la similitude et l'exemple; la division, l'apostrophe, l'antithèse, la réticence, la recommandation; la liberté du langage (παρρησία), qui quelquefois s'emporte au delà des bornes, et sert à l'amplification; la colère, l'invective, la promesse, la déprécation, l'obsécration; une légère déviation du sujet, différente de la digression dont j'ai déjà parlé; la justification, la conciliation, la dépréciation, l'optation, l'imprécation. Telles sont les figures de pensées dont on peut orner le discours. LIV. Quant aux figures de mots, on peut les comparer à l'escrime, qui sert non seulement pour se mettre en garde et pour attaquer, mais encore pour manier sou arme avec grâce. Ainsi, la répétition donne, tantôt de la force, tantôt de l'agrément au style; il en est de même des altérations qu'on fait subir aux mots, de leur redoublement, soit au commencement, soit à la fin de la phrase, de la complexion, de l'adjonction, de la progression, de l'intention particulière attachée à un mot qu'on ramène souvent, de ces chutes et de ces terminaisons semblables, de ces membres qui se correspondent, ou se répètent symétriquement. Il y a encore la gradation, la conversion, l'hyperbate employée avec goût, les contraires, la dissolution, la déclinaison, la répréhension, l'exclamation, l'imminution (ou syncope), l'usage d'un mot à différents cas; l'énumération de parties, qui reprend tout en détail ; la preuve confirmative, jointe à la proposition générale, ou à chacune de ses parties; la permission, une autre dubitation, la surprise, la dinumération (μερισμός), une autre correction, la distinction, la continuation, l'interruption, l'image (ou comparaison), la subjection, la paronomase, la disjonction, l'ordre, la relation, la digression, la circonscription. Telles sont à peu près les figures de pensées et de mots qui contribuent à l'ornement du discours : on en pourrait citer bien davantage. LV. - Vous croyez, sans doute, dit Cotta, que ces figures nous sont connues; car vous les avez accumulées sans en donner ni définition, ni exemples. - Je ne pensais pas, répondit Crassus, que rien de ce que je viens de dire fût nouveau pour vous, et je n'ai fait que céder à votre désir commun; mais le jour qui se précipite vers son déclin, me force d'être court, et de précipiter aussi la fin de cette discussion. Au surplus, la théorie et les règles relatives à ce sujet sont à la portée de tout le monde; quant à l'application, rien n'est plus important, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile dans l'art de la parole. Après avoir ouvert, ou du moins indiqué les sources de tous les ornements du discours, je dois dire un mot des convenances, ou bienséances oratoires. Mais n'est-il pas évident que toute espèce de discours ne convient pas à toute espèce de sujet, et qu'il faut avoir égard aux temps, aux lieux, aux personnes? Une affaire qui intéresse la vie d'un homme ne veut pas être traitée comme une cause civile de peu d'importance; et les délibérations publiques, les panégyriques, les plaidoyers, les entretiens, les consolations, les invectives, les discussions, l'histoire, n'admettent pas le même ton. Il faut encore considérer devant qui l'on parle, si c'est le sénat qui nous écoute, ou le peuple, ou des juges; si l'on s'adresse à un auditoire nombreux, à peu de personnes, ou à un seul homme; si l'on est en paix ou en guerre; si l'affaire est pressante, ou si elle peut souffrir des délais; enfin, l'orateur doit avoir égard à son âge, à son rang et à la considération dont il jouit. On ne peut, je crois, donner sur ce point d'autre règle que de choisir dans les trois genres de style, l'un relevé, l'autre simple, le troisième tempéré, celui qui convient le mieux au sujet, et d'employer les ornements du discours, tantôt avec réserve, tantôt avec plus de hardiesse. En toute chose, pouvoir faire tout ce qui convient, c'est le triomphe de l'art, joint à la nature; le savoir, c'est l'effet du discernement et du goût. LVI. Mais tous ces avantages, c'est l'action qui les fait valoir. L'action domine dans l'art de la parole : sans elle, le meilleur orateur n'obtiendra aucun succès; avec elle, un orateur médiocre l'emporte souvent sur les plus habiles. On demandait à Démosthène quelle était la première qualité de l'orateur; il répondit : L'action. Quelle était la seconde, puis la troisième ? et il répondit toujours : L'action. C'est ce qui fait mieux sentir la justesse de ce mot d'Eschine. Après la condamnation déshonorante qui le fit sortir d'Athènes, il s'était retiré à Rhodes. Les Rhodiens le prièrent de leur lire la belle harangue qu'il avait prononcée contre Ctésiphon, avec Démosthène pour adversaire; il y consentit. Le lendemain, on le pria de lire aussi la réponse de Démosthène en faveur de Ctésiphon. Il la lut avec un ton de voix plein de force et de grâce; et comme tout le monde se récriait d'admiration : Que serait-ce, dit Eschine, si vous l'eussiez entendu lui-même? Il montrait assez par là quelle puissance il attribuait à l'action, lui qui croyait que le même discours pouvait sembler tout autre selon la personne qui le prononçait. Quel effet devait produire C. Gracchus, que vous vous rappelez mieux que moi, Catulus, lorsque, s'abandonnant à ce mouvement si vanté au temps de mon enfance, il s'écriait : Misérable ! où irai je ? quel asile me reste-t-il? Le Capitole? il est inondé du sang de mon frère. Ma maison? j'y verrais une malheureuse mère fondre en larmes et mourir de douleur; son regard, sa voix, son geste, au dire de chacun, étaient si touchants, que ses ennemis eux-mêmes en versèrent des pleurs. J'insiste là-dessus, parce que les orateurs, qui sont les organes de la vérité même, semblent avoir abandonné toute cette partie aux comédiens, qui n'en sont que les imitateurs. LVII. Sans doute la vérité l'emporte en toute chose sur l'imitation, et si la nature suffisait pour nous former à l'action, l'art deviendrait inutile. Mais comme les mouvements de l'âme, que l'action surtout doit exprimer et produire au dehors, sont souvent confus et obscurs, il faut savoir les dégager des ténèbres qui les environnent, et s'attacher aux traits saillants qui les produisent au dehors. La nature a donné, pour ainsi dire, à chaque passion sa physionomie particulière, son accent et son geste. Notre corps tout entier, notre regard, notre voix résonnent comme les cordes d'une lyre, au gré de la passion qui nous ébranle ; et comme les tons de l'instrument varient sous la main qui le touche, ainsi l'organe de la voix produit des sous aigus ou graves, pressés ou lents, forts ou faibles, avec toutes les nuances intermédiaires. De là naissent les différents tons, doux ou rudes, rapides ou prolongés, entrecoupés ou continus, mous ou heurtés, affaiblis ou enflés : toutes ces inflexions diverses de la voix, ont besoin d'être employées tour à tour avec ménagement, et l'art peut les régler; elles sont pour l'orateur comme les couleurs qui servent au peintre à varier ses tableaux. LVIII. La colère a son accent, qui est prompt, vif et coupé comme :
Ce frère
sacrilège, outrageant la nature, Voyez encore ce passage, rapporté déjà par Antoine : Avez-vous bien osé vous séparer de lui? et cet autre : Ne l'entendez-vous pas? Qu'on l'enchaîne ... et presque toute la tragédie d'Atrée. La douleur et la pitié ont un autre ton; il est plein, touchant, entrecoupé, mêlé de gémissements :
Malheureuse!
où chercher encore une patrie? ou bien encore : O Troie! ô ma patrie! ô palais de mon père ! et ce qui suit :
J'ai vu dans
Ilion en flammes La crainte s'exprime d'un ton bas, tremblant, soumis :
Pauvre,
exilé, souffrant, tout m'accable à la fois; Le ton de la violence est énergique, impétueux, précipité, menaçant :
Eh quoi!
Thyeste encore ose approcher d'Atrée! L'accent de la volupté est doux, tendre, et plein d'abandon; il respire la joie et le calme.
Pour l'hymen
qui s'apprête apportant la couronne, La douleur qui ne cherche point à inspirer la pitié, s'énonce d'un ton grave et uniforme :
Dans le
temps que Pâris, par de coupables noeuds, LIX. Toutes ces inflexions de la voix doivent être accompagnées d'un geste analogue : non qu'il faille exprimer chaque mot à la manière des comédiens; l'orateur n'a pas besoin de tout rendre par la pantomime; il lui suffira de marquer l'effet général de la pensée. Ses poses doivent être nobles et mâles; elles doivent rappeler l'attitude du guerrier sous les armes ou même de l'athlète, plutôt que celle du comédien sur la scène. Que la main n'en veuille pas trop dire; que les doigts suivent les paroles, sans chercher à en exprimer le sens; que le bras s'étende en avant, comme pour lancer le trait de l'éloquence; que le pied frappe quelquefois la terre, au commencement et à la fin d'une discussion animée. Mais tout dépend de la physionomie, dont le pouvoir réside surtout dans les yeux. Nos pères en cela voyaient mieux que nous; car ils goûtaient peu les acteurs sous le masque, fût-ce même Roscius. En effet, c'est l'âme qui donne de la force et de la vérité à l'action; l'âme dont le visage est le miroir, et dont les yeux sont les interprètes : c'est la seule partie du corps qui puisse rendre nos passions avec toutes leurs nuances et toute leur mobilité; et l'on n'y réussira jamais, si l'on tient constamment les yeux fixés sur le même objet. Théophraste disait en partant d'un acteur appelé Tauriscus, qu'il parlait le dos tourné au public, parce qu'en débitant son rôle son regard était toujours fixe et immobile. C'est donc le mouvement des yeux qu'il faut régler avec le plus grand soin; quant à l'expression des traits, on ne doit pas chercher à la varier outre mesure; on se rendrait ridicule ou difforme. C'est le regard qui tour à tour tendu ou adouci, lancé puissamment ou égayé, peut traduire tous les mouvements de l'âme dans un juste rapport avec le caractère des paroles. L'action est comme l'éloquence du corps; elle doit donc être toujours en harmonie avec la pensée. Or, la nature nous a donné les yeux pour exprimer ce que nous sentons, comme elle a destiné à la même fin les oreilles du cheval, la queue et la crinière du lion. Ainsi dans l'action, après la voix, la physionomie est ce qu'il y a de plus puissant, et ce sont les yeux qui la gouvernent. La nature a donné à tout ce qui tient à l'action une force qui agit puissamment sur les ignorants, sur la multitude, sur les barbares eux-mêmes. Pour que les mots fassent impression, il faut que l'auditeur connaisse la langue de celui qui parle; et souvent toute la finesse des pensées vient échouer contre des esprits qui manquent de finesse. Mais l'action, qui peint les mouvements de l'âme, parle un langage intelligible à tous les hommes; car nous éprouvons tous les mêmes passions; et nous les reconnaissons dans les autres aux mêmes signes qui nous servent à les exprimer. LX. Cependant, de tout ce qui concourt au succès de l'action oratoire, ce qu'il y a de plus important, c'est la voix. Une belle voix est à désirer; mais quelle que soit celle que la nature nous a donnée, sachons l'entretenir et en tirer parti. Quels sont à cet égard les soins à prendre? Cette question est en dehors des préceptes oratoires qui nous occupent; seulement je pense qu'il en faut prendre beaucoup. Mais une observation qui entre davantage dans le sujet de notre entretien, et que j'ai déjà faite, c'est que dans beaucoup de choses ce qui est le plus utile est en même temps, je ne sais par quelle raison, ce qui a le plus de grâce. Rien ne soutient mieux, en effet, la voix, que d'en varier les inflexions; rien ne l'épuise plus vite, qu'une déclamation tendue et monotone. Qu'y a-t-il de plus propre à flatter l'oreille, et à rendre le débit agréable, que la succession variée des tons? Licinius, homme instruit, et votre client, Catulus, a pu vous dire que C. Gracchus, dont il a été autrefois l'esclave et le secrétaire, faisait cacher derrière lui, lorsqu'il parlait en public, un musicien habile qui lui donnait rapidement le ton sur une flûte d'ivoire pour relever sa voix si elle venait à baisser, ou pour le ramener à la suite d'éclats un peu vifs. — J'ai entendu citer le fait, répondit Catulus, et j'ai souvent admiré l'ingénieuse précaution de cet homme célèbre, ainsi que ses talents et son savoir. — Quant à moi, reprit Crassus, j'ai la même admiration pour lui, et je regrette vivement que des hommes tels que les Gracques se soient laissé entraîner à une coupable et funeste politique. Mais dans un temps où l'on voit s'ourdir des trames si criminelles, où les désordres qui pénètrent dans l'État préparent à la postérité de si pernicieux exemples, nous sommes réduits à désirer des citoyens semblables à ceux que nos ancêtres ne purent souffrir. — Écartez, je vous prie, dit César, ces tristes réflexions, et revenez à la flûte de Gracchus, dont je ne conçois pas encore bien l'usage. LXI. — Toutes les voix, reprit Crassus, ont un médium qui est différent pour chacune d'elles : c'est de ce point qu'il faut partir, pour monter graduellement jusqu'aux tons les plus élevés. Cette méthode est tout à la fois utile et agréable; éclater en cris dans le commencement d'un discours, a quelque chose d'étrange et de choquant; et en même temps cette ascension graduelle de la voix est propre à la fortifier. Ensuite, dans les notes élevées de la voix, il est un dernier point, voisin des sons aigus, auquel la flûte ne vous laissera jamais arriver; et même, si vous en approchez, elle vous forcera de descendre. La voix, en s'abaissant, trouve aussi des sons graves, auxquels il ne faut arriver que par degrés. Cette variété et ce passage successif de la voix par tous les tons, la conservent, la soutiennent, et donnent de la grâce au débit. Mais vous laisserez au logis le joueur de flûte, et vous vous contenterez d'apporter avec vous au forum l'esprit de la méthode. J'ai rempli ma tâche, non comme je l'aurais voulu, mais comme je l'ai pu, dans le temps qui m'était accordé; car il y a une certaine adresse à s'en prendre au temps de ce qu'on n'en dit pas davantage, quand on ne trouve plus rien à dire. - Mais il me semble, dit Catulus, que vous n'avez rien oublié; et, autant que j'en puis juger, vous avez exposé vos préceptes avec tant de talent, qu'au lieu de paraître avoir pris des leçons des Grecs, vous semblez capable de leur en donner. Pour moi, je m'estime heureux d'avoir assisté a cet entretien, et je regrette beaucoup que mon gendre Hortensius, qui est votre ami, n'ait point partagé ce bonheur. Un jour, je l'espère, il parviendra à réunir tous les genres de mérite que vous venez de parcourir et d'exposer. — Il y parviendra, dites-vous, reprit Crassus. Je pense, moi, qu'il y est déjà parvenu. Je l'ai jugé ainsi lorsque, pendant mon consulat, il défendit la cause de l'Afrique, et surtout lorsqu'il plaida dernièrement en faveur du roi de Bithynie. Non, vous ne vous trompez pas, Catulus; il ne manque rien à ce jeune homme de ce que donne la nature ni de ce que l'étude peut faire acquérir. C'est une raison de plus pour vous, Sulpicius, et pour vous, Cotta, de travailler avec ardeur : un rival redoutable s'élance après vous dans la carrière; il unit à un génie brillant un savoir profond, une heureuse mémoire, une application infatigable. Quoique je m'intéresse à ses succès, je désire que sa gloire se borne à surpasser ceux de son àge : plus âgés que lui, comme vous l'êtes, il serait peu honorable pour vous de lui céder la victoire. Mais levons-nous, et terminons cet entretien; il est temps de nous mettre à table, et d'aller nous délasser enfin d'une si longue et si grave discussion. NOTES DES DIALOGUES DE L'ORATEUR. VII. Quum.. inveheretur in causam principum consul Philippus. On peut voir, sur ces querelles entre le consul Philippe et le sénat, ce que dit le continuateur de Rollin, dans l'exposé des causes de la guerre Sociale, livre XXXI. Outre plusieurs autres lois proposées par le tribun Drusus, il voulait rendre au sénat le département des tribunaux,don tjouissait depuis trente et un ans L'ordre des chevaliers, en vertu de la loi Sempronia, et faire revivre la loi portée par Servilius Cépion l'an 647, qui ordonnait que le droit de juger serait partagé entre les chevaliers et le sénat. Voyez aussi le Brutus chap. 47, 50 etc., et les notes du traducteur. Ludorum romanorum diebus. Les jeux publics faisaient une partie du culte chez les Romains. On les distinguait par le lieu où ils étaient célébrés ou par la qualité ou le nom du dieu à qui on les avait dédiés. Ainsi il y avait les jeux circenses et scaenici, les jeux apollinaires, céréaux, floraux, etc. Les principaux étaient ceux qu'on appelait ludi romani ou magni (Tite Live, I, 35).Ils furent institués par Tarquin l'ancien, l'an de Rome 150. Ils se célébraient du 4 au 12 septembre tous les travaux et les affaires publiques étaient interrompus pendant leur célébration. L. Crassus. M. Antonius. C. Cotta. P. Sulpicius. Nous ne parlerons pas des interlocuteurs qui figurent dans ce dialogue et les suivants. Comme il est souvent question d'eux ailleurs, et surtout dans le Brutus, nous renvoyons le lecteur aux notes qui accompagnent ces différents ouvrages, et qu'il serait inutile de répéter ici. Crassus et Antoine sont jugés par Cicéron, Brut., chap. 43 et suivants; Cotta et Sulpicius, chap. 88 etc. Il en est de même des orateurs et des personnages plus ou moins célèbres, cités par Cicéron dans le cours de ce traité. Nous ne nous arrêterons qu'à ceux qui ne seraient pas nommés ailleurs. VIII. Neque mihi quidquam proestabilius videtur quam posse dicendo. Sur la dignité du talent de l'orateur, sur les avantages et l'utilité de l'éloquence, on peut lire, outre le beau morceau de Quintilien, livre II, chap. 16, Ies chap. 5 6 et 7 du brillant dialogue sur les Orateurs, attribué à Tacite. IX. Plura... detrimenta publicis rebus quam adjumenta per homines eloquentissimos importata. Voyez dans le même dialogue de Oratoribus, chap.40, un morceau à peu près semblable, où l'un des interlocuteurs reproche à l'éloquence d'être née de la licence et du désordre: « Alumna licentiae, quam stulti libertatem vocabant, comes seditiosum, effrenati populi incitamentum, sine obsequio, sine servitute, contumax, temeraria, arrogans, quae in bene constitutis civitatibus non oritur, etc. » In urbanas tribus. On peut voir, sur le nombre et la division des tribus, Denys d'Halicarnasse, Tite-Live, Varron, Pline l'ancien, et les dissertations de Boindin sur les tribus romaines, dans les Mémoires de l'Académie des Inscriptions. XI. Charmadas. La plupart des éditions ont ici Carneades. Voyez, sur cette erreur, les notes de Pearce, et celles qui accompagnent l'édition in-4° de l'abbé d'Olivet, tom. I, pag. 139 et suivantes; seulement nous croyons qu'Ernesti et Wetzel (Encyclopädie der lateinischen classiker, de Oratore, Brunswick, 1795) ont eu tort de rétablir aussi Charmadam dans cette phrase, ipsum illum Carneadem diligentius audierat. Pearce et d'Olivet ne s'y étaient pas trompés. XII. Hoc est proprium oratoris... oratio gravis et ornata. Fénelon (Dialogue sur l'éloquence) se fait une idée plus haute encore de l'éloquence que les anciens. Il ne la considère que comme l'art de persuader la vérité. Il ne s'occupe que de la pensée, et proscrit tous les vains ornements; il ne veut que des beautés simples, faciles et naturelles; il est surtout ennemi de celte éloquence qui ne va qu'à plaire. « D'ordinaire, dit-il, un déclamateur fleuri ne veut que des phrases brillantes et des tours ingénieux ce qui lui manque le plus, est le fond des choses il sait parler avec grâce, sans savoir ce qu'il faut dire; il énerve les plus grandes vérités par un tour vain et trop orné. Au contraire, le véritable orateur n'orne son discours que de vérités lumineuses, que de sentiments nobles, que d'expressions fortes et proportionnées à ce qu'il tâche d'inspirer; il pense, il sent, et la parole suit. » - « Il ne faut pas, dit-il encore, faire à l'éloquence le tort de penser qu'elle n'est qu'un art frivole, dont un déclamateur se sert pour imposer à la faible imagination de la multitude, et pour trafiquer de la parole : c'est un art très sérieux, qui est destiné a instruire, à réprimer les passions, à corriger les moeurs, à soutenir les lois, à diriger les délibérations publiques, à rendre les hommes bons et heureux. Plus un déclamateur ferait d'efforts pour m'éblouir par les prestiges de son discours, plus je me révolterais contre sa vanité; son empressement pour faire admirer son esprit me paraîtrait le rendre indigne de toute admiration. L'homme digne d'être écouté est celui qui ne se sert de la parole que pour la pensée, et de la pensée que pour la vérité et la vertu. Rien n'est plus méprisable qu'un par-leur de métier, qui fait de ses paroles ce qu'un charlatan fait de ses remèdes. » - Montaigne exprime avec la piquante naïveté de son vieux langage des idées conformes à celles de Fénelon : « C'est aux paroles à servir et à suyvre, et que le Gascon y arrive, si le François n'y peult aller. Je veule que les choses surmontent, et qu'elles remplissent de façon l'imagination de celuy qui escoute. qu'il n'aye aulcune souvenance des mots. Le parler que j'aime, c'est un parler simple et naïf, tel sur le papier qu'à la bouche; un parler succulent et nerveux, court et serré; non tant délicat et peigné, comme vehement et brusque... l'éloquence faict injure aux choses, qui nous detourne à soi.» XIII. M. Marcellus hic noster. On croit que ce Marcellus est le père de celui pour qui Cicéron composa quelques années après la fameuse harangue où il remercie César d'avoir permis à ce sénateur de revenir de l'exil. XVI. Aratum. « Cicéron, dit Racine le fils, ne parle ainsi, que pour relever un auteur qu'il avait traduit. » Cet éloge a cependant été répété depuis par Quintilien (X, 1), qui y met, il est vrai, quelques restrictions. Les poèmes d'Aratus étaient en grande faveur à Rome. Ovide (Amor., I, XV) leur promet une grande durée, égale à celle des grands objets qu'ils célèbrent : Cum sole et luna semper Aratus erit. Virgile et Manilius en ont emprunté d'heureux détails; ils ont été traduits successivement par Cicéron, Germanicus, Aviénus, peut-être aussi par Stace. Aratus naquit vers la cent vingt-cinquième olympiade; il était de Soles en Cilicie; contemporain de Théocrite, qui le cite honorablement dans sa sixième idylle, il mérita la protection de Ptolémée Philadelphe, et vécut dans la constante amitié d'Antigone Gonatas, fils de Démétrius Poliorcètes. Enfin les Pères de l'Église ont parlé de lui avec une profonde estime, sans doute parce qu'un de ses vers a été cité par l'apôtre saint Paul, natif cumule lui de Cilicie,dans son célèbre discours à l'Aréopage. (Act. Apost. XVII, 28.) Il avait composé un grand nombre d'ouvrages sur divers sujets; mais il n'est connu aujourd'hui que par son poème des Phénomènes, titre sous lequel on a coutume de réunir deux productions tout à fait distinctes. Il se recommande par la pureté et l'élégance de son style, plus que par le mérite de l'invention et de la disposition; car il s'est contenté de mettre en vers les connaissances astronomiques de son temps, probablement comme il les avait trouvées dans les écrits d'Eudoxe, et de quelques autres. Aussi son ouvrage est-il moins précieux pour les littérateurs que pour les savants, auxquels il offre des renseignements utiles sur l'état de l'astronomie à cette époque. On peut consulter la notice de Bühle sur Aratus, dans son édition de ce pacte, et l'article de M. Delambre, dans la Biographie universelle. XVI. Nicandrum Colophonium. Nicandre, grammairien, poète et médecin, vivait vers la cent soixantième olympiade, l'an 140 avant J. C., du temps d'Attale, surnommé Galatonicès, roi de Pergame. Il était de Claros, petite ville d'Ionie, dans le voisinage de Colophon, et son père se nommait Damnée. Il nous reste de lui deux poèmes intitulés l'un Θηριακά, l'autre Ἀλεξιφάρμακα. Il en avait composé plusieurs autres, parmi lesquels on distinguait des Géorgiques, dont parle Athénée en plusieurs endroits, et auxquelles se rapporte ce passage de Cicéron. Il avait écrit aussi l'histoire de l'Étolie, où il avait habité longtemps, ce qui a fait croire à quelques critiques qu'il était Étolien; l'histoire de Colophon, celle de la Béotie et quelques autres. Athénée, Macrobe, Étienne de Byzance, le scholiaste des Thériaques, et Suidas, parlent de ces divers ouvrages. Une phrase de Quintilien (quid? Nicandrum frustra secuti Macer atque Virgilius? X, 1) nous apprend que Virgile n'avait pas dédaigné de l'imiter, et ne l'avait pas fait sans fruit. XX. Corace nescio quo, et Tisia. Sur ces deux rhéteurs, ainsi que sur tes rhéteurs et sophistes grecs qui les suivirent, sur l'abus et les subtilités de la rhétorique, sur les règles du langage et les progrès de l'éloquence chez les Grecs, etc., on lira avec beaucoup d'intérêt et de fruit le chapitre cinquante-huitième du Voyage d'Anacharsis. On peut voir aussi, sur Corax et Tisias, les notes du Traité de l'Invention, II, 2. XXI. Quantum auguror conjectura. « Ne pourrait-on pas croire que Cicéron prophétise ici par la bouche d'Antoine, et prophétise sur lui-même? Ce qui est certain, c'est que tous les traits qu'il a rassemblés jusqu'ici paraissent lui convenir, et ne convenir qu'à lui seul. Il était non seulement le plus éloquent, mais le plus savant des Romains, et il a fait dire à Antoine, il n'y a qu'un moment, que rien n'est plus propre à nourrir et à fortifier le talent de l'orateur, que la multitude des connaissances. Quoique alors celles que l'on pouvait acquérir fussent plus bornées qu'aujourd'hui, cependant il n'a pas voulu dire, et lui-même en convient, que l'orateur devait tout savoir; mais il a soutenu qu'il était de l'essence du talent oratoire de pouvoir orner tous les sujets, autant qu'ils en sont susceptibles, et c'est précisément ce qu'il avait fait; car il avait écrit, et toujours avec agrément et abondance, sur toutes les matières générales de philosophie, de politique et de littérature. Il n'était nullement étranger à l'histoire, puisqu'il avait fait celle de son consulat; ni à la poésie, puisqu'il avait composé un poème à l'honneur de Marius. Ainsi, grâce à l'amour du travail, qui était en lui au même degré que le talent, il était précisément l'homme qu'il demande, celui qui ne se contente pas d'être exercé aux luttes du barreau, et aux délibérations publiques, mais qui peut écrire éloquemment sur tous les objets qu'il voudra traiter. » La Harpe, Cours de littérature, tom. III. XXII. Cretio. Ce mot, selon le jurisconsulte Ulpien (lit. 22, qui hered. instit. possint), signifie l'espace de tempe accordé à un héritier pour se déterminer à accepter ou à refuser un héritage dont on le mettait provisoirement en possession en ces termes : Titius heres esto, cernitoque in diebus centum proximis, quibus scieris poterisque; nisi ira creveris, exheres esto. Voyez aussi Cujas, Observat., VII, 18; IX, 29, etc. Staesas. Staséas était de Naples. Cicéron en parle avec plus de détail, de Finibus, V, 3, 25. XXV. Naturam primum, atque ingenium... Horace a dit à ce sujet, Art poétique, vers 407 :
Natura
fieret laudabile carmen, an arte, Quintilien traite la même question dans ses Institutions, liv. II, chap. 19. Nous remarquerons ici qu'il n'est pas un seul point important, dans les dialogues de l'Orateur, qui ne se trouve reproduit et développé dans Quintilien. Son ouvrage, sous un certain rapport, peut être considéré comme un commentaire et une éloquente paraphrase de celui de Cicéron. Les rapprochements qua se présentent à chaque instant entre les deux auteurs seraient toujours curieux et instructifs; mais par la raison qu'ils sont continuels, il nous semble superflu de les indiquer. Il suffit de prévenir une fois pour toutes le lecteur, qui pourra les faire lui-même. La Harpe a donné du même ouvrage, dans le tome Il de son Cours de littérature, une analyse qu'on pourra consulter. Marmontel montre aussi pour ce Traité la plus grande admiration; il l'appelle son oracle; il le cite à chaque instant, et regrette de ne pas pouvoir le répandre tout entier dans ses articles sur l'éloquence. Il en tire toutes ses théories sur l'art de la parole; il en reproduit tellement toutes les idées, qu'il semble le savoir par cœur. Voyez, dans ses Éléments de littérature, tous les articles qui ont rapport à l'art oratoire. XXV. C. Celio, aequali meo.... Q. Varium.... C. Célius Caldus, et Q. Varius Hybrida, sont jugés par Cicéron dans le Brutus, l'un au chap. 45, et l'autre aux chap. 62, 89. XXXIII. Ut, concitato navigio.... Rien de plus juste ni de plus ingénieux que cette comparaison; rien de plus harmonieux ni de plus élégant que ce style. Cicéron, dans une lettre à Atticus (XIII, 21, fait une remarque intéressante sur le mot inhibuerunt: « Inhibere illud tuum, quod valde mihi arriserat, vehementer displicet. Est enim verbum totum nauticum. Quanquam id quidem sciebam : sed arbitrabar sustineri remos, quum inhibere essent remiges jussi. Id non esse ejusmodi, didici heri, quum ad villam nostram navis appelleretur. Non enim sustinent, sed alio modo remigant. Id ab ἐποχῇ remotissimum est.... Inhibitio autem remigum motum habet, et vehementiorem quidem, remigationis navem convertentis ad puppim. » Pearce, d'après ce texte, voulait lire ici quum remiges sustinuerunt. Mais ce texte même prouve que Cicéron, à l'époque où il écrivit les dialogues de l'Orateur, n'avait pas encore fait cette observation; ils sont de l'an 698, et la lettre à Atticus est de l'an 708. Le savant Anglais supposait peut-être que Cicéron changea depuis quelque chose à cet endroit; nous trouvons ailleurs d'autres exemples de ces corrections faites par l'auteur lui-même. XXXIV. C. Carbonem. Sur C. Carbon, qui avait été tribun du peuple en 622, et consul en 633, voyez Brutus, chap. 27, et la note 54 du traducteur. Non mihi displicet adhibere... istam locorum rationem, quae in arte traditur. Cicéron parle plus au long de la mémoire artificielle à la fin du second livre; mais les détails les plus singuliers qu'il nous ait transmis sur cette méthode, se trouvent dans neuf chapitres du troisième livre de la Rhétorique à Hérennius, chap. 16 et suiv. Il paraît que les Grecs, inventeurs de cet art, ne conservèrent point les nombreux ouvrages où leurs ancêtres en avaient développé les règles (ad Herenn., III, 23 ), car M. Mai a publié dernièrement une assez mauvaise traduction grecque de ces neuf chapitres entiers, d'après un manuscrit de la bibliothèque Ambrosienne. C'est là sans doute l'origine d'un prétendu traité de Cicéron, de Memoria artificiali, dont quelques savants ont parlé. XXXVI. Turpi tutelæ judicio. Les Romains punissaient un tuteur qui avait mai administré les biens de son pupille; mais si le défenseur du pupille demandait une réparation et une amende plus forte que ne le voulait la loi, on le déboutait de sa demande, et le tuteur était déchargé de l'accusation. XXXVII. Cujus pecuniae dies juisset. Suivant les lois romaines, un créancier qui demandait au mois de juillet ce qui n'était dû qu'au mois d'août, était condamné à une amende considérable, aux frais de la procédure, et il ne pouvait plus se servir des privilèges accordés aux créanciers ; cette loi se trouve encore dans les Pandectes, liv. XLIV, de Exceptionibus. XL. C. Mancinum. Ce traité de Mancinus, et les événements qui en furent la suite, se rapportent à l'an de Rome 615 et 616. On trouvera les détails de cette affaire dans le tome VIII de l'histoire de Rollin. XLVI. Non tam caduceo.... Les ambassadeurs romains et les féciaux portaient une baguette dorée, entrelacée de deux serpents ; elle rendait leur personne sacrée, et elle inspirait la vénération et la crainte. XLIX. Si grammaticus.... Les anciens n'attachaient pas la même signification que nous au mot grammairien. Ils ne désignaient pas seulement sous ce nom celui qui s'occupe des principes élémentaires des langues; le titre de grammairien avait chez eux un sens beaucoup plus étendu. C'était l'homme qui s'adonne à l'étude de la littérature et des sciences, soit pour les enseigner, soit pour orner son esprit. C'était ce que nous entendons par homme de lettres, critique, érudit, philologue, etc. LII. In maxima concione tuorum civium. La loi Sempronia, portée par Caïus Gracchus, en 630, avait enlevé les jugements aux sénateurs pour les donner aux chevaliers. Servilius Cépion (dont il sera parlé dans le second livre) fit passer, pendant son consulat, en 647, une loi qui ordonnait que le droit de juger serait partagé entre l'ordre équestre et celui des patriciens. Les plus célèbres orateurs montèrent à la tribune, et le passage qu'on vient de citer est tiré de discours que prononça Crassus en fa. veur du sénat. Cette loi n'eut pas d'exécution, ou ne fut pas longtemps en vigueur, puisque, l'an 662, la même proposition fut faite par le tribun Drusus. Voyez le Brutus, chap. 34, note 71. LIII. In procinctu.... sine libra atque tabulis. Pour expliquer l'allusion comprise dans les mots latins sine libra atque tabulis, nous ne pouvons mieux faire que d'emprunter le passage suivant du savant ouvrage de M. Ducaurroy, les Institutes expliquées. « La transmission de l'hérédité ne s'opérait chez les anciens Romains que par un acte législatif. Les premiers. testaments ne furent que des lois privées, par lesquelles le peuple, sur la proposition de chaque citoyen, sanctionnait l'institution des héritiers choisis par ce dernier. Aussi les testaments se faisaient-ils calatis comitiis, c'est-à-dire dans une assemblée de comices, qui, deux fois par an, se tenait pour cet objet spécial. Pendant la guerre, les citoyens prêts à entrer en campagne, n'attendaient pas, comme en temps de paix, l'assemblée des comices; ils testaient in procinctu, c'est-à-dire, devant l'armée ; car procinctus, dit Caïus (2 Inst. 101), est expeditus et armatus exercitus. « Il arrivait souvent que les citoyens ne pouvaient pas attendre l'occasion de tester, soit dans l'assemblée des comices, soit in procinctu ; et pour leur donner un moyen plus facile de tester, les prudents introduisirent une vente de l'hérédité ou du patrimoine que l'on transféra par mancipation. Telle fut l'origine d'une troisième espèce de testament per aes et libram, que la désuétude des deux autres laissa seule en usage, mais qui tomba plus tard elle-même dans une désuétude partielle. « Il importe de retracer ici sa forme primitive et ses différentes modifications. « Pour la confection d'un testament, comme dans tout autre but, la mancipation se faisait entre deux parties contractantes, le vendeur et l'acheteur, en présence de six assistants pubères et citoyens romains, dont cinq témoins et un porte-balance appelé libripens. Le testateur déclarait vendre et transférer familiam suam à une personne qui se portait acheteur en termes solennels, et pour prix de la vente remettait au vendeur un lingot d'airain, dont elle touchait préalablement la balance du libripens. (Caius, 2 Inst. 104). On voit d'après cela pour-« quoi l'on désignait comme fait per aes et libram le testament qui résultait d'une mancipation, et pourquoi l'on appelait emptor familiae la personne à qui le testateur mancipait familiam suam, c'est-à-dire, son hérédité «ou l'ensemble et la totalité de ses droits. » « Effectivement, dans l'origine, on mancipait directement à la personne que l'on voulait avoir pour successeur, et l'héritier n'était autre que l'emptor familiae. Mais ensuite on reconnut qu'il était dangereux pour le testateur d'instituer, avec tant de publicité, un acheteur, dont le titre trop certain pouvait même être considéré comme irrévocable; et bientôt celui-ci ne fut plus qu'un intermédiaire entre le testateur et le véritable héritier. Il y eut toujours un emptor familiae; on continua de lui manciper la famille ou l'hérédité, mais seulement pour la remanciper, après la mort du testateur, à une ou plusieurs personnes dont celui-ci inscrivait le nom sur des tablettes qu'on appelle tabulae testamenti. Le testateur, tenant ces tablettes à la main, en confirmait le contenu par une déclaration solennelle, en invoquant le témoignage des assistants. Dès lors le testament ne consista plus uniquement dans une mancipation; on distingue la mancipation proprement dite, et la mancipation par laquelle le vendeur fait la désignation verbale, on confirme la désignation écrite d'un héritier, à qui l'hérédité doit être remise par l'emptor familiae, en sorte que la mancipation n'était plus, à l'égard de ce dernier; qu'une vente fictive. » Rutilius... ipse et sensu effecit. Voyez sur l'affaire de Rutilius Brut. ch. 30, et la note qui y est relative. LVII. Si verba non rem sequeremur. Cicéron expose ici ce qu'il lit lui-même en plaidant pour Cécina. Voyez ce plaidoyer, chap. 18 et suiv. Il y rappelle le discours de Crassus, prononcé, dit-il, paullo ante, quasis nos in forum venimus. In illa militis causa. Il était question d'un père qui, ayant reçu une fausse nouvelle de la mort de son fils, qui était à l'armée, institua héritier un de ses collatéraux. Voyez plus haut, chap. 38. LVIII. Magonis Carthaginiensis. On croit qu'il y a eu au moins deux écrivains carthaginois du nom de Magon : l'un grand voyageur, qui, selon Athénée, fit trois fois le tour du globe. II appartenait à l'illustre famille Barcée, et commanda les troupes carthaginoises. L'autre auteur du même nom, dit Poinsinet de Sivry, traducteur de Pline, écrivit sur les maladies des chevaux. Ce second Magon, ou peut-être un troisième, a écrit vingt-huit livres sur l'agriculture. Varron, Pline et Columelle le citent souvent et s'appuient de son autorité. Son ouvrage fut, dit-on. préservé des flammes, et envoyé à Rome par Scipion Émilien, après la prise de Carthage. Le sénat le fit traduire de la langue punique en latin, par Décimus Silanus. II paraît que les Romains en faisaient grand cas, et qu'il était souvent consulté . quoique Caton eût déjà écrit sur les mêmes matières. Il fut aussi traduit en grec par Dionysius Cassius, surnommé d'Utique, et non pas par Caton d'Utique. Servius dit que Virgile, dans ses Géorgiques, a souvent puisé dans l'ouvrage de Magon. LX. Tardiores tibicinis modos.., esse facturum. De quelle manière la flûte accompagnait-elle la voix des acteurs sur les théâtres anciens, et jusqu'à quel point le chant et la musique se joignaient-ils à la déclamation théâtre ; c'est une question qui n'a jamais été bien éclaircie, et qu'il est peut-être impossible de résoudre, comme toutes celles qui ont rapport à la musique des anciens. Le passage de l'Art poétique d'Horace, Tibia non ut nunc, etc. (v. 202), n'explique pas la difficulté. On peut voir ce que dit à ce sujet Marmontel (Éléments de littérature, article DÉCLAMATION THÉÂTRALE). Il cite l'opinion de l'abbé Dubos et celle de l'abbé Vatry. On consultera avec plus de fruit le chapitre soixante et dixième du Voyage d'Anacharsis, et les notes qui y sont jointes. LXII. Tum Scaevola. Cicéron, dans ses Lettres à Atticus (IV, 16), nous apprend pour quels motifs il n'a pas fait assister Scévola à l'entretien suivant. LIVRE SECOND. III. Q. Catulus senex, cum C. Julio fratre. Ils étaient fils de la même mère, Popillia (chap. Il). On peut voir sur ces deux orateurs le Brutus, chap. 35, 48. V. Discum audire malunt.. qui simul ut increpuit... Je regrette de n'avoir pas eu plus tôt connaissance de la note suivante, qui m'eût fait rectifier une erreur dans laquelle je suis tombé après tous les interprètes et tous les critiques, sans exception, qui se sont exercés sur le de Oratore. Cette note se trouve à la suite d'un petit poème, en vers latins purs et élégants, sur la vie de Collège (vita Scholastica) publié par M. Rossignol, agrégé de l'université, et philologue très érudit. « Pour appeler les baigneurs répandus dans les vastes gymnases qui entouraient les bains, les anciens se servaient d'une espèce de disque ou de tam-tam, peut-être aussi de métal composé, pour que les vibrations en fussent plus sonores : c'est dans une lettre de Marc-Aurèle à Fronton que j'en trouve la preuve. Marc-Aurèle parle d'un entretien familier qu'il a eu avec sa mère vers la fin de la journée, et qui a été interrompu par le bruit d'un disque annonçant que l'empereur venait de passer dans le bain. « Dum ea fabulamur, atque altercamur uter alterum vestrum magis amaret, discos crepuit, id est, pater meus in balneum transisse nuntiatus est. » Le mot Discus est évidemment l'équivalent du mot aes, dans ce vers de Martial : Redde pilum, sonat aes thermarum, ludere pergis. Le passage de Fronton nous derme l'explication naturelle d'une phrase de Cicéron mal comprise jusqu'à présent, et en emprunte lui-même une éclatante confirmation. Crassus, dans le de Oratore, se plaint de ce qu'on a détourné les gymnases de leur destination première, et il ajoute : « Nam et saeculis multis ante gymnasia inventa sunt, quam in his philosophi garrire coeperunt, et hoc ipso tempore, cum omnia gymnasia philosophi teneant, tamen eorum auditores discum audire quam philosophum malunt; qui simul ut increpuit, in media oratione de maximis rebus et gravissimis disputantem philosophum omnes unctionis cuusa reliquerunt. » Or tous les commentateurs et tous les traducteurs que je connais ont vu dans le mot discum l'instrument du discobole, et dans unctionis l'usage où étaient les lutteurs de se frotter d'huile avant d'engager la lutte. Mais d'abord il est évident qu'il s'agit ici d'une seule et même circonstance; en second lieu, l'instrument du discobole faisait-il du bruit, et ce bruit serait-il exprimé avec propriété par increrpuit ? Enfin le mot unctio se dit moins souvent de la lutte que du bain. Il ne faut donc voir dans discum que le tam-tam qui appelait les baigneurs, et dans unctionis que le bain lui-même, au l'action de se parfumer au sortir du bain. » VI. Persium. Voyer Brut., chap. 26,, et de Finibus, I, 3. VII. Quis mendacio nixa ait,... quae opiniones.... Ce que dit ici Antoine s'applique surtout à l usage qu'on était obligé de faire de l'éloquence dans les anciennes républiques, au milieu de la corruption des moeurs et du déchaînement de toutes les passions. « Aussi, dit Marmontel, Cicéron a beau dire que l'éloquence, la sagesse, la probité doivent aller ensemble; il n'est pas moins vrai que les livres de l'Orateur sont comme un arsenal où la bonne et la mauvaise foi, la vérité et le mensonge, la justice et la fraude trouvent également des armes. On y voit (ajoute-t-il, en parlant des orateurs romains), que le juste et l'injuste, le vrai, le faux, le crime, l'innocence, tout leur était indifférent; qu'une bonne cause était pour eux celle qui prêtait à leur éloquence des moyens de troubler l'entendement des juges, de leur faire oublier les lois, et de les remuer au point que la passion, dominant leur raison et leur volonté même, dictât seule leur jugement. Antoine, dans le même dialogue (II, 47, 48), avoue à Sulpicius, qu'il a gagné contre lui la plus mauvaise cause, et il dit comment il s'y est pris, comment il a fait succéder la douceur à la véhémence, comment il a triomphé de l'accusation, plus par l'émotion des âmes, que par la conviction des esprits. C'est une étude intéressante pour l'orateur, et plus sérieuse encore pour les juges, que de voir, dans ces livres de rhétorique, de combien de manières on peut s'y prendre pour les séduire, les étourdir, les égarer dans leurs jugements, et soulever en eux toutes les passions contre l'équité naturelle. », Éléments de littérature. Vlll. Quod carmen artificiosa verborum conclusione aptius ? On peut s'étonner d'abord de voir Cicéron préférer à l'harmonie des vers le nombre d'une période bien cadencée; mais il est vraisemblable qu'il ne parle ici que de la poésie romaine, telle qu'elle était de son temps. Les Grecs, doués d'une extrême délicatesse d'organes, d'une sensibilité exquise pour la mélodie, ne concevaient pas la poésie indépendamment de l'harmonie et du chant. Il n'en fut pas de même chez les Romains. Ce qui nous reste d'Ennius et de leurs anciens tragiques, peut nous faire juger que leur première poésie se recommandait beaucoup plut par l'énergie et l'élévation, par la douce des pensées, la justesse de l'expression, et même la grandeur des images poétiques, que par le nombre et l'harmonie. Les discours de Cicéron sont les premiers modèles de la langue latine où ces qualités se manifestent. Catulle et Lucrèce ses contemporains, paraissent les premiers qui, chez les Romains, aient ou le sentiment de l'harmonie poétique. Virgile la porta au plus haut degré de perfection ; mais Virgile écrivit qu'après Cicéron, et c'est peut-être an grand orateur qu'on doit le grand poète. X. Ut ait ille in Trinummo. Dans la pièce de Plante, que rappelle ici Catulus, un valet, enchanté de ce que vient de aire un des personnages appelé Lysitelés, s'écrie (art. III, sc. II) :
Nom enim possum,
quin exclamem: Euge ! Euge ! Lysiteles, πάλιν. Tum Anionius. « Lorsqu'on se rappelle la prédilection qu'avait Cicéron pour la secte des académiciens, qui avait pour principe de discuter beaucoup et d'affirmer peu, et de reconnaître bien plus de choses probables que de choses démontrées, on n'est pas surpris de voir Antoine revenir presque entièrement à l'avis de Crassus, et avouer, en badinant, qu'il n'a coule qu'essayer, dans sa réfutation, s'il lui enlèverait ses deux jeunes disciples, Sulpicius et Cotta; mais qu'actuellement, devant les nouveaux auditeurs qui leur sut arrivés, il ne songe qu'à dire sincèrement ce qu'il pense... » La Harpe, Cours de Littérature, tome II. XI. Quum abs te est Popillia laudata. Selon Plutarque, dans la Vie de Camille, longtemps avant Popillia, on avait prononcé les éloges funèbres de quelques dames romaines, qui avaient donné leurs bijoux pour accomplir un voeu fait en l'honneur d'Apollon. On peut concilier cet deux auteurs en disant que l'usage de louer sur la tribune toutes les femmes de qualité, même celles qui n'avaient jamais rien fait d'éclatant hors de leur ménage, commença à Popilia. (Desmeuniers.) - Dans la suite, Auguste prononça, dans le temple de César, l'éloge de sa soeur Octavie; et Néron, sur la tribune, celui de Poppée, dont il fut successivement l'amant, l'époux et l'assassin. Voyez l'Essai sur les Éloges, chap. 10 et 11. Quam contra collegam censor habuit. C'était Domitius Ahénobarbus, quadrisaïeul (atavus) de l'empereur. Néron. Il fut censeur l'an de Rome 662. Voyez Pline, XVII, 1; Valère Maxime, IX, 1. XII. Ut noster Cato, ut Piclor, ut Piso. L'histoire a eu son enfance comme tous les autres genres de littérature. Partout elle a commencé par de simples annales; partout sa marche a dû suivre le développement de l'esprit humain, les progrès de la civilisation et des lumières. On me permettra de citer, sur les diverse; révolutions que subit la manière d'écrire l'histoire, quelques réflexions judicieuses de M. Patin, professeur de poésie latine à la faculté des lettres: « Quand les hommes imaginèrent de supplier par des monuments à l'incertitude des traditions, l'histoire prit naissance; mais le devoir des historiens se bornait d'abord à bien peu de chose. De simples annales, destinées à conserver la mémoire du fait, du temps, du lieu, des personnages, c'était là toute leur tâche. Tels furent chez les Grecs, au rapport de Cicéron, Phérécyde, Hellanicus, Acusilas, et beaucoup d'autres; tels furent, chez les Romains, Caton, Fabius Pictor et Pison; tels furent, dans les temps modernes, tous tes faiseurs de chroniques. Ils étaient bien loin de vouloir plaire en instruisant, et peut-être bien loin de vouloir instruire; ils ne se proposaient que d'aider la mémoire, et de guider la tradition, plutôt que de la remplacer. Mais après la longue enfance des sociétés, arriva, par une marche toute naturelle, l'âge de la civilisation et de la politesse. On crut voir dans l'histoire un moyen certain de plaire, en présentant à la fois une instruction solide. Des orateurs, que des raisons particulières éloignaient de la tribune et du barreau, racontèrent les actions dignes de mémoire : ils le firent en orateurs. L'histoire ne fut plus, comme dans ses premiers commencements, une suite de dates et de noms propres, une simple nomenclature; elle devint une scène vivante, où chacun parut avec son caractère, ses vices et ses vertus; les événements ne furent plus seulement indiqués, ils furent racontés, développés, exposés aux yeux du lecteur; on les suivit avec intérêt dans des récits vifs, animés, dramatiques; on devint, selon l'expression du poète,
Contemporain de
tous les âges, On eut des Hérodote, des Thucydide, des Xénophon, des Salluste, des Tite-Live et des Tacite. Mais déjà avait paru parmi eux un historien qui devait faire révolution dans la manière d'écrire l'histoire. Polybe, en racontant les guerres Puniques, ne s'attacha pas seulement à retracer les faits avec exactitude, il voulut en développer les causes. Guidé par cette idée philosophique, que la plupart des événements de ce monde ne sort pas le fruit du hasard, mais le résultat presque inévitable de la force des choses; qu'ils arrivent le plus souvent, parce qu'ils doivent arriver; il chercha à faire voir que la chute de Carthage et l'agrandissement de Rome étaient des conséquences nécessaires de la constatation des deux républiques; il le prouva par le tableau comparé de leur gouvernement, de leur puissance, de leurs ressources. Cette manière d'envisager l'histoire ne fut pas perdue pour les modernes. Les anciens n'avaient guère prit que l'histoire des hommes; ils entreprirent de faire aussi l'histoire des choses. L'histoire d'un peuple ne fut donc plus seulement celle de ses maîtres, de ses ministres, de ses généraux, de ses grands hommes; elle devint encore celle de ses institutions, de ses meurs, de ses idées. Bientôt le domaine de l'histoire s'agrandit encore. Elle ne se borna plus aux annales d'une seule nation; elle embrassa, d'un coup d'oeil hardi, toutes les nations connues; elle les rapprocha, les compara dans des tableaux généraux, et, à travers la multitude des événements, la multiplicité des intérêts, elle suivit la marche lente de l'esprit humain, les progrès successifs des lumières et de la civilisation, quelquefois même le développement d'une idée particulière. Dès lors elle présenta une instruction plus vaste et plus solide; elle devint plus austère, plus grande : mais peut-être aussi devint-elle moins attachante; peut-être, en s'occupant des grandes niasses, perdit-elle quelque chose de cet intérêt qui s'attache aux individus. » XII. Erat historia nihil aliud, nisi annalium confectio. Nous empruntons la traduction de ce passage à l'ouvrage publié en 1838, par un savant académicien, M. J. V Leclerc sons ce titre : Des Journaux chez les Romains, ouvrage ingénieux et piquant, où en traitant une question neuve, l'auteur a réuni à la profondeur de k'érudition, la sagacité des vues et l'élégance de la forme; c'est un des livres dont s'honore le critique français dans ces dernières années. Nous y renvoyons le lecteur pour tout ce qui concerne les Annales. Pherecydes, Hellanicus, Acusilas... De ces trois historiens grecs, Acusilas et Phérécyde sont les plus anciens. Acusilas d'Argos paraît avoir composé le premier un corps d'histoire régulier. Peu de temps après, Phérécyde de Léros, qu'il ne faut pas confondre avec le philosophe, recueillit les traditions relatives à l'histoire d'Athènes, et par occasion, à celle des peuples voisins. Son ouvrage, au rapport de Denys d'Halicarnasse (Antiq. Rom., liv. i, pag. 10), contenait des détails intéressante, tels que la fondation de plusieurs villes, et les émigrations des premiers habitants de la Grèce. Hellanicus de Lesbos est à peu près contemporain d'Hérodote. Il avait écrit sur l'histoire des différentes nations de la Grèce. Thucydide, I, 97, lui reproche de manquer d'ordre et d'étendue dans son histoire d'Athènes. Il mourut dans la vingt et unième année de la guerre du Péloponnèse, c'est-à-dire, vers l'an 410 avant J. C. On peut consulter sur ces trois historiens, et sur ceux qui sont nommés ensuite, le Voyage d'Anacharsis, chap. 65, et le traité de Vossies sur les historiens grecs. XXIV. Susceptis rebus...receptis. On aurait pu traduire cette phrase d'une manière aussi exacte et plus concise, en disant : Ils méritent le reproche d'avoir ou négligé leur ouevre ou trahi leur mission; ou bien encore : ils méritent d'être accusés soit de négligence à l'égard de l'affaire, soit de déloyauté à l'égard du client. XXVIiI. Excitare rem consularem, M'. Aquillius, général d'un mérite et d'une bravoure signalés. II avait terminé (l'an de Rome 651) la guerre des esclaves en Sicile. Mais, dit Rollin, comme il ne se piquait pas de probité aussi bien que de courage, il fut, trois ans après, accusé de concussion, et n'échappa à l'exil que par l'éloquence entraînante d'Antoine. 1l avait été collègue de Marius dans son cinquième consulat. Antoine (chap. 47) parle avec détail de sa défense d'Aquillius. Voyez, sur cette même affaire, Cicéron, Verrines, V, 1. Hominem seditiosum furiosumque. Voyez plus bas la note du chap. XLVII. XXXVII. Carneadem et Critolaum. Carnéade était de la secte académique; Diogène, de la secte stoïque; et Critolaüs, péripatéticien. Les auteurs ne sont pas d'accord sur l'époque précise de leur voyage à Rome. On le place vers les dernières années de la seconde guerre Punique. Voyez, sur les motifs de leur ambassade, Rollin , Histoire ancienne, tomes IX et XI. Sicut Zethus Ille Pacuvianus... Euripide avait comosé sur Antiope, reconnue par ses deux fils Zéthus et Amphion, et vengée par eux de ses persécuteurs Lycus et Dircé, une tragédie fort célèbre dans l'antiquité, et qu'imitèrent ou traduisirent successivement, pour la scène latine, Livius Andronicus, Ennius, enfin Pacnvius. La pièce de Pacuvius conserva longtemps une grande réputation; Cicéron, qui la cite souvent, prononce une sorte d'anathème contre ceux qui ne l'admireraient pas autant que lui : « quis tam inimicus paene nomini romano est, qui Antiopam Pacuvii spernat aut rejiciat? » (de Fin. I, 2.) Cela n'a pas empêché Perse d'en parler avec un mépris que justifient assez les quelques mots qu'il parait lui emprunter :
Sunt quos Paccuvius et verrucosa movetur Pacuvius , en reproduisant la pièce d'Euripide, n'avait pas omis une scène où ce poète, un peu sophiste, avait introduit une de ces thèses par lesquelles il flattait l'esprit un peu sophistique aussi de ses auditeurs. Zéthus, rude pasteur, y blâmait de ses goûts libéraux, qu'il appelait mollesse efféminée, fainéantise, son frère Amphion , gratifié par Mercure de la lyre qui lui servit à élever les murs de Thèbes. Amphion se défendait, et la dispute, qui avait commencé par une censure et une apologie de la musique, finissait par le procès de ce que les anciens appelaient sagesse, et qui comprenait tout ce qui cultive l'âme et police les mœurs, c'est-à-dire les artis , les lettres, les sciences, la philosophie. Cicéron, après Platon dans le Gorgias, a fait (ad Herenn., II, 27; de, Invent. , 50; de Rep., I , 18, etc.) de nombreuses allusions à cette scène, qu'on n'eût guère dû attendre dans une tragédie de sujet mythlogique, et qui montre que les anciens ne se piquaient pas !toujours beaucoup de couleur locale. Depuis, Horace l'a rappelée (Ep.. I, XVIII, 41) dans le, temps où Hygin (Fab. VIII) et Properce (Eleg. III, XV) donnaient de la pièce elle-même des espèces d'analyses qui ne s'accordent pas en tout. Des débris qui en restent, épars dans les ouvrages de l'antiquité, Valckenaer, après Heinsius, a tiré une sorte de restitution du morceau qu'on lira avec intérêt dans le vue chapitre de sa Diatriba in Euripidis fragmenta. Voir, sur le Zéthus de Pacuvius, la Rhétorique à Herennius, II, 27. XXXVII. Ut Neoptolemus apud Ennium. Celte citation , qui se retrouve au commencement du IIe livre des Tusculanes, et dans Aulu Gelle liv. V, chap. 15, 16, est tout ce qui reste de la tragédie d'Ennius, à laquelle il appartenait. XXXVIII. Cujus et ilium legi librum. Cet ouvrage d'Aristote est perdu. Les commentateurs croient qu'il est ici question des douze livres auxquels il donna le nom d'Atacton. XXXIX. Domicilia omnium argumentorum. Cicéron parle plus au long de tous ces lieux communs dans la Rhétorique à Hérennius, l'Invention, les Topiques, les Partitions oratoires; il ne fait ici qu'en diminuer le nombre. S'il répète des détails aussi secs , il a soin de n'en dire qu'un mot. Cependant ces analyses paraissent plus conformes au goût de Cicéron qu'à celui d'Antoine. XL. Hic parvae consuetudinis, etc. Vers tirés de l'Andrienne de Térence , I, 1, 84. XLV. Nisi signa doloris tui.... ostenderis. Boileau a dit dans son Art Poétique :
Il faut, dans la
douleur, que vous vous abaissiez; et Horace :
... Si vis me flere, dolendum est XLVI. Segregare abs te ausus.... La scène, si éloquemment citée et comme décrite dans ce passage, appartenait à une tragédie imitée par Pacuvius du Teucer de Sophocle. Télamon y reprochait à Teucer de n'avoir point empêché ou du moins vengé la mort de son frère Ajax, et le condamnait à cet exil pour lequel le fait partir, sans doute en souvenir sinon de la tragédie de Pacuvius, du moins de celle de Sophocle, Horace dans sa belle ode à Plancus :
... Teucer
Salamina patremque Dans un mot emprunté par Cicéron (Tusc., V, 37), à la même pièce, et, peut-être à la même scène, « patria est ubicumque bene est » on peut voir une expression de la résignation de Teucer assez conforme à celle que lui prête Horace. XLVII. Aquillius. Voyez sur M'. Aquillius la note du chap, 28. In accusando sodali et quœstore meo. Il faut se rappeler les faits sur lesquels est fondé le célèbre procès dont Antoine va rendre compte- Servilius Cépion, consul l'an de Rome 647, attira aux Romains, par son orgueil et son incapacité, une des plus honteuses et des plus sanglantes défaites dont leur histoire fasse mention. Il fut vaincu en 648 , sur les bords du Rhône , par les Cimbres , el perdit quatre-vingt mille hommes. Le peuple indigné le dépouilla à son retour de sa charge de proconsul. Dix ans après celte première condamnation , traduit de nouveau devant le peuple par le tribun Norbanus, il trouva des défenseurs parmi les patriciens, dont il s'était concilié la faveur par sa lui sur les tribunaux. (Voyez la note 1 du livre 1, chap. 7.) Scaurus, prince du sénat, et tout l'ordre des sénateurs, s'intéressèrent pour lui. L. Crassus, celui qui joue le principal rôle dans ces dialogues, se chargea de le défendre; deux tribuns, Didus et Cotta, mirent opposition à la loi de leur collègue. Norbanus, voyant que la force pourrait seule triompher de celte résistance, excita une émeute populaire. A son tour, il fut appelé en jugement par Sulîcius ; mais l'éloquence d'Antoine le sauva de la peine qu'il avait méritée. Il est vraisemblable que la haine que le peuple portait à Cépion contribua puissamment à faire absoudre son accusateur, quoique sa condamnation partit inévitable. Ce Cépion, fameux en outre par le pillage du trésor de Toulouse, s'était rendu méprisable à plus d'un titre. Tous les historiens l'ont représenté sous les couleurs les plus odieuses. C'est sans doute, dit Rollin, par attachement aux principes aristocratiques du sénat, que Cicérone parle plusieurs fois avec éloge d'on homme qui avait mérité si justement la sévérité de l'histoire. Voyez le Brutus, ch. 35 et note. On peut voir plus haut, dans la note du ch. 7, l'opinion de Marmontel sur la conduite d'Antoine dans ce procès. LII. Acerrimus.... omnium motus invidiae. Les effets de l'envie et les moyens de l'exciter, sont admirablement développés dans le chap. 10 dusecond livre de la Rhétorique d'Aristote. Toute la première partie de ce livre, qui traite des Moeurs et des Passions, est un chef-d'oeuvre de profondeur et de vérité. Nul philosophe n'a peut-être poilé plus loin la science de l'observation. LIV. Grœcos inscriptos libros... de ridiculis. Diogène Laërce nous apprend que Théophraste, par exemple, avait écrit un ouvrage sur le moyen d'exciter le rire (περὶ γελοίου). Bona dicta. Ce mot offre la même équivoque en latin qu'en français. Ennius entendait par bona dicta, des propos vertueux, des paroles utiles. LVIII. De omni isto genere perbreviter exponam. Un illustre savant du seizième siècle, Adrien Turnèhe, professeur de langue grecque au collège royal , a consacré un livre entier de ses Adversaria à l'explication de toutes les plaisanteries rapportées par César. Ce livre est intitulé : In Jocos Ciceronianos libri secuntdi de Oratore explicatio. LIX. Duo enim sunt genera facetiarum. Il faut convenir que la plupart des plaisanteries citées par Cicéron nous paraissent bien froides, bien communes, bien peu agréables. La gravité du caractère romain se prêtait peu à ce genre d'esprit, qui demande avant tout de la finesse et de la gaîté. D'ailleurs, la différence des mœurs, des habitudes et des institutions doit aussi, sur cette matière, faire beaucoup varier le goût suivant les temps ou les pays. Nous ne prétendons pas justifier toutes les plaisanteries qui sont présentées ici comme modèles; mais on doit au moins faire observer qu'il en est beaucoup qui, renfermant une allusion à des moeurs ou à des usages qui nous sont étrangers, avaient plus de sel pour les Romains que pour nous. Plusieurs aussi tiennent au mot, et roulent sur une équivoque de langage : il n'est pas possible de les faire passer d'une langue dans une autre; nous serons même quelquefois obligés de ne pas essayer de les traduire. LX. Manus lava. Appius avait la réputation de souiller ses mains par des rapines. Puer, abige muscas. Ce Sempronius avait sans doute le surnom de Musca. On trouve un Sempronius Musca dans Tite-Live, XCV, 13. LX!. Num claudicas? at hic claudicat. Il est difficile de faire entendre ce prétendu bon mot. Il roule sur le double sens de claudicat, qui signifie boiter, chanceler, être faible, incertain, sans constance, sans fermeté. Num claudicat? était une forme proverbiale par laquelle ou affirmait de quelqu'un qu'il n'avait pas de faiblesse. La réponse, ut hic claudicat, est une allusion faite à ce proverbe pour le démentir. Quelques critiques écrivent clodicat, ce qui signifierait fait le Clodius. LXI. Quid hoc Naevio ignavius ?... circumveniri. Ce changement de lettres qui se trouve dans le latin, et qui fait la plaisanterie, n'a pu être transporté dans la traduction : quid hoc Nœvio ignavius? Nevius ressemble à gnavus, qui veut dire brave, et à ignavus, qui veut dire lâche; il n'y a presque qu'une lettre à changer. Quant à la plaisanterie de Philippe , elle consiste dans le changement du mot circumveniri, être circonvenu , être trompé, en celui de hircum veniri , mot forgé qui semble signifier, être approché par un bouc. Hircum est l'accu. salit de hircus, qui signifie bouc. (Note de M. Andrieux.) Il est probable que la prononciation aspirée de la première syllabe du mot hircum ajoutait encore à la conformité de son. LXI. Calvus satis est.... Les commentateurs proposent, sur ce mot Calvus satis est quod dicit parum, plusieurs explications, et même différentes versions fort peu satisfaisantes : les uns veulent que Calvus soit un nom d'homme; les autres veulent qu'on l'entende dans son sens ordinaire de chauve. Turnèbe est de ce dernier avis, et il observe que, chez les Romains, on avait une prévention défavorable contre les chauves, qu'on les regardait comme de malhonnêtes gens, et cherchant à tromper; tellement que le verbe calvor signifiait tromper, dérober; que les mimes, qui représentaient des personnages ridicules et même odieux, comme les marchands de belles esclaves, portaient des masques rasés n'ayant ni cheveux ni sourcils, ce qui leur donnait une physionomie difforme, propre à faire rire. Il ajoute que le mot dicere parum est équivoque ; qu'il signifie à la fois , parler peu, et ne pas être éloquent, ne pas savoir parler; et qu'ainsi le mot cité dans cet endroit doit s'entendre par, il est chauve; tant mieux s'il parle peu, et s'il n'est pas éloquent, car il pourrait bien nous tromper. (Note de M. Andrieux. ) Quid potest esse tam ridiculum quam Sannio est? Le Sannion était un de ces personnages convenus qui égayaient les farces latines. C'est à lui que parait se rattacher, par son surnom de Zanni, l'Arlequin moderne, d'aussi noble origine que le Polichinelle napolitain, issu, cornette l'on sait, du Maccus des Atellanes. « Arlequin et Polichinelle, dit Schlegel (Cours de litt. dramat.) seraient sans doute bien étonnés d'apprendre qu'ils descendent en droite ligne des anciens Romains et même des Osques : cette souche glorieuse leur inspirerait une burlesque fierté. » LXII. Brachium fregisse. L'équivoque est plus complète dans l'original. Brachium fregisse signifie également qu'il s'est cassé un bras, ou qu'il a cassé le bras d'une statue. Nuculam an confixum vis facere ? Les commentateurs se sont animés inutilement d'expliquer ce passage. L'équivoque tombe sur le double sens du mot confixum, et peut-être de Nucula. Pour comprendre ce vers elle Lucilius, il faudrait avoir le passage d'où il est tiré. Voici la note du jésuite Proust sur cette équivoque, edit. ad usum Delphini : « Si etiamnum exstarent Lucilii satirae, huic sententiae, quam non nisi divinando possumus assequi, lumen afferrent. nunc qualemcumque sensum, explosis aliorum turpiculis interpretationibus, elicimus : Quid? o Deci , inquit alius quispiam, an Nuculam hominem vis configere? Configi autem aliquis et mucrone et sermone asperiori dicitur, in quo ambiguum posuit Africanus. » Sextantis. Le même jésuite fait ici cette note : « Sextans est sexta pars assis. Res aliqua magni pretii esse dicebatur : Gramus dixit, ilium non esse sextantis. Ambigunm est : si enim, ut vox unica, pronuntietur, significat vilissimum et minimum pretium; si separate legatur sex tantis, sensus erit, id de quo agitur, non esse comparandum et aequiparandum ses aliis tantis, seu pluris valere, quam alia sex, tanta'e seu aequalis magnitudinis et pretii, adeoque esse rem valde pretiosam. » LXlIl. Nihil addo. Les lois étaient fort dures à Rome contre les débiteurs insolvables : elles autorisaient les créanciers à les charger de chaînes, à les emmener de l'autre côté du Tibre pour être vendus et devenir esclaves. Dans l'exemple que César cite, et qui parait tiré d'une comédie de Névius, cet homme qui voit passer le malheureux débiteur qu'on vient de vendre, arrête celui qui le conduit, et demande pour quelle somme ce pauvre débiteur vient d'être adjugé. il semble vouloir faire quelque chose en sa faveur, payer ou répondre pour lui, afin qu'il obtienne sa liberté. Point du tout. Après qu'on lui a dit le prix, il a l'air de n'avoir eu que l'intention de satisfaire une vaine curiosité, et il dit : Je n'ajoute rien ; emmenez-le. Le côté comique de cette parole, c'est qu'elle trompe, et qu'on attendait toute autre chose de cet homme qui paraissait s'être intéressé à l'infortuné débiteur. Il y a de plus une équivoque dans cette expression , nihil addo, Je n'ajoute rien, qui peut signifier, je n'ai plus rien à vous dire; ou bien, je n'ajoute pas d'argent, je n'enchéris pas sur la somme pour laquelle il a été vendu. (Note de M. Andrieux. ) LXIII. M. Nobiliorem. M. Ful vins Nobilior, qui triompha des Étoliens, l'an de Rome 567. Il fut accusé de concussion. On lui reprochait en outre d'avoir mené avec lui, à l'armée, le poèle Ennius, ce qui était une chose nouvelle. Caton, qui parla contre lui, lui donna, à cette occasion , le surnom de mobilior, pour désigner la légèreté de son caractère. Nummium divisorem. A Rome, depuis que la corruption s'était introduite dans les élections, les candidats achetaient publiquement les suffrages. Quand ils descendaient au Champ de Mars, ils avaient avec eux des personnes chargées de distribuer en leur nom de l'argent aux tribus, pour obtenir leurs voix. Ces distributeurs s'appelaient divisores, et leurs fonctions étaient peu estimées. Ce trafic, quoique expressément défendu par les lois, se faisait ouvertement. Il se fit une fois pour empêcher l'élection de César, et même avec l'approbation de Caton. (Suéton., Julius, 19. ) Des individus nominés interpretes, marchandaient les votes du peuple, et ceux entre les mains de qui on déposait le prix convenu, étaient nommés sequestres. C'est à cet abus que Juvénal fait allusion dans ce vers , X, 77 :
... Ex quo
suffragia nulli César disait que Nummius avatl pris son nom de nummi, des écus qu'il distribuait au Champ de Mars. LXIV. Tuam legem de civitate. L'an de Rome 658, les consuls L. Licinius Crassus et Q. Mucius Scévola portèrent une loi, de Civitate, pour empêcher l'usurpation frauduleuse du titre de citoyen. (Cic., de Off., II, 11 ; pro Balbo, 21, 24; pro C. Cornelio.) Cette loi s'appela de leur nom lex Licinia-Mucia. Elle devint une des causes principales des guerres italiques ou Marsiques. (Ascon., ad Orat. pro Cornel.) Quibus nec mater, nec pater. L'application n'était ni décente ni juste. Scaurus n'était point bâtard; il était patricien, et de l'illustre maison des Émile, mais d'une branche tombée dans une si grande pauvreté, que son père était réduit, pour se soutenir, à faire le commerce du charbon. Son fils devint consul, censeur et prince du sénat. LXIV. Triginta minis. La mine attique valait cent drachmes (environ 90 fr., selon l'évaluation de Barthélemy). Il fallait soixante mines pour faire un talent attique. Il faut se souvenir que la plupart des comédies latines étaient traduites du grec; voilà pourquoi les monnaies y sont grecques, aussi bien que les personnages. Antoine faisait entendre par sa citation que l'argent avait été dérobé par le fils libertin à son père, comme cela se pratiquait dans les comédies, et que ce bon homme, qui ne savait comment ses fonds avaient disparu, prétendait qu'ils avaient été employés à gagner des suffrages. (Note de M. Andrieux.) Agas asellum. Ce proverbe signifiait sans doute : Vous avez beau chasser un âne, il ne courra jamais. Quelques commentateurs supposent qu'il était ainsi conçu : Agas asellum, cursum non docebitur; d'autres, Agas asellum, si bovem agere non queas. Scipion, en ne prononçant que les deux premiers mois d'un proverbe très connu, laissait achever à chacun le sens dans sa pensée. On voit qu'il joue sur l'équivoque du nom propre Asellus. Tutor, mimus vetus. On donnait aussi le nom de mimes à des pièces d'un genre bouffon, jouées par des mimes. li est ici question d'un ancien mime , ou ancienne pièce bouffonne, qui avait pour titre le Tuteur. Nous avons sous ce même titre une petite pièce de Dancourt, laquelle, par la bouffonnerie qui y règne, pourrait passer pour un ancien mime. (Note de M. Andrieux.) Maleaginensem Scipionem. La plaisanterie de Scipion Maluginensis consiste à répondre sur L. Manlius, quand on l'interroge sur L. Manlius Acidinus. C'était au crieur à s'expliquer mieux. Ex tui animi sententia. Il paraît que ces mots étaient la formule ordinaire du censeur quand il demandait aux citoyens s'ils étaient mariés. Nasica répond qu'il l'est, mais non ex animi sui sententia. Si, d'après Aulu Gelle, IV, 20, on lit dans la réponse, non hercule ex tui animi sententia, le sens est bien différent, et il y a quelque chose de plus piquant dans la pensée. Nasica fut dégradé par le censeur, relatus in aerarios, pour s'être permis cette plaisanterie. LXV. Turmales dixit displicere. Ce jeu de mots , par lequel Scipion faisait entendre aux Corinthiens qu'il était peu jaloux d'un honneur trop prodigué, a moins de sens en français que dans la langue latine, où le mot turma se prend métaphoriquement pour désigner une réunion de statues équestres. Ainsi, dans Velléius, I , 11 : « Hanc turmam statuarum equestrium... ex Macedonia detulit. » Et dams Cicéron même, ad Attic., VI, 1 : « In turma inauratarum equestrium. » Cortem in Palatio. Basse-cour, c'est-à-dire apparemment, théâtre de débauches. LXVII. Ad aquas. Noue donnons à ces mots le sens qu'ils ont très souvent dans les bons auteurs, comme dans cette phrase des lettres familières, XVI, 24: Puto utrumqne ad aquas. Il s'agit ordinairement des eaux de Baïes. LXVII. L Metello. Il reprochait par là à Métellus le luxe et le faste de ses maisons de campagne, dont les immenses bâtiments se voyaient des portes de Rome. LXIX. Et in ejus tabulis ostenderet. Il faut se rappeler que les pères de famille, à Rome, étaient obligés de tenir un registre journalier de leur famille et de leur propre dépense (voyez ci-dessus, chap. 23), et que ceux qui y manquaient étaient regardés comme négligents et d'une mauvaise conduite. Ces registres faisaient foi en justice, et les juges en exigeaient quelquefois la présentation pour y trouver des éclaircissements sur le point en litige. On dit même qu'un certain nombre d'accusés ayant été condamnés d'après leurs propres registres ou tablettes, la coutume de les écrire régulièrement se perdit. Quoiqu'il en soit, dans l'affaire dont il est question, Scaurus interprétait ces quatre lettres, qu'on avait trouvées sur les tablettes de P. Rutulius : A. F. P. R de celte manière : Actum fide P. Rutilii; ce qui voulait dire, selon lui, que Rutilius avait fait distribuer de l'argent pour corrompre les suffrages, et que cela s'était fait sous sa foi, c'est-à-dire, sous l'engagement qu'il avait pris de rendre les sommes données par son ordre. Rutilius disait qu'il avait entendu écrire en simples initiales, ante factum, post relatum ; que c'était un article de dépense qu'il avait oublié de porter à sa date, et que, s'en étant souvenu , il l'avait inscrit de cette manière; fait auparavant, et relaté depuis. L'explication de Canius était des trois la plus claire, et elle était assez plaisante : Aemilius fecit, pleclitur Rutilius; Émilius (Scaurus) a fait ce dont il accuse son adversaire (il a brigué, acheté des suffrages) ; Rutilius est puni quand son accusateur devrait l'être; on lui a refusé le consulat pour le donner à Scaurus. (Note de M. Andrieux.) LXXI. M. Cincius quo die legem.... La loi Cincia, portée en 549, et ainsi appelée du nom de son auteur M. Cincius Alimentus, tribun du peuple, s'appelait aussi lex muneralis, parce qu'elle avait été faite de donis et muneribus. Elle défendait de recevoir de l'argent et des présents pour plaider une cause. La plaisanterie de Cincius; consiste en ce qu'il répondait à ce mot à double sens Quid fers, d'une manière sentencieuse et pareille aux formules dans lesquelles les lois étaient conçues. Ce genre de plaisanterie se retrouve dans une satire d'Horace, II, I , où il suppose qu'il s'entretient avec le jurisconsulte TrIbatius, qui lui reproche de faire des satires, et qui, sans y penser, retombe toujours dans le style des sentences et des formules qui lui est familier :
.. . Ter uncti LXXII. Turpius.. nocuisse causae quam non profuisse. On peut voir à ce sujet l'histoire des frères Cépasius plaisamment racontée par Cicéron dans son plaidoyer pour Cluentius, 20 et 21. LXXXVI. Simonidi illi Ceo.... Quintilien (liv. XI, ch. 2) raconte à peu près de la même manière, et dans le même but, l'aventure de Simonide, et y joint une petite dissertation sur les personnages et le lieu de la scène. il donne aussi quelques détails sur la mémoire artificielle. Nous n'avons pas besoin de rappeler la fable si connue de la Fontaine, Simonide préservé par les dieux. LXXXVIi. Qui sit... Oratori memoriae fructus. Ce que dit Cicéron des avantages de la mémoire, ne doit pas nous faire penser que les orateurs anciens apprissent par coeur des discours composés d'avance, et les récitassent dans les mêmes termes où ils les avaient écrits, selon la méthode suivie généralement parmi nous par les prédicateurs, et quelquefois par les avocats. Si dans le premier dialogue (chap. 33) il paraît faire entendre le contraire. lorsqu'il conseille aux orateurs d'écrire leurs discours, il faut remarquer qu'il recommande ce travail , moins comme nue pratique habituelle et constante, que comme un exercice utile pour se former à la correction, à l'élégance et à l'harmonie. On sait que le plus souvent les anciens n'écrivaient leurs discours qu'après les avoir prononcés, et qu'ils se contentaient de rédiger auparavant des notes pour guider leur marche, et un canevas plus on moins étendu. Si quelquefois ils les écrivaient tout entiers, ils ne s'astreignaient pas à suivre servilement cette rédaction. Les grands effets connus de l'éloquence ancienne, et les préceptes mêmes développés par Antoine sur l'invention oratoire, viennent à l'appui de cette opinion. Nous citerons à ce sujet l'autorité de Fénelon, qui, dans son second dialogue sur l'Éloquence, commente ce passage de Cicéron sur la mémoire. « - Croyez-vous que Démosthène et Cicéron ne savaient pas par coeur ces harangues si achevées que nous avons d'eux ? Nous voyons bien qu'ils les écrivaient; mais nous avons plusieurs raisons de croire qu'ils ne les apprenaient point par coeur mot à mot. Les discours mêmes de Démosthène, tels qu'ils sont sur le papier, marquent bien plus la sublimité et la véhémence d'un grand génie, accoutumé à parler fortement des affaires publiques, que l'exactitude et la politesse d'un homme qui compose. Pour Cicéron, on voit, en divers endroits de ses harangues, des choses nécessairement imprévues. Mais rapportons-nous à lui-même sur cette matière. Il veut que l'orateur ait beaucoup de mémoire; il parle même de la mémoire artificielle comme d'une invention utile; mais tout ce qu'il en dit ne marque point que l'on doive apprendre mot à mot par coeur; au contraire, il paraît se borner à vouloir qu'on range exactement dans sa tête toutes les parties de son discours, et que l'on prémédite les figures et les principales expressions qu'on doit employer, se réservant d'y ajouter sur-le-champ ce que le besoin et la vue des objets pourrait inspirer : c'est pour cela même qu'il demande tant de diligence et de présence d'esprit dans l'orateur. » Dans le même dialogue, l'éloquent archevêque de Cambrai compare deux orateurs dont l'un apprend par coeur, et dont l'autre parle sans réciter mot à mot ce qu'il dit. Ce passage peut nous donner une assez juste idée de la méthode de composition des anciens; et quoiqu'il soit un peu long et qu'il s'applique particulièrement à l'éloquence de la chaire, nous ne pouvons résister au plaisir de le transcrire. On nous permettra sans doute de citer le seul ouvrage, peut-être, qui dans notre langue puisse être opposé à celui de Cicéron. « Je mets d'un côté un homme qui compose exactement tout son discours, et qui l'apprend par coeur jusqu'à la moindre syllabe: de l'autre, je suppose un homme savant qui se remplit de son sujet, qui a beaucoup de facilité à parler; un homme qui médite fortement tous les principes du sujet qu'il doit traiter, et dans toute leur étendue; qui s'en fait en ordre dans l'esprit, qui prépare les plus fortes expressions par lesquelles il veut rendre son sujet sensible, qui range toutes ses preuves, qui prépare un certain nombre de figures touchantes. Cet homme sait sans doute tout ce qu'il doit dire, et la place où il doit mettre chaque chose : il ne lui reste, pour l'exécution, qu'à trouver les expressions communes qui doivent faire le corps du discours. Croyez-vous qu'un tel homme ait de la peine à les trouver? - Il ne les trouvera pas si justes et si ornées qu'il les aurait trouvées à loisir dans son cabinet. - Je le crois; mais, selon vous-même, il ne perdra qu'un peu d'ornement; et vous savez ce que nous devons penser de cette perte, selon les principes que nous avons déjà lésés. D'un autre côté„ que ne gagnera-t-il pas pour la liberté et pour la force de l'action , qui est le principal? supposant qu'il se soit beaucoup exercé à écrire, comme Cicéron le demande, qu'il ait lu tous les bons modèles, qu'il ait beaucoup de facilité naturelle et acquise, qu'il ait un fonds abondant rte principes et d'érudition , qu'il ait bien médité tout son sujet, qu'il l'ait bien rangé dans sa tête. Nous devous conclure qu'il parlera avec force, avec ordre, avec abondance. Ses périodes n'amuseront pas tant l'oreille : tant mieux, il en sera meilleur orateur. Ses transitions ne seront pas si fines ; n'importe : outre qu'il peut les avoir préparées sans les apprendre par coeur, de plus, ces négligences lui seront communes avec les plus éloquents orateurs de l'antiquité, qui ont cru qu'il fallait par là imiter la nature, et ne montrer pas une trop grande préparation. Que lui manquera-t-il donc? Il fera quelque petite répétition; mais elle ne sera pas inutile : non seulement l'auditeur de bon goût prendra plaisir à y reconnaître la nature, qui reprend souvent ce qui la frappe davantage dans un sujet; mais cette répétition imprimera plus fortement les vérités : c'est la véritable manière d'instruire. Tout au plus trouvera-t-on dans son discours quelque construction peu exacte, quelque terne impropre, ou censuré par l'Académie, quelque chose d'irrégulier, ou; si vous voulez, de faible et de mal placé, qui lui aura échappé dans la chaleur de l'action. Il faudrait avoir l'esprit bien petit pour croire que ces fautes-là fussent grandes s on en trouvera de cette nature dans les plus excellents originaux; les plus habiles d'entre les anciens les ont méprisées. Si nous avions d'aussi grandes vues qu'eux, nous ne serions guère occupés de ces minuties. Il n'y a que les gens qui ne sont pas propres à discerner les grandes choses, qui s'amusent à celles-là, etc. » LXXXVIII. Verborum memoria. Voyez sur la mémoire artificielle la fin du troisième livre de la Rhétorique à Hérennius, et les notes du premier livre de l'Orateur, chap. 34, etc. LIVRE TROISIÈME. 1. Extremo scenicorum ludorum die. Voyez, sur les jeux scéniques, les Lettres familières, VII, 1. Habita in concione a Philippo. Sur la querelle entre Crassus et le consul Philippe, voyez les notes des Livres précédents et celles du Brutus. Pignoribus ablatis Crassum instituit coercere. Le pouvoir du consul ou du magistrat qui présidait le sénat n'a pas toujours été le même aux différentes époques de la république romaine. Il paraît qu'il pouvait faire saisir un sénateur qui violait la discipline établie dans les délibérations. Caton, pour empêcher l'adoption d'un décret, employa à discourir un jour entier; César, alors consul, ordonna de le conduire en prison ; mais le sénat s'étant levé pour y suivre l'orateur, César révoqua son ordre. (Aulu Gelle, IV, 10) On pouvait aussi lui imposer une amende, et en attendant qu'il l'eût payée, on prenait un gage ou une hypothèque sur ses biens, ce qui s'appelait pignora auferre. Voyez le chap. 5 de la première Philippique, et Aulu Gelle, XIX, 7. II. O falalcem hominum spem, fragilemque fortunam ! « Ô vanité! ô néant! ô mortels ignorants de leurs destinées! » Bossuet, Oraison funèbre de Henriette d'Angleterre. Ardentem invidia senatum. Toutes les traductions se sont trompées sur le sens de ce passage, comme sut' celui de beaucoup d'autres. Ardentem invidia senatum ne veut pas dire que le sénat était déchiré par les discordes, ni sceleris nefarii reos, que les premiers citoyens aspiraient à la tyrannie. Le tribun Drusus, pour s'appuyer de l'influence des alliés, s'était engagé à leur faire obtenir le droit de cité romaine, en leur donnant le sénat pour garant de sa promesse. Lorsqu'il eut succombé dans ses entreprises ambitieuses, les alliés, voyant leur espoir trompé, se soulevèrent de tous côtés, et telles furent la cause et l'origine de la guerre Sociale. Tout ce qu'avait l'ait Drusus fut annulé, et un tribun nommé Varius, à l'instigation des chevaliers, profita du mécontentement général pour faire passer une loi, en vertu de laquelle on devait informer contre ceux dont les mauvaises pratiques avaient forcé les peuples de l'Italie à prendre les armes. Cette accusation regardait les premiers sénateurs qui avaient eu tant de liaisons avec Drusus, et par lui avec les alliés. C'est à ces faits que font allusion les expressions que nous avons citées plus haut. II. Non luctum filiae. La fille de Crassus était célèbre par ses lumières et les grâces de son esprit. Cicéron en parle dans le Brutus, chap. 58. Elle avait épousé un Scipion Nasica, petit-fils de P. Cornélius Scipion, fils de Scipion Corculum, et surnommé Sérapion. III. Viris qui hoc sermone continentur. Tous les interlocuteurs du dialogue, excepté Cotta, périrent de mort violente dans les guerres civiles qui suivirent la guerre Sociale. Il serait trop long de raconter le détail de ces événements, et le sort des autres personnages célèbres, nominés ici par Cicéron. Nous renvoyons le lecteur aux historiens qui ont parlé des guerres civiles. On pourra consulter aussi les notes du Brutus, et celles des Lettres. Non vidit.. mortis opportunitate, etc. Ce morceau si pathétique et si éloquent, inspiré à Cicéron par le souvenir de la mort de Crassus et des suites épouvantables des guerres civiles, a été imité par Tacite dans les deux derniers chapitres de la Vie d'Agricola. L'imitation est même tellement marquée, qu'on s'étonne de voir un génie aussi original s'approprier les idées d'un autre, surtout dans un moment où il semblait ne devoir chercher d'autres inspirations que celles de son coeur. Nous n'accuserons pas l'historien de larcin; il est plus convenable de penser qu'en empruntant les tours, les mouvements, et même les expressions d'un passage très connu, il a voulu rendre hommage au plus grand orateur de sa nation, et consacrer son admiration pour un des plus beaux génies qui aient honoré l'humanité. IV. Mihi quidem, Quinte, frater.... Cicéron fait ici un retour douloureux sur lui-même. La destinée déplorable des hommes fameux qu'il vient de citer lui rappelle son exil et ses malheurs. Il semble qu'il prévoie déjà les orages politiques qui vont bientôt éclater, et qu'un sinistre pressentiment lui montre dans l'avenir le triste sort réservé à son éloquence et à sa vertu. II se rappelle les conseils que lui donnait la tendresse inquiète de son frère; mais il ne regrette pas de s'être exposé dans cette carrière périlleuse , et il se console, par la pensée de la gloire, de ses infortunes passées et peut-être de ses infortunes à venir. « Les premiers chapitres de ce troisième dialogue forment, dit la Harpe, un épisode du plus haut intérêt; et quand l'auteur nous montre cette tête sanglante de l'orateur Antoine, attachée à la tribune, ne se rappelle-t-on pas aussitôt celle de Cicéron lui-même placée quelques années après à cette même tribune par cet autre Antoine, qui, bien différent de son illustre aïeul, se signala par le crime et la tyrannie, comme l'orateur s'était signalé par ses talents et ses vertus? » VI. Una est eloquentia. « C'est surtout dans le troisième livre, dit la Harpe, qu'on aperçoit sous quel point de vue aussi vaste que hardi et lumineux, Cicéron avait embrassé tout l'art oratoire. Il ne peut se résoudre à séparer l'orateur du philosophe et de l'homme d'État. Il se plaint du préjugé des esprits étroits et pusillanimes, qui, rapetissant tout à leur mesure, ont séparé ce qui de sa nature est inséparable. Il reproche ans rhéteurs d'avoir renoncé par négligence et par paresse à ce qui leur appartenait en propre, en se tenant au talent de bleu dire., comme s'il était possible de bien dire sans bien penser, et souffrant que les philosophes s'attribuassent exclusivement tout ce qui est du ressort de la morale, usurpation évidente sur l'éloquence. Il va jusqu'à réclamer, en faveur de ses prétentions, cette chaîne immense qui lie ensemble toutes les connaissances de l'esprit humain; il les voit comme nécessairement combinées et dépendantes les unes des autres; et cette idée, aussi grande que vraie, qui a été de nos jours la base de l'Encyclopédie, et qui est mieux exposée dans la préface qu'elle n'est exécutée dan: le livre, Cicéron, de tous les anciens, paraît être le seul qui l'ait connue. » XII. Equidem quum audio socrum meam Laeliam. Cicéron parle ainsi d'après ses propres souvenirs. Il dit, dans le Brutus, chap. 68 : « J'ai plus d'une fois assisté aux entretiens de Lélia, fille de C. Lélius. On voyait briller en elle toute l'élégance de son père. J'en dis autant des deux Mucia ses filles, dont j'ai connu la manière de parler, et des deux Licinia ses petites-filles (filles de Crassus), que j'ai entendues l'une et l'autre. » XIV. Horum, qui nunc ita appellantur, rhetorum. C'est du temps de Crassus que des Grecs établis à Rome commencèrent à donner des leçons sur l'art oratoire; ils prirent le nom de r/taures , et ils introduisirent ce mot grec, dans la langue latine. XV. Apud Homerum Phoenix, etc. Voyez Iliade, liv. IX, v. 428. XIX. Haec autem, ut ex Apennino fluminum.... Cette phrase de Cicéron, si belle, si hardie et si intraduisible, offre un rapport remarquable avec tue phrase célèbre de Bossuet, qui présente une confusion semblable dans les termes de la comparaison : « Nous mourons tous, disait cette femme, dont l'Écriture a loué la prudence au second livre des Rois, et nous allons sans cesse au tombeau, ainsi que des eaux qui se perdent sans retour. En effet, nous ressemblons tous à des eaux courantes. De quelque superbe distinction que se flattent les hommes , ils ont tous une môme origine , et cette origine est petite. Leurs années se poussent successivement comme des flots : ils ne cessent de s'écouler; tant qu'enfin, après avoir fait un peu plus de bruit, traversé un peu plus de pays les uns que les autres, ils vont tous ensemble se confondre dans un abîme, où l'on ne reconnaît plus ni princes ni rois, ni toutes ces autres qualités superbes qui distinguent les hommes; de même que ces fleuves tant vantés demeurent sans nom et sans gloire, mêlés dans l'Océan avec les rivières les plus inconnues. » Oraison funèbre de Madame, duchesse d'Orléans. XIX. Veterem ilium Periclem. Nous croyons que Cicéron se sert du mot veterem pour marquer son antiquité, et non pour distinguer le célèbre Périclès, fils de Xanthippe, et disciple d'Anaxagore, de Périclès d'Éphèse. homme inconnu, dont il fait mention dans la première Verrine, chap. 33. XXI. Coracem. On voit que Crassus joue sur le mot corax, nom d'un rhéteur syracusain, qui, en grec, signifie corbeau. Cette plaisanterie est une de celles qui ne peuvent pas se traduire. Pamphilum. Ce Pamphilus est cité par Aristote, Rhétorique, II, 23, et par Quintilien, III, 6. Au rapport de Suidas, il avait imaginé des figures pour représenter les éléments des différents arts. Il avait pu appliquer cette méthode à la rhétorique, et en représenter les règles sur de petites bandes d'étoffe, in infulis, pour en faire des jouets d'enfants. N'avons-nous pas aussi des jeux historiques, géographiques, etc.? Cette conjecture est tout aussi vraisemblable que celles de Turnèbe et d'Ernesti. XXIIi. Magister hic Saturninum. Les Samnites étaient une sorte de gladiateurs ainsi nommés à cause de leur armure, et que les Romains employaient d'ordinaire à la fin de leurs festins pour amuser leurs convives, quod spectaculum inter epulas erat, dit Tite-Live (IX, 40) , qui nous apprend en cet endroit l'origine du nom de ces gladiateurs. Comme ils n'avaient pour arme offensive que des fleurets, ils se disputaient longtemps la victoire; et Horace (Epist., II , 2 , 98) appelle cet exercice lentum duellum. Il compare tes fausses louanges que les poètes se donnent mutuellement aux coups sans effet que se portaient les gladiateurs samnites. Voyez Juste-Lipse, Saturnal., II, 11. XXIII. Philosopho quum operam daret... Ce philosophe éatit Panétius. Voyez la dissertation de Van Lynden sur Panétius, p. 51. XXIV. Quos ego censor... sustuleram. Crassus ferma les écoles des rhéteurs latins ; mais elles se rouvrirent après sa censure. Aulu Gelle, XV, 11 , dit que le décret des censeurs Domitius Ahénobarbus et Licinius Crassus était conçu en ces termes : « Nous avons appris que des hommes, prenant le nom de rhéteurs latins, ont ouvert de nouvelles écoles, où la jeunesse se porte en foule et passe les jours dans l'oisiveté. Nos ancêtres voulaient que leurs enfants fussent élevés d'une autre manière. Celte institution nous déplaît , et ne nous paraît pas utile. Nous avons cru devoir témoigner aux rhéteurs latins et à leurs disciples, que nous la désapprouvons. » Il y a beaucoup de modération dans les termes du décret, nobis non placere. C'était la formule. On trouve aussi ce monument dans Suétone, au commencement de son ouvrage de claris Rhetoribus. XXVI. Nam sapiens virtuti, etc. on ne sait de qui est ce vers, ni d'où il est emprunté. Il faut en dire autant du suivant : Ecquid video, etc.
Quid petam Praesidi ? On voit, dans le chap. 19. liv. III des Tusculanes, que ces vers appartenaient à l'Andromaque d'Eunnius. XXVIII. Surculo defringendo. Par le mot surculus, l'orateur romain fait allusion à une ancienne coutume qui consistait, en cas de contestation sur la propriété d'un terrain, à briser une motte de terre, ou à rompre une branche sur ce terrain, afin de constater ses droits à la propriété. XXXIt. Non inaurata statua, sed aurea statueretur. Si l'on en croit Pline l'Ancien, Hist. nat., XXXIII, 24,Gorgias ce serait élevé lui-même cette statue, sibi posuit; mais il veut mieux s'en rapporter à l'assertion exprimée ici par Cicéron , et à celle de Valère Maxime, VIII, 11, et de Pausanias, X. Selon ce dernier auteur, la statue n'était que dorée. XXXlII. Magntiudines sunt artium diminutae. Ce dont se plaint ici Crassus est une suite inévitable, de la nature des choses. Dans l'enfance des sociétés, les connaissances humaines sont nécessairement bornées; les sciences ne se composent que d'un petit nombre d'observations; on ne sent pas encore le besoin de les diviser, et l'intelligence d'un seul homme peut sure à en saisir tout t'ensemble. Mais bientôt l'expérience et le besoin conduisent à de nouveaux faits; les observations se multiplient, et le cercle des idées s'étend. Les rapports des choses, mieux connus, et déterminés avec plus d'exactitude, doivent amener de nouvelles classifications, et l'on sépare ce que jusque là une analyse moins éclairée avait réuni. Ainsi les sciences se divisent et se compliquent, à mesure qu'elles se perfectionnent. Il n'est plus possible désormais à la faiblesse humaine de les embrasser toutes, lorsqu'une seule quelquefois peut occuper l'activité d'une vie entière de travaux et d'études. XXXIII. Bonarum artium... societatem cognationemque.... On peut voir le développement de pensées analogues dans le célèbre discours du chancelier d'Aguesseau, sur l'union de l'éloquence et de la philosophie. XXXIV. Cujus in labris leporem habitasse... Allusion à des vers d'Eupolis, très souvent cités par les anciens. Clepsydram. La clepsydre, ou horloge d'eau. On s'en servait chez les anciens pour limiter, dans certaines circonstances, la durée des discours. Socraticis... disputationibus. Socrate fut même accusé d'avoir formé de tels disciples. Voyez son Apologie par Platon, et les Mémoires de Xénophon sur son maître. Philolaus Archytam Tarentinum. Les éditions antéieures à celles d'Orelli (Zurich , 1828) donnent, ainsi que la plupart des manuscrits, aut Philolaum Archytas Tarentiinus. Plusieurs manuscrits, et une ancienne édition sans date, collationnés par M. Mueller, appuient la nouvelle leçon que l'on a cru devoir suivre ici, parce qu'elle s'accorde mieux et avec l'ensemble du sens et celui de la période, et avec les divers témoignages de l'antiquité sur l'âge de Philolaüs. Dès 1829, M. A. Boeckh, dans nue excellente monographie sur ce philosophe, avait fait observer (pag. 7) combien il était peu probable que Philolaüs, signalé par les anciens comme le mimiez élève de Pythagore qui eût rédigé et publié quelques parties de la doctrine de son maître, fit venu après Archytas, auteur d'un grand nombre d'ouvrages analogues dont il nous reste de nombreux fragments. Barthélemy, dans les tables chronologiques de son voyage d'Anacharsis, et Tennemann, (Manuel de l'hist. de la Philosophie, § 95) placent également le philosophe de Tarente aprés Philolaüs. La variante aut Philolaus Archylam Tarentinum confirme ces inductions de la critique, et en reçoit à son tour une nous elle autorité. XXXV. Versum quendam Philotletae.
Αἰσχρὸν σιωπᾷν, βαρβάρους
δ' ἐᾷν λέγειν. Le vers que parodiait Aristote appartenait, pense-t-on à une tragédie, où Euripide avait traité, après Eschyle et Sophocle, le sujet de Philoctète. Une comparaison des trois pièces, et une paraphrase du prologue qui ouvrait celle d'Euripide, l'une et l'autre de Dion Chrysostôme (Orat.,LII, LIX), donnent sur le dernier des trois Philoctète de curieux renseignements, et peuvent conduire à une explication du vers cité par Cicéron, et dont Quintilien (Instit. orat., III, I) s'est aussi souvenu, ainsi que de l'application qu'en fait Aristote. Il y est dit, que dans la tragédie d'Euripide, les Troyens, informés de l'importance attachée par les oracles à la possession du héros et de ses flèches, essayaient de se l'attacher. C'était probablement, comme le remarque Valckenaer (Diatr. in Euripid. fragm., chap. XI), à celte tentative que s'appliquait le vers dont il s'agit. Qui le prononçait? la phrase de Cicéron donnerait à penser que c'était Philoctète. Des savants cependant, entre autres Musgrase, préfèrent le rapporter au rôle d'Ulysse. Matthiae (Euripide, fragm, tom. 9, p. 281), au sujet du mot d'Aristote sur Isocrate, rapporté par Cicéron et par Quintilien, fait la remarque suivante : « Quod vero Cicero et Quintilianus narrant contra Isocratem hoc versu usum esse Aristotelem, id temporum rationibus repugnat, ut jam munuit. Aldobrand. ad Diog. Laert. locum, si quidem Isocrates vita excessit olympiad. 110 , 3, Aristoteles ol. III, 2 demum Athenis scholam aperuit. Sed fortasse illud de Aristotele non Stagirita, sed Siculo valet, quem Diogenes, l. V, 35, scribit πρὸς τὸν Ἰσοκράτους Πανηγυρικὸν ἀντιγεγραγέναι, vel de iis quae Aristotelem Stagiritam ipsum contra Isocratem jam mortuum scripsisse, ῥυπαίνειν τὸν ἄνδρα βουλόμενον, narrat Dionys. Halic. Judic. de Isocr. 18, t. v, p.577. Ed. Reisk., ubi etiam apologiam Isocratis a Cephisodoro scriptam, ἐν ταῖς πρὸς Ἀριστοτέλη ἀντιγραφαῖς commemorat. » XXXVI. Hic Sulpicius.... Fénelon, en recommandant d'unir les études philosophiques aux études oratoires, paraît blâmer la méthode à laquelle s'arrête Sulpicius. Il désapprouve ces gens qui vivent au jour la journée, sans nulle provision : « Malgré tous leurs efforts, ajoute-t-il, leurs discours paraissent toujours maigres et affamés. Il n'est pas temps de se préparer trois mois avant de faire tin discours public : ces préparations particulières, quelque pénibles qu'elles soient, sont nécessairement très imparfaites, et un habile homme en remarque bientôt le faible; il faut avoir passé plusieurs années à se faire un fonds abondant. Après cette préparation générale, les préparations particulières coûtent peu : au lieu que quand on ne s'applique qu'a des actions détachées, on est réduit à payer de phrases et d'antithèses, ça ne traite que des lieux communs, on ne dit rien que de vague , on coud des lambeaux qui ne sont pas faits les uns pour les autres; on ne montre point les vrais principes des choses; on se borne à des raisons superficielles, et souvent fausses; on n'est pas capable de montrer l'étendue des vérités, parce que toutes les vérités générales ont un enchaînement nécessaire, et qu'il les faut connaître presque toutes pour en traiter solidement une en particulier. Je voudrais qu'un orateur se préparât longtemps en général pour acquérir un fonds de connaissances, et pour se rendre capable de faire de bous ouvrages. Je voudrais que cette préparation générale le mit en état de se préparer moins pour chaque discours particulier. Je voudrais qu'il fût naturellement très sensé, et qu'il ramenât tout au bort sens; qu'il fil de solides études, qu'il s'exerçât à raisonner avec justesse et exactitude, se défiant de toute subtilité. Je voudrais qu'il se déliât de son imagination , pour ne se laisser jamais dominer par elle, et qu'il fondât chaque discours sur un principe indubitable dont il tirerait les conséquences naturelles. »
Scribendi recte sapere est et principium et fons. XXXVIII. Ut Coelius. Ce passage de l'historien Célius Antipater était imité, en effet, de quelques vers de tragédie, qu'on trouvera plus bas, chap. 59. Voyez aussi l'Orateur, chap. 49.
Tum pavor sapientiam omnem mihi exanimato expectorat. Le premier de ces deux vers est de l'Alcméon d'Ennius. Il est cité encore dans les Tusculanes, IV, 8. On ne sait si le second appartient à Pacuvius, à Attius, ou à Ennius. Il est d'Attius, si l'on admet la conjecture de Görenz de Finibus, IV, 25. Les mots versultloquas malitias sont cités dans l'Orator, 49.
XXXIX
........................ Inhorrescit mare, Ces vers appartenaient à une tragédie de Pacuvius intitulée : Duloreste (ou Oreste esclave.) Les deux premiers sont cités dans le traité, de Divinatione, I, 14. Les vers fiançais sont tirés de l'Idoménée de Crébillon. Ils ont beaucoup de rapport avec ceux de Pacuvius, et en sont peut-être imités. XXXIX. Quandoq idem iste, etc. On ignore de qui est ce vers, et d'où il est tiré. XL. Ut pes in navi. Par le mot pes, les anciens désignaient soit l'extrémité inférieure de la voile, soit le cordage au moyen duquel cette voile était attachée paras partie basse au flanc du navire, connue elle l'était aux antennes par sa partie supérieure. La manœuvre qui consistait à tendre et à attacher ainsi la voile, pour la présenter à l'action du vent, s'appelait facere pedem.
Una omnes
fecere pedem etc. Nexum quod per libram agitur.... Chez les Romains la balance, libra, intervenait dans plusieurs actes ayant pour but soit de transférer la propriété, soit de constituer une obligation. Dans le premier cas, l'acte s'appelait mancipatio; dans le second, il prenait le nom de nexum. Nous avons déjà vu (liv. I, ch. 53, et note) une espèce de testament dite per aes et libram, qui se faisait par la mancipation, c'est-à-dire, sous la fiction d'une transaction entre deux parties contractantes, dont l'une était censée vendre, et l'autre acheter. Le prix de l'objet vendu était représenté par du métal, de l'airain, tes; et comme primitivement ce métal, non encore monnayé, était livré sous la forme de lingot, il fallait le peser. Delà la présence d'un officier public appelé Libripens, qui, armé d'une balance , présidait à la transaction. On voit combien il s'en faut que le mot nexum désigne ici un contrat de mariage, comme toutes les traductions l'ont à tort supposé. Coeli ingentes fornices. Il paraît que par fornix il ne faut pas entendre une voûte dans le sens équivalent à l'expression poétique cet convexes. Car dans ce cas on ne voit pas pourquoi cette figure serait blâmée par Cicéron. Le mot fornix signifie apparemment une voûte oblongue et non circulaire, comme l'arche d'un pont, le dessous d'un portique, d' un arc de triomphe. Il se prend même três souvent dans ce dernier sens. Ainsi on trouve plus haut, livre II, ch. 66, Ita sibi ipsum magnum videri . Memmium, ut in forum descendens caput ad fornicem Fabii demitteret.
... Vive, Ulysses, dum licet : On ne sait d'où sont tirés ces deux vers, ni quel en est l'auteur. Cicéron (Academic. I, Iib. II, c. 28, ed. T. V. Leclerc), en parlant d'un homme dont la raison serait égarée, fait évidemment allusion , dans la phrase suivante, à une scène de quelque tragédie : « Quid loquar de insanis?... quid ille « qui, » Video, video te vivent , Ulysses, dum licet: « Nonne etiam bis exclamant se videre, cum omnino non e videret ? » Si l'on pense, avec de savants critiques (Görenz, Schütz, Bothe) que c'est le même vers qui se trouve cité dans les Académiques et dans le de Oratore, avec la différence de vivum à vive, il faudra admettre que ce mot a été altéré dans l'un ou l'autre des deux ouvrages, ou, ce qui n'a rien d'invraisemblable, que Cicéron lui-même, soit trompé par sa mémoire, soit pour donner plus de sens au vers qu'il isolait en le citant, lui aura fait subir, ici ou là, ce léger changement. Quoiqu'il en soit, il est fort probable que ce vers, ou ces deux vers, appartenaient à une tragédie d'Ajax, et étaient mis dans la bouche de ce personnage. XLI. Quidnam est, obsecro. Ce vers et le suivant ne contagio mea, etc, appartenaient au Thyeste d'Ennius. Le second est cité dans les Tusculanes, III,12. Neque me patiar iterum, etc. On ne sait d'où sont empruntés ces deux vers, ainsi que les deux suivants : Erras, erras, etc. Bothe les place parmi les fragments ex incertis incertorum tragaediis. XLII. Africa terribili, etc. Cicéron, dans l'Orator, ch. 27, cite ce même vers comme d'Ennius; mais, en le citant, il en rompt la mesure, qu'il rétablit ici. Nos sumu' Romani, qui fuvimus ante Rudini. Juste-Lipse (Lect., liv. V, chap. 2) pense que ce vers appartenait à quelque passage dans lequel Ennius, né à Rudic (Rudiae), ville de Calabre, se félicitait d'avoir reçu le titre de citoyen romain. Cicéron rappelle aussi cette circonstance dans le discours pro Archia, c. 9 : « Ergo illum qui haec fecerat, Rudium hominem, majores nostri in civitatem receperunt. » Il est probable que le vers précédent, at Romanus homo, est également d'Ennius. XLIII. Quam Iepide Iexeis, etc. Ces deux vers de Lucilius sont encore cités dans I'Orator, ch. 44.- Sur Albucius, voyez le Brutus, ch. 35, avec la note, et le de Finib., I, 3, où Cicéron cite sept vers de Lucilius. XLIV. Hanc diligentiam subsequitur modus, etc. Dans une note du ch. VII de son Essai sur les Langues, J. J. Rousseau cite, sans le traduire , tout ce passage, sur lequel se fondent, dit-il, quelques savants, pour prétendre que les anciens ont connu et pratiqué dans l'écriture les signes appelés accents. Interspirationis, etc. Le texte a paru à de bons critiques altéré dans cet endroit. On a proposé, non sans apparence de raison, de lire, interspirationis enim, non defatigatione nostra, etc. On trouvera, dans le ch. 68 de l'Orator, des idées semblables à celles que Cicéron ex-prime ici. XLVI. Fastigium illud. Voyez la note du chap. 43, seconde Philippique. Les antiquaires ne sont point tout à fait d'accord sur le vrai sens du mot fastigium. Perrault, dans ses notes sur Vitruve, l'explique par un fronton surmonté d'acrotères. On retrouve ce terme d'architecture, de Divinat., I, 10; Tite-Live, XXVI, 23; XI., 2; Pline, XXXV, 12; XXXVI, 2 , 5 , etc. XLVII. Quid petant praesidi, etc. Vers tiré de l'Andromaque d'Ennius. Voyez plus bas les notes du ch. 58. On consultera surtout l'Orateur, chap. 52.71 , si l'en veut avoir une idée plus approfondie de l'harmonie oratoire dans la langue latine. De temps de Crassus, les Romains ne connaissaient pas encore assez bien cette partie de l'art du style, et Cicéron ne veut pas id faire honneur à Crassus d'une science dont il donna lui-même le premier les préceptes et les modèles. L. Antipater ille Sidonius. Sur Antipater de Sidon, qui avait le talent d'improviser, voyez Pline, VII, 51; Valère Maxime, I, 8 ; Cicéron, de Fato, chap. 2 , et l'Introduction au plaidoyer pour Archias. LIII. Nam et commoratio.... Il ne faut pas oublier, avant de parcourir cette énumération un peu confuse, quelle est l'opinion constante de Cicéron sur les figures. Il entend par là tous les mouvements et les tours qu on peut donner à la phrase, toutes les attitudes du style, σχήματα, comme il s'exprime lui-même, Orat., c. 25. Telle est aussi la doctrine de la Rhétorique à Hérennius, dans tout le quatrième livre, où l'on voit au rang des figures de pensées l'amplification, l'exemple, etc.; nouveau point de conformité entre cet ouvrage et ceux que l'on ne conteste pas à Cicéron. C'est à quoi n'a point songé Quintilien, IX, 2, lorsqu'il lui reproche d'avoir compris dans sa classification plusieurs formes du discours, qui, suivant lui, ne sont point des figures. Mais Quintilien, IX, 1, comme plusieurs rhéteurs modernes, entendait par figures des façons de parler, éloignées de la forme commune et ordinaire, fausse définition si bien réfutée par Dumarsais. Il était difficile qu'il fût de l'avis de Cicéron. Voyez l'Orateur et les notes. LIV. Depuis l'énumération de parties, l'auteur cite quelques figures de pensées, qui ne paraissent pas être à leur place. LV. Quid maxime deceat.... Voyez la traduction elles réflexions de Marmontel, Éléments de littérature, au mot CONVENANCE. LVI. Voyez, pour ce chapitre et les suivants, l'analyse de Marmontel, au mot DÉCLAMATION ORATOIRE. Quanto... magis admiremini. Le mot d'Eschine tel qu'il est cité par Pline le jeune, II, 3 , a plus d'énergie : Τί δὲ, εἰ αὐτοῦ τοῦ θηρίου τ' αὐτὰ ῥήματα βοῶντος ἀκηκόοιτε. La Harpe, en rappelant ce fait, ajoute la réflexion suivante : « Je ne conçois pas, je l'avoue, comment il eut le courage de lire à ses disciples la harangue de Démosthène. On peut sans crime être moins éloquent qu'un autre; mais comment avouer sans rougir qu'on a été si évidemment convaincu d'être un calomniateur et un mauvais citoyen? » LVIII. Impius hortatur me frater, etc. Suivant Bothe (Poetae scenici latin. fragm.), dont les opinions sur ces fragments sont quelquefois conjecturales, ce vers appartenait à l'Atrée d'Attius. Il est encore cité dans les Tusculanes, IV, 36. Segregare abs te ausus. Ce vers, déjà cité, liv. II, chap. 46, est tiré du Teucer de Pacuvius. Ecquis hoc animadvertit? Vincite. Cicéron cite encore ce vers dans le liv. IV, ch. 25, des Tusculanes, et le cite comme d'Attius. « Croirons-nous, dit-il, qu'Ésopus fût en colère en prononçant ces mots, ou Attius en les écrivant? » Nam aut egisse unquam iratum Aesopum, aut scripsise existimamus iratum Attrium ? Quo nunc me vertam, etc. Tiré de la Médée d'Ennius, suivant Bothe. O pater! o patria! o Priami domus! Ce verset les deux suivants sont cités par Cicéron (Tusc., III,19), comme appartenants à l'Andromaque d'Ennius. Multi' modis sum circumventus, etc. Cité par Cicéron (de Finibus bon. et mal., IV, 23), comme appartenant à l'Alcméon d'Ennius. Iterum Thyeste, Atreum , etc. Tiré de l'Atrée d'Attius, suivant Bothe. LVIII. Sed mihi cum delutit, etc. Plusieurs manuscrits portent tetulit. On ne sait d'où sont tirés ces trois vers. Roth suppose, avec apparence de raison, qu'ils sont empruntés de quelque comédie latine. Il faut remarquer que trois manuscrits ont, au second vers, Ajaci au lieu de alteri, ce qui pourrait faire croire qu'ils se trouvaient dans une tragédie. Qua tempeatate Paris, etc. On ne sait de qui sont ces trois vers, dont les premiers mots sont encore cités dans l'Orateur, ch. 49. Bothe les range parmi les fragmenta ex incertis incertorum tragoediis. LIX. Qui personatum, ne Roscium quidem... Ce passage de Cicéron ne doit pas nous faire penser que Roscius jouât ordinairement sans masque; nous savons au conte aire que, du temps de Cicéron, cet usage était établi chez les Romains, à cause de l'immense étendue de leurs théâtres Pour expliquer cette espèce de contradiction, M. Schlege. (Cours de Poésie dramatique) pense que ce célèbre acteur cédait quelquefois au désir de ses concitoyens, en se dispensant de suivre une coutume généralement pratiquée; nais cette conjecture est inutile. Festus nous apprend que l'usage des masques dans les comédies et les tragédies est postérieur de plusieurs armées au poète Névius, quum multis post annis comoedi et tragædi personis uti coeperint ; on ne s'en servait jusque-là que dans les Atellanes. Or, Névius mourut vers l'an de Rome 550; ainsi les vieillards dont parle Crassus (en 662) avaient pu voir les commencements de cet usage et les premiers succès de Roscius. Athénée dit même (liv. XIV) que Roscius fut le premier ou un des premiers, à Rome, qui introduisit le masque dans la comédie et la tragédie. Sur l'usage des masques, outre un passage assez curieux de Quintilien (XI, 3), on pourra consulter, Barthélemy, Voyage d'Anacharsis; l'abbé Dubos; un Mémoire de Boindin, Académie des inscriptions, tom. IV, pag. 132, un Mémoire de Mongez, troisième classe de l'Institut, tom. I, pag. 256; le Traité italien de Ficoroni, traduit en latin; Winkelmann, tom. i. pag. 411. L'Onomasticon du grammairien Julius Pollux fournit aussi quelques renseignements sur cette question. Inest quaedam vis a natura data. « Tout l'art des bons orateurs ne consiste qu'à observer ce que la nature fait, quand elle n'est pas retenue. Ne faites point comme ces mauvais orateurs qui veulent toujours déclamer, et ne jamais parler à leurs auditeurs; il lient au contraire que chacun de vos auditeurs s'imagine que vous parlez à lui en particulier. Voilà à quoi servent les tons naturels, familiers et insinuants. Il faut, à la vérité, qu'ils soient toujours graves et modestes; il faut même qu'ils deviennent puissants et pathétiques dans les endroits où le discours s'élève et s'échauffe. N'espérez pas exprimer les passions parle seul effort de la voix; beaucoup de gens, en criant et en s'agitant, ne font qu'étourdir. Pour réussir à peindre les passions, il faut étudier les mouvements qu'elles inspirent. Par exemple, remarquez ce que font les yeux, ce que font les mains, ce que fait le corps, et quelle est sa posture; ce que fait la voix d'un homme, quand il est pénétré de douleur, out surpris à la vue d'un objet étonnant. Voilà la nature qui se montre à vous; vous n'avez qu'à la suivre. Si vous employez l'art, cachez-te si bien par l'imitation, qu'on le prenne pour la nature môme. Mais, à dire le vrai, il en est des orateurs comme des poètes qui font des élégies ou des vers passionnés. Il faut sentir la passion pour la bien peindre; l'art, quelque grand qu'il soit, ne parle point comme la passion véritable. Ainsi, vous serez toujours un orateur très imparfait, si vous n'êtes pénétré des sentiments que vous voulez peindre et inspirer aux autres; et ce n'est pas par spiritualité que je dis ceci, je ne parle qu'en orateur. e Fénelon, Dialogues sur l'Éloquence. LIX. Subsequi debet gestus. On trouvera dans Quintilien (de Instit orator., lib XI, c. 3) sur l'action, et principalement sur le geste, des détails infinis, qui tout minutieux et même puérils qu'ils peuvent paraître, sont curieux cependant, et intéressent par l'idée qu'ils nous donnent du soin avec lequel étaient étudiées toutes les parties de l'art oratoire. LX. Cum eburneola fistula. AuliuGelle, I, 11, transcrit ce passage célèbre sur la flûte qui donnait le ton à C. Gracchus. LXI. Quo te fistula... et tamen. Le texte de cette phase a paru altéré à Ernesti. Le mot lumen lui parait surabondant ou plutôt contraire au sens. Il propose de lire : quo te fistula progredi sinet, en retranchant la négation. Cette correction, que nous n'avons pas osé adopter, nous semble heureuse.
|