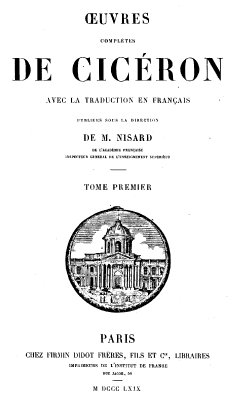|
ALLER A LA TABLE DES MATIÈRES DE CICÉRON
Cicéron
L'ORATEUR
ARGUMENT. Cicéron range lui-même dans l'ordre suivant ses principaux ouvrages de rhétorique « Ita tres erunt de Oratore quartus, Brutus quintus, Orator. » Il composa ce traité à la prière de Brutus, pour lequel il venait d'écrire l'Éloge de Caton. César venait de vaincre à Pharsale. Cicéron, après avoir attendu à Brindes le pardon du vainqueur, était rentré dans Rome et dans le sénat, où le découragement et la crainte lui firent garder le silence. C'est alors qu'il reprit ses études philosophiques et littéraires. « Quand il ne me reste plus de rôle à jouer ni au barreau ni dans les affaires publiques, dit-il tristement (Orat., c. 43), dois-je craindre de trouver un censeur assez chagrin ou plutôt assez impitoyable pour me faire un crime de chercher des consolations au sein des lettres, plutôt que de m'abandonner à l'oisiveté, qui m'est odieuse, ou à la tristesse que je veux repousser ? » De l'oppression de la république par César sont nés, avec l'Orateur, la plupart des ouvrages de rhétorique et de philosophie de Cicéron. Il avait pour le traité de l'Orateur une grande prédilection et il en parle souvent dans sa correspondance. (Ep. fam., VI, 18; XII, 17; XV, 20, etc.) La première partie où l'auteur a tracé le portrait idéal d'un orateur parfait est en effet une des plus telles productions de la langue latine. L'autre partie offre moins d'élévation dans les idées, étant toute didactique; quoiqu'elle ne l'ait pas paru assez à un érudit du seizième siècle, Pierre Ramus, lequel en fit une longue et amère censure, lourdement réfutée par un érudit du même temps. Ce Traité, dont il ne restait pas en France au neuvième siècle, un seul exemplaire complet, fut retrouvé, en 1419, par Gérard Landriano, évêque de Lodi. Il en confia le manuscrit à Gasparini de Bergame, qui en parle en ces termes, ainsi que de la copie que, suivant. Biondi, il en fit faire par Cosme de Crémone « Feci autem, ut pro illo vetustissimo, ac paene ad nullum usum apto, novum, manu hominis doctissimi scriptum, ad illud exemplar correctum, alium codicem haberet. » C'est de ce manuscrit, presque indéchiffrable, que viennent, d'après l'opinion d'Ernesti, combattue par Schneider, tous ceux qui ont servi à imprimer les premières éditions dont quelques-unes intitulent ce traité De optimo genere dicendi; titre que Cicéron lui donne aussi quelquefois. (Ep. fam., XII, 17; ad Attic, XIV, 20.) I. J'ai longtemps balancé, mon cher Brutus, entre l'embarras d'un refus, si pénible après vos instances, et le danger d'un engagement trop grave. Dire non à l'ami le plus cher, et, je n'en puis douter, le plus tendre; non, quand il ne réclame que son droit, et dans la plus honorable des vues : quel effort pouvait me coûter davantage? Mais s'aventurer dans une entreprise si rebelle à l'exécution, et dont la pensée même a peine à mesurer l'étendue, tant d'audace est-elle permise à qui respecte l'opinion, et redoute le blâme des hommes graves et des bons esprits? Qu'il est difficile, quand les grands orateurs se ressemblent si peu, de préciser la forme par excellence, et de fixer, en quelque sorte, le type de l'art oratoire! Mais vous le voulez; je me résigne, sans me flatter du succès, à tenter de vous satisfaire. Et s'il faut donner prise sur moi, ou par ma facilité, ou par ma résistance, manquons à la prudence plutôt qu'à l'amitié. Je dois donc m'expliquer sur le genre d'éloquence que je préfère, exprimer comment je me représente le dernier période de l'art, la perfection souveraine. Un scrupule m'arrête encore. Si je réponds à votre question tant de fois proposée, ne vais-je pas créer le découragement par une peinture trop fidèle, et détourner plus d'un aspirant d'un but qu'il va désespérer d'atteindre? Mais dans les grandes choses, qui veulent de grands efforts, c'est un droit pour tous de tenter toutes les voies. Et quand il nous manquerait, à certain degré, ou quelque don de la nature, ou le feu divin du génie, ou le secours des bonnes études, ne laissons pas de pousser jusqu'où il nous est donné d'atteindre. Qui aspire au premier rang peut, sans déshonneur, s'arrêter au second, et même au troisième. La liste des poètes, pour ne parler que des Grecs, n'est pas fermée après Homère, Archiloque, Sophocle et Pindare. D'autres noms prennent rang à leur suite; et, après ceux-là, d'autres encore. Si nous passons aux philosophes, l'ambition d'Aristote n'a pas reculé devant la grande image de Platon. Et Aristote lui-même, puissance d'entendement universelle, n'a découragé personne après lui. II. Cette persévérance n'est pas exclusivement propre à ces génies privilégiés. Même, dans les beaux-arts, il est sans exemple qu'on ait abandonné sa profession, en désespoir d'atteindre à la perfection de l'Ialyse que nous avons vu à Rhodes, ou de la Vénus de Cos. Jamais le Jupiter Olympien, jamais le Doryphore, n'ont fait tomber le ciseau des mains d'un statuaire : aucun n'a renoncé à essayer ses forces et sa portée. Les sculpteurs se sont multipliés à l'infini; mais le talent a si bien percé dans tous les genres, qu'après l'admiration qui s'épuise devant les chefs-d'oeuvre, il reste encore une haute estime pour des efforts moins heureux. Parmi les orateurs, au moins ceux de la Grèce, on est frappé de voir à quelle hauteur plane un seul au-dessus de tous les autres. Il s'est trouvé un Démosthène; et cependant, que d'orateurs on a vu encore prétendre parvenir à la célébrité ! Il avait eu ses devanciers, il n'a pas manqué de successeurs. Ainsi, plus d'ambition qui se décourage, d'ardeur qui se ralentisse. Dans la route de l'éloquence, le point culminant lui-même n'est pas inaccessible; et, quand le but est si noble, il est déjà beau d'en approcher. Je vais peindre l'orateur accompli; et, peut-être, le portrait n'aura jamais eu de modèle. Car ce dont je suis en quête n'est pas une prééminence individuelle, mais bien la perfection absolue : perfection qu'on a vue rarement, si même on la vit jamais, se soutenir du commencement à la fin d'un discours; et qui, cependant, s'y montre par éclairs, plus rapprochés dans tel orateur, moins fréquents chez tel autre. J'affirme que la beauté en tous genres, à quel que degré qu'elle nous frappe, n'est que la reproduction, et comme la copie imparfaite d'une beauté d'ordre supérieur, qui échappe à la vue, à l'ouïe, à tous les sens, et ne peut être saisie que par l'intelligence et la pensée. Devant les statues de Phidias, qui effacent tout ce que nous connaissons en sculpture; devant les chefs-d'oeuvre du pinceau que j'ai cités, l'imagination s'élance encore au delà. Sans doute ce grand artiste, quand il travaillait à son Jupiter ou à sa Minerve, n'avait pas la nature vivante sous les yeux pour en tirer leur image. Mais il portait empreint dans sa pensée le caractère d'une beauté surnaturelle; et, tout entier à cet objet d'une contemplation intime, c'est à en reproduire les traits qu'il appliquait son art et son ciseau. III. Le peintre et le statuaire tendent donc également à s'approcher d'un beau rationnel; modèle invisible des produits que l'art offre ensuite à nos yeux. L'éloquence a de même sa perfection abstraite, dont le type est dans la pensée et dont l'oreille cherche l'imitation sensible. Ces formes immatérielles, Platon les appelle idées : sublime penseur chez qui l'élévation du style atteint la hauteur des conceptions, grand maître et admirable modèle, Platon soutient que les idées sont de tous temps et à toujours. Elles ont pour siège l'entendement et la raison; et, seules, sont exemptes de la loi générale, qui veut que tout commence et finisse, ait un cours et un déclin; et que rien ne reste immuable ou stationnaire dans la nature. Quelque sujet qu'on traite, la première opération d'un esprit qui procède avec méthode sera donc de rechercher une idée primitive, un type générateur. Je sens bien que cette métaphysique me jette, dès le début, hors des habitudes de l'école. Et j'appréhende que des notions de ce genre, empruntées à une doctrine antique, peut-être un peu obscure, ne deviennent un sujet de blâme ou de surprise. Ou l'on se demandera quel rapport une telle introduction peut avoir avec l'objet de nos recherches, à quoi je ne puis répondre que par la déduction elle-même, qui fera juger si je l'ai prise de trop haut; ou l'on va se récrier sur cette prétention de m'ouvrir une route nouvelle, en dehors de tout sentier frayé : ce ne sera pas la première fois que j'aurai passé pour novateur, tout en ne désirant que des choses fort anciennes, mais ignorées du plus grand nombre. Ici je dois faire un aveu. Quoique je sois orateur, ou tout ce qu'on voudra, je n'ai pas surgi de nos ateliers de rhétorique; je suis enfant de l'Académie ; c'est dans cette école ambulante, ouverte par Platon, que l'éloquence peut librement s'essayer en tous genres et sous toutes les formes. Les ouvrages du maître et ceux des autres philosophes, où l'orateur est si peu ménagé, lui offrent en compensation les plus précieuses ressources de son art. C'est, pour lui, le magasin, l'arsenal universel, bien qu'assez mal fourni des matériaux à l'usage de l'éloquence publique; et cela parce que les philosophes affectaient de traiter cet exercice de vulgaire, et de l'abandonner aux muses de second ordre. Rabaissée de la sorte, et comme répudiée par les philosophes, l'éloquence du barreau dut manquer de ses vrais éléments, de force et de puissance; cependant, grâce au prestige de certains effets de style et de pensées, elle put encore obtenir la vogue, et s'en prévaloir contre un arrêt de proscription qui n'émanait que du petit nombre. De là quelque chose d'incomplet des deux parts. Aux uns le savoir, sans les formes d'élocution aimées de la multitude; aux autres le talent de parler, sans l'inspiration des belles doctrines. IV. Posons donc un premier principe, que la suite fera mieux comprendre. C'est que, sans la philosophie, on ne devient pas orateur, comme je l'entends. Ce n'est pas que seule elle suffise à tout; mais elle est à l'art oratoire ce que la gymnastique est à l'art de la scène. Les plus humbles comparaisons sont quelquefois les plus justes. La philosophie peut seule agrandir et féconder toutes les hautes questions. Ne voyons-nous pas Socrate lui-même, dans le Phèdre de Platon, attribuer la prééminence oratoire de Périclès aux sciences naturelles qu'il avait étudiées sous Anaxagore? Là son esprit s'était enrichi des notions élevées de la plus magnifique des sciences, source inépuisable de richesses pour la parole. Bien plus, il y avait surpris tout le secret de l'éloquence, l'art de reconnaître par où les âmes sont accessibles, et de quels coups il faut les frapper. Démosthène peut servir de second exemple, lui qui, d'après sa correspondance, ne manquait pas une leçon de Platon. Comment parvenir, sans les méthodes philosophiques, à classer les objets par genres et par espèces, à les préciser par la définition, à les coordonner par les divisions, à démêler le vrai du faux, à déduire les conséquences, à signaler une contradiction, à relever une équivoque? Et cette philosophie qui interroge la nature, quelle mine à exploiter pour l'orateur ! Et toutes les notions sur l'homme, les devoirs, la nature, la morale! Si l'on n'y a pas consacré une longue étude, de quoi peut-on parler, et que peut-on comprendre? V. Toutes ces grandes pensées ne peuvent se montrer que revêtues des grâces de l'expression. Mais autrefois les ornements du style se trouvaient chez les seuls maîtres en l'art de bien dire. Et si, même aujourd'hui, nul n'est arrivé en éloquence à la perfection absolue, c'est que, dans l'enseignement, on sépare encore l'expression de la pensée, et qu'il existe une école pour les choses, et une école pour les mots. Un homme que nos pères ont mis au premier rang des orateurs, Marc-Antoine, esprit naturellement plein de sagacité et de finesse, déclare, dans le seul livre qu'il ait laissé, qu'il a souvent rencontré le parleur habile, mais jamais l'homme éloquent. Sans doute, il avait l'esprit frappé d'une certaine forme d'éloquence, qui ne s'offrait à lui qu'en abstraction, jamais en réalité; et saisissant avec ce tact, qu'il possédait au plus haut degré, ce qui lui manquait à lui-même, et ce qui manquait aux autres, il ne voyait personne qu'on pût appeler éloquent. Il est donc évident que s'il n'a trouvé l'éloquence ni dans ses propres discours ni dans ceux de Crassus, c'est qu'il s'en était créé une image toute parfaite n'existant que dans sa pensée, et qu'en des talents plus ou moins incomplets il ne retrouvait plus ce type de perfection absolue. Cherchons donc, mon cher Brutus, à découvrir cet orateur, ou, plutôt, cet être de raison, qu'Antoine n'a jamais vu, et qu'un dieu même, selon lui, pourrait à peine réaliser. A plus forte raison, nous sera-t-il impossible de le montrer personnifié en nous-même. Mais il ne nous est peut-être pas interdit de le définir, et de le qualifier. VI. Il n'y a que trois genres de style, et dans chacun des trois il s'est fait d'assez belles réputations. Mais nous voulons, nous, une égale supériorité dans les trois genres, et cet ensemble est des plus rares. Dans le sublime, on voit des orateurs soutenir, par la majesté de l'expression, l'élévation de la pensée. Véhémence, variété, abondance, force, pouvoir de remuer les âmes, et de les pousser en tous sens, tels sont les caractères essentiels de ce genre, sous deux formes d'élocution bien différentes. L'une, âpre, austère, négligée, étrangère aux délicatesses du goût et de l'oreille; l'autre, posée, travaillée, d'une élégance et d'une harmonie soutenue. Le genre simple, au contraire, n'est que fin, et ne veut qu'instruire; il ne grossit pas les objets, mais il en éclaire toutes les faces. Subtil, précis, et sévèrement élaboré, il admet aussi deux formes de langage: l'une où l'art se cache sous une écorce brute, et s'enveloppe à dessein de rudesse et d'ignorance; l'autre, également sobre d'ornements, mais qui décèle quelque soin de plaire, et se permet même un léger vernis d'enjouement, de grâce et d'élégance. Entre ces deux genres, un troisième tient le milieu. Tempéré, par excellence, il amortit les foudres du premier et les traits du second. En lui, l'un et l'autre sont combinés; nul ne domine; il participe de chacun au même degré, ou, pour mieux dire, il se tient à égale distance de tous deux. Toujours doux et coulant, ce style n'a, dit-on, d'autre caractère qu'une égalité soutenue. S'il admet les ornements, soit dans l'expression, soit dans la pensée, il leur ôte le relief en les distribuant sur l'ensemble ; ou ne leur laisse de saillie qu'autant qu'en donne la ciselure aux fleurons d'une couronne. VII. Il a toujours suffi d'exceller dans un seul de ces genres, pour tenir un rang distingué parmi les orateurs; mais nos exigences ne vont-elles pas au delà? Il est quelques hommes, sans doute, qui ont su réunir la pompe à l'énergie, et la finesse à la grâce. Et plût aux dieux que l'Italie nous offrît de tels modèles! Il serait beau de ne pas les chercher à l'étranger, et de trouver chez nous ce genre de gloire. Ce n'est pas que j'oublie la part brillante que j'ai faite à l'éloquence latine, dans mon Dialogue intitulé Brutus; mais je m'abandonnais alors, soit au désir de stimuler l'émulation de nos Romains, soit à un sentiment de prédilection nationale; et je me souviens bien pourtant de n'avoir pas hésité à mettre Démosthène infiniment au-dessus de tous les orateurs, parce que dans cette puissance qu'il a donnée à la parole je trouve l'éloquence telle que je la conçois, et non l'éloquence telle que je l'ai connue. Il est encore sans rival dans le sublime, dans le simple et dans le tempéré. Avis à ces discoureurs qui, voyant l'atticisme à la mode, s'évertuent à se montrer Attiques dans tout ce qu'ils disent. Ils feront bien de réserver toute leur admiration pour Démosthène, et de se bien persuader qu'Athènes même n'est pas plus Attique que lui. Il se chargera de leur apprendre ce que c'est qu'atticisme; et ces nains se déshabitueront d'abaisser l'éloquence à leur taille, quand ils l'auront mesurée aux proportions du géant. On ne loue plus ce qu'on croit pouvoir imiter. Mais je veux que l'intention chez eux soit excellente, et que le goût seul soit en défaut. C'est bien le cas de faire voir ce que c'est que le véritable atticisme. VIII. De tous temps, le goût public a donné le ton à l'éloquence. L'orateur qui veut plaire étudie les dispositions de ceux qui écoutent. Il s'assujettit absolument à leurs volontés, à leurs fantaisies. Dans la Carie, par exemple, et chez quelques autres peuples non moins étrangers aux raffinements de l'élégance, tels que les Phrygiens et les Mysiens, s'est naturalisée une diction boursouflée, bien faite pour leurs oreilles, et qui donne à leur éloquence une sorte d'embonpoint grotesque. Cette monstruosité n'avait à franchir qu'un bras de mer pour envahir les Rhodiens, qui n'en ont pas voulu. Les Grecs ont accueilli plus mal encore ce style, que les Athéniens enfin ont absolument repoussé. Et comment avec un goût si pur et si éclairé auraient-ils permis à un orateur de blesser, ou même d'étonner leurs oreilles sévères? Une exquise pureté pouvait seule trouver grâce devant eux, et il n'eût fallu qu'un mot pour effaroucher leur délicatesse ombrageuse. Voyez l'orateur que je mets au-dessus de tous les autres, dans le Discours pour la Couronne, son chef-d'oeuvre, sans contredit. Quelles précautions dans son exorde! Arrivé aux lois, alors son allure devient plus vive; mais il ne gagne que peu à peu ce terrain, et ce n'est que quand il voit ses juges échauffés, que s'animant lui-même, il plane enfin dans toute sa liberté. Pas un mot chez lui qui ne soit pesé ; et cependant il y a encore prise aux critiques et aux sarcasmes d'Eschine, qui relève quelques termes, et les déclare durs, révoltants, intolérables. Eschine va plus loin. Il traite Démosthène de bête sauvage, lui demande si ce sont là des paroles ou des monstres. Ainsi Démosthène lui-même, au jugement d'Eschine, n'a pas d'atticisme. C'est une tactique facile que de reprendre à froid un mot de feu, si j'ose le dire, et de le tourner en dérision quand la sympathie des auditeurs a eu le temps de s'éteindre. Aussi Démosthène ne se défend-il que par un badinage. Est-ce, dit-il, d'un mot ou d'un geste que dépendrait la fortune de la Grèce? De quel air serait donc reçu un orateur phrygien ou mysien dans une ville où le reproche de mauvais goût va chercher jusqu'à Démosthène? Aux premiers roucoulement de cette voix asiatique, à ces lamentations modulées, il n'y aurait qu'un cri pour être délivré du discours de l'orateur, et même de sa présence. IX. On est donc Attique lorsqu'on a satisfait aux rudes exigences de l'oreille athénienne. Or, il y a plusieurs sortes d'atticisme. Et nos gens n'en soupçonnent qu'une seule . une diction sèche et nue, mais où l'expression est pure et claire, est, à leur avis, tout ce qui constitue l'atticisme. Qu'il soit là, d'accord; qu'il ne soit que là, voilà l'erreur. Le restreindre à ce point, c'est le refuser à Périclès lui-même, à qui la palme en est décernée d'un commun accord. S'il n'eût élevé la voix au-dessus du ton simple, où donc aurait pris Aristophane ces éclairs et ces foudres dont la commotion bouleversait la Grèce? Que Lysias soit Attique, cet écrivain si poli, si gracieux; qui pourrait le nier? mais qu'il soit bien entendu que ce qu'il y a d'attique en lui, ce n'est pas le manque d'élévation et d'ornements; c'est son attention scrupuleuse à ne rien dire, ni en termes hasardés, ni hors de propos. Reconnaissons encore que l'éclat, la force, l'abondance ne dérogent pas à l'atticisme : autrement Eschine et Démosthène ne seraient pas Attiques. Mais voilà que Thucydide a aussi des sectateurs. Écart inouï de l'ignorance! Qu'on prenne Lysias pour guide ; on a du moins un homme de barreau. Rien de large, il est vrai, ni d'élevé dans sa manière; mais il a de la finesse et de l'élégance, et peut se produire avec avantage dans la plaidoirie. Thucydide, lui, rapporte les faits, décrit avec force, avec noblesse, les guerres et les batailles, mais n'offre rien qui soit à l'usage de l'éloquence judiciaire. Dans ses harangues même, la pensée se cache et s'enveloppe si souvent, qu'à peine on peut la saisir. Or, pour le discours public, c'est là le plus grand des défauts. Mais quelle bizarrerie, quand on a le blé, d'aller se repaître de gland ! Les Athéniens, à qui nous devons une meilleure nourriture, n'ont-ils pu nous donner aussi un meilleur langage? Jamais rhéteur grec fit-il un seul emprunt à Thucydide? On s'accorde à le louer, sans doute : mais comme sage et sévère appréciateur des faits, comme politique profond; qualités de l'historien qui doit écrire une guerre, et non de l'avocat qui doit plaider une cause. Aussi n'a-t-il jamais compté parmi les orateurs; et s'il n'eût écrit l'histoire, ni son rang ni ses honneurs n'auraient pu le sauver de l'oubli. Ajoutons que cette profondeur d'expression et de pensée n'est pas ce que ses imitateurs vont prendre chez lui. Mais qu'ils aient réussi à jeter quelques phrases tronquées et décousues, qu'ils auraient bien créées sans modèle, voilà qu'ils se croient de vrais Thucydides. N'ai-je pas rencontré aussi au barreau un imitateur de Xénophon? comme si la douceur de l'Abeille attique pouvait se trouver à l'aise dans le tapage des tribunaux. X. Revenons à notre orateur. Inventons pour lui cette éloquence dont Antoine n'a jamais trouvé le modèle. Grande et rude entreprise, mon cher Brutus; mais l'amitié ne connaît pas d'obstacles: oui, j'ai toujours aimé votre caractère, vos goûts, votre manière de vivre. Ce sentiment s'avive chaque jour par le souvenir, hélas! trop amer, de nos fréquentes réunions, de notre communauté d'habitudes, de vos savants entretiens. Il s'exalte encore par l'admiration générale que vous ont conquise, tant de vertus en apparence incompatibles, et que votre haute raison a su concilier. Quel accord plus rare que celui de la douceur et de la sévérité? Et où est l'homme plus aimable à la fois et plus austère? N'est-ce pas un prodige de gagner tous les coeurs quand il faut trancher au vif dans tous les intérêts? Eh bien! Brutus a l'heureux secret de renvoyer calmes et désarmés ceux mêmes qui ont perdu leur cause à son tribunal. Enfin, il ne donne rien à la faveur; et, à tout ce qu'il fait, s'attache une faveur universelle. Sous votre gouvernement, la Gaule cisalpine échappe seule à l'incendie qui ravage les autres parties de la terre. Heureuse contrée! brillant fanal de l'Italie! Là, du moins, entouré de la fleur et de l'élite des citoyens, Brutus jouit de lui-même et de la douceur de se voir apprécié. Qu'il est admirable encore cet amour des lettres qui ne vous abandonne pas un moment au milieu des plus graves occupations! toujours il faut, ou que vous écriviez, ou que vous m'excitiez à écrire. L'Éloge de Caton est à peine achevé, et voilà qu'à votre voix j'entreprends un autre ouvrage. Cet Éloge même, je ne l'aurais point abordé, dans ce siècle ennemi des vertus, si un désir de Brutus, réveillant en moi une mémoire si chère, m'eût laissé une excuse légitime. Je me serais fait un crime de ne pas vous obéir. Nouvel effort aujourd'hui; mais je proteste et de vos instances, et de mes refus. Je veux que la responsabilité nous soit commune; que, si je succombe, nous encourions le reproche, vous de m'avoir soumis à une trop forte épreuve; moi, de l'avoir témérairement acceptée. Le mérite de mon dévouement pourra du moins racheter l'erreur de mon esprit. XI. Rien de plus difficile à donner en toutes choses que la définition précise, ou, comme disent les Grecs, le caractère de la perfection. Ce qui est perfection pour les uns, ne l'est pas pour les autres. Ennius fait mes délices, dira l'un, parce qu'il ne s'écarte jamais des habitudes familières du langage. Pacuvius est mon auteur, reprend un autre, pour la pompe et le fini de ses vers. Ennius est trop négligé. Accius sera le poète favori d'un troisième. Diversité dans les jugements chez nous comme chez les Grecs. Il n'est pas aisé de faire comprendre quelle forme est la meilleure. En peinture, il faut aux uns un faire brut, des touches heurtées, des teintes rembrunies et chargées. Aux autres, des effets lumineux, des tons gais, un coloris éclatant. Où trouver une formule universelle et absolue? chaque genre a sa perfection; et il y a tant de genres! Toutefois, ces obstacles n'ont pu m'arrêter; car j'ai toujours pensé qu'une chose quelconque a sa perfection propre; difficile, peut-être, à découvrir, mais toujours saisissable pour l'oeil exercé de l'homme qui a fait de cette chose une étude approfondie. L'art oratoire a diverses applications qui ne peuvent être ramenées à une forme unique. Je ne chercherai donc pas à rassembler dans un même cadre, et les traits qui appartiennent spécialement à l'éloge, à la narration, à l'histoire; et ceux qui caractérisent l'espèce de composition dont Isocrate, dans le Panégyrique, et, après lui, le corps nombreux des sophistes, nous ont tracé les modèles. J'écarterai également tout ce qui rentre dans ce genre étranger aux luttes du barreau, et que les Grecs ont nommé Démonstratif, parce que c'est un jeu de l'esprit qui donne tout à l'effet extérieur. Ce n'est pas que l'étude en soit à dédaigner; au contraire, c'est le premier lait que devra sucer notre orateur à qui nous nous proposons d'assigner bientôt un rôle plus important. XII. Il y aura toujours puisé l'abondance des termes et l'art des constructions, avec l'habitude du nombre et de l'harmonie. Ces qualités se montrent sans opposition dans ce genre, où tous les agréments de l'esprit sont de mise. On y permet une sorte d'artifice et de calcul dans les balancements de la phrase. Là ce n'est pas un travail qui se déguise; c'est une tendance manifeste et avouée à obtenir certaines combinaisons, certains rapports de mots, dont il résulte antithèse ou symétrie, correspondance de nombre ou similitude de désinence; figures employées beaucoup plus sobrement, et presque toujours masquées dans les combats sérieux du barreau. Isocrate avoue, dans son Panathénaïque, combien il a mis de soins à se ménager ces moyens de succès. Mais s'il eût eu des intérêts sérieux à défendre, il eût moins sacrifié au plaisir de l'oreille. Thrasymaque de Chalcédoine, et Gorgias de Léontium, furent les premiers, dit-on, à considérer l'art sous ce point de vue. Viennent ensuite Théodore de Byzance, et une foule d'autres, que Socrate, dans le Phèdre, appelle enfileurs de paroles. Leur style n'est pas sans finesse; mais ce sont des traits à peine accusés, comme dans l'enfant qui vient de naître. On dirait de petits vers où l'enluminure est prodiguée. En vérité, l'admiration redouble pour Hérodote et pour Thucydide, quand on songe que tous deux, nés dans le même siècle que ces sophistes, n'offrent pas l'ombre de ces gentillesses, ou plutôt de ces niaiseries. Le style du premier coule uniformément comme un fleuve paisible. Un courant plus rapide entraîne l'autre, et ses accents résonnent comme le clairon quand il nous parle de combats. C'est, dit Théophraste, au mouvement imprimé par ces deux écrivains, que l'histoire est redevable de cette forme large et brillante, que leurs devanciers n'avaient pas même soupçonnée. XIII. Le siècle suivant a vu naître Isocrate, que je persiste à louer comme le premier des rhéteurs de son genre. Je sais, mon cher Brutus, que je ne puis le défendre, sans trouver en vous un contradicteur redoutable et par sa science, et par les traits de son esprit. Mais les armes vous tomberont des mains, je l'espère, quand vous saurez les motifs de ma prédilection. Thrasymaque et Gorgias passent pour avoir les premiers compris le mécanisme de l'arrangement des mots. Mais Isocrate trouvait leur phrase hachée et dépourvue de nombre. Il blâmait chez Thucydide l'absence de toute liaison et de toute période. En garde contre ces défauts, il sut le premier assouplir et arrondir la phrase ; et le nombre vint mollement caresser l'oreille. Cet art, dont il a donné des leçons à tout ce que la Grèce a compté depuis d'orateurs et d'écrivains célèbres, a fait nommer sa maison l'officine de l'éloquence. Je me souviens que, fort de l'approbation de Caton, je devenais insensible à toute critique. Le témoignage de Platon me semble placer de même Isocrate au-dessus de toute censure. Voici, vous le savez, comment il fait parler Socrate vers la dernière page de son Phèdre : "Isocrate est bien jeune encore; n'importe, je dirai ce que j'augure de lui. Voyons, dit Phèdre. Ce serait, continue Socrate, méconnaître la supériorité de son génie que de le comparer à Lysias. Il a, d'ailleurs, plus d'éloquence et de goût pour la vertu. Vous le voyez, aujourd'hui, triompher sans peine de ses jeunes concurrents. Ne vous étonnez pas de le voir un jour effacer, dans le genre qu'il s'est fait, les orateurs de tous les temps. Ou, s'il ambitionne une palme plus belle, un mouvement divin l'élèvera assez haut pour lui permettre de l'atteindre. Car la philosophie l'a marqué de son sceau". Voilà ce que le premier des sages augurait de la jeunesse d'Isocrate, voilà ce que Platon, un contemporain, écrivait d'Isocrate devenu vieux. Platon, le fléau de tout rhéteur, n'a pour celui-ci que de l'admiration. Que ceux donc qui ne veulent pas reconnaître un tel mérite, me permettent de me tromper avec Socrate et Platon. En résumé, style doux, abondant et facile, pensées brillantes, et combinaisons de mots harmonieux; voilà le genre démonstratif. C'est, comme je l'ai dit, celui qu'ont adopté les sophistes; genre de parade, plutôt que de combat, consacré aux gymnases et aux écoles, mais que dédaigne et repousse le barreau. C'est toutefois la première nourriture de l'éloquence, qui trouve ensuite en elle-même la force et la couleur. Il n'était donc pas sans intérêt de prendre en quelque sorte l'orateur au berceau. Mais c'est assez nous arrêter aux jeux de son enfance; quittons avec lui l'exercice pour le combat, le simulacre de la guerre pour la réalité. XIV. L'Invention, la disposition, l'élocution, voilà les trois objets de l'orateur. Dire en quoi consiste la perfection pour chacune de ces parties, voilà ma tâche. Je ne procéderai point méthodiquement, en établissant d'abord des préceptes : car mon seul but est de crayonner l'image de la parfaite éloquence, et je dirai, non par quelles voies on peut l'acquérir, mais à quels signes on la reconnaît. J'ai peu à dire sur ses deux premiers points. Préliminaires indispensables même pour d'autres études, ils n'intéressent pas essentiellement la gloire de l'orateur. L'Invention qui trouve les moyens, la disposition qui en règle l'emploi, sont, il est vrai, au discours ce que l'âme est au corps. Cependant, malgré leur importance, elles tiennent de plus près au jugement qu'au talent de la parole. Mais est-il une cause où le jugement n'ait rien à faire? L'orateur, que nous supposons parfait, connaîtra donc les sources des arguments et des preuves. Toute question, toute controverse roule nécessairement sur trois points; l'existence de la chose, son genre, ses qualités. L'existence se constate par les indices; le genre, par les définitions; les qualités, par les notions antérieures du bien et du mal. L'orateur (je ne dis pas l'orateur vulgaire, mais l'orateur par excellence) trouvera toujours moyen de ne pas se restreindre aux circonstances, ni de temps, ni de personnes. Remonter ainsi du particulier au général, c'est se donner plus de latitude; et la preuve générale entraîne nécessairement la preuve particulière. Ainsi généralisée, sans égard aux personnes ni aux temps, la question devient ce qu'on appelle Thèse. C'est la forme d'argumentation recommandée par Aristote, comme plus féconde et plus propice au développement des ressources oratoires; c'est celle qu'il propose à la jeunesse, quand il l'exerce à parler pour et contre, non pas avec la précision des philosophes, mais avec l'abondance des rhéteurs. Il a même composé un livre de Topiques, c'est-à-dire, de lieux communs, espèce de répertoire universel des moyens d'attaque ou de défense pour toute proposition donnée. XV. Les lieux ainsi trouvés d'avance, on peut sans peine les passer en revue, s'emparer de ceux qui ont trait à la cause, et même trouver la source des lieux communs. Or, ce n'est pas un fonds où l'on puise à l'aventure; il y faut un tact, un discernement qu'on ne saurait attendre d'un criailleur de barreau, ou d'un déclamateur d'école. Mais nous voulons, dans notre orateur, la réunion de toutes les connaissances et de toutes les perfections. Il saura donc peser et choisir les preuves, de manière à ne pas toujours produire les mêmes dans toute espèce de cause. Que le jugement surtout le dirige; qu'au travail d'invention succède le travail d'examen. Rien de plus fécond que l'intelligence, surtout quand elle a été cultivée par l'étude. Mais plus la moisson est riche, et plus on y trouve mêlées d'herbes ennemies du bon grain ; de même les lieux oratoires abondent fréquemment en développements inutiles, ou frivoles, ou déplacés. Que l'orateur y apporte donc un choix sévère. Autrement, pourra-t-il démêler et s'approprier ce qui est vraiment à sa convenance, adoucir les circonstances fâcheuses, déguiser, supprimer ce qu'il ne peut adoucir; quelquefois donner le change à l'attention, et glisser une objection plus forte en apparence que celle qu'on lui oppose à lui-même? L'invention a fourni les moyens. Il s'agit de les disposer. C'est là le second point. Qu'un exorde plein de dignité ouvre honorablement les voies, et jette sur la cause une sorte d'éclat et de faveur. Attentif à l'impression produite par cette première attaque, l'orateur en profitera pour saper ou miner les moyens de son adversaire. Dans la distribution des preuves, il placera les plus fortes au commencement et à la fin. Les plus faibles seront comme intercalées. Nous venons d'indiquer rapidement les deux premières conditions de l'éloquence. Je répète que je les considère comme essentielles. Mais, encore une fois, ce n'est pas là ce qui exige le plus d'art et de travail. XVI. L'orateur sait enfin ce qu'il doit dire, et sa disposition est nettement arrêtée. Reste maintenant la manière de le dire; et c'est le point capital. Notre ami Carnéade observait assez plaisamment que Clitomaque disait toujours les mêmes choses, et Charmadas aussi; mais que Charmadas les disait toujours de la méme manière. Or, si dans la philosophie même, où l'on n'a égard qu'aux choses sans s'occuper des mots, la manière de s'exprimer a cependant encore tant d'importance, que ne sera-t-elle pas dans les causes où tout est subordonné à l'élocution? Si j'ai bien compris le sens de vos lettres, mon cher Brutus, vous ne m'avez pas demandé ce que c'est que l'orateur parfait sous les rapports de l'invention et de la disposition, mais vous voulez savoir quel genre d'élocution je juge le meilleur. Question difficile, grands dieux ! oui, la plus difficile des questions: car il n'est rien de plus souple, de plus flexible, de plus variable que le langage, puisqu'il se prête aux formes les plus capricieuses. Puis, la diversité des esprits et des goûts a donné naissance à une foule de styles différents. Les uns veulent voir rouler les périodes comme un courant continu, dont la rapidité est pour eux l'éloquence; les autres préfèrent un discours découpé en petites phrases, parce que ce sont autant de repos qui permettent de respirer à l'aise. Quel contraste entre ces deux manières, dont chacun a pourtant sa perfection! Celui-ci s'applique à donner au style un caractère de douceur et d'égalité, un ton pur et naïf. Celui-là au contraire affecte des formes dures et sévères, assombries d'une teinte mélancolique. Enfin, chacune de ces variétés d'élocution, d'après la division des trois genres, a son sublime, son simple, son tempéré. Qu'on juge combien d'espèces d'éloquences, et, par conséquent, de classes d'orateurs. XVII. Vous me demandiez seulement quel est le meilleur style; j'ai déjà été au delà de vos désirs en ajoutant quelques mots sur l'invention et la disposition. Afin de rendre l'énumération complète, je ne m'en tiendrai pas là, et je traiterai aussi de l'action. Quant à la mémoire, qui s'applique en général à toute opération de l'intelligence, je n'ai point à m'en occuper. Il y a deux moyens d'expression oratoire, l'action et l'élocution. On peut dire que l'action est l'éloquence du corps, puisqu'elle se compose de la voix et du geste. La voix est modifiée par chacune de nos passions, et c'est elle surtout qui les communique. Aussi l'orateur parfait dont je cherche à donner l'idée saura toujours faire prendre à la sienne l'inflexion propre au sentiment qu'il voudra manifester, à l'émotion qu'il voudra produire. J'en dirais bien davantage, si je m'annonçais en professeur, ou même si tel était votre désir. J'aurais aussi à parler du geste, dont on ne peut séparer le jeu de la physionomie. Toutes choses d'une indicible importance, suivant l'usage qu'en fera l'orateur. On a vu, chez des gens qui n'avaient pas le don de la parole, la seule puissance de l'action produire les effets de l'éloquence, et, chez d'autres, au contraire, la gaucherie de l'action paralyser l'élocution la plus brillante. Ce n'est donc pas sans raison que Démosthène assignait à l'action le premier rang, et le second, et le troisième. En effet, si l'éloquence sans l'action est nulle; si l'action sans l'éloquence a encore tant de pouvoir, que l'on juge de son importance dans l'art de la parole. XVIII. L'orateur qui aspire à la perfection aura des accents énergiques dans les passions fortes, des tons calmes dans les sentiments doux. Son organe trouvera des inflexions graves pour imposer, et des modulations touchantes pour attendrir. Quel admirable instrument que la voix humaine! avec trois tons seulement, l'aigu, le grave et le moyen, elle produit dans le chant une variété de combinaisons ravissantes. Le discours a aussi sa musique; mais, habilement dissimulée, elle est loin de ressembler à cette déclamation chantante dont les rhéteurs de Phrygie et de Carie croient embellir leurs péroraisons. Je veux parler de certaines intonations dont Eschine et Démosthène faisaient usage, et qu'ils se sont plus d'une fois reprochées l'un à l'autre. Démosthène est celui qui revient le plus souvent sur cet article, tout en accordant à son rival une voix douce et un beau timbre. Ce besoin de donner du charme à la déclamation me suggère une remarque. C'est que la nature, comme si elle eût voulu régler elle-même la mélodie du langage, nous fait articuler chaque mot avec un accent aigu, avec un seul, dont la place est toujours dans l'une des trois dernières syllabes. Elle a consulté en cela le plaisir de l'oreille, et l'art n'a plus qu'à suivre la nature. Une belle voix est désirable, sans doute. Mais cet avantage ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est de la former, de la fortifier par l'exercice. Notre orateur par excellence s'étudiera donc à varier, à modifier la sienne. Il doit fréquemment en parcourir tous les tons, en grossir tour à tour, ou en diminuer le volume. Il saura aussi régler ses mouvements, et s'interdire tout geste inutile. L'attitude sera droite et déployée. Peu d'allées et venues; qu'elles soient circonscrites et rarement précipitées. Point de laisser-aller dans les mouvements du cou. Point de mouvement dans les doigts : qu'on ne les voie point battre la mesure. Le buste doit conserver son aplomb, ou s'incliner sans mollesse. Et, suivant que le débit est véhément ou calme, il faut que le bras se projette en avant ou s'arrête replié sur lui-même. A la voix doit répondre l'expression du visage. Quelle convenance et quel charme puissant résulte de cet accord? De la vérité, point de grimaces. Les yeux ont aussi un grand rôle à jouer : ils sont les interprètes de l'âme, si le visage en est le miroir; la joie et la tristesse doivent s'y peindre avec des nuances réglées sur la nature du sujet. XIX. Mais arrêtons enfin les traits de cet orateur accompli, de cette éloquence souveraine. L'éloquence est tout entière, le mot l'indique assez, dans l'élocution, où le reste se trouve implicitement. Invention, disposition, action, aucun de ces termes ne répond à cet ensemble que suppose, chez les Grecs, le mot Rhéteur, et, chez nous, le mot éloquent, habile à parler. Les autres qualités de l'orateur ne sont pas sa propriété exclusive: mais la souveraineté de la parole n'appartient qu'à lui. Le style philosophique s'élève quelquefois à de grandes beautés. Théophraste a dû son nom au charme divin de ses discours ; Aristote a défié Isocrate lui-même. On a dit de Xénophon que les Muses parlaient par sa bouche. Quant à Platon, il n'est personne qui, soit en parlant, soit en écrivant, ait jamais approché de lui pour la grâce ou pour la majesté. Il n'en est pas moins incontestable que l'élocution, chez aucun d'eux, ne déploie cette vigueur, n'est armée de ces traits qui décident de tout à la tribune et au barreau. Les philosophes s'adressent à des hommes éclairés dont ils veulent calmer plutôt qu'exciter les passions. Traitant toujours des sujets paisibles, jamais de questions irritantes, ils cherchent à instruire leurs auditeurs, non à les captiver. Aussi les accuse-t-on de sortir de leur rôle, s'il leur arrive de faire le moindre effort pour plaire. On voit que la distinction est facile entre leur éloquence et celle qui nous occupe. La faconde philosophique est douce et amie de la solitude; elle n'admet ni ces pensées, ni ces expressions qui agissent sur les masses. Le besoin du rythme n'impose aucune contrainte à son allure, toujours libre et franche. Chez elle, jamais d'indignation, de fiel, de rage; point d'exaltation, point de détours. Elle est chaste et modeste comme la vierge timide; aussi l'a-t-on mieux caractérisée par le mot d'entretien que par celui de discours. Tout exercice de la parole est bien un discours: mais cette désignation n'est proprement applicable qu'au langage d'un orateur. Une nuance moins sensible sépare l'orateur des sophistes, qui prétendent s'approprier tous les ornements de son éloquence. Voici ce qui marque la distinction. Les sophistes s'attachent plutôt à maintenir le calme dans l'âme qu'à y porter le trouble. Ils visent moins à persuader qu'à plaire ; et cette coquetterie, que nous dissimulons, ils l'affichent. Dans les pensées, ils cherchent l'agrément de préférence à la justesse. Ils abondent en digressions, sèment les épisodes, et prodiguent les métaphores; ils disposent les mots comme les peintres disposent leurs couleurs, s'étudiant tantôt à les mettre en rapport, tantôt à les faire valoir par le contraste. Enfin ils terminent le plus souvent leurs périodes par le retour des mêmes désinences. XX. A côté de ce genre vient se ranger celui de l'histoire, qui aime les narrations à effet et les belles descriptions de pays et de batailles. Des harangues, des exhortations, s'y montrent par intervalles. Mais la diction historique est toujours coulante et développée, tandis que la nôtre est incisive, et comprime tous ses ressorts pour lancer le trait avec plus de vigueur. L'éloquence que nous cherchons ne s'éloignera donc guère moins du style de l'histoire que du style de la poésie. On a élevé la question de savoir en quoi le poète diffère de l'orateur. Autrefois, le nombre et la coupe des vers marquaient suffisamment la distinction; mais voilà que le nombre a complètement envahi le discours oratoire. Le nombre existe en effet partout où l'oreille reconnaît dans les sons une certaine mesure; et cela indépendamment de la construction métrique, que les Grecs nomment rythme, et qui serait un défaut dans la prose. Ce n'est pas que la prose animée de Platon et de Démocrite, si brillante d'images et de figures, n'ait souvent paru plus près de la phrase poétique que la poésie même des comiques, dont le langage n'est autre que la conversation ordinaire, bien que formulée en vers de petite mesure. La versification n'est pas le point essentiel chez le poète; mais elle ajoute à son mérite, puis que avec les mêmes conditions à remplir que l'orateur il rencontre, dans le mécanisme du vers, une difficulté de plus. Malgré la pompe et la majesté de certains poètes, je crois qu'ils diffèrent surtout des orateurs, d'abord, par une faculté moins limitée de créer des mots et de les allier; puis, par l'habitude de donner plus de soin à l'expression qu'à la pensée; habitude née du besoin de plaire à toutes sortes de juges. Il est vrai qu'ils se rapprochent par le goût et par l'art de choisir les termes. Mais cet unique point de ressemblance fera mieux ressortir encore la différence du reste. La question est donc jugée ; et, s'il y subsiste encore quelque doute, la solution ne nous intéresse pas. Voilà donc l'éloquence oratoire séparée de celle des sophistes, des historiens et des poètes. Reste à la faire connaître par des attributs positifs. XXI. L'homme éloquent cherché par Antoine sera pour nous celui qui, dans la défense d'un intérêt politique ou privé, saura prouver, plaire, entraîner. Prouver, c'est la stricte obligation de l'orateur; plaire, c'est son moyen de séduction; entraîner, c'est son triomphe. Dès qu'il entraîne, sa cause est gagnée. De ces trois conditions de succès sont nés les trois genres de diction. Il faut employer le style simple pour prouver; le tempéré, pour plaire; le pathétique, pour entraîner; et, entraîner c'est toute l'éloquence. Outre un jugement exquis, il faut encore une rare puissance de talent pour calculer les effets et gouverner l'action de ce triple ressort; enfin; pour faire à chaque genre sa part, suivant les besoins de la cause. Le bon sens est donc le fondement de l'éloquence, comme de toute chose, mais ce qui convient n'est pas moins difficile à observer dans le discours que dans le monde. C'est ce que les Grecs appellent τὸ πρέπον, les Latins, decorum; matière féconde de préceptes admirables; matière digne de l'étude la plus scrupuleuse, puisqu'il n'est rien dont l'ignorance entraîne à plus d'écarts, et l'homme, et le poète, et l'orateur. Il faut donc chercher la convenance dans l'expression comme dans la pensée. Différence de conditions, de rang, d'importance personnelle et d'âge; différence même de lieux, de temps, d'auditeurs : autant de modifications, soit dans le fonds, soit dans la forme du langage, et qui commandent une attention spéciale dans le discours comme dans le commerce de la vie. Le style changera suivant le sujet qu'on traite, puis selon la position sociale et de celui qui parle et de ceux qui écoutent. Ce lieu commun des bienséances est susceptible d'immenses développements. Les philosophes lui accordent beaucoup de place dans leurs traités des devoirs, où ils se gardent bien de confondre le convenable avec l'honnête, qui est invariable de sa nature. Les grammairiens s'étendent sur la même matière, en commentant les poètes, et les rhéteurs ne s'en occupent pas moins sérieusement à propos de tous les discours et de chacune de leurs parties. Qu'y aurait-il, en effet, de plus inconvenant qu'un étalage de mots pompeux et de lieux communs au sujet d'une gouttière, et devant un seul juge; ou qu'un style nu et familier quand il s'agit du peuple romain? XXII. Ce serait confondre les genres. D'ailleurs l'inconvenance est relative aux personnes, soit à celui qui parle, soit aux juges, soit même à la partie adverse. Elle se montre, non pas seulement dans les choses, mais souvent dans les mots. Sans doute les mots ne sont rien sans les choses, mais on a vu le sort d'une pensée dépendre du succès ou de la défaveur des termes qui l'ont exprimée. Il faut, en tout, se renfermer dans une juste mesure. Chaque chose a la sienne sans doute, mais le trop choque toujours plus que le trop peu. Ne pas savoir se dire : assez; est un défaut qu'Apelles reprochait aux peintres. Vous concevez, mon cher Brutus, quels développements demanderait cette matière. Il lui faudrait un livre à part. Mais c'est assez pour notre plan d'établir que les considérations de convenance et d'inconvenance se reproduisent dans toutes les occasions de parler et d'agir, dans les plus grandes comme dans les moindres. Mais plus ces considérations ont d'importance, plus il est essentiel de tracer une démarcation profonde entre la convenance et la nécessité. Par nécessité, on entend une loi absolue, invariable, universelle : par convenance, une obligation relative et subordonnée aux personnes et aux temps. Actions, paroles, physionomie, geste, démarche, la convenance s'étend à tout; et l'inconvenance aussi : l'inconvenance est le plus grand écueil du poète, a qui l'on ne pardonnerait pas de faire parler le méchant en homme de bien, ou de mettre dans la bouche d'un insensé le discours d'un sage. Voyez le peintre du sacrifice d'Iphigénie. Après avoir montré par une admirable gradation la tristesse chez Calchas, la douleur chez Ulysse, et chez Ménélas, le dernier abattement, il comprit qu'il fallait jeter un voile sur la tête d'Agamemnon; convenance indiquée par l'impossibilité d'exprimer à l'aide du pinceau les angoisses du coeur paternel. Voyez le comédien lui-même étudier les convenances pour s'y asservir. Que ne doit donc pas faire l'orateur, qui en apprécie toute l'importance? Il examinera ce qui convient à son sujet, et pour l'ensemble et pour les détails, afin de donner à chaque partie d'un discours le genre de diction qu'elle comporte, si toutefois le discours entier ne demande pas un seul et même style. XXIII. Voici le moment de déterminer enfin le caractère de chaque genre. Plus d'une fois je me suis récrié contre les difficultés d'une si haute entreprise; mais toute réflexion devient inutile quand ou a quitté le port. Nous n'avons plus maintenant qu'à faire voile, selon le vent qui nous pousse. Et, d'abord, esquissons l'orateur rigoureusement attique. Son langage familier comme celui de la conversation, est simple et uni ; mais de ce terre-à-terre, à l'absence de l'art, il y a bien plus loin qu'on ne pense. Ceux qui n'ont pas le talent de la parole se figurent, en l'écoutant, qu'ils n'ont qu'à vouloir pour parler aussi bien que lui. Mais cette simplicité qu'ils jugent si aisée à reproduire les trahit à l'essai, et se montre insaisissable. C'est qu'il y a de la vie dans ce corps qui semble recéler si peu de sang. C'est qu'à défaut d'une grande force musculaire, on y trouve du moins cette consistance que donne la plénitude de la santé. Commençons par affranchir de la tyrannie des nombres l'orateur attique. Ces nombres dont nous traiterons plus tard, sont de mise ailleurs; mais lui, il les repousse absolument. Sans contrainte, comme sans écart, son allure est libre, mais non capricieuse et déréglée. Chaque mot se montre indépendant du mot voisin. Notre orateur glisse au milieu de ces hiatus avec une gracieuse mollesse, qui leur donne je ne sais quel charme, et il s'avance, toujours insouciant de l'expression, à la poursuite de l'idée. Mais d'autres soins réclament son attention, que n'embarrassent pas l'arrangement des périodes et la succession des mots. N'allez pas croire que cette diction simple et rapide soit en effet négligée; rien de plus étudié qu'une telle négligence. Il est des femmes, dit-on, qui négligent toute parure, et n'en savent que mieux plaire. L'éloquence attique tire le même avantage de sa simplicité. Là, comme ici, le charme opère, et les moyens restent cachés. Imaginez une toilette dont toute prétention semble bannie. Point de diamants. Le fer n'a point tourmenté la chevelure ; aucun fard n'a enluminé le visage d'une blancheur ou d'un incarnat factice; la propreté vient seule au secours des grâces naturelles. Telle sera la séduction d'un style pur, toujours simple, toujours clair, fidèle à toutes les convenances, et d'une exquise latinité. XXIV. Nous admettrons pourtant avec Théophraste une nouvelle qualité, qu'il place au quatrième rang dans l'énumération de celles de l'orateur, et qu'il définit, un éclat doux et continu. On multipliera donc ces traits vifs et inattendus, qui sont un des signes distinctifs du genre. Mais on n'usera qu'avec timidité des ressources tirées du répertoire de la rhétorique, je veux dire, des figures de mots et de pensées. L'effet des mots comme ornement est de deux sortes, et résulte, ou de leur valeur intrinsèque, ou de la place qu'ils occupent. La première catégorie renferme d'abord les mots propres généralement usités; c'est-à-dire, ou celui qui sonne le mieux à l'oreille, ou celui qui peint le mieux la chose. Ensuite, les mots étrangers au langage ordinaire, tel que le mot métaphorique, c'est-à-dire, pris ou emprunté d'ailleurs, et détourné de son acception commune; le mot dérivé, le mot nouveau ou créé, le mot vieilli ou tombé en désuétude, quoique, à vrai dire, ce dernier appartienne à la classe des mots propres, mais rarement usités. La seconde catégorie est celle des termes dont la valeur dépend de leur position; l'agrément qui en résulte manifeste si bien le pouvoir d'un mot mis à sa place, qu'il suffit d'une simple transposition pour détruire l'effet produit, lors même que la pensée n'a pas subi la moindre altération. Il y a ainsi des milliers de pensées dont le fond demeure invariable, quand les termes ont changé; mais, après une telle épreuve, ce n'est plus guère par leur éclat qu'elles se recommandent. Ainsi l'orateur attique s'en tient à son élégante; il craindrait de se fourvoyer à créer des mots nouveaux, à en rajeunir d'autres, à se lancer dans les tropes, à prodiguer les figures de style et de pensée. Sobre, et même avare de tous ces ornements, il n'hésitera pas toutefois à user, même largement, de certaines métaphores tombées dans le domaine de la conversation à la ville et aux champs. Il parlera, comme tout le monde, des yeux de la vigne, du luxe des moissons, de prairies altérées ou de riantes campagnes; toutes façons de parler dont la hardiesse est justifiée par la vérité des images, ou par l'absence du mot propre. Il s'en sert donc pour se faire comprendre, non pour courir après un peu d'esprit. Aussi le style simple usera plus librement de cette sorte de métaphore que des autres; mais il en sera toujours plus sobre que le style sublime. XXV. La définition que nous avons donnée plus haut de la convenance, nous dispense d'expliquer ce que nous entendons ici par inconvenance. Or, elle serait flagrante, si le style simple se permettait de ces métaphores ambitieuses qui ne sont admissibles que dans un autre genre. Quant à l'effet que tel mot ne peut produire qu'à telle place, où il brille d'un éclat qu'il n'aurait plus ailleurs, effet qu'on peut considérer comme le port du style (et que les Grecs ont nommé σχήματα, nom qu'ils étendent aussi aux figures de pensée), c'est un genre d'ornement que peut employer, avec réserve toutefois, l'orateur attique ; bien entendu qu'on reconnaisse avec moi plus d'une sorte d'atticisme. On peut bannir d'un repas la somptuosité prodigue, sans en exclure une certaine élégance compatible avec l'économie; c'est ainsi que le style simple, quoique ennemi de la magnificence, admettra, mais sans profusion, des agréments avoués et choisis par le bon goût. Notre orateur s'interdira les recherches étudiées dont j'ai parlé plus haut, les combinaisons symétriques, les allitérations, le retour des mêmes chutes, le cliquetis de deux mots qu'un simple changement de lettre a mis en rapport. Ce sont là des beautés où le travail se fait trop sentir. Il lui faut des moyens de succès ou la séduction opère moins à découvert, et soit moins aisément prise sur le fait. Il ne s'accommodera pas mieux des figures de répétition, car elles exigent que le débit s'anime par degrés jusqu'aux explosions de voix; et la sienne ne sort jamais de son diapason. Il peut faire usage de toutes les autres figures de mots ; mais il évitera les périodes de longue haleine. Ses phrases seront coupées, et n'offriront que des mots reçus dans la conversation. Il ne laissera voir ni trop de hardiesse dans les métaphores, ni trop d'éclat dans les figures de pensée. Point de ces prosopopées où la république pérore, où les morts retrouvent la parole. Point de ces énumérations qui étreignent une infinité d'objets dans les longs bras d'une période. Laissons ces grands efforts à des personnes plus robustes; il ne faut exiger ni attendre de notre orateur qu'il se donne une poitrine d'athlète. Son débit ne fera pas plus de fracas que son style. Et pourtant la simplicité à laquelle il s'est voué n'exclut pas absolument la plupart des figures de pensées : mais c'est une parure qu'il a soin de froisser un peu avant de s'en revêtir. Car la sévérité d'ajustement est, à nos yeux, ce qui le caractérise. L'action ne sera, chez lui, ni tragique ni théâtrale. Il s'aidera peu du geste, mais beaucoup de la physionomie; une mobilité expressive, sans dégénérer en grimace, fera lire dans ses traits le fidèle commentaire du discours. XXVI. La plaisanterie assaisonne bien le genre simple; et l'on en tire un merveilleux parti. Il y en a deux espèces, l'enjouement et la raillerie; toutes deux bonnes à mettre en oeuvre. L'enjouement donnera de la grâce aux détails de la narration; la raillerie aiguisera et décochera les traits du ridicule : mais restons dans notre sujet, et bornons-nous à quelques avis généraux. La plaisanterie maniée à tout propos est la ressource du bouffon : trop libre, elle doit être abandonnée aux tréteaux; outrée, elle trahit un mauvais cœur ; dirigée contre le malheur, elle devient inhumaine; contre le crime, elle risque de faire éclater le rire, où devrait éclater l'indignation. Avant de lancer la raillerie, l'orateur pèsera bien ce qu'il doit à sa propre dignité, à celle de ses juges, et ce que comportent les circonstances du moment : toutes conditions qui rentrent dans le chapitre des convenances. Qu'il évite soigneusement ces bons mots amenés de loin, ou fabriqués à loisir, et qu'on apporte tout faits. Il n'est rien de plus glacial. Qu'il respecte l'amitié, comme le rang; qu'il n'aille jamais jusqu'à l'outrage qui fait des blessures mortelles : qu'enfin, il ne frappe que sur ses ennemis, mais non sur tous; non sans relâche, non de toutes manières. Avec ces ménagements, il ne lui restera plus qu'une condition à remplir, c'est d'assaisonner les plaisanteries de ce sel fin et piquant dont je ne trouve pas un grain dans nos Attiques du jour, quoique ce soit là ce qu'il y ait de plus Attique au monde. J'ai terminé le portrait de mon orateur du genre simple; grand orateur pourtant et véritablement Attique. Car toute manière de parler, piquante ou solide, est un fruit du terroir athénien. Ce n'est pas que la fine plaisanterie soit l'assaisonnement obligé de l'éloquence; si Lysias et Hypéride l'ont maniée avec succès, si Démade en a obtenu la palme, Démosthène n'y a pas réussi. Je le regarde, moi, comme un modèle accompli d'urbanité; mais sa raillerie est moins de verve que d'enjouement. La verve annonce plus de vivacité dans l'esprit, et l'enjouement, plus de savoir faire. XXVII. Je passe au genre tempéré. Plus abondant, plus nourri que le genre dont il vient d'être question, il a moins d'élévation que le sublime dont je m'occuperai bientôt. C'est ce que le langage a de moins nerveux, mais de plus suave. Il a une plénitude qui manque au premier genre ; mais il est écrasé par la magnificence de l'autre. Ici tout ornement est de mise, car le seul but est de charmer. La Grèce a vu fleurir de nombreux talents en ce genre; mais, selon moi, Démétrius de Phalère les a tous éclipsés. Sa diction est une causerie douce et facile, mais parfois étincelante de l'éclat des métaphores et des métonymies dont elle est semée. La métaphore, ainsi que j'ai eu souvent occasion de le dire, transporte une expression de son acception ordinaire à un autre sens analogue, soit pour obtenir une heureuse alliance de mots, soit pour suppléer un terme que la langue ne fournit pas. La métonymie ne change rien au sens, mais elle remplace un mot par un autre mot, ayant avec le premier une relation de dépendance. C'est bien aussi un transport, mais avec une différence que des exemples feront sentir. On lit dans Ennius : Arcem et urbem orbas; c'est une métaphore; mais arcem, employé pour patriam, est aussi une métonymie, comme Africa tremit, pour Afri tremunt, chez le même auteur. Les rhéteurs nomment cette figure hypallage, c'est-à-dire, échange, parce que c'est une sorte d'échange de mots. Les grammairiens l'appellent métonymie; ce qui signifie transport de nom. Aristote, qui donne le nom de métaphore à toutes ces figures, range sous la même dénomination la catachrèse ou abus de mots. On dira par catachrèse minutum animum pour paruum animum; cet abus des mots a, tantôt l'agrément pour excuse, et tantôt la nécessité. Quand les métaphores se succèdent sans interruption, leur ensemble prend le nom d'allégorie. Ce mot grec fait bien comprendre que le discours exprime alors toute autre chose que ce qu'il semble dire. Mais il vaudrait mieux désigner tous ces tropes par le terme général de métaphore. Le style de Démétrius de Phalère est plein de métaphores qui lui donnent le plus grand charme. Il abonde également en métonymies. Aucun orateur ne s'est montré plus prodigue de cette espèce de figure. Le genre tempéré (celui dont je parle) s'accommode de toutes les figures de mots et de la plupart des figures de pensées. Il fournit de larges développements aux discussions savantes et aux lieux communs qui n'exigent pas d'expression passionnée. En un mot, c'est l'éloquence telle qu'on la rapporte de l'école des philosophes. Elle a un mérite qui lui est propre, mais qui pâlit bien vite quand elle ose se montrer auprès du sublime. Ce style paré, fleuri, brillant de coloris et d'élégance, assemblage coquet de toutes les séductions de la parole et de la pensée, s'avisa un jour de quitter les bancs des sophistes, où il avait pris naissance, et parvint à se glisser au barreau. Mais dédaigné par le genre simple, et repoussé par le sublime, il s'est arrêté à égale distance de tous deux. XXVIII. Grandeur, richesse, force, magnificence; tels sont les attributs du genre sublime, le plus puissant des trois. C'est par des formes larges et majestueuses que l'éloquence a conquis, sur l'admiration des peuples, tant de prépondérance dans leur gouvernement. J'entends cette éloquence à grands mouvements, à grands éclats, qu'on suit avec stupeur dans son essor prodigieux, et qu'on désespère d'atteindre; cette éloquence qui se saisit des âmes, et les remue en tous sens; qui brise ou pénètre, et qui, souveraine de l'opinion, impose des idées nouvelles, et détrône celles qui régnaient. Quelle différence entre ce genre et les deux autres! quiconque, à force de s'exercer dans le genre simple, est arrivé à parler avec esprit et avec goût, sans porter plus haut ses prétentions, se trouve d'emblée grand orateur, quoiqu'on en reconnaisse de plus grands. Comme il s'est placé sur un terrain qui n'a rien de glissant, une fois sur ses pieds, il n'a plus de chute à craindre. Quant au style intermédiaire, que j'appelle tempéré, l'orateur qui en connaît à fond et s'en est approprié les ressources, n'a plus de chances sérieuses contre lui. Souvent exposé à des mécomptes, il ne l'est jamais à une catastrophe. Après tout, il ne tomberait pas de bien haut. Ces garanties sont loin d'exister pour l'orateur sublime à qui j'assigne le premier rang. Si, malheureusement, sa nature, ses études, ses prédilections, lui ont imprimé une direction exclusive vers les régions supérieures; si, toujours majestueux, toujours tendu, toujours enflammé, il ne sait quelquefois tempérer cette fougue par l'alliance des deux autres genres, il ne recueillera qu'humiliation. En effet, l'orateur simple a pour lui sa finesse et cette connaissance du monde qui annonce un sage. L'orateur tempéré nous séduit par ses agréments; mais l'orateur sublime, qui ne sait être que sublime, paraît à peine dans son bon sens. Quoi ! ne jamais trouver un moment de calme pour parler posément, pérorer sans analyse, sans définition, sans tons variés, sans enjouement, même dans des causes qui, en tout ou en partie, exigent ces accessoires; prendre feu au premier mot, avant d'avoir échauffé ses auditeurs, n'est-ce pas là le transport d'un frénétique qui vient se ruer parmi des personnes de sang-froid, ou l'extravagance d'un homme qui pousse, au milieu de gens à jeun, les hurlements de l'ivresse? XXIX. Nous le tenons, mon cher Brutus, cet orateur, objet de nos recherches; mais ce n'est malheureusement qu'en idée. Car si ma main pouvait le saisir, non, lui-même, avec toute la puissance de sa parole, ne saurait me faire lâcher prise. Le voilà trouvé celui qu'Antoine n'avait jamais vu. Hâtons-nous d'énoncer ici en peu de mots ce que nous ne tarderons pas à développer. L'orateur parfait est celui qui, maniant à propos les trois genres, sait toujours être simple dans les petites choses, sublime dans les grandes, tempéré dans celles qui tiennent le milieu. Jamais, me direz-vous, un tel orateur n'a existé. Eh ! sans doute. Je dis ce que je voudrais voir, non ce que j'ai vu. Et me voilà revenu à ce type, à cette forme idéale de Platon, visible pour l'esprit, insaisissable pour les sens. Ce n'est pas l'homme éloquent que je cherche; car il ne faut rien de mortel ou de périssable. Je ne poursuis qu'une abstraction, une qualité dont le possesseur serait éloquent; et cette qualité n'est autre que l'éloquence même. Être de raison, qui ne se révèle qu'aux yeux de l'esprit, et dont le caractère, je n'hésite pas à répéter ma définition, est de revêtir les petites choses d'un style simple; les moyennes, d'un style modéré; les grandes, d'un style majestueux. Tout mon plaidoyer pour Cécina roulait sur l'ordonnance du préteur. On avait embrouillé le point de droit. J'ai eu soin de l'éclaircir par des définitions, après lesquelles j'ai glissé l'apologie du droit civil. A des chicanes de mots, j'ai opposé des distinctions précises. Ma défense de la loi Manilia amenait l'éloge de Pompée. Aussi le discours est-il d'un bout à l'autre du genre tempéré qui se prête aux formes du panégyrique. L'affaire de Rabirius intéressait la majesté du peuple romain. Mon style s'agrandit avec le sujet, et j'y fis passer tout le feu dont je me sentais consumé. Voilà l'emploi successif des trois genres. Mais il faut, dans certaines causes, le mélanger, et passer plus d'une fois de l'un à l'autre. Quelle est la forme d'élocution qu'on ne trouve pas dans mes Verrines, dans mes plaidoyers pour Avitus, pour Cornélius, enfin dans un grand nombre de mes harangues? J'en citerais les exemples, si je ne les croyais trop connus, ou trop faciles à trouver. Car il n'y a pas de beauté oratoire, dont on ne puisse rencontrer dans mes discours, je ne dis pas le parfait modèle, mais au moins l'intention, le reflet. Le but n'est pas atteint, mais il est montré. Au reste, il ne s'agit pas de moi, mais de l'art lui-même. Loin de m'extasier devant mes oeuvres, je sens que Démosthène lui-même, ne satisfait pas pleinement la chagrine délicatesse de mon goût. Non, cette supériorité qu'il faut lui reconnaître dans tous les genres ne répond pas toujours à l'exigence insatiable de mon oreille, à son inextinguible besoin de quelque chose d'immense et d'infini. XXX. Brutus, pendant votre séjour à Athènes, vous avez fait de cet orateur une étude approfondie et complète avec Pammène, le plus ardent de ses admirateurs ; ses ouvrages ne sortent pas de vos mains, et cependant vous lisez les miens de temps à autre. Vous savez donc mieux que personne que s'il atteint souvent à la perfection, je fais mille efforts pour en approcher ; et qu'il met toujours le doigt sur le genre d'éloquence que demande chaque sujet, et fait acte de puissance, tandis que je suis réduit à faire acte de bonne volonté. Grand homme, succédant à d'autres grands hommes, il a trouvé dans ses contemporains des rivaux encore plus redoutables. Et moi, s'il m'eût été donné de parvenir à la hauteur qui tentait mon ambition, j'aurais fait aussi quelque chose de grand, dans cette Rome, qui, au jugement d'Antoine, n'avait pas encore retenti des accents de la véritable éloquence. Certes, Antoine, qui la refusait à Crassus et à lui-même, ne l'eût reconnue ni chez Cotta, ni chez Sulpicius, ni chez Hortensius. Cotta n'a rien d'élevé ; Sulpicius, rien de séduisant; et la force manque trop souvent à Hortensius. Leurs devanciers, je veux dire Crassus et Antoine, étaient plus propres qu'eux à manier tous les genres. J'ai donc trouvé l'oreille des Romains toute neuve encore à l'impression d'une éloquence variée, qui sait prendre tous les tons et tes croiser sans dissonance. Et, malgré la médiocrité de mes essais, malgré la faible autorité de mon exemple, j'ai donné le premier à cette importante innovation une vogue prodigieuse. Que d'acclamations à ce passage que je prononçai, bien jeune encore, sur le supplice des parricides, et dont le style n'a pas tardé à me paraître bien jeune aussi! « S'il est des choses dont l'usage soit naturellement commun à tous, c'est assurément l'air pour les vivants, la terre pour les morts, la mer pour les naufragés, le rivage pour ceux qu'ont rejetés les flots. Eh bien! le parricide, pendant toute la durée de son supplice, vit sans respirer l'air du ciel; il meurt, sans que la terre reçoive ses ossements; il flotte, sans que l'eau baigne sa dépouille; il est enfin rejeté par la mer au milieu des rochers, sans qu'il soit accordé à ses restes un instant pour y reposer. » L'effervescence du jeune âge se fait sentir dans ce morceau; et les applaudissements dont il fut accueilli s'adressaient moins au talent actuel de l'auteur, qu'à ce qu'il offrait d'espérances et d'avenir. On reconnaît la même main, mais déjà plus ferme, dans ce portrait de femme: "Épouse de son gendre, belle-mère de son fils, corruptrice de sa fille". Mais je n'étais pas exclusivement passionné pour cette manière; et au milieu même de cette emphase de jeunesse figuraient, dans ma défense de Roscius, de nombreux morceaux, les uns du genre simple, les autres du genre fleuri. On trouvera la même variété de tons dans tous mes plaidoyers pour Avitus, pour Cornélius, et tant d'autres : car il n'est pas un seul orateur, même dans la Grèce, si désoeuvrée, qui en ait écrit autant que moi. Et pourtant j'ai varié chacun de mes discours par le mélange des genres que je viens de recommander. XXXI. Si je loue Homère, Ennius, les poètes en général, et surtout les tragiques, de détendre quelquefois leur style, d'en varier les formes, de descendre même jusqu'au ton de la conversation ordinaire, ce n'est pas pour me condamner, moi orateur, à rester cloué au sublime. Mais sans aller chercher les poètes, ces génies inspirés, n'avons-nous pas vu des acteurs, inimitables dans leur genre, jouer, sans en sortir, les rôles les plus étrangers à leur emploi, ou même en sortir tout à fait sans perdre leur supériorité? N'a-t-on pas souvent accueilli avec faveur l'acteur comique dans la tragédie, l'acteur tragique dans la comédie? Et moi, je craindrais de faire les mêmes efforts ! Quand je dis moi, Brutus, c'est vous que je veux dire, car mes efforts sont à bout depuis longtemps; et je ne serai jamais que ce que je suis. Mais vous, vous asservirez-vous à une manière uniforme dans toutes les causes? ou n'accepterez-vous de causes que celles qui s'ajusteront à votre genre exclusif? ou plaiderez-vous une cause d'un bout à l'autre avec une monotonie systématique? ce serait vous déclarer contre Démosthène, votre orateur favori. Il l'est, sans doute, puisque j'ai vu dernièrement à Tusculum son image en bronze, au milieu des vôtres et de celles de vos ancêtres. Or, Démosthène ne le cède pas à Lysias pour la simplicité; à Hypéride, pour la finesse et le trait; à Eschine, pour la douceur et l'éclat des paroles. Il a des discours entiers, ou dans le genre simple, comme sa harangue contre Leptine; ou dans le genre sublime, comme quelques Philippiques; ou dans ces deux genres à la fois, comme ses deux plaidoyers contre Eschine, l'un dans l'affaire de l'Ambassade, l'autre pour la Couronne. Il ne réussit pas moins dans le tempéré, qu'il saisit dès qu'il le veut, et où il fait ordinairement sa première pause en descendant des hauteurs de l'éloquence. Mais quand il vous arrache des cris d'admiration; quand vous vous sentez maîtrisé par son irrésistible puissance, soyez sûr qu'il plane alors dans la région du sublime. Quittons un moment Démosthène, pour ne pas faire d'une question générale une question individuelle. La nature et la force de l'éloquence, voilà ce qu'il s'agit de développer. Mais, encore une fois, qu'on se souvienne que je ne prétends pas donner de préceptes. Je veux analyser l'art, non l'enseigner. S'il m'arrive souvent d'aller plus loin, c'est que je dois être lu par d'autres que par vous. Si, en effet, ce Traité était pour vous seul, pour vous, qui en savez bien plus que moi sur ces matières, je ne me donnerais pas le ridicule d'y semer quelques leçons. Mais j'ai l'espoir d'être utile à de nombreux lecteurs. Car si mon nom est pour ce livre une recommandation assez faible, le nom de Brutus, à qui je l'adresse, lui assure la célébrité. XXXII. A mon avis, l'orateur ne peut pas se contenter de la faculté qui le caractérise, celle de donner à son sujet de riches développements; il doit y joindre la dialectique, art qui est en contact intime avec l'art de parler. Je sais bien que discourir et disserter sont deux ; qu'autre chose est de parler, et de parler en orateur. Mais l'un et l'autre se trouvent compris dans le talent de l'élocution. L'argumentation, le débat, appartiennent plus essentiellement à la dialectique; les belles formes de langage et le charme de l'expression, à l'éloquence. Zénon, le père de la philosophie stoïcienne, exprimait avec la main la différence de ces deux arts. Il serrait les doigts et fermait le poing, pour figurer la dialectique; puis ouvrant la même main et la déployant tout entière. Voilà, disait-il, l'emblème de l'éloquence. Avant Zénon, Aristote avait dit au commencement de sa Rhétorique, que cet art est comme le pendant de la dialectique, et que toute la différence consiste en ce que l'une étend son cadre, et que l'autre le resserre. Je veux que mon orateur possède tout ce qui, de près ou de loin, peut se ramener aux besoins de l'élocution. Ce n'est pas à vous, versé comme vous l'êtes dans toutes ces théories, que j'apprendrai qu'il y a deux méthodes d'enseignement. La première est d'Aristote, qui a donné sur cette matière un traité fort étendu; la seconde a été introduite par ses successeurs, qui ont pris le nom de dialecticiens, et dont l'imagination a compliqué la science par une foule de questions épineuses. L'ignorance absolue de ces doctrines n'est pas permise à qui veut recueillir la palme de l'éloquence. Il faut même qu'il possède et l'ancienne et la nouvelle méthode, qui porte le nom de Chrysippe. Il apprendra aussi à connaître la valeur des mots, leur nature, leurs espèces diverses, soit qu'on les considère isolément, soit qu'on étudie le jeu de leurs combinaisons; les diverses manières d'exprimer une idée ; les règles pour démêler le vrai d'avec le faux, les déductions à tirer de chaque fait; les conséquences qui découlent naturellement d'un principe, et celles qui ne sont point légitimes; l'art enfin de séparer les éléments d'une proposition équivoque, et d'y porter la lumière par les distinctions : tous ces procédés doivent être familiers à l'orateur, car il aura fréquemment besoin d'y recourir. Mais il aura soin d'en déguiser la sécheresse, qui doit disparaître sous le vernis de l'élocution. XXXIII. Une nécessité première en matière de raisonnement méthodique, c'est de déterminer l'état de la question. Sans ce préliminaire nettement admis de part et d'autre, le débat ne saurait avoir ni direction fixe ni résultat. Il faut donc, sur chaque point, expliquer plus d'une fois sa pensée; il faut que toute obscurité s'évanouisse devant le flambeau de la définition. Définir, c'est énoncer clairement ce dont il s'agit, mais avec toute la brièveté possible. Le genre de chaque chose une fois déterminé, vous savez qu'il faut le subdiviser en espèces, et régler, d'après cette division, toute la distribution du discours. Il faut donc que notre orateur sache, au besoin, faire intervenir la définition, non pas avec la précision technique, si propre aux discussions de la philosophie, mais sous une forme plus développée, plus attrayante, et mieux appropriée au goût et à l'intelligence du public. Il saura aussi descendre du genre aux espèces, sans trop resserrer la division, et sans l'étendre inutilement. Quant à l'à-propos et au mode d'application de tout ceci, je n'ai pas à m'en occuper. Je l'ai déjà dit, je me pose comme critique, et non comme professeur. L'arsenal de la dialectique ne fournira cependant à notre orateur qu'une partie des armes qui lui sont nécessaires. Il y en a d'autres à emprunter à la philosophie, dont il doit s'être rendu tous les lieux familiers, et par l'étude et par la pratique. S'il n'est pas rompu à les manier, il se trouvera au dépourvu quand il faudra parler sur la religion, sur la mort, sur les affections de famille, sur l'amour de la patrie, sur les biens et les maux, sur les vertus et les vices, sur les devoirs, sur la douleur, sur les plaisirs, sur les perturbations de l'âme, sur les égarements de l'esprit: lieux qui reviennent si souvent dans les causes, mais qu'on traite généralement avec trop de réserve; parce que si on n'est préparé par l'espèce de gymnastique dont je viens de parler, il est impossible de trouver la touche large, l'abondance, la noblesse, que réclament ces graves sujets. XXXIV. Je parle ici des matériaux du discours, et non de la mise en oeuvre, car je veux que l'orateur se soit assuré d'un fond intéressant pour des auditeurs éclairés, avant de s'occuper de la forme. La chose avant les mots. Je voudrais même, que, pour éclairer son esprit, et agrandir le cercle de ses idées, il eût, comme Périclès que j'ai déjà cité, une teinture des sciences naturelles. Comment descendrait-il des choses du ciel aux choses d'ici-bas, sans en rapporter une habitude de grandeur et d'élévation qui se reproduirait dans sa pensée et son langage? Mais que ces sublimes considérations ne lui fassent pas négliger des notions plus applicables aux transactions sublunaires. Qu'il connaisse à fond le droit civil, dont l'usage au barreau est de tous les jours. Quand toutes les contestations s'y décident par les lois, ou par la jurisprudence, quoi de plus honteux que d'entreprendre la défense d'un client sans rien connaître à la jurisprudence ni aux lois? Notre orateur sera versé dans les annales de l'antiquité, et surtout dans celles de son pays. Il saura quels peuples ont dominé sur la terre, et quels rois se sont fait un nom célèbre. L'ouvrage de notre cher Atticus a rendu ce travail facile. Rigoureusement fidèle à l'ordre chronologique, il a su renfermer dans un seul volume, sans rien omettre d'essentiel, l'histoire de sept cents ans. Ignorer ce qui s'est passé avant nous, c'est se condamner à une éternelle enfance. Qu'est-ce que la vie de l'homme, si l'on ne rattache au présent la mémoire des temps qui ne sont plus? Les souvenirs de l'antiquité, l'autorité de ses exemples, sont, pour le discours, une source inépuisable d'intérêt; et rien ne dispose mieux les esprits à la confiance et au respect. XXXV. Ainsi armé de toutes pièces, l'orateur se présente enfin au barreau. Familier de longue main avec les divers genres de causes, il sait que toute contestation roule sur les choses ou sur les mots. Quant aux choses, il y a question de fait ou question de droit. Quant aux mots, il s'agit d'un équivoque ou d'une contradiction. Il y a équivoque quand les mots paraissent ne pas répondre à l'intention de celui qui s'en est servi. Cette sorte d'ambiguïté provient assez ordinairement de l'omission d'un mot essentiel. Il en résulte un double sens, caractère de toute équivoque. Les genres de cause ne sont pas nombreux. Il n'y a pas non plus beaucoup de préceptes sur les arguments. Ils sont tirés de deux sortes de lieux, dont les uns sont inhérents, et les autres, étrangers au sujet. C'est dans la mise en oeuvre que réside le succès; car les preuves se trouvent fort aisément. A quoi donc se réduisent les conseils de l'art? Le voici : Assurez-vous par l'exorde la bienveillance, l'attention, l'intérêt des auditeurs. Exposez le fait en peu de mots, et d'une manière assez plausible, assez claire, pour que l'intelligence en soit à l'instant saisie. Établissez solidement vos preuves; détruisez celles de votre adversaire le tout, sans confusion, et à l'aide d'une argumentation de détail qui fasse sortir de chaque principe toutes ses conséquences. Vous finirez par une péroraison qui, suivant les besoins de la cause, puisse enflammer ou calmer les esprits. Il serait difficile de formuler des règles précises à l'appui de chacun des conseils de l'art, puisqu'il faudrait une règle pour chaque éventualité. Et à quoi bon des règles? l'orateur que je cherche n'est plus à son apprentissage, car je lui prête une éloquence à laquelle il n'y ait rien à redire. Pour tout approuver en lui, je veux d'abord qu'il saisisse les convenances avec ce goût exquis et cette sagacité flexible qui sait tenir compte des circonstances et des personnes. Je n'accorderai jamais, en effet, qu'un même langage soit admissible en toute occasion, pour ou contre tous, dans toutes les bouches, et par toutes les oreilles. XXXVI. Il faut donc, pour être éloquent, savoir porter avec grâce le joug de toutes les bienséances. Dès lors, plus de difficulté pour rencontrer toujours l'expression juste et convenable, pour éviter d'être sec où il faut être abondant, de baisser le ton quand il doit être grandiose, et réciproquement. Le style marchera toujours de pair avec le sujet. Exorde modeste, sans paroles ambitieuses ou irritantes, mais semé de ces traits fins qui préviennent pour l'orateur, ou portent coup à l'adversaire. Dans les narrations, vraisemblance, clarté. Les faits s'y dérouleront en style familier plutôt que sur le ton de l'histoire. La cause a-t-elle peu d'importance, l'argumentation sera simple, et dans la confirmation, et dans la réfutation. Elle ne s'élèvera jamais qu'en raison de la grandeur du sujet. Est-elle, au contraire, de nature à mettre en jeu les grands ressorts de l'éloquence, l'orateur alors se donne carrière. Habile à saisir une circonstance favorable, il s'empare des esprits, et leur imprime la direction la plus convenable aux intérêts dont il a entrepris la défense. Il est deux moyens irrésistibles, qui, sans jamais lasser l'admiration des hommes, ont porté l'éloquence au comble de la gloire. Je ne parle ici ni de l'éloquence ni de la force qu'on doit porter dans toutes les parties d'un discours. Je veux faire ressortir deux ornements principaux qui répandent sur le tout l'éclat et la vie. L'un est la thèse, l'autre, l'amplification. Les Grecs ont assigné, comme je l'ai dit plus haut, le nom de θέσις (thèse) à toute question généralisée, et le nom d' αὔξησις (amplification) à ces riches développements qu'on peut, il est vrai, donner indifféremment à toutes les parties du discours, mais qui brillent surtout dans l'emploi des lieux communs. Ces lieux, encore une fois, sont ainsi nommés, parce qu'ils se représentent dans une foule de causes, quoiqu'il faille à chaque fois des modifications pour les adapter à celles qu'on traite. Il arrive souvent que la thèse embrasse la cause entière. Car, quel que soit le point à décider (en grec, κινόμενον), il est bon de l'amener à l'état de question générale, à moins qu'il ne s'agisse que d'un fait douteux, et qu'on ne puisse procéder que par conjecture. Aristote a donné d'élégantes formules pour les questions générales; mais il faut, dans un plaidoyer, quelque chose de plus nerveux que la méthode péripatéticienne. On aura soin, dans l'emploi des lieux communs, de ne pas se laisser entraîner à des développements qui fassent perdre de vue, et le client qu'il s'agit de défendre, et l'adversaire qu'il importe de mener rudement. L'amplification est un levier dont la puissance triomphe de tout. Comme elle agrandit ou rapetisse à son gré tous les objets, elle peut, dans le cours de l'argumentation, intervenir partout où s'offre l'occasion d'atténuer ou de faire valoir. Dans la péroraison, j'ose le dire, son emploi est sans limite. XXXVII. Il est deux autres ressorts, dont le jeu, habilement conduit, assure à l'éloquence les plus éclatants triomphes. Les Grecs nomment le premier ἠθικὸν (éthique); il consiste dans l'observation fidèle des moeurs, des caractères, et de tout ce qui tient aux habitudes sociales. L'autre, qu'ils appellent παθητικὸν (pathétique), est le secret d'émouvoir et d'entraîner ; secret qui fait de l'éloquence une véritable souveraine. L'éthique a quelque chose d'engageant et d'agréable qui dispose les esprits à la bienveillance ; le pathétique, violent, bouillant, impétueux, arrache la victoire, et l'emporte au milieu des débris qui signalent son passage. Grâce au pathétique, tout médiocre que je suis, si toutefois je ne suis pas au-dessous du médiocre, l'impétuosité de mon attaque a souvent terrassé mes adversaires. Elle a déconcerté le grand orateur Hortensius, qui ne trouva plus une seule parole pour la défense d'un ami. Elle a paralysé la langue de Catilina, le plus audacieux des hommes, quand je l'accusais en plein sénat. Enfin, dans une cause particulière, mais de la plus grande importance, elle a tellement étourdi Curion le père, qu'après s'être levé pour sa réplique, il demeura muet, et prit le parti de se rasseoir un instant, disant qu'un sortilége avait égaré sa mémoire. Parlerai-je de l'art d'exciter la compassion? J'ai souvent eu l'occasion de le mettre en oeuvre; car, chaquefois que je me suis vu associer à d'autres avocats dans la même cause, on s'accordait à me charger de la péroraison. Ce n'est pas à mon talent, c'est à ma sensibilité naturelle, que je dois mes succès en ce genre. Je me sens doué de cette faculté telle quelle, et je n'ai pas eu à me repentir de la posséder à un si haut degré. On en jugera par la lecture de mes plaidoyers, quoiqu'il soit impossible de faire passer dans un livre ce feu du débit qui, après avoir passionné l'auditoire, s'éteint dans la solitude du cabinet. XXXVIII. Mais ce n'est pas assez d'attendrir les juges, comme je l'ai fait dans une péroraison, en leur présentant un jeune enfant soulevé dans mes bras; et une autre fois en faisant lever tout à coup un illustre accusé, dont je montrais aussi le fils en bas âge : langage d'action qui arracha de tous les coins du forum des sanglots et des larmes. Il ne suffit pas, dis-je, que le juge s'attendrisse; il faut, qu'à votre gré, il s'irrite et s'apaise; qu'il s'indispose ou s'intéresse; qu'il passe tour à tour de l'admiration au mépris, de la haine à l'amour, du désir à la satiété, de l'espérance à la crainte, de la joie à la douleur. Pour toutes ces passions, j'ai fourni des exemples; les émotions pénibles abondent dans mon accusation contre Verrès, et les sentiments doux, dans mes défenses. Car, de tous les moyens d'émouvoir ou de calmer les auditeurs, il n'en est pas un que je n'aie tenté; je dirais que j'ai atteint la perfection en ce genre, si je le croyais moi-même, et si la crainte d'être taxé de présomption n'arrêtait la vérité sur mes lèvres. Mais, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas le talent chez moi, c'est l'âme qui s'exalte; et c'est au point que je ne suis plus maître de moi. Pour enflammer les auditeurs, il faut que la parole brûle. Je citerais mes ouvrages, si vous ne les aviez lus; ou nos auteurs latins, s'ils me fournissaient des exemples. Quant aux Grecs, il n'est pas convenable de leur en emprunter. Il y en a bien quelques-uns de Crassus, mais non dans le genre judiciaire. Je n'en trouve ni chez Antoine, ni chez Cotta, ni chez Sulpicius. Hortensius savait mieux parler qu'écrire. A défaut d'exemple, cherchons notre éloquence dans le monde idéal; ou, s'il faut personnifier un modèle, prenons Démosthène, dans son discours pour la Couronne, à partir de l'endroit où il commence à parler de ses actes, de ses conseils et de ses droits à la reconnaissance de la république. De là jusqu'à la fin du discours, tout répond si bien à l'idée que je me suis faite de l'éloquence, que nous ne pouvons rien désirer de mieux. XXXIX. Il nous reste à déterminer la forme et ce qu'on appelle le caractère du style oratoire; ou plutôt, cette investigation est déjà faite pour quiconque se rappelle les observations qui précèdent. Nous avons indiqué les brillants effets que produisent les mots, soit isolés, soit enchaînés dans la phrase. L'orateur puisera largement à cette source de beautés, et n'admettra pas une seule expression qui ne se recommande par la force ou par la grâce. Il multipliera les métaphores, qui, par de piquantes analogies, promènent l'esprit d'un objet à l'autre, et lui impriment de rapides secousses auxquelles se prête voluptueusement sa mobilité naturelle. Les figures qui naissent de l'arrangement des mots donnent aussi beaucoup de charme au discours. Elles font l'effet de ces décorations extraordinaires qu'on déploie dans les grandes solennités, soit au théàtre, soit sur la place publique. Ces ornements ne sont pas les seuls de la fête, mais ce sont ceux qui tranchent le plus. Les figures de mots ont le même privilége d'attirer plus vivement l'attention : ce sont, tantôt des mots répétés, soit sans changement, soit avec une légère altération, et qui se montrent ordinairement en tète de la phrase, souvent à la fin, quelquefois aux deux places, d'autres fois au milieu; tantôt des termes, qui, après avoir paru dans une acception, reparaissent avec une acception différente. Ici, l'orateur affecte les mêmes chutes et les mêmes désinences; là, il varie le choc des contraires. Plus loin, il procède par gradation ascendante ou descendante; ailleurs, il supprime les liaisons, et les phrases se succèdent sans s'enchaîner. Quelquefois il passe sous silence, après en avoir averti, certains détails que fait ressortir cette discrétion insidieuse. Vous l'entendrez encore, tantôt se reprendre à dessein, comme d'une erreur, tantôt pousser une exclamation d'étonnement, ou soupirer une plainte. Il n'est pas jusqu'à la déclinaison qui ne lui fournisse une figure tirée d'un même nom répété plusieurs fois, à des cas différents. Mais la prééminence appartient aux figures de pensées. Démosthène en fait un fréquent usage; et c'est, aux yeux de quelques critiques, le mérite de son éloquence. On trouve à peine un passage de lui où le fonds des idées ne se produise sous une forme saillante. Et il faut en convenir, on n'est point orateur, quand on ne sait pas donner ces vives et brillantes tournures à ses pensées. Ce secret vous est connu, mon cher Brutus; il est donc superflu de passer ici en revue les figures de pensées, et d'en donner des exemples : je me borne à les indiquer. XL. Notre orateur saura présenter une même chose sous ses divers aspects, afin d'y concentrer l'attention et de l'y tenir arrêtée. Voyez-le atténuer certains objets, railler à propos, s'écarter à dessein de son sujet, annoncer ce qu'il se propose de dire; puis, après avoir conclu sur chaque point entamé, revenir sur ses pas pour reprendre ce qu'il a dit, fortifier ses preuves dans un résumé, presser de questions son adversaire, s'interroger lui-même, et se répondre; exprimer une chose, et en laisser entendre une autre, paraître hésiter sur ce qu'il dira, ou sur la manière de le dire; établir des divisions; omettre, ou négliger un point; prévenir en sa faveur; se décharger sur son adversaire des reproches qu'on lui adresse à lui-même; entrer en délibération, tantôt avec les juges, tantôt avec celui qu'il combat; tracer des portraits de moeurs; supposer des dialogues; donner une voix aux êtres inanimés, détourner adroitement les esprits de la question; souvent exciter la gaieté, provoquer le rire ; courir au-devant d' une obj ection, établir des parallèles; s'appuyer sur des exemples, distribuer les rôles, imposer silence à qui veut l'interrompre; déclarer qu'il en sait plus qu'il n'en dit; prémunir les juges contre une surprise; s'émanciper parfois jusqu'à la hardiesse, jusqu'à la colère; parfois aussi éclater en reproches; prier, supplier, verser du baume sur une plaie trop vive; se détourner de son but; faire des voeux, des imprécations; causer familièrement avec ceux qui l'écoutent. Tout cela ne dispensera pas l'orateur de déployer les autres qualités du discours; il saura être bref, s'il le faut; frapper l'imagination par des peintures si vives, qu'on croie avoir les objets sous les yeux; exagérer ou donner à entendre plus qu'il n'a dit; jeter çà et là des mots plaisants, et semer souvent des traits de moeurs et de caractères. XLI. Voilà le fonds, je dirai presque le champ sans limite, d'où l'éloquence tire souvent ce qui fait sa force et sa splendeur; mais il faut que le style mette en oeuvre ces éléments, les lie et les ordonne. Nul, sans cette condition, ne peut prétendre au glorieux titre d'orateur. Au moment de poursuivre cette dissertation, je m'arrête, inquiet déjà de ce que j'ai dit, et, plus encore, de ce qu'il me reste à dire. Car, sans parler des envieux, espèce qui se rencontre partout, les amis même de ma gloire ne peuvent-ils pas trouver inconvenant qu'un homme dont le sénat, aux applaudissements du peuple romain tout entier, a payé les services par des honneurs jusqu'alors inconnus, descende à ce détail minutieux des artifices du langage? Leur répondre que je n'ai pas voulu me refuser à la demande de Brutus, n'est-ce pas désarmer toute critique? et le besoin de satisfaire un tel homme, un tel ami, en m'associant à son honorable désir, n'est-il pas pour moi l'excuse la plus légitime? Mais si j'allais plus loin, si j'osais déclarer (et que n'ai-je assez de talent pour justifier cette audace! ) que j'ai voulu former un corps de préceptes qui pût guider sûrement notre studieuse jeunesse dans la route de l'éloquence, quel bon esprit s'aviserait de me blâmer? En temps de paix, l'éloquence n'a-t-elle pas toujours tenu à Rome le premier rang, et la jurisprudence, le second? La première ne donne-t-elle pas le crédit, la gloire, la sécurité; tandis que la seconde, bornée aux formules d'attaque et de défense, est presque toujours réduite à mettre sous le patronat de l'éloquence son propre domaine, qu'elle aurait bien de la peine à sauver, si celle-ci lui refusait son concours? Quoi! de tous temps les hommes les plus illustres ont tenu à honneur d'enseigner la jurisprudence, et d'attirer chez eux une affluence de disciples; et ce serait un titre de réprobation de former, d'encourager la jeunesse au talent de bien dire! Si c'est un mal de bien parler, hâtez-vous de proscrire l'éloquence. Mais s'il est vrai qu'en couvrant de gloire celui qui la possède, elle contribue encore à l'illustration nationale, comment serait-il honteux d'enseigner ce qu'il est si honorable de connaître? Ce qu'il est si beau de savoir, il n'est pas moins beau d'en donner des leçons. XLII. Mais l'enseignement de la jurisprudence a pour lui l'autorité de l'usage; l'autre est une innovation, j'en conviens, et cette différence s'explique. Pour s'instruire dans la science du droit, il suffit d'assister aux audiences d'un jurisconsulte. Celui-ci n'est tenu à aucun sacrifice de temps pour ses disciples, lesquels arrivent chez lui à l'heure de ses consultations; de sorte qu'il parle à la fois pour eux et pour ses clients. Les orateurs, au contraire, ne trouvant point le temps de donner des leçons, celui qu'ils passent chez eux est dévoré par l'instruction des causes et par la composition des plaidoyers; celui qu'ils passent au forum se consume en plaidoiries. Le peu de moments qui leur restent, il faut le consacrer à quelque délassement indispensable. Comment donc se réserver une heure pour instruire et pour diriger les autres? D'ailleurs, avant de donner des leçons, il faut s'être fait un corps de doctrine ; et nos anciens orateurs avaient, je crois, moins de théorie que de talent naturel. Aussi étaient-ils plus en état de parler que d'instruire; tandis que je me trouve, peut-être, dans une position absolument différente. Autre objection. L'enseignement est une fonction sans dignité. Oui, si l'on s'asservit à la routine des écoles. Mais si par une suite de conseils, d'exhortations, d'interrogations; par un échange d'observations et d'idées; par une communauté de lectures; si même par un enseignement direct on peut rendre les hommes meilleurs, je ne sais pourquoi l'on s'en ferait scrupule. Il est honorable, par exemple, d'enseigner quelle formule de procédure peut rendre valable l'aliénation des biens sacrés. Comment serait-il déshonorant d'enseigner l'art de faire respecter la consécration une fois consommée? Mais, dira-t-on, on s'honore du titre de jurisconsulte, même quand on est peu versé dans les matières de droit, tandis que les orateurs s'accordent à dissimuler leur talent. N'est-ce pas une preuve que si la jurisprudence est généralement estimée, l'éloquence est généralement suspecte? D'abord, l'éloquence peut-elle se cacher; et, si elle se dissimulait, qui serait dupe de ce déguisement? A qui persuadera-t-on qu'un orateur, élevé par la noblesse de son art à la plus haute considération, aurait à rougir, s'il enseignait à son tour ce qu'il lui a été si glorieux d'apprendre? D'autres peuvent y mettre plus de mystère; moi, j'ai toujours avoué mes études; et comment les désavouer, quand on sait que, dans ma jeunesse, je n'ai quitté Rome que pour aller au delà des mers chercher l'instruction; quand ma maison est comme le rendez-vous des esprits les plus cultivés; quand mes entretiens laissent percer, peut-être, quelques rayons des lumières que j'ai puisées partout; quand enfin mes écrits ont révélé à tant de lecteurs les soins que je me suis donnés pour apprendre? XLIII. Je conviendrai toutefois que, dans ce qui me reste à dire, il y a réellement moins de dignité que dans les considérations qui précèdent. Car je vais parler de l'art d'ajuster les mots, de mesurer, et, en quelque sorte, de supputer les syllabes. C'est un talent que je juge indispensable, mais qui, magnifique dans ses résultats, l'est fort peu dans ses détails élémentaires. On peut en dire autant de beaucoup de choses; jamais avec plus de vérité qu'ici. Car il en est des arts libéraux comme de ces grands chênes, dont on admire la masse imposante, sans donner la moindre attention à la souche ni aux racines, qui, pourtant, sont la première condition de l'existence de l'arbre. Fidèle au précepte d'un vers devenu proverbe, et qui défend de rougir de l'art qu'on professe, je ne songe pas même à dissimuler le plaisir que je prends aux travaux qui m'occupent ici; plaisir, rendu plus vif encore par votre empressement à me les imposer. Les objections, que je prévois trop bien, m'ont commandé cette sorte d'apologie. Mais, admettant que mes raisons ne seraient pas aussi bonnes que j'aime à les croire, dois-je craindre, quand il ne me reste plus de rôle à jouer, ni au barreau, ni dans les affaires publiques, de trouver un censeur assez chagrin, ou plutôt assez impitoyable, pour me faire un crime de chercher des consolations au sein de la littérature, plutôt que de me jeter dans les bras de l'oisiveté, qui m'est odieuse; ou de céder à la tristesse, dont je veux repousser les assauts? Les lettres, qui m'accompagnaient autrefois avec quelque honneur, tantôt devant les tribunaux, tantôt au milieu du sénat, charment aujourd'hui ma retraite. Je ne consacre pas exclusivement mes méditations à l'objet que je traite ici: elles se portent sur des sujets plus graves, et d'un ordre beaucoup plus élevé. Oui, si je puis mettre la dernière main à ces travaux de cabinet, j'ose répondre qu'ils ne pâliront pas auprès de mes compositions publiques. Mais revenons à notre sujet. XLIV. Dans l'arrangement des mots, il faut, ou que la fin de l'un se lie avec grâce au commencement de l'autre, pour caresser l'oreille par les sons les plus doux; ou qu'un rythme élégant en arrondisse tous les contours, ou que leur ensemble forme une période nombreuse dont la chute soit bien amenée. Examinons d'abord ce qu'on doit faire pour deux mots qui se suivent. Je me garderai bien de prescrire ici la vétilleuse attention qu'exige une mosaïque, ou un ouvrage de marqueterie. Donner des soins à un travail si puéril, ce serait imiter la manie dont Lucilius a marqué si finement le ridicule, dans ces deux vers ironiques où Scévola plaisante Albucius :
Quam lepide lexeis compostae? ut tesserulae omnes
Je n'approuve pas ces laborieuses minuties; un tel arrangement ne doit être qu'un jeu pour une plume exercée. Si l'oeil du lecteur prend toujours les devants, l'esprit de l'écrivain ira plus vite que ses doigts. Attentifs l'un et l'autre à ce qui va suivre, ils sauront éviter les cahotements, les hiatus, les cacophonies. La grâce, la noblesse même ne sauvent pas la pensée, quand l'expression blesse l'oreille, ce juge si dédaigneux et si sévère. Le génie de la langue latine est si exigeant à cet égard, qu'un rustre même élide une voyelle, plutôt que de la heurter contre une autre voyelle. On blâme toutefois Théopompe d'avoir poussé ce soin jusqu'à l'excès. Il imitait en cela son maître Isocrate. C'est un reproche qu'on ne fera pas à Thucydide, ni même à un écrivain plus grand qu'eux tous, à Platon. Je ne parle pas de ses dialogues, où cette négligence est un effet de l'art; mais on la retrouve dans l'oraison funèbre qu'il prononça, suivant l'usage d'Athènes, en l'honneur des guerriers morts pour la patrie, et dont le succès fut si prodigieux, vous le savez, que la loi prescrit d'en faire tous les ans une lecture solennelle; on y rencontre à chaque instant ce choc de voyelles que Démosthène évite presque partout comme un défaut. [XLV. Mais les Grecs ont leur goût à eux. Le nôtre nous défend, quand nous le voudrions, de faire ainsi violence aux voyelles; témoins ces harangues de Caton, d'ailleurs si négligées; témoins tous nos poètes, à l'exception de ceux que la mesure du vers forçait souvent de recourir à l'hiatus. C'est ainsi que Mévius a dit : Vos qui accolitis Istrum fluuium atque Algidam; et au même endroit : Quam nunquam uobis Graii, atque Barbari. Ennius en offre un seul exemple : Scipio inuicte; et j'ai dit moi-même : Hoc motu radiantis Etesiae in uada ponti : mais c'est une licence que nous ne faisons excuser qu'en nous en montrant fort sobres, tandis que les Grecs s'en font un mérite. Mais pourquoi ne parler que des voyelles? on a vu aussi retrancher des consonnes pour obtenir une brève, comme dans multi mollis; uasi' argenteis; passi' crinibus; tecti' fractis. La licence a été plus loin, et l'on a contracté jusqu'à des noms propres pour les rendre plus maniables. Comme on avait fait bellum de duellum, et bis de duis, on fit par analogie Bellius de Duellius, vainqueur de la flotte carthaginoise, bien que Duellius fût le nom de tous ses ancêtres. D'autres contractions n'ont eu pour but que de flatter l'oreille. Pourquoi le nom d' Axilla, l'un de vos ancêtres, a-t-il été changé en Ala (Ahala), si ce n'est pour éviter une lettre d'une prononciation un peu difficile? Les progrès du beau langage ont fait plus tard disparaître la même lettre des mots maxilla, taxillus, vexillum, paxillus. On aimait aussi à fondre deux mots en un, comme sodes pour si audes, et sis pour sivis; ou même trois, comme dans capsis (cape si vis). On dit ain', pour ais ne; nequire pour non quire; malle, pour magis velle; et encore dein, exin, pour deinde, exinde. Qui ne sent pourquoi l'on dit cum illis, tandis que cum ne se montre jamais suivi de nobis? On dit nobiscum pour éviter un concours de syllabes qui présenterait une image obscène; ce qui serait arrivé tout à l'heure, si je n'avais eu soin de séparer cum de nobis par le mot autem. De nobiscum on est arrivé bien vite à uobiscum; et l'analogie n'a pas tardé à faire subir la même opération à cum me, cum te, qui sont devenus mecum et tecum. [ XLVI. Nous avons aujourd'hui des réformateurs qui s'avisent un peu tard de corriger certaines formes traditionnelles. Au lieu de deum atque hominum fidem, par exemple, ils s'obstinent à lire deorum. Était-ce ignorance chez nos pères? ne profitaient-ils pas plutôt d'une licence autorisée par l'usage? Aussi le même poète qui avait dit : Patris mei factum meum pudet pour meorum factorum, et exitium pour exitiorum, n'emploie jamais liberum pour liberorum, syncope dont nous usons journellement dans ces phrases Cupidos liberum, in liberum loco; mais il dit, comme le veulent nos puristes : Neque tuum unquam in gremium extollas liberorum ex te genus et ailleurs : Namque Aesculapi liberorum --- et cependant Pacuvius a dit dans son Chrysès : Ciues, antiqui amici maiorum meum. C'était, du moins, une locution usitée alors. Mais il a en créé une un peu plus dure dans ce vers : Consilium, augurium, atque extum erpretes; et dans cet autre : Postquam prodigium horriferum, portentum pavos; quoiqu'une telle contraction ne soit pas en usage dans tous les neutres. Je répugnerais donc à dire armum pour armorum, comme dans ce vers du même poète : Nihilne ad te de iudicio armum accidit? Mais je n'hésite nullement, avec l'autorité des tables des censeurs, à dire fabrum et procum pour fabrorum et procorum, je ne dirai cependant pas duorum uirorum judicium; Trium uirorum capitalium; decemuirorum litibus iudicandis. Je trouve, il est vrai, dans Accius : Video sepulcra, dua duorum corporum. Mais il a dit ailleurs : Mulier una deum uirum. Je n'ignore pas qu'elles sont les locutions régulières; mais j'use, sans scrupule, de la liberté de dire indifféremment, Proh deum et Proh deorum; parce que l'alternative est autorisée. Mais je dis trium uirum, et non uirorum; sestestertium nummum, et non nummorum, parce qu'ici l'usage a irrévocablement frappé de désuétude le génitif grammatical. XLVII. Nos aristarques ont aussi la prétention de proscrire nosse et iudicasse; comme si nous ne savions pas que le mot s'emploie fort bien dans son entier, mais que la syncope est aussi consacrée par l'usage; Térence emploie indifféremment les deux formes : Eho, tu cognatum tuum non noras? et ailleurs: Stilphonem, inquam, noveras? " Sit est la bréviative du primitif complet siet. Tous deux se trouvent chez un de nos poètes dans la même phrase :
Quam cara sintque, post carendo intelligunt,
Je suis loin de blâmer Scripsere alii rem, quoique scripserunt soit plus régulier. Mais quand l'usage est né d'une exigence de l'oreille, j'y souscris volontiers. Ennius a dit : Idem campus habet; et ailleurs : In templis isdem. La règle voulait eisdem, qui n'est pas si coulant; l'harmonie repoussait iisdem. L'oreille a ses prédilections, que l'usage ne tarde pas à consacrer. J'aime mieux pomeridianas quadrigas, que postmeridianas, et mehercule, que mehercules. Non scire est devenu barbare; nescire est plus doux. Pourquoi meridiem, et non medidiem ? sans doute pour éviter un redoublement désagréable. La préposition abs ne se trouve plus que dans les livres de recette, et non pas même dans tous. Partout ailleurs, elle est modifiée; nous disons : Amouit, abegit et abstulit. De sorte qu'on se demande quel est le plus régulier de abs ou de ab. On a proscrit abfugit; on ne veut plus d' abfer : aufugit, aufer ont prévalu. Ce sont les deux seuls verbes où la forme de la préposition se trouve modifiée de cette manière. Nous avions les simples noti, naui et nari. Quand on a voulu y accoler la forme négative in, on l'a dénaturée pour en adoucir la prononciation; et nous disons ignoti, ignaui, ignari. Pourquoi ex usu, e republica? Parce que, dans le premier cas, le son de l'x perd de sa rudesse devant une voyelle, et qu'il ne se ferait sentir dans le second qu'aux dépens de l'euphonie. De là exegit, edidii, extulit, edidit. Ailleurs, la dernière lettre de la préposition s'est modifiée par assonance, d'après l'initiative du verbe composé, comme dans effecit, suffigit, summutauit, sustulit. XLVIII D'autres altérations ont encore ajouté à l'agrément des mots composés. Comment ne pas préférer insipientem à insapientem? iniquum à inaequum? tricipitem à tricapitem? concisum à concaesum? On a voulu introduire, ainsi pertisum mais sans succès. Quel raffinement plus délicat que cette convention contraire aux lois de la quantité de faire la préposition in brève dans inclytus, inhumanus, et longue dans insanus, infelix; de sorte que in est long quand on le joint aux mots qui commencent par les mêmes lettres que sapiens ou felix, et qu'il se prononce bref partout ailleurs! Même observation pour consueuit, concrepuit, confecit. Consultez la règle, elle vous condamne; l'oreille, elle vous absout. Pourquoi? parce qu'on la flatte en prononçant ainsi, et que le besoin de lui plaire est une loi suprême. Moi-même, sachant que les anciens n'aspiraient que les voyelles, j'avais cru devoir prononcer pulcros, Cetegos, triumpos, Cartaginem. Je m'aperçus enfin, un peu tard peut-être, que l'oreille ne s'accommodait pas de ma prononciation ; je me convertis alors à celle du peuple, qui est la vraie, et, je gardai mon érudition pour moi. Par une nouvelle bizarrerie, cependant, l'oreille et l'usage permettent de dira : Orciuios, Matones, Otones, Caepiones, sepulcra, coronas, lacrimas. Ennius dit toujours Burrus, et jamais Pyrrhus. On trouve aussi chez lui, dans les copies faites de son temps, Bruges pour Phryges; car l'alphabet latin n'avait pas encore admis de lettre grecque : il en a, depuis, reçu deux. Puisque nous disons au nominatif Phryges, mot entièrement grec, il parait peu logique de le dénaturer dans les autres cas, et de dire avec des désinences bâtardes, Phrygum, Phrygibus. Mais nos oreilles ont exigé ces terminaisons latines, et l'usage a sanctionné ce caprice. C'était pour nos ancêtres un trait d'élégance, et ce serait pour nous un trait de rusticité, de supprimer la consonne finale des mots en us, le mot suivant ne commençant pas par une voyelle. On disait donc omnibu' princeps, pour omnibus, et Vita illa dignu', locoque, pour dignus. Les poètes ne se faisaient pas faute de cette réserve, que dédaigne la poésie moderne. Si l'usage, sans autre guide que sa fantaisie, a su trouver tant de moyens de flatter l'oreille, quel résultat n'obtiendra-t-on pas d'une méthode raisonnée et des combinaisons de l'art? J'ai traité ce point sommairement, comme un simple accessoire. On ferait un long volume sur la nature et l'emploi des mots : mais cette matière occupe déjà trop de place dans mon cadre. XLIX. Si, dans un discours, le choix des pensées et celui des expressions sont uniquement du ressort de l'esprit, le choix des sons et celui des nombres n'ont d'arbitre que l'oreille. D'un côté donc, oeuvre d'intelligence; de l'autre, affaire de plaisir. Ici l'art est né des calculs de la raison; là, des exigences du sentiment. Il faut donc, ou sevrer d'un plaisir ceux dont on veut conquérir le suffrage, ou trouver le moyen d'attaquer à la fois chez eux l'esprit et la raison. Ce plaisir dont l'oreille est si avide, naît pour elle du son et du nombre. Le nombre aura son tour; occupons-nous d'abord du son. Employons, je le répète, des mots harmonieux, non ronflants comme ceux des poètes, mais heureusement choisis parmi ceux de la langue ordinaire. Ne vous lancez pas dans des hardiesses telles que Qua ponto ab Helles. Le vers Auratos aries Colchorum est plein de mots brillants. Mais en voici un que gâte la répétition d'une lettre fort dure : Frugifera et ferta arua Asiae tenet. Tenons-nous en aux solides beautés de nos mots latins, et laissons aux Grecs l'éclat de leurs termes sonores. Contentons-nous, par exemple, de dire Qua tempestate Paris Helenam, etc. Voici un modèle à suivre; mais évitons ces phrases rocailleuses: Habeo istam ego perterricrepam ---Versutiloquas malitias. Ce n'est pas assez d'avoir arrangé les mots dans un ordre favorable à l'harmonie, il faut encore songer à les mesurer; opération soumise, comme je l'ai dit, à un second jugement de l'oreille. Si l'arrangement est naturellement symétrique, la mesure est toute trouvée; Il en est de même dans les chutes semblables, dans les antithèses, dans les contrastes. Tout cela s'encadre et se balance de soi-même. C'est un travail tout fait. Gorgias est, dit-on, le premier qui ait cherché ces balancements symétriques. On en trouve un exemple dans ma Milonienne : Est enim, iudices, haec non seripta, sed nata lex; quam non didicimus, accepimus, legimus, uerum ex natura ipsa arripuimus, hausimus, expressimus; ad quam non docti sed facti; non instituti, sed imbuti sumus. Ici, tous les mots sont tellement en rapport, que le nombre paraît non pas cherché, mais rencontré. On obtient le même résultat par les contrastes, comme dans cet exemple, où l'on trouve non seulement les conditions du nombre, mais encore la mesure poétique: Eam, quam nihil accusas, damnas. En substituant condamnas, on eût évité le vers.
Bene quam meritam esse autumas, dicis male mereri.
Le vers se forme ici de l'opposition des contraires. En prose, le nombre aurait voulu : Quod scis, nihil prodest; quod nescis, multum obest. Ces formes de langage, que les Grecs nomment antithèses, c'est-à-dire, opposition de contraires, produisent spontanément, et, sans l'intervention de l'art, le nombre oratoire. Les anciens, même avant Isocrate, prenaient plaisir à ces jeux de style; Gorgias surtout, qui ne connaît presque pas d'autre nombre. J'en ai fait aussi un fréquent usage dans ma quatrième Verrine, par exemple : Conferte hanc pacem cum illo bello; huius praetoris aduentum, cum illius imperatoris uictoria; huius cohortem impuram, cum illius exercitu inuicto; huius libidines, cum illius continentia: ab illo, qui cepit, conditas, ab hoc, qui constitutas accepit, captas dicetis Syracusas. Il faut donc connaître ces sortes de nombres. L. Arrivons à la troisième espèce, le nombre de la phrase. S'il est des gens insensibles à cette mélodie, je ne vois pas ce qu'ils ont de l'homme, et ne puis concevoir comment leurs oreilles sont faites. Ce que je sais, c'est que les miennes trouvent un charme infini à la perfection d'une période complète, et s'effarouchent du manque d'équilibre d'une phrase qui pèche par excès ou par défaut. Mais que dis-je, les miennes! n'ai-je pas vu cent fois toute une assemblée se récrier d'admiration à une chose qui ne laissait rien à désirer? C'est que l'oreille éprouve un véritable besoin de sentir la pensée bien renfermée dans le cercle de la phrase. - Les anciens, se passaient fort bien de tant de symétrie. - Aussi est-ce un mérite, et le seul, qui leur manque. Ils excellaient dans l'art de choisir les mots, et leurs pensées brillaient toujours par l'énergie ou par la grâce; mais ils ne s'entendaient guère ni à les lier, ni à les arrondir. - Et c'est là précisément ce qui me charme en eux. - Mettez-vous donc la peinture antique, bornée à un si petit nombre de couleurs, au-dessus de la peinture moderne, enrichie de tant de perfectionnements? Faut-il rétrograder jusqu'à l'enfance de l'art, et le déshériter de ses précieuses acquisitions? On m'oppose avec orgueil d'anciens noms; c'est l'autorité de la vieillesse que l'antiquité donne à ses exemples; et nul, plus que moi, ne la respecte. Loin de blâmer les anciens de ce qui leur manque, j'admire ce qu'ils possèdent, et je me plais à reconnaître que ce qu'ils ont surpasse de beaucoup ce qu'ils n'ont pas. Le mérite de la pensée et de l'expression, si éclatants chez eux, est bien supérieur à l'ordonnance de la période, qu'ils n'ont pas connue : cet art n'est venu qu'après eux. Mais je crois que s'il eût existé de leur temps, ils n'auraient pas plus négligé d'en tirer parti que tous les grands orateurs qui leur ont succédé. LI. Au nom seul de nombre, dans un discours politique, ou dans un plaidoyer; nombre, si c'est un Romain qui parle; rythme, si c'est un Grec; une prévention s'élève. C'est, dit-on, tendre à la fois trop de piéges pour surprendre l'oreille. Le but d'une telle chicane est évident. On veut justifier une phraséologie décousue et tronquée, en jetant le blâme sur quiconque entend la construction et la période. Si l'expression est faible et le fond vide, fort bien. Mais si le discours offre substance et couleur, vaut-il mieux qu'il aille boitant à chaque pas, ou même s'arrête en chemin, que de fournir sa course en se déployant de front avec le sens? Ce nombre, si décrié, est-il autre chose qu'un cadre ou s'ajuste exactement la pensée? les anciens eux-mêmes, ont rencontré le nombre, quelquefois par hasard, plus souvent par instinct. Leurs passages les plus vantés sont presque tous d'un rythme harmonieux qui leur a valu ces éloges. Voilà près de quatre cents ans que le nombre a pris faveur chez les Grecs; et nous ne faisons que de l'accueillir chez nous ; Ennius aura pu, sans respect pour leur antiquité, mépriser les vers que chantaient les Faunes et les devins, Versibu', quos olim Fauni vatesque canebant; et moi je ne pourrai pas, avec la même liberté, parler sur le compte des anciens! Certes, je ne dirai pas comme lui : « C'est moi qui ai le premier ouvert la route. » Car j'ai lu et entendu beaucoup d'orateurs dont le style était presque parfaitement périodique. C'est à quoi certaines gens ne peuvent parvenir. Et ce n'est pas assez qu'on leur pardonne cette impuissance, ils veulent qu'on leur en fasse un mérite. Moi, je loue volontiers et à juste titre ceux qu'ils se piquent d'imiter, tout en reconnaissant ce qui manque à ces grands modèles. Mais je n'ai point d'éloges pour le copiste maladroit, qui ne reproduisant que leurs défauts, se tient si loin de leurs beautés. Ces hommes, dont les oreilles sont si barbares, si sauvages, récuseront-ils aussi l'autorité du savoir et de l'expérience? Je laisse de côté Isocrate, ainsi qu'Ephore et Naucrate, ses disciples; tous trois, pourtant, grands orateurs et passés maîtres dans l'art d'ourdir et d'orner la trame du style. Mais où trouver plus de science, plus de finesse, une imagination plus féconde, un jugement plus sûr que chez Aristote? qui, d'ailleurs, s'est autant déchaîné contre Isocrate? Eh bien ! Aristote, qui bannit le vers de la prose, veut qu'elle soit assujettie au nombre. Théodecte, son élève, qu'Aristote cite souvent, comme écrivain élégant et versé dans tous les artifices du style; Théodecte pense et s'exprime à ce sujet comme son maître. Théophraste insiste encore plus sur la nécessité du rythme. Nos aristarques s'inscriront-ils en faux contre de tels témoignages? Peut-être ignorent-ils que ces préceptes s'appuient sur de si imposantes autorités. C'est là l'explication la plus probable de leur entêtement; et c'est, pour mon compte, celle à laquelle je m'arrête. Mais quoi! la sensation est-elle morte chez eux? Une phrase vide on surchargée, écourtée ou raboteuse, boiteuse ou redondante, glisset-elle sur leurs oreilles sans les agacer? Qu'une brève ou une longue placée à faux échappe à un auteur, il entend une explosion de murmures soudaine et générale. Tout ce peuple cependant ignore la prosodie, ne se doute pas du nombre, ne se rend aucun compte de ce qui le choque; mais il se sent blessé, sans savoir ni comment, ni pour quoi. C'est que tous, indistinctement, nous portons dans nos oreilles le sentiment inné des longues et des brèves, comme celui des tons graves et des tons aigus. LII. Voulez-vous, mon cher Brutus, que j'entre plus avant dans cette matière, et que je lui donne plus d'étendue que les maîtres qui l'ont traitée avant moi? ou faut-il s'en tenir à ce qu'ils en ont dit? Mais pourquoi cette question? Vos lettres, ces chefs-d'oeuvre de style, ne témoignent-elles pas assez que c'est là surtout ce que vous désirez? je vais donc exposer successivement l'origine, la cause et l'emploi du nombre oratoire. Les admirateurs d'Isocrate l'exaltent surtout comme l'introducteur du rythme dans la prose. Ils prétendent que, frappé de cette froideur avec laquelle les orateurs étaient écoutés, et du vif plaisir qu'on éprouvait à entendre les poètes, il s'avisa de chercher des nombres que le discours pût admettre, et de bannir ainsi par une agréable variété cette impression d'ennui. Cette assertion n'est vraie qu'en partie, et doit être restreinte. Nul, sans contredit, n'a poussé plus loin qu'Isocrate la science des nombres. Mais l'invention n'en peut être contestée à Thrasimaque, dont tous les ouvrages nous font voir qu'il a prodigué le rythme jusqu'à l'abus. Quant aux nombres que j'ai désignés comme de la seconde espèce, et qui, sans travail de la part de l'orateur, résultent spontanément de certaines formes telles que les antithèses, les désinences semblables, les contraires, et les autres symétries naturelles, on les doit à Gorgias, qui en usa également sans mesure. Tous deux sont précurseurs d'Isocrate. C'est donc comme régulateur, et non comme inventeur du rythme, qu'il a l'avantage sur eux. Plus sobre de métaphores, moins hardi à créer des mots nouveaux, il est aussi plus sage dans l'emploi du nombre. Gorgias, passionné pour ces enjolivements, comme il les appelle, les multiplie à l'excès. Il était déjà vieux, quand Isocrate fréquenta son école en Thessalie. Mais celui-ci, tout jeune qu'il était, comprit qu'il devait se prescrire plus de modération. En vieillissant à son tour, Isocrate, qui mourut presque centenaire, sentit se refroidir peu à peu cette passion du rythme qui l'avait trop dominé. Et c'est lui qui nous a fait cette confidence dans son discours à Philippe de Macédoine; production de sa dernière vieillesse. Il y déclare qu'il s'asservit au nombre beaucoup moins qu'autrefois, et il obtient ainsi le double honneur d'avoir corrigé les autres et de s'être corrigé lui-même. LIII. Maintenant que nous connaissons l'origine et les auteurs du nombre, cherchons-en la cause. Elle est si évidente, qu'il est étonnant que les anciens n'en aient pas été frappés, surtout quand il leur arrivait si souvent de rencontrer, sans les chercher, le nombre et la cadence. L'oreille devait conspirer, avec l'intelligence, pour leur révéler l'agréable effet d'une telle rencontre. Constater ce simple résultat, c'était créer l'art; et l'art ne leur imposait qu'une seule condition, celle de s'imiter eux-mêmes. L'oreille, en effet, ou plutôt l'intelligence, dont l'oreille n'est que l'organe, porte naturellement en elle-même la mesure exacte de tous les sons; elle juge de ce qui est trop court comme de ce qui est trop long; elle attend toujours la précision et la justesse. Mutilez, tronquez le nombre, elle s'offense d'un larcin qui lui fait perdre ce qui lui est dû. Allongez, délayez le rythme; cette surcharge la révolte encore davantage. Car en ceci, comme presque en tout, le trop est plus choquant que le trop peu. La mesure du vers est restée dans les limites que lui assignait l'organisation de l'oreille, et que le goût a tracées d'après les données de l'observation. Le tour de la prose est venu beaucoup plus tard. Mais l'observation a fini par reconnaître le voeu de la nature ; et l'art, assujettissant les mots à se mouvoir dans des espaces réglés, a créé la période. Je viens d'indiquer la cause du nombre; je vais, si vous le permettez, en expliquer la nature. Ce troisième point n'est pas lié nécessairement au plan que je me suis tracé, mais il nous fera entrer dans les profondeurs de la théorie. Ici, les questions naissent en foule. Qu'est-ce que le nombre oratoire? en quoi consiste-t-il? d'où résulte-t-il ? est-il simple? double ou multiple? de quelle manière le composer ? à quoi, quand et comment l'appliquer pour éveiller un sentiment de plaisir? Cette matière peut, comme tant d'autres, se traiter par deux voies, l'une plus longue, l'autre plus courte et plus unie. LIV. En suivant la première voie, nous trouverons une nouvelle série de questions. D'abord, existe-t-il, en effet, un nombre oratoire? Bien des gens n'en conviennent pas, parce que la prose n'a pas de mesure fixe comme le vers, et parce que ceux même qui affirment l'existence du nombre, ne peuvent la démontrer. Supposez qu'il existe un nombre dans la prose, ou qu'il y en ait plusieurs; de quelle nature sont-ils? sont-ils les mêmes qu'en poésie? sont-ils différents? S'ils sont les mêmes, auxquels des mètres de la versification ressemblent-ils? Car les uns n'admettent qu'un nombre pour la prose, tandis que d'autres en reconnaissent plusieurs, ou même les reçoivent tous. D'ailleurs, simple ou complexe, le nombre est-il commun à toute forme de discours? Car, pour narrer, pour persuader, pour instruire, autant de variétés de style. Chacune a-t-elle son nombre spécial? Si les nombres sont communs, quels sont-ils? s'ils différent, en quoi? D'où vient qu'on ne les sent pas dans la prose, quand ils se font si bien sentir dans la poésie? Ce qu'on appelle discours nombreux, ne l'est-il que par la vertu du nombre? Ne l'est-il pas par l'arrangement des mots, par la qualité des expressions, ou même par la réunion de toutes ces choses; de sorte que le nombre concoure à l'effet général par la délimitation des espaces; l'arrangement, par la mélodie des sons; les expressions enfin, par l'éclat des formes? Ou plutôt, n'est-ce pas à l'arrangement seul qu'il faut tout rapporter, nombre et figures? Eh ! non, ce n'est pas à l'arrangement qu'il faut tout attribuer; car il n'a pour objet que l'énergie ou la douceur des sons; ce qui n'a rien de commun, ni avec le nombre, qui est la justesse de la mesure, ni avec les agréments du style figuré. J'admettrais, à la rigueur, quelque relation entre le nombre et les figures, parce que celles-ci portent souvent avec elles une symétrie satisfaisante. Telles sont à peu près les questions dont la solution doit mettre en évidence la nature du nombre. LV. La première, existe-t-il un nombre oratoire? n'est pas difficile à résoudre. L'oreille a prononcé. On n'a pas le droit de nier un fait, par la raison qu'on en ignore la cause. Connaît-on mieux la cause du plaisir que procure le nombre poétique? Non. C'est la nature et le sentiment qui ont fait le vers. La raison est venue en constater l'existence, et le mesurer. L'art n'a pas tardé à naître de l'observation intelligente de la nature. Le nombre se fait mieux sentir en poésie, bien que plusieurs espèces de vers ressemblent beaucoup à de la prose, quand on ne les chante point. Tels sont surtout les vers lyriques. Supprimez le chant, la prose se montre à nu. On peut en dire autant de quelques passages de nos poètes, de ce vers de Thyeste, par exemple : Quemnam te esse dicam? qui tarda in senectute ... Rien ne ressemblerait davantage à la prose, si l'on retranchait l'accompagnement de la flûte. Les vers ïambiques des comédies se rapprochent tellement du langage ordinaire, qu'on y saisit à peine quelque vestige de nombre et de versification. On conçoit dès lors que le nombre est moins facile à reconnaître dans la prose que dans les vers. L'agrément du style dépend surtout du charme de l'expression et de l'harmonie du nombre. Les mots sont des matériaux que le nombre doit polir. Mais en cela, comme en tout, le nécessaire a précédé l'agréable. Et les hommes ont trouvé un langage âpre et simple pour les premiers besoins de la pensée, bien des siècles avant d'imaginer l'art du nombre pour le plaisir de l'oreille. LVI. Hérodote, ses contemporains et ses devanciers, n'ont connu le nombre, ou ne l'ont rencontré que par hasard. Les plus anciens rhéteurs n'ont rien dit sur cette matière, eux qui ont tant écrit sur la théorie de l'art oratoire. On a toujours commencé par trouver ce qu'il y a de plus facile et de plus nécessaire. Ainsi l'on a connu de bonne heure les métaphores, les dérivés et les composés, dont l'emploi est journalier dans la conversation. Le nombre, qui jamais n'a approché du foyer domestique, et qui n'a ni parenté ni liaison avec le langage familier, n'a été signalé et connu que fort longtemps après. Mais bientôt, appliqué à l'art de la parole, il est venu donner comme le fini de l'oeuvre, et la dernière touche du pinceau. Si la diction paraît tantôt concise et serrée, tantôt étendue et large, n'en cherchez pas la cause dans la nature des mots employés. Elle tient à des intervalles plus ou moins longs, semés à dessein dans la période, et qui déterminent, dans les nombres, une variation correspondante. La période sera donc, suivant la marche des nombres, accélérée ou ralentie dans tout sou cours. Il est donc évident que la prose, quoique soumise au nombre, ne doit pas avoir la mesure uniforme des vers. Mais ces nombres sont-ils ceux des poètes, ou sont-ils d'une autre espèce? C'est la seconde question. Tout nombre à une mesure; donc, tout nombre est poétique. Les nombres ou pieds (car le nombre représente le pied qu'il mesure) se divisent en trois classes. L'une antérieure ou tète, l'autre postérieure. Dans le pied de la première classe, ces deux parties sont égales. Dans le pied de la seconde classe, la partie postérieure est le double de la tête. Enfin, dans la troisième classe, la partie postérieure du pied vaut une tète et demie. Ainsi le dactyle (une longue suivie de deux brèves) est un nombre ou pied de première classe, puisque la longue équivaut à deux brèves. L'iambe (une brève suivie d'une longue) est de la seconde classe; enfin le péon (une longue suivie de trois brèves) appartient à la troisième et dernière classe. Or, de toute nécessité, ces trois sortes de pieds entreront dans la prose; il ne reste donc plus, pour produire le nombre, qu'à les bien placer. Fort bien; mais duquel ou desquels de ces trois systèmes de pieds se servira- t-on de préférence? La parole les admet nécessairement tous. Il est d'autant plus aisé de le comprendre, que souvent on fait un vers par mégarde; et c'est même une faute grave. Mais notre attention n'est pas toujours éveillée, et nous ne pouvons nous écouter nous-mêmes. A peine parvenons-nous à éviter le vers ïambique et le vers hypponactéen ; cela tient à la nature de la prose latine, qui est presque toute composée d'iambes. Notre oreille, que l'habitude a rompue au rythme du vers ïambique, le reconnaît facilement au passage ; mais il échappe à l'orateur d'autres vers, qui, pour être d'une nature moins familière, n'en sont pas moins des vers. Tendance vicieuse, contre laquelle il faut se prémunir de longue main. Hiéronyme, célèbre péripatéticien, s'est appliqué à extraire de plusieurs ouvrages d'Isocrate une trentaine de vers, la plupart iambiques. Il s'y trouve aussi quelques vers anapestes, faute vraiment choquante. Il y a bien un peu de mauvaise foi dans la critique d'Hiéronyme ; car il commence par retrancher la première syllabe du premier mot de la phrase; puis il y ajoute au dernier mot la première syllabe de la phrase suivante. Et c'est ainsi qu'il parvient à former cette sorte de vers anapeste, qu'on nomme vers aristophanéen. Contre de tels accidents, la précaution n'est ni possible, ni nécessaire. L'acharnement d'Hiéronyme m'a donné la fantaisie de l'éplucher à mon tour. Et ne voilà-t-il pas que notre censeur a laissé échapper, dans l'expression même de son blâme, un vers ïambique? Concluons de tout ceci, qu'il y a des nombres dans la prose, et que ce sont les mêmes que ceux de la poésie. LVII. Déterminons maintenant quelle espèce de nombre convient le mieux au discours oratoire. Les uns se déclarent pour l'iambe, parce qu'il est le plus rapproché de la prose; ce qui l'a fait choisir par les auteurs dramatiques, comme; propre à donner à leur dialogue un air de vérité : tandis que le dactyle, s'accorde mieux avec la pompe de l'hexamètre. Éphore, orateur médiocre, mais sorti d'une excellente école, met autant de soin à employer le péon et le dactyle, qu'à éviter le spondée et le tribraque. Il prétend que les trois brèves qui suivent la longue dans le péon, et les deux brèves qui la suivent dans le dactyle, font couler le discours dans une pente douce et suffisamment rapide; tandis que le spondée, avec ses deux longues, rend la phrase tramante, et que le tribraque, dont les trois syllabes sont toutes brèves, lui imprime mi mouvement trop précipité; double écueil qu'il évite en gardant un juste milieu. Quant à moi, je ne me rangerai ni du côté des partisans exclusifs de l'iambe, ni du côté d'Éphore. S'interdire le péon, avec les premiers, c'est se priver du nombre qui a le plus de douceur et le plus de noblesse. Aristote en juge bien autrement, lui qui trouve le nombre héroïque, trop élevé pour la prose, et l'iambe trop conforme au langage familier. Il condamne dans le discours, et la familiarité abjecte, et l'emphase guindée. Il veut un ton de noblesse soutenue qui commande l'admiration. Il proscrit le chorée qui présente une longue suivie d'une brève, mesure égale aux trois brèves du tribraque. Il lui donne même le nom de cordacique, à cause de son allure sautillante, incompatible avec la dignité. Le pied favori d'Aristote est le péon. Il soutient que tout le monde l'emploie sans s'en apercevoir, parce que c'est un nombre intermédiaire entre le dactyle héroïque, et l'iambe familier. Dans ces trois pieds, en effet, la partie postérieure, comparée à la partie antérieure, donne l'égalité, ou un pour le dactyle, deux pour l'iambe, et un et demi, ou le terme moyen, pour le péon. Ainsi, Éphore et les autres partisans de l'iambe, en s'arrêtant au nombre le plus facile, ont sacrifié la dignité du discours à sa commodité. Les vers sont remplis d'iambes et de dactyles. Il faut donc avoir soin de n'en pas mettre plusieurs de suite dans la prose, qui repousse comme absolument contraires à son génie toutes les habitudes de la versification. Or le péon est le pied dont le vers s'accommode le moins. Raison de plus pour que la prose s'en empare. Éphore n'a pas su voir que le spondée qu'il rejette, est de même valeur que le dactyle qu'il adopte. C'est qu'il mesure les pieds par les syllabes, et non par les temps. Il se trompe de même sur le tribraque, dont la mesure est de trois temps comme celle de l'iambe, mais qui a l'inconvénient de mal terminer la phrase, parce que la voix, à la fin d'une période, aime à se reposer sur une syllabe longue. Telle est la doctrine d'Aristote sur le péon; doctrine adoptée par Théophraste et par Théodecte. Pour moi, je n'hésite pas à déclarer que tous les pieds, mélangés habilement, doivent entrer et se fondre en quelque sorte dans le discours. Comment se soustraire au reproche de monotonie, en reproduisant toujours certains pieds, à l'exclusion de tous les autres? Sans doute il ne faut pas que la prose soit cadencée comme la poésie. Mais il ne faut pas non plus la dépouiller du nombre, qui la distingue du langage populaire. La langue des poètes n'est pas assez libre, et l'art s'y fait trop sentir. La langue du peuple est lâche et triviale. On écouterait la première sans plaisir, et l'autre avec dégoût. Encore une fois, la prose ne doit être ni rigoureusement mesurée, ni tout à fait privée de mesure. Le péon y dominera, puisque ainsi le veut une imposante autorité; mais on aura soin d'y entremêler avec art tous les autres nombres dont le maître n'a rien dit. LVIII. Mais comment s'y prendre pour former cet heureux mélange des nombres, opération aussi délicate que celle d'assortir la pourpre à d'autres couleurs? Et puis, comment assigner à chacun des différents genres de discours les nombres qui lui conviennent le mieux? L'iambe dominera dans le style simple; le péon, dans le style sublime; ces deux pieds seront l'un et l'autre soutenus du dactyle, qui s'y marie facilement; et il résultera de cette union, dans le corps du discours, une agréable variété. Cet adroit mélange, en dérobant à l'attention le piège tendu aux oreilles, dissimulera les combinaisons de symétrie, et le succès de cette diversion sera d'autant plus sûr, que la pensée et l'expression seront plus remarquables. Les auditeurs, en effet, tout entiers à la pensée et aux paroles qui la développent, demeurent sous le charme; et tandis qu'ils cherchent à se rendre compte de leur admiration, le nombre leur échappe, et passe inaperçu. Il est vrai que, même sans le nombre, une belle pensée bien exprimée ne saurait manquer de plaire. Le nombre n'est pas une condition d'existence pour la prose comme pour la poésie. Un discours où tout serait soumis au nombre, serait un poème. Il lui suffit, pour être nombreux, d'avoir une allure égale et décidée, où rien de boiteux ne trahisse un défaut d'équilibre. Il ne sera pas entièrement composé de nombres, mais il se rapprochera de cette constitution. Et voilà pourquoi la difficulté d'écrire est plus grande en prose qu'en vers. Ici, des lois positives, invariables, nécessaires; là, des conditions de rythme vagues, arbitraires et négatives. Car il ne doit être ni trop étendu, ni trop resserré, ni trop négligé. La musique a des temps frappés, qui donnent à la mesure une précision parfaite. La prose n'a que des règles générales, des préceptes d'ensemble, qui la laissent sans guide pour les détails, et sans autre régulateur que le caprice de l'oreille qu'elle veut séduire. LIX. On demande si le nombre doit s'étendre à toute la période, ou ne se faire sentir qu'au commencement et à la fin. Il suffit, suivant l'opinion la plus générale, qu'en s'arrêtant, la période forme une chute nombreuse. C'est beaucoup, mais ce n'est pas assez. Il faut que cette chute soit un repos au bas d'une pente douce, et non une brusque culbute. L'oreille attend toujours la fin, qui est aussi pour elle un temps de repos. La fin doit donc lui offrir le nombre qui la délasse. Mais il faut que le dernier effet soit préparé dès l'origine de la phrase, et que son mouvement initial soit combiné de manière à la faire glisser mollement jusqu'au point d'arrêt. Une bonne école, un exercice fréquent, l'habitude d'écrire, rendent si facile la pratique de cette règle, que, dans l'improvisation même, le nombre vient spontanément harmoniser les périodes. La pensée n'a pas plutôt conçu la place de la phrase, que les termes sont accourus en foule. L'esprit, avec cette inimaginable rapidité qui lui est propre, envoie chaque mot à la place où il produit mieux son effet. Et, tantôt dès le début, tantôt dans le cours de la période, il en a préparé la chute, qu'il sait toujours varier. Que la marche du discours soit vive ou modérée, il faut aviser dès le commencement aux moyens d'arriver au terme. Mais si, dans le nombre, comme dans les autres ornements du langage oratoire, nous suivons le procédé des poètes, c'est toujours en le modifiant, de manière à ne pas donner à la prose l'air de la poésie. LX. Dans l'une comme dans l'autre, établissons deux divisions, les matériaux et la mise en oeuvre, c'est-à-dire, les mots et l'arrangement qui les fait valoir. Pour chaque division, nous formerons trois classes. Ainsi les mots seront ou anciens ou nouveaux, ou métaphoriques car il n'est pas ici question des mots du langage ordinaire. L'arrangement, à son tour, nous donnera composition, symétrie, nombre. Sous tous ces rapports, les poètes, plus indépendants que nous, montrent beaucoup moins de réserve. Leurs métaphores sont plus multipliées et plus hardies. Ils aiment à s'emparer des mots vieillis et à créer des termes nouveaux. Ils ont aussi plus de nombre, mais en cela ils obéissent à la loi de la nécessité. On voit qu'entre eux et nous, il n'y a ni trop de disparité, ni trop de ressemblance, et que leur nombre n'est pas le nôtre, puisque nous pouvons faire un discours nombreux sans le perpétuel emploi du nombre, auquel nous pouvons suppléer quelquefois par la symétrie des mots ou par leur arrangement. Je me résume. Quel est le nombre qui convient à la prose? tous les nombres ; mais chacun d'eux prédomine suivant les circonstances. Où est la place du nombre? partout. D'où est-il né? du plaisir de l'oreille. Son emploi exige-t-il des combinaisons? c'est ce que nous allons dire en traitant de l'usage des nombres, quatrième et dernière partie de notre division. Dans quel but se sert-on du nombre? pour plaire. Quand? toujours. Dans quelle partie de la phrase? d'un bout à l'autre. Quelle est la cause du plaisir qu'il procure? la cause inconnue qui fait le charme des vers; cause dont l'art analyse les effets, mais que l'oreille, sans le secours de l'art, semble deviner par un secret instinct. LXI. Nous en avons assez dit sur la nature des nombres. Arrivons à leur usage, qui demande un examen plus sérieux. Ici revient la question. Faut-il du nombre dans tout cet ensemble que les gens ont nommé période, et les latins, contour, circuit, compréhension, continuité ou circonscription? La place du nombre est-elle marquée, soit au commencement, soit à la fin de la phrase, ou, à la fois, aux deux bouts de la phrase? Ensuite, puisqu'on distingue ce qui est nombre de ce qui est nombreux, en quoi consiste la différence? On demande encore si tous les nombres de la période doivent être de même longueur ou de longueur inégale; quand, pourquoi, où cette uniformité ou disparité de dimension? quand faut-il une période entière? quand ne faut-il qu'un membre ou une incise? quels sont les membres, quelles sont les incises qui ont ensemble le plus d'affinité? ou toutes ces distinctions sont-elles inutiles ? par quels moyens, et c'est là notre objet principal, rendra-t-on le discours nombreux? il faut en outre examiner ce qui détermine la forme de la période, et par quel circuit elle parvient à son terme. Il faut parler de sa coupe, c'est-à-dire, de ses membres. Voir s'il y en a de plusieurs espèces et de diverses longueurs, et, s'il y en a plusieurs en effet, dire comment, où et quand il convient de s'en servir. Enfin il faut approfondir la question de l'utilité des nombres, utilité qui n'est pas bien appréciée; car ou la borne à un seul objet, tandis qu'elle en embrasse plusieurs. Sans répondre en détail à tant de questions particulières, faisons ici une réponse générale. J'écarte toute autre forme d'éloquence, pour ne considérer que le genre judiciaire. Avant d'en parler, je dois avertir que l'histoire et le genre démonstratif s'accommodent parfaitement de périodes semblables à celles d'Isocrate et de Théopompe. La pensée s'y trouve en effet renfermée comme dans un cercle assez étendu pour lui permettre de se développer avec toutes ses modifications, et d'arriver complète au point où doit s'arrêter son mouvement. Depuis l'invention de la période, tous les auteurs un peu en réputation qui se sont exercés loin de la lice du barreau, dans des compositions de pur agrément, ont jeté presque toutes leurs phrases dans cet heureux moule, d'où elles sortent riches de nombre et d'harmonie. L'auditeur, délivré, par la nature du sujet, de cette inquiétude ombrageuse qui voit un piège dans un discours étudié, savoure le plaisir qui charme son oreille, et sait gré à l'orateur de la peine qu'il prend pour le faire naître. LXII. Au barreau, la période ne doit être, ni toujours admise, ni constamment rejetée. Cet artifice de la phrase, s'il était continu, amènerait bientôt la lassitude, et ne manquerait pas d'être reconnu pour ce qu'il est, même par les moins habiles. Que deviendrait l'art oratoire, avec un débit si composé? Le pathétique y perdrait son accent, le lamage des passions humaines serait entièrement dénaturé, toute ombre de vraisemblance disparaîtrait; et, sans vraisemblance, plus de persuasion. Cependant, comme l'emploi du nombre est quelquefois utile, voyons en quelle occasion, pour combien de temps, et sous combien de formes il convient de l'admettre. Le nombre est à sa place dans l'éloge pompeux. Aussi l'ai-je introduit, et dans ma seconde Verrine, pour louer la Sicile, et dans le discours où le sénat m'entendit faire l'apologie de mon consulat. Le nombre va bien aussi à la narration, qui demande en général plus de dignité que de pathétique : aussi relève-t-il, dans la quatrième Verrine, les descriptions de la Cérès d'Enna, de la Diane de Sagesse, et du site heureux de Syracuse. Quant à l'amplification un accord unanime l'autorise à se déployer librement dans la rondeur des périodes. Je m'y suis bien souvent donné carrière. Mais ai-je atteint la perfection que poursuivait mon infatigable ardeur? Mes péroraisons trahissent partout les efforts obstinés de mon ambition. La période est un corps de réserve qui ne doit donner qu'au moment où les auditeurs, déjà enveloppés par les attaques de l'éloquence, ne peuvent plus lui échapper. Serrés de trop près pour trouver le loisir d'épier quelques fautes dans les manoeuvres de l'orateur, ils reconnaissent leur défaite, et vont jusqu'à désirer qu'elle s'achève; tant ils trouvent de charme dans l'admiration que leur inspire l'irrésistible pouvoir qui les a subjugués. Mais un tel effet ne peut se prolonger que dans la péroraison, parce que c'est le morceau final. Il faut être plus sobre de périodes dans les autres divisions du discours. Quand on les a employées dans les passages où elles peuvent être; admises, il faut recourir aux nombres et aux incises. Car pourquoi ne risquerais-je pas ces termes que l'usage n'a point encore introduits dans notre langue, mais qui sont la traduction littérale des κῶσα et des κόμματα des grecs? Notre vocabulaire ne pouvait pas posséder ces mots, signes d'idées inconnues chez nous. Mais comme ils sont métaphoriques, et que l'usage consacre journellement des métaphores hasardées pour le besoin et pour l'agrément, dans les arts, où la langue n'a pas de mots pour des objets jusqu'alors ignorés, j'ai dû céder à la nécessité de créer de nouveaux termes, ou de donner, par métaphore, à des noms existants, une nouvelle acception. LXIII. Nous dirons bientôt comment l'on procède par nombre et par incises. Commençons par énumérer les moyens de varier les périodes et leurs chutes. Tantôt, dès le début de la phrase, les brèves se multiplient pour donner des ailes au nombre; tantôt, des pieds plus chargés de longues lui donnent une marche solennelle. La vivacité des débats veut un rythme accéléré. La netteté des expositions exige un mouvement plus calme. Quant à la chute des périodes, elle est loin d'être uniforme. Les Asiatiques affectionnent le dichorée, ou double chorée. Leurs quatre dernières syllabes offrent donc deux fois de suite une longue suivie d'une brève. J'entre dans ce détail parce qu'un même pied ne porte pas le même nom chez tous les auteurs, dont les uns nomment chorée ce qui est le trochée des autres. Le dichorée n'est pas en lui-même une finale vicieuse; ce qui est vicieux, surtout en fait de nombre oratoire, c'est l'uniformité. Le dichorée forme une chute harmonieuse et brillante. C'est pour cela qu'il ne faut pas le reproduire jusqu'à la satiété. J'étais présent au forum, lorsque C. Carbon, fils de Caïus et tribun du peuple, prononça ces paroles : O Marce Druse, patrem appello. Voilà deux incises, chacune de deux pieds. Viennent ensuite deux membres de trois pieds chacun : Tu dicere solebas, sacram esse rempublicam; puis ce fragment de période: Quicumque eam uiolauissent, ab omnibus esse ei pœnas persolutas. Ce dernier mot est un dichorée : car toute dernière syllabe est indifféremment longue ou brève. Voici la chute: Patris dictum sapiens, temeritas filii comprobauit. Ce fut merveille d'entendre quelles acclamations excita ce dernier dichorée. Eh bien! Cet effet ne tient-il pas au prestige du nombre? Changez l'ordre des mots, et dites, par exemple : Comprobauit filii temeritas. L'effet a disparu. Et pourtant, dans temeritas, les trois brèves suivies d'une longue constituent le pied, auquel Aristote, par un goût que je ne partage pas, donne la préférence. Que voyons-nous ici'? la même pensée, les mêmes mots. C'est assez pour l'esprit, ce n'est pas assez pour l'oreille. Il ne faut pas user trop souvent de cet artifice; il est trop remarquable pour ne pas être immédiatement reconnu. La satiété viendrait bien vite, et l'auditeur, en garde contre un moyen si facile, ne l'accueillerait qu'avec dédain. LXIV. D'autres pieds forment encore une chute nombreuse et agréable: le crétique avec sa brève entre deux longues, et le péon, qui a la même mesure, malgré une syllabe de plus, passent pour s'adapter admirablement aux habitudes de la prose. Le péon qui résulte d'une longue suivie de trois brèves, donne de l'énergie au commencement de la phrase; mais il en rendrait la fin languissante. Le péon, renversé, qui, après ses trois brèves, présente la longue, termine parfaitement la période, au dire des anciens rhéteurs. Quant à moi, sans répugner à cette finale, j'en préfère quelques autres. Le spondée lui-même, tout alourdi, tout embarrassé qu'il paraît de ses deux longues, a quelque chose de grave, et même de noble dans son allure. Sa place est surtout dans les incises et dans les membres, où il compense le petit nombre des pieds par la lenteur de la mesure. Quand je parle des pieds qui terminent la période, je ne désigne pas le dernier pied exclusivement; j'y joins au moins l'avant-dernier, et quelquefois l'antépénultième. Pour l'avant-dernier pied, on peut choisir, ou l'iambe, composé d'une longue et d'une brève; ou le tribraque, dont les trois brèves offrent la même mesure que l'iambe, quoique avec une syllabe de plus; ou enfin le dactyle, qui est d'une longue et de deux brèves. Mais il faut alors que le dernier pied soit un spondée ou un trochée : car l'un ferme la marche aussi bien que l'autre; mais elle serait mal fermée par l'iambe, ou par le tribraque, ou par le dactyle, à moins que le dactyle ne fût employé comme crétique. Car, puisque en prose et même en vers, on est maître de faire brève ou longue la dernière syllabe, crétique ou dactyle à cette place, c'est tout un. Cette valeur arbitraire de la dernière syllabe ne s'est probablement pas présentée à l'esprit du premier qui a prétendu que le péon renversé était, à cause de la longue qui le termine, le meilleur pied final pour une période. Il y a d'ailleurs des critiques aux yeux de qui le péon est un nombre, et non pas un pied, parce qu'il a plus de trois syllabes. Quoi qu'il en soit, tous les anciens rhéteurs, Aristote, Théophraste, Théodecte, Éphore, s'accordent à regarder le péon comme éminemment convenable à la prose, soit au commencement, soit au milieu d'une phrase, soit même à la fin. Je pense, moi, que pour dernier pied de la période, le crétique est préférable. Toutes les places conviennent au dochmius, qui se forme de cinq syllabes, une brève, deux longues, puis une brève et une longue, comme amicos tenes; mais ce nombre ne doit pas se répéter. Employé deux, ou plusieurs fois de suite, il attire trop vite l'attention, et trahirait le secret de l'orateur. Changeons, varions sans cesse. Il n'est pas d'autre moyen de masquer l'artifice, et de prévenir la satiété. LXV. Nous l'avons déjà dit; ce n'est pas seulement la présence d'un nombre qui rend la prose nombreuse; cet effet résulte également de la disposition d'ensemble, ou de certain rapport de symétrie entre tels ou tels mots. Il est, par exemple, des constructions si heureuses, qu'il semble qu'on n'y ait pas cherché le nombre, mais qu'il soit venu de lui-même; tel est ce passage de Crassus : Nam ubi lubido dominatur, innocentiae leue praesidium est. Ici l'ordonnance a tout fait pour le nombre, sans que l'orateur semble y avoir songé. Même remarque chez les anciens. S'il se rencontre du nombre dans Hérodote, dans Thucydide, et dans leurs contemporains, ce n'est pas qu'ils l'aient cherché; il n'est que la conséquence fortuite de l'ordre où les mots sont venus se placer. La symétrie des tours est aussi une cause nécessaire du nombre. Ainsi, quand il y a, soit corrélation entre les membres de la phrase, soit opposition de contraires, soit retour de la même consonance ou de la même chute, la période se termine presque toujours par une cadence harmonieuse. J'ai déjà parlé de ces effets; j'en ai même cité des exemples. Mais on ne saurait trop multiplier ses ressources pour varier les finales. Au reste, les règles que j'ai posées ne sont pas tellement étroites, tellement obligatoires, qu'on ne puisse se donner, si l'on veut, un peu de latitude. Une prose nombreuse, je veux dire bornée à une imitation libre et non continue des nombres, est bien loin d'une prose qui y serait strictement asservie. Adoptez cette dernière, on n'y verra qu'une affectation intolérable. Renoncez à l'autre, votre style va courir au hasard, sans ordre, sans mesure et sans lien. LXVI. Les formes périodiques, loin d'être habituelles, au barreau et dans les causes sérieuses, n'ont même que rarement l'occasion de s'y montrer. Il devient essentiel d'y suppléer par les membres et les incises dont j'ai déjà dit un mot. Voyons en quoi consistent ces nouveaux moyens de soutenir l'élocution dans les débats où des intérêts sérieux se trouvent en jeu. Une période, pour être pleine et parfaite, doit se composer de quatre parties distinctes, qu'on appelle membres. C'est cette période carrée qui remplit le mieux l'oreille. Autrement la phrase parait trop courte ou trop longue. Cependant il faut quelquefois, ou franchir ces limites, ou rester en deçà, suivant les besoins de l'oreille, que trop de brièveté laisserait à jeun, ou que trop de longueur rassasierait jusqu'à la fatigue. Prenons pour terme moyen un à peu près, puisqu'il ne s'agit pas de vers, et que la prose n'exige pas de mesure précise. Assignons en général à la période une étendue qui représente la valeur de quatre vers hexamètres. Les quatre membres, dont chacun se rapprochera ainsi de la longueur d'un vers, seront liés l'un à l'autre par des articulations sensibles (conjonctions). Cependant, comme le retour fréquent de ces joints inspirerait bientôt de la défiance, on aime souvent mieux, pour marquer la période, en détacher les membres, et les produire séparément. Le nombre se cache ainsi; mais il n'en doit être que plus harmonieux, et l'effet en devient plus puissant. C'est ainsi que Crassus a dit : Missos faciant patronos; ipsi prodeant. S'il ne se fût arrêté avant ipsi prodeant, il se serait aperçu qu'il faisait un vers ïambique : et peut-être prodeant ipsi aurait-il mieux valu. Mais passons, car nous ne nous occupons ici que de la structure de la phrase. Cur clandestinis consiliis nos oppugnant? cur de perfugis nostris copias comparant contra nos? Ici les deux premières parties sont des incises; la troisième est un membre, la quatrième est une courte période composée de deux membres, et qui se termine par des spondées. Cette ordonnance était commune chez Crassus, et je l'approuve hautement. LXVII. Quand on procède par membres et par incises, il faut donner un soin particulier à l'harmonie des chutes, comme j'ai tâché de le faire dans ces quatre incises : Domus tibi deerat? at habebas. Pecunia superabat? at egebas, ainsi que dans ces deux membres qui viennent immédiatement après: Incurristi amens in columnas; in alienos insanus insanisti. Ces courtes incises, ces petits membres sans liaison, avaient besoin d'être soutenus par une sorte de digue; aussi ai-je terminé par une période plus étendue. Depressam, caecam, iacentem domum pluris, quam te, et quam fortunas tuas aestimasti. Ce dernier mot est un dichorée. C'est un double spondée qui avait marqué la chute du membre précédent, car dans ces phrases qu'on lance rapidement comme autant de coups d'aiguillon, la brièveté même laisse plus de liberté dans le choix de la mesure. L'incise est souvent d'un pied, plus souvent de deux. Elle peut être d'un et demi, ou de deux et demi. Il est bien rare qu'elle excède trois pieds. Les incises et les membres ont beaucoup de force au barreau, surtout quand on presse, ou qu'on réfute un adversaire. Ainsi, dans mon plaidoyer pour Cornélius : O callidos homines! o rem excogitatam! o ingenia metuenda! Voilà trois membres. Diximus, voilà une incise. Testes dare uoluimus, voilà encore un membre. Enfin une période à deux membres seulement, c'est le moins qu'elle comporte. Quem, quaeso, nostrum fefellit, ita uos esse facturos? Rien ne porte coup avec plus de force et plus de sûreté, que ces incises de deux ou trois mots ; quelquefois d'un seul, flanquées de loin en loin par des périodes nombreuses, dont on a varié les chutes. C'est ce que ne veut pas admettre le mauvais goût d'Hégésias, dans les malheureux efforts qu'il fait pour attraper la manière de Lysias, qui est presque un autre Démosthène. Il va sautillant d'incise en incise, aussi pauvre de pensée que de style. Qui le connaît, n'a plus à chercher le type du mauvais écrivain. Les exemples que j'ai empruntés à Crassus, ou tirés de mes ouvrages, suffiront pour permettre à l'oreille de juger que les moindres fragments du discours ont leur harmonie. Mais en voilà plus qu'on n'en avait encore dit sur l'emploi du nombre oratoire. Essayons maintenant d'en faire connaître l'utilité. LXVIII. Bien parler, parler en orateur, vous le savez mieux que personne, Brutus, c'est rendre les plus belles pensées dans les termes les mieux choisis. Mais les belles pensées seront stériles pour la gloire de celui qui ne les aura pas exprimées avec une justesse parfaite; et les termes les plus brillants perdront leur éclat, s'ils ne sont pas bien placés. Enfin les pensées et les paroles sans le nombre n'auront pas le vernis qui leur donne tant de lustre. Ne nous lassons pas de répéter qu'il ne s'agit pas ici de la mesure poétique; elle est incompatible avec la prose, qui en repousse jusqu'à l'apparence. Ce n'est pas que les nombres ne soient les mêmes pour les orateurs et pour les poètes, et pour tous ceux qui parlent, et même pour tous les sons que l'oreille peut mesurer. Mais si les pieds sont identiques, la manière de les combiner pour la poésie ne ressemble en rien à la disposition qui leur est assignée pour la prose. Et il n'y a pas à s'y méprendre. Donnez à cette ordonnance le nom de nombre, d'arrangement, de fini, ou tel autre nom qu'il vous plaira, il n'y aura pas sans son entremise d'élocution brillante. Aristote et Théophraste ont eu raison de dire qu'un discours privé de nombre roulerait indéfiniment comme un fleuve, et n'aurait pour le repos que des règles arbitraires, telles que la durée de la respiration ou les marques faites par un copiste. Mais le nombre a un autre genre d'utilité d'une haute importance, puisque les pensées, enchaînées avec art dans les liens de la période, y acquièrent une force qui se serait dissipée dans le vague d'un style décousu. Voyez l'athlète ou même le gladiateur, jusque dans l'impétuosité de l'attaque ou les précautions de la défensive, dessiner tous ses mouvements suivant certaines règles de gymnastique. Toutes ses poses, si admirablement calculées pour les chances du combat, ne coûtent pourtant rien à la grâce. Que l'orateur porte aussi ses coups avec art, s'il veut faire une blessure profonde. Vivement pressé par son adversaire, qu'il pare avec adresse, et garde, même en reculant, de la dignité dans son attitude. Je compare les orateurs qui négligent les nombres à ces athlètes que les Grecs appelaient ἀπαλαίστρους (étrangers à l'art de la palestre); et loin de convenir que le rythme énerve le discours, comme le prétendent des hommes qui, faute de maître, de talent, ou de travail, n'en ont jamais connu les secrets, je soutiens, au contraire, que, sans le nombre, l'éloquence, au lieu de dominer, verrait son pouvoir s'évanouir. LXIX. Mais rien ne demande plus d'habitude. Craignons les efforts maladroits. N'imitons point, par exemple, tel qui, sans plus de mystère, risque des inversions forcées, pour rendre la phrase plus coulante ou plus nombreuse. L. Célius Antipater dit, dans la préface de sa guerre Punique, que s'il a jamais recours au nombre, ce ne sera que par nécessité. Nous mettre ainsi dans sa confidence, - que de candeur! obéir à la nécessité, que de philosophie! - mais c'est être par trop simple. Quand on écrit, ou quand on parle, on ne saurait alléguer pour excuse une nécessité qui n'existe pas. Et, fallût-il l'admettre, on n'est pas, du moins, obligé de la proclamer. Mais que fait Antipater, après cette belle apologie, qu'il adresse à Lélius, en lui dédiant son livre? Il court après le nombre, à force d'inversions pénibles, qui ne rendent ses phrases, ni moins maigres, ni mieux terminées. D'autres orateurs, et notamment les asiatiques, véritables esclaves du rythme, vont jusqu'à intercaler des mots vides de sens, qui ne servent qu'à compléter le nombre. D'autres, au contraire, donnent dans le défaut dont la contagion remonte à Hégésias; et, à force de briser, de mutiler le nombre, ils appauvrissent le style jusqu'à l'indigence des orateurs siciliens. Deux frères, chefs de l'école asiatique, Hiéroclès et Ménéclès, orateurs que je suis loin de mépriser, ont levé un troisième étendard. On ne trouve, il est vrai, chez eux, ni la vérité sévère, ni le mouvement régulier de l'éloquence; mais ils offrent, en compensation, une verve brillante et uνe heureuse fécondité. Ce qui leur manque, surtout, c'est l'art de varier leurs finales, qui sont toutes taillées sur le même modèle. En récapitulant les défauts que nous venons de relever, nous verrons qu'il ne faut ni hasarder ces inversions inusitées qui trahissent un calcul, ni intercaler des mots inutiles qui accusent des vides mal remplis, ni affecter des nombres trop courts qui mutilent et disloquent la pensée, ni ramener sans cesse les mêmes cadences qui fatiguent comme un tintement. Fuyez ces quatre écueils, et vous aurez évité presque tous les abus du rythme oratoire. Nous nous sommes assez étendu plus haut sur les perfections du nombre, pour qu'il devienne inutile de signaler ici les défauts qui leur servent de contrastes. LXX Deux épreuves bien faciles vont nous mettre à même d'apprécier sans hésitation toute l'utilité de l'harmonie. La première consiste à changer l'ordre des mots dans une phrase bien construite. Je vais tirer quelques exemples de mon plaidoyer pour Cornelius. Neque me diuitiae mouent, quibus omnes Africanos et Laelios, multi uenalitii mercatores que superarunt. Faites un léger changement, et dites : Superarunt mercatores uenalitiique, tout est détruit. Et, plus bas : Neque uestis, aut caelatum aurum et argentum, quo nostros ueteres Marcellos Maximosque multi eunuchi e Syria Aegyptoque uieerunt. Changez ainsi l'ordre des mots : Vicerunt eunuchi e Syria Aegyptoque. Troisième exemple : Neque ornamenta ista uillarum, quibus L. Paullum et L. Mummium, qui rebus his urbem Italiamque omnem referserunt, ab aliquo uides perfacile Deliaco aut Syro potuisse superari. Mettez à la place: Potuisse superari ab aliquo Syro aut Deliaco. On voit que, sans altérer en rien ni les mots ni les pensées, on porte un coup mortel à la phrase la plus expressive, par le simple déplacement de quelques termes. C'est qu'on a remplacé l'harmonie par la confusion. Passons à la seconde épreuve, qui présentera l'inverse de la première. Choisissons, dans un auteur peu soigneux du nombre, une phrase sans harmonie. Puis, à l'aide d'un simple déplacement, donnons-lui le rythme et la liaison dont elle est dépourvue, et voyons ce qu'elle aura gagné à cette métamorphose. Je tire mon exemple de l'allocution de Gracchus aux censeurs: Abesse non potest, quin eiusdem hominis sit, probos improbare, qui improbos probet. Quelle différente pour l'harmonie, s'il eût dit: Quin eiusdem hominis sit, qui improbos probet, probos improbare! Il n'est personne qui voulût désavouer la phrase ainsi rectifiée, et qui se sentant capable de la faire, aimât mieux la jeter dans l'autre moule. Quand on parle sans harmonie, c'est par impuissance; et c'est alors qu'on se donne pour attique. Ces attiques improvisés prennent-ils donc Démosthène pour un Trallius, lui dont les foudres accélérées par l'impulsion du nombre manifestent la puissance de l'harmonie par leurs terribles effets? LXXI. Est-ce par goût que vous préférez un style dont aucun nombre ne gêne la liberté? Contentez-vous. Mais, à défaut de liaison et d'ensemble, offrez-nous des beautés de détail. Si l'on s'avisait de découper par fragments la grande composition du bouclier de Phidias, l'effet général serait détruit; mais chaque fraction serait encore un chef-d'oeuvre. Thucydide n'a pas de nombre, mais il réunit toutes les autres beautés du style. Il n'en est pas ainsi de nos attiques. Dans leurs phrases déchiquetées, où la forme est aussi chétive que le fonds, ils semblent, non pas mettre en pièces le bouclier de Minerve, mais (si j'ose risquer une image dont la justesse excusera la trivialité) séparer les brins d'un balai. S'ils tiennent à me convaincre que c'est par dédain qu'ils rejettent le nombre dont je préconise l'utilité, qu'ils écrivent un morceau dans le goût d'Isocrate, ou à la manière d'Eschine et de Démosthène, et je me hâterai de proclamer qu'il y a chez eux esprit de système, et non pas impuissance. Pour contre-épreuve, je me charge de trouver quelqu'un qui acceptera le défi d'écrire ou de parler, soit en latin, soit en grec, dans le style qu'ils se sont faits. C'est qu'il y a beaucoup moins de difficulté à rompre la trame d'une période, qu'à former de lambeaux épars un tissu régulier. Voici, pour terminer, mon opinion réduite au plus bref énoncé. Parler en périodes nombreuses, mais sans idées, c'est un trait de folie. Avoir des idées, mais les exprimer sans ordre et sans harmonie, c'est se montrer étranger à l'art de la parole. Imperfection, qui, pourtant, ne fait pas descendre un homme au rang des sots; qui, même assez souvent, ne porte pas la moindre atteinte à sa réputation d'habileté. Borne, qui voudra, son ambition à ce rôle. Celle de mon orateur vise beaucoup plus haut. L'approbation ne le contente pas. Il lui faut conquérir une admiration qui éclate en applaudissements, en cris d'enthousiasme; et il rougirait, lui, qui doit exceller en tout, si ce public, idolâtre de quelque autre talent, pouvait rien voir et entendre avec de plus vifs transports. Voilà, Brutus, l'orateur tel que je le conçois. Si vos idées répondent aux miennes, adoptez le modèle que je viens de tracer; si nos opinions différent, persistez dans la vôtre. Je ne chercherai pas à la combattre. Je ne m'aviserai pas d'affirmer qu'après cette consciencieuse dissertation, je sois plus près que vous de la vérité. Je puis voir autrement que vous, voir même autrement aujourd'hui que je ne voyais dans un autre temps. Cette instabilité de jugement serait un léger mal, si elle se bornait au sujet qui nous occupe. Car comment asseoir sur une base invariable l'éloquence dont le but est de capter les suffrages capricieux de la multitude et de l'oreille? mais malheureusement, dans les matières même les plus importantes, la certitude m'a toujours échappé. Je suis donc réduit à chercher dans le vraisemblable ma règle de conduite et de goût, puisque le vrai ne sort jamais de sa mystérieuse obscurité. De votre côté, si mon travail ne vous satisfait pas, ne vous en prenez qu'à la disproportion de mes forces avec les difficultés de l'entreprise. Avant tout, j'ai voulu vous complaire; et si je me suis compromis par ma témérité, c'est pour n'avoir pas eu le courage du refus. 1. Brute, dubitavi. Quintilien blâmait cette chute de phrase. (IX, 4.) II. Ialysi, quem Rhodi vidimus. Prologène, célèbre peintre rhodien, travaillait à son fameux tableau du chasseur Ialysus, quand Démétrius, roi de Macédoine, assiégea Rhodes. Le roi ayant su que ce peintre continuait sen travail dans un faubourg déjà occupé, le lit venir, et lui demanda comment il osait se croire eu sûreté au milieu des ennemis. « C'est que je sais, répondit-il, que vous ne faites la guerre qu'aux Rhodiens, et non aux beaux-arts ; » réponse qui plut tellement à Démétrius, qu'il plaça une garde autour de son atelier, pour préserver l'artiste de toute atteinte et de toute distraction. - Ce tableau d'lalysus, transporté depuis à Rome dans le temple de la Paix, périt dans un incendie. Cooe Veneris pulchridudinem... Jouis Olympii, aut Doryphori statua. Les plus célèbres tableaux d'Apelle furent deux Vénus, la Vénus Anadyomène, et la Vénus de Cos. - La statue de Jupiter Olympien passait pour le chef-d'oeuvre de Phidias, le plus illustre statuaire de l'antiquité. Quintilien dit (XII, 10) que Phidias représentait mieux les dieux que les hommes, et que son Jupiter ajoutait quelque chose à la religion des peuples. - Le Doryphore, œuvre de Polyclète, était une petite statua qui représentait, comme l'indique son nom, un guerrier portant une lance. Les artistes l'appelaient la règle, ὁ κανών. Sic perfcetae eloquentiae speciem animo videmus. Cicéron traduit le mot grec ἰδέα tantôt par species, et tantôt par, forma. Ainsi, il dit dans ses Académiques (1, 8) : « Hanc illi ἰδέαν appellabant, jam a Platone ita nominatam; nos recte speciem possumus dicere; » mais, dans ses Topiques (c. 8), il rejette ce même mot species de la langue philosophique, par la raison qu'il n'oserait pas dire au pluriel, specierum, speciebus; et il préfère le mot forma, dont il se sert quelquefois dans l'Orateur, où il emploie aussi le mot species, comme dans le passage qui est le sujet de cette note. Au reste, on lit dans Festus : Speciem quam nos dicimus, εἶδος; Graeci dixerunt, Plato quidem ideam. » lII. Has rerum formas appellat ideas. Platon traite des idées dans le Parménide, dans le Timée, et dans le dixième livre de la République. Il y établit que la véritable science n'a point pour objet les choses singulières, visibles, changeantes et périssables, telles que sont une maison, un homme, un triangle, etc., mais l'original immatériel, immuable et éternel, sur lequel chaque chose n été créée; qu'ainsi, pour devenir habile en quelque science et en quelque art que ce soit, il ne faut pas s'arrêter à la connaissance des individus, mais qu'il faut considérer les genres et les espèces universelles. Pour connaître, par exemple, la nature et les propriétés des triangles, il ne faut pas examiner un tel triangle en particulier, mais on doit examiner le triangle en général. De même, pour connaître en quoi consiste la vertu, il ne faut pas considérer la vertu de Socrate, de Phocion, ou de quelque autre homme vertueux; mais on doit s'attacher à examiner l'essence de la vertu en elle-même. Cicéron suit exactement cette méthode dans son Traité. Quoiqu'il rende justice an mérite et à l'éloquence de Démosthène, d'Eschine, de Crassus, d'Antoine, et des autres orateurs tant grecs que romains, il ne s'attache à aucun d'eux pour établir sou système; il le fonde entièrement sur l'idée de la parfaite éloquence. Or, comme tout le fond de sou livre est appuyé sur la doctrine des idées platoniques, il ne sera pas hors de propos d'en donner ici une explication plus détaillée. !Vous nous servirons pour cela de deux ou trois passages de saint Augustin, où l'on trouvera cette doctrine bien exposée. « Ideas Plato primus appellasse perhibetur.... Sunt ideae principales formae quaedam, vel rationes rerum stabiles atque immutabiles, quae ipsae formatae non sunt, ac per hoc aeternae, ac semper eodem modo sese habentes, quae in divina intelligentia continentur. Et quum ipsae nec oriantur, nec intereant, secundum eas tamen formari dicitur omne, quod oriri et interire potest. Quod si reste dici vel credi non potest, Deum irrationabiliter omnia condidisse, restat, ut omnia ratione sint condita, nec eadem ratione homo, qua equus. Hoc enim absurdum existimare. Singula igitur propriis sunt creata rationibus. Hias autem rationes ubi arbitrandum est esse, nisi in mente creatoris? » (D. Augustin., Liber octog. trium quaest., Q.46.) « Insinuavit nobis, animam humanam et mentem rationalem non vegetari, non beatificari, non illuminari, nisi ab ipsa substantia Dei. (Id., Tract. 23, in Joann.) Dans le livre de Magistro, chap. II, il dit : « De univernis, quae intelligimus, non loquentem, qui personat foris, sed intus ipsi menti praesidentem consulimus veritatem... Ille autem, qui consulitur, docet, qui in interiore homme habitare dictus est Christus, id est immutabilis Dei virtus, atque sempiterna sapientia. » Il résulte de ces passages : 1° que les idées sont éternelles et immuables; 2° qu'elles sont les archétypes et les modèles de chaque chose; 3° qu'elles sont dans l'entendement divin; 4° que Dieu a créé toutes choses sur ces modèles ; 5° que les idées sont bien différentes des perceptions que nous en avons, puisqu'elles ne se peuvent trouver qu'en Dieu qui en est la source, qui éclaire tous les esprits, et qui en est la souveraine et immuable vérité; 6° que toutes nos idées particulières ne sont que des perceptions et des participations causées par l'action des idées divines sur notre entendement. En effet, comme mon oeil n'est point la lumière qui me rend visibles les objets dont je suis environné, et que je ne pourrais les voir s'ils n'étaient éclairés par les rayons du soleil matériel ; de même mon esprit n'est point la lumière de mon intelligence, il n'est que la faculté qui reçoit les rayons de cette lumière primitive et originale, de ce soleil divin qui habite en chacun de nous, et qui illumine tout homme venant en ce monde. (Joann., I, 9.) Cette lumière universelle se communique à tous les esprits avec mesure, à proportion de leurs besoins, et selon le degré de leur attention. On ne peut pas dire que je me donne à moi-même mes idées, on que je les reçoive des autres, puisque ma raison, de même que celle des autres hommes, est changeante, incertaine, sujette à l'erreur, et que les idées sont certaines, éternelles et immuables. Les hommes peuvent parler pour m'instruire; mais je ne dois acquiescer à leurs instructions qu'autant que je trouve leurs discours conformes à ce que me dit le maître intérieur : c'est lui qui me redresse, quand je m'égare, et qui me rappelle à lavé cité, lorsque les autres m'en éloignent. Il est comme une règle infaillible, qui redresse les lignes tortues, et qui confirme la justesse de celles qui sont droites. Je n'ai donc qu'à rentrer au dedans de moi-même; j'y trouverai un maître qui m'enseignera les vérités dont j'ai besoin, et qui me fera connaître si ce que les autres me proposent extérieurement, est vrai ou faux, juste ou injuste. Cette raison, supérieure à la mienne, et supérieure à toutes les autres raisons bornées et imparfaites, se communique en tout temps, en tout lieu, à tous les esprits qui la consultent avec attention et avec docilité. Elle assujettit tous les hommes, de quelque pays qu'ils soient, et quelque éducation qu'ils aient reçue, à penser et à parler de même sur un certain nombre de vérités. Quelque éloignés qu'ils soient les uns des autres, le sont tous unis par des notions communes et par des règles sûres, qu'on nomme les premiers principes. D'un bout de l'univers à l'autre, tous sont d'accord sur les vérités des nombres, sur les vérités de la géométrie, et sur les règles immuables de la morale. Le père Malebranche s'est servi des principes de saint Augustin, pour établir son sentiment sur les idées. On peut voir sur cela sa Recherche de la vérité, ses Réponses à M. Arnauld, et ses Entretiens sur la métaphysique et sur la religion. Mais le père Malebranche ne s'en tient pas là; il prétend encore que nous voyons les corps en Dieu. C'est une question dans laquelle je n'entrerai point; elle est étrangère à notre sujet. (Note empruntée à M. V. Leclerc.) III. Non ex rhetorum, officinis sed ex Academiae spatiis. C'est donc, selon Cicéron, de la philosophie platonique qu'on doit tirer ce fonds de connaissances, si nécessaire à l'orateur; c'est d'elle qu'on apprend à bien penser et à bien parler, comme dit Horace :
Scribendi recte
sapere est et principlum et fons. Ce passage de Cicéron a été cité par Quintilien (III, 2) et par Tacite. (Dial. de orat., c. 32.) IV. Anaxagorae physici. Anaxagore de Clazomènes, le premier philosophe qui ait enseigné à Athènes, était si estimé pour l'élévation et la sublimité de sa doctrine, qu'on le nomme l'Esprit, Νοῦς. II eut parmi ses disciples Socrate, Euripide et Périclès. (Quintil., XII, 2.) Cujus ex epistolis intetligi licet. Nous n'avons plus ces lettres de Démosthène; elles sont toutes perdues, à l'exception de six. V. M. Antonius. Voyez sur l'orateur Antoine, Brutus, chap. 36 et suiv. VI. Tria sunt omnino genera dicendi. Cicéron donne ici une idée générale des trois styles, du sublime, du simple, et du tempéré, ou plutôt des trois caractères de perfection qu'il exige de son orateur. Il est important de remarquer exactement les propriétés et les convenances qu'Il attribue ici à chaque genre d'éloquence, pour se mettre en état de mieux juger de l'application ample et détaillée qu'il en fera dans la suite, depuis le chapitre 23 jusqu'au chapitre 29. VII. In illo sermone nostro, qui est expositus in Bruto. Cicéron renvoie ici au chap. 9 du Brutus, où l'on peut voir comment il parle de Démosthène. Dici se desiderant atticos. Voyez ce que Cicéron dit du faux atticisme, Brutus, chap. 82 et suiv. Il parle encore de ces prétendus attiques au chapitre premier de la seconde Tusculane. Ne Athenas quidem ipsas magis credo fuisse atticas. Cicéron, en proposant Démosthène pour un modèle d'atticisme, et en déclarant qu'Athènes même n'était pas plus que lui dans le goût attique, nous fait entendre qu'aucune des perfections de l'atticisme ne lui manquait; qu'il savait employer, selon les occasions, tantôt l'air naturel et délicat du style simple, tantôt la douceur et les ornements du tempéré, tantôt la grandeur et la majesté du sublime. VIII. Semper oratorum eloquentiae moderatrix fuit auditorum prudentia. On voit que ceci n'est pas un précepte, mais un fait. Cicéron ne dit pas expressément que les orateurs doivent se régler sur le goût de ceux qui les écoutent : il dit seulement qu'ils s'y règlent toujours dans la vue de plaire, et que ce mauvais usage a produit, ces discours fastidieux et emphatiques qui étaient du goût des peuples de l'Asie. Il est vrai que l'orateur doit étudier les moeurs, les inclinations et les dispositions des auditeur% pour en profiter; mais il est faux qu'il doive toujours se conformer à leur goût; il tant même s'en éloigner, quand ll est dépravé et corrompu. Que prétend donc ici l'auteur? Il l veut que l'on se règle sur le goût des Athéniens, goût sûr et exquis, et que Démosthène, qui est celui de tous les orateurs qui ale mieux réussi dans l'éloquence, soit regardé comme le plus parfait modèle en ce genre. VIII Caria, et Phrygia et Mysia, quod minime potitae minimeque elegantes sunt... eorum vicini... Rhodii nunquam probaverunt. Les Cariens, les Phrygiens, les Mysiens, habitaient cette région de l'Asie Mineure qu'on appelle aujourd'hui la Natolie. « Les Grecs de Carie, de Mysie, et de Phrygie sont grossiers encore, et ne semblent connaître d'autre mérite que le luxe des satrapes auxquels ils sont asservis; leurs orateurs déclament avec des intonations forcées, des harangues surchargées d'une abondance fastidieuse. » (Voyage d'Anacharsis, chap. 58.) Rhodes n'est éloignée des rivages de la Carie que d'environ dix lieues communes. In illa pro Ctesiphontc oratione. - Cicéron avait traduit en latin la harangue de Démosthène pour Ctésiphon, avec celle qu'Eschine, son rival, avait faite contre lui. Mais il ne nous reste de ce travail que l'avant-propos que Cicéron avait mis en tête des deux plaidoyers. Facile est enim verbum aliquod ardens... notare, idque restinctis jam animorum incendiis irridere. Eschine, pour tourner en ridicule les expressions de Démosthène, les tirait hors de leur place, et les lisait languissamment, dénuées du feu avec lequel l'orateur les avait prononcées. IX. Ad Atticorum igitur aures teretes et religiosas qui se accommodant, ii sunt existimandi attice dicere. Quintilien (XII, 10) a fort bien éclairci cette matière ; mais sa dissertation étant trop étendue pour trouver place ici en entier, en voici l'abrégé. Il y a une grande différence, selon lui, entre le style attique et le style asiatique. Le premier est serré, sain et pur: le second, au contraire, est diffus, enflé, et souvent vide de choses. L'un n'a rien de superflu; l'autre ne garde ni bornes ni mesure. De ces deux genres de style est né le rhodien, style qui participe des deux autres; car il n'est ni aussi serré que l'attique, ni aussi diffus que l'asiatique; en sorte qu'il semble tenir quelque chose du génie de son auteur. En effet, Eschine, qui avait choisi Rhodes pour le lieu de son exil, y porta le goût et les sciences d'Athènes, y établit une école d'éloquence, et y forma des disciples ; mais comme les plantes dégénèrent en changeant de climat et de terroir, de même le goût attique perdit beaucoup de sa première pureté parmi les Rhodiens, après la mort d'Eschine. On ne peut douter que le genre attique, ce genre si pur, si naturel, si éloigné de toute affectation, ne soit le plus parfait. Les auteurs qui ont écrit dans ce style ont quelque chose de commun entre eux; savoir, un jugement excellent et un goût sûr : mais ils diffèrent par le caractère d'esprit. C'est pourquoi je pense, dit Quintilien, que ceux-là se trompent, qui n'admettent le goût attique que dans les orateurs qui ont un style simple, clair, expressif, et qui contents, pour ainsi dire, d'une certaine frugalité d'éloquence, s'interdisent les grands mouvements. Que veulent-ils, ajoute Quintilien, que nous prenions pour exemple? Lysias? Je le veux. En effet, c'est l'auteur favori des partisans du goût attique. Mais je leur demande si Isocrate n'a pas écrit daim ce style; ils diront peut-être que non. Cependant c'est de son école que sont sortis les plus grands orateurs d'Athènes. Hypéride n'est-il pas dans le goût attique? toutefois il a beaucoup plus donné à la don. celle et à l'agrément du style que Lysias. Que diront-ils d'Eschine? N'est-il pas plus étendu, plus hardi, plus élevé, que. tous ceux dont je viens de parler? Que diront-ils de Démosthène? N'a-t-il pas plus de force, plus de grandeur, plus d'impétuosité, plus d'harmonie que tous ces orateurs que l'un exalte si fort parmi les Romains, el dont tout le mérite ne consiste souvent que dans une timide et circonspecte délicatesse? Concluons donc qu'écrire et parler attiquement, c'est parler de la manière la plus parfaite; mais que chaque orateur attique est différent des autres par le caractère d'esprit. IX. Ab Aristophane poeta. Les deux vers d'Aristophane auxquels Cicéron fait allusion dans ce passage sont dans les Acharniens, vers 529. - Il avait d'abord écrit ab Eupoli poeta, trompé par des vers d'Eupolis sur Périclès, qu'il a rappelés lui-même dans le Brutus, c. 9; mais plus tard, dans une lettre à Atticus (XII, 6), il le pria de corriger cette erreur sur son exemplaire, en y substituant Aristophane à Eupolis. Aliqui se Thucydidios esse profitentur. Thucydide a toutes les qualités nécessaires pour bien écrire l'histoire; mais Cicéron ne trouve pas la lecture de son livre utile à l'orateur, parce que, dit-il, son style n'est ni assez harmonieux, ni assez lié, ni assez arrondi. Thucydides praefractior, nec satis, ut ita dicam, rotundus. (Orat., c. 13.) In Thucydidi orbem orationis desidero. (Ibid., c. 71.) Subtilem et elegantem tamen. Quintilien dit aussi (XII, 10) : « Lysiaca gracilitas. » Quum mutila quaedam et hi antia locuti sunt... germanos se putant esse Thucydidos. C'est ainsi comme nous l'apprend Quintilien (X, 7), que des imitateurs maladroits se croyaient des Cicérons, parce qu'ils finissaient leurs périodes par esse videatur. X. Una Gallia communi non ardet incendio. César, avant de passer en Afrique, pour combattre Caton, Scipion et le reste des légions qui s'y étalent retirées après la bataille de Pharsale, donna le gouvernement de la Gaule cisalpine à Brutus, qui administra cette province avec tant de modération et de sagesse, qu'elle ne se sentit point des désordres et des maux de la guerre civile. Catone absotuto. Après la mort de Caton, Cicéron composa son éloge, à la prière de Brutus. César, dont ce grand citoyen avait été l'ennemi le plus constant, répondit à cet éloge par une satire, intitulée Anti-Cato.- Remarquons que Cicéron, en disant qu'il n'eût point, sans les instances de Brutus, entrepris cet éloge dans un siècle ennemi de la vertu, tempora timens inimica virtuti, laisse échapper une plainte peu honorable pour le gouvernement de César, et parait vouloir chercher un abri contre la vengeance du dictateur derrière le nom de Brutus. Aussi Cécina, qui redoutait César, écrivait-il à Cicéron, peu après la publication de l'Orateur : Vous-même, vous augmentez nos alarmes, quand je vous vois dans votre Orateur, vous mettre à couvert sous le nom de Brutus, et chercher un complice qui vous fasse excuser. (Ad Fam. Epist. VI, 7. ) XII. Ut verba verbis quasi demensa et paria respondeant. Voici un exemple de cette figure, tirée de la harangue pour la loi Manilia, où Cicéron fait un éloge magnifique des vertus et des exploits de Pompée : « Ita tantum bellum, tam diuturnum, tam longe lategue dispersum, quo bello omnes gentes ac nationes premebantur, Cn. Pompeius extrema hieme apparavit, ineunte vere suscepit, media aetate confecit. (I, 12.) On voit dans cet arrangement un rapport de paroles qui se répondent mutuellement tes unes aux autres ; en sorte que les différents membres de la phrase présentent à peu près le même nombre de syllabes, et forment une espèce de concert mesuré qui flatte agréablement l'oreille. Ut pariter extrema terminentur, eumdemque referant in cadendo sonum. Cicéron réunit ici deux figures bien connues des rhéteurs, dont la première s'appelle en latin similiter desinens, et la seconde similiter cadens. Selon les lois de la première, les membres de la phrase doivent se terminer parles mêmes consonnances; comme Dux fuit tam egregius, ut ejus semper voluntatibus non modo cives assenserint, socii obtemperarlnt, hostes obedierint, sed etiam venti tempestatesque obsecundarint. (Pro leg. Manil., c. 16.) - Selon les règles de la seconde, on doit terminer les membres de la période par des cas semblables, comme, Est idem Verres, qui fuit semper; ut ad audendum projectus, sic ad audiendum paratus. (In Verrem, I, 1.) Cicéron n'a point négligé ces tours de phrase et ces délicatesses de langage dans ses discours; mais il ne s'y est point livré avec excès. XII. Isocrates ea studiose consectatum fatetur. Isocrate (Panathénaïque, c. 1 ) se reproche à lui-même le trop de soin qu'il mettait, dans sa jeunesse, νεώτερος μὲν ὤν, à rechercher les fleurs de la rhétorique : il se corrigea de cet excès à mesure qu'il avançait en âge. Voyez l'éloge que Cicéron fait de cet auteur, Brutus, c. 8. Herodotus Thucydidesque. Voyez dans Quintilien (X, 1) et dans Denys d'Halicarnasse (édit. de 1586, p. 69) un parallèle entre Hérodote et Thucydide, qui complète celui qu'en fait ici Cicéron. XIV. Quid dicat, et quo quidque loco, et quo modo. Cicéron indique ici le devoir de l'orateur. Quid dicat orator, ce qu'il doit dire ; l'invention lui en montre les moyens. Quo quidque loco, comment il doit arranger les différentes parties de son discours; la disposition en fixe les règles. Quo modo, de quelle manière il doit s'énoncer; ce qui renferme l'élocution et l'action. Aut sitne, aut quid sit, aut quale sit, quaeritur. Toutes les matières qui regardent les contestations son! comprises, selon Cicéron, dans ces trois articles : 1° si la chose est; 2°de quelle nature elle est; 3° quelle en est la qualité : c'est-à-dire, qu'il faut examiner, 1°si l'action dont il s'agit a été laite ou non; 2° si elle est bonne ou mauvaise; 3° si l'on a eu ou non le droit de la faire. Le premier état est l'état de conjecture; on ne peut découvrir la vérité que par les signes et les indices qui ont accompagné l'action. Le second est l'état de ta définition; on ne peut connaître si l'action est bonne ou mauvaise qu'en la définissant. Le troisième est l'état de ta qualité; il faut, pour décider si l'on a eu le droit de faire l'action ou non, recourir aux idées que nous avons du bien et du mal, du juste et de l'injuste. Haec igitur quæstio... appellatur thesis. Mais. Il y a deux sortes de questions : la première s'appelle thèse, ou proposition générale; la seconde se nomme hypothèse, ou pro position particulière. La première n'est déterminée par aucune circonstance de temps, de lieux, de personnes; la seconde est limitée par toutes ces circonstances. Cicéron veut que l'orateur s'éloigne, autant qu'il pourra, de la question particulière, et qu'il remonte à la question générale, et cela pour deux raisons : la première, parce qu'il est plus aisé de s'étendre sur le genre que sur l'espèce; la seconde, parce que ce qui a été une fois établi dans la thèse, demeure nécessairement prouvé pour l'hypothèse. Par exemple, s'il s'agit de taire voir combien Catilina était criminel d'avoir conjuré coutre sa patrie, il faut commencer par montrer quel est le crime des conjurations en général, et les maux qui s'ensuivent : alors tout ce qui aura été prouvé dans cette première partie, servira à faire connaître l'énormité du crime de Catilina. XV. Inculcabitque leviora. Voyez de Oratore (II, 77) et Biset. ad Herenn. (III, 10. ) XVI. Carneades noster. Carnéade était un ami de Cicéron et de Brutus, différent dru fameux Carnéade qui fonda la nouvelle Académie. XVII. Est enim actio quasi corporis quaedam eloquentia, quum constet e voce atque motu. Cicéron a dit encore dans son traité de Oratore (III, 56) : « Est ceint actio quasi sermo corporis. » La voix et le geste sont les deux parties qui composent l'action : l'une frappe l'oreille, et l'autre les yeux; deux sens, dit Quintilien (XI, 3), par lesquels nous faisons passer nos sentiments et nos passions dans l'âme des auditeurs. Quorum alter oculos, altera aures movet, per quos duos sensus omnis ad animum penetrat affectus. XVII. Nam et infantes.... Diserti est, dans cette phrase, opposé à infantes (in priv., fari, parler, qui ne savent pas parler); d'où il suit que le mot infantes a la signification de indiserti, infacundi. XVIII. Est in dicendo etiam quidam cantus obscurior. On peut avoir recours à cette espèce de prononciation, qui approche du chant, pour inspirer aux auditeurs des sentiments de compassion. Alors la voix, après s'être un peu soutenue, baisse insensiblement; et ces sortes de tons sourds et gémissants ont une certaine douceur, triste et touchante, capable d'attendrir les cœurs. « Ce sont, dit Quintilien (XI, 3), ces mêmes inflexions de voix que Démosthène et Eschine se reprochaient l'un à l'autre, et qu'il ne faut pas condamner pour cela; car, puisqu'ils se les reprochent, il est évident qu'ils en ont tous deux fait usage. » Cicéron ne blâme donc point ces imitations de modulations adoucies : il ne les blâme que lorsqu'elles sont trop marquées, et qu'elles approchent d'un cantique, comme était la prononciation des orateurs asiatiques dans leurs péroraisons. Ipsa natura... in omni verbo posuit acutam vocem... 1° Tous les mots reçoivent naturellement un accent aigu, parce qu'on ne peut en prononcer aucun sans y donner quelque sorte d'élévation. 2° Chaque mot ne reçoit qu'un aigu; autrement la prononciation, n'étant point variée, serait dénuée d'harmonie. 3° Comme l'oreille ne peut juger que des trois dernières syllabes, le lieu le plus éloigné pour l'accent doit être l'antépénultième. Status erectus et celsus; rarus incessus, nec ita longus... L'orateur doit avoir la tète droite, comme Cicéron le recommande; la tête trop élevée donne un air d'arrogance; si elle est baissée, ou négligemment penchée, c'est une marque de timidité ou d'insolence. - Cléon, général athénien, doué d'une éloquence véhémente et emportée, fut le premier, chez les Grecs, qui donna l'exemple d'aller et de venir dans la tribune en haranguant. A Rome, il y avait des orateurs qui couraient étourdiment tantôt d'un côté et tantôt de l'autre. (Brutus, c. 38.) Cicéron n'approuve point ces sortes de promenades, à moins qu'elles ne soient extrêmement rares et faites avec modération. Trunco magis toto se ipse moderans, et virili laterum flexione. Quintilien fait cette réflexion sur ce passage de l'Orateur (XI, 3) : Les flancs et les reins doivent s'accorder avec le geste. En effet, il y a un certain mouvement de tout le corps qui contribue beaucoup à l'action; de sorte qu'an jugement de Cicéron, ce mouvement y a plus de part que les mains mêmes. « Latera cum gestu consentiant : facit enim aliquid et totius corporis motus; adeo ut Cicero plus illo agi, quam manibus ipsis, putet. » Vultus vero, qui secundum omet plurimum potest. Le visage est ce qui domine le plus dans l'action. Il n'y s point, dit Quintilien (XI, 3), de mouvement ni de pestions qu'il n'exprime. Il menace, il caresse, il supplie; il est triste, il est gai; il est fier, il est humble. Il fait entendre une infinité de choses, et souvent il en dit plus que n'en pourrait dire le discours le plus éloquent. XIX. Si quidem et Theophrastus divintate loquendi nomen invenit. Théophraste, instruit d'abord à l'école de Platon, passa ensuite à celle d'Aristote, qui, charmé de la beauté de son génie, et de l'agrément de son élocution, changea son nom, qui était lyrisme, en celui de Théophraste, homme dont le langage est divin (Θέος, Dieu, φράζω, je parle). XIX. Aristoteles Isocratem ipsum lacessivit. Voyez Tuscul., I, 4. Aristote, dit-on (Quintilien, III, 1), fit contre Isocrate la parodie d'un vers de Sophocle : Αἰσχρὸν σιωπᾷν, Ἰσοκράτην δ' ἐᾷν λέγειν. (Philoct.) Sophistarum, de quibus supra dixi. Cicéron a déjà parlé des sophistes dans le chapitre XII de ce Traité. Ce nom, qui fut d'abord un titre honorable, et signifiait un homme savant et éloquent, commença, dés le temps de Philippe, à s'avilir dans la Grèce. Socrate et Platon tirent connaître la vaine doctrine des sophistes et leur fausse sagesse; de façon qu'on ne regarda plus qu'avec mépris ces sortes de charlatans qui couraient de ville en ville pour débiter leur science avec ostentation, et pour en faire un trafic sordide. « Num sophistes? sic enirn appellabantur, qui ostentationis aut quaestus causa philosophabantur. » (Academ., II, 23.) On donne encore le nom de sophistes à ceux qui cherchent à faire illusion par de vaines subtilités et par des discours captieux. Mais ici ce mot a une toute autre idée, et signifie des gens qui parlent uniquement pour plaire, comme on peut s'en convaincre par ce que Cicéron en dit dans ce passage. XX. Numerus vocatur, qui graece ῥυθμὸς dicitur. Le nombre avait deux noms chez les Grecs : le nombre pour la prose s'appelait ῥυθμὸς, et μέτρον quand on l'appliquait aux vers. Les rythmes et les mètres ont entre eux cela de commun, qu'ils sont composés de pieds, c'est-à-dire, de longues et de brèves; mais ils diffèrent, en ce que les rythmes consistent seulement dans un certain espace de temps, et que les mètres, outre cet espace de temps, sont assujettis à une certaine mesure fixe et déterminée, selon la qualité des vers. Il est indifférent au rythme qu'un mot soit un dactyle ou un anapeste, parce qu'il n'a égard qu'an temps, et que le dactyle et l'anapeste ont les mêmes intervalles et la même mesure de temps. On sait qu'une syllabe longue a deux temps, et qu'une brève n'en a qu'un; qu'un dactyle est composé d'une longue et de deux brèves, et que l'anapeste, au contraire, est composé de deux brèves et d'une longue, ce qui revient à la même mesure de temps. Mais dans la composition des vers, un poète n'emploie pas indifféremment un anapeste, parce que le vers est astreint à une certaine marche et à une certaine mesure de pieds. Platonis et Democriti locutionem. Cicéron dans le de Oratore (I, I1) nomme ensemble comme dans celui-ci, Démocrite et Platon. Les anciens regardaient leur prose comme régale de la plus belle poésie. A plus forte raison n'est-il pas un seul poète comique qu'on puisse mettre en parallèle avec Platon pour l'harmonie, la hardiesse et la poésie du style. XXI. Nos dicamus sape deorum. Cicéron (de Officiis, I, 40) définit la bienséance, l'art de placer à propos tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait. « Scientia earum rerum, quae agentur, sut dicentur, suo loco collocandarum. » XXII. Pictor ille vidit obvolvendum caput Agamemnonis esse. Allusion au tableau fameux du peintre Timanthe, loué par tous les connaisseurs de l'antiquité. (Pline, XXXV, 10.) Si denique histrio, quid deceat, quaerit. Cicéron rapporte ailleurs (de Oratore, I, 29) le mot de Roscius : Caput artis, decere. XXV. Immutatione lilterae quasi quaesitae venustates. On pourrait citer de nombreux exemples de ces espèces de jeux de mots, qui tiennent à un changement de lettres. Haec res potius oneri fuit quam honori, etc. Verborum iterationes. Cicéron fournit lui-même d'assez nombreux exemples de la figure dont il parle ici, de la répétition. « Occidi, occidi, non Sp. Melium. » ( pro Mil. c. 27.) « Nihil ne te nocturnum praesidium palatii, nihil urbis vigiliae, nibil timor populi,.. nihil horum ora vultusque moverunt? » (In Cat, I. ) « Qui sunt, qui foedera saepe ruperunt? Carthaginienses.... Qui sunt qui ltaliam deformaverunt? Carthaginienses. Qui sunt qui sibi postulant ignosci? Carthagiuienses. » (Rhet. ad Herenn., IV, 14.) XXVI. Hyperides... Demades praeter ceteros fertur. Quintilien reconnaît à Hypéride une grande douceur de style et beaucoup de délicatesse, dulcis et acutus. Un de ses plaidoyers les plus célèbres fut celui qu'il prononça en faveur de la courtisane Phryné, accusée d'impiété, mais que sa beauté défendit mieux que son avocat. « Et Phrynem non Hyperidis actione, quanquam admirabili, sed conspectu corporis ... putant periculo liberatam. » ( Quint. II 15,.) - Démade, de marinier, devint un orateur illustre, dont le proverbe, « de la rame à la tribune. » Il avait peu de savoir, mais beaucoup d'esprit. Son éloquence lui acquit un grand crédit sur l'esprit de Philippe, roi de Macédoine. On croit qu'Antipater le fit mourir. D'autres disent que ce fut Cassander. Il ne restait rien de Démade au temps de Cicéron. Brut., c. 9. XXVII. Phalereus Demetrius. Démétrius de Phalère est le dernier des orateurs attiques. XXVIII. Tertius est ille amplus, copiosus, gravis, etc. Cicéron traite, comme ou voit, le sublime d'une manière sublime. S'il en faut donner une définition, voici celle de Boileau dans ses Réflexions critiques sur sa traduction de Longin: « Le sublime est, dit-il, une certaine force de discours propre à élever et à ravir l'âme, et qui provient ou de la grandeur de la pensée et de la noblesse du sentiment, ou de la magnificence des paroles, ou du tour harmonieux, vif et animé de l'expression; c'est-à-dire, d'une de ces choses regardées séparément, ou, ce qui fait le parfait sublime, de ces trois choses jointes ensemble. » XXIX. Is erit igitur eloquens... qui poterit parva summisse... etc. - « C'est, dit la Harpe, la conclusion de ce traité; c'est celle de Quintilien; c'est dans tous les temps celle des bons esprits. » Tota mihi causa pro Caecina.... In Manilia lege.... Rabirii causa.... Le plaidoyer pour Cécina est probablement de l'an de Rome 684. - Le discours pour la loi Manilia fut prononcé en 687. - Le plaidoyer pour Rabirius, en 690. XXX. Uxor generi, noverca filii, filiae pellex. C'est un trait tiré du plaidoyer pour Cluentius Avitus, c. 70. XXXV. Chrysippi disciplina institutum. Chrysippe, disciple du philosophe Cléanthe, avait un esprit subtil et porté à la dispute; il fit un traité de logique, si estimé des anciens, qu'on disait que si les dieux font usage du raisonnement, ils n'emploient pas d'autre méthode que la sienne. XXXIV. Quem laborem nobis Attici nostri levavit labor. T. Pomponius Atticus, l'ami de Cicéron, composa des annales qui comprenaient sept siècles, et qui étaient surtout remarquables par l'exactitude de la chronologie. Voyez la vie d'Atticus, par Cornélius Nepos. XXXVI. Alteram in augendis amplificandisque rebus. Il y a entre la preuve et l'amplification cette différence, que la preuve doit établir une vérité, ou constater un fait, et l'amplification, exagérer ou confirmer l'importance de la vérité ou du fait en question. L'amplification se divise en plusieurs espèces; niais il faut savoir qu'aucune de ces espèces n'est parfaite, s'il n'y a du grand et du sublime, à moins qu'il mie s'agisse de ravaler le prix des choses. « L'amplification, dit Longin (chap. 9 et 10), est un accroissement de paroles, que l'on peut tirer de toutes les circonstances particulières de chaque chose pour fortifier le discours, en appuyant sur ce qui a été dit. » XXXVII. Nobis pro familiari reo summus orator non respondit Hortensius. L'orateur veut parler ici de l'affaire de Verrès, défendu par Hortensius, son ami, et que Cicéron fit condamner. Catitina in senatu accusatus obmutuit. Salluste dit néanmoins que Catilina ne demeura pas tout à fait sans réplique; qu'il commença par conjurer le sénat de ne pas ajouter foi aux invectives de Cicéron, qui était, disait-il, son ennemi, et qui avait inventé un plan de conjuration pour s'acquérir le titre de défenseur de la patrie; mais que Catilina fut interrompu par un murmure général, qui l'empêcha de se faire entendre; qu'on lui donna les noms d'incendiaire, de parricide, d'ennemi de la patrie; qu'outré de ces reproches, il s'écria avec fureur que, puisqu'on le poussait à bout, il ne périrait pas seul, et qu'il éteindrait sous des ruines le feu qu'on allumait contre lui. Curio.... Subito assedit, quum sibi venenis ereptam memoriam diceret. Cette victoire fut la troisième que Cicéron remporta par la force et la vivacité de son éloquente. Il raconte le fait dans son Brutus, chap. 60. Perorationem mihi tamen omnes relinquebant. Voyez aussi le Brutus, chap. 51. XXXVIII. Ut puerum infantem in manibus perorantibus tenuerimus; ut, alia in causa, excitato reo nobili, sublato etiam filio parvo.... Cicéron fit le premier de ces plaidoyers en 691, pour justifier Sylla accusé d'avoir trempé dans la conspiration de Catilina; et il fit le second en 694, pour Flaccus, accusé de concussion dans l'Asie, et il avait commandé durant trois ans, après sa préture. XXXIX. Frequentissimae transtationes erunt. Voyez sur la métaphore la Rhétorique à Hérennius, IV, 34. Eadem ratio est horum, quae sunt orationis lumina.... Cicéron a renfermé ici en peu de mots presque tout ce qui peut avoir rapport aux figures de diction et aux figures de pensées, sans les nommer et sans les accompagner d'exemples. Si l'on voulait les expliquer toutes,on ferait un volume entier. Quum gradatim sursum versus reditur. La gradation est, selon Quintilien, une figure qui tient de la répétition. On y répète eu effet plusieurs choses; mais on ne passe à ce qui suit qu'en reprenant une partie de ce qui a précédé, comme dans cet exemple : « Africano industria virtutem, virtus gloriam, gloria aemulos comparavit. » Rhétorique à Hérennius, IV, 25. Demtis conjunctionibus. Si vous allez embarrasser, dit Longin, une passion de ces liaisons et de ces particules inutiles, vous lui ôtez toute son impétuosité, et vous arrêtez la liberté de sa course. Aliqua exclamatio. Voyez, sur l'exclamation, la Rhétorique à Hérennius, IV, 15. Ejusdem nominis casus saepius commutatur. Voici un exemple du changement de cas d'un nom. « Senatus est summi imperii consilium; senatuti reipublicae cura mandatur; ad senatum in dubiis periculosisque rebus omnis civitas respicit. » XL. Ut interrogando urgeat. Cicéron, dans son plaidoyer pour Ligarius (chap. 3), fournit un très bel exemple de ce moyen oratoire. Ut rursus quasi ad interrogata sibi ipso respondeat. Voyez le même plaidoyer (chap. 3), « apud quem igitur hoc dico, etc. » Ut contra ac dicat accipi et sentiri velit. Figure qui est une espèce d'ironie par laquelle on feint de louer ceux qu'on veut blâmer on critiquer.
Cotin, à ses
sermons traînant toute la terre, XL. Ut muta quaedam loquentia inducat. La prosopopée est une figure qui fait parler des personnes absentes ou mortes, et prête même un langage à des choses inanimées. (Rhét. à Hérenn., IV, 53.) Saepe etiam rem dicendo subjiciet oculis. C'est la fonction de l'hypotypose, qui peint les choses avec des couleurs si vives qu'on croit les voir. Cicéron emploie cette figure pour peindre la colère, ou plutôt la fureur de Verrès, in Verrem, v, 62. Saepe supra feret. L'hyperbole est une ligure qui, soit pour amplifier, soit pour diminuer, va au delà du vrai. On l'emploie quand les termes ordinaires ne paraissent pais assez forts pour exprimer tout ce qu'on veut dire. Mais ceux qui nous écoutent rabattent de nos exagérations ce qu'il en faut rabattre. Ainsi cette figure ramène l'esprit à la vérité par la voie du mensonge. - Il est inutile d'en dire plus long sur les figures. On peut lire Quintilien, liv. VIII, chap. 6; liv. IX, chap. 1, 2 et 3 ; et Rollin, Traité des Études, où, en expliquant les principales ligures, il accompagne ses explications de plusieurs exemples tirés des meilleurs auteurs, tant anciens que modernes. XLI. De cujus mentis tanta Senatus judicia fecisset. Cicéron rapporte lui-même (in Pison, chap. 3) les éloges et le témoignage singulier que le sénat et le peuple romains avaient donnés aux services importants qu'il avait rendus à la république. Hominumque clarissimorum discipulis floruerunt domus. Mucius Scévola, Sext. Elius, M'. Manilius, et d'autres. XLIi. An, quibus verbis sacrorm alienato fiat, docere honestum est. Pour entendre ce passage, il faut se rappeler que chez les Romains il y avait non seulement des places et des champs publics consacrés à la religion, et que la loi des Douze Tables avait déclarés inaliénables, mais que certains fonds de terre appartenants à des familles particulières, et consacrés parla religion, étaient aussi in-aliénables et perpétuels. Voilà pourquoi Cicéron dit, dans le second livre des Lois, chap. 9: Sacra privata perpetua manento. Quum et abfuissem domo adolescens, et horum studiorum causa mare transissem. Voyez Brutus, chapitre 91. XLIII. Quum meae forenses artes, et actiones publlcaa concidissent. Nous devons à l'oppression de la république romaine par César les ouvrages de philosophie que Cicéron a composés. Voyant, après la bataille de Pharsale, son rôle politique fini, il se retira dans sa maison de campagne, où il sellerais ses compositions philosophiques, dont la beauté ne cède point à ses ouvrages d'éloquence. Il avait eu dès sa jeunesse, beaucoup de goût pour ces études, qui lui offrirent alors une consolation. Profecto forensibses nostris rebus etiam domesticae litterae respondebunt. On est étonné que Cicéron, qui ne dédaignait pas de travailler avec tant de scrupule le style de ses discours, paraisse si confus d'en écrire la théorie. Les rhéteurs avaient déshonoré l'art, et on laissait ces petits détails aux hommes oisifs qui ne pouvaient prendre aucune part au gouvernement de la république. Mais depuis que la domination de César réduisait au silence et à l'inaction les sénateurs et les consulaires, il devait dire courageusement que ce travail, malgré sa simplicité, valait bien celui des tyrans qui opprimaient l'État. XLIV. Quod apud Lucilium scite exagitat in AIbucio Scævola. Voyez Brutus, chap. 35; de Finibus, I, 3, etc. XLV. Et quidem nos. Cicéron avait traduit dans sa jeunesse, en vers latins, le poème grec d'Aratus. Voyez les Fragments. XLV. Quomodo enim vester Axilla, Ala factus est. Tous les historiens disent Ahala et non Ala. C. Servilius Ahala, maître de la cavalerie, tua sp. Mélius, par l'ordre du dictateur Cincinnatus, l'an de Rome 317. (Tite-Live, IV, 14; in Catilin., I, chap. I ; pro Milon., chap. 27. ) Brutus descendait de ce Romain par sa mère Servilia, et avait été adopté par le frère de sa mère, Q. Servilius Cépion. (Philipp., chap. X, 6, 11, etc.) Quam litteram etiam e maxillis, et taxillis, et vexilio', et paxillo, consuetudo elegans latini sermonis evellit. La contraction de ces mots est malae, tali, velum, palus. Jam in uno capsis. Cicéron semble croire ici que capsis est la contraction de cape, si vis. Quintilien (I, 5, 66) est d'un autre avis; capsis paraît être un ancien subjonctif pour reperis. ( Pestes capsit, prehenderit.) On peut toutefois conjecturer que l'e bref de cape se prononçait à peine, et qu'on disait capsis pour capesis. XLVII. « Scripserunt, »esse verius sentio; sed consuetudini auribus indulgenti libenter obsequor. - Verum et veritas, outre leur signification ordinaire, ont encore une signification peu commune, et qui mérite ici d'être remarquée, d'autant plus que Cicéron s'en sert en plusieurs endroits de ce traité, en y attachant l'idée de règle : ces deux mots sont alors apposés à usus et consuetudo, usage et coutume. Impetratum est a consuetudine, ut peccare suavitalis causa liceret. Nous avons, dans notre langue, imité l'exemple des Latins : nous aimons mieux faire un solécisme pour adoucir notre prononciation, que de choquer l'oreille par un mauvais son. Ainsi nous disons mon épée, mon cime, et non ma épée, ma cime, comme le demanderait la règle de la construction grammaticale. XLVIII. Exegit, edixit, effecit. Le mot effecit ne paraît pas ici à sa place et appartient plutôt aux exemples suivants. Inclytus dicimus brevi prima littera, insanus producta; inhumanus brevi, infelix longa. Cette observation regarde, non la quantité, mais la manière dont les Romains prononçaient in et cum dans les mots composés. C'est pourquoi Cicéron ajoute : Consule veritatem, reprehendet; refer ad aures, probabunt. Loquebar sic, ut pulcros.... On revint plus tard à cette prononciation, puisqu'on trouve dans un grand nombre de manuscrits et d'inscriptions pulcer, pulcra, etc. Matones, Otones.... On reprit aussi pour ces deux mots l'ancien usage ; et aujourd'hui on écrit Mathones, Othones. Nunc autem etiam duas. Ces deux lettres sont y et ph, répondant à υ et à φ. Ita non erat offensio in versibus, guam nunc fugiunt poetae novi. On ne trouve que deux ou trois fais, dans les vers qui nous restent de Cicéron la licence dont il parle ici. XLIX. Versutiloquas malitias. Cicéron, dans le de Oratore (III, 38), a cité en entier ce vers qui parait, être d'Attius. Nostra sont in Miloniana. Voyez le chapitre 4 de la Milonienne de Cicéron. Eam, quam nihil accusas, damnas. Ces phrases sont, en effet, citées comme de la prose. Topiques, chapitre 13. L. Genus illud terbium explicetur, quale sit, numerosae et aptae orationis. Voyez la division établie par Cicéron, ch. 44. - Voici la définition du nombre oratoire que donne l'abbé d'Olivet dans sa Prosodie française, avec un abrégé des explications qu'il y joint : « Le nombre oratoire est une sorte de modulation, qui résulte non seulement de la valeur syllabique, mais encore de la qualit6 et de l'arrangement des mots. » 1° Il donne pour première cause de cette modulation la valeur syllabique des mots dont une phrase est composée, c'est-à-dire, leurs longues et leurs brèves, non assemblées fortuitement, mais assorties de manière qu'elles précipitent ou ralentissent la prononciation au gré de l'oreille. 2° ll ajoute qu'il faut avoir égard à la qualité des mots considérés comme des sons ou éclatants, ou sourds, ou lents, ou rapides, ou rudes, ou doux. Il avertit qu'un des plus importants secrets de la prosodie, c'est de tempérer les sons l'un par l'autre, et qu'il n'y en a point de si rudes qui ne puissent être adoucis, ni de si faibles qui ne puissent être fortifiés. 3° Il apporte pour dernière cause de l'harmonie l'arrangement des mots. Il remarque que souvent on est obligé de transposer des mots, ou même des membres de phrase, non seulement pour être plus clair, ou plus énergique, mais encore pour attraper un ton harmonieux. Il conclut qu'une phrase bien cadencée est un tissu de syllabes bien choisies, et mises dans un tel ordre qu'il n'en résulte rien de dur, rien de lèche, rien de trop long, rien de trop court, rien de pesant, ni de sautillant. LI. Ephorum et Naucratem. Naucrate est encore cité par Cicéron, de Oratore, II, 23; III, 44. In versu quidem theatra tota exclamant, si fuit una syllaba, aut brevior aut longior. Denys d'Halicarnasse, de l'Arrangement des mots, chap. 2 ; « Dans nos vastes théâtres, on se rassemble de toutes parts une foule ignorante, j'ai cru reconnaître que nous avons le sentiment inné de la mélodie et de la cadence; j'ai entendu huer par la multitude de fameux joueurs de cithares qui avaient manqué une note ou troublé la mesure; j'ai entendu siffler tel joueur de flûte, non moins habile dans son art, pour avoir mal ménagé son haleine et fait entendre des sons durs et discordants. Cependant, qu'on appelle un de ces censeurs, qu'on lui donne l'instrument, qu'on lui dise de jouer ce que l'artiste a manqué, le pourra-t-il? non. C'est que, pour exercer l'art, il faut la science que nous n'avons pas tous, et que, pour juger, il ne faut que le sentiment, don commun de la nature. Il en est de même des rythmes; j'ai vu tout un auditoire s'indigner, se soulever à cause d'un battement, d'un accord, d'une intonation qui ne tombait pas au point juste, et rompait l'harmonie. LII. Sed princeps inveniendi fuit Thrasymachus. Thrasymaque fut le premier chez les Grecs qui inventa le nombre et la cadence. Mais Isocrate en perfectionna l'art par ses préceptes et par ses exemples. LIII. Aures enim, vel animus aurium nuntio. Cicéron, après s'être servi du mot aures, se corrige aussitôt, et ajoute, vel animas aurium nuntio, pour montrer qu'à proprement parler, ce n'est point l'oreille qui entend, et qui juge de la mesure. des longues et des brèves. LIV. Haec igitur fere sunt, in quibus rei natura quarenda sit. Cicéron satisfait à toutes ces petites questions en détail; ensuite, chap. 60, il fait la récapitulation de toutes les décisions qu'il en a données. LVI. Itaque et Herodotus, et eadem superiorque aetas numero caruit. Quintilien (IX, 4) n'est pas de ce sentiment. Cicéron, dit-il, tout bon juge qu'il est, ne me persuadera pas que Lysias, Hérodote et Thucydide aient été peu curieux du nombre. Peut-être ont-ils une autre manière que celle de Démosthène et de Platon, qui eux-mêmes sont différents l'un de l'autre; mais cela ne prouve rien. Sed hi numeri, poeticine sint.... Comme Cicéron, dans le reste de ce Traité, est obligé de parler de la mesure des pieds qui entrent dans la prosodie latine, il est bon d'en faire ici une liste, et d'en marquer en peu de mots la nature, afin que le lecteur puisse y avoir recours dans le besoin. Les pieds sont de deux sortes : les uns, simples, et les autres, composés. Les simples sont de deux ou trois syllabes. Voici ceux de deux syllabes : Le spondée, qui a deux longues, comme musae. Le chorée, qu'on nomme ordinairement trochée, est d'une longue et d'une brève, comme Musa. L'iambe, qui est le contraire du chorée, est d'une brève et d'une longue, comme Deo. Le pyrrhique qui sert à la composition du péon, est de deux brèves : Deus. Les pieds de trois syllabes dont Cicéron parle, sont : Le dactyle, qui est d'une longue et de deux brèves : carmina. L'anapeste, qui est le contraire du dactyle, est de deux brèves et d'une longue : Domini. Le crétique est d'une brève au milieu de deux longues : castitas. Le tribraque, nommé trochée par Cicéron, pied de trois brèves, est égal au chorée, non en nombre de syllabes, mais en intervalle : Domina. Outre ces pieds simples, il y en a de composés, qui sont plutôt des assemblages de pieds que des pieds. On en compte plusieurs; mais Cicéron n'en cite que trois dans son traité de l'Orateur; savoir : le dichorée, le péon et le dochmius. Le dichorée est composé de deux chorées : comprobare. Le péon ou le péan est de deux sortes : le premier est d'une longue et de trois brèves, comme conficere : ainsi il est composé d'un trochée et d'un pyrrhique. Le second est au contraire de trois brèves et d'une longue, comme celeritas : alors il est composé d'un pyrrhique et d'un iambe. Le dochmius est de cinq syllabes, savoir : d'une brève et de deux longues, et ensuite d'une brève et d'une longue, comme amicos tenes : ainsi il est composé d'un iambe et d'un crétique. LVI. Pes enim, qui adhibetur ad numeros, partitur in tria,.... Les pieds, dont le nombre est composé, sont de trois espèces : les uns sont égaux, c'est-à-dire, ont une partie égale à l'autre, comme le spondée, qui est de deux longues, ou comme le dactyle, qui est d'une longue et de deux brèves; car la longue est équivalente à deux brèves. Les autres sont d'une mesure et demie; en sorte qu'une partie est une fois plus grande que l'autre : tel est l'iambe, qui est d'une brève et d'une longue; on sait qu'une longue a deux temps, et que la brève n'en a qu'un. Enfin, les autres pieds sont en proportion sesquialtère, c'est-à-dire, qu'ils sont comme deux nombres, dont le dernier contient le premier une fois, avec l'addition de sa moitié. Neuf, par exemple, contient une fois six, et encore la moi lié de six, qui est trois; tel est le premier péon, dont la dernière partie, qui est de trois brèves, égale la première, qui est d'une longue, et la surpasse encore d'une moitié. Hipponacteos. Les vers hipponactéens sont semblables aux scazons ou choliambes. Il n'y a aucun de ces pieds qui n'entre dans la prose. Mais plus ils ont de temps, c'est-a-dire, de syllabes longues, plus ils lui communiquent (Ir poids et de stabilité; et plus ils ont de brèves, plus ils lu donnent de vitesse et de mouvement. LVI. Aristophanaeus nominatur. Les vers aristophanéens sont ainsi appelés du nom d'Aristophane, qui faisait un fréquent usage des vers anapestes. LVII. Fugit autem spondeum et truchieum. Il ne faut pas oublier, que dans Cicéron, le trochée est le même que le tribraque. Le trochée ordinaire est appelé chorée par Cicéron. LXiI. Ut nos in accusationis secundo de Siciliae laude diximus.... De Enneni Cerere, de Segestana Diana, de Syracusarum situ. - L'Éloge de la Sicile, Verrines, seconde action, II, 1 sq. - La Cérès d'Enna, IV, 48. La Diane- de Ségeste, ibid., c. 33. - La ville de Syracuse, ibid., c. 52. Κόμματα et κῶλα, incisa et membra. Le membre est une des parties de la période. Il est renfermé dans une certaine quantité de paroles, dont le nombre est complet. L'incise ne diffère du membre, qu'en ce qu'elle n'a pas tant d'étendue, et que le nombre n'en est pas si complet. Le membre détaché est semblable à une période simple, comme dans cet exemple de Cicéron (2. Philippe ch. 22) : « Nulla causa justa cuiquam esse potest contra patriam arma capiendi. » L'incise est composée que de deux ou trois mots, comme Furor arma ministrat; quelquefois elle est renfermée dans un seul mot, comme Diximus. LXIIII. Verborum ordinem immuta. « Dans la péroraison de l'éloge de Turenne par Fléchier, au lieu de la religion et de la patrie éplorée, que l'on dise, de la religion et de la patrie en pleurs, il n'y a plus aucune harmonie; et cette différence si sensible pour l'oreille, dépend d'un dichorée sur lequel tombe la période, effet singulier de ce nombre, qui, dans notre langue, conserve sur l'oreille le même empire qu'il exerçait dans la langue latine du temps de Cicéron. » (Marmontel, Harmonie du style.) Aut etiam dactylos, qui est e longa, etc. Cicéron dit ici que le dactyle, suivi d'un spondée ou d'un chorée, termine heureusement la période : mais cela ne peut s'accorder avec le précepte qu'il donne plus haut (chap. 20 et 56), et dans les Partitions oratoires (chap. 21) : « Orationem circumscribendam esse numerose, non ad similitudinem versuum.» Quintilien (IX, 4 ) condamne expressément les fins de périodes qui ressemblent aux fins des vers hexamètres : « Ne dactylus quidem spondeo bene praeponitur, quia fidem versus damnamus in fine orationis. » Toutefois si le dactyle et le spondée n'avaient point la forme poétique, l'oreille loin d'en être choquée, en serait satisfaite, comme dans cet exemple : « Qui alibi primus afflicto et jacenti consularem fidem dexteramque porrexit; qui mea morte ad vitam, a desperatione ad spem, ab exitio ad salutem revocavit, » (Post redit. in Sen., chap. 9. ) LXVI. His igitur singutis versibus quasi nodi apparent continuationis. Ces noeuds, ces jointures, sont les particules qui servent à lier et à unir les différentes parties de la période, sed, quanquam, tamen, non solum, sed etiam, quum, tum, etc., les pronoms relatifs, qui, quae, etc. Deinde tertium, κολῶν illi. Cette troisième phrase manque dans le texte de Cicéron. LXVII. « Domus tibi deerat, etc. » Ce passage est tiré d'un plaidoyer aujourd'hui perdu, et que Sigouius et Strébée pensent avoir été celui qui fut fait pour Scaurus. Asconius nous apprend que Triarius, accusateur de Scaurus, lui reprochait d'avoir une maison magnifique, ois l'on voyait quatre colonnes d'un grand prix; et l'on suppose que Cicéron rejetait la même inculpation sur l'accusateur. In nostra Corneliana secundo, Ces plaidoyers, que l'on comptait parmi les plus beaux de Cicéron, ne nous sont connus aujourd'hui que par les fragments que nous en ont conservés quelques écrivains anciens, et par les scholies d'Asconius. LXVII. Hegesias. Hégésias de Magnésie était un écris vain d'un style affecté et plein de pensées froides et inspides : témoin ce qu'il dit sur l'incendie du temple d'Éphèse: « Qu'il ne fallait pas s'étonner que ce temple consacré à Diane eût été brûlé la nuit même qu'Alexandre vint au monde, que la déesse était alors occupée aux couches d'Olympias. »Voyez le Traité de la Nature des dieux, n, 27. LXIX. L. Coelius Antipater. - Cicéron dit ailleurs (Brutus, C. 26) que cet annaliste était, pour son temps, un assez bon écrivain : « L. Coelius Antipater scriptor fuit, ut temporibus illis, luculentus. » Il l'estimait aussi comme jurisconsulte, et en parle encore avec éloge dans le Traité de Legibus (I, 2). Ici, il lui refuse seulement la connaissance du nombre oratoire et le secret de l'harmonie du style. LXXI. Non clypeum. Le bouclier de Minerve fut placé par Phidias aux pieds de la déesse, dans la statue du Parthénon. Quum ipsum illud verum in occulte lateret. - Cicéron faisait profession de la philosophie académique; et la maxime capitale de cette secte était, que le vrai ne pouvait se trouver avec certitude, qu'il fallait en conséquence se contenter de chercher le vraisemblable sur chaque chose, et que ce n'est qu'à force d'agiter le pour et le contre qu'on peut découvrir la vraisemblance.
Si tibi ea,
quae disputata sunt, minus probabuntur. Malgré l'excellence de cet
ouvrage, malgré le soin que Cicéron avait pris de l'établir sur des
preuves et des fondements solides, Brutus ne l'approuva pas. Ctceron
s'en plaint dans une lettre à Atticus (XIV, 20) « Lorsque j'adressai à
Brutus mon livre de la parfaite éloquence, que je n'avais composé qu'à
sa sollicitation, il m'écrivit, et à vous aussi, que son système était
différent du mien. » Comme Brutus avait pris Lysias pour modèle, il ne
faisait consister l'éloquence que dans la justesse des pensées, dans la
précision et la politesse du style; les grands mouvements et la
magnificence de l'élocution ne lui plaisaient pas. C'est dans ce goût
qu'il composa la harangue qu'il fit au Capitole après le meurtre de
César; harangue que Cicéron loue comme un modèle de cette éloquence un
peu nue que préférait Brutus. Pour lui, écrit-il à Atticus (XV, I) il y
aurait mis plus de chaleur. « Si illam causam habuissem, dixissem
ardentius. Ὑπόθεσις vides quæ sit, quae persona dicentis. » En effet,
Brutus n'y avait pas assez vu ce qu'il se devait à lui-même, ce qu'il
devait aux auditeurs, ce qu'il devait à son sujet. C'est Brutus qui
parle, Brutus, le chef de la conjuration contre César : en tuant le
tyran, il avait délivré sa patrie de la servitude; il s'agissait de
faire sentir aux Romains l'importance du service qu'il leur avait rendu,
et d'exciter leur indignation contre tous les oppresseurs de la liberté.
Un sujet de cette nature aurait dû animer l'orateur et produire les plus
grands mouvements. Mais Brutus, qui était partisan outré de l'atticisme,
et qui n'en connaissait point toutes les perfections, suivit son idée
dans la composition de cette harangue, et se contenta d'y mettre de la
douceur, de la précision et de l'élégance.
|