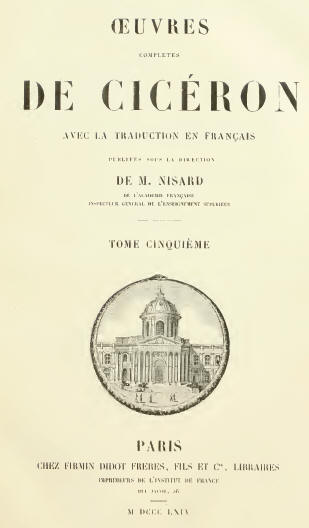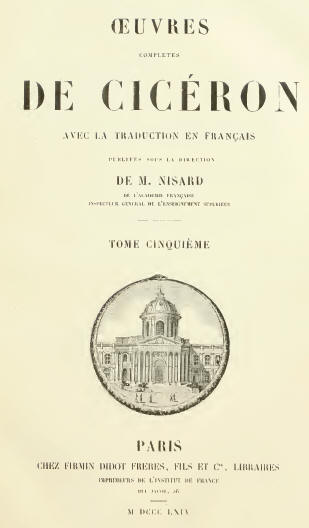|
350 . — A ATTICUS. Formies, mars.
A. IX, 3. Le fils de Domitius a
passé à Formies le 8 des ides, se rendant en toute diligence auprès de
sa mère, à Naples. Pressé de questions par mou esclave Dionysius, il l'a
chargé de me dire que Domitius son père était dans les environs de Rome.
il s'était embarqué, nous disait-on, pour rejoindre Pompée, ou passer en
Espagne. Je tiens à savoir ce qui en est. La présence de Domitius en
Italie n'est rien moins qu'indifférente a la question. C'est pour Pompée
une preuve de
331
la difficulté extrême de sortir de la péninsule, cernés comme nous le
sommes par les troupes et les garnisons de César; difficulté que l’hiver
augmente encore. Dans un autre temps de l'année, la mer intérieure nous
ouvrirait passade. A l'époque ou nous sommes, la navigation n'est
possible que sur l'Adriatique, dont tous les chemins nous sont fermés.
Informez-vous donc de Domitius et de Lentulus. - Aucune nouvelle de
Brindes n'a encore percé jusqu'à nous. Nous sommes au 7 des ides; César
a dû y arriver hier ou aujourd'hui; il a couché à Arpi le jour des
kalendes. A entendre Postumus, il va poursuivre Pompée, qui, suivant son
calcul, doit être embarqué. Je ne crois pas que César puisse se procurer
des matelots. Postumus est persuadé du contraire, d'autant, dit-il,
qu'il n'y a pas un marin qui ne connaisse sa générosité. Mais je ne puis
tarder à savoir tout ce qui se sera passé à Brindes.
351. – A
ATTICUS. Formies, mars.
A. IX, 4. Il n'est de repos pour moi
qu'en vous écrivant ou en lisant vos lettres. Ce qui n'empêche pas que
la matière ne commence à me manquer; et je sais que très certainement
vous êtes dans le même cas. Allez donc aujourd'hui écrire de ces riens
dont s'amusent les esprits tranquilles. Quant aux affaires du moment,
c'est un sujet dès longtemps épuisé entre nous. Mais pour lutter contre
le chagrin, je me pose à moi-même des questions politiques, ayant trait
aux circonstances présentes. Par là mon esprit échappe à la mélancolie,
et ses facultés restent tendues sur les difficultés qu'il s'agit de
résoudre. Ces questions, les voici : « Doit-on rester dans son pays,
lorsqu'il est sous le joug d'un tyran? Tous moyens sont-ils légitimes
pour arriver au renversement de la tyrannie, dût même la secousse avoir
éventuellement pour effet la ruine de l'État? Celui qui renverse un
tyran ne rend-il pas suspectes à propre élévation? Pour secourir la
patrie, la voie d'attente et de négociation est-elle préférable à la
force ouverte? Un bon citoyen peut-il, quand la patrie est opprimée, se
tenir à l'écart et rester inactif? ou lui faut-il, coûte que coûte, tout
faire pour la liberté? Peut-on, en vue de l'affranchissement de son
pays, y porter la guerre et assiéger même sa patrie? Celui qui, par
sentiment, répugne à en appeler aux armes, est-il néanmoins tenu de se
ranger du bon parti? Est-on irrévocablement lié à une cause politique
par l'amitié ou les bienfaits, quelques fautes qu'on y ait commises?
L'homme qui a bien mérité de la patrie, qui pour elle a souffert tous
les maux que peut infliger la haine des méchants, n'a-t-il pas payé
définitivement sa dette? Ne lui est-il pas donné de faire enfin
acception de lui-même et de ceux qui lui sont chers, de quitter l'arène
politique, laissant le gouvernement à ceux qui ont le pouvoir? Voilà sur
quels sujets je m'exerce, traitant le pour et le contre tantôt en grec,
tantôt en latin. C'est une diversion salutaire à ma tristesse ; car ces
abstractions-là me sont très applicables. Mais je crains que, pour vous,
tout cela ne vous tombe à contretemps ; car cette lettre, si le porteur
marche comme il faut, vous arrivera juste le jour de votre accès.
335
352. — A ATTICUS. Formies, mars.
A. IX, 5. Vous raisonnez on ne peut
mieux dans votre lettre datée du jour de votre naissance, et que m'a
remise le lendemain Philotimus : votre affection s'y montre autant que
votre prudence. Oui, gagner l'Adriatique, s'embarquer sur la mer de
Toscane, se rendre à Arpinum, rester à Formies, difficultés de toutes
parts. Si je m'en vais, j'aurai l'air de le fuir; si je reste, de
l'attendre pour le féliciter. Mais je ne sais rien de pis que de voir ce
qu'il me faudra voir bientôt. J'ai eu Postumus chez moi ; vous savez
comme il m'a excédé. Depuis, Fufius a passé par ici; il courait à
Brindes. Quels airs! quelle assurance I Pompée est un monstre. Le sénat
ne sait ce qu'il veut, ni ce qu'il fait. Même ici je ne puis tenir à ces
incartades ; comment les essuyer de la part d'un Curtius en pleine
curie? Or supposez que je le prenne sur moi. Quand j'entendrai dire :
Parlez, Marcus Tullius, comment me tirer de là? Sans parler de la
république, que je regarde comme morte de ses remèdes autant que de son
mal, que dire sur Pompée? Je l'ai (à quoi bon le nier?) assez peu
ménagé; car on laisse les événements pour s'en prendre aux causes.
Persuadé, convaincu, comme je l'étais, que tous nos maux (et quels maux
! ) proviennent de lui, naissent de ses fautes, je me suis montré plus
animé contre sa personne que contre César même. C'est ainsi que nos
ancêtres ont attaché un souvenir plus funeste au jour de la bataille
d'Allia qu'a celui de la prise de Rome. Un mal a produit l'autre. Le
premier jour est demeuré néfaste. Qui sait même la date du second? Aussi
quand je récapitule toutes ses fautes depuis dix années, y compris celle
où, pour ne rien dire déplus, il me laissa opprimer sans défense; quand
je songe à tout ce qu'il a montré dans ces derniers temps de légèreté,
de lâcheté, d'incapacité, mon indignation s'allume. Mais tout cela est
du passé. Je ne veux me rappeler que ses bienfaits, que le prestige de
son nom. Je commence à voir un peu tard, mais je vois clairement, que
Balbus m'a pris pour dupe, et que l'on ne tend aujourd'hui, que l'on n'a
visé dès, le principe, qu'à la ruine de Pompée. Quand, dans l'Iliade,
une mère, une déesse dit a Achille,
Ton trépas, ô mon
fils, suivra celui d'Hector;
il lui répond :
Eh bien! si je
n'ai pu secourir mon ami,
Mourons sur l’heure....
A cette heure, il
s'agit non seulement d'un compagnon, mais d'un bienfaiteur; ajoutez d'un
grand homme, et d'une belle cause. Qui peut, pour de telles
considérations, regarder au sacrifice de sa vie? Pour vos gens de bien,
je ne compte point sur eux, ni ne me soucie de leur opinion. Ils sont ou
seront pour César. Qu'est-ce que les prières officielles des municipes
pour la santé de l'autre, auprès de cet élan de félicitations qui
accueille celui-ci après la victoire? Ils ont peur, me direz-vous;
c'était aussi leur excuse auprès de lui, ils avaient peur. Attendons les
événements de Brindes ; peut-être ils m'apporteront de quoi me décider,
de quoi vous écrire au moins.
353. — A ATTICUS. Formies, mars.
A. IX, 6. Point de nouvelles encore
de Brindes. Balbus m'écrit de Rome qu'il croit le consul
336
Lentulus embarqué ; Balbus jeune, qui n'a pu le joindre, a appris cette
nouvelle à Canusium, d’où il lui écrit. Balbus ajoute que les six
cohortes qui étaient à Albe se sont livrées à Curius sur la voie
Minucienne; qu'il le tient directement de César, qui sera bientôt à
Rome. Je suivrai votre conseil. Je n'irai point me cacher à Arpinium,
dans de telles circonstances. Je voulais pourtant m'y rendrez pour
revêtir mon fils de la robe virile, et je comptais donner cette excuse à
César; mais il pourrait trouver étrange que je n'eusse pas choisi Rome
de préférence pour la cérémonie. Après tout, s'il faut que je le voie,
autant vaut ici qu'ailleurs. Nous y pourrons réfléchir sur le reste,
savoir, si je dois m'en aller! par ou? Et quand m'en aller? — On dit que
Domitius est à sa maison de Cosa, et l'on assure même qu'il va
s'embarquer. Si c'est pour l'Espagne, tant pis ; s'il va rejoindre
Pompée, bon. Mieux vaut être au bout du monde sans doute que de se
trouver avec Curtius, dont moi, son patron, je ne pourrais pas supporter
la vue. Que dire des autres? Mais chut, j'aurais trop à dire sur mon
propre compte; moi qui ai si bien fait, avec mon amour pour la patrie,
et mes idées de conciliation, que je me trouve cerné et comme pris au
piège. Ma lettre écrite, j'en reçois une de Capoue, dont voici la
teneur. « Pompée s'est embarqué avec toutes ses troupes, formant un
effectif de trente mille hommes. Les consuls, les deux tribuns du peuple
et les sénateurs qui étaient avec lui, se sont embarqués avec leurs
femmes et leurs enfants. Ils ont fait voile, dit-on, le 4 des nones de
mars, et depuis le vent du nord n'a cessé de souffler. On ajoute que
Pompée a fait détruire ou brûler tous les vaisseaux qui restaient dans
le port. » Ces nouvelles ont été données a Lucius Métellus, tribun du
peuple, à Capoue, par Claudia sa belle-mère, qui s'est aussi embarquée.
— Jusqu’ici j'ai bien souffert, comme on le conçoit, d'une anxiété dont
je ne trouvais aucun moyen de sortir; mais a présent que Pompée et les
consuls ont quitté l'Italie, ce n'est plus de l'anxiété, c'est un
supplice. « Mon cœur est sans force, et mon esprit frappé de stupeur :
» oui, ma tête s'égare, je succombe sous le poids du déshonneur. Il
fallait tout d'abord m'attacher aux pas de Pompée, quelques fautes qu'il
ait faites ; ne pas me séparer des gens de bien, quelque aveugles que
fussent leurs mesures. Que dis-je ? ces mêmes objets d'affection qui me
rendaient si timide à tenter la fortune, ma femme, ma fille, nos chers
Cicérons, me conseillaient ce parti, et déclaraient l'autre honteux et
indigne de moi. Pour mon frère Quintus, il était résigné à trouver tout
bien, et à faire sans répugnance ce que je ferais. — Je me suis mis à
relire vos lettres depuis le commencement ; cela m'a redonné du ton. La
première est une invitation, une prière de ne pas me compromettre. Vous
me félicitez dans la seconde de n'être point parti. En les lisant, je me
réconcilie avec moi-même. Mais l'excitation cesse avec la lecture ; le
chagrin reprend le dessus. La honte, ce fantôme, est toujours la. Je
vous en conjure, ô mon cher Titus, arrachez-moi à mes maux,
adoucissez-en du moins l'amertume ; conseillez-moi, consolez-moi, s'il
est possible. Hélas ! qu'y pouvez-vous faire? quelle puissance
337
humaine y réussirait ? un Dieu le pourrait à peine.— Ce que je veux au
moins chercher d'obtenir, ce dont vous-même encouragez l'espoir, c'est
que César m'accorde de n'être pas au sénat lors des propositions qu'on
ne va pas manquer d'y faire contre Pompée. Je crains bien, moi, d'être
refusé. Furnius est venu de sa part : (et pour que vous sachiez en
passant à quels hommes nous avons affaire) il m'a dit que le fils de Q.
Titinius était avec César. Celui-ci m'adresse, au surplus, des
remerciements plus que je n'en voudrais. Lisez sa lettre, et voyez ce
qu'il souhaite de moi ; elle est courte, mais significative. Quel
malheur que vous ayez été malade ! nous ne nous serions pas quittés. Je
n'aurais pas manqué de conseils. « Nous aurions été deux. » Mais
laissons là le passé, songeons a l'avenir. — Je me suis laissé abuser en
deux choses : d'abord, j'ai cru à un accommodement ; bien décidé, les
partis une fois d'accord, à rentrer dans la vie commune et à préserver
ma vieillesse de tout tracas; ensuite j'ai vu que Pompée allait allumer
une guerre sanglante, désastreuse, et je jugeai, j'en atteste les Dieux,
que mon devoir d'homme et de citoyen était de braver tous les supplices,
plutôt que d'être, à aucun degré, promoteur ou seulement agent d'un
pareil dessein. Maintenant je trouve qu'il eût mieux valu mourir que de
me ranger avec le parti contraire. Pensez à tout cela, mon cher Atticus,
et repensez-y mille fois. Toute solution est préférable au tourment
d'esprit que j'endure.
CÉSAR, IMPÉRATOR, A
CICÉRON, IMPÉRATOR, SALUT.
J'ai à peine
entrevu Furuius, et je n'ai le loisir ni de lui parler ni de l'entendre.
Le temps me presse. Nous sommes en maiche, et les légions ont pris les
devants. Je ne veux pourtant pas laisser partir Furnius sans vous
envoyer un mot de gratitude. Combien ne vous dois-je pas ! et combien,
j'en suis sur, ne vous devrai-je pas encore? vous faites tant pour moi !
Ce que je vous demande surtout, c'est de vous rendre à Rome. J'y serai
bientôt, j'espère. Puissé-je vous y voir, et profiter de vos lumières,
de votre crédit, de votre position, de tout ce que vous pouvez enfin !
Je finis comme j'ai commencé ; le temps me presse. Pardonnez-moi donc si
je ne vous écris qu'un mot : Furnius vous dira le reste.
354. — A
ATTICUS. Formies, mars.
A. IX, 7. Je vous avais écrit sous
la date du 4 des ides, mais l'homme qui devait se charger de ma lettre
n'est point parti. Par compensation, le coureur dont m'avait parlé
Salvius est arrivé ce jour-la même, et il m'a remis de votre part une
dépêche bien nourrie. Elle m'a mis un peu de baume dans le sang. Je ne
puis me dire ressuscité, mais c'est quelque chose d'approchant. Je n'en
suis pas, comme vous le pensez bien, à compter sur un dénouement
heureux. Ces deux hommes vivant, l'un d'eux surtout, il n'est pas de
république possible. J'ai fait mon deuil de la tranquillité, et me
résigne à tout pour l’avenir. Ma crainte était de ne point me montrer,
ou plutôt de ne m'être point montre digne de moi. — Vous comprenez tout
ce que vos lettres m'ont fait de bien ; je ne parle pas seulement de la
plus longue ou tout est dit et admirablement dit. Je parle aussi de
cette petite lettre où j'ai trouvé ce que je désirais le plus au monde,
l'approbation
338
de mes intentions et de ma conduite par Pédiicéus. C'est un vrai bonheur
pour moi; car je sais à quel point il m'aime, et tout ce qu'il a de
rectitude dans l'esprit. Votre grande lettre a remis le cœur à tous les
miens, comme à moi-même. Je suivrai votre conseil ; je resterai à
Formies. Ainsi on ne m'accusera point de courir au-devant de lui; et si
nous ne nous voyons point, il ne pourra pas, de son côté, dire que je
l'évite. — Quant à obtenir son agrément pour observer à l'égard de
Pompée autant de ménagements que j'en ai gardé envers lui-même, vous
verrez par une lettre d’Oppius et de Balbus, dont je vous envoie copie,
que j'y travaille depuis longtemps. Je vous envoie également copie d'une
lettre que César leur a écrite; elle est aussi modérée qu'on pouvait
l'attendre, venant d'un homme dont l'ambition est sans mesure. Si César
me refuse, je dois, selon vous, m'entremettre pour négocier la paix. Je
ne recule pas devant les dangers de ce rôle. Lorsque des périls vous
environnent de toutes parts, comment ne se jetterait-on pas
préférablement du côté où il y a du moins de l'honneur à gagner? Mais je
crains d'embarrasser Pompée; je crains « son regard, plus terrible que
celui de Méduse. » Vous n'imaginez pas à quel point notre cher Cnéius
tient à être un second Sylla. J'en parle savamment; il ne s'en est
d'ailleurs jamais beaucoup caché. Eh quoi! direz-vous, vous le savez, et
vous restez ce que vous êtes ! J'agis non par sympathie, sachez-le bien,
mais par reconnaissance, comme pour Milon, comme pour .... Il suffit
d'en citer un. Vous ne trouvez donc pas cette cause bonne? allez-vous
dire encore. Excellente, au contraire. Mais souvenez-vous qu'on la
soutiendra par les moyens les plus mauvais. Leur dessein est d'abord
d'affamer Rome et l'Italie; puis de dévaster et de brûler tout. Et ils
ne se feront pas un .scrupule de dépouiller les riches. Le parti
contraire en fera tout autant ; et si, par gratitude, je n'étais pas
engagé d'un côté, j'aimerais mieux attendre chez moi le pis qu'on puisse
faire. Mais j'ai de telles obligations à Pompée, que je ne puis
supporter l'idée d'ingratitude. Ce n'est pas que vos raisons contre ce
scrupule ne me paraissent très- fondées. — Je suis de votre avis sur mon
triomphe; je le laisse de côté sans peine et sans regret. Ce serait
admirable sans doute, si nous pouvions insensiblement gagner le moment
ou la navigation s'ouvrira; pourvu, dites-vous, qu'il ait pris un peu de
consistance ! Il en a plus que nous ne croyons ; là-dessus, ne vous
mettez pas en peine. Je vous réponds que s'il en a la puissance, il ne
laissera pas en Italie pierre sur pierre. Et vous voulez vous associer à
lui, allez-vous vous écrier encore ! J'agis contre ma pensée, je vous le
répète, et contre tous les enseignements de l'histoire. D'ailleurs, si
je veux m'en aller, c'est beaucoup moins pour aider un parti dans ses
violences, que pour ne pas être témoin des violences de l'autre. Ne
croyez pas en effet qu'on s'arrête en chemin, et qu'on ne nous en fasse
pas voir de toutes les façons. Ne les connaissez-vous pas aussi bien que
moi? Ne savez-vous point qu'il n'y a plus de loi, plus de magistrats,
plus de justice, plus de sénat, et que les fortunes particulières et la
fortune publique ne suffiront point aux débauches, aux extravagances,
aux profusions et aux besoins de tant de misérables qui manquent de
tout? Donc, à tout prix, je veux m'embarquer, si tel est toutefois votre
avis. Sortons donc de ces lieux
339
et partons, n'importe par quelle mer! par où il vous plaira pourtant.
Mais partons; rien ne peut plus me retenir. Vous n'attendez que les
nouvelles de Brindes, et nous allons les avoir. — Jusqu'à présent,
dites-vous, les gens de bien approuvent ma conduite, et ils savent que
je ne suis pas parti. Tant mieux! si toutefois un pareil mot est de mise
aujourd'hui. Je chercherai de nouveau à savoir ou est Lentulus ; j'en ai
chargé Philotimus, homme de tête , et qui n'est que trop exalté
dans le bon parti. —Je ne terminerai pas cette lettre sans vous dire
combien je crains que vous ne trouviez plus matière à m'écrire. Peut-on
parler d'autre chose que des affaires publiques? Et qu'auriez-vous à
ajouter à ce que vous m'avez dit? mais vous avez assez d'esprit (je
parle comme je pense) pour suppléer à tout; et l'amitié, qui chez moi
sait si bien m'ouvrir l'esprit, l'amitié vous viendra aussi en aide.
Encore des lettres donc, je vous prie, et le plus que vous pourrez. Je
vous en veux de ce que vous ne m'invitez pas en Épire, moi qui ne suis
pas pourtant un trop mauvais compagnon. Mais bonsoir. Vous avez à vous
promener et à vous faire frotter ; et moi j'ai besoin de dormir. Je
devrai à vos lettres une nuit de bon sommeil.
BALBUS ET OPPIUS A M. CICÉRON,
SALUT.
Dans quelque
position qu'on se trouve, soit humble et obscure comme la nôtre, soit
haute et considérable, on doit s'attendre à voir juger par l'événement
et non par l'intention les conseils que l'on donne. Cependant votre
bonté nous encourage, et nous allons vous dire quel est, selon nous, le
vrai point de vue des choses au sujet de ce que vous nous écrivez. Dans
le cas où nous nous tromperions, ce sera de bonne foi et dans toute la
candeur de notre âme. Si César ne faisait point ce que dans notre
opinion il doit faire ; si son premier soin, en arrivant à Rome, n’était
point de travailler à une conciliation entre lui et Pompée; si nous ne
savions pas enfin de lui-même que telle est son intention, nous ne vous
appellerions pas à Rome, où le rôle de médiateur sera pour vous plus
honorable et plus facile que pour qui que ce soit, étant comme vous
l'êtes lié avec l'un et avec l'autre. Si nous supposions à César
d'autres intentions et la pensée de faire la guerre à Pompée, de même
que nous vous avons supplié de ne pas vous armer contre César, de même
nous n'irions pas vous conseiller la guerre contre un homme à qui vous
devez tant. Enfin, si nous ne parlions de César que par conjecture, au
lieu d'en parler de science certaine, nous vous dirions encore qu'ami de
tous les deux, il est de voire honneur et de votre loyauté de vous
abstenir. Or cette neutralité, nous ne doutons point que le généreux
cœur de César ne vous en tienne un très grand compte. Si même vous le
jugez à propos, nous lui demanderons de s'expliquer lui-même à cet
égard, et, sur sa réponse, nous vous dirons quelle est notre impression.
Nous vous engageons notre foi que vous n'aurez de nous que des conseils
inspirés par le soin de votre honneur, plutôt que par les intérêts de
César. Telle est son amitié pour nous, que nous comptons absolument sur
son approbation.
BALBUS A CICÉRON, IMPERATOR,
SALUT.
Si vous vous
portez bien, je m'en réjouis. Après vous avoir écrit en commun, Oppius
et moi, j'ai
340
reçu une lettre de César dont je vous envoie copie; vous y pourrez, voir
combien il souhaite la paix et un rapprochement avec Pompée, et combien
son cœur est éloigné de toute pensée violente. Je suis heureux, autant
que je le dois, de le voir dans ces dispositions. Quant à vous, mon cher
Cicéron, sur vous, sur vos engagements, sur vos affections, je ne pense
pas autrement que vous-même. L'honneur et le devoir vous défendent de
porter les armes contre un homme dont vous êtes l'obligé. Je connais
César, et il m'est démontré qu'il ne vous en blâmera podiez votre toge et que vous me serviez à Rome, comme
vous les servirez d'ailleurs eux-mêmes s'ils le veulent. Et maintenant
en effet je suis occupé à Rome de toutes les affaires de Lentulus, que
seul je dirige. J'acquitte ainsi envers lui et en même temps envers
Pompée ma dette de gratitude et de dévouement. Après tout, il me semble
qu'on ne doit pas absolument désespérer d'un accord, puisque César est
dans les dispositions que nous pouvons le plus souhaiter. Je verrais
avec satisfaction qu'il vous parût a propos de lui écrire pour lui
demander son appui, comme vous demandâtes avec tant de raison, selon
moi, l'appui de Pompée dans l'affaire de Milon. Ou je connais bien mal
César, ou je me porte fort que, pour vous répondre, il consultera
beaucoup moins son intérêt que votre position personnelle. —Je ne sais
point si toutes ces observations vous paraîtront justes; ce que je sais,
c'est qu'il n'en est aucune qui ne me soit inspirée par une vive
affection et par un dévouement véritable. Je vous place si haut dans ma
pensée, (je vous le jure sur la tête de César) qu'il est bien peu de
personnes au monde qui me soient aussi chères que vous. Aussitôt que
vous aurez pris votre parti, soyez assez bon pour me l'écrire. Ce ne
m'est pas chose indifférente que vous restiez bien avec l'un et avec
l'autre. C'est votre désir à vous-même, et je n'ai pas le moindre doute,
je vous assure, que vous n'y réussissiez. Ayez soin de votre santé.
CÉSAR A
OPPIUS ET BALBUS.
C'est, je vous
jure, avec un plaisir bien vif que je trouve dans votre lettre
l'approbation de ce qui s'est passé à Corfinium. Je suivrai vos
conseils, et il m'en coûtera d'autant moins qu'ils sont d'accord avec
mes propres déterminations. Oui, j'userai de douceur et je ferai tout
pour ramener Pompée. Tentons ce moyen de gagner les cœurs et de
consolider la victoire. La terreur n'a réussi qu'a faire détester mes
devanciers, et n'a soutenu personne. Sylla fait exception, mais je ne le
prendrai jamais pour modèle. Cherchons la victoire par d'antres voies,
et prenons désormais pour appuis les bienfaits et la clémence. Mais
comment procéder? J'ai quelques idées en tête, il peut m'en venir
encore. Tournez aussi vos méditations de ce côté. — Cn. Magius, préfet
de Pompée, a été surpris par mes troupes. Fidèle à ma résolu-
341
tion, je l'ai renvoyé sur-le-champ. Déjà deux autres préfets des
ouvriers de Pompée étaient tombés en mon pouvoir, et je les avais
renvoyés de même. Si de tels procédés les touchent, leur devoir est de
faire comprendre à Pompée que mon amitié vaut mieux pour lui que son
alliance avec des hommes qui, au fond, ont toujours été ses ennemis et
les miens, et dont les intrigues ont mis la république dans le triste
état où nous la voyons.
355. — A ATTICUS, Formies, mars.
A. IX, 8. Je suis à souper
aujourd'hui, veille des ides, et il est nuit, lorsque Statius me remet
votre petite lettre. Je vous réponds d'abord non seulement sur L.
Torquatus, mais encore sur Aulus; ils sont partis l'un et l'autre, le
premier depuis plusieurs jours. J'apprends avec peine ce que vous me
rapportez des réunions de Réate, et de tous ces permes de proscription
pour le pays des Sabins. Oui, on m'avait annoncé déjà que beaucoup de
sénateurs étaient revenus à Rome. Quelqu'un pourrait-il médire pourquoi
ils en sont sortis? — L'opinion générale ici est que César sera à
Formies le 11 des kalendes d'avril. Ce n'est guère au surplus qu'une
conjecture. On n'a ni courriers ni lettres. Je voudrais bien avoir
auprès de moi cette Minerve d'Homère, sous les traits de Mentor. Je lui
dirais : « Mentor, quel maintien avoir à son approche et quel accueil
lui faire? » — Je ne me suis jamais trouvé en si grand embarras : du
moins j'y suis préparé ; et, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose de
n'être pas pris au dépourvu. Soignez-vous bien, car je pense que c'était
hier votre jour de fièvre.
356. — A
ATTICUS. Formies, 17 mars.
A. IX, 9. J'ai reçu, le lendemain
des ides, trois de vos lettres, qui sont du 4, du 3, et de la veille des
ides; j'y vais répondre suivant l'ordre de leur date. Je crois, comme
vous, que ce que j'aide mieux à faire c'est de demeurer à Formies ; et
de ne me point embarquer sur la mer Adriatique. Je m'y prendrai, comme
je vous l'ai déjà dit, de telle façon avec César, qu'il trouvera bon que
je ne me mêle point des affaires du gouvernement. Vous me louez de ma
disposition à oublier les fautes de notre ami : oui, je les oublie, et
je veux même oublier, de plus, tous les sujets de plaintes qu'il m'a pu
donner; tant il est vrai que je suis plus sensible aux bienfaits qu'aux
injures. Faisons donc comme vous le dites, et tâchons de nous remettre
bien avec nous-mêmes. C'est à quoi je pense dans mes promenades, et tout
en cheminant je m'exerce sur les questions que je vous ai proposées;
mais il y en a quelques-unes bien difficiles à décider. Je veux croire
ce que vous me mandez de nos gens de bien, mais vous savez le proverbe:
Denys a Corinthe. Le fils de Titinius est avec César, il semble que vous
appréhendez de me donner des conseils qui ne me plaisent pas; rien au
contraire ne me fait plus de plaisir que vos lettres ou vous me dites ce
que vous pensez. Continuez donc, je vous prie, comme vous me le
promettez, et écrivez-moi tout ce qui vous viendra dans l'esprit; encore
une fois, rien ne peut m'être plus agréable. — Venons maintenant à votre
seconde lettre. Vous avez raison de ne pas croire que Pompée ait emmené
tant de soldats; Clodia s'était trompé de moitié. Il n'est pas vrai non
plus qu'on ait détruit ce qui restait de vaisseaux dans le port. Vous
louez les consuls; j'approuve leur bonne intention, mais je blâme
342
le parti qu'ils ont pris. En se séparant de Pompée, ils ont coupé court
a toutes les propositions de paix. Ainsi je ne pense plus à l’ouvrage
que je méditais, et je vous renvoie par Philotimus le traité de
Démétrius sur l'union des citoyens. Je ne doute plus que nous soyons
menacés d'une guerre funeste, que Pompée commencera en affamant l'Italie
; et je suis fâché néanmoins de n'être rien dans cette mêlée fratricide.
En effet, si c'est un crime de laisser dans le besoin ses vieux parents,
quel nom donner à ces fureurs de nos chefs, qui vont faire périr par la
faim la patrie elle-même, la plus vénérable et la plus sacrée des mères?
Ce n'est pas seulement mon imagination qui s'en épouvante ; j'ai tout
entendu de mes oreilles. Ces vaisseaux qu'on rassemble de tous côtés,
d'Alexandrie, de la Colchide, de Tyr, de Sidon, d'Arade, de Cypre, de la
Pamphylie, de la Lycie, de Rhodes, de Chio, de Byzance, de Lesbos, de
Smyrne, de Milet, de Cos, c'est pour intercepter les convois destinés à
l'Italie, et pour envahir toutes ces provinces nourricières de Rome.
Mais quelle sera la colère du chef, surtout contre ceux qui avaient le
plus à cœur de sauver l'Italie, comme s'il avait été abandonné par ceux
qu'il a abandonnés lui-même ! Aussi, lorsque je délibère sur le parti
que j'ai à prendre, je ne me sens vraiment entraîné que par mon
attachement pour Pompée ; sans cela, j'aimerais mieux mourir dans le
sein de ma patrie, que de la détruire sous prétexte de la sauver. Pour
le vent du nord, rien n'est plus sûr. Je crains, comme vous, pour
l'Épire; mais quelle province de la Grèce sera à l'abri des ravages? Il
promet hautement lui-même à ses soldats, il leur montre déjà des
largesses plus grandes que celles de César. Vous me conseillez fort bien
de ne point mollir dans mon entrevue avec ce dernier, et de lui parler
avec vigueur. Oui, je le ferai. Je n'irai à Arpinum qu'après que je
l'aurai vu, de peur de ne me pas trouver ici lorsqu'il y passera, ou
d'être obligé, pour le joindre, de courir de côté et d'autre par de fort
mauvais chemins. J'ai ouï dire, comme vous le marquez, que Bibulus était
arrivé, et qu'il était reparti la veille des ides. — Vous me dites, dans
votre troisième lettre, que vous attendez Philotimus, mais il n'est
parti d'ici que le jour des ides, et c'est pour cela que vous n'avez pas
reçu plus tôt ma réponse à la lettre qu'il m'avait apportée, quoique je
l'eusse faite sur-le-champ. Je crois, comme vous, que Domitius est
auprès de Cosa; mais on ignore ses projets. Et que pensez-vous d'un
certain homme de cet infâme qui prétend qu'un préteur peut tenir les
comices consulaires? c'est bien la le mauvais citoyen que nous avons
connu. Je vois bien maintenant l'intention de César, lorsqu'il me dit,
dans la lettre dont je vous ai envoyé une copie, qu'il a besoin de mes
conseils : passe encore pour cela, de mon crédit, il y a de quoi en
effet! mais il veut peut-être m'insinuer que je pourrais bien lui gagner
quelques voix de sénateurs : de mon autorité; un consulaire lui paraît,
sans doute, quelque chose; enfin, de tout mon pouvoir. J'ai commencé par
soupçonner à la lecture de votre lettre que c'était cela, ou quelque
chose de fort approchant, qu'il avait en vue. Il est très important pour
lui qu'il n'y ait point d'interrègne, et il n'y en aura pas, si un
préteur peut tenir les comices consulaires. Mais, dans nos livres
d'augures, nous trouvons qu'un préteur ne peut présider, ni à l'élection
des consuls, ni même à celle des préteurs, et qu'il n'y en a point
d'exemple : il ne peut présider à celle des consuls, parce qu'un
magistrat inférieur n'en peut
343
créer un supérieur, ni à celle des préteurs, parce que leur élection est
la même, quoique les consuls soient au-dessus d'eux. Vous verrez que
César pense bien un peu a se servir de moi pour faire décider que cela
se peut, et qu'il voudrait bien se passer de l'autorité de Galba, de
Scévola, de Cassius et d'Antoine.
Que la terre
plutôt s'entr'ouvre sous mes pas!
— Mais vous voyez
quel orage se prépaie. Lorsque je saurai au juste les noms et le nombre
des sénateurs qui ont passé la mer, je vous le manderai. Vous avez
raison de croire que Pompée ne pourra faire subsister son armée qu'en
levant des subsides extraordinaires; et vous jugez fort bien, par
l'avidité insatiable de ceux qui l'entourent, que cette guerre ne peut
être que désastreuse. Quoique Trébatius, à ce que vous me mandez,
n'espère rien de bon de tout cela, je ne laisse pas d'avoir fort envie
de le voir : pressez-le, je vous prie; je serais bien aise de
l'entretenir avant l'arrivée de César. Dès que je sus la mort de Phaméa,
je souhaitai, si nous devons encore avoir une république, que quelqu'un
de mes amis achetât sa maison de Lanuvium : cependant, quoique vous
soyez mon meilleur ami, je n'avais point du tout pensé à vous. Je savais
comment vous placiez votre argent, et j'avais vu à Rome et à Délos vos
livres de compte. Au reste, quoique cette maison soit très agréable, je
ne voudrais pas en donner maintenant ce que j'en offris sous le consulat
de Marcellinus. Comme elle était fort à ma convenance, à cause de celle
que j'avais alors à Antium, et que je croyais qu'il m'en coûterait moins
pour l'acheter que pour rebâtir celle de Tusculum, j'en offris cinq cent
mille sesterces à Phaméa, qui était à Antium pour la vendre : il refusa.
Mais tout cela est bien tombé, à cause de la rareté de l'argent. Si vous
l'achetiez, cela m'irait fort bien à moi, ou plutôt à nous deux. Et ne
comptez pas pour rien les folles dépenses qu'on y a faites; ces
embellissements l'ont rendue charmante. Mais, hélas I il me semble déjà
que toutes ces belles choses sont la proie de la destruction. Voilà ce
que j'avais à répondre à vos trois lettres; mais j'en attends d'autres :
c'a été jusqu'à présent ma seule consolation. Le jour des liberalia.
357. — A ATTICUS. Formies, mars.
A. IX,10. Je n'ai, à vrai dire, rien
à vous mander; j'ai répondu hier a toutes vos lettres, et il n'est venu
depuis aucune nouvelle : mais comme le chagrin, qui m'ôte le sommeil, ne
me laisse pas même veiller en repos, et que je n'ai de soulagement que
lorsque je m'entretiens avec vous, je vous écris sans savoir précisément
ce que je vais vous dire. — .le trouve que j'ai été aveugle dès le
commencement, et mon plus grand tourment c'est de me reprocher
aujourd'hui de n'avoir pas suivi partout Pompée, comme un soldat suit
son drapeau, quoiqu'il allât de chute en chute à sa perte dernière. Je
le vis le 14 des kalendes de février; la peur le tenait déjà, et de ce
jour je connus quel était sou dessein. Je n'en ai pas été plus content
depuis; il n'a fait qu'entasser fautes sur fautes; il ne m'écrivait
point, il ne pensait qu'à fuir. Que voulez- vous? Comme en amour les
femmes qui se négligent, qui n'ont ni grâce ni esprit, s'en vont bientôt
de notre cœur, ainsi la faiblesse de Pompée et la honte de sa fuite
m'avaient dégoûté de l'aimer. Il ne faisait rien qui
344
fût digne de lui ; pourquoi me serais-je mis à la suite d’un fuyard?
Maintenant l’amitié reprend le dessus, et je ne peux plus supporter
d'être loin de lui. Mes livres, mes éludes, ma philosophie ne me
soutiennent pins; je suis comme cet oiseau que vous savez; je regarde
unit et jour la mer; je voudrais m'envoler. Je suis puni, oui,
cruellement puni de mon imprudence; mais, après tout, qu'ai je à me
reprocher? qu'est-ce que j’ai fait sans d'excellentes raisons? S'il ne
s'était agi que de fuir avec Pompée, je m'y serais déterminé sans peine;
mais c'est cette guerre, qui sera plus cruelle qu'on ne pense, c'est
cette guerre que j'ai eu en horreur. Quelles menaces n'a-t-il pas faites
aux villes de l'Italie, à plusieurs gens de bien en particulier, et en
général à tous ceux qui ne le suivraient point? Combien de fois lui
est-il échappé de dire : Sylla a pu le faire, pourquoi ne le ferais-je
pas? Non, je ne puis bannir ces idées. Tarquin fut coupable d'avoir armé
contre sa patrie Porsenna et Octavius Mamilius. Coriolan fut impie de
s'être fait aider par les Volsques : honneur à Thémistocle, qui a mieux
aimé mourir ! On détestera toujours la mémoire d'Hippias, fils de
Pisistrate, qui fut tué à la bataille de Marathon en combattant contre
sa patrie. Mais Sylla, mais Marius, mais Cinna, n'ont rien fait de
semblable ; ils avaient même une apparence de droit; et pourtant quoi de
plus cruel que leur victoire? Quoi de plus funeste? Une telle guerre me
faisait reculer d'horreur, et d'autant plus qu'on prenait sous mes yeux
des résolutions et des mesures encore plus terribles. Moi, à qui on a
donné les titres saints de sauveur et de père de la patrie, j'amènerais
sous ses murs les Gètes, les Arméniens et la Colchide! Je viendrais
affamer Rome et ravager l'Italie! Je considérais que Pompée était un
homme sujet à la mort et pouvant périr de mille manières, tandis que
nous devions, autant qu'il était en nous, travailler au salut et à
l’immortalité de Rome et du peuple romain. J'avais bien quelque
espérance d'ailleurs qu'on s'accorderait, et que César ne pourrait se
résoudre à soutenir un pareil attentat, ni Pompée à suivre un si funeste
dessein. Les choses sont tout autres maintenant, et mon esprit aussi. Le
soleil, pour me servir de l'expression d'une de vos lettres, me paraît
s'être retiré du monde. Comme on dit qu'un malade n'est pas désespéré
tant qu'il a un souffle de vie, de même tant que Pompée a été en Italie,
j'ai eu quelque espérance de paix. Voilà, voilà ce qui m'a trompé; et
pour vous parler vrai, cet âge où la nature, après de si longs travaux,
se tourne vers le repos, m'a rendu plus chères, en m'affaiblissant, ces
douceurs du bonheur domestique. maintenant je suis résolu, quel que soit
le danger, à m'échapper d'ici. Peut-être l'aurais-je dû faire plus tôt;
mais j’ai été retenu par les raisons que je viens de vous dire, et
encore plus par vos conseils. — En ce même instant je me suis misa
relire vos lettres, que je tiens cachetées, et que j'enferme avec soin.
Voici ce que vous me dites dans celle du 1 des kalendes de février :
Voyons auparavant ce que fera Pompée, et où aboutiront ses dispositions.
S'il abandonne l’Italie il ne peut faire une plus grande faute, et une
faute plus déraisonnable : alors il nous faudra suivre un autre plan.
Vous m'écrivîtes cette lettre quatre jours après que nous fûmes sortis
de Rome. Dans une autre du même jour, vous décidez la chose absolument :
Je viens, dites vous, à votre question : Si Pompée
345
sort de l’Italie, je crois que vous ferez bien de revenir à Rome :
quelle apparence de le suivre jusqu'au bout du monde? J'ai bien retenu
cela, et je vois maintenant que cette fuite honteuse, que vous appelez
par adoucissement une retraite, sera suivie d'une guerre qui ne finira
point. C'est la prédiction que vous faites le 6 des kalendes de février
: Si Pompée demeure en Italie, et que les affaires ne s'arrangent point,
la guerre sera longue ; s'il passe la mer, nous n'en verrons pas la fin.
Faut-il donc que je participe, que j'aide, que je pousse à une guerre
éternelle, et contre des Romains? Informé ensuite du projet de Pompée,
voici comme vous finissiez une lettre du 7 des ides de février : Je ne
vous conseille point du tout de suivre Pompée, s'il sort d’Italie; ce
parti serait très dangereux pour vous, et inutile à la république; au
lieu qu'en demeurant, vous pourrez lu servir. Comment un bon citoyen, un
politique ne se rendrait pas au conseil d'un ami aussi sage que vous? Le
3 des ides de février, je reçois de vous cette autre réponse décisive :
Vous me demandez si vous devez maintenant fuir avec Pompée, ou si vous
ferez mieux d'attendre : pour moi, je crois que dans la conjoncture
présente vous ne devez rien précipiter, et qu'en partant si subitement
vous vous exposez sans lui être utile. Je trouve qu'il vaut mieux que
vous vous partagiez pour observer l'ennemi : mais en vérité il est
honteux de songer à fuir. Ce que vous trouvez si honteux, Pompée y avait
pensé il y a déjà deux ans; tant il ne rêve que Sylla et proscriptions.
Quelques jours après, comme j'avais cru voir, à travers quelques
propositions générales d'une de vos lettres, que vous m'engagiez à
quitter l'Italie, vous rejetez cela fort loin dans votre lettre du 11
des kalendes de mars. Je n'ai, dites-vous, prétendu nulle part vous
conseiller de suivre Pompée, s'il sort de l'Italie; ce serait, non pas
contradiction, mais démence. Et ailleurs, dans la même lettre : il ne
reste plus que de fuir avec Pompée; mais je ne suis point du tout de ce
sentiment, et je n'en ai jamais été. — Vous examinez cette question
encore plus à fond dans votre lettre du 12 des kalendes de mars : Si M.
Lépidus et L. Volcatius demeurent, faites comme eux. Cependant si Pompée
en réchappe, et s'il s'arrête enfin quelque part, vous ferez bien, de
quitter ce peuple des enfers qui est avec César : il vaut mieux mourir
avec celui-là, que de régner avec celui-ci au milieu du désordre qu'il
est aisé de prévoir. Vous développez cette idée, et vous concluez ainsi
: Si M'. Lépidus et Volcatius suivent Pompée? alors je doute. Mais je
croirai que le parti que vous aurez pris était le meilleur. Vous ne
pouvez plus douter, puisqu'ils sont restés en Italie. Le 5 des kalendes
de mars, Pompée étant déjà parti pour Brindes : Je ne doute point, me
dites-vous, que vous ne restiez à Formies, où vous pourrez, mieux que
partout ailleurs, voir la tournure que prendront les choses. Et aux
kalendes de mars. Pompée étant déjà à Brindes depuis cinq jours : Nous
pourrons alors nous déterminer; et si vous n'êtes pas entièrement libre
sur l'un ou l'autre parti, vous le serez toujours plus que si vous
précipitiez votre départ. Le 4 des nones de
346
mais, dans une autre lettre écrite un peu avant votre accès : Je vous
répondrai demain en détail; mais je vous dirai, en attendant, que je ne
me repens point de vous avoir conseillé de rester; et quoique
l'agitation où vous êtes soit un mal, comme il me parait que votre
départ en serait un plus grand, je ne change point d'avis, et je suis
bien aise que vous ne soyez point parti. Ensuite, comme j'étais fort
inquiet, comme je vous témoignais ma crainte de manquer à l'honneur,
vous me dites le 3 des nones de mars : Je ne suis point fâché néanmoins
que vous ne soyez pas avec Pompée : si dans la suite c'est un devoir,
vous pourrez aisément l'aller joindre, et il vous verra toujours avec
plaisir. Mais j'ajouterai que si César ne se dément point, et qu'il
montre toujours autant de droiture, de modération et de prudence, il
faudra alors considérer, avec une nouvelle attention, ce qui nous
conviendra le mieux. Le 7 des ides de mars, vous m'apprenez que Peducéus,
dont le jugement a tant de prix pour moi, trouve que j'ai bien fait de
rester. Je me console ainsi en lisant vos lettres, qui font que je me
trouve quant à présent parfaitement net. Défendez-vous, non pas pour
moi, mais pour les autres. Si je n'ai encore fait aucune faute, je
pourvoirai bien à l'avenir. Encouragez-moi de votre côté, et surtout
aidez-moi de vos conseils. On ne parle point encore ici du retour de
César. Quand cette lettre n'aurait servi qu'à me donner occasion de
relire les vôtres, c'est toujours beaucoup, et mon âme en est soulagée.
358. — A ATTICUS. Formies, mars.
A. IX, 11. Saviez-vous que Lentulus
est à Pouzzol? Nous le tenons d'un voyageur qui dit l'avoir rencontré
sur la voie Appia, et l'avoir reconnu dans un moment ou il
entrouvrait
sa litière. Tout en doutant du fait, j'ai chargé quelques-uns de mes
gens de s'informer de lui à Pouzzol, et de lui porter une lettre de ma
part. On l'a trouvé, non sans peine, caché au fond de sa maison de
campagne. Dans sa réponse, il se loue beaucoup des procédés de César, et
m'annonce avoir chargé C. Cecius de me communiquer ses résolutions. Je
l'attends aujourd'hui 13 des kalendes d'avril. Le jour de la fête de
Minerve, j'ai eu chez moi Matius, homme sage et modéré, à ce qu'il m'a
paru, et qui a toujours eu la réputation de pousser à la paix. Ah I que
j'ai bien vu qu'il est loin d'approuver ce qui se passe, et de ne rien
craindre de la bande infernale, comme vous l'appelez ! Nous avons
beaucoup causé, et je lui ai montré la lettre de César dont je vous ai
envoyé copie, et ou il exprime le désir de « profiter de mes lumières,
de mon crédit et de mon influence, de tout ce que je puis enfin. »
Matius ne doute pas qu'il n'entende par là user de mon intervention pour
amener un accommodement. Que ne puis-je en effet accepter efficacement
un rôle pacifique dans cette crise funeste ! Matius croit fermement que
c'est la pensée de César, et se fait fort d'en ouvrir l'avis. — Le jour
d'avant j'avais vu Crassipès, qui me dit avoir quitté Brindes la veille
des nones de mars. Pompée y étant encore. Même rapport m'a été fait par
des gens qui n'en sont partis que le 8 des ides : ils s'accordent tous à
dire, et Crassipès avec eux, que la bas ce ne sont qu'imprécations, que
menaces de haine aux riches, de guerre aux municipes, (admirez leur
prudence ! ) que
347
proscriptions en masse. Ce ne sont que Syllas! Et il faut voir le ton de
Luccéius, et tout ce cortège de Grecs, et ce Théophane! Voilà pourtant
l'espoir de In république. C’est à n'y pas tenir; aussi n'ai-je pas un
moment tranquille. Pour fuir tout contact avec ces fléaux, j'irais
chercher les gens qui me ressemblent le moins. Un Scipion, un Faustus,
un Libon, avec leurs assemblées de créanciers sur les bras! De quelles
énormités ces gens-là ne seront-ils pas capables? Quels excès contre
leurs concitoyens se refuseront de pareils vainqueurs? Mais
n'admirez-vous pas les immenses vues de Pompée? Le voilà, dit-on, qui
songe à l'Égypte, à l'Arabie heureuse, à la Mésopotamie. Et l’Espagne
serait mise de côté, tout ce qu'il y a de plus incroyable! Mais on
invente peut-être. Ce qui est certain, c'est que d'un côté on ne
travaille guère à sauver la république, et que de l'autre on sait fort
bien comment la perdre ! J'attends une lettre de vous avec impatience.
Depuis notre fuite, mes réponses se succèdent sans intervalle. Voici la
copie de ma lettre à César, j'en attends quelque chose.
CICÉRON,
IMPERATOR, A CÉSAR, IMPERATOR, SALUT.
J'ai lu la lettre
dont vous avez chargé pour moi Furnius, et où vous m'engagez a revenir à
Rome. Vous parlez de profiter de mes lumières et de ma position.
Jusque-là rien qui m'étonne. Mais vous ajoutez : de mon crédit et de
tout ce que je puis, et je me demande quel sens vous attachez a ces
paroles. Naturellement je penche a croire que votre haute sagesse ne
peut vous inspirer que des pensées de paix, de bien-être et de concorde
pour vos concitoyens. Je suis dès lors l'homme qu'il vous faut, et par
position et par nature. Si donc mon pressentiment ne m'abuse point, et
si vous éprouvez quelque bienveillance pour Pompée, quelque désir de le
voir revenir à vous et à la république, vous ne trouverez nulle part un
meilleur agent que moi, qui n'ai jamais donné que des conseils de paix à
Pompée à toutes les époques, au sénat aussitôt que je l'ai pu; que moi,
qui, la guerre venue, n'y ai pris aucune part active, et l'ai toujours
considérée au contraire comme une brèche faite par la haine et l'envie
au privilège que vous avait conféré le peuple romain. Et je ne me suis
pas borné à une simple manifestation de mon opinion sur ce point, je me
suis appliqué à la faire partager aux autres. Mais de même aujourd'hui,
je ne puis voir avec indifférence l'abaissement de Pompée. Car, depuis
quelques années, j'ai fait de vous et de lui mes idoles, et je vous ai
voué à lui, à vous, à tous deux une amitié si profonde. — Je vous en
prie donc, je vous en conjure même à genoux, dérobez un moment aux
graves soins qui vous occupent, et avisez à ce qu'il me soit permis de
me montrer loyal, reconnaissant, fidèle, enfin au souvenir des plus
grands services qu'homme ait jamais reçus. qu'il avait
348
fait pour moi. Mais depuis la lettre qu’il m'a écrite dans l’effusion de
sa gratitude, il me semble que je partage avec lui le bienfait. Si telle
est ma reconnaissance pour ce qui touche Lentulus, faites, je vous en
supplie, que je puisse vous en avoir une égale au sujet de Pompée.
359. — A ATTICUS. Formies, mars.
A. IX, 12. 1ere part. Au moment où
je lisais votre lettre du 13 des kalendes, j'en ai reçu une de Lepta par
laquelle j'apprends que Pompée est cerné, que le port est fermé avec des
radeaux. Les larmes m'offusquent et m'empêchent d'écrire. Je vous envoie
une copie de sa lettre. Malheureux que nous sommes! pourquoi
n'avons-nous pas tous partagé son sort? Voici Matius et Trébatius qui me
confirment ces nouvelles. Les courriers de César les ont rencontrés à
Minturne. Ce que je souffre est affreux, et j'envie le sort de Mucius.
Ah! combien vos conseils sont nobles et sûrs! quelle pénétration !
itinéraire par terre, traversée par mer, entrevue avec César, tout y est
tracé jusqu'au langage à lui tenir, et la dignité ménagée autant que la
prudence. Et l'offre de votre maison d'Épire, qu'elle est obligeante,
généreuse, fraternelle ! — Le trait de Dionysius me confond ; un homme
mieux traité chez moi que Panetius chez Scipion, et qui me traite aussi
indignement dans mon infortune! C'en est fait; je ne lui pardonnerai
jamais. Que ne puis-je me venger! Mais je lui laisse à lui-même le soin
de ma vengeance. — C'est maintenant surtout, mon cher Atticus, qu'il
faut réfléchir sur ce que j'ai à faire. Une armée romaine assiège
Pompée. Une ligne de retranchements l'étreint de toutes parts. La fuite
est impossible. Et nous vivons ! et Rome est debout! les préteurs ont
leurs audiences ; les édiles préparent des jeux ; les gens de bien
placent leur argent, et moi-même je me croise les bras ! Tenterai-je un
coup de désespoir pour percer jusqu'à lui ? irai-je soulever en sa
faveur les villes municipales? Les bons me laisseront faire; les
indifférents se moqueront de moi et les factieux aujourd'hui vainqueurs
et qui ont la force en main, ne reculeront devant aucune violence. —
Voyons; un avis, un conseil. Quel moyen d'en finir de cette condition
misérable? Ce qui me désole en ce moment, ce qui me met au supplice,
c'est de m'entendre louer comme sage, comme bien inspiré de n'avoir pas
été le rejoindre. Je dis, moi, tout le contraire; je n'ai jamais
souhaité d'avoir part à sa victoire, mais je donnerais tout pour
m'associer à son désastre. Maintenant à quoi bon vous prier de m'écrire,
vous demander des conseils, solliciter votre bonté? Tout est fini. En
quoi peut-on m’aider? que désirer même, si ce n'est qu'un ennemi ait
pitié de moi et m'achève?
360. — A
ATTICUS. Formies, mars.
A. IX, 12 2eme part, et 13. C'était
une fausse nouvelle, je le crois, que la fermeture du port de Brindes.
Car comment Dolabella m'écrirait-il de Brindes, le 3 des ides de mars,
et comme un bonheur de César, que Pompée est au moment de fuir et
n'attend qu'un bon vent pour s'embarquer? Cela ne s'accorde guère avec
les lettres dont je vous ai envoyé copie. Ici on ne raconte que des
choses abominables; heureusement que sur le fait en question, personne
ne peut avoir des détails plus sûrs et plus récents que Dolabella. —
J'ai reçu votre lettre du 11 des kalen-
349
des. Vous ne pouvez, dites- vous, me donner aucun conseil avant de
connaître ce qui s'est passé; c'est juste; impossible de prendre un
parti d'ici là, et même d'y songer. Cependant cette dernière lettre de
Dolabella me ramène malgré moi à mes anciens projets; car enfin, la
veille des quinquatrides, le temps a été superbe, et je ne doute pas que
Pompée n'en ait profité. — Ce n'est pas pour me plaindre que j'ai
rapproché divers passages de vos lettres, c'est pour y trouver des
consolations. Je souffre moins des maux présents que de la crainte
d'avoir failli et agi d'une manière inconsidérée. Or, je me rassure en
voyant ma conduite d'accord avec toutes vos observations. Si je n'avais
pas tant parlé, me dites-vous, de ce que je dois a Pompée, je serais
beaucoup moins engagé envers lui, c'est vrai. Je n'ai fait sonner si
haut, trop haut même ses services, que pour l'empêcher de croire que ses
torts passés eussent laissé un levain dans mon esprit. Ces torts, je ne
les aurais pas oubliés, que je ne devrais pas moins m'en souvenir
aujourd'hui que de ses derniers procédés. Il a commencé par me refuser
son appui quand il pouvait m'être utile ; mais il est devenu ensuite mon
ami, et mon ami très chaud. Pourquoi'? je l'ignore. Quoi qu'il en soit,
je dois me montrer son ami, à mon tour. De plus, il y a ce rapprochement
entre nous, que nous avons été lui et moi trompés par les mêmes
individus. Ah ! que ne suis-je en position de faire pour lui tout ce
qu'il aurait pu faire pour moi ! Ce qu'il a fait toutefois est gravé
dans mon cœur ; et moi, je ne sais en quoi lui être utile. Quand j'en
aurais eu les moyens, je me serais fait scrupule de lui prêter mon appui
pour ses affreux projets de guerre; mais je ne veux pas lui faire
l'affront de rester ici. Aussi bien je ne saurais voir plus longtemps
tout ce qui se passe sous mes yeux, et vous ne savez que trop où l'on
nous mené. Si j'ai toujours attendu, c'est qu'on a de la peine à se
condamner volontairement à un exil sans retour; car je ne me fais aucune
illusion : César a de l'infanterie, de la cavalerie, des vaisseaux, des
auxiliaires gaulois dont Matius exagère sans doute l'importance. J'ai la
certitude qu'il a parlé de dix mille fantassins et de six mille chevaux
que la province a offert d’entretenir à ses frais pendant dix ans. Qu'il
y ait la de l'exagération. César n'eu a pas moins une armée nombreuse;
et il ne se contentera point, comme l'autre, de contributions de guerre,
il prendra les biens des citoyens. Mettez déplus dans la balance, son
caractère qui ne doute jamais du succès, et l'imbécile mollesse des gens
de bien qui n'ont pris ce terrible jeu en haine que parce qu'ils savent
Pompée justement irrité contre eux. Mais, je vous en prie, quel est donc
celui qui l'a, dites-vous, déclaré tout haut? Ce qu'il y a de certain,
c'est que, comme l'un avait donné a craindre plus de mal qu'il n'en
fait, on se sent porte pour lui, et que l'autre, au contraire, perd
chaque jour de ses partisans. Les villes municipales et les gens de la
campagne le redoutent, et sont favorables à son adversaire. Enfin César
est si puissant que fût-on capable de lui résister, on ne serait pas en
état de l'abattre. Pour moi, je ne crains pas tant ses séductions que ce
qu'elles peuvent cacher de disgrâces. Vous savez ce que Platon dit des
prières d'un tyran, qu'il faut presque toujours les prendre pour des
ordres. Vous n'êtes donc pas d'avis de cette retraite qui ne me
laisserait aucune communication avec la mer. J'y répugnais aussi
moi-même ; mais j'y serai bien caché entouré de gens
350
sûrs. Je préférerais Brindes avec les mêmes avantages; mais comment y
rester en secret? Attendons, au surplus, les événements. Quant aux gens
de bien, je ne veux pas par trop me mettre en peine de ce qu'ils peuvent
dire. Sextus me parle de leurs soupers. Quelles descriptions et quelle
chère ! quelle recherche! Gens de bien tant qu'on voudra, je le suis
plus qu’eux. Qu'ils aient un peu plus de cœur, et je m'inquiéterai
davantage de leur opinion. Je me suis trompé sur la maison de Phaméas.
Je me figurais celle qui est près de Troie, dont j'ai offert cinq cent
mille sesterces. Celle-ci vaut plus. Je voudrais vous voir cette
propriété; mais y a-t-il quelque chose dont on puisse jouir? Jugez par
la note que je fais joindre à ma lettre quelles effroyables choses nous
apprenons tous les jours. Lentulus, à ce que dit Cécius, est toujours à
Pouzzol, en proie à un chagrin profond et ne sachant que faire. Il
craint un second Corflnium. Il croit avoir assez fait pour Pompée, et
les bons procédés de César le touchent ; ce qui le touche davantage,
c'est la position, qu'il juge parfaitement. Eh bien ! qu'en dites-vous?
Au milieu de nos maux, n'est-ce pas là le pire de tous? Pompée a envoyé
M. Magius pour traiter de la paix, et pendant ce fait, ou l'assiège. Je
ne voulais pas le croire ; mais j'ai des lettres par l'entremise de
Balbus, et je vous en envoie copie. Lisez, lisez I et voyez surtout le
dernier paragraphe de celle de Balbus, de cet honnête Balbus à qui notre
Pompée a fait cadeau d'une terre pour y bâtir une villa, et à qui il a
cent fois donné la préférence sur nous autres tous tant que nous sommes.
Le pauvre homme ! comme il se tourmente ! mais je ne veux pas transcrire
deux fois sa lettre et je vous y renvoie. Je ne vois plus le moindre
jour à la paix. J'ai une lettre de Dolabella, des ides de mars, qui est
tout a la guerre. Persistons donc dans ma misérable et désespérée
résolution, car il n'y a rien de plus misérable que de rester ici.
BALBUS A CICÉRON, IMPERATOR,
SALUT.
« J'ai reçu de
César une toute petite lettre que je transcris ici. A en juger par son
laconisme, il faut que son temps soit bien pris pour qu'il n'écrive que
deux mots sur des choses de cette importance. Vous saurez à l'instant
tout ce qui surviendrait de nouveau. »
DE CÉSAR A OPPIUS ET A
CORNELIUS BALBUS.
« Je suis arrivé
devant Brindes, à la pointe du jour, le 7 des ides de mars, et j'ai fait
mes dispositions. Pompée est dans la ville. Il m'a envoyé Cn. Magius
pour traiter de la paix. J'ai fait la réponse convenable a ses
ouvertures. Je ne perds pas un moment pour vous en faire part. Dès que
j'aurai l'espoir d'un arrangement définitif, vous le saurez. »
Maintenant, mon cher Cicéron, vous faites-vous une idée de mes
angoisses, à moi que, pour la seconde fois, on flatte de la paix et qui
tremble qu'il ne vienne quelque incident à la traverse? De loin, on n'a
que des vœux à faire, et j'en fais de bien vifs. Si j'étais avec eux,
peut-être pourrais-je pousser utilement à la roue. Maintenant l'attente
me met au supplice.
361 . —
A ATTICUS. Formies, mars.
A. IX, 14. Le 9 des kalendes, je
vous ai envoyé copie d'une lettre de Balbus et d'une autre qu'il avait
reçue de César. Le même jour je reçus pour vous de Capoue une lettre de
Q. Pédius. César lui avait écrit, la veille des ides de mars, ce qui 351
suit : « Pompée lient toujours dans Brindes. Je suis campé devant la
place. J'entreprends un travail important; il sera long;, parce que la
mer est profonde ; mais je crois que c'est ce qu'il y a de mieux, à
faire. Je jette une digue d'une des pointes du port à l'autre. Par là,
je force Pompée à s'embarquer lui et ses troupes, ou je lui ferme le
passage. » Eh bien ! où sont ces espérances de paix dont se préoccupait
si fort Balbus? Que ce langage est cruel et impitoyable ! On affirme
même l'avoir entendu dire qu'il vient venger C. Carbon, M. Brutus et
toutes les victimes des cruautés de Sylla dont Pompée fut le ministre ;
que Curion agit par ses ordres, comme Pompée agissait sous Sylla, si ce
n'est que Pompée avait ses vues ; qu'il ne rappelle de l'exil que ceux
qu'on y a condamnés contrairement aux anciennes lois de Rome; qu'il n'y
avait pas, au contraire, un seul banni rappelé par Sylla qui ne fût
traître à la patrie. Il se plaint de la violence employée contre Milon
et déclare que, pour lui, il n'y a d'ennemis que ceux qui ont les armes
à la main. Ces propos sont démentis par un homme envoyé en mission par
Curion, le 3 des ides; un certain Bébius, assez beau parleur, mais
sortant on ne sait d'où. Je suis dans l'incertitude sur ce que je dois
faire. Pompée a sans doute quitté Brindes en ce moment : je le saurai
dans deux jours d'une manière positive. Point de lettre de vous, pas un
mot même par Anteros. Apres tout, je n'en suis pas surpris. Que
pouvons-nous avoir à nous dire ? Cependant je ne veux pas, moi, laisser
passer un jour sans vous donner de mes nouvelles. Ma lettre écrite, je
reçois avant le jour une lettre de Lepta; il me mande de Capoue que
Pompée s'est embarqué à Brindes, le jour des ides de Mars, et que César
sera à Capoue le 7 des kalendes d'avril.
362. — A
ATTICUS. Formies, mars.
A. IX, 15. Je vous ai mandé que
César serait à Capoue le 7 des kalendes. On m'écrit depuis qu'il
couchera le .5 chez Curion, près d'Albe. Dès que je l'aurai vu, je gagne
Arpinum. S'il m'accorde ce que je demande, c'est bien ; si non, je
saurai prendre mon parti. Il m'écrit qu'il fait occuper les villes de
Brindes, de Tarente et de Siponte, chacune par une légion, pour nous
fermer la mer apparemment. Du reste, je le crois disposé à passer en
Grèce plutôt qu'en Espagne. Mais nous n'en sommes pas là ; c'est
l'entrevue qui m'inquiète. L'instant approche. Par où va-t-il débuter?
J'en frissonne. Il va vouloir un sénatus-consulte, une décision
augurale. Il faudra donc aller à Rome, ou bien gare les mesures contre
les absents! Il fera déclarer qu'un préteur peut présider l'élection des
consuls et nommer un dictateur. Illégalité dans les deux cas. Mais Sylla
a bien pu se faire nommer dictateur pendant un interrègne. Qui empêche
César de l'imiter? Ce que je vois là de plus clair c'est l'alternative
pour moi d'être traité par celui-ci à la Q. Mucius et par l'autre à la
L. Scipion. Quand vous lirez ceci peut-être notre rencontre aura-t-elle
déjà eu lieu. Courage! allez-vous dire; vous avez soutenu de plus rudes
épreuves. Jamais, pas même celle de mon exil. Alors j'avais l'espoir de
revenir bientôt; on me plaignait. Aujourd'hui je me bannis : quand
viendra le retour? On n'a plus de compassion pour nous; on nous redoute.
Les villes et les gens de la campagne ne voient Pompée que furieux et
altéré de sang. Je ne sais rien de pis toutefois que d'être resté, rien
de mieux
352
que d'aller le joindre, et c'est mon désir, non pour combattre, mais
pour fuir avec lui. Vous ajourniez vos conseils jusqu'à l'événement de
Brindes. Le voilà, et nous ne savons que faire encore. Je ne me flatte
guère de réussir près de lui, bien que j'aie à lui donner les meilleures
raisons du monde. Mais je vous rendrai compte de notre conversation mot
pour mot. Maintenant que votre amitié s'évertue, car, plus que jamais,
j'ai besoin de vos conseils et de votre prudence. Au train dont il
marche, il ne me laissera pas même le temps de voir T. Rébilus, comme je
me l'étais promis. Je suis pris au dépourvu. Mais, comme dit Mentor. «
Je trouverai des ressources en moi-même, ou un Dieu m'inspirera. » Quoi
qu'il arrive, vous le saurez aussitôt. Je n'ai point vu les propositions
de César a Pompée et aux consuls, et Lucius ne m'en a point apporté de
.copie; mais je vous ai précédemment envoyé quelqu'un qui pourra vous
mettre au fait. Philippus est à Naples et Lentulus à Pouzzol. Tâchez
toujours de savoir où est Domitius et ce qu'il compte faire. — Vous
trouvez donc dans ce que je vous ai écrit de Dionysius une dureté qui
n'est pas dans mon caractère. Voyez comme je suis du vieux temps. Je
croyais sur ma parole que vous prendriez la chose encore plus vivement
que moi. Je me figurais qu'un tort à mon égard ne pouvait vous trouver
indifférent, de quelque part qu'il vînt. Cet homme, d'ailleurs, vous a
fait injure à vous-même, en se conduisant aussi indignement avec moi.
Toutefois je laisse vos impressions libres à cet égard et je ne prétends
en aucune manière vous imposer mon ressentiment. Mais j'avais toujours
jugé Dionysius comme une tête assez peu saine; je vois maintenant que
c'est une âme perverse, un cœur dépravé. Mais c'est à lui qu'il a fait
tort. Parlez-moi de votre réponse a Philargryrus; voilà qui est
convenable et juste. De nous deux, en effet, c'est moi qui ai reçu
congé. Ma lettre du 8 des kalendes était déjà partie, lorsque j'en ai
reçu une de Trébatius et de Matius par les gens que j'avais envoyés avec
eux. En voici la copie.
MATIUS
ET TRÉBATIUS A CICÉRON, IMPÉRATOR, SALUT.
« Comme nous
quittions Capoue, nous avons appris que Pompée s'était embarqué, le 16
des kalendes d'avril, avec tout ce qu'il avait de troupes; que César,
étant entré le lendemain dans la ville, avait harangué le peuple et
était reparti pour Rome, où il veut être avant les kalendes. Il n'y
restera que quelques jours et fera voile ensuite pour l'Espagne. Nous
croyons bien faire, ayant la certitude de l'arrivée de César, de vous en
instruire aussitôt, et nous vous renvoyons vos gens a cet effet. Vos
recommandations sont en bonnes mains, et nous y satisferons en temps et
lieu. Trébatius Scévola prend les devants. On nous dit à l'instant que
César couchera, le 8 des kalendes d'avril, à Bénévent, et le 6, à
Sinuesse. Nous le croyons. »
363. — A ATTICUS. Formies, mars.
A. IX, 16. Je n'ai rien à vous
mander, mais je ne veux pas laisser passer un jour sans vous
353
écrire. On dit que César doit coucher à Sinuesse le 6 des kalendes; j'ai
reçu une lettre de lui datée du 7 ; il ne me demande plus une marque de
déférence et d'adhésion comme précédemment; ce sont mes lumières et mon
concours dont il veut s'appuyer en tout. Je l'avais loué de sa
modération à Corfinium : vous allez voir sa réponse.
CÉSAR, IMPÉRATOR, A CICÉRON,
IMPERATOR, SALUT.
« Vous ne vous
trompez point et vous me connaissez. Rien n'est plus loin démon
caractère que la cruauté. Je me complais, je l'avoue, dans cette manière
d'être, et je suis heureux autant que fier de votre suffrage. Des
prisonniers à qui j'ai rendu la liberté n'en veulent, dit-on, profiter
que pour reprendre les armes. Je ne changerai pas pour cela de marche.
Restons chacun ce que nous sommes. Mais vous, faites, je vous en prie,
que je vous trouve bientôt à Rome, afin que je puisse, selon ma vieille
habitude, recourir en tout a vos lumières et m'appuyer en tout de votre
concours. Je n'aime rien tant que votre cher Dolabella ; soyez-en
convaincu. Je lui devrai de vous avoir auprès de moi; oui, je le lui
devrai; j'en ai pour garant sa bonté, son tact et sa tendre affection. »
364. — A
ATTICUS. Formies, mars.
A. IX, 17.Trébatius doit arriver
aujourd'hui, 9 des kalendes ; j'attends ce qu'il me dira et ce que me
mandera Matius, pour voir quel langage je dois tenir a César. Cruelle
extrémité! pas de doute qu'il ne me presse d'aller à Rome; car il a déjà
fait publier à Formies qu'il serait au sénat le jour des kalendes et
qu'il désirait une assemblée nombreuse, il me faudra donc lui dire non?
Mais pourquoi anticiper? Je vous rendrai compte de tout aussitôt. Je
verrai par ce qu'il me dira si je dois aller à Arpinum ou ailleurs. Je
songe à donner la robe virile à mon fils, ici sans doute. Ensuite quel
parti prendre? conseillez-moi. Le chagrin ôte à l'esprit son ressort.
Est-il question de Tiron dans la lettre de Curius? La sienne, à lui,
m'inspire des craintes sur sa santé. Des gens qui l'ont vu en parlent
d'une manière alarmante. C'est un surcroit de chagrin pour moi à qui son
zèle et sa fidélité seraient si utiles dans les circonstances présentes.
365. — A
ATTICUS. Formies, mars.
A. IX, 18. J'ai suivi votre avis sur
l'un et l'autre point : mon langage a été d'un homme qui cherche à
gagner l'estime plutôt que les bonnes grâces; et j'ai tenu bon pour ne
pas aller à Rome Mais j'avais tort de croire qu'on prendrait bien mon
refus : rien moins que cela. Il (César) prétend que ma conduite sera sa
condamnation et que mon exemple va retenir tout le monde. J'ai objecté
que ma position était exceptionnelle. Après bien des dits et des
contredits, Eh bien ! s'est-il écrié, venez-y comme médiateur entre
nous.— Aurai-je les coudées franches? — Je ne prétends pas vous dicter
votre rôle. — Eh bien I je pousserai le sénat à vous empêcher de passer
en Espagne et de porter la guerre en Grèce, A chaque instant j'aurai à
récriminer en faveur de Pompée. — Non, non, je ne veux pas. -— Je m'en
doutais. Aussi n'irai-je point à Rome. Il faut, ou que je m'explique
sans réserve sur tout cela et sur mille autres points impossibles à
passer sous si-
354
lence, ou que je m'abstienne de paraître. »« En dernière analyse, il me
pria d’y réfléchir, il voulait évidemment couper court à la discussion,
Je ne pouvais le refuser. Là-dessus, nous nous séparâmes. Je crois qu'il
n'est pas content de moi; en revanche, je suis très-content de moi-même
; ce qui, depuis longtemps, ne m'était pas arrivé. Mais quel entourage
que le sien, bons Dieux ! Que vous les avez bien nommés la bande
infernale ! Quel nid de brigands ! cause détestable ! infâme parti ! et
le fils de Servius et le fils de Titinius qui sont là! Il y en avait
bien d'autres dans le camp qui assiégeait Pompée : six légions, tout
autant. Cet homme ne s'endort ni ne recule jamais. Je ne vois pas nos
maux prés de finir. C'est maintenant qu'il me faut vos conseils. Vous
n'avez plus à attendre; mais j'allais oublier ses dernières paroles.
Elles font frémir : « Si vous me refusez vos conseils, il faudra bien
que j'en prenne où je pourrai, et alors il n'y a rien qu'on ne doive
craindre. » Eh bien ! me disiez-vous dans une de vos lettres, vous
l'avez donc vu! et vous avez gémi! il y a de quoi. Et après? après, il
est parti pour Pédum, et moi pour Arpinum. Là, j'attendrai, comme vous
dites, le retour des hirondelles. Mais alors, me direz-vous, le moment
sera passé. Ah! celui que je vais suivre a eu bien d'autres mécomptes.
J'attends une lettre devons. Il n'y a plus à dire : voyons d'abord
comment cela se passera. Cette entrevue était votre dernier
retranchement. J'ai blessé César, j'en suis sûr. Raison de plus de me
décider. Une lettre, une lettre, je vous en conjure, mais une lettre
d'homme politique. Je ne saurais vous dire avec quelle impatience je
l'attends aujourd'hui.
366. — A
ATTICUS. Formies, mars.
A. IX, 19. Je viens de faire prendre
à mon fils la robe virile ; ne pouvant faire la cérémonie à Rome, j'ai
donné la préférence à Arpinum. Ce qui a fait grand plaisir aux
habitants. Ce n'est pas qu'on ne soit fort triste, fort consterné à
Arpinum et partout où j'ai passé. Ce qui se passe est si épouvantable et
si affreux! On lève des troupes : on les met en quartiers d'hiver. Des
levées de soldats sont toujours un mal pour le pays, même faites par des
gens de bien pour une guerre juste et avec des ménagements convenables.
Jugez ce qu'elles ont de vexatoire dans de pareilles mains pour une
guerre civile horrible, et avec l'insolence qu'on y met. Vous pouvez
compter qu'il n'y a pas un seul homme déshonoré en Italie qui ait manqué
au rendez-vous. Je les ai vus tous à Formies. Ce sont à peine des
figures humaines, je vous le jure. Je connaissais chacun
individuellement, mais je ne les avais jamais vus tous ensemble comme à
Formies. Ah ! partons ! cédons au penchant qui m'entraîne et laissons là
tout ce que je puis posséder au monde. Il nous saura gré de le rejoindre
plus que de ne l'avoir jamais quitté. Au commencement, sa cause avait de
l'avenir; aujourd'hui elle est sans espérance; et seul parmi tous, je
quitte l'Italie sans avoir personnellement rien à craindre de son rival.
Ce n'est malheureusement pas non plus l'intérêt de la république qui me
guide. Je la regarde comme anéantie. Mon seul désir est de ne pas
paraître ingrat, ingrat envers l'homme à qui je n'ai d'obligation que
d'avoir réparé le mal qu'il m'avait fait. Mais je ne puis rester témoin
de ce qui s'accomplit ou se prépare. Déjà même, je le crois, des séna-
355
tus-consultes sont rendus : encore s'ils étaient inspirés par Volcatius
! Mais qu'importe? Ils n'ont qu'une même pensée. Servius sera le plus
violent ; lui qui a pu envoyer son fils avec Pontius Titianus pour ôter
à C. Pompée la vie ou la liberté. Pontius du moins est pous
amour pour notre patrie, nous allons faire contre elle le métier de
pirates. Je ne vois que ce moyeu de tenter encore la fortune. L'Égypte
sera notre retraite sur terre; il n'y a pas à lutter; et qui peut croire
a la paix? Mais voilà assez de doléances. Veuillez me rendre compte par
Céphalion de tout ce qui se fait et même de tout ce qui se dit, si
toutefois on ose parler encore. J'ai suivi vos conseils : mon attitude
avec César a été digne, et j'ai tenu bon pour ne pas aller à Rome.
Réfléchissez bien et donnez-moi, je vous en prie, votre avis, votre
jugement sur ce qui me reste à faire. Le moment presse. Il n'y a plus,
il est vrai, à délibérer, mais une idée peut vous venir. Écrivez-moi
dans tous les cas.
367. — A
ATTICUS. Latérium, près d'Arplnum, avril.
A. X, 1 . J'ai reçu votre lettre, le
3 des nones, à mon arrivée chez mon frère à Latérium. J'ai respiré en la
lisant; c'est la première fois depuis nos désastres. Je mets à haut prix
l'approbation que vous donnez à la fermeté de mon âme et de ma conduite.
Sextus m'en loue aussi, m’écrivez-vous. J'en suis heureux : son
approbation vaut pour moi celle de son père qui était l'homme que
j'estimais le plus. Il me fit un jour une réponse qui me revient souvent
à la mémoire : c'était aux fameuses nones de décembre. Eh bien! Sextus,
lui disais-je, que faut-il faire? « Je ne veux pas mourir, me dit-il,
lâchement et sans gloire, mais en me signalant par quelque grand exploit
qui retentisse dans la postérité. » L'autorité de sa parole est toujours
vivante pour moi, et je ne fais pas moins de cas de l'opinion d'un fils
si semblable à son père. Offrez-lui , je vous prie, mes plus
affectueuses salutations. Vous ne pouvez guère tarder à me donner votre
avis; déjà le pacificateur à gages aura, je pense, fait sa motion, et
quelque décision aura été prise dans cette réunion de sénateurs que je
ne veux pas appeler sénat. Vous ne m'en tenez pas moins dans une sorte
d'incertitude; quoique d'ailleurs je ne puisse douter du parti que vous
me proposerez. Ne m'annoncez-vous pas qu'on envoie Flavius en Sicile
avec une légion, et qu'il est déjà parti? Que d'attentats se préparent,
dites-vous, les uns près d'éclore, les autres en travail dans de
coupables pensées, sans compter ce que nous réserve l'avenir! J'en
demande pardon à Selon votre compatriote, et, je pense, aussi le mien;
mais je repousse sa loi de mort contre ceux qui ne prennent pas parti
dans les guerres civiles, et, à moins d'arrêt contraire de votre bouche,
je m'en vais avec mes enfants. Quant à ma neutralité, nulle incertitude.
Toutefois, je ne précipiterai
356
rien ; j’attends votre avis et la lettre que je vous ai prié de remettre
à Céphaiion, a moins que déjà vous ne l'ayez expédiée par une autre
voie. Vous pensez, maison n'en dit rien encore, que, s'il est question
de paix, on m'appellera à Rome. Je n'imagine pas qu'il puisse être
question de paix avec le projet arrêté de prendre a Pompée son armée et
sa province? Il se peut, il est vrai, que cet orateur vendu persuade à
notre homme de ne point agir pendant que les négociateurs iront et
viendront. Mais, pour moi, je n'espère rien. Je ne vois rien de
possible. C'est d'ail leurs une grande question en politique de savoir
si un homme de bien peut entrer dans le conseil d'un tyran, même pour y
délibérer d'une affaire qui importe à la chose publique. Mais enfin s'il
arrivait qu'on m'appelât, je ne m'en préoccupe guère, je vous assure.
Qu'aurais-je a dire pour la paix que je n'aie déjà dit, et fait à son
grand déplaisir? Le cas supposé pourtant, que devrais-je faire? je vous
le demande : jamais je ne me serais trouvé dans une position plus
délicate. — Je suis charmé que vous ayez été content du langage de
Trébatius ; c'est un homme excellent et un bon citoyen. Depuis longtemps
rien ne m'avait été au cœur comme vos très-bien! très-bien! si souvent
répétés. Ah! que j'attends avec impatience votre lettre! Elle est déjà
partie, j'espère. Je n'ai en fait de dignité qu'à suivre votre exemple
et celui de Sextus. Votre Céler a plus d'esprit que de bon sens. Ce que
Tullie vous dit de nos jeunes gens est vrai. Le mot que vous me
rapportez de M. Antoine me paraît moins fâcheux au fond que blessant
dans la forme. Je vis dans une incertitude qui est pour moi pire que la
mort; il me fallait rester libre au milieu des méchants ou m'exposer
avec les bons à tous les périls; suivre ceux-ci en aveugle ou braver
ceux-là en face. L'alternative était périlleuse. Le parti que je veux
prendre n'est pas moins honteux et n'est pas plus sur. On députera, je
pense, pour traiter, celui qui a envoyé son fils à Brindes. (Serv.
Sulpicius) Mais ce sera pure feinte; au fond on se préparera avec
acharnement à la guerre, j'en suis convaincu comme vous; et l'on ne
songera guère à me prendre pour négociateur. D'ailleurs mon nom n'a pas
même encore été prononcé, et c'est tout ce que je souhaite. Il est donc
bien inutile que je vous demande ce que je devrais faire dans une
hypothèse qui ne se présentera point, inutile que je m'en occupe
moi-même.
368. — A ATTICUS. Arcanum, avril.
A. X, 2. Céphalion m'a remis votre
lettre des nones d'avril. Mon parti était pris : je comptais coucher le
lendemain à Minturnes, et je me mettais immédiatement en route. D'après
ce que vous me dites, je reste provisoirement à Arcanum, chez mon frère.
C'est un lieu retiré : j'y attendrai des nouvelles plus positives, et
l'on n'en mettra pas moins ordre à tout ce qui peut se faire sans moi.
J'entends l'hirondelle qui chante et je brûle de partir, quoique je ne
sache encore où aller, ni par quel chemin. Je verrai, je consulterai. En
attendant, et tant qu'il y a possibilité, ne cessez pas de m'aider de
vos conseils. Nous sommes dans un dédale ; il faut s'en remettre à la
fortune. Je m'agite sans espérance, et ce serait merveille si les choses
ne tournaient pas au pis. Je serais fâché que Dyonisius fût parti, comme
Tullie me le mande; ce n'est pas le moment. Je ne me soucie pas, dans le
trouble où je me sens,
357
de me donner en spectacle à un homme qui n'est pas mon ami. Je ne
prétends pas toutefois vous empêcher d'être le sien.
369. - A ATTICU.S. Areanum, avril.
A. X, 3.
1ere partie. Je n'ai rien à vous dire, sinon que je voudrais
bien savoir quelques nouvelles. Est-il parti (César)? Dans quel état
a-t-il laissé Rome? A qui a-t-il parfaire les districts d'Italie et
délégué le pouvoir? Qui a-t-on nommé pour porter à Pompée et aux consuls
des propositions du paix? Voilà seulement pourquoi je vous écris. Vous
serez bien aimable et vous me ferez un plaisir extrême de me mettre au
courant, et de me dire tout ce qui peut m'intéresser. En attendant, je
me tiens coi à Areanum.
370. — A
ATTICUS. Areanum, avril.
A. X, 3. 2e partie. Voilà la seconde
lettre que je vous écris aujourd'hui, 7 des ides d'avril. Hier je vous
en écrivis une plus longue et toute de ma main. On vous a vu, me dit-on,
dans la maison des pontifes. Je ne prétends pas vous en faire un
reproche, car je n'y échapperais pas moi-même. J'attends de vos lettres
avec impatience. Que peuvent-elles m'apprendre? je ne sais, n'importe,
écrivez-moi toujours. César m'a écrit; il ne me sait pas mauvais gré de
n'être pas venu à Rome; il prend, au contraire, cette résolution en
bonne part. Mais je le trouve excellent quand il me dit que Tullius et
Servius se sont plaints à lui de ce qu'il ne leur avait pas montre la
même condescendance. Les plaisantes gens ! Ils ont envoyé leur fils
assiéger Pompée, et ils se font scrupule de venir en personne au sénat!
Je vous envoie toutefois copie de la lettre de César.
371. — A SER. SULPICIUS. Avril.
F. IV, I. Je sais par mon ami C.
Trébatius que vous vous êtes informé prés de lui du lieu ou je me
trouvais. Votre triste santé, me dit-il, vous fait regretter de n'avoir
pu me voir, quand je me suis approché de Rome; et, si je m'en
rapprochais encore, vous tiendriez beaucoup, dans les circonstances
actuelles, à vous entendre avec moi sur ce que l'honneur et le devoir
exigent de nous deux. Ah ! que ne nous a-t-il été donné, mon cher
Servius, de nous entendre avant que tout ne fût perdu, car tout est
perdu ! Nous aurions arrêté la république sur le bord de l'abîme. Je
n'ai pas ignoré dans mon absence que, voyant de loin l'orage, vous ne
cessiez de prêcher la paix pendant et après votre consulat. Hélas! j'ai
fait de même, je partageais vos convictions; mais vains efforts! il
était trop tard. J'étais seul; je me trouvais comme dépaysé et je ne
voyais autour de moi que des fous ne parlant que guerre et batailles.
Aujourd'hui il ne reste plus rien à faire pour la république; mais il y
a peut-être quelque chose à faire pour nous, non pas afin de garder des
positions qui nous échappent, mais afin de conserver du moins quelque
dignité dans nos maux. Il n'est personne au monde avec qui je désirasse
plus me mettre d'accord qu'avec vous qui connaissez si bien et les
grands exemples que nous devons imiter, et qui n'oubliez pas ces maximes
des sages dont vous avez toujours fait la règle de votre vie. J'ai
failli vous écrire : c'était lors
358
de cette assemblée du sénat ou plutôt de cette assemblée de sénateurs à
laquelle vous avez assisté. Je voulais vous dissuader d’une démarche
inutile; mais j'ai craint de blesser un personnage qui me proposait
votre conduite comme modèle. Quand il me parla de son désir de me voir
au sénat, je ne lui cachai pas au surplus que j'y dirais tout ce que
vous y avez dit vous-même sur la paix et sur l'Espagne. Vous voyez ce
qu'ils ont fait; après s'être partagé le gouvernement, ils ont mis
l'univers en feu. Plus de lois, ni do justice, plus de droits ni
d'honneur, et Rome est laissée eu proie à la dévastation et à
l'incendie. J'ai beau me creuser la tête : je ne vois nulle part
d'espérance et je n'ose pas même former un vœu. Mais si vous croyez
utile que nous nous voyions, vous qui êtes le plus sage des hommes,
parlez. Je voulais m'éloigner encore de cette ville dont le nom seul me
fait mal; mais je me rapprocherai. Je mande à Trébatius de se charger de
vos commissions. Remettez-lui une lettre, je vous en supplie, ou bien
envoyez-moi un homme sûr; nous n'aurions ainsi, ni vous, ni moi, à nous
déplacer. J'ai une haute idée de votre sagesse, je ne me crois pas non
plus tout a fait dépourvu de prudence, et si, en mettant nos idées en
commun, il en pouvait jaillir quelque chose d'utile au salut de tous, je
ne doute pas d'avance que notre plan n'obtînt l'assentiment général.
Adieu.
372. — A ATTICUS. Cumes, 14 avril.
A. X, 4. Je viens de recevoir à la
fois plusieurs lettres de vous, toutes remarquables, surtout celle qui
ressemble à un volume. Je la relirai plus d'une fois, elle le mérite. Ne
regrettez pas votre peine, je vous prie; vous me faites un trop grand
plaisir. Aussi, tant que vous le pourrez, c'est-à-dire tant que vous
saurez où m'adresser vos lettres, ne vous épargnez pas, je vous en
conjure ; mais mettons, dès aujourd'hui, un terme à nos éternelles
lamentations, s'il est possible; si non mettons-y du moins quelque
mesure : car j'ai dit adieu pour jamais à tout ce que j'ai perdu, en
position, en honneurs, en prépondérance. Je ne veux plus me rappeler que
la manière dont j'y étais parvenu, comment je m'y suis montré, quelle
gloire j'y ai acquise, tout ce qu'il reste enfin de distance, jusque
dans mon abaissement môme, entre moi et ceux par qui tout cela m'est
enlevé. Je parle de ces deux hommes qui ont cru ne pouvoir lâcher la
bride à leurs passions qu'a la condition de m'expulser de Rome. Vous
voyez les fruits de ce bel accord, de cette alliance criminelle. L'un,
dans le délire d'une coupable ambition, ne respecte rien, et chaque jour
accroît sa rage, il vient de chasser sou rival de l'Italie. Il veut le
poursuivre plus loin encore et le dépouiller de sa province. Déjà le nom
de tyran ne lui fait plus peur; on dirait même qu'ayant la chose, il ne
serait pas fâché d'avoir le nom. Et cet autre qui ne daignait pas même
me tendre la main, lorsque je me jetais à ses pieds, qui ne pouvait,
disait-il, rien faire que du consentement d'une autre volonté, le voilà
qui, à peine échappé au glaive de son beau-père, va porter la guerre et
sur terre et sur mer; guerre juste, guerre sainte, indispensable même,
mais qui n'en sera pas moins l'anéantissement de Rome, s'il est vaincu
et, s'il est vainqueur, une source de calamités sans fin. Ainsi, bien
loin de mettre les actions de ces grands généraux au-dessus de ma
gloire, je préfère même à tout l'éclat de leur fortune les dures
359
vicissitudes de la mienne. Est-ce être heureux, en effet, que de
déserter sa patrie ou de s'en rendre l’oppresseur? Et si, comme vous me
le rappelez, j’ai dit avec raison dans mes ouvrages qu'il n'y a de
bonheur que dans la vertu et de honte que dans le mal, ne doit-on pas
les regarder tous deux comme les plus malheureux des hommes, eux qui ont
toujours fait passer leur ambition et leur intérêt avant le salut et la
gloire de la patrie? Oui, ma conscience me rend ce beau témoignage que
j'ai toujours bien servi la république, que j'ai du moins toujours tout
prévu ; et si le tourbillon l'emporte, il y a quatorze ans que je
l'annonce. Je pars soutenu par cette idée, avec le cœur navré, non pour
moi ou pour mon frère, notre carrière est finie; mais pour nos enfants,
à qui nous aurions dû laisser une patrie. L’un d'eux surtout me met la
mort dans l'amé ; sa tendresse est si touchante. L'autre, ô douleur!
c'est le plus amer de ma coupe ; l'autre, gâté par notre indulgence, en
est venu à des excès que je n'ose dire. J'attends d'ailleurs ce que vous
m'écrirez sur son compte comme vous avez promis de le faire en détail,
aussitôt que vous l'aurez vu. J'ai usé à la fois de douceur et de
sévérité, je l'ai préservé, non pas une fois, mais mille, de fautes
tantôt graves et tantôt légères. Mais l'extrême bonté de son père
méritait un redoublement de tendresse au lieu d'un si cruel retour. Sa
lettre à César nous a chagrinés au point de vous en faire mystère ; son
père en était inconsolable Je n'ose dire ce que je pense de ce voyage et
du motif de tendresse filiale dont il a voulu le colorer. Ce que Je
sais, c'est qu'après une entrevue avec Hirtius, César le fit appeler; il
paraît qu'il lui parla de moi comme de l'homme le plus en opposition à
ses vues et me dénonça comme ayant formé le projet de sortir d'Italie.
Je ne vous dis cela qu'avec peine. Au reste, nous n'aurions là-dessus
rien à nous reprocher ; il faudrait n'accuser que sa nature qui est
mauvaise. Il en est ainsi du fils de Curion et du fils d'Hortensius. Les
deux pères ne sont pour rien dans la conduite de leurs enfants. Mon
pauvre frère est dans un état d'abattement cruel. Il craint pour moi le
contrecoup de cette démarche, et non pour lui-même. A lui, à lui vos
consolations, si vous en avez à offrir. La meilleure pour moi serait
d'apprendre que tous ces rapports sont faux ou du moins exagères. S'ils
sont vrais, je ne sais vraiment ce que nous ne devons pas craindre d'une
conduite pareille et d'une telle escapade. Si nous avions encore une
république, je saurais bien à la fois et déployer une juste rigueur et
la tempérer ensuite par l'indulgence. Mais peut-être que mon irritation,
mon chagrin ou mes alarmes m'aveuglent, et que j'en dis plus qu'il ne
convient à mes sentiments comme aux vôtres. Si les faits sont vrais, il
faut me pardonner ces épanchements; s'ils manquent d'exactitude, avec
quelle joie je les verrai par vous rectifiés ! Quoi qu'il en soit et en
aucun cas, ne vous en prenez, je vous en conjure, ni à son oncle, ni à
son père. — Tout cela était écrit lorsque Curion m'a fait annoncer sa
visite. Il était à Cumes depuis hier au soir, qui était le jour des
ides. Je ne fermerai pas ma lettre, sans y ajouter tout ce qu'il me dira
de notable. — Curion a passé devant ma maison sans s'arrêter, en me
faisant annoncer son prompt retour. Il allait en toute hâte à Pouzzol
pour
360
haranguer le peuple. Sa harangue faite, il revint chez moi et y resta
assez longtemps. Que d'abominations il m'a dites! Vous connaissez
l’homme : il n'a rien eu de caché pour moi. D'abord il m'a donné comme
positif le rappel de tous les bannis de la loi Pompéia. Il compte
lui-même employer en Sicile ceux qu'il y trouvera. Il regarde César
comme déjà maître de l'Espagne. De là César doit se mettre, avec toutes
ses forces, à la poursuite de Pompée, en quelque lieu qu'il soit, la
guerre ne devant finir que par la mort de ce dernier. César s'est
emporté contre Métellus, tribun du peuple, et a failli le faire tuer,
exécution qui eût été le prélude d'un massacre, car il se trouvait bien
des gens pour y pousser. César n'est pas clément par goût ou par nature;
mais il sait que c'est un moyen de popularité. L'affection du peuple une
fois perdue, sa cruauté prendrait le dessus. L'affaire du Trésor avait
excité les murmures de la populace, et, quand le grand homme l'a su à
n'en pas douter, il n'a point osé haranguer le peuple avant de partir,
et s'en est allé dans un trouble extrême, .l'ai demandé à Curion ce
qu'il voyait dans l'avenir, ce qu'il pensait d'une hardiesse sans
exemple : dans le passé, ce qu'il augurait de la forme de république que
nous devions avoir. Il me répondit nettement qu'aucune république
n'était possible. Il craint que Pompée n'ait une flotte, auquel cas, il
évacuerait, lui, la Sicile. — « Que signifient, lui ai -je dit, ces six
faisceaux? Si c'est le sénat qui vous les donne, pourquoi les lauriers?
Si c'est César, pourquoi n'en avez-vous que six? » J'aurais voulu,
dit-il, supposer un sénatus-consulte, car c'est la seule voie. Mais
César a plus que jamais le sénat en aversion. « Dorénavant, m'a-t-il
dit, tout émanera de moi. » Mais pourquoi rien que six? parce que je
n'en ai pas voulu douze. Je n'avais qu'a dire.
« Je voudrais
bien, ai-je alors repris, avoir demandé à César ce qu'il a accordé à
Philippe ; mais j'ai craint un refus n'ayant rien fait pour lui
moi-même. — Il y aurait consenti de grand cœur, reprit Curion; mais
supposez la chose faite. .Te vais lui écrire que nous avons arrangé
cette affaire ensemble. Des que vous ne venez pas au sénat, que lui
importe où vous soyez! Il y a mieux ; je suis sûr qu'il n'eût point
trouvé mauvais que vous eussiez d'abord quitté l'Italie. » Je lui dis
que c'était surtout mon cortège de licteurs qui me faisait souhaiter la
retraite et la solitude. Et il m'a approuvé en cela. — « Mais, ai-je
encore dit, je ne puis gagner la Grèce qu'en passant par votre province,
car la côte de l'Adriatique est toute garnie de troupes. — Tant mieux,
a-t-il répondu, rien ne me charmera davantage ; » et mille autres choses
très-aimables. Ainsi ma traversée s'opérera en sûreté et même sans
mystère. Curion a remis à demain ce qu'il lui reste à me dire. Je vous
écrirai tout ce qui en vaudra la peine. J'ai oublié de l'interroger sur
bien des choses. Y aura-t-il interrègne? Dans quel sens entend-il que
César lui a offert le consulat, mais qu'il n'en a pas voulu pour l'année
prochaine? Et mille autres questions encore. Il me jurait à tout bout de
champ, vous savez que les serments ne lui coûtent guère, il me jurait
que César était très certainement au mieux pour moi. « _ Car enfin,
disait-il, qu'est-ce que m'écrit Dolabella ? — Que vous écrit-il donc? —
Qu'il a dit à César son désir de vous voir à Rome; que César lui a
répondu par de grands remerciements et l'assurance de son approbation et
même de sa vive satisfaction, si
361
vous y veniez. » Que vous dirai-je? Je suis plus tranquille ; mon cœur
se trouve du moins ainsi déchargé du poids de cette trahison domestique,
et de ce pourparler avec Hirtius. Combien je souhaite que notre neveu
soit digne de nous, et combien je combats pour écarter de ma pensée tout
soupçon contre lui ! Mais pourquoi cette démarche près d'Hirtius? II y a
quelque chose là-dessous. Espérons que cène sera rien ; mais il est
singulier qu'il ne soit pas encore de retour. Nous verrons. Vous
remettrez à Térentia les fonds que j'avais chez les Oppius; car il ne
faut pas s'exposer à être sans argent dans Rome. Conseillez-moi :
faut-il m'en aller par terre à Rhégium ou m'embarquer ici? et puisque je
reste encore, donnez-moi vos avis sur tout. Je vous écrirai, des que
j'aurai revu Curion. Continuez, je vous prie, à me donner des nouvelles
de la santé de Tiron.
373. — CÉLIUS A CICÉRON. Cumes, avril.
F. VIII, 16. Votre lettre m'a mis la
mort dans l'âme. Pas un mot qui ne soit en noir, rien pourtant de
précis. Mais il n'est que trop facile de pénétrer votre pensée, et je me
hâte de vous écrire. Au nom de tout ce qui vous est cher, au nom de vos
enfants, n'allez pas, Je vous en conjure, mon cher Cicéron, vous perdre
ou vous compromettre par quelque coup de tête . Je ne vous ai rien
dit à l'aventure, je ne vous ai rien conseillé à la légère, j'en atteste
les Dieux et les hommes, j'en jure par notre amitié : j'avais vu César,
et je ne vous al écrit qu'après avoir entendu de sa propre bouche ses
intentions envers le parti vaincu. Mais si vous croyez que ses
dispositions seront toujours les mêmes et qu'il offrira toujours les
mêmes conditions, vous vous trompez. Déjà on voit percer quelque chose
de sinistre dans ses projets et même dans son langage. Il est parti très
mécontent du sénat : ces oppositions l'ont fort irrité. Si vous avez
quelque amitié pour vous, pour votre fils, pour votre famille, si vous
ne voulez pas briser vos dernières espérances, si ma voix, si celle de
votre excellent gendre ont sur vous quelque pouvoir, si vous ne voulez
pas jeter le trouble dans nos existences, de grâce, ne nous mettez pas
dans l'alternative de haïr et de répudier un parti dont le triomphe doit
nous sauver, ou de former des vœux sacrilèges contre votre propre vie.
Faites une réflexion : vous avez tardé trop à vous prononcer pour n'être
pas suspect. Braver, lorsqu'il est vainqueur, l'homme que vous ménagiez
quand la fortune était incertaine : vous unir dans leur fuite à ceux que
vous n'avez pas soutenus dans leur résistance, serait agir en insensé;
prenez garde, en craignant de ne pas être assez du parti des bons,
d'aller vous tromper sur ce qui est le bon parti. Que si je ne puis
faire passer dans votre esprit ma conviction tout entière, attendez du
moins les événements d'Espagne. L'Espagne est à nous, c'est moi qui vous
le dis, aussitôt que César y aura mis le pied; et s'ils perdent
l'Espagne, que leur reste-t-il, je vous prie? Je ne vois en vérité pas
ce qui peut vous décider pour une cause désespérée. César est informé de
ce que vous m'avez fait entendre par votre silence. On lui a tout
rapporte, et c'est la première chose qu'il m'a dite, l'autre jour en me
voyant. J'ai feint de n’en rien savoir, mais je l’ai engagé à vous
écrire et a employer près de vous ses moyens de persuasion. Il m'emmène
en Espagne, sans quoi, je
362
n'aurais rien de plus pressé, une fois à Rome, que de courir après vous,
quelque part que vous soyez, de débattre avec vous la question et de
vous retenir à toute force. Regardez-y à deux fois, mon cher Cicéron;
n'allez pas vous perdre, vous et les vôtres, ni vous jeter de gaieté de
cœur dans une voie sans issue. Enfin, si vous ne voulez pas absolument
fermer l'oreille aux grands qui vous appellent, et si l'insolence et les
bravades de quelques parvenus vous font peur, choisissez un terrain
neutre, et allez vous y fixer, en attendant que les événements
s'accomplissent. C'est un parti sage et dont César ne sera pas blessé.
374. — A ATTICUS. Cumes, 17 avril.
A. X, 5. Je vous ai précédemment
rendu compte de mes déterminations d'une manière assez complète, ce me
semble. Quant au jour fixé, je ne saurais rien vous en dire encore, si
non que ce ne sera point avant la nouvelle lune. Curion n'a guère fait
que répéter le lendemain sa conversation de la veille; seulement il dit
positivement qu'il ne voit aucune fin à tout ceci. Oui, je vois bien ce
que vous entendez pour le jeune Quintus; mais c'est vraiment l'Arcadie à
gouverner qu'une pareille tête : n'importe; vous m'en priez; j'y mettrai
tous mes soins. Pourquoi faut-il que vous-même?.... enfin je ne serai
pas si méchant. J'ai fait passer immédiatement la lettre pour Vestorius;
il envoyait sans cesse s'en enquérir. Vectiénus est bien mieux quand il
vous parle que quand il m'a écrit; mais je ne puis assez admirer sa
négligence. Philotime m'avait mandé qu'il pourrait avoir le pied-à-terre
de Canuléius pour cinquante mille sesterces, et même à moins, si je
m'adressais à Vectiénus. Je le priai en effet de faire rabattre quelque
chose sur le prix. Il m'en donna sa parole. Ce n'est que d'hier qu'il
m'annonce avoir traité à trente mille sesterces. Il me demande quel nom
mettre dans le contrat, et me prévient que l'argent doit être prêt pour
les ides de Novembre. Je lui ai répondu d'une manière assez verte, en
plaisantant toutefois comme entre amis. Puisqu'il se décide à se bien
conduire, je ne lui en veux plus. Je lui ai dit que j'avais reçu de vous
tous les détails. Où en êtes-vous de vos projets de départ? Quel jour
avez- vous fixé? Veuillez me le dire. Le 15 des kalendes de Mai.
375. - A Atticus. Cumes,
avril.
A. X, 6. Rien ne me retient plus
aujourd'hui que le vent. Je n'y mets pas de finesse : arrive que pourra
en Espagne... Toutefois n'en dites rien, s'il vous plaît. Je vous ai
déroulé mon plan dans mes précédentes lettres. Aussi je serai court. Le
temps presse d'ailleurs, et j'ai beaucoup à faire. Quant à Quintus, «
j'en fais le premier de mes soucis. » Vous savez le reste. Je reconnais
votre amitié et votre sagesse dans les bons conseils. Je vois qu'en me
gardant d'un seul écueil tout peut devenir facile; c'est toutefois une
bien grande affaire; le caractère est insaisissable, nulle simplicité,
nulle franchise. Que ne l'avez-vous pris sous votre tutelle! Le père est
trop indulgent. Il est toujours là pour mollir quand je tiens ferme.
Sans lui j'en viendrais à bout. Il vous en aurait coûté si peu à vous!
mais je ne veux pas vous chercher querelle. Seulement, je vous le
répète, c'est une grande affaire. On regarde comme certain que Pompée se
rend dans les Gaules par l’Illyrie. Ainsi donc nécessité d'un autre plan
pour moi et d'un autre itinéraire.
363
376. — A ATTICUS. Cumes, avril,
A. X, 7. Sans contredit, j'approuve
le détour que vous faites par l'Apulie et Siponte. Votre position est
toute différente de la mienne. Ce D'est pas que nous ne soyons tenus
tous deux à de semblables devoirs envers la république; mais il s'agit
bien de la république. Qui sera le maître? Voilà la question. Le roi qui
fuit a plus de modération et de probité; il est moins engagé, et s'il
n'est vainqueur, c'en est fait du nom romain. Mais si la victoire lui
reste, ce sera une victoire à la Sylla. Au milieu du débat, vous n'avez,
vous, à prendre ouvertement parti pour personne, et vous êtes libre
d'agir suivant les circonstances. Ma position à moi est tout autre. Je
suis lié par des bienfaits et je ne puis être ingrat. Je ne veux
pourtant pas aller sur les champs de bataille. Je veux me retirer à
Malte ou dans quelque autre petit coin. Mais me direz-vous, tout en
voulant n'être pas ingrat, c'est ne rien faire pour la reconnaissance.
Lui-même peut-être eût-il encore exigé moins. Au surplus j'ai le temps
d'y réfléchir. L'essentiel est de partir. Grâce à Dolabella et à Curion
qui sont maîtres, l'un de l'Adriatique, l'autre du détroit, je puis
attendre que la saison soit meilleure. - Il m'est venu je ne sais quelle
espérance que Ser. Sulpicius désirait me voir. Je lui écris par
Philotime mon affranchi. S'il tient bon, je ne puis avoir meilleure
compagnie ; s'il recule, je n'eu serai pas moins fidèle à mes
résolutions. Curion a été avec moi ces jours-ci. Il prétend que César
est un peu découragé de la désaffection du peuple et qu'il craint pour
la Sicile, si Pompée est déjà en mer. J'ai vigoureusement tancé le jeune
Quintus. Je vois dans son fait de la cupidité. Il espérait obtenir une
grosse somme. C'est déjà fort mal sans doute, mais je veux le croire
innocent du crime dont nous l'avions soupçonné. La cupidité, vous le
concevez bien, n'est pas le fruit de mon indulgence, c'est un penchant
de sa nature. Vous réglerez comme vous l'entendrez avec Philotime
l'affaire des Oppius de Veîie. Je serais comme chez moi en Épire. Je le
sais bien; mais c'est probablement ailleurs que je me dirigerai.
377. — A SERV. SULPICIUS. Cume, avril
F. IV, 2. J'étais à Cumes le 3 des
kalendes de mai, lorsque j'ai reçu votre lettre. Je trouve Philotime
assez mal avisé, venant de votre part et avec vos commissions expresses
pour moi, de ne pas me l'avoir remise en mains propres. Elle n'était si
courte que parce qu'il devait me l'apporter lui-même. Toutefois, à peine
en avais-je achevé la lecture, que votre chère Postumia et votre bon
Servius sont arrivés. Ils désirent beaucoup que vous veniez à Cumes et
ils m'ont engagé à vous l'écrire. Vous me demandez mes conseils : mais
de la manière dont je vois les choses, je puis bien arrêter pour
moi-même un plan et ne pas oser le conseiller à un autre. Puis,
conseiller un homme tel que vous, de tant de sagesse et de raison!
Cherchons-nous ce que veut le devoir? Cela saute aux yeux. Ce que veut
l'intérêt? Je n'y vois qu'incertitude. Sommes-nous ce que nous devons
être, c'est-à-dire ne regardons-nous comme utile que ce qui est droit et
honorable? Il n'y a pas à hésiter sur le parti à suivre. Vous dites que
mon sort et le vôtre sont liés. Il est certain que tous deux, avec les
meilleures intentions, nous
364
nous sommes grandement trompés. Toutes nos vues aboutissaient a la paix
; la paix faisait évidemment les affaires de César, et nous avons cru
qu'en travaillant pour elle, nous nous mettrions bien avec lui. Vous
voyez quelle a été notre illusion, et ou en sont maintenant les choses.
Vous voyez ce qui se passe, quels faits sont déjà consommés, et ce que
l'avenir nous promet encore. Il faut, ou approuver, ou rester témoin de
ce qu'on n'approuve pas : ignominie d'un côté, péril de l'autre. Reste,
il est vrai, le parti de la fuite. Mais le moyen de partir, et où se
retirer? Autre embarras. Jamais situation pire, jamais complication plus
grande. Je ne trouve aucun parti qui ne soulevé une difficulté. Voici
pourtant mon avis, que je vous livre. Si déjà vous avez arrêté un plan
qui ne s'accorde pas avec les vues que vous me connaissez, épargnez-vous
la peine de venir ; si au contraire vous désirez vous concerter avec
moi, je vous attends. Le plus tôt sera le mieux, si vous le pouvez :
c'est l'avis de Servius et de Postumia. Adieu.
378. — A M.
CÉLUJS, ÉDILE CURULE. Cumes, avril.
F. II, 16. Votre lettre m'aurait
causé un chagrin profond, si je ne m'étais fait une raison sur toute
espèce de chose, et si le spectacle journalier de nos calamités ne
m'avait depuis longtemps rendu presque insensible a de nouvelles
douleurs. Mais comment se fait-il, je vous prie, que vous ayez pu voir
dans mes lettres ce que vous y avez vu? Qu'y a-t-il autre chose que des
lamentations ordinaires sur le malheur des temps, sur les circonstances,
qui ne sont pas pour moi, je pense, plus affligeantes que pour
vous-même? Avec votre coup d'oeil, il est impossible que vous ne soyez
pas frappé de ce qui me frappe. Mais vous me connaissez, et je m'étonne
que vous ayez punie croire inconsidéré au point de passer du parti que
la fortune favorise au parti dont elle s'éloigne et qui tombe; et que
vous me supposiez assez inconséquent pour vouloir perdre a plaisir, près
d'un personnage puissant, des bonnes grâces péniblement acquises, pour
me manquer ainsi à moi-même, et pour me mêler à la guerre civile, que
j'ai toujours eue en horreur. Quels sont donc mes sinistres projets ? de
me retirer peut-être dans quelque solitude. Mais vous savez bien, vous
qui jadis partagiez ces sentiments, ce que mon cœur et mes y eux
souffrent en présence de tant d'indignités. C'est un surcroît d'embarras
pour moi que l'appareil de mes licteurs, et le titre d'imperator que
l'on me donne. Si j'étais libre de ces chaînes, j'accepterais pour
retraite le moindre coin en Italie, quoiqu'elle ait bien peu de
retraites sûres. Mais mes ennemis sont la; mes lauriers offusquent leurs
yeux et mettent en mouvement leurs langues. Voilà où j'en suis. Mais
partir sans votre aveu, c'est à quoi je n'ai jamais songé. Vous
connaissez mes petites propriétés. Il faut bien que j'y vive pour n'être
pas a charge à mes amis, et je me tiens plus volontiers dans celles qui
bordent la mer. C'est ce qui a fait croire à un départ. Et je n'y
répugnerais pas trop peut-être, si le repos était au bout. Mais
guerroyer! et dans quel but? me battre contre un homme qui doit être
assez content de moi, et pour un homme que je ne contenterai jamais,
quoi que je fasse! J'ajoute que cette détermination, je
365
l’avais à l'époque où vous vîntes me trouvera Cumes, et que vous avez pu
vous en apercevoir ; car je ne vous cachai point le discours de T.
Ampius, et vous vîtes combien je répugnais à quitter Rome. Lorsque
depuis j'ai su ce qui est arrivé, n'ai-je pas déclaré que je souffrirais
tout plutôt que d'abandonner l'Italie, pour m'engager dans une guerre
civile? Pourquoi mes résolutions auraient-elles changé? Est-il rien
survenu qui n'ait dû au contraire les confirmer? Croyez-le donc bien, et
vous le croyez sans doute, mon seul but au milieu de toutes ces misères
est de convaincre chacun que j'ai toujours mis la paix au-dessus de
tout, et que l'espoir de la paix perdu, il n'y a rien dont je sois pour
mon compte plus éloigné que de me mêler à la guerre civile. Je suis
fidèle à ces sentiments, et j'espère ne m'en repentir jamais. Q.
Hortensius, notre ami, je m'en souviens, se glorifiait de n'avoir jamais
pris une part quelconque aux guerres des citoyens contre les citoyens.
C'était, dit-on, chez lui défaut de caractère ; et comme je ne pense pas
qu'on ait de moi cette opinion, ma gloire sera plus pure. Je ne me
laisse pas effrayer par tous ces monstres que se fait votre amitié. On
doit s'attendre à tout dans une perturbation universelle. Mais il n'est
pas de calamité personnelle et domestique, y compris celle que vous me
montrez en expectative, au prix desquelles je ne rachetasse volontiers
le salut, de la république. Mon fils, que je suis heureux de vous voir
si cher, aura, pourvu qu'il reste ombre de la république, un assez beau
patrimoine dans la mémoire de mon nom. Dans le cas contraire, il n'est
exposé à rien de plus que tous ses concitoyens. Il faut songer à mon
gendre, dites- vous, jeune homme si plein de mérite, et que j'aime si
tendrement. Eh ! pouvez-vous douter de l'inquiétude cruelle qu'il me
cause, vous qui connaissez mes sentiments pour lui et pour ma chère
Tullie, d'autant qu'au milieu de nos communes misères j'aimais à me
figurer ce Dolabella, si cher à mon cœur et au vôtre, bientôt libre des
embarras sans nombre où son trop de libéralité l'avait plongé. Vous ne
pouvez pas savoir quels moments il a eu à passer pendant son séjour a
Rome, tout ce qu'ils ont eu d'horrible pour lui et d'humiliant pour moi,
son beau-père. D'un côté, je n'attends rien, de bon de l'Espagne, dont
je juge comme vous en jugez vous-même; et de l'autre, je vous dirai sans
déguisement ce que je pense : Si la constitution de Rome prend le
dessus, il y aura place pour moi à Rome; si elle périt, vous viendrez
vous-même, j'en suis sûr, me rejoindre dans la solitude où vous me
saurez confiné. Peut-être vois-je trop en noir, et peut-être les choses
tourneront-elles plus heureusement. Je me souviens que, dans ma
jeunesse, j'entendais les vieillards désespérer de tout. Il est possible
que je fasse aujourd'hui comme eux, et que je tombe aussi dans le défaut
propre à cet âge. Puisse-t-il en être ainsi! Et pourtant... Vous savez,
je le suppose, qu'il y a une robe prétexte sur le métier pour Oppius.
Pourquoi pas ? Curtius rêve bien un manteau de double pourpre ; mais le
teinturier se fait attendre. Je plaisante, pour que vous sachiez que
j'aime à rire même dans ma mauvaise humeur. Voyez, je vous prie, et
comme s'il s'agissait de vous, ce que j'ai écrit à Dolabella. Je finis
en vous assurant que vous n'avez à craindre de moi ni coup de tête ni
étourderie; mais où
366
je me trouve, promettez-moi de compter pour moi et mes enfants sur notre
amitié et sur votre fidélité.
379. — A RUFUS. Cumes, avril.
F.V, 19. Je n'ai jamais douté que je
ne vous fusse cher, mais j'en suis chaque jour plus convaincu, et j'en
trouve une preuve nouvelle dans ce que vos lettres m'avaient déjà fait
pressentir : c'est que votre zèle pour moi, étant plus libre à Rome, y
serait plus vif que dans ma province, où pourtant vous ne m'aviez rien
laissé a désirer. J'ai été charmé au dernier point, d'abord de cette
première lettre toute empreinte de la joie de votre âme à l'annonce de
mon arrivée, et remplie de si bons sentiments au sujet d'une résolution
qui n'est pourtant pas d'accord avec vos idées. Puis, dans la dernière,
j'ai retrouvé avec bonheur vos principes et votre dévouement pour moi :
vos principes, en ce que vous ne regardez comme utile que ce qui est
juste et honorable, et tout homme de tête et de cœur doit penser ainsi;
votre dévouement, en ce que vous ne voulez pas vous séparer de moi,
quelque soit le parti que je prenne. Nulle conduite ne peut me toucher
plus, ni, je crois, vous faire plus d'honneur. Depuis longtemps ma
résolution est prise ; si je ne vous en ai rien écrit jusqu'à ce moment,
ce n'est pas par mystère, c'est parce qu'au milieu des circonstances où
nous sommes une pareille communication a l'air d'un conseil pour celui à
qui on l'adresse, peut-être même d'un appel explicite à une communauté
d'efforts et de dangers. Mais puisque je trouve en vous des dispositions
de bienveillance et de sympathie si bien arrêtées, je m'en empare de
grand cœur; toutefois en ce sens seulement (car je veux rester fidèle à
ma réserve habituelle ) que si vous accomplissez votre promesse, je vous
en saurai un gré infini, et que si vous ne l'accomplissez point, je ne
vous en ferai point un crime. Je me dirai, dans cette hypothèse, que
vous avez de justes craintes; dans l'autre, que vous ne savez rien me
refuser. La question en effet est grave. Ce que veut le devoir est assez
clair, ce que veut l'intérêt l'est un peu moins. Toutefois, si nous
sommes ce que nous devons être, c'est-à-dire, si nous nous montrons
dignes de tout ce que nous ont appris l'étude et les lettres, nous ne
douterons pas que ce qui est le plus juste ne soit aussi le plus
avantageux. Si donc le projet vous en plaît, venez me trouver sans
perdre un moment. Si, la chose étant de votre goût, vous ne pouvez
pourtant pas me rejoindre ici, ni partir sur-le-champ, je ferai en sorte
de vous informer de tout. Quoique vous fassiez, je vous tiens pour mon
ami, pour mon meilleur ami, si vous faites ce que je souhaite.
380. — A
ATTICUS. Cumes, 2 mai.
A. X, 8. Vos avis s'accordent avec
mes propres observations, et la chose parle assez d'elle-même. Il est
temps de cesser une correspondance qu'on peut saisir, et qu'il y aurait
dès lors péril à continuer. Mais ma Tullie m'a écrit plusieurs fois pour
me supplier de ne pas prendre un parti avant de savoir comment les
choses se passeraient en Espagne. Elle ajoute que c'est votre avis, et
je le vois bien par vos lettres. A cela j'ai plusieurs choses à dire. Le
conseil me paraîtrait bon, si j'avais a régler ma conduite sur les
événements d'Espagne. Ou César sera chassé du pays, ce que je souhaite
fort; ou la guerre traînera en longueur,
367
ou enfin il s'en rendra maître, comme il semble n'en pas douter. S'il
est chassé, n'aurais-je pas bonne grâce alors à aller trouver Pompée? et
quel gré m'en saurait-il, lorsque Curion lui-même pourrait bien aussi,
je le suppose, en faire alors autant? Si la guerre traîne en longueur,
combien de temps faudra-t-il attendre? Enfin si nous sommes vaincus, il
est clair que je ne bouge pas. Voici comme je raisonne. J'aime mieux le
quitter vainqueur que vaincu, et quand il doute encore du triomphe que
lorsqu'il s'en croirait assuré. S'il est vainqueur, je prévois des
massacres, des confiscations, le rappel des bannis, la banqueroute, les
honneurs accordés aux plus infâmes; enfin une tyrannie qui serait
insupportable même à un Perse, bien plus à un Romain. Mon indignation
pourrait-elle rester silencieuse? Il me faudrait voter avec Gabinius,
après lui peut-être! Avoir à mes côtés votre client Clélius, le client
de C. Atéius, Plaguléius, mille autres encore! Je cite des ennemis.
N'éprouverais-je pas déjà assez de dépit à la vue de mes plus intimes,
de gens que j'ai défendus, et au milieu desquels il faudrait, non sans
mourir de honte, me trouver au sénat? Que sais-je? On m'interdirait
peut-être l'entrée de la curie : ses amis me mandent qu'il a été fort
mécontent de ne pas m'y voir en dernier lieu. Je n'ai pas voulu de son
alliance, quand elle m'offrait des avantages; dois-je me vendre à lui,
quand il n'y a que péril à le faire? Considérez enfin que tout ne sera
pas décidé avec la question d'Espagne, à moins qu'en perdant cette
province. Pompée ne mette bas les armes : mais il n'a que Thémistocle en
tête, et il se persuade que quand on est maître de la mer on est maître
de tout. Aussi remarquez qu'il n'est pas de sa personne en Espagne, et
qu'il ne met d'intérêt qu'à se rendre formidable sur mer. On le verra,
lorsqu'il en sera temps, réunir une puissante flotte, mettre à la voile
et débarquer en Italie. Nous qui sommes restés, que deviendrons-nous
alors? Plus de neutralité possible. Nous opposerons-nous à sa descente?
quelle extrémité et quel opprobre ! Nous fera-t-il un crime de notre
absence et de notre sécurité? irons-nous partager avec Pompée et ses
lieutenants les inimitiés et les vengeances de l'autre? Laissons un
moment de côté le devoir, et ne faisons acception que du danger. Là, il
y a péril en faisant mal; ici, péril en faisant bien. Péril partout.
Point de doute alors : ne faisons pas en nous exposant ce que nous ne
voudrions pas faire pour nous sauver. Mais pourquoi n'avoir pas passé la
mer avec Pompée? La chose était matériellement impossible. Qu'on
rapproche les époques, et je l'avoue quand je pouvais garder cela pour
moi, j'ai cru, je n'aurai pas du croire peut-être, mais enfin j'ai cru à
la paix, et je n'ai pas voulu avoir pour ennemi César redevenu l'ami de
Pompée : je les connais, ce sont toujours les mêmes hommes. Voilà le mot
de mes retardements. Aujourd'hui l'occasion est à moi, si je me hâte ;
elle est perdue, si j'hésite. C'est ce que me disent aussi, mon cher
Atticus, certains augures en qui j'ai toute confiance; non les augures
de notre collège que consulte Appius, mais ceux de Platon sur les
tyrans. Je mets hors de doute que notre homme (César) ne peut passe
soutenir, et que, dût notre résistance être languis-
368
sante, il ne tombe de lui même, lui a qui, dans ses plus beaux moments
et dans toute sa nouveauté, il n'a pas fallu plus de six ou sept jours
pour se faire exécrer de cette populace avide et affamée ; et qui a si
vite abandonné le double mensonge de sa douceur et de sa richesse, en
traitant comme il l'a fait Métellus et le trésor public. Voyez quels
seront ses ministres et ses seconds pour conduire les provinces et la
république ! Il n'y en a pas un qui ait su gouverner son patrimoine
pendant deux mois. Inutile de remarquer ici tout ce qu'il y a à en dire,
vous le savez aussi bien que moi ; mais réfléchissez-y un moment, et
vous verrez qu'un tel règne n'en aurait pas pour six mois a durer. Me
trompé-je? Eh bien. Je prendrai mon parti comme tant d'hommes illustres
et de grands citoyens, à moins pourtant que vous ne préfériez pour moi
le lit de mort de Sardanapale à l'exil de Thémistocle, l'homme, au dire
de Thucydide, qui jugeait le mieux le présent et appréciait le mieux
l'avenir, et qui néanmoins tomba dans des malheurs qu'il eût évités s'il
avait su tout prévoir. Quoique, toujours suivant Thucydide, personne ne
fût plus habile à reconnaître le bon et le mauvais côté des choses, il
ne sut se mettre à couvert, ni contre la jalousie des Spartiates, ni
contre la jalousie de ses concitoyens, et il ne vit pas où le menaient
ses engagements avec Artaxerce. Si on ne se trompait jamais, notre
Africain, le plus sage des hommes, n'aurait pas vu cette nuit cruelle
qui fut pour lui sans lendemain ; et C Marius, le plus rusé des hommes,
n'aurait pas eu les durs moments que Sylla lui a fait subir. Mais
l'augure dont je parle ne me trompe point, il est Infaillible,
l'événement le prouvera. Il faut que cet homme tombe ou sous les coups
de ses adversaires, ou par ses propres mains, car il n'a pas de plus
dangereux ennemi que lui-même. Nous vivrons assez pour le voir,
j'espère. Apres tout, il est temps que je songe a la vie dont la durée
est sans fin de préférence à cette misérable vie d'un jour. Que si
quelque incident en avance le terme, il m'est aussi indiffèrent de
toucher déjà au moment suprême, que de l'avoir longtemps en expectative.
Avec de tels sentiments, irai-je faire ma soumission à ceux contre qui
le sénat m'a arme d'un décret de salut public? Je vous ai donne mes
instructions sur tout, et votre amitié rend mes recommandations
superflues. Je n'ai donc plus rien à vous dire, sinon que j'attends le
premier vent favorable pour m'embarquer. Que dis-je? il est une chose
qu'il importe par-dessus tout que je vous écrive; c'est que de toutes
vos bontés, si nombreuses pour moi, aucune ne m'est plus douce et plus
sensible que vos aimables attentions et vos tendres soins pour ma chère
Tullie. Elle en a été enchantée, et je n'y suis pas moins sensible
qu'elle. Avec quelle résignation elle supporte les calamités publiques
et les chagrins d'intérieur! Quel courage dans notre séparation ! Sa
tendresse est infinie. Son âme ne fait qu'une avec la mienne. Eh bien!
elle ne voit que ce que le devoir et l'honneur me prescrivent. Je
m'arrête, je crains ma propre émotion. Ne manquez pas, je vous prie, de
me tenir au courant des nouvelles d'Espagne, et de tout ce qui pourrait
survenir pendant que je suis encore ici. Peut-être vous écrirai-je
moi-même un mot avant mon départ, surtout s'il est vrai, comme Tullie me
l'assure, que vous n'aurez point quitté l'Italie. J'ai maintenant à
recommencer avec Antoine les mêmes
369
manœuvres qu'avec Curion, pour qu'on me laisse à Malte sous ma promesse
d'être neutre. Puissé-je trouver l'un aussi accommodant et aussi facile
que l'autre! On annonce son arrivée à Misène pour le 6 des nones,
c'est-à-dire, pour aujourd'hui. Il s'est fait précéder de l'odieuse
lettre dont je vous envoie copie.
ANTOINE, TRIBUN DU PEUPLE ET PROPRÉTEUR, A CICÉRON, IMPÉRATOR, SALUT.
« Sans l'amitié
que j'ai pour vous, et qui est plus forte que vous ne pensez, je ne
m'inquiéterais pas d'un bruit qui court à votre sujet, d'autant plus que
je le crois sans le moindre fondement. Mais je vous aime trop pour ne
pas m'affecter même de rumeurs vaincs. Non, je ne puis croire que vous
vouliez passer la mer, vous à qui Dolabella et voire charmante Tullie
sont si chers, vous qui nous êtes si cher à tous, vous enfin qui ne
pouvez, je le jure, prendre plus à cœur que nous ce qui touche à votre
honneur et à votre considération. Il n'y aurait pas, selon moi, d'amitié
à rester insensible à de méchants propos ; et je m'en suis d'autant plus
préoccupé que je sens toute la délicatesse de ma position envers vous,
par suite de ces démêles où je m'accuse de plus de vivacité que je ne
saurais vous reprocher de torts. Je tiens à vous convaincre que, César
excepté, il n'est personne pour qui j'aie plus d'affection que pour
vous, et qu'il n'est personne à ma connaissance sur le dévouement de qui
César compte davantage. Je vous en supplie donc, mon cher Cicéron,
abstenez-vous de toute démarche qui vous engage; gardez-vous de qui a
voulu vous faire payer son appui par un injurieux abandon, et n'allez
pas fuir comme un ennemi un homme qui, lors même qu'il ne vous aimerait
pas, chose impossible, voudrait encore vous voir puissant et honoré. Je
vous envoie cette lettre par Calpurnius, mon ami particulier, afin que
vous sachiez à quel point j'ai à cœur tout ce qui se rapporte à votre
salut et à votre gloire. » Le même jour, Philotime m'a apporté de
la part de César une autre lettre dont voici la copie :
CÉSAR,
IMPERATOR, A CICÉRON, IMPERATOR SALUT. 17 avril.
« Je vous crois
tout à fait incapable d'agir imprudemment et à la légère. Cependant il
court des bruits qui m'inquiètent, et je me décide à vous écrire.
N'allez pas, je vous en supplie, au nom de nos bons rapports, n'allez
pas vous rallier à une cause aujourd'hui compromise, quand vous n'en
avez pas voulu alors que les chances étaient entières. Voulez-vous vous
soustraire à l'arrêt de la fortune ? Ce serait outrager l'amitié, ce
serait vous faire gratuitement tort à vous-même. Tout ne nous a-t-il pas
réussi? tout ne leur a-t-il pas été contraire? Non, vous ne cédez point
à des affections de parti : leur cause était la même, quand vous
refusâtes d'aller prendre place dans leurs conseils. Il faut donc que
j'aie fait quelque action bien condamnable; car jamais démarche de votre
part n'aura pour moi une signification plus grave. Gardez -vous de la
faire. Je le demande à votre amitié. J'en ai le droit; et dites-moi
d'ailleurs si la neutralité n'est pas le rôle qui convient le mieux à un
homme de bien et de paix, à un bon citoyen. Quelques hommes, qui au fond
pensaient ainsi, ont été jetés hors de la voie par un sentiment de
crainte. Mais pour vous qui savez ma vie entière
370
qui pouvez en interroger tous les témoignages, et qui connaissez mon
amitié, quoi de mieux et de plus honorable que de vous abstenir? En
marche, le 16 des kalendes de mai. »
381. — A ATTICUS. Cumes, mai.
A. X, 9. Philotime est arrivé : vous
savez quelle tête folle, et quel magasin de fausses nouvelles favorables
à Pompée. Il a mis la mort dans l'âme a mes commensaux. Moi, je suis de
marbre. Nous pensions tous que César avait suspendu sa marche : c'est le
contraire, dit Philotime; César vole. On avait annoncé la jonction de
Pétréius avec Afranius. Philotime prétend que la nouvelle ne s'est pas
confirmée. Que voulez- vous? On assure que Pompée, à la tête de forces
considérables, se dirige par l’Illyrie vers la Germanie. Cela est donné
comme positif. Eh bien ! partons vite pour Malte. Allons-y attendre les
événements d'Espagne, .l'entre un peu par là dans les idées de César,
puisqu'il me dit dans une de ses lettres que la neutralité est pour moi
le parti le plus honorable et le plus sûr. Qu'est donc devenu,
allez-vous me direendrissants; il me conjure de ne pas brusquer ma résolution, de
ne pas compromettre ma position, mon fils, ma famille, par un coup de
tête . Nos enfants n'ont pu lire sa lettre sans des torrents de larmes.
Cicéron toutefois montre une fermeté qui ne fait que rendre ma
sensibilité plus vive. Il ne songe qu'aux exigences de l'honneur. A
Malte donc ! on verra ensuite. — Écrivez-moi un mot encore, je vous
prie, surtout si vous savez quelque chose d'Afranius. En cas d'entrevue
avec Antoine, je vous dirai comment les choses se seront passées : mais
je ne me fierai qu'à bon escient à ses paroles, soyez tranquille. Je ne
pense plus à me cacher : c'est trop difficile et trop dangereux.
J'attendrai Servius jusqu'aux nones. Postumius et le jeune Servius m'en
ont prié. Enfin votre fièvre quarte commence a tomber. Tant mieux ! Je
vous envoie une copie de la lettre de Célius.
382. — A ATTICUS. Cumes, 3 mai.
A. X, 10. Aveugle que j'étais !
Comment n'ai-je pas vu ce qui arrive ! Lisez cette lettre d'Antoine; je
lui avais écrit mille fois que je n'avais aucune pensée hostile à César,
que je n'oubliais pas mon gendre, que je n'oubliais pas l'amitié que, si
je l'avais voulu, je serais avec Pompée; seulement que j'avais
l'intention de quitter l'Italie, parce qu'il ne me convenait pas de
courir sans cesse à droite et à gauche avec mes licteurs; mais que ce
n'était pas même encore une idée arrêtée. Voyez ce que l'ivrogne me
répond : « Comme votre conduite est franche ! quand on veut rester
neutre, on demeure chez soi. Qui émigre se prononce. Au surplus, ce
n'est pas « à moi de juger si l'on a ou non des raisons légitimes de
partir. J'ai l'ordre positif de César de ne laisser sortir d'Italie qui
que ce soit. Ainsi, il importe peu que j'approuve votre intention,
puisque je n'y puis rien. Envoyez un exprès à César, et présentez-lui
votre demande ; il l'ac-
371
cueillera, je n'en doute pas, surtout si vous y joignez la promesse de
ne point faillir a notre amitié. » Voilà bien la scytale lacédémonienne.
Il faut absolument que je lui donne le change. Il doit arriver le 5 des
nones au soir, c'est-à-dire, aujourd'hui; peut-être viendra-t-il me voir
demain. J'userai de ruse, je lui dirai avec assurance que rien ne me
presse, je lui cornerai aux oreilles que je vais envoyer un exprès à
César; puis je me tiendrai coi quelque part avec un très-petit nombre de
mes gens, et je parviendrai bien à m'échapper en dépit de tout.
Puissé-je seulement rejoindre Curion ! les dieux me protègent ! je suis
piqué au vif, on verra quelque trait de ma façon. Votre indisposition
m'afflige; vous m'obligerez beaucoup de ne pas la négliger, surtout dans
le principe. Que j'aime vos nouvelles de Marseille ! Tenez-moi, je vous
prie, au courant de tout ce que vous apprendrez. J'irais rejoindre
Ocella si je le pouvais ouvertement, comme j'en étais convenu avec
Curion; j'attends ici Servius; sa femme et son fils m'en ont prié. Il le
faut, je crois. Antoine traîne à sa suite Cythéris dans une litière
découverte ; sa femme est dans la seconde. 11 en a de plus sept autres
de suite, toutes remplies ou de maîtresses ou de mignons. Voilà par
quelles honteuses mains il nous faut périr ; et doutez après cela, si
vous le pouvez, du sang qui coulera au retour de César ou vainqueur ou
vaincu! Pour moi, je prendrai plutôt une nacelle, à défaut de vaisseau,
pour me sauver de leurs mains parricides. Je vous en dirai plus quand
j'aurai vu Antoine. Je ne puis me défendre d'aimer notre jeune homme,
mais je vois clairement qu'il ne nous aime point. Je n'ai jamais vu
d'esprit plus de travers, le contre-pied de tous les siens une tête qui
bouillonne sans cesse. Quelle source d'afflictions! je fais de mon mieux
pour rectifier cette nature étrange. Il faut le veiller de près.
383. — A ATTICUS. Cumes, mai.
A. X, 11 . Après avoir fermé ma
dernière lettre, l'idée me vint de ne plus la confier à la personne qui
devait s'en charger, et qui n'est pas des nôtres. Aussi ne fut-elle pas
expédiée à sa date. Dans l'intervalle est arrivé Philotime, qui m'a
remis celle ou vous vous plaignez de mon frère. Oui, c'est un caractère
faible, mais sans fard, sans détours, facile à ramener au bien, et dont
vous ferez d'un mot tout ce que vous voudrez. Sans aller plus loin, il
ne cesse de s'emporter contre les siens, et pourtant il les aime
tendrement, moi en particulier plus que lui-même. Touchant son fils, il
écrit à vous dune façon, et à la mère d'une autre. Je n'y vois pas grand
mal. Ce que je trouve fâcheux, c'est ce que vous me dites de votre
sœur, et a propos de ce voyage; d'autant plus que je n'y puis que
faire, placé comme je le suis. Dans une autre situation, je trouverais
remède au mal ; mais voyez ou nous en sommes réduits. Quant à la somme
qu'il vous doit, ce n'est rien moins que mauvaise volonté de sa part, je
l'ai vu cent fois, s'il tarde à vous payer. Il y fuit tous ses efforts.
Mais quand je ne puis, moi, à la veille d'un départ, rentrer dans les
treize mille sesterces que j'ai prêtés au fils de Q. Axius; quand je
vois le père s'excuser sur le malheur des temps; quand Lepta et autres
font de même, en vérité je m'étonne de vous voir tourmenter mon frère
pour ces vingt milles sesterces, vous qui connaissez son embarras.
372
Au surplus, ses ordres sont donnés pour vous satisfaire. Ne le croyez
pas serré et mauvais payeur; jamais homme ne le fut moins. Passons au
fils. Il est vrai que son père ne l'a jamais assez tenu; mais
l'indulgence ne rend pas un enfant menteur, intéressé, et sans amitié
pour les siens : elle peut seulement le rendre fier, hautain, turbulent.
Il a les défauts qu'engendre une éducation trop molle, mais ce sont des
défauts qui se tolèrent. Et puis, il faut le dire, il est si jeune !
mais il en a d'autres qui deviennent bien graves par les circonstances
fatales où nous sommes. Je ne me dissimule malheureusement pas, moi qui
l'aime, que ceux-là ne procèdent pas de notre indulgence. Non, la cause
en est radicale. Je viendrais bien à bout de les déraciner, si j'en
avais le loisir : mais au temps où nous vivons, il faut tout supporter.
Quant à mon fils, j'en fais ce que je veux. C'est le caractère le plus
maniable. Mon cœur se brise pour cet enfant; voilà ce qui m'ôte
l'énergie. Plus il me veut ferme, et plus je crains à son égard de me
montrer cruel. — Antoine est arrivé hier au soir. J'aurai sans doute sa
visite, à moins qu'il ne veuille en rester sur la lettre où il me
notifie sa volonté. Quoi qu'il advienne, je vous écrirai. Je ne puis
plus partir que secrètement. Mais que faire de nos jeunes gens? Irai-je
les exposer sur une nacelle? Jugez ce que j'aurai à souffrir dans cette
traversée. Je me rappelle encore les alarmes de cette navigation en
vaisseau plat de Rhodes, et c'était en été. Que sera-ce quand je les
verrai sur une frêle barque, dans la saison de l'année la plus cruelle?
De tous côtés des angoisses ! J'ai ici Trébatius, homme excellent et bon
citoyen. Que d'horreurs il entrevoit, grands dieux? Balbus prétendre au
sénat? mais vous entendrez Trébatius lui-même. Je lui donnerai demain
une lettre pour vous. Je crois à l'amitié de Vectiénus sur votre parole.
Il m'avait réclamé sou argent d'un ton un peu incisif. Je me suis piqué,
et peut-être ai- je poussé avec lui la plaisanterie un peu loin. S'il a
pris la chose trop au sérieux, faites ma paix. Je l'ai appelé Monétalis
en tête de ma lettre. Il m'avait donné du proconsul tout court. Mais
s'il entend raison et n'en est pas moins mon ami, je reste le sien.
384. — A ATTICUS. Cumes, mai.
A. X, 12. Que devenir? Je suis le
plus malheureux des hommes et en même temps le plus déshonoré. Antoine
prétend avoir injonction spéciale de me retenir. Je ne l'ai pas vu
lui-même, mais il l'a déclaré à Trébatius. Quel parti prendre, quand
rien ne me réussit, et que mes plus sûres combinaisons sont précisément
celles qui me tournent le plus mal? Je regardais comme une bonne fortune
d'avoir trouvé la Curion, et je me croyais au bout de mes peines. Il
avait écrit pour moi à Hortensius. Réginus était tout à moi. Mais je ne
me doutais pas qu'Antoine eût rien à voir sur cette côte. Où fuir
maintenant? me voilà gardé à vue. Toutefois trêve de gémissements. Il ne
me reste plus qu'à gagner furtivement quelque barque, et à voguer malgré
vents et marée. Risquons tout, plutôt que de laisser croire que les
obstacles qui me retiennent ne sont qu'un jeu joué. Gagnons d'abord la
Sicile. Une fois là, j'aurai de l'espace devant moi. Pourvu que les
choses tournent bien en Espagne! pourvu même que ce qu'on dit de la
Sicile soit vrai, si peu que ce soit I On dit que la population en masse
est venue au devant de Caton, qu'elle l'a supplié de se mettre
373
à sa tête, en lui offrant toutes les ressources de l'île ; qu'il s'est
rendu à leurs vœux et a commencé des levées. La nouvelle m'est
suspecte; mon auteur voit tout eu beau. Ce qui est incontestable , c'est
qu'on pourrait se maintenir en Sicile. Au surplus, on saura bientôt
quelque chose d'Espagne. Marcellus est ici, ayant le même dessein que
moi, du moins en faisant semblant à merveille. Nous ne nous sommes pas
vus, mais j'ai causé avec un de ses intimes. Faites-moi part de vos
nouvelles. De mon côté, je ne vous laisserai rien ignorer de mes
démarches. Je tiens de près le fils de Quintus. Puissé-je réformer son
caractère! Déchirez, je vous prie, les lettres où je parle de lui trop
en mal. Ces choses-là doivent rester entre nous. J'en ferai autant des
vôtres. Servius va venir; mais je n'attends de lui rien de bon. Je vous
en écrirai dans tous les cas. Je me suis trompé, il faut que j'en
convienne. Trompé une fois? sur un seul point? Allons! je me suis trompé
d'un bout à l'autre, et ce sont toutes mes précautions qui m'ont perdu.
« Mais laissons le passé et ses regrets, » et tâchons de sauver ce qui
peut rester encore de l'avenir. Vous me dites de tout prévoir pour ma
fuite. Prévoir quoi ? Tout n'est que trop prévu; il n'y a guère à
délibérer. Rester ici avec ma honte et mes remords, ou m'échapper, au
risque de tomber aux mains de ces bandits. Mais voyez à quelle extrémité
je me trouve réduit! J'en suis à désirer parfois un mauvais traitement,
afin qu'il soit notoire que je suis mal avec le tyran. Ah! si le moyen
d'évasion que j'espérais pouvait se retrouver, je saurais bien répondre
à vos vœux et justifier mes retards. Mais l'on fuit autour de moi si
bonne garde, et je ne me fie pas trop même à Curion. Reste à me faire
jour par la force, ou à tromper la surveillance par un déguisement.
J'aurai, dans un cas, affaire aux éléments; dans l'autre, à mes ennemis.
Et si je suis pris sur le fait, quelle ignominie! Mais l'honneur
commande et m'entraîne. Je ne reculerai devant rien. Je me propose
souvent Célius pour exemple : que l'occasion de faire comme lui se
présente, je n'y manquerai pas. L'Espagne tiendra bon, je l'espère. Le
coup de vigueur des Marseillais est une excellente chose en soi, et j'en
conclus que tout va bien en Espagne. S'ils se sont tant avancés, c'est
qu'ils ont des informations sûres; ils sont à proximité et ne
s'endorment point. Oui, vous avez raison, ce qui s'est passé au théâtre
est un symptôme de mécontentement. C'est aussi, je le vois, dans les
légions levées en Italie qu'il trouve le moins d'affection. Mais son
plus grand ennemi, c'est lui-même. Vous avez bien raison de craindre
qu'il ne tourne à la violence ; et il y tournera, si ses affaires vont
mal. Raison de plus pour moi de me signaler par quelque entreprise à la
Célius. Et puissé-je être plus heureux! Quoi que je fasse, de quelque
manière que je m'y prenne, vous le saurez aussitôt. Soyez tranquille sur
le jeune homme. Je suis là, et ferai face au besoin à tout le
Péloponnèse. Il y a du fonds chez lui. L'éducation rectifie la nature et
peut même y suppléer, à moins qu'on ne prétende que la vertu ne
s'acquiert point; ce qu'on ne me persuadera jamais.
385. — A ATTICUS. Cumes, mai.
A. X, 13. Votre lettre a enchanté ma
Tullie, et moi par contrecoup : il y a toujours quelque
374
chose à gagner dans votre correspondance. (Continuez donc à m’écrire. Si
vous pouvez me donner quelque bonne nouvelle, n'y faites faute, N’allez
pas avoir peur des lions d'Antoine. Jamais on ne fut plus doux et plus
aimable que lui. Voulez-vous un échantillon de sa tenue comme homme
public? Il avait convoqué par lettres les premiers décurions et les
quatuorvirs des villes municipales. Des le matin voilà mes gens qui
arrivent. Mais Antoine est au lit, et ne bouge qu'à la troisième heure
(neuf heures du matin). Plus tard on lui annonce les gens de Cumes et de
Naples, à qui César garde rancune : il les remet au lendemain. Il avait
à se baigner, il avait un laxatif à prendre : telle est sa journée
d'hier. Il se propose aujourd'hui de passer dans l'île d'Enaria. il
annonce hautement le retour des bannis. Mais assez sur son compte.
Occupons-nous de ce qui nous intéresse. — J’ai reçu une lettre d'Axius.
Bien obligé pour Tiron. Vectiénus est tout aimable. J'ai remboursé
Vestorius. On dit que Servius a couche à Minturne la veille des nones de
mai, et qu'il s'arrêtera aujourd'hui à Literne chez Marcellus. J'aurai
donc sa visite demain de bonne heure, et ainsi de quoi remplir une
lettre. Je commençais à ne savoir que vous écrire. Je m'étonne
qu'Antoine ne m'ait pas adressé même un message. Il avait toujours
montré pour moi beaucoup d'égards. Probablement il a des ordres pénibles
en ce qui me concerne, et il ne veut pas avoir à me dire non en face.
Mais je ne lui aurais pas demandé de grâce; et m'en eût-il accordé, je
ne me serais pas lié à sa parole. Je trouverai bleu quelque autre voie.
— Donnez-moi, je vous prie, des nouvelles d'Espagne; on doit maintenant
en avoir. Elles sont attendues comme si tout devait s'y décider. Pour
moi, je ne vois pas plus le succès assuré si nous conservons l'Espagne,
que désespéré si nous la perdons. Peut-être s'est-il élevé des obstacles
au départ de Siiius, d'Ocella et des autres. Il paraît que vous en
éprouvez vous-même de la part de Curtius, bien que muni d'un
passeport;
je le suppose.
386. — A
ATTICUS. Cumes, mai.
A. X, 14. Quelle misérable vie!
cette appréhension continuelle est un mal pire que le mal lui-même.
Ainsi que je vous l'ai déjà mandé, Servius, arrivé le jour des nones de
mai, est venu me voir le lendemain. Pour ne pas vous faire languir, je
vous dirai que nous n'avons pu arriver à aucune conclusion. Jamais je ne
vis d'homme plus terrifié ; et, par Hercule, il ne craint rien qui ne
soit à craindre. L'un lui veut du mal, l'autre ne lui veut guère de
bien. La victoire, quelque parti qu'elle favorise, amènera des scènes
d'horreur; soif de sang d'un côté, audace effrénée de l'autre; chez tous
deux : extrême pénurie d'argent, et qui ne pourra s'assouvir que par des
spoliations. Ses larmes coulaient pendant ces réflexions, et avec une
abondance qui depuis longtemps eût dû en tarir la source. Quant à moi,
ce n'est pas à force de pleurer que mes yeux souffrent au point de
m'empêcher d'écrire; c'est l'irritation produite par l'insomnie. Aussi,
je vous conjure de rassembler tout ce que vous trouverez de consolations
à m'offrir : non pas de celles qu'on puise dans la philosophie et dans
les livres, celles-là je puis les tirer de mon propre fonds ; et
toutefois je ne sais pourquoi le mal est plus fort que le remède. C'est
en Espagne, à Marseille, qu'il faut aller me chercher des consola-
375
tions. Servius m'en apporte d’assez bonnes de ces pays- là. Il paraît
même que la nouvelle des deux légions vient de bonne source. Voilà ce
qu'il me faut, ou quelque chose de semblable. On ne peut tarder à avoir
des nouvelles. — Pour revenir à Servius, nous remîmes notre conversation
au lendemain ; mais il ne peut se résoudre à partir; il aimerait mieux
attendre les événements dans son lit. La campagne de son fils à Brindes
le gène terriblement. Il m'a pourtant énergiquement déclaré que si l'on
rappelait les bannis, il s'exilerait lui-même. Je lui ai dit que le
rappel aurait lieu infailliblement, qu'on voyait tous les jours des
choses de cette force; et j'en multipliais les preuves. Loin de
s'affermir dans sa résolution, je vis ses hésitations croître au point
que, n'espérant pas le déterminer, j'ai cru devoir lui l'aire mystère de
mon dessein. Il n'y a pas réellement de fond à faire sur Servius. Votre
avis est bon. Je songerai à l'exemple de Célîus.
387. — A
ATTICUS. Cumes, mai.
A. X, 15. Servius était encore chez
moi le 6 des ides, quand Céphalion m'a remis votre lettre. La nouvelle
des huit cohortes me donne bonne espérance. Les cohortes d'ici sont
également, dit-on, prèles à lui échapper. Le même jour, Funisulanus m'a
apporté une seconde lettre de vous qui confirmait la première. Je l'ai
rendu content au dernier degré pour ce qui le concerne, et je vous en ai
laissé tout l'honneur. Il est mon débiteur d'une forte somme, et ne
passe pas pour être riche. Mais il sera bientôt, dit-il, en mesure de me
payer au moyen d'un remboursement qu'on lui a fait un peu attendre. Vous
pourriez charger un messager de cet argent dès qu'il vous sera remis.
Éros, l'affranchi de Philotime, vous dira le chiffre exact. — Mais
parlons de choses plus importantes : vous serez satisfait; sous peu,
l'exemple de Célius portera son fruit. Seulement je suis au supplice.
Dois-je ou non attendre les vents favorables? Il ne faut qu'un drapeau :
tout le monde va s'y rallier. Vous me conseillez d'agir sans mystère,
c'est tout à fait mon avis, et je suis décidé à partir. Écrivez-moi
toujours en attendant. Servius ne se décide a rien. Il a objection a
tout. Je ne connais de plus peureux que C. Marcellus, qui se repent
d'avoir été consul, et qui, dit-on (le lâche!), pousse Antoine à
empêcher mon départ, sans doute pour se couvrir de mon manteau, Antoine,
au contraire, est parti pour Capoue le 6 des ides, et m'a fait dire que,
s'il n'était pas venu me voir, c'était par discrétion, me croyant fâché
contre lui. Je partirai donc, et partirai comme vous me le conseillez, à
moins que d'ici là il n'y ait quelque chose de mieux à faire. Mais il
n'y a pas d'apparence que l'occasion s'en présente de si tôt. Cependant
l'opinion du préteur Alliénus est qu'il y a un grand rôle à jouer, et
que si ce n'est moi, ce sera un de ses collègues. N'importe qui, pourvu
que quelqu'un s'en charge. Je vous approuve pour votre sœur. Le jeune
Quintus a tous mes soins, et j'en augure mieux, Quant à mon frère, je
vous jure, il est fort tourmenté de sa dette. Mais il n'a encore rien pu
tirer de L. Egnatius. Axius y va sans façon avec ses douze mille
sesterces. Il m'avait écrit de donner à Gallius tout ce qu'il
demanderait; quand il ne me l'eut pas écrit, aurais-je pu m'en
dispenser? ne m'étais-je pas mis à sa disposition? mais trouver à
l'instant pareille somme! Que je m'avise de compter sur
376
eux, moi, dans mes embarras présents ! Les dieux !e leur rendent! Mais
laissons ces gens-là. Enfin vous voilà délivrés de votre fièvre quarte,
vous et Pilia. J’ai bien du plaisir à vous en faire mon compliment.
Pendant qu'on charge mon vaisseau de vivres et autres provisions, je
vais faire une excursion à Pompéi. Remerciez, je vous prie, Vectiénus de
ses bonnes dispositions; et s'il se présente une occasion de m'écrire
avant mon départ, ne la laissez point échapper, je vous en conjure.
388. – A
ATTICUS. Cumes, mai.
A. X, 16. Dionysius vint chez moi
l'autre jour de grand matin, comme je venais de vous écrire
tranquillement sur une foule de choses. Il n'aurait pas eu de peine à me
désarmer, et j'étais même disposé à tout oublier; mais il fallait au
moins qu'il eût les dispositions que vous m'aviez annoncées. La lettre
que j'ai reçue de vous à Arpinum portait positivement qu'il venait se
mettre à ma discrétion. Ma volonté ou plutôt mon désir était de le
garder. C'est précisément pour m'a voir déjà refusé net à Formies, que
je m'étais expliqué sur son compte avec tant d'humeur. Il ne m'a dit que
quelques mots, où en somme il me prie de ne pas lui en vouloir, et me
déclare que le soin de ses affaires ne lui permet pas de rester. Ma
réponse fut bientôt faite. Le trait avait porté. Je sentais le
contrecoup de ma mauvaise fortune. Que voulez-vous? Vous auriez beau
vous étonner, mes grands chagrins ne m'empêchent pas d'être sensible à
celui-ci. Puisse Dionysius rester votre ami ! C'est vous souhaiter que
la fortune vous soit fidèle. Tant qu'elle durera, comptez sur lui. — Mon
plan, je pense, n'offre aucun danger. Je saurai feindre, et bien prendre
mes précautions. Que j'aie seulement le vent pour moi, et, autant que la
prudence peut le faire, je réponds de tout. En attendant que je parte,
écrivez-moi, je vous prie, non-seulement ce que vous savez et ce qu'on
dit, mais encore ce que vous prévoyez de l'avenir. Rien n'empêchait
Caton de conserver la Sicile. Sa présence eût suffi pour en faire le
rendez- vous de tout ce qu'il y a de gens de bien au monde. Mais Curion
m'écrit qu'il a quitté Syracuse le 8 des kalendes de mai. Puisse du
moins Cotta se maintenir en Sardaigne, comme on le dit ici! S'il en est
ainsi, quelle honte pour Caton ! — Afin de donner le change sur mon
départ et mes projets, je suis parti pour Pompéi le 4 des ides, et j'y
resterai tout le temps que dureront les préparatifs de la traversée. En
y arrivant, on m'annonça que les centurions des trois cohortes en
garnison dans la ville devaient venir me trouver le lendemain. Mon ami
Ninnius me dit en confidence que leur intention était de me livrer la
place. Mais moi je vous ai laissé là Pompéi dès le lendemain avant le
jour, afin d'éviter jusqu'à l'ombre d'une entrevue. Qu'est-ce que trois
cohortes? et quand il y en aurait eu davantage, avec quoi les
entretenir? J'ai songé au sort de Célius, et j'ai pensé tout ce que vous
m'en dites dans la lettre que je viens précisément de recevoir en
arrivant à Cumes. Peut-être était-ce un piège qu'on me tendait? J'ai ôté
prise à tout soupçon. — Pendant que j'étais en route pour revenir,
Hortensius est venu faire visite à Tèrentia : il n'a eu à mon sujet que
des paroles flatteuses. Je le verrai, je pense ; car il m'a envoyé un de
ses esclaves me dire qu'il reviendrait. Voilà un procédé meilleur que
celui
377 de
mon collègue Antoine, qui promené une comédienne dans sa litière, au
milieu de ses licteurs. Quant à vous, puisque la fièvre quarte est
partie, que le dernier accès a manqué, et qu'il ne vous en reste même
plus de trace, venez avec toute votre santé nous retrouver en Grèce. En
attendant, quelques bonnes petites lettres, je vous prie.
389. — A ATTICUS. Cumes, 16 mai.
A. X, 17. Hortensius est venu me
voir la veille des ides, comme je venais de finir ma lettre. Puisse-t-il
être toujours ainsi pour moi ! Que de protestations de dévouement I Je
compte bien le mettre a l'épreuve. Un moment après, Sérapion m'apporta
votre lettre. Avant de l'ouvrir, je dis à Sérapion que vous m'aviez déjà
écrit en sa faveur. Je lus ensuite votre lettre, et tout ce que
j'ajoutai le combla. Eu effet, c'est, je crois, un excellent sujet,
instruit autant qu'honnête. Je pourrai me servir de son navire, et
l'engager à s'embarquer avec moi. — Mon mal d'yeux me tourmente sans
cesse, non pas au point d'être insupportable, mais assez pour m'empêcher
d'écrire. J'apprends avec joie que votre santé est tout à fait remise,
et des atteintes de votre dernière maladie, et des ressentiments que
vous aviez éprouvés. Je voudrais bien avoir Ocella : tout ici en irait
mieux. Maintenant nous ne sommes plus arrêtés que par l'équinoxe, qui
est fort mauvais cette aimée. Des que le temps se remettra, je n'aurai
qu'un souhait à faire : c'est qu’Hortensius ne change point. On n'est
pas meilleur que lui, jusqu'à ce jour. — Vous vous récriez sur mon mot
de passeport, comme si j'avais voulu y entendre malice et vous le
reprocher comme un crime. Vous n'imaginez pas, dites-vous, d'où peut me
venir une pareille idée. Mais vous m'aviez écrit que vous partiez;
j'avais ouï dire qu'on ce pouvait partir sans passeport. Je trouvais
donc tout simple que vous en eussiez un, surtout en ayant pris pour vos
gens. Mon observation n'a pas d'autre cause. Mandez-moi, je vous prie, à
quoi vous vous déterminez, et n'oubliez pas de me donner des nouvelles.
Le 17 des kalendes de juin.
390. — A
ATTICUS. Cumes, mai.
A. X, 18. Tullie est accouchée d'un
fils à sept mois, le 14 des kalendes de juin. Sa délivrance a été
heureuse, à ma grande joie. Mais son enfant est d'une faiblesse extrême.
Les calmes qui continuent de me retenir sont incroyables, et me gênent
bien plus que la surveillance dont je suis entouré. Les belles paroles
d'Hortensius ont abouti à néant, chose assez ordinaire. Ce n'en est pas
moins un vilain homme. Son affranchi Salvius l'a perverti. Je ne veux
plus vous dire : Je ferai ceci, mais bien : J'ai fait cela; car il me
semble qu'il y a des Coryciens (des espions) de tous côtés qui guettent
mes paroles. Quant à vous, ne cessez, je vous prie, de 'en ressent. Je songe
maintenant à Formies; peut-être y trouverai-je encore les furies ( les
troupes de César) sur mon chemin. D'après votre conversation avec
Balbus, je renonce à Malte. Est-ce que vous pouvez croire qu'il (César)
ne 378
me regarde pas encore son ennemi? J’ai écrit à Balbus au sujet de ce que
vous me dites de sa bienveillance et de ses soupçons. Je le remercie sur
le premier point; disculpez-moi sur l'autre. Y eut-il jamais, a votre
avis, homme plus infortuné que moi? Mais je ne veux pas vous mettra au
supplice. Ce qui me désole, c'est d'en être venu ace point que le
courage et la prudence ne peuvent rien pour moi.
391. — A TÉRENTIA. Du port de Calète, 11 juin.
F. XIV, 7. Je suis enfin parvenu à
me débarrasser de ce malaise et de ces inquiétudes qui, à mon grand
chagrin, vous ont rendu si malheureuses, vous et notre chère petite
Tullie, que j'aime plus que moi-même. J'en ai reconnu la cause le
lendemain de mon départ. J'ai dans la nuit vomi de la bile toute pure,
et à l'instant je me suis senti soulagé, comme si un dieu m'eût lui-même
apporté le remède. Vous aurez soin, en femme pieuse et fervente, d'en
rendre grâce aux dieux, c'est-à-dire, d'offrir un sacrifice à Apollon et
à Esculape. Je crois que nous avons un navire excellent; à peine
embarqué, je vous écris à vous d'abord, puis je ferai quelques lettres
de recommandation à vos intimes pour vous et notre chère enfant. Je vous
exhorterais l'une et l'autre au courage, si je ne connaissais votre
courage plus que viril à toutes deux. D'ailleurs les choses tourneront,
j'espère, de manière à vous rendre votre séjour là-bas aussi agréable
que possible, et à me mettre moi-même un jour en position de servir la
république avec les hommes qui me ressemblent. Je vous recommande votre
santé avant tout. En second lieu, si vous le trouvez bon, fixez de
préférence votre séjour dans celles de nos propriétés qui seront le plus
loin des gens de guerre. Vous seriez, par exemple, très bien à Arpinum
avec toute votre maison de la ville, surtout si les vivres devenaient
trop chers à Rome. Cicéron, qui est plus charmant que jamais, vous fait
mille tendresses. Adieu, adieu. Le 3 des ides de juin.
AN DE R. 706. -
47 AN. AV. J. C. — DE C. 60.
C. J. César, pour
la seconde fois, et Serv. Isauricus, consuls.
392. — A
ATTICUS. De l'Épire, février.
A. XI, 1. J'ai reçu le billet dont
vous aviez chargé Antéros. Il n'a pu rien m'apprendre de mes affaires
domestiques. Elles sont dans un état déplorable, et ce qui augmente mon
chagrin, la main qui en tenait le fil est maintenant éloignée. En quel
lieu? je ne sais. Pour ma réputation comme pour mes intérêts, je puis
donc absolument compter sur votre affection tant de fois éprouvée. Si
vous ne me la retirez pas dans cette extrémité cruelle, j'en aurai plus
de courage contre les maux qui nous accablent. Donnez-moi encore cette
preuve d'amitié, je vous en conjure. J'ai en Asie deux raillions deux
cent mille sesterces en cistophores. Il vous sera facile, en tirant des
lettres de change sur cette somme, de faire honneur à mes engagements.
Si je n'avais cru mes ressources locales en état d'y faire face, et cela
sur la foi d'un homme dont vous avez de longue main appris à vous
défier, j'aurais ajourné mon déport et mis ordre à mes affaires. Si cet
avis vous arrive un peu tard, c'est que je n’ai pas su plus tôt ce que
j'avais a craindre. A l'aide, à l'aide, je vous en supplie! Qu'il me
soit donné
379
de jouir du succès de mes associés, si la fortune les favorise ; et
puissé-je en rapporter le bienfait à votre amitié!
393. — A ATTICUS. De l’Empire, février.
A. XI, 2. J'ai reçu votre lettre la
veille des nones de février, et le jour même j'ai accepté la succession.
Au milieu de toutes mes misères, j'aurai un souci de moins, si, comme
vous le dites, l'actif de l’héritage suffit pour satisfaire mes
créanciers et mettre mon honneur à couvert. Je vois bien que lors même
que cette ressource me manquerait, je pourrais encore compter sur vous.
Quant à la dot de ma fille, au nom des dieux, je vous eu conjure,
consacrez à secourir cette infortunée, qui l'est par ma faute, tout ce
qui me reste, s'il me reste quelque chose; faites au besoin des avances
de vos deniers, vous le pouvez sans gène. Enfin veillez, vous me le
promettez et j'y compte, veillez à ne pas la laisser manquer de tout. Ou
passent donc les revenus de mes terres? Voilà soixante mille sesterces
de moins. C'est la première fois que j'en entends parler. Je n'eusse
jamais consenti à en diminuer d'autant les échéances de la dot. Mais
j'ai bien d'autres sujets de plaintes que je ne puis vous raconter, tant
mon cœur se serre. J'ai retiré la moitié environ des fonds que j'avais
en Asie. Je crois cet argent plus en sûreté là où il est maintenant
qu'entre les mains des fermiers publics. Du courage, me dites-vous; mais
où sont, je vous prie, vos motifs de confiance? et s'il est vrai, pour
surcroît de maux, que, quoique vous ne m'en ayez rien dit, on en
veuille, comme le dit Chrysippe, à ma maison, fut-il jamais homme plus
infortuné que moi? Pardon, pardon ; je ne puis continuer. Vous voyez
l'excès de ma douleur. Encore si ce malheur m'affligeait en commun avec
ceux de mon parti, je me le reprocherais moins et le supporterais mieux.
Mais je n'ai pas même cette consolation. Ah! tachez, s'il en est temps
encore, d’empêcher que je ne sois l'objet de rigueurs et de persécutions
exceptionnelles. J'ai tardé à vous renvoyer votre messager, mais je n'ai
pu le faire plus tôt. J'ai reçu de vos gens soixante-dix mille
sesterces, avec les habits dont j'avais besoin. Écrivez en mon nom, je
vous prie, à qui vous le jugerez nécessaire. Mes amis vous sont connus.
Ils seront surpris de voir une autre écriture et un autre cachet. Dites
que j'ai craint que mes lettres ne fussent interceptées.
394. —
CÉLIUS A CICÉRON. Rome, mars.
F. VIII, 17. Que n'ai-je été à
Formies plutôt qu'en Espagne, quand vous êtes allé joindre Pompée ! Et
plût au ciel du moins que Curion eût été de ce parti-là comme Appius
Claudius; Curion, dont l'amitié m'a engagé dans cette cause détestable!
Oui, je le sens, l'affection d'un côté et le ressentiment de l'autre ont
concouru à me faire perdre la tête. Mais vous aussi, quand pour vous
voir je vins de nuit a Ariminum, et que je me chargeai de vos paroles de
paix pour César, votre rôle de bon citoyen, dites-moi, ne vous a-t-il
pas fait oublier celui d'ami? Vous n'avez pas eu même un conseil pour
moi. Ce n'est pas que je doute de notre cause ; mais il vaut mieux
mourir que d'avoir affaire à ces gens-la. Sans la crainte de vos
représailles, il y a longtemps que nous ne serions plus ici. A Rome,
sauf quelques usuriers, tout est pompéien, les
380
individus comme les ordres. J'ai mis dans vos intérêts jusqu'à la
canaille qui nous était si dévouée et même ce qui s'appelle le peuple.
Comment, me direz-vous? Attendez, .le vous ferai vaincre en dépit de
vous-même. Je veux être un second Caton. Vous dormez; vous ne voyez
seulement pas combien nous prêtons le flanc, combien nous sommes
faibles. Aucun intérêt ne m'excite en ce moment, mais je suis vindicatif
a mon ordinaire, et l'on me traite indignement. Que faites-vous donc
là-bas? Voulez-vous livrer bataille? c'est le fort de vos adversaires.
Je ne connais pas vos troupes, mais les nôtres savent se battre et ne
craignent le froid ni la faim. Adieu.
395. —
DOLOBELLA A CICÉRON. Rome, mai.
F. IX, 9. Recevez mes compliments.
Notre Tullia est en parfaite santé. Votre Térentia n'a pas toujours été
bien portante; mais je suis certain qu'elle est maintenant rétablie. Du
reste, tout va chez vous le mieux du monde. A aucune époque, sans doute,
le conseil que je vous ai donné de vous ralliera César et à nous, ou
tout au moins de rester neutre, n'a pu vous être suspect; l'esprit de
parti n'y était pour rien ; votre intérêt seul me l'inspirait.
Aujourd'hui que la victoire a prononcé, il est impossible de ne pas
reconnaître que je cédais à un besoin de mon cœur en vous tenant le
langage que je vous ai tenu. Et si cette lettre vous parvient, qu'elle
soit bien ou mal venue de vous, vous la prendrez encore en bonne part,
mon cher Cicéron, et vous n'y verrez que l'inspiration de mon
dévouement. — Vous le voyez, ce grand nom de Pompée, toute la gloire que
l'homme avait acquise, cette brillante clientèle de peuples et de rois
dont il faisait tant de bruit, tout cela n'a pu lui assurer même la
ressource ordinaire du vaincu, une honorable retraite. Il se voit
chasser d'Italie, déposséder de l'Espagne, enlever toute une armée de
vieux soldats; il se voit enfin cerné de toutes parts, et je ne crois
pas qu'il y ait un seul général romain à qui de pareils désastres soient
arrivés. Lui reste-t-il la moindre chance? pouvez-vous fonder sur lui le
moindre espoir? J'en appelle à votre raison, à votre sagesse ; elles ne
vous inspireront que de salutaires pensées. J'insisterai cependant sur
un point : s'il venait à échapper et à se réfugier sur ses vaisseaux,
cessez défaire abnégation de vos intérêts, et tâchez d'aimer les autres
un peu moins que vous-même. Voila bien assez de sacrifices faits au
devoir, à l'amitié, à votre parti et à la république, telle du moins que
vous l'entendiez. Il est temps pour tous de rester là où est la patrie,
sous peine, en poursuivant je ne sais quel fantôme de république
surannée, de n'embrasser qu'une ombre. Je vous en conjure donc, mon
bien-aimé Cicéron, si Pompée, expulsé de nouveau, doit chercher d'autres
régions pour asile, retirez-vous à Athènes ou dans quelque cité
paisible. Une fois ce parti pris, faites-le-moi savoir, et il n'est rien
que je ne fasse pour accourir près de vous. Tout ce que votre nom et
votre position exigent, vous l'obtiendrez de César. Vous connaissez sa
bonté. Il ne vous refuserait rien à vous-même, et je me flatte que mes
prières ne seront pas sans influence sur lui. Ma confiance et votre
amitié me sont garants que mon messager reviendra avec une réponse.
381 396. — A TERENTIA. Du
camp de Pompée, juin.
F. XIV, 8. Je vous conjure d'avoir
bien soin de votre santé. On m'écrit et on vient de me dire que vous
aviez été subitement saisie d'un accès de fièvre. Je vous sais un gré
infini de la célérité que vous avez mise à me faire part des lettres de
César. Si vous aviez besoin de quelque chose, ou s'il arrivait quelque
incident nouveau, faites que je le sache. Ne négligez rien pour votre
santé. Adieu.
397. — A ATTICUS. Du camp de Pompée, 13 juin.
A. XI, 3. Le porteur de votre lettre
vous dira en quel état nous sommes. Je l'ai retenu assez longtemps,
comptant chaque jour sur du nouveau. Il n'est rien survenu, et je ne
vous écris que pour vous répondre. Quant à mes intentions aux kalendes
de juillet, la question n'est pas facile à résoudre. Compromettre une
somme si considérable en dus temps si malheureux, faire ce divorce au
milieu de telles incertitudes, je ne puis là-dessus, comme en toute
chose, que m'en remettre à votre constante amitié, et laisser ma fille
maîtresse de l'alternative. Il est bien malheureux pour elle que je
n'aie pu jadis m'entendre avec vous de vive voix plutôt que par lettres,
sur ce qu'exigeait le soin de nos intérêts et de notre existence. Je
n'ai, dites-vous, aucun risque particulier à courir. C'est toujours un
point de tranquillité; mais il y a, vous le savez très bien, plus d'un
sujet d'inquiétudes qui ne concernent que moi, qui sont très graves, et
que j'aurais pu aisément m'épargner. Ils peuvent s'alléger, si vous me
prêtez, comme vous l'avez toujours fait, le secours de votre active
prudence. — J'ai de l'argent chez Egnatius ; qu'il reste où il est. La
crise actuelle ne peut durer longtemps. Je verrai plus tard à prendre un
parti. Cependant je manque de tout; et notre chef n'est pas dans une
condition meilleure, bien que je lui aie fait un prêt considérable, me
flattant de pouvoir un jour m'en faire honneur, si l'ordre se rétablit.
Si vous jugez çà propos que j'écrive à tel ou tel, chargez-vous de le
faire eu mon nom. Mes compliments à votre famille. Soignez votre santé.
Sur toute chose, rappelez-vous votre promesse, et mettez toute votre
sollicitude à ne laisser manquer de rien une personne dont les
souffrances, vous le savez, sont les plus cruels de mes maux.
398. — A ATTICUS. Du camp de Pompée, juin.
A. XI, 4. J'ai reçu une lettre de
vous par Isidore; puis deux autres de plus fraîche date. Je vois par la
dernière que mes biens de campagne ne se vendent pas. Il vous faudra
donc pourvoir de votre bourse aux besoins de ma fille. Quant à Frusinum,
s'il m'est donné de vivre, c'est une chose tout à fait à ma convenance.
La rareté de mes lettres tient à la disette des nouvelles. Je ne sais
rien qui mérite votre attention; et d'ailleurs, ni la tournure des
choses, ni les mesures qu'on prend, ne me conviennent le moins du monde.
Ah ! que je voudrais m'être dans le temps entendu avec vous de vive
voix, plutôt que par correspondance! Je soutiens vos intérêts de mon
mieux auprès de ceux-ci. Celer agit de son côté. Je n'ai voulu jusqu'à
présent me charger de quoi que ce fût, rien de ce qu'on fait n'étant de
mon goût ni dans mes vues. Vous me demandez ce qui s'est passé de
nouveau. Isidore vous le dira. Le reste va sans doute marcher aussi
aisément.
382
Bien, bien ! continuez, je vous prie, de veiller au plus chez de mes
intérêts. Mon tourment d'esprit est sans relâche et ma santé s'en
ressent. Dès qu'elle me le permettra, j'irai conférer avec celui qui
mène nos affaires et qui est dans une grande confiance. Notre ami Brutus
montre ici un grand zèle. Voilà tout ce que la prudence me permet de
vous écrire. Et le second payement, ne négligez rien pour l'assurer, je
vous prie; je vous en ai déjà écrit par Pollex.
399. — A
TÉRENTIA. Du camp de Pompée, juillet.
F. XIV, 6. Il se présente rarement
des occasions pour vous écrire, et je n'ai rien d'ailleurs qui puisse
faire le sujet d'une lettre. Je vois par votre dernière lettre que vous
n'avez réussi à rendre aucune de vos terres. Avisez donc de votre mieux,
je vous prie, avec nos amis, au moyen d'en finir avec cette dette, dont
vous savez que je veux absolument me libérer. Que notre très chère vous
témoigne de la reconnaissance, quoi d'étonnant? Elle vous doit beaucoup
: il est tout simple qu'elle le sente et l'exprime. Est-ce que Pollex
n'est pas encore parti? débarrassez-vous-en donc au plus vite. Ayez bien
soin de votre santé. |