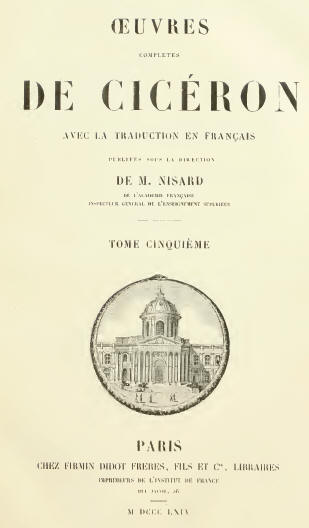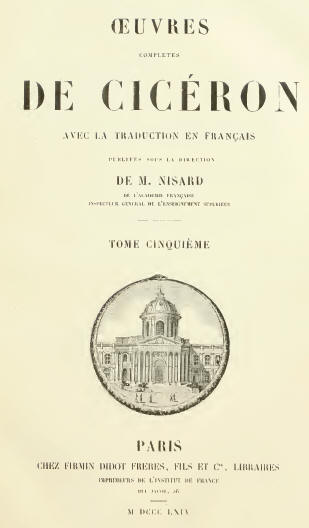|
700. — A ATTICUS. Pouzol, avril.
A. XIV, 10. Est-il bien vrai? ce
Brutus qui nous est si cher n'aurait frappé ce grand coup que pour être
a Lanuvium ! Trébonius ne pourrait se rendre à son gouvernement que par
des chemins détournés : et tout ce que César a fait, écrit, dit, promis
ou même pensé, aurait autorité plus grande que de son vivant! Vous
rappelez-vous le jour de la retraite au Capitole, comme je demandais à
grands cris qu'on y fît convoquer le sénat par les préteurs? Dieux
immortels! que ne pouvait-on pas faire dans ce premier moment de ferveur
pour les honnêtes gens et même pour les tièdes, et de consternation pour
les méchants? La faute en est, dites-vous, aux fêtes de Bacchus : que
pouvait-on alors? déjà tout était perdu. Vous rappelez-vous ce que vous
disiez tout haut; que c'en était fait, si on lui élevait un bûcher? Eh
bien! en plein forum on a brûlé son corps, on a prononcé son éloge, on
s'est apitoyé sur son sort, et l'on a mis la torche à la main à des
esclaves, à des mendiants, pour venir incendier nos demeures. Vous savez
la suite. On ose dire aujourd'hui : Est-ce que vous voulez aller
contre la volonté de César? C'est vraiment trop fort, et je n'y puis
plus tenir. Aussi je veux aller vivre ailleurs. Le lieu même où vous
êtes n'est pas sûr. Vos maux de cœur sont-ils tout à fait passés? Votre
lettre me le donne à entendre. Je reviens aux Tébassus, aux Scéva, aux
Frangon. Croyez-vous possible que ces gens-là soient tranquilles dans
leur usurpation, tant qu'ils nous verront en face, nous d'ailleurs à qui
ils croyaient plus de cœur que nous n'en avons? Beaux amis de l'ordre
vraiment, les auteurs de tous les vols! Ce que je vous ai dit de
Curtilius au sujet des biens de Sextilius, prenez que je le pense des
Censorinus, des Messalla, des Plancus, des Postumius et de toute la
clique. Lui mort, il valait mille fois mieux périr (ce qui ne serait pas
arrivé), que de voir ce que nous voyons. — Octave est arrivé à Naples le
14 des kalendes. Balbus l'y a vu le lendemain matin, et il est venu le
jour même a Cumes m'annoncer qu'Octave se proposait d'accepter la
succession de César; mais, comme vous le dites, il aura terriblement
maille a partir avec Antoine. Je donne et donnerai toute l'attention que
je dois à voire affaire de Buthrote. Vous me demandez si le bien de
Cluvius rendra cent mille sesterces; il en approchera, je pense. Mais
j'en ai déjà mangé quatre-vingt mille celte année. Quintus a beaucoup à
se plaindre de la conduite de son fils, qui est au mieux aujourd'hui
avec sa mère, avec qui il était en guerre ouverte tant qu'elle a été
bien avec son père. La lettre de mon frère contre son fils est des plus
vives. Que fait ce jeune homme en ce moment? Si vous le savez et si vous
êtes encore à Rome, veuillez me le mander. Bien entendu, dites-moi aussi
les nouvelles, s'il y en a. C'est un grand bonheur pour moi que vos
lettres.
701. — A ATTICUS. Pouzzol,
avril.
A. XIV, 11. Je vous ai écrit
avant-hier une assez longue lettre. Je réponds aujourd'hui à vos
dernières questions. Oui, je voudrais voir Brutus a Asture. Vous me
parlez de l'insolence de ces misérables : avez-vous donc espéré mieux?
nous en verrons bien d'autres. Lorsque je lis dans leurs discours : « un
si grand homme, un citoyen si illustre, » la patience
m'échappe. Il vaudrait mieux en rire. Pourtant, souvenez-vous de ce que
je vous dis : on habitue l'oreille du peuple à ces déclamations
perfides; si bien que nos amis, ces héros, ces demi-dieux, avec leur
gloire immortelle non contestée, vont se trouver en butte à la haine,
exposés à mille dangers. La conscience de ce qu'ils ont fait les
console. Mais où sera notre consolation à nous, qui sommes délivrés du
tyran et qui ne sommes pas libres? Un caprice de la fortune sera notre
sort; la raison ne tient plus le gouvernail. — Ce que vous m'écrivez de
Cicéron me fait plaisir. Puisse-t-il justifier mes espérances! Je vous
sais un gré infini de vos soins pour fournir assez largement à ses
besoins et à ses dépenses : continuez, je vous en prie. — Vous jugez
très-bien l'affaire de Buthrote, et moi je ne la perds pas de vue. Je me
chargerai même de tout. La tâche devient chaque jour plus facile.
Puisque vous vous intéressez à mes affaires plus que moi-même, je vous
dirai que le bien de Clinius pourra produire cent mille sesterces.
L'éboulement qui a eu lieu ne réduira pas ce chiffre; je suis, au
contraire, fondé à espérer une augmentation. J'ai ici avec moi Balbus,
Hirtius et Pansa. Octave vient d'arriver, et même à ma porte, chez
Philippe; il est tout à fait à ma dévotion. Lentulus Spinther passe la
journée chez moi, et part demain matin.
702. — A ATTICUS. Pouzzol, avril.
Α. XIV, 12. Ô mon cher Atticus,
nous n'avons, je le crains bien, gagné aux ides de mars qu'un moment de
joie et le plaisir de la vengeance. Que me mande-t-on? que vois-je? Ô
action admirable et vaine tout ensemble! Vous savez combien je porte
d'intérêt aux Siciliens, et tiens à honneur leur clientèle. César
faisait beaucoup pour eux, et j'étais loin de m'en plaindre, quoiqu'on
eût bien pu ne pas leur accorder les droits des peuples du Latium.... et
encore! Mais voici qu'Antoine, moyennant une grosse somme d'argent qu'il
a reçue, fait publier une loi qu'aurait portée, dit-on, aux comices, le
dictateur, et par laquelle les habitants de la Sicile sont tous déclarés
citoyens romains. De son vivant, on n'en a jamais dit un mot. Mais quoi!
est-ce que l'affaire de Déjatorus n'est pas exactement la même? Certes
il n'y a pas un royaume qu'il ne mérite d'obtenir! mais le tenir de
Fulvie! .le vous en raconterais de la sorte par centaines. Je reviens à
mon l'ait. Comment, dans une affaire aussi éclatante, aussi bien
établie, aussi juste, comment dans l'affaire de Ruthrote
n'obtiendrions-nous pas au moins une partie de nos demandes, quand on se
montre si facile pour d'autres? Octave me traite ici avec autant de
distinction que d'amitié : les siens l'appellent César; Philippe non, ni
moi non plus, par conséquent. Octave ne peut pas, je le déclare, être un
bon citoyen; il n'entend bourdonner autour de lui que des menaces de
mort contre nos amis. Impossible, disent-ils, de leur passer ce qu'ils
ont fait. Que sera-ce, je vous le demande, lorsque cet enfant arrivera à
Rome, où déjà nos libérateurs ne peuvent pas se trouver en sûreté? Sans
doute ils seront à jamais célèbres, heureux même par le témoignage de
leur conscience : mais pour nous, ou je me trompe fort, ou nous n'en
serons pas mieux. Dans cette persuasion, je veux fuir, et j'irai
jusqu'aux lieux où, comme dit le poète, le nom des Pélopides n'est pas
venu. Je hais ces consuls désignés qui me forcent de tenir ici cours de
déclamation, et me rendent tout repos impossible, même, aux eaux. Cela
tient, il est vrai, à ma trop grande facilité. Jadis ma complaisance
était en quelque sorte, nécessaire; de quelque manière que les choses
tournent, elle ne l'est plus aujourd'hui. Depuis longtemps je n'ai rien
à vous écrire, et je ne vous en écris pas moins. Ce n'est pas pour vous
faire plaisir, mais pour vous arracher une réponse. Parlez-moi de ce qui
se passe, de Brutus surtout. Je vous écris aujourd'hui, 10 des kalendes,
à table chez Vestorius, assez pauvre dialecticien, mais calculateur fort
habile.
703. — A ATTICUS. Pouzzol, avril.
A. XIV, 13. On me remet enfin, à
sept jours de date, la lettre que vous m'avez écrite de 13 des kalendes.
Vous me demandez ce que j'aime le mieux ici, de mes coteaux et de leurs
beaux points de vue, ou de la promenade unie de la vallée. Vous croyez
m'embarrasser. Et, en effet, le charme de ces lieux est si grand que je
ne saurais vraiment dire ce que je préfère. « Mais comment avoir le cœur
aux festins, en face du désastre immense envoyé par Jupiter, quand nous
sommes saisis de crainte, et quand nous ne savons pas s'il nous sera
donné de vivre, ou s'il nous faudra mourir? » Ce n'est pas
que vous ne m'annonciez une grande et bien bonne nouvelle, l'arrivée de
Décimus Brutus au milieu de ses légions. J'en tire un bon augure. Mais
en supposant que la guerre civile éclate (elle éclatera si Sextus reste
sous les armes, et il y restera; ) que ferons-nous? Voilà ce que
j'ignore. Il ne nous sera pas permis, comme dans la guerre de César, de
n'être, ni pour ni contre. Quiconque se sera réjoui de la mort de César
(et nous ne nous en sommes pas cachés) sera traité en ennemi ; alors ce
sera un carnage. Irons-nous chercher un asile sous la tente de Sextus,
on bien encore sous celle de Brutus? C'est un effort qui répugne à
nos âges. Puis l'issue de la guerre est trop incertaine, et nous pouvons
nous dire l'un à l'autre : « Ο mon fds, il ne t'est pas donné
d'atteindre à la gloire des guerriers. L'éloquence que le ciel t'a
départie te destine à des lauriers plus doux. » Le mieux
sera de nous abandonner au hasard, qui pourra plus ici que la prudence.
Appliquons-nous seulement (ceci dépend de nous ) à supporter les
événements avec courage et sagesse, en nous rappelant ce que nous
sommes; et demandons aux lettres ou aux ides de mars de nous consoler du
reste. Décidez maintenant, et faites cesser les incertitudes qui
m'agitent : il y a tant de raisons pour et contre ! En partant, comme
j'en avais dessein, avec une mission pour la Grèce, j'écarte en partie
les périls qui menacent ma tête; mais je m'expose au reproche de manquer
à la république dans de si graves circonstances. Si je demeure au
contraire, je suis, il est vrai, personnellement en danger; mais il peut
arriver que je sois utile à la chose publique. Enfin il y a aussi
quelques motifs particuliers pour que j'aille en Grèce. J'y serais, j'en
suis convaincu, d'un grand secours à Cicéron pour achever son éducation.
Je n'avais même pas d'autre but, lorsque je songeai dans le temps à
demander une mission à César. Pesez toutes ces réflexions, je vous prie,
avec l'attention que vous mettez toujours à ce qui me touche. — Je
reviens a voire lettre : le bruit court, dites-vous, que je veux vendre
ce que j'ai près du lac; on ajoute que mon frère veut à tout prix avoir
cette toute petite maison, pour y établir, comme son fils vous l'a dit,
Aquillia, qui va devenir son épouse. En ce qui me concerne, je ne songe
pas le moins du monde, à vendre; à moins qu'il ne se rencontre quelque
chose qui me convienne davantage. De son côté, Quintus ne se soucie pas
de rien acheter. Il a bien assez à faire de rembourser la dot, et à cet
égard il se loue infiniment d'Egnatius. Quant à prendre femme, il en est
à cent lieues. Rien de si bon, dit-il, que de coucher seul. — Assez sur
ce sujet; je reviens à notre pauvre république, si république il y a.
Antoine m'a écrit pour le rappel de Sex. Clodius. Vous verrez par sa
lettre dont je vous envoie copie combien il me montre de déférence; mais
au fond que de corruption et de turpitude! Quel homme dangereux! c'est à
en regretter quelquefois César. Ce que César n'eût jamais fait ni
souffert, on l'ose aujourd'hui en son nom, à l'aide de falsifications
odieuses. Je me suis montré facile avec Antoine. Il est évident que ce
qu'il s'était mis en tête, il l'aurait fait bon gré, mal gré. Vous
trouverez ci-jointes sa lettre et ma réponse.
D'ANTOINE A CICERON.
Je vous adresse une prière que mes
occupations et votre départ soudain m'ont empêché de vous faire de vive
voix, et je crains bien qu'elle n'y perde. Mais vous me rendrez vraiment
heureux, si vous confirmez l'opinion que j'ai toujours eue de la bonté
de votre cœur. J'avais sollicité et obtenu de J. César le rappel de
Sextus Clodius, bien décidé toutefois à ne m'en prévaloir qu'autant que
vous y donneriez les mains. Aujourd'hui plus que jamais je tiens à votre
assentiment. Si devant un malheur comme le sien vous demeurez
inexorable, je me résignerai, quoiqu'un autre devoir me soit tracé par
les instructions de César. Mais si vous prenez conseil de l'humanité, de
la sagesse, et de vos bons sentiments peur moi, vous vous laisserez
toucher. P. Clodius (fils de l'ennemi de Cicéron) est un jeune homme
plein d'avenir. Vous voudrez qu'il sache que, pouvant persécuter les
amis de son père, vous ne l'avez pas fait. Souffrez, je vous eu conjure,
qu'il ne voie dans vos débats que l'opposition de l'homme publie. Cette
famille n'est pas à dédaigner, et l'on transige avec plus d'honneur et
moins de difficultés sur les querelles politiques que sur les inimitiés
personnelles. Ne m'empêchez pas d'élever cet enfant dans cette maxime
dont je veux pénétrer sa jeune âme : Point de haines héréditaires! Je
suis loin de croire assurément que, dans une position comme la votre, on
ait jamais rien a craindre. Mais sans doute vous préférez une vieillesse
honorée et paisible à une vieillesse sans cesse agitée. Enfin j'ai bien
quelques droits à ce que je vous demande comme une grâce; car il n'y a
rien que je n'aie fait de mon côté pour vous. Si je ne réussis pas, je
renonce à rappeler Clodius de mon chef. Vous voyez quelle est ma
déférence ; laissez-moi espérer qu'elle vous touchera.
REPONSE DE CICERON A ANTOINE.
Je regrette pour un seul motif que vous ne
m'ayez point parlé au lieu de m'avoir écrit : c'est que vous auriez pu
voir non-seulement à mon langage, mais encore sur ma physionomie, dans
mes yeux, et, comme on dit, dans toute ma personne, les sentiments que
j'ai pour vous. Je vous ai toujours aimé, par retour d'affection
d'abord, puis par reconnaissance. Et aujourd'hui la république me parle
trop haut en votre faveur, pour que personne au monde puisse m'être
aussi cher que vous. Vous m'écrivez en termes si affectueux, vous me
montrez une si honorable déférence, que j'en suis tout pénétré; et
c'est, selon moi, m'accorder une faveur, loin de m'en demander une, que
de ne vouloir point, sans mon consentement, lorsque rien ne vous le rend
indispensable, rappeler un homme a vous, qui se trouve être un de mes
ennemis. Eh bien! cet homme, je le remets entièrement entre vos mains,
mon cher Antoine, et je tiens la lettre que je viens de recevoir de vous
comme le plus généreux el le plus flatteur de tous les procédés. Ce que
vous souhaitez, je le ferais, en tout cas, uniquement pour vous
complaire; mais je cède aussi, croyez-le bien, à ma nature et au
penchant de mon cœur. Il n'y a pas de fiel en moi. Et même on ne m'a
guère vu me faire rigide et sévère plus que ne le voulait la raison
d'état. J'ajoute que contre Sextus en particulier jamais je n'ai donné
signe de haine; car je me suis fait une loi de ménager les amis de mes
ennemis, surtout quand ils sont à terre. Cette pratique a des avantages
dont il ne faut pas se priver. Quant au jeune Clodius, il vous
appartient, comme vous le dites, de prévenir son âme contre les haines
héréditaires. Lors de mes démêlés avec Publius, il défendait sa cause,
et moi celle de l'Etat. La république s'est prononcée pour moi. S'il
vivait, je ne conserverais aucun ressentiment; mais puisque vous voulez
mon consentement pour une chose qui est absolument en votre pouvoir,
puisque vous êtes dans l'intention de ne point passer outre sans l'avoir
obtenue, faites valoir ce consentement au jeune Clodius, si telle est
votre envie. Ce n'est pas que, quand je songe à mon âge et au sien, je
puisse rien appréhender de sa part, ou que mon caractère recule devant
des luttes; mais je désire que nous vivions en meilleure intelligence:
car il faut dire que si toutes ces querelles ne m'ont pas fermé votre
cœur, elles m'ont du moins interdit votre maison. Je finis : mais encore
un mot. Partout où mon entremise vous sera désirable et utile, elle est
à vous sans hésitation et de tout cœur; veuillez en être convaincu.
704. — A ATTICUS. Pouzzol, avril.
A. XIV, 14. Comment? répétez, je
vous prie. Notre Quintus aux jeux Pariliens de César, la couronne en
tête? aux jeux Pariliens? Et seul? Ah! et Lamia aussi! Voilà de quoi me
surprendre. Citez-moi un peu les autres noms, s'il vous plaît; quoique
je sois sûr d'avance qu'il n'y en aura pas un d'honorable. Donnez-moi
des détails. Il s'est trouvé que je vous avais écrit le 6 des kalendes
assez longuement, quand trois heures après j'ai reçu de vous une lettre
très-remplie. Ai-je besoin de vous dire combien j'ai ri de vos
spirituelles plaisanteries sur la secte Vestorienne et sur la coutume
des banquiers de Pouzzol? Alais parlons politique. Vous défendez les
deux Brutus et Cassius comme si je les attaquais, moi qui pense qu'on ne
peut les louer assez. Je m'en prends aux événements et non aux hommes;
car enfin le tyran n'est plus, et la tyrannie est debout! ce que le
tyran n'aurait jamais osé faire, on le fait! témoin le rappel de
Clodius. J'ai la certitude aujourd'hui que non-seulement il n'y avait
pas pensé, mais qu'il ne l'aurait pas souffert. Bientôt viendra le tour
de Rufio le Vestorien, puis de Victor, dont le nom n'est écrit nulle
part; puis des autres. Car à qui s'arrêtera-t-on? Nous n'avons pas voulu
être esclaves de l'homme, et nous obéissons à des chiffons de papier.
Pouvait-on se dispenser d'aller au sénat le jour des l'êtes de Bacchus?
Dites que oui tant que vous voudrez. Cela fera-t-il qu'une fois à la
curie on ait pu opiner librement? N'a-t-il pas fallu de vive force
maintenir les droits des vétérans qui nous environnaient en armes, nous
sans défense? Vous savez mieux que personne combien j'ai désapprouvé
cette assemblée du Capitole. Qu'en conclure? que c'est la faute des
Brutus? non sans doute; c'est la faute de gens à qui le nom de brutes
convient à merveille, et qui se croient pourtant bien sages et bien
habiles : de ces gens comme on en trouve pour applaudir, même pour
serrer la main, mais qui ne sont plus là quand il faut vous défendre. Au
surplus, laissons le passé Serrons-nous seulement autour de nos
libérateurs, et, comme vous le dites si bien, consolons-nous avec ces
ides de mars, qui ont ouvert à nos amis, à des demi-dieux, les portes du
ciel, mais qui n'ont pas ouvert au peuple romain les portes de la
liberté. Rappelez-vous vos prédictions. Ne proclamiez-vous pas à grands
cris que tout était perdu, si on lui élevait un bûcher? Vous aviez bien
raison, et l'on voit aujourd'hui ce qui est sorti de ce bûcher. Vous me
dites qu'Antoine doit faire son rapport sur les gouvernements aux
kaiendes de juin; qu'il demandera pour lui les deux Gaules, avec une
extension de la durée légale pour ses pouvoirs. Pourra-t-on voter comme
on voudra? Si on le peut, je me réjouirai du retour de la liberté. Si on
ne le peut pas, qu'aurai-je gagné, je vous prie, à un changement de
maître, si ce n'est la joie de renaître mes yeux de la mort d'un tyran ?
Le temple d'Ops, dites-vous, est au pillage : je m'y attendais. Faut-il,
grands Dieux! qu'une poignée de héros nous aient délivrés, et que nous
ne puissions être libres ! A eux la gloire! à nous les sottises! Et vous
m'engagez à écrire ; l'histoire! et vous voulez que je trace le tableau
des attentats sous lesquels nous gémissons encore ! Et ceux qui
vous ont fait signer leur testament, pourrai-je. n'en pas parler avec
éloge? Ce n'est pas à coup sûr quelque peu d'argent qui me touche. Mais
quand un homme vous fait du bien, quel qu'il soit, il est dur d'en dire
du mal. Je crois d'ailleurs, comme vous, que nous pourrons plus en
connaissance de cause décider toutes ces questions aux kaiendes de juin.
J'y serai sans faute; et, soutenu de votre nom, de votre crédit, de
l'incontestable justice de vos droits, il n'y aura pas d'efforts que je
ne fasse, de soins que je n'emploie, pour obtenir sur l'affaire de
Buthrote un décret tel que vous le souhaitez. Vous voulez que je
réfléchisse encore avant de prendre un parti. Je réfléchirai. Et
cependant c'était à vos réflexions que j'avais fait appel. A propos,
croyez-vous donc la république tout à fait ressuscitée, que vous rendez
déjà à vos voisins de Marseille ce qui leur appartient? On pourrait tout
par la force matérielle, et je ne sais jusqu'à quel point nous pouvons y
compter. On ne peut plus rien par la force morale.
705. —A BITHYNICUS Pouzzol.
F. V1, 17. J'ai bien des raisons
pour souhaiter que la république se rassoie; mais, en lisant votre
lettre, j'y trouve un motif de plus encore, puisque vous me dites
qu'alors nous pourrions vivre ensemble. C'est une perspective qui me
charme. Je reconnais là votre amitié, et aussi la bonne opinion que l'un
de nos premiers citoyens, que votre illustre père avait conçue de moi.
Parmi les hommes qui, grâce à vos bienfaits, ont eu de l'influence, il
en est qui par calcul peuvent être pour vous des amis plus utiles; de
plus attachés, jamais. Je vous sais donc à la fois bien bon gré, et du
souvenir que vous gardez de notre amitié, et du dessein que vous avez
d'eu resserrer les liens.
706. — A TIRON. Pouzzol.
F. XVI, 23. Eh bien! faites la
déclaration pour cet argent, si vous le pouvez. Ce n'est pas que dans
l'espèce une déclaration soit nécessaire. Toutefois Balbus m'écrit qu'il
a si mal aux yeux qu'il ne peut desserrer les lèvres. Que fait Antoine
avec sa loi? Qu'on me laisse tranquille à mes champs, voilà tout ce que
je demande. J'ai écrit à Bithynicus. C'est vous que touche l'exemple de
Servilius, puisque vous vous souciez de vieillir. Atticus, qui m'a vu
autrefois sujet à des paniques, me croit toujours prêt comme lui à
prendre l'alarme. Il ne sait pas quel rempart je me suis fait de la
philosophie, et il fait du bruit parce qu'il a peur. Pour en revenir à
Antoine, je veux conserver son amitié, cette amitié qui a vieilli sans
nuage. Je lui écrirai donc, mais pas avant de vous avoir vu. Cependant
je ne vous empêche pas de payer le billet : avant la jambe est le genou.
J'attends demain Lepta, et j'aurai besoin de votre miel pour faire
passer son absinthe. Adieu.
707.— A ATTICUS. Pouzzol, mai.
A. XIV, 15. Votre petite dernière
lettre me charme. J'augure de celles de Brutus à Antoine et à vous, que
les affaires vont prendre un meilleur tour. Il est temps que j'avise à
ma position, et que je voie dans quel lieu me retirer. Ô que. je suis
fier de mon Dolabella! Il est bien mien en effet aujourd'hui.
Auparavant, croyez-moi, j'en doutais quelque peu au fond de lame. On
doit ouvrir de grands yeux, au moins! La roche Tarpéienne, des croix, la
colonne à bas, le sol pavé, que voulez-vous de plus? Tout cela est
héroïque. Il a ainsi coupé court a ces semblants de regrets qui
grossissaient à chaque instant, et qui, si on les eut laissés aller,
auraient fini par devenir funestes à nos illustres tyrannicides. Oui, je
suis d'accord avec vous maintenant, il y a du mieux à espérer. Ce n'est
pas que je me fasse à ces faux partisans de la paix, défenseurs obstinés
des actes les plus abominables. Mais tout ne peut passe faire en un
jour. Les choses commencent à marcher mieux que je ne le pensais, et je
ne partirai que quand vous me direz que. je le puis avec honneur. Que
Brutus compte sur moi en tout et pour tout. Quand même nous n'aurions eu
aucun rapport antérieur, je serais encore a lui, par respect pour sa
rare et incroyable vertu. Je laisse notre chère Pilia entièrement
maîtresse de ma villa et de tout ce qu'elle renferme. Je partirai le
jour des kalendes de mai pour Pompéi. Que ne pouvez-vous persuader à
Brutus de se trouver à Asture!
708. — A ATTICUS. Pouzzol, mai.
A. XIV, 16. Je vous écris celte
lettre le 6 des nones, au moment de quitter ma villa de Cluvius, un pied
à bord de mon léger bateau. Je laisse à Pilia ma villa du lac Lucrin,
maison et gens. Je compte aujourd'hui faire brèche au tyrotarique
de notre frugal ami Pétus. Je passerai à Pompéi ; pu je me
rembarquerai pour revenir ici dans mes royaumes de Pouzzol et de Cumes,
lieux adorables par dessus tout, mais qu'on est presque réduit à fuir, à
cause du tourbillon d'importuns qui vous y assiège. — Parlons de nos
affaires. Que la conduite de Dolabella est belle! comme elle doit faire
ouvrir les yeux ! Je ne cesse de le soutenir par mes éloges et mes
conseils. Je vois avec plaisir dans vos lettres quelle est votre pensée
sur l'événement et sur l'homme. Il me semble qu'à présent notre Brutus
pourrait se montrer en plein forum, une couronne d'or sur le front. Qui
oserait l'outrager avec la croix ou la roche Tarpéienne en perspective,
surtout après tant d'applaudissements, tant de témoignages d'adhésion de
la part du bas peuple? Maintenant donc, mon cher Atticus, il faut me
laisser partir ; mon vœu, aussitôt après mes comptes bien réglés avec
notre Brutus, est d'aller parcourir la Grèce. Il importe beaucoup à
Cicéron, ou plutôt à moi-même, ou plutôt encore à Cicéron et à moi tout
ensemble, que je me mêle de ses études. Qu'y a-t-il, en effet, je vous
prie, dans cette lettre de Léonidas, que vous m'avez communiquée, qui
puisse me causer de la joie? Jamais je ne me contenterai d'un éloge de
mon fils avec cette restriction : Quant à présent. C'est là le langage
de la crainte et non de la confiance. J'avais dit à Hérode de me donner
des détails. Je n'ai pas eu un mot de lui jusqu'à ce jour, et je crains
qu'il se soit abstenu pour ne pas me faire de la peine. Je vous sais
beaucoup de gré de ce que vous avez écrit à Xénon ; car il est de mon
devoir comme de mon honneur de ne laisser Cicéron manquer de rien.
J'entends dire que Flaminius Flamma est à Rome. Je viens de lui écrire
ce que vous m'aviez mandé vous-même, que vous comptez lui parler de
l'affaire Montanus. Veillez, je vous prie, à ce que ma lettre lui soit
remise, et ayez un entretien avec lui, quand vous en trouverez le moment
sans vous gêner. Je crois que si cet homme a un peu de pudeur, il
s'exécutera, afin de ne pas exposer ceux qui ont répondu pour lui. Je
vous sais un gré extrême de m'avoir appris le rétablissement d'Attica,
avant de m'avoir parlé de son indisposition.
709. — A ATTICUS. Pompéi, mai.
Α. XIV, 17. Je suis arrivé à Pompéi
le 5 des nones de mai, après avoir la veille, comme je vous l'ai dit,
installé Pilia à Cumes. J'étais à table quand j'ai reçu la lettre dont
vous aviez chargé pour moi l'affranchi Démétrius, la veille des
kalendes. Vos réflexions sont eu général fort sages. Cependant on voit
bien que, pour vous mettre en quelque sorte à couvert, vous voulez
abandonner à la fortune le choix du parti à suivre : eh bien ! nous
prendrons ensemble conseil des circonstances. Fasse le ciel que je
puisse joindre Antoine pour lui parler de l'affaire de Buthrote! J'en
tirerai bon parti: maison ne croit pas qu'il se détourne de Capoue, ou
il va. Je crains ce voyage pour la république. Et César, que j'ai laissé
hier bien souffrant à Naples, en a la même opinion. Il résulte de tout
cela qu'il nous faudra attendre les kalendes de juin pour traiter et
terminer cette affaire. Assez sur ce sujet. — Quintus a reçu de sou fils
les lettres les plus aigres, qui lui ont été remises à Pompéi au moment
de notre arrivée. Le jeune homme commence par dire qu'il ne veut pas
d'Aquillia pour belle-mère. Passe pour cela encore ; mais ailleurs
il dit qu'il a toujours tout obtenu de César, jamais rien de son
père, et qu'il met désormais sa confiance dans Antoine. Le
malheureux! c'est au surplus son affaire. — J'ai écrit à Brutus, à
Cassius et à Dolabella. Je vous envoie des copies de mes lettres, non
que je vous consulte pour les envoyer, je n'hésite, pas un moment à cet
égard, mais parce que je n'ai pas non plus le moindre doute sur votre
approbation. — Ne cessez pas, je vous prie, mon cher Atticus, de fournir
à Cicéron tout ce que vous jugerez nécessaire, et souffrez que je me
repose sur vous de ce soin. Je vous exprime toute ma gratitude de la
peine que déjà vous avez bien voulu prendre à ce sujet. — Je n'ai pas
encore travaillé autant que je l'ai voulu à mes Anecdotes. Les
choses que vous voulez que j'y ajoute feront partie d'un volume séparé,
dont je m'occuperai plus tard. Croyez-moi pourtant, il y avait moins de
danger pendant la vie du tyran à parler de toutes les infamies qui se
faisaient, qu'à en parler aujourd'hui qu'il est mort. C'est un fait que
je ne m'explique pas; mais il souffrait tout de moi avec une
merveilleuse patience. A présent, au contraire, de quelque côte que nous
fassions un pas, on nous arrête au nom de César, en prenant prétexte
non-seulement de ce qu'il a pu faire, mais même de ce qu'il a pu penser.
— Puisque Flamma est arrivé, vous allez sans doute vous occuper de
l'affaire de Montanus. .le crois qu'on est maintenant eu meilleure
position.
710. — A DOLABELLA. Pompéi, mai.
F. IX, 14. Sans doute, c'est tout
pour moi que votre gloire, mon cher Dolabella, et seule elle suffit à ma
joie et à mon bonheur; cependant je ne puis cacher tout ce que j'éprouve
de vive satisfaction lorsque je vois l'opinion publique, m'associer en
quelque sorte à vos succès. Chaque jour, je me trouve ici en grande
compagnie de toute espèce; nombre de nos meilleurs citoyens y sont
attirés par des raisons de santé; des habitants des villes municipales,
mes amis, y vont et viennent sans cesse : eh bien ! je ne rencontre
personne qui ne vous élève jusqu'aux nues, et qui ne m'adresse en même
temps des félicitations. On se persuade en effet que votre, déférence
pour mes recommandations et mes conseils entre pour beaucoup dans ce que
vous avez fait de si grand comme citoyen, de si remarquable comme
consul. Je pourrais répondre avec toute vérité que votre raison et votre
caractère expliquent naturellement ce que vous faites, et qu'il n'en
faut pas chercher l'inspiration ailleurs. Mais sans tomber tout à fait
d'accord avec eux, de peur de diminuer votre mérite, en le laissant
reporter sur moi tout entier, je ne leur oppose pas non plus, je
l'avoue, une complète dénégation. Je suis pour cela trop sensible à la
louange. D'ailleurs votre caractère ne peut recevoir aucune atteinte de
ce dont Agamemnon lui-même, le roi des rois, se faisait honneur,
c'est-à-dire des conseils de Nestor ; et c'est ma gloire à moi
d'entendre les éloges qu'on décerne au jeune consul, s'adresser en
quelque sorte à l'élève formé par mes principes. Voici les premiers mots
de L. César, lorsque je l'allai voir à Naples pendant sa maladie :
quoiqu'accablé par la souffrance, il m'avait à peine salué qu'il s'écria
: « Ah! mon cher Cicéron, que je vous félicite du crédit que vous
avez sur Dolabella ! si j'en avais autant sur le fils de ma sœur, nos
maux ne seraient pas sans remède. Combien j'aime votre cher Dolabella !
combien je lui rends grâce! Depuis vous, nous pouvons le dire, c'est le
seul consul, le seul vrai consul que nous ayons eu. » Il me parla
beaucoup ensuite de la situation et de la mesure prise. C'est, selon
lui, tout ce qu'il y a de plus grand, de plus beau, de plus décisif pour
la chose publique; au fait, il n'y a là-dessus qu'une voix. Ne me
contestez donc pas, de grâce, la part qu'on veut à faux titre me donner
dans une gloire qui n'est pas la mienne, et laissez arriver jusqu'à moi
un peu de l'admiration dont vous êtes l'objet. Badinage à part, mon cher
Dolabella, j'aimerais mieux vous transporter tout ce que j'ai de gloire,
si gloire il y a, que de vous faire tort de la plus faible part de la
votre. Je vous ai toujours vivement aimé, vous l'avez pu voir; mais
aujourd'hui je suis tellement enthousiaste de ce que vous venez de
faire, que je ne trouve pas de terme pour exprimer la vivacité de mes
sentiments. C'est que la vertu, croyez-moi, est ce qu'il y a au monde de
plus beau, de plus touchant, de plus aimable. J'ai toujours chéri
Brutus, vous le savez, et son esprit si distingué, et l'exquise douceur
de ses mœurs, et sa probité sévère, et la noble constance de ses
principes. Pourtant, les ides de mars ont ajouté à mon affection pour
lui, au point que j'en suis à comprendre comment un sentiment si plein
et si parlait a pu grandir encore. De même, qui eut dit qu'une affection
comme celle que j'ai pour vous fut susceptible de s'accroître? Eh bien !
elle s'est accrue au point qu'il me semble que c'est d'aujourd'hui
seulement que je vous aime, et qu'auparavant je n'avais qu'une bonne
disposition pour vous. Maintenant irais-je vous conseiller de suivre
toujours les inspirations du devoir et de l'honneur? Vous proposerais-je
d'illustres exemples, ainsi que le. font tous les donneurs de conseils?
Je ne connais personne de plus illustre que vous. C'est en vous-même
qu'il faut prendre modèle, c'est vous-même qu'il faut chercher à
surpasser. Après être monté si haut, il ne vous est plus possible de
descendre. Arrière donc les conseils: il n'y a que des félicitations à
vous faire. Il vous arrive en effet ce qui n'est, je crois, arrivé à
personne encore, d'employer des moyens d'une rigueur extrême, el de voir
non-seulement que cette rigueur ne se rend pas odieuse, mais qu'elle
devient populaire, chère à tous, au bas peuple comme aux honnêtes gens.
Si c'était là seulement du bonheur, je vous ferais mon compliment d'être
heureux; mais on est forcé d'y reconnaître du courage, de. l'habileté et
du calcul. J'ai lu votre discours: c'est le comble de l'adresse. Vous
entrez pris à pas dans la question, vous ménageant toujours une retraite
: si bien qu'il n'y a qu'une voix pour convenir que la rigueur était de
saison. Enfin vous avez délivré Home du danger et ses citoyens de la
crainte. Et ce n'est pas la un de ces actes qui passent; c'est un
exemple qui fera loi pour l'avenir. Vous comprendrez que le sort de la
république est dans vos mains, et que non-seulement protection mais
récompense est due à ces héros qui ont pris l'initiative de notre
affranchissement. J'espère vous voir au premier jour, et je vous en
dirai davantage. Vous qui venez de sauver la république et nous tous,
veillez soigneusement à votre tour sur vous-même, mon cher Dolabella.
711. — A ATTICUS. Pompéi, mai.
Α. XIV, 19. C'est à Pompéi, le jour
des nones de mai, que j'ai reçu vos deux lettres, l'une à six jours de
sa date, l'autre a quatre. Je réponds d'abord à la première. Combien je
suis charmé d'apprendre que ma lettre vous soit arrivée à propos par
Barnéus ! Vous avez parlé à Cassius comme toujours. N'est-il pas heureux
que je lui aie moi-même écrit, quatre jours à l'avance, précisément ce
que vous me recommandiez de lui dire? Vous avez une copie de ma lettre.
Mais au moment ou je suis tout bouleversé de la banqueroute de Dolabella
(c'est votre expression), voici que je reçois votre lettre et la copie
de celle de Brutus. Brutus songe à se réfugier dans l'exil. A l'époque
de la vie ou je suis parvenu, il est un parti dont on se rapproche
chaque jour davantage: j'aimerais mieux sans doute n'y entrer qu'après
avoir vu Brutus heureux et la république puissante; mais je n'ai pas,
comme vous le dites fort bien, le choix des partis, et vous pensez comme
moi que la guerre, la guerre civile surtout, ne va point à mon âge.
Antoine s'est borné à me répondre, au sujet de Clodius, que ma bonté, ma
modération l'avaient bien touché, et que ce serait un jour pour moi un
grand sujet de satisfaction. Pansa, dit-on, au contraire, se déchaîne
contre Clodius et contre Déjotarus. C'est la sévérité même, à l'en
croire. Cependant ce qui n'est pas si bien de sa part, c'est de se
prononcer violemment comme il le fait contre Dolabella. Le fils de votre
sœur a été fortement réprimandé par son père, à l'occasion des
couronnes; sa réponse est qu'il a pris une couronne pour faire hommage à
César, qu'il l'a déposée en signe de deuil, et qu'en définitif il
accepte volontiers le reproche d'aimer César mort. J'ai écrit à
Dolabella dans le sens que vous vouliez; j'ai écrit aussi à Sicca. Je ne
vous charge pas de cette affaire, de crainte que Dolabella ne vous en
sache mauvais gré. Je connaissais le discours de Servius; j'y trouve
plus de peur que de sagesse; mais comme la peur est partout, je suis de
son avis. C'est une chienne que vous l'ait Publilius. On m'avait député
Cérellia, et je n'ai pas eu de peine à lui persuader que ce qu'elle
demandait n'était pas possible, quand bien même il m'eût convenu de le
faire. Si je vois Antoine, je n'oublierai pas l'affaire de Buthrole. —
J'arrive à votre seconde lettre. Je vous l'ai déjà dit en vous parlant
de Senius, je tiens l'action de Dolabella pour une très-grande affaire ;
je ne vois pas ce que, pour le temps et la circonstance, on pouvait
faire de mieux. Mais ce que je dis de lui, je ne le dis que d'après
vous. Je pense bien aussi comme vous que s'il me paye ce qu'il me doit,
son action me paraîtra plus belle encore. Que je voudrais voir Brutus à
Asture! Vous approuvez mon projet de ne partir qu'après avoir vu comment
les choses tourneront; mais j'ai changé d'avis. Au surplus, je ne ferai
rien sans vous voir. Je suis fort sensible aux remercîments d'Attiea, à
l'occasion de ce que j'ai fait pour sa mère, en la laissant à Cumes
maîtresse absolue de ma maison et de mes celliers; je compte la revoir
le 5 des ides. Mille compliments à Attica, je vous prie, et dites-lui
que j'aurai tout le soin possible de Pilia.
712. — A ATTICUS. Pompéi, mai.
A. XIV, 18. Vous me poussez
toujours sur ce que j'élève trop haut Dolabella : sans doute j'approuve
ce qu'il a fait; cependant si je l'ai porté aux nues, je n'y ai été
déterminé que par votre première et votre seconde lettre. Mais depuis,
Dolabella s'est perdu auprès de vous par des procédés qui m'ont brouillé
moi-même avec lui. Quel front ! le terme écheait aux kalendes de
janvier, et il en est encore a me payer. Cependant il a Fabérius qui,
d'une ligne de sa main, l'a libéré de tant de dettes, et qui peut encore
lui procurer le secours divin. Vous voyez que je trouve, encore le mot
pour rire. Je lui ai écrit le 8 des ides, de grand matin; le soir, j'ai
reçu à Pompéi votre lettre, venue en trois jours. C'est aller vite.
Mais, comme je vous l'ai déjà mandé ce jour-là même, j'ai écrit à
Dolabella quelques mots assez piquants, je vous assure. S'il ne répond
pas, j'irai le trouver; il ne me résistera point. Vous avez sans doute
fini avec Albius. Je vous remercie beaucoup de ce que vous m'avez prêté
pour la dette de Patulcianus ; ce sont là de vos traits. Je m'en
reposais sur Éros; je l'avais laissé à Rome pour ces affaires qui, par
son fait, ont failli si mal tourner. Je m'en expliquerai avec lui. Quant
à l'affaire de Montanus, je vous en laisse derechef toute la
responsabilité. — Je ne m'étonne point que Servius en partant vous ait
tenu un langage désespéré : il ne peut pas être plus découragé que je le
suis moi-même. Si notre cher Brutus, l'homme unique, ne vient pas au
sénat le jour des kalendes de juin, je ne vois pas ce qu'il ferait au
forum. Il sait, au reste, mieux que personne ce qu'il a à faire. Quant à
moi, j'augure de tout ce que je vois que nous n'aurons pas gagné
grand-chose aux ides de mars, et je pense plus que jamais à la Grèce. En
quoi puis-je être utile à Brutus, puisqu'il songe à s'exiler lui-même? —
La lettre de Léonidas ne me plaît pas merveilleusement. Je suis de votre
avis sur Hérode. Je voudrais bien lire la lettre de Sauféius. Mon
intention est de quitter Pompéi le 6 des ides de mai.
713. — A TIRO. Mai.
F. XVI, 24. Je vous ai envoyé
Harpalus ce matin; il n'y a rien de nouveau; mais comme voici une
occasion directe, je vous écris encore, pour vous parler toujours des
mêmes choses. Ce n'est pas que je me défie de votre exactitude; mais
l'affaire est assez considérable pour me préoccuper. J'ai, comme dit le
proverbe grec, pourvu à tout, de la poupe à la proue, en vous détachant
de moi pour aller régler mes comptes. Il faut satisfaire d'abord
Ofillius et Aurélius. Si vous ne pouvez avoir de Flamma toute la somme,
tachez d'en arracher au moins une partie. Sur toutes choses, faites
qu'il ait soldé aux kalendes de janvier. Terminez pour le transport, et
voyez ce qu'il y a à faire quant au payement anticipé. Mais laissons là
les affaires privées, et passons aux affaires publiques. Je veux des
détails sur tout. Que fait Octave? que fait Antoine? De quel côté se
tourne l'opinion? Que pensez-vous vous-même? Je ne me tiens pas, tant je
brûle de partir; mais st! attendons une lettre de vous. Sachez que
Balbus était à Aquinum le jour où on vous l'avait dit, et qu'Hirtius y
arriva le lendemain. Ils allaient l'un et l'autre aux eaux, je le
suppose. Qu'auront-ils fait? Veillez à ce qu'on avertisse les gens
d'affaires de Dolabella. Il faudra aussi que Papia soit citée. Adieu.
714. — A ATTICUS.
Environs de Naples, mai.
Α. XIV, 20. Le 6 des ides, je me suis
embarqué à Pompéi, et je suis arrivé à la maison de Lucullus vers la
troisième heure. J'ai reçu en débarquant la lettre que votre secrétaire
avait, m'a-t-on dit, apportée à Cumes, et qui est datée des nones de
mai. Le lendemain, presque à la même heure encore, Lucullus m'a remis
une autre lettre datée de Lanuvium, le 7 des ides. Je répondrai à tout à
la fois. Je commence par vous remercier de vos bons soins, et pour le
payement et pour l'affaire d'Albius. Quant à votre réclamation de
Buthrote, Antoine est venu à Misène pendant que j'étais à Pompéi; mais
je ne l'ai su qu'après son départ, et il est allé dans le Samnium.
Espérez-vous toujours? Nous verrons à Rome. Le discours de L. Antoine
est horrible, la réponse de Dolabella admirable. Eh bien! qu'il garde
aujourd'hui son argent, s'il le veut; je ne lui demande que de ne pas
oublier les ides. Combien je suis fâché de la fausse-couche de Tertulla!
Il nous faut de In graine de Cassius aussi bien que de Brutus. Qu'y
a-t-il de vrai, je vous prie, dans l'histoire de la reine et de son
petit César? — J'en ai fini avec la première lettre : venons à la
seconde. Ce que vous désirez pour les Quintus et pour Buthrote sera fait
à mon arrivée. Je vous remercie de l'argent que, vous faites donner à
Cicéron. Vous dites que c'est une erreur de croire que de Brutus seul
dépend le sort de la république. Rien n'est plus vrai, au contraire. Ou
la république sera anéantie, ou c'est à lui et à ses amis qu'elle devra
son salut. Quant au discours tout fait que vous m'engagez à envoyer,
permettez-mo, mon cher Attieus, do vous expliquer quels sont mes
principes généraux sur des choses dont j'ai bien quelque expérience.
Jamais poète ni orateur n'a cru trouver son maître; et je le dis même
des plus méchants. Que serait-ce de Brutus, dont l'esprit est à la fois
si heureusement doué et si bien cultivé? L'épreuve vient d'être faite à
l'occasion de son édit; j'en avais préparé une rédaction, à votre
prière; ma rédaction me paraissait bonne, à moi; la sienne lui a paru
meilleure. Il y a plus, c'est à sa sollicitation presque uniquement que
je me suis mis à faire ce traité sur l'éloquence. Eh bien! il m'a écrit,
il vous a écrit à vous-même que mes préférences n'étaient pas de son
goût. Laissons donc, je vous prie, chacun composer ses discours pour son
compte. « A chacun sa fiancée, à moi la mienne. A chacun ses amours, à
moi les miens. » Voilà qui n'est pas merveilleux, car Attilius, à qui
j'emprunte ces vers, est le poète le plus dur que je connaisse. Prions
seulement les Dieux qu'un homme comme Brutus ait à faire des harangues ;
car le jour où Rome sera sure pour lui, nous pourrons chanter victoire.
Les meneurs alors ne trouveront personne pour les suivre dans une
nouvelle guerre civile, ou n'entraîneront que des gens dont on aura bon
marché. — J'arrive à la troisième partie de mon discours. Je suis charmé
que Brutus et Cassius aient clé contents de ma lettre. Je viens de leur
répondre. Ils me prient de ne pas négliger Hirtius, dont ils doutent un
peu. Je m'en occupe. Il parle à merveille; mais il vit et demeure avec
Balbus qui parle bien aussi, et vous savez ce qu'il en faut croire. Je
vois que vous êtes content de Dolabella; pour moi, je le mets au-dessus
de tout. Je viens d'avoir Pansa chez moi a Pompéi ; il m'a montré les
meilleurs sentiments, tout à la paix. Je vois clairement qu'on cherche
la guerre. J'approuve l'édit de Cassius et de Brutus. Vous voulez que je
réfléchisse sur ce qu'ils ont a faire ; mais on ne peut prendre conseil
que du moment, et à chaque minute la scène change. Il me semble que ce
premier acte de Dolabella, puis son discours contre Antoine, ont fait
grand bien. Les choses marchent, et je crois que nous allons avoir un
chef. C'est tout ce que demandent les villes municipales, ainsi que les
gens de bien. Osez-vous bien citer Epicure et vous écrier : Point de
politique! Eh ! ne voyez-vous pas la mine que ferait Brutus à de tels
propos? Le fils de Quintus est. dites-vous, le bras droit d'Antoine. Eh
bien! nous obtiendrons tout sans peine par son crédit. Si Antoine a
présenté Octave au peuple comme vous le pensiez, je voudrais bien savoir
en quels termes il aura parlé. Je vous écris en courant. Le messager de
Cassius repart à la minute. Je vais aller voir Pilia, puis je me ferai
conduire en barque chez Vestorius, ou je soupe. Mille compliments à
Attica.
715. — A ATTICUS. Pouzzol, mai.
A. XIV, 21. Je venais de remettre
mes dépêches au messager de Cassius, le 5 des ides, lorsque le mien
arriva, et, chose prodigieuse! arriva sans lettres de vous; mais j'ai
jugé aussitôt que vous étiez à Lanuvium. Éros l'a dépêché en toute hâte,
; à cause d'une lettre de Dolabella dont il était porteur pour moi. Il
ne s'agit pas dans cette lettre de mon argent. Dolabella n'a pas encore
reçu celle où je lui en parle. Il répond a la missive dont je vous ai
envoyé copie, et y répond d'une manière très-satisfaisante. A peine
avais-je congédié le messager de Cassius, que Balbus est entré chez moi.
Bons Dieux! que la paix lui fait peur! vous connaissez l'homme, à quel
point il est caché. Pourtant il m'a parlé des projets d'Antoine. Antoine
cherche, dit-il, à circonvenir les vétérans, pour qu'ils sanctionnent
les actes de César. Il veut qu'ils s'y engagent par serment, afin que
tout le monde s'y soumette ; et il serait fait une inspection chaque
mois par les décemvirs. Balbus se plaint des préventions dont il est
l'objet. Enfin il n'y a rien dans son langage qui ne dénote un partisan
d'Antoine. Que voulez-vous? jamais rien de vrai dans sa bouche, Pas le
moindre doute, selon moi, que tout ne tende à la guerre. C'est tout
simple. Ils ont été, dans cette grande affaire, hommes par le cœur,
enfants par la tête. Le successeur du tyran n'est-il pas visible à tous
les yeux? or, qu'y a-t-il de plus absurde que d'avoir tu peur de l'un,
et que de ne pas se mettre en peine de l'autre? Et aujourd'hui encore
que d'inconséquences ! Le domaine de Pontius à Naples n'est-il pas
toujours, par exemple, en la possession d'une femme mère de l'un des
meurtriers du tyran? J'ai bien souvent besoin, je vous assure, de relire
le Caton l'ancien, dont vous avez un exemplaire. La vieillesse me rend
chagrin; tout me blesse; mais moi j'ai vécu. C'est l'affaire de ceux qui
sont jeunes. — Continuez, je vous prie, de veiller, comme vous le
faites, à mes intérêts. Je vous écris, ou plutôt je dicte, pendant le
second service chez Vestorius. Je me propose d'aller voir demain
Hirtius, le seul restant des cinq; et c'est pour essayer de le gagner au
parti des gens de bien. Mais temps perdu ! il n'y a pas un de ces
hommes-la qui ne craigne le repos. Allons donc, chaussons les
talonnières. Toul, tout, plutôt que d'être encore au milieu des camps!
Dites, je vous prie, mille et mille choses de ma part à Attica.
J'attends avec impatience le discours d'Octave, et des nouvelles, s'il y
en a. Dites-moi surtout si Dolabella fait sonner les pièces, ou si, en
ma considération, il veut encore abolir les dettes.
716. — A ATT1CUS. Pouzzol, mai.
A. XIV, 22. Pilia me dit à
l'instant que vos messagers partent le jour des ides, et je prends mes
tablettes, sans trop sa voir encore ce que je vous écrirai. Apprenez
pourtant d'abord que je partirai le 16 des kaiendes pour Arpinum, où je
vous prie de me mander les nouvelles, bien que je ne doive pas tardera
vous rejoindre. Je veux, avant d'arriver à Rome, flairer un peu ce qui
va s'y passer. Mes conjectures ne seront que trop exactes, je le crains,
et ce qu'on machine me paraît plus clair que le jour. J'ai aujourd'hui
mon disciple (Hirtius) à souper. Il aime passionnément celui qu'a frappé
Brutus. Voulez-vous que je vous le dise? Il n'y en a pas un, c'est
évident, à qui la paix ne fasse peur. Ils ont adopté une thèse qu'ils
soutiennent très-hautement : C'est qu'on a tué un grand homme ; que sa
mort est une perturbation pour la république; qu'il ne restera rien de
ce qu'il a fait, le jour où nous cesserons de craindre; qu'il n'a péché
que par sa clémence; que sans elle la catastrophe n'eut pas eu lieu. Je
considère aussi que rompue arrivant, comme cela est vraisemblable, avec
des forces de quelque importance, la guerre est inévitable. Cette idée
me tourmente et me trouble; car la liberté que vous avez eue jadis, on
ne me la laissera point. Je n'ai pas caché ma joie, et ils ont sans
cesse à la bouche le mot d'ingrat. Non, je le répète, je ne puis avoir
la liberté que vous eûtes jadis, vous et tant d'autres. Quoi ! se
déclarer, et aller se jeter au milieu des camps! ah! plutôt mourir mille
fois! à mon fige, surtout. Les ides de mars ne suffisent plus, hélas!
pour me consoler. On lit ce jour-là une. si grande faute! Mais nos
jeunes héros « nous ont ôté par leur courage le droit de nous plaindre.
» Si vous avez meilleure idée des choses, vous qui entendez tout, qui
assistez à tout, écrivez-moi. Dites-moi aussi ce que vous pensez pour
moi de ce projet de légation votive. On me conseille fortement ici de ne
pas me rendre au sénat le jour des kalendes. Des soldats y seront,
dit-on, secrètement apostés, et c'est à nos amis qu'on en veut. Je ne
crois pas qu'il y ait pour eux en effet, dans le monde entier, un seul
endroit moins sur que le sénat.
717.— A ATTICUS. Sinuesse, mai.
A. XV, 1, 1ere part. Quelle triste
chose que la mort d'Alexion ! J'en ai un chagrin inexprimable. Ce n'est
pas, je vous assure, de la manière que supposent les gens qui me disent
: Quel médecin allez-vous prendre? Qu'ai-je affaire de médecin
aujourd'hui? Et si j'en veux, en manque-t-il ? Ce que je regrette en
lui, c'est son affection, son amabilité, sa douceur; et puisque! retour
a faire sur soi-même, quand on voit un homme de cette tempérance et un
si grand médecin ainsi emporté en un clin d'œil ! Il n'y a qu'une chose
à se dire, c'est qu'on est homme, et qu'on doit se résigner aux
conditions de l'humanité. — Je vous ai déjà mandé qu'il ne m'avait pas
encore été possible de rejoindre Antoine. Il est venu a Misène, pendant
que j'étais à Pompéi; mais il était déjà parti quand je l'ai su.
Cependant le hasard a voulu qu'Hirtius se trouvât justement chez moi à
Pouzzol au moment où j'ai reçu votre lettre. Je la lui ai montrée, et
j'ai insisté sur son contenu. Son premier mot a été qu'il ne s'y
intéressait pas moins que moi-même, et son dernier, que pour cette
affaire comme pour toute autre il met le consul à ma discrétion. Quand
je verrai Antoine, je m'y prendrai de manière à lui faire entendre que
si, dans cette occasion, il fait ce que nous désirons, je suis à lui
sans réserve. — Je pense bien que Dolabella n'aura pas mis la clef sous
la porte. Revenons à nos amis. Vous augurez favorablement de la
modération des édits. Pour moi, je sais parfaitement ce qu'il y a au
fond de la pensée d'Hirtius; j'en ai pu juger le 17 des kalendes,
lorsqu'il partit de Pouzzol pour se trouver avec Pansa à Naples. Je le
pris à part, et l'exhortai au maintien de la paix. Il ne pouvait pas
répondre : Je ne veux pas de la paix. Mais il dit que cette altitude
armée ne l'inquiète pas moins de notre, part que de celle d'Antoine; que
sans doute ou fait bien des deux côtés d'être sur ses gardes, mais
qu'enfin d'un côté ou de l'autre la collision est imminente. Que vous
dirai-je? Je n'en attends rien de bon. - Je suis de votre avis pour le
fils de Quintus. Votre charmante lettre au père lui a fait le plus grand
plaisir. J'ai fait sans peine entendre raison à Cérellia. Elle n'a pas,
je crois, l'affaire grandement à cœur, et en tout cas je ne m'en soucie
guère. Quant à cette autre personne qui se rend, dites-vous, si
importante, je ne m'étonne que d'une chose: c'est que vous ayez voulu
l'écouter. Si j'en ai dit du bien chez ses amis, en présence de ses
trois fils et de sa fille, j'ai bien changé de note. Pourquoi cela?
parce que, le rôle fini. je n'ai que faire du masque. Celui de la
vieillesse est déjà bien assez laid. — Brutus désire, dites-vous, me
voir avant les kalendes; il me l'a écrit. Je me rendrai probablement a
son désir; mais je ne devine point ce qu'il veut. Moi qui ne sais pas me
conseiller moi-même, quels conseils aurais-je à donner à un homme qui a
si bien travaillé pour sa gloire, si peu pour notre repos? Les bruits
qu'on a répandus sur la reine tomberont tout seuls. Si vous pouvez
quelque chose auprès de Flamma, ne manquez pas d'agir, je vous prie.
718. — A ATTICUS Sinuesse, mai.
Α. XV, 1, 2me partie. Je vous
écrivis hier en quittant Pouzzol. J'allais à Cumes. J'y ai trouvé Pilia
bien portante. Je l'ai vue ensuite un moment à Baules, où elle s'est
rendue de Cumes pour une cérémonie funèbre à laquelle j'ai moi-même pris
part. Notre ami Cn. Lentulus plaçait le corps de sa mère sur le bûcher.
J'ai couché ce jour-là à Sinuesse, et j'en suis paru ce matin pour
Arpinum, d'où je vous écris. Je n'ai rien de nouveau a vous apprendre ou
à vous demander. Peut-être pourtant ne serez-vous pas fâché de savoir
que notre cher Brutus m'a envoyé le discours qu'il a prononcé dans
l'assemblée du Capitole, et il me prie de le corriger sans ménagement,
avant qu'il le rende public. Ce discours est semé de pensées admirables;
et quant au style, il n'est rien au-dessus. Mais si j'avais à traiter un
tel sujet, je le ferais plus chaudement. Vous connaissez les principes
et le caractère de l'orateur, et vous comprenez qu'aucune correction ne
m'était possible. Ce que Brutus veut être en fait d'éloquence, il l'a
été; et l'on ne saurait, mieux qu'il ne le fait, réaliser l'idée qu'il
s'est formée de la perfection dans l'art de la parole. Mais soit à tort,
soit à raison . et quand même je serais seul de mon avis, mon système
est autre. Si vous ne connaissez pas encore ce morceau, faites-moi le
plaisir de le lire et dites-moi ce que vous en pensez. Ce n'est pas que
je ne redoute beaucoup chez vous l'influence du nom et des dispositions
ultra-attiques. Cependant rappelez-vous les foudres de Démosthène, et
vous verrez que le style peut se passionner sans cesser d'être ce qu'il
y a de plus attique. Nous en parlerons à notre première recentre.
Aujourd'hui je voulais seulement que Métrodore partît avec une lettre de
moi, et une lettre qui ne fût pas vide.
719. — A ATTICUS. Sinuesse, mai.
Α. XV, 2. Je partais de Sinuesse le
15 des kalendes, après avoir quitté Cumes, lorsque, sur le territoire de
Vescia, votre messager me remit une lettre de vous. C'est trop insister
sur Buthrote. Cette affaire ne vous est et ne vous sera jamais plus a
cœur qu'a moi. Ainsi devons-nous être l'un pour l'antre. Je m'y suis mis
dés l'origine, comme à la chose qui me préoccupe le plus au monde, .le
vois, par votre lettre et par d'autres, que Lucius Antoine a fait un
discours dégoûtant. Mais quel effet a-t-il produit? Vous ne m'en parlez
point. J'approuve fort ce que vous me dites de Ménédémus. Ces propos de
Quintus ne sont que trop vrais, il les tient à tout venant. Je suis ravi
que vous me permettiez de laisser là le discours que vous m'aviez engage
à faire ; vous vous en applaudirez en lisant celui dont je vous parle
dans ma lettre d'aujourd'hui. Ce que vous dites des légions est vrai:
mais vous ne vous persuadez pas assez que l'autorilé du sénat est
insuffisante pour emporter l'affaire de Bulhrote. C'est du moins mon
avis. Je vois tant de haine ! notre vie même est menacée, à en juger par
les apparences. Puissé-je me tromper ! Vous ne vous seriez alors pas
trompé pour Buthrote. — Je partage votre opinion sur le discours
d'Octave; ses préparatifs pour les jeux publics, et ses commissaires,
tels que Matius et Postumius, ne sont pas de mon goût. Saserna aussi est
un digne collègue. Oui, vous le dites avec raison, il n'y a pas un seul
de ces gens-là qui ne redoute la paix autant crue nous redoutons la
guerre. Je voudrais bien réhabiliter Balbus parmi nos amis.
Malheureusement il ne croit pas la chose possible lui-même, et il porte
ses vues ailleurs. Je suis charmé du courage que vous donne la lecture
de ma première Tusculane. Le remède qu'elle indique est toujours à notre
disposition. Merci des bonnes paroles données par Flamma. Quelle est
l'affaire des Tyndaritains dont il s'inquiète? On peut en tous cas
compter sur moi. Ce qui se passe, et particulièrement les distributions
d'argent, paraissent ébranler le dernier des cinq (Hirtius). La
mort d'AIcxion m'afllige; mais, après une attaque si grave, son
existence devenait telle que je ne puis le plaindre. Quels sont ses
seconds héritiers, je vous prie? et quelle est la date de son testament?
je voudrais le savoir.
720. — A ATTICUS. Atina, mai.
A. XV, 3. J'ai reçu le 11 des
kaiendes, à Atina, vos deux réponses à mes lettres. L'une est du 15,
l'autre du 12. Commençons par la plus ancienne. Vous accourez à
Tusculum. Eh bien ! c'est le 6, je le suppose, que j'y serai. Quant à
courber la tête sous le vainqueur, ce n'est pas là mon avis; il y a bien
mieux à faire. Vous rappelez ce qui arriva dans le temple d'Apollon,
sous le consulat de Lentulus et de Marcellus. Mais la question n'est pas
la même, et les circonstances sont tout autres. Ne dites-vous pas
surtout que Marcellus et les autres se retirent? Nous aurons ensemble à
chercher et à voir s'il y a sûreté pour nous dans Rome. D'un autre côté,
cette masse de propriétaires nouveaux me donne à réfléchir. Nous sommes
pris dans un défilé. Mais qu'importe? J'en ai vu froidement bien
d'autres. Je connais le testament de Calva; c'est l'œuvre d'un homme
avare et sordide. Merci de l'attention que vous donnez à la mise en
vente des biens de Dominicus. Il y a longtemps que j'ai écrit à
Dolabella en termes très-pressants au sujet de Marius. Est-ce que ma
lettre ne serait pas parvenue? Je n'ai fait pour lui que ce que je
désirais et devais faire. — J'arrive à votre seconde lettre. J'ai appris
sur Alexion tout ce que je voulais savoir. Hirtius est pour vous. Je
souhaite pis encore à Antoine. Vous jugez bien du fils de Quintus ; nous
parlerons ensemble de son père. Je ne demande pas mieux que de faire
pour Brutus tout ce qui dépend de moi. Je vois bien que vous partagez
mon opinion sur son petit discours. Mais je ne comprends point que je
puisse en faire un autre en son nom, aujourd'hui qu'il l'a publié. De
quelle manière l'entendez-vous? S'agit-il seulement d'établir qu'on
avait le droit de tuer le tyran? Il y eu a long à dire, long à écrire
sur ce sujet. Mais je m'y prendrai autrement et dans d'autres temps.
Bravos aux tribuns pour le siège de César ! bravos aussi aux quatorze
rangs! Je suis charmé que Brutus ait logé chez moi, pourvu qu'il s'y
soit bien trouvé, et qu'il y ait fait quelque séjour.
721. — A ATTICUS. Atina mai.
Α. XV, 4. Le 12 des calendes, à la
8e heure à peu près, un messager m'arrive porteur de je ne sais quel
diminutif de billet, par lequel Fufius me. redemande mon amitié. On
n'est pas plus gauche, en vérité. Mais peut-être tout semble-t-il gauche
de la part des gens qu'on n'aime pas? Ma réponse serait de votre goût.
Le même messager m'a remis deux lettres de vous, l'une du 11, l'autre du
10. Voyons d'abord la plus récente, qui est en même temps la plus
aimable. A merveille. Quoi ! Et Carfulénus aussi? En vérité, les fleuves
remontent vers leurs sources. Que de tempêtes prêtes à sortir de tous
ces projets d'Antoine ! Puisse-t-il agir par le peuple plutôt que par le
sénat! Il le fera, je crois. Mais si on veut enlever à Hrutus son
gouvernement, c'est la guerre; si peu de nerf que je lui suppose, il ne
se laissera pas dépouiller sans en venir aux coups. Je ne désire pas la
guerre, puisqu'on s'occupe des Buthrotiens. Vous riez! mais moi,
j'aurais bien mieux aimé réussir par ma persévérance, mon crédit et mes
soins a arranger leur affaire. Je gémis. Vous ne savez que dire de nos
amis, et de ce qu'ils doivent faire en de telles circonstances. J'en
suis là pour moi-même, et ce n'est pas d'aujourd'hui que les ides de
mars me semblent une consolation dérisoire. Nous avons montré un courage
de héros et pris des résolutions d'enfants. Il fallait arracher l'arbre.
On s'est borné à le rogner; aussi voyez comme il repousse. — Revenons-en
à mes Tusculanes, que vous citez sans cesse. Ne parlons point à
Sauféius, si vous le voulez. Je vous garderai le secret. Brutus demande
quel jour je serai à Tusculum : le 6 des kaiendes, comme je vous l'ai
déjà dit. Je voudrais bien vous y voir à mon arrivée. Je crois que je
serai obligé d'aller à Lanuvium, et cela fera jaser. Nous y
réfléchirons. — Je reviens maintenant à votre première lettre. Vous
parlez d'abord de Buthrote : je passe outre. Je suis tout plein de cette
affaire : et je dis comme vous, vienne seulement l'instant d'agir! Vous
revenez si longuement sur ce discours de Brutus, que je vois bien que
vous ne vous rendez point encore. Voulez-vous donc que je refasse son
discours, et cela sans qu'il m'en ait prie? Mais rien ne blesse comme
cette espèce de défi. Faites, me dites-vous, quelque chose dans le goût
d'Héraclide. A cela, je ne réponds pas non : seulement, il faut choisir
la thèse et attendre des temps favorables. Λ vous permis de penser de
moi tout ce qu'il vous plaira! du bien pourtant, j'espère ; mais si la
situation reste la même, comme il y a apparence, permettez-moi de vous
dire que je ne trouve dans les ides de mars rien qui me contente. Il
fallait empêcher le tyran de renaître; ne pas craindre d'annuler tous
ses actes. Ou bien je rentre dans les principes de Sauféius, et je
laisse de côté ceux de mes Tusculanes, que vous voulez pourtant faire
lire même à Vestorius. Oui, puisque le meurt re ne nous a pas rendu la
liberté, j'étais dans les bonnes grâces de ce mort (que les Dieux le
confondent !), et je devais, à mon âge, m'accommoder d'un tel maître.
Je rougis de mes paroles; mais n'importe! Ce qui est écrit est écrit et
restera. — Que n'avez-vous dit vrai sur Ménédème! Que ne dit-on vrai sur
la reine! Le reste à la première rencontre et de vive voix. Nous aurons
surtout à voir ce que nous devons faire, et à prévoir le cas où Antoine
environnerait le sénat de ses soldats. Je n'ai pas voulu donner cette
lettre à son messager, de crainte qu'il ne l'ouvrît. Je vous envoie donc
un exprès. J'avais d'ailleurs à vous répondre. — Que j'aurais été
heureux si vous aviez pu rendre ce service à Brutus! mais je lui ai
écrit. Je viens d'envoyer Tiron à Dolabella avec des instructions et une
lettre. Faites-le venir, et s'il y a quelque chose de bon à me faire
savoir, écrivez-moi. Voilà L. César qui vient à la traverse, et me prie
fort malencontreusement de l'aller joindre au Bois, ou d'indiquer
moi-même un rendez-vous, et c'est Brutus qui le désire. Quelle
complication de contrariétés! Je pense aller à ce rendez-vous; puis de
là à Rome; peut-être non. Je me borne à ce peu de mots ; car je n'ai pas
encore vu Balbus. J'attends de vos nouvelles; parlez-moi de tout ce qui
se fait ou doit se faire.
722. — A CASSIUS. Rome, mai.
F. XII, 1. Pas un seul instant, mon
cher Cassius, que je ne pense à vous, à Brutus, à la république tout
entière, qui n'a d'espérance qu'en vous, en lui, en Décimus. J'augure
mieux des affaires, depuis les admirables mesures prises par Dolabella.
La fermentation de Rome gagnait de proche en proche, et bientôt il n'y
aurait plus eu de sécurité ni de repos dans son enceinte. D'ignobles et
dégoûtantes tentatives ont été comprimées vigoureusement, et nous voilà,
selon toute apparence, pour jamais à l'abri de pareilles scènes. Sans
doute il reste beaucoup à faire, et le plus difficile. Mais tout roule
sur vous. Tachons de dénouer les difficultés successivement et vite.
Nous sommes délivrés du tyran, nous ne le sommes pas de la tyrannie. On
l'a tué, mais on maintient les actes de son bon plaisir. Il ya plus :
une foule de choses qu'à coup sûr il n'eût jamais faites s'il eût vécu,
on lui en prête la pensée, et cela suffit. Impossible de dire où l'on
s'arrêtera dans cette voie. On suspend des tables d'airain ; on accorde
des immunités; on lève d'énormes impôts; on rappelle des exilés ; on
produit de faux décrets, si bien que la haine d'un pervers et la honte
de l'esclavage s'effacent, et la république reste comme anéantie dans le
bouleversement où César l'avait précipitée. La réparation de tant de
maux sera votre ouvrage. Ne vous dites pas à vous-même que vous avez
assez fait pour la république. Vous avez fait plus qu'on n'eût jamais
osé espérer; mais la patrie n'est point satisfaite, et elle ne mesure
qu'à la grandeur de votre courage et de vos bienfaits ce qu'elle attend
encore de vous ! Vous avez lavé ses affronts dans un sang impur : rien
de plus. A-t-elle retrouvé l'honneur? Le retrouvera-t-elle en obéissant
au tyran mort, quand elle n'a pu le supporter virant? Le
retrouvera-t-elle en respectant des chiffons de papier, quand il y a des
tables d'airain qu'elle devrait mettre au néant? Nous l'avons, il est
vrai, ainsi voulu et décrété. Oui, sous l'impérieuse contrainte de cette
loi du moment, qui a tant de puissance dans le gouvernement des empires.
Hélas! avec quelle impudeur, avec quelle ingratitude n'abuse-t-on pas de
notre facilité? Mais nous traiterons bientôt ces questions et d'autres
encore. En attendant, vous savez combien j'ai toujours chéri la
république et combien je vous aime. Ne doutez pas de ma vive sollicitude
pour tout ce qui vous touche. Adieu.
723. — A TRÉBONIUS. Mai.
F. XV, 20. J'ai recommandé mon
Orateur, c'est le titre que j'ai choisi, à votre ami Sabinus. Son
pays natal m'a prévenu en sa faveur. Peut-être Sabinus ne se trouve-t-il
la pourtant qu'en vertu d'une de ces licences que prennent les
candidats, et peut-être ce surnom n'est-il qu'un surnom de circonstance.
Quoi qu'il en soit, son air est modeste, ses paroles réfléchies, et j'ai
cru retrouver en lui quelque chose du vieux peuple de Cures. Assez sur
Sabinus. Je reviens à vous, mon cher Trébonius, à vous dont les récents
adieux ont si fort redoublé mon affection. Songez aux regrets que vous
laissez derrière vous, et veuillez les adoucir du moins par la
consolation de vos lettres. Ecrivez-moi souvent; de mon côté, je ne
resterai point en retard. Il y a deux raisons pour que vous écriviez
plus que moi. Autrefois c'était de Rome qu'on mandait à ses amis des
provinces les nouvelles de la république. Maintenant, c'est à vous à
nous instruire. La république n'est-elle pas aux lieux où vous êtes? De
plus, nous pouvons, en votre absence, vous rendre ici une foule de
petits services; et vous, je ne vois point ce que vous pourriez faire
là-bas pour nous, si ce n'est de nous écrire. Vous nous tiendrez donc au
courant de tout; mais ne songez d'abord qu'à une chose, c'est à me dire
comment votre voyage se passe, en quel lieu vous avez rencontré Brutus,
combien de temps vous êtes resté avec lui. Plus tard, lorsque vous serez
plus avancé, vous nous entretiendrez de la marche des événements
militaires et de l'ensemble de votre situation, pour que nous puissions
juger ou nous en sommes. Je n'aurai confiance entière qu'en vos lettres.
Ayez soin de votre santé, et gardez-moi toujours la bonne place que
j'occupe dans votre affection.
724. — BRUTUS ET CASSIUS A ANTOINE. Lanuvium. mai.
F.XI, 2. Si votre loyauté et vos
bonnes dispositions ne nous étaient pas connues, nous n'aurions pas à
vous écrire. Mais, avec les sentiments qui vous animent, vous ne pouvez
manquer de prendre notre lettre en bonne part. On nous mande qu'un grand
nombre de vétérans se trouvent réunis à Rome, et qu'un plus grand nombre
y est attendu pour les kalendes de juin. Nous n'avons ni soupçons ni
crainte : notre caractère les repousse. Cependant, après nous être
livrés à vous; après avoir, par vos conseils, éloigné nos amis des
villes municipales ; après avoir travaillé à cet éloignement
non-seulement par des édits, mais encore par des injonctions directes,
nous méritons bien que vous nous fassiez part de vos desseins, surtout
en une matière qui nous touche de si près. Nous venons donc vous
demander quelles sont vos intentions. Pensez-vous qu'il y ait sûreté
pour nous au milieu de cette multitude de vétérans qui parlent déjà,
dit-on, d'autels à rétablir, projet qu'on ne peut former ou approuver
pour peu qu'on s'intéresse a nous et à notre honneur? Nous n'avons
jamais eu qu'un but, la paix et la liberté; les faits le prouvent.
Personne ne peut nous tromper, personne, excepté vous. Et rien
assurément n'est plus loin de votre caractère fort et loyal. Mais enfin
nul autre, que vous n'aurait le pouvoir de nous tromper. Nous n'avons eu
foi et nous n'aurons jamais foi qu'en vous. Eh bien ! nos amis sont en
proie aux plus vives alarmes. Votre droiture leur est connue, mais il
est clair qu'il serait pins facile au premier venu de pousser les
vétérans à des violences, qu'à vous de les retenir. Nous vous en
conjurons, expliquez-vous ! ce ne serait pas sérieusement qu'on pourrait
dire que les vétérans ont eu avis d'une motion que vous devez faire au
mois de juin en leur faveur. Le prétexte serait aussi vain que
dérisoire. Quelle opposition ont-ils à craindre, quand on sait que nous
resterons neutres? Nul ne dira que c'est pour nous que nous craignons,
car il est évident que la moindre atteinte à nos personnes entraînerait
un bouleversement complet et une confusion générale.
725. — DE TRÉBONIUS A CICÉRON.
Athènzes, 25 mai.
F. XII, 16. Je suis arrivé à
Athènes le 11 des calendes de juin, et, suivant le plus cher de mes
désirs, j'y ai trouvé votre fils tout entier à l'étude et jouissant de
la meilleure réputation. Vous devinez, sans que je vous le dise, combien
j'en suis heureux. Vous savez ce que vous êtes pour moi, et ce que notre
vieille et franche amitié peut m'inspirer non-seulement dans un bonheur
comme celui-là, mais encore pour la moindre bagatelle, du moment qu'elle
vous touche. N'allez pas croire au moins, mon cher Cicéron, qu'en vous
parlant ainsi de votre fils, je veuille seulement chatouiller
agréablement vos oreilles. Parmi la jeunesse qui est à Athènes, il n'y a
personne d'aussi aimable que notre enfant, oui notre enfant, car,
entre vous et moi, tout doit être commun ; personne qui ait en même
temps plus de goût pour ces études, que vous aimez, et qui sont ce qu'il
y a de meilleur au monde. C'est donc avec une satisfaction sincère que
je vous félicite et me félicite aussi des justes raisons que nous avons
d'aimer celui que nous aimerions encore, quand il en serait moins digne.
Au milieu de la conversation, il m'a parlé de l'intention de visiter
l'Asie. J'ai applaudi; je l'ai même prié de réaliser son projet pendant
que je gouvernerai la province. Il trouverait en moi la tendresse et les
soins d'un père. Je veillerai à ce que Cratippe l'accompagne, car je ne
veux point que vous regardiez ce voyage comme une interruption des
études où vous le poussez. Il s'y livre avec zèle, ou, pour mieux dire,
de tout cœur; mais je ne l'en excite pas moins à demander chaque jour de
nouveaux progrès à l'étude et à l'exercice. — Je ne sais comment vous
gouvernez les affaires au moment où j'écris. On parle de troubles.
Puisse-t-il n'en être rien, et puissions-nous obtenir enfin un peu de
loisir et de liberté! C'est un bonheur dont j'ai bien rarement joui
jusqu'à ce jour. Toutefois, j'ai profité d'un moment pendant que j'étais
en mer, et je vous envoie un petit présent de ma façon ; vous verrez à
la fin un mot de vous, qui me fit tant d'honneur. La dédicace est à la
suite; c'est à vous que je le dédie. Si quelques expressions vous
paraissent un peu libres, l'infamie du personnage auquel je m'attaque
sera mon excuse. Vous pardonnerez à ma colère. La passion n'est que trop
légitime envers des hommes et des citoyens de cette espèce. D'ailleurs,
on a bien passé ces licences à Lucilius. Il n'a pas montré moins de
fiel. Et certes ceux qu'il attaque ne méritaient pas autant la liberté
que se donne sa plume. Quant à vous, n'oubliez pas votre promesse, et
faites-moi figurer le plus tut possible dans l'un de vos dialogues. Si
vous composez quelque chose sur la mort de César, j'ai la confiance que
vous ne me mettrez pas au dernier rang, ni parmi les acteurs du drame,
ni parmi les amis de l'auteur. Prenez soin de votre santé. Je vous
recommande ma mère et tous les miens.
726. — A MATIUS. Tusculum, mai.
F. XI, 27. Je ne sais pas au juste
si je dois m'affliger ou me réjouir de la visite que je viens de
recevoir de Trébatins, le plus obligeant des hommes et l'homme, du monde
qui nous aime le plus l'un et l'autre. J'étais allé le soir à Tusculum.
Je le vois arriver le lendemain matin de très-bonne heure, malgré sa
santé encore chancelante; je le grondai d'avoir si peu soin de lui; il
ne pouvait, dit-il, se tenir d'impatience de me voir. Qu'y a-t-il donc,
lui demandai-je? Alors il me parla de vos plaintes. Avant de
m'expliquer, permettez-moi quelques observations : autant que ma mémoire
peut remonter vers le passé, je ne trouve personne avec qui je sois plus
anciennement lie qu'avec vous; j'ai plusieurs amis qui datent d'aussi
loin, mais pas un qui me soit aussi cher. Le premier jour que je vous
vis, je vous aimai, et je sentis que vous m'aimiez de même; votre
départ, votre longue absence, la diversité de nos vues et nos carrières
différentes ont empêché entre nous cette fusion intime de sentiments que
l'habitude de se voir constamment peut seule opérer entre des esprits
sympathiques. Je n'en ai pas moins en occasion, des longtemps avant la
guerre civile et lorsque César était dans les Gaules, de voir vos
dispositions pour moi. Vous avez fait une chose que vous jugiez devoir à
la fois m'être fort utile, et n'être pas inutile a César. Vous l'avez
disposé à m'aimer, à me rechercher, à me compter parmi les siens. Je
passe sur ce qu'on peut voir d'intimité dans nos entretiens, notre
correspondance, nos rapports de toute espèce à cette époque. Ce qui suit
est plus sérieux. Au commencement de la guerre civile, comme vous alliez
rejoindre César a Brindes, vous vîntes me voir à Formies. Cette visite
seule, d'abord de quel prix n'était-elle pas dans de semblables
circonstances? Croyez-vous ensuite que j'aie oublié vos conseils, vos
instances, et tant d'autres preuves du plus tendre intérêt? Trébatius,
je m'en souviens, était présent à cette entrevue. Je n'ai pas oublié non
plus la lettre que vous m'avez écrite en allant au-devant de César, dans
le canton de Trébula, si je ne me trompe. Plus tard, vint le moment où
je ne sais quel sentiment d'honneur ou de devoir, ou peut-être un
caprice du sort, me poussèrent à joindre Pompée? Quel service ne
m'avez-vous pas rendu, quel gage d'affection ne m'avez-vous pas donné, à
moi et aux miens, pendant mon absence? Aussi n'est-il pas un seul
des miens qui ne vous regarde comme notre meilleur ami. J'arrive à
Brindes. Puis-je oublier l'empressement avec lequel vous accourûtes de
Tarente? Je vous vois vous asseoir auprès de moi, consoler, ranimer mon
esprit abattu, et qui ne rêvait plus que misères et calamités. Enfin je
me revis à Rome. Qu'a-t-il manqué alors à notre intimité? Vos conseils
en de graves circonstances ont décidé de ma conduite a l'égard de César.
Dans le commerce ordinaire, quelle maison, après celle de César,
fréquentiez-vous de préférence? Où veniez-vous passer tant d'heures qui
s'écoulaient pour nous dans les plus doux entretiens? Ce fut même alors,
si vous vous le rappelez, que vous m'engageâtes a composer mes
ouvrages philosophiques. Après le retour de César, qu'avez-vous eu de
plus à cœur que de me rapprocher de lui plus étroitement? Et vous y
aviez réussi. — Mais où tend cette digression, qui devient plus longue
que je ne le pensais? à exprimer ma surprise de ce que, connaissant
toutes ces circonstances, vous ayez cru que j'aie pu manquer aux droits
d'une amitié comme la nôtre. Outre ces titres éclatants et publics, il
en est d'autres plus particuliers dont les paroles ne donnent qu'une
idée imparfaite : c'est qu'en vous tout me plaît. Que j'aime votre
inébranlable fidélité à vos amis, votre sagesse, votre gravité, la
constance de vos sentiments ! que je n'aime pas moins l'enjouement de
votre esprit, la douceur de votre caractère, votre goût pour les
lettres! J'arrive maintenant à vos plaintes : premièrement je n'ai
jamais cru que vous eussiez voté pour cette fameuse loi; ensuite, quand
même je l'aurais cru, je vous aurais supposé de justes raisons pour le
faire. Votre haute position attire naturellement les yeux sur vos
moindres actions, et fait que la malignité publique ne leur donne pas
toujours une interprétation favorable. Si vous ignorez cela, je ne
saurai que vous dire. Apprenez cependant que lorsque cette malignité
s'exerce en ma présence, je ne manque jamais de prendre votre parti,
comme je sais que vous prenez le mien contre mes ennemis. Je fais mon
thème en deux façons : dans certains cas, je donne des démentis formels,
comme pour le vote en question ; dans d'autres, j'explique votre
conduite par les motifs les plus honorables pour vos sentiments et votre
caractère, comme dans l'affaire des jeux. Mais vous êtes trop éclairé
pour ne pas reconnaître que si César fut roi, et il le fut sans doute,
on peut disputer sur la ligne de conduite que vous avez suivie,
c'est-à-dire, ou soutenir, par exemple, ainsi que je le fais, que vous
vous honorez comme ami et comme homme en restant fidèle à vos
affections, même après la mort de celui qui en était l'objet; ou
prétendre, ainsi que d'autres le font, qu'on doit préférer la liberté de
sa patrie a la vie de son ami. Que ne vous a-t-on dit mes combats sur
cette double thèse? Mais il y a deux points qui sont l'un et l'autre
tout a votre gloire, et que personne ne relève avec plus de plaisir et
plus souvent que moi : c'est que vous avez toujours été et fort
opposé à la guerre civile, et très-prononcé pour la modération dans la
victoire. Sur cela je n'ai encore trouvé personne pour me contredire. —
En résumé, je dois des grâces à Trébatius pour m'avoir donné l'occasion
de vous écrire cette lettre. Vous ne pourriez mettre eu doute la
sincérité des sentiments qu'elle exprime, sans me croire dépourvu de
cœur et de principes, supposition qui serait la plus blessante
pour moi et au moins bien étrange chez vous.
727. — DE
MATIUS A CICÉRON. Rome.
F. XI, 28. J'ai éprouvé un grand
bonheur en lisant votre lettre, qui répond si bien à mon attente et à
mon vœu, et où je vois comment vous me jugez toujours. Non, je n'avais
pas le moindre doute ; mais le haut prix que j'attache à votre estime me
rend jaloux de la conserver intacte. J'ai la conscience de n'avoir dans
aucune occasion mérité un reproche d'un homme de bien ; et je me
refusais à croire qu'avec une nature aussi excellente et un esprit aussi
clairvoyant que le vôtre, vous eussiez pu céder légèrement a des
préventions contre un homme, qui a été et qui est toujours porté
d'inclination pour vous. Satisfait sur ce point, je vais répondre aux
accusations où votre bonté de cœur et votre affection ont si souvent
pour moi pris fait et cause. Je sais tout ce qu'on a dit contre moi
depuis la mort de César. On m'a fait un crime d'avoir gémi de cette fin
tragique. Mon ami est tué; et l'on ne veut pas que je m'indigne ! La
patrie, dit-on, doit passer avant l'amitié; comme s'il était prouvé que
le trépas de César est profitable à la république. Je parlerai sans
détour : j'avoue que je n'en suis pas encore à ce haut degré de sagesse.
Dans nos guerres civiles, je ne me suis pas attaché au parti de César.
J'ai servi l'ami, bien qu'à contrecœur, et je ne déserte point sa cause.
Jamais on ne m'a vu approuver la guerre, ni le principe de nos
dissensions. Il n'est point d'efforts que je n'aie tentés pour en
étouffer le germe. La victoire s'est rangée du côté de mes affections ;
mais je n'ai pas succombé à la tentation des honneurs et des richesses.
Ceux qui s'en sont gorgés avec le plus d'impudeur avaient bien moins de
crédit que moi sur l'esprit de César. Il y a plus, ma fortune a souffert
de la loi dont profitent beaucoup de gens qui triomphent de ce qu'il est
mort, et qui, sans elle, ne seraient pas à Rome aujourd'hui. J'ai
demandé qu'on épargnât les vaincus, et j'y ai travaillé avec autant de
zèle que s'il se fût agi de moi-même. Et moi, qui voulais qu'il ne
tombât pas un cheveu de la tête de personne, je ne pourrais pas
m'indigner du meurtre de celui par qui ce vœu s'accomplissait ; je ne le
pourrais pas, quand je le vois périr de la main de ces mêmes hommes pour
lesquels il avait encouru la désaffection des siens! Eh bien ! me
dit-on, puisque vous blâmez notre action, vous porterez la peine de
votre audace. C'est vraiment inouï! Quoi! ici on pourrait impunément se
glorifier d'un forfait, et là on ne pourrait pas en gémir sans danger!
Mais les esclaves eux-mêmes ont leur libre arbitre pour pleurer, pour
espérer ou craindre, sans attendre le signal du maître; et cette
liberté-là, ceux qui se proclament les restaurateurs de la liberté
voudraient nous la ravir par la terreur! Vaines menaces! Jamais danger
ni crainte ne me feront reculer devant mes devoirs d'homme et d'ami.
J'ai pour principe qu'il ne faut jamais fuir une mort honorable, et que
souvent il faut l'aller chercher. Mais pourquoi tant m'en vouloir de
leur souhaiter qu'ils se repentent? Oui, je souhaite que la mort de
César devienne pour chaque Romain un sujet de deuil. Mais comme citoyen,
dit-on, je dois désirer le salut de la république. Si ma vie tout
entière et les espérances que je garde dans ma douleur ne sont pas à cet
égard de suffisantes, quoique de muettes garanties, je renonce à lu
prouver par des discours. Aussi vous demanderai-je avec plus d'instance
que jamais du me juger par mes actions plutôt que par mes paroles ; et
si vous considérez que mon intérêt est d'accord avec mon devoir, vous ne
craindrez point de voir jamais le moindre rapprochement entre les
méchants et moi. Tels étaient mes principes dès mon jeune âge, alors
qu'une erreur a toujours pour elle l'excuse de l'inexpérience.
Aujourd'hui, sur le déclin des ans, irais-je abjurer ce que je suis et
me refaire moi-même? non, certes! Je ne donnerai aucune prise contre
moi, si ce n'est par la douleur que j'ai du déplorable sort d'un grand
homme et d'un ami. Si mes sentiments étaient autres, je ne les
désavouerais pas davantage, afin de ne pas ajouter du moins à la
perversité des actions le tort d'une lâche et vaine hypocrisie. J'ai
présidé aux jeux que le jeune César a fait célébrer pour les victoires
de César. Ce fait est du domaine de la vie privée et des devoirs qui s'y
rattachent ; il n'a rien de commun avec la politique. Je devais cet
hommage à la mémoire et à la renommée d'un ami dans la tombe, et je n'ai
pu me refuser au désir d'un jeune homme de tant d'espérances, du digne
héritier de César. Je vais souvent chez le consul Antoine, dans l'unique
but de lui offrir mes salutations : mais qui rencontre-t-on sans cesse
chez lui? Ceux-là qui me croient sans dévouement à mon pays, et qui n'y
vont que pour en solliciter et en arracher des faveurs. Comment! César
ne m'a jamais empêché de voir qui bon me semblait, ni demandé compte de
mes relations avec des hommes qu'il n'aimait pas; et ceux qui m'ont
arraché mon ami croiraient, en me harcelant, parvenir a étouffer mes
affections! C'est par trop fort; mais je suis sans alarme : ma conduite
aura force et pouvoir dans l'avenir contre la calomnie, et je sais bien
que ceux même qui m'en veulent le plus de ma fidélité à César
préféreraient des amis comme moi à des amis qui leur ressemblent. Si mes
vœux s'accomplissent, je me retirerai à Rhodes pour y passer dans la
retraite le peu qu'il m'est donné de vivre encore. Que si quelque
empêchement me retenait à Rome, ma conduite y prouverait à tous que je
n'ai d'autre ambition que celle du bien public. — J'ai beaucoup
d'obligations à notre ami Trébatius. Je lui dois d'avoir pu lire vos
sentiments dans votre cœur aimant et candide, et de savoir que l'homme
que j'ai toujours tendrement aimé a plus que jamais des droits à ma
déférence et à mon respect. Portez-vous bien, et ne cessez pas de
m'aimer.
728. — A ATTICUS. Atina, mai.
Α. XV, 5. Le messager que j'avais envoyé à
Brutus est de retour. Il m'a
apporté des lettres de lui et de Cassius : tous deux demandent
instamment mes conseils; Brutus surtout veut que je tranche
l'alternative. Ο embarras ! Je ne sais que leur dire. Aussi garderai-je
le silence, à moins que vous n'en jugiez autrement. Ecrivez-moi dans
ce
cas quelles sont vos vues. Cassius me conjure d'agir sur Hirtius de
manière à le rendre le meilleur possible. A-t-il bien sa raison ? « Le
foulon a-t-il jamais blanchi le charbonnier? » Vous avez dû recevoir une
lettre de moi. Balbus et Hirtius m'écrivent, comme vous, qu'il y aura un
sénatus-consulte pour les gouvernements de
Brutus et de Cassius. Hirtius est parti; il doit déjà être à Tusculum.
Il me prie instamment de rester éloigné. Il y a du danger à courir,
dit-il; i! en a couru lui-même. Mais quand il n'y aurait aucun danger,
je suis si loin de craindre qu'Antoine sache mon déplaisir de ses succès,
que je n'ai qu'un seul motif pour ne pas aller à Rome : je ne veux pas
le voir. Varron vient de me communiquer une lettre qui lui a été écrite
j'ignore par qui; il a effacé. la suscription. Cette lettre annonce que
les vétérans, non compris dans la distribution des terres, (ils n'y ont
pas tous eu part,) tiennent les plus mauvais propos, et que les gens qui
ne sont pas pour eux peuvent avoir de grands risques à courir à Rome.
Ainsi, pour nous, je vous prie, quel moyen d'y aller, d'en sortir?
quelle y serait notre figure, notre contenance ? De plus, est-il vrai,
comme vous l'annoncez, que L. Antoine marche contre D. Brutus, et les
autres contre nos deux amis? Que dois-je faire? quel parti prendre? Pour
le moment je suis décidé à rester ici, c'est-à-dire hors cette ville ou
j'ai jeté tant d'éclat, et ou, sous la servitude même, mon
caractère n'a
pas été sans dignité. Quant à quitter tout à fait l'Italie, nous en
parlerons ensemble. J'y suis moins résolu qu'à m'absenter de Rome.
729. — A ATTICUS. Tusculum.
A. XV, 8. Deux lettres de Balbus depuis votre départ, mais rien de
nouveau. Hirtius m'écrit aussi: il est très-offensé de la conduite des
vétérans. J'hésite toujours sur ce que je dois faire aux kalendes de
mars. J'ai dépêché Tiron, et avec lui plusieurs de mes gens, afin qu'au
fur et à
mesure des événements, je puisse avoir des lettres de vous. J'écris
aussi à Antoine, au sujet de la mission que je désire. J'aurais craint
de blesser cet esprit irritable en ne m'adressant qu'à Dolabella. Mais
comme on pénètre, dit-on, très-difficilement jusqu'à Antoine, j'ai
écrit à Eutrapélus pour le charger de remettre ma lettre, et d'appuyer
sur le besoin que j'ai de cette légation. Il faut bien dès lors qu'il
remette ma lettre. Une mission votive est plus honorable; enfin celle-là
ou une autre. — Réfléchissez mûrement, je vous prie, sur votre position
personnelle : le mieux serait de venir en conférer avec moi; mais il
nous est toujours possible de nous écrire. Grécéius me mande qu'il
tient de Cassius qu'on soudoie des hommes armés destinés pour Tusculum.
Je n'y crois pas : cependant il est bon de prendre ses précautions, et
d'avoir plusieurs villas toutes prêtes. D'ici à demain nous verrons
ce
qu'on en doit penser.
730. — A ATTICUS. Tusculum.
A. XV, 6. Brutus m'écrit, ainsi que Cassius, pour me parler d'Hirtius.
Ils savent qu'il a été excellent jusqu'à ce jour; mais comme ils
doutent maintenant de lui, ils désirent que j'use de mon influence pour
l'affermir dans ses bons sentiments. Sans doute il est mal avec Antoine,
mais il est en même temps fort attaché à leur cause. Je lui ai écrit, et
lui ai recommandé les intérêts de Brutus et de Cassius. Je veux que vous
voyiez sa réponse. Peut-être jugerez-vous comme moi que la faction se
figure nos amis plus fermes qu'ils ne sont réellement.
HIRTIUS A CICERON.
« Vous me demandez si je suis de retour
des champs. Est-ce quand tout fermente autour de moi que je puis rester à ne
rien faire? C'est de Rome que je suis de retour. J'ai cru qu'il serait
mieux de n'y pas rester. Je vous écris partant pour Tusculum, et
n'allez pas me croire assez brave pour revenir à la ville à l'époque des
nones. En quoi d'ailleurs ma présence y pourrait-elle être utile,
lorsqu'on a fait la besogne pour tant d'années à l'avance? Quant à
Brutus et Cassius, qui me trouvent si maniable lorsque vous intercédez
pour eux, puissent-ils aussi facilement se laisser persuader par vous de
s'abstenir de résolutions extrêmes! C'est en partant, dites-vous, qu'ils
vous ont écrit. Où vont-ils? que veulent-ils faire? Retenez-les, mon
cher Cicéron, je vous en conjure, et ne souffrez pas que notre ruine,
préparée par tant de violences, d'incendies et de meurtres d'un bout de
la république à l'autre, s'accomplisse à la fin tout entière. S'ils ont
quelque chose à craindre, qu'ils prennent leurs précautions, mais qu'ils
s'arrêtent là. Ils ont à coup sûr bien moins à gagner par les mesures
précipitées qu'en abandonnant les choses à leur cours naturel, tout en
restant sur leurs gardes. Laissez passer le torrent, il ne durera pas
toujours. Résistez-lui, sa violence va tout détruire. Mandez-moi à
Tusculum ce que vous espérez de leurs dispositions. » — Telle est la
lettre d'Hirtius : je lui ai répondu qu'ils ne songeaient à rien moins
qu'à faire un coup de tête, et je le lui ai démontré. J'ai voulu que
vous sussiez ce détail tel quel. Ma lettre fermée, il m'en arrive une de
Balbus. Servilie est de retour. Ils ne partiront point. A vous maintenant
de m'écrire.
731. — A ATTICUS. Tusculum.
A. XV, 7. Mille grâces pour toutes
ces lettres; elles m'ont charmé,
surtout celle de notre cher Sextus. Parce qu'il vous loue, allez-vous
dire. En vérité, je crois qu'il en est quelque chose. Cependant, avant
d'arriver à l'endroit de ses éloges, j'étais déjà ravi et de son
sentiment sur les affaires publiques, et de son attention à m'écrire.
Quant au pacificateur Servius, le voila embarqué dans sa médiation,
escorté de son petit secrétaire, et uniquement préoccupé de faire tête à
des arguties légales; il devrait bien penser « que ce n'est pas au
droit qu'on aura recours en cette affaire, mais bien à ce qui est
mentionné après » (Le glaive. Sed mage
ferro. vers d'Euripide). » Écrivez-moi donc aussi vous-même, je vous prie.
732. — A ATTICUS. Tusculum, juin.
Α. XV, 9, 1ère partie. Le 3 des nones, au soir, on m'a remis une lettre
de Balbus. Il m'annonce que le sénat se réunit le jour des nones, afin
d'aviser à l'envoi de Brutus et de Cassius, le premier en Asie, le
second en Sicile, avec mission d'acheter des blés et de les expédier à
Rome. Quelle honte! Recevoir une mission de ces gens-là! Et à ce titre
encore! Après tout, je ne sais trop si cela ne vaut pas mieux que de
rester les bras croisés aux bords de l'Eurotas. Le sort en décidera.
Balbus ajoute qu'on fera aussi un décret pour leur donner des
gouvernements, ainsi qu'aux autres prétoriens. Voila qui vaudrait mieux
que le portique des Perses; ne vous y trompez pas au moins. C'est de
Lanuvium que j'entends parler, et non de la Sparte de Laconie. Quoi !
direz-vous, plaisanter dans pareil moment! Que voulez-vous? je suis las
de pleurer.
733 — A ATTICUS. Tusculum, Juin.
Α. XV, 9, 2eme part. Dieux immortels! que j'ai tremblé en lisant la
première page de votre lettre ! Qu'est-ce donc, je vous prie, que
cette descente armée dans votre maison ? Heureusement, l'orage a passé
vite. Je suis impatient de savoir comment vous vous serez lire de cet
affligeant et épineux rendez-vous où l'on doit tenir conseil. C'est un
embarras inextricable; tant il est vrai que nous sommes serrés et pris
par tous les côtés ! La lettre de Brutus, que je comprends que vous ayez
lue, m'a jeté dans un trouble inexprimable. Déjà incapable d'une seule
idée, je crois que, depuis cette lettre, la douleur m'a encore plus
appesanti. Je vous en dirai davantage, lorsque je saurai à quoi m'en
tenir sur toutes ces tristes questions. En ce moment je n'aurais rien à
vous mander, et je reste d'autant plus dans la réserve que je doute que
vous receviez cette lettre; car il n'est pas sur que mon messager vous
trouve. J'attends de vos nouvelles avec impatience.
734. — A ATTICUS. Tusculum, juin.
Α. XV, 10. Quelle affectueuse lettre que celle de Brutus! et qu'il est
fâcheux le contretemps qui ne vous permet pas de l'aller voir! En
attendant, que dols-je lui conseiller? D'accepter l'offre qu'on leur
fait? n'est-ce pas le comble de l'opprobre? De tenter quelque grand
coup? la volonté leur manque, et même le pouvoir. Faut-il enfin les
encourager dans leur inaction? mais quelle garantie leur donner pour
leur sûreté ? Et si la chance tourne mal pour Décimus, quelle sera leur
existence, en supposant qu'on les épargne? Ne pas présider aux jeux
qu'il donne, quelle honte! Aller ramasser des vivres, quelle mission à la
Dion ((Denys, qui craignait Dion, l'envoyait souvent en ambassade.
C'était un exil continu, coloré d'un prétexte honorable), et dans toute la république quel emploi plus ignoble! Bien de
plus dangereux que d'avoir, en pareil cas, un avis à donner. Encore si
les conseils étaient utiles! mais pourquoi s'ingérer d'en donner en pure perte; et comment m'interposer entre lui et
sa mère, dont il écoute la voix et dont les prières l'entraînent
toujours? Je réfléchirai pourtant sur ce que je dois écrire, car le
silence ne m'est pas permis. Je ferai immédiatement partir un exprès
pour Antium ou Circéi.
735. — A ATTICUS. Antium, juin.
A. XV, 11. Je suis arrivé à Antium avant le
6 des ides. Brutus a paru
charmé de me voir. Puis, en présence d'une foule de personnes, de
Servilia, de Tertulla, de Porcia (la mère, la sœur et la femme de
Brutus), il m'a demandé hautement mes conseils. Favonius aussi était
présent. J'ai médité ma réponse en route. Mon avis, lui dis-je, est
qu'il faut accepter la mission d'Asie, pour les blés; qu'il ne nous
reste rien à faire que de songera votre conservation ; qu'en cela seul
nous pouvons encore être utiles à la république. Au moment où je
parlais, Cassius est entré. J'ai recommencé : en m'écoutant, ses yeux
s'animaient, Mars semblait l'inspirer. Pour moi, s'écria-t-il, je n'irai
point en Sicile. Qui, moi, recevoir un affront comme un bienfait ! Que
ferez-vous donc, répliquai-je? J'irai en Achaïe. - Et vous, Brutus? — A
Rome, si vous n'y voyez pas d'objection. — J'en vois beaucoup au
contraire ; vous n'y pouvez être en sûreté. — Mais enfin, si je le
pouvais, que diriez-vous? — Je dirais tout à fait oui. Je ne voudrais
même d'une mission pour vous ni maintenant, ni à la sortie de votre
préture. Mais je ne prends pas sur moi la responsabilité de votre
séjour à Rome. — Je lui ai énuméré alors tous les dangers qui l'y
attendaient. Ai-je besoin de les dire? Vous les devinez. On vint ensuite
a parler des occasions perdues ; on les déplorait, et Cassius plus
fortement que les autres. Il s'en prit surtout et avec amertume à
Décimus. Je demandai qu'on ne revînt pas sur le passé. Mais je tombai
d'accord des faits. Puis je dis quelques mots. Rien de nouveau
assurément sur ce qu'il aurait fallu faire; je répétai ce que chacun dit
tous les jours; mais je m'abstins même du point délicat, qu'il y avait
un homme qu'il eût fallu frapper. Aussi je déclarai seulement qu'on
aurait dû assembler sur-le-champ le sénat, profiter de l'exaltation du
peuple pour l'entraîner, et se rendre maître de la direction des
affaires. Là-dessus votre amie (Servilia) se récriant : Mais c'est la
première fois que j'entends pareille chose! je la réduisis au silence.
Bref, je crois que Cassius partira. Servilia se fait fort d'obtenir
qu'on retranche du sénatus-consulte ce qui est relatif à l'expédition
des blés. Notre cher Brutus est lui-même revenu sur les paroles vaines
qu'il avait prononcées. Car il avait dit positivement : « Je veux aller
à Rome. » Il a été convenu que les jeux auraient lieu sans lui, sous son
nom. Il m'a paru que son intention était de partir d'Antium pour l'Asie.
Je n'ai plus qu'un mot à ajouter, c'est que je n'emporte d'autre
satisfaction de mon voyage que l'acquit de ma conscience. Il ne m'était
pas possible de laisser Brutus quitter l'Italie sans le voir. Mais après
avoir cédé au besoin de mon cœur et payé ma dette à l'amitié, je peux bien
me dire à moi-même, avec le poète grec :
« A quoi donc t'a servi d'aller trouver l'oracle? »
J'ai trouvé un vaisseau brisé, ou plutôt je n'en ai vu que les débris
: plus de combinaison, de calcul, de plan. C'était mon dessein avant
de les voir, et c'est mon dessein plus que jamais de battre de l'aile au
plus vite, et de chercher des lieux ou « les forfaits des Pélopides et
jusqu'à leur nom ne. soient jamais parvenus. » — A propos, afin que
vous ne l'ignoriez point, sachez ! que Dolabella m'a nommé son
lieutenant le 4 des nones d'avril. J'en ai eu la nouvelle hier. La
légation votive ne vous plaisait pas non plus. C'eût été absurde en
effet. Moi, qui aurais fait un vœu pour le maintien de la république,
j'aurais été l'accomplir après son renversement! D'ailleurs, je crois
que la loi Julia a limité la durée des légations libres, et qu'il est
difficile à ceux qui en ont d'obtenir la liberté de venir à Rome, et
d'en sortir quand ils veulent. Je le pourrai maintenant, et il est fort
agréable d'avoir cette faculté pour, cinq ans. Cinq ans? c'est porter
mes vues bien loin. Mais pas de mauvais présage!
736 A ATTICUS. Antium, juin.
A. XV, 12. Je suis charmé vraiment du tour que prend l'affaire de
Buthrote. Mais moi qui, sur votre ordre, avais envoyé Tiron avec une
lettre à Dolabella! Au surplus, quel mal? Je croyais vous avoir écrit
assez clairement pour ne vous laisser aucun doute sur la disposition des
gens d'Antium (Brutus et Cassius) à demeurer tranquilles, et à accepter
l'ignominieux bienfait d'Antoine. Cassius ne veut point de cette
commission des blés. Servilia avait promis que l'article serait
retranché; notre Brutus, toujours stoïque, s'est décidé à aller eu Asie,
après avoir reconnu avec moi qu'il n'y avait aucune sûreté pour lui dans
Rome. Il aime mieux que les jeux se fassent sans lui, et son
intention est de partir dès qu'il en aura remis le programme à des
commissaires. Il réunit des vaisseaux et ne songe qu'à son voyage. En
attendant, il se propose de rester dans les environs. Brutus a dit qu'il
irait à Asture. — L. Antonius m'a généreusement écrit que je n'eusse
rien à craindre : c'est une. première obligation que je lui ai.
Puissé-je lui en avoir une seconde, en ne le voyant pas venir à Tusculum
! Que de choses intolérables et qu'on supporte cependant ! A qui des
deux Brutus s'en prendre? Je crois de l'esprit et du cœur à Octavianus
(Octave, qui fut depuis Auguste), et ses dispositions pour nos héros
m'ont paru telles que nous pouvons les désirer. Mais jusqu'à quel point
se lier à son âge, à son nom, à l'héritage qu'il recueille, aux
impressions qu'on lui a données? La question est capitale. Son beau-père
(Philippe), que nous avons vu à Asture, ne sait qu'en dire. Il faut en
tout cas le ménager, ne fut-ce que pour l'empêcher de se lier avec
Antoine. Marceline fera une bien belle chose, s'il réussit à le gagner à
nous et à nos amis. Octavianus m'a semblé lui être tout à fait dévoué;
mais il n'a guère de confiance dans Pansa, ni dans Hirtius. Son naturel
est bon : puisse-t-il rester toujours le même !
737. — A ATTICUS. Pompéi, juin.
Α. XV, 16, 1ere partie. Voilà enfin un messager de Cicéron, et, sur ma
parole, une lettre fort bien tournée; c'est un indice de progrès. Tout
le monde m'en écrit des merveilles. Le seul Léonidas met toujours sa
restriction : jusqu'à présent; mais il n'y a sorte d'éloge qu'Hérode
n'en fasse. Que voulez-vous? Il est possible qu'ici l'on me paie de
paroles, et j'avoue que je les prends volontiers pour comptant. Si vous
avez des nouvelles de Statius sur ce qui me concerne, veuillez m'en
faire part.
738. — A ATTICUS. Pompéi, juin.
A. XV, 16, 2e partie. Écoutez bien : ces lieux sont charmants, tout à fait
solitaires. Si on veut s'y livrer à l'étude, point de visite importune à
craindre. Pourtant, je ne sais comment j'aime mieux mon chez moi. Aussi
mes pieds me ramènent à Tusculum. D'ailleurs, on doit se rassasier
facilement de ce joli rivage. De plus, j'ai à craindre les pluies, si
mes pronostics sont exacts, car les grenouilles font assaut d'éloquence.
Soyez assez bon pour me mander où et quand je pourrai voir Brutus.
739. — A ATTICUS. Pompéi, juin.
A. XV, 15. Que tous les maux pleuvent sur L. Antonius, s'il est vrai qu'il
veuille mal aux Buthrotiens! J'ai rédigé mon témoignage; vous y mettrez
votre cachet quand vous voudrez. Il faut rendre à la ville d'Arpinum son
argent, tout son argent, si l'édile L. Fadius le demande. Je vous ai
prié dans une lettre précédente de veiller aux cent mille sesterces que
me doit Statius. Si donc Fadius demande cet argent, il faut le lui
donner, mais à lui et point à d'autre. Je crois aussi qu'il y a un dépôt
chez moi ; j'ai écrit à Éros de le rendre. Oui, cette reine d'Egypte
m'est odieuse,
et ce n'est pas sans raison, elle le sait bien. Ammonius s'était porté
garant de ses promesses ; et de quoi s'agissait-il? Uniquement de choses
propres a un homme de lettres (Probablement des objets d'art, des curiosités égyptiennes).
et compatibles avec ma dignité: je les
publierais au besoin en plein forum. Quant a Sara, outre qu'il m'est
connu pour un misérable, il a été fort impertinent à mon égard. Il vint
une seule fois chez moi, et quand je lui demandai poliment ce qui
l'amenait : C'est Atticus que je cherche, me dit-il. Encore aujourd'hui
je ne pense pas sans colère à l'arrogance de la reine, dans les jardins
d'au delà du Tibre. Qu'on ne me parle donc pas de ces gens-là. Ils me
regardent indubitablement comme un homme sans cœur, comme un être dénué
de toute sensibilité. — Mon départ, je le vois, sera retardé par le peu
d'ordre d'Eros. D'après la situation qu'il m'a remise aux nones
d'avril, je devrais avoir de l'avance, et me voilà réduit aux emprunts,
.le croyais au moins que le produit de ces loyers avait été mis à part
pour le temple. Mais Tiron est chargé de ces détails; c'est pour cela
que je l'ai envoyé à Rome, .le n'ai pas voulu ajouter cet embarras aux
vôtres. — Plus Cicéron est réservé, et plus je suis porté pour lui. Il
ne m'a pas écrit à moi, à qui il devrait s'adresser de préférence; mais
il mande à Tiron que, depuis les kaiendes d'avril que son année est
finie, il n'a rien reçu. D'après vos propres façons d'agir, et d'après
l'idée que vous avez de ce que je me dois à moi-même, je veux me montrer
généreux avec mon fils; le traiter même avec une sorte de magnificence
et le combler. Je vous prie donc (si je pouvais m'adresser à un autre,
je vous épargnerais ce soin, ), je vous prie de lui faire payer à
Athènes une année entière de ses dépenses. Éros vous en remettra le
montant ; c'est encore pour cela que j'ai
envoyé Tiron. Je compte sur vos bons soins, et je vous prie de me mander
là-dessus ce que vous jugerez à propos.
740. — A ATTICUS. Pompéi, juin.
A. XV, 17. J'ai reçu deux lettres de vous le lendemain des ides, datées,
l'une de la veille, l'autre du jour même des ides. Je réponds d'abord à
la plus ancienne. Vous attendez des nouvelles de Brutus pour me parler
de lui. Je savais la prétendue peur des consuls (Ils
affectaient de craindre quelque coup de main des conjurés.), car Sica, du meilleur
cœur du monde, mais un peu à l'étourdie, était venu me donner l'alarme.
Mais que me dites-vous? qu'il faut toujours prendre ce qu'on vous donne?
Pas un mot de Sirégius : cela ne me plait guère. Il m'est pénible qu'un
autre ait su avant moi ce qui concerne votre voisin Plétorius.
Très-sagement pour Syrus. Je crois que vous pourrez facilement agir sur
L. Antonius par Marcus, son frère. J'avais donné contre-ordre pour
Antron ; mais ma lettre ne vous était pas arrivée. Ne payez, je vous
prie, qu'à l'édile L. Fadius; il n'y a que lui qui présente sûreté et
qui ait qualité. Vous attendez encore, me dites-vous, les cent mille
sesterces que vous avez fait payer à Cicéron. Sachez donc d'Eros, je
vous prie, ce que deviennent les loyers de mes maisons. Je n'en veux
point à Arabion, au sujet de Sitius. Je ne partirai point avant d'avoir
mis mes affaires à jour. C'est votre avis aussi, je le suppose. — Voilà
pour la première lettre. J'arrive à la seconde. Je vous reconnais dans
tout ce que vous faites pour Servilie, c'est-à-dire pour Brutus. Quant à
la reine d'Egypte, je vois avec plaisir que vous ne vous en souciez
guère et que vous m'approuvez. Tiron m'a mis au fait des comptes d'Eros,
que j'ai mandé ici. Que vous me charmez en m'assurant que rien
ne manquera à Cicéron ! J'en ai appris des merveilles par Messalla, qui
a passé chez moi en revenant de Lanuvium, où sont nos amis. Sa lettre,
je vous le jure, est si bien et de sentiment et d'expression, que je ne
craindrais pas de la produire même dans une réunion de connaisseurs.
Aussi me crois-je obligé d'en agir très-largement avec lui. Sextius,
j'espère, ne se formalisera pas à cause de Rucilianus. Si Tiron revient,
je partirai pour Tusculum. Quels que soient les événements, donnez-moi
toutes les nouvelles qui pourront m'intéresser.
741. — A ATTICUS. Du lac l.ucrin, juin.
A. XV, 18. Ma lettre du 17 des kalendes était suffisamment explicite sur
ce qui m'est nécessaire et sur ce que j'attends de vous, sans trop vous
déranger pourtant. Cependant à peine parti et embarqué sur le lac, j'ai
résolu de vous envoyer Tiron pour intervenir dans tous ces détails
d'affaires. De plus, j'ai écrit à Dolabella que je désirais me mettre en
route, s'il n'y voyait pas d'obstacle, et je lui ai demandé des mules de
transport, pour mon voyage. Je comprends à quel point les intérêts des
Buthroliens d'un côté, ceux de Brutus de l'autre, doivent vous absorber.
Je soupçonne même que c'est sur vous que tombent en grande partie, le
soin des préparatifs et même la direction des jeux de Brutus. Aussi je
ne vous demande qu'un moment. Il ne m'en faut pas davantage. Tout
indique un massacre, et même prochainement. Voyez quels chefs et quels
satellites! il est clair que je ne suis pas en sûreté. Si vous en jugez
différemment, soyez assez bon pour me l'écrire. Pour peu que la prudence
le permette, j'aime bien mieux rester chez moi.
742. — A ATTICUS. Tusculum, juin.
Α. XV, 19. Que tenter désormais pour les habitants de Buthrole, puisque
tous vos efforts, dites-vous, ont été vains? Mais à quoi se détermine
Brutus? Je m'afflige de vous savoir si occupé : tout cela vient des dix
(Commissaires institués par Antoine pour partager les terres aux
vétérans.). La chose est difficile, mais elle ne vous fait pas peur. Recevez en
tout mes remerciements. On se battra : rien n'est plus clair. Fuyons donc
! mais, comme vous le dites, c'est un parti à prendre après avoir
raisonné tête à tête. Je ne sais ce que veut Théophane; il m'avait
écrit; je lui ai répondu tant bien que mal, et voilà qu'il m'annonce sa
visite pour me parler de ses affaires et de quelques autres qui me
regardent. J'attends une lettre de vous. Veillez à ce qu'on ne fasse pas
d'incartade. Statius me mande que Q. Cicéron lui a déclaré de la manière
la plus formelle ne plus vouloir entendre parler de ses amis, et être
irrévocablement dans l'intention de prendre parti pour Brutus et
Cassius. Je désire beaucoup apprendre quelque chose de positif là-dessus
: je ne sais qu'en penser. C'est peut-être un mouvement d'humeur contre
Antoine, peut-être le désir d'un nouveau genre de gloire, peut-être
enfin un pur caprice : oui, plutôt cela. Toutefois, je ne suis pas sans
crainte, et mon frère est aux champs : il sait en effet ce qu'Antoine
lui a dit de son fils. Il m'en a confié des choses qui ne peuvent se
répéter. C'est à s'y perdre J'ai des ordres de Dolabella pour tout ce
que je voudrai, c'est-à-dire pour rien. Dites-moi, je vous prie, s'il
est vrai que C. Antoine ait voulu être septemvir. Il en est bien digne.
Je partage votre avis sur Ménédéme. Tenez-moi au courant de tout.
743. -- A ATTICUS. Tusculum, juin.
A. XV, 20. J'ai fait mes
remerciement à Vécténus : on n'est vraiment pas plus aimable. Que
Dolabella me donne telles instructions qu'il lui plaira, peu importe; ne
fut-ce qu'un ordre à porter à Nicias. S'y tromperait-on? Pour peu qu'on
ait de réflexion, ne verra-t-on pas bien que je désespère de tout, et
que c'est pour cela, non pour une mission, que je pars? Vous dites que
nombre de personnes, et de personnes graves, regardent la république
comme touchant à ses derniers moments. Mais, moi , le jour où j'ai
entendu à la tribune qualifier le tyran de grand homme, je nie suis
défié de tout: et quand ensuite j'ai vu à Lanuvium nos amis n'espérer
pour leur propre tête que dans les paroles d'Antoine , il ne m'est pas
resté le moindre espoir. Mon cher Atticus, prenez ceci, comme je vous
l'écris, avec courage. C'est une mort honteuse qui nous attend au
dénouement, vous le savez , et Antoine nous l'a bien l'ait entendre. Eh
bien ! je veux sortir de cette nasse, non pour fuir la mort, mais pour
en chercher une meilleure. Voilà ce que nous devons à Brutus. — Cartéia
, dites-vous , a ouvert ses portes à Pompée. Une armée va donc marcher
contre lui , et alors quel camp choisir? Pas de neutralité possible avec
Antoine. Ici, faiblesse; là, infamie: hâtons-nous de fuir. Mais
donnez-moi un conseil: Faut-il que je m'embarque à Brindes ou à Pouzzol?
Brutus a pris son parti, et il a fait sagement. Je ne suis pas
maître de mon émotion. Hélas! quand le reverrai-je? Mais ce sont là les
maux de la vie : il faut se résigner. Vous ne le verrez pas non plus :
que tous les Dieux confondent celui qui n'est plus (César), et qui vous
a laissé sur les bras
les affaires de Buthrote! Mais laissons le passe; avisons au présent. Je
sais a peu près a quoi m'en tenir sur les comptes d'Eros, quoique je ne
l'aie pas encore vu ; mais il m'en a écrit, et Tiron les a examinés.
Vous pensez que j'ai besoin d'un emprunt ; qu'il doit être de deux cent
mille sesterces; qu'il me les faut pour cinq mois, jusque l'échéance de
pareille somme qui m'est due pur mon l'ivre. Puisque Tiron m'assure que
vous n'êtes pas d'avis que j'aille exprès à Rome, soyez assez bon, si
cela ne vous gêne en rien, pour me chercher cet argent et le prendre en
mon nom ; c'est ce qui presse en ce moment, .le me ferai rendre compte
du reste en détail par Éros lui-même, notamment en ce qui concerne le
revenu de mes biens dotaux. Si on le fait tenir exactement à mon fils,
quelque largement que je veuille le traiter, il doit à peu près suffire.
Il est vrai qu'il me faut aussi de l'argent pour mon voyage. Mon fils
peut recevoir au fur et à mesure des rentrées. Moi, il faut que je
prenne à l'avance tout ce qui me sera nécessaire. Quelque persuadé que
je sois que ce malheureux, qui a peur de son ombre, prépare un massacre,
je ne veux pourtant pas m'en aller sans laisser mes affaires en ordre.
Aurez-vous réussi à conclure, oui ou non? C'est ce que je saurai en vous
voyant. J'ai cru utile d'écrire ceci de ma main, et vous vous en
apercevrez bien. C'est entendu pour Fadius, mais à personne autre que
lui. Je voudrais bien avoir réponse de vous dans la journée.
744. -- A ATTICUS. Tusculum, juin.
A. XV, 21. Écoutez les nouvelles; le père de Quintus bondit de joie : son
fils lui écrit qu'il va se joindre à
Brutus : Antoine voulait qu'il le fît nommer dictateur, et qu'il
s'emparât d'un poste. Quintus aurait refusé, et cela pour ne pas
chagriner son père. De là grande inimitié de la part d'Antoine. « Mais je
me suis observé, ajoute-t-il à son père, pour qu'il n'allât pas dans
sa fureur s'en prendre à vous. Nous avons fait la paix. J'ai quatre
cent mille sesterces, et le reste en espérance. " Statius écrit que
l'intention de Quintus est de se réunir à son père: n'est-ce pas bien
extraordinaire en vérité? Il s'en réjouit. Vit-on jamais pareil mauvais
sujet? J'approuve votre hésitation sur l'affaire de Canus. J'étais loin
de me douter de cette dette; de bonne foi, je croyais la dot restituée.
Je vous attends pour ce que vous vous réservez de traiter de vive voix.
Retenez mes messagers tant qu'il vous plaira. Je sais vos occupations.
Vous avez bien fait d'écrire à Xénon. Dès que l'ouvrage dont je m'occupe
sera fini, je vous l'enverrai. Vous avez écrit à Quintus qu'il avait dû
recevoir une lettre de vous ; personne ne lui en a remis. Tiron
m'assure que vous n'êtes pas d'avis que j'aille à Brindes, à cause des
soldats dont on parle dans ces parages. Je m'étais déjà presque décidé
pour Hydrunte (Otrante). Ce sont vos cinq heures de trajet qui me
touchent. Mais de ce côté-ci quelle longue navigation! Nous verrons.
Point de lettres de vous depuis le 11 des kaiendes : c'est tout simple.
Y a-t-il du nouveau? Dès que vous le pourrez, venez ; moi, je me hâte,
de peur que Sextus ne me prévienne. On annonce son retour.
745. — A ATTICUS. Tusculum, juin.
Α. XV, 23. J'ai la fièvre; je ne suis pas malade pourtant, mais il y a un
violent combat en moi.
Partirai-je, ne partirai-je pas? Jusqu'à quand ces irrésolutions,
direz-vous? Jusqu'à ce que le sort en soit jeté, c'est-à-dire jusqu'à
ce
que je sois à bord. Si Pansa me répond, je vous enverrai ma lettre et la
sienne. J'attends Silius, pour qui j'ai fait un mémoire. Mandez-moi
ce
qu'il y aura de nouveau. J'ai écrit à Brutus: si vous savez quelque
chose de son voyage, veuillez aussi me le dire.
746. — A ATTICUS.
Tusculum, juin.
A. XV, 24. Le messager que j'avais envoyé à Brutus est revenu le 7 des
kaiendes. Servilie lui a dit que Brutus était parti le jour même, à la
quatrième heure : je regrette beaucoup qu'il n'ait pas ma lettre. Silius
n'est pas venu. J'ai terminé le mémoire, et je vous l'envoie. Dites-moi,
je vous prie, quel jour je dois vous attendre.
747. — A ATTICUS. Tusculum, juin.
Α. XV, 22. Félicitons-nous de voir le fils de Quintus parti. C'est une
gêne de moins. Je crois aux bons discours de Pansa. Il n'a jamais fait
qu'un avec Hirtius : je le sais. Je crois même qu'il sera fort ami de
Brutus et de Cassius, s'il y trouve son compte. Hélas! quand les
verra-t-il? Mais lui, ennemi d'Antoine? depuis quand? Et pourquoi, je
vous prie? Faudra-t-il donc que nous nous laissions toujours ainsi
abuser? En vous annonçant que Sextus arrivait, je n'ai pas prétendu dire
qu'il fût déjà arrivé. Il se prépare, et ne renonce point à la chance
des combats. S'il persiste, la guerre est certaine. Quant à notre amant
de Cythéris (Antoine), il répète, lui, que pour vivre il faut vaincre.
A cela que. dit Pansa? Avec qui se mettra-t-il, si la guerre a lieu? ici il n'y a que trop d'apparence. Mais nous parlerons de tout
cela, et de bien d'autres choses encore, quand je vous verrai. Ce sera,
m'avez-vous dit, aujourd'hui ou demain.
748. — A ATTICUS. Tusculum, juin.
A. XV, 14. Le 6 des kalendes, j'ai reçu une lettre de Dolabella, dont
je vous envoie copie. Vous y verrez qu'il avait rempli vos souhaits. Je
lui ai sur-le-champ répondu, en insistant beaucoup sur ma
reconnaissance. Mais comme je l'avais déjà remercié, j'ai dû,
pour expliquer ma seconde lettre, me fonder sur ce que vous ne m'aviez
précédemment donné de vive voix aucun détail. Un plus long préambule
serait inutile. Voici ma lettre :
CICERON A SON CHER DOLABELLA, CONSUL.
« Quand j'eus appris par notre Atticus vos excellents procédés et
l'important service que vous lui aviez rendu, et lorsque vous m'eûtes
mandé vous-même que vous aviez déféré à notre vœu, je me suis empressé
de vous écrire, et j'ai taché de vous exprimer que rien de votre part
ne pouvait m'être plus agréable. Mais Atticus vient de venir à
Tusculum, exprès pour me parler de sa gratitude, pour me dire combien il
est pénétré du zèle que vous avez mis dans l'affaire de Buthrote, et des
précieux témoignages de votre affection. Je ne puis, à mon tour,
résister au plaisir de vous témoigner une seconde fois plus
explicitement encore mes sentiments et les siens. De toutes les preuves
d'intérêt et d'attachement dont vous m'avez si souvent
comblé, aucune,
sachez-le bien, mon cher Dolabella, ne pouvait me plaire et me toucher
plus que celle qui montre à Atticus combien vous m'aimez et combien je vous
aime. Grâce à vous, la cause et la ville des Biithrotiens seront sauvées : or,
on se plaît toujours à continuer son ouvrage. Ils sont sous votre
sauvegarde. Vous savez combien de fois je vous les ai recommandés; il
ne me reste donc qu'à vous demander de leur conserver votre protection,
el d'employer votre autorité à les défendre. Si vous y consentez pour
l'amour de moi, et si désormais les Buthrotiens peuvent compter sur
vous, c'en est fait, vous devenez, à vous seul, le gage assuré
de leur repos, et pour jamais vous nous délivrez, Atticus et moi, d'un
souci, d'un tourment de tous les jours. Souffrez que je vous adresse
encore une fois ici à cet égard mes plus vives, mes plus pressantes
instances. »
Cette lettre écrite, je me suis remis à mon travail. Mais je crains que
vous n'y trouviez bien des endroits à noter au crayon rouge. Je n'ai pas
l'esprit assez calme pour écrire. De trop graves pensées m'agitent.
749. — A ATTICUS. Tusculum, juin.
Α. XVI, 16. J'ai lu tout ce que vous me dites d'aimable. Je viens
d'écrire à Plancus; voici la copie de ma lettre. Je saurai de Tiron ce
qu'il lui aura dit. Vous pourriez vous occuper davantage de votre sœur
si vous étiez délivré de cette vilaine, affaire.
M. CICERON A CN. PLANCUS, PRETEUR DESIGNE.
« Vous êtes, je le sais, très-désireux de plaire à Atticus, et si
passionné pour ce qui me touche moi-même, que je crois avoir rarement
trouvé ailleurs une bienveillance et une affection comparables aux
vôtres. Comment en serait-il autrement, quand à la longue et fidèle
amitié dont nos pères nous ont
transmis l'héritage, viennent se joindre entre nous des sentiments
personnels d'une vivacité si grande et d'une réciprocité si parfaite?
Vous connaissez l'affaire de Buthrote. Nous en avons souvent parlé. Je
vous en ai expliqué les détails. Voici comment les choses se sont
passées. Aussitôt que nous sûmes que les terres des Buthrotiens étaient
comprises dans le partage, Atticus alarmé rédigea une note, et me la
donna pour la présenter à César, chez qui je soupais le jour même. Je
remis la note ; César trouva la réclamation fondée ; il répondit à
Atticus que ce qu'il demandait était juste. Il l'avertit toutefois qu'il
fallait qu'à l'époque marquée, les Buthrotiens payassent la solde de
leurs contributions. Atticus, qui voulait sauver la ville, avança la
somme de ses deniers. Cela fait, nous allâmes trouver César; nous lui
parlâmes avec chaleur des Buthrotiens, et nous enlevâmes un décret tout
en leur faveur; des personnages considérables y apposèrent leur sceau.
Les choses étant ainsi, j'eus lieu d'être surpris que César eût laissé
s'assembler ceux qui avaient convoité les terres des Buthrotiens, et
surtout qu'il vous eût chargé de l'opération. Je lui en parlai, et je
revins même assez souvent à la charge, jusque-là qu'il se plaignit de
ce
que je ne me fiais pas à sa parole. Il recommanda à M. Messalla et à
Atticus lui-même d'être sans aucune inquiétude. Il leur confia sans
déguisement qu'il était gêné par la présence de ses soldats, qu'il ne
voulait pas mécontenter (vous savez combien il tenait à sa popularité);
mais qu'aussitôt après leur embarquement, il leur ferait assigner
d'autres terres. Nous en étions là quand César vivait.
Lors de sa mort, les consuls furent autorisés par sénatus-consulte à
connaître de toutes les affaires pendantes. II leur en fut référé. Pas
la moindre hésitation. La réclamation fut à l'instant admise, et ils
promirent qu'une lettre allait vous être expédiée. Je ne doute pas, mon
cher Plancus, que le sénatus-consulte, la loi, le décret des consuls et
la lettre qui vous a été écrite ne vous paraissent décisifs; et dès
qu'il s'agit d'Atticus, je suis sûr de vos bonnes intentions. Eh bien!
je m'autorise de notre liaison et de votre bonté ordinaire pour vous
demander une chose que la rare bienveillance et l'heureux penchant de
votre caractère vous inspireraient naturellement : c'est de faire avec
grâce, vite et bien, à ma considération, ce que vous feriez. de
vous-même, j'en suis convaincu. Je n'ai pas d'ami qui me soit plus
cher
qu'Atticus, et dont l'amitié me soit plus douce et plus précieuse. Ce
n'était dans le principe qu'une affaire d'argent, de beaucoup d'argent,
il est vrai. C'est maintenant une question personnelle. Il s'agit pour
lui de savoir s'il réussira, vous aidant, à obtenir définitivement
aujourd'hui ce qu'il a obtenu déjà, après tant de démarches et de prières, du vivant et après la mort de César. Ce service, s'il vous le
doit, sera interprété par moi comme l'une des plus grandes marques de
bouta que j'aie pu recevoir de vous. Veuillez en être persuadé. De mon
côté, vous me trouverez soigneux et empressé d'aller au-devant de tout
ce qui pourrait vous intéresser ou vous plaire. Ne négligez pas votre
santé. »
|