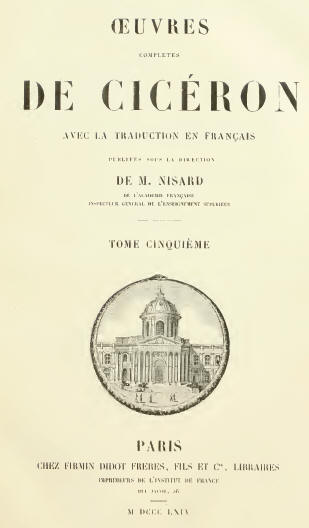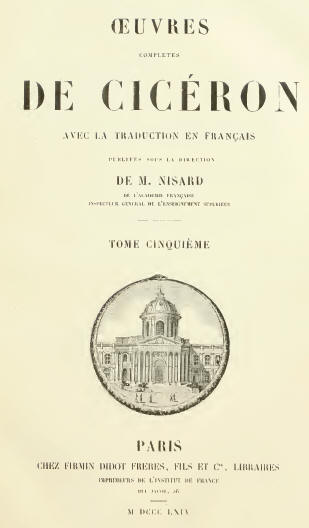|
450. — A ATTICUS. Rome, mai.
A. XII, 2. Oui vraiment, il est
question d'un naufrage où Murcus aurait péri; de Pollion fait
prisonnier, et de cinquante vaisseaux poussés par le même coup de vent
dans le port d'Utique. On ne saurait de plus ce qu'est devenu Pompée,
qui
411
n'a pas touché les îles Baléares, ainsi que l'affirme Paciécus. Mais
dans tout cela, rien de positif, rien d'authentique. Voilà ce qui s'est
dit pendant votre absence. En attendant, on célèbre les jeux à Preneste.
Hirtius y est, et toute la séquelle. En voila pour huit jours, et quels
festins! quelles orgies! Pendant ce temps, tout se décide peut-être.
Admirables gens! Balbus ; bâtit. Que lui fait tout cela? Que
voulez-vous? pour qui cherche le plaisir et non la vertu, n'est-ce pas
là vivre? Eh bien! vous dormez. Allons, prononcez-vous, et choisissez
enfin l'un ou l'autre MIon avis à moi, si vous me le demandez, est qu'il
faut prendre son bien où on le trouve. Mais en voila assez. Je vous
attends bientôt; car c'est chez moi que vous descendrez, j'espère. Nous
donnerons un jour à Tyrannion, nous verrons pour le reste.
451. — A VARRON. Tusculum, juin.
F. IX, 4. Le système de Diodore sur
la nécessité est le mien. S'il est vrai que vous deviez venir, c'est
qu'il est dans l'ordre des choses nécessaires que vous veniez : si au
contraire je ne vous vois point, c'est que votre venue se trouve en
dehors des choses nécessaires. Voyez maintenant ce qui vous aimez le
mieux, ou de la doctrine de Chrysippe, ou de celle-ci, que mon pauvre
Diodote avait grand'peine à concilier avec la philosophie. Mais nous
causerons de tout cela quand nous n'aurons rien de mieux à faire; car,
selon Chrysippe encore, il est dans l'ordre des choses nécessaires que
nous en causions. Je suis charmé de ce que vous me mandez de Coctius. Je
l'avais annoncé à Atticus. Si vous ne vous hâtez, je cours auprès de
vous, soyez-en sûr; et pour peu que vous ayez un jardin près de vos
livres, nous n'aurons rien à désirer.
452. — A ATTICUS. Tusculum. Juin.
A. XII, 3. Je crois qu'après vous il
n'y a pas d’homme moins complimenteur que moi ; ou s’il nous arrive de
l'être à l'un ou a l'autre, ce n'est pas entre nous du moins. Je vais
donc vous parler en toute sincérité. Que je meure, si ce Tusculum, ou
d'ailleurs je me plais tant, si les îles Fortunées elles-mêmes
pourraient m'offrir de quoi me passer de vous des journées entières.
Nous avons encore trois jours a prendre patience. Vous voyez que je vous
associe a mes peines, et non pas a tort, je crois. Quand aurai-je des
nouvelles de la vente? Aujourd'hui? ou seulement à votre arrivée? En
attendant j'ai mes livres, mais l'histoire de Vennonius me manque
beaucoup. N'oublions pas les affaires cependant. J'ai le choix de trois
moyens pour cette créance que César a bien voulu reconnaître : 1° Me
faire adjuger le bien à l'encan. Mais j'aimerais mieux tout perdre. Et à
part l'ignominie, la perte est encore au bout. 2° Accepter un effet à un
an sur l'un des acquéreurs. Mais à qui accorder tant de confiance? Et
cette année ne serait-elle pas l'année de Méton? 3°Se contenter comme
Vettiénus de moitié comptant. Réfléchissez sur tout cela. Je crains
encore que l'homme chargé de la vente ne la fasse point, et qu'une fois
les jeux finis, il ne coure à Préneste renforcer les claqueurs, afin de
rendre plus éclatant un succès si bien mérité. Mais nous verrons.
453. — A ATTICUS. Tusculum, Juin.
A. XII, 4. L’aimable, la charmante
lettre! Oui, c'est un jour de fête que vous me faites. J'étais fort en
peine. Tiron m'avait dit que votre figure était d'un rouge
extraordinaire; mais j'attendrai un jour de plus, comme vous me le con-
412
seillez. — Cet éloge de Caton, c'est un véritable problème d'Archimède.
Je n'arriverai jamais à me faire lire de vos convives, je ne dis pas
avec plaisir, mais môme avec patience. Eh ! quand je n'articulerais rien
des opinions qu'il a prononcées, de la part active ou de conseil qu'il a
prise aux affaires de la république; quand je me réduirais à un éloge nu
de son énergie, de sa constance, ces braves sens en trouveraient encore
la digestion assez rude. Mais le moyen de louer un tel homme, sans
mettre en relief les trois points que voici : Il a prévu tout ce qui est
arrive; il a tout fait pour y mettre obstacle ; il a renoncé à la vie
pour n'en être pas témoin. Je ne vois là rien qui soit du goût d'Alédius
(quelque ami de César). Soignez votre santé, je vous en prie, et prudent
en toutes choses, soyez-le pour vous rétablir.
454. — A VARRON. Rome. juin.
F. IX, 6. Caninius m'a prié en votre
nom de vous avertir de tout ce qui pourrait survenir d'important. Eh
bien ! on attend César de jour en jour. Mais, vous ne pouvez l'ignorer,
il parait qu'il avait annoncé à ses amis l'intention d'arriver a Alsium;
on lui a répondu de s'en garder; qu'il serait exposé à voir par là
beaucoup de visages qui lui déplairaient, et que le sien serait loin d'y
plaire à tout le monde ; qu'il ferait donc mieux de débarquer à Ostie.
Ostie ou Alsium, je ne vols pas la différence; mais enfin c'est Hirtius,
il me l'a dit à moi-même, c'est Balbus, c'est Oppius, tous trois vos
amis dévoues, je le sais, qui en ont écrit à César. Ce détail m'a paru
ne pas vous être indifférent au moment où vous cherchez en quel lieu
fixer votre retraite, ou plutôt la nôtre à tous deux. Car enfin sait-on
ce que fera César? A la vérité, je suis bien avec ces trois personnages,
et je vous fais voir que je suis même leur confident, pourquoi m'en
défendrais-je? II y a une grande différence entre laisser faire et
approuver. D'ailleurs, je ne sais en vérité pas ce que j'aurais à
blâmer, pour peu que je misse de coté l'origine des choses. Alors on
pouvait tout empêcher. Vous étiez absent, mais moi j'ai vu nos amis
appeler la guerre de tous leurs voeux, et César moins la désirer que ne
pas la craindre. C'était donc la volonté des hommes qui agissait. Plus
tard, il n'y a eu que des conséquences nécessaires. Il fallait bien
qu'il y eût un vainqueur d'un côté ou d'un autre. — Je me rappelle
combien vous gémissiez avec moi, quand nous réfléchissions alors que
l'une des deux armées serait anéantie, que les chefs périraient, et
qu'une victoire de guerre civile serait l'inévitable dénouement de la
situation. Hélas! cette victoire me faisait peur, même aux mains du
parti que j'avais été rejoindre. Les menaces contre ceux qui n'étaient
pas venus étaient si horribles! Votre caractère et mes avis leur
déplaisaient, et je vous jure qu'à l'heure qu'il est, s'ils étaient les
maîtres, nous verrions d'abominables choses. C'est à moi surtout qu'ils
en voulaient; comme si je m'étais fait, en quelque sorte, un thème à
part différent du leur, ou qu'en allant implorer le secours de bêtes
sauvages, on servit mieux la république qu'en se résignant soit à
mourir, soit a vivre, je ne dirai certes pas avec une magnifique
perspective devant soi, mais du moins encore avec un peu d'espérance.
Cependant, dira-t-on, la confusion et le boul-
413
versement sont partout. Qui le nie? Eh bien! c'était une raison pour ne
pas se laisser surprendre et pour se ménager une position. C'est ici que
j'en voulais venir, quoique je me sois arrêté en chemin plus que je ne
le pensais. Je vous ai regardé dans tous les temps comme un esprit
supérieur, mais bien plus aujourd’hui, quand je vois que, par une
exception que je crois unique vous êtes au port, l'orage grondant autour
de vous, et que vous puisez paisiblement aux sources fécondes du savoir,
tout entier à des spéculations et à des travaux dont le charme est bien
préférable à la vie agitée et à toutes les voluptés des vainqueurs. Il
n'y a, selon moi, qu'à Tusculum que l'on vive et que l'on sache vivre.
Et je donnerais tous les trésors du monde pour qu'il me fût permis de
jouir en paix d'une pareille existence. — Je vous imite toutefois autant
que je le puis, et je demande aussi le reposa l'étude. Puisque la patrie
repousse mes services, ou qu'elle ne peut plus les employer, qui
pourrait me blâmer de me faire une autre vie? Suivant beaucoup de sages,
les lettres méritent la préférence sur la patrie elle-même. En cela ils
s'abusent peut-être : quoi qu'il en soit, fort du témoignage de ces
grands hommes qui ont jugé que les études pouvaient dispenser des
charges civiles, comment n'userais-je pas largement du droit de m'y
livrer tout entier, alors que c'est la république elle-même qui m'y
convie? — Mais je fais plus que ne demandait Caninius. Il me priait
seulement de vous instruire de ce que j'apprendrais d'important, et
voilà que je cause de mille objets que vous savez mieux que moi. Je ne
manquerai pas du moins à ma lâche, et vous serez informé de tout ce qui
peut vous toucher.
455. — A VARRON. Rome, juin.
F. IX, 7. Je soupais chez Séius
quand on nous a remis vos lettres à lui et a moi. Oui, le moment est
mûr. Si je ne vous ai pas dit le fond de ma pensée, je vous avouerai ma
finesse : je voulais vous avoir à ma portée, afin de pouvoir me
concerter avec vous en cas d'événement heureux. Aujourd'hui tout est
consommé, plus de doute ; il faut courir, il faut voler à lui ; car en
apprenant le tort de L. César le fils, j'ai pu me dire tout bas : « Que
me réserve-t-on à moi son père? » — Je vais presque tous les jours
souper chez nos puissants du jour. Que faire? ne faut-il pas se plier
aux circonstances? Mais trêve de rire : aussi bien nous n'en avons pas
sujet. L'Afrique a entendu ses bords sauvages retentir d'un horrible
craquement. « Il n'y a lien de si monstrueux à quoi je ne m'attende.
D'ailleurs vous me demandez ce que je ne sais pas encore moi-même, le
moment, la route et le lieu. On ignore là-bas s'il viendra à Baies, ou
s'il passera par la Sardaigne La Sardaigne est le seul de ses domaines
qu'il n'ait pas encore inspecté. C'est bien assurément le plus médiocre
; mais il y tient comme aux autres. Mol, je suis persuadé qu'il viendra
par la Sicile. Au surplus, nous saurons bientôt à quoi nous en tenir.
Dolabella arrive. Je pense en faire mon guide et mon maître. « Il y a
bien des maîtres qui ne valent pas les élèves. — Cependant si je savais
ce que vous avez résolu, je tâcherais par-dessus tout de faire cadrer
mes déterminations avec les vôtres. Écrivez-moi donc.
456. — A VARRON. Rome, juin.
F. IX, 5. Va pour le jour des nones!
ce n'est ni trop tôt ni trop tard pour les affaires et pour la
414
saison. J'accepte, et ne ferai faute.— Non, non, je ne me repentirais
pas de ma conduite, quand même ceux qui en ont suivi une autre n'en
seraient pas aux regrets. J'ai agi par devoir, non par intérêt. Ce n'est
pas le devoir que j'ai abandonné, c'est une cause sans ressource. J'ai
montré à la fois plus de vergogne que ceux qui sont restes chez eux les
bras croisés, et plus de prudence que ceux qui n'y sont rentrés qu'après
avoir tout perdu. Ce qui est odieux, c'est d'entendre des gens qui n'ont
pas bougé se montrer sévères pour les autres. Au surplus, que m'importe!
Je ne crains que ceux qui sont morts les armes à la main, et me soucie
fort peu des vivants qui trouvent à redire que je sois encore en vie. —
Si j'ai quelques moments à moi avant les nones, j'irai vous voir à
Tusculum ; sinon, je me rendrai droit à Cumes, et je vous écrirai un mot
pour que le bain soit prêt.
457. — A ATTICUS. Tusculum, juillet.
A. XII, 5. Quintus est fou aux trois
quarts, sinon tout à fait. Le voilà enchante de ce que son fils et
Statius sont tous deux Luperques. Double scandale pour la famille! Et je
puis dire triple; car Philotime en est aussi. folie sans pareille! mais
la mienne la passe. Et il a le front de vous mettre à contribution pour
cette équipée! Eh! quand vos sources ne seraient pas à sec; quand on y
puiserait aussi largement qu'à celle de Pyrène ou d'Aréthuse, celle
divine émanation de l'Alphée, pour parler votre langage, où tout cela le
mènera-t-il, gêné comme il l'est déjà? c'est son affaire. - Je suis
enchanté de mon Cnton; mais Lucilius Bassus l'est bien aussi de ses
ouvrages. Voyez donc pour Célius. Je n'ai aucune notion là-dessus. Ce
n'est pas le tout de recevoir de l'or, il en faut connaître le titre.
Pour peu que vous ayez le moindre doute, prenez également des
informations sur Hortensius et Virginius. Il est bien difficile, je le
vois, de savoir ce qu'il y a de mieux a faire. A l'égard de Mustella,
c'est bien ; attendez l'arrivée de Crispus. J'ai écrit à Aulus, pour cet
or, que je savais bien à quoi m'en tenir, et que j'avais convaincu
Pison. Je pense comme vous. Cette affaire traîne trop. Par le temps qui
court, il est urgent de réaliser. Je vois bien que vous ne pensez qu'à
moi, que vous ne vous occupez que de moi, et que c'est tout ce tracas
qui vous empêche de venir me voir. Mais c'est comme si je vous avais
âmes côtés. Vous faites mes affaires, et je puis dire que j'en suis tous
les mouvements; car vous ne me laissez pas ignorer un quart d'heure de
vos journées. Je reconnais que Tubulus a été préteur sous le consulat de
L. Métellus et de Q. Maximus. Je voudrais savoir maintenant sous quels
consuls P. Scévola le grand pontife a été tribun. Je crois que c'est
l'année suivante, sous Cépion et Pompée. Il a bien été préteur sous P.
Furius et Sext. Attilius. Mais a quelle époque son tribunat ? Et si vous
le pouvez, dites-moi de quel crime fut accusé Tubulus. N'oyez aussi un
peu, je vous prie, si L. Libon, l'accusateur de Ser. Galba, fut tribun
sous le consulat de Censorinus et Mauilius, ou de T. Quintius et de M.
Acilius. Brutus est là qui me brouille avec son abrégé des annales de
Fannius. J'en avais copié la fin, et sur son autorité j'avais fait de
l'historien Fannius le gendre de Lélius. Mais vous m'avez
mathématiquement réfuté. Voici maintenant Brutus et Fannius qui vous
rendent la pareille. J'avais puisé à une source excellente, Hortensius,
qui est d'accord
415
avec Brutus. Voilà mon autorité. Tirez-moi cela au clair. — J'ai envoyé
Tiron au devant de Dolabella. Il sera de retour le jour des ides. Je
vous attends le lendemain. Je vois votre intérêt pour ma Tullia.
Conservez-le-lui toujours, je vous en conjure. Oui, que les choses
restent entières jusqu'a nouvel ordre, comme vous le proposez. Je ne
suis pas fâché que les kalendes se passent sans moi, afin d'esquiver les
comptes des Nicasions, et avoir le temps de régler les miens. Mais être
loin de vous, voilà ce que rien ne rachète. Quand j'étais a Rome,
pensant vous voir arriver à tous moments, les heures me semblaient
encore bien longues. Je ne suis pas homme à compliments, vous le savez.
J'en dis moins que je ne pense.
458. — A PAPIRIUS PÉTUS. Tusculum, juin.
F. IX, 16. Votre lettre me charme;
j'aime surtout cette tendre amitié qui vous a porté à me l'écrire, dans
la crainte que je ne fusse troublé du message de Silius. Déjà vous m'en
aviez écrit deux fois dans la même lettre; par où j'ai bien vu votre
préoccupation. Je vous ai répondu avec empressement, voulant à tout
prix, dans les circonstances où nous sommes, faire cesser ou du moins
calmer vos alarmes. Mais votre dernière lettre est trop pleine
d'inquiétude pour que je ne vous donne pas des explications
catégoriques. La raison seule, mon cher Pétus, ne suffît plus
aujourd'hui, si on n'y joint pas un peu d'art. Or tout ce que je puis
avoir d'habileté, tout ce qu'il est possible de combiner et de mettre en
jeu pour se concilier les hommes du jour, pour s'assurer leur
bienveillance, je l'ai fait, et je me flatte de ne l'avoir pas fait en
vain. Les favoris de César ont pour moi tant d'égards, tant de
prévenances, que je ne puis m'empêcher de croire un peu à leur amitié.
Sans doute il est difficile de distinguer le vrai du faux, tant que les
circonstances n'ont point éprouvé les coeurs, comme le feu éprouve l'or.
Les apparences sont les mêmes ; mais ce qui prouve qu'on a vraiment de
la sincérité et de l'affection, c'est que, dans ma position et dans la
leur, il n'y a pas intérêt à dissimuler. Quant au personnage en qui
réside aujourd'hui toute la puissance, je ne vois pas que j'aie rien à
en craindre, si ce n'est que la ou il n'y a plus de lois, il n'y a rien
de certain, et qu'on ne peut répondre à tout jamais de la volonté, je ne
veux pas dire du caprice d'un homme. Mais il n'a rien sur le coeur
contre moi : j'ai mis tant de mesure avec lui I C'était jadis mon rôle
d'avoir le verbe haut et libre dans une ville qui me devait la liberté;
mais la liberté n'est plus, et je m'abstiens de toute parole qui
pourrait choquer le maître ou ses favoris. Il est vrai que je ne
m'interdis pas tout à fait l'épigramme et le bon mot : ce serait
abdiquer ma réputation d'homme d'esprit. Encore, si je le pouvais, je le
ferais. Mais César est d'une sûreté de tact sans pareille; et de même
que votre frère Servius, l'un des plus habiles critiques que je
connaisse, dit toujours à coup sûr : « Ce vers-la est de Plaute,
celui-ci n'en est pas; » tant il a fait son oreille à la manière de
chaque auteur et tant il les a étudiés; de même César, qui a écrit
lui-même des volumes de bons mots, connaît, dit-on, si bien mon genre
d'esprit, qu'il n'est jamais dupe de ce qui n'est pas de moi. Il s'y
trompe d'autant moins au-
416
jourd'hui que ses intimes passent presque leur vie avec moi. Dans mes
conversations avec eux, il m'échappe des traits qui ne sont ni l’un
ignorant ni d'un sot, et ils les reportent à César comme tout le reste;
c'est leur consigne : de sorte que César ne tient aucun compte de ce qui
lui arrive par d'autres voles. A d'autres donc votre Énomaüs, quoique
votre citation d'Accius ait un à-propos parfait. De grâce, où serait
l'envie? et par quel bout pourrait-elle mordre? N’importe, admettons
tout pour un moment : eh bien ! les philosophes, c'est-a-dire les hommes
qui possèdent seuls, selon moi, la véritable notion de la vertu, les
philosophes sont d'accord que le sage ne doit se garder que d'une chose,
c est de se mettre en prise. Or je suis doublement sage, à mon avis, moi
qui ai toujours montré le bien où il était, et qui, ne voyant nulle part
assez de puissance pour le réaliser, n'ai pas voulu engager de lutte
contre des forces supérieures. Comme citoyen, on n'a certes pas de
reproche à me faire. Il n'y a plus aujourd'hui qu'à s'abstenir de
blesser les puissants du jour par des paroles irréfléchies ou des
démarches inconsidérées; et, selon moi, c'est encore de la sagesse.
Après cela, je ne puis en conscience m'inquiéter ni de ce qu'on me fait
dire, ni de la manière dont César le prend, ni de ce qu'il y a dans le
coeur des gens qui vivent avec moi, me faisant la cour et me comblant
d'égards. J'ai vu juste dans le passé, je suis circonspect dans le
présent. Cela suffit pour ma tranquillité. Je ne tiens votre comparaison
d'Accius pour bonne qu'à l'égard de la fortune et non de l'envie ; de la
fortune, chose vaine et légère, qui se brise contre la fermeté du sage
comme la mer contre le roc. La Grèce nous apprend par mille exemples
comment les sages s'arrangeaient de la tyrannie à Athènes ou à Syracuse,
et comment seuls ils restaient libres en quelque sorte, quand il n'y
avait plus autour d'eux que des esclaves. Pourquoi ne réussirais-je pas
comme eux à tenir une position, sans offusquer personne et sans perdre
ma dignité? — J'arrive maintenant à vos plaisanteries, oui
plaisanteries, car dans votre citation d'Accius je vois le bouffon du
jour et non l’Atellane d'autrefois. Que venez-vous me parler de Popilius,
de Dénarius? Que voulez-vous dire avec votre plat de tyrotarique? Si
j'étais assez bonhomme pour m'arranger de peu jadis, ce n'est plus cela
aujourd'hui. Hlirtius et Dolabella sont mes élèves dans l'art de bien
dire, mes maîtres dans l'art de bien manger; et vous devez savoir, si
vous êtes informé de tout ce qui se passe ici, que sans cesse on nous
voit, eux chez moi pour déclamer, et moi chez eux pour souper. Donc, je
vous prie, point de cris de détresse. Quand vous étiez riche, vous étiez
à l'affût des moindres économies. Aujourd'hui que vous perdez gaîment
votre bien, n'allez pas voir une banqueroute à la César dans
l'hospitalité que je vous demande : ne vaut-il pas mieux en tout cas
être ruiné par un ami que par des créanciers? Je ne vous demande point
de ces repas dont les miettes nourriraient tout un monde. M'importe ce
qu'il vous plaira : mais magnifique et délicieux. Je me rappelle votre
récit d'un certain repas de Pharaéa. Soupons moins tard ; mais tout le
reste m'en plait. Que si vous voulez me
417
réduire au souper de votre mère, J’y souscris encore. Aussi bien je
serai curieux de voir qui aurait le front de m'offrir des mets tels que
ceux dont vous parlez, ou même des polypes à la mine enluminée, comme le
Jupiter Minianus. Je vous le jure, vous n'oserez ! La renommée ira vous
dire, avant mon arrivée, et ma métamorphose, et mes goûts délicats et
somptueux. Tremblez ! ne croyez pas me donner le change avec des
hors-d’œuvre. Fi de ces fadaises ! Le temps n'est plus où je vous
laissais m'affadir l'estomac avec des olives et des ragoûts de Lucanie.
Mais à quoi bon ce discours? Que j'arrive, je ne demande rien de plus.
Pour vous mettre cependant l'esprit en repos, revenez-en au vieux
tyrotarique. Je ne vous veux mettre en frais que pour le bain, que vous
aurez soin de tenir chaud. Du reste, à la bonne vieille mode ; car tout
ceci n'est qu'un jeu. Vous avez fait merveille pour la villa de Sélicius,
et ce que vous m'en écrivez est fort piquant. Je ne pense pas m'y
arrêter ; non qu'il n'y ait assez de sel : ce sont les saunions qui
manquent. Adieu.
459. — A L. PAPIRIUS PÉTUS. Tusculum, juillet.
F. IX,18. J'étais à Tusculum tout
désœuvré, depuis le départ de mes disciples; je venais de les envoyer
au-devant de leur ami, avec mission de me concilier ses bonnes grâces,
lorsque j'ai reçu votre lettre pleine de bonté. Je vois avec plaisir que
vous approuvez mon dessein : oui, à l'exemple de Denys le tyran, qui,
chassé de Syracuse, ouvrit, dit-on, une école à Corinthe, je veux,
puisque la carrière de l'éloquence judiciaire m'est fermée et que le
sceptre du forum m'échappe, je veux tenir école à mon tour. Que
voulez-vous? cette occupation me sourit aussi. J'y trouve une foule
d'avantages : en premier lieu, et c'est tout aujourd'hui, elle me donne
de la force contre les événements. J'aurais peine à vous expliquer
comment toutefois je ne vois guère jusqu'ici de meilleur parti à
prendre. Mourir eût été préférable; le destin ne l'a pas voulu. Je dis
mourir sur un lit, puisque je n'étais pas sur les champs de bataille.
D'autres y furent. Pompée, Lentulus votre ami, Scipion, Afranius; tous
ont péri honteusement; la fin de Caton seule a été belle. Je limiterai
quand je le voudrai ; je tâcherai seulement de ne pas me rendre cette
extrémité nécessaire comme elle l'a été pour lui-même; et c'est à quoi
je m'applique. Tel est mon premier avantage : en voici un autre. Je
gagne en force et en talent. Le défaut d'exercice avait énervé ma santé
: je la retrouve. Quant à l'éloquence, s'il est vrai qu'on en vit
parfois briller chez moi quelques étincelles, le foyer s'en allait
éteindre; de nouveaux aliments le rallument. Enfin il y a un autre
avantage que je crois que vous placerez au-dessus de tous les autres.
J'ai déjà mangé plus de paons que vous de poulets. Régalez-vous là-bas
des ragoûts d'Hatérius; moi, je fais ici mes délices de la table d'Hirtius.
Venez donc, si vous avez du coeur, venez recevoir les leçons que vous me
demandez; seulement, gare pour moi le proverbe du pourceau qui en
remontre à Minerre' Je vois que vous ne pouvez escompter vos valeurs, ni
remplir votre caisse; vous allez donc rebrousser chemin jusqu'à Rome.
Tenez, tout compte fait, il vaut mieux mourir d'indigestion ici que de
faim là-bas. Je comprends que vous vous ruinez : j'espère du moins que
vos chers et bons amis de ces parages se ruinent de même. C'en est fait
418
de vous, si vous n'y prenez garde. Mais il vous reste une mule, dites-
vous. Eh bien! Montez dessus, puisque vous avez mangé les chevaux, et
revenez à Rome. Je vous promets un siège de sous-maitre, à côté de moi,
dans mon école : il y aura un coussin.
460. — A M. MARIUS. Rome, juillet.
F. VII, 3. Je songe sans cesse à la longue suite des calamités qui nous
accablent, et qui ne sont hélas ! pas près de finir ; et il m'arrive
souvent, au milieu de mes réflexions de me reporter à l'époque où j'ai
commencé à vous connaître. J'ai retenu jusqu'au jour où je vous vis pour
la première fois; c'était le 3 des ides de mai, sous le consulat de
Lentulus et de Marcellus. J'étais allé le soir à Pompéi. Vous vîntes m'y
trouver en grande alarme. Vous croyiez mon honneur et ma vie en péril.
En restant en Italie, disiez-vous, je trahissais mon devoir; en partant
pour la guerre, vous étiez effrayé des dangers que je courais. Mon
trouble était si grand, vous l'avez vu, que je ne savais pas distinguer
le bon parti : cependant je fus moins touché des exigences de mon salut
que des scrupules de l'honneur et du cri de l'opinion. Je ne tardai pas
à m'en repentir, non pour mes dangers personnels; mais j'avais été
chercher un si déplorable spectacle des troupes peu nombreuses et mal
aguerries, des hommes, je parle des grosses tètes, des hommes qui tous,
à l'exception du chef d'un très petit nombre, ne respiraient que le
pillage ; des discours à faire d'autant plus frémir, que la victoire
pouvait les convertir en réalités; pas un personnage considérable qui ne
fût criblé de dettes : que demandez- vous de plus? II n'y avait rien,
absolument rien de bon, si ce n'est la cause que l'on servait. Devant ce
tableau je désespérais naturellement de la victoire, et je reparlais de
la paix que j'avais toujours conseillée. Pompée fut sourd à toute idée
de dénouement pacifique. Je voulus alors lui persuader de traîner du
moins la guerre en longueur : il entrait quelquefois dans cette vue; il
paraissait disposé à l'adopter; et je l'y aurais amené tout à fait, sans
je ne sais quel coup de main heureux qui lui fit prendre une confiance
aveugle en ses troupes. Depuis ce moment, il n'y eut plus rien du
guerrier dans ce grand homme. De pauvres recrues, une armée composée de
toutes pièces fut mise aux prises avec des bataillons formidables.
Honteusement vaincu, forcé jusque dans son camp, il s'échappa seul et
sans suite. Ce fut pour moi le signal de la retraite. J'avais jugé les
chances inégales avant le combat : pouvaient-elles nous revenir après la
défaite ? Je quittai une partie qui ne m'offrait d'autre alternative que
de périr les armes à la main, ou de tomber dans une embûche ; de devenir
la proie du vainqueur, ou d'aller demander secours à Juba ; de me
condamner a l'exil, ou de me donner la mort. A moins de se soumettre et
de se fier au vainqueur, il n'y avait pas d'autres partis. Le plus
tolérable, surtout pour un homme qui n'avait rien à se reprocher, eût
été l'exil, où l'honneur restait sauf; l'exil, il ne faut pas l'oublier,
qui éloignait d'une ville ou tout était sujet de douleur. Mais à l'exil
je préférai ma famille et mon chez moi, si on peut dire aujourd'hui
qu'il y a un chez soi au monde. Vous le voyez, j'avais tout prédit,
419
tout prévu. J'arrivai dans mes foyers: je n'avais pas l'espoir d'y être
heureux, mais avec l'ombre seule de la république je m'y serais cru dans
ma patrie ; sinon, dans l'exil. Je ne vis pas de raison suffisante pour
me donner la mort, quoique j'en visse mille pour la désirer. Il y a
longtemps qu'on a dit pour la première fois que « qui déchoit ne peut
plus aimer la vie. » Mais pourtant je trouve une grande consolation à
sentir ma conscience nette, surtout quand j'ai deux points d'appui tels
que ma passion pour les lettres et la gloire de mon nom. La première, je
ne la perdrai qu'avec la vie; la mort même ne me dépouillera pas de la
seconde. Si je vous en distant et si je vous importune, mon excuse sera
dans l'affection que je vous connais pour moi et pour la république. Je
tenais a vous montrer l'enchaînement de ma conduite, et vous savez
maintenant qu'à aucune époque je n'ai voulu pour personne de pouvoir
au-dessus du pouvoir de la république tout entière; que j'ai désiré la
paix, quand j'ai vu toute résistance impossible contre un homme que
quelqu'un avait comme à plaisir rendu puissant; qu'après la perte de
l'armée et de son chef, notre seule espérance, j'ai persisté à désirer
la paix pour tout le monde; que mes cris n'ayant pu prévaloir, j'ai mis
fin à la lutte en ce qui me concernait. Maintenant, si Rome est Rome
encore, je suis citoyen; sinon, je suis un exilé ; autant vaut l'être
ici qu'a Rhodes ou à Mitylenes. J'aurais préféré vous donner ces détails
de vive voix. Mais il eût fallu trop attendre. Les voilà par écrit. Vous
avez de quoi répondre à ceux qui m'attaquent. On me fait un crime de
vivre, mais ma mort n'eût en rien servi la république. Ne voit-on donc
point, hélas! qu'il n'en a péri que trop déjà, qui vivraient si on m'eût
écouté? On nous eût fait de dures conditions, mais l'honneur eût été
sauf. Nous n'avions pas la force, mais nous avions le droit. Je crains,
je le répète, que ma lettre ne vous paraisse bien longue. Prouvez-moi le
contraire, en m'en écrivant une plus longue encore. Si je puis finir
quelques affaires qui me retiennent, j'espère ne pas être longtemps sans
vous voir.
461. — A ATTiCUS. Tusculum, juillet.
A. XII, 6. Assurez-vous qu'il n'y a
pas d'alliage dans l'or de Célius. Cela s'est vu ; c'est bien assez de
tout perdre sur le change, sans perdre encore sur l'or. Mais pourquoi
toutes ces phrases'? Vous ne vous y laisserez pas prendre. Je vous donne
là du style d'Hégésias, que Varron aime tant. Parlons de Tyrannion. Quoi
! serait-il vrai? sans moi? Il s'était vingt fois mis à ma disposition,
et moi je n'ai jamais voulu, sans vous. Comment expier ce forfait?
Comment? Il n'y a qu'un moyen. Envoyez-moi son ouvrage; je vous le
demande instamment. Au surplus, il ne me fera pas plus de plaisir que
votre admiration ne m'en a fait. J'aime tout ce qui est populaire; et ce
vif intérêt pour des détails techniques me charme de votre part. Au
surplus, je vous reconnais bien là. S'instruire, toujours s'instruire;
c'est la vraie nourriture de l’âme. Mais, dites-moi, quel rapport entre
l'accent aigu ou grave, et mon traité de Finibus? Cette discussion au
surplus nous menaçait de loin, et peut-être en ce moment même avez-vous
quelqu'une de mes affaires en tête. Si vous avez eu une séance agréable
dans mon jardin, je m'en ferai payer avec usure. Je reviens à mon dire.
Envoyez-moi le livre de Tyrannion, je vous en prie. Il est à vous,
420
puisqu'on vous l'a dédié. « Vos affaires, Chrémès, vous laissent-elles
assez de loisir » pour lire mon Orateur? Courage! vous êtes bien
aimable, mais vous le serez encore plus si vous prenez la peine de faire
mettre par vos copistes Aristophane au lieu d'Eupolis, et de faire
opérer la même correction dans tous les exemplaires. — César a l'air de
se moquer de votre quaeso, qui est cependant latin et de bon goût. Mais,
du reste, il vous a rassuré d'un ton qui m'ôte toute inquiétude. Cette
fièvre d'Attica est bien opiniâtre; mais si déjà le frisson a disparu,
elle ne tardera pas, j'espère, à en être quitte.
462. — A L. PAPIRIUS PÉTUS. Rome, juillet.
F. IX, 19. Quoi ! toujours de la
malice ! Balbus, dites-vous, s'est contenté d'un repas frugal. Je vous
entends : vous voulez que la sobriété des rois soit la leçon des
consulaires. Mais vous ne savez pas que votre ruse est éventée, Balbus
est venu droit de la porte de Rome à ma maison. Qu'il n'ait pas été à la
sienne, c'est tout simple mais qu'il n'ait pas été tout d'abord chez la
sienne, vous comprenez, voilà ce qui m'étonne ; quoi qu'il en soit, mon
premier mot a été : Et Pétus? — Pétus? m'a-t-il répondu, je ne me suis
jamais mieux trouvé nulle part. — Si c'est votre beau langage qui a
opéré le charme, j'ai à votre disposition et je vous porterai deux
oreilles qui ne sont ni moins délicates ni moins friandes que celles de
Balbus. Mais si c'est votre cuisinier, je vous somme de ne pas vous
figurer que des bègues valent mieux que les gens à la langue bien
pendue. Les affaires semblent se multiplier autour de moi ; une finie,
une autre arrive. Si je puis une fois être libre et aller vous voir,
soyez tranquille; je ne ferai pas la faute de ne vous avertir que la
veille.
463. — A L. PAPIRIUS PÉTUS. Rome, juillet.
F. IX, 17. N'êtes-vous pas risible,
vous qui quittez Balbus, de venir me demander à moi ce qu'on fera de ces
biens et de ces terres? Est-ce que je sais quoi que ce soit que Balbus
ignore, et n'est-ce pas de lui que me vient le peu que je sais? De
grâce, ami, que fera-t-on de moi? Ma question est toute simple. Vous
l'avez eu à votre disposition, et vous avez pu tout savoir, soit avant
le repas, quand sa tète était saine, soit après, plus sûrement encore,
quand le vin la lui faisait perdre. Mais je n'insiste pas, mon cher
Pétus : d'abord, depuis quatre ans, je regarde comme une grâce les jours
de répit qu'on nous laisse, si toutefois c'est la une grâce, et si c'est
vivre que de vivre sur le tombeau de la liberté. Puis franchement je
crois mes prévisions aussi sûres que vos confidences: le plus fort fera
la loi, et le glaive fera le plus fort. Quant à nous, quoi que ce soit
qu'on nous accorde, il faudra dire merci! Qui ne sait pas se résigner
doit savoir mourir. — On mesure en ce moment toute la campagne de Véies
et de Capène. Il n'y a pas bien loin de à Tusculurn, cependant je ne
m'en préoccupe point; je jouis du temps qu'on me donne, je souhaite
qu'on m'en donne toujours. Cela ne durera peut-être pas; en attendant,
puisque moi, homme de courage et philosophe tout ensemble, j'ai décidé
qu'il n'y avait rien de plus beau que de vivre, je ne puis me défendre
d'aimer celui à qui je dois de vivre encore. Hélas! si ses pen-
421
sées sont pour la république, pour la république telle que nous
l'entendons et qu'il la veut peut-être, il n'est malheureusement plus en
mesure : il s'est laissé lier de trop de façons. Je vais plus loin; car
c'est à vous que j'écris. Eh bien I quoique je ne sois pas de leurs
conseils, sachez que celui qui est le chef ne sait pas même où il nous
mène. Nous obéissons en esclaves à sa volonté, mais il obéit en esclave
aux circonstances. Il ne peut pas dire ce que les circonstances
exigeront de lui; nous ne pouvons pas dire ce que sa volonté exigera de
nous. Si je ne me suis pas expliqué jusqu'ici aussi clairement, n'en
accusez pas ma paresse. Vous savez si je suis paresseux surtout pour
écrire. Mais je doutais encore, et je ne voulais ni vous tourmenter par
mes incertitudes, ni vous donner trop de confiance par des affirmations
téméraires. Je dois pourtant vous dire, et ceci est la vérité même,
qu'il n'existe encore aucun symptôme extérieur du danger que je signale.
Dans de telles conjectures, la sagesse commande de désirer le bien, de
prévoir le mal et de se résigner à tout; c'est ce que vous ferez.
464. — A PÉTUS. Rome, juillet.
F. IX, 20. Votre lettre me charme
doublement : j'ai ri, et vu que vous pouviez rire! J'aime cette pluie de
pommes que vous me lancez comme sur le bouffon de la troupe. Ce qui me
désole, c'est de ne pouvoir aller vous voir, comme je le désirais ; ce
n'était pas en oiseau de passage ; au moins j'aurais posé mon nid chez
vous, et vous auriez vu quel homme! Ce n'est plus le convive dont vous
aviez raison avec des hors-d’œuvre. C'est un convive dont l'appétit
dévorant attaque l'œuf du début, et n'a pas encore bronché aux rôtis de
la fin. Arrière les éloges que vous me donniez autrefois : quel homme
facile! quel convive commode ! Je n'ai plus a me nourrir de
préoccupations politiques, de discours au sénat, de préparations
judiciaires; et je me jette corps et biens dans le camp d'Épicure, mon
ancien ennemi. Je ne veux pas de ses excès, mais j'aime le goût de bonne
chère que vous mettiez jadis dans votre somptueuse existence, quoique
vous n'ayez jamais été bien riche en habitations et en terres. — Alerte,
alerte! Vous avez affaire à un gourmand, qui commence à s'y entendre.
Vous connaissez les savants de fraîche date, et leur insolence! Plus de
sportelles, s'il vous plaît ! plus d’artolagans! Savez-vous bien que
j'ai souvent a ma table et votre Verrius et Camille? Quels types
d'élégance! Quels modèles de bon goût ! Mais voyez mon audace ! j'ai été
jusqu'à donner à souper à Hirtius, sans avoir de paon. Cependant, à
l'exception des consommés bouillants, mon cuisinier n'a réussi à donner
le change sur rien. — Voici ma vie. Le matin, je reçois des gens de bien
à la mine longue, des vainqueurs au visage rayonnant; tous d'ailleurs me
comblant de prévenances et de témoignages d'affection. Quand la foule
s'est écoulée, je m'enveloppe dans mes livres, et j'écris ou je lis.
Viennent alors quelques visites; il y a des personnes qui sont avides de
m'entendre, et qui me croient savant parce que j'en sais un peu plus
qu'elles. Je donne le reste du temps aux soins du corps et de la santé :
n'ai-je pas hélas ! assez pleuré sur la patrie, pleuré plus amèrement et
plus longtemps que jamais aucune mère sur un fils unique? Mais, de
grâce, soignez-vous bien. Je ne voudrais pas aller manger le bien d'un
homme au lit; et pourtant, malade ou non, je ne vous ferai pas de
quartier.
422
465 A PÉTUS. Cumes, août.
F. IX, 23. Je suis depuis hier à ma
maison de Cumes; peut-être irai-je demain vous voir. Je vous le ferai
dire. M. Caparius, que j'ai rencontré dans la forêt Gallinaire, venant
au-devant de moi, et à qui j'ai demandé de vos nouvelles, m'a dit que
vous étiez cloué dans votre lit par la goutte. J'en suis affligé, comme
vous pouvez le croire; mais je n'en persiste pas moins à aller vous
visiter, à aller causer et même souper avec vous. Car enfin votre
cuisinier n'a pas la goutte aussi, je pense. Comptez donc sur un convive
de plus, mais sur un convive qui mange peu, et qui a horreur des grands
repas.
466. — A M. MARIUS. Cumes, août.
F.VII, 4. Le 9 des kalendes, je suis
arrivé à Cumes, avec Libon votre ami et le mien. Je pense déjà à aller à
Pompéï. Je vous dirai le jour à l'avance. Vous vous portez bien,
j'espère! Je le désire toujours, mais plus encore pendant que je suis
ici. Qui peut dire quand nous nous reverrons plus tard ? Aussi, si vous
avez quelques comptes à régler avec la goutte, ajournez-les. Adieu, et
comptez sur moi d'ici à deux ou trois jours.
467. — A ATTICUS. Pouzzoles.
A. XII, 9. Que je suis bien ici, et
que chaque jour je m'y trouverais mieux encore, sans ce dont je vous ai
parlé dans ma dernière lettre ! Rien de plus charmant que cette retraite
; mais le fils d'Amyntas vient un peu trop souvent en troubler les
délices. L'insupportable bavard! D'ailleurs croyez bien qu'il n'y a rien
de plus adorable au monde que cette habitation, ces rivages, cette mer,
et tout le reste. Mais il n'y a pas là de quoi fournir à une longue
lettre : je n'ai rien à vous mander, et le sommeil me presse.
468. — A ATTICUS. Pouzzoles, septembre.
A. XII, 10. Quel malheur que la mort
d'Athamas ! Votre douleur n'est que trop juste; mais il faut vous
modérer. Il y a une foule de consolations à se faire : le plus simple
est de demander à la raison ce que le temps ne refuse jamais. Mais
occupons-nous surtout de la santé de votre Alexis fidèle image de mon
cher Tiron, que je viens de renvoyer malade à Rome. Pour peu qu'il y ait
apparence d'épidémie sur le Quirinal (ou demeurait Atticus), envoyez-
moi Alexis chez moi avec Tisamène : tout le haut de ma maison, comme
vous savez, est libre. Il n'y a rien de mieux à faire.
469. — A SERVIUS SULPICIUS. Rome, septembre.
F. IV, 3. Il ne se passe pas de jour
qu'on ne me parle de votre trouble et de votre désespoir au sujet des
calamités publiques. Je ne m'en étonne point, et dans le portrait qu'on
me fait je reconnais mon image. Cependant je m'afflige de voir qu'avec
une si haute raison vous oubliiez les biens qui vous sont propres, et
que vous vous préoccupiez de maux qui ne vous sont pas personnels.
Certes, l'état déplorable et horrible de la république m'est sensible et
douloureux plus qu'à personne; pourtant je trouve quelque consolation
dans le souvenir des conseils que je donnais. J'avais vu comme d'un lieu
d'observation la tempête se former : j'en fus plus frappé encore quand
je vous entendis donner l'éveil et signaler le nuage. J'ai passé loin de
Rome une grande partie de
423
votre consulat. Mais je connaissais votre opinion sur cette guerre
affreuse qui s'approchait, disiez-vous, et dont vous vouliez nous
garantir. J'étais là d'ailleurs dans les premiers jours de votre
consulat, lorsque, passant en revue l’histoire de nos guerres civiles,
vous engageâtes le sénat à se faire un effroi de ces souvenirs, et à se
persuader que si, à une époque où elle était nouvelle, la tyrannie n'en
fut pas moins affreuse, l'oppression armée qui viendrait ensuite serait
mille fois plus abominable; car si, dans cette carrière, on ne manque
jamais de s'autoriser des exemples du passé, on y ajoute et on y met
toujours du sien. Que d'insensés, hélas! ont péri, vous le savez, pour
n'avoir voulu écouter ni votre expérience, ni vos conseils, et qui
vivraient aujourd'hui par votre sagesse ! « Mais, direz-vous, qu'est-ce
que toutes ces réflexions eu présence des ténèbres de notre situation et
des ruines de la patrie? » Sans doute il n'y a presque qu'à gémir sur
nos maux. Tant de débris à terre! si peu d'espoir de les relever!
Cependant quelle est la pensée de Cé.ar, quelle est l'opinion de tous
les citoyens sur vous? C'est que quand tous les astres de l'empire ont
disparu de l'horizon, vous seul brillez encore comme un flambeau par
l'éclat de votre noble vie, par la maturité de votre raison, par la
dignité de votre caractère. C'est là un grand contre-poids à bien des
chagrins. Si vous êtes séparé des vôtres, ne vous en plaignez pas: que
de déboires vous sont épargnés mais je m'en fais scrupule, quand je
songe que l'avantage de vivre loin des scènes qui se passent sous nos
est précisément ce qui rend votre condition meilleure que la nôtre. — Ma
tendre amitié ne se méprend pas, j'ose le croire, en vous indiquant ces
moyens de procurer quelque adoucissement à vos douleurs. Mais vous
trouverez en vous-même d'autres consolations qui ne me sont pas non plus
étrangères, et dont je connais trop bien la force pour les regarder
comme indifférentes; après l'épreuve que j'en ai faite, je n'hésite pas
à dire que je leur dois en quelque sorte la vie. Pour vous, je n'ai pas
oublié que, dès vos jeunes ans, vous étiez avide d'apprendre, et que
vous vous nourrissiez des traditions et des préceptes des sages sur la
science de la vie. Même au sein d'une existence prospère, ces traditions
et ces préceptes ne sont pas sans utilité ni sans charme ; mais dans des
temps comme les nôtres, on ne trouve de repos que dans leur étude. Je ne
sortirai point de ma réserve habituelle : ce n'est pas un homme aussi
riche des dons de la nature et des fruits de l'étude que j'irai rappeler
à des principes qui ont occupé sa vie depuis son enfance. Je n'ai qu'une
observation à vous soumettre, et vous la goûterez, j'espère : du moment
où j'ai vu qu'il n'y avait plus place à la curie ni au forum pour l'art
auquel je m'étais consacré, j'ai reporté sur la philosophie mes loisirs
et mon intelligence. Vous aussi, vous n'avez plus d'occasion d'exercer
vos rares et admirables talents. C'est ce qui me porte, non à vous
donner des conseils, mais à croire que vous cultivez ces mêmes études,
qui, fussent-elles d'ailleurs moins utiles, auraient du moins pour effet
de vous distraire de vos chagrin. Voire Servius, qui n'est étranger à
aucune occupation libérale, excelle surtout dans la science ou je vous
ai dit que j'allais maintenant puiser le calme. Aussi je l'aime ce bon
Servius comme je n'aime personne, si ce n'est son père.
424
Il me le rend de tout coeur, et je vois dans ses soins pour moi, dans
ses témoignages de déférence et de respect, qu’il pense vous être
agréable à vous-même.
470. — A P. SERVILIUS ISAURIlCUS, PROCONSUL. Rome,
septembre.
F. XIlI, 68. Je vous sais un gré
infini de me donner des détails sur votre traversée. Je vois que votre
coeur est fidèle, et j'en suis touché. Cependant, si vous me disiez çà
et là quelques mots de la république, c'est-à-dire de l'état de votre
province, des actes de votre gouvernement, je vous en saurais plus de
gré encore. Ce n'est pas qu'on ne me parle souvent de ce que vous faites
de beau, mais j'aurais été charmé d'en apprendre quelque chose de
vous-même. Je ne vous écrirai pas toujours ce que je pense sur les
affaires publiques, il y a trop de danger; mais je vous tiendrai au
courant des faits. Je commence pourtant à espérer que notre collègue
César ne veut pas et qu'il ne voudra pas détruire toute espèce de
gouvernement régulier. Il nous importerait beaucoup que vous fussiez ici
présent à ses conseils. Mais s'il vous semble plus utile, je veux dire
plus glorieux, de commander à l'Asie, et de raffermir les liens relâchés
de cette portion de l'empire, je ne dois pas former d'autres voeux pour
votre intérêt et votre honneur. Je veille avec zèle et dévouement à tout
ce qui peut vous intéresser. J'environne surtout d'égards et de respects
votre illustre père. Je le dois à notre vieille amitié, à sa bonté pour
moi, à la vôtre et à son noble caractère.
471. — A P. NIGIDIUS FIGULUS. Rome.
F. IV, 13. Je veux depuis longtemps
vous écrire, mais aucun sujet ne s'offre a mon esprit, et je cherche
même en vain le fonds d'une lettre ordinaire. Le temps nous a ravi ce
qui alimentait notre correspondance aux moments heureux du passé. La
parole et jusqu'à la pensée nous sont aujourd'hui interdits par la
fortune. Je pourrais, il est vrai, vous écrire une lettre bien lugubre
et bien lamentable, une lettre de la couleur des circonstances ; mais il
faudrait au moins y joindre quelque antidote et quelques consolations.
C'est impossible : je n'ai rien à vous faire espérer. Comme vous battu
par la tempête, je ne soutiens ma famille que par les ressources
d'autrui; et je suis plus prés de pleurer sur ma triste existence que de
me réjouir de vivre encore. Ce n'est pas que personnellement j'aie à me
plaindre, ni même que César n'ait été au-devant de mes désirs. Mais je
souffre un chagrin cruel,parce que je me reproche la vie comme un crime.
Je n'ai plus d'amis particuliers : la mort ou l'émigration m'en
séparent. Les amis politiques ont disparu de même : je parle des hommes
dont la république, sauvée par mes soins et les vôtres, m'avait assuré
la bienveillance. Je me vois seul au milieu des débris de leur naufrage
et du pillage de leurs biens. Ah ! si le récit en est affligeant, le
spectacle en est cent fois plus douloureux encore! Sous mes yeux, on
partage les dépouilles
425
de ceux dont le concours me servit naguère à conjurer l'incendie qui a
fini par nous dévorer; et là, dans la ville ou la faveur publique,
l'ascendant du caractère et la gloire m'avaient environné de tant
d'éclat, Cicéron compte pour rien. César pousse à l'excès la bouté; mais
la bonté de César est faible contre le mouvement des choses et la
transformation des temps. Privé des biens dont ma nature, mes goûts et
mes habitudes m'avaient fait un besoin, je sens que je déplais, et je me
déplais à moi-même. Né pour jouer un rôle, je n'ai plus la faculté
d'agir ni de penser; après avoir fait jadis descendre ma protection sur
des hommes obscurs, quelquefois sur des criminels, je n'ose aujourd'hui
m'avancer en rien, même pour un homme tel que P. Nigidius, esprit si
sage, coeur si pur; pour Nigidius, naguère au faite de la faveur, et
certes l'un des hommes qui m'aiment le plus au monde. Vous voyez qu'il
n'y a rien là pour fournir matière à des lettres. Je pourrais, il est
vrai, chercher des consolations et vous indiquer des remèdes à vos
souffrances. Mais s'il y a un homme capable de se faire une raison et de
consoler les autres, n'est-ce pas vous? Je ne vous parlerai donc point
de ce qu'on peut demander à la raison et à la science ; vous le savez,
et vous verrez ce qui sied aujourd'hui à un citoyen courageux et à un
sage; vous verrez ce qu'exigent et la gravité de votre caractère et
l'élévation de votre âme, et votre passé, et vos penchants, et tous ces
dons par ou vous excelliez dés l'enfance. Ce que je pressens, parce que
je suis à Rome, examinant et observant tout, et ce que j'ose vous
garantir, c'est que ce qu'il y a de cruel dans votre situation
particulière ne durera point, mais que les malheurs qui nous sont
communs à tous seront peut-être sans terme. En premier lieu, l'homme en
qui réside la toute-puissance est très bien pour vous. Je n'en parle pas
à la légère. Moins je le vois, plus je mets de soin à le pénétrer. Ce
n'est que pour rester plus longtemps armé de sévérité contre les autres
qu'il vous fait languir. Mais ses intimes, ceux qui sont le plus avant
dans sa faveur, ont pour vous un langage et des sentiments admirables.
Comptez de plus sur le voeu qui se manifeste parmi le peuple, ou plutôt
comptez sur l'opinion publique tout entière. La république, aujourd'hui
sans pouvoir, mais qui ne peut manquer d'en retrouver un jour, emploiera
pour vous ce qu'elle a de force auprès de ceux qui la tiennent asservie,
et sous peu, croyez-moi, ses efforts seront couronnés de succès. Mais
voilà que je vous donne des espérances, après avoir dit que je n'en
avais point à vous donner. Ses amis me chérissent, ils passent avec moi
leur vie. Je vais m'attachera eux, et, secouant la honte qui m'a retenu
jusqu'à ce moment, je m'insinuerai même dans son intimité. I! n'y aura
pas un chemin que je ne batte pour arriver à notre but ; je ferai plus
même que je n'ose écrire. Le zèle des amis les plus empressés, vous le
trouverez chez moi, et bien au delà. Persuadez-vous d'abord que tout ce
que je possède est à vous, à vous plus qu'à moi. Si je ne vous fais pas
là-dessus des protestations plus étendues, c'est que j'aime mieux me
persuader que vous rentrerez bientôt dans la jouissance de vos biens. Je
vous conjure en finissant de ne pas perdre courage. Remettez-vous sans
cesse en l'esprit et les exemples
426
des grands hommes, et les principes que vous avez puisés clans l'étude
et la méditation, rassemblez ainsi toutes vos forces : l'espérance vous
sera plus douce, et l'avenir vous trouvera plus résigné. Mais je vous
dis ce que vous savez mieux que moi, mieux que tout autre. J'emploierai
à vous servir tout ce que j'ai d'affection et de zèle. Je tiens à
montrer que je n'oublie pas ce que vous fîtes pour moi, à l'époque de
mes cruelles épreuves.
472. — A M. MARCLLUS. Rome.
F. IV, 7. Vous êtes encore dans le
même ordre d'idées, je le vois bien. Je ne vous en blâme point, quoique
j'aie moi-même changé de route. L'opinion que j'ai de votre sagesse ne
me permet pas de croire mes raisons meilleures que les vôtres. Quoi
qu'il en soit, je viens, sous l'inspiration de ma vieille amitié et des
souvenirs de vos bontés depuis mon enfance, vous faire part de quelques
réflexions sur la manière dont je conçois votre salut sans porter
atteinte à votre caractère. Je me rappelle à merveille que vous aviez vu
longtemps d'avance poindre le mal qui nous dévore, et que sous votre
consulat vous aviez imprime aux affaires la plus salutaire et la plus
noble direction ; mais je sais aussi que le plan de la campagne, que les
ressources de Cn. Pompée, que l'organisation de l'armée n'avaient ni
votre approbation ni votre confiance; là-dessus nous étions d'accord,
vous le savez. Aussi nous a-t-on vus l'un et l'autre, vous, ne prendre
que rarement part au mouvement, et moi, m'en tenir éloigné le plus
possible. Nos armes n'étaient pas celles qui font vaincre; nous n'étions
forts que par la raison, le bon droit, l'équité; et il s'agissait d'une
lutte brutale et a forée ouverte, que nous n'étions pas de taille à
soutenir. Enfin nous voila vaincus, ou s'il y a des hommes dont on ne
peut jamais dire qu'ils sont vaincus, du moins nous voila renversés et
par terre! On ne peut s'empêcher de rendre hommage a votre prudence. En
voyant l'espérance du triomphe nous échapper, vous avez abandonne toute
idée de lutte, montrant ainsi qu'un homme sage, qu'un bon citoyen peut
bien, à son corps défendant, s'engager dans une guerre civile qui
commence, mais qu'il ne doit pas y persister jusqu'à en faire un combat
à mort. — Je divise en deux parts les hommes qui ont adopté une marche
différente de la vôtre : d'un côté ceux qui se sont efforcés de
recommencer la guerre et qui ont passé en Afrique, de l'autre ceux qui
comme moi se sont fiés au vainqueur. Entre cette résignation et cet
acharnement, vous avez pris un terme moyen. Je reconnais que presque
partout, que partout on vous approuve comme ayant fait acte de sagesse,
que même beaucoup de personnes voient dans votre conduite une nouvelle
preuve de la grandeur de vos sentiments et de la force de votre âme.
Cependant je crois qu'il y a des bornes à tout, d'autant que, pour
rentrer dans tous les avantages de votre position, il ne vous manque
absolument que la volonté. S'il y a encore de l'hésitation chez celui de
qui tout dépend, c'est qu'il craint de ne pas trouver de reconnaissance
chez vous : inutile de m'expliquer là-dessus, ma conduite parle assez
haut. Quand déjà vous auriez pris en vous-même la résolution de subir
une
427
absence perpétuelle plutôt que vous soumettre au pouvoir que vous avez
combattu, vous n'en devriez pas moins réfléchir qu'il n'y a pas un seul
lieu en dehors de la puissance que vous vouiez fuir; et si on doit vous
laisser tranquille et libre là où vous êtes sans patrie et sans biens,
certes il y a lieu d'examiner si, quelle que soit d'ailleurs la
situation des affaires, il n'est pas préférable de vivre à Rome et dans
sa maison, plutôt qu'à Mytilène ou à Rhodes. Car enfin la puissance que
nous redoutons s'étendant sur tout l'univers, pourquoi n'être pas chez
soi sans dangers plutôt qu'ailleurs environné de périls? Pour moi, la
mort me fût-elle en perspective, j'aimerais mieux l'attendre au milieu
des miens et dans ma patrie, qu’au loin sur des bords étrangers. Il n'y
a là-dessus qu'une seule opinion parmi ceux qui vous aiment; et grâce à
l'éclat de vos vertus, le nombre n'en est pas petit. — Votre fortune ne
doit pas non plus rester à l'abandon. Sans doute les dommages qu'elle
recevrait ne seraient pas éternels. Celui qui gouverne, et la
république, ne le souffriraient pas. Mais je ne veux pas que des
brigands viennent s'abattre sur vos biens. Cette bande, je vous
nommerais ceux qui la composent, si vous ne les deviniez de reste. —
Vous avez ici votre excellent frère, mais vous n'avez plus que lui. Ses
tourments, sa sollicitude, ses pleurs parlent vivement pour vous. On ne
me voit ni moins de chagrin, ni moins de préoccupations. Quanta mes
démarches, si j'y mets moins d'activité, c'est qu'ayant eu besoin de
solliciter pour moi-même, mes coudées ne sont pas franches. Je n'ai que
le crédit d'un vaincu. Toutefois mon expérience des choses et mon
dévouement ne manqueront jamais à Marcellus. Je ne suis appuyé,
sollicité par aucun des vôtres, mais je suis prêt à tout pour vous
servir.
473. - A LIGARIUS. Rome, septembre.
F. VI, 13. Mon amitié doit à vos
malheurs des consolations et des conseils. Si je ne vous ai point écrit
jusqu'à ce moment, c'est que je cherchais en vain des paroles pour
adoucir vos maux et des secrets pour les guérir. J'ai aujourd'hui plus
d'une raison de croire que vous nous serez bientôt rendu, et je ne puis
me défendre de vous parler de mes espérances et de mes voeux. César ne
vous tiendra pas rigueur, je le devine et le vois. La nature de ses
griefs, le temps, l'opinion publique, et même, à ce qu'il me semble, son
propre caractère, tout contribue à lui inspirer chaque jour plus de
modération. J'en ai la conviction pour les autres. Quant à vous
personnellement, ses amis les plus intimes me l'assurent, et depuis les
premières nouvelles d'Afrique, je ne cesse de les harceler de concert
avec vos frères. Leur courage, leur vertu, leur incomparable tendresse,
leur activité toujours éveillée, ont si bien fait, que César n'est plus,
selon moi, en situation de nous rien refuser. Si la décision tarde au
gré de nos voeux, c'est qu'il est assiégé de toutes parts, et qu'on a
bien de la peine à arriver à lui. Il faut dire de plus que les affaires
d'Afrique l'ont piqué au vif, et il n'est pas fâché sans doute de faire
un peu languir ceux à qui il impute la prolongation de ses embarras et
de ses luttes. Mais on s'aperçoit que déjà même là-dessus il se calme et
se modère. Croyez-moi donc, et mettez-vous bien dans l'esprit que le
terme de vos tourments approche. Telle est ma confiance : quant à mes
voeux et mes sentiments, je vous les prouverai
428
par des effets plutôt que par des discours. Si j'avais la puissance que
je devrais avoir dans une république dont vous dites que j'ai si bien
mérité, vous auriez été, oui vous-même, vous auriez été affranchi de
tous ces désagréments. N'est-ce point par la même cause que votre
existence est compromise et que mon rôle s'est effacé? Pour peu qu'il me
reste encore une ombre de ce que je fus jadis et quelques débris de mon
influence, vos excellents frères peuvent compter sur moi, sur mes
conseils, mes démarches, mon crédit; ma fidèle amitié ne leur fera faute
en rien. Courage donc ! courage! vous voyez que de motifs pour en avoir!
D'ailleurs, après ce que vous avez fait, voulu, tenté pour la
république, c'est pour vous une obligation de compter sur un meilleur
avenir, ou du moins de vous résigner a l'adversité en homme qui n'a
failli à aucun devoir, à aucune prévision, et qui a sa fermeté et son
courage à opposer aux coups du sort.
474. - A MARCELLUS. Rome.
F. IV, 8. Comment vous donner un
conseil, à vous qui êtes la sagesse même? Ou comment vous parler de
résignation, à vous qui êtes doué d'une âme si forte et de tant de
courage? Quant à des consolations, je ne saurais vous en offrir.
D'abord, avec ce qu'on raconte de la situation de votre esprit, j'aurais
à me réjouir de votre vertu plus qu'à m'affliger de vos douleurs; et
s'il se pouvait, au contraire, que les maux de la république eussent
jeté le découragement dans votre âme, où trouverais-je des consolations
pour vous, moi qui ne peux pas en trouver pour moi-même? Je n'ai donc
qu'une chose à faire; j'agirai, je m'emploierai pour vous servir; je
répondrai à tous les appels de vos amis ; et je veux si bien faire pour
une cause à laquelle je me dois tout entier, qu'on me verra pour elle
aller même jusqu'à l'impossible. — Prenez ce que je vais vous dire pour
un avis que je vous donne, pour une opinion que j'exprime, ou pour
l'inspiration d'une amitié qui ne peut se taire, peu m'importe : mais
persuadez-vous bien, comme j'en suis moi-même convaincu, que s'il y a
une république, vous en êtes nécessairement, de fait et de droit, le
premier citoyen, quoique soumis comme les autres à la nécessité du
temps; et que s'il n'y a plus de république, c'est encore dans son sein
que vous trouverez le meilleur exil. Est-ce la liberté que nous
cherchons? Il n'y a pas un coin du monde à l'abri de la servitude.
Est-ce une retraite? Il n'est rien de mieux que d'être chez soi.
Croyez-moi, l'homme du jour a un faible pour les intelligences
supérieures; et autant que sa situation et son intérêt le lui
permettent, il honore la noblesse dans la conduite, et la dignité dans
le caractère. En voila plus long que je ne voulais. Je finis en vous
répétant que je suis à vous, que je m'unirai aux vôtres, si les vôtres
se mettent en avant : sinon, que je n'en ferai pas moins pour vous, seul
et sans eux, tout ce que me commandent nos anciens rapports et tout ce
que l'amitié m'inspire. Adieu.
475. — A GALLUS. Rome.
F. VII, 27. Je m'étonne de vos
reproches; il ne vous appartient pas de me parler ainsi ; en
eussiez-vous le droit, cela vous siérait mal encore, vous m'avez servi,
dites-vous, pendant mon consulat, et vous allez me servir prés de César.
Vous êtes fort en paroles, mais personne ne vous croit. Vous prétendez
que c'est pour moi que vous re-
429
cherchez le tribunat. Bons dieux ! que n'êtes-vous toujours tribun !
vous n'auriez pas à vous mettre en quête d'un répondant. Vous m'aviez
mis au défi de vous répondre : est-ce que cette réponse a toutes vos
inconvenantes demandes ne vous semble pas assez ferme? Je me mets à
votre ton; vous comptiez sur le succès de ce langage auprès de moi. J'ai
voulu vous montrer que vous n'y entendiez rien. Si vous aviez mis de la
politesse dans vos plaintes, j'y aurais répondu de grand coeur, et je
n'aurais pas de peine à me justifier. Je vous sais gré de la manière
dont vous vous êtes conduit, mais la manière dont vous m'écrivez me
blesse. Moi qui ai agi envers tout le monde d'une manière si libérale
que chacun m'a dû d'être libre, je n'ai pas, dites-vous, agi assez
libéralement envers vous : je ne vous comprends pas. Vous m'avez donné
beaucoup d'avis. S'ils étaient faux, puis-je vous en avoir obligation ?
Et s'ils étaient vrais, ne savez-vous pas mieux que personne combien le
peuple romain me doit de reconnaissance?
476. — A MARCELLUS. Rome, septembre.
F. IV, 9. Il y a très peu de jours
que j'ai remis pour vous a Q. Mucius une assez longue lettre où je vous
parle de vous, de votre position, et de ce que je pense de ses
exigences. Mais voici votre affranchi Théophile qui part; je connais sa
fidélité et son dévouement, et je veux qu'il vous porte encore un mot de
moi. Je persiste plus que jamais dans mes observations; et quelle que
soit cette république où nous sommes, j'insiste pour que vous rentriez
au plus tôt dans son giron. Sans doute vous verrez beaucoup de choses
que vous ne voudriez point voir; mais vous les entendez raconter.
Certes, vous n'êtes pas de ces hommes chez qui les émotions n'arrivent
que par les yeux, et les récits, qui surtout grossissent toujours les
objets, ne frappent sans doute pas, impunément vos oreilles. Mais il
vous faudra quelquefois dire ce que vous ne pensez pas ou faire ce que
vous blâmez? D'abord, c'est une règle de sagesse pour tous les temps de
céder aux circonstances, c'est-à-dire de se soumettre à la nécessité.
Mais jusqu'à présent du moins le mal que vous redoutez n'est pas à
craindre. Peut-être n'est-on pas toujours libre de dire ce qu'on pense;
on peut du moins toujours se taire. Tout se concentre dans un homme. Cet
homme n'admet personne à son conseil, pas même ses amis ; mais en
serait-il beaucoup autrement, je vous le demande, si la victoire s'était
prononcée pour celui dont nous avons suivi la fortune? Pendant la
guerre, au milieu des dangers que nous partagions avec lui il n'agissait
qu'à sa tête, et vous savez de quelles médiocrités il s'entourait :
croyez-vous donc qu'après la victoire, nous l'eussions trouvé plus
communicatif que pendant les incertitudes de la lutte? Et si durant
votre consulat vos sages avis furent repoussés ; si durant le consulat
de votre frère qui ne fit que continuer le vôtre, il vous dédaigna tous
deux, croyez-vous qu'an faîte de la puissance il eût fait grand cas de
vos conseils ? — Tout est funeste dans une guerre civile. Nos ancêtres
en ont fait quelquefois l'épreuve et notre siècle n'a eu que trop
d'occasions de s'en convaincre; mais ce qui est funeste par-dessus tout,
c'est la victoire. Même dans le juste parti elle exalte les têtes et
pousse les plus honnêtes gens au-delà des bornes. En dépit de leur
nature, la nécessité les entraîne. Le vainqueur a si souvent
430
la main forcée par ceux qui l'ont fait vaincre! Que de fois n'avons-nous
pas ensemble gémi sur les inévitables cruautés qui auraient ensanglanté
notre triomphe ! Eh bien ! est-ce que vous auriez alors quitté votre
patrie pour vous épargner la douleur de les voir? » Non, direz-vous,
parce que je n'aurais pas perdu mon rang, ma fortune et mes dignités.
Mais que sont ces bagatelles pour un caractère comme le vôtre, auprès de
la république et des préoccupations qu'elle commande? Ou voulez-vous
aller en définitif? On applaudit à votre conduite et même à votre
bonheur, en tant qu'il peut y avoir de bonheur dans une telle bagarre :
à votre conduite, parce que vous avez pris les armes, comme vous le
deviez, au début de la guerre, et parce que vous avez eu la sagesse de
les déposer avant la dernière extrémité; à votre bonheur, parce que vous
vous êtes tenu depuis dans une neutralité honorable, et que vous avez su
sauver ainsi votre position et la dignité de votre caractère. Maintenant
quel lieu pourrait vous être plus doux que la patrie? Faut-il moins la
chérir à cause des blessures qui l'ont défigurée? Ne faut-il pas bien
plutôt la plaindre ; et devez- vous la priver d'un de ses enfants dans
le veuvage de tant d'illustres citoyens? — Enfin, s'il y a eu du courage
a ne pas aller se jeter en suppliant devant le vainqueur, il y aurait
trop d'orgueil a repousser aujourd'hui sa générosité : s'il a pu être
sage de quitter sa patrie, il serait inhumain de ne pas la regretter. Il
serait insensé de se priver même des douceurs de la vie privée, parce
qu'on ne peut jouir des douceurs de la vie publique. Voici une
observation capitale. J'admets que votre existence actuelle vous
convienne mieux ; mais elle vous offre bien moins de sécurité. La
licence du glaive est partout; cependant c'est sur les bords étrangers
que les attentats se renouvellent le plus effrontément. Dans mes
préoccupations pour vous, je marche a légal ou tout au moins à la suite
immédiate de votre frère Marcellus. Pesez les circonstances et songez à
votre position, à votre vie, à votre fortune.
477. — A SERVIUS SULPICIUS. Rome.
F. IV, 4. J'accepte vos explications
sur ces lettres de vous qui semblaient si souvent sortir du même moule;
mais je ne les accepte qu'en tant que la négligence ou l'infidélité des
messagers a pu rendre des duplicata nécessaires. Quant à la pauvreté
d'imagination (c'est votre mot), dont vous vous faites une excuse pour
vos fréquentes répétitions, je ne sais ce que vous voulez dire, et c'est
une défaite que je repousse. Par un badinage que j'entends a merveille,
à cette pauvreté vous opposez mes richesses : pourquoi ne
conviendrais-je pas que je ne me sens pas en effet trop à la gène pour
exprimer mes pensées? Mais en même temps comment pourrais-je me
dispenser de rendre à la vérité un hommage plus juste encore, en
déclarant qu'en fait de richesses de ce genre, le fonds chez vous et la
forme valent mieux cent fois que chez moi ? — C'est fort bien fait a
vous de ne pas refuser la mission d'Achaïe. J'en ai toujours été
partisan, et je le suis plus que jamais après avoir lu votre dernière
lettre. Rien de plus fort que les motifs que vous y déduisez avec cette
autorité de raison qui vous est propre. Malheureusement, dites-vous,
l'événement a trompé vos calculs. Je suis loin d'en convenir. Partout la
perturbation et la confusion sont si grandes, cette horrible guerre a si
bien tout bouleversé et renversé, qu'il n'est personne qui ne se croie
plus malheureux et plus à plaindre que son voisin. Voilà ce qui vous
fait
431
pousser des soupirs ; mais pendant que vous nous regardez comme heureux
d'être à Rome, nous pensons, nous, sans vous croire tout à fait exempt
de tourments, que vous êtes comparativement bien mieux ou vous êtes.
Vous avez au moins cela de bon, qu'en écrivant vous ne vous contraignez
point pour épancher votre bile; cette liberté n'est pas ici sans danger.
Il ne faut pas s'en prendre au vainqueur, qui est le plus modéré des
hommes. Le mal est dans la victoire même, qui, comme dans toutes les
guerres civiles, ne peut se contenir. — Nous avons eu sur vous un
avantage, un seul : c'est de connaître un peu plus tôt la grâce de
Marcellus votre collègue; et, par Hercule, j'ai eu la joie de voir de
mes yeux comment tout s'est passé. Je vous jure que c'est la première
bonne chose dont nous sommes témoins depuis nos misères, c'est-à-dire
depuis que le glaive a pris la place du droit. César, après s'être
plaint du caractère intraitable de Marcellus (c'est son mot ), et avoir
loué dans les termes les plus flatteurs votre modération et votre
sagesse, se ravise tout à coup, et déclare, comme on s'y attendait le
moins, que, malgré ses justes griefs, il n'a rien à refuser au sénat, ni
à son intercession en faveur de Marcellus. En effet, au premier mot de
L. Pison sur Marcellus, C. Marcellus s'était jeté aux pieds de César; le
sénat s'était levé tout entier comme un seul homme, tendant vers lui les
bras. Je vous le dirai franchement, ce jour m'a paru si beau que j'ai
cru y voir comme une nouvelle aurore de la république. Pas un sénateur,
appelé à la parole avant moi, qui ne crût devoir un hommage à César; pas
un, excepté Volcatius, qui prétendit que Marcellus devait refuser. Mon
nom étant venu à son tour, je pris soudain ma résolution; je m'étais
promis de garder à jamais le silence, non certes par faiblesse, mais par
un secret retour sur ce que je fus jadis. Mais je fus vaincu par la
magnanimité de César et l'entraînement du sénat. Je prononçai un
discours tel, que je crains d'y avoir dit adieu au repos, ou je trouvais
une sorte de compensation à mes peines. Cependant comme César aurait été
fondé à s'offenser de mon silence, et à y voir une protestation en
faveur de la république toujours exilée, je pourrai désormais, sans
m'aliéner sa bienveillance, me tenir sur la réserve et m'abandonner à
mes goûts pour la retraite et l'étude. Car quoique, dès mes premiers
ans, je m'appliquasse avec passion aux arts, aux sciences, surtout à la
philosophie, il arrive aujourd'hui, soit par l'âge qui mûrit la raison,
soit par une réaction des calamités publiques sur moi-même, il arrive
que cette passion s'accroît chez moi de jour en jour, et qu'elle fait ma
seule consolation. — Je vois par vos lettres que des détails d'affaires
ne vous laissent guère de moments pour l'étude; vous vous dédommagerez
en dérobant quelque chose au repos de la nuit. Votre Servius (je dirai
plutôt notre Servius) me comble de prévenances ; j'aime en lui l'heureux
assemblage de toutes les qualités, et cette haute raison, à laquelle il
joint tant de science et de goût. Il vient souvent me confier ses
réflexions sur la prolongation de votre absence ou les conséquences de
votre retour. Moi, je suis toujours d'opinion que nous ne devons en rien
devancer les désirs exprès de César. Excepté votre famille, vous ne
verriez d'ailleurs à Rome rien qui pût
432
vous plaire : et César est encore le meilleur de tous. Hommes choses,
tout Rome est si bien à l'avenant, que pour qui en a le choix, il vaut
mille fois mieux les voir de loin que de près. Je vous donne là un bien
mauvais conseil pour nous, qui avons soif de vous revoir. Mais votre
intérêt avant tout.
478. — A CÉCINA. Rome.
F. VI, 6. Je crains de vous un
reproche : une liaison fondée comme la nôtre sur des services mutuels,
sur la conformité des goûts, m'imposait des devoirs, et je crains, je le
répète, que vous n'accusiez mon silence. Vous auriez reçu depuis
longtemps des lettres de moi, et plus d'une, si je n'avais attendu de
jour en jour, dans l'espérance d'avoir à vous adresser des compliments
plutôt que des consolations. Le moment de vous féliciter n'est pas loin
d'ailleurs, je l'espère. Mais attendons pour aujourd'hui qu'il soit
venu. Je veux en ce moment que ma voix, qui est celle du plus aimant, si
ce n'est du plus sage des hommes, fasse un appel à votre constance, à
votre courage, qui sont, au surplus, me dit-on, et je le crois, bien
loin de faiblir. Je ne vous parlerai pas comme à un malade désespéré. Je
n'ai pas plus de doute sur votre rétablissement que vous n'en aviez
vous-même sur le mien; car lorsque je fus chassé de la république, qu'on
ne croyait pas pouvoir renverser sans m'avoir d'abord mis à terre, tous
les voyageurs venant de l'Asie où vous étiez, me disaient, je m'en
souviens, que vous parliez sans cesse de mon rappel comme d'un événement
certain et qui me couvrirait de gloire. — Si cette science d'Étrurie, à
laquelle vous a initié votre très noble et très excellent père, ne vous
égara point alors, mon talent pour la divination ne m'abuse pas
davantage aujourd'hui. Ce talent, je le dois aux traditions et aux
préceptes des savants, à une longue étude de la matière, vous le savez,
et surtout à ma grande habitude des affaires, et à cette variété infinie
de phases que j'ai parcourues. C'est dans cette dernière espèce de
divination que je place le plus de confiance; elle ne m'a pas trompé une
seule fois au milieu des complications les plus obscures et les plus
embrouillées. Je vous dirais toutes les prédictions que j'ai faites, si
je ne craignais pas qu'elles vous parussent arrangées après coup. Plus
d'un témoin existe pourtant qui m'a entendu conjurer Pompée, d'abord de
ne pas faire alliance avec César, et ensuite de ne pas rompre cette
alliance. Je voyais l'influence du sénat se détruire par leur union, et
la guerre civile sortir de leur rupture. J'étais lié avec César,
j'honorais Pompée. Le conseil était d'un ami de Pompée, mais dans
l'intérêt de l'un autant que de l'autre. — Je laisse de côté une foule
de prophéties. Je dois beaucoup à César, et je ne veux pas le laisser
penser que j'ai donné à Pompée des conseils qui, si on les avait suivis,
auraient fait de César le plus illustre et le premier des citoyens
pendant la paix, mais l'auraient empêché d'arriver au degré de richesse
et de puissance où nous le voyons. Plus tard, je conseillai à Pompée
d'aller en Espagne; s'il l'eût fait, il n'y aurait pas eu de guerre.
J'ai lutté ensuite pour qu'on tînt compte à César de son absence. Ce
n'était point pour favoriser César, c'était pour l'honneur d'une
décision du peuple provoquée par le consul lui-même. La guerre devait
avoir bientôt un motif : ai-je encore ménagé
433
mes avertissements et mes cris pour faire comprendre que la paix même la
plus mauvaise valait mieux que la guerre même la plus juste? — Les
conseils de mon expérience furent repoussés moins par Pompée qui en fut
ébranlé, que par des hommes qui croyaient pouvoir ne douter de rien sous
un tel chef, et qui avaient besoin de la guerre et de la victoire pour
leur fortune et leur ambition. La lutte commença; je restai neutre. Elle
fut transportée hors de l'Italie; je n'y pris point de part encore. A la
fin, des scrupules me vinrent, qui furent plus forts que mes tristes
pressentiments. J’eus peur de ne pas f:aire pour Pompée ce que naguère
il avait fait pour moi. En un mot, je cédai, que sais-je? au devoir, au
bon renom du parti, à la honte peut-être ; et j'allai de propos délibéré
me jeter volontairement, comme l'Amphiaraüs de la fable, dans le
précipice que je voyais béant et prêt à m'engloutir. Depuis, il n'y a
pas eu une seule des malheureuses péripéties de cette fatale guerre que
je n'aie prédite. — Maintenant donc qu'a la manière des augures et des
astrologues, moi, qui suis augure aussi, je vous ai prouvé par des faits
ma science augurale et divinatoire, vous ne pouvez vous dispenser de
croire à ma prédiction nouvelle. Je n'ai pas consulté le vol des
oiseaux, je n'ai pas examiné si, suivant les règles sacramentelles de la
discipline, leur chant vient de la gauche; je ne me suis arrêté ni aux
miettes qui tombent, ni au son qu'elles rendent. J'ai consulté des
signes qui, sans être absolument certains, permettent pourtant d'aller
un peu moins à. Tâtons et trompent moins souvent que les autres. Je
donne à ma divination deux points de départ, dont l'un est César,
l'autre la nature des temps et la condition des discordes civiles. Du
côté de César, voici les observations : son caractère est doux et
généreux. Il est tel que vous l'avez dépeint dans votre beau livre des
Gémissements. Il a une prédilection toute particulière pour les esprits
supérieurs de la trempe du vôtre. Plein d'égards pour les intentions
droites et les convictions généreuses, il est sans oreilles pour les
sollicitations légères ou intéressées. Le cri de l'Étrurie tout entière
ne manquera pas de le toucher. Mais pourquoi en avez-vous ressenti si
peu d'effet? parce qu'une fois votre pardon prononcé, et c'est contre
vous qu'il est le plus en colère, il n'y a plus de barrière pour
personne. Mais s'il est en colère, qu'espérer de lui? Il comprend qu'en
pressant votre main, une abondante rosée de louanges va bien vite
adoucir les légères égratignures que cette même main lui a faites. Enfin
César a de l'esprit et voit de loin. Il sait à merveille que le plus
noble et le premier personnage d'une contrée de l'Italie qui n'est pas à
dédaigner, qu'un homme placé d'ailleurs aussi haut que qui que ce soit
dans l'estime du peuple romain pour ses talents, son crédit et son
importance, ne peut pas demeurer toujours en dehors des affaires, et il
voudra que votre retour soit un bienfait de César et non pas un bienfait
du temps. — Voila pour César. Je passe maintenant à l'examen des temps
et à la nature des circonstances. Le plus grand ennemi de la cause que
Pompée avait embrassée, hélas! avec plus de courage que de moyens de
résistance, n'oserait pas dire que nous sommes de mauvais citoyens et
des hommes pervers. C'est en cela surtout que j'admire le ton de César,
la droiture de son esprit, sa sagesse : il ne prononce jamais le nom de
Pompée qu'avec des expressions de respect Le nom, oui, direz-vous; mais
la personne, avec quelle dureté ne l'a-t-il pas traitée! Ceci est le
fait de la guerre et de la victoire : ce n'est pas le
434
fait de César. Voyez ! ne nous a-t-il pas tous recherchés? De Cassius il
fait son lieutenant, il donne les Gaules à Brutus, à Sulpiicius la
Grèce, et Marcellus, contre qui son irritation était si vive, Marcellus
a retrouve ses honneurs et son rang. Qu'en conclure? Il est dans la
condition des choses et des discordes civiles, il est dans la nécessité
des affaires, la direction actuelle changeant ou non, qu’on ne fasse
point une condition et une fortune diverse aux partisans de la même
cause, et que des gens de coeur, de bons citoyens dont la vie est sans
tache, ne se voient pas fermer l'accès d'une ville qui a ouvert ses
portes à tant de misérables flétris par les lois. — Tel est mon
pronostic : si je n'y avais pas foi, je ne vous le dirais point, et
voici le dilemme que j'adresserais à un homme de coeur : Ou c'est en
croyant à la victoire que vous avez pris les armes pour la république,
et vous n'en êtes que plus digne d'éloges; ou sachant combien les armes
sont journalières et la fortune des combats douteuse, vous avez fait
entrer la défaite dans vos prévisions. Eh bien! dans l'un ou l'autre
cas, vous devez savoir vous résigner au rôle de vaincu, vous qui pensiez
à jouer le rôle de vainqueur. Je chercherais avec vous tout ce qu'au
sein de l'adversité on peut trouver de consolation dans le témoignage de
sa conscience et de charme dans le commerce des Muses. Je vous
rappellerais les extrémités cruelles où furent réduits autrefois
d'illustres guerriers, et même dans ces derniers temps vos propres chefs
et vos compagnons d'armes. Je joindrais a cette liste des noms célèbres
empruntés aux nations étrangères : car c'est un adoucissement aux maux
dont on souffre, que le tableau des infortunes d'autrui et des misères
attachées à l'humanité. Je vous dirais enfin comment on vit ici, au
milieu de quelle confusion, dans quel chaos. Je vous montrerais, au lieu
d'une république florissante, une république en poudre: et vous
soupireriez avec moins de douleur après la patrie absente. Mais ce
langage n'est point de saison. Vous allez bientôt nous être rendu; j'en
ai le pressentiment, la certitude. Jusque la, vous pouvez, vous et votre
digne et excellent fils, cette image fidèle des traits et de l'âme de
son père, vous pouvez tous deux, vous de loin, lui de près, compter sur
moi, comme vous en avez déjà fait l'épreuve. Je mets a votre service
tout ce que peuvent le dévouement, le devoir, l'activité, les efforts de
toute sorte. Je le fais avec d'autant plus de confiance aujourd'hui que
César me recherche et me choie chaque jour davantage, et que son
entourage est pour moi ce qu'il n'est pour personne. Tout ce que
j'obtiendrai de crédit et de faveur sera pour vous. En attendant,
courage et confiance! soutenez-vous par là.
479. — A VOLUMNIUS. Rome.
F. VII, 33. Non, vous ne perdez rien
à ne plus m'entendre ; et ne dites point que vous seriez jaloux d'Hirtius,
si vous ne l'aimiez tant : jaloux de son mérite, a la bonne heure, mais
non pas de sa présence à mes exercices. Je ne suis plus rien, mon cher
et aimable Volumnius. Privé des fidèles amis qui m'animaient par leur
présence, privé de vos applaudissements, je ne puis plus me contenter
moi-même; et si parfois encore Cicéron trouve de dignes paroles, il
gémit, comme le Philoctète d'Accius, de voir « que ses traits
435
vont tomber sans gloire sur des corps de plume et non sur des corps de
fer. » Venez, venez ! vous embellirez tout ici : malheureusement vous
arriverez, vous le savez, au moment des plus grandes complications.
Puissé-je une fois en sortir! Alors je dis adieu pour jamais au forum,
au sénat, et j’rai vivre avec vous et ces amis qui nous adorent, avec
mon Dolabeiia, avec mon Cassius aussi, qui tous deux partagent nos
goûts, et qui tous deux me charment également par leur esprit. Venez.
Nous avons besoin de vos jugements si délicats et si fins, et de ces
discussions philosophiques où vous ne prenez jamais la parole sans me
faire sentir le besoin de plus de sévérité pour moi-même. Oui, c'en est
fait: pour peu que César le permette ou le tolère, j'abandonne le rôle
politique auquel il a souvent applaudi, et, me cachant au sein de
l'étude et des lettres, je goûterai, près de vous et d'amis qui vous
ressemblent, les plus beaux loisirs du monde. Mais quoi ! n'allez-vous
pas craindre que la longueur de vos lettres m'effraie? Désabusez-vous,
de grâce. Les plus longues sont les meilleures.
480. - A CURIUS. Rome.
F. VIl, 28. Je me souviens que
naguère vous me me sembliez fou d'aimer mieux vivre avec les Grecs
qu'avec nous. Je trouvais que Rome, alors le centre de l'urbanité
romaine, était, cent fois plus que le Péloponnèse et mille fois plus que
Patras, le fait d'un homme aussi poli et aussi aimable que vous. Mais
aujourd'hui que notre situation est presque désespérée, il m'est évident
que vous lisiez dans l'avenir, lorsque vous prîtes la résolution de vous
retirer en Grèce; et vous avez montre, à ce moment, autant de sagesse
que de bonheur, si toutefois, par le temps qui court, on peut être
heureux, quand on est sage. Vous étiez libre de tous vos mouvements et
vous pouviez aller chercher des lieux où ni le nom des Pélopides, ni....
Vous savez le reste; mais moi, j'ai dû me procurer la même liberté par
un autre moyen. Ce moyen c'est d'aller me cacher au milieu de mes
livres, aussitôt après avoir reçu les visites de mes amis; visites ou la
foule est plus grande que de coutume, parce qu'on court après un bon
citoyen presque comme après un merle à blanc plumage. Vous jugez si je
travaille, et de quelle façon, vous qui, me voyant un jour triste et
découragé, me disiez que mes livres vous auraient donné une plus haute
idée de mon courage. Mais alors, de par tous les dieux, je pleurais sur
la république, que ses bienfaits et mes services me rendaient si chère :
je pleure encore sur elle, et, en dépit de la raison qui devrait me
retenir, en dépit du temps, cette banale consolation du vulgaire, oui,
je pleure avec désespoir sur des maux désormais sans remède. La faute
n'en est pas à celui qui a la puissance, si ce n'est qu'il n'aurait pas
dû la vouloir. Nos malheurs sont en partie le fait du hasard, en partie
notre propre ouvrage, et nous n'avons pas le droit d'accuser le passé.
Je le répète, il n'est plus d'espérance, et je reviens à mon début : si
votre départ fut un acte de prudence, je loue votre sagesse; si ce fut
un effet du hasard, je loue votre bonheur.
436
481. — A PÉTUS. Rome.
F. IX, 15. Je vais répondre aux deux
lettres que j'ai reçues de vous, l'une, il y a quatre jours par Zéthus,
l'autre à l'instant même par le messager Philéros. Je vois par la
première combien vous avez été sensible à mes inquiétudes pour votre
santé, et combien les témoignages de mon attachement vous touchent : je
vous en rends mille grâces. Croyez pourtant que ce n'est pas dans des
lettres que vous pouvez apprendre à juger mon coeur, et que de toutes
les personnes qui m’honorent et m'affectionnent, et il y en a beaucoup
vraiment, il n'en est aucune qui me soit plus chère que vous. D'abord
votre amitié date de loin et n'a jamais varié; ce qui n'est pas peu de
chose; ce qui est même immense à mes yeux. Cependant cela vous est
commun avec d'autres : mais ce qui n'appartient qu'à vous, c'est cette
grâce aimable, celte bonté charmante, et cet art de plaire que vous
portez en tout. Il faut ajouter à ces dons heureux vos spirituelles
saillies, et ces traits du vieil esprit romain, qui, sans être
précisément attiques, sont plus piquants que l'atticisme même. Libre à
vous de penser autrement; mais pour moi, rien ne me met plus en train
que cette plaisanterie dans l'ancien goût national, surtout lorsque je
vois ce cachet se perdre dans le Latium ; que d'autres moeurs viennent
s'infuser dans les nôtres; que Rome est un pêle-mêle d'étrangers ou
viennent se jeter des Gaulois, et jusqu'à de ces gens à braies, d'au
delà des monts; et qu'enfin il ne restera bientôt plus trace de
l'enjouement de nos ancêtres. Quand vous arrivez, je crois sur ma parole
voir entrer a la fois les Granius, les Lucilius, et même les Crassus et
les Lélius. Que je meure si après vous on saura ce que c'est que la
vieille et franche gaieté romaine! Comment donc, quand j'aime tant votre
joyeuse humeur, et quand vous m'aimez tant vous-même, comment vous
étonnez -vous de ma consternation, à la nouvelle de votre maladie et de
ses dangers? — Je passe à votre seconde lettre. Vous vous défendez
d'avoir voulu me détourner d'une acquisition à Naples. Vous m'avez
seulement conseillé, dites- vous, de rester à Rome. Je ne l'ai pas
entendu autrement ; cependant j'ai compris et je vois encore, dans cette
lettre même, que vous ne me reconnaissez pas le droit que je prétends
avoir de renoncer, sinon tout à fait, du moins dans une certaine mesure,
a me mêler des affaires. Vous me citez Catulus et cette époque-là ; quel
rapport? Dans ce temps-là, moi-même je jugeai nécessaire de ne pas
rester longtemps en dehors des affaires. J'étais alors à la poupe du
vaisseau et je tenais le gouvernail. Mais aujourd'hui à peine y a-t-il
place pour moi à la sentine. Croyez-vous qu'on ferait moins de
sénatus-consultes si j'étais à Naples? Je suis à Rome, je fatigue le
forum de ma présence, et cependant on fabrique des sénatus-consultes à
foison dans la maison de l'homme qui vous adore et qui me veut aussi du
bien. Si mon nom lui passe par la tête, on l'inscrit sur-le-champ en
tête des décrets. Ainsi, par exemple, on a reçu en Arménie et en Syrie
un décret dont je n'avais jamais entendu parler, et qui a été rendu,
est-il dit, sur ma proposition; ce n'est pas une plaisanterie au moins !
Oui, à l'extrémité du monde, il y a des rois qui m'écrivent pour me
remercier du titre de rois dont ils disent m'être redevables. Or, ces
rois, j'ignorais qu’on les eût faits
437
rois, j'ignorais jusqu'à leur existence. Qu'y a-t-il donc à faire? Je
consens à suivre votre conseil, tant que ce gardien des moeurs restera
ici. Mais du moment qu'il se retirera, j'irai à l'instant retrouver vos
délicieux mousserons. Si je puis avoir une maison, je dépenserai en dix
jours ce que la loi somptuaire permet de dépenser en un seul. Si je ne
découvre rien à ma convenance, j'irai m'établir chez vous. Vous avez, je
le sais, la bonté de penser que rien ne peut vous être plus agréable.
Déjà, dans ma dernière lettre, je vous témoignais mes craintes pour la
maison de Sylla. Je n'y renonce pourtant pas tout à fait encore.
Rendez-moi le service de la faire visiter par des experts. Que les toits
et les quatre murs soient en bon état, je n'en demande pas davantage.
482. — A PÉTUS. Rome, octobre.
F. IX, 26. Je suis à table; c'est la
9e heure, et je vous écris là sur mes tablettes. Chez qui? Chez
Volumoius Eutrapélus, et j'ai vos deux amis à côté de moi, Atticus
au-dessus et Verrius au-dessous. Vous admirez que notre servitude soit
si joyeuse. Que voulez-vous donc que je fasse? répondez, disciple d'un
philosophe. Faut-il me tourner le sang, me mettre à la torture? Qu'y
gagnerai-je? et quel sera le résultat en définitif? Il faut vivre avec
les lettres, dites-vous. Eh bien! fais-je autre chose? Et sans les
lettres pourrais-je vivre? Mais quoiqu'on ne se lasse jamais de l'étude,
elle a pourtant des bornes. Le souper, cette grande question par vous
posée au philosophe Dion, me touche fort peu ; néanmoins, quand je
quitte mes livres, je ne vois rien de mieux à faire en attendant le
moment du sommeil. Mais vous n'êtes pas au bout. Écoutez : près d'Eutrapélus,
était Cythéris. Quoi ! et le fameux Cicéron était là, « ce Cicéron dont
les Grecs attendaient le passage, que les Grecs regardaient avec de si
grands yeux. » Par Hercule ! j'étais loin de me douter que
Cythéris dut être de la partie. Mais écoutez encore : l'ami Aristippe, à
qui on reprochait d'être à Lais, osa répondre, à la Socrate : Je l'ai,
mais elle ne m’a pas. Le mot est meilleur en grec. Traduisez-le, si cela
vous fait plaisir. Quant à moi, même dans ma jeunesse, j'ai dédaigné
toutes ces folies; à plus forte raison les dédaignai-je maintenant que
je suis vieux. Mais j'aime la table, j'y parle sans contrainte, ainsi
qu'a mon bonnet, comme on dit; et je ris aux larmes, même des choses les
plus tristes. Croyez-vous être meilleur que moi, vous qui vous moquez
des philosophes à leur barbe; vous qui, pressé un jour par l'un d'eux de
lui demander tout ce que vous voudriez, se faisant fort d'y répondre,
eûtes le front de lui demander à souper? Le bélître s'attendait à des
questions sur le ciel : n'y en a-t-il qu'un? y en a-t-il plusieurs?
Qu'est-ce que tout cela vous fait à vous? un souper, à la bonne heure,
partons les dieux, ici surtout. Eh bien ! voilà ma vie : je passe une
partie de la journée à lire ou à écrire; puis, pour ne pas négliger mes
amis, nous dînons ensemble dans la limite de la loi au moins, si
toutefois il y a des lois aujourd'hui ; quelquefois même nous restons en
deçà de la limite. Ainsi ne craignez pas mon arrivée. Vous aurez un
convive de bonne humeur, sinon de grand appétit.
483. — A LIGARIUS. Cumes.
F. VI. 14. Je vous consacre tous mes
efforts, toutes mes démarches, tous mes soins, toutes mes
438
pensées. Quand je ne vous aimerais pas comme je vous aime, le touchant
dévouement et la pieuse tendresse de vos frères, que j’affectionne aussi
très-tendrement, ne me permettraient pas de laisser échapper l'occasion
et la bonne fortune de vous servir. Mais il vaut mieux que vous sachiez
par eux que par moi ce que j'ai fait et ce que je ferai. Je veux
seulement vous faire part de mes réflexions, de mes espérances, de mes
découvertes. S'il y a un homme au monde qui doute dans les grandes et
épineuses circonstances, un homme toujours plus disposé à craindre un
revers qu'à croire à un succès, c'est moi : est-ce un défaut? Je m'en
accuse. Eh bien! le 5 des kalendes, dans les premiers jours
intercalaires, j'allai le matin, à la demande de vos frères, trouver
César; après les ennuis sans nombre et les difficultés indignes qu'il
faut essuyer pour arriver jusqu'à lui, je l'abordai; vos frères et vos
proches étaient à ses pieds ; je dis tout ce qu'on peut dire dans un
pareil moment. César n'eut que de douces et généreuses paroles;
j'observai son regard, l'expression de sa physionomie, une foule
d'autres signes qu'il est plus facile de saisir que de préciser, et je
sortis convaincu que votre rétablissement était désormais hors de doute.
Ainsi, courage ! courage et fermeté ! vous avez conservé votre
sang-froid pendant la tempête, vous pouvez vous réjouir en voyant le
calme prêt à renaître. Je n'en veillerai pas moins comme si toutes les
difficultés subsistaient, et je continuerai de tourmenter César et ses
amis, qui sont tous les miens.
484. - CÉCINA. Rome.
F. VI, 8. J'ai rencontré l'autre
jour Largus: c'est un des hommes qui s'occupent le plus de vous. Il me
dit qu'on ne vous avait laissé que jusqu'aux kalendes de janvier. Comme
je sais que César ratifie tout ce que Balbus et Oppius font en son
absence, j'ai été leur demander pour vous la permission de demeurer en
Sicile au delà de ce terme, et aussi longtemps que nous le jugerions
nécessaire. Quand il n'y a pas d'objections à mes demandes, ils me
répondent toujours oui; s'ils disent non, ils m'expliquent leurs motifs.
Cette fois, ils crurent devoir attendre ; mais la journée n'était point
passée que je les revis. Vous resterez en Sicile tant que vous voudrez.
César ne s'en formalisera point, ils en font leur affaire. Vous voilà
donc libre, mais il faut examiner ce qui convient le mieux. — Je venais
de faire ces démarches, lorsque j'ai reçu la lettre où vous me demandez
conseil, et me priez de décider si vous resterez en Sicile, ou si vous
irez achever vos affaires en Asie. Ceci ne s'accorde point avec les
paroles de Largus. A l'entendre, le séjour en Sicile vous était
absolument interdit. Votre question implique le contraire, et vous
hésitez seulement sur le parti à prendre. Mais, dans un cas comme dans
l'autre, mon avis est que vous demeuriez en Sicile. La proximité permet
l'échange plus fréquent des lettres et des courriers, elle favorise
ainsi le succès. Si on réussit, et j'y compte, le retour est plus prompt
; enfin on sait plus tôt à quoi s'en tenir. Demeurez donc, c'est mon
avis, tout à fait mon avis. — Je vous recommanderai
439
très particulièrement à T. Furfanius Postumus, qui est mon ami; et à ses
lieutenants, tous mes amis (le même. On les attend. Ils sont à Modène.
Ce sont des gens parfaits, bons pour tous ceux qui sont dans votre
position; et notre liaison est intime. Si je vois quelque chose à faire
dans votre intérêt, je le ferai sans attendre qu'on me le dise. Si
quelque chose m'échappe, qu'on m'avertisse, et je me mettrai en quatre.
Je compte parler à Furfanius en des termes qui m'eussent dispensé de lui
écrire; mais votre famille souhaite que vous ayez une lettre de moi à
lui remettre. Je me rends à ce voeu. Voici la lettre.
485. — A T. FURFANIUS, proconsul. Rome.
F. VI, 9. Je suis lié avec A. Cécina
d'une amitié sans égale. J'ai été lié d'abord fort étroitement avec son
père, homme de beaucoup de distinction et de caractère. Je pris de bonne
heure une haute idée des sentiments et du mérite du fils. Nous ne nous
quittions pas, tant nous étions attires l'un vers l'autre par le
penchant de nos coeurs et la conformité de nos goûts. Enfin je l'aime si
tendrement que je n'ai pas vraiment de meilleur ami. Je n'en dirai pas
davantage. Ce peu de mots suffit pour vous faire comprendre que je dois
m’intéresser à son sort et le défendre de toutes mes forces. Je sais
parfaitement quel est le fond de votre pensée sur la situation des gens
de bien et les malheurs de la république; d'avance vos bonnes
dispositions sont acquises à Cécina. Mais soyez meilleur encore pour lui
que pour les autres : je vous le demande afin qu'il sache ce que vous
avez de déférence et de bouté pour moi. Rien ne peut vous donner plus de
droits â ma reconnaissance.
486. — DE CÉCINA A CICÉRON.
F. VI, 7. Si j'ai tardé à vous
envoyer mon livre, pardonnez à mes scrupules et prenez pitié de ma
position. Mon fils craint non sans raison la publicité. Qu'importe, en
effet, le sentiment dans lequel il est écrit, si tout dépend des
dispositions du lecteur auquel on s'adresse? et cette seconde
publication ne va-t-elle pas sottement encore envenimer mon mal, quand
je suis déjà tout meurtri de la première? Étrange destinée que la
mienne! un auteur fait une faute, il l'efface, et c'est fini. Un autre
publie un sot ouvrage, il n'encourt d'autre peine que la publicité :
mais moi, on me punit d'une erreur par l'exil, moi dont tout le crime
est d'avoir, dans le combat, souhaité du mal à mon ennemi. Il n'y a pas
un seul de nous, je pense, qui n'ait adressé des vœux pour le triomphe
de son parti ; pas un qui, offrant des sacrifices aux Dieux, même pour
d'autres objets, n'ait mêlé à ses invocations d'ardents souhaits pour la
défaite de César. S'il ne le croit pas, il est bien heureux. S'il le
sait, s'il n'en peut douter, comment expliquer la persévérance de sa
colère pour quelques lignes contre lui, et son indulgence envers les
hommes qui ont tant de fois invoqué les Dieux pour sa perte? — Mais,
pour en revenir au début de ma lettre, je craignais de vous envoyer mon
livre, et voici pourquoi. J'y ai peu parlé de vous, et je n'en ai parlé
qu'en peureux. Je n'ai pourtant pas rétracté les louanges que je vous
avais données dans mon premier
440
écrit, mais j'ai l’air de ne les reproduire qu'a regret . Or, qui ne
sait qu'il faut avoir ses coudées franches pour aborder un genre qui
veut de l'entraînement et une certaine élévation? L'auteur d'un pamphlet
semble pouvoir hardiment se donner carrière; encore faut-il qu'il ne
pousse pas la satire jusqu'au dévergondage. Il est, au contraire, bien
embarrassant de se louer soi-même sans se faire accuser d'outrecuidance.
Le champ ne sera-t-il donc parfaitement libre que pour l'éloge d'un
autre? Oui, si on loue sans réserve; car à la moindre restriction, voilà
le panégyriste accusé d'impuissance ou d'envie. Je ne sais ni si vous
reconnaîtrez l'opportunité, ni si vous approuverez le résultat des
efforts que j'ai faits pour voguer a travers tant d'écueils. Le mieux
eût été sans doute de ne pas braver un péril dont je ne pouvais me tirer
avec honneur. Le moins mal ensuite était de le proportionner à ma
faiblesse. Aussi ai-je tenu en bride l'ardeur qui m'y entraînait. Que de
teintes j'ai affaiblies! que de traits j'ai sacrifiés ! que de lacunes
je n'ai pas même essayé de remplir! Représentez-vous un escalier, dont
on aurait supprimé plusieurs degrés, rompu quelques-uns ça et là, laissé
d''autres mal joints et vacillants, escalier qui servirait moins à
monter qu'il ne serait propre à faire tomber, Voilà mon livre. Pauvre
auteur chargé d'entraves et brisé en tous sens, comment trouverais-tu
assez de verve pour éveiller l'attention et commander l'intérêt? — Mais
c'est bien pis, lorsque le nom de César arrive : alors je tremble de
tous mes membres ; ce n'est pas sa vengeance, c'est son jugement qui me
fait peur. Moi, je ne connais pas à fond César : jugez donc des
perplexités d'un auteur qui se parle ainsi à lui-même : « Ceci plaira;
ce mot sera mal pris : si je le changeais? Mais ne sera-ce point pis?
Passons : voici l'éloge d'un autre : ne s'en choquera-t-il point? quand
il s'en choquerait, que faire s'il ne veut rien entendre? On s'acharne
contre l'auteur soldat et combattant : qu'espérer pour l'auteur vaincu
et proscrit? » Mes craintes redoublent quand je vous vois, vous, dans
votre Orateur, mettre Brutus en avant, et vous excuser en quelque sorte
à la faveur de sa complicité. Si le patron officiel des autres en est
réduit là, qu'attendre pour son ancien client, aujourd'hui le client de
tout le monde? Quand on a peur de chaque mot ; quand on tremble à chaque
ligne; quand, au lieu de suivre le mouvement de sa pensée, on doit se
régler sur la pensée d'un autre qu'on ne connaît qu'imparfaitement, il
est bien difficile de sortir de l'épreuve à son honneur. Vous n'avez
peut-être jamais éprouvé cet embarras, vous qui, avec la souplesse et la
supériorité de votre esprit, vous jouez de tous les écueils. Mais moi,
j'en fais la dure expérience. Je n'en avais pas moins dit à mon fils de
vous lire mon livre, puis de me le rapporter, même de vous le laisser,
mais à charge par vous de le revoir ou même de le refaire. —Je renonce
au voyage d'Asie, et malgré les plus impérieux motifs, je me rends à vos
observations. Qu'ai-je besoin de nie recommander à vous? Vous voyez
vous-même que le moment est venu où l'on va prendre un parti. Eh bien,
mon cher Cicéron, ne vous en rapportez en rien à mon fils. Il est jeune
: dans l'excès de son zèle, dans l'inexpérience de son âge, au milieu de
ses anxiétés, il ne saurait penser à tout. Chargez-vous du fardeau
entier. En vous seul est mon espoir. Vous êtes pénétrant : vous savez
comment on plaît à César, par quelle voie on arrive à son coeur : que
tout vienne de vous, que jusqu'à la fin tout se fasse par vous. Vous
avez une grande influence sur lui, une plus grande encore sur son
entourage. Il ne faut que vous persuader à vous-même qu'il ne s'agit pas
seulement de faire inci-
441
demment telle ou telle démarche qui vous serait demandée, ce qui déjà
d'ailleurs serait immense, mais qu'il s'agit de prendre seul la conduite
et la responsabilité de mon affaire. Alors le succès viendra, je n'en
doute pas; à moins toutefois que le malheur ne m'aveugle, ou que ma
téméraire amitié ne passe la mesure de ses exigences. Sous ce double
rapport, je trouverais mon excuse dans les habitudes de votre vie. Vous
avez si bien accoutumé vos amis à vous voir préoccupé de ce qui les
touche, qu'ils se croient en droit non seulement d'attendre, mais encore
d'exiger tout de votre bonté. J'en reviens à mon livre : mon fils vous
le remettra; mais de grâce, ne le laissez point paraître, ou
corrigez-le, et ôtez tout ce qui pourrait nuire.
487. — A CÉCINA. Rome.
F. VI, 5. Chaque fois que je vois
votre fils (et je le vois presque tous les jours), je lui répète qu'il
peut compter, sans restriction, sur mon dévouement et mes démarches,
quels que soient la peine, le travail et le temps ; mais que je ne lui
promets pas de même, sans restriction, mon crédit et mon influence,
parce que je ne puis m'engager que pour ce que je vaux et ce que je
puis. J'ai lu et relu votre livre, et je le garde avec soin. Votre
affaire et vos intérêts me préoccupent plus que je ne saurais dire : le
terrain devient chaque jour plus facile et meilleur. On s'occupe de vous
de beaucoup de côtés. Mais vous devez savoir par votre fils ce que font
vos amis et ce qu'ils espèrent. Je ne prétends pas que, pour une
appréciation conjecturale des faits, mon coup d'oeil soit plus sûr et
plus pénétrant que le vôtre. Cependant il est possible que votre esprit
soit moins calme, et c'est pourquoi je crois bien faire en vous disant
ma pensée : la force des choses et le cours des événements amèneront
bientôt du changement dans votre position et dans toutes les positions
analogues; c'est infaillible, et la mauvaise fortune ne persécutera pas
toujours une si bonne cause et d'aussi bons citoyens. Oui, je suis plein
de confiance pour vous; et cette confiance repose non seulement sur la
considération de votre rang et de votre caractère, ce sont là des titres
que vous partagez avec d'autres, mais aussi sur des considérations qui
vous sont plus particulières encore : je veux parler de cet esprit divin
et de ces rares talents pour lesquels je vous jure que celui de qui nous
dépendons tous a un faible étonnant. Vous n'auriez pas même eu de lui
une égratignure, si vous n'aviez pas fait servir ces dons heureux, qu'il
apprécie, à le blesser lui-même. Mais son irritation se calme tous les
jours, et, si j'en crois ses confidents, l'idée qu'il a de votre mérite
est votre meilleur avocat près de lui. Courage donc! courage ! votre
naissance, votre éducation, votre savoir, l'opinion qu'on a de votre
caractère, vous font du courage un devoir; et ce que je vous dis
n'est-il pas fait pour vous rassurer? Enfin je veille à tout, soyez-en
convaincu, vous et vos enfants ; notre vieille amitié, mes façons avec
mes amis, et les bons offices que vous m'avez si souvent rendus, m'en
font une obligation.
488. — DE MARCELLUS A CICÉRON. Mitylène.
F. IV, 11. Voici qui peut vous
persuader que j'ai toujours accordé à vos paroles une grande autorité
dans toutes les occasions, et particulièrement dans celle-ci. Mon frère
C. Marcellus, qui
442
est le plus tendre des frères, avait beau me conseiller, me presser; je
résistais : mais votre lettre arrive, et je me soumets. Votre avis et le
sien feront ma loi. le trouve avec plaisir dans vos deux lettres des
détails sur la manière dont tout s'est passé. Je suis bien sensible à
vos félicitations, parce que je sais qu'elles partent du coeur. Mais il
y a quelque chose qui me charme et me touche davantage encore : c'est
que parmi les amis, les proches, les intimes, en si petit nombre, hélas
! qui se sont véritablement intéressés à moi. Il n'en est aucun qui
m'ait témoigné plus de dévouement que vous, et qui m'ait servi avec une
amitié plus parfaite. .l'ai supporté sans peine et sans murmure ce que
le malheur du temps m'imposait de sacrifices et de privations : mais
quelle que soit ma fortune, bonne ou mauvaise, je ne résisterais pas à
la douleur de perdre de tels amis. Leur coeur est à moi, et voila ce
dont je me félicite. Vous avez obligé l'homme qui vous aime le plus au
monde. Sa conduite vous le prouvera.
489. — A BRUTUS. Rome.
F. XIII, 11. J'ai remarqué en
maintes occasions l'intérêt que vous mettiez à connaître une foule de
détails qui me concernent. Je suis donc sur que vous savez à quel
municipe j'appartiens, et l'attachement que je porte à mes concitoyens,
les Arpinates. Leurs revenus, qui font leur bien-être et qui composent
toutes leurs ressources, consistent dans des impôts en Gaule. Ils y
trouvent de quoi pourvoir a la dépense des sacrifices, ainsi qu'à
l'entretien des temples et des autres édifices publics. Il est devenu
indispensable de procéder à une vérification générale, de faire rentrer
un arriéré dû par les colons ; de se bien rendre compte de l'état des
choses, et de réorganiser l'administration. Nous envoyons à cet effet
sur les lieux en qualité de délégués trois chevaliers romains, Q.
Fulidius, fils de Quintus, M. Faucius, fils de Marcus, et Q. Mamercus,
fils de Quintus. Je recommande très-chaudement l'affaire à votre amitié,
et je vous demande d'y mettre assez d'intérêt pour que nos délégués
n'éprouvent aucune entrave, et puissent remplir leur mission vite et
bien. Je recommande en outre à tous vos égards et à toutes vos bontés
les trois honorables citoyens que je viens de nommer. Ce sont des gens
de bien, dont vous vous ferez des amis ; c'est une ville municipale
naturellement disposée à la reconnaissance, que vous vous attacherez
pour toujours; c'est moi enfin qui vous saurai d'autant plus de gré de
vos bons offices, qu'indépendamment de mes devoirs habituels de
patronage envers mes concitoyens, je suis cette année plus que jamais
obligé par position à n'y pas manquer. En effet, lorsqu'on a récemment
constitué la municipalité d'Arpinum, j'ai voulu que mon fils fût édile
avec le fils de mon frère et M. Césius, l'un de mes bons amis. Chez nous
il n'y a d'autre magistrature municipale que l'édilité. Or, pour peu
que, grâce à vous, à votre intérêt, à vos bons soins, les affaires de
notre ville se terminent heureusement, c'est à eux trois et à vous tout
le premier qu'en reviendra l'honneur. Ne nous refusez pas cette
satisfaction. Je vous le demande avec instance.
490. — A BRUTUS. Rome.
F. XIII, 12. J'ai donné en commun
aux députés
443
d'Arpinium une lette où je vous les recommande de mon mieux : Je veux
par celle-ci vous recommander particulièrement Q. Fulidius, que j'aime
beaucoup et que j'ai mille raisons d'aimer. Ce n'est point une
restriction que je mets à ma précédente lettre, c'est une seconde
recommandation que j'ajoute a la première. Fulidius est oncle de M.
Cesius, l'un de mes plus intimes et de mes meilleurs amis. Il était avec
moi en Cilicie, comme tribun des soldats. Il s'y est si bien conduit que
je me crois son obligé, au lieu de le considérer comme le mien. De plus,
et voici ce qui vous touchera davantage, Q. Fufidius n'est point
étranger aux lettres. Ouvrez-lui donc vos bras, je vous en conjure, et
donnez-lui l'occasion de faire preuve d'habileté dans une mission qu'il
a acceptée contre son gré et par déférence pour moi. Comme toutes les
natures excellentes, il met de l'amour-propre à justifier ma confiance
et à mériter au retour mes éloges, ainsi que ceux de toute sa ville. Il
y réussira, pour peu que ce mot éveille pour lui votre intérêt.
491. — A BRUTUS. Rome.
F. XIII, 13.
L. Castronius Petus, de la ville municipale de Lucques, et le premier
sans contredit de tous ses habitants, est un homme honorable, grave,
obligeant, excellent enfin dans toute l'acception du mot; de plus, si
cela peut y faire quelque chose, il n'est pas moins riche de biens que
de vertus. C'est un de mes bons amis, et je puis dire qu'il n'y a
personne dans notre ordre qu'il affectionne et honore plus que moi. Je
vous le recommande comme un des miens, digne de devenir un des vôtres.
Obligez-le, vous n'aurez qu'à vous en applaudir, et je vous en saurai un
gré infini. Adieu.
492. — A BRUTUS. Rome.
F. XIII, 14. Je suis fort lié avec
L. Titius Strabon, chevalier romain, homme honorable autant que
distingué. Entre moi et lui, c'est une amitié à toute épreuve. Il lui
est dû de l'argent dans votre province par P. Cornélius Volcatius, qui
rend la justice à Rome, a prononcé le renvoi devant la juridiction des
Gaules. Je vous demande avec plus d'intérêt que s'il s'agissait de
moi-même, parce qu'il est plus beau de se préoccuper de l'argent de ses
amis que du sien propre ; je vous demande, dis-je, de ne pas laisser
traîner cette affaire. Faites-vous en rendre compte, occupez-vous-en
vous-même, et veuillez enfin, autant que la justice et l'équité le
permettent, vous y employer de manière que l'affranchi de Strabon envoyé
tout exprès sur les lieux, puisse en finir aux meilleures conditions
possibles, et réussisse surtout à faire compter les écus. Je vous en
saurai un gré infini, et vous verrez en même temps combien L. Titius est
digne de votre amitié. Vous êtes toujours aimable et bon pour moi ;
soyez de même encore aujourd'hui, je vous en conjure.
493. — A SERVIUS SULPICIUS. Rome.
F. XIII, 17. J'aime M'. Curius,
négociant à Patras; je l'aime par mille raisons toutes meilleures les
unes que les autres : d'abord il y a des siècles que je le connais,
depuis mon entrée au forum; puis il m'a cent fois ouvert sa maison de
Patras; il me l'a offerte encore en dernier lieu à l'occasion de cette
malheureuse guerre, et j'en aurais pu au
444
besoin disposer comme de ma propre demeure ; enfin ce qui m'attache
surtout à Curius, ce qui me rend son amitié sacrée, c’est qu’Atticus n'a
point d'ami plus tendre, plus dévoué que lui. J'arrive trop tard, si
déjà vous connaissez Curius, parce qu'il se sera suffisamment recommandé
par son caractère aimable et ses manières affectueuses. Si vos bontés
ont en effet devancé mon voeu, que ce mot ajoute pourtant encore, je
vous en conjure, à vos lionnes dispositions. Mais si sa réserve l'avait
tenu trop à l'écart, si vous ne le connaissiez qu'imparfaitement encore,
si vous ignoriez enfin en quoi il a besoin de vous, souffrez que
j'invoque de toutes mes forces, et comme je le dois, votre bienveillance
en sa faveur. Je m'intéresse à Curius par une affection toute
désintéressée. Je me bornerai donc à vous dire, à vous répéter, à vous
assurer sur ma parole et ma tète, que vous aimerez M'. Curius, quand
vous connaîtrez son caractère, sa bonté, sa droiture. Oui, vous
l'aimerez, et vous ne vous étonnerez plus si je vous le recommande avec
instance. Laissez-moi espérer que ma lettre fera sur votre esprit toute
l'impression que j'en attends.
494. — A SERVIUS. Rome.
F. XIII, 18. Oui, je prétends
qu'Atticus, dont j'ai vu pourtant les transports de joie, n'a pas été
plus sensible que moi à votre charmante, aimable et bonne lettre ; ou
s'il en a été touché tout autant, je soutiens qu'il n'a pu du moins
sentir aussi profondément et cette attention délicate qui n'a rien
d'ailleurs dont je m'étonne de votre part, mais qui va le chercher, lui
qui n'a rien écrit, rien demandé, et ces obligeantes offres de service
qui vont le surprendre au moment ou il s'y attend le moins. Je ne vous
dirai point : Ajoutez encore à ces bonnes dispositions pour l'amour de
moi : y ajouter est impossible; vos promesses le comblent. Je ne vous
dirai pas non plus : Agréez ma gratitude ; c'est pour Atticus et de
vous-même que vous avez agi. Il faut pourtant que je vous exprime
combien votre procédé me pénètre; car si rien au monde ne peut m'être
plus agréable que vos sentiments flatteurs pour un homme que j'aime
passionnément, comment ne serais-je pas envers vous pénétré de
reconnaissance ! Dussé-je donc blesser votre délicatesse, votre
indulgente amitié me le pardonnera, je reviendrai sur mes paroles, et je
vous dirai ce qui me semblait tout à l'heure inutile de vous dire. Oui,
d'abord ajoutez à vos bonnes dispositions pour Atticus tout ce que vous
inspirera votre affection pour moi, puis agréez l'expression ouverte et
profondément sentie de la gratitude dont je craignais il y a un instant
de vous parler ; enfin croyez que les services que vous rendrez à
Atticus pour les affaires d'Épire et les autres m'obligeront non moins
étroitement que lui-même.
495. — A SERVIUS. Rome.
F. XIII, 19. Il y a des siècles que
Lyson de Patras est mon hôte, et j'ai toujours pensé que ce titre
imposait des devoirs. Si d'autres sont aussi mes hôtes, il n'en est
aucun avec qui je sois plus lié. Ses bons offices, nos relations
journalières ont si bien serré nos noeuds, qu'il est vraiment impossible
d'être plus intimement unis. Pen-
445
dant l'année qu'il a passée à Rome , il a vécu , pour ainsi dire, avec
moi : nous comptions alors sur l'effet de mes lettres et de mes
recommandations près de vous pour la défense de ses intérêts et de sa
fortune en son absence, et nous avions raison d'y compter. Cependant,
comme tout dépendait d'une seule volonté, et comme Lyson avait embrassé
notre cause et suivi nos armes, nous ne laissions pas que d'être, malgré
tout , dans une appréhension continuelle. Aujourd'hui l'éclat de son
rang , mes démarches , l'intervention de tous ceux qui ont comme moi
logé chez lui, ont eu leur plein effet auprès de César. Vous le verrez
par la lettre que César lui-même vous adresse. — Il semblerait que je
n'ai plus à m'occuper de Lyson ; mais je n'en veux pas moins vous parler
encore de l'intérêt que je lui porte. Je vous demande même avec instance
de lui accorder accueil et confiance. Tant qu'il y a eu incertitude sur
son sort , je mettais une sorte de timidité dans mes prières, de peur de
quelque coup de foudre que vous n'auriez pu parer. Maintenant qu'il est
rétabli dans sa position, je fais hardiment appel à votre bienveillance.
Ma recommandation ne porte pas sur tel ou tel des siens en particulier;
elle comprend sa famille entière , notamment son jeune fils, que ,
pendant son malheureux exil , mon client C. Meramius Gémellus a adopté,
conformément aux lois de Patras, après s'être fait d'abord naturaliser
lui-même citoyen de cette ville. Je place sous votre protection ses
droits sur l'héritage de Gémellus. — Veuillez, en un mot, donner votre
amitié à Lyson, au meilleur, au plus reconnaissant des hommes. C'est
l'important. Une fois liés, vous eu penserez ce que j'en pense, et vous
le servirez à votre tour, comme je le fais, auprès de vos amis. Oui, je
vous demande expressément votre amitié pour Lyson. N'allez pas, par un
peu de froideur, lui donner à penser, non pas que vous êtes changé pour
moi, mais que je ne vous ai parlé de lui qu'avec un faible intérêt,
d'autant qu'il m'a trop souvent entendu lui-même parler de vous et qu'il
a trop vu de vos lettres pour ne pas savoir à quoi s'en tenir sur vos
bontés pour moi !
496. A SERVIUS, Rome.
F. XIII, 20. J'aime beaucoup le
médecin Asclapon de Patras ; sa société me plaît , et j'ai pu juger son
mérite dans les soins qu'il a donnés à ma famille. Science , vertu ,
bonté , il a tout pour lui. Je vous le recommande : qu'il sache, je vous
prie, en quels termes je m'exprime sur son compte , et qu'il voie que ma
recommandation lui a été très utile. Je vous en saurai un gré infini.
497. — A SERV. SULPICIUS. Rome.
F. XIII, 21. M. Émilius Avianus
étant fort jeune encore, me témoignait déjà des égards; depuis il m'a
toujours été fidèle. C'est un esprit droit, un caractère aimable , et le
plus serviable des hommes. Si je le savais à Sicyone , ou plutôt si je
ne le savais pas à Chypre , ou je l'ai laissé et ou l'on m'assure qu'il
est encore, je n'aurais que quelques mots à vous dire : son caractère et
son mérite vous le rendraient bientôt aussi cher qu'à moi et à tous ceux
qui le connaissent. Le croyant donc absent , je viens vous recommander
sa famille, qui est à Sicyone , ainsi que tout ce qui lui appartient,
notamment C. Avianus Hammonius,
446
son affranchi, qui mérite une mention particulière. Je lui dois des
éloges non seulement pour son zèle et son dévouement singulier envers
son patron, mais parce qu'il m'a rendu à moi-même de grands services.
Dans mes plus mauvais temps, je l'ai trouvé aussi empressé, aussi chaud
que s'il m'eût été redevable de la liberté. Veuillez donc lui faire bon
accueil, prendre intérêt aux affaires de son patron, bien traiter son
agent que je vous recommande, lui accorder quelques égards à lui-même,
et le regarder comme un des vôtres. Vous serez bientôt frappé de sa
délicatesse, de son obligeance, et des qualités aimables dont il est
doué. Adieu.
498. — A SERVIUS. Rome.
F. XIII, 22. J'aime beaucoup T.
Manlius, négociant a Thespie ; il a toujours été plein d'égards,
d'attentions et de respect pour moi. De plus, il n'est pas étranger aux
lettres. Enfin Varron Muréna lui veut du bien : il vous en a écrit, et
il compte sur l'effet de sa recommandation. Il se persuade toutefois
qu'un mot de moi ajoutera encore à votre intérêt. Je vous recommande
donc Manlius, parce que je ne sais résister ni au voeu d'un ami que
j'aime, ni à un désir de Varron. Soyez pour Manlius ce que vous êtes
pour ceux a qui vous vous intéressez le plus. Servez-le, honorez-le, en
tant que la justice et le rang le permettent ; je vous en saurai un gré
extrême. C'est le coeur le plus reconnaissant , le caractère le plus
aimable ; et je me porte garant que vous trouverez chez lui la gratitude
dont les hommes droits ont coutume de payer vos bontés.
499. — A SERVIUS. Rome.
F. XIII, 23. Je suis extrêmement lié
avec L. Cossinius, qui est votre ami et de votre tribu. Nous nous
connaissions de vieille date, lui et moi; mais Atticus nous allés plus
intimement encore. Aussi n'y a-t-il personne de sa maison qui ne m'aime.
Celui de tous qui me témoigne le plus d'attachement est L. Cossinius
Anchialus, affranchi de Cossinius , fort estimé de son patron et des
amis de son patron , au nombre desquels je me range. Je viens vous le
recommander : fût-il mon propre affranchi, eût-il été pour moi ce qu'il
est pour son maître, je ne vous le recommanderais pas plus chaudement.
Ouvrez-lui donc le coeur et les bras , si vous voulez m'être agréable;
et rendez-lui tous les bons offices dont il pourrait avoir besoin , sans
vous imposer trop de gêne. Je vous en saurai un gré infini , et vous y
trouverez vous-même votre compte ; car vous verrez bientôt tout ce qu'il
y a en Cossinius d'honnêteté, de douceur et de modestie. |