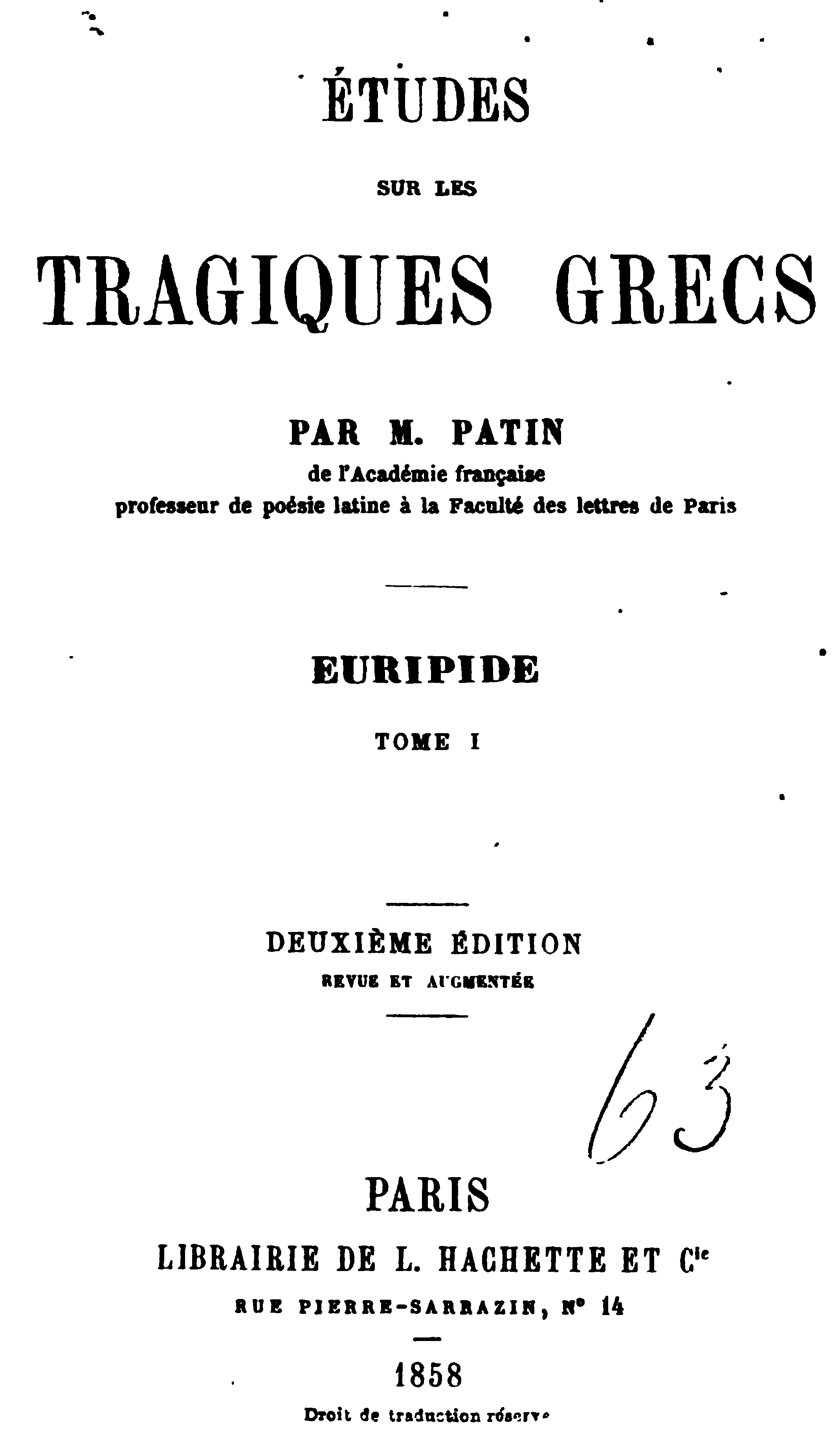
M. PATIN
ÉTUDES SUR LES TRAGIQUES GRECS
EURIPIDE. Tome I
CHAP. VI. ALCESTE
ÉTUDES
SUR LES
TRAGIQUES GRECS
----------------
SOPHOCLE
OUVRAGES DU MÊME AUTEUR
PUBLIÉS DANS LA BIBLIOTHÈQUE VARIÉE
PAR LA LIBRAIRIE HACHETTE ET Cie
FOHMAT IN-16 A 3 FR. 50 LE VOLUME BROOHÉ
Études sur les tragiques grecs. Trois parties qui se vendent séparément :
Etudes sur Eschyle. Un vol.
Etudes sur Sophocle. Un vol.
Eludas sur Euripide. Deux vol.
Études sur la poésie latine. 4e édit. Deux vol.
Discours et mélanges littéraires. Un vol.
Prix de chaque volume, broché, 3 fr. 50
20099. — Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, à Paris.
TRAGIQUES GRECS
PÀVR M. PATIN
Secrétaire perpétuel de l'Académie franchise
Doyen de la Faculté des lettres de Paris
ESCHYLE
SEPTIJSMB EDITION
PARIS
LIBRAIRIE HACHETTE ET Gie
79, BOULEVABD SAINT-GERMAIN, 79
1890
lh-oit.fi do U^luclion ot do reproduction réservés.
ÉTUDES
SUR LES
TRAGIQUES GRECS
PAR H. PATIN
Secrétaire perpétuel de l'Académie
franchise
Doyen de la Faculté des lettres de Paris
ESCHYLE
SEPTIEME EDITION
------------
PARIS
LIBRAIRIE HACHETTE ET Cie
79, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 79
-----
1890
Droits de traduction el de reproduction réservés.
AVANT-PROPOS
DE LA DEUXIÈME ET DE LA TROISIÈME ÉDITION
(1858, 1865).
En réimprimant, après un assez long intervalle de temps, ces Études sur les tragiques grecs, j'ai dû chercher à les rendre moins indignes de l'accueil bienveillant qui leur avait été accordé. J'ai donc souvent changé, souvent aussi ajouté. Bien des ouvrages avaient paru depuis, sur le même sujet, qu'il était de mon devoir de mettre à profit, et pour l'amendement, l'amélioration de mon œuvre, et dans l'intérêt des personnes qui voudraient bien encore s'en aider comme d'une introduction utile a l'intelligence d'une portion bien considérable, à tous égards, de la littérature des anciens.
Le livre a conservé le double caractère, la double destination que je m'étais appliqué à lui donner, par une conciliation difficile à opérer, j'en conviens, des préoccupations du goût avec celles de l'érudition. J'avais souhaité qu'il pût pénétrer dans le monde ; y ramener l'attention vers de beaux monuments ou négligés, ou peu compris ; y éveiller quelque désir d'en prendre plus directement connaissance, de les regarder de plus près : mais je n'aurais pas voulu, d'autre part, qu'une classe particulière de lecteurs, à laquelle il me convenait surtout de m'adresser, fût en droit de le trouver trop étranger à tant de questions de toutes sortes que s'est faites, de notre temps, et continue de se faire, sur ces monuments, la critique savante.
Ces questions, d'ailleurs, je ne puis convenir qu'elles n'in- ii téressent.ainsi qu'on le dit quelquefois, qu'une curiosité érudite. Comme elles tendent, plus ou moins, à nous replacer dans la situation du public auquel s'offrit d'abord la tragédie grecque, à la replacer elle-même dans l'ensemble des faits sociaux, religieux, littéraires, au milieu desquels elle s'est produite, à en faire suivre les fortunes diverses, en d'autres lieux, en d'autres temps, chez de nouveaux imitateurs, de nouveaux appréciateurs, ces questions, avec tous les détails qui s'y rattachent, préparent certainement à des jugements plus complets, plus sûrs, plus libres, plus dégagés des préjugés de l'habitude et de la théorie. En revenant sur mon travail, je n'ai pas pensé que je dusse le restreindre en ce point, bien au contraire.
Je ne me suis point corrigé non plus d'une sorte de partialité pour les trois grands tragiques athéniens. Peut-être sied-il à la critique d'être partiale pour de tels poètes, de ne pas croire trop légèrement à leurs fautes, d'en essayer d'abord, avant de les admettre comme telles, de favorables interprétations. Ce qui lui sied surtout, ce qui est assurément sa vocation la plus haute, sa plus utile application, c'est de poursuivre le secret de leurs beautés, de les mettre, s'il est possible, plus en lumière.
Voilà les dispositions que j'avais apportées primitivement à ma tâche, et avec lesquelles je l'ai reprise. Puissent mes nouveaux efforts m'être comptés par les amis que conservent encore les lettres anciennes, dans notre temps aux préférences si modernes, si occupé d'intérêts présents, de politique et d'affaires !
----------------------
iii PREFACE
DE LA. PREMIÈRE EDITION (1841-1843).
....Je ne pense pas avoir à m'excuser de revenir, après tant d'autres, sur un si ancien sujet. Il n'y a point d'ancien sujet pour un professeur voué par devoir à l'antiquité, et peut- être n'y a-t-il pour personne de sujet entièrement épuisé. Le point de vue de la critique, rétréci et faussé par les ignorances et les préjugés de chaque époque, gagne perpétuellement en étendue, en rectitude, et ce qu'elle a le plus fréquemment décrit et jugé, peut reprendre ainsi, à la longue, grâce au temps qui vieillit le faux et rajeunit le vrai, quelque nouveauté. J'ose croire, et ne voudrais pas avoir préparé laborieusement une démonstration du contraire, qu'il en est ainsi pour le théâtre tragique des Grecs. Après les travaux multipliés de tant de savants et judicieux écrivains qui n'ont cessé, et ne cessent encore, d'en épurer, d'en compléter les textes, d'en éclaircir les difficultés de toutes sortes, mythologiques, archéologiques, historiques, d'en expliquer l'esprit; après les disputes littéraires où ont été plus d'une fois remis en question les principes mêmes d'après lesquels on doit le juger; après les hardis essais qu'ont fait naître, particulièrement dans ces dernières années, et la satiété des formes qu'il avait consacré&s, et la séduction de formes nouvelles, offertes kl imitation par des modèles bien différents, nous sommes, je le crois, plus capables qu'on ne l'a encore été d'apprécier sans préoccupation étrangère, librement, impartialement, ses originales beautés....
iv Je ne veux point anticiper ici sur une exposition, sur des discussions qui trouveront mieux leur place dans l'ouvrage même. Je me bornerai à indiquer sommairement le contenu des cinq livres entre lesquels il m'a paru convenable de les distribuer.
Le premier renferme une Histoire générale de la tragédie grecque. On y fait connaître son origine, ses progrès, ses transformations diverses, le caractère de ses principaux représentants et de leurs écoles, la foule même des poètes, d'ordre inférieur, qu'elle a produits, et au temps des grands maîtres, et dans les âges suivants, sans oublier ces illustres acteurs qui, dans le déclin de l'inspiration dramatique, restèrent presque ses seuls interprètes. Cette tragédie, dont la décadence même ne fut pas sans éclat, on la suit sur toutes les scènes suscitées par la scène athénienne, dans les villes, dans les îles de la Grèce, en Sicile, en Macédoine, à Alexandrie, à Rome ; on la montre se perpétuant par les nombreuses imitations des pièces grecques, par la rare application de la poétique grecque à d'autres sujets, romains, juifs, chrétiens. Enfin, après avoir donné une idée de l'immense et universelle popularité qu'elle obtint chez les anciens, et dont l'ensemble de leur civilisation, leurs mœurs, leurs lettres, leurs arts offrent partout le témoignage, on retrace son influence sur la renaissance, sur les nouveaux développements du théâtre, et particulièrement du genre tragique, chez les modernes.
Au premier livre, dans lequel s'annoncent les traits généraux de ce qui doit être ensuite exposé plus en détail, répond le cinquième, où ils se rassemblent et se résument sous la forme d'une revue critique des jugements portés jusqu'à ce jour sur la tragédie grecque. Rappeler tout ce qu'on en a dit, à diverses époques, et d'erroné, et aussi de juste; montrer que, le plus souvent, on l'a rapportée à des règles de composition, à des habitudes scéniques, à des v mœurs, à des institutions, a des croyances, qui lui étaient étrangères, et d'après lesquelles il était facile, mais peu raisonnable, de la censurer ; que bien rarement, au contraire, on s'est fait, comme il le fallait, son contemporain, afin de voir dans leur jour, de comprendre dans leur vérité, des ouvrages écrits pour des Grecs, et sans prévision aucune, assurément, de ce qu'imposeraient plus tard au même genre de nouvelles données morales, de nouveaux besoins d'imagination; réclamer pour ces antiques productions, qui na pouvaient, sans rétroactivité, être rendues justiciables de codes postérieurement promulgués, le droit d'être jugées uniquement d'après le petit nombre de lois universelles, éternelles, qui ont autorité en tous lieux, en tous temps, sur le génie des poètes: tel est le sujet de mon cinquième livre, où se reprend et s'achève, je l'ai voulu ainsi, pour que le tout offrît plus d'ensemble et d'unité, l'histoire retracée par le premier. Les arts ont une double histoire comme une double vie, qu'il faut suivre à la fois, et dans la pratique de ceux qui les cultivent, et dans les théories de ceux qui les expliquent. C'est l'objet des deux morceaux par lesquels j'ai cru devoir commencer et finir, qui me servent d'introduction et de conclusion.
A Eschyle, à Sophocle, à Euripide sont consacrés trois livres intermédiaires, d'étendue inégale comme la matière dont ils traitent...
Dans ces livres, chacune des tragédies qui nous sont parvenues d'Eschyle, de Sophocle et d'Euripide, a son chapitre à part, où elle est considérée et en elle-même et relativement au système dramatique de son auteur; replacée parmi les circonstances au sein desquelles elle s'est produite, et qui en ont accru l'intérêt ; rapprochée d'autres pièces grecques, soit conservées, soit perdues, auxquelles l'unissaient le lien d'une même composition, d'une même représentation, ou simplement la communauté, l'analogie des sujets; vi comparée enfin aux imitations plus ou moins libres et originales qu'on en a faites chez les Romains, chez nous, chez d'autres peuples de l'Europe moderne.
J'ai rangé les tragédies d'Eschyle dans un ordre conforme à ce qu'on sait, à ce qu'on peut conjecturer de la date de ces pièces, et propre, par conséquent, à y faire suivre les progrès de l'art dramatique. Une habileté, une perfection à peu près égales se faisant remarquer dans toutes les compositions de Sophocle, je me suis réglé pour les classer, selon mes convenances, tantôt sur l'usage ordinaire, tantôt sur la succession chronologique et l'enchaînement des sujets. L'emploi de ces diverses dispositions m'a permis de finir l'examen des deux théâtres par des tragédies qui ont ensemble de grands rapports, les Choéphores et les Euménides d'Eschyle, l'Electre de Sophocle, et d'établir entre elles, au moyen de la place que je leur donnais, ne pouvant les rapprocher davantage, une sorte de correspondance symétrique. Le parallèle que j'en ai dû faire, et où je ne pouvais manquer de comprendre l'Electre d'Euripide, m'a fourni une transition naturelle au théâtre du troisième des grands tragiques athéniens. A l'égard de ce dernier, dont les nombreuses pièces présentent de notables différences, non-seulement pour le mérite, mais pour les procédés de la composition, revenant en partie à l'ordre plus méthodique que j'avais suivi pour Eschyle, j'ai distribué ses œuvres en plusieurs groupes où l'on pût étudier les innovations par lesquelles ce poète inventif s'est efforcé de rajeunir la tragédie vieillie et épuisée.
Les observations de toute nature dont les tragédies qui nous sont restées du théâtre grec, au nombre de trente- deux, m'ont paru pouvoir être l'objet, je les ai comme en cadrées dans une analyse de chaque pièce, méthode d'exposition plus susceptible d'intérêt qu'une autre plus sévèrement didactique, et qui n'offre d'ailleurs qu'une apparente facilité ; vii car s'il est facile de passer de l'analyse aux observations, il ne l'est pas autant de revenir avec naturel et agrément des observations à l'analyse ; il est surtout bien malaisé de ramener les fragments de l'une et la variété des autres à des vues d'ensemble desquelles résulte, avec l'unité de chaque chapitre, le rapport de tous à un but général. Y aurai-je réussi plus que tant d'autres? je ne sais. J'ai du moins la conscience d'y avoir tâché davantage.
Je me suis, du reste, proposé avant tout d'être utile. Aussi n'ai-je point évité d'aborder dans des notes nombreuses, et même souvent dans mon texte, certains détails, nécessaires à l'exactitude, mais difficiles à exprimer sans sécheresse. Les faits que j'ai recueillis et rassemblés, j'ai pris soin de les rapporter aux autorités qui les établissent et leur donnent de la valeur. J'ai dû souvent traduire ce que je louais, au risque d'infirmer par là mes éloges; mais j'ai toujours renvoyé aux vers grecs eux-mêmes, prenant mes chiffres, j'en avertis ici, une fois pour toutes, dans les éditions si répandues de M. Boissonade.
Les tragiques grecs, négligés et presque dédaignés en France, au dernier siècle, y ont été, dans celui-ci, réhabilités avec éclat par de grands écrivains, d'habiles critiques, d'éloquents professeurs. Moi-même, s'il m'est permis de rappeler de modestes efforts auxquels j'aime à rattacher l'origine de cet ouvrage, j'en ai fait souvent le texte de mes leçons de littérature ancienne à l'École normale, de 1815 à 1822, et dans ces dernières années, par comparaison avec les tragiques latins, à la Faculté des lettres. Je serais heureux de n'avoir pas été étranger au mouvement qui ramène de plus en plus vers ces antiques fondateurs, ces éternels maîtres du théâtre, la curiosité et l'intérêt de la jeunesse studieuse, l'attention des littérateurs instruits.
------------------------------
ETUDES
SUR LES
TRAGIQUES GRECS.
--------------------------------------------
LIVRE PREMIER.
Histoire GÉnÉrale De La TragÉdie Grecque.

On ne peut remonter à l'origine de la littérature grecque et la suivre dans son développement sans remarquer d'abord ce caractère d'originalité qui la distingue de la littérature latine et de nos .littératures modernes. Seuls, entre tous les peuples européens, les Grecs n'ont reçu d'aucun autre peuple l'inspiration poétique. On dirait même qu'ils n'ont point connu cette barbarie qui précède d'ordinaire la naissance de l'art; du moins le souvenir ne s'en est-il point conservé. Leur histoire poétique commence pour nous à Homère, à ce modèle de perfection que depuis on n'a jamais atteint; et tandis que, chez des nations moins heureusement douées, les premiers poêles invoquent un dieu inconnu qui souvent ne leur répand point, les Grecs ont, pour ainsi dire, reçu la poésie des Muses elles-mêmes, et les fables mythologiques qui attestent cette origine merveilleuse ne semblent être qua l'expression de la vérité.
Comment expliquer le développement spontané, la per- 2 fection hâiive de la poésie grecque, sinon par cette vivacité d'imagination accordée aux peuples méridionaux et qui a été surtout le partage des Grecs? La nature était à leurs yeux animée et vivante ; la vie domestique, la vie civile, toutes pleines d'enchantements; un intérêt poétique se mêlait aux actes les plus sérieux, aux détails les plus vulgaires de leur existence. La poésie était chez eux dans les mœurs et dans les institutions; il est permis de le dire, elle s'élevait quelquefois elle-même au rang d'une institution religieuse et politique; il lui était quelquefois donné d'exprimer, dans une sorte de langage public, les sentiments de tous, de prêter, pour ainsi dire, une voix à la patrie. Quel caractère singulier de gravité une telle mission ne devait-elle pas communiquer aux hommes privilégiés qui, dans cette nation de poètes, méritaient d'être appelés les poêles par excellence, et que, d'un consentement unanime, tous reconnaissaient pour leurs interprètes! Faut-il s'étonner de trouver dans les premières productions du génie grec, dans les chants que fit naître une inspiration si sincère et si haute, tant de vérité et de grandeur?
La poésie se partagea de bonne heure chez les Grecs en divers genres, selon les diverses occasions qu'elle trouva de se produire, et aussi selon le goût particulier des poètes. Alors s'établit tout naturellement, sans réflexion et sans calcul, révélée par un instinct heureux, cette classification générale tant de fois débattue depuis par la critique.
Les uns, en l'absence de l'histoire, qui n'était pas encore née, se firent les historiens du temps passé : ils créèrent la poésie épique ; les autres entreprirent de sauver de l'oubli les traditions de la sagesse antique, les connaissances recueillies avec peine et lentement amassées par le travail des siècles : ils créèrent la poésie didactique, qu'un lien étroit unissait alors à l'épopée, car elle était aussi une sorte d'histoire du passé, qui satisfaisait aux premiers besoins de ces sociétés naissantes. Les poètes didactiques étaient vraiment, à cette époque d'ignorance, 3 ce qu'ils n'ont jamais été depuis, les précepteurs et comme les législateurs de l'humanité. Ils polissaient les esprits, adoucissaient les mœurs, enseignaient la morale, et les arts; leurs préceptes, parés de toutes les grâces de la poésie et du langage, flattaient l'imagination, se gravaient dans la mémoire, passaient d'une génération à l'autre, et perpétuaient ainsi les leçons de l'expérience.
Il s'en trouva un grand nombre qui se consacrèrent à célébrer les dieux et les héros enfants des dieux, à exprimer les sentiments d'admiration et d'amour que l'homme éprouve pour la Divinité et pour ce qui la retrace imparfaitement sur la terre; à peindre les affections les plus profondes et les plus vives, quelquefois les plus légères et les plus frivoles, l'enthousiasme religieux, l'amour de la patrie, le dévouement, le courage, la tendresse et la haine, la douleur et la joie, l'ivresse même des plaisirs : ils créèrent la poésie lyrique.
Telles furent les trois formes principales sous lesquelles se montra d'abord la poésie des Grecs, les trois genres que produisit, en quelque sorte fatalement, l'état primitif de leur société. Cultivés tous à la fois, dans l'âge fabuleux, par les Orphée, les Musée, les Linus, ils le furent aussi, mais à part, dans l'âge suivant par Homère et par Hésiode, et par cette nombreuse élite de poètes lyriques qui leur succéda. Seulement, on le conçoit, ils durent perdre beaucoup de leur importance, lorsque, par le progrès des connaissances, par l'invention de l'écriture, par la découverte de la prose, par l'établissement de l'histoire, ils furent devenus moins nécessaires.
Alors, comme le raconte Horace (1), on commença avoir dans la poésie un délassement, une distraction :
........................ ludusque repertus
Et longorum operum finis.
Alors parut un nouveau genre d'une utilité moins directe 4 et moins réelle que ceux dont il avait été précédé, et qui, s'emparant de la plupart de leurs beautés, intérêt épique, sagesse didactique et gnomique, mouvement lyrique, les fit briller d'un éclat tout nouveau, attira les esprits par le charme d'un plaisir jusqu'alors inconnu.
On a lieu de s'étonner que l'art dramatique ait été si longtemps a naître chez les Grecs. Depuis plusieurs siècles ils le possédaient, à leur insu, dans les poèmes d'Homère: une action simple et riche tout ensemble, soumise dans sa marche progressive aux lois de cette unité qui est le besoin commun de tous les arts et que réclament surtout les productions du théâtre ; des mœurs, des passions, des caractères, que mettait en jeu l'artifice habile des situations et des contrastes; toutes les affections du cœur humain exprimées avec une naïve éloquence, dans des discours énergiques et véhéments, dans un dialogue rapide et animé; la substitution perpétuelle, à part quelques mois d'exposition, des personnages eux-mêmes au poète, aussitôt effacé de son œuvre pour ne s'y plus montrer, forme que Platon et Aristote assimilent à celle des compositions dramatiques et qu'ils appellent de leur nom (2); enfin, pour le dire en un mot, le drame tout entier était renfermé dans les compositions du chantre de l'Iliade et de l'Odyssée; il ne fallait que le dégager tout à fait des formes du récit, que le transporter sur une scène. Comment cette révolution, qui nous semble aujourd'hui si naturelle, ne se fit-elle pas d'elle-même? Comment les rhapsodes, dans ces concours, dans ces luttes d'un caractère déjà presque dramatique, où, par un débit musical et expressif, un geste passionné (3), ils se disputaient le prix de leur art, n'imaginèrent-ils pas quelque jour, en récitant, par exemple, la dispute d'Agamemnon et d'Achille, de se substituer aux héros dont ils rappelaient les paroles, de se montrer à la foule attentive et charmée qui les entourait, sous le personnage d'Achille, sous celui d'Agamemnon? Comment, par un progrès insensible et presque inévitable, ne devinrent-ils pas les 5 acteurs des scènes dont ils n'étaient que les narrateurs elles historiens ? Homère eut sans doute plus tard une puissante influence sur les progrès de la tragédie; il fut, Platon l'a dit (4), le véritable maître des poètes tragiques, qui se composèrent sur son modèle, qui lui empruntèrent la plupart de leurs sujets ; Eschyle, de son propre aveu, n'offrit sur sa table que les reliefs des grands festins d'Homère (5) ; quand on voulut louer dignement Sophocle, on l'appela l'Homère tragique (6); comme, par une sorte de réciprocité, on appelait quelquefois Homère lui- même le Sophocle de l'épopée, le plus tragique des poètes (7). Mais, malgré ces traits frappants de ressemblance, malgré cette espèce de parenté qui unissait Homère à ces poètes enfants de son génie, il ne contribua en rien à la naissance de leur art, que ses exemples devaient un jour porter si loin. Entre Homère et Eschyle, qui auraient dû se suivre, se placèrent, après une longue suite de poètes plutôt lyriques que dramatiques, que tragiques, qu'on a cependant quelquefois, et même longtemps après la découverte de la véritable tragédie, appelés de ce dernier nom (8), Thespis, Chérilus, Pratinas, Phrynichus et d'autres encore sans 6 doute (9). Le hasard, qui joue un si grand rôle dans la plupart de nos découvertes, donna au drame la plus accidentelle, la plus imprévue de toutes les origines : il le fit naître du dithyrambe (10)
Disons-le cependant : le hasard n'est -peut-être encore ici que l'expression vague de causes plus positives auxquelles il serait possible de remonter. L'épopée avait fait son temps; les poètes cycliques l'avaient acheminée insen- 7 siblement vers l'histoire, qui devait la remplacer; l'époque approchait où, dans ses récits moins empreints de merveilleux, il ne resterait plus que des événements humains, des passions humaines, les éléments du drame. L'ode, de son côté, après avoir prêté sa voix à tous les sentiments qui fermentent au fond du cœur de l'homme et aspirent à se répandre au dehors, avait besoin d'un thème nouveau qui rajeunît ses inspirations; elle ne pouvait plus guère le demander qu'aux souvenirs de l'épopée dramatiquement évoqués devant elle. Une nouvelle forme poétique restait à trouver qui exprimât la vie, non plus par des récits, non plus par des élans passionnés, mais par quelque chose d'intermédiaire, d'aussi intéressant que les uns, d'aussi éloquent que les autres, et de plus agissant; par l'action dramatique, en un mot, toute prête à naître du premier rapprochement de l'ode et de l'épopée. Que si c'est au sein du dithyrambe que ces deux genres se sont rencontrés, se sont unis par un hymen fécond qui devait produire l'art du théâtre, faut-il donc tant s'en étonner? Ces chants dithyrambiques de tout caractère, sérieux ou folâtres, selon la nature des aventures divines qu'ils célébraient, selon l'esprit divers des fêtes où ils se faisaient entendre, à l'entrée de l'hiver ou au retour du printemps, ces chants, accompagnés d'un appareil musical et orchestique approprié à la variété des sujets, et qui existaient déjà dans le chœur des Satyres et des autres suivants de Bacchus, introduits par Arion (11) comme leurs acteurs (12), 8 étaient-ils sans analogie avec les représentations tragiques et comiques qui devaient en sortir? La liberté qui y régnait n'y ménageait-elle pas un accès plus libre, que dans les autres poèmes liturgiques, aux innovations d'où pouvait résulter le drame? Aussi, quand la tragédie eut réellement commencé à Athènes, les autres peuples de la Grèce, chez qui la poésie, la musique, la danse, l'expression mimique, avaient aussi et peut-être plus anciennement concouru de même à animer le culte des dieux et particulièrement celui de Bacchus, réclamèrent-ils la priorité de l'invention, et, la faisant remonter dans le passé, essayèrent-ils de trouver de lointains prédécesseurs à Thespis. Prétention vaine ! car une découverte n'est pas dans les éléments qui la préparent, mais dans le génie puissant ou heureux qui les assemble.
On sait, sans pouvoir s'en rendre bien compte, tant les témoignages sont, à cet égard, rares, incomplets, obscurs ! tant la difficulté, l'impossibilité de les entendre s'est accrue par les innombrables, minutieuses et quelquefois indiscrètes explications de la critique ! comment la tragédie athénienne, ou plutôt cette sorte de poème confus qui en contenait le germe et ne tarda pas à la faire éclore, prit naissance au sein même des rites dionysiaques. Les louanges du dieu étaient célébrées par des chœurs, dont la distribution naturelle ea coryphées et en choristes, qui prenaient tour à tour la parole, probablement aussi en demi-chœurs qui se répondaient, eût seule conduit à l'invention du dialogue, s'il eût été besoin de l'inventer. Dans leurs chants qui avaient déjà quelque chose de dramatique (13), mais qui n'étaient pas le drame, on intercala plus tard, soit pour varier l'intérêt de la composition par des intermèdes, soit pour ménager aux exécutants quelques moments de repos, par l'intervention de l'artiste spécialement chargé de ces intermèdes, des récits où étaient primitivement rappelées les aventures de la divinité que l'on fêtait, mais qui ne tardèrent pas à 9 leur devenir étrangers (14). Une telle innovation fut d'abord réprouvée par les vieillards et par les magistrats, comme irrespectueuse et impie; mais elle passa, à la faveur du plaisir et des suffrages de la foule. C'est à elle, chose singulière, que l'en doit véritablement la découverte de l'art dramatique et des divers genres entre lesquels il ne tarda pas à se partager, particulièrement de la tragédie. On avait déjà le dialogue : elle mit sur le chemin de l'action. Ces récits, qui coupaient, par intervalles, les chants du chœur, furent bientôt destinés à faire connaître, non plus seulement des événements passés, mais un événement que l'on supposait présent, et dont ils retraçaient les progrès. L'action, exposée au commencement par des récits, et à laquelle on n'assistait qu'en imagination, fut insensiblement amenée par l'introduction successive d'un second, d'un troisième acteur (15), sur ce qui n'était d'abord qu'une sorte de tribune, d'où leur devancier s'entretenait avec le chœur (16), et qui devint une scène. Elle se développa devant le chœur, qui la contemplait, et qui, exprimant les sentiments de peine ou de plaisir, d'admiration ou de surprise qu'elle lui inspirait, devint ainsi, par le seul fait de son origine, un témoin idéal du drame, chargé d'en recueillir l'impression et de la transmettre pure et entière aux véritables spectateurs. Le chœur avait été d'abord, dans les cérémonies du culte de Bacchus, la représentant 10 du peuple entier; il ne perdit pas ce caractère lorsque, par suite d'innovations successives, ces pompes religieuses se changèrent en un spectacle; il se trouva naturellement chargé de jouer devant le public, chez lequel il se recruta longtemps, par la voie du sort, de libres acteurs, le rôle du public même; regardant avec lui et jugeant en son nom, interrompant la marche des événements pour faire entendre les arrêts de cette morale universelle dont la voix retentissait confusément dans tous les cœurs et à laquelle il servait d'interprète : personnage vraiment singulier, placé, dans l'esprit de la composition poétique, entre le drame et l'auditoire, comme il l'était matériellement, dans la représentation, entre la scène et l'amphithéâtre; personnage dont la création appartient spécialement aux Grecs, que leur avait donné le hasard, et qu'ils conservèrent volontairement, par réflexion, et par choix, dont l'emploi ne fut pas toujours sans inconvénient, mais qui contribua puissamment à constituer la tragédie grecque, et à lui donner la forme et le caractère qui la distinguent entre toutes les tragédies connues.
Et en effet, comme le chœur ne quittait jamais la place particulière qui lui avait été assignée dans l'enceinte du théâtre, comme il ne perdait jamais l'action de vue, et qu'il y intervenait à chaque instant, les unités sévères qui la limitent sous le rapport du temps et du lieu s'établirent en quelque sorte toutes seules et nécessairement. Comment changer une scène qui ne cessait d'être occupée? Comment faire illusion sur la durée d'une pièce que l'aspect d'un acteur toujours présent permettait de mesurer avec exactitude? Une action resserrée dans des bornes si précises ne pouvait, on le conçoit, se passer de l'unité d'intérêt et de la simplicité d'intrigue, naturelles d'ailleurs à un théâtre qui avait commencé par des chants, par des récits, par le dialogue d'un chœur avec un seul personnage. Enfin, si l'on songe à la pompe, à la majesté qui résultaient du spectacle de tant de témoins groupés sur le devant de la scène ; si l'on songe à la grandeur 11 morale et poétique dont leurs chants entouraient l'action, on aura une idée à peu près complète de l'influence exercée sur le développement de la tragédie grecque par l'emploi presque forcé de ce chœur qui en avait été l'origine (17).
Ainsi se formait la tragédie sous l'empire des circonstances qui accompagnèrent son établissement. Celle unité, cette simplicité, cette grandeur qui en caractérisent la forme, étaient tout à fait d'accord avec la nature des sujets qu'elle fut, dès le principe, appelée à traiter. Née au milieu des cérémonies de la religion, faisant pour ainsi dire partie du culte public, elle dut se consacrer d'abord à exposer aux regards les aventures des dieux. Bientôt les hommes, qui, selon les traditions mythologiques, s'étaient trouvés, aux premiers jours du monde, dans un commerce fréquent et familier avec les habitants du ciel, s'introduisirent à leur tour sur la scène. Ils ne tardèrent pas à en devenir, par suite de ce vif intérêt qui nous attache à la peinture de nos semblables, les principaux personnages. Cependant les dieux ne disparurent pas entièrement de ces drames qu'ils avaient autrefois remplis seuls; et quand ils cessèrent, ou à peu près, de s'y montrer, leur volonté toute-puissante y joua longtemps le principal rôle, et y resta le plus puissant mobile, le ressort le plus actif de l'action : elle s'expliquait par des pressentiments sinistres, des songes effrayant?, des présages, des oracles; et la grande image de la fatalité, toujours rappelée à l'esprit des spectateurs, toujours présente, toujours visible, semblait former le fond de ce tableau lugubre sur le devant duquel paraissaient les passions humaines, libres et esclaves tout ensemble, marchant vers le but que leur avait marqué d'avance l'immuable destinée, mais y marchant d'elles-mêmes, et conservant, lors même qu'elles pliaient sous la main de la 12 nécessité, cette volonté indépendante, le plus noble attribut de notre nature (18).
L'idée de la lutte que l'homme soutient contre le sort, sans cesse exprimée, dans le drame, ramenait à l'unité la variété des situations, et imprimait à l'ensemble une sorte de grandeur triste et imposante. Quoi de plus propre à toucher et à élever les âmes que ce sublime et pathétique contraste de l'inévitable destinée et de la liberté morale, de notre faiblesse et de notre force? Quelles graves leçons devaient sortir de ces spectacles qui réveillaient dans les âmes le sentiment confus d'une puissance supérieure à l'homme, souvent ennemie, et quelquefois protectrice; qui les fortifiaient contre les grands accidents de l'humanité ; qui les portaient à la pitié et au respect pour le malheur !
La tragédie se montrait digne de cette origine qui avait placé son berceau au milieu des pratiques religieuses du culte des dieux, qui l'avait marquée dès sa naissance d'un caractère sacré; elle méritait de rester associée à ces fêtes qui rassemblaient autour des autels la nation tout entière; elle-même était une fête donnée aux citoyens par leurs magistrats dans des jours solennels (19), fête instituée par la religion et adoptée par la po- 13 litique des législateurs, qui firent de ces représentations une sorte d'instrument moral de gouvernement. Ce peuple léger qu'abattait l'infortune, qu'enivrait la prospérité, venait prendre au théâtre, en contemplant les calamités des rois et des empires, et le tableau touchant et terrible des grands revers, des leçons de constance et d'humanité : de telles leçons convenaient dans un siècle aussi plein de révolutions et de catastrophes, que celui des guerres médiques et de la guerre du Péloponnèse; et il était digne de les entendre, le peuple qui, seul chez les Grecs, avait élevé un autel à la Pitié (20). En même temps l'amour du pays, le sentiment de l'orgueil national, l'attachement aux lois et à la cité, s'exaltaient dans les âmes, quand on entendait rappeler ces noms antiques et vénérables qui réveillaient les plus chers souvenirs de la patrie.
Des représentations dont l'objet était tout ensemble politique, moral, religieux; où l'on évoquait, pour ainsi dire, au milieu des cérémonies du culte et à la vue du peuple entier, les images des héros et des dieux, et avec elles les émotions les plus vives, les plus graves enseignements, de telles représentations appelaient nécessairement toute la pompe, toute la magnificence du spectacle; elles devaient séduire les sens en même temps qu'elles ébranlaient l'imagination, qu'elles touchaient et élevaient l'âme. A la puissance de la poésie vint s'unir celle de tous les autres arts : l'architecture construisit 14 ces immenses édifices où se pressait une innombrable multitude; la statuaire et la peinture décorèrent la scène tragique; la musique régla les mouvements cadencés, les évolutions régulières du chœur, et prêta son harmonie à la mélodie des vers ; tout conspira pour produire le plaisir dramatique, qui pénétra jusqu'au cœur par tous les sens à la fois.
La nécessité de s'adresser, en même temps, dans de si grands théâtres à de si nombreux spectateurs, amena l'emploi de divers moyens matériels qui permettaient de reconnaître et d'entendre facilement des acteurs placés à une si grande distance des yeux et des oreilles. De là tous ces usages si étrangers à l'art moderne et qu'il faut se garder de condamner légèrement; ces masques qui reproduisaient les traits généralement attribués aux personnages mythologiques, et qui les annonçaient avant qu'on les eût nommés; ces procédés ingénieux qui avaient pour but de grossir la voix de l'acteur et de la porter au loin ; ces cothurnes, ces amples vêtements, ces robes longues et flottantes qui lui donnaient les proportions réclamées par le besoin de la perspective théâtrale, par le grandiose de la composition poétique, et sous lesquelles l'imagination se figurait les héros qu'il représentait (21). On peut croire que chez un peuple si amoureux du beau, qui l'exprimait avec tant de génie et de goût dans tous les arts à la fois, jamais ces moyens d'imitation ne furent portés, dans la tragédie du moins, jusqu'à cette exagération monstrueuse et grotesque dont quelques modernes, après certains anciens, il est vrai, après Lu- 15 cien, qui s'égaye souvent à ce sujet (22), après Philostrate (23), se sont plu à tracer des tableaux de fantaisie. Sans doute ces personnages héroïques qui se montraient sur la scène n'offraient point un contraste trop choquant avec les belles représentations de la nature que produisait dans le même temps le ciseau des artistes grecs : tout porte à penser, au contraire, qu'ils les rappelaient par la grâce et la noblesse de leurs attitudes, de leurs mouvements, et même par ces traits empruntés que leur prêtait la statuaire, et qui, grâce à l'éloignement, semblaient perdre quelque chose de leur immobilité. Si on lit avec attention les ouvrages des tragiques grecs, on ne pourra manquer de s'apercevoir que tout y était calculé pour le plaisir des yeux : chaque scène était un groupe, un tableau, qui, en attachant les regards, s'expliquait presque de lui-même à l'esprit, sans le secours des paroles. Les poètes, par mille ressources habiles, rendaient plus prompte et plus facile à des spectateurs nombreux, éloignés, souvent distraits, l'intelligence de leurs compositions, dont le sujet, en partie par le même motif, continua d'être choisi dans les traditions fabuleuses, familières à la foule, et qu'une exposition simple et claire, une intrigue peu compliquée, faisait suivre d'ailleurs sans fatigue et sans travail.
Il y a quelque intérêt à voir ainsi se former, comme de lui-même, le système si uni, si complet de la tragédie des Grecs. Ces divers éléments de leur art tragique, produit nécessaire des circonstances toutes fortuites, toutes locales, au milieu desquelles il naît et se développe, sont rassemblés par l'industrie des poètes; ils se rapprochent, ils se confondent dans des compositions qui durent sans 16 doute offrir d'abord un mélange bien incohérent, un caractère bien indécis, mais qui ne tardèrent pas à s'ordonner, et d'où sortit enfin un ensemble régulier et harmonieux. Quand tout fut prêt pour le génie, quand au chœur primitif on eut ajouté les personnages, quand aux chants de l'ode se furent unis les récits de l'épopée, quand l'action avec son double ressort divin et humain, avec ses effets dramatiques et moraux, avec la simplicité et l'unité de son mouvement, se fut emparée de la scène, et que, marchant à sa suite, le dialogue eut commencé à restreindre et à resserrer la partie épique et lyrique de l'ouvrage, quand la représentation théâtrale se fut entourée par degrés de toutes ses séductions et de tons ses prestiges, alors un homme vint, qui, s'emparant de tous ces matériaux que des mains laborieuses avaient rassemblés et dégrossis, éleva seul le monument et mérita d'être appelé le créateur, le père de l'art dramatique (24). Cet homme, ce fut Eschyle (25), qui, la deuxième année de la Lxxe olympiade, en 499 (26), âgé d'environ vingt-cinq ans, commença au théâtre son illustre carrière.
Le nom d'Eschyle est le premier que nous écrivions dans cette histoire abstraite des progrès de la tragédie naissante. C'est le premier, en effet, qui éveille en nous quelque idée nette et distincte; ceux qui l'ont précédé ne sont que des mois auxquels nous ne pouvons rien rattacher. Eschyle a effacé d'abord de son éclat tout ce qui avait brillé avant lui; ses devanciers ont disparu au milieu de sa gloire, comme disparaîtront un jour, pour une postérité plus reculée, les devanciers du grand Corneille. A la distance où nous sommas aujourd'hui de cas premiers jours du théâtre antique, il nous semble que la tragédie est sortie tout armée du génie d'Eschyle. Il n'en est rien pourtant; ces statues immortelles qu'il nous a laissées n'ont pas été fondues d'un seul jet, par un pre- 17 mier et heureux effort de l'art; ce que nous appelons son œuvre, est l'œuvre du temps, d'une longue et patiente recherche, d'essais successifs et multipliés : mais ces essais ont péri, il en reste à peine le souvenir ; nous savons seulement qu'il y eut autrefois un Thespis, un Chérilus, un Pratinas, un Phrynichus, qui travaillèrent tour à tour à former le grand Eschyle.
Une curiosité bien naturelle s'est attachée à rechercher quelle a été la part de ces anciens poètes dans la création de la tragédie ; on n'a là-dessus que bien peu d'indices, et des indices bien obscurs. On ne sait même pas très-bien en quoi consistait la découverte qui rendit le nom de Thespis fameux dans toute l'antiquité, dont tant d'auteurs ont fait mention , par laquelle les Grecs ont marqué une des dates de leurs annales, qu'à défaut des marbres de Paros, où cette date est effacée et ne peut être rétablie que par conjecture, on rapporte avec Suidas (27) à la LXie olympiade, environ 536 ou 535 (28) ans avant cotre ère. Thespis a-t-il mérité tant de gloire, uniquement pour avoir composé à loisir ces récits, primitivement improvisés (29), dont on entremêlait les chants du chœur; pour avoir remplacé leur narrateur fortuit par une sorte d'acteur préparé à son rôle; ou bien encore, pour avoir dégagé de l'alliage étranger qui s'y mêlait, dans des représentations où figuraient des satyres avec des dieux et des héros, où se confondaient le bouffon et le sérieux, l'élément pur de la future tragédie? Ces explications (30), je l'avoue, ne ire rendent pas suffisamment compte de ce grand nom d'inventeur, décerné par l'antiquité à Thespis. Voici ce que dit à ce sujet Plutarque; je me sers pour le citer de la naïve traduction d'Amyot :
18 « Or commençait jà pour lors Thespis à mettra en avant ses tragédies, et estoit chose qui plaisoit merveilleusement au peuple pour la nouveauté, n'y ayant pas encore nombre de poëtes qui en fissent à l'envi l'un de l'autre, à qui en emporteroit le prix, comme il y a eu depuis; et Solon étant de sa nature désireux d'ouïr et d'apprendre, et en sa vieillesse cherchant à passer son temps à tous ebattements, à la musique, et à faire bonne chère plus que jamais, alla un jour voir Thespis, qui jouoit lui-même comme étoit la coutume ancienne des poëtes, et après que le jeu fut fini, il l'appela, et lui demanda s'il n'avoit point de honte de mentir ainsi en la présence de tant de monde. Thespis lui répondit qu'il n'y avoit point de mal de faire et dire telles choses, vu que ce n'étoit que par jeu. Adonc Solon, frappant bien ferme contre là. terre avec un bâton qu'il tenoit en sa main : « Mais en louant, dit-il, et approuvant de tels jeux de « mentir à son escient, nous ne nous donnerons garde que « nous les retrouverons bientôt à bon escieut dedans nos .< contrats et nos affaires mêmes (31). »
Remarquons, en passant, que le Solon de Lucien, celui que, dans un dialogue ingénieux, il fait converser avec Anacharsis sur les institutions d'Athènes, et vanter au Scythe étonné le théâtre tragique et comique comme une école publique de morale (32), s'éloigne fort du Solon plus historique de Plutarque, au temps duquel l'art de la scène commençait à peine, et qui l'accusait si sévèrement de mensonge.
Quel était ce mensonge? Celui-là même, je pense, pour lequel Platon excluait plus tard la tragédie de sa République (33), la jugeant propre à corrompre les mœurs, en amenant, par l'imitation de ce qui était trop souvent vicieux et coupable, à la chose même et les auteurs et les acteurs et les spectateurs. Ce mensonge consistait, si je 19 ne m'abuse, à se présenter sur la scène avec le nom et le masque d'un personnage étranger, à entretenir son auditoire d'un événement imaginaire comme s'il se fût agi d'un événement réel. C'était le mensonge de l'action dramatique, de l'illusion théâtrale; celui par lequel, plus tard, Gorgias définissait assez obscurément la tragédie (34) ; celui que Platon (35) reprochait, qu'Aristote (36) conseillait et enseignait, d'après Homère, aux poètes; et si Thespis fut le premier qui s'en rendit coupable, il faut certainement le regarder comme le créateur de l'art.
Quoi qu'il en soit de cette interprétation, il est impossible de ne pas conclure du renom et de la gloire obtenus par Thespis, que ce poète a été pour beaucoup dans l'invention du drame, et que si cette invention ne lui appartient pas entièrement, il l'a du moins fort perfectionnée. Nous n'avons pas ses pièces, disparues (si jamais elles ont été écrites (37)) bien avant l'époque où Horace les comprenait, pour le besoin de son vers, je crois, parmi les modèles du théâtre latin (38); qu'il ne faut pas confondre avec les ouvrages que des fraudes littéraires y substituèrent de bonne heure6; auxquelles il est bien douteux qu'appartiennent les quelques vers que l'on en cite (39) : mais nous avons les litres de plusieurs, et particulièrement d'un Penthée (40). La Chronique de Paros donnait même la date, à ce qu'on a cru légèrement (41), d'une Alceste composée par 20 ce précurseur d'Euripide. Or le choix de pareils sujets, peu conforme, pour le dire en passant, à l'assertion de Plutarque (42), que Phrynichus et Eschyle mirent les premiers sur la scène des événements malheureux ; le choix du moins de celui dont la réalité est moins contestable (43), indiquerait seul que Thespis avait déjà quelque idée de la véritable tragédie. Il ne faut pas croire trop légèrement à tout ce qu'a dit Horace (44), sur la foi de quelques scoliastes, de son tombereau, de ses acteurs mal ornés et barbouillés de lie, de cette heureuse folie qu'il promenait par les bourgs, et qu'on a représentée comme si grossière et si barbare : c'est plutôt là l'histoire de Susarion que l'histoire de Thespis. Bien que Thespis, né au bourg d'Icarie, ait peut-être amusé de ses ébauches de drame les campagnes, avant de les introduire à la ville; bien que ses succès, comme chez nous ceux des Confrères de la Passion, aient commencé par la populace, de sa nature peu exigeante en fait d'art, on devait être, auteurs et public, plus avancé du temps de ce Solon, aussi bon poêle que grand législateur; de ce Pisistrate, qui avait recueilli et rassemblé en un corps régulier les poésies d'Homère, et après que la langue poétique, créée par ce grand génie, avait été savamment maniée et pliée à tous les usages par Archiloque, par Alcée, par Sapho, par Anacréon, par tant d'autres. Des vers qu'Aristophane fait encore répéter, en haine de la poésie contemporaine, par un vieil amateur du théâtre (45), ne pouvaient être tout à fait dépourvus de beauté tragique. Il faut pourtant en convenir, la tragédie devait être encore bien à l'étroit dans des drames joués, en présence d'un chœur, par un acteur unique, 21 soit que (la chose est restée douteuse) cet acteur ne représentât qu'un seul personnage plus d'une fois ramené sur la scène, soit qu'au moyen de certains déguisements il y remplît successivement plusieurs rôles (46). Dans les deux cas, les discours qu'il débitait devant le chœur, ou qu'il lui adressait, tenaient plus du monologue que du dialogue. Pour que le dialogue prît, avec l'action elle-même, quelque développement, il fallait, ce qui se fit assez longtemps attendre, et fut dû seulement à Eschyle, l'introduction d'un second acteur.
Parmi les successeurs de Thespis et les prédécesseurs d'Eschyle, on distingue surtout Phrynichus (47), acteur puissant autant que poète habile, dont la beauté relevée par de beaux vêtements (48), dont le chant (49), dont la danse (50) même, d'une expression désordonnée et encore dithyrambique, restèrent longtemps célèbres; l'inventeur, a-t-on dit souvent, mais à tort, du tétramètre trochaïque ; l'introducteur des personnages de femmes, ajoute-t-on (51), ce qui ferait penser ou que l'Alceste attribuée à Thespis par un passage fort suspect de la chronique de Paros doit en effet lui être retirée, ou que dans cette pièce l'héroïne ne paraissait point, et que des récits faisaient seuls connaître au chœur et au public son dévouement (52). Phryni- 22 chus, qui, dans sa tragédie intitulée les Pleuroniennes, avait parlé du tison fatal à la durée duquel était attachée celle des jours de Méléagre, et que jeta au feu sa propre mère Althée, avait-il imaginé cette circonstance dramatique, ignorée d'Homère, d'Hésiode, de l'auteur de la Myniade, et où ses successeurs ont trouvé le sujet de plus d'une tragédie (53)? Pausanias, qui cite ce passage (54), s'applique à montrer le contraire, constatant ainsi l'existence d'une opinion plus favorable au génie inventif du vieux poète. Le premier, très-probablement, Phrynichus osa mettre sur la scène un sujet contemporain ; il le fit avec un succès éclatant, dont il fut très-mal payé : c'est un fait unique dans l'histoire de l'art dramatique et qu'on n'a peut- être pas assez remarqué (55). La ville de Milet venait d'être prise et traitée fort rigoureusement par Darius; les Athéniens, affligés de cet événement, en témoignaient leur douleur de mille manières. Phrynichus s'avisa de le célébrer dans une tragédie qui fit, comme on le pense bien, fondre en larmes les spectateurs. Tout allait fort bien jusque-là pour le poète; son triomphe était complet, sa gloire au comble ; il avait obtenu le plus beau de tous les suffrages, l'attendrissement universel. Mais les Athéniens s'irritèrent qu'on leur eût rappelé si vivement la mémoire de ce qu'ils regardaient, dit Hérodote, comme un malheur domestique; ils défendirent par une loi de représenter jamais l'ouvrage de Phrynichus, et le condamnèrent lui-même à une forte amende pour avoir été trop touchant, ou du moins pour l'avoir été mal à propos. C'est ainsi qu'il leur arriva, dans la suite, de punir des généraux vainqueurs , au retour d'une expédition glo- 23 rieuse. Peut-être cependant ne faudrait-il pas les blâmer entièrement de leur sévérité pour Phrynichus ; peut-être ce poète s'était-il, en effet, rendu coupable envers les lois de la morale publique, comme envers les règles du bon goût, en offensant indiscrètement, par un pathétique facile à produire, le sentiment national. Phrynichus paya sans doute un peu cher cette leçon de convenance que lui donnaient les Athéniens ; mais la leçon n'en était pas moins bonne, et il parut qu'il en avait profité, lorsque, quelques années après (56), dans sa tragédie des Phéniciennes, avant-courrière des Perses d'Eschyle, il appela au spectacle, non plus de leurs disgrâces, mais de leurs prospérités, ses ombrageux concitoyens. Un instinct délicat avertissait déjà ce peuple, né pour les arts, que l'émotion douloureuse de la pitié ne doit pas être le seul but de l'artiste; que, recherchée uniquement et par tous les moyens, elle peut être portée à un excès qui révolte la sensibilité, au lieu de la séduire et de la charmer. Ainsi le jugement populaire devançait, dans cette patrie de la poésie, le jugement même des poètes, dont l'exemple forme partout ailleurs le goût général. Le temps de la tragédie était enfin venu : les Eschyle, les Sophocle, les Euripide pouvaient paraître ; ils étaient attendus par des spectateurs capables de les comprendre.
Il est à regretter que quelqu'une des compositions de Phrynichus, de Polyphradmon (57) ou Phradmon (58), son père ou plutôt son fils, de Chérilus, de Pratinas, ses contemporains, des prédécesseurs d'Eschyle qui furent ses maîtres et devinrent bientôt ses disciples, comme notre Rotrou le devint de Corneille, ne soit pas arrivée jusqu'à nous. 24 On y suivrait avec curiosité les premiers pas de l'art qui assure sa marcha et qui cherche sa route. A défaut de monuments si anciens, on peut retrouver dans le théâtre d'Eschyle les traces à moitié effacées de cette tragédie primitive qu'il a fait disparaître. Parmi les quelques pièces qui nous sont restées de ses nombreux ouvrages, il en est, par exemple ses Suppliantes et ses Sept Chefs, qui portent sans doute comme les autres l'empreinte de ce génie hardi et vigoureux, mais où le peu d'intérêt et d'étendue de la fable, les développements excessifs de la partie lyrique, la petite place accordée au dialogue, semblent devoir reproduire assez exactement le caractère indécis de ce drame primitif dans lequel luttaient encore ensemble, comme dans une sorte de chaos, les éléments discordants de la tragédie. Mais dans ses autres pièces, incontestablement supérieures, qu'elles soient venues ou après ou avant (on dispute à ce sujet), sinon par l'élan du génie et la hauteur de l'expression poétique, du moins par l'art de la composition, dans ses Perses, dans son Prométhée, dans son Agamemnon, ses Choéphores, ses Euménides, ces éléments s'ordonnent en un tout plus harmonieux; ils y forment d'admirables modèles d'un genre qui nous est fort étranger sans doute, qui ne l'était presque pas moins à Euripide et à Sophocle, qu'Aristote toutefois, dont nous aurions mauvaise grâce, nous autres modernes, de contester en pareille matière l'autorité, reconnaissait sous le nom de tragédie simple, la distinguant ainsi de la tragédie implexe, qui lui succéda et qui est devenue la nôtre. Expliquons ces deux mots dans lesquels se résument les deux premiers âges de l'art tragique des Grecs, les deux poètes qui représentent l'un et l'autre.
Sans doute, comme toute tragédie, la tragédie d'Eschyle reposait sur un fait unique, entier, d'une certaine étendue; ce sont là les termes les plus généraux, sous lesquels tout le monde comprend, depuis qu'Aristote l'a expliqué (59), le caractère de l'action dramatique. Mais le développement 25 de ce fait indispensable n'occupait dans ses ouvrages que bien peu de place ; il n'excitait qu'à un degré très- faible le sentiment de la curiosité, qui, en général, n'a jamais été chez les Grecs l'émotion dominante des représentations théâtrales, tandis que c'est au contraire le plus vif attrait qu'offre le théâtre à l'imagination des modernes. Sophocle et Euripide ne cherchent pas comme nous à faire naître l'attente, l'inquiétude, la surprise; ils n'enchaînent pas très-fortement leurs scènes, ne donnent point à leurs drames un mouvement très-rapide; et toutefois, ils ont une marche régulière, progressive, attachante, des situations nombreuses et variées, des révolutions, des péripéties. Quant à Eschyle, il n'a rien de tout cela, ou du moins ce qu'il en a ne se rencontre dans ses ouvrages que par exception, et marque seulement le progrès insensible de l'art vers une forme nouvelle et, il est juste d'en convenir, plus parfaite. Ses drames ne sont guère qu'une sorte de cantate, dont l'introduction successive de ses rares personnages, montrés en général une fois seulement, renouvelle de temps en temps le motif épuisé (60). L'action, sans incidents, s'y réduit assez généralement à une exposition et à un dénouement : c'est-à-dire qu'il n'y a pas proprement d'action. Qu'y trouve-t-on donc? L'expression d'une seule idée, d'un seul sentiment, d'une seule situation, un développement uniforme, mais qui excite toutefois dans l'âme, par l'artifice d'une habile gradation, une émotion, un trouble toujours croissants; une pitié et surtout une terreur à chaque instant plus profondes et plus douloureuses; le sentiment d'une admiration, d'un étonnement, d'une stupeur qui vous retiennent comme immobile à la vue de ces formes majestueuses, de ces proportions gigantesques qu'il prête à la nature humaine, du sombre et imposant tableau où il exprime les grands accidents du sort. Voilà, en quelques mots, la 26 constitution et les effets de la tragédie d'Eschyle, tels que les montre l'étude attentive de ses divers ouvrages; voilà le drame qu'il avait créé, et dont il emporta le secret, drame si puissant sur l'imagination des Athéniens, qu'ils n'y renoncèrent pas entièrement, lors même que Sophocle et Euripide les eurent accoutumés à des compositions d'un intérêt plus vif et plus varié; drame que le législateur du théâtre grec, Aristote, après plusieurs générations d'artistes et de systèmes tragiques, qui avaient porté l'art au plus haut point de perfection qu'il parût alors pouvoir atteindre, ne crut pas toutefois devoir omettre dans ses classifications, et qu'il désigna sous le nom de tragédie simple, par opposition à celle où se rencontre une peinture plus vive des passions humaines, une plus grande complication d'intérêts et d'incidents, plus d'intrigue, plus de mouvement, et qu'il appelait, par cette raison, tragédie implexe.
C'est ici le lieu de rappeler une disposition dramatique dont il n'y a point de trace avant Eschyle, qui ne se retrouve guère après lui, même chez ses traducteurs et imitateurs latins, et que peut-être il faut ajouter aux nombreuses créations de ce génie inventif. On sait qu'aux concours Dionysiaques les poètes disputaient le prix avec ce que les critiques d'Alexandrie, probablement, ont appelé une Tétralogie (61), c'est-à-dire trois tragédies suivies d'un drame satyrique, qui ramenait le spectacle tragique à ce dont il s'était fort écarté, à son origine dithyrambique, qui le rattachait, par un dernier lien, à l'esprit des fêtes de Bacchus. On sait aussi que les trois tragédies, le plus souvent de sujets divers, furent quelquefois liées par la communauté, peut-être même aussi par la simple analogie du sujet, et formèrent, sous un titre général, une sorte de composition complexe, qui reçut, encore des Alexandrins (je le crois), le nom de Trilogie (62). 27 Au vide trop ordinaire des pièces suppléaient, dans le premier cas, leur nombre et leur variété; dans le second, leur ensemble. A quelle époque les concours, primitivement dithyrambiques, devinrent-ils encore dramatiques? Quand et comment s'établit-il qu'on devait concourir avec quatre pièces, détachées ou liées? Laquelle des deux manières précéda l'autre? La trilogie, j'entends et continuerai d'entendre uniquement par ce mot trois pièces à sujet commun, ne fut-elle qu'un perfectionnement temporaire apporté à l'usage plus ancien de la libre et incohérente tétralogie? ou bien amena-t-elle, comme on l'a aussi pensé (63), cet usage? On ne le sait pas, et, les savants efforts de la critique le prouvent assez, il n'est guère possible de le savoir. Ce qui est, non pas certain, mais probable, c'est qu'à Eschyle fut due encore cette idée de rassembler trois drames dont chacun avait son unité, par le lien d'une, unité plus vaste ; soit que d'autres aient, avant lui, mis à la fois sur la scène plusieurs tragédies (64), soit que le premier 28 il ait donné cet exemple, imparfaitement suivi par les poètes ses rivaux et ses successeurs auxquels il aurait semblé plus commode de multiplier, ainsi que lui, les ouvrages, que de les lier comme il avait fait (65). Les anciens (66) ont eux- mêmes désigné, par le nom, collectif à l'Orestie, son Agamemnon, ses Choéphores, ses Euménides, où, nous en 29 pouvons juger fort heureusement par nous-mêmes, se développe en trois drames, qui sont comme les actes d'un autre drame résultant de leur union, le cercle entier de la devinée d'Oreste, poussé au crime par le devoir de venger le crime, et, comme on l'a dit d'Alcméon, facto pius et sceltralus eodem (67), si coupable et si innocent tout ensemble, que ia faveur seule des dieux peut départager la justice humaine. Le nom de Lycurgie a été aussi donné par les anciens (68) à une suite de pièces qui ne nous sont connues que par les savantes et ingénieuses restitutions de la critique (69), et qui toutes se rapportaient aux divers incidents de la lutte du roi de Thrace, Lycurgue , contre l'introduction du culte de Bacchus. Une didascalie récemment publiée (70) nous apprend qu'Eschyle remporta une de ses victoires dramatiques, sur une Lycurgie, tétralogie de Polyphradmon , avec trois tragédies, Laïus, Œdipe, les Sept devant Thèbes, dont les titres seuls marquent la liaison, la connexité. Il est remarquable que les drames satyriques ajoutés, selon la coutume, aux trois trilogies n'étaient pas eux-mêmes sans rapport avec ce qui en formait le sujet général. Cela est évident pour ceux qui avaient pour titres précisément Lycurgue, le Sphinx; on peut le croire du troisième, qui, sous le titre de Protée (71), paraît avoir complété ce qui est dit obscurément dans l'Agamemnon de la disparition de Ménélas, par la peinture familière de ce qu'Homère raconte assez familièrement sur son séjour en Egypte, sur ses aventures avec il fille de Protée, et Protée lui-même (72). L'Orestie, la Lycurgie, ajoutons-y, d'après la nouvelle didascalie, la Thébaïde, les 30 seules trilogies d'Eschyle dont parlent lès anciens, ne sont pas certainement les seules qu'il ait composées. Parmi les rares pièces qui se sont conservées de son immense théâtre, il en est, comme les Suppliantes, comme le Prométhée, qui sont, nous le montrerons plus tard, des restes de trilogies. On en peut dire autant d'un nombre plus ou moins grand de ses pièces perdues (73), dont la liaison disparut, probablement de bonne heure, dans l'ordre ou plutôt le désordre des catalogues alphabétiques qu'on en rédigea, quand fut passé le temps de la trilogie, ce qui ne tarda pas. Avec Eschyle parait avoir à peu près fini ce genre de composition, dont on ne cite plus qu'un seul exemple et chez un poète de sa famille, la Pandonide de Philoclés (74), peut-être encore l'Œdipodie de Mélitus (75). Sophocle ne composa pas de trilogies, et, selon un témoignage obscur et diversement interprété (76), ou bien (c'est l'opinion adoptée le plus généralement, et cependant la moins vraisemblable) se permit et obtint de ne présenter au concours qu'une seule tragédie, ou bien en présenta trois, mais désormais sans connexion entre elles (77), comme faisaient Euripide et d'autres poètes de cette même époque, comme on continua de faire après eux (78). Les qualités nou- 31 velles que ces deux grands maîtres de l'art, nous le verrons bientôt, ajoutèrent au drame, une plus grande complication de l'intrigue, un plus riche développement des passions et des caractères chez le premier, et, chez le second, l'art de ramener à une impression unique la diversité des tableaux, remplacèrent, dans une même pièce, les effets qu'Eschyle, averti par un sentiment confus dj ce qu'il y avait d'excessif dans sa simplicité, avait demandés à la trilogie. Ces effets ne sont connus que par un seul exemple, celui de l'Orestie. Ce n'était peut-être pas assez pour établir (79) que, d'après des règles invariablement fixées, et qui, en certains cas, eussent €té bien gênantes, des trois tragédies, la première devait s'adresser surtout à l'âme, la seconde à l'oreille, la troisième aux yeux; qu'il fallait que l'une fût plus dramatique, l'autre plus lyrique, la dernière enfin plus riche de spectacle; ou bien encore (80) que, comme dans les grandes composi- 32 tions de la statuaire, où tout se groupe autour d'un point central, la pièce eu milieu était toujours la plus intéressante. L'inventeur de la trilogie, je le crois, pour ordonner ces vastes ensembles, aussi bien que leurs parties détachées, lie prenait conseil que de la diversité de ses sujets. Tout au plus peut-on soupçonner que, dans l'ouvrage final, il ménageait à ces sortes de problèmes moraux, dont la doctrine de la fatalité avait, dans les précédents, embarrassé lu conscience des spectateurs, une solution plus satisfaisante.
En attribuant à Eschyle, non pas seulement, comme la plupart des critiques, l'accidentelle beauté de quelques détails énergiques et frappants, mais une conception forte et profonde, l'unité du dessein, la proportion et l'arrangement des parties, en un mot le génie de la composition, qu'on lui a refusé si injustement, nous ne lui accordons rien que démentent ses drames, dont l'ensemble, au premier coup d'œil un peu confus, se révèle cependant par la continuité, par la progression des émotions qu'ils excitent. Ce n'est pas que nous prétendions qu'Eschyle ait eu la connaissance claire et distincte de son art; qu'il ait travaillé sur un plan systématique, suivi des procédés réguliers, des principes positifs, une théorie fixe et arrêtée. Il n'en est pas ordinairement ainsi de ces esprits inventeurs que guide vers le grand, vers le beau, vers les formes propres à les revêtir, une sorte d'instinct secret que, dans leur superstition poétique, ils appellent leur génie et leur dieu. Quel est ce dieu? Ils l'ignorent et ne peuvent le dire. Ce n'est autre chose toutefois que le sujet même qu'ils traitent, l'idée dont ils sont possédés et qu'ils s'efforcent de produire au dehors. Déposée, enfermée dans leurs œuvres, cette idée leur communique l'esprit de vie qui est en elle; elle les développe, elle les ordonne en quelque sorte par sa seule vertu. C'est un moule intérieur, sur lequel s'appliquent d'elles- mêmes, à l'insu du sublime ouvrier, ces formes merveilleuses que décrira plus tard la critique, et qu'elle proposera à l'imitation comme le type de l'art. On dirait de 33 l'âme, que Virgile place au centre du monde, animant de sa chaleur féconde ce vaste corps, circulant dans ses veines, et se manifestant enfin dans les phénomènes visibles de la vie, dans la scène variée de la nature.
Quelle est l'idée puissante, créatrice, qui vit au sein d'Eschyle, et qui, passant dans ses compositions, leur imprime ce caractère singulier de simplicité et de grandeur, que n'offre aucun autre monument de l'art tragique ?
C'est l'idée de la divinité terrible qui , dans l'opinion de ces temps reculés, présidait avec une puissance invincible à toutes les révolutions du monde, aux grands succès, aux grands revers; changeait, au gré d'un aveugle caprice ou d'une justice sévère, le désespoir en joie et les triomphes en désastres; répandait du haut de ce trône, d'où elle régnait despotiquement sur les hommes et même sur les dieux, les biens et les maux, les châtiments et les récompenses; du Destin, en un mot, expression poétique, personnification religieuse de cette irrévocable fatalité qui règne dans les choses humaines; image imparfaite, représentation confuse de cette puissance meilleure qu'accompagnent toujours la sagesse et la justice, et qu'une croyance plus digne de la divinité nous l'ait adorer sous le nom de Providence.
Voilà l'idée dominante des compositions d'Eschyle, l'idée qui les remplit et les constitue; elle obsède, elle fatigue l'imagination du poêle, qui se travaille sans cesse à l'exprimer : c'est comme un esprit malfaisant qu'il force par ses évocations de paraître sous une forme visible, avec un corps et un visage. Elle devient, tout abstraite qu'elle est, une sorte de personnage vivant et agissant, le héros de son drame, et comme son drame lui-même.
De là l'effroi et la stupeur dont on se sent saisi à une apparition si redoutable, et dont les mouvements progressifs suppléent par leur gradation à cette succession d'incidents, à ces peintures suivies de passions et de caractères, que ne connaissait point encore la tragédie.
De là l'extrême simplicité d'une fable qui n'offre jamais 34 autre chose qu'un coup subit et imprévu du sort, que le tableau rapide d'une catastrophe fatale.
De là la grandeur démesurée des personnages mis aux prises avec un tel adversaire, leur fière immobilité sous la main qui les écrase et qu'ils bravent.
De là cette pompe majestueuse, ces éclatantes images, ces figures hardies, ces pensées sublimes, ce style énergique, impétueux, d'un tour si inusité, si extraordinaire, qu'appelle naturellement un si grand, un si étrange spectacle.
Ainsi se forma, sous l'empire d'une seule idée, une tragédie dont les monuments marquent la première époque de l'art: tragédie simple, comme le dit Aristote, si on la considère dans son ordonnance; terrible, grande, et comme colossale, si on regarde au style de la composition et à ses effets; tragédie dont le système, qu'on nous permette ce mot, s'explique tout entier par les opinions religieuses des Grecs dans ces temps antiques, par leur croyance à la fatalité (81).
Mais déjà s'annonçait, au sein même de cette constitution primitive, une autre tragédie. L'action dramatique, si étroitement circonscrite, avait fait quelques pas hors du cercle qui la retenait captive, et semblait aspirer à s'ouvrir une carrière plus spacieuse. Ces ébauches de caractères, jetées d'abord à si grands traits, avec tant de vigueur et d'audace, avaient pris insensiblement une forme plus harmonieuse et plus pure. Des développements nouveaux avaient permis à la passion de se répandre, de s'épancher avec plus de liberté et de mouvement. Quelques tableaux d'une grâce ravissante, bien que rude et sauvage encore, étaient venus tempérer, par des émotions plus douces, l'horreur de représentations qui semblaient les 35 visions d'un songe; aux cris de l'épouvante, aux éclats du désespoir, se mêlaient les accents d'une plainte mélancolique et pénétrante; un dialogue vif, rapide, entraînant, plein de vie et de vérité, se faisait jour à travers les longueurs des intermèdes et du récit, la pompe solennelle de l'épopée, les transports, les écarts de l'ode et du dithyrambe; tout était prêt pour produire cette tragédie à la fois simple et variée, grande et belle, terrible et touchante, élevée et naïve, qui était encore à naître. Dans Eschyle, on pouvait apercevoir Sophocle, et ce dernier s'y voyait sans doute lorsqu'il disait, avec cette conscience de son génie qui n'avait parlé que confusément à son devancier, avec ce sentiment de l'art que lui avait donné la méditation de ses premiers essais : « Eschyle fait ce qui est bon ; mais il le fait sans le savoir (82). »
Sous sa main habile se rassemblèrent en un tout harmonieux et régulier ces éléments confus d'une tragédie encore inconnue. Mais comme une seule idée avait présidé à la conception et à l'ordonnance des compositions d'Eschyle, une seule idée détermina l'esprit et la forme des compositions de Sophocle et renouvela entièrement l'art dramatique, par une manière toute nouvelle de comprendre et de peindre le cours des choses humaines. Eschyle les avait vues particulièrement soumises à une invincible fatalité; Sophocle y aperçut davantage le jeu de nos passions et de nos facultés. A cette cause merveilleuse que le premier avait montrée avant tout dans les événements, le second substitua ces ressorts naturels que découvrent la réflexion et l'expérience à un âge plus éclairé.
Les premiers Grecs, dont la poétique ignorance per- 36 sonnifiait toutes les forces de la nature, avaient donné un caractère divin à cette force aveugle que nous nommons hasard, nécessité; ils en avaient fait le Destin, dieu suprême, dont les hommes et les dieux eux-mêmes n'étaient que les instruments ou les victimes ; qui réglait par ses obscurs et immuables décrets l'ordre entier des accidents de la vie. Le Destin régna longtemps dans la poésie et même dans l'histoire : Hérodote est en cela tout à fait conforme à Homère et à Eschyle ; comme eux, il nous montre, au-dessus des révolutions du monde, une puissance fatale qui les conduit au gré de son caprice ou de sa passion, plus rarement selon les lois de la sagesse et de la justice; comme eux, il fait du Destin l'allié ou l'ennemi de l'homme, un juge sévère, ou un rival jaloux, qui le punit autant de sa prospérité que de ses crimes; quelquefois un tyran bizarre qui se plaît à des jeux cruels, à d'étranges catastrophes, qui brise entre ses mains, ainsi que des jouets, les races royales, les peuples, les empires (83). Mais enfin cette terreur superstitieuse commença à se dissiper aux rayons de la science; et de même que les dieux qui avaient longtemps animé les éléments, et prêté un charme mythologique aux scènes de la nature, se retiraient par degrés d'un domaine usurpé, devant les découvertes de la physique, de même aussi une étude plus attentive de l'homme et du monde moral fit reculer dans un lointain mystérieux cette puissance inexplicable qui enveloppait de ses ombres les événements humains. Ils apparurent enfin, non plus comme les inévitables effets d'une cause brutale et déréglée, mais comme les conséquences de nos actes et de notre volonté. On se convainquit que si nous sommes souvent entraînés par la force irrésistible des choses, par des rencontres toutes fortuites et tout imprévues, plus souvent encore nous sommes, par nos libres déterminations, les agents de ce qui se passe 37 ici-bas, les ouvriers de notre destinée mortelle. L'homme prit dans la poésie et dans l'histoire la place qui lui appartient comme au premier, comme au seul acteur du drame où il se trouve jeté ; à la place des Hérodote on eut des Thucydide, qui expliquèrent par les combinaisons de la politique et de la guerre, par les chances hasardeuses des négociations et des combats, par les mouvements de la passion, par les calculs de l'intérêt, par l'influence des talents et des vertus, des vices et de l'ignorance, par le génie divers des hommes, des temps et des lieux, ce qu'on avait trop poétiquement mêlé d'une divine obscurité. Après les Eschyle vinrent naturellement les Sophocle, qui, sans renoncer entièrement à l'effet poétique des agents surnaturels, rendirent aux actes de l'homme l'empire de l'action dramatique, et remplacèrent l'antique ascendant de la fatalité par le ressort nouveau de la liberté morale.
En constatant cette révolution, opérée par Sophocle dans l'esprit et en même temps dans la forme de la poésie dramatique, nous sommes loin de prétendre que son prédécesseur ait entièrement effacé de ses œuvres la volonté humaine: nous n'avons pas oublié celle grande et imposante figure de Prométhée, où il a peint sous des traits si sublimes l'indomptable fermeté d'une âme que l'injustice et la rigueur du sort ne peuvent ni subjuguer ni abattre. Mais cette résistance est toute passive. L'homme n'agit point véritablement chez Eschyle, ou du moins toute son activité se borne à se soumettre, à se résigner, à succomber sans faiblesse dans la lutte inégale où il se trouve engagé, à ennoblir son inévitable chute par quelque dignité; comme ces gladiateurs de Rome, qu'une sentence, fatale aussi, condamnait à périr sous le fer d'un vainqueur, et qui, par la grâce et la majesté de leur main- lien, arrachaient, en tombant sur l'arène, les applaudissements des spectateurs féroces, dont ils n'avaient pu émouvoir la pitié.
Quelquefois les personnages d'Eschyle se laissent emporter à des actes d'une cruauté forcenée , sans qu'on 38 puisse voir bien clairement s'ils obéissent à la violence de leurs passions ou à l'impérieuse volonté du Destin. Quoi qu'il en soit, leur liberté morale semble enchaînée : son Oreste, sa Clytemnestre se disent eux-mêmes poussés vers le crime par une main invisible et toute-puissante. On croirait que, comme au Macbeth de Shakespeare, un poignard fantastique leur apparaît dans la nuit et les guide vers leur victime. Écoutez comme parle Etéocle, lorsqu'il court au fratricide ; en vain on cherche à l'arrêter : « Sa place est marquée, dit-il; les imprécations d'un père le poursuivent;... les dieux précipitent l'événement fatal;... le vent de leur colère se lève et pousse sur les flots du Cocyte la race de Laïus (84) — » Quel terrible et sombre langage ! quelle superstitieuse fureur ! Se croit-il en effet irrévocablement destiné au forfait qu'il va commettre ! ou bien prend-il pour un arrêt du destin la féroce inspiration de sa haine t Le poète nous abandonne à ce doute et nous offre ainsi l'effrayante et admirable peinture d'un temps de barbarie, où, dans l'enfance du sentiment moral, la volonté asservie à d'atroces penchants se reniait elle-même pour échapper aux remords, et par un affreux sophisme chargeait de ses détestables œuvres les dieux de sang qu'elle avait créés (85).
Les drames de Sophocle, quoiqu'ils nous reportent également à celte époque reculée, nous présentent une image plus pure et plus noble de l'homme: il y paraît plus dégagé des liens d'une sensibilité brutale ou d'un ignorant fanatisme ; au milieu des passions violentes qui le sollicitent et l'entraînent, des croyances monstrueuses qui le 39 préoccupent et l'égarent, il conserve toutefois la conscience de sa liberté ; il sent qu'il est l'arbitre de ses déterminations, que ses actes lui appartiennent. Sans doute il est au pouvoir du sort de le rendre malheureux; mais c'est là que s'arrête pour lui l'empire de la fatalité : elle est sans force sur les mouvements de sa volonté, et ne peut malgré lui les tourner à la vertu ou au crime. Le destin a conduit Œdipe par une voie mystérieuse à d'exécrables forfaits; Œdipe toutefois est pur des horreurs dont il s'est souillé. Si, dans le premier égarement qui suit la révélation de son sort, épouvanté de lui-même, il s'accable des noms les plus odieux, et se punit des plus cruels châtiments, bientôt il se rend plus de justice, et cet incestueux, ce parricide, lève vers la ciel un front serein et des mains innocentes, il s'assied sans effroi au seuil du temple des Furies. C'est sous cette image poétique qu'avec l'heureux génie de la Grèce, Sophocle exprime la réclamation de la liberté morale contre ces lois tyranniques du sort qui prétendaient l'asservir : réclamation que bientôt Aristole doit renouveler, et dans sa Morale, où il refusera d'admettre qu'Alcméon puisse renvoyer au destin la responsabilité de son parricide (86), et implicitement dans sa Poétique, où il omettra le ressort apparemment usé et abandonné de la fatalité. Il est bien vrai qu'une volonté suprême préside toujours aux événements que retrace le drame ; mais cette merveilleuse influence n'est plus que le cadre, ou, si l'on veut, le fond du tableau : au premier plan se montre l'homme avec ses passions, son caractère, sa volonté, marchant librement dans cette carrière que le destin lui a ouverte et dont il a marqué le terme fatal. Si dans ce mélange de servitude et d'indépendance qui naît d'accidents inévitables et d'actes spontanés, il reste encore pour l'esprit quelque chose de confus, d'obscur, d'inexplicable, on y reconnaît bientôt l'éternelle et insoluble énigme de notre nature, l'accord 40 mystérieux de la liberté humaine et de la prescience divine (87).
Il n'est personne qui n'aperçoive les conséquences nécessaires du rôle agissant que l'homme commence à jouer dans les drames de Sophocle. De là devait sortir la tragédie implexe tout entière, avec ses développements, ses oppositions de caractères; avec la variété et l'enchaînement de ses situations, de ses incidents, de ses péripéties; avec l'artifice plus difficile et plus habile de son ordonnance ; avec l'attrait nouveau, quoique faible encore, qu'elle offrait à la curiosité; avec ces impressions de terreur, de pitié, d'admiration que produisait la peinture ennoblie, mais toujours vraie, du malheur et de l'héroïsme humains.
Alors s'ouvrit un spectacle dont l'imagination peut à peine aujourd'hui se figurer les effets ravissants: les yeux étaient occupés par une succession de tableaux, ou touchants ou terribles, qu'embellissaient constamment la grâce et la noblesse des attitudes et des mouvements; une versification d'un rythme varié, dont une déclamation variée comme elle, un accompagnement musical marquaient encore l'harmonie, enchantait les oreilles ; l'âme était émue par des discours qui, s'élevant au sublime et descendant avec aisance au familier, se prêtaient à l'expression forte et naïve de toutes les affections ; sous ces formes extérieures se produisait la peinture des caractères dont les traits individuels, énergiquement marqués, ressortaient au milieu des traits plus généraux de la nature humaine; cependant l'esprit était doucement atta- 41 ché au développement vrai, simple et calme d'une fable construite avec art, et dans laquelle chaque partie concourait à la perfection de l'ensemble.
Voilà le drame de Sophocle tel qu'il apparut aux spectateurs athéniens encore troublés des gigantesques et effrayantes conceptions d'Eschyle. Enfin se dissipa celle horreur profonde qui n'avait cessé d'envelopper la scène tragique. Un jour plus pur, quoique triste encore, sembla y descendre et éclairer cette noble figure de l'homme, que Sophocle parait de tant de dignité, de tant de grâce, et dont, par tous les moyens de son art, toutes les ressources de son génie, il s'efforçait d'exprimer l'idéale beauté. C'est ainsi qu'après une tempête qui a couvert de ténèbres la face de la terre, on voit renaître aux rayons encore voilés du soleil l'aspect riant de la nature; qu'avec un ravissement mêlé d'un reste d'effroi, on aime à jouir du tableau mélancolique de la sérénité renaissante.
Ce fut une grande journée dans l'histoire de la tragédie grecque que celle où les deux systèmes se disputèrent, pour la première fois, l'empire de la scène. Le public se partageant d'avance entre leurs représentants, des brigues animées se formant de toutes parts pour soutenir la gloire vieillissante d'Eschyle, ou l'audacieux début du jeune Sophocle, l'archonte Aphepsion hésitait à tirer au sort, selon l'usage, les juges de la lutte (88). Dans ce moment monta 42 sur le théâtre, pour y faire des libations à l'autel de Bacchus, avec les neuf autres généraux de la république , Cimon, qui venait de conquérir l'île de Scyros, et d'en rapporter les os de Thésée. L'archonte, leur sacrifice offert, les retint pour remplir l'office de juges, et ce fut par cet imposant tribunal, dont la présence redoubla l'émulation des acteurs, que fut prononcé en faveur de Sophocle un jugement dont il importe de consigner ici la date; car c'est celle, non pas seulement de la victoire d'un nouveau poêle tragique, mais de l'avènement d'une nouvelle tragédie. Cette date, qui nous est donnée par l'intéressant récit de Plutarque (89), c'est la première année de la Lxxviiie olympiade, la 468e avant notre ère (90).
L'art tragique, tel que le concevaient les Grecs, était parvenu, sous l'influence des opinions générales et du génie particulier de deux poètes, au plus haut point de grandeur et de beauté qu'il lui fut donné d'atteindre. Il ne pouvait s'y arrêter longtemps, et, au risque d'en descendre, il devait, par celte loi de l'esprit humain qui ne lui permet point le repos, s'engager dans des voies nouvelles.
43 Sans doute plusieurs des tragédies dans lesquelles le génie d'Euripide lutta avec succès contra celui de Sophocle, participent à cette perfection où l'art se complut un instant, et lâcha quelquefois de revenir. Ainsi, par la variété et l'heureuse opposition des caractères ; par le développement simple , régulier et tout ensemble savant et riche de l'intrigue; par l'expression naïve et vraie du sentiment et de la passion ; par le choix exquis des détails et la disposition achevée de l'ensemble ; par cette élévation morale, cette majesté religieuse qui dominent le drame, qui l'enveloppent, et où se rassemblent, se confondent, se perdent, comme dans leur unité, ses impressions les plus diverses; par tous ces mérites enfin, et par ceux que j'oublie, l'Iphigénie en Aulide (91), une des dernières productions d'Euripide, un de ses ouvrages posthumes, semble tout à fait contemporaine des chefs-d'œuvre dé Sophocle. Mais cet exemple est presque unique; et dans les pièces assez nombreuses qui nous sont restées du théâtre d'Euripide, il en est bien peu où l'on n'aperçoive la double trace de la décadence et du renouvellement de l'art. C'est même un spectacle curieux que de le voir, dans certains ouvrages d'un mérite indécis et partiel, perdre ses attributs primitifs, et en rechercher d'encore inconnus; se décomposer, se dissoudre et produire dans sa ruine des combinaisons imprévues, des genres qu'on ne soupçonnait point : comme ces empires longtemps et laborieusement accrus, qui se démembrent par l'excès des conquêtes, et forment avec leurs débris de nouveaux États.
Lorsque l'on compare Euripide à ses devanciers, on est d'abord frappé d'un grand changement : l'antique merveilleux au sein duquel la tragédie avait pris naissance, et qui, après avoir couvert de ses ombres la scène d'Eschyle, s'était par degrés éclairci, pour y laisser paraître les idéales figures de Sophocle, s'est tout à fait 44 dissipé. Cette progression était inévitable (92); elle suivait le mouvement des esprits vers les spéculations philosophiques. Le disciple d'Anaxagore, l'ami de Socrate, qui, professant leur religion, avait, en plein théâtre, refusé de reconnaître pour dieux des êtres souillés d'actions honteuses (93); qui, comme autrefois les Perses ruinant les temples grecs, avait demandé « quelle maison bâtie de la main de l'homme pouvait enfermer dans l'enceinte de ses murailles la nature divine (94); » dont la divinité, éloquemment adorée dans ses vers, « voit tout et n'est point vue (95), » existe par elle-même, a formé l'assemblage de tout ce qu'enveloppe le tourbillon du ciel, est comme revêtue des rayons de la lumière et des voiles de la nuit; « tandis qu'autour d'elle court éternellement l'innombrable chœur des astres (96); » qui dit à cette divinité, ainsi conçue : « A toi, maître souverain, j'apporte mes libations, mes offrandes, sous quelque nom que tu préfères être invoqué, Jupiter ou Pluton.... C'est toi qui parmi les dieux du ciel tiens le sceptre de Jupiter; toi qui gouvernes le royaume terrestre de Pluton: envoie ta lumière à l'âme des mortels qui veulent, avant la lutte, apprendre d'où leur vient le mal, quelle en est la racine, et qui parmi les Immortels ils doivent fléchir par des sacrifices, pour trouver le terme de leurs souffrances (97): » un tel poète, avec ces idées sur 45 l'unité, la spiritualité de Dieu, sa puissance créatrice, sa providence, avec ce langage dont on conçoit qu'aient dû s'étonner, se prévaloir les docteurs chrétiens, ne pouvait prendre eu sérieux (98) les puissances surnaturelles qui avaient jusqu'alors régné sur le drame, et que des traditions, encore respectées, ne lui permettaient pas d'en bannir. Par déférence pour la coutume et pour l'ordre public, il montrait encore aux spectateurs leurs simulacres consacrés ; il les prodiguait même plus qu'où n'avait encore fait ; mais la divinité n'y était plus, et la présence de ces froides idoles ne pouvait produire cette sainte horreur que leur idée seule excitait autrefois. Qu'est-ce, en effet, le plus souvent, que les dieux d'Euripide? un personnage de prologue, une machine de dénouement. Cet office les ravale presque au niveau de ces subalternes du théâtre qui lèvent et baissent le rideau. En vain l'on nous dit, l'on nous répète que leur volonté préside à l'action et la mène à son gré ; nous voyons trop qu'il n'en est rien, et que cette merveilleuse influence est ajoutée après coup à des accidents tout fortuits. La foule peut s'y tromper et se payer de ce mensonge littéraire , de ce politique ménagement; mais de plus habiles, pénétrant la pensée du poète, ne prendront sa mythologie que pour ce qu'il la prend lui-même, pour un cadre convenu, pour une forme commode, tout au plus pour un symbole scientifique, une allégorie morale ; ce sera pour eux comme le souvenir d'Esculape à la dernière scène du Phédon.
Qu'Euripide ait fait du merveilleux un tel usage; qu'il lui ait donné un sens pour le vulgaire ignorant, et un autre pour quelques spectateurs choisis ; qu'il ait de cette sorte voulu concilier le devoir du poste chargé de concourir par son œuvre à une solennité religieuse, et la conscience du philosophe désabusé des vieilles croyances, c'est ce qui a été remarqué, même dans l'antiquité (99), c'est ce que ne permettent pas de nier, et de nombreux 46 passages de ses tragédies, même de celles où il a voulu faire profession d'orthodoxie, ses Bacchantes (100) par exemple, et quelques anecdotes de sa vie, souvent citées parles critiques. Le peuple d'Athènes, si indulgent pour les irrévérences d'Aristophane (101), s'offensa plus d'une fois des libertés d'Euripide. Ce qui, dans la comédie, cette vengeance de l'égalité démocratique contre toutes les supériorités, y compris celle des dieux, ne lui avait paru qu'un badinage innocent, l'affecta tout autrement dans la tragédie, où il n'entendait pas qu'on plaisantât des choses sérieuses. Euripide s'étant hasardé à faire proférer par son Bellérophon des discours qui semblaient à la fois immoraux et blasphématoires, une grande clameur s'éleva dans tout le théâtre, et on se mettait en devoir de lapider les acteurs, lorsque l'auteur se jeta tout à coup sur la scène, en s'écriant : « Attendez, attendez seulement, il le payera bien à la fin (102). » II lui fallut défendre à peu près de même, contre le mécontentement des spectateurs, l'impiété de son Ixion : « Je ne lui ai pas, dit-il, laissé quitter la scène, que je ne l'eusse attaché à sa roue (103). » Une autre fois il eut à changer le premier vers de sa Ménolippe (104), que l'on trouva, sans doute à la répétition de l'ouvrage (105), peu respectueux pour Jupiter. Eschyle avait avant lui encouru, à moins juste titre, l'indignation du dévot peuple d'Athènes. Soupçonné d'avoir dans quelques-unes de ses pièces, dans ses Prêtresses, ses Chasseresses, Τοξότιδες, son Sisyphe, son Œdipe, son Iphigénie, révélé les secrets des mystères, il s'était vu un jour réduit à chercher un asile sur le théâtre même, près de l'autel de Bacchus. Réclamé par l'aréopage, il n'eût point échappé à une condamnation, s'il n'eût prouvé qu'il n'était point initié, ou 47 si, selon d'autres récits, ses juges ne se fussent souvenus qu'il avait reçu d'honorables blessures dans cette marne bataille de Marathon, où son frère Cynégire avait si héroïquement péri ; si son autre frère Aminias ne fût venu produire pour sa défense le bras qu'avait mutilé le fer des Perses à Salamine (106). Nous ne sommes pas, nous autres modernes, aussi faciles à scandaliser sur ce sujet que les Athéniens, et nous n'avons pas les mêmes raisons pour prendre contre Euripide la défense de leurs dieux : ces dieux toutefois étaient ceux de la tragédie, et au nom de la religion de l'art il nous est peut-être permis de réclamer contre le rôle insignifiant, équivoque, même dérisoire qu'il leur a donné, supprimant ainsi, avec cette puissance fatale, jusque-là l'âme du drame, l'unité qu'elle imprimait à sa marche et la sombre majesté dont elle l'entourait.
Est-ce donc à dire qu'Euripide ait complètement effacé de ses œuvres la fatalité ? Non sans doute, et, pour être juste, il faut se hâter d'ajouter qu'il l'a plutôt déplacée. Eschyle et Sophocle avaient peint les dieux précipitant les mortels dans des malheurs inévitables; Euripide les montra qui leur envoyaient d'invincibles passions. Auparavant, le personnage tragique était mis aux prises avec les obstacles du dehors; il eut désormais à combattre des ennemis intérieurs : c'est dans le cœur même de l'homme que fut transportée la lutte dramatique; les acteurs furent nos facultés elles-mêmes, et le sujet de la pièce cette guerre intestine de la sensibilité et de la raison, aussi ancienne que notre nature, el qui ne finira qu'avec elle.
Ces peintures, qui sont le trait saillant des ouvrages d'Euripide, qui le distinguent de ce qui avait précédé, et lui assurent la gloire d'un génie créateur, ont, je ne sais trop pourquoi, embarrassé les critiques. Ils n'ont pas vu que la liberté morale y est suffisamment attestée, même 48 par une résistance impuissante ; ils n'ont pas vu que le poêle, en attribuant aux dieux ces entreprises sur la volonté humaine, avait seulement, avec ses imparfaites idées de la divinité, personnifié sous une forme sensible un phénomène intellectuel. Enfin, il leur a échappé que cette nouveauté hardie avait ouvert la roule à l'art des modernes; qu'une Médée, emportée par la jalousie à des parricides qu'elle déteste, une Phèdre, malgré soi perfide, incestueuse, leur avaient révélé le secret de ces admirables développements, où, par l'artifice des situations, par les crises décisives dans lesquelles elle est successivement jetée, la passion se dévoile tout entière; où du combat qu'elle livre au devoir naissent les émotions les plus vives ou les plus nobles, selon qu'elle succombe ou qu'elle triomphe.
De ces deux sortes d'émotions que chez nous se sont partagées Racine et Corneille, Euripide préféra les premières, qui convenaient sans doute davantage à son génie plus pathétique qu'élevé. Il se plut à représenter l'âme abandonnée, presque sans défense, à d'insurmontables penchants, les séductions du désir, le trouble des sens, la défaillance de la volonté, l'ivresse douloureuse de la passion, le remords, le désespoir. Non-seulement sa muse ne recula pas devant ces peintures qu'Aristophane lui a peut-être trop sévèrement reprochées (107), des égarements d'une Phèdre, d'une Sthénobée, d'une Macarée; il ne craignit point d'exprimer, dans son Chrysippe, le honteux amour dont, selon lui, Laïus avait donné le premier exemple (108). Nul enfin ne produisit sur la scène, avec 49 des traits plus vifs et plus pénétrants, la déplorable et effrayante image de la raison abattue, détruite par le malheur (109) : il fut le peintre de la faiblesse humaine, comme avant lui Eschyle et Sophocle l'avaient été de l'héroïsme.
Ce n'est pas qu'à leur exemple il n'ait quelquefois ennobli l'accent de la plainte par le mélange de la dignité et du courage. On peut même dire que jamais il ne s'est montré plus véritablement pathétique que lorsqu'il a pris soin, comme eux, de tempérer l'attendrissement par l'admiration. Cette Iphigénie, celle Polyxène (110), cette Macarie (111), qui, dans la fleur de la jeunesse et de la beauté, se dévouent avec une si pénible constance ou un si généreux entraînement, à un trépas prématuré; cette Évadné (112), qui se précipite dans le bûcher de son époux, à qui elle ne veut pas survivre; cette Alceste, qui, pour sauver les jours du sien, s'arrache volontairement à toutes les joies de la vie; cette Andromaque, qui se livre pour racheter son jeune fils; cette Electre (113), qui oublie ses propres maux pour veiller, avec la tendresse inquiète d'une mère, au chevet d'un frère souffrant et malheureux : voilà des tableaux aussi nobles qu'ils sont touchants. On ne saurait s'y arrêter sans qu'avec les larmes amères que fait répandre l'aspect du malheur, ne se confondent aussitôt ces larmes plus douces qu'on ne peut retenir devant les représentations du beau moral.
Les impressions que laissent dans l'âme les tragédies d'Euripide ne sont pas toujours aussi pures; plus souvent il la tourmente et la torture par l'insupportable excès des misères et des lamentations. La prétention d'émouvoir se trahit même chez lui par l'emploi facile et vulgaire de moyens tout matériels : ce sont des vieillards, arrivés au dernier terme de la décrépitude, qui se trament avec peine sur la scène et semblent tout près d'exhaler leur vie avec leurs sanglots; ce sont des malheureux livrés aux 50 angoisses du besoin, aux souffrances de la maladie, aux vertiges du délire; ce sont des héros qui croiraient manquer à leur infortune, s'ils ne se présentaient couverts de haillons et de sales lambeaux !
Ce pathétique grossier qui s'adresse aux sens plus qu'à l'esprit, et qui, pour être d'un succès assuré au théâtre!, n'en est pas plus digne de l'art, fut souvent tourné en ridicule par Aristophane avec son ingénieuse bouffonnerie. Ainsi, dans ses Acharniens, il introduit un pauvre homme, accusé devant le peuple, et qui, cherchant les moyens de toucher son juge, imagine d'aller trouver le peintre des douleurs de Télèphe, et de lui emprunter quelque pièce bien déchirée, bien lamentable de cette friperie dramatique tant de fois reproduite aux yeux des Athéniens, et qui n'a pas encore lassé leur sensibilité.
Euripide a rencontré de plus graves, de plus sévères censeurs : c'est à lui probablement que s'en prend Platon, c'est à lui qu'eut dû s'en prendre Cicéron, lorsque, bien différents d'Aristote, qui trouve le héros tragique digne d'indulgence quand il succombe à la douleur en lui résistant (114), ils reprochent à la tragédie d'amollir, d'énerver les courages par la continuelle peinture de héros qui souffrent et se plaignent (115). Eschyle et Sophocle avaient aussi étalé sur la scène de grandes infortunes, de grandes douleurs; mais c'était pour faire ressortir, par le contraste, l'image d'une constance au-dessus des accidents du sort. Le pathétique n'avait été que leur point de départ; il devint pour Euripide le but même. Ici se découvre dans toute son étendue la révolution que le génie divers des poètes, le goût changeant des spectateurs, ou plutôt celle marche fatale qui préside au développement des arts, amenèrent alors dans la tragédie. Lorsque, après avoir travaillé à élever les âmes, elle ne se proposa plus que de les remuer, de les attendrir, on vit bientôt succéder dans ses œuvres, à la grandeur impo- 51 sante des proportions, à l'idéale beauté des formes, la vivacité de l'expression : au lieu des nobles images de l'humanité agrandie, on eut la copie fidèle de la réalité : les demi-dieux, dépouillés de cet éclat fantastique qui les séparait des mortels, descendirent à leur niveau, et, par le partage de nos faiblesses comme de nos misères, se confondirent dans la foule commune ; pour emprunter l'expression du plus exact et du plus ingénieux interprète du théâtre antique (116), « ils quittèrent leur cothurne et marchèrent tout simplement sur la terre. » Sophocle, qui, dans quelques mots profonds qu'on nous a conservés, nous a laissé comme une histoire abrégée de la tragédie grecque, put dire avec vérité : « J'ai peint les hommes tels qu'ils devraient être; Euripide les peint tels qu'ils sont (117). » Lui-même aurait été dans cette voie le précurseur d'Euripide, s'il était vrai, comme on le lui fait encore dire (118), qu'après s'être d'abord amusé, en jeune homme, à reproduire la pompe et l'élévation d'Eschyle, après s'être ensuite appliqué à l'artifice de la composition, il eût fini par rechercher surtout, dans des ouvrages d'une troisième manière, la vérité des mœurs, la moralité de la peinture.
Ainsi vont les arts et l'esprit humain qui les produit. On commence par des compositions simples et gigantesques : bientôt leurs traits rudes et démesurés se règlent, s'adoucissent; elles deviennent des modèles achevés d'élévation et de pureté : enfla arrive, par un progrès inévitable, cette brillante décadence, où la grandeur et la beauté fout insensiblement place à la recherche de l'effet, à la vérité de l'imitation. Gela est naturel; cela, est nécessaire. A mesure que les intelligences s'éclairent, elles sont moins capables d'enthousiasme ; elles préfèrent à la poursuite du merveilleux et de l'idéal la 52 conquête plus prochaine et plus sûre du réel, de l'ordinaire.
Ce temps de l'expression est venu pour la poésie, comme pour la philosophie celui de l'analyse. Sans doute, dans cette Grèce où les beaux-arts étaient nés à la fois et comme d'eux-mêmes; où, soustraits à toute influence étrangère, ils se développaient ensemble par leur propre vertu et selon les lois de l'humanité ; où on les voyait marcher de front, du même pas, et se tenant par la main, ainsi que le chœur des Muses dans une peinture célèbre, il en dut être pour tous comme pour la tragédie. Le critique que je citais tout à l'heure, et que, sans le citer toujours, j'ai suivi souvent, parce que, dans un sujet qu'il a tant éclairci, il est souvent impossible de dire mieux, et difficile de dire autrement, a établi entre les divers âges de la statuaire des Grecs et ceux de leur tragédie un rapprochement qu'on ne peut omettre. Phidias, avec ses fortes et sublimes images de la divinité, lui représente Eschyle; Polyclète, par la régularité, par l'harmonie des proportions, lui semble répondre à Sophocle; enfin Lysippe et Euripide complètent ce parallèle; il lui paraît que tous deux, dans leurs imitations animées, se sont appliqués à exprimer le charme du mouvement et de la vie, plutôt que le calme pur et solennel des figures idéales.
Gloria Lysippo est animosa effingere signa (119).
Euripide, en effet, n'oublie rien pour séduire; en même temps qu'il ébranle et trouble les sens par le pathétique, il prend soin de les flatter par la naïveté et par la grâce. Souvent, aux dépens du caractère ou de la situation, il appuie à dessein sur des traits de mœurs; il peint l'âge, le sexe, le pays, la profession, plutôt que l'action et le personnage; la sujet s'efface presque sous cette brillante broderie, qui le cache en le parant.
53 Son penchant le portait visiblement vers ces peintures générales: il semble qu'Horace lui ait emprunté, autant qu'aux drames de Térence et à la Rhétorique d'Aristote, les traits sous lesquels il trace, pour servir de modèle aux poètes dramatiques, le portrait des quatre âges. Une chose fort remarquable, c'est qu'il y laisse paraître le plus souvent une intention satirique, assez étrangère à l'esprit de la tragédie, et même quelquefois contraire à l'effet particulier qu'il veut produire. Ainsi aux nobles images de la vieillesse il mêle complaisamment celles de la caducité, avec ses animosités et ses bravades, sa raison défaillante et ses longs discours. Une matière sur laquelle la verve amère et moqueuse du poète ne s'épuise pas, ce sont les défauts du sexe. Même dans ceux de ses ouvrages où il le représente sous le plus noble et le plus touchant aspect, il se montre encore, par quelques traits, comme on l'appelait, et comme l'a représenté Aristophane (120), l'ennemi des femmes (121). On a cru que des chagrins domestiques l'avaient aigri contre elles (122). Il est certain que ces invectives décèleraient à leur égard un ressentiment profond, si elles ne témoignaient encore plus, comme il est arrivé quelquefois, d'un cœur trop sensible à leur attrait (123), et qui s'indigne de sa faiblesse. Rousseau leur a dit bien des injures, pour se punir de les aimer ou plutôt pour s'en empêcher. Il en était de même d'Euripide : « Euripide, disait Sophocle, hait les femmes, mais dans ses tragédies (124). »
Cette disposition d'Euripide à saisir les caractères généraux de la nature humaine et à la prendre de préférence 54 par ses mauvais côtés, l'amenait à son insu, en dépit de la tragédie, vers un genre qui n'existait pas encore, et qui dut beaucoup à ses exemples. On peut le regarder comme le précurseur et presque comme le créateur de la comédie nouvelle, de celle qui, à la satire des personnes, substitua décidément la satire des mœurs. Ceci n'est point une conjecture : c'est Quintilien (125) qui nous apprend que Ménandre, quoique dans une carrière différente, suivit les traces d'Euripide. Diphile et Philémon, comiques de la même école, ne l'admiraient pas moins : l'un l'appelait « un poète d'or », l'autre disait ou faisait dire à un de ses personnages, peut-être à cet admirateur fanatique d'Euripide, à ce Phileuripide, souvent montré sur cette scène, et dans des pièces de ce titre (126) : « Si j'étais sûr que les morts, comme certaines gens le prétendent, eussent encore du sentiment, j'irais me pendre aussitôt, afin de voir Euripide (127).» Cet enthousiasme aune teinte d'extravagance qui peut en rendre la sincérité suspecte. Mais le fait général de l'admiration reconnaissante des poètes de la nouvelle comédie pour Euripide, leur modèle et leur maître, n'en est pas moins évident (128). Ainsi de ses fautes mêmes est sortie une inspiration féconde à laquelle se sont renouvelées la tragédie et la comédie, et qui s'est fait sentir jusqu'aux modernes. Heureuses fautes, pouvons- nous dire, auxquelles nous devons quelque chose de Racine et de Molière !
Toutes n'ont pas cette excuse, et il en est, au contraire, que nous aurions le droit de blâmer doublement, 55 puisque, altérant la beauté des compositions d'Euripide, elles ont encore servi, non pas assurément de modèle, mais du moins de prétexte et d'autorité au système antidramatique de Sénèque, et que, transmises par cette voie à notre indiscrète imitation, elles ont exercé sur les premiers développements de notre tragédie une fâcheuse influence. On comprend que je veux désigner ici cette funeste manie de discourir et de moraliser, qui porte Euripide à faire de ses personnages, quelquefois contre toute convenance (129), des philosophes et des sophistes, et, dans ses meilleures pièces, à remplacer le débat animé des passions par les formes de l'argumentation et du plaidoyer, à l'interrompre par de longues digressions oratoires (130) à partager symétriquement son dialogue, tantôt en harangues prolongées qui se suivent et se répondent, tantôt en répliques rapides et concises, où, comme dans une sorte d'escrime, la maxime pare et repousse la maxime. Sénèque, qui offre la charge de cette manière, peut servir du moins à faire comprendre combien elle est contraire à l'art. Euripide n'avait pas impunément écouté les leçons du fameux Prodicus; il n'écrivait pas impunément pour un peuple épris des luttes de la parole, et qui retrouvait volontiers sur la scène les artifices de la tribune et du barreau, les subtilités de l'école, ses orateurs, 56 ses avocats, ses sophistes. Sans doute les discours prêtés par lui à des personnages de l'âge héroïque sont quelquefois la satire de l'abus que faisaient du raisonnement et de la parole, pour corrompre les esprits, quelques-uns de ses contemporains ; mais il n'échappe pas toujours lui-même à la contagion de ce qu'il censure. Sans doute il montre, dans ces hors-d'œuvre d'éloquence et de philosophie, une grands dextérité d'esprit, un art ingénieux, et qu'il met constamment au service des plus nobles doctrines morales; il a mérité, j'en conviens, d'être appelé le Philosophe du théâtre (131), et d'y attirer parfois, soit, comme on l'a cru (132), à ce que nous appellerions les répétitions de ses pièces, soit aux représentations dans les jeux dramatiques d'Athènes et même dans ceux du Pirée (133), Socrate, qui d'ailleurs ne se souciait guère de tragédies ; Socrate, qu'on a quelquefois dit son maître, mais qui, plus jeune que lui d'environ douze ans, ne pouvait guère être que son condisciple à l'école d'Anaxagore, que son ami, et dont la malignité des poètes comiques se plaisait à faire, par des insinuations au fond fort honorables, 57 presque son collaborateur (134). J'ajoute qu'il n'a pas moins mérité que Quintilien (135) le proposât à l'étude des jeunes orateurs comme un excellent modèle de l'art de convaincre et de persuader. Ces éloges toutefois renferment une censure : ce qu'approuvent la philosophie, la dialectique et la rhétorique, la poétique du théâtre peut justement le condamner; des beautés qui ne sont point dramatiques, ne font dans le drame que des défauts; et quoi de moins dramatique que de plier aux lois du raisonnement, à la méthode oratoire, la passion de sa nature si involontaire et si libre, qu'il faut abandonner, au contraire, à sa fougue et à ses écarts?
Les moralités d'Euripide, dont un si grand nombre, au sens, au tour frappants, nous sont parvenues avec les pièces qu'elles décoraient, ou même sans elles; qui attestent une si grande connaissance de la société, de la nature humaine, une philosophie, une religion si élevées; pour lesquelles Plutarque a dit de lui, qu'il était habile à connaître les maladies du corps politique (135b); à qui il a dû l'honneur d'être déclaré, par la Pythie, plus sage que Sophocle et moins sage seulement que Socrate, le premier des hommes en sagesse (135c) ; que saint Clément d'Alexandrie, avec d'autres auteurs chrétiens, a louées plus encore, en les rapprochant du langage des Écritures, en y 58 voyant comme un pressentiment de la foi nouvelle, au sein du paganisme (135d); ces moralités, une des meilleures parts de sa gloire littéraire , alors même que la vérité dramatique n'en avoue pas l'introduction trop fréquente, ont été l'objet d'un reproche fort sérieux : on les a accusées d'être quelquefois contraires à la morale. Je crois qu'on peut les défendre et les justifier. Ce n'est pas la faute du poète si la forme sentencieuse de quelques maximes perverses leur fait attribuer un sens absolu qu'il n'a point prétendu leur donner. Où en serait-il, si on le rendait responsable des mauvais principes de ses personnages? On pourrait donc aussi lui demander compte de leurs méchantes actions. Il suffit que ces traits d'une morale condamnable dont sa sert la logique ordinaire des passions, et qu'on ne peut, par ce motif, interdire à l'imitation dramatique, soient d'ailleurs corrigés par l'esprit général de l'ouvrage. Or, c'est ce qu'on peut dire en faveur d'Euripide, et ce que lui-même eut occasion de faire valoir pour sa défense, lorsqu'un certain Hygiénon l'accusa juridiquement d'impiété (135e) pour ce vers sentencieux de son Hippolyte :
La bouche a juré, mais non pas l'âme (135f).
Cette espèce de réserve, de restriction mentale, que Pascal se fût applaudi de rencontrer dans les tragédies de collège des Jésuites, est sans doute, quoi qu'en ait dit. Cicéron (135g), d'une bien mauvaise morale. Mais Hippolyte, à qui elle échappe dans un mouvement d'impatience contre d'importunes sollicitations, se réfute lui-même, à la fin de la pièce, en mourant pour garder son serment.
59 César, au rapport de Cicéron (135h), avait sans cesse à la bouche ce passage des Phéniciennes ;
Si l'on peut violer la justice, c'est pour régner : en tout le reste, il faut être juste (135i).
« Coupable Etéocle, s'écrie Cicéron ; ou plutôt, coupable Euripide, qui excepte précisément le plus grand de tous les crimes I »
Mais n'en déplaise à l'auteur des Offices, qui fait cette exception? Est-ce Euripide ou plutôt Etéocle (135j)? Celte criminelle ambition n'est-elle pas blâmée dans tout le cours de la pièce? Ne trouve-t-elle pas, au dénouement, sa punition? Et s'il arrive au poète dramatique, qui doit et peut tout exprimer, de produire sur la scène la morale des méchants, ne poursuit-il pas sans relâche, comme Socrate, ceux qui en usent, et notamment ces orateurs sans conscience, fléaux de la place publique et du barreau, qui corrompent le peuple (135k) et pervertissent la justice (135l)?
On ne peut donc, je pense, appliquer à Euripide cette règle posée par Bayle (135m): « II est bien certain que l'auteur d'une tragédie ne doit point passer pour croire tous les sentiments qu'il étale; mais il y a des affectations qui découvrent ce qu'on doit mettre sur son compte. » Je ne trouve point chez l'auteur de l'Hippolyte et des Phéniciennes trace de ces affectations; mais je conviens aussi que W. Schlegel n'a pas tout à fait tort de dire au sujet de la citation de César : Celui qui citait une pareille 60 maxime, prouvait assez combien elle pouvait être dangereuse. » II n'est point, en effet, sans danger de prêter à une pensée coupable, par un tour sentencieux, l'apparente autorité d'une vérité générale, et de préparer ainsi des axiomes commodes aux apologies du crime.
Ces apologies ne manquent point chez Euripide, et quand la morale les absoudrait toujours, elles seraient quelquefois condamnées par la vraisemblance dramatique. Il a des personnages qui étalent assurément avec trop de complaisance et proclament avec trop d'orgueil leur bassesse et leur méchanceté. L'égoïsme et le vice ont aussi leur pudeur, et les secrets honteux du cœur n'arrivent pas si facilement sur les lèvres. Ces personnages montrent en outre une scélératesse qui n'est pas toujours nécessaire, et c'est ce qu'Aristote appelle des mœurs gratuitement mauvaises (136). Il est rare qu'on soit plus méchant qu'on n'a besoin de l'être.
Si Euripide manque trop souvent dans ses scènes aux convenances théâtrales, ce défaut devait surtout se montrer dans ses chœurs, d'une belle poésie sans doute, mais faiblement rattachés à l'action et qui lui restent même quelquefois complètement étrangers (137). Le chœur, ce fondateur de la tragédie grecque, qui en était dans l'origine l'unique acteur, qui longtemps s'était maintenu au rang des principaux personnages, qui, lors même qu'il n'agissait pas, était encore sur la scène l'interprète des pensées secrètes du poète et comme le démonstrateur de son œuvre, le chœur était bien déchu de son antique importance : ce n'était plus qu'un témoin incommode, dont la présence continuelle nuisait à la vraisemblance du drame; on l'y souffrait par habitude, comme ces fa- 61 miliers disgraciés, qu'on ne renvoie pas, mais auxquels, par un froid accueil et des manières indifférentes, on fait sentir qu'ils sont de trop.
Une chose fort ordinaire à Euripide, et que Sophocle ne se permit que fort rarement, par exemple dans son Hipponoüs (138), c'est de se servir du chœur, comme les poètes comiques dans leurs parabases, pour entretenir le public, non pas du sens caché de ses tragédies, ainsi qu'on faisait avant lui, mais de sa personne et de ses affaires. Il le chargeait familièrement de ses commissions, et cela avec si peu de mystère, qu'il lui est une fois arrivé, dit-on (139), dans sa Danaé, faisant parler une troupe de femmes, d'employer, par inadvertance, des terminaisons masculines, parce qu'en effet c'était alors lui qui parlait.
En plus d'une occasion, il ne s'est pas fait scrupule d'introduire dans ses tragédies, particulièrement, nous le verrons, dans ses Phéniciennes, dans son Electre, la satire et même la parodie de ses rivaux ; il les a aussi, comme eux, très-souvent(140) tournées à la louange de sa patrie, et mêlées d'allusions aux conjonctures présentes, mais d'une manière moins indirecte, et par là moins ingénieuse. Ses Hèraclides, ses Suppliantes, sont trop visiblement, avec des sujets fabuleux et sous des noms anciens, des tragédies de circonstance, et l'on trouve des intentions de ce genre jusque dans son Andromaque.
Des productions où se confondaient tant de desseins différents, qui se mélangeaient de politique, de critique littéraire, de morale, de philosophie, de rhétorique, ne pouvaient échapper à quelque incohérence; brillantes par les détails, elles devaient pécher par l'ensemble. Ce n'est pas que, sous le rapport de la composition, Euri- 62 pide ne mérite que des éloges : en cela, comme en tout le reste, il a cherché à innover. L'épuisement des sujets, bornés dans leur nombre, et tant de fois traités, l'y eût forcé, quand il n'y aurait pas été poussé par son génie. On voit qu'il veut sortir de la simplicité primitive : il multiplie les personnages, les incidents, les tableaux ; il cherche à éveiller la curiosité, à frapper l'imagination, à ébranler les sens; il a même inventé une sorte de fable toute nouvelle, en réunissant, comme dans son Hécube et ses Troyennes, ses Phéniciennes et son Hercule furieux, dans un même cadre et sous un même aspect, par l'unité d'un personnage principal et d'une idée dominante, plusieurs actions diverses. Mais on doit dire aussi que la répétition monotone des mêmes moyens et des mêmes effets, la disposition arbitraire, fortuite, invraisemblable , imprévoyante de l'intrigue, les prologues postiches, les dénouements à machine qui viennent à point nommé sauver l'auteur avec ses personnages, tant de défauts trop visibles et trop fréquents chez Euripide, justifient, plus qu'il ne faudrait, cet arrêt d'Aristote, « qu'il n'est pas toujours heureux dans la conduite de ses pièces (141). »
Aristote aussi l'a proclamé le plus tragique des poètes (142), et par cette expression, qu'il faut entendre dans un sens restreint, mais assez vaste encore, il a loué dignement ce pathétique admirable qui efface toutes les imperfections d'Euripide, et suffirait à sa gloire.
Son style eut naturellement les vices et les mérites de la pensée qu'il traduisait. Aristophane y a relevé, sans doute avec justice, quoique avec malignité, une mollesse trop efféminée, trop de parure et en même temps trop de négligence. Quelques modernes, très-bons juges, se sont plaints des mêmes défauts, plus peut-être que des modernes n'en ont le droit (143). Quoi qu'il en soit de ces cri- 63 tiques, on ne peut méconnaître dans sa poésie le caractère même que nous avons attribué à ses ouvrages et que nous résumons ici en deux mois, une expression touchante et noblement familière (144).
Cette poésie ravissait les Grecs; elle balançait dans leur admiration l'incontestable supériorité des tragédies de Sophocle. Le récit plaisant que fait Lucien, au début de son traité sur la manière d'écrire l'histoire, de la maladie d'Abdère, en serait tout seul une preuve. Il raconte que, sous le règne de Lysimaque, un comédien fameux de ce temps, nommé Archélaüs, joua devant les Abdéritains l'Andromède d'Euripide. La tragédie était touchante, l'acteur véhément et pathétique; de plus, on était au cœur de l'été, et il faisait grand chaud. Tout le public fut saisi, au sortir du théâtre, d'un mal violent dont le principal symptôme était des plus bizarres : ils se promenaient à grands pas, gesticulant et déclamant; toute la ville était pleine d'acteurs maigres et pâles qui s'écriaient comme Archélaüs dans la tragédie :
" Amour, tyran des hommes et des dieux ! »
leur imagination était obsédée du souvenir enchanteur d'Andromède et du fantôme ailé de Persée. Cette folie tragi-comique ne finit, dit Lucien, qu'au retour de l'hiver.
On n'est pas, en conscience, obligé d'ajouter foi à cette histoire, quoiqu'elle ait pour garant, outre l'autorité de Lucien, un récit d'Eunape , assez récemment découvert et publié en Italie (145) ; mais il nous est permis de la recueillir comme un témoignage favorable à Euripide. Cette tragédomanie, cette euripidomanie, Lucien les prête, dans d'autres ouvrages (146), au roi des dieux Jupiter, au philosophe Ménippe, à lui-même, attestant ainsi, par cet usage bouffon des vers du grand- poète, le long empire qu'il garda sur les imaginations.
Il ne manque pas, du reste, de témoignages plus sé- 64 rieux, et dans le nombre je choisis comme les plus intéressants les anecdotes suivantes rapportées par Plutarque (147).
Un vaisseau de la ville de Caunus en Carie, poursuivi par des corsaires, s'était réfugié dans un port de la Sicile. Les habitants refusèrent d'abord de le recevoir; mais, ayant demandé aux passagers s'ils savaient des vers d'Euripide, sur leur réponse affirmative , ils laissèrent entrer le vaisseau.
Quelque temps après la déroute des Athéniens en Sicile , cette déroute sur laquelle nous avons d'Euripide quelques vers élégiaques (148), des soldats de l'armée vaincue , de retour dans leur patrie, vinrent remercier le poêle de leur avoir conservé la vie et la liberté. Errants dans la campagne, sans nourriture, ou réduits en esclavage, ils avaient obtenu, les uns des secours, les autres leur affranchissement, en récitant aux passants et à leurs maîtres quelques vers des tragédies d'Euripide.
Il fut donné à ce grand poète de sauver, quelque temps après sa mort, sa patrie elle-même. Lorsque Athènes fut prise par Lysandre, on proposa dans le conseil des alliés de réduire en servitude ses habitants, de raser ses édifices, et de faire de tout le pays un lieu de pâturage pour les troupeaux. Ce conseil fut suivi d'un festin où se trouvèrent tous les généraux : or il arriva qu'un musicien de Phocée, qui y fut appelé, y fit entendre, soit par hasard, soit à dessein, quelques vers où Euripide avait retracé l'abaissement à Electre, réduite par Égisthe à la condition des esclaves et précipitée d'un palais dans une chaumière (149). Les convives, émus par cette peinture touchante du malheur, par son rapport frappant avec l'humiliation d Athènes, enfin par la gloire de cette ville qui avait produit de si beaux ouvrages et de si grands hommes et qu'ils allaient détruire, renoncèrent à user si cruellement du droit de la victoire (150).
65 Ainsi, dans celle contrée toute poétique, dont les fabuleux législateurs avaient bâti les premières villes au son de la lyre, et les avaient policées par des chansons, où l'historique Solon avait parlé en vers sur la place publique (151), la poésie se mêlait aux intérêts les plus sérieux de la vie et s'asseyait dans les conseils mêmes de la politique et de la guerre. La poésie d'Euripide n'était point belliqueuse comme celle d'Eschyle; elle ne remplissait pas les âmes de la fureur de Mars, selon l'expression d'Aristophane (152); elle ne servit de rien aux conquêtes et à la défense d'Athènes : mais si, par une douceur mélancolique, elle désarma ses farouches vainqueurs et la préserva de l'asservissement et de la ruine, jamais poésie fut-elle couronnée d'une gloire pareille ?
Peu de temps avant, deux tombeaux avaient été successivement élevés : le premier à Euripide, dans la Macédoine, où il était allé mourir, par le roi Archélaüs, protecteur de ses derniers jours, et qui, refusant ses restes aux instances du peuple athénien, le condamnant, par ce refus, à ne les honorer que d'un cénotaphe, que des regrets , des protestations d'une inscription funèbre, les avait lui-même fait ensevelir dans un magnifique monument (153); le second à Sophocle, sur la terre de sa patrie, qu'il ne lui avait pas fallu, comme à Euripide, comme à Eschyle, abandonner; dans le bourg de Décélie, où reposaient ses pères et où Lysandre, qui l'occupait et s'y était fortifié, averti dans un songe par Bacchus lui-même, dit la légende du poète, avait laissé paisiblement transporter sa dépouille (154). Ces deux tombeaux, objets de si 66 éclatants hommages de la part d'étrangers et même d'ennemis, étaient ou du moins sont pour nous, avec un autre plus ancien que notre souvenir leur associe, avec celui qu'avaient élevé, en Sicile, les habitants de Gela à Eschyle, comme les tombeaux mêmes de la tragédie grecque. Trois hommes nous la représentent en effet tout entière, trois hommes seulement, Eschyle, Sophocle, Euripide, dont les longues vies, dont les nombreux chefs- d'œuvre ont rempli un siècle entier, le ve avant notre ère. En effet, la naissance d'Eschyle se place en 525 (155) ; celle de Sophocle en 495 (156); celle d'Euripide en 480 (157): ils sont morts, le premier en 456 (158) ; les deux autres presque en même temps, savoir, le troisième en 406 (159), le second en 405 (160). Leur existence contemporaine, marquée par les dates voisines de quelques-uns de leurs ouvrages, l'est surtout par un fait éclatant auquel se rattache diversement leur souvenir. Euripide naquit dans l'île de Salamine, où depuis il alla composer quelques-unes de ses tragédies, au fond d'une caverne sombre et sauvage, que dit avoir vue Aulu-Gelle (161); il y naquit de parents qui s'y étaient réfugiés, comme beaucoup d'autres Athéniens, pour échapper aux Perses, le jour même où se livra la fameuse bataille navale à laquelle elle donna son nom. Sophocle avait alors quinze ans, Eschyle en avait quarante-cinq, et l'un, bel adolescent, à la tête des enfants d'Athènes, chanta et dansa autour du trophée (162), que l'autre, déjà, vétéran de Marathon et futur vainqueur de Platée, avait contribué à conquérir. Ces trois grands hommes se rencontrèrent à une époque où des prodiges d'héroïsme, exaltant les esprits, les rendaient le plus capables qu'il fût possible du sentiment et de la production 67 du beau dans les arts et dans les lettres; où le progrès de la fortune publique et des fortunes privées, accrues par les fruits de la victoire, par les produits du commerce, permit à l'État et aux particuliers de défrayer les dépenses du théâtre avec un excès de munificence qui, en ruinant les ressources et par suite l'indépendance du pays, servit puissamment à y développer l'art dramatique ; où la solennité de luttes sans égales dans la Grèce excita aux plus grands efforts les tribus, les chorèges les acteurs, les poètes, qui, sur la première des scènes, se disputaient la victoire (163) : par eux trois, la tragédie athénienne, rapidement portée à sa perfection, a changé trois fois de forme, et ainsi accompli, s'il est permis de l'affirmer, le cercle complet de ses destinées : ce ne sont pas seulement trois poètes, ce sont trois chefs d'écoles distinctes, au sein desquelles se sont perpétuées, conservées, épurées, corrigées et probablement multi- 68 pliées les œuvres si nombreuses qu'on leur attribue (164).
Ils ont eu, comme les poètes épiques, leurs
rhapsodes et, si on peut le dire, leurs diascevastes (165)
quelquefois officiels. Les Athéniens, faisant judicieusement la part du temps
qui vieillit tout et du génie qui ne doit pas vieillir, avaient permis que les
tragédies d'Eschyle, retouchées, retravaillées, fussent de nouveau admises au
concours avec celles de ses successeurs (166), et
nous savons que sa mémoire fut honorée par plus d'une victoire posthume (167).
Autour de ce père de la tragédie, se groupent donc comme ses éditeurs, et
peut-être aussi ses collaborateurs, ses continuateurs (168),
avec d'autres, dont les noms ont péri, ses fils Bion et Euphorion (169),
et son neveu Philoclès (170), qui fit aussi
souche de poêles tragiques : car il eut pour fils le glacial Morsimus (171),
peut-être le glouton Mélanthius (172),
pour petits-fils et arrière-petils-fils les deux
Astydamas1 et un nouveau Philoclès *, tous auteurs, mais quelques-uns assez
méchants auteurs de tragédies.
Les enfants de Sophocle, Jophon et Ariston, qui ont eu le malheur de flétrir
eux-mêmes leur plus beau titre, le fils d'Ariston, Sophocle le jeuce, dont le
nom est resté plus pur, ont aussi continué, non sans succès, ni même sans
gloire, le genre où s'était illustré leur père et leur aïeul. Jophon, il est
vrai, qui avait vaincu au théâtre de son vivant3, et s'y était même mesuré, non
sans gloire, contre Euripide 4, a été soupçonné de s'être paré de ses
dépouilles". Pour Ariston, on sait, ou du moins on croit savoir et c'est tout,
qu'il a fait des tragédies 6. Mais Sophocle le jeune, l'amour du grand
Sophocle7, qu'il promettait de recommencer, dans une carrière dramatique ouverte
la première année de la xcvi* olympiade, en 396, et qui, selon quelques-uns, n'a
pas compté moins de quarante ouvrages8, a remporté jusqu'à sept ou même douze
victoires3. On a cru10, non sans vraisemblance, qu'il fallait lui faire sa part,
comme peut-être aussi à Jophon, dans le nombre prodigieux de tragédies que
l'antiquité attribue au seul Sophocle *'.
Peut-être le catalogue, à peu près aussi long, des tragédies d'Euripide, doit-il
être de même diminué de quelques-unes appartenant soit à un Euripide plus ancien
que lui1, auteur, dit-on*, de douze pièces, et deux fois couronné ; soit, ce qui
est plus vraisemblable, à son fils * ou son neveu*, Euripide le jeune.
Peut-être, parmi celles où l'on ne peut méconnaître l'œuvre du grand maître,
s'en trouve-t il auxquelles ce poète, qui lui tenait de si près, a mis la main.
Aristophane, dans ses Grenouilles5, faisait dire par Eschyle à Euripide : « Ma
poésie, comme la tieune, n'est pas morte avec moi. * Euripide le jeune donna à
cet arrêt insultant du comique, dans l'année même ou dans l'année suivante6, un
éclatant démenti, en remettant au théâtre, quatre ans avant que l'Œdipe à Colone
y parût, ou y reparût, par les soins de Sophocle le jeune', l'Iphigénie en
Aulide, l'Alcméon, les Bacchantes*, non sans avoir pris sur lui d'y faire les
corrections indiquées par la critique, et qui autorisaient ces sortes de
reprises9. Ainsi, la première de ces trois tragédies avait primitivement, comme
toutes les autres, un prologue dont Élien a conservé quelque chose10, et dans
lequel Diane, après avoir expliqué le sujet de la pièce, en annonçait le
dénoûment. Son nouvel éditeur, la ramenant à la manière plus dramatique de
Sophocle, fondit les explications dans la première scène et supprima l'annonce.
Avant ce collaborateur posthume, Euripide en avait, dit-on, trouvé d'autres, et
même pour ce qui semblait la partie la plus difficile, la plus importante de
l'œuvre tragique, pour la composition des chœurs " ; un surtout, dont il a été
beaucoup parlé, son esclave1 Géphisophon, malignement accusé par les comiques
d'avoir été chez lui quelque chose de plus encore qu'un collaborateur littéraire
'. Ces grands poêles, du reste, ne peuvent rien perdre à la découverte de
coopérations obscures, qui disparaissent aux yeux de la postérité, comme le
travail des manœuvres dans la gloire du monument. Phidias n'a pas seul mis la
main au Parthénon, ni Raphaël au Vatican; mais seuls ils y ont attaché leurs
noms.
trouvera,au sujet de ces habitudes gastronomiques si peu d'accord avec le culte
de Melpomèi e, de piquants détails chez Meineke, Fragm. comte, grxc., 1.1, p.
66, 88, 95, 137,186,205, 206, 217, 392, 425.
1. Suid., v. 'AaTu8i(iaç. — 2. Athen., Deipn.; Suid., V. 4>iXoxX»ji;; schol.
Aristoph.,41). 281. M. Kajser, Hist. crit. traq.grxe., p. 47 sqq., n'admet point
comme poëte tragique ce second Philoclès, admis par M. Wagner, Poet. trag. grxc.
fragm., éd. F. Didot, p. 63.
3. Schol. Arisioph., flan., 73. — 4. Arguai. Hippolyt. Euripid.
5. Aristoph., Ran., 73, 75, 78; schol. Aristoph., ibid.; Suid., v. 'loçwv.
6. Diog. Laert., VU, 164.
7. Vil. Sophocl.
8. Suid., v. ïoifoxiflî. — 9.7d., ibid.; Diod.Sic., XIV,53.Cf.Bœckh, Grxc. trag.
princip., vin; Clinton, Fast. hellenic., p. xxxvi, 101. — 10. Bœckh, i6»'d.,ym,
ix, etc.—11. Suid., v. SocpoxXîiç; Vit.Sophocl. Sur les poètes tragiques de la
famille et de l'école de Sophocle, voyez encore Fr. G. Wagner, Poet. (rag.grxc./Voom.
,éd.F.Didut.p.74suq.: W. C. Kajser, ibid., p. 73-81. ' '
1. Son aïeul, s-elon la conjecture de M. W. C. Kayser, Uist. erit. trag. grxc.,
p. 80.
2. Suid., v. EOpiiri?1»];.
3. Schol. Aristoph., fian.,67; Moschopul., Thom. Mag., Vit.Eurip.
4. Suid., v. EùpnuÔYiç. Sur cette difficulté, fort controversée, voyez Fr. G.
Wagner, ibid., p. 79, 80; W. C. Kayser, ibid.. p. 81 s;q.
5. Kan., 877. — 6. Clinton, Fast. hellenic., p. 95. — 7. Argum. III Œd. Colon.
Cf. Clinton, ibid., p. 95.
8. Schol. Aristoph., Ban., 67.
9. Aristoph., tfub., 537; Argum., etc. Voyez Eiclistadt, de Dramat. grxe. corn,
satyr.; Breckh, Grxc. trag. princ., xvn, xvni, xix, xxn, xxin, xxiv. — 10. Uist.
anim., VII, 39.
11. Fit. Eurip., éd. Elmsley.
Tant qu'ils vécurent, il leur fallut, auprès d'archontes quelquefois partiaux ou
sans goût, qui n'ouvraient pas la scène aux plus dignes, devant un public
souvent distrait, ignorant, prévenu, dont le Bacchus des Grenouilles, si
embarrassé de prononcer entre Eschyle et Euripide, peut être considéré comme une
personnification bouffonne, au tribunal de juges à qui la même comédie dit en
face d'assez dures vérités', de juges choisis par le sort, comme tous les juges
à Athènes, et qui n'étaient pas toujours les plus éclairés*, les plus
indépendants, les plus intègres s, disputer leurs succès et leur gloire à une
1. Ainsi, selon Hésychius (voyez Meineke, Fragm. corn, grxc., 1.1, p. 37), le
vieux comique athénien Ecphautides s'était fait aider dans la composition de ses
pièces par son esclave Chérilus.
2. Aristopb., flan., 944, 1451 sq.; Id., Fragment inédit, publié par M.
Rossignol dans le Journal des Savants, avril 1832. Cf. God. Her- mann, Opusc.,
t. V, p. 202; voyez aussi Diog. Laert., II, 18; Suid., V. MovwSeïv.
3. Kan., 814 sqq.
4. < Ils faisaient biensermpntrFêtrejustes,maisnond'avoirdugo<U,» dit fort bien
Lévesque (Considérations sur les trois grands tragiques delà Grèce). Combien
l'assemblée entière pouvait-elle compter de véritables juges? Peut-être sii ou
sept, répond le joueur de flûte Timothée chez Lucien (Harmonid., n). On Simylus
auquel M. Meineke (Hist. crit. corn, grxc , p. 425; prsefat,, p. xm-xvi) a tour
à tour accoidé et refusé une place dans l'histoire de la moyenne
comédie,comptaitparmi les difficultés semées sur la route du poète le plus
favorisé des dons de la nature, le mieux préparé par les préceptes de l'art,
celle de trouver des juges capables de saisir au vol les vers récités (Simyl. ap.
Stob., LX,4; Cf. E. Egger., Histoire delà critique chez les Grecs,p.43; G.
Guizotj Ménandre, etc., p. 134).
5. Ces juges du théâtre d'Athènes manquaient quelquefois de qualités morales
aussi nécessaires à l'exercice de leur charge que le goût
(1) Ad Pison., 405.
(2) De republ., II, X; Poet., III, xxiv.
(3) Aristot, Poet, xxvi.
(4) De republ, X.
(5) Athen., Deipn., VIII.
(6) Mot du philosophe Polémon, Diog. Laert., IV, 20. Cf. Suid., v. Πολέμων
(7) Plat., de Republ.., X.
(8) Nicéphore Grégoras (liv. X) l'a donné, on ne pouvait le faire commencer plus tôt, à Orphée. Platon, ou l'auteur inconnu du dialogue de Minos, à des poêles athéniens contemporains de ce roi de Crète (voyez Plutarque, Vit. Thés., xvi, qui corrige celle tradition en supprimant la contemporanéité plus que douteuse de Minos et des tragiques d'Athènes par lesquels a été flétri son nom : voyez aussi, dans les Variétés littéraires, Paris, 1804, t. III, p. 488, des Réflexions sur la tragédie grecque, très-hasardées, où l'abbé Arnaud la prend, au contraire, avec pleine confiance, pour son point de départ) ; un vieux scoliaste cité par Stanley (ad Aeschyl.) et par Bulenger (de Theatr., I, 2), Jean Malalas (Chron.), l'ont donné à un certain Théomis, contemporain d'Oreste, et, après lui, à un Minos, à un Auléas. Écartant ces origines vagues et fabuleuses, nous trouvons qu'Hérodote (V, 67) a fait remonter le commencement de la tragédie aux chantres antiques des malheurs d'Adraste dans les fêtes solennelles de Sicyone ; que Suidas l'a daté, tantôt (v. Φρυνίχος) de Thespis, tantôt (vv. Θέσπις, οὐδεν πρὸς τὸν Διόνυσον), d'accord en cela avec Hérodote, d'Épigène de Sicyone, son seul prédécesseur selon quelques-uns, dit-il, selon d'autres le seizième (voy. De dram. graec. sat. origine, 1822, p. 6, Pinzger, qui concilie heureusement les deux opinions en supposant que Thespis est bien le seizième selon l'ordre des générations, mais le deuxième quant au mérite, les intermédiaires ne méritant pas d'être comptés); qu'Aristote (Poet, III), Thémiste (Orat., xix) ont réclamé la gloire d'avoir inventé la tragédie, qu'Athènes aurait seulement perfectionnée, pour les Doriens en général, et en particulier pour les Sicyoniens. C'est à ces derniers, en raison de certaines innovations dans les chœurs bachiques (Suid., v. οὐδεν πρὸς τὸν Διόνυσον), en raison de leurs chants sur Adraste (Hérodote, V, 67), qu'on est le plus autorisé à faire honneur de la découverte (voyez à l'appui de ce système, combattu par Bentley, Dissert. de Phalarid. epist. X, respons. ad C. Boyl. X, des notes savantes de Bœttiger, Quatuor aetates rei sceniae apud veteres, Weimar, 1798; Opusc., Dresde, 1837, p. 329 sqq. ; consultez aussi les recherches de M. Ch. Magnin sur les divers éléments du drame antique, dans ses Origines du Théâtre moderne, Paris, 1838. Introduction, t. Ier. Celle question obscure et difficile a paru rencontrer une heureuse solution dans la distinction faite par M. Bœckh, d'une tragédie lyrique et d'une tragédie dramatique, trouvées, la première dans le Péloponnèse, la seconde, postérieurement, dans l'Attique, et qui toutes deux continuèrent d'exister concurremment, comme le lui fait penser une inscription relative à des jeux de diverses sortes donnés à Orchomène, et dans laquelle sont nommés deux vainqueurs, l'un pour la tragédie ancienne, παλαιή, l'autre pour la nouvelle, καινή, dénominations qu'il applique (renvoyant à son Économie politique des Athéniens, t. II, p 361, où il a d'abord énoncé son opinion : s'appuyant de l'opinion conforme de O. Müller, Dor.,t. II, p. 368; Welcker, Trilogie d'Eschyle, Appendice, p. 243, et combattant les objections de Lobeck, de Aetate Orphei diss., IV, p. 9 ; Aglaoph, p. 974) à la tragédie lyrique et à la tragédie dramatique (voyez Bœckh, Corpus inscript, graec., V, ii, n° 1585, t. Ier, p. 765, et t. II, p. 509). Mais il faut dire que God. Hermann (De tragœdia comœdiaque lyrica, 1836; Opusc., 1833, t. VII, p. 211), a fort ébranlé le système de la tragédie lyrique : il n'y a vu, comme précédemment Pinzger, ouvrage cité plus haut, p. 1, autre chose que le dithyrambe, berceau reconnu par tout le monde de la tragédie, et a rapporté ces mots de l'inscription, tragédie ancienne, tragédie nouvelle, non pas à la différence des genres, mais simplement à la date des ouvrages représentés, les uns anciens, les autres nouveaux.
(9) Athénée (Deipn., I) comprend dans le nombre, seul, il est vrai, et peut-être par méprise, un Cratinus.
(10) Aristot., Poet., iv.
(11) Suid., v. Ἀρίων.
(12) De là une
des étymologie du mot tragédie qu'on fait venir (Etym. magn., v. Τραγῳδία;
Hesych., v. Τράγοι, etc.) du nom de boucs quelquefois donné aux satyres.
Selon d'autres, on le sait, ce mot viendrait plutôt du bouc que l'on immolait
dans les fêtes de Bacchus, ou que l'on donnait primitivement en prix au
vainqueur dans les concours dionysiaques, lyriques et peut-être dramatiques, dès
le temps même de Thespis, comme semble le dire la Chronique de Paros (Marm
Par., epoch. 43, v. 58-59) :
Non aliam ob culpam Baccho caper omnibus aris
Cœditur, et veteres ineunt proscenia ludi,
Praemiaque ingentes pagos et compita circum
Theseidae posuere. (VIRG., Georg., II, 380.)
Carmine qui tragico vilem certavitob hircum. (HORAT.,ad Psison.,220.)
Du plus habile chantre un bouc était le prix. (BOIL., Art poét., III.)
(13) Diog. Laert., III, 56.
(14) Plutarch., Sympos., I, i; Suid. Οὐδὲν πρὸς τὸν Διόνυσιον, etc.
(15) Aristote (Poet., iv), Diogêne Laërce (III, 56), Suidas (vv. Σοφοκλῆς, Τιταγωνιστής, cf. Vit. Sophocl.), attribuent à Thespis, à Eschyle, à Sophocle l'introduction de chacun de ces trois acteurs; mais cela a été contesté comme d'autres points de celte antique histoire, particulièrement par Thémiste, Orat., xxvi (voy. God. Hermann, Dissert. II de choro Eumenidum Aeschyli, 1809 et 1816; Opusc., 1827, t. II, p. 141 ; E. Egger, Histoire de la critique chez les Grecs, 1849, ch. iii, § iv, p. 139). Sophocle ayant été contemporain d'Eschyle, et Euripide de Sophocle, quelques-unes des inventions qui ont progressivement constitué la tragédie grecque, ont pu, contrairement à l'ordre de succession des trois poètes, passer, par imitation, du plus récent au plus ancien, et, comme cela est arrivé chez nous à l'égard de Rotrou et de Corneille, changer en certains points le disciple en maître. Delà des questions de priorité fort controversées dans tous les temps par la critique, et la plupart insolubles.
(16) . Jul. Poll., Onomast., IV, 19. Cf. Eusltth., ad Il., VII, 407.
(17) Voyez sur les heureux effets, l'importance et même la nécessité ria chœur dans le système de la tragédie grecque, de judicieuses réflexions de M. E. Egger, Histoire de la critique chez les Grecs, ch. III, § viii.
(18) Le concours des deux ressorts qui faisaient mouvoir ensemble l'action tragique des Grecs se trouve heureusement exprimé dans ce vers où l'auteur inconnu du Ciris peut-être à l'imitation de la tragédie grecque, et comme on l'a cru (Voy. Hartung, Eurioid. restitut. t. II, p. 215), d'une pièce d'Euripide, a peint Scylla contrainte au crime, et par sa passion et par une influence fatale :
Quo vocat ire dolor, subigunt quo tendere fata,
Fertur.
(Ciris, 183.)
(19). La représentation des ouvrages dramatiques, née du culte même de Bacchus, y resta toujours et exclusivement affectée. Car il ne paraît pas, comme on l'a conclu à tort de passages de Diogène Laërce, III,56 et de Suidas, v. Τετραλογία, qu'il faille joindre les Panathénées aux diverses fêtes où se donnaient des tragédies et des comédies. Ces fêtes étaient au nombre de quatre : les grandes Dionysiaques, les Lénéennes, les Anthestéries, enfin les petites Dionysiaques, appelées encore Dionysiaques rurales, parce qu'on les célébrait hors de la ville, ou Dionysiaques du Pirée, de Drauron, etc., du lieu particulier où elles étaient célébrées ; elles étaient au nombre de trois seulement selon ceux qui ne distinguent point les Lénéennes des Anthestéries. Voyez sur ce sujet obscur, et toutes les questions particulières, non moins difficiles, qui s'y rattachent, Barthélémy, Mém. de l'Acad. des Belles-Lettres, t. XXXIX, p. 172 ; Bœckh, Graec. trag. princip., Heidelberg, 1808, c. xvi, p. 204; Mém. de l'Acad. de Berlin, 1816-1817; Corpus inscript, graec., t. 1er, p. 351; Ch. Magnin, Origines du théâtre moderne, 1838, t. I, p. 106; Fr. Creuzer et J. D. Guigniaut, Religions de l'antiquité, t. III, 1839, p. 222 ; Bode, Geschichte, etc., Histoire de la poésie grecque, tragédie, Leipzig, 1839, t. III, p. 123 sqq., etc.
(20) Pausan., Att., xvi. L'institution de cet autel, souvent rappelée dans l'antiquité, a fourni à Stace le sujet d'un des plus beaux passages de sa Thébaïde, xii, 481 sqq,; elle a aussi heureusement inspiré Claudien, De bello Gildonico, 405,
(21) Il n'y avait pas bien longtemps que s'étaient retrouvés à Tégée les os d'Oreste, longs, disait-on, de sept coudées! Voyez Hérodote, I, 68 ; Pausan., Lacon., iii, 3. Cf. Aelian. II, 5; A. Gell., III, 10. Θήκη μεγάλου σώματος, dit Plutarque, Vit. Thés., xxxvi, en parlant du cercueil de Thésée retrouvé dans l'île de Scyros et rapporté à Athènes par Cimon. C'était l'année même où, comme nous le rappellerons plus loin, au jugement de Cimon et des généraux ses collègues, chargés par l'archonte de prononcer entre le vieil Eschyle et le jeune Sophocle, qui paraissait pour la première fois dans ces luttes, celui-ci l'emporta. Voyez encore Plutarque, Vit. Cim., viii.
(22) Nigrin. II; de Saltat. xxvii; Jupit. tragœd., XLI; Anach..,xxiii, etc.
(23) Vit. Apollon., V, 3. Philostrate y raconte qu'à une représentation dramatique donnée par un tragédien du temps de Néron, dans une ville de Bétique, Ispula, où ce genre de spectacle était encore inconnu, le public, d'abord fort effrayé par la démarche, la stature, la masque de l'acteur, se mit à fuir de toutes parts quand il l'entendit déclamer, le prenant pour quelque démon.
(24) Philostrat., Vit. Apollon.., VI, ii. Cf. Val. Max., IX, 12.
(25à. Aristot. Poet.. iv; Horat., ad Pison., 278, etc.
(26) Suid., vv. Αἰσχύλος, Πρατίνας. Cf. Clinton, Fast. hellenic., éd.Krüger, Leipzig, 1830, p. 23.
(27) Suid., v. Θέσπις;.
(28) Clinton , Fast. hellenic., p. 11. Cf. Fr. G. Wagner, Poet. trag. graec. fragm., 1846, éd. Firmin Didot, p. 4.
(29) Arist., Poet., iv.
(30) Voyez, après les très nombreux critiques qui se sont occupés de cette question, parmi les plus récents, Welcker (Nachträge, etc., Appendice à l'ouvrage sur la trilogie d'Eschyle, 1826, p. 221 sqq.) ; Ch. Magnin (Origines du théâtre moderne, 1838, Introduction, t. Ier p. 29 sqq.)
(31) Plut., Vit. Sol, xxix. Cf. Diog. Laert., I, 59.
(32) Lucien, Anach., xxii, xxiii.
(33) Republ., Il, III. Voyez le commentaire de Bossuet sur ces passages, dans ses Maximes et Réflexions sur la comédie, ch. xiv.
(34) Plutarch., De gloria Atheniensium, v; De aud. poet., i. Voy. la traduction du passage de Gorgias dans l'Histoire de la critique chez les Grecs de M. Egger, ch. II, § ii, p. 78.
(35) Republ., II, 111.— 5. Epist. II, i, 163. —6. Iliog Laert., V, 92.
(36) Poet., xxiv.
(37) Donat., de Com, et Trag. Cf. Bentley, Respons.ad C. Boyle, xi.
(38) Ad Pison., 275. Cf. Sid. Apollon., IX, 232
(39) Plut., De audiend. poet.,xiv; Clem. Alex.,Strom., V. Cf Bentley, ibid. M. Letronne ne croit pas davantage à l'authenticité du vers, fort insignifiant, que cite, sous le nom de Thespis, un papyrus du Musée royal dont il a donné l'explication dans le Journal des Savants, n° de juin 1838, p. 324.
(40). Suid., v. Θέσπις; J. Poll., VII, 12.
(41) Barthélémy l'a répété (Anach., ch. Lxii), bien que Bentley (ibid.) paraisse avoir établi que ce titre est un erreur de Selden, auteur de ta première édition des Marbres. Cf. Bœckh, Corp, inscript graec., t. II, p. 301. Lévesque a mieux profité de la remarque de Bentley, dans ses Considérations sur les trois grands poètes tragiques de la Grèce (Mém. de l'Institut, classe de littérature, t. I, p. 309, et Études de l'Histoire ancienne, t. V, p. 4: et suiv.); on en peut dire autant de M. Ch. Magnin, Origines du théâtre moderne, t. I, p. 38.
(42) Sympos., I, i..
(43). Elle est contestée par Bentley (ibid.), qui n'attribue à Thespis que des drames satyriques, et qui, d'après le passage de Plutarque, précédemment cité (Sympos., I., i), recule jusqu'à Phrynichus et Eschyle le commencement de la tragédie véritable.
(44) Ad Piosn,, 275. Cf. Sid. Apoll.., ΙX, 372.
(45) Vesp., 1501
(46) Cela est vraisemblable; mais on ne peut, sans forcer le sens des expressions de Suidas, le conclure avec Boda (Geschichte, etc., Histoire de la poésie grecque, tragédie, t. III, p. 55); avec Welcker (Nachträge, etc., Appendice à l'ouvrage sur la trilogie d'Eschyle, p. 271); avec d'autres, suivis par eux en cela, de ce qu'il a dit, non pas de trois moyens différents employés dans une même pièce par Thespis pour changer son visage, mais du progrès des inventions par lesquelles, dans sa carrière dramatique, ce poêle est arrivé jusqu'au masque.
(47) Il n'y a eu qu'un tragique de ce nom, comme le démontrent fort bien, contre des assenions contraires, Périzonius, ad Aelian. Var. hist., III, 8; Bentley, Respons ad C. Boyl., xi. Sur les confusions qu'on a faites de ce poète avec Phrynichus le comique et Phrynichus le choriste, objet des railleries de la comédie, voyez Meineke, Fragm. comic. grœc., Berlin, 1839, t. I, p. 146 sqq.
(48) Aristoph., Thesmophor., 154.
(49) id., Av., 746; Vesp., 220; Aristot., Problem., XIX, 31.
(50) Aristoph., Vesp., 1512 sq; Plutarch., Sympos., VIII, 9; Athen., Deipn., I, etc. .
(51) Suid., v. Φρυνίχος
(52) Phrynichus avait lui-même donné une Alceste, dοnt Hésychius, v. Ἀθαμβές, a conservé quelque chose.
(53) Voyez les fragments des Méléagre de Sophocle, d'Euripide, d'Attius.
(54) Phocid., xxxi.
(55) Hérodot., VI, 21 ; Callisth. apud Strab., XIV; Plutarch., Praecept. politic., XVI; Suid., v. Φρυνιχος; Tzetzes, Chil, VIII, 156; schol. in Hesiod. Op. et Dies, 414; Amm. Marcel!., XXVIII, i, etc Voyez sur un proverbe auquel donnèrent lieu, dit-on, la disgrâce de Phrynichus et l'émotion qu'elle lui causa, mais qu'on explique encore autrement, Aristoph., Vesp., 1512; Aelian., Var. hist., XIII, 17, etc.; Bentley, Opusc., p. 298; Fr. G. Wagner, Poet, trag. graec. fragm., éd. F. Didot, p. 11.
(56) La Prise de Milet de Phrynhbus a pu être donnée, près de l'événement, la quatrième année de la Lxxie olympiade; les Phéniciennes l'ont été la première de la Lxxvie. Thémistocle, qui était chorège, consacra la victoire du poète et la sienne par une inscription. (Voyez Plutarch., Vit. Themist., v; cf. Clinton, Fast. hellenic., p. 25 et 35; Fr. G. Wagner, Poet. trag. graec. fragm., éd. F. Didot, p. 14.)
(57) Pausan., Phoe., xxxi; Suid., v. Φρυνίχος ; schol. Aristoph., Av., 747.
(58) Anonym., de Comœdia. Voyez Meineke, Fragm.comic.graec., t. I, p. 536; cf. p. 146.
(59) Poet., vi.
(60) Ainsi les définit exactement God. Hermann, de Escliyli Persis, 1812; Opusc., 1827, t. II, p. 90, et ailleurs, se référant à l'opinion de Heeren et de Jacobs.
(61) Voyez ce nom donné par les scoliastes d'Aristophane, Ran., 1124; Thesmoph., 135 ; Av., 281, à l'Orestie, à la Lycurgie d'Eschyle, à la Pandionide de Philoclès. Diogène Laërce s'en sert et l'explique, III, 50.
(62) 2. D'Aristarque et d'Apollonius, selon les scoliastes d'Aristophane, Ran., 1124. Le mot trilogie, inséré parmi les litres des tragédies que Suidas attribue à un poêle du nom de Nicomaque, auquel nous reviendrons plus loin, n'est probablement pas un de ces litres, mais une qualification appliquée, par apposition, à trois d'entre eux. L'argument que tire de là Welcker pour établir que ce mot trilogie et l'emploi littéraire qu'on en a fait, sont antérieurs à l'époque des grammairiens d'Alexandrie, est donc assez peu solide, comme l'a remarqué Meineke (Frag. comic, grœc., t. I, p. 497). Sur cette combinaison dramatique, dont Aristote n'a rien dit (voyez au sujet d'un passage du ive ch. de la Poétique dont on tire une opinion contraire, le Commentaire de M. Egger, p. 418), qui n'a attiré qu'assez tard, mais très-vivement, l'attention de la critique moderne, on peut consulter surtout W. Schlegel (Cours de littérature dramatique, professé à Vienne en 1808, publié en 1809 et 1811, traduit en français en 1814, leçon ive; God. Hermann (de Composit. Tetralog. tragic., 1819; Opusc., 1827, t. II, p. 307) ; Welcker (die Aeschylische, etc , la trilogie d'Eschyle, etc., 1824); J. A. Hartung (Euripides restitutus, passim,1844); M. S. Karsten (de Tetralog. tragic. et didascal. Sophocl, IV, 1846). L'opinion de God. Hermann, que, outre les trilogies, il y eut, si on peut risquer ce mot, des dilogies, n'est pas dénuée de vraisemblance; mais elle ne paraîtra pas appuyée sur des preuves suffisantes à ceux qui pensent, ce qu'il nie, que les Suppliantes et les Danaïdes étaient précédées d'une première pièce, comme aussi le Prométhée enchaîné et le Prométhée délivré.
(63) Welck., ibid.,p. 498.
(64) On l'a conjecturé de Chérilus, dont les cent cinquante tragédies (Suid., v. Χοίριλος;) ne pourraient sans cela trouver leur place dans sa carrière dramatique, quelque longue qu'on la suppose ; de Pratinas, illustré par des drames satyriques, qui ne se donnaient pas seuls; mais auraient pu, il est vrai, être donnés après deux, après une, aussi bien qu'après trois tragédies (voyez Bode, qui a fort exactement résumé et quelquefois heureusement complété ces discussions, Histoire de la poésie grecque, tragédie, t. III, p. 59). Pour Phrynichus, à la différence de Chérilus, et même de Pratinas, ou cite de lui si peu d'ouvrages, que ce serait, selon le même critique (ibid., p. 82), se donner une peine inutile que d? vouloir les distribuer en tétralogies. Bode remarque plus loin (p. 93) que le nombre des tragédies attribuées à Pratinas (dix-huit) est bien loin de ce qu'il devrait être (quatre-vingt-seize), pour qu'elles formassent, avec ses trente-deux drames satyriques, des tétralogies; d'autre part il est frappé, dans le théâtre d'Eschyle et de ses successeurs, d'une disproportion toute contraire : il n'y trouve pas, il s'en faut de beaucoup, assez de drames satyriques pour que chaque tétralogie ait pu avoir le sien. De là cette double conjecture que peut-être, chez les derniers, le drame satyrique a été remplacé quelquefois par une quatrième tragédie d'un genre plus tempéré, à dénomment heureux, comme l'Alceste (voyez Alcest. Argum.), comme l'Oreste (voyez Orest. Argum. et schol., ad v. 1689, et qu'au temps du premier le drame satyrique a pu être accouplé à une seule tragédie ou composé et joué isolément. Concluons qu'il est bien difficile de savoir quand l'usage de la tétralogie a commencé, et qu'on ferait peut-être sagement de se résigner à l'ignorer, comme tant d'autres points obscurs de l'origine des arts.
(65) Eschyle lui-même a donné des tétralogies sans aucun lien trilogique, celle-ci entre autres dont parle l'argument des Perses : Phinée, les Perses, Glaucus de Potnie (voyez God. Hermann, de Aeschyli Glaucis, 1812; Opusc., 1827, t. II, p. 59), Prométhée, drame satyrique. Disons cependant que Welcker (ibid., p. 470 et suiv.) a fait bien hardiment des trois tragédies une trilogie, non pas de sujet commun, mais de sujets simplement analogues, en supposait que, dans la première, Phinée comprenait parmi ses prédictions aux Argonautes même ces triomphes des Grecs sur les Barbares célébrés par la seconde, et que, dans la troisième, le dieu marin Glaucus, substitué par lui à Glaucus de Potnie, racontait la victoire contemporaine de Gélon sur les Carthaginois. Il lui a même paru que lorsque Aristote (Poet., xxiii) cite la défaite des Perses à Salamine et celle des Carthaginois en Sicile, arrivées, disait-on (cf. Hérodote, Vil, 155), le même jour, comme exemple d'événements qui, liés par le temps, ne se tiennent réellement pas, il a fait allusion à leur rapprochement dans la trilogie d'Eschyle. Ces conjectures n'ont point passé sans contradiction. Voyez, entre autres, E. A. J. Ahrens Aeschyl. fragm., 1842, éd. F. Didot, p. 193 sqq.
(66) Aristoph , Ran, 1137.
(67) Ovid., Metam., IX, 408.
(68) Aristoph., Thesmoph., 135.
(69) God. Hermann, de Aechyl. Lycurgia, 1831; Opusc., 1834, t. V, p.I sq.; F. A. J. Ahrens, Aeschyl. fragm., éd. F. Didot, p. 177 sqq.
(70) Par M. J. Frantz, dans un programme académique de l'université de Berlin. Voy. E. Egger, trad. et comm. de la poét. d'Aristote, p. 418.
(71) Arg. Agamem.; schol. Aristoph., Ran., 1124.
(72) C'est l'opinion de Bœckh. (Graec, trag. princ., xx), de God. Hermann (de Composit, telralog. trag., ibid.), contredite par Welcker (ibid., p. 508); de K. A. J. Ahrens, Aeschyl. fragm., édit. F. Didot, p. 254. Cf. Hom., Odyss., IV, 341 sqq.
(73) Voyez God. Hermann, de Composit. tetral. trag., ibid.; de Aeschyli Danaïdibus, 1820; Opusc., 1827, t. Il, p. 319; de Aeschyli Myrmidonibus, Nereidibus, Phrygibus, 1833; Opusc. ,1834, t. v, p, 136 sqq.; de Aeschyli trilogiis Thebanis, 1835; Opusc., 1839, t. VII, p. 390 : de Aeschyli Psychostasia, 1838, ibid., p. 343; de Aeschyli tragoediis fata Ajacis et Teucri complexis, 1838, ibid. , p. 362; Welckel, ibid., p. 7-111, 311-481, où sont distribués en vingt trilogies presque tous les ouvrages tragiques d'Eschyle dont le souvenir s'est conservé; enfin E. A. J. Ahrens, Aeschyl. fragm., édit. F. Didot.
(74) Schol. Aristoph., Av., 281. Voyez la restitution de cette trilogie chez Welcker, ibid. , p. 502.
(75) Citée d'après les Didascalies d'Aristote, par le scoliaste de Platon. Voyez Welcker, ibid., p. 528.
(76) Suid., vv. Σοφοκλῆς τετραλογία... Ἦρξε δρᾶμα πρὸς δρᾶμα ἀγωνίζεσθαι ἁλιὰ μὴ τετραλογιαν.
(77) C'est le sens nouveau donné au passage de Suidas par Welcker, ibid., p. 509, et adopté par Bode, Histoire de la poésie grecque, tragédie, t. III, p. 95.
(78) Quand Xénoclès l'emporta sur Euripide, comme le rapporte, en s'en scandalisant Elien, (Var. hist., II, 8), le débat était entre deux tétralogies, l'une, celle de Xénoclès, qui comprenait ces quatre pièces : Oedipe, Lycaon, les Bacchantes, Athamas; l'autre, celle d'Euripide, ainsi composée : Alexandre, Palamède, les Troyennes, Sisyphe. L'argument de la Médée nous a fait connaître qu'elle fut donnée avec deux autres tragédies du même poète, Philoctète, Dictys, et un drame satyrique, les Moissonneurs. Il en fut de même de ses Phéniciennes, qu'accompagnèrent les tragédies d'Hypsipyle, d'Antiope et l'on ne sait quel drame satyrique (schol. Aristoph., Ran., 53). On sait, depuis peu de temps, que la deuxième année de la Lxxxve olympiade, la 439e avant notre ère (Clinton, Fast. hellenic., p. 61), sous l'archonte Glaucinus, ou, comme dit Diodore (XII, 30), Glaucides, dans un concours où Sophocle obtint le prix sur Euripide, ce dernier donna avec trois tragédies, savoir : les Crétoises, Alcméon à Psophis, Télèphe, en place de drame satyrique, comme on l'avait conjecturé (voyez plus haut p. 28), son Alceste (Argum. Alcest. ex cod. Vatic. apud. G. Dindorf, Oxon.,1834). C'est sous forme de tétralogie qu'après la mort d'Euripide furent redonnés par son neveu, Euripide le Jeune, l'Iphigénie en Aulide, l'Alcméon, les Bacchantes (schol. Aristoph., Ran., 67). L'auteur de l'Euripides restitutus déjà cité, M. Harlung, a cru pouvoir distribuer en tétralogies tous les ouvrages conservés ou perdus, d'Euripide. C'était une tétralogie que Platon, qui dans la suite devait distribuer en tétralogies ses dialogues (Diog. Laert., III, 56, cf. 61), avait confiée aux comédiens, quand il quitta la poésie pour la philosophie (Aelian., Var. hist., II, 30). Après Platon, dans une inscription que l'on rapporte à la deuxième année de la cvie olympiade, c'est-à-dire à. l'an 355 (Bœckh, Corpus incript. grœc., t. I, p. 334), il est encore question d'une tétralogie.
(79) God. Hermann, de Compos, tetral. trag., ibid.
(80) Welcker, ibid., p. 286-493, 538.
(81) On lira, avec beaucoup de fruit, sur Eschyle et les origines de la tragédie grecque, l'Aperçu où M. H. Weil, professeur de littérature ancienne à la facullé des lettres de Besançon, a résumé, avec une précision élégante, les idées exposées par lui à ce sujet, dans son cours de 1848-1849 (Aperçu, etc., Besançon, 1849). Dans une dissertation intitulée Eschyle, Caen, 1851, M. P. L. Énault a depuis spirituellement rassemblé les traits caractéristiques du créateur de la tragédie athénienne.
(82) Chamaeléon chez Athen., Deipn.,1. C'est trop restreindre, je crois, la portée de ce mot que d'y voir, avec Stanley, Bayle et autres, seulement une allusion à l'inspiration désordonnée qu'Eschyle, selon quelques témoignages anciens (Plutarch., Sympos., 1,5; VII, 10; Lucian., Demosth. encom.; Athen., Deipn., X, etc.), puisait dans l'ivresse, en poète qui travaillait pour le théâtre de Bacchus, et à qui dans son, enfance, comme il donnait en gardant des raisins, le dieu du vin était apparu pour lui ordonner de composer des tragédies (Pausan., Attic., xxi).
(83) Voyez les deux dissertations de Boettiger, de Herodoti historia ad carminis epici indolem propius accedente (Opusc., p. 182 sqq.); celle de M. P. L. Lacroix, Quid apud Herodotum ad philosophiam et religionem pertinent; Pans, 1846, notamment p. 51 sqq.
(84) Sept, ad Theb., v. 640 sq.; 676 sq.
(85) Bossuet a dit . « Quand les anciens se sentaient possédés de quelque mouvement extraordinaire, ils croyaient que ce mouvement venait d'un dieu, ou bien que ce violent désir était lui-même un dieu. C'est un souvenir du doute que Virgile, avec les idées de son temps, prête à un Troyen de l'Age héroïque :
Nisus ait : Dine hune ardorem mentibus addunt,
Euryale? an sua cuique deus fit dira cupido ?
(Aen., IX, 181.)
(86) Moral,, Nicom., V, ii.
(87) L'auteur d'un Essai sur la fatalité dans la tragédie grecque, publié à Paris, en 1855, M. Y. R. Cambouliu, est moins éloigné de ces idées, généralement admises, qu'il ne paraît le croire. Apercevant dans toutes les tragédies grecques, et particulièrement dans celles d'Eschyle, des traces de justice divine et de liberté humaine, il en conclut que c'est à tort qu on les dit gouvernées par la fatalité. Mais comme personne n'a jamais prétendu qu'à l'action de ce gouvernement ne se mêlassent point, dans des proportions variables, selon le génie des poètes et le caractère des époques, les éléments différents qu'il indique, il se trouve avoir combattu, avec érudition et avec esprit, une opinion au fond conforme à la sienne.
(88) Voyez ce qui est dit à ce sujet dans l'Histoire de la critique chez les Grecs, de M. Egger, ch. i, § 2, p. 13 et suiv. S'arrêtant avec quelque détail à l'institution fort démocratique de ces cinq juges tirés au sort dans tout le peuple d'Athènes pour l'aire en son nom ce qu'il faisait primitivement lui-même, c'est-à-dire pour décerner le prix de la tragédie, de la comédie, se demandant comment on avait pourvu à ce que ces cinq juges, ainsi improvisés, fussent garantis des erreurs auxquelles pouvaient les entraîner, comme l'a dit Platon (de Leg., II; I. VII, p. 88 de la tract, de M. Cousin), les acclamations irréfléchies de la foule ou leur propre ignorance, M. Egger suppose qu'ils n'étaient pas choisis au moment même du spectacle, mais quelque temps auparavant; qu'une connaissance préliminaire des pièces, acquise soit aux répétitions, soit par la lecture de copies distribuées à cet e£M, les avait préparés d'avance à l'exercice de leur difficile ministère; que la représentation publique n'était pour eux qu'une dernière et solennelle épreuve où leur opinion quelquefois se contrôlait, quelquefois aussi se corrigeait au contact d'une opinion moins savante, mais plus sympathique et plus soudaine, celle de l'immense auditoire convié aux fêtes de Bacchus. Cette conjecture est ingénieuse, mais c'est une simple conjecture, M. Egger en convient, et elle a contre elle précisément ce qu'il raconte un peu plus loin, d'après Plutarque, et ce que nous racontons nous-même ici, de la représentation fameuse où le jeune Sophocle l'emporta sur le vieil Eschyle. Dans son récit comme dans le nôtre, c'est bien évidemment sur le lieu même du combat, quand la lutte va s'engager, que les juges sont institués d'une façon tout extraordinaire.
(89) Vit. Cim., viii. Cf. Marm. Par., Lvii. Cette anecdote est belle, et il est permis de s'étonner qu'elle n'ait point trouvé place dans un drame où un poète de notre temps a fait applaudir au théâtre et couronner par l'Académie le tableau élevé et touchant de la vieillesse d'Eschyle désespéré, d'une part, par l'avènement inattendu d'un nouveau poète de génie, et d'autre part, consolé par la piété de sa fille, qui abandonne le vainqueur qu'elle aime pour suivre le vaincu dans son exil volontaire. Voy. la Fille d'Eschyle, étude antique en cinq actes et en vers, par J. Autran, représentée pour la première fois sur le second Théâtre-Français le 9 mars 1848. Voyez aussi le Rapport de M. Villemain, secrétaire perpétuel de l'Académie française, sur les concours de 1850.
(90) Clinton, Fast, hellenic., n 39.
(91) Il serait plus exact de dire d'après le grec, comme le font aujourd'hui les traducteurs, Iphigénie à Aulis; mais il en coûte de renoncer à un titre consacré par un chef-d'œuvre de Racine.
(92) On peut en suivre l'histoire exposée fort en détail dans la dissertation où M. E. Roux a traité savamment et ingénieusement Du merveilleux dans la tragédie grecque, Paris. 1846.
(93) Plutarch., de Andiend. poet.; de Stoïc. répugnant., etc.; Belleroph., frag. ix. Cf. Pind., Olymp., I, 43; XIV, 7; Nem., VII, 33, etc. dans le premier de ces passages, Pindare, après avoir rapporté, sans vouloir y ajouter foi, une histoire injurieuse pour la divinité, discutait ainsi les devoirs et les droits du poète à l'égard des traditions mythologiques:
" Il est certes bien des merveilles véritables, mais souvent aussi les récits des hommes sont emportés au delà de la vérité par les séduisants mensonges de la fable. La grâce du discours, qui nous rend toutes choses agréables et douces, répand sur ces récits une beauté persuasive, et l'incroyable même y devient digne de foi. Aux jours à venir les témoignages véridiques. Il convient toutefois que l'homme ne prête aux dieux que du bien : moindre alors est la faute."
(94) Clem. Alex , Strom., V.
(95). Id., Protreptic.
(96) Id., Strom., V; Euseb., Praeparat. evang., XIII, etc.; Pirith. fragm., ii.
(97) Clem. Alex., Strom., V; Eurip., frag. incert., ClV. Voyez, sur ces divers passages, Veilckenaer, Diatrbi. in Eurip. perdit, dram. reliq., v.
(98) Voyez Andromach., 1138; Ion., 445; Herc. fur., 1289, 1313, etc.
(99) Lucian., Jup. tragœd., XIII.
(100) Trach.. v. 198.
(101) Voyez la dissertation de Bœttiger, Aristophanes impunitus deorum gentitlium irrisior, 1790. (Opusc., p. 64, sqq.)
(102) Senec., Epist. 115. Cf. Belleroph. fragm.
(103) Plutarch., de Audiend. poet.
(104) Plutarch., Amator. Cf. Menalipp. fragm.
(105) Ch. Magain, De la mise en scène chez les anciens, Revue des Deux-Mondes, 1839, t. XIX, p. 657.
(106) Aristot., Ethic., Nicom., III, 2; ibid., Eustrat.; .Aelian., Var. hist., V, 19; Clem. Alex., Strom., II, 14.
(107) Ran., 1056; Nub., 1357, etc.
(108). Aelian., Hist. an., VI, 15; Athen., Deipn., XIII; Cic., Tusc., IV, 33,, etc. Cf. Valcken., Diatr. in Eurip. perd. dram. reliq., iii. Avant Euripide. Eschyle avait lui même louché sans réserve à ce dérèglement par quelques traits de ses Myrmidons que nous ont conservés les anciens (Plutarch., Moral.; Athen., Deipn., XIII; Lucian., Amor., 54) et auxquels Ovide a peut-être fait allusion dans ces vers :
Est et in obscœnos deflexa tragœdia risus,
Multuque prasteriti verba pudoris habet;
Nec nocet auctori, mollem qui fecit Achillem
Infregisse suis fortia facta modis. (Trist., II, 409.)
(109) Longin., Subl., xiii..
(110) Hécube
(111) Les Héraclides.
(112) Les Suppliantes
(113) Oreste.
(114) Ethic.,Niicom., VII, 8.
(115) Plat., de Republ., III, X: Cic.. Tusc., Il, 7-12.
(116) W. Schlegel, Cours de littérature dramatique, leçon Ve.
(117) Aristot.,Poet.,xxv. Cf. iii.
(118) Plutarch., de Profect. in virtut. sent., VII. Voyez, sur le sens de ce passage, les notes de Xylander et de Reiske, dans le Plutarque de ce dernier, t. VI, p. 294.
(119) Propert., Eleg.,III, ix, 9. Cf. Cic., de Clar. orat., xviii : Quintil., Instit. orat., XII, 10.
(120) Voyez, entre autres, Thesmophor.
(121) Μισογύνης;. Voyez cependant, fragments du Phryxus et de la Ménalippe, certains passages où cette aversion semble se démentir ; un surtout, publié pour la première fois en avril 1832, dans le Journal des Savants, par M. Rossignol, ou, selon la traduction du savant éditeur, Ménalippe s'exprimait ainsi : « C'est en vain que la censure des hommes lance ses traits impuissants contre les femmes, et cherche à les décrier; les femmes sont meilleures que les hommes, c'est moi qui vous le dis. »
(122) A. Gell., XV, 90.
(123) Athen., Deipn., XIII.
(124) ld., ibid.; Stobée, Serm.
(125) Inst. orat., X, i.
(126) Voyez Meineke, Hist. crit. com. graec., p. 287, 341, 417, 474.
(127) Thorn. Magist., Vit. Eurip.
(128) Les rapports de la tragédie d'Euripide avec la nouvelle comédie ont souvent attiré l'attention delà critique. Voyez, dans ces dernières années, une dissertation de M. Moncourt : De parte satyrica et comica in tragœdiis Euripidis, 1851, et, plus récemment, les deux Mémoires sur Ménandre, couronnés en 1853 par l'Académie française, et publiés, l'un, celui de M. Benoît, en 1854, sous ce titre : Essai historique et littéraire sur la comédie de Ménandre; l'autre, celui de M. G. Guizot, en 1855, sous ce litre: Ménandre, étude historique et littéraire sur la comédie et la société grecques.
(129) C'est le mot d'Aristote (Poet., xv) au sujet de discours philosophiques prêtés à une femme sans lettres, Ménalippe (voy. Menalipp, ,fragm. xxii. Cf. Dionys. Hal., Rhet., IX, ii); c'est celui d'un scoliaste {Alcest., 780) sur des développements de ce genre attribués à Hercule et à Hercule ivre I On en pourrait dire autant de quelques passages du rôle d'Hécube, dans la pièce de ce nom (Theon., Progymn.), de I'argumentation de Jocaste sur les avantages de l'égalité dans les Phéniciennes, v. 535 sqq., et surtout de cette scène fameuse et souvent citée (Plat., Gorg.; Cic. ad Herenn., II, 27; de Invent., I, 50; de Orat., Il, 37; de Republ., I, 18; Horat., Epist. l, xviii, 41; A. Gell., X, 22; D. Chrys., Orat., LXXIII, etc.) de l'Antiope, où Amphion et Zéthus passent d'une dispute sur la musique à une autre sur la philosophie. (Voyez la restitution rie ce morceau singulier, chez Valckenaer, Diatr. in Eurip., vii, viii. Con sultez aussi J. A. Hartung., Euripid. restitut., 1844, t. II, p. 415 sqq.; F. G. Wagner, Eurip. fragm., éd. F. Didot, 1847, p. 661 sqq ; H. Weill, articles sur l'Antiope d'Euripide, insérés en 1847 dans le Journal général de l'instruction publique, t. XVI, p. 850, 858 et suiv.)
(130) Dionys. Hal., de Vet. Script.
(131) Vitruv., VIII, i; Athen., Deipn., IV, XIII; Sext. Emp., Adv, Gramm., I; Clera. Alex., Strom., V; Euseb., Prœparat. évang., X, etc. Dion Chrysoslome, dans un de ses discours (Orat., xviii, de dicendi exercitio), explique par cette raison sa préférence pour Euripide.
(132) Bœttiger, Quid sit docere fabulam, Weimar, 1795; Opusc., p. 294; Ch. Magnin, De la mise en scène chez les anciens {Revue des Deux-Mondes, 1840, t. XXII, p. 285). Cf. Cic., Tusc., IV, 29.
(133) Aelian., Nat. hist., II, 13. Xénophon (Hist. graec., II, iv, 32; cf. Thucyd., VIII, 93) nous apprenant d'autre part l'existence d'un théâtre au Pirée, précisément à cette époque Démosthène, (in Mid.) parlant des fêtes de Bacchus célébrées annuellement au Pirée par des spectacles et comiques et tragiques, Valckenaer était peu fondé à prétendre (Diatrib. in Eurip., II) que les représentations dramatiques mentionnées par Elien ne le sont par aucun autre auteur, et à contester la correction du passage. Ajoutons que ce n'est point là un fait isolé. Certains bourgs de l'Attique avaient leur théâtre : nous aurons occasion de parler de celui de Colyttus, où Eschine mérita le titre que lui donna Démosthène (de Cor ; cf. Hesych.), « d'Œnomaüs de village ». Sur ces théâtres, qui n'étaient pas les seuls, on représentait des tragédies, lors des Dionysiaques appelées rurales, dont le babillard des Caractères de Théophraste (Charact., III) fixe l'époque au mois de Posidéon. Voyez, plus haut, page 12, note 2.
(134) Vit. Eurip.; Diog. Laert., II, 18. On a pensé cependant que, lorsque Platon fait dire à Socrate, dans le Ménon, d'une pensée plus spécieuse que juste : " Elle a je ne sais quoi de tragique, » ce pouvait être une allusion à certaines sentences d'Euripide (voyez Œuvres de Platon, trad. par V. Cousin, t. VI, p. 157). Ailleurs, dans le Théagés, dans le livre VIII de la République, Socrate, par une méprise qu'il n'eût peut-être pas commise lui-même, reproche avec sévérité à Euripide une sentence dont Sophocle est réellement l'auteur (voyez ibid., t. V, p. 247; IX, 179, 180). On peut penser que la fameuse distinction de l'Hippolyte, entre le serment de la langue et celui de l'âme, n'est pas oubliée dans ces citations, ces allusions malignes, qui, malgré l'amitié de Socrate pour Euripide, ne manquent pas de vraisemblance. Elle est rappelée par trois fois, dans le Théétète, dans le premier Alcibiade, dans le Banquet (voyez ibid., t. 11, p. 72; V, 49; VI, 291.
(135) Inst. orat., X, i.
(135b) Vit. Syll., iv.
(135c) Suid., v. Σοφός;. Cf. schol. Arisloph., Nub., 144; Xenoph. Plat., Apolog. Socrat.
(135d) Clem. Alex., Strom., V; Protreptic. Cf. Euseb., Préparat evang.. etc.
(135e) Arist., Rhet., III, 15.
(135f) Hipp. 698. Balzac, qui cite en le condamnant ce vers d'Euripide (le Prince, ch. xxv), le traduit ainsi :
J'aï juré de la langue et non pas de l'esprit.
(135g) Off., III, 29. Bayle (art. Euripide) préfère avec raison la manière dont le scoliaste explique ce que le poêle fait dire à Hippolyte, l'entendant de son ignorance quant à l'objet du serment qu'on lui a surpris , et par suite, de la nullité de ce serment.
(135h) Off., III, 21.
(135i) Phœniss., 524. Cf. Plutarch., Vit. Nic. Crass. compar.
(135j) Cicéron lui-même serait de cet avis si on lisait, par une transposition bien facile et bien naturelle, qu'a proposée M. Boissonade : « Capitalis Euripides, vel potius Eteocles.» D'autres critiques ont voulu effacer ces mots « vel potius Euripides » qui sont peut-être la réflexion de quelque lecteur, de quelque copiste.
(135k) Hec.,252; Orest., 890 ; Hippolyt.,487; Troad.,967; Bacch., 266; Suppl., 413; fragm. Pirith., vi; Rhadamanth., I, 5.
(135l) Hec., 1164; Phœniss., 578; Ion, 831; Med., 577
(135m) Art. Eschyle. Voyez encore l'article Euripide, où il est dit : « II est absurde d'imputer à l'auteur d'une tragédie les sentiments qu'il lait débiter par ses personnages. »
(136) Poet., xv, xxv. Cf. Dionys. Hal., de Vet. script.
(137) Arist., Poet., xviii. Un critique un peu partial pour Euripide, l'auteur de l'Euripides restitutus, J. A. Hartung, t. II, p. 3S9, de son livre, efface de ce passage d'Aristote la différence qui y est marquée entre Euripide et Sophocle quant au bon emploi du chœur, et, au moyen d'une correction qu'on peut trouver arbitraire, oppose la pratique de l'un et de l'autre à celle d'Agathon et des poètes tragiques qui ont suivi.
(138) Poll., IV, c. 16, § iii.
(139) Id., ibid.
(140) Trop souvent pour en rappeler ici les exemples qui s'offriront à nous dans l'analyse de presque toutes ses tragédies. Le plus frappant est peut-être une tirade, d'ailleurs fort belle, de son Érechthée, insérée par l'orateur Lycurgue dans le discours contre Léocrate (Cf. Plutarch., de Exsil.); la suite de ce chapitre nous offrira l'occasion de la citer.
(141) Poet,, XIII.
(142) Ibid.
(143) W. Schlegel, Cours de Littérat, dram., leç. V, trad. franc., t. I, p. 239; God. Hermann, Praefat. ad Euripid. Hecub., Lipsiae, 1800, p. Lvi, Lxii ; Animadvers. ad Hecubam, p. 143; Bœokh., Graec. trag. princ., xxiv, p. 307, etc.
(144) Arist., Rhet., iii, 2.
(145) Eunap , xxix, Scriptorum veterum nova collectio, etc., A. Mai, 1827, t. II, p. 274.
(146) Jupit. tragœd,; Necyomant.; Piscat..
(147) Vit. Nic., xxix ; Vit. Lysand., xv.
(148) Plutarch., Vit. Nic., XVII.
(149) Electr., v. 166.
(150) Philostrate, Vit. Sophist. Crit,, accuse d'avoir poussé Lysandre à cet acte de barbarie Critias, que nous rencontrerons bientôt lui-même parmi les poètes tragiques d'Athènes.
(151) Plutarch., Vit. Solon., viii.
(152) Ran., 1029 sqq.
(153) A.Gell.,XX,20; Vitruv., VIII, 3; Th. Magist.. Vit. Eurip., etc.
(154) Vit. Soph. Cf. Pausan., Att., xxi; Plin., Hist. nat., VII, 30. Le récit du biographe de Sophocle offre, on l'a remarqué, plus d'une difficulté : Décélie n'était point, comme il le dit, à onze stades d'Athènes, mais à cent vingt, et le général lacédémonien qui commandait à cette époque n'était point Lysandre, mais le roi de Lacédémone lui- même, Agis, fils d'Archidamus (voyez Thucyd., vii, 19).
(155) Bœckh., Graec,, trag. princip., v, p. 47-50; God. Hermann, Opusc., t. II, p. 159 sqq. ; Clinton, Fast, hellenic., p. 15.
(156) Vit .Sophocl. Cf. Clinton, ibid., p 25.
(157) Diog Laert., II, 45; Plutarch., Sympos., VIII, 1; Suid. ,v. Εὐριπίδης, etc. Cf. Clinton, ibid., p. 31.,
(158) Marm. Par., n° 60; schol. Aristoph., Acharn., 10. Cf. Clinton, ibid.,p.49.
(159) Apollodor. apud Diod. Sic., XIII, 103, etc. Cf. Clinton, ibid , p. 87.
(160) Diod. Sic., ibid.; Marm. Par., n° 65. Cf. Clinton, ibid., p. 89.
(161) XV, 20.
(162) Vit. Sophocl; Athen., Deipn.I.
(163) Dans un ouvrage moins exclusivement consacré à l'histoire et à l'appréciation littéraires de la tragédie grecque, il y aurait beaucoup a dire sur la constitution de ces concours dramatiques entre les tribus athéniennes, sur les fonctions, les devoirs de leurs représentants, les chorèges, sur la manière dont celui-ci entraient en partage avec l'État dans les frais de la représentation, sur l'énormité d'une dépense dont Plutarque a dit (de Glor. Athen.) : « Si on faisait le compte de ce qu'a coûté aux Athéniens chacune de leurs tragédies, on trouverait qu'ils ont plus dépensé pour jouer les Bacchantes, les Phéniciennes, les Œdipes, les infortunes de Médée et d'Electre, que pour obtenir par la guerre la liberté et l'empire. Sur les voies et moyens du théâtre athénien alimenté aux dépens des tributs payés au trésor par les alliés; sur les distributions théoriques qui mettaient le peuple à même de payer sa place au spectacle, distributions établies par Périclès dans l'intérêt de sa popularité, protégées contre toute révocation par les menaces de la loi, timidement et vainement attaquées dans des circonstances bien pressantes, où elles devenaient une charge bien lourde et bien incommode, par le patriotisme de Démosthène ; sur tous ces points, qui seraient ici imparfaitement traités, et l'ont été souvent ailleurs d'une manière spéciale et complète, voyez surtout Barthélémy (Voyage du jeune Anacharsis, xi, xxiv, Lxix, Lxxi) ; Boettiger (Opusc.,passim) ; Bœckh (Économie politique des Athéniens, II, 3, 7, 12, 13; III, 22 ; t. 1, p. 251, 299, 344, 356; II, 243 de la traduction française); Grysar (de Graec.trag. circum tempora Demosthenis; Cologne, 1830); Ch. Magnin (Origines du théâtre moderne, 1838, Introduction, t. I ; De la Mise en scène chef les anciens. — Revue des Deux-Mondes, 1839,1040, t. XIX, p. 649, XXII, 254).
(164) De ce que les trois grands tragiques d'Athènes ont été contemporains, Oh n'en doit pas conclure, selon moi, qu'ils n'ont pu représenter trois systèmes distincts de tragédie, comme semble le lfire M. Mich. Vlangali à la fin de son érudite et élégante dissertation De tragoedis graecae principibus, Paris, 1855.
(165) Une pièce ainsi refaite et reproduite s'appelait, on le voit souvent chez les scoliastes, διεσκευασμένη. Voyez Bœckh, Trag. graec. princ., iii ; Meineke, Fragm. comic, graec., t. I, p. 31, 32, etc
(166) Vit. Eschyl.; Schol. Aristoph. Acharn., 10, Ran., 892; Quintil., Inst. orat., X, i, 66; Philostr., Vit. Apollon., VI, 6; Suid., v. Εὐφορίων.
(167) Vit. Aeschyl.; Suid., ibid.; Arg. Med. Eurip.
(168) C'est le sentiment de Bœckh, ibid., mais non de God. Hermann, qui l'a combattu, Dissert. ll, de chor. Eumen. Aeschyl. Opusc., t. II, p. 155. En 1840, Gust. Exner l'a appuyé dans un ouvrage spécial, de Schola Aeschyli et trilogiarum ratione. Plus récemment, en 1845, Fr. G. Wagner, Poet. trag. graec. fragm., édit. F. Didot, p. 61 sqq.; W. G. Kayser, Hist. crit. trag. graec., p. 40-70, se sont appliqués à établir la réalité d'une école d'Eschyle dans sa propre famille, et en ont retracé l'histoire fort en détail.
(169) . Suid., vv.'Αἰσχύλος, Εὐφορίων.
(170) Suid., v. Φιλοκλῆς; schol. ad Aristoph. Av.. 281.
(171) Schol. Aristoph. Ran., 151.
(172) On l'a conclu (Fabric., Biblioth. graec., t. II, p. 311; Bœckh, ibid., III,etc.) d'un passage d'Aristophane (Pax., 807) que cependant le scoliaste entend autrement. Il peut y être en effet question d'un frère de Mélanthius, autre que Morsimus. Sur la gloutonnerie reprochée à Mélanthius par les comiques, voyez Athénée (Deipn., I, VIII, XII). Celait, selon les mêmes autorités, le vice d'un autre tragique du temps, Nothippus, et d'un tragédien plus ancien, Myniscus. Un tragédien de la même école, Simus ou Simylus, avait écrit sur l'art de la cuisine. On
(173)
(174)
(175)
(176)
(177)
(178)
(179)
(180)
(181)
(182)
(183)
(184)
(185)
(186)
(187)
(188)
(189)
(190)
(191)
(192)
(193)
(194)
(195)
(196)
(197)
(198)
(199)
(200)
(201)
(202)
(203)
(204)
(205)
(206)
(207)
(208) Ibid., § 7, p 44.
(209) Ibid., § 8, p. 44.
(210) Ibid., § 1, p. 36, note 5; § 9, p. 46.
(211) Ibid., § 8, p. 44.
(212) Ibid. § 7, p. 43.
(213) Ibid., § 8, p. 45.
(214) C'est l'imagination intellectuelle. Voy. § 7, p 43.
(215) C'est l'imagination sensible, que Plotin appelle conception des choses fausses, § 9, p. 48.
(216) Ibid, § 7, p. 43.
(217) Ibid., § 8, p. 45.
(218) Ibid, § 8, p. 45.
(219) Ibid., § 10, 11 ; p. 47, 48.
(220) Ibid., § 8, p. 45.
(221) Ibid., § 9, p. 46.
(222) C'est ce que Plotin nomme la conception des choses vraies, § 9, p. 46.
(223) Ibid., § 8, p. 44.
(224) Ibid., § 12, p. 49-50.
(225) Voy. Enn. I, liv. IV, § 10, p. 85.
(226) Voy. Enn. I, liv. I, § 11, p. 48.