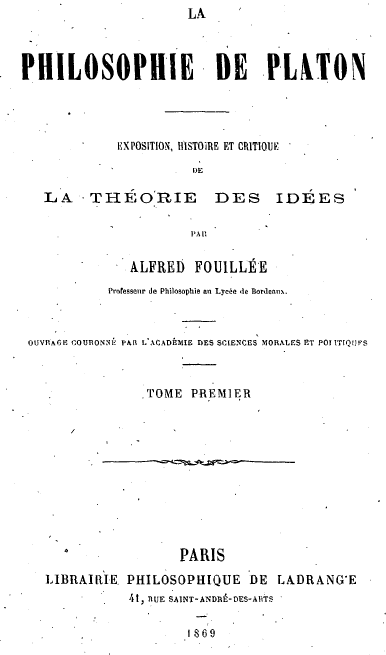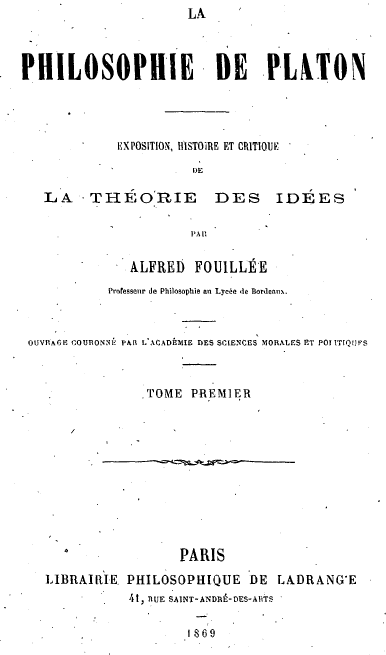|
PREMIÈRE
PARTIE
EXPOSITION DE LA PHILOSOPHIE PLATONICIENNE
LIVRE
PREMIER.
EXISTENCE DES IDÉES.
CHAPITRE III.
PREUVE DES IDÉES PAR LES CONDITIONS DE L'EXISTENCE.
I. L'Idée, principe d'essence. La détermination, l'indétermination et l'essence
mixte. - II L'Idée, type de perfection. - III. L'Idée, principe des genres. -
IV. L'Idée, cause finale.
L'analyse de la connaissance suffit pour prouver les Idées ; car elle aboutit à
cette conclusion : sans les Idées, point d'intelligence. Cherchons cependant des
preuves d'un autre ordre, et après avoir étudié les principes de la
connaissance, étudions les principes de l'existence.
Comment cette preuve ne serait-elle pas la confirmation de la première? comment
pourrait-il y avoir opposition entre la pensée et son objet, entre la raison et
la réalité? D'ailleurs, la réalité ne nous est connue que par la pensée, comme
d'autre part la pensée n'entre en acte que par la réalité qu'elle conçoit. Pas
de pensée sans l'être, pas d'être pour nous sans la pensée. Là où nous voyons
deux preuves, il n'y en a qu'une seule pour celui qui descend au fond des
choses. Telle est la connaissance, et telle est pour nous l'existence. La
connaissance a son origine dans les Idées : comment n'en serait-il pas de même
de la Nature ?
Il n'est pas inutile, cependant, de reprendre à un autre point de vue la
recherche des Idées. L'analyse de l'être sera la contrepartie et la
confirmation de l'analyse du connaître. Si nous trouvions entre les deux
points de vue des oppositions véritables et invincibles, il faudrait y
reconnaître le signe de quelque illusion naturelle et de quelque erreur
inévitable ; l'esprit humain entrerait alors en suspicion, et nous n'aurions
d'autre refuge que le doute. Si au contraire l'harmonie se maintient jusqu'au
bout entre la raison et la réalité, ne sera-ce pas la preuve que les principes
de la raison sont identiques aux principes de la réalité, les lois de la pensée
aux lois des choses?
I.
L'Idée, principe d'essence.
Considérons les objets sensibles, d'abord en eux-mêmes, puis dans leurs
relations entre eux, et recherchons quelles sont toutes leurs conditions
d'existence.
De même qu'au plus bas degré de la connaissance nous avons trouvé la sensation,
de même, au plus humble degré de l'existence, nous trouvons le phénomène
sensible, ou génération (γένεσις), « toujours en mouvement, naissant dans un
lieu, d'où il disparaît bientôt en périssant, compréhensible par l'opinion
accompagnée de la sensation (01).
Dans ce monde sensible, la variété est infinie ; mais cette variété a elle-même
son origine dans un phénomène commun, auquel se réduisent tous les autres,
auquel aboutit toute explication du monde physique : « Le mouvement est le
principe de l'existence apparente et de la génération, et le repos, celui du
non-être et de la corruption. En effet, la chaleur, le feu qui engendre et
entretient tout, est lui-même produit par
la translation et le frottement, qui ne sont que du mouvement. N'est-ce pas
là
ce qui donne naissance au feu? - Sans contredit. - L'espèce des animaux doit
aussi sa production aux mêmes principes. - Assurément. - Mais quoi? notre
corps ne se corrompt-il point par le repos et l'inaction, et ne se conserve-t-il
point principalement par l'exercice et le mouvement? - Oui. - L'âme elle-même
n'acquiert-elle pas et ne conserve-t-elle pas l'instruction, et ne devient-elle
pas meilleure par l'étude et la méditation, qui sont des mouvements ; au lieu
que le repos, c'est-à-dire le défaut de réflexion et d'étude, l'empêchent de
rien apprendre, ou lui font oublier ce qu'elle a appris? - Oui. - Le mouvement
est donc un bien pour l'âme comme pour le corps, et le repos un mal... Admets
donc cette façon de raisonner pour tout ce qui frappe tes yeux; conçois que ce
que tu appelles couleur blanche, n'est point quelque chose qui existe hors de
tes yeux, ni dans tes yeux : ne lui assigne même aucun lieu déterminé, parce
qu'ainsi elle aurait un rang marqué, une existence fixe, et ne serait plus en
voie de génération... Il faut se former la même idée de toutes les autres
qualités, telles que le dur, le chaud, et ainsi du reste; et concevoir que rien
de tout cela n'est tel en soi, mais que toutes choses sont produites avec une
diversité prodigieuse dans le mélange universel qui est une suite du
mouvement (02). » Héraclite, en ramenant tous les phénomènes au mouvement, et tous
les mouvements à l'action d'un feu intérieur qui anime, produit et détruit
toutes choses, avait parfaitement compris le caractère principal du monde
sensible.
De l'universelle mobilité résulte l'universelle indétermination. « Examine si
tu découvriras quelque chose de déterminé dans ce qui est plus chaud ou plus
froid ; ou si le plus et le moins qui réside dans cette espèce d'êtres, tant
qu'il y réside, ne les empêche point d'avoir des bornes précises; car aussitôt
qu'ils sont déterminés et finis, leur fin est venue... Tout ce qui nous paraîtra
devenir plus et moins, recevoir le fort et le doucement, et encore le trop et
les autres qualités semblables, il nous faut le rassembler en quelque sorte en
un, et le ranger dans l'espèce de l'indéterminé (τὸ ἄπειρον), suivant ce qui a
été dit plus haut, qu'il fallait, autant qu'il se peut, réunir les choses
séparées et partagées en plusieurs sortes, et les marquer du sceau de l'unité
(03). »
Cependant l'indétermination n'est pas absolue dans le monde matériel, comme le
prétendait faussement Héraclite. Nous déterminons les objets sensibles en les
qualifiant et en les nommant. Nous disons même qu'ils sont, sinon absolument, du
moins d'une certaine manière. Il faut donc admettre qu'ils sont un mélange
d'indéterminé et de détermination. Examinons-les attentivement sous chacun de
ces points de vue, et recherchons d'abord le principe de l'indétermination des
objets sensibles. Considérés en eux-mêmes, il est vrai de dire avec Héraclite,-
qu'ils n'ont aucune forme propre, aucune unité, et par conséquent aucune
existence véritable. « L'eau, en se congelant, devient, à ce qu'il semble, des
pierres et de la terre; la terre dissoute et décomposée s'évapore en air;
l'air enflammé devient du feu; le feu comprimé et éteint redevient de l'air; à
son
tour l'air condensé et épaissi se transforme en nuage et en brouillard; les
nuages, en se condensant encore plus, s'écoulent en eau ; l'eau se change de
nouveau en terres et en pierres; tout cela forme un cercle, dont toutes les
parties ont l'air de s'engendrer les unes les autres. Ainsi, ces choses ne
paraissant jamais conserver une nature propre, qui oserait affirmer que l'une
d'elles est telle chose et non pas telle autre?... Il ne faut pas parler de ces
choses comme d'individus distincts, mais. il faut les appeler toutes et chacune
des apparences soumises à de perpétuels changements. Nous appellerons donc des
apparences le feu et tout ce qui a eu un commencement.» (En effet, ce qui
commence ne peut sortir du pur néant; il est donc nécessairement un simple
changement d'apparence dans ce qui existait déjà.) « Mais l'être dans lequel.
ces choses apparaissent pour s'évanouir ensuite, celui-là seul peut être désigné
par ces mots : ceci ou cela, tandis qu'on ne peut les appliquer aux qualités...
Supposons qu'on fasse prendre successivement toutes les formes possibles à un
lingot d'or, et qu'on ne cesse de remplacer chaque forme par une autre ; si
quelqu'un, en montrant une de ces formes, demandait ce que c'est, on serait
certain de dire la vérité en répondant que c'est de l'or; mais on ne pourrait
pas dire, comme si cette forme, avait une existence réelle, que c'est un
triangle ou toute autre figure, puisque cette figure disparaît au moment même où
l'on en parle. Si donc on répondait, pour éviter toute erreur : elle est
l'apparence que vous voyez, il faudrait se contenter de cette réponse. L'être
qui contient tous les corps en lui-même est comme ce lingot d'or : il faut
toujours le désigner par le même nom, car il ne change jamais de nature;
il reçoit perpétuellement
toutes choses dans son sein, sans revêtir jamais une forme particulière
semblable à quelqu'une de celles qu'il renferme; il est le fond commun où vient
s'empreindre tout ce qui existe, et il n'a d'autre mouvement ni d'autres
formes que les mouvements et les formes des êtres qu'il contient. Ce sont eux
qui le font paraître divers... Il est donc nécessaire que ce qui doit recevoir
dans son sein toutes les formes, soit dépourvu lui-même de toute forme... En
conséquence, - cette mère du monde, ce réceptacle de tout ce qui est visible et
perceptible par les sens, nous ne l'appellerons ni terre, ni air, ni feu, ni
eau, ni rien de ce que ces corps ont formé, ni aucun des éléments dont ils sont
sortis ; mais nous ne nous tromperons pas en disant que c'est un certain être
invisible, informe, contenant toutes choses en son sein (04). » S'il faut donner
un nom à ce principe innommable, appelons-le l'indéfini ou l'indéterminé,
τὸ ἄπειρον. Ce n'est pas la matière, dans le sens ordinaire de ce mot, puisque nous
appelons matière quelque chose de déterminé, ayant des formes et des qualités
réelles. Mais c'est une matière première, qui contient en elle-même la
possibilité de toutes choses, sans être par elle-même aucune chose en
particulier.
Tel est le fond commun de tous les phénomènes sensibles; telle est la première
condition de leur existence; par là ils sont possibles, mais ils ne sont pas
encore réels. De la matière indéfinie vient ce caractère d'indétermination qui
apparaît tout d'abord dans le monde extérieur.
Mais il y a autre chose dans ce monde; ce monde n'est pas la matière pure,
l'indétermination absolue, τὸ ἄπειρον ; il a des qualités déterminées, des formes réelles, quoique
fugitives, quoique emportées par un mouvement sans fin. L'indéfini n'est pas, à
proprement parler. Peut-on dire d'une chose qu'elle est, si elle n'est point
telle ou telle chose? Où donc est l'être? il n'est pas dans l'indétermination
absolue de la matière pure : il est dans la forme que prend cette matière, qui
la définit et la détermine (τὸ πέρας).
Or, nous disons que le monde sensible existe, non d'une manière absolue, mais
dans un sens relatif, qui convient à son incessante mobilité; il naît, il
apparaît, il est donc d'une certaine manière, et s'il n'est pas l'être
véritable, au moins il est une imitation de l'être : l'apparence n'est autre
chose que cette imitation de l'existence. D'où vient donc ce commencement de
détermination que la pensée aperçoit dans les objets sensibles? Encore une fois,
la détermination ne vient pas de ces objets eux-mêmes; elle vient d'ailleurs,
elle vient de plus haut. Au-dessus d'eux, il faut bien admettre un principe de
détermination. Ce principe, appelons-le l'essence, c'est-à-dire ce qui fait que
ce qui est est tel, ou plus simplement que ce qui est est; puisque l'être est
dans la forme déterminée et non dans la matière indéterminée.
C'est ce principe de détermination, de qualification, d'existence, dont il faut
approfondir la nature.
Nous ne saurions trop le redire: Les objets sensibles n'ont par eux-mêmes aucune
essence, et cependant ils en ont une dans la réalité actuelle. Quel est donc le
principe qui explique la présence de telle ou telle qualité dans les choses?
Pourquoi, par exemple, une chose est-elle belle ou bonne? Il y a une réponse
bien simple : mais c'est souvent dans la simplicité que l'on trouve la
profondeur. Voici cette réponse : une chose
est belle par la présence de la beauté, bonne par la présence de la bonté. « Je
ne saurais comprendre toutes ces autres causes si savantes que l'on nous donne.
Si quelqu'un me dit qu'une chose est belle à cause de ses couleurs vives, ou de
sa forme, ou d'autres propriétés semblables, je laisse là toutes ces raisons
qui ne font que me troubler (05). » Et en effet, elles reculent la difficulté
sans la résoudre.; elles énumèrent les conditions d'une chose sans en faire
comprendre le principe et l'essence. « Autre chose est la cause, et autre chose
est la condition sans laquelle la cause ne serait jamais cause. » Les couleurs
vives, par exemple, ne communiqueront la beauté à un objet que si elles la
possèdent déjà en elles-mêmes; et alors d'où vient. qu'elles la possèdent?
qu'est-ce que cette beauté qu'elles contiennent? - La même question se
présentera toujours tant qu'on restera dans le domaine des causes secondaires
et particulières. « Je me dis donc à moi-même, sans façon et sans art, peut-être
même trop simplement, que ce qui rend belle une chose quelconque, c'est la
présence ou la communication de la beauté, de quelque manière que cette
communication se fasse : car, sur ce dernier point, je n'affirme rien ; ce que
j'affirme, c'est que toutes les belles choses sont belles par la présence du
beau. C'est, à mes yeux, la réponse la plus sûre pour moi et pour tout autre,
et tant que je m'en tiendrai là j'espère bien ne jamais me tromper et répondre
en toute sûreté, moi et tout autre, que c'est à la beauté que les choses belles
doivent d'être belles... De même, c'est par la grandeur que les choses grandes
sont grandes, et par la petitesse que les choses petites sont petites (τῷ καλῷ
τὰ καλὰ γίγνεται καλά, καὶ μεγέθει ἄρα τὰ μεγάλα μεγάλα) (06).
Maintenant, quels sont les caractères de cette bonté, de cette beauté, de cette
grandeur, dont la présence rend un objet bon, beau ou grand? Est-ce, par
exemple, une beauté particulière, qui appartienne seulement à l'objet où elle
se trouve et qui y soit comme épuisée tout entière? Il faudrait dire alors que
ce qui rend un objet beau, c'est sa beauté. Mais une telle réponse serait un
cercle vicieux ridicule : elle n'aurait aucun caractère scientifique; elle
serait même la négation de la science. Dire que Phédon est beau à cause de sa
beauté, ce n'est pas seulement une naïveté, c'est une erreur car la beauté n'est
point une chose propre à Phédon, une chose qui lui appartienne tout entière : la
beauté particulière qui réside dans Phédon n'a point en elle-même sa raison et
son principe : elle n'est ni nécessaire ni absolue. En d'autres termes, elle
n'est pas son essence à elle-même; car alors il serait contradictoire de
supposer Phédon sans beauté; et pourtant il n'a peut-être pas toujours eu, il
n'aura peut-être pas toujours cette beauté qu'il possède aujourd'hui. Qu'est-ce
donc, sinon une beauté d'emprunt? Ainsi Phédon n'est point le principe de la
beauté qui est en lui, et il est encore moins le principe de la beauté qui est
dans les autres. Le particulier ne peut être principe ni essence. La beauté de
tel ou tel objet se rattache donc à un principe supérieur, qui est la beauté
même, la beauté, dis-je, et non telle ou telle beauté particulière. Il en est de
même pour la bonté, pour la grandeur. - Cette proposition : - Simmias est plus
grand que Socrate, - n'est pas vraie dans son acception littérale; Simmias
n'est pas plus grand naturellement et parce qu'il est Simmias, mais à cause de
la grandeur qu'il se trouve avoir; et de même, s'il est plus grand que Socrate,
ce n'est pas parce que Socrate est Socrate, mais parce que Socrate se trouve
avoir la petitesse en comparaison de fa grandeur de Simmias (07). » La preuve en
est que Socrate lui-même, qui est petit par rapport à Simmias, est grand par
rapport à Phédon. Loin d'avoir pour essence la grandeur, il admet en lui-même
la petitesse. En un mot, les termes particuliers d'une comparaison, comme
Simmias et Socrate, ne sont point ce qui constitue le rapport de grandeur; et ce
rapport n'est lui-même que la manière dont se manifeste dans deux objets
particuliers le principe universel de la grandeur ou de la quantité. ,
L'universalité, tel est donc le premier caractère qu'offre le principe de
l'essence ou de la forme.
Le second caractère de ce principe, c'est la pureté, c'est-à-dire cette
simplicité absolue qui exclut les contraires et qui est identique à la
perfection. Socrate, nous l'avons vu, est à la fois grand et petit; « la
grandeur en soi ne peut jamais être en même temps grande et petite; il y a plus,
la grandeur même qui est en nous n'admet point la petitesse » (en tant qu'elle
est grandeur) « et ne peut être surpassée » (car alors elle deviendrait petite).
Socrate peut être surpassé par Simmias, et admettre en lui-même grandeur et
petitesse; mais la grandeur à laquelle il participe en tant qu'il est grand,
exclut absolument la petitesse. « De deux choses l'une, ou la grandeur s'enfuit
et se retire quand elle voit venir son contraire, ou elle
périt à son approche ; mais lorsqu'elle demeure et reçoit la petitesse, elle ne
peut devenir autre chose qu'elle n'était. Ainsi, moi, après avoir admis la
petitesse, restant le même Socrate que je suis, je suis ce même Socrate petit. »
Il n'y a pas contradiction entre Socrate et la petitesse, parce que Socrate
n'est pas la grandeur, quoiqu'il en participe. Il peut donc, sans cesser d'être
Socrate, admettre la petitesse; mais la grandeur qui est en lui sans être lui ne
l'admet pas : elle peut coexister dans un même sujet, qui est Socrate, avec la
petitesse; mais elle ne se confond pas avec la petitesse même. « En un mot, il
n'est pas un seul contraire qui puisse, pendant qu'il est ce qu'il est, devenir
ou être son contraire: Mais il se retire ou il périt quand l'autre arrive. » - «
Pourtant, objecte Cébès, nous avons dit tout à l'heure que les contraires
naissent toujours de leurs contraires, et maintenant nous disons qu'un contraire
ne peut jamais être contraire à lui-même, soit en nous, soit dans la nature des
choses.
» - « Alors, mon ami, nous parlions des choses qui ont en
elles les contraires et leur empruntent leur nom. » (Voici, par exemple, deux
contraires : la vie et la mort; quanti un être possède la vie (ἔχει), il a en
lui l'un des contraires et on l'appelle vivant; s'il meurt, il sera passé
d'un contraire. à l'autre, et en lui la mort sera née de la vie, qui est son
contraire.) « Mais à présent nous parlons des essences mêmes qui, par leur
présence, donnent leur nom aux choses où elles se trouvent, et ce sont ces
essences qui, selon nous, ne peuvent naître l'une de l'autre (08).
» Les essences générales qui prêtent leur forme aux objets particuliers,
excluent donc nécessairement tout mélange ; car en elles le mélange serait une
contradiction. La grandeur en soi, la grandeur parfaite, exclut nécessairement
la petitesse ; car, si elle l'admettait, elle cesserait d'être absolue et
parfaite. Le mélange des contraires est la marque infaillible de la
multiplicité, de l'impureté, de l'imperfection. Mais toute chose qui est son
essence à elle-même est simple, sans degré, sans défaut, sans contradiction
intérieure. Ce qu'elle est, elle l'est sans restriction, elle l'est absolument,
elle l'est uniquement. A cette unité, qui résulte de son universalité, elle
joint l'unité de la perfection.
De là dérive une conséquence importante. Les principes d'essence, comme la
grandeur en soi, la beauté en soi, excluant tout mélange qui altérerait la
perfection de leur essence, sont parfaitement distincts entre eux sous le
rapport même de l'essence ou de la forme. Il peut exister des essences qui
s'allient et d'autres qui s'excluent, mais lors même. qu'il y a union, l'unité
intrinsèque de chaque essence persiste, et cette unité intérieure est
précisément ce qui fait leur distinction les unes par rapport aux autres.
Unité intrinsèque et distinction réciproque des essences, - tels sont, d'après
Platon, les fondements métaphysiques de cette loi logique que l'on appellera
plus tard axiome d'identité et de contradiction. « Ce qui est grand est grand et
ne peut être en même temps petit sous le même rapport. » Cet axiome logique
suppose que chaque essence, est identique à elle-même, et qu'elle doit à sa
perfection une simplicité, une unité intérieure exclusive de tout mélange, par
laquelle telle se distingue nettement de toute essence opposée ou même
simplement différente. La raison conçoit cette nécessité métaphysique, et elle
la transforme en règle logique : l'absence de contradiction, qui est la loi de
toute essence, devient la loi de toute pensée.
« Dans une chose n'entrera jamais d'idée contraire à la
forme qui la constitue (ἀπεργάζεται). Par exemple, ce qui constitue trois, c'est
l'impair » (l'impair n'est pas un accident, mais l'essence même de trois,
essence sans laquelle trois ne pourrait exister). « L'idée du pair ne se
trouvera donc jamais dans le trois ; » car il y aurait alors contradiction, et
l'essence de trois serait détruite.
En résumé, toute chose multiple, mobile, relative et particulière, n'a point et
ne peut avoir en elle-même la raison de son essence. Il n'y a d'essence
véritable que dans l'unité, non pas l'unité vide et morte produite par
l'élimination de toute qualité, mais l'unité infiniment riche produite par
l'élévation d'une qualité à sa plus haute puissance. Alors disparaît toute
contradiction, toute négation, toute limitation. Les principes des formes, les
causes essentielles, renferment l'identité absolue qui s'exprime dans la logique
par l'absolue affirmation ; c'est donc par eux que les êtres particuliers sont
identiques à eux-mêmes et distincts des autres êtres. Ces
principes d'identité et de distinction, d'essence et de forme, ce sont les
Idées.
II. L'Idée, type de perfection.- Du
matérialisme.
L'Idée, par cela même qu'elle est un principe d'essence, nous est
apparue aussi comme un principe de perfection. Un objet ne peut être qu'à la
condition de posséder certaines qualités positives qui le déterminent en
lui-même et dans notre pensée. Autant il aura de qualités positives, et par
conséquent de perfections, autant de fois nous aurons le droit d'affirmer son
existence.
Nous l'avons vu, dans les êtres variables et multiples aucune qualité n'est pure
et parfaite : on ne peut dire que Phédon est beau, que Socrate est grand, sans
restriction et dans le sens absolu de ces termes. Il n'y a point en eux cette
simplicité infiniment riche de la beauté véritable et de la véritable grandeur.
Seule la beauté en soi est belle simplement, et sans qu'aucune négation vienne
s'ajouter à cette affirmation absolue, sans qu'aucun mélange de contraires
vienne altérer cette parfaite identité du beau avec lui-même. Le beau seul est
beau, la grandeur seule est grande, et sous l'apparente naïveté de ces termes se
cache une réelle profondeur.
De même la véritable science est celle qui sait, dans toute la simplicité et
dans toute l'universalité de ce terme; ce n'est pas cette science incomplète et
inachevée qui sait telle chose et ignore telle autre, qui par là même a est
sujette au changement et variable suivant les différents objets que nous
appelons des êtres (09).
» Non, la vraie connaissance n'est pas celle qui connaît
telle et telle chose, mais celle qui connaît tout, ou, plus simplement encore,
celle qui connaît, sans qu'il soit nécessaire de rien ajouter. Telle n'est pas
la science humaine avec toutes ses ignorances : elle a beau s''étendre;
s'accroître et faire effort pour se compléter, passant de la science d'un objet
à la science d'un autre; jamais il ne lui sera donné de se reposer dans
l'universel et de se résumer elle-même dans l'infinité de ce seul mot : « Je
sais !
»
« Je sais !
» - Expression étrange qui semble l'indétermination
même pour un esprit borné comme l'esprit de l'homme, et qui exprime cependant la
détermination la plus absolue et la perfection même de la science.
« Je sais ! »
Derrière ce mot, il n'y a rien ou il y a toutes choses ; il y a la simple
possibilité ou la complète réalité de la science, l'absolu non-être, ou l'être
absolu. Mais dans aucun de ces deux sens ce mot ne s'applique véritablement à
l'homme; car la science humaine n'est ni la pure indétermination et la pure
possibilité de la science, ni la science parfaitement déterminée et réelle;
c'est quelque chose d'intermédiaire, comme le mouvement entre le repos du
non-être et le repos de l'être, comme le nombre entre l'unité du néant et
l'unité de l'universel; c'est un trait, d'union entre la pure ignorance et la
pure science, c'est un milieu entre rien et tout.
Ce qui est vrai de la science humaine est vrai de toutes les qualités ou vertus
humaines ; et il en faut dire autant de la nature entière, mélange de perfection
et d'imperfection.
Ce mélange, comme le montre fort bien le Philèbe, doit avoir une cause.
Cette cause ne peut être elle-même un mélange, un degré particulier de
perfection ou d'imperfection : car alors on ne sortirait pas du relatif et du
multiple, et comme il n'y aurait aucune raison pour s'arrêter à tel degré plutôt
qu'à tel autre, la pensée avancerait ou reculerait toujours sans pouvoir se
fixer nulle part, sans se reposer dans l'absolu et dans l'unité. La cause du
mélange doit - donc être pure, simple, sans mélange, et par conséquent elle ne
peut être que l'absolue imperfection de la matière pure ou l'absolue perfection
de l'Idée. Le matérialisme, qui choisit la première hypothèse, prétend faire
sortir le plus du moins ; mais d'où peut venir ce surplus qui se trouve dans
l'effet, s'il n'est pas emprunté à la cause? Ne venant ni de la cause qui ne
peut donner ce qu'elle n'a pas, ni de l'effet qui n'existe pas encore et reçoit
tout de sa cause, ce surplus est évidemment sans cause. Donc, le matérialisme,
après nous avoir annoncé qu'il nous découvrirait la cause du mélangé, finit par
la supprimer. Sans doute le plus est communiqué au moins, mais non par le moins.
Si le monde est le développement d'un germe que la Pauvreté ou la Matière reçoit
dans son sein, encore faut-il que ce germe fécondant y ait été déposé par la
Richesse ou la Perfection. L'Amour, c'est-à-dire ce monde mobile qui aspire sans
cesse au bien, et qu'un désir insatiable pousse au développement et au progrès,
ne doit donc à sa mère, l'Imperfection radicale, que sa: possibilité et la
condition passive de son existence ; mais il doit à son père, le Parfait, son
existence réelle et son activité (10). Le
matérialisme confond, par une erreur grossière, le réceptacle (ἐκμαγεῖον) (11)
avec la vraie cause.
Si vous voulez trouver la vraie cause d'un être, ne regardez pas au-dessous de
lui, mais au-dessus ; ne cherchez pas seulement d'où il vient, mais encore, mais
surtout où il va ; ne vous contentez pas de regarder le sein qui l'a reçu,
découvrez le germe fécondant qui lui a donné la forme et la vie. La vraie raison
des choses, c'est le parfait ou l'Idée, qui est à la fois cause et modèle, ou
cause exemplaire : αἴτιον παραδειγματικόν (12). Les
degrés relatifs du bien ne s'expliquent que par l'absolu du bien.
Aristote, dans son traité sur la Philosophie, où il résumait les leçons
de son maître, exprime avec une admirable précision cette formule platonicienne
qui rattache la perfection relative à la perfection absolue. « En général, là où
se trouve du plus parfait (et du moins, c'est-à-dire des degrés),
là existe aussi le parfait. Si donc il y a dans les êtres tel être
meilleur que tel autre, il faut qu'il existe aussi quelque chose de parfait, qui
ne peut être que le divin (13).
»
Impossible de mieux dégager le procédé fondamental
du platonisme, qui consiste à expliquer les degrés des choses, ou le mixte, par
l'absolu et le pur, c'est-à-dire par le parfait. Nous l'avons vu, pourquoi
disons-nous que Phédon est plus beau que Socrate? Est-ce seulement parce que
nous le comparons à Socrate? - Réponse incomplète et qui ne pénètre pas au fond
de la difficulté! Cette comparaison de Phédon avec Socrate n'est elle-même
possible que si une lumière supérieure vient éclairer les deux termes; je veux
dire cette lumière de la beauté absolue au milieu de laquelle nous apercevons
tout ensemble Phédon et Socrate, comme deux ombres dans lesquelles l'obscurité
n'est pas complète, et qui empruntent inégalement au soleil de la beauté une
partie de sa lumière. Alors nous disons que Phédon est plus beau que Socrate,
c'est-à-dire qu'il participe davantage à la beauté, mais sans la posséder tout
entière. Ainsi donc la connaissance de la beauté relative a pour condition celle
de la beauté absolue; et de même, dans la réalité, la première n'existe que par
la seconde dont elle est l'imitation. « Là où se trouve le meilleur, existe
aussi le parfait.
»
En résumé, la variété des choses sensibles est produite par le concours de deux
termes : la matière première et indéterminée, semblable à l'obscurité complète ;
la forme déterminante, ou type de perfection, analogue à la pure lumière. Le
monde sensible est la région des ombres où la lumière se mêle à l'obscurité dans
les proportions les plus diverses, où le parfait se reflète dans l'imparfait
avec plus ou moins de netteté. La cause du mélange est le bien absolu, l'unité
concrète qui enveloppe toutes les qualités positives, et non l'unité abstraite
qui les exclut. Tel est le grand principe du platonisme : Identité de la
perfection avec la détermination et par conséquent avec l'existence. C'est le
parfait qui constitue le réel.; c'est le Bien, τὸ ἀγαθόν, qui est la source de
toute existence ; et les, différents aspects du bien par rapport au monde où il
se reflète, les apparences diverses de l'unité par rapport à la multiplicité, ce
sont les types éternels, principes de perfection, causes exemplaires de toutes
choses ; ce sont les Idées.
III. L'Idée, principe des genres.
Jusqu'à présent, nous avons considéré les objets en eux-mêmes,
dans leur essence et leurs qualités. Si nous les considérons maintenant dans
leurs relations mutuelles, ils nous apparaîtront sous de nouveaux aspects,-
genres, lois et fins, - dont l'ensemble constitue l'ordre du monde.
La connaissance n'a point pour objet l'individu, sujet au changement, à la
naissance et à la mort ; car elle serait variable elle-même et s'évanouirait
dans l'indétermination. Ni la multiplicité pure ni la pure unité ne sont l'objet
ordinaire de la science humaine, du moins de la science discursive : l'unité
pure n'est saisissable que dans l'unité de l'intuition, et la multiplicité
indéfinie se conçoit indirectement par un raisonnement bâtard, à peine
compréhensible. Les objets ordinaires de la science, ce sont les rapports, chose
intermédiaire entre le multiple et l'un : tout rapport, en effet, suppose
l'unité dans la multiplicité.
Entre les divers individus l'esprit saisit des rapports de ressemblance ou
d'opposition. S'il considère les ressemblances isolément, en faisant abstraction
des différences, l'idée ainsi obtenue est générale.
Çette idée n'existe-t-elle que dans notre esprit, et ne suppose-t-elle rien' en
dehors de l'esprit lui-même ou des objets particuliers qui ont servi de termes à
la comparaison? -
Les genres ne désignent pas des individus, mais s'ensuit-il qu'ils ne désignent
rien de réel? Parmi les notions générales, il en est sans doute que l'esprit
forme à son gré et qui semblent de pures fictions. Et cependant, même dans ces
idées factices, l'esprit est peut-être moins créateur qu'il ne le semble;
peut-être une analyse plus profonde découvrirait-elle, même dans nos chimères,
des éléments nombreux de réalité. La possibilité de concevoir une chimère
suppose quelque principe réel d'où cette possibilité dérive (14).
N'importe ; accordons qu'il y a des notions tout artificielles, et considérons
exclusivement celles que la nature même nous enseigne à produire, celles qu'on
retrouve dans toutes les langues parce qu'elles existent dans tous les esprits.
Cette universalité de certaines notions prouve qu'elles sont tout au moins des
lois de la pensée et le résultat nécessaire du développement intellectuel. Ne
sont-elles rien de plus, et n'y a-t-il absolument rien qui leur corresponde en
dehors de nous? Cela est impossible; car comment la nature viendrait-elle se
conformer d'elle-même aux conceptions de notre pensée? comment se
soumettrait-elle aux lois de notre intelligence? Confiez à la terre le germe
d'une fleur, et vous savez à l'avance que ce germe produira une fleur semblable
à celle d'où il est sorti: jamais la fleur n'engendrera autre chose qu'une fleur
de son espèce. Cette espèce n'est donc pas seulement dans votre esprit ; elle
est dans les choses mêmes, et les lois de la pensée sont les lois de la nature.
Cependant, si les genres et les espèces sont dans les objets particuliers, il
faut reconnaître qu'en
L'IDÉE, PRINCIPE DE$ GENRES. 73
même temps ils dépassent de l'infini ces mêmes ob¬jets. Le type général déborde,
pour ainsi dire, les choses présentes : il s'étend dans le passé et dans
l'avenir; bien plus, il déborde la réalité tout entière, présente, passée ou
future, et embrasse le possible, qui n'existera peut-être jamais, mais qui
pourrait exister. Ne dites donc pas que les genres sont seule-ment dans les
choses et existent par elles ; ne voyez-vous pas plutôt que ce sont les choses
particulières qui existent par les genres, que ce sont les phéno¬mènes qui
existent par la loi? La loi qui préside à la génération de la fleur et qui la
fait sortir du germe, n'est pas l'effet de cette fleur qui n'existe pas encore;
elle en est plutôt la cause. « C'est le semblable, objec¬tera-t-on, qui produit
par lui-même le semblable (1). v Etrange explication qui n'est qu'une pétition
de prin¬cipe : ces deux semblables, l'un engendrant, l'autre engendré, d'où
vient qu'ils sont semblables? C'est pré¬cisément cette ressemblance qui étonne
et qu'il s'agit d'expliquer. Suffit-il pour cela de répondre par la question
même, et de dire qu'un être particulier a la vertu de produiré un être semblable
à lui? Encore une fois, c'est cette vertu même, qu'il s'agit d'expli¬quer; c'est
cette possibilité indéfinie des semblables dont il faut donner la raison ; et
tant que vous reste¬rez dans le domaine des êtres particuliers, vous
n'ob¬tiendrez aucune raison générale et absolue : la diffi¬culté reculera à
l'infini dans la série rétrograde des causes secondes, mais elle subsistera tant
que l'esprit . ne se reposera pas dans une cause première (2).
(t) V. plus loin les chapitres sur Aristote.
(2) Cf.. Jacobi, Des chose' divines, Appendice C. « Les genres, les Idées de
Platon, existent en réalité et en vérité avant les espèces et les choses
particulières, et dans le sens le plus propre et le plus strict, elles
74 EXISTENCE DES IDÉES.
Concluons que les genres et les lois existent dans les choses sensibles, mais
mutilés et incomplets. Le par¬ticulier aura beau s'ajouter au particulier, il ne
sera jamais identique au général. Les genres et les lois sont la condition des
objets individuels, loin d'en être l'effet. S'ils ne sont pas eux-mêmes des
causes, ils expriment du moins le rapport des effets à leur cause première. Là
est la grande conception platoni¬cienne : les notions générales sont des
rapports, mais non pas seulement des rapports entre les objets par¬ticuliers,
comme l'enseigne une logique vulgaire; car ces rapports supposent eux-mêmes un
rapport supé¬rieur celui des objets particuliers et imparfaits avec l'être
universel ;et parfait, qui est l'unité absolue. Ainsi, au-dessus de la-matière,
comme au-dessus de
rendent d'abord celles-ci possibles, .de la même manière que la pensée du
premier inventeur et le modèle qu'il a construit sur cette pensée, existent
avant le nombre infini des copies, qui se font d'après la vue et la règle du
modéle, en sorte que cette multiplicité postérieure n'est devenue possible qu'au
moyen de l'unité antérieure et lui doit sa nais¬sance ; mais il ne se peut, en
aucune façon, que l'unité, qui a donné nais¬sance à la pluralité, devienne
elle-même multiple ; elle demeure à jamais l'unité, et ne peut absolument pas
être multiple. Il ne saurait rien sortir de la pluralité, en tant que pluralité
; de l'unité, il ne sort jamais que l'unité. On n'invente point' des montres,
des vaisseaux, des métiers, des langues ; mais on invente une ou la montre, un
ou le vaisseau, une ou celte langue. On ne peut et l'on ne doit dire d'aucune
chose particulière et individuelle de ces différentes espèces, d'aucune montre,-
d'aucun vaisseau, d'aucune langue, qu'elle est la montre, le vaisseau, la
langue. Cette manière de s'exprimer ne convient qu'à une cause, qu'on l'appelle
comme on voudra, espèce, loi, pensée ou âme, d'où est provenu le mul¬tiple, et
d'où il continue à provenir. » Malebranche dit aussi : Il semble même que
l'esprit ne:serait pas capable de se représenter les Idées. uni¬verselles de
genre, d'espèce, etc., s'il ne voyait tous les êtres renfermés en un
(c'est-à-dire dans leur Idée). Car, toute créature étant un être particulier, on
ne peut pas dire qu'on voye quelque chose de créé, lors-qu'on voit un triangle
en général. Enfin, je ne crois pas qu'on puisse rendre raison de plusieurs
vérités abstraites et générales, que par la présence de celui qui peut éclairer
l'esprit en une infinité de façons différentes. (Recherche de la vérité, v. m,
ch. 6.)
l'esprit, il faut admettre un principe qui explique la réalisation des genres
dans la matière et la concep¬tion des genres dans l'esprit. Cette « cause
exem¬plaire de ce qu'il y a de constant dans la nature n et clans la pensée
humaine, c'est l'Idée (1).
IV. L'Idée, cause finale.
« N'y a-t-il point deux sortes de choses, l'une qui est pour elle-même, l'autre
qui en désire sans cesse une autre? - Comment, et de quelle chose parles-tu?
L'une est très-noble de sa nature, l'autre lui est in¬férieure en dignité...
Celle-ci est toujours faite en vue de quelque autre chose ; l'autre est celle en
vue de laquelle se fait ordinairement tout le reste... Conçois à présent le
phénomène et l'être. Lequel des deux di¬rons-nous qui est fait à cause de.
l'autre?... Mais la chose en vue de laquelle les autres se font doit être mise
dans la-classe du bien ; et il faut mettre dans une clisse toute différente ce
qui se fait en vue d'une autre chose (2). »
Ainsi, le caractère essentiel du monde sensible, c'est la mobilité, la
génération, le devenir (i -' veaiç). Mais conçoit-on le mouvement sans un but
auquel il aspire? Si un objet se suffisait à lui-même, admettrait-il le
changement et le développement? Non sans
1) Aristot., Dlét., XII, 242. Procl. in Partnen. éd. Cousin, V, 133
Keidi yraty i BEVCxpzcnç, Eivxt "d l%) 6ép.EVOç airiav rxpaSEtYu.artxnv Twv xxrà
(AMY &Et aUVEaTc,rG1V... 'O p.àv cÛV GEVOlgATYÇ Tcûrcv ir apiaxcvra Till
xaer,7ap.dvt TGV 4GV t Cà; dvi-pa4 E, Xtilptarfv awT7V xat eEtav alTtav
TteillEVG:. L'opinion
d'Alcinoüs est parfaitement d'accord avec le témoignage de Xénocrate. Introd. in
Platon., viii : 'Op:;cvrcc eà Tnv iSiav aapciSEt7ua Twv xxrà yûan' aiuivtcv
(1eg. aïmvimv?). Diogène de Laerte;semble aussi faire allusion à la définition
rapportée par Xénocrate ; III; Ltivn : Tàç eà ïSiaç Üalara.Tat
&Lrlaç Ttvàç X7.1 d.pXàç TGb T06xIT.x Eévac T& aÛact a'VEaTWTa et 7riG ta tY
airG.
2) Philèbe, 27. a. b. c.
76 EXISTENCE DES IDÉES.
doute, et il faut dire que le mouvement existe à cause du but, le moyen à cause
de la fin, l'imparfait à cause du bien qui est la perfection, l'amour à cause de
l'objet aimé.
Le bien, fin dernière des choses , existe donc par lui-même et pour lui-même,
Set, de plus, c'est 'pour lui seul qu'existe le reste : le vrai principe de
toute chose imparfaite, c'est l'Idée du meilleur, c'est la perfection.
Sans doute le mouvement suppose, non-seulement une fin, mais un moteur.
Cependant la cause motrice n'est point la raison dernière et véritable du
mouve¬ment. Lé mouvement ne pourrait se produire sans un but; la cause du
mouvement serait donc impuissante et inactive si ce but n'existait pas. Aussi
les causes motrices sont-elles pour Platon « au nombre de ces
causes secondaires et comme auxiliaires (GUVXLT:6)v),
dont Dieu se sert pour représenter l'Idée du bien aussi parfaitement qu'il est
possible. » a La plupart des hommes les regardent, non comme des causes
secon¬daires, comme des moyens auxiliaires, mais comme les vraies causes de
toutes choses, parce qu'elles re¬froidissent, échauffent, condensent, liquéfient
et pro¬duisent d'autres effets semblables. Mais il ne peut y avoir en elles ni
raison ni intelligence. Car, de tous les êtres, le seul qui puisse posséder
l'intelligence, c'est l'âme;, or l'âme est invisible, tandis que le feu, l'eau,
la terre et l'air sont tous des corps visibles. Mais celui qui aime
l'intelligence et la science doit rechercher, comme les vraies causes premières,
les causes intelli
gentes (Tx; T ; ÉiU.ppoVOç ?LM »; airixç IreG)T c; tJ.er2k;)Zetv), et
mettre au, rang des causes secondaires toutes celles qui sont mues et meuvent
nécessairement. Il faut suivre et exposer ces deux genres de causes, en trai-
L'IDÉE, CAUSE FINALE. 77
tant séparément de celles qui produisent avec intel¬ligence ce qui est beau et
bon, et de celles qui, dépour¬vues de raison, agissent au hasard et sans ordre
(1). »
Socrate, pendant sa jeunesse, était possédé du dé-sir d'apprendre. cette science
qu'on appelle la phy¬sique ; mais il reconnut bientôt l'insuffisance d'une
science qui se réduit tout entière à la considération des causes motrices, et
qui néglige la fin en faveur des moyens,'les raisons véritables en faveur de
rai-sons secondaires. a Enfin, ayant un jour entendu quelqu'un lire, dans un.
livre qu'il. disait être d'Anaxa¬gore, que l'intelligence est l'ordonnatrice et
le prin-, cipe de toutes choses, je fus ravi; il me parut con¬venable que
l'intelligence eût tout ordonné et tout disposé dans le meilleur ordre possible.
Si donc, pen¬sai-je, quelqu'un veut trouver la cause de chaque chose, comment
elle naît, périt ou existe, il faut qu'il cherche comment l'être, l'action ou
une modification quelconque, sont pour elle ce qu'il y a de meilleur ; et
d'après ce principe, il s'ensuit que l'homme ne doit chercher à connaître, dans
ce qui le concerne comme dans ce qui se rapporte à quoi que ce soit,'que ce qui
est le meilleur et le plus parfait. Que l'on dise, par exemple, que, si je
n'avais ni os ni muscles, je ne pourrais faire ce que je jugerais à propos, on
dira la vérité; mais dire que ces os. et ces muscles sont la cause de ce que je
fais, et non pas la préférence pour ce qui est le meilleur, en quoi je me sers
de l'intel¬ligence, voilà une explication de la dernière faiblesse : c'est ne
pouvoir pas-faire cette distinction qu'autre chose est la cause, et autre chose
ce sans quoi la cause ne serait jamais cause ; c'est pourtant à ce qui
(1) Timée, 46, c. Cf. Phil., 27, a, et Polit., 128.
-78 EXISTENCE DES IDÉES.
sert de moyen que la plupart des hommes, marchant à tâtons comme dans_les
ténèbres, donnent impro¬prement le nom de cause... Ils n'admettent pas le
principe du bien, nécessaire pour tout lier et tout sou-tenir. Quant à moi, pour
apprendre quelle est cette cause, je me serais fait volontiers le disciple de
qui que ce fût ; mais n'ayant pu parvenir à la connaître, ni par moi ni par les
autres, j'allai à sa recherche par une voie nouvelle (1). D
Cette voie consiste à regarder comme cause véri¬table d'un objet la perfection
idéale de ce même objet, c'est-à-dire son Idée. Pour Platon , la méthode des
causes finales et la méthode des Idées sont absolu-ment identiques, et il expose
la seconde dans le Phé¬don, comme application de la première (2). Entre la cause
exemplaire et la cause finale, il n'y a pour lui aucune différence. L'artiste «
qui a les yeux fixés sur l'idéal et qui s'efforce d'en reproduire la vertu, D
n'a d'autre fin que l'idéal lui-même. Ainsi l'intelligence divine a. pour modèle
la perfection, le bien, soit qu'elle porte en elle-même ce modèle, soit qu'elle
s'en dis¬tingue ; et'sa fin est également le bien. Elle n'agirait point si le
bien n'existait pas; elle aurait beau conte¬nir en elle-même la puissance
efficiente, elle ne pour-rait la manifester et la développer; car cette
manifes¬tation, étant sans motif et sans but, serait sans raison, Si donc la
cause efficiente explique la réalité de l'effet, la cause finale, à son tour,
explique l'action de la cause efficiente, et ainsi, au premier rang des causes,
il faut placer, non pas l'activité, non pas la pensée, non pas même l'être, mais
le bien.
1) Phoedo, 100, sqq.
2) La première appartient à Socrate, la seconde à Platon, qui a changé la cause
finale en Idée. Phcedo 100, 101 et ss.
L'IDÉE, CAUSE FINALE. 79
A cette hauteur, la métaphysique et la morale s'u¬nissent dans la communauté
d'un même principe, et c'est pour ainsi dire la moralité et la bonté des choses
qui en explique l'existence. Toute qualité, toute'es¬sence, dérive du bien et
n'est complétement intelli¬gible que si on l'élève au degré de la perfection.
Tout genre, toute loi, dérive du bien et n'est intelligible que par un modèle
idéal qui est la perfection même. Tout mouvement, enfin, tout changement
s'explique par un but idéal qui est encore la perfection. Il y a un principe qui
se repose à jamais clans son unité et sa pu¬reté, tandis que la nature inquiète
le poursuit et le dé-sire : ce principe esi l'Idée.
L'Idée est donc la raison suprême de l'existence, comme elle est la raison
suprême de la connaissance. C'est tout à la fois une forme de'l'être et une
forme de la pensée, par laquelle l'être devient intelligible et la pensée
intelligente. L'être et la pensée émanent d'un même foyer; ce sont les rayons
d'un même soleil intelligible ; et s'il y a partout harmonie entre
l'intelligence et l'existence, c'est que la pensée et l'être ne font qu'un à
leur origine dans ce centre commun des Idées, qui est le Bien (1).
(l) Nous reviendrons sur la cause finale et sur la cause efficiente dans la
Théodicée.
(01) Timée,
52, a. τὸ δὲ ὁμώνυμον ὅμοιόν τε ἐκείνῳ δεύτερον, αἰσθητόν, γεννητόν,
πεφορημένον ἀεί, γιγνόμενόν τε ἔν τινι τόπῳ καὶ πάλιν ἐκεῖθεν ἀπολλύμενον, δόξῃ
μετ᾽ αἰσθήσεως περιληπτόν·
(02) Théét., 153, 154.
(03) Philèbe, 23 c. et ss.
(04) Timée, 50; a. b. c.
(05) Phéd., 100, 101.
(06) Phéd., 101, a.
(07) Phéd., 102, b.
(08) Phéd., ib. Nous corrigeons
la traduction Cousin, qui contient un énorme non-sens.
(09) Phèdre, 248 et ss.
(10) Banquet, 208.
(11) Timée, 50.
(12)
Procl., in Parm. V, 133.
(13) Λέγει δὲ περὶ τούτου ἐν τοῖς περὶ φιλοσοφίας.
Καθόλου γάρ, ἐν οἷς ἐστι τὸ βέλτιον, ἐν τούτοις ἐστὶ καὶ τὸ ἄριστον· ἐπεὶ οὖν
ἐστιν ἐν τοῖς οὖσι ἄλλο ἄλλου βέλτιον, ἔστι ἄρα τι καὶ ἄριστον, ὅπερ εἴη ἂν τὸ
θεῖον. - Simplicius, de Coelo. (Aldd.; 67;b.)
(14) Nous ne laissons pas d'affirmer d'une manière
absolue les vérités que nous avons une fois découvertes, que les objets existent
ou n'existent pas ; ce qui ne pourrait avoir lieu, si ces vérités dépendaient
uniquement de l'existence des objets, et si elles ne subsistaient pas toujours
comme des possibilités, dont la réalité est fondée dans quelque chose d'actuel
ou dans les Idées.
«Les scolastiques, dit Leibnitz, ont fort disputé de constantia subjecti,
c'est-à-dire comment la proposition faite sur un sujet peut avoir une vérité
réelle, si ce sujet n'existe pas.
» C'est que la vérité n'est que conditionnelle, et dit qu'en cas que le sujet
existe jamais, on le trouvera tel.
» Mais on demandera en quoi est fondée cette connexion, puisqu'il y'a de la
réalité là dedans qui ne trompe pas.
» La réponse sera qu'elle est dans la liaison des idées.
» Mais on demandera en répliquant où seraient ces idées, si aucun esprit
n'existait, et que deviendrait alors le fondement réel de cette certitude des
vérités éternelles?
» Cela nous conduit au dernier fondement des vérités, savoir à cet esprit
suprême et universel, qui ne peut manquer d'exister, dont l'entendement est la
région des vérités éternelles. Et afin qu'on ne pense pas qu'il n'est point
nécessaire d'y recourir, il faut considérer que les vérités nécessaires
contiennent la raison déterminante des existences mêmes, en un mot, les lofs de
l'univers. Ainsi, ces vérités étant antérieures aux existences des êtres
contingents, il faut bien qu'elles soient fondées dans l'existence d'une
substance nécessaire. » (Nouveaux Essais sur l'entendement humain, liv.
IV, ch. 2.)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28) Id.
(29) Id., 39, a.
(30) Théét., 189, e., 190, a.
(31) Th. 199, 200 et ss.
(32) Th. 207 et ss.
(33) Leibnitz : Il y a de l'être dans toute
proposition.
(34) Cf. Phédon. 102, e.
(35) Ὡς τὸ δοξαστὸν πρὸς τὸ γνωστόν, οὕτως τὸ
ὁμοιωθὲν πρὸς τὸ ᾦ
ὡμοιώθη. Rép., 510, a.
(36) Le Théétète n'a d'autre but que de
montrer l'insuffisance de Ia sensation et de l'opinion. C'est un dialogue
négatif, comme le soutiennent Ast, Socher, Stallbaum, Ueberweg, Zeller et Grote.
Mais ce dernier prétend que, au delà de ce résultat négatif, Platon ne tend à
aucune doctrine positive, qu'il n'y a dans le Théétète aucune allusion
aux Idées, et que les difficultés soulevées dans ce dialague ne reçoivent aucune
solution dans les autres ouvrages de Platon. Ces trois points sont également
erronés. Prétendre que Platon n'avait aucune doctrine positive sur la nature de
la science, est-ce comprendre les théories platoniciennes? Nous verrons dans la
République et dans tous les autres dialogues la fausseté de cette assertion.
En second lieu, Platon laisse clairement entrevoir les Idées dans le Théétète,
1° quand il représente le philosophe comme se demandant : qu'est-ce que
l'homme? et non qu'est-ce que tel ou tel homme? - Qu'est-ce que le juste? et non
ceci est-il juste? 2° Quand il parle de l'être, de l'unité, de la
différence, impliqués dans le jugement, de l'essence et de la vérité, objets de
la science, etc.
Quant à l'absence de solution dont parle M. Grote, nous verrons plus tard ce
qu'il en faut penser. - V. Grote Plato, t. lI, Theaetetus.
(37) Rép., VI, 510 c. d. et ss., 511, a. b.
- Cf.
Lettre VII « Ce cercle est un dessin qu'on efface, une figure matérielle
qui se brise ; tandis que le cercle lui-même (αὐτόκυκλον) auquel tout cela se
rapporte ne souffre pourtant rien de tout cela. » Cousin, 97.
(38) εἰς μίαν τε ἰδέαν συνορῶντα ἄγειν τὰ
πολλαχῇ διεσπαρμένα, ἵνα ἕκαστον ὁριζόμενος δῆλον ποιῇ (Phèdre, 265, d.)
(39) Arist., Mét. XIII.
(40)Voir notre travail spécial sur Socrate.
(41) Phédo, loc. cit.
(42) Philéb., p.58. - « Le cercle véritable
ne peut avoir en lui-même, ni en petite ni en grande quantité, rien de contraire
à sa nature. » Lettre VII. Cousin, 98.
(43) Rép. VII, 525.
(44) Rép. VI, 507 c.
(45) Phédo, 75.
(46) Philèbe, 58.
(47) Théet. 196 e. Dans ses symboles
mathématiques, Platon appelle la science l'unité ou le point; le raisonnement,
la dualité ou la longueur; l'opinion, la triplicité ou surface ; et la
sensation, le nombre quatre ou le solide. V. plus loin un important passage
d'Arist. Liv. Il, les Nombres. Sur l'Idée de la science v. l'analyse du
Parménide.
(48) Dans la Lettre VII, la plus authentique de
toutes (M. Grote admet même que toutes le sont) nous trouvons une confirmation
remarquable de l'exposition qui précède. « Il y a dans tout être trois choses
qui sont la condition de la connaissance : en quatrième lieu vient la
connaissance elle-même, et en cinquième lieu ce qu'il s'agit de connaitre, la
vérité (l'Idée). La première chose est le nom, la seconde .la définition, la
troisième l'image; la science est la quatrième... Le cercle a d'abord un nom...
puis une définition composée de noms et de verbes... Le cercle matériel est un
dessin qu'on efface... tandis que le cercle en soi est essentiellement
différent. Vient ensuite la science, la pensée, l'opinion vraie sur cet objet »
(Ce sont les trois degrés de la connaissance, raison, raisonnement et opinion).
» Prises ensemble ces trois choses sont un nouvel élément qui n'est ni dans les
noms, ni dans les figures des corps, mais dans les âmes ; d'où il est clair que
sa nature diffère et du cercle en soi et des autres choses dont nous avons
parlé.» C'est-à-dire que les états subjectifs et les notions de notre âme,
intuitives, discursives, ou purement conjecturales, diffèrent à la fois des
objets sensibles, des noms et des objets intelligibles ou Idées. Eclatante
réfutation de ceux qui prennent les Idées de Platon pour des notions générales
et subjectives. « De ces quatre éléments, le νοῦς est celui qui, par ses
ressemblances et son affinité naturelle, se rapproche le plus du cinquième
(l'Idée), les autres (raisonnement, opinion, mots, figures) en diffèrent
beaucoup plus. » (342 c.) - Donc les Idées sont les objets de la science et des
notions scientifiques; le subjectif est seulement analogue à l'objectif, en
vertu du principe platonicien que la connaissance doit être analogue à l'objet
connu (Arist., De an., 404b.)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59) Sur un lit de parade. - Cet usage a duré
longtemps. V. Sévigné, Lettr., 8 déc. 1679, et comp. Labruyère, ch. VII,
De la Ville, av.-dern, alinéa.
(60) Six livres : Histoire des empereurs
romains depuis Auguste jusqu'à l'an 410; simple résumé jusqu'à Dioclétien,
le récit est plus développé à partir du règne de ce prince. Il manque la fin du
1er livre, le commencement du second, c'est-à-dire la fin du règne de Probus,
les règnes de Carus, de Numérien et de Carin (liv. 1), puis les règnes de
Dioclétien, de Maximien, de Constance et de Galerius jusqu'à l'an 305 de J.-C.;
il manque aussi la fin du 6e.
(61) Sévère.
(62) Comp. plus.haut, p. 144-145, Eusèbe,
Chronic., II, sub ann. Ol. 254, 1, apr. J.-C. 235.
(63) Apr. J-C. 237.
(64) Apr. J.-C. 253.
(65) Apr. J.-C. 254.
(66) Agrippina (Colonia), Cologne (an de J.-C.
260).
(67) C'est-à-dire cantonnées chez les Celtes.
(68) An de J.-C. 276.
(69) An de J.-C. 277.
(70) An de J.-C. 277. - Eumène (Paneg. de
Constance Chl., 18) rappelle ce fait d'incroyable audace de prisonniers
francs « qui a Ponto usque correptis navibus, Graeciam Asiamgiie populati, nec
impune plerisque Libye littoribus appulsi, ipsas postremo navalibus quondam
victoriis ceperant Syracusas, etc.
(71) An de J.-C. 307.
(72) An de J.-C. 308.
(73) An de. J.-C. 312.
(74) An de J-C. 313.
(75) An de J.-C. 317.
(76) An de J.-C. 332.
(77) An de J.C. 337. Les deux princes ici
mentionnés étaient fils de Constantin 1er, dit le Grand.
(78) An de J.-C. 350 : Le repas se prolongea fort
avancé dans la nuit... Toè d¢ sumposÛou m¡xri m¡svn ¤ktay¡ntow nuktÇr, õ
Magn¡ntiow di‹ ti d°yen tÇn ŽnagkaÛvn dianstŒw ¤k toè deÛpnou kaÜ pròw braxç tÇn
daitumñnvn ¥autòn Žpost®saw, ¤faÛneto toÝw sumpñtaiw Ësper ¤n skhn» t¯n
basilik¯n ±mfiesm¡now stol®n. TÇn de ktl.
(79) Ce passage est traduit d'Aurelius Victor (De
Vita et Moribus impp. rom., XLI) ou puisé à la même source « Constans fugere
conatus apud Helenam oppidum Pyrenaeo proximum a Gaisone cum lectissimis misso
interficitur anno III dominationis. - Helena, Elne (Pyrén.-Orientales),
nommée primitivement Illiberis.
(80) An de J.-C. 350.
(81) An de J.-C. 351. Saint Jérôme dit « son frère.
»
(82) An de J.-C. 352. - V. la note 2 de la page
ci-contre.
(83) La perte de la bataille de Mursa, en Pannonie
(351), lui avait porté un coup dont il n'avait pu se relever. Il avait dans son
armée des cohortes gauloises ou celtes; il en engagea quatre qui périrent
jusqu'au dernier homme dans un stade près de la ville où il les avait postées.
Zosime, II, 50. ToætÄ (stadÛÄ) KeltÇn f‹laggaw t¡ssaraw ¤nap¡krucen... xriw ÷te
di¡fyeiran "pantaw .- Sur Magnence et sa tyrannie, v. ci-après Socrate, II, 25,
32. Selon cet historien, Mursa est une place forte des Gaules (froærion d¢ toèto
tÇn GalliÇn), à trois journées de marche de Lyon, et Adrien de Valois n'hésite
pas à y voir la petite ville de La Mure en Dauphiné. « Eam esse existimat Hadr.
Valesius, quæ, sublata una littera, nunc appellatur Mura, La Mure, et in
Delphinatu posita est, abestque ab urbe Lugduno leugas circiter XXV aut etiam
XXX, quod trium dierum iter facile conficitur. Note de D. Bouq. - Sozornène,
Hist. eccl., IV, 7 (v. ci-apr.), copie Socrate.
(84) Sur le rôle de l'impératrice Eusébie en cette
affaire, v. ci-apr. Socrate, Hist. eccl., III, 1. Comp. Amm. Marcell.,
XV, VIII, 1 : Queis (Constantii proximis) adnitentibus obstinate, opponebat se
solaregina, incertum...... an pro nativa prudentia consulens in commune,
omnibusque memorans anteponi debere propinquum....
(85) Comp. plus bas Socrate, Hist. eccl.,
liv. II, 1, et Sozomène, Hist., eccl., V, 1-3. Ces écrivains chrétiens
apprécient avec assez d'impartialité dans le nouveau césar et dans le successeur
de Constance l'homme de guerre, l'administrateur, le philosophe et le
restaurateur impuissant d'une religion à jamais déchue.
(86) 350 ap. J.-C. - Socrate, ibid., indique
l'espèce de désordres auxquels le jeune césar dut avant tout remédier.
87) Pour les détails de la
bataille d'Argentoratum (apr. J.-C. 357), v. les développements un peu
emphatiques d'Amm. Marcellin (XVI,,12). Selon lui, les pertes des Romains furent
insignifiantes : Ceciderunt autem in hac pugna Romani quidem CCXL et in rectores
vero IV... ex Alamannis vero sex millia corporum inventa sunt in campo
constrata, et inaestimabiles mortuorum acervi per undas fluminis ferebantur...
(88) Ici, comme plus haut, dans le XIIIe fragm.
d'Eunape, p. 128-9, il faudrait sans doute écrire Vadomarios ou Vadomarius. Cf.
Amm. Marcel:, XIV, X, 1 et ailleurs.
(89) Les quatre lignes qui précédent se trouvent
dans les extraits de D. Bouquet. - 900 stades = 180 m. X 900 st. = 162 kil. -
C'est de la Bretagne qu'il tirait d'habitude ses approvisionnements, annona a
Britannis sueta transferri. Amm. Marcell., XVIII, II, 3.
(90) Ce morceau, à partir d'ici, se trouve dans D.
B.
(91) Comp. plus haut, p. 122-129, le dramatique
récit d'Eunape.
(92) An de J.-C. 359.
(93) Amm. Marcell.,. XX, IV, 1 : .... Urebant
Juliani virtutes, quas per ora gentium diversarum fama celebrior efundebat...
(94) An de J.-C. 360. - Cf. Amm. Marcel l., ibid.,
11 : cum ambigeretur diutius qua pergerent via, placuit...... per Parisios
homines transire, ubi morabatur adhuc caesar nusquam motus...
(95) Comp. Ammien, ibid., 14, 17 : ...
lmpositusque scuto pedestri et sublatius eminens, nullo silente, Augustus
renuntiatus ...
(96) Il était le beau-père du nouvel empereur
Jovien, et avait été chargé, avec Procope et Valentinien (le successeur de
Jovien), de porter aux armées la nouvelle de la mort de Julien. - Apr. J.-C.
363.
(97) Apr. J.-C. 366.
(98) Charietton périt dans cette bataille: V., Amm.
Marcell., XXVII, 1.
(99) An de J.-C. 366.
(100) Valentinien demeura toute cette année dans
le N.-E. de la Gaule, à Reims, à Metz, à Chalons, pour surveiller les desseins
des Alamans.
(101) An de J.-C. 375.
(102) An de J.-C. 379.
(103) Ces mauvaises nouvelles étaient le
déplorable état de la Thessalie et de la Macédoine, et la négligence de
Théodose, son associé à l'empire, qui, sans être touché des misères publiques,
ne songeait qu'a donner à Constantinople un luxe et des plaisirs en rapport avec
la grandeur de la ville.
(104) An de J.-C. 383.
(105) An de J.-C. 388. Magister officiorum.
« C'était une espèce de ministre universel, dont les fonctions étaient fort
étendues ; il rendait la justice à presque tous les employés du palais (palatini),
etc., etc. » Guizot, Hist. de la civil. en France, t. III, p. 9, in-8°.
(106) Comp. ci-après Philostorge, XI, 1, p. 283.
- Grég. de Tours, 11;9, donne, d'après Sulpice Alexandre, d'autres détails
intéressants ... Valentiniano, pene infra privati modum redacto, militaris rei
cura Francis satellitibus tradita...
(107) An de J.-C. 392. - Cf. Philostorg., ibid.,
p. 85.
(108) An de J.-C. 395.
(109) Proprement « adoré, » selon l'usage.
(110) Littéralement des « paeans. » - Cf. ci-apr.
Philost., p. 288-289.
(111) An de J.-C. 405.
(112) A Honorius qui voulait passer en Orient
pour venir en aide à son jeune neveu, Théodose II, que la mort d'Arcadius venait
de mettre en possession du trône.
(113) An de J.-C. 407.
(114) Ici commence l'extrait de D. Bouquet.
(115) An de J.-C. 408.
(116) An de J.-C. 406.
(117) De l'empereur Julien.
|