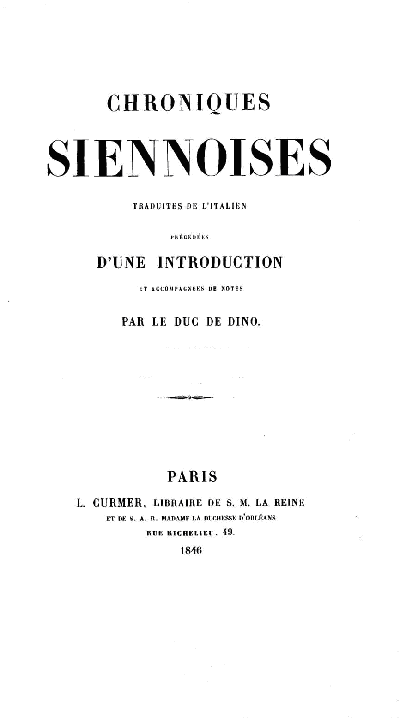
Nicolo de Giovanni de Francesco Ventura
CHRONIQUES SIENNOISES
Œuvre numérisée par Marc Szwajcer
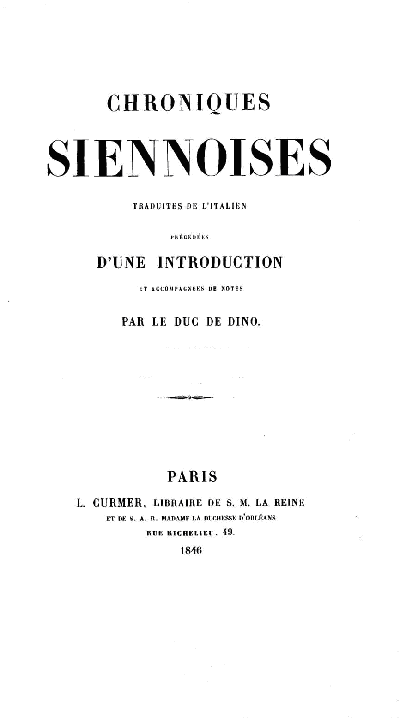
CHRONIQUES SIENNOISES
Œuvre numérisée par Marc Szwajcer
IN NOMINE DOMINI NOSTRI.
L'histoire suivante, après avoir exposé de quelle manière les Siennois battirent les Florentins à Monte-Aperto, raconte en détail toutes les circonstances qui se rattachent à ce grand événement.
Dans le courant de l'année 1260, les Montalcinaisiens, sujets de la commune de Sienne, se révoltèrent contre elle, et réclamèrent l'appui de la commune de Florence, qui résolut de secourir Montalcino, en y faisant pénétrer, malgré les Siennois, des troupes et des vivres. Mais les Florentins, sentant bien qu'ils n'étaient pas assez puissants par eux-mêmes pour mener à bonne fin une pareille entreprise, requirent leurs alliés et adhérents de se joindre à eux pour marcher contre la commune de Sienne. Aussitôt dix-huit cents cavaliers de Lucques, seize cents de Pistoia, quinze cents de Prato, deux mille de Volterra, quatorze cents de Colligiano, tous parfaitement équipés et pleins d'ardeur, se rendirent à leur appel. En outre, San Miniato leur envoya quatorze cents cavaliers ; San Gimignano, quinze cents ; Val d'Eisa, trois mille six cents ; les Arétins vinrent au nombre de deux mille. Les habitants d'Orbietano firent marcher deux mille cavaliers ; le comte Aldobrandino de Pitigliano (1) en amena mille ; Pierre Minella de Campilla, six cents. Quatre mille six cents hommes d'une valeur éprouvée quittèrent dans le même but la Lombardie. Le reste de l'armée se composa de Florentins, dont la majeure partie appartenait au corps même de la ville de Florence. Après s'être rassemblées et organisées pendant le mois d'août, toutes ces troupes, formant une armée d'environ trente mille combattants, sortirent de Florence, le 1er septembre 1260, et s'avancèrent sur notre territoire, dans le but d'approvisionner Montalcino, de s'emparer ensuite de la ville de Sienne, de la soumettre aux Florentins, et de permettre à la fureur des soldats de la saccager, ainsi que nos campagnes. Les troupes, florentines vinrent camper à Pieve Asciata (2) : là, tous les bagages ayant rejoint l'armée, le capitaine et les commissaires des Florentins tinrent conseil, et prirent le parti d'envoyer une ambassade aux Siennois. Les ambassadeurs, munis d'instructions suffisantes, quittèrent Pieve Asciata, et arrivèrent à Sienne le 2 septembre.
A cette époque, la ville était gouvernée par vingt-quatre citoyens notables (3) et un camerlingue ; le podestat était M, Francesco Troisi. Aussitôt après leur arrivée, les deux ambassadeurs se rendirent au sein du conseil, qui tenait ses séances dans l'église Saint-Christophe (4), située sur la place Tolomei. Ils entrèrent sans se découvrir et sans manifester le moindre respect pour la présence des magistrats, puis ils exposèrent leur mission en ces termes : «Nous exigeons que cette ville soit détruite, et que ses murs soient entièrement abattus, afin de pouvoir y entrer et en sortir selon qu'il nous plaira et par où nous le voudrons. Nous prétendons, en outre, établir une seigneurie à notre gré dans chaque Tiers de Sienne. Nous voulons de plus, et dès à présent, construire dans Campo Reggio (5) une forte citadelle, la munir de troupes et de vivres, et la garder pour notre illustre commune de Florence. Que tout cela soit exécuté sans aucun délai. Si vous n'effectuez pas immédiatement tout ce que nous venons de vous commander, vous pouvez être certains d'avoir à soutenir l'assaut de notre puissante commune de Florence. Nous vous déclarons, en outre, que plus tard nous serons sourds à toute espèce de prières ; ainsi donc, faites-nous savoir sur-le-champ quelles sont vos intentions. »
Après avoir entendu la sommation inique qui venait de leur être adressée, les vingt-quatre répondirent : « Nous avons écouté et entendu ce que vous demandez, et nous vous invitons à retourner vers le capitaine et les commissaires de votre commune, pour leur dire qu'il leur sera répondu de vive voix. » Alors les ambassadeurs retournèrent au camp des Florentins. Ceux-ci avaient quitté Pieve Asciata, tandis que leurs envoyés se rendaient à Sienne, et ils s'étaient avancés jusqu'à Monte-Aperto, où ils établirent leur camp, entre la Malena et le val di Biena (6), dans la plaine appelée le Cortine. Ce fut en ce lieu que les ambassadeurs allèrent rendre compte au capitaine et aux commissaires que les vingt-quatre, après avoir écouté leur message, s'étaient bornés à répondre qu'ils feraient connaître leur détermination de vive voix. Les troupes campèrent en cet endroit, en attendant les Siennois.
Dès que les ambassadeurs florentins eurent quitté Sienne, les hommes sages et prudents qui gouvernaient la ville (les vingt-quatre magistrats) rassemblèrent un conseil dans l'église de Saint-Christophe, pour exposer la nature des demandes des Florentins, et la manière dont elles avaient été formulées par leurs envoyés. En apprenant le but de cette étrange ambassade, l'un des membres du conseil, messire Bandinello, se leva et dit : « Messieurs les conseillers, et vous sages citoyens, il me semble que l'on doit obtempérer à toutes les exigences des Florentins, pour détourner de nous de plus grands malheurs. Je pense donc qu'il vaut mieux démolir les murailles dans certaines parties de la ville, que d'en venir à de si terribles extrémités. »
M. Buonaguida Boccacci et d'autres conseillers opinèrent dans le même sens, mais leur avis ne prévalut point. Alors messire Provenzano Salvani (7) s'écria : « Comme vous le savez, messieurs les conseillers, nous sommes protégés par le roi Manfred, et nous avons dans notre ville le comte Giordano, son vicaire, qui est à notre disposition, avec les troupes qu'il commande ; il conviendrait de l'informer de toutes ces choses. Mon avis est donc qu'on l'envoie chercher immédiatement, et qu'on lui rapporte, sans rien dissimuler, les discours des ambassadeurs.»
La plus grande partie des conseillers adopta la proposition de M. Provenzano. Le comte Giordano, appelé au conseil, vint à Saint-Christophe, suivi de seize connétables de cinquante hommes par bannière, et de son sénéchal, de sorte qu'ils étaient dix-huit Allemands : comme ils ne comprenaient pas notre langue, ils se firent accompagner par un interprète. En arrivant, ils se découvrirent simultanément et s'inclinèrent devant la régence et son conseil ; puis, ayant fait avancer leur interprète, ils demandèrent ce que la seigneurie attendait d'eux. Un des conseillers, chargé de répliquer à l'interprète, se leva et répondit : « Messire Giordano, et vous vaillants et hardis chevaliers, voici les choses qui nous ont été dites par les ambassadeurs de la commune de Florence. » Il énuméra alors successivement les diverses exigences émises par les Florentins.
Lorsque l'interprète en eut donné connaissance à messire Giordano (8), celui-ci ainsi que ses compagnons en témoignèrent une vive satisfaction, et s'étant retirés à l'écart, ils délibérèrent en allemand sur ce qu'ils devaient faire, afin de conserver leur honneur et de défendre vigoureusement la ville. Les conseillers, témoins de la joie de messire Giordano et de ses compagnons, résolurent de leur accorder un mois entier de double paye, pour les encourager à battre les Florentins et leurs alliés. On obtint sans peine l'adhésion du conseil. Tout ceci se passait le jeudi 2 septembre. Après avoir instruit les Allemands de la décision qui les concernait, on calcula le montant de la somme nécessaire à l'accomplissement de cette promesse, et l'on vit qu'il fallait cent dix-huit mille florins d'or. Les conseillers firent inutilement chercher cette somme dans la ville : il fut impossible de réunir une masse d'argent si considérable. Alors, avant que le conseil sortît de l'église Saint-Christophe, un de ses membres, noble siennois, nommé Salimbene Salimbeni, réclama un moment d'attention (9) : «Messieurs les vingt-quatre, et vous sages et honorables conseillers, dit-il, c'est peut-être de ma part une grande présomption d'oser prendre la parole dans un tel lieu ; mais le grand besoin dans lequel nous nous trouvons m'enhardit à vous offrir la quantité de florins demandée, pour que vous la fassiez servir à notre salut commun. »
Cette offre généreuse ayant été acceptée par les vingtquatre et par le conseil avec les démonstrations de la satisfaction la plus vive, Salimbene Salimbeni quitta l'église, et alla chercher l'argent dans son palais. Il le fit placer sur un chariot couvert d'une tenture écarlate et orné de branches d'olivier, et le conduisit en grande pompe sur la place Saint-Christophe, voulant, par cette manifestation, témoigner la joie qu'il éprouvait de pouvoir prêter à la commune de Sienne la somme énorme de cent dix-huit mille florins d'or. Lorsque le conseil eut reçu l'argent, il le fit distribuer au comte Giordano et à ses compagnons. Ceux-ci réunirent sans tarder les huit cents Allemands placés sous leurs ordres : c'étaient tous des hommes hardis, éprouvés, vieillis dans le métier des armes. Le comte leur parla en ces termes : «Nous avons touché toute notre solde et même un mois entier de double paye ; ainsi donc prenez deux fois ce qui vous est dû.» Transportés de ravissement, ces braves soldats se mirent à danser, enchantant nombre de refrains allemands ; puis ils se répandirent dans la ville et achetèrent tous les cuirs qu'ils purent trouver, afin de préparer l'équipement de leurs chevaux. On vit alors telle personne, qui dans d'autres temps avait été occupée à changer la monnaie et les florins à la banque, fabriquer des housses de selle ; on vit les orfèvres, les ébénistes, les tailleurs, tous les artisans enfin, rivaliser de zèle avec le reste de la population, pour satisfaire les soldats sur lesquels reposaient les plus chères espérances de la cité.
Ces derniers, déjà remplis d'ardeur et d'allégresse, ne tardèrent pas en effet à se trouver bien équipés et bien montés.
L'annonce de la cruelle sommation faite par les Florentins s'étant ébruitée dans la ville, tandis qu'on cherchait l'argent nécessaire pour solder les troupes, les habitants sortirent de leurs maisons et vinrent à SaintChristophe ; on aurait peine à se figurer la foule qui encombrait alors la place Tolomei et les rues avoisinantes.
Les vingt-quatre, remarquant cette émotion populaire, convoquèrent aussitôt un conseil : ils proposèrent de nommer un syndic auquel on abandonnerait tous les pouvoirs, dont l'autorité serait aussi grande à elle seule que celle de tous les citoyens nommés pour diriger les affaires de la commune, et qui, de plus, aurait le droit illimité de donner, de vendre ou d'engager Sienne et son territoire.
Les conseillers, comme s'ils avaient été inspirés de Dieu, élurent d'un commun accord un homme qui, par la pratique de vertus exemplaires, avait conquis la plus légitime influence sur ses concitoyens : cet homme s'appelait Buonaguida Lucari. On lui conféra, ainsi que nous l'avons dit déjà, une autorité pleine et entière. Au moment où ce syndic fut élu, notre père spirituel monseigneur l'évêque fit sonner les cloches afin de rassembler dans l'église du Dôme le clergé de Sienne, prêtres, chanoines, moines et religieux. Lorsque monseigneur l'évêque les vit tous réunis, il leur adressa une courte allocution, commençant par ces mots : Tantum est ministri virginis Dei, etc.) Il exhorta tous les membres du clergé à remplir leur devoir en implorant Dieu, la sainte Vierge Marie et tous les saints, en faveur du peuple et de la ville, pour qu'il plût au Seigneur de les sauver d'un cruel assujettissement, d'une ruine inévitable, et pour que de même que Ninive fut délivrée par les jeûnes et les prières, de même le Seigneur éloignât de Sienne le joug et l'extermination dont les Florentins la menaçaient. Il ordonna ensuite à chaque homme de se déchausser et de faire une procession dans l'intérieur du Dôme, en chantant des psaumes, des hymnes sacrées et des litanies.
Pendant que monseigneur l'évêque, accompagné de son clergé, faisait la procession ordonnée, Dieu, touché par les prières de sa Mère, par celles des prêtres et de toutes les âmes pieuses qui l'imploraient dans la ville, éclaira tout à coup l'esprit du syndic, messire Buonaguida, qui, se levant, s'écria, d'une voix tellement forte qu'il fut entendu de tous les citoyens rassemblés en dehors, sur la place Saint-Christophe : « Comme vous le savez, messieurs les Siennois, nous sommes recommandés au roi Manfred ; mais à présent il me semble que nous devons donner nos biens et nos personnes, la ville et son territoire, à la reine d'éternelle vie, je veux dire à notre Dame la Vierge Marie, mère de Dieu. Veuillez tous m'accompagner pour accomplir cette donation. »
Après avoir prononcé ces paroles, Buonaguida se dépouilla de ses vêtements, ne conservant que sa chemise ; puis, s'étant déchaussé, et s'étant mis une corde autour du cou, il s'achemina, tête nue, vers le Dôme, suivi de tous les citoyens qui se trouvaient réunis sur la place, et dont la foule se grossissait à chaque pas ; la plupart d'entre eux étaient nu-pieds, sans manteaux, la tête découverte. Pendant tout le trajet, Buonaguida ne cessait de s'écrier : «Glorieuse Vierge Marie, reine du ciel, venez à notre secours dans notre grande nécessité, pour nous délivrer de nos ennemis les Florentins ; ce sont des lions qui veulent nous dévorer. » Et tout le peuple ajoutait : «Madone, reine du ciel, nous implorons votre miséricorde. »
Ils arrivèrent ainsi près du Dôme, au moment où monseigneur l'évêque, achevant sa procession, commençait à chanter, devant le maître-autel dédié à Notre Dame, le Te Deum laudamus. Buonaguida se trouva à la porte du temple au commencement de ce chant sacré, et se mit à crier à haute voix : Miséricorde ; aussitôt le peuple qui le suivait répéta : Miséricorde. A ces cris, monseigneur l'évêque se retourna, et vint avec tout son clergé au-devant de messire Buonaguida. S'étant rencontrés presque au pied du chœur du Dôme, chacun d'eux s'inclina. Buonaguida était à demi prosterné : monseigneur l'évêque le releva en lui donnant le baiser de paix. Cet exemple fut imité par tous les citoyens, qui s'embrassèrent les uns les autres sur la bouche.
Monseigneur l'évêque et messire Buonaguida, se tenant par la main, s'avancèrent vers l'autel, où ils s'agenouillèrent devant l'image de notre mère la Vierge Marie en versant des torrents de larmes. Buonaguida demeura agenouillé durant un quart d'heure, ainsi que tout le peuple, qui poussait de grandes lamentations, et dont on entendait les fréquents sanglots ; puis, se relevant seul et se plaçant devant l'image de notre mère la Vierge Marie, il s'écria : « Vierge gracieuse, reine du ciel, mère des malheureux et des repentants ; moi, misérable pécheur, je vous donne et recommande cette ville de Sienne, ainsi que ses campagnes, et vous prie, mère du ciel, de vouloir bien l'accepter, quoique l'offrande soit indigne de votre toute-puissance. Je vous prie de même, et vous supplie, de garder notre ville, de la défendre contre nos ennemis les Florentins, et de la délivrer de tous ceux qui chercheraient à l'opprimer ou à la soumettre. »
Après cette invocation, monseigneur l'évêque monta en chaire, et fit un très beau sermon, dans lequel il invitait $S peuple à l'union et à la concorde, enjoignant à tous de se donner de nouveau le baiser de paix, de se pardonner réciproquement leurs injures, de se confesser, de communier, et de se recommander, ainsi que leur ville, à la glorieuse Vierge Marie. Il finit par engager tous les fidèles à le suivre, avec son clergé, dans une procession solennelle.
En tête de cette procession, on portait un crucifix sculpté, qui se trouve dans le Dôme, à côté du campanile, au-dessus de l'autel de Saint-Jacques coupé en deux (10). Derrière ce crucifix marchaient tous les religieux ; puis venait un dais, sous lequel était placée l'image de notre mère la Vierge Marie. Immédiatement après s'avançait monseigneur l'évêque, pieds nus, ayant à côté de lui Buonaguida, portant, comme nous l'avons dit, une corde au cou ; apparaissaient ensuite les chanoines du Dôme, les pieds déchaussés et la tête nue, chantant des psaumes divins, des litanies et des prières ; derrière eux, se pressait une masse de peuple. Les femmes, sans chaussures, échevelées pour la plupart, se recommandaient incessamment à Dieu et à sa mère la très sainte Vierge, répétant des Pater noster, des Ave Maria et autres oraisons. Cette procession, qu'un sentiment pieux transportait, pensait peu à la terre qu'elle foulait aux pieds. Le cortège se rendit sur-le-champ à Saint-Christophe (11), et de là au Dôme, où la foule encombra les confessionnaux, afin de se préparer à communier et à faire les actes de contrition qui lui avaient été recommandés. On vit alors celui qui était le plus offensé chercher son ennemi, afin de sceller, dans un baiser expiatoire, le pardon de l'injure qu'il en avait reçue.
Il faut que tu saches, lecteur, qu'on fit à cette époque placer dans le Dôme, au-dessus du maître-autel, devant lequel avait été faite la donation de la ville, un tableau peint sur bois, représentant notre Dame la très sainte Vierge Marie, mère du Sauveur, tenant entre ses bras son Fils, dans la main duquel on plaça une charte commémorative de l'abandon fait à la sainte Vierge. Plus tard, ce tableau fut enlevé du maître-autel, et posé au-dessus de celui que l'on appelle aujourd'hui l'autel de Saint-Boniface. Cet autel s'éleva dans le Dôme, le long du campanile ; le tableau se nomme la Madone des Grâces. Porte-lui dévotion, lecteur, car elle est encore plus gracieuse qu'on ne le dit, Mais avant de continuer, je veux t'avertir que la madone qui surmontait le maître-autel du Dôme, lorsqu'eut lieu la donation de la ville à la sainte Vierge, était un tableau plus petit et beaucoup plus ancien, ayant au centre une figure de vierge de demi-grandeur, ainsi que les figures %ii sont groupées à l'entour. Tu peux la voir à présent, car elle est attachée, sans avoir d'autel, au campanile, dans'le Dôme, près de la porte du Pardon. On fit ensuite celle dont nous avons parlé plus haut, et qui fut nommée la Madone des Grâces ; dans la suite, on peignit ce beau tableau qu'on entoura d'un riche ornement intérieur, afin de rendre un plus éclatant hommage à Notre Dame, à laquelle nous ne saurions faire trop d'offrandes pour la protection qu'elle accorda à la ville de Sienne et à ses habitants (12).
Tandis que les Siennois se succédaient dans les confessionnaux, Buonaguida, accompagné de quelques personnes, sortit du Dôme et retourna à Saint-Christophe, où, de concert avec les vingt-quatre, il adopta des résolutions extrêmement prévoyantes et sages.
On était alors au jeudi 3 septembre : la plus grande partie de la nuit fut employée par le peuple à se confesser (13).
Lorsque l'heure des matines fut sonnée, les vingt-quatre firent publier dans chacun des trois quartiers de Sienne la proclamation suivante : «Debout, vaillants citoyens, armez-vous, prenez vos bonnes armures, et que chacun suive son gonfalonier en se recommandant toujours à Dieu et à sa Mère.» Le crieur public avait à peine rempli sa tâche, que les citoyens accoururent de leur propre mouvement, sans que le père attendît le fils, ni le frère son frère, et s'acheminèrent vers la porte Santo Viene, rendez-vous des gonfaloniers. Celui de Saint-Martin y arriva le premier, d'abord par respect pour le saint, ensuite parce que son quartier se trouvait le plus rapproché de la porte.
Le second gonfalon fut celui de la ville ; il était escorté d'une grande quantité de peuple rangé en bon ordre. Le troisième fut le gonfalon royal de Camollia, qui représentait le manteau pur et blanc de notre mère la Vierge Marie. Derrière ce gonfalon, se pressait une foule nombreuse composée non seulement du peuple, mais aussi de soldats à pied et à cheval ; à cette multitude étaient mêlés des prêtres et des moines, les uns armés, les autres sans armes, venus pour encourager les troupes, par leurs paroles ou par leur exemple, à combattre ces Florentins qui osaient demander, avec tant d'orgueil, des choses d'une si visible déraison et d'une iniquité si révoltante.
Le vendredi matin, après le départ de toute la population masculine, les courageuses femmes restées à Sienne firent une procession solennelle, conduite par monseigneur l'évêque et par tout son clergé ; on y porta les reliques qui se trouvaient dans le Dôme et celles déposées dans les autres édifices religieux de Sienne. Cette procession alla d'église en église, les prêtres chantant toujours des psaumes divins, des litanies et des oraisons ; les femmes, pieds nus et couvertes de poussière, suivaient le cortège en priant Dieu de leur rendre leurs pères, leurs enfants, leurs frères, leurs maris.
Bien qu'on eût observé un jeûne rigoureux, la procession parcourut la ville jusqu'au soir. Elle s'en retourna alors au Dôme, et là tout le monde s'agenouilla en attendant que monseigneur l'évêque de Sienne eût récité toutes les litanies en l'honneur de Dieu et de sa Mère, qui est aussi la nôtre. Ensuite on se confessa, et l'on récita beaucoup d'autres prières. «Nous vous prions spécialement, ô madone très sainte, disait cette foule pieuse, de secourir notre peuple, de lui donner la valeur, l'audace et la force nécessaires pour remporter la victoire sur ses ennemis, sur ceux qui ont voulu et pourraient vouloir l'outrager, afin de briser l'orgueil monstrueux de ces Florentins, vrais chiens maudits et iniques. Et nous vous prions encore, ô notre mère, de faire en sorte que les Florentins ne puissent opposer au peuple siennois, qui est votre peuple, ni résistance, ni force, ni courage. O vous, notre madone et mère, secourez de vos conseils votre ville de Sienne. »
Ayant ainsi raconté comment notre père le pieux évêque, les citoyens et les femmes, s'étaient mis en prières pour demander au Seigneur et à sa sainte mère Marie de donner la victoire à la ville de Sienne et à son peuple, nous parlerons maintenant des troupes composant l'armée.
Dès que le soleil commença à se lever sur la journée bénie du vendredi 3 septembre, les troupes, rangées en bataille et bien préparées, s'acheminèrent vers le Bozzone. Les bataillons marchaient étroitement unis, sous la conduite du sénéchal de la commune de Sienne et celle de monseigneur le comte Giordano.
Le premier, appelé Nicolo de Bigozzi, était un homme plein de courage et de prudence ; l'autre sénéchal, égale ment rempli de mérite, était le comte d'Arasi. Tous deux cherchaient à pourvoir les troupes de ce qui pouvait leur être nécessaire, selon les inspirations et les conseils de leur expérience. Les soldats se suivaient de près, en côtoyant le Bozzone et en invoquant l'appui du ciel. L'armée atteignit ainsi le pied d'une colline, dit le Poggio des Rospoli, et qui faisait face au lieu où l'on voyait apparaître le camp de l'armée florentine.
Parvenues en cet endroit, nos troupes s'arrêtèrent, et tous les capitaines, gonfaloniers et sénéchaux, s'étant rejoints, prirent le parti de s'emparer de la hauteur de la manière suivante. D'abord mille cavaliers, dont huit cents Allemands et deux cents Siennois ou autres amis de la commune de Sienne, commencèrent à gravir la colline en bon ordre ; après eux venait Jean de Guastelloni, gonfalonier du tiers de Saint-Martin, précédé du gonfalon sur lequel était représentée l'image de ce saint, et suivi de la plus grande partie des gens de Sienne. Ils étaient tous vêtus d'habits rouges, selon l'ordre qu'ils en avaient reçu.
Arrivés sur la crête de la colline, du côté qui regardait le camp florentin, ils se mirent en ordre de bataille et présentèrent à l'ennemi un rassemblement imposant. A cette vue, le capitaine de l'armée florentine demanda à quelqu'un qui se trouvait près de lui quels étaient ces hommes. On lui répondit : «Celui-ci est le commandant de mille cavaliers que le roi Manfred a envoyés aux Siennois pour défendre leur ville. Je puis vous assurer qu'ils sont tous jeunes, parfaitement montés et équipés, vaillants et très experts en faits d'armes ; j'ajouterai que la troupe que vous voyez sur la hauteur est la moins nombreuse des trois tiers de Sienne, et s'appelle le tiers de Saint-Martin.»
Le capitaine des Florentins reprit alors : « Tu prétends que ce tiers est le moins considérable des trois ; mais il me semble qu'ils sont plus pressés que des fourmis, et si, comme tu le dis, celui-ci est le moins nombreux, je me demande comment doivent être les deux autres. »
Lorsqu'après avoir légèrement dépassé le coteau, le tiers de Saint-Martin se fut mis en bataille, la plupart des citoyens descendirent pour aller à la rencontre du gonfalon de la Ville. Les vestes rouges furent immédiatement échangées contre des vestes vertes semblables à celles que portait le tiers de la Ville. Ils suivirent, sous ce nouvel habillement, Jacomo da Fondo, gonfalonier dû tiers de la Ville, dont le gonfalon était de gueules à une croix blanche, et ils commencèrent à gravir la colline, du côté des Florentins. Arrivés sur le plateau, ils se déployèrent en ligne de bataille. Une partie d'entre eux, dépassant la hauteur, ôtèrent leurs habits, et descendirent l'autre versant de la montagne en se dirigeant vers le troisième gonfalon, qui était tout blanc, et plus grand qu'aucun de ceux déjà rassemblés. Lorsqu'ils l'eurent rejoint, ils retournèrent leurs vestes, parce que le tiers de Camollia les portait de deux nuances, c'est-à-dire blanc par-dessus et noir dessous, selon les couleurs adoptées dans les armoiries de la ville de Sienne. On vit alors apparaître Bartolomeo Rinaldini, suivi d'un vaste et magnifique carroccio, chargé de symboles de joie et d'ornements de triomphe, que surmontait ce superbe gonfalon blanc autour duquel se pressait toute la population de Sienne. Cette dernière troupe gravit la colline en suivant, à l'exemple des deux autres divisions, le côté qui se présentait aux regards des Florentins. Dès que le carroccio, avec toutes les bannières et gonfalons, eut été amené jusqu'au sommet, on l'arrêta, et les troupes se rangèrent en bataille à l'entour.
Sur ces entrefaites, les commissaires florentins et le capitaine général, ainsi que tous les autres chefs, s'étant réunis, se dirent entre eux : «Comment se fait-il que ces Bestiolini (14) aient eu l'audace de sortir en rase campagne au-devant de nous ?» L'un d'eux répliqua : « Ce qu'il y a de certain, c'est que leurs troupes sont mieux disposées et infiniment plus nombreuses que les nôtres ; d'ailleurs, n'oublions pas que le peuple de Sienne est le plus résolu et le plus hardi qu'il y ait en Toscane et en Lombardie ; que partout où se trouvent les Siennois, ils veulent se faire honneur. Rappelez-vous comment ils nous ont traités jadis en diverses rencontres » (15). Le capitaine des Florentins ajouta : « Plus j'y pense, et plus je crois que nous avons agi avec témérité.» Et, s'étant retourné vers les commissaires, il continua en ces termes : « Vous disiez que la ville de Sienne était dépourvue de soldats, et voici qu'on y a formé trois corps, dont deux, même sans compter la multitude de cavaliers qui les accompagne, sont véritablement beaucoup plus considérables que notre propre armée. Comment se nomment, ajouta-t-il, ces maisons là-haut ? quel est le nom de la rivière qui coule à droite, et comment appelez-vous celle qui coule à gauche ? » On lui répondit : « Ces maisons s'appellent les Cortine ; l'une de ces rivières est la Malena, l'autre la Biena. » A ces mots le capitaine, se rappelant qu'on lui avait prédit qu'il mourrait entre le mal et le bien, dans la plaine des Cortine, dit en se parlant à lui-même : « Ainsi donc, nous sommes entre le mal et le bien. » Effrayé par cette pensée, il ajouta : «Je le répète, nous avons agi imprudemment. Pour ma part, je suis d'avis de changer le plus vite possible de position ; mais comme l'heure des vêpres est déjà passée, et qu'il est trop tard maintenant pour partir, nous pouvons préparer nos équipages pour le point du jour, faire bonne garde pendant la nuit, et dès le matin nous mettre en marche.» Tous les chefs approuvèrent cette résolution.
Après avoir fait la parade, comme vous l'avez entendu, les Siennois s'établirent gaiement sur la colline et allumèrent de suite de grands feux. Le capitaine, les sénéchaux et les gonfaloniers s'étaient entendus avec les vingt-quatre pour que les vins les plus recherchés de Sienne, et les meilleurs mets, tels que chapons, poulets, et autres viandes rôties, fussent envoyés au camp. On les avait fait préparer de la sorte, parce que la chair rôtie provoque la soif, et qu'étant bien approvisionnés de toutes choses, les soldats devaient se montrer plus forts et plus entreprenants.
Le capitaine, le comte Aldobrandino, le comte Giordano, le sénéchal messire Nicolo, le comte d'Arasi, maître Arrigo et messire Gualtieri, prirent à part les gonfaloniers, et tinrent conseil sur la marche qu'il convenait d'adopter. Ils décidèrent qu'on livrerait bataille dès le matin du jour suivant, et que pendant la nuit on simulerait quelques attaques sur différents points, afin de ne laisser aux Florentins aucun repos. Les ordres furent donnés en conséquence. Comme les généraux siennois s'étaient d'ailleurs aperçus que l'armée florentine, effrayée de leurs préparatifs, se disposait à se retirer secrètement et en silence, ils eurent le soin de faire circuler le bruit de cette prochaine retraite parmi les troupes de Sienne, dans le but d'accroître encore leur courage. Ceux-ci accueillirent cette nouvelle avec enthousiasme, et passèrent le reste du jour en réjouissances.
Le soir venu, des feux furent allumés autour du camp, et l'on désigna ceux des combattants qui devaient tour à tour monter la garde. Les Florentins, au contraire, dominés par l'appréhension d'une attaque, restèrent toute la nuit sous les armes. Il résulta de cette vaine attente, qu'au point du jour ils se trouvèrent harassés, sans courage et sans ardeur.
Sur ces entrefaites, on vit un manteau blanc qui recouvrait le camp siennois et s'étendait sur la ville de Sienne. La surprise et l'émotion furent générales. Les Florentins supposèrent que cette vision avait une cause naturelle, et qu'elle était due à la fumée des grands feux allumés par les Siennois. Ils ne tardèrent point cependant à se désabuser, en observant que la fumée se serait dissipée, tandis que l'objet miraculeux restait immobile. Quelques personnes assuraient que c'était là un signe par lequel notre mère la Vierge Marie annonçait qu'elle prenait sous son égide le peuple de Sienne. Telles étaient les suppositions faites dans le camp florentin. D'autres disaient : « N'avez-vous pas remarqué ce matin, lorsque l'armée des Siennois s'est rassemblée sur la colline où ils sont campés, que les premiers étaient habillés de rouge, ce qui signifie sang et bataille ; que la seconde troupe était vêtue de vert, ce qui veut dire mort dans le combat ; que les autres enfin portaient des habits blancs et noirs, ce qui est un indice de captivité ?» Ces paroles ne faisaient qu'accroître l'inquiétude des Florentins, qui, dès ce moment, ne songèrent plus qu'à effectuer mystérieusement leur retraite.
Les Siennois, ayant aperçu le manteau suspendu au-dessus du camp et de la ville de Sienne, se précipitèrent à genoux, tout en larmes, et transportés de reconnaissance. « Ceci, disaient-ils, est un miracle que nous devons aux prières de notre père monseigneur l'évêque et à celles des saints religieux, des hommes et des femmes qui sont restés auprès de lui à Sienne, où tous ensemble ils supplient Dieu et la sainte Vierge de nous venir en aide contre ces chiens de Florentins. »
Tandis que, dociles aux ordres qu'ils avaient reçus, les soldats de la commune de Sienne se reposaient, les cavaliers désignés pour inquiéter le camp florentin commencèrent, protégés par l'obscurité, à l'assaillir de divers côtés. Toute cette nuit du vendredi se passa en vives escarmouches, en continuelles alertes. Les Florentins ne purent jouir d'un seul instant de tranquillité, ce qui les épouvanta tellement, qu'il leur semblait que mille années les séparaient encore du moment où le jour leur permettrait de s'éloigner. Dès qu'apparurent les premières lueurs du matin, ils plièrent leurs tentes et chargèrent leurs bagages. Ces préparatifs furent aperçus des Siennois, qui, remplis d'exaltation, s'écrièrent : «Les laisserons-nous partir ainsi ?» Alors le comte Giordano, le comte Aldobrandino, le sénéchal de la commune de Sienne, les gonfaloniers, et d'autres chevaliers, parcoururent le camp afin de réveiller les troupes, de leur enjoindre de s'armer et de se tenir prêtes au combat. Ces ordres furent exécutés sans délai. Les chefs arrêtèrent l'ordre de bataille, reformèrent les bataillons, et désignèrent les officiers et les éclaireurs qui devaient précéder ou suivre l'armée, munis du matériel nécessaire pour obvier à tout péril et profiter de la victoire.
Les troupes furent disposées dans l'ordre suivant : Deux cents cavaliers allemands et deux cents fantassins d'élite formèrent la première brigade, qui fut confiée aux soins de l'intrépide comte d'Arasi, sénéchal du comte Giordano. La seconde brigade se composait de six cents cavaliers allemands, commandés par le comte Giordano, et de six cents fantassins bien armés ; au milieu de l'escadron flottait l'étendard du roi Manfred, porté par messire Orlando de la Magna, aussi réputé pour sa brillante valeur que pour sa prudence et son habileté militaires. La troisième division, représentée par quatre cents cavaliers et nobles siennois, marchait sous les ordres du brave comte Aldobrandino (16), général en chef de la commune de Sienne ; ce corps constituait ce que l'on appelait alors la chevalerie. Deux cents autres cavaliers composaient la garde du comte Aldobrandino. Les gonfaloniers s'avançaient ensuite avec le peuple de Sienne, entourant le carroccio, sur lequel était planté le gonfalon blanc du tiers de Camollia ; ce gonfalon se trouvait précédé de cent cavaliers commandés par maître Arrigo d'Astimbers. Messire Gualtieri venait immédiatement après cet escadron, avec cent autres cavaliers dont la tenue était très remarquable. Enfin messire Nicolo de Bigozzi, sénéchal de la commune de Sienne, fermait la marche, ayant sous sa direction deux cents cavaliers et un corps de fantassins siennois.
C'est ainsi que furent distribuées les différentes fractions de l'armée. Il n'est pas inutile que tu saches, lecteur, qu'il y avait sur ce lieu devenu célèbre dix-neuf mille citoyens siennois tous à pied, savoir : huit mille cinq cents hommes du tiers de la Ville, quatre mille huit cents du tiers de Saint-Martin, et cinq mille sept cents du tiers de Camollia. L'armée comptait en outre dans ses rangs huit cents Allemands à cheval, deux cents cavaliers de la commune, et deux cents nobles de Sienne : de sorte que la cavalerie se montait à douze cents chevaux, et l'infanterie à dix-neuf mille fantassins. L'armée siennoise s'élevait donc en totalité à vingt mille deux cents combattants. «
Lorsque le comte Aldobrandino eut reconnu que tout était préparé pour l'attaque, il appela près de lui les capitaines et les gonfaloniers ; puis, ayant fait ranger l'armée en cercle autour d'eux, il lui adressa une harangue qui l'électrisa. Se retournant ensuite vers le peuple : « Messieurs les Siennois, leur dit-il, je vous rappelle que vous combattez aujourd'hui pour la défense de votre ville, et je vous prédis la victoire. Ainsi donc ayez tous confiance ; secourez-vous mutuellement, combattez avec ardeur ; du reste, soyez assurés que, grâce à l'appui de ces braves Allemands, aucun avantage ne sera perdu. Ce matin, le soleil en se levant nous frappera au visage, ce qui nous sera défavorable ; néanmoins il faut savoir occuper nos ennemis assez longtemps pour que le soleil, en continuant sa course, vienne les éblouir à leur tour : c'est vers ce but que doivent tendre tous nos efforts. Suivez-moi sans crainte, et que chacun de vous se prépare uniquement à bien combattre et à passer au fil de l’épée toutes ces méchantes gens. Que les premiers coups soient dirigés sur les chevaux, afin qu'aucun ennemi ne puisse s'enfuir ; mais que personne, sous peine de la vie, ne fasse de prisonniers.
« Souvenez-vous, citoyens siennois, dit-il encore, que vous allez combattre pour préserver votre honneur et votre vie ; vous savez, en effet, que vos ennemis vous ont fait annoncer par leurs ambassadeurs que si vous ne démolissiez pas vos murailles, ils ne vous accorderaient aucune pitié. Il n'y a aucun péché à faire aux autres ce qu'ils veulent vous faire à vous-mêmes : redoublez donc de résolution et de courage. » Il prononça encore de sages discours et d'ardentes paroles, propres à allumer dans les cœurs le désir de la vengeance.
Lorsque le comte Aldobrandino eut cessé de parler, le comte Giordano se leva et harangua ainsi les Allemands : « Braves et intrépides cavaliers, voici le jour où nous allons venger d'une manière éclatante l'honneur de notre seigneur et maître le roi. Qu'aucun de vous ne reste sans combattre et sans frapper l'ennemi de son épée ; je vous défends encore, sous peine de mort, de descendre de, cheval, lors même que vous entreverriez la possibilité de vous emparer de riches dépouilles. Demeurez tous serrés les uns contre les autres ; luttez vaillamment, et si quelqu'un cherche à fuir, qu'il soit tue par son plus proche compagnon d'armes »
Ces harangues terminées, le comte d'Arasi, prenant à part le capitaine général, le comte Giordano et les gonfaloniers, leur dit : Au nom de Dieu et de notre mère la Vierge Marie, j'irai, si vous le jugez convenable, me placer en embuscade là-bas, abrité par cette hauteur, et quand j'entendrai le bruit de votre attaque, je chargerai les ennemis en flanc ou par derrière, et ce sera miracle si un seul d'entre eux peut échapper. » Les chefs consultés approuvèrent unanimement ce projet. Alors le capitaine ajouta : « Le jour est sur le point de paraître, je voudrais que les troupes se préparassent en faisant un bon repas ; puis, qu'au nom de Dieu, de la Vierge Marie et du noble chevalier saint Georges, nous allions commencer cette victorieuse bataille. » On fit alors apporter d'excellentes viandes rôties de diverses espèces, une grande quantité de conserves, des vins justement réputés, et l'on distribua abondamment aux soldats du pain de la qualité la plus belle. Telle était l'ivresse commune, que le comte d'Arasi, messire Gualtieri et d'autres Allemands se mirent à danser, en chantant un refrain allemand qui signifiait dans notre langue : « Nous verrons bientôt ce qu'il adviendra. » Bien qu'au gré de leur impatience, il parût à ces braves Allemands que l'heure désirée de monter à cheval n'arriverait jamais, ils continuèrent à danser, afin de donner à ceux qui dormaient le temps de s'éveiller et de prendre leur nourriture ; puis, le comte d'Arasi, ayant appelé ses cavaliers et ses hommes de pied, se hâta de se mettre en marche pour aller dresser son embuscade le plus secrètement possible. Il chevaucha, en se recommandant à saint Georges, dont le nom fut adopté pour mot d'ordre ; se dirigea vers Monteselvoli, descendit le long de la Valdibiena et s'y cacha avec le plus grand soin. Toute sa troupe se tint aux aguets pour distinguer les cris que devaient pousser les Siennois, lorsqu'ils assailliraient le camp florentin.
Le comte Aldobrandino et le comte Giordano défendirent aux tambours, trompettes et autres instruments de se faire entendre. Ils recommandèrent en outre à chaque soldat de pousser les plus bruyantes exclamations possibles, au moment décisif où l'on en viendrait aux mains. Les troupes, animées des meilleures dispositions, s'avancèrent alors vers les ennemis. A l'avant-garde de l'armée on apercevait le comte Giordano, ses cavaliers allemands et ses fantassins. Après eux venaient le comte Aldobrandino, le peuple et les gonfaloniers ; maître Arrigo d'Astimbers, à la tête de ses cavaliers ; messire Gualtieri, chevalier intrépide qu'entouraient de vaillants soldats ; enfin messire Nicolo de Bigozzi fermait la marche avec sa compagnie et les nobles de Sienne, qui avaient laissé leurs bagages sur la colline que l'armée venait de quitter pour gagner la plaine. En ce moment, le brave chevalier maître Arrigo d'Astimbers, ayant donné de l'éperon à son cheval, s'approcha du capitaine de l'armée, le salua et dit : « Les membres de notre maison ont reçu du Saint-Empire le privilège d'être les premiers à charger dans toutes les batailles où le devoir les appelle ; je revendique aujourd'hui cet honneur qui a été dévolu à ma famille, et je vous prie de l'avoir pour agréable. » Cette demande lui fut immédiatement accordée.
De son côté, messire Gualtieri, apprenant que son oncle avait obtenu, selon son droit, la faveur de porter les premiers coups, s'avança vers lui, et, se jetant à bas de son cheval, s'agenouilla devant maître Arrigo : « Maître, dit-il, comme vous le savez, je suis votre neveu, le propre fils de votre sœur ; jamais je ne me relèverai, si vous ne vous engagez pas à souscrire à la prière que je vous adresse. » Les chevaliers et les nobles personnages qui les entouraient pressèrent maître Arrigo de céder aux désirs de messire Gualtieri ; vaincu par leurs instances, le premier répondit : « Quelle grâce veux-tu ? je suis prêt à te l'accorder, mais avant tout, quitte cette posture suppliante et remonte sur ton destrier. » Messire Gualtieri se remit à cheval, puis se rapprochant de son oncle : «Messire maître Arrigo, dit-il, celui qui obtient une grâce doit être généreux et bienveillant envers ses amis : c'est pourquoi, comme votre neveu et au nom de la faveur qui vous a été octroyée par le Saint-Empire, à vous personnellement et à tous ceux de votre maison, en récompense des admirables prouesses accomplies par nos aïeux, faveur qui nous autorise à charger les premiers l'ennemi dans toutes les batailles, je vous prie de m'accorder la permission d'être aujourd'hui le premier à combattre. » Sur la sollicitation de toutes les personnes présentes, maître Arrigo accorda cette juste demande, et quoiqu'ils fussent à cheval l'un et l'autre, l’oncle pressa son neveu dans ses bras en l'embrassant sur la bouche. Messire Gualtieri, baissant ensuite la tête jusque sur le cou de son cheval, fit une grande révérence, et dit : « Soyez mille fois remercié. » Il se couvrit aussitôt la tête de son casque, le fit solidement attacher, et s'écria en relevant la visière : « Maître Arrigo, marche en avant, nous serons toujours sur tes pas ; n'aie aucune crainte, nous t'aiderons de bonne sorte ; enfonce ton cheval dans la mêlée au nom de Dieu, de notre mère la Vierge Marie et de saint Georges, notre avocat et notre protecteur. »
Après avoir prononcé ces mots, messire Gualtieri fit sentir l'éperon à son cheval, qui bondissait comme un lévrier, bien qu'il portât deux armures, l'une en mailles d'acier, l'autre en cuir brut, le tout recouvert de soie vermeille, brodée de dragons verts rayés d'or. Cet animal, qui, caparaçonné de la sorte, avait un aspect étrange, était le plus fort cheval que l'on pût trouver à cette époque, très ardent, et d'un prix inestimable. Quant à messire Gualtieri, imaginez un superbe jeune homme, plein de vaillance, et aussi adroit dans le maniement des armes que le plus habile des chevaliers réunis sous la bannière du roi Manfred.
L'armée se remit en marche dans l'ordre que nous avons décrit ; seulement maître Arrigo suivait, avec ses cavaliers et son infanterie, son neveu, qui se trouvait alors à l'avant-garde. Les troupes, présentant une masse compacte et se tenant aussi serrées que possible, s'acheminèrent vers l'Arbia, par la route qui mène à Monteselvoli, en traversant cette rivière, et entrèrent enfin dans la plaine, le samedi matin, peu de temps après le lever du soleil.
Sur ces entrefaites, un tambour, nommé Cerreto Ceccolini, étant monté sur le sommet de la tour des Marescotti (17), d'où il pouvait distinguer à la fois et notre armée et celle des Florentins, se mit à battre la caisse. A ce bruit, la foule s'étant précipitamment rassemblée au pied de la tour, le tambour s'écria : «Les nôtres se mettent en mouvement ; ils descendent le coteau, ils se dirigent vers l'Arbia, ils l'ont passé, les voici à Monteselvoli ; priez Dieu pour leur succès.» Chacun tomba à genoux. «Ils sont maintenant dans la plaine, et commencent à gravir la colline ; les Florentins les imitent ; chaque armée monte de son côté, pour s'assurer l'avantage du terrain.»
Le monticule dont parlait le tambour Cerreto Ceccolini se terminait à son sommet par un petit plateau. Messire Gualtieri s'en approcha à la distance d'un trait d'arbalète ; voyant paraître les Florentins, il baissa sa visière, saisit sa lance, fit dévotement le signe de la croix, enfonça ses éperons dans le ventre de son cheval, et se précipita sur les ennemis en poussant à haute voix son cri de guerre.
Le tambour, auquel aucun des incidents de cette rencontre ne pouvait échapper, du point où il se trouvait placé, continuait à en instruire la foule. « Les voici, disait-il, arrivés sur la hauteur, ainsi que les Florentins ; ils en viennent aux mains. Demandez tous à Dieu miséricorde. » Miséricorde ! répétait le peuple au pied de la tour des Marescotti.
Le premier ennemi que messire Gualtieri put joindre fut Nicolo Garzoni, commandant des Lucquois. La lance de ce dernier se brisa en frappant messire Gualtieri, qui ne fut pas ébranlé du coup, et resta ferme dans ses arçons ; la sienne, au contraire, traversa de part en part l'armure de son adversaire, qui Chancela et tomba mort. Arrachant sa lance de ce corps sans vie, Gualtieri en frappa un second, puis un troisième, qui subirent un sort également fatal. Privé de sa lance, qui se brisa, il mit l'épée à la main, et se rua comme un lion au milieu des Lucquois, tuant ou blessant tous ceux qui essayaient de lui résister. Derrière lui, maître Arrigo d'Astimbers n'était pas demeuré inactif ; il avait attaqué, en premier lieu, messire Zanobi, chef des Pratésiens, et l'avait frappé avec tant de force que sa lance, après avoir traversé bouclier et cuirasse, s'était enfoncée dans la poitrine, et avait pénétré jusqu'au cheval, qui roula expirant sur le sol ainsi que son maître. Messire Arrigo, après cette remarquable prouesse, se précipita sur les Pratésiens, dont il fit un tel massacre, qu'il semblait impossible que sa main ne fût pas lassée.
C'est alort que survint le comte Giordano. Le noble messire Donatello, capitaine des Arétins, qui l'avait aperçu, courut droit à lui, mais sa lance ne put entamer la cuirasse du comte et se rompit ; le comte Giordano, plus heureux, perça son adversaire d'outre en outre et le renversa inanimé sur l'herbe qui devait lui servir de lit de mort. Saisissant son épée, le comte Giordano, semblable à un nouvel Hector, s'enfonça dans les rangs des Arétins. Jamais les Troyens n'eurent à supporter une boucherie semblable à celle qu'il fit subir aux Florentins : frappant en tous sens autour de lui, sans qu'aucun de ses coups demeurât inutile, ce brave chevalier n'avait pas besoin de lever une seconde fois son glaive sur l'homme qu'il avait atteint, car dès le premier choc cet homme tombait mort ou dangereusement blessé. Il faisait beau voir avec quelle ardeur ses Allemands malmenaient les ennemis.
Le courageux comte Aldobrandino, qui entra à son tour en lice avec les gonfaloniers et le peuple de Sienne, s'attaqua au capitaine des Orviétains, nommé messire Sinibaldo Rubini : bien que cet homme fût réputé pour sa grande vigueur, le comte Aldobrandino le renversa d'un coup de lance qui, traversant l'armure, pénétra dans l'épaule gauche. Le capitaine des Siennois prit alors son épée à deux mains, et malheur à celui qui l'attendit de pied ferme !
Ah ! qui eût vu le brave peuple de Sienne, durant cette sanglante journée, pourrait dire quels cris de fureur et d'extermination s'élevaient du lieu du combat ! Si Dieu eût fait alors gronder son tonnerre, on ne l'eût point entendu. Il est impossible de se figurer avec quelle audace les Siennois abordaient ces maudits Florentins qu'ils égorgeaient comme des pourceaux. A les voir frapper sans relâche, soit les chevaux, soit les hommes, on eût dit des tigres acharnés sur leur proie : en vain les Florentins imploraient-ils l'assistance de saint Zanobi ou de sainte Liperata, on en faisait un massacre plus grand mille fois que celui des bestiaux égorgés par les bouchers le vendredi saint.
Du haut de la tour, Cerreto continuait à suivre les diverses phases ej particularités du combat, et les racontait à la population tremblante.
Tierce et none étaient déjà passées, lorsque arriva le vigoureux et brave sénéchal messire Nicolo de Bigozzi, à la tête de sa compagnie, criant : « Ah ! canaille ! à mort, à mort les traîtres. » Il attaqua sans coup férir le comte Aldobrandino de Pitigliano, qu'il atteignit d'un coup de lance. Bien que blessé dangereusement, le comte de Pitigliano tua le cheval de messire Nicolo ; mais les compagnons de ce dernier lui présentèrent aussitôt un beau cheval à poil noir, qui avait appartenu au capitaine des Arétins. Dès qu'il fut remis en selle, Nicole de Bigozzi courut au plus épais du combat, et se vengea cruellement sur les Florentins du péril qu'il avait couru.
L'heure de vêpres approchait ; le soleil venait de tourner, et ses rayons donnaient dans les yeux des Florentins. Les Siennois poussaient de si grands cris, des acclamations si furieuses, que les ennemis s'en épouvantaient. Les mots de « à mort ces traîtres » dominaient toujours le tumulte, et nombre d'hommes et de chevaux succombaient sous les coups de nos soldats, lorsque le puissant comte d'Arasi, averti par le bruit, quitta l'embuscade où il se tenait avec sa compagnie, et vint prendre en flanc l'armée florentine.
Bien que le comte d'Arasi se tînt seulement en avant de sa troupe de la portée d'une arbalète, la fougue de son cheval fut telle, qu'il pénétra jusqu'au milieu du camp et se trouva face à face avec messire Uberto Ghibellino, capitaine général des Florentins. Dès que celui-ci vit approcher le comte, il se disposa au combat et courut à lui ; mais sa lance vola en éclats en frappant le comte d'Arasi, qui ne broncha pas plus sur sa selle que si le coup eût porté contre une muraille. Quant au comte d'Arasi, il atteignit son adversaire en pleine poitrine ; sa lance traversa l'armure de part en part, et lui fit mordre la poussière. Il s'éleva alors une terrible rumeur parmi les Florentins, consternés de la mort de leur chef et de la nouvelle attaque dirigée contre eux. Le comte d'Arasi parcourait le camp, l'épée à la main, comme s'il allait à la noce, et qu'il n'eût aucun péril à courir.
La bravoure avec laquelle ces intrépides Allemands et les valeureux citoyens qui les accompagnaient se précipitaient vers les étendards ennemis, était véritablement merveilleuse ; on ne saurait énumérer le nombre d'hommes et de chevaux qui périrent sous leurs coups. Ce fut en combattant avec un acharnement furieux, en renversant tout ce qui se rencontrait sur leur passage, qu'ils parvinrent jusqu'aux gonfalons des Florentins, les leur arrachèrent et les renversèrent dans la poussière. Des cris de victoire étourdissants accueillirent la prise et la chute des gonfalons.
Grande avait été la consternation des Florentins en voyant leurs drapeaux renversés ; la même raison avait redoublé l'ardeur des Siennois à tel point, que le moindre d'entre eux se sentait capable de faire tête à dix ennemis. Toute espèce de secours, d'ailleurs, était inutile à celui qui tombait ; il ne lui restait qu'à mourir. Le nombre des cadavres était si considérable, qu'à peine pouvait-on aller de l'un à l'autre, et que l'on aurait cru traverser un gué de sang humain, en parcourant le champ de bataille. Vous pouvez penser s'il y avait des morts.
Maintenant que nous avons raconté les prouesses des Allemands, nous parlerons de celles accomplies, dans jle cours de cette journée, par le vaillant peuple et les braves chevaliers siennois. Il serait impossible de les dire toutes, car chacun d'eux combattait avec amour pour la défense de sa ville natale, en répétant au milieu du carnage : « Que nous renversions à terre nos murailles ! Eh bien, venez donc prendre la ville à présent, bâtissez des citadelles dans Camporeggi, établissez une seigneurie dans chaque tiers de Sienne !» Ils poursuivaient les ennemis en les apostrophant ainsi, et se précipitaient au milieu de leurs bataillons. Partout, sur le coteau comme dans la plaine, on marchait dans le sang des Florentins et de leurs alliés. De son poste d'observation, le tambour Cerreto, dont il a été question déjà, voyait tout ce qui se passait. « Les ennemis perdent du terrain, criait-il ; mais non, voici qu'ils tiennent ferme de nouveau. Les nôtres reculent : priez Dieu qu'il donne de la force à notre armée. » Alorsles respectables vieillards et les femmes éplorées qui se trouvaient au pied de la tour, s'agenouillaient et tendaient les mains vers le ciel, suppliant le Seigneur de leur accorder la victoire. Le tambour reprit : « Le combat est très acharné de tous les côtés, et voici les bannières des Florentins abattues. » En effet, le massacre que les Siennois faisaient de leurs ennemis était si grand, que ces derniers ne pouvaient plus combattre, et étaient sur le point de se débander. Lorsque l'heure de vêpres fut passée, et que le soleil vint donner dans les yeux des Florentins, ceux qui étaient restés vivants jusqu'alors lâchèrent pied et commencèrent à fuir. Les Siennois, retrouvant alors de nouvelles forces, se précipitèrent à leur poursuite : quiconque tombait aux mains de ces courageux soldats était mis à mort sans miséricorde. Dieu seul peut dire combien de Florentins périrent de la sorte, car ils avaient beau crier : « Nous nous rendons ! » on les passait au fil de l'épée, sans les écouter. Vous jugerez de ce que faisaient les autres citoyens et les Allemands, en apprenant qu'un fendeur de bois de Sienne, nommé Geppo (18), en tua à lui seul vingt-cinq avec sa hache. Sur toutes les routes, dans chaque ravin, dans chaque fossé, le sang coulait à grands flots, comme un large fleuve. La Malena se grossit tellement du sang des Florentins et de leurs alliés, et son cours devint si rapide, qu'elle eût suffi pour faire marcher quatre grands moulins.
L'homme de la tour s'écria : « Maintenant les Florentins sont en déroute et prennent la fuite. » En entendant cette nouvelle, un nommé Magiscuolo, qui se tenait auprès de la tour, ôta son manteau, le fit tourner en l'air et dit : « Les nôtres sont enfin victorieux ; les Florentins sont dispersés, ils fuient, ils sont battus. Louange à Dieu ! »
Cependant l'intrépide peuple de Sienne poursuivait les fuyards sans relâche. Les soldats d'Orvieto, de Prato, de Pistoia, du val d'Eisa, c'est-à-dire de Colligiano, de San Gimignano, de Volterra, principalement les Lucquois et les Arétins, qui avaient survécu à ce grand désastre, comprenant que la défaite était irréparable, cherchèrent à se dérober à la mort en se sauvant vers Montaperto, où ils s'arrêtèrent accablés de fatigue et saisis de terreur. Les autres fugitifs, errant en tous sens, ne savaient de quel côté se diriger. Chacun d'eux disait : « Je me rends prisonnier » ; mais, personne ne consentant à les recevoir, ils étaient massacrés sans pitié. Voyant la victoire assurée, le capitaine des Siennois fut touché de compassion, et songea à préserver ceux des vaincus qui survivaient. Il appela en conséquence auprès de lui les gonfaloniers, le comte Giordano, ainsi que les autres chefs, et leur dit : « Vous voyez le carnage d'hommes et de chevaux qui s'est fait et qui se fait encore ; il me semble qu'il est temps d'ordonner que ceux qui voudront se rendre prisonniers soient reçus à quartier, mais que l'on égorge sans miséricorde les récalcitrants. » Cet ordre fut immédiatement transmis à l'armée siennoise, et il n'avait pas été publié trois fois, que l'on vit les ennemis se lier eux-mêmes les mains, afin d'échapper à la mort sanglante dont ils étaient menacés. Lorsque les Lucquois, les Orviétains et tous ceux qui s'étaient enfuis vers Montaperto connurent cette proclamation, ils descendirent de cheval, jetèrent leurs armes, et vinrent se constituer prisonniers entre les mains du capitaine des Siennois. Le comte Giordano fit prisonniers les combattants de San Miniato et dePistoia ; le comte d'Arasi, ceux de Prato ; maître Arrigo d'Astimbers, ceux de San Gimignano ; messire Gualtieri, ceux de Val d'Eisa ; messire Nicolo de Bigozzi, ceux de Volterra. Chacun s'empressait de s'assurer des siens le mieux possible.
Il fallait voir comme nos braves concitoyens garrottaient avec plaisir les vaincus, les uns natifs de Colle, les autres de Pitigliano, ou de Campiglia, ou de Florence, quelques-uns même de Lombardie. La multitude des captifs était telle, qu'ils formaient une masse noire, au milieu de laquelle l'œil ne pouvait rien distinguer. Vous allez juger des prouesses que durent faire les hommes, par l'exemple suivant : Une pauvre fruitière, nommée Usiglia (19), faisant partie de la confrérie de Sainte-Marie-des-Grâces, et demeurant dans le tiers de Camollia, avait été envoyée au camp pour porter aux troupes diverses provisions ; elle les avait chargées sur l'ânesse que les Florentins avaient jetée dans la ville par la porte Camollia. Après avoir relevé cet animal, elle lui avait mis une selle neuve, et l'avait emmené avec elle. S'apercevant que les Florentins étaient en pleine déroute, elle partit immédiatement du camp, c'est-à-dire de la colline de Rospoli, où les Siennois avaient laissé l'étendard blanc planté sur le carroccio, et se rendit sur le champ de bataille. Là, elle arrêta à elle seule trente-six hommes, appartenant tous au corps de la ville de Florence, et les ayant attachés à l'aide de ceintures, elle les amena ainsi à sa suite, dans l'endroit où se trouvaient réunis les autres prisonniers. Vous pouvez facilement vous figurer ce que faisaient des hommes courageux, en voyant que cette femme, seule et faible, avait pu capturer et conduire ainsi trente-six gens de guerre. Tout bien compté, il y avait plus de prisonniers que de combattants. Si vous tenez à en connaître exactement le chiffre, je vous dirai qu'il s'élevait à vingt mille, ce qui dépassait le nombre des habitants de Sienne à cette époque. Ajoutez à cela dix mille cadavres humains et dix-huit mille chevaux tués, et vous ne pourrez vous étonner que la grande infection qui résulta de ce carnage ait forcé la population à abandonner cette contrée, qui pendant un grand nombre d'années ne fut plus habitée que par des animaux sauvages (20).
La journée du samedi était déjà fort avancée, lorsque l'armée siennoise acheva sa célèbre victoire ; il fut résolu qu'on ne rentrerait pas le même jour dans la ville de Sienne, et toutes les troupes retournèrent sur la colline de Rospoli, où se trouvaient, comme nous l'avons fait remarquer, le bagage de l'armée et le carroccio, surmonté du blanc et royal étendard du tiers de Camollia. Au centre de ce carroccio s'élevait un grand mât, auquel s'attachait une antenne plus petite, qui se hissait le long du premier mât à l'aide de cordes et de poulies, et à l'extrémité de laquelle était fixé l'étendard. Pour que tu n'ignores pas, lecteur, ce que sont devenus ces deux mâts, j'ajouterai qu'ils sont dans le Dôme, adossés à deux piliers près du chœur (21), à l'endroit où se trouve l'eau bénite : le plus petit est attaché contre le pilier du côté du campanile ; l'autre, contre le pilier opposé et qui lui fait face. Ce dernier n'est autre que le grand mât planté à poste fixe dans le carroccio. Quant au carroccio lui-même, il est actuellement déposé dans la fabrique de Sainte-Marie, où l'on travaille en menuiserie et en pierre (22).
L'étendard blanc dont nous avons parlé peut se voir dans la sacristie de l'hôpital de Sainte-Marie de la Scala ; il est serré dans un bahut, où se conserve aussi la boîte qui servait au ballottage de l'élection de la seigneurie de Sienne (23). Toutes les fois que nos aïeux retiraient Cette boîte afin de procéder au scrutin qui décidait de la composition de la seigneurie, ils avaient l'habitude de déployer l'étendard dans la sacristie, et rappelaient à ceux qui pouvaient l'ignorer que ce drapeau était le même qui flottait dans le camp siennois, lors de la victoire remportée sur les Florentins et leurs alliés dans les champs de Montaperto. C'était ainsi que se perpétuait le glorieux souvenir de cet événement.
Dès que l'armée fut réunie sur la colline, elle s'y établit avec ses prisonniers, et elle y déposa le butin qu'elle avait recueilli dans le camp des Florentins. Ce butin se composait d'abord de bannières, étendards, gonfalons, tentes et pavillons ; d'une quantité considérable d'armes, de bagages, de vivres, de fourniments de toute espèce, que les Florentins portaient avec eux pour ravitailler Montalcino ; enfin d'une cloche qu'on appelait la Martinella et dont ces derniers se servaient, dans leur camp, pour indiquer les réunions du conseil. Après avoir fait l'inventaire de ces dépouilles, les Siennois passèrent la nuit dans cet endroit, et le dimanche, à l'aube naissante, ils commencèrent à mettre toutes choses en ordre, et à charger leur bagage et leur butin. Comme représailles des anciennes injures qui leur avaient été faites, ils placèrent la Martinella, entourée de toutes les bannières et pavillons, sur le dos de l'ânesse qu’Usiglia avait amenée avec elle au camp. Lorsque tout fut prêt, ils s'acheminèrent vers Sienne, dans l'ordre qui sera décrit plus loin, et y arrivèrent vers la demi-tierce du matin (sept heures et demie du matin, dans le mois de septembre).
En tête de l'armée, on voyait l'un des deux ambassadeurs florentins qui s'étaient, avant le combat, présentés à Sienne pour formuler d'iniques demandes ; le second était resté mort sur le champ de bataille. Celui qui survivait fut mis sur un âne, les mains liées derrière le dos, le visage tourné vers la queue de l'animal, et les Siennois le contraignirent à traîner par terre la bannière de la commune de Florence. Un grand nombre d'enfants couraient devant lui en criant : « Voilà le traître qui voulait que nous abattissions nos murs. » D'autres ajoutaient : « Viens donc bâtir ta forteresse dans Camporeggi, et créer des seigneuries pour chaque tiers de Sienne. » Non contents de le poursuivre de railleries et d'outrages, les enfants l'eussent tué à coups de pierres, si les hommes ne les en eussent empêchés.
Des trompettes faisaient en même temps retentir l'air de fanfares guerrières, et l'on voyait s'avancer le royal étendard du roi Manfred, derrière lequel marchaient le comte Giordano, le comte d'Arasi, et quatre cents cavaliers allemands, tenant tous à la main des branches d'olivier, et chantant en chœur leurs plus belles hymnes nationales.
Le carroccio, attelé de deux magnifiques chevaux de haute taille, et surmonté de l'étendard de Camollia, précédait les nombreuses files de prisonniers, ainsi que les bannières, les tentes, les pavillons, les bagages et autres objets enlevés du camp florentin. L'ânesse portait sur sa nouvelle selle la Martinella avec les autres trophées de Montaperto, et la fruitière Usiglia conduisait ses trente six captifs. Après elle, le valeureux comte Aldobrandino de Santa Fiore, capitaine général de la commune de Sienne, s'avançait suivi de tous les soldats siennois, munis.
comme les Allemands, de guirlandes d'olivier, en signe de victoire. C'était d'abord le gonfalonier du tiers de la Ville, portant son gonfalon, et accompagné des hommes de son quartier, puis les gonfaloniers de.Saint-Martin et du tiers de Camollia.
Le premier s'appelait Jacomo del Tondo ; celui de SaintMartin, Giovanni Guastelloni, et celui de Camollia, Bartolomeo Rinaldini. Le reste du cortège se composait de maître Arrigo d'Astimbers, avec deux cents cavaliers armés ; du preux messire Gualtieri, accompagné de deux cents cavaliers allemands de la tenue la plus martiale ; enfin de messire Nicolo de Bigozzi, à la tête de quatre cents cavaliers siennois ou appartenant à la commune de Sienne. Ce fut selon cet ordre que se fit l'entrée triomphale de l'armée dans la ville, et qu'elle se dirigea immédiatement vers le Dôme, où elle rendit des actions de grâces au Dieu tout-puissant pour les succès qu'elle avait obtenus, lui en reportant avec humilité toute la gloire. Ces actes de piété terminés, chacun retourna à Saint-Christophe, où furent solennellement déposés le bagage, les étendards, pavillons, tentes et bannières des Siennois, ainsi que tout ce qui avait été pris dans le camp des Florentins, sans en excepter la Martinella, qui se trouve aujourd'hui dans la salle de la commune de Sienne, c'est-à-dire dans le palais (24). Les bannières et pavillons sont dans le même édifice, attachés aux poutres de la terrasse de la seigneurie de Sienne (25). A mesure qu'un soldat s'était dessaisi de ce qu'il avait apporté, il retournait, plein d'une légitime fierté, dans son ménage et dans sa famille.
La défaite dont nous venons de rapporter les particularités eut lieu le 4 septembre 1260.
Le lendemain matin, tous les citoyens se rendirent à Saint-Christophe, où étaient déjà rassemblés les généraux de l'armée, avec les vingt-quatre magistrats formant la seigneurie. On y tint conseil, et l'on convint de se rendre au Dôme, afin de faire une grande procession dans laquelle on porterait les reliques de Sienne, et que suivraient tous les habitants, y compris les religieux, prêtres, moines et abbés. On envoya aussitôt dans la ville publier un ban par lequel il était enjoint aux divers membres du clergé de se réunir immédiatement au Dôme, avec toutes les reliques, et d'y attendre l'arrivée des vingt-quatre. Par ce même ban, il était ordonné aux grands comme aux petits, aux femmes comme aux enfants, de se joindre à la procession, de fermer les boutiques et de se livrer à toutes sortes de réjouissances.
Tandis que le crieur public s'acquittait de ce message, il fut décidé dans le conseil que quiconque voudrait racheter un prisonnier le pourrait faire, mais qu'indépendamment du prix de rançon, il serait tenu de donner un jeune bouc ; que le rachat des captifs s'effectuerait à l'embranchement des deux routes, dont l'une conduit à Quercia Grossa et l'autre à Montereggioni ; qu'après avoir délivré les prisonniers, on égorgerait sur-le-champ tous les boucs, dont le sang, mêlé à de la chaux vive, serait destiné à bâtir, en cet endroit, une belle fontaine, à laquelle serait donné le nom de fonte de Becchi, fontaine des Boucs. Il fut arrêté, en outre, qu'on sculpterait sur chaque paroi de cette fontaine la représentation d'un de ces animaux.
Après ces délibérations, messire le comte Aldobrandino, en sa qualité de capitaine général de l'armée de la commune de Sienne, se leva et dit : « Messieurs les conseillers, toutes les choses que vous venez d'ordonner, je les trouve justes et sagement faites ; néanmoin^Je me permets de vous rappeler qu'une fois la procession et la fête terminées, les prisonniers rachetés et élargis, il faudra regarder les ennemis comme des ennemis et les amis comme des amis. C'est pourquoi je pense que quiconque s'est montré hostile à votre commune, ou s'est révolté contre elle, doit être châtié de telle manière qu'il ne soit plus tenté de recommencer. N'importe qui ce sera, de quelque nom qu'il s'appelle, que ce soit une commune entière ou seulement un particulier, je vous réponds qu'avec mes compagnons et l'aide du valeureux comte Giordano et de ses braves amis, nous le mettrons à la raison et le ferons disparaître du monde. Ainsi donc, commandez ; nous sommes tous prêts à obéir. » Le comte Giordano dit également par le moyen de son interprète : «Je suis disposé à faire tout ce que vous désirerez, pourvu qu'il s'agisse de choses dignes de votre gloire et de la mienne, et en même temps honorables pour notre roi. » Après avoir parlé ainsi, il s'assit et fut remplacé par messire Bandinelli, qui s'exprima en ces termes : « Sages conseillers, le capitaine de l'armée de Sienne, que je m'abstiens d'appeler par son nom, vient de vous dire qu'il fallait traiter les ennemis comme des ennemis, les amis comme des amis, et qu'on devait faire la guerre à ceux qui se sont montrés opposés à la commune de Sienne, ou qui se sont révoltés Contre elle ; vous l'avez entendu. Pour moi, je dis qu'il né me semble ni nécessaire ni sage de faire la guerre à personne, que ce soit à un ennemi ou à un ami. Vous leur avez fait éprouver plus de mal et de dommage qu'ils ne vous en ont occasionné : à mon avis, ce succès doit suffire, et l'on ne doit pas tenter de nouvelles entreprises. Je pense même qu'il serait utile aux intérêts de la commune de donner congé aux Allemands et de licencier tous les soldats ; vous n'ignorez pas, en effet, qu'on manque d'argent pour les payer, et que dernièrement, lorsque vous vous êtes résolus à solder ces Allemands, on n'en eût point trouvé, siSalimbene.ne vous en eût prêté. Songez donc au moyen de vous procurer de l'argent, avant de vous lancer dans de nouvelles et de hasardeuses expéditions.» En prononçant ces mots, messire Bandinelli regagna sa place. Son discours tout entier avait été dicté par son désir de protéger les Florentins, dont la défaite l'avait affligé cruellement. Ce Bandinelli était le même, en effet, qui, avant la bataille de Monte-Aperto, avait conseillé, selon les demandes des ambassadeurs de Florence, qu'on abattît en différents endroits les murs de la ville.
Messire Buonaguida Boccacci se leva à son tour, et déclara qu'il lui semblait qu'une partie du discours que venait de prononcer messire Bandinelli devait être prise en considération et l'autre repoussée ; qu'il lui paraissait hors de saison d'attaquer qui que ce fût', mais qu'il ne croyait pas prudent de licencier les troupes, et qu'on ne devait pas y penser, «attendu, ajouta-t-il, que nous avons beaucoup d'ennemis et que nous en aurons bien plus encore que par le passé, actuellement que nous venons de donner une si terrible leçon aux Florentins et à tous ceux qui s'étaient associés à leur fortune. En conséquence, nous ne devons pour rien au monde démembrer notre armée, mais il importe au contraire de faire bonne garde, et de se procurer des moyens de l'entretenir et de la récompenser de ses bons services.» Le comte Aldobrandino dit aussitôt : «Pour le moment, nous ne devons pas penser à l'argent, car nous en avons suffisamment, et la somme s'en augmentera lors du rachat des prisonniers ; aussi ne songeons-nous qu'à ce qu'il nous est possible de faire pour le soin de votre honneur et pour votre utilité.» Lorsque le comte eut cessé de parler, Salimbene se leva :«Messieurs les conseillers, observa-t-il, vous avez entendu les nobles paroles de messire le comte Aldobrandino ; à mon tour, je vous dirai d'être sans inquiétude quant à l'argent, parce qu'il me reste encore une somme égale à celle que je vous ai prêtée, et qu'elle est entièrement à votre disposition. Ainsi donc vous n'avez aucune raison de ne pas suivre la marche que vous jugerez préférable dans votre sagesse.» Après cette offre généreuse, Salimbene descendit et se rassit à sa place. « Sages conseillers, et vous braves citoyens, dit alors messire Provenzano, chaque membre du conseil venant d'émettre librement son avis, je puis faire aussi quelques observations sur nos affaires. Je partage complètement l'opinion que messire Aldobrandino a développée au commencement de la discussion : oui, vous devez traiter en ennemi celui qui est votre ennemi, et en ami celui qui est votre ami ; il faut châtier les rebelles de manière qu'ils ne soient plus tentés désormais de retomber dans de pareilles fautes. J'appuierai donc sa proposition, et j'ajouterai que, les Montalcinaisiens s'étant révoltés contre les ordres de votre commune, et qu'étant par leur conduite les principaux instigateurs des dangers de ruine et de servitude qui ont menacé notre ville et son territoire, lorsque les Florentins vous demandaient avec tant d'arrogance et tant d'orgueil de raser vos murs, c'est contre les Montalcinaisiens que vos premiers coups doivent être dirigés. A présent que vous avez recueilli tous les avis, voyez celui qui doit être embrassé pour le bien de la commune. » On résolut de mettre aux voix l'opinion de messire Provenzano, comme étant celle de toutes qui paraissait la meilleure ; elle fut adoptée par l'assemblée, et l'on convint qu'une fois la procession, la fête et le rachat des prisonniers terminés, on irait attaquer Montalcino, puis porter la guerre chez les autres ennemis de la commune de Sienne.
Sur ces entrefaites, le crieur public revint annoncer que les religieux, hommes et femmes, attendaient le conseil dans le Dôme. Les vingt-quatre, accompagnés des personnes qui avaient assisté à la séance, s'y rendirent sur-le-champ. Lors de leur arrivée au Dôme, ils disposèrent ainsi l'ordre de la procession. En avant de toutes les reliques, on portait un gonfalon, religieusement conservé depuis lors, et qui figure encore aujourd'hui dans les processions. Ce gonfalon avait été fait exprès ; il était en soie vermeille, le manche était surmonté d'une petite croix. On voyait apparaître ensuite le crucifix, qui est déposé dans le Dôme, comme nous l'avons dit, précédant tous les ordres religieux avec leurs reliques. Monseigneur l'évêque était accompagné des chanoines et suivi des vingt-quatre, au milieu desquels se trouvait le syndic Buonaguida ; du capitaine, qui s'avançait avec nombre de cavaliers de la ville ; du comte Giordano, à la tête d'une grande partie de ses Allemands, et enfin de la population de Sienne, hommes et femmes, grands et petits, qui récitaient force Ave Maria et Pater noster, pour glorifier Dieu et sa Mère. La procession parcourut ainsi toute la ville, en passant par chaque tiers, et retourna au Dôme, où monseigneur, après avoir fait faire une confession générale, donna la bénédiction à tout le peuple. Les fêtes vinrent ensuite, et chaque rue présenta bientôt le spectacle animé de joyeux plaisirs et d'une ardente allégresse. Ainsi s'écoula la journée entière.
Les jours suivants, ceux qui avaient des prisonniers s'occupèrent d'en tirer le meilleur parti possible. Les habitants de Colle envoyèrent racheter leurs captifs, qui étaient au nombre de six cents : les sommes varièrent selon les moyens, mais aucun prisonnier ne fut exempt de payer en sus de sa rançon un bouc, conformément à l'ordre formel de la commune ; après quoi les prisonniers de Colle retournèrent chez eux. Le 7 septembre, San Gimignano réclama huit cents captifs ; Volterra, près de mille ; San Miniato, neuf cents ; Prato, sept cents ; Pistoia, huit cents. Tous, ainsi que nous l'avons dit, furent imposés selon leur fortune, et durent acquitter l'impôt du bouc.
Le jour suivant, les Lucquois du parti guelfe vinrent délivrer leurs concitoyens, dont le nombre se montait à mille deux cents ; ils étaient tous Guelfes. Ils furent libérés moyennant cinq mille florins d'or (plus un bouc par personne), et partirent pour Lucques le 8 septembre. Les Arétins, qui n'étaient pas moins de mille cinq cent cinquante, furent remis en liberté, le 10 septembre, après avoir acquitté cinq mille florins d'or et mille cinq cent cinquante boucs. Le 12 septembre enfin, les Orviétains retournèrent dans leur patrie en acquittant l'impôt du bouc, et en payant une rançon de trois mille cinq cents florins d'or.
Le prix des boucs s'était tellement accru, qu'ils coûtaient presque aussi cher que les prisonniers. Le 13 et le 14, on vint pour Pitigliano chercher quatre cents prisonniers, et trois cents pour Campiglia. Les habitants de Pitigliano rachetèrent en même temps, au prix de dix mille florins, leur comte qui avait été blessé. Pepo Minella se racheta également, moyennant six mille florins.
Le 15 du même mois, on vit arriver les habitants du val d'Eisa et les Florentins, qui payèrent en même temps la rançon de leurs compatriotes et celle des Lombards. Le chiffre des prisonniers partis ce jour-là fut de deux mille quatre cents, parmi lesquels figuraient les trente-six de la fruitière Usiglia, qui furent obligés de donner chacun à cette femme deux cents florins. L'immolation des boucs eut lieu en présence des Florentins, et leur sang fut mélangé avec de la chaux vive. La fontaine bâtie, on l'entoura de murs, et elle prit, ainsi que le projet en avait été formé, le nom de fontaine des Boucs (fonte de' Becchi) (26), en mémoire de cet événement.
Le 16 septembre, les Florentins (l'auteur entend ici les Florentins réfugiés) retournèrent à Florence, accompagnés d'une troupe d'Allemands, et ayant excité du tumulte dans la ville, s'emparèrent du gouvernement et chassèrent tous les Guelfes, tandis que les Gibelins y rentraient le même jour.
Lorsque tous les prisonniers eurent été rachetés, et que tous les ordres donnés par le conseil eurent reçu leur entière exécution, on s'occupa sans délai d'aller attaquer les Montalcinaisiens et leurs amis. Dans ce but, mille cavaliers et deux mille fantassins, divisés en trois corps, sortirent de Sienne. Le premier corps se composait de trois cents cavaliers parfaitement équipés et commandés par maître Arrigo d'Astimbers ; il était soutenu par le brave comte d'Arasi et par six cents hommes de pied, armés pour la plupart d'arbalètes. Le second corps avait pour capitaine le comte Giordano ; il se montait à treize cents hommes, dont cinq cents cavaliers de la compagnie de messire Gualtieri, et huit cents fantassins portant des arbalètes et d'autres armes. Enfin, deux cents cavaliers siennois à la solde de la commune de Sienne formaient, avec six cents fantassins bien armés, le troisième corps, placé sous les ordres du comte Aldobrandino de Santa Fiore, accompagné de messire Nicole de Bigozzi.
Les troupes sortirent de Sienne le 22 septembre, et se dirigèrent vers Montalcino, où elles arrivèrent le 23. Elles établirent aussitôt leur camp devant cette ville. Lorsque les Montalcinaisiens virent les Siennois, ils en furent profondément affligés et se dirent entre eux : « Nous n'avons plus à présent d'excuse à leur offrir, car nous avons été des traîtres et nous avons failli à notre serment ; aussi tout le mal qu'ils nous feront sera mérité. Quelle conduite tenir vis-à-vis de ce peuple qui ne nous a fait jamais que du bien ? Ne savons-nous pas dans quelles angoisses et dans quels dangers ils viennent de se trouver par notre faute ? qu'à cause de nous, Sienne a été sur le point d'être ruinée de fond en comble, et sa population anéantie ? Comment nous accorderaient-ils miséricorde, lorsque tant de leurs compatriotes sont tombés, par notre faute, sur le champ de bataille ? Ainsi donc, le meilleur parti qui nous reste à prendre est de nous défendre le plus vigoureusement possible. Il est vrai que nous ne saurions triompher d'une si puissante armée, et que nous n'avons de troupes ni pour les repousser, ni pour marcher à leur rencontre ; néanmoins efforçons-nous de leur résister, et quand nous ne le pourrons plus, nous traiterons avec eux, afin d'avoir la vie sauve. »
Bernardo de Guido Gianni dit alors : « Il serait mieux de traiter avec eux dès le début, car lorsque les choses seront plus avancées, nous serons contraints de subir les conditions les plus cruelles. Il faudrait leur envoyer un ambassadeur, pour savoir quelles sont leurs intentions, et ce qu'ils exigent de nous. S'ils veulent notre ville, il vaudrait mieux la leur abandonner de plein gré que de tomber ensuite à leur merci. Ainsi donc, délibérez. » Mais loin d'adopter la proposition de Bernardo, on résolut au contraire de se défendre jusqu'à la mort.
Cependant les Siennois avaient assis leur camp sous les murs de la ville, et après les avoir examinés, ils tinrent conseil tant sur la manière dont ils devaient livrer l'assaut, que sur l'heure qu'ils devaient choisir. Il fut décidé que, dès le matin suivant, on planterait les échelles sur différents points, et qu'on tenterait l'escalade, tandis qu'à coups d'arbalètes on éloignerait ceux des assiégés qui se porteraient à la défense de la muraille ; qu'à l'aide de fascines enflammées on brûlerait la porte ; qu'une fois la ville prise, on la livrerait au pillage, qu'on bouleverserait la terre dans les divers lieux, et qu'on chasserait le reste des habitants.
Ces délibérations furent adoptées le 29 septembre, et le 30, on donna l'assaut ainsi qu'il suit.
La cavalerie commença par s'avancer vers les portes, accompagnée de quelques hommes de pied portant les fascines : une partie des assiégés sortit à leur rencontre ; mais, après un combat des plus vifs, ils furent rejetés en dedans des portes, laissant beaucoup des leurs sur la place, tandis que les Siennois ne perdirent que quelques chevaux. Le reste des assiégés garnissait les murs et combattait vaillamment. On en tua un grand nombre à coups d'arbalète, puis on plaça les échelles, on s'élança à l'assaut, et l'on mit le feu à un amas de bois dont on avait eu soin d'encombrer l'une des portes de la ville attaquée. Consumée bientôt, cette porte finit par tomber, et ouvrit, par sa chute, une issue facile aux cavaliers, qui se précipitèrent dans la ville. A l'entrée de cette porte, il se livra une lutte acharnée, ce qui n'empêcha pas nos soldats de pénétrer dans l'intérieur, aux cris de « Vive la commune de Sienne, mort aux traîtres ! »
Ils parcoururent la ville en tous sens, la saccagèrent, rasèrent les murs et incendièrent une bonne partie des maisons. Tous les Montalcinaisiens, grands et petits, hommes et femmes, prêtres et religieux, qui ne furent point égorgés, en furent chassés. Nos troupes séjournèrent encore quelques jours dans la ville, pour en retirer toutes les dépouilles précieuses qu'elle pouvait contenir.
Une fois hors de leur cité, les habitants de Montalcino se rassemblèrent dans une plaine, au pied de Percera, à l'endroit même où se trouve aujourd'hui Buonconvento, et après une courte délibération, ils résolurent de se rendre pieds nus et la corde au cou à Sienne, pour implorer le pardon du crime qu'ils avaient commis, espérant, grâce à cette expiation douloureuse, apitoyer les Siennois, naturellement humains et miséricordieux.
Ils vinrent donc à Sienne et défilèrent dans la ville, précédés de leurs prêtres, en criant tous ensemble : «Miséricorde pour l'amour de Dieu et de la Vierge Marie ; nous vous prions de nous pardonner et de nous regarder comme des hommes morts ! » On leur répondit alors : « Rendez-vous à Montaperto, là où les intrépides Siennois ont combattu, et là où se trouvaient notre carroccio et notre victorieux étendard, afin d'y voir de quels maux vous avez été la cause, et restez-y jusqu'à ce qu'on vous ait pardonné. »
Ils partirent et allèrent, le 4 octobre, sur le champ de bataille, d'où s'exhalait une odeur si fétide, causée par la grande quantité de cadavres d'hommes et de chevaux, qu'il était impossible d'y demeurer. Les Montalcinaisiens y passèrent cependant deux jours, mais ce fut leur dernier châtiment : on les fit avertir que la magnifique et puissante commune de Sienne les recevait en grâce, et leur permettait de retourner dans leur pays. On les autorisa en outre à rebâtir Montalcino, et à l'habiter comme ils l'entendraient, sous la condition d'être toujours de loyaux et vrais fils de la commune de Sienne. Ils jurèrent d'être fidèles, serment qui fut bientôt transgressé, et partirent pour Montalcino, que les Siennois quittèrent alors avec tout leur butin, après avoir mis le feu sur différents points, afin de n'y rien laisser subsister. Rentrés dans leur ville, les Montalcinaisiens s'occupèrent à la rebâtir, mais un peu moins grande qu'elle n'était auparavant, ce dont on s'aperçoit encore aujourd'hui.
L'armée siennoise s'avança alors dans le pays d'Arezzo, y fit beaucoup de prisonniers, s'empara de nombreux bestiaux, et fit subir à cette ville le sort de Montalcino. Les Siennois entrèrent ensuite sur les terres de Florence, c'est-à-dire à Monte Luco de Berardenga, prirent cette ville d'assaut et la détruisirent jusque dans ses fondements. Monte Luco a Lecchi ne fut pas non plus épargnée : le 12 octobre, nos soldats l'investirent ; ils se rendirent maîtres du château, le brûlèrent et rasèrent la ville. Le 18 du même mois, ils prirent d'assaut Fornano, qu'ils traitèrent de la même façon. Cela fait, ils marchèrent sur Monte Castelli, qui tomba également en leur pouvoir et dont la prise fut achetée par de sanglantes pertes. Le comte Giordano eut son cheval tué sous lui, mais il fut replacé en selle immédiatement ; le château fut enlevé de vive force et entièrement détruit. Les Siennois, changeant alors de direction, se dirigèrent sur Tribbio qu'ils brûlèrent après une faible résistance. Ils exercèrent une vengeance non moins terrible à l'égard de Castellina, qu'ils saccagèrent tellement qu'il n'y resta debout que quelques maisons. Ils tinrent ainsi la campagne jusqu'à la moitié de février, avant de retourner à Sienne. Dans cette même année 1260, ils réparèrent Poggibonsi et Cortone, puis rentrèrent à Sienne, ramenant avec eux une quantité importante de bétail, nombre de prisonniers et un riche butin. Les citoyens les accueillirent avec de grandes démonstrations de joie, et les conduisirent au Dôme, pour rendre grâce à Dieu et à sa mère la Vierge Marie de faveurs tellement signalées et de succès si éclatants.
Qu'à l'avenir les Florentins, leurs alliés, ou tout autre peuple, qui nourriraient de mauvais desseins contre la commune de Sienne, ne recueillent de leurs tentatives d'autre fruit qu'une réputation semblable à celle des Florentins après leur expédition en faveur de Montalcino ! Que tous les ennemis, les traîtres, les rebelles, qui conspireraient contre la ville ou la contrée de Sienne, puissent être exterminés de même ! Je prie Dieu et sa mère la Vierge Marie de permettre qu'il en arrive ainsi, et qu'il nous soit accordé aussi l'immense grâce d'assister une autre fois, avant de mourir, à de semblables événements. Amen.
Ici finit la narration de la déroute de Montaperto. Deo gratias, Amen. Écrite par moi, Nicolo de Giovanni de Francesco Ventura, natif de Sienne, et terminée le 1er décembre 1442.
Dans la suite, les citoyens, en commémoration de la grande victoire qu'ils avaient remportée, et du profit considérable qui en était résulté pour eux, érigèrent en l'honneur de Dieu et de saint Georges la splendide église qui s'élève aujourd'hui dans Pantaneto. On suppose qu'il y existait, avant la bataille, une petite chapelle dédiée à saint Georges ; mais ils l'agrandirent et lui donnèrent la magnificence qui la distingue actuellement. On ordonna aussi que chaque année, à l'anniversaire de la Saint-Georges, on y célébrerait une fête solennelle (27) pour perpétuer le souvenir de ces événements remarquables. Cette fête présentait diverses particularités curieuses : on voyait en premier lieu une forêt, puis un homme armé représentant saint Georges combattant un dragon, non loin d'une jeune fille en prière. Cette allégorie était destinée à rappeler que saint Georges délivra d'un dragon, dans la ville de Silenza en Libye, le roi de Silenza, sa fille, et toute la population. Les Siennois, délivrés avec le même bonheur, ordonnèrent qu'à perpétuité on fît combattre, chaque année, un dragon figuré et un homme armé, en face de l'église de SaintGeorges. Mais l'exiguïté de la place obligea de transporter la représentation de ce spectacle sur le champ de Sienne, et de la reculer jusqu'à l'époque de la fête de saint Ambrogio, afin d'honorer ce saint, natif de Sienne, membre de l'ordre de Saint-Dominique, et qui nous fit la grâce d'obtenir du pape la levée de l'interdiction lancée sur notre ville (28). Cette translation du spectacle sur le champ de Sienne fut résolue également dans le but d'en rendre l'accès plus facile à nos voisins ; ce spectacle a lieu encore et s'exécutera à l'infini, in saecula saeculorum. Amen. Deo grattas.
Dans le mois de juillet 1443, on acheva de peindre ce livre, dont les figures ont été exécutées par Nicolo de Francesco de Giovanni Ventura. Le pape Eugène IV résidait à cette époque, avec ses cardinaux, à Sienne, où il était arrivé le samedi 10 mars 1442 ; il retourna à Rome le 14 septembre 1443, en louant et glorifiant notre Seigneur Dieu Jésus-Christ, in sempiterna saecula saeculorum.
Pendant le séjour du pape Eugène IV à Sienne, le feu du ciel tomba sur la ville et incendia les deux côtés du toit de l'église de Saint-Dominique, située dans le quartier de Camporeggi. Ce désastre eut lieu dans la nuit du 30 août 1443.
(1) Malavolti (tome xi, page 16) prétend que le capitaine général des Siennois, lors de la bataille de Montaperto, ne fut pas le comte Aldobrandino Aldobrandeschi de Santa Fiore, mais bien le podestat Francesco Troisi. Cette assertion, contestée par Uberto Benvoglienti (voyez Muratori, Rer. ital. script., tome xv, page 3, in nota), contredit presque tous les chroniqueurs siennois. L'auteur se fonde sur les motifs d'inimitié existants à cette époque entre ledit comte Aldobrandino et la république, qui avait fait non seulement envahir une partie de ses domaines, mais tuer son propre cousin, le comte Uberto, dans Campagnatico. On peut opposer à cette argumentation (ce à quoi Malavolti n'a pas songé), qu'attaché au parti gibelin, comme il l'était, le comte Aldobrandino de Santa Fiore dut craindre pour sa propre existence en voyant celle de Sienne menacée. Il ignore, ce que nous apprend Tommasi (tome i, page 320), que le comte Aldobrandino avait contracté un engagement avec la république pour faire sa paix avec elle ; il ne sait pas que le roi Manfred s'était employé comme médiateur entre lui et la république, qui, le connaissant pour un homme généreux et vaillant, n'hésita pas à lui confier le commandement supérieur de ses forces, dans la situation périlleuse où elle se trouvait. Un autre Aldobrandino Aldobrandeschini, dit le Roux, comte de Pitigliano et de Sorrana, combattit à Montaperto contre les Siennois ; mais ses débats avec la république de Sienne ne provenaient pas de discussions touchant des droits féodaux, ils tenaient uniquement à l'attachement extrême qu'il portait au parti guelfe.
(2) Pieve Asciata ou a Sciata, petite paroisse située dans le val d'Arbia, sur les confins du Chianti, à neuf milles de Castelnuovo Berardenga, et à six milles environ au nord de Sienne.
(3) Gigli, dans son Journal siennois, que j'aurai l'occasion de citer fréquemment, donne des détails précis sur les diverses transformations que subit le gouvernement de Sienne (tome xi, page 568). Les lecteurs curieux de connaître à fond ces matières peuvent le consulter ; pour moi, je me contenterai de faire remarquer ici que la concentration de l'autorité entre les mains des vingt-quatre magistrats fut la seconde forme du gouvernement de la ville. Ces magistrats étaient nommés par voie d'élection, au sein d'un conseil général. Chaque tiers de la ville (Sienne est partagée en trois quartiers appelés tiers) en nommait huit, dont quatre nobles et quatre roturiers ; sur ce nombre, on en choisissait un dans chaque tiers, et ces trois magistrats devenaient, sous la qualification de prieurs, les chefs de cette magistrature. Leurs fonctions duraient quinze jours, de manière que chacun des vingt-quatre était trois fois prieur dans la même année.
(4) L'église de Saint-Christophe, qui s'élève sur la place Tolomei, est souvent désignée, par les historiens et les chroniqueurs siennois, comme l'endroit où se tenaient les conseils publics, même antérieurement à 1260. Gigli (Diar. san., tome II, p. 31, 32) affirme, sur la foi de quelques mémoires recueillis par lui dans les archives de l'hôpital, que la colonne surmontée de la louve (cette colonne, qui était autrefois en bronze, est maintenant en étain) qu'on voit sur la place Tolomei fut érigée en 1260, «vraisemblablement après la victoire de Montaperto, pour rappeler que là se tenaient les conseils publics les plus importants. »
(5) Il est inutile d'indiquer dans quel quartier de Sienne se trouve le lieu appelé Campo Reggio ou vulgairement Camporeggi : tout le monde le sait. Je dirai seulement que les historiens siennois sont d.'accord pour assurer que ce nom fut donné à la partie de la ville où campa le roi Henri, fils de Frédéric Barberousse, et son successeur au trône impérial, en l'année 1194.
(6) La Malena et la Biena sont deux faibles cours d'eau qui coulent à très peu de distance de Montaperto, et qui se jettent tous deux dans l'Arbia.
(7) Dante fait allusion à Provenzano Salvani, que le poète place dans le purgatoire, malgré sa qualité de Gibelin. Ajoutons que les historiens siennois sont unanimes dans leurs témoignages de vénération envers cet illustre citoyen. Malavolti (tome xi, p. 14) affirme «qu'on ne peut pas induire des papiers publics de cette époque (1260), que Provenzano Salvani exerçât dans Sienne un pouvoir plus étendu que les autres gentilshommes…. Les registres publics prouvent qu'il fut envoyé plusieurs fois en ambassade dans divers lieux, comme les autres particuliers ; que, dans le conseil, ses avis ne prévalaient pas sur ceux des autres citoyens. On trouve dans ces mêmes papiers, qu'il se rendit en qualité de podestat à Montepulciano après la bataille de Montaperto : s'il eût été aussi puissant à Sienne qu'on le dit, il n'eût point quitté le gouvernement de la ville pour une charge de podestat…. Le fait est qu'il n'eut jamais dans Sienne une grande autorité, et que son caractère était trop doux et son ambition trop modeste pour ne pas obéir aux magistrats. » Il joignait à une probité parfaite un sens éminemment juste. La considération que des qualités si distinguées lui valurent chez les peuples voisins, de même que dans sa patrie, fut probablement appelée domination, et le fit qualifier de sire et de lyran, effet ordinaire de la disposition du public à mal interpréter les choses et à mal juger des hommes. Je laisse à penser si là défense présentée par l'historien que je viens de citer, et qui vivait deux siècles environ après le Dante, suffit pour laver la mémoire de Salvani. Cet illustre Siennois mourut le 11 juin 1269 ; il commandait alors, avec des alternatives de bonheur et de revers, une armée siennoise occupée au siège de Colle, ville du val d'Eisa, et véritable nid de Guelfes, défendue par des Français et des Florentins.
(8) Le comte Giordano Lancia, mentionné si fréquemment dans cette chronique, était parent de Manfred par sa mère et fut un de ses plus fidèles serviteurs. Lors de l'invasion du royaume de Naples par Charles d'Anjou, il fut chargé de défendre, conjointement avec le comte de Caserta, beau-frère de Manfred, le passage du Garignano. La trahison du comte de Caserta força le comte Giordano de se retirer. Lors du combat livré sur les rives du Caloro, près de Bénévent, il fut fait prisonnier et amené par ordre de Charles d'Anjou, pour constater la mort de Manfred, en face des restes sanglants de ce prince, qu'on venait de découvrir sur le champ de bataille, sous un monceau de morts. Le comte Giordano n'écouta que son affection pour son ancien maître, se frappa la tête de ses mains, et se jeta sur le corps en pleurant et en criant : « Hélas ! mon Dieu ! qu'est-ce que je vois ! Bon seigneur, sage maître, qui a pu ainsi t'arracher inhumainement la vie ! Vase de philosophie, ornement des armées, modèle des rois, pourquoi me refuse-t-on un couteau pour m'en frapper et devenir ton compagnon dans la mort, comme j'ai été, durant ta vie, le compagnon de ta gloire et de tes infortunes ! »
Les chevaliers français, et Charles d'Anjou lui-même, donnèrent les plus grands éloges à sa fidélité et à son dévouement. Il n'en fut pas moins conduit prisonnier en France, où le nouveau roi de Naples le fit cruellement périr. (Voir Giannone, Storia civile del regno di Napoli, lib. xix. chap. 3.—Sismondi, Hist. des rép. ital., chap. 21.)
(9) La famille des Salimbeni était une des plus nobles et des plus anciennes de Sienne. Marc Antonio Bellarmati, dans sa trop courte histoire de cette ville, rapporte qu'un Salimbene Salimbeni, ayant suivi en terre sainte Bonifazio Gricci, chef de mille cavaliers siennois, lors de la croisade prêchée par Pierre l'Ermite, fut élu patriarche d'Antioche, immédiatement après la prise de cette ville, en récompense de sa conduite durant l'expédition.
(10) Il est placé dans le Dôme, au-dessus du premier autel qui se trouve à main gauche, après la chapelle Saint-Jean.
(11) C'est-à-dire sur la grande place dite du Campo.
(12) Ce passage s'applique à trois tableaux distincts, représentant l'image de la Vierge, et il n'est pas inutile de donner à leur sujet quelques détails au lecteur. Le plus ancien, dont parle en premier lieu Nicolo Ventura, est une peinture sur plastique, qui se conserve actuellement dans la chapelle des prisons de Sant' Ansano : mais comme on en a restreint les dimensions, il n'est resté que la Vierge ; les figures qui l'entouraient ont disparu.
La madone des Grâces se trouve à la cathédrale, dans la chapelle dite del Voto.
Le troisième est le célèbre tableau de Ducio de la Buoninsegna, qui décora pendant près de deux siècles le maître-autel. Malheureusement la table de bois sur laquelle il est peint se rompit : on divisa alors le tableau en deux parties ; l'une d'elles fut suspendue à côté de l'autel de Sant' Ansano, et l'autre à côté de celui du Sacrement.
(13) L'évêque de Sienne s'appelait Tommaso, de la famille Balzetti. On rencontre d'amples particularités sur la vie de ce prélat dans l’Histoire de l'évêché de Sienne, de Pecci, p. 216.
(14) M. Hari, savant conservateur de la bibliothèque de Sienne, voulut bien m'indiquer un manuscrit contenant des mélanges d'Uberto Benvoglienti, où se trouve l'explication du mot besciolini. Cet auteur prétend que besciolini est un diminutif de besci ou bessi, c'est-à-dire fous, sots, impertinents, et que ce mot dérive du latin barbare beccus, les cc ayant été changés en ss. Quant à l'époque à laquelle les Siennois reçurent un tel surnom des Florentins, Benvoglienti est parvenu à découvrir qu'en 1203, les deux républiques, voulant terminer à l'amiable un léger différend, choisirent pour arbitre un certain Oggeri, alors podestat de Poggibonsi. Les Florentins ayant corrompu ce personnage, son arrêt leur fut favorable : les Siennois furent condamnés, et furent dès lors traités de sots et d'insensés par leurs adversaires. Ceux-ci marchèrent contre Sienne ; arrivés à la fontaine érigée en 1228, et appelée d'abord fontaine Bugnoli, ils dirent : « Voici la fontaine des bessi ou des becci. » Benvoglienti termine en raillant les assertions des écrivains qui, changeant becci en becchi, font dériver le nom de cette fontaine des boucs égorgés après la bataille de Montaperto, et dont le sang aurait servi, disent-ils, à tremper la chaux dont on se servit pour la construire.
(15) Il semble que l'auteur ait voulu faire allusion, dans ce passage, à deux batailles qui eurent lieu, l'une à Montemaggio, l'autre près de Sienne, au pont du Rosajo.
Aldobrandini, dans l'une de ses chroniques, raconte ainsi le combat de Montemaggio : « En 1045, les Siennois rassemblèrent à San Salvadore, dans la forêt du lac Lecceto, une armée de six mille hommes de la ville, qui, marchant à la rencontre des Florentins, les battirent à Montemaggio. Jean Bisdomini, qui a écrit une narration de cette bataille, raconte que ce furent les huit frères Porsio qui engagèrent les premiers la lutte avec les Florentins, et furent la cause principale de leur, déroute. Aussi-furent-ils les premiers Siennois qu'on appela capitaines, et par suite de ce fait, les membres de leur maison portèrent le nom des Incontrati (les Rencontrés).
Cette victoire donna lieu d'ailleurs à une réunion solennelle des principaux habitants de Sienne, dans laquelle l'un d'eux conseilla de suivre les exemples de Sennio et Aschio, premiers fondateurs de Sienne ; et d'autres citoyens illustres, lesquels, après avoir remporté une victoire, faisaient faire de grandes constructions, et érigeaient une tour en mémoire de leur triomphe. Ils demandèrent en conséquence que, selon cette ancienne coutume, l'on élevât une tour attenante à la maison de Porsio et de ses frères, et qu'on la leur donnât en souvenir de leur belle action ; qu'enfin, pour stimuler le patriotisme des futures, générations, on établît une loi qui autorisât ceux des citoyens qui se seraient distingués dans les armes, dans les conseils, ou dans l'administration de la justice, à construire une tour en témoignage de leur mérite ou de leur vertu. L'assemblée adopta cet avis à l'unanimité.
S'il est permis d'ajouter une foi entière à ce passage de la chronique d'Aldobrandini, il en résulterait que les tours, ou du moins une grande partie d'entre elles, furent élevées par des particuliers, alors, qu'on leur en accordait la permission. Mais cette autorité n'a pas persuadé tous les esprits ; plusieurs pensent que ces tours étaient destinées à fortifier les murs de la ville, qui, à en croire Teofilo Gallaccini, furent reculés jusqu'à huit reprises différentes, et qui auraient fini par enfermer toutes ces forteresses dans l'enceinte même de la cité. D'autres soulèvent une nouvelle difficulté en représentant que des constructions de cette nature auraient été trop dispendieuses pour être entreprises par des particuliers.
Je ne me propose pas de contredire qui que ce soit, ni d'exposer une opinion divergente qui pourrait être à son tour susceptible de réfutation ; néanmoins deux choses paraissent certaines : c'est, d'une part, que les particuliers ont disposé de ces tours comme de biens propres, les faisant passer en tout ou en partie à d'autres familles et les transmettant même quelquefois à titre de dots ; d'autre part, que le public y exerçait aussi des droits, car l'histoire nous apprend que la tour des Ugurgieri, située à l'entrée du Castellare, fut diminuée de trente brasses en 1280, pour cause de rébellion. Il me suffit, au, reste, d'avoir cité les faits qui se rapportent à l'origine des tours, et je laisse à d'autres le soin d'en tirer les conséquences.
Quanta la bataille du pont du Rosajo, les chroniqueurs et les historiens siennois ne sont pas d'accord sur sa date précise. Les uns, et dans ce nombre Tommasi, la placent en 1184 ; d'autres, tels que Muratori, pensent qu'elle eut lieu en 1186. Voici du reste quelle fut, selon les historiens siennois, la cause de cette bataille. L'empereur Frédéric Barberousse, usant sans mesure de l'ascendant que son parti exerçait en Italie, avait coutume de disposer du sol en faveur des hommes qui avaient le plus favorisé ses desseins. Sigonio (de Regno italico, lib. xv) s'exprime ainsi à l'égard de cet empereur : « In Italiam transgressum omnibus civitatibus, preter Pisas et « Pistorium, totius agri jurisdictionem ademit. » Le peuple de Sienne, dont la générosité s'indigna d'un tel abus de pouvoir, ne permit pas à l'empereur de pénétrer dans la ville, et lui en ferma les portes. Frédéric laissa derrière lui son fils Henri pour châtier l'orgueil des Siennois, en assiégeant la ville et en dévastant les campagnes. L'avenir lui réservait une défaite éclatante au pont du Rosajo.
(16) Voir la note 1.
(17) La tour des Marescotti est celle du palais aujourd'hui possédé par la noble famille Saracini, qui l'acheta des comtes Piccolomini Mandoli de la Triana ; ceux-ci la tenaient des Marescotti, ses premiers possesseurs. Elle est située sur une petite éminence, dans le quartier dit de la Città, non loin du Dôme. Quelques écrivains font descendre la famille des Marescotti de Mario Scoto, seigneur de Marra, province de l'Ecosse, qui, au temps d'Acaius, roi de cette île, conduisit une puissante armée au secours du souverain pontife Léon III, menacé par Charlemagne. Trois rameaux de cette maison donnèrent naissance à trois familles établies en Italie, l'une à Rome $ l'autre à Bologne, et la troisième à Sienne. Cette dernière occupa, dès les premiers temps de la république, les postes les plus considérables du gouvernement. En 1194, 1202 et 1208, la dignité consulaire fut dévolue à trois membres différents de cette maison. (Gigli, Diario sanese, p. 31.) Elle possédait de très grands biens et en outre deux tours dans la ville, dont l'une s'élevait sur la place Manetti, et l'autre, ancienne résidence des quinze magistrats gouverneurs de Sienne, dans le palais Saracini, ainsi que nous l'avons déjà fait observer. La famille Saracini, en la possession de laquelle cette tour se trouve aujourd'hui, est l'une des plus anciennes et des plus illustres de Sienne. Son nom fut mêlé à toutes les époques de l'histoire de cette république ; les dignités les plus importantes, les plus hauts emplois, furent confiés à ses membres. La place actuellement occupée par le palais de la commune lui appartenait autrefois. Indépendamment des hommes remarquables de la famille Saracini, on cite encore plusieurs femmes, dont la renommée s'est transmise jusqu'à nos jours : l'une est la bienheureuse sœur Alessia, compagne inséparable de sainte Catherine jusqu'à sa mort ; la seconde est Cristofana, qui fut mère du pape Jules III ; la troisième enfin, Onorata Orsini, mariée à Giacomo Saracini. Son père, le prince de Mugnano Orsino, après avoir quitté le commandement militaire dont le duc de Milan l'avait investi, était venu se fixer à Sienne. Lorsque l'empereur Frédéric III se rendit dans cette ville, au mois de février 1451, pour y chercher sa future femme, Éléonore, infante de Portugal, l'évêque de Sienne l'amena au-devant de lui hors de la porte Camollia. On voit encore, à l'endroit même où les deux augustes époux se rencontrèrent, une colonne surmontée d'un petit monument qui, d'un côté, porte une inscription rappelant cet événement, et de l'autre, les armes de l'empereur et celles de l'infante Éléonore. La princesse était accompagnée de quatre cents nobles dames siennoises, au milieu desquelles on remarquait Onorata Saracini, née Orsini. Ses compagnes lui ayant reproché d'être habillée trop simplement, elle répondit que les gentilles dames de Sienne ne devaient avoir d'autre ornement que leur modestie, parce que les dames habitant des villes plus riches et plus grandes pouvaient facilement les éclipser par le luxe de leurs vêtements et par l'éclat de leurs parures. Comme on lui demandait, dans un bal, quel était à son avis le cavalier le plus élégant, elle répondit qu'elle ne portait jamais ses regards sur un autre homme que sur son mari. Onorata mourut saintement, le 16 mars 1457, en prédisant à ses concitoyens que la reine du ciel ne tarderait pas à les secourir contre le comte Giacomo Piccino, qui payerait chèrement ses insolences envers les Siennois.
Sa prédiction s'accomplit exactement. Un poète du temps, Bernardino llicino, a célébré les vertus d'Onorata, qui fut enterrée dans l'église de Saint-Augustin, devant l'autel de l'Annunziata. (Gigli, Diario sanese, febbrajo, 37, marzo, 50.)
(18) Il n'est pas permis de-révoquer en doute l'anecdote relative à Usiglia, fruitière de Sienne, à moins de refuser toute croyance aux historiens et aux chroniqueurs siennois, car tous sans exception ont fait mention de cette particularité. On comprend d'ailleurs que les vaincus, saisis d'épouvante, n'ayant plus ni énergie morale ni force physique, purent préférer une prison avilissante à la mort qui les attendait sur le champ de bataille. Usiglia partagea avec son mari Geppo, fendeur de bois, la couronne et les récompenses. Ils habitaient près du couvent des filles converties ; on montre encore, à Sienne, l'emplacement où leur maison était située.
(19) Voir la note 18.
(20) Sienne eut aussi des pertes à déplorer. Tommasi rapporte que les corps des Siennois et des Allemands tués pendant cette journée furent enterrés dans la ville ; un décret public ordonna même d'ensevelir dans la cathédrale deux nobles qui avaient trouvé la mort dans ce combat mémorable, Andréa Beccarini et Giovanni Ugurgieri. Ils furent les premiers auxquels un tel honneur fut accordé. Voici les inscriptions gravées sur leurs tombes : « Andreas ex nobili Beccarinorum familia, qui in Montisaperti certamine cecidit, hic situs est primus. A. D. MCCLX. » — « Joannes Ugurgerius decreto publico hic situs est. Decessit Montisaperti clade, anno salutis MCCLX. »
(21) L'enceinte destinée aux chanoines et formant le chœur était autrefois située sous la coupole : Pandolfo Petrucci changea cette disposition et reporta l'enceinte canoniale derrière le maître-autel. Les deux antennes occupent encore aujourd'hui les places que leur assigne Ventura ; mais plusieurs de nos antiquaires croient, sur la foi de divers historiens, que ces antennes surmontaient le carroccio de l'armée florentine et non celui de la commune de Sienne.
(22) Il y a peu d'années, dans la soirée qui précédait le jour de l'Assomption, un char de forme antique partait de la place du Campo, près du palais public, et se dirigeait vers la place du Dôme, précédant le cierge que l'on portait en offrande ; arrivé là, il s'arrêtait au milieu des cris de la population, du bruit des trompettes et de la musique militaire. Du milieu de ce char, s'élevait une antenne sur laquelle étaient peintes des bandelettes blanches et noires, armes du peuple de Sienne, et surmontée d'un lion rampant ; le long du mât pendait une longue pièce de velours cramoisi, appelée vulgairement drapeau (c'était le prix destiné au cheval qui gagnait la course le jour de l'Assomption, prix auquel a été depuis substituée une somme d'argent). La tradition populaire voulait que ce char fût le même que celui mentionné par Ventura ; après avoir été un symbole de guerre, il serait devenu, par suite des changements introduits dans les usages nationaux, un signe de réjouissances. Depuis quelques années, il a été remplacé, à cause de sa vétusté, par un char plus élégant ; mais, sous le rapport historique, on doit regretter cette substitution, car le nouveau char n'offre plus le prestige que la tradition y attachait.
(23) Il paraît qu'en 1700, cet étendard se conservait encore dans les archives de l'hôpital, puisqu'il est dit dans les mémoires de Macchi, qui vivait à cette époque (tomes i, vi, LXVI), que l'on gardait « dans le sac de l'étendard de Montaperto » un contrat daté du 10 avril 1257, par lequel Ranieri de Ugone vendait quelques terres peu éloignées de Montaperto. En 1775, tous les livres et diplômes qui n'appartenaient pas à l'administration de l'hôpital furent transportés dans les archives des Réformations, et il est probable que ce sac, ainsi appelé à cause de l'étendard, y fut également déposé. Si réellement il n'existe plus, comme le ferait craindre l'entière inutilité de mes recherches, on doit regretter la perte d'un monument historique qui méritait d'être soigneusement conservé.
(24) Il y a vingt-deux ans, qu'à la suite d'une délibération prise par le conseil de la ville, on fit descendre d'une des deux tourelles qui surmontent le palais public une cloche réputée pour être la Martinella. Tous les érudits s'empressèrent d'aller la voir. En tête de l'inscription, qu'il est inutile de rapporter ici, on trouva le millésime A. D. MCCLXU. Cette date, postérieure de deux ans à la bataille, prouve que ce ne pouvait être la Martinella, et l'on se demande en vain quel a été le sort de cette fameuse cloche.
(25) On ignore ce que sont devenus ces trophées.
(26) Gigli (Diar. san., t. II, p. 144), d'accord avec les historiens siennois les plus estimés, ne partage pas l'opinion de Ventura touchant l'origine du nom de Becci donné à cette fontaine. Il cite à ce sujet les assertions de Francesco Patrizi, qui voit dans ce mot une corruption de bessia, terme grec qui signifie lieu désert et boisé.
Les Grecs (c'est Patrizi qui parle) appelèrent la Toscane Tirrenia, à cause de Tirreno, leur roi ; ils nommèrent les landes désertes et boisées Bessa, et Bessi ceux qui les habitèrent les premiers : d'après cette étymologie, la fontaine des Becci aurait pris le nom de ceux qui relevèrent, les deux ss de ce nom ayant été changées en deux ce, etc. Je ne me porte pas caution d'une érudition aussi mystérieuse : ce qu'il y a de certain, c'est que cette fontaine, avant de s'appeler des Becci, s'appelait fonte Bugnoli (fontaine des Paniers) ; on y lit encore cette inscription : « MCCXVIII, hic fons factus fuit tempore Domini Piccardi, Domini manentis de Spoleto Potestanis Sen. » Elle a été réparée ensuite en 1309 et 1418 ; il en résulte qu'elle fut construite trente-deux ans avant la bataille de Montaperto. En ce qui concerne l'origine du nom de Becci, je préférerais adopter l'opinion de Benvoglienti (voir note 14), qui passe pour un critique très pointilleux et extrêmement versé dans les antiquités de sa patrie.
(27) Il est à regretter que l'auteur ne se soit pas étendu plus longuement sur ces jeux de Saint-Georges et sur ceux que l'on appelait juvenals, lesquels tombèrent en désuétude lorsque les premiers commencèrent à se célébrer. En 1791, on imprima à Sienne un livre intitulé Relation des fêtes publiques données à Sienne dans les cinq derniers siècles, etc. ; malheureusement ce livre est sans couleur et sans intérêt. On s'occupe actuellement à Florence de publier un ouvrage relatif à toutes les fêtes publiques de l'Italie, et qui sera rédigé par un écrivain distingué, M. Philippe de Boni. Cinquante dessins de M. Charles-Ernest Liverati ajouteront au charme et à l'importance de cette publication toute nationale.
(28) Les personnes qui désireraient s'enquérir des raisons politiques qui firent frapper la ville de Sienne d'interdit, et des efforts du bienheureux Ambrogio Sansedoni pour le faire lever, n'ont qu'à lire le chapitre 13 du livre iii de la vie d'Ambrogio, rédigée par un de ses agnats, Jules Sansedoni, évêque de Grosseto. Le chapitre qui suit contient une description minutieuse et fort intéressante des fêtes qui avaient lieu chaque année en commémoration de cet événement ; elles furent célébrées jusqu'à la mort du bienheureux Ambrogio. On institua alors d'autres fêtes sacrées et profanes, qui se renouvelaient annuellement en son honneur, et dont on trouve également la description dans le chapitre 12 du livre iii de la vie écrite par l'évêque de Grosseto.