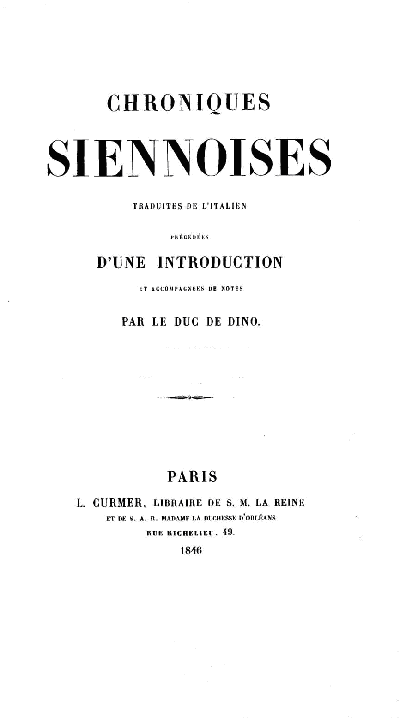
Nicolo de Giovanni de Francesco Ventura
CHRONIQUES SIENNOISES : introduction
Œuvre numérisée par Marc Szwajcer
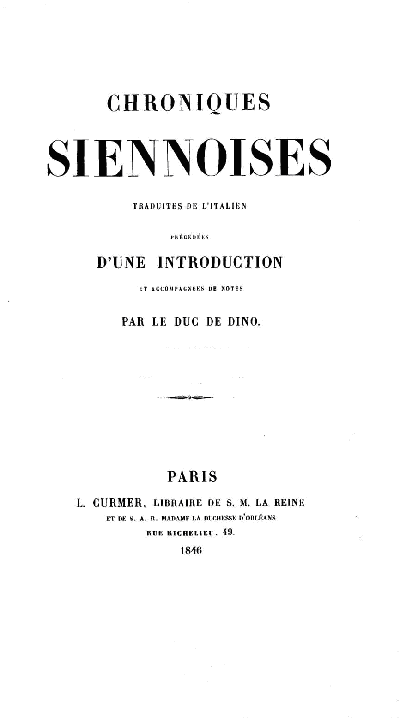
CHRONIQUES SIENNOISES : introduction
Œuvre numérisée par Marc Szwajcer
Parmi les républiques qui se formèrent de toutes parts en Italie au moyen âge, Sienne doit être considérée comme une de celles que leur position géographique, leur richesse et leur importance, appelèrent à jouer un rôle marquant sur la scène politique du monde. Moins puissante que Pise, moins riche que Florence, on peut la regarder comme la troisième des républiques de la Toscane. Ses liens politiques la mirent presque constamment en lutte ouverte ou cachée avec la brillante reine de l'Arno ; ses peintres, ses architectes, ses sculpteurs, lui permirent de lutter de magnificence avec ses rivales, et formèrent une école célèbre, digne d'entrer en comparaison avec les écoles les plus justement renommées. Plus heureuse que Pise, elle disputa souvent avec succès la domination de la Toscane à Florence, et ne vit s'anéantir son existence indépendante qu'à l'époque où cette dernière cachait son humiliation sous la couronne ducale, qu'une main étrangère avait placée sur la tête d'un de ses propres citoyens.
L'amour des études historiques a fait entreprendre, dans toutes les bibliothèques de l'Italie, de laborieuses recherches, dont les résultats ont été la publication de manuscrits précieux. La bibliothèque de Sienne offrait surtout un vaste champ aux explorations des érudits.
Aussi a-t-elle été soumise à de nombreuses investigations, auxquelles nous devons entre autres la publication d'un ouvrage des plus intéressants (1) sur l'histoire de Sienne, imprimé en 1844, par M. Joseph Porri, littérateur distingué de cette ville. Dans cet ouvrage se trouvent deux chroniques de la bataille de Monte-Aperto, savamment annotées par M. Porri lui-même. La première de ces chroniques est celle de Dominico Aldobrandini ; la seconde, celle qui nous a été laissée par Nicolo de Giovanni de Francesco Ventura (2).
Cette dernière chronique m'ayant paru pleine d'intérêt et d'originalité, j'ai tenté de la traduire en français, afin de la mettre ainsi plus à la portée des personnes qui aiment à étudier ces temps de bouleversements, pendant lesquels les luttes acharnées des partis, loin de ralentir la marche de l'esprit humain, semblaient au contraire lui donner un nouvel essor, allumer son flambeau dans le vaste incendie qui ravageait l'Italie, et en éclairer la civilisation du monde.
Parmi les nombreux événements dont l'Italie fut le théâtre au xiiie siècle, la bataille de Monte-Aperto a toujours frappé les historiens par ses conséquences importantes. En effet, la défaite qu'éprouvèrent dans cette journée les troupes de Florence ne fut pas seulement un échec pour l'ambition de cette ville, déjà redoutée par son ardeur à étendre son territoire ; mais ce fut encore un temps d'arrêt dans l'exécution de la grande pensée, que les Guelfes conçurent les premiers, de réunir les diverses républiques de la Toscane en un seul État, gouverné dans le même esprit. Elle eut aussi pour résultat de raviver en quelque sorte le parti gibelin, abattu dans presque tout le nord de l'Italie, de lui rendre de la force, de la confiance, et de prolonger pour longtemps encore les guerres effroyables qui déchirèrent l'Italie jusqu'à l'assujettissement de Florence sous le sceptre des Médicis.
Le manuscrit de Ventura fut écrit près de cent quatre vingt trois ans après la bataille de Monte-Aperto. Attentif à n'oublier aucune des actions remarquables de ses concitoyens, l'auteur de cette chronique n'y fait aucune mention de la part que les réfugiés florentins prirent à cette lutte, et omet, sans doute pour capter la bienveillance des chefs du gouvernement siennois, de rapporter la trahison d'une partie des troupes florentines. Il ne pouvait cependant pas ignorer l'action puissante qu'eut, à cette époque, Farinata des Uberti sur la destinée de sa patrie et sur les décisions du parti gibelin, dont ce grand homme était un des chefs les plus influents. J'essayerai donc ici de réparer cet oubli en traçant rapidement les faits principaux qui précédèrent la guerre de 1260 entre les deux républiques, et de donner un aperçu succinct de leur état intérieur. Examinant ensuite les conséquences de la victoire des Siennois, je serai amené à parler des autres chroniques qui complètent cet ouvrage ; chroniques que l'on peut regarder comme intimement liées à l'histoire de France, puisqu'elles se rapportent à cette autre époque, non moins glorieuse pour les Siennois, où, menacés dans leur liberté par les armes de Charles-Quint et de Côme des Médicis, premier duc de Florence, ils implorèrent l'appui de la France, et aidés par ses armées, défendirent leur indépendance jusqu'à la dernière extrémité.
Sans remonter jusqu'aux premières causes de dissentiment qui, éclatant entre les papes et les empereurs, nationalisèrent en Italie les deux surnoms de Guelfes et de Gibelins, il suffira de remarquer quelles avaient été les positions respectives des deux partis pendant les dix années qui précédèrent la bataille de Monte-Aperto.
L'empereur Frédéric II, luttant sans relâche contre la cour de Rome, avait su forcer Innocent IV à se retirer en France. Puissamment servi par Ezzelino de Romano, dans le nord de l'Italie, et par Manfred, son fils naturel, dans le royaume de Naples, cet empereur était encore parvenu, en 1248, à faire triompher le parti gibelin à Florence, écrasant ainsi, en quelque sorte, le parti guelfe dans la Toscane. La famille des Uberti, la plus nombreuse et la plus puissante du parti gibelin, et dont les palais étaient situés sur l'emplacement occupé actuellement par le Palais Vieux (3), le seconda de tout son pouvoir dans cette entreprise. La guerre cessa momentanément entre Sienne, ville essentiellement gibeline, et Florence, qui fut presque toujours regardée comme la tête du parti guelfe.
Mais, outre les passions ambitieuses des deux grands partis italiens, d'autres causes de discorde attisaient dans le sein de chaque cité le feu des guerres civiles, et faisaient naître à tout instant des révolutions municipales, dont les brusques secousses changeaient la face des affaires de l'Italie. Ces autres causes de désunion provenaient de la haine qui existait entre le peuple, Guelfe en général, et les nobles, pour la plupart Gibelins. En 1240, le peuple de Sienne, animé par les discours éloquents d'Aldobrandiup Cacciaconti (4), avait chassé les nobles, et leur avait enlevé en grande partie la direction des affaires publiques. Cependant Sienne ne se sépara pas du parti gibelin : son organisation politique resta telle qu'elle avait été instituée lors de la réforme de l'année 1200 ; seulement, au lieu de cinquante et un citoyens composant le conseil de gouvernement, et divisés en vingt-sept membres du corps de la noblesse et vingt-quatre membres nommés par le peuple, il n'y eut que ces derniers qui continuèrent à diriger les affaires de la ville. Chacun des trois quartiers de Sienne participait à la formation de ce conseil par l'élection de huit de ses membres.
Si l'impéritie de la noblesse fut la cause de cette révolution dans la république siennoise, à Florence ce fut l'arrogance des nobles, les violences et les outrages dont ils abreuvaient le peuple, qui soulevèrent celui-ci contre leur domination. Le 20 octobre 1250, les plus riches bourgeois se rassemblèrent sur la place Santa-Croce, forcèrent le podestat à se démettre de ses fonctions, et s'organisèrent en vingt compagnies ; puis, ayant créé la charge de capitaine du peuple, ils choisirent, par la voie de l'élection, deux anciens dans chacun des six quartiers de la ville, et formèrent des douze élus un conseil de gouvernement, qui prit le nom de Seigneurie. Cette révolution, faite principalement contre la noblesse, replaçait le gouvernement dans la main des Guelfes ; néanmoins le pouvoir impérial avait acquis une telle prépondérance en Toscane, que la nouvelle seigneurie se contenta de forcer les nobles à diminuer la hauteur de leurs tours, véritables forteresses à l'abri desquelles ils se croyaient tout permis (5).
Excepté dans la Romagne et dans la Pouille, les Guelfes ne luttaient plus avec avantage contre leurs ennemis, lorsque la mort frappa l'empereur Frédéric, 1e 13 décembre 1250, à l'âge de cinquante-six ans (6). Cet événement arrêta non seulement les Gibelins dans le cours de leurs succès, mais fit bientôt pencher la balance politique en faveur de leurs adversaires.
En apprenant la mort de Frédéric, Innocent IV s'empressa de quitter Lyon et vint à Gênes, sa patrie, recevant sur son passage dans toutes les villes de son parti, et notamment à Milan, les marques de la joie la plus vive. Avide de vengeance et dévoré d'ambition, ce pape, convoitant déjà la réunion du royaume de Naples au patrimoine du Saint-Siège, s'empressa de renouer plus activement que jamais ses intrigues avec les Guelfes. Ce fut alors que se ralluma, dans le midi de l'Italie, la longue guerre entreprise par les papes contre la maison de Souabe ; duel à mort, dans lequel on déploya de part et d'autre tant d'énergie, de talent et de persévérance, et qui devait finir par faire participer la France aux affaires de l'Italie, en favorisant la conquête du royaume de Naples par Charles d'Anjou.
La seigneurie de Florence se contenta de rappeler les exilés guelfes dans leur patrie. Ceux-ci, redevenus prépondérants dans le conseil de la ville, voyant d'une part Manfred, régent du royaume de Naples pour son frère Conrad IV, trop occupé de sa propre défense pour pouvoir protéger efficacement les Gibelins, d'autre part toute la haute Italie déchirée par la guerre entreprise contre le cruel Ezzelino de Romano, surnommé à juste titre le tyran de Padoue, conçurent le projet de pacifier la Toscane en expulsant successivement les Gibelins de toutes les villes où ils dominaient. Ce fut dans cette pensée que, de concert avec les Lucquois, ils entrèrent sur le territoire de Pise, en 1252, battirent les troupes de cette république, puis, traversant le territoire de Sienne, vinrent ravitailler Montalcino, ville appartenant aux Siennois, et qui, s'étant révoltée, avait imploré l'appui de Florence. En 1253, Pistoja se vit forcée de se soumettre aux Florentins, et l'année suivante, ils vinrent assiéger Montereggione (7), forteresse siennoise, dont la conservation importait tellement à la commune de Sienne, qu'elle se décida à signer un traité de paix par lequel elle renonçait à son alliance avec les Gibelins, sans changer néanmoins la forme intérieure de son gouvernement. Par ce même traité, les deux républiques contractantes s'engageaient mutuellement à ne point donner asile à ceux que l'une ou l'autre d'entre elles frapperait d'ostracisme. Ce traité, si avantageux pour le parti guelfe, présente une circonstance curieuse, c'est qu'il fut rédigé par le notaire Brunetto Latini, dont les ouvrages littéraires, et principalement la gloire d'avoir été le maître du Dante, ont transmis le nom à la postérité (8).
L'armée florentine, quittant alors les murs de Montereggione, poursuivit le cours de ses succès en forçant Volterra, l'antique cité étrusque, à chasser les Gibelins qui s'étaient réfugiés dans ses murs.
Les victoires des Florentins et celles que les troupes du pape avaient remportées sur Manfred semblaient promettre le triomphe définitif des Guelfes, lorsque Innocent IV mourut, le 7 décembre 1254 (9). Sa mort exerça, sur le parti guelfe la même influence que celle de Frédéric avait eue sur le parti gibelin. Privés d'un chef aussi courageux et aussi habile que l'était ce pontife, ne trouvant pas la même énergie dans son successeur, Alexandre IV, les Guelfes s'arrêtèrent, tandis que le parti gibelin redoublait d'efforts pour reconquérir le terrain perdu, et que Manfred, délivré de son ardent antagoniste, redevenait maître de toutes les provinces qui lui avaient été enlevées.
En Lombardie la lutte continua, mais elle prit momentanément un autre caractère. Dégagé de toute contrainte par la mort de l'empereur Frédéric, Ezzelino de Romano avait donné un libre cours à ses passions. Ses crimes, les cruautés inouïes qu'il commettait et que toute l'Italie apprenait avec horreur, les trahisons constantes dont il payait les services de ses alliés, le firent prendre en exécration. Guelfes et Gibelins s'unirent pour le combattre, à la voix du pape, qui avait fait prêcher une croisade contre ce monstre. Son habileté et son courage militaire ne purent tenir enfin contre tant d'ennemis : blessé dans un combat (10), lorsqu’après avoir fait une tentative inutile pour surprendre Milan il se retirait avec son armée, il fut pris, et mourut peu d'heures après des suites de sa blessure, le 16 décembre 1259. Les croisés (11) marchèrent alors contre son frère, Albéric de Romano, podestat de Trévise, le firent prisonnier avec toute sa famille, et, malgré ses prières, le mirent à mort ainsi que tous ses enfants. Leurs cadavres, envoyés dans toutes les villes où la cruauté de cette famille s'était fait sentir, apprirent aux peuples que leurs longues tortures avaient enfin été vengées.
Malgré la mort d'Innocent IV, aucun changement n'était survenu à Florence. Les Gibelins, toujours éloignés du gouvernement, voyaient avec amertume leurs adversaires affermir de plus en plus leur domination : aussi résolurent-ils, en 1258, de sortir de l'état où ils étaient réduits ; mais leurs sourdes menées ayant été découvertes, le peuple les attaqua avec fureur. Vaincus après une résistance opiniâtre, ceux d'entre eux qui purent s'échapper vinrent à Sienne chercher un refuge. Parmi eux se trouvait Farinata des Uberti. Les Florentins envoyèrent aussitôt à Sienne réclamer auprès de cette république l'exécution du traité de 1254. Excités par les réfugiés, et jaloux de se venger des défaites qu'ils avaient éprouvées, les Siennois repoussèrent cette demande, et la guerre fut déclarée entre les deux républiques.
Pise et Sienne (12) étaient alors les deux seules villes importantes de la Toscane restées au pouvoir des Gibelins ; dans toutes les autres, les Guelfes, soutenus par les Florentins, s'étaient rendus maîtres du gouvernement. La nouvelle lutte qui allait s'engager était donc, en quelque sorte, une dernière partie tentée par les deux factions, et d'où dépendait entièrement le sort des Gibelins toscans : aussi ni l'une ni l'autre des deux cités rivales ne négligèrent aucun moyen de s'assurer la victoire.
La république de Sienne tourna naturellement ses regards vers Manfred, regardé à cette époque comme le chef du parti gibelin. Une députation lui fut envoyée pour implorer son secours ; elle s'adjoignit Farinata des Uberti, dont l'habileté semblait être un gage certain de succès. Arrivée à Naples, l'ambassade siennoise trouva Manfred occupé à rétablir l'ordre dans le royaume qu'il venait de reconquérir, et dont il avait usurpé la couronne, en profitant de la fausse nouvelle, répandue peut-être à son instigation, que son neveu Conradin était mort en Allemagne (13). Bien que ses affaires se fussent rétablies, Manfred avait trop à craindre encore pour détacher loin de lui une partie de son armée : aussi les députés siennois auraient-ils refusé le faible secours offert par ce monarque, sans Farinata des Uberti, qui leur persuada que malgré l'insuffisance d'un tel secours, on pouvait l'employer de manière à forcer bientôt Manfred de prendre une part plus grande à la défense de leur cause.
Florence, de son côté, fit un appel à tous ses alliés. Lucques, qui, de toutes les républiques italiennes, devait être la dernière à voir succomber son indépendance, et qui était destinée à payer un large tribut de grands hommes (14) à l'histoire du moyen âge, fut une des premières à la secourir.
Dès le commencement de l'année 1260, les Siennois assiégèrent Montalcino. Pour forcer l'ennemi à en lever le siège, l'armée florentine pénétra sur les terres de Sienne, dévastant tout sur son passage ; puis, encouragée par la prise de Casole et de Menzano, elle vint asseoir son camp sous les murs de Sienne, en face de la porte Camuglia. L'armée siennoise, rappelée aussitôt, accourut au secours de la ville et attaqua le camp florentin. Le combat fut rude (15), et bien que les Guelfes restassent victorieux, leur armée eut tant à souffrir de sa victoire qu'elle se replia sur Florence, où elle rapporta pour trophée de ses succès la bannière de Manfred.
L'infatigable Farinata des Uberti profita habilement de cette circonstance pour presser plus vivement Manfred de venir au secours des Gibelins. Il lui rendit compte des insultes faites par la populace de Florence à son étendard ; il lui montra la réputation de ses armes compromise par l'échec qu'elles venaient d'éprouver, et lui fit envisager quelle serait la périlleuse situation du parti gibelin, s'il ne le secourait pas d'une manière efficace. Touché par ces considérations, le roi de Naples envoya aussitôt huit cents cavaliers allemands au secours des Gibelins.
Voyant alors les Siennois rassurés, et voulant profiter au plus tôt de l'ardeur qu'ils manifestaient, Farinata les décida à recommencer le siège de Montalcino, et parvint en même temps, par ses intrigues, à circonvenir deux des membres du gouvernement de Florence. A l'aide de deux frères mineurs, il leur persuada qu'une conspiration n'attendait pour éclater que le moment où une armée imposante se montrerait sous les murs de Sienne, et que la ville serait livrée aux Florentins. Abusés par les promesses des faux conspirateurs, les deux anciens entraînèrent la seigneurie à renouveler immédiatement les hostilités. Ce fut en vain que les nobles du parti guelfe combattirent, dans l'assemblée du peuple, un projet que les renforts envoyés par Manfred rendaient inopportun ; en vain Cece des Gherardini éleva la voix à trois reprises différentes, malgré les amendes dont le frappait le conseil pour le forcer au silence : sa vieille expérience ne put prévaloir contre l'aveuglement et la passion du peuple. La résolution de la seigneurie fut sanctionnée, et l'armée florentine, renforcée par de nouveaux secours qui la portèrent à trente mille combattants, s'achemina vers Sienne, sous prétexte d'aller ravitailler Montalcino.
Messire Uberto, général des Florentins, alla camper avec son armée dans la plaine de Monte-Aperto, située à six milles de Sienne, et enfermée entre la Biene et la Malena, petites rivières tributaires de l'Arbia. Plusieurs jours se passèrent à attendre le signal promis par les prétendus conspirateurs ; mais voyant qu'aucun mouvement ne se manifestait en leur faveur, les Florentins commencèrent à se repentir de leur imprudence. Déjà ils se préparaient à la retraite, lorsque, le 4 septembre, les Siennois, sortant de la porte Sanviene, se ruèrent sur leur camp. Dès le commencement de l'action, une partie des Florentins, Gibelins de cœur et gagnés par Farinata des Uberti, abandonna ses rangs, et, passant du côté des Siennois, chargea avec eux les Guelfes. Bocca des Abati donna le premier l'exemple de la défection, en tranchant d'un coup de sabre le bras de Jacopo Vacca des Pazzi, porte-étendard de l'armée florentine. A la vue de cette trahison, une partie des Guelfes prit la fuite ; l'autre, se serrant autour du Carroccio (16), se fit massacrer en le défendant courageusement. Bientôt il n'y eut plus de combat, mais la plaine de Monte-Aperto devint une véritable boucherie, dans laquelle dix mille hommes environ de l'armée guelfe furent taillés en pièces.
Les conséquences de cette victoire furent immenses : frappés de terreur, les Guelfes abandonnèrent les villes qu'ils gouvernaient ; dans Florence même, ce parti, incapable de lutter encore après le coup terrible qui venait de le frapper, se condamna à l'exil, et la république de Lucques vit arriver dans ses murs, de tous les points de la Toscane, les familles éplorées de cette grande faction guelfe, dont, quelques jours auparavant, la puissance semblait être si fortement consolidée. Les Lucquois, qui devaient un jour renouveler les blessures du peuple florentin dans les plaines d'Altopascio (17) et de Montecatini (18), secoururent en fidèles alliés tous ces malheureux exilés, et ne les abandonnèrent que lorsque, contraints par la force des armes, ils se virent eux-mêmes obligés de s'allier au parti vainqueur.
Le pape, effrayé de l'ascendant que donnait à Manfred l'appui de toute la Toscane, eut recours aux moyens les plus violents pour combattre l'ennemi qui l'enlaçait de toutes parts, et fit prêcher une croisade contre ce prince, sous prétexte qu'il favorisait les ennemis de la foi en entretenant des Sarrasins dans son armée, et en protégeant leurs colonies dans la Sicile et dans les Abruzzes. Mais ce moyen extrême aurait eu peu d'efficacité si Urbain IV, succédant (19) à Alexandre IV, n'avait pas appelé au trône de Naples un compétiteur capable, par sa propre puissance, de disputer à Manfred la couronne qu'il avait usurpée.
Si le règne d'Urbain IV fut de courte durée, du moins il est signalé dans l'histoire par un grand fait politique, la participation donnée, par ce pape français, à ses compatriotes, dans les affaires d'Italie ; et c'est peut-être au gain de la bataille de Monte-Aperto par les Gibelins que l'on doit attribuer la ligne adoptée alors par la cour de Rome.
La ville de Florence elle-même fut au moment de disparaître de la surface de l'Italie. Réunis à Empoli, dans une espèce de parlement fédératif sous la présidence du comte d'Anglone, vicaire de Manfred, les chefs gibelins des différentes cités de la Toscane se demandèrent si cette ville de Florence, imbue de l'esprit guelfe et si menaçante naguère, ne devait pas être détruite de fond en comble.
Alors, à la place des chefs-d'œuvre que l'on admire dans cette ville, à la place de ces monuments d'une architecture si imposante, élevés par la république à mesure que sa destinée glorieuse la rendait plus puissante ; au lieu de trouver dans Florence le berceau de tant d'hommes célèbres par leur génie, on n'aurait plus rencontré, sur les bords de l'Arno, que des ruines abandonnées, et dont la vue eût fait naître peu de regrets dans l'esprit des archéologues. Peut-être le grand poète, fondateur de la littérature moderne, n'aurait pas accompli son œuvre ; peut-être les sciences, les lettres, les arts, ne trouvant pas pour les protéger la grande famille des Médicis, ne se seraient développés qu'avec des difficultés inouïes, dans le sein d'une société fondée sur d'autres principes. Mais la pacification de la Toscane devenait un fait accompli, les derniers germes de discorde étaient détruits, et cette contrée centrale de l'Italie, reprenant l'antique constitution des Étrusques, eût opposé, par sa masse compacte, une barrière aux invasions qui par la suite ravagèrent l'Italie. La Providence en avait décidé autrement, et, pour sauver Florence, elle se servit du même homme qui, par son énergie et son habileté, avait mis son existence en péril.
Pendant cette période de l'histoire italienne, le nom de traître ne peut stigmatiser que les hommes qui, semblables à Bocca des Abati, attendaient l'heure du combat pour plonger leur épée dans le sein de ceux qui les regardaient comme amis ; il ne doit pas s'attacher à la mémoire des vaincus du moment, qui, bannis par un parti politique, allaient, dans leur exil, recruter des forces chez les partisans de leur foi politique, afin de ressaisir l'autorité dans leur ville natale. Une distinction que la politique et la saine nïoi-ale nous feraient repousser aujourd'hui, comme contraire à la dignité et aux devoirs du citoyen, doit être faite pour les hommes de cette époque ; car il y a toujours en eux deux êtres politiques, le citoyen municipal et le citoyen guelfe ou gibelin : celui-ci appartenant à une secte politique dont les ramifications s'étendaient sur le sol entier de l'Italie ; celui-là faisant partie d'une famille dont il devait protéger l'existence, et au sein de laquelle il devait chercher à faire triompher les principes de la faction dont il était membre.
Farinata des Uberti offre un exemple frappant de cette double pensée patriotique, qui dirigeait alors les actions des citoyens. Du fond de son exil à Sienne, il alimente par ses intrigues la guerre qui doit écraser ses adversaires ; dans l'assemblée d'Empoli, il sauve d'une ruine complète sa ville natale, par la puissance de sa parole et par l'ascendant de son esprit. Peut-être est-ce avec raison que les Gibelins l'accusèrent, par la suite, de tous les maux qu'entraîna pour eux la conservation de Florence ; mais on doit reconnaître qu'en s'opposant à la destruction de cette ville, ce grand homme obéit à une noble impulsion, à un saint amour de sa patrie, et que les forces acquises dans ce moment par le parti gibelin étaient bien propres à l'abuser sur les conséquences de la résolution qu'il fit adopter.
Les deux républiques, dont la lutte venait de préoccuper l'Italie, se retrouvèrent bientôt en présence par le renversement des Gibelins à Florence, et poursuivirent leurs destinées avec des fortunes diverses. Sienne, fidèle à la maison de Souabe, envoya au jeune Conradin cent mille florins d'or pour l'aider à reconquérir son royaume. Ce fut dans ses murs que ce prince infortuné apprit le premier succès obtenu par ses armes à Ponte-a-Valle, dans le val d'Arno supérieur ; succès qui enflamma encore plus son courage et l'ardeur de tous les Gibelins. Mais bientôt les espérances de Conradin furent détruites dans les champs de Tagliacozzo, où, le 23 août 1268, il fut battu par les Angevins, fait prisonnier, et peu après porta sur l'échafaud cette même tête que ses partisans croyaient déjà voir ornée de la couronne des Deux-Siciles. La nouvelle de cette défaite plongea le parti gibelin de la Toscane dans la plus grande détresse. Pise et Sienne furent les seules villes qui osèrent refuser d'arborer l'étendard de la maison d'Anjou. Sienne même, ayant recueilli les débris de l'armée de Conradin, en confia le commandement à Provenzano Salvani, et déclara la guerre à Florence. Mais cette levée de boucliers lui fut fatale, et le 11 juin 1269, cette armée fut anéantie sur les bords de l'Eisa, ce qui fit perdre à la république de Sienne la prépondérance que la victoire de Monte-Aperto lui avait acquise dans la Toscane. A la suite de ces revers, les Siennois furent obligés de payer six mille onces d'or au vicaire de Charles d'Anjou, pour obtenir grâce et protection de la part de ce redoutable prince.
A partir de cette époque, les dissensions intestines paralysèrent le développement de la puissance des Siennois, dont l'histoire, jusqu'à la fin du xve siècle, n'est plus qu'une longue et pénible série d'intrigues, de proscriptions, de massacres. Au milieu de ce chaos, aucun grand caractère, aucune vaste intelligence ne fixe les regards ; mais la soif du pouvoir descend jusque dans les classes les plus infimes de la société. Les Siennois se divisent en castes, qui, sous les noms de Grands, de Nobles, Mont des Gentilshommes, Mont du Peuple, Mont des Neufs, Mont des Réformateurs, s'arrachent le droit de puiser à pleines mains dans les trésors de la ville.
Ce fut en vain qu'à différentes époques les papes ou les souverains étrangers essayèrent de pacifier cette ville turbulente : à la première occasion qui semblait favorable à l'un ou l'autre des partis, les haines reparaissaient aussi vivaces et aussi ardentes que par le passé. Des inimitiés de famille à famille se mêlaient à ce dédale de rivalités, et augmentaient encore la violence des persécutions politiques. A ces calamités vinrent se joindre d'autres fléaux, communs à toute l'Italie. La peste exerça ses ravages à Sienne, et, vers le milieu du xiiie siècle, les condottieri commencèrent à dévaster la péninsule italienne et à faire trembler les diverses républiques de la Toscane. Sienne fut une des premières à ressentir les pernicieux effets de cette organisation militaire, qui non seulement causait la ruine de ces pays, mais éteignait encore l'esprit guerrier des populations, en leur faisant perdre l'habitude des armes, et en livrant ainsi les villes et lès campagnes presque sans défense à une soldatesque effrénée.
Tant de maux n'empêchaient pas le commerce, particulièrement celui des laines, de prospérer dans la république de Sienne, et les richesses des habitants leur inspirant le goût du luxe, on vit s'élever des monuments dignes d'être cités parmi les plus splendides créations de l'art. D'habiles artistes décoraient les édifices publics, et jetaient ainsi les fondements de cette école siennoise, remplie d'imagination et de sentiment, qui devait un jour donner presque un rival à Raphaël dans la personne de Gio Antonio Razzi de Vergelle, surnommé le Sodome. Les sciences trouvaient aussi un asile dans ses murs, ensanglantés à chaque instant par les partis, et les difficultés survenues en 1321 à Bologne, entre le gouvernement de la ville et l'université, refoulant vers Sienne une jeunesse studieuse et d'éminents professeurs, furent les premières causes qui amenèrent, en 1357, la fondation définitive de la célèbre université de Sienne.
Cependant les troubles continuels de cette république devaient avoir de fatales conséquences pour sa prospérité. Elles commencèrent à se faire sentir plus spécialement après 1384, lorsque, par suite d'une de ses fréquentes mutations de gouvernement, le peuple ayant chassé le Mont des Réformateurs, près de quatre mille artisans furent exilés, et s'établirent par la suite dans les lieux où ils avaient trouvé un asile, plutôt que de profiter de l'amnistie qui les rappelait dans leur patrie.
Vers la fin du xive siècle, les Siennois, aveuglés par leur haine contre les Florentins, se jetèrent dans les bras de Jean Galéas Visconti, comte de Virtù et duc de Milan ; un lieutenant de ce dernier vint, le 1er janvier 1400, résider à Sienne, pour y gouverner au nom de son maître, collectivement avec la seigneurie et le capitaine du peuple. Presque toute la Toscane s'était alors livrée à ce prince habile ; les Florentins seuls lui résistaient avec courage, et le forcèrent à signer un traité en 1389. Un de leurs ambassadeurs, interpellé sur les garanties réciproques que devraient donner les deux parties contractantes, répondit fièrement : « Que l'épée soit la garantie qui rende la paix durable, maintenant que Galéas connaît par expérience notre force et nous la sienne. »
La mort du duc de Milan, en 1402, rendit l'indépendance aux villes qui s'étaient placées volontairement sous son joug. Sienne attendit jusqu'en 1404, avant de renvoyer le lieutenant du duc. A cette époque, le paix ayant été conclue de nouveau avec Florence, les Siennois purent songer à reconquérir tous les châteaux qui s'étaient révoltés contre la commune. Cette nouvelle alliance des Siennois et des Florentins fut d'un grand avantage pour ces derniers ; car, fidèle au traité, la république de Sienne refusa d'entrer en accommodement avec Ladislas, roi de Naples, et fit échouer l'entreprise de ce monarque contre Florence, en supportant avec constance les dégâts causés par les troupes de ce souverain, surnommé par les Toscans le Roi gâte-grain.
Cette union des deux républiques ne fut pas de longue durée ; Après la mort de Ladislas, la guerre recommença vers la fin du pontificat de Martin V ; pontificat illustré par la bulle que ce pape rendit en faveur des juifs, et qui témoigne des progrès faits par l'esprit humain, malgré les guerres continuelles qui ensanglantaient l'Europe.
Ce fut par de semblables secousses que la république de Sienne arriva haletante au commencement du xvie siècle, époque à laquelle un homme d'une prudence consommée, d'un esprit vaste et profond, d'un courage inébranlable, surgit au milieu des guerres civiles, et revint de l'exil pour donner à cette malheureuse cité un moment de repos. Membre du Mont des Neuf, Pandolfo Petrucci parvint à se former une espèce de pouvoir suprême, sous le titre de Protecteur, et à le transmettre à ses descendants. C'est ainsi que, dans presque toute l'Italie, les républiques, fatiguées de convulsions intestines, semblaient faire bon marché de leur indépendance, en se rangeant sous les lois de leurs citoyens les plus capables. Déjà Florence s'était en quelque sorte habituée à la domination des Médicis, et il avait fallu toute la faiblesse de Pierre, fils de Côme, Père de la patrie, pour qu'elle échappât quelques années encore à sa destinée. Gênes voyait de jour en jour la grandeur des Doria étendre un voile sur ses vieilles traditions républicaines. Venise seule, grâce à l'admirable et terrible constitution qui la régissait, pouvait, sans trembler pour sa liberté, contempler la gloire de ses patriciens. Pandolfo Petrucci sut conserver son influence dictatoriale jusqu'à sa mort ; mais peu après, les héritiers de sa puissance, inhabiles à diriger les affaires, laissèrent échapper le pouvoir, et la république retomba dans les mêmes convulsions auxquelles Pandolfo Petrucci avait su l'arracher.
A cette même époque, les grandes monarchies européennes, délivrées des entraves de la féodalité, s'étaient peu à peu fortifiées par une meilleure administration. Elles avaient convoité cette riche terre de l'Italie, qui, malgré ses commotions continuelles, était restée jusqu'alors le centre du commerce et des arts. La France, gouvernée par un prince audacieux, avait tiré l'épée pour résister à la puissance de plus en plus menaçante de Charles-Quint, et bien que vaincu à Pavie, François Ier ne perdait pas l'occasion de susciter des embarras à son dangereux rival. La réforme religieuse, qui grandissait de plus en plus dans le nord de l'Allemagne, vint mettre un terme aux rivalités de la papauté et de l'empire. Ce fut à Bologne que Charles-Quint et Clément VII conclurent la paix. Longtemps, persécuté, et réduit aux dernières extrémités par les armes victorieuses de l'empereur, le pape se vit réintégré par lui dans toute son autorité ; il obtint même, pour rétablir dans Florence sa famille et lui en assurer à jamais la possession, le secours des troupes qui peu auparavant avaient saccagé Rome. Désormais il n'y eut plus en Italie ni Guelfes ni Gibelins, mais des Impériaux et des Français.
La malheureuse paix de Cambrai liait la France et laissait Florence livrée à ses propres forces. Néanmoins la seigneurie ne perdit pas courage, et s'apprêta à lutter contre les ennemis ; tous les véritables amis de la liberté unirent leurs efforts pour repousser l'asservissement, et forcèrent par leur courageuse attitude les partisans des Médicis à dissimuler leur espérance. A cette heure de danger, une ardeur martiale, presque éteinte dans cette ville commerçante, vint enflammer la jeunesse : on vit se former, dans le sein de la cité, des corps de troupes urbaines dont la valeur ne le cédait en aucune manière aux vieilles bandes espagnoles. Les artistes fameux de Florence, qui ne semblaient destinés qu'à jeter par leurs œuvres un lustre pacifique sur la république, firent servir leur talent à la défense de la patrie. Le grand Michel-Ange répara un moment de faiblesse en revenant fortifier une des portes de la ville. Benvenuto Cellini, quittant ses travaux délicats, et se rappelant s'être vanté d'avoir pointé le canon dont le coup frappa le connétable de Bourbon, sous les murs de Rome, voulut présider aux fortifications d'une autre partie de la ville. Un Martelli, avide de gloire, allait dans le camp ennemi combattre en champ clos un Florentin servant dans l'armée du pape ; partout enfin, dans les terres de la république, en courait aux armes.
Mais l'heure marquée par la Providence était arrivée : aussi, malgré une longue résistance, malgré les efforts de Feruccio, qui de marchand était devenu, à force d'intrépidité, général de la république, et qui périt assassiné dans le même combat où le prince d'Orange, général en chef des Impériaux, perdit la vie, Florence, trahie par Malatesta Baglioni, fut obligée de se soumettre, et d'accepter les changements qu'il plut à l'empereur d'introduire dans sa constitution politique.
Alexandre des Médicis, aimé à l'égal d'un fils par Clément VII, bien que la mulâtresse à laquelle il devait le jour pût lui compter deux autres pères également probables, Laurent des Médicis, duc d'Urbin, et un muletier, fut nommé par l'empereur chef de la république. Il ne tarda pas à faire exécrer son gouvernement, par les vengeances qu'il exerça contre le parti opposé à sa maison ; ces vengeances une fois-accomplies, il lui fut facile de se défaire des hommes qui avaient puissamment secondé son élévation, et dont le crédit portait ombrage à sa politique soupçonneuse. Philippe Strozzi, dont le mariage avec une Médicis avait été un lien de rapprochement momentané entre ces deux familles rivales, fut l'un de ceux qu'il poursuivit avec le plus d'acharnement.
Ce dernier réunissait en effet tout ce qui pouvait rendre un homme redoutable au nouveau duc. Doué d'un esprit actif et entreprenant, il avait reçu, comme tous les citoyens distingués de la république, une éducation forte, dont il avait retiré de grands fruits. Ses immenses richesses, habilement employées, lui avaient formé une nombreuse clientèle, que les mécontents du nouvel ordre de choses grossissaient chaque jour. L'ambition personnelle qui lui avait fait braver la puissance de Soderini et les lois de son pays, lors de son mariage avec la fille de Pierre des Médicis, l'avait attaché pour quelque temps à la fortune de la famille naguère exilée, aujourd'hui toute-puissante ; mais le mécontentement toujours croissant des citoyens lui fit rêver une position plus haute. Les soupçons dont il se vit l'objet le poussèrent plus rapidement sur la pente où il se trouvait déjà entraîné, et cachant ses projets sous le masque de son affection aux anciennes formes de gouvernement de sa patrie, il se déclara bientôt l'ennemi acharné d'Alexandre. Habile à profiter de toutes les circonstances, il vint en France lors du mariage de Catherine des Médicis avec le duc d'Orléans, y laissa son fils Pierre, puis se rendit à Naples, où les réfugiés florentins imploraient de Charles-Quint la liberté de leur patrie. Trompé dans ses espérances du côté de l'empereur, il se réfugia à Venise, d'où il dirigeait tous les complots qui éclataient en Toscane contre le gouvernement du duc, et entretenait une active correspondance avec son fils Pierre. On trouvera dans l'appendice de cet ouvrage plusieurs lettres intéressantes que le duc de Strozzi a bien voulu me permettre d'extraire de ses archives, et qui caractérisent parfaitement la position de la famille Strozzi. (Voir l'Appendice, lettres 1, 2, 3, 4.)
La fin tragique d'Alexandre vint surprendre les exilés au milieu de leurs sourdes menées. Rien n'était préparé pour profiter du crime qui venait de plonger Florence dans la stupeur, et le peuple, en apprenant la mort de son premier maître, ne se livra à aucune de ces réactions qu'on pouvait attendre d'une populace turbulente et jusqu'alors si fortement éprise de sa liberté. L'enthousiasme, au contraire, fut extrême parmi les exilés. Lorenzino des Médicis, dont l'âme sanguinaire et corrompue avait adopté l'idée de ce meurtre comme elle adoptait toutes les missions honteuses de l'homme qu'il frappa, fut proclamé parmi eux un Brutus. Philippe Strozzi, aveuglé par sa haine, lui demanda la main de ses deux sœurs pour deux de ses fils.
L'élection de Côme Ier, fils de Jean de Médicis, dit des Bandes noires, habilement conduite par Francesco Vettori, Guicciardini, Roberto Acciajuoli et Matteo Strozzi, donna pour maître à la Toscane un de ces hommes doués de tous les talents propres à affermir sur le trône une dynastie, à fonder et étendre un nouvel État ; mais qui lèguent à la postérité, en même temps que la gloire qui s'attache à des qualités si brillantes, le souvenir de leurs passions haineuses, de leurs débauches et de leurs crimes. Impénétrable dans ses projets, défiant, souple, tenace dans ses résolutions, habile à cacher ses manques de foi ; ne reculant jamais devant l'emploi des moyens les plus criminels pour arriver à son but ; studieux, admirateur des beaux-arts, savant chimiste, il y a du Néron, du Louis XI, et du Côme des Médicis, Père de la patrie, dans ce prince qui réussit, dès le commencement de son règne, à déjouer les intrigues ourdies contre sa puissance, et à repousser plus tard par la force les agressions de ses adversaires.
Fort de l'appui de François Ier ; trompé sur les dispositions actuelles du peuple florentin par l'histoire de leurs dissensions politiques et leurs héroïques efforts lors du siège de Florence ; aveuglé par les illusions que se font trop souvent les bannis, Philippe Strozzi ne tarda pas à tomber au pouvoir de Côme, après s'être avancé jusqu'à Montemurlo, dans la province de Pistoie. Son fils Pierre, battu par Alexandre Vitclli, général de l'empereur, ne put arracher son père à sa malheureuse destinée. Conduit et renfermé dans la citadelle de Florence, il fut, pendant quelque temps, possible à Philippe Strozzi de se faire illusion sur son sort. Les lois de la guerre, telle qu'on la pratiquait alors, le faisaient la propriété de Vitelli, qui avait engagé sa parole de lui conserver là vie : le prix de sa rançon semblait donc être la seule difficulté qui dût s'opposer à sa mise en liberté. Mais il était d'une trop grande importance qu'un homme aussi influent parmi les exilés ne pût jamais se trouver en position de troubler son gouvernement, pour que Côme consentît à le voir rester dans les mains de Vitelli : une active négociation s'entama auprès de Charles-Quint, afin d'en obtenir l'ordre de faire remettre au duc de Florence la personne de Strozzi, en échange d'une rançon égale à celle que pouvait offrir le prisonnier. Du fond de son cachot, Strozzi faisait de nombreux efforts à la cour de Madrid, et l'empereur, désireux de s'assurer de la fidélité du duc de Florence, tenait la sentence en suspens. Bientôt pourtant le prisonnier put s'apercevoir que sa cause était perdue. Le 29 novembre 1537, il adressa au cardinal Salviati la lettre publiée dans l'appendice de cet ouvrage. (Voir Appendice, lettre 3.) Ce document curieux, copié sur l'original déposé dans les archives de la famille Strozzi, accuse les angoisses de Philippe. On voit qu'il ne compte guère que sur la clémence de Côme ; son courage, abattu par une longue détention, ne lui fait même plus envisager comme indigne de lui, l'un des chefs de la république florentine bannie, d'avoir recours à la prière. Toutefois, Philippe Strozzi ne tarda pas à surmonter cette faiblesse d'un moment, bien excusable sans doute chez un homme accablé d'aussi grands revers, et peu après, il évita aux ministres de Côme un nouveau crime, en mettant lui-même fin à ses jours ; mais avant de rendre le dernier soupir, il traça avec son sang, sur les murs de sa prison, ce vers de Virgile :
Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor !
Cet appel suprême de Philippe Strozzi ne fut pas sans écho en Toscane : son fils, Pierre Strozzi, animé du désir de venger la mort de son père et les injures faites à sa famille, voua sa Vie à traverser Côme dans toutes ses entreprises, et à rendre à sa patrie son antique liberté. Destiné dans sa jeunesse à l'état ecclésiastique, Pierre avait reçu une éducation distinguée : aussi conserva-t-il, au milieu des tribulations de sa vie, le goût de la littérature et des auteurs latins. Brantôme dit avoir lu une traduction en grec des Commentaires de César, suivie d'additions en latin à l'usage des chefs d'armée, écrite par cet illustre Florentin, dans les moments perdus que lui laissaient les intrigues politiques ou les travaux de la guerre. Le chapeau de cardinal lui ayant été refusé, il quitta l'état ecclésiastique et prit du service en France, où la vive amitié de sa cousine, femme du dauphin, lui assurait une précieuse protection. Pierre Strozzi ne tarda pas à se faire remarquer par son audace et par son talent pour les affaires. La connaissance des hommes et des choses de l'Italie lui donna un grand ascendant dans les conseils du roi ; son esprit brillant et enjoué le rendit cher à ses maîtres. Brantôme nous a conservé, dans ses mémoires, divers traits pleins d'originalité de cet homme célèbre. Après la mort de son père, il fut regardé par les Florentins exilés comme leur chef, et reçut d'eux le nom de Protecteur de la république. Attentif à saisir toutes les occasions propres à favoriser ses projets de vengeance, il trouva dans la ville de Sienne un puissant auxiliaire, et se vit sur le point d'atteindre à son but, grâce aux événements survenus dans cette république.
En effet, pendant que Florence succombait sous les armes de Charles-Quint, et que les Médicis s'y établissaient en souverains, Sienne, aveuglée sur les conséquences de son union avec l'empereur, aidait de tout son pouvoir à l'asservissement de son antique rivale. Les luttes intestines se perpétuaient néanmoins dans cette malheureuse cité : aussi amenèrent-elles enfin les Siennois à recevoir dans leurs murs le duc d'Amalfi, envoyé par l'empereur comme gouverneur, et qui était chargé de s'entendre, pour le gouvernement de la ville, avec le conseil des Huit, nommé par les quatre Monts, du Peuple, des Gentilshommes, des Réformateurs, et des Neufs. L'empereur vint lui-même à Sienne, le 24 avril 1535, et, pendant le court séjour qu'il fit dans cette ville, confirma tous les privilèges accordés par ses prédécesseurs à la république. Ces faveurs impériales calmèrent momentanément l'irritation qu'avait fait naître la présence d'un étranger, commandant presque en maître dans Sienne ; mais bientôt des plaintes de plus en plus vives assaillirent l'empereur.
La situation topographique de Sienne, d'où l'on pouvait menacer à la fois Rome et Florence, était trop importante pour que Charles-Quint consentît à lui rendre son entière liberté. Les papes et les nouveaux ducs de Florence convoitaient, chacun de leur côté, la conquête de cette république, dont le territoire vaste et fertile eût fourni un notable accroissement à leur puissance. Néanmoins, en 1541, Charles-Quint, cédant aux sollicitations des Siennois, rappela le duc d'Amalfi, et envoya Nicolo Grauvela et Sfrondato pour le remplacer. En 1543, Jean de la Luna vint les relever dans leur mission difficile. A peine installé, le nouveau gouverneur commit la faute de se poser en quelque sorte en chef de parti, ce qui compromit à la fois sa personne, la tranquillité publique, et la dignité de l'empereur. Le Mont des Neufs se groupa autour de lui, et fort de son appui, ne tarda pas à lui attirer la haine du reste des citoyens. Oubliant de vieilles rancunes pour résister à leurs adversaires communs, les autres ordres se réunirent, et, le 7 février 1545, attaquèrent les amis du gouverneur. Poursuivi, puis bloqué dans le palais Piccolomini, qu'il occupait, Jean de la Luna fut obligé de capituler, et de se retirer hors de la ville avec ceux de ses partisans qui s'étaient réfugiés dans «on palais.
A la suite de ce mouvement populaire, on institua un nouveau conseil de gouvernement composé de dix membres, trois pour le Mont du Peuple, trois pour celui des Réformateurs, trois pour celui des Gentilshommes, et un capitaine du peuple. Aussitôt que l'empereur apprit l'affront que son représentant avait subi à Sienne, il y envoya messire François Grasso de Milan. Ce dernier déclara aux Siennois que son maître, profondément affecté des excès qui avaient eu lieu, et désirant conserver la paix dans une république à laquelle il portait un si vif attachement, demandait que la ville acceptât et défrayât une garnison de trois cents soldats espagnols, et rouvrît ses portes au Mont des Neufs. Cette proposition ayant été repoussée avec dédain, François Grasso sortit de la ville au milieu des huées du peuple. L'empereur, après avoir laissé aux esprits le temps de se calmer, envoya, en 1548, don Diego Urtado de Mendoza à Sienne. Le nouveau gouverneur, réforma le gouvernement, et fit nommer un conseil composé de quarante-cinq membres, choisis dix par dix dans les Monts du Peuple, des Gentilshommes, des Réformateurs, et des Neufs, auxquels il fit rendre leurs droits politiques ; la nomination des cinq autres membres resta un des privilèges du gouverneur. Maître alors des décisions du conseil, il fit accepter une garnison de trois cents Espagnols payée par la ville, et l'augmenta de six cents soldats destinés à protéger sa personne, et soldés par la chambre impériale de Milan.
C'est à cette époque que se rapporte la chronique du renvoi des Espagnols. Cette chronique, écrite en assez mauvais style, a du moins l'avantage d'initier parfaitement le lecteur à la situation des Espagnols à Sienne, aux, mœurs de l'époque, à l'activité des intrigues que la France ourdissait en Italie, pour détacher les peuples de leur alliance avec l'empire. La conjuration qui vint renverser les projets de Charles-Quint sur Sienne peut être regardée comme l'une des plus remarquables qui aient jamais éclaté. Le secret, connu de tant de citoyens, et si religieusement gardé, l'union d'éléments si divers, le soulèvement général de tous les citoyens, couronnèrent dignement la longue préparation de cet événement, conduit avec une patience, une astuce, une fermeté et une présence d'esprit admirables par le chevalier Amerighi. Il faut remonter jusqu'aux Vêpres siciliennes pour trouver un exemple analogue.
A partir de cette époque, les trois chroniques du renvoi des Espagnols, de la campagne de Pierre Strozzi dans le Valdinievole et de la déroute de ce capitaine près de Marciano, forment, avec la partie des mémoires de Montluc qui traite du siège de Sienne, une histoire complète des événements qui se succédèrent, sur ce point de l'Italie, jusqu'à la chute définitive de la république siennoise. Le rôle que la France joua dans ce drame fait rentrer tout ce qui se passa alors en Toscane dans le domaine de l'histoire de France : j'ai donc pensé que la traduction de ces chroniques italiennes pouvait offrir un double intérêt, en ce qu'elles remplissent le vide laissé dans les mémoires de Montluc, exclusivement relatifs au siège de la ville, et en ce qu'elles nous montrent les efforts des réfugiés florentins pour l'affranchissement de la Toscane.
Dans les deux récits de Roffia, nous voyons Pierre Strozzi, ardent à poursuivre son œuvre de vengeance, combattre pour sauver Sienne menacée par Côme des Médicis, et porter la guerre sur les terres mêmes de ce prince, dont en même temps on cherchait à soulever les peuples.
La marche hardie de Strozzi, traversant Sienne, et glissant entre les mains du marquis de Marignan, qui le croyait renfermé dans la ville, parcourant la Toscane, et allant sur les frontières lucquoises chercher les secours qui lui arrivaient de la Mirandole, est une des plus habiles et des plus heureuses manœuvres qu'un général ait exécutées en Italie, terre devenue en quelque sorte un champ d'étude pour tous ceux qui rêvent la gloire des armes. Dans ce récit, on peut voir quelle différence existait entre les deux armées. La férocité des compagnons de Fernand Cortez se retrouve dans les cruautés exercées par les soldats du marquis de Marignan sur le territoire siennois, et, quoique écrit par un partisan des Médicis, le même récit contient la narration d'un fait honorable pour un officier de l'armée française. La présence de la nouvelle armée recueillie par Strozzi ne put tirer les Florentins de leur léthargie ; d'ailleurs, les vrais amis de la liberté voyaient peut-être dans Strozzi un homme combattant au nom de la liberté pour renverser un ennemi personnel, et aspirant en secret au pouvoir suprême. D'un autre côté, l'activité de Côme, ses habiles intrigues, la supériorité de son esprit, imposaient aux mécontents : ses sujets ne remuèrent donc pas, et Strozzi, forcé de retourner sur les terres de Sienne, y fut poursuivi par le marquis de Marignan.
Le second récit de Roffia nous fait assister à la dernière tentative de Strozzi pour dégager Sienne. Mais ici ce ne sont plus des lauriers que va cueillir l'heureux Italien, commandant au nom de Henri II : ses talents, sa valeur, deviennent impuissants contre la trahison qui s'est glissée dans son camp ; sa cavalerie se débande sans combattre, et les plaines de Marciano s'abreuvent de sang français. Strozzi lui-même, dangereusement blessé, est transporté à Montalcino, et bientôt Sienne voit l'armée victorieuse se répandre de nouveau autour de ses murs. Désormais, il n'est plus de ressource pour la ville que dans là pitié de ses ennemis ou dans l'ardent amour de ses citoyens pour la liberté. Les Siennois ne balancent pas, et jurent de défendre l'indépendance de leur bannière, suspendue auprès de la bannière royale de France aux tours de l'hôtel de ville. L'héroïque défense de Metz par le duc de Guise avait enfanté, dans ces temps chevaleresques, la plus vive ardeur chez tous les gentilshommes français. Montluc, guerrier illustre, dont la vieillesse fut entachée par la cruauté qu'il déploya pour pacifier la Guyenne, envoyé pour défendre Sienne, trouva, malgré la maladie qui le consumait, l'énergie et l'adresse nécessaires pour maintenir les Siennois dans leur courageuse résolution, et pour résister à toutes les tentatives des Espagnols. Ses mémoires nous apprennent toutes les particularités de ce siège célèbre. On ne peut lire sans se sentir ému les pages qu'il consacre à honorer l'ardeur martiale des femmes siennoises, qui, voulant concourir à la défense de leur patrie, se divisèrent en trois compagnies, de mille dames chacune, commandées par les dames Forteguerra, Piccolomini et Livia Fautta ; puis, s'armèrent de piques, de hottes, de pelles, de fascines, et coururent travailler sans relâche aux fortifications. Ces nobles élans des malheureux Siennois ne devaient porter aucun fruit. Strozzi, impuissant depuis sa défaite, travaillait à Montalcino à réparer son désastre, mais ne pouvait distraire le marquis de Marignan du siège. Tous les jours, les vivres devenaient plus rares dans la malheureuse cité, que les habitants de la campagne n'osaient plus approvisionner, tant la cruauté du marquis de Marignan avait surchargé de cadavres les arbres environnants. Bientôt les habitants, réduits à la plus dure famine, furent contraints de capituler, et Montluc, n'espérant plus de secours de la France, abandonna une ville qu'il avait défendue avec une honorable opiniâtreté.
Les plus notables habitants de Sienne se réfugièrent alors à Montalcino, où Strozzi créa un simulacre de république siennoise, qui refusa, quelques années encore, de reconnaître les nouveaux droits conquis par Côme sur leur patrie, et arrachés par son habile politique à l'empereur Charles-Quint. Ce fut dans cette ville, qui servit si souvent de prétexte aux attaques des Florentins, que la vieille république de Sienne rendit son dernier soupir.
A ce suprême moment, les magistrats siennois déployèrent un courage digne du peuple qui, pendant tant de siècles, avait su conserver son indépendance. Refusant de reconnaître le traité fait par les Siennois, et qui plaçait l'État de Sienne sous la protection du duc Côme, ils répondirent aux envoyés de ce prince que « la république était là où se trouvait le sénat, et qu'ils regardaient comme non advenu tout traité fait sans leur participation. »
Malgré la fierté de ces paroles, la cité de Montalcino ne put protéger que peu de temps encore les derniers débris de la république siennoise, et au mois d'avril 1559, la Toscane, entièrement pacifiée, obéissait aux lois de la nouvelle famille ducale, qui, par son extinction, à la mort du grand-duc Jean Gaston de Médicis, au xvinc siècle, devait léguer cette belle contrée à l'administration paternelle et éclairée de la branche impériale de la maison de Lorraine, régnant actuellement sur la patrie de Farinata des Uberti. Vue 52 sur 411 Vue 53 sur 411
(1) L'ouvrage publié à Sienne, en Ï8U, par M. Porri, est intitulé Miscellanea istorica sanese. Il se compose : 1° d'une dédicace, dans laquelle il offre à ses compatriotes le fruit de ses recherches ; 2° d'observations préliminaires sur les différentes parties de l'ouvrage ; 3° du premier livre de Y Histoire de Sienne, par Marc-Antonio Bellarmati, docteur et patricien de Sienne ; 4° de la chronique de Montaperto, tirée des chroniques recueillies par Domenico Aldobrandini ; 5° de la chronique de Montaperto, écrite par Niccolo Ventura ; 6° enfin d'une dissertation fort savante et fort étendue sur les monnaies de Sienne. Le corps complet de l'ouvrage forme un volume petit in-8°.
(2) Le manuscrit de Nicolo Ventura est déposé à la bibliothèque de Sienne, dans la salle des Mss., cod. 1, vii, 12. C'est un petit in-4°, écrit sur papier commun. La moitié inférieure des pages est remplie par de mauvaises miniatures, qui font peu d'honneur au talent de Ventura ; néanmoins elles sont intéressantes, en ce qu'elles reproduisent exactement les costumes du temps et les bannières de toutes les troupes de Sienne, parmi lesquelles on retrouve presque constamment celle de la maison d'Anjou, à l'époque où cette famille occupait le trône de Naples. Fort étonné de voir figurer cette bannière parmi les drapeaux siennois, j'interrogeai à ce sujet M. Porri et M. Gaétan Milanesi, un des conservateurs de la bibliothèque, dont l'obligeance égale la profonde érudition ; mais je ne pus obtenir d'eux aucun renseignement sur cette singularité. Je cherchai alors dans le manuscrit la bannière de Manfred, et ne la découvrant nulle part, je fus conduit à penser que Ventura, sans se rendre compte de l'erreur qu'il commettait, avait fait entrer dans ses dessins la bannière de la maison d'Anjou, régnant de son temps sur le trône de Naples, à la place de celle de la maison de Souabe. Je dois prévenir le lecteur que, dans la traduction qu'il va lire, je me suis permis de supprimer quelques-unes des trop fréquentes répétitions dont le texte original est surchargé, et qui n'ajoutent aucun intérêt à la chronique.
(3) Malespini (Storia Fiorenlina) fait descendre la famille des Uberti d'un fils de Catilina, nommé Uberto César, qui naquit à Fiesole, et y fut élevé. Étant allé à Rome, à l'âge de quinze ans, Uberto fut renvoyé à Florence, appelée alors Césarée, par Jules NCésar, qui redoutait son caractère franc et ouvert. Il s'occupa d'agrandir la ville où on l'avait relégué, et dans laquelle il exerçait, au nom de la république romaine, un pouvoir presque souverain.
Il épousa la sœur d'un de ses compagnons d'exil, noble romain du nom d'Elison ; de ce mariage naquirent treize fils et quatre filles. Malespini prétend encore que cet Uberto, ayant inspiré de l'ombrage à Octavien, quitta Florence, accompagné de ses sept fils aînés et d'une nombreuse cavalerie, laissant ses six autres fils en otage à l'empereur ; qu'il pénétra alors en Allemagne, où il épousa en secondes noces une fille du landgrave, et que de ce mariage sortit la lignée d'Othon le Bon, premier empereur d'Allemagne. Je n'ai pas besoin de dire le peu de confiance que méritent les assertions de Malespini, mais il est certain que la famille des Uberti était une des plus anciennes, des plus nombreuses et des plus puissantes de Florence. Sa parenté avec les empereurs d'Allemagne, quoique éloignée, expliquerait même sa constante ardeur à servir leurs intérêts en Italie. Les Uberti furent l'âme de toutes les conspirations tramées contre les Guelfes ; ils donnèrent le coupable exemple de la spoliation des biens des vaincus, en détruisant les tours de leurs adversaires politiques. L'animosité des Guelfes se porta aussi plus particulièrement sur cette famille : par représailles le peuple, en 1258, détruisit toutes les maisons qui lui appartenaient, et il fut ordonné au célèbre architecte Arnolfo di Lapo, chargé de bâtir le palais de la commune, de faire en sorte qu'aucune des pierres du nouvel édifice ne couvrît la moindre parcelle de l'emplacement occupé naguère par les maisons des Uberli. Il est en outre à remarquer qu'on redoutait tellement leur audace et leur esprit de rébellion, que, dans la suite, les Guelfes les exclurent toujours des trêves conclues avec les Gibelins. On prétend que la famille Farinati, établie à Cutigliano, bourg de la montagne de Pistoja, descend de Farinata des Uberti.
(4) Dans son Histoire de Sienne (p. 62), Bellarmati dit qu'Aldobrandino Cacciaconti appartenait à une famille plébéienne, mais qu'il était doué d'une grande prudence et d'un grand courage ; que le peuple s'étant soulevé contre la noblesse, Aldobrandino l'excita par des discours violents et pleins d'éloquence ; qu'à la suite de ses harangues, les deux partis en vinrent aux mains sur divers points de la ville ; qu'après un combat acharné, les nobles, obligés de céder au nombre, furent chassés de Sienne ; que ce mouvement populaire éleva en quelque sorte Aldobrandino au rang de prince de la ville, et qu'enfin le surnom de Cacciaconti lui fut donné pour avoir été, dans cette occasion, l'actif instigateur de l'expulsion des nobles, dont la plupart étaient des comtes (Cacciaconti, Chassecomtes).
(5) La petite ville de San Gimignano, située dans le val d'Eisa, à six milles de Poggibonsi, compte à peu près cinq mille habitants ; elle mérite d'être rangée parmi les lieux les plus curieux et les plus pittoresques de l'Italie. Je ne crois pas qu'il existe de ville qui ait conservé davantage le cachet des temps anciens. Bâtie sur •le sommet d'une petite montagne, elle semble dominer tout le pays. Ses tours nombreuses, resserrées sur un petit espace, lui donnent l'aspect le plus menaçant que l'on puisse imaginer. La place de la commune est le point le plus intéressant : elle est formée par l'église collégiale, dans laquelle on remarque un bon tableau de Pietro Perugino, un du Pollajolo, une bonne fresque de Benozzo Gozzoli ; les deux nefs des côtés sont ornées d'une suite de peintures de l'ancienne école siennoise. En face de l'église, sont des maisons surmontées de tours ; à droite, d'autres maisons d'une construction analogue, et à gauche, le palais de la commune, immense donjon adossé à une énorme tour carrée, sur le sommet de laquelle s'élève un olivier. Les murs du palais communal sont couverts, depuis le bas jusqu'au faîte, d'écussons sculptés reproduisant les armes de la commune et celles des podestats de San Gimignano. Malheureusement les soldats français, poussés par l'enthousiasme révolutionnaire qui les inspirait lors de nos premières campagnes en Italie, à la fin du siècle dernier, ont mutilé ces signes héraldiques ; on voit encore la trace des coups de sabres républicains qui effacèrent les emblèmes populaires des citoyens illustres successivement préposés à l'administration de cette commune. On prétend qu'une des tours, placée à trois ou quatre cents pas sur la gauche de la porte Florentine, fut bâtie par Désiré, roi des Lombards. Cette tour est construite en briques et à moitié ruinée. Dans les autres églises de San Gimignano, on remarque de belles fresques de Benozzo Gozzoli et de délicieuses peintures de Vincent, dit de San Gimignano, digne élève de Raphaël.
(6) Frédéric II était depuis un an dans la Pouille, se préparant à attaquer Bologne, pour remettre en liberté son fils Enzius, lorsqu'il fut pris d'une dysenterie, dans le château de Fiorentino, petite bourgade située à six milles de Nocera. Il mourut quelques jours après, le 15 décembre 1250, âgé de cinquante-deux ans. Il avait régné trente et un ans comme empereur, trente-huit comme roi des Romains, et cinquante-deux comme roi des Deux-Siciles. Selon Cuspignano, écrivain guelfe, il fut empoisonné par Manfred, prince de Tarente, son fils bâtard, qu'il avait eu d'une comtesse Lancia, et qu'il légitima. Sentant son mal s'aggraver, l'empereur fit appeler Bernard, archevêque de Palerme, qui reçut sa confession et lui administra les sacrements. Cuspignano ajoute que Manfred, voyant que les médecins parvenaient à dominer la maladie, s'introduisit dans la chambre de l'empereur, et l'étouffa sous un oreiller de plumes. Giovenazzo, lié aussi au parti guelfe, paraît attribuer la mort de Frédéric à un empoisonnement. Il dit que l'empereur était déjà rétabli, lorsqu'ayant mangé des poires cuites dans du sucre, il ressentit tout à coup de nouvelles douleurs ; le lendemain matin on le trouva mort dans son lit. Un astrologue avait prédit à Frédéric qu'il mourrait à Fiorenza ; aussi ne voulut-il jamais entrer dans cette ville, persuadé que la prédiction désignait Fiorenza en Toscane ; mais elle s'accomplit dans la petite bourgade de Fiorentino, ce qui frappa beaucoup les esprits crédules. Il est peu d'hommes dont la mémoire ait été attaquée et défendue avec plus de passion que celle de Frédéric. Les historiens contemporains, selon qu'ils étaient Guelfes ou Gibelins, ont exagéré ses fautes ou ses mérites. Tous néanmoins nous le dépeignent comme un prince remarquable par sa valeur, sa sagacité, son immense savoir et sa générosité. Si Frédéric II soutint par ses guerres la gloire de l'empire, son habileté ne le servit pas moins dans sa longue lutte contre ses ennemis, et principalement contre les trois papes Honoré III, Grégoire IX et Innocent IV. Il accorda une puissante protection aux savants, cultiva lui-même la poésie, et sut honorer, à l'égal de, ses plus illustres capitaines, les hommes qui, par leurs talents, l'aidaient dans ses négociations, ou influaient sur les progrès de la littérature et des sciences. Les historiens guelfes lui ont reproché à juste titre sa cruauté ; mais peut-être n'ont-ils écouté que les suggestions de l'esprit de parti, en l'accusant d'athéisme. Nous devons néanmoins remarquer que le Dante, malgré ses préventions de Gibelin, le place dans le cercle de son Enfer où sont punis les athées.
(7) Montereggione est une gracieuse bourgade qu'on rencontre à huit milles de Poggibonsi, en allant vers Sienne ; elle est située sur une petite colline, qu'on laisse à une centaine de pas sur la gauche de la route. Elle offre un aspect très pittoresque ; la muraille circulaire qui l'entoure est flanquée de petites tours, et ne présente à l'œil d'autres ouvertures que les deux portes communales : on croirait voir une couronne de tourelles ; du reste, aucun clocher, aucun toit ne domine son enceinte en ruines. En 1545, Pierre Strozzi fit relever ses constructions stratégiques ; le marquis de Marignan s'en empara en 1554.
(8) Brunetto Latini fut un des littérateurs et des savants les plus remarquables de son temps. Son principal ouvrage est le Tesoro, qu'il composa pendant son séjour en France, et que M. de Sismondi (Hist. des républ. ital., chap. 18) considère comme l'encyclopédie de toutes les connaissances humaines répandues dans le monde à l'époque où il vivait. Le Dante rencontre son maître Brunetto Latini, lors de sa descente aux enfers ; il le trouve dans le neuvième cercle, où il expie un vice honteux, fort commun alors, même dans les classes les plus distinguées…
On peut trouver d'amples renseignements sur Brunetto Latini dans l'excellent cours de littérature au moyen âge, de M. Villemain, et dans la notice publiée par M. Fauriel dans l'Histoire littéraire de la France.
(9) Grégoire IX étant mort le 21 août 1241, Godefroi de Castiglione, Milanais, lui succéda, et prit le nom de Célestin IV ; mais ce pontife ne survécut que quelques jours à son élection. Frédéric parvint par ses intrigues, et grâce au petit nombre de cardinaux qui Composaient le conclave, à empêcher pendant longtemps une nouvelle élection ; enfin, en 1243, les suffrages de la majorité se portèrent sur Pierre Sinibaldo de Fiesque, des comtes de Lavagne, de Gênes, cardinal de Saint-Laurent. Le nouveau pape prit le nom d'Innocent IV. Il avait vécu jusqu'alors en grande amitié avec l'empereur ; aussi, à la nouvelle de son élévation sur la chaire de saint Pierre, les courtisans de Frédéric félicitèrent-ils ce prince de ce qu'enfin le trône pontifical allait être occupé par une personne selon ses désirs. Frédéric leur répondit : « Ne vous étonnez pas du peu de joie que me cause cette nouvelle, car le choix du sacré collège me porte un grand préjudice, en me privant d'un cardinal ami, pour m'en faire un pape ennemi » (Malespini, chap., 127.) Les prévisions de l'empereur se réalisèrent : malgré toutes ses démarches pour faire la paix avec le Saint-Siège, il trouva dans Innocent IV un adversaire implacable, qui ne le poursuivit pas avec moins d'acharnement que ses prédécesseurs. Le règne de cet illustre pontife fut une longue guerre dirigée contre la maison de Souabe ; il se signala par la convocation et la direction du concile de Lyon, dans lequel l'empereur Frédéric II fut excommunié et déposé. Aussitôt après la mort de cet empereur, Innocent tenta de chasser Manfred du royaume de Naples. Il réussit d'abord, et mourut assez à temps pour ne point apprendre les premiers revers de ses partisans. Il décéda à Naples, le 7 décembre 1254, après un règne de onze ans et cinq mois. Les cardinaux élurent aussitôt l'évêque d'Ostie, issu de la famille des comtes de Signa, qui prit le nom d'Alexandre IV. Le nouveau pape, doué d'un esprit moins élevé et d'un caractère moins violent que son prédécesseur, vit sous son pontificat les Gibelins triompher dans presque toute l'Italie. Il mourut à Viterbe, le 25 mai 1261. Un Français, d'une naissance obscure, natif de Troyes en Champagne, fut appelé à lui succéder. Malespini (chap. 179) prétend qu'il était fils d'un savetier. Ce pontife prit le nom d'Urbain IV. Il était parvenu par son mérite à l'évêché de Verdun puis au patriarcat de Jérusalem, et revenait de la terre sainte, pour solliciter des secours auprès du pape, lorsque les cardinaux lui déférèrent, comme au plus digne, les honneurs de la tiare, bien qu'il ne fût pas membre de leur collège. A Urbain IV, mort en 1265, succéda le cardinal-archevêque de Narbonne, Français aussi, et sujet de Charles d'Anjou ; il prit le nom de Clément IV, et poursuivit avec ardeur et persévérance le projet, conçu par son prédécesseur, d'appeler à la conquête du royaume de Naples le frère de saint Louis.
(10) La puissante maison de Romano descendait d'un gentilhomme allemand, nommé Ezelino, qui suivit en Italie l'empereur Conrad II, dont il obtint, en récompense de ses services, les terres d'Onara et de Romano, dans la Marche Trévisienne. Sous ses successeurs Albéric Ier et Ezelino II, le patrimoine de la famille s'augmenta de Bassano et d'autres possessions, situées dans les environs de Vicence et de Padoue : ainsi se forma une principauté capable de résister aux républiques voisines, dont les constantes divisions fournirent aux membres de la famille de Romano les moyens de devenir les chefs du parti gibelin dans cette partie de l'Italie. Ezelino III, dit le Féroce, quatrième successeur du compagnon de Conrad, naquit le 4 avril 1194. M. de Sismondi, dans son excellente Histoire des républiques italiennes, parle ainsi de cet homme célèbre : « Une longue vie, de rares talents, et un grand courage, furent consacrés par lui à fonder une tyrannie telle, que ni l'Italie, ni peut-être le monde, n'en avaient point encore vu de semblable. L'art avec lequel il usurpa la souveraineté, au milieu de républicains jaloux, les crimes par lesquels il la conserva, sa grandeur et sa chute, méritent d'être étudiés par les amis de la liberté, et peuvent leur donner d'importantes leçons. » Outre ses cruautés, on cite de ce farouche seigneur des traits d'une profonde dissimulation et d'une ingénieuse rapacité. Une anecdote peu connue m'a paru peindre un des côtés de son caractère. Un jour, Ezelino fit publier que tous les pauvres estropiés qui se présenteraient à sa cour dans un certain délai recevraient de sa main des vêtements neufs. Au jour dit, un grand nombre de malheureux se rendirent au palais, et reçurent en effet de nouveaux habits. Ezelino voulut que l'on gardât toutes leui-s guenilles ; ils les réclamèrent avec instance, mais ce fut en vain. Chassés du palais, ils parcoururent l'Italie en maudissant le traître qui, sous l'apparence d'un bienfait, avait su s'approprier de fortes sommes qu'ils avaient cachées dans leurs vieux vêtements. En 1259, Ezelino, accablé de tous côtés par ses ennemis, voulut compenser ses échecs par la prise de Milan ; mais l'armée milanaise, commandée par Martino de la Torre, fut avertie à temps, et put se replier pour défendre la ville. Ezelino, qui avait déjà passé l'Adda, tenta vainement d'emporter d'assaut Monza ; il prit alors le parti de retourner sur ses pas, mais, pressé de toutes parts, il ne put échapper à la poursuite des croisés. Comme tous les hommes de cette époque, Ezelino était superstitieux, et l'horoscope que lui avait tiré un astrologue avait tellement fasciné son esprit, qu'il s'éloigna du pont de Cassano, attaqué par le marquis d'Este, comme étant un lieu qui, selon la prédiction, devait lui être fatal. Néanmoins, en apprenant que les ennemis venaient de se rendre maîtres de ce poste important, il courut intrépidement pour le reprendre, mais un trait d'arbalète lui traversa le pied gauche. Cet événement jeta la terreur parmi ses troupes. Pendant la nuit, il chercha à traverser l'Adda dans un autre endroit ; mais le marquis d'Este l'atteignit, et mit ses troupes en déroute. Lui-même, frappé à mort par un homme dont il avait fait mutiler le frère, expira le 16 septembre 1259. Sa fin est racontée d'une manière pleine d'intérêt par M. de Sismondi (ch. 19).
(11) Un cri unanime de réprobation s'était élevé dans toute l'Italie contre Ezelino : ses amis, comme ses ennemis, avaient été tour à tour sacrifiés à sa cruelle politique ; des crimes sans but semblaient même avoir des charmes pour le cœur de cet homme féroce. Aussi un des premiers actes d'Alexandre IV fut d'obéir à l'indignation générale, en faisant prêcher à Vérone, par l'archevêque de Ravenne, une croisade contre Ezelino. A la voix du prélat, accoururent tous les exilés des pays soumis à la maison de Romano ; ils choisirent pour chef Marco Quirini, sénateur vénitien. La république de Venise prêta des vaisseaux pour faciliter à l'armée croisée l'approche de Padoue, en remontant la Brenta. Le marquis d'Este, chef du parti guelfe dans la Marche Trévisienne, le comte de Saint-Boniface, prince de Mantoue, et Tiso Novello de Campo San Piero, dernier rejeton d'une famille exterminée par les ordres du tyran de Padoue, se joignirent à l'archevêque de Ravenne, qui fut nommé général en chef des croisés. Son impéritie fit traîner la guerre en longueur, jusqu'à ce qu'enfin Boson de Dovara et le marquis Pallavicini, tous deux zélés partisans d'Ezelino, s'étant racontés mutuellement les insinuations perfides qu'il avait employées pour se défaire d'eux, et comment il les excitait l'un contre l'autre, pour s'approprier ensuite leurs dépouilles, ils résolurent d'un commun accord de se joindre aux croisés. Alors les communes de Crémone, de Mantoue, de Ferrare, de Padoue et de Milan étant entrées dans la ligue, la guerre reçut une nouvelle impulsion, et bientôt Ezelino dut succomber sous le nombre des ennemis qu'il avait soulevés par ses crimes.
(12) Quelques écrivains prétendent que Brennus, chef des Gaulois, fut le premier fondateur de Sienne, lorsqu'il traversa l'Italie en marchant sur Rome. D'autres historiens, partant de ce fait que Sienne a pour emblème la louve romaine, et porte également le titre de ville éternelle, attribuent, par analogie, sa fondation à Senius, fils de Rémus. Bellarmati croit que le nom de Sienne fut donné à la ville (appelée autrefois, selon lui, Castelvecchio) à l'époque où la population commença à s'accroître, parce que, dit-il, cette ville se trouve située au sein de la Toscane ; et du mot seno (sein), il fait dériver celui de sena, et par corruption Siena. Malespini (ch. 23) prétend que des Français poursuivant, au temps de Charlemagne, une secte de Lombards païens, s'arrêtèrent, harassés de fatigue, dans le lieu où se trouve actuellement la ville, et y séjournèrent longtemps pour réparer leurs forces ; ayant formé un établissement dans cet endroit, ils l'appelèrent Sene, parce qu'ils y avaient recouvré la santé : de Sene serait dérivé Sena, puis Siena. Malespini raconte encore que c'est à l'influence d'une femme que Sienne doit son érection en ville et en évêché. Cette femme s'appelait Veglia, et n'était qu'une simple hôtesse. Un légat du Saint-Siège s'arrêta dans son hôtellerie, en revenant de France ; ai» moment de repartir, il voulut en vain payer sa dépense : Veglia ne voulut point recevoir son argent, et le supplia seulement d'employer son influence à la cour de Rome pour faire ériger Sienne en évêché. Le légat l'engagea à venir elle-même présenter cette demande au souverain pontife, et lui promit de la seconder dans ses démarches. Veglia suivit ses conseils, et sut si bien persuader le pape et les cardinaux, que sa supplique fut accueillie. Le pape consentit à distraire une paroisse de chacun des évêchés d'Arezzo, de Chiusi, de Perugia, de Volterra, de Grossetto, de Massa, d'Orvieto, de Florence, de Fiesole, pour former la circonscription du nouvel évêché. Le premier possesseur du siège fut messire Gualterano. Sienne fut dès lors classée parmi les cités. Les premières querelles survenues entre les Siennois et les Florentins remontent à l'année 1177 environ. Vers cette époque, les deux républiques, se disputant la possession de quelques castels situés sur leurs frontières, dans le Chianti, en vinrent aux mains près du château d'Asciano. Depuis ce temps, la guerre entre ces deux peuples ne fut plus interrompue que par de courtes trêves, jusqu'à leur assujettissement commun sous le sceptre des Médicis.
La ville de Sienne est située sur de petites collines entrecoupées de ravins ; son aspect est pittoresque et riant. Des hauteurs de la ville, on jouit d'une vue fort étendue, sur un pays accidenté et boisé. La ville est remplie de monuments curieux ; sa cathédrale est un des plus imposants chefs-d'œuvre de l'architecture du xmc siècle. M. Valéry, dans son excellent Itinéraire de l'Italie, donne une description fort exacte de toutes les curiosités de la ville (Valéry, t. m, chap. 10). Sainte Catherine, fille d'un teinturier, est la sainte la plus vénérée à Sienne, où elle est née : elle a composé des ouvrages dogmatiques remplis de force et de talent. La maison de son père, où elle habita et rendit le dernier soupir, fut transformée, par ordre du grand conseil de la république, en chapelles et en oratoires magnifiquement décorés. La bibliothèque de Sienne est riche de trente mille, volumes et d'environ trois mille manuscrits. Les environs de la ville sont charmants ; le sol offre un grand intérêt sous le rapport géologique. Lorsqu'on vient à Sienne, en quittant Florence, on s'étonne de trouver la campagne presque déserte, et l'on se demande avec effroi si les massacres exécutés par ordre du marquis de Marignan, lors du siège de Sienne par les armées de Charles Quint et de Côme Ier, ne seraient pas encore la cause de cette dépopulation.
(13) Manfred, fils naturel de l'empereur Frédéric II et d'une comtesse Lancia, fut, dit-on, légitimé par son père. Malgré les crimes dont quelques écrivains l'accusent, on doit reconnaître que ce prince déploya, dans le cours de sa vie aventureuse, toutes les qualités qui caractérisent les grands hommes. Constant dans ses projets, soldat infatigable, capitaine habile, il sut reconquérir le royaume qu'il administrait pour son neveu Conradin. Après l'avoir délivré des armées du pape, et avoir soumis les fiers barons dont la révolte avait failli causer sa perte, il s'occupa avec ardeur de rétablir la prospérité du pays. Versé dans la philosophie et les mathématiques, il composa un traité de la chasse qui lui assigne un rang parmi les littérateurs de son temps. Probe et libéral, il aimait la justice ; l'ambition de régner put seule l'entraîner à la violation des lois. Il était grand, bien fait, et d'un visage agréable : aussi quelques écrivains le comparent-ils à Titus, fils de Vespasien (Riccobaldo presso Summonte, Hist. del regno di Napoli). Lorsque, après avoir usurpé la couronne, il se vit menacé par les armes de Charles d'Anjou, il se prépara à soutenir vaillamment ses droits, aimant mieux mourir en héros que survivre à sa défaite. La mort même de ce prince ne suffit pas pour apaiser la haine du pape : le légat du Saint-Siège défendit de l'inhumer en terre consacrée, parce qu'il était mort excommunié. Charles d'Anjou, cédant alors aux prières de ses prisonniers et de ses propres partisans, le fit enterrer près du pont de Bénévent ; sur sa fosse, chaque soldat vint déposer une pierre. Mais ce simple mausolée offusquait encore Clément IV : par ses ordres, Pignatelli, archevêque de Cosenza, qui avait déjà négocié les conventions conclues entre le pape et le comte de Provence, fit déterrer le cadavre de Manfred, et l'ayant fait brûler, ordonna de jeter les cendres dans le Garignano, appelé alors le Verde.
Manfred avait épousé la fille d'un Comnène d'Épire. Il en eut un fils, appelé Manfredino, et une fille. Sa femme, s'étant retirée dans Nocera avec son fils, y fut vaillamment défendue par les Sarrasins, restés fidèles à la cause de leur ancien protecteur ; mais ayant voulu se réfugier en Morée, elle fut arrêtée à Manfredonia, au moment où elle s'embarquait, et périt misérablement avec son fils dans les prisons du nouveau roi de Naples. On trouve de curieux détails sur Manfred dans l'excellent ouvrage concernant la maison de Souabe, publié sous les auspices de M. le duc de Luynes.
(14) La ville de Lucques, ancienne cité étrusque, est située dans une vallée délicieuse, non loin de la rive gauche du Serchio. Les riches campagnes qui l'entourent, les montagnes pittoresques qui bordent l'horizon de tous côtés, font de cette jolie résidence un des points de l'Italie les plus recherchés par les étrangers. La ville renferme plusieurs monuments remarquables. Quelques-uns remontent à une haute antiquité, entre autres la cathédrale, placée sous l'invocation de saint Martin, l'ancienne basilique des Lombards, appelée San Frediano, et l'antique église de Saint-Pierre. Le palais du souverain, commencé par Ammannato, est un des plus beaux palais royaux de l'Italie. Lucques est richement dotée de tous les établissements qui peuvent seconder l'essor de l'esprit humain. La bibliothèque publique compte près de trente mille volumes ; la bibliothèque particulière du duc régnant est riche en manuscrits et en ouvrages modernes ; celle du chapitre possède des documents historiques de la plus haute importance, qui ont été publiés par Muratori et par une société de savants lucquois.
Les boulevards de la ville forment une des plus jolies promenades de l'Europe, et pendant l'été, une foule de voitures élégantes se croisent sous l'ombrage des grands arbres qui ornent les remparts. Lucques est une des plus anciennes villes de l'Italie. Malespini prétend qu'elle s'appelait autrefois Arnigia, et changea de nom lors de la conversion de ses habitants, dans les premiers temps du christianisme. Notre Seigneur, dit-on, touché de la foi vive avec laquelle ils embrassaient la nouvelle religion, les aurait tous illuminés d'une clarté céleste, d'où serait venu le nom de Luce ou Luca. Ce fut dans cette ville que Jules César donna rendez-vous à Crassus et à Pompée, pour former le fameux triumvirat qui devait changer les destinées politiques du monde romain (an de Rome 698, avant J. C. 56).
Dans l'année 553 de l'ère vulgaire, Lucques fut la seule ville d'Italie qui osa fermer ses portes à Narsès, et en obtint les conditions les plus honorables lorsqu'elle capitula après trois mois d'un siège acharné. (Voir Mazzarosa, Storia di Lucca, lib. i.)
La république de Lucques joua un rôle important au moyen âge ; plusieurs grands hommes virent le jour dans son sein, entre autres le fameux Castruccio Castracani, surnommé par Ripeti, dans son excellent Dict. geo. fist. stor. della Toscana, le Napoléon du moyen âge. Dans les arts, on peut citer Mathieu Civitali, fameux sculpteur ; les lettres comptent aussi plusieurs écrivains distingués, natifs de Lucques, tels que Jean Guidiccioni, poète et ami d'Annibal Caro, le marquis Cesare Boccella, dont les charmantes poésies ont ajouté un nom de plus à la liste des poètes italiens, et le marquis Mazzarosa, auquel nous devons une excellente histoire de sa patrie.
En 1805, Lucques, la plus vieille et la dernière des républiques italiennes, fut donnée par l'empereur Napoléon à sa sœur la princesse Élisa Bacciocchi. Destiné, par le congrès de Vienne, à être incorporé à la Toscane, à la mort de la grande-duchesse de Parme, le duché de Lucques attend, sous les lois d'un petit-fils de Louis XIV, le moment où il cessera de figurer parmi les États indépendants. Il m'est doux, comme Français, de pouvoir rendre un hommage à ce prince, digne de ses aïeux par son esprit, ses qualités et la manière dont il gouverne ses États, qui jouissent sous son administration d'une remarquable prospérité.
(15) L'armée guelfe florentine s'avança, dans le mois de mai 1260, pour ravager le territoire siennois, et vint bientôt asseoir son camp près de la porte Camullia. Manfred n'avait encore envoyé aux Siennois qu'un faible secours de cent hommes d'armes allemands ; on prétend que Farinata des Uberti saisit cette occasion de faire prendre au roi Manfred une part plus active dans les affaires de cette partie de l'Italie, en faisant boire les Allemands, et, une fois ivres, en les menant à la rencontre des Florentins. L'impétuosité des Allemands jeta d'abord un grand désordre dans le camp florentin ; mais lorsqu'on eut reconnu combien les assaillants étaient peu nombreux, le combat changea de face, et tous les Allemands furent massacrés. La bannière de Manfred, restée sur le champ de bataille, fut rapportée à Florence et promenée dans les rues, au milieu d'outrages de toute espèce. Bellarmati ne pense pas que les Siennois aient fait ainsi massacrer les soldats de Manfred, dans la pensée d'exciter en lui le désir de la vengeance ; car, comme il l'observe avec beaucoup de justesse, une telle conduite aurait irrité Manfred contre eux bien plus encore que contre les Florentins.
(16) Turpino prétend que le carroccio est une machine d'origine orientale : suivant lui, les Sarrasins en faisaient usage au vmc siècle ; mais l'opinion la plus accréditée est que-le carroccio fut introduit dans les armées par Aribert, archevêque de Milan, qui, en 1089, remporta plusieurs victoires au delà des Alpes, et résista victorieusement à l'empereur Conradin. Tous les auteurs des xiie, xiiie et xive siècles font mention du carroccio et en ont donné des descriptions. C'était, en quelque sorte, le centre de gravité autour duquel toute l'armée faisait ses évolutions pendant la bataille. On célébrait les offices divins sur cette arche sainte ; l'étendard de la commune y était fixé. Les conseils de guerre se tenaient autour du carroccio ; sa prise était la preuve d'une complète défaite, car sa défense étant confiée aux hommes les plus réputés pour leur vaillance, on ne pouvait s'en rendre maître avant d'avoir anéanti tout le nerf de l'armée. Peut-être doit-on aux rudes combats livrés autour des carrocci la première appréciation de la force de l'infanterie agglomérée sur un même point. Généralement, le carroccio était un vaste chariot à quatre roues, de dimensions plus qu'ordinaires, recouvert d'un grand tapis rouge, blanc ou noir, selon les couleurs de la ville à laquelle il appartenait. Du milieu du carroccio, s'élevait une grande antenne terminée par un globe doré surmonté d'une croix ; au sommet de cette antenne, on hissait un ou deux drapeaux aux couleurs de la ville et de la commune. Plusieurs paires de bœufs attelés à cet immense char le traînaient d'un lieu à l'autre. On voyait sur la façade de Saint-Pierre en Sceraggio, église qui fut incorporée aux bâtiments des Offices, à Florence, la représentation en marbre du carroccio pris lors de la destruction de Fiesole. Une des roues du carroccio de Florence est imitée dans le milieu du pavé de la Loggia du Mercato Nuovo.
(17) Castruccio Castracani, le plus grand homme qui ait paru sur la scène politique de l'Italie pendant le moyen âge, naquit en 1281, et mourut en 1328, à l'âge de quarante-sept ans. Ayant délivré les Lucquois du joug des Pisans, il fut nommé capitaine général de la commune, puis, en 1320, dictateur à vie de la république. Élevé dans l'exil, par suite de la proscription portée contre la famille gibeline des Interminelli, dont il était membre, Castruccio avait su mettre à profit le temps de sa jeunesse en parcourant les diverses contrées de l'Europe et en servant comme volontaire sous les plus fameux capitaines. Son élévation au pouvoir suprême, dans sa patrie, permit à Castruccio de donner un libre essor aux vastes projets qu'il avait conçus. Devenu, par l'ascendant de son génie, chef du parti gibelin, il attaqua corps à corps la république de Florence. Après une longue guerre, dans laquelle Castruccio eut toujours l'avantage, il remporta une grande victoire sur l'armée florentine, vers le milieu de septembre 1325 ; cette action décisive eut lieu près du château d'Altopascio, situé dans le val de Nievole. Après la destruction complète de l'armée florentine, Castruccio revint à Lucques, et y célébra ses succès par des fêtes dignes des anciens triomphes de la république romaine.
(18) Uguccione de la Faggiuola, lieutenant de l'empereur Henri Vil, investi, par les anciens de la république de Pise, de la charge de podestat et de celle de capitaine du peuple pisan, s'empara de Lucques par surprise, et y laissa son fils Neri de la Faggiuola, pour y maintenir son autorité. Il réunit ensuite les forces de Pise et de Lucques, et assiégea la ville de Montecatini, située dans le val de Nievole. Les Florentins confièrent aussitôt le commandement de leur armée à Philippe, prince de Tarente, frère de Robert, roi de Naples, et accoururent au secours de Montecatini. Les deux armées en vinrent aux mains, le 29 août 1315, et les Florentins furent entièrement défaits. Castruccio Castracani contribua puissamment à la victoire.
(19) Voir, à la note 9, le paragraphe concernant Urbain IV.