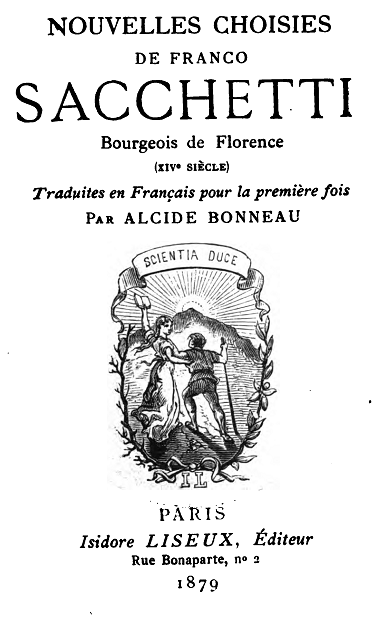
FRANCO SACCHETTI
NOUVELLES CHOISIES
CC - fin
Œuvre numérisée par Marc Szwajcer
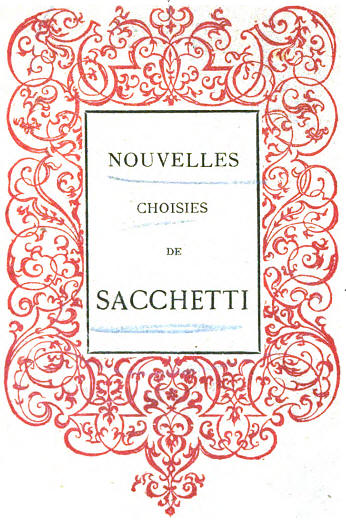
|
NOUVELLES CHOISIESDE FRANCO SACCHETTI
précédentNOUVELLE CCIIOn vole peu à peu une pièce de terre à un pauvre homme de Faenza; il fait sonner toutes les cloches et dit que le droit est mort.
Ce fut une grande justice et une grande bonté de ce Seigneur, quoique peut-être le Riche méritât pis. Mais, toute chose bien considérée, ce Seigneur montra beaucoup de prudence, et la justice rendue au pauvre homme ne fut pas mince. Quand celui-ci disait que les cloches sonnaient pour le trépas du droit, il aurait pu dire qu'elles sonnaient pour faire ressusciter le droit. Elles devraient bien sonner aujourd'hui et opérer sa résurrection.
NOUVELLE CCVIFarinello de Rieti, meunier, est amoureux de Monna Collagia; sa femme l'apprend et fait si bien, qu'elle se cache dans la maison et dans le lit de Monna Collagia; Farinello, avisé par celle qu'il aime, vient coucher avec elle, et croyant avoir affaire à l'autre, fait l'amour à sa femme.
La veuve, écoutant ces propositions et voyant que, sans perdre son honnêteté, elle augmentait son gain, que de plus Farinello n'aurait que ce qu'il méritait, fut bien vite d'accord. Elle s'en alla et rencontra Farinello qui portait à moudre une charge de grain; il l'aborda et lui dit : J'ai à votre service tout le blé que vous voyez là. La veuve lui répondit à voix basse que dans la gêne où elle était, il lui fallait bien en passer par son bon plaisir, et que ce soir même il pouvait venir chez elle; ainsi fut donné le rendez-vous. Farinello tenant enfin la promesse après laquelle il courait depuis si longtemps, et songeant à ce qu'il avait à moudre la nuit suivante, ne fit pas grande attention au moulin, ce jour-là; il mit les deux quartauts de blé dans deux sacs, pour les porter le soir chez Monna Collagia, et s'occupa de trouver un compagnon discret, qui l'aidât à porter l'un des deux. Après mûre réflexion, il requit un de ses amis intimes, meunier comme lui, nommé Chio-dio, de l'aider à porter un sac, le soir même', et de n'en rien dire. C'était bien tout le contraire, l'inverse de ce que font d'ordinaire les meuniers ; ils prennent volontiers pleine charge de grain ou de farine, mais c'est qu'ils l’ont dérobée aux autres, et non pas pour faire un cadeau. Donna Collagia revint le jour même voir Monna Vanna et lui conta qu'elle avait donné rendez-vous à Farinello la nuit suivante, pour lui apporter le blé et coucher ensemble; qu'elle irait chez une voisine, comme c'était convenu, et la laisserait disposer de son logis. — Vous avez bien fait, dit Monna Vanna, j'irai ce soir préparer ce que je veux faire ; pour vous, ne vous inquiétez plus de rien. Ainsi fut fait. Farinello avait pour habitude de veiller assez tard au moulin, et si jamais il resta dehors une nuit entière, ce fut celle-ci, car, après avoir quitté le moulin, il s'arrangea de façon que la nuit se passât toute. Monna Vanna, sa femme, était allée prendre possession du logis et de la couchette de Monna Collagia ; elle attendait là son Farinello, à la place de celle qu'il désirait si fort. Quand Farinello, la lance en arrêt, jugea le moment venu d'éperonner la haquenée, ayant d'un côté son sac de froment sur l'épaule, de l'autre Fami Chiodio, il se mit en route. Arrivés à l'huis de la veuve, ils le trouvèrent entrebâillé et n'eurent qu'à pousser pour entrer et déposer leurs sacs. Cela fait, Farinello dit à Chiodio : Ne t'ennuie pas de m'attendre un peu; il t'en reviendra bon profit. — Mon cher, répondit Chiodio, va et prends tout le temps que tu voudras : je ne m'en irai pas que tu ne reviennes. Chiodio resta là ; Farinello s'en fut à la chambre où le rendez-vous lui était assigné et où l'attendait Donna Vanna, au lieu et place de Monna Collagia. Il gagna le lit à tâtons et se coucha près de sa femme, sans qu'elle soufflât mot ni lui non plus, de peur qu'on ne les entendît; ils se contentaient de pousser de grands soupirs, et la femme lui signifiait, par gestes, de ne point parler, à cause des voisins. Ce qu'elle en faisait, c'était pour que Farinello ne la reconnût pas. Farinello lui obéit, la prit dans ses bras et en jouit dans l'idée qui l'avait fait venir, quoique la chose fût bien autre qu'il pensait : en un court espace de temps, il trouva moyen de percevoir quatre fois la dîme. Enfin il se leva en disant : — Je vais uriner, et quitta la chambre. Aussitôt, il va trouver Chiodio, qui l'attendait et lui dit : Mon cher, cette femme m'a longtemps fait languir, avant de consentir à ce que je voulais. Tu as apporté ici tout autant de blé que moi ; s'il te convient d'être de moitié dans le bénéfice ou maléfice, comme tu voudras, va droit à la chambre : là, sans desserrer les dents, fourre-toi au lit et fais semblant d'être moi-même. Quant à moi, j'en ai assez, pour cette nuit. Chiodio ne laissa pas tomber ces mots dans l'oreille d'un sourd; vitement il s'en fut à la chambre, se mit dans le lit près de la femme à la place de Farinello, et en un rien de temps satisfit trois fois son désir; puis il s'échappa, vint retrouver Farinello qui. l'attendait, et tous deux reprirent le chemin du. moulin. La femme, croyant avoir couché toute la nuit avec son mari, revint à la maison de bonne heure; Monna Gollagia, quittant la voisine, dès le matin, rentra également chez elle et y trouva le lit tout aplati. Donna Vanna attendait à la maison comment la chose allait se passer Farinello, qui s'était montré si bon cavalier, revient et lui dit qu'il a eu toute la nuit bien du mal au moulin, qu'elle lui mette cuire deux œufs sous la cendre. — Il t'en faut sept, lui dit sa femme. — Qu'est-ce que cela signifie ? demande Farinello; je n'en veux que deux. — Il t'en faut sept, répète la femme. — Est-ce que tu as perdu la tête ? — C'est toi qui l'as perdue, dit la femme. Farinello restait là tout ébahi. — Oui, roule tes yeux, reprit-elle ; tu as bien de quoi. Tu t'es montré cette nuit vaillant cavalier ; tu as porté sept fois à moudre, et tu sais bien où ; mais ce n'est pas à celle que tu croyais. C'est à moi et non pas à Monna Collagia que tu as donné à moudre sept fois, cette nuit ; à telles enseignes qu'après les quatre premières fois tu t'es levé pour aller pisser, puis tu es revenu, et trois fois encore tu as recommencé le jeu, si bien que j'ai eu de toi, sans être connue, ce que je n'ai jamais pu en obtenir autrement. Maintenant tu, me demandes des œufs parce que tu as eu du mal à moudre ; tu dis bien vrai : c'est à mon moulin que tu as travaillé, et c'est ce qui te rend si piteux. Dieu te confonde ! Tu veux me traiter en servante et tu t'en vas prodiguant ton grain ; moi, j'en ai donné un sac en plus, et j'ai eu meilleur bénéfice avec mon sac que toi avec tes deux. Autant vous en arrive à tous, scélérats, qui manquez honteusement à vos femmes, et autant en arrive à vos femmes qu'à moi-même, la nuit dernière. Toutes les fois que tu voudras de cette marchandise, tu me trouveras prête à t'en donner. Va donc maintenant; porte le grain à ton moulin, tu auras bien assez à faire. Occupe-toi de gagner ta vie, dont tu as grand besoin, sans aller enfariner les veuves, la maie aventure te vienne ! A toutes ces révélations, Farinello ne savait que répondre, sinon qu'il marmottait : — Je ne sais ce dont tu parles, à moins que tu ne me dises tout cela pour ne pas me donner mes œufs. — Tu as bon besoin de les couver, répliquait-elle; va donc à ton moulin, prends autant d'œufs qu'il te plaira, et fais la mouture comme cette nuit. Farinello mit fin à la querelle, jugeant que c'était ce qu'il avait de mieux à faire, et désormais certain que la chose était éventée, plus vite qu'il ne l'aurait cru, il vit qu'il avait doublement fauté : d'abord en ce qu'il n'avait pas moulu son grain où il croyait, puis en ce qu'il avait fait moudre Chiodio à son propre moulin, croyant le mener au moulin d'un autre. Il s'en fut tout triste et pensif au moulin, sans manger ses œufs, y rencontra Chiodio et lui dit que sa femme semblait avoir eu connaissance du trictrac de cette nuit ; qu'il tînt la chose secrète, au nom de Dieu, parce que si les parents de Donna Collagia l'apprenaient, ils seraient tous deux en grand péril; pour cette raison, jamais il ne lui découvrit qu'il avait couché avec Donna Vanna. Ensuite Farinello, revenu un peu de sa surprjse, se réconcilia tout, doucement avec sa femme : — Suis-je donc le premier, lui dit-il, qui ait été amoureux et qui en ait perdu la tête ? Tu as su t'y prendre si bien, que tu dois en être contente ; moi : aussi je me suis contenté, dans l'idée que tu étais celle que je voulais avoir. Cela me coûte assez cher, car j'ai mis dans l'entonnoir plus que je ne pouvais et tu en as eu le profit ; tu m'en as fait faire une qui en valait plus de sept. Ainsi fallut-il que Farinello, pour apaiser, les cris de sa femme, la radoucît à l'aide d'une foule de bonnes paroles et fréquemment lui rendît le devoir conjugal, alors qu'il aurait plus volontiers dormi un brin. Quand il restait quelque temps sans moudre au moulin, sa femme aussitôt lui reprochait les sept fois de Monna Collagia, lesquelles en peu de temps lui valurent plus de sept fois sept, et le pauvre homme en devint comme hébété. Ainsi finit l'histoire ; Monna Vanna, fut payée en main-d'œuvre et Donna Collagia en froment, avec moitié en sus. Farinello se trouva avoir acheté une denrée dont il n'avait nulle envie et qu'il ne cherchait guère ; Chiodio, sans débours aucun, eut de cette bonne farine d'échange, qui appartenait à Farinello, et crut toute sa vie avoir couché avec Donna Collagia. Ainsi advient souvent à ceux qui ont affaire aux femmes ; en cas pareil, elles sont toujours plus fines que les hommes, et il semble que l'Amour leur suggère sans cesse de nouveaux expédients et de nouvelles ruses. Cette Donna Vanna, si avisée, fit une louable besogne; son mari voulant négliger de labourer son propre domaine, elle trouva moyen de le lui faire labourer mieux qu'il ne l'avait été jamais. Et ce scélérat de mari ! Monna Collagia lui ayant octroyé son amour, il ne se contenta pas d'en prendre à son plaisir, il voulut encore là faire déshonorer par son compagnon : le déshonneur fut pour lui. Je n'ai jamais vu que l'amour ait si justement donné en réplique un : C'est bien fait ! que dans le cas de Farinello. Pour Madame Vanna, grâce à son adresse, ce fut tout le contraire, car elle ne méritait pas que Chiodio couchât avec elle. Mais il en résulta une chose assez peu ordinaire : c'est qu'elle ne sut jamais que les sept fois n'étaient pas toutes de la façon du mari, et Chiodio ne soupçonna pas non plus que ses trois hommages eussent été adressés à Donna Vanna.
NOUVELLE CCVIIBuccio Malpanno d'Amelia, trouve dans le lit de sa femme les brayes qu'un Capucin couché avec elle y avait laissées : on lui persuade que ce sont les brayes de Saint François, et il le croit tout bonnement.
Advint par hasard que Buccio étant de garde une nuit, comme il est d'usage en beaucoup de villes, le Frère prit rendez-vous pour venir coucher avec Dame Caterina, et comme il tenait un peu de l'odeur du bouc, ainsi que tous ses pareils, il s'était ôté de dessus le dos son linge crasseux et l'avait changé contre de fin linge de toile blanche. Cela fait, il pénétra dans la chambre de la femme et, en se couchant, quitta ses brayes toutes blanches, qu'il posa sur le chevet du lit. Par un accident quelconque, il arriva que Buccio, ayant besoin à la maison, obtint la permission de l'officier de garde ; arrivé à sa porte, il mit la clé dans la serrure et, comme il la tournait pour ouvrir, le Frère l'entendit rentrer ; vite il se leva, en homme expert et toujours aux aguets, empoigna son froc, ses autres hardes, puis, sans s'apercevoir qu'il laissait ses brayes, se jeta par une fenêtre peu élevée qui donnait sur la rue, et s'enfuit du mieux qu'il put, à la grâce de Dieu. Buccio, entré dans la chambre, se fourra, pour y reposer, dans son lit, qui venait d'être consacré, et ils dormirent tous deux, lui et sa femme, jusqu'au grand jour ; ils en avaient bon besoin, fatigués qu'ils étaient d'avoir veillé, l'un au corps de garde, l'autre sur le matelas. En ouvrant la fenêtre, Buccio aperçut les brayes sur le chevet; il crut que c'étaient les siennes et les prit, pour les mettre ; puis, regardant sur le coffre, il en vit une autre paire et se mit à songer en lui-même : Qu'est-ce que cela veut dire ? Je sais bien que je ne porte pas deux paires de brayes. Il reconnut alors que celles du chevet n'étaient pas à lui, les serra dans un coffre et mit les siennes ; puis, d'un penser à un autre, se demandant à qui elles pouvaient appartenir, car à leur taille elles semblaient être celles d'un géant, il tomba dans une telle mélancolie, qu'il n'en mangeait quasi plus. De son côté, Frère Antonio songeait qu'il avait fort mal fait d'oublier ses brayes ou caleçons, et le fit savoir à la femme, secrètement, en lui recommandant les brayes qu'il avait laissées. La femme, qui ne s'en doutait guère, ne les ayant pas trouvées et voyant son mari tout mélancolique, devina trop bien qu'il les avait aperçues et serrées quelque part; elle en eut une grande frayeur, quoiqu'elle n'en montrât rien, et ne pouvant faire ce que son dévot lui demandait, elle lui répondit que son mari les avait trouvées ; qu'elle ne savait où elle en était de chagrin ; qu'elle n'imaginait aucune excuse à donner et s'attendait à quelque malheur. En apprenant l'histoire, le Frère se vit en d'assez mauvais draps, lui et la femme. Il alla secrètement s'en lamenter près d'un Frère Domenico, son intime ami, homme instruit et plein d'expérience, auquel il se fiait beaucoup et qui de plus était âgé. Frère Domenico le reprit d'abord vivement en paroles, mais à la fin, pour obvier au déshonneur de l'Ordre et en second lieu à celui de Frère Antonio, il dit : Je vais tâcher d'ôter ce soupçon à Buccio ; puis se tournant vers Frère Antonio : Allons trouver ce Buccio, lui dit-il et laisse-moi faire. Ils se mirent en chemin et s'arrangèrent de façon à rencontrer le bonhomme en Pabordant, Frère Domenico le salua, lui prit la main et le regardant bien en face, lui dit : Mon cher Buccio, tu as de la mélancolie. — Oh ! pourquoi ? dit Buccio ; je n'ai de mélancolie aucune. — Si, reprit Frère Domenico ; je le sais par révélation de Saint François; et pour te dire la vérité, je voulais aller chez toi chercher une relique que ta femme nous a emportée ces jours-ci. Sache-le bien, nous avons une relique douée de la plus grande efficacité pour faire concevoir les femmes qui ne peuvent avoir d'enfants : ce sont les caleçons de toile du bienheureux Messire Saint François. Une femme qui nous les avait empruntés les rapportait à notre sacristie, lorsque survint la tienne, qui connaissant leur vertu et se sachant stérile, me les demanda très instamment, pour que Saint François lui fît la grâce d'avoir des enfants, suivant son désir. L'amitié que je te porte m'engagea à les lui prêter et elle les a depuis assez longtemps. Maintenant, voici que d'autres femmes me les demandent, car il y en a beaucoup qui n'ont pas d'enfants, et il faut bien leur rendre service, nous montrer plus prodigues de ces brayes que nous ne le devrions peut-être. Te voilà bien au fait, si toutefois tu avais quelque soupçon. Je te prie donc de ne pas trouver mauvais que nous allions chercher ces brayes avec toute la révérence qui leur est due, quoique ce soient des reliques de pauvreté et d'humilité. Le Frère n'eut pas plutôt achevé ces paroles que Buccio s'écria : — Je crois que vous êtes l'Ange du Seigneur, car vous m'avez tiré au clair tout ce dont je doutais; )t soupçonnais le mal et tout est pour le mieux. Là-dessus ils se mirent en route, se dirigeant vers la maison de Buccio; quand ils y furent arrivés : Où est cette sainte relique ? demanda le Frère. Buccio le mena droit à un coffre où se trouvaient toutes ses autres hardes et dit : Les voici. Sa femme était présente. Quand le Frère vit comment Buccio avait négligemment serré ces brayes, il sortit un napperon de soie et s'écria : Buccio, est-ce un objet à serrer de la sorte? Tu as péché mortellement, Il prit les susdites reliques, les enveloppa du napperon de soie et entonna un De profundis clamavi, puis quantité d'autres psaumes, pour mieux lui faire avaler la bourde. En. outre, il se mit à le confesser et lui donnant à croire qu'il était tombé en excommunication, lui appliqua de bons coups de bâton sur les épaules, puis lui administra l'absolution, moyennant certaines pénitences, toutes en faveur de l'appétit charnel de Frère Antonio, qui put les mettre à exécution quand il lui plut. Ce pauvre Buccio poussa la crédulité jusqu'à attendre chaque jour la grossesse de sa femme ; mais il put bien attendre, car tout le temps de sa vie Monna Caterina resta sans enfants, quoiqu'elle fit tout son possible avec Frère Antonio pour en avoir. Ces reliques culières furent emportées par Frère Domenico et Frère Antonio, qui par la suite ne les employa peut-être pas moins activement avec d'autres femmes qu'avec Donna Caterina. Que dirons-nous de l'adresse ou de la ruse dont fit preuve ce Frère Domenico ? C'est en lui que l'on a confiance, plus qu'en tout autre moine de son Ordre, et il foule aux pieds l'honnêteté pour pallier la faute de son compère, qui pouvait rejaillir sur le couvent. Mais en voulant cacher ce déshonnête adultère, il usa d'une bien plus grande impiété à l'égard du bienheureux Messire Saint François, sous la règle duquel il vivait et à qui il attribua de si vénérables reliques. Il aurait bien pu du moins les attribuer à quelque autre, quoique, ce fût très mal, et encore mieux agi en châtiant et en gardant si étroitement Frère Antonio, que ses chaleurs désordonnées s'en fussent amorties. Il n'eut pas honte de tromper, d'imaginer une abominable imposture, et de la placer sous le nom de Saint François, un Saint tel que parmi la quantité de Saints qu'il y a au monde, je n’en trouve pas un seul en qui le Seigneur ait montré, autant qu'en lui, sa miraculeuse et divine puissance, jusqu'à le marquer de ses précieux stigmates sur la sainte montagne d'Alvernia. Ce lieu, s'il se trouvait en pays infidèle, on en ferait plus de cas; il est trop près d'ici. Dans le monde entier, il n'existe que deux endroits spécialement notables : le premier en pays infidèle, c'est le Saint Sépulcre ; le second en pays Chrétien, c'est cette montagne. Et notre hypocrite, un ribaud plutôt qu'un Religieux, moine de Saint François, n'eut pas honte d'inventer une imposture, dans un but tellement indigne, au grand déshonneur du bienheureux Messire Saint François, dont il était le Religieux! Mais à force de temps, il en fut récompensé comme il le méritait; il devint lépreux et si horriblement, qu'il lui fallut quitter et le Couvent et le pays. Il vécut encore plusieurs années avec cette infirmité dégoûtante, puis mourut, et il était en effet bien digne de mort. Ce fut un de ces miracles qu'opère journellement Notre-Seigneur ; puisque ce Moine hypocrite et vicieux montrait, sous le couvert de Saint François, les dehors d'une sainte vie, il était convenable de faire apparaître sur son corps, en forme de lèpre, le vice ou plutôt la lèpre intérieure qu'il cachait. NOUVELLE CCXVIMaître Albert d'Allemagne, se trouvant dans une auberge près du Pôf fabrique un poisson de buis avec lequel l’hôte prend autant de poissons qu’il veut; l’hôte perd l’engin et se met à la recherche de Maître Albert pour qu'il lui en fasse un autre, mais ne peut rien obtenir de lui.
L’hôte, resté avec le poisson de bois et désireux de ressayer tout de suite, alla pêcher ce jour même; tant de poissons se mirent à suivre l'engin, et se jetèrent dans le filet, qu'à peine put-il les tirer de l'eau et les emporter à la maison. Cette chance persista; il faisait fort bien ses affaires et de pauvre homme il devenait riche, au point qu'en peu de temps il aurait pu marier toutes ses filles. Mais il advint que la Fortune,. envieuse d'un tel bonheur, opéra si bien, qu'un jour, comme il ramenait à lui, son filet avec une masse de poissons, la ficelle du poisson de bois se rompit et le poisson s'en alla en dévalant le long du Pô ; il ne put jamais le rattraper. S'il fut jamais chagrin d'un accident arrivé, certes ce fut de celui-là, et il pleura tant qu'il put sa mésaventure. Il essayait de pêcher sans le poisson de bois, mais c'était comme s'il n'eût rien fait; il n'en prenait pas un au lieu de mille. Aussi tout en se répétant : Que faire? que dire? il résolut enfin de se mettre en route et de ne pas prendre de repos qu'il ne fût en Allemagne, dans la maison de Maître Albert; il le supplierait en grâce de lui refaire le poisson perdu. Il se tint parole et. ne s'arrêta point qu'il ne fût arrivé où demeurait Maître Albert. Là, avec grand respect et tout en larmes, il s'agenouilla, lui conta la grâce qu'il avait reçue de lui, comment il prenait une infinité de poissons, puis, que la corde s'étant cassée, le poisson de bois s'en était allé au cours du Pô, et qu'il l'avait ainsi perdu. Par conséquent, il suppliait Sa Sainteté de consentir, pour le bien qu'elle lui voulait, par pitié pour lui et ses filles, à lui en fabriquer un autre, afin qu'il recouvrât la faveur dont il avait été d'abord jugé digne. Maître Albert, le regardant fixement, en eut grande compassion : — Mon fils, lui dit-il, je voudrais bien faire ce que tu me demandes, mais je ne puis. Il faut que tu saches que lorsque je fabriquai ce poisson, pour te le donner, le Ciel et toutes les Planètes étaient à cette heure même dans une conjonction favorable et propre à donner telle efficacité à ce poisson ; maïs que toi ou moi nous entendions jamais dire : Cette conjonction, ce hasard peut se représenter, il est possible de fabriquer un poisson de même vertu : non ; je te le déclare, ferme et net, cela ne peut pas arriver avant trente-six mille ans. Maintenant, juge s'il est possible de refaire ce que j'avais fait ! En entendant parler d'une si longue période d'années, l'aubergiste se mit à sangloter à chaudes larmes; il déplorait surtout sa mésaventure et disait : — Ah ! si j'avais su ! je l'aurais attaché avec un fil de fer et si solidement, qu'il ne se serait jamais en allé. — Console-toi, mon fils, reprit Maître Albert, tu n'es pas le premier qui n'ait pas su conscrit ver la fortune que Dieu lui avait mise dans là main ; il y en a beaucoup, et de plus savants que toi, qui n'ont pas su, comme toi, en profiter même un court espace de temps; bien mieux, ils n'ont pas su la saisir, quand elle s'est présentée devant eux. Réconforté de la sorte et après avoir reçu une foule de bonnes paroles, le pauvre aubergiste s'en alla, et reprit sa vie de misère. Souvent il regardait le Pô, cherchant à revoir le poisson perdu, mais il pouvait bien regarder : le susdit poisson était peut-être dans la grande Mer, avec une multitude d'autres tout autour, et personne pour profiter de l'aubaine ! Il vécut ainsi tout le temps qu'il plut à Dieu, se remémorant toujours le poisson perdu ; mieux eût valu pour lui ne l'avoir jamais possédé. Ainsi fait maintes fois la Fortune : elle se montre, le visage riant, pour voir si on saura la saisir, et le plus souvent celui qui en profite le mieux n'en reste pas moins en chemise; maintes fois elle se présente, pour que celui qui n'a pas su la prendre s'en lamente ensuite et vive dans la misère, se répétant sans relâche : Je pouvais avoir telle chose et je n'en ai pas voulu. D'autres savent s'en emparer et la retenir un peu de temps, comme cet aubergiste. Mais à bien considérer tout ce qui se passe, celui qui ne profite pas de son bonheur, quand la Fortune et l'occasion le lui octroient, y repense souvent plus tard et voudrait le ravoir, mais c'est impossible, à moins que d'attendre trente-six milliers d'années, comme disait ce savant homme. Le mot me paraît conforme à ce qu'ont dit autrefois certains Philosophes, à savoir que dans trente-six mille ans le monde se retrouvera juste en l'état où il est aujourd'hui. De mon temps, il y a certains pères de famille qui laissent leurs biens à leurs enfants à telle condition que ceux-ci ne peuvent ni les vendre ni emprunter dessus : c'est évidemment qu'ils partagent cette croyance et veulent retrouver leurs domaines intacts quand ils reviendront, dans trente-six mille ans d'ici. NOUVELLE CCXXVILà Châtelaine de Beaucaire, voyant d'une fenêtre des moineaux, puis un âne, hasarde un mot plaisant.
Aimable Châtelaine, aimable aussi cette Marion, qui pour passer le temps agréablement, mit en avant son opinion. Ainsi les Seigneurs et leurs Dames hasardent souvent, par plaisanterie, des mots qui sembleraient condamnables et scabreux ; dans leurs actes, ce sont de fort honnêtes gens. Qui de terra est, de terra loquitur, pourrait-on dire, et nous en avons bien d'autres qui se délectent à parler de ce qui plaît si fort à l'homme et à la femme. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui pour s'amuser tiennent des propos assez libres et sont au fond très vertueux ; en revanche, les hypocrites se montrent autant de petits saints, dans leurs paroles et dans leurs gestes, et en réalité ce sont de vrais démons.
NOUVELLE CCXXVIIUne Dame de Florence, voyant des passereaux faire l'amour, lance un mot plaisant à sa belle-mère.
Il arriva que la jeune femme, se trouvant en la salle avec sa belle-mère et d'autres dames, les unes cousant, les autres filant, elle aperçut dans un petit jardin, par la fenêtre, ou peut-être bien sur un toit, un moineau faire l'amour tant et plus, comme c'est leur habitude ; Bonne chance pour toi, petite, de n'avoir pas de belle-mère ! s'écria-t-elle. Les Dames se regardant l'une l'autre se mirent à étouffer de rire, et la jeune femme rit aussi, mais non la belle-mère qui secoua la tête et se prit à marmotter entre ses dents; la bru sortit, faisant semblant de n'y être pour rien. L'anecdote ou propos se répandit dans le pays, si bien que lorsqu'une dame rencontrait la jeune mariée, elle ne manquait pas de lui dire : Bonne chance pour toi, petite, de n'avoir pas de belle-mère ; elle, bonne fille, en riait volontiers et rendait la chose plus expressive par une foule de réflexions. Il arrive maintes fois et il est arrivé à bien des femmes qu'on leur donne un mari, puis, qu'on le leur retire et qu'on ne le leur prête qu'à certaines Lunes. Je ne sais trop si ce moyen est moins dangereux pour le jeune homme : après avoir longtemps jeûné, tous deux n’en ont que plus grand désir de forcer la nature quand ils couchent ensemble. Je crois que lorsqu'on donne femme à un garçon, il faudrait aussi tenir compte de sa compagne, qui ne se marie pas pour vivre en chasteté. Il est advenu à plus d’un, après avoir mis en train l’accointance charnelle sans la continuer, que leurs femmes s'en sont allées en quête et leur ont trouvé des remplaçants. C'est grande folie que de mettre le feu à un tas de paille et de ne pas croire qu'il va brûler. En toutes choses, celui qui s'habille comme le voisin ne peut errer.
SERMONS
SERMON XLIVJeudi. — De corpore ChristiProbet enim seipsum Homo, etc.I. Cor. Cap. n.
Remarquez que les Grecs offrent le corps du Christ dans du pain levé, en coupant une tranche de leur pain de froment; nous, nous l'offrons dans du pain sans levain. Et le leur comme le nôtre est véritablement le corps du Christ : les Grecs font bien et nous faisons bien. Si nous empruntions leur coutume et eux la nôtre, nous pécherions les uns et les autres ; restant chacun avec nos usages, il n'y a de péché pour personne. Remarquez que ce pain doit être fait de pâte de froment, et de nulle autre farine. Comment se peut-il, diront certaines gens, que le Fils de Dieu vienne dans cette pâte ? Pour l'expliquer brièvement, les choses divines, en dehors de la nature humaine, se peuvent mal aisément démontrer en ce monde corrompu; mais je veux faire une comparaison. La poule couve un œuf, et, au bout de quelques jours, le poussin est dans la coquille. Par où est-il entré ? Maintenant, pense à la toute-puissance de Dieu et vois s'il peut être dans cette hostie ! Maintenant, comment se trouve-t-il dans chacune des parties ? Cela se figure par un miroir qui se brise et dont chaque fragment réfléchit l'image. Comment le corps du Christ se convertit dans l'hostie consacrée ? Je réponds comme plus haut, qu'il n'y a pas de science qui puisse le démontrer à qui n'a pas la foi ; la foi, c'est précisément la croyance à ce que nous ne voyons point. Donc, l'homme qui a foi dans la puissance de Dieu, par la même raison qu'il croit que Dieu a créé le monde, qu'il a tiré l'homme du limon, qu'il a créé et crée continuellement des âmes et des corps, qu'il est entré dans une Vierge et né d'une Vierge, ainsi de même cet homme doit croire que depuis ce temps, pour notre salut, toutes les fois que se prononcent les paroles qui doivent se dire, il se convertit en la substance de ce pain, c'est-à-dire en l'hostie : quia nihil impossibile est apud Deum. Maintenant, revenons à ce que nous disions. Qui a donné leurs vertus aux paroles, aux pierres et aux herbes ? Dieu seul. Et ne voyons-nous pas tous les jours la parole d'un homme de bien ou d'un prédicateur faire qu'un scélérat devienne honnête homme ? A bien plus forte raison la parole de Dieu prononcée sur l'hostie peut faire que la substance de ce pain devienne le corps du Christ. Il existe des pierres précieuses, et entre autres une qu'on appelle héliotrope : celui qui la porte sur soi est invisible et voit les autres. Le Christ, qui lui a donné cette vertu, ne peut-il pas à plus forte raison nous rester invisible dans l'hostie ? Bien sûr que si, puisque l'auteur de la loi est de plus grande autorité que celui qui l'applique. C'est lui qui a donné leurs vertus aux plantes dont se confectionnent les remèdes et qui guérissent les corps des maladies; par conséquent, de même qu'il a créé ces plantes, précieuses pour guérir les corps, de même, voulant être le précieux remède de Pâme, il donne sa propre personne en nourriture sous la substance du pain et du vin. Accipite et manducate, hoc est corpus meum. Comment ? Lorsqu'on brise en morceaux cette hostie, on ne brise pas le corps du Christ ? Je te dis que non, on ne le brise pas, et sa gloire n'en reste pas moins entière dans le Paradis ; son corps n'est point partagé dans l'hostie, quoiqu'on partage l'hostie, et il est tout entier dans chaque morceau. Prends la comparaison du miroir, que j'ai donnée plus haut. Il y a des ignorants grossiers qui doutent encore qu'en fractionnant l'hostie, on ne fractionne le corps et sa substance. Mais moi je dis que si un homme est mis en pièces et dévoré par un lion ou tout autre animal, son âme reste sauve ; elle n'est ni mise en pièces ni dévorée.par le lion, ou par toute autre bête. Comment peut-il se faire que si l'on prend seulement une parcelle de la pâte de cette hostie, le corps du Christ est entier, avec tous ses membres, dans cette parcelle et en même temps dans tout le reste de l'hostie ? Voici : regarde ton œil, combien il est petit ; l'organe de la vision n'est pas plus gros qu'une pointe d'aiguille. Cependant, va dans un lieu découvert et regarde le ciel : tu apercevras la quatrième partie du ciel, lequel ou laquelle est si vaste qu'il n'y a pas d'homme capable d'en prendre la mesure. Le ciel, malgré son immensité, consent donc à se réfléchir dans ton œil, et l'œil s'agrandit assez pour le voir; ainsi une quantité aussi grande que le quart du ciel pénètre en un tout petit organe comme est la prunelle de l'œil. Par conséquent, celui qui a voulu cela n'a-t-il pas pu vouloir être dans une petite parcelle de l'hostie? Bien sûr que si. Comment ce pain angélique se change-t-il en nous et comment nous changeons-nous en lui, de sorte que nous devenions lui ? Je réponds que Dieu n'est pas doué d'une vertu moindre que ce que mange l'homme, nourriture qui se convertit en chair et en sang. Les herbes que nous mangeons, nous et les bêtes, se convertissent en sang. Donc, celui qui a la foi doit croire sans hésiter en tout ce que Dieu fait ; l'hostie consacrée, quand elle est prise avec la contrition et la dévotion convenables ne se convertit pas en notre chair et en notre sang ; c'est au contraire la chair et le sang de celui qui Ta prise qui se convertit en cette hostie, et, se convertissant en l'hostie, devient Dieu. Combien de miracles n'a déjà pas faits cette benoîte hostie? Combien Dieu n'en a-t-il pas fait, n'en fait-il pas encore ? Et nous autres, ne voyons-nous pas un arbre ou une vigne, qui, en hiver, n'a pas de feuilles, puis qui porte ensuite de si beaux fruits ? Ne voyons-nous pas les saisons, le cours du soleil, de la lune et des planètes, et tant d'autres choses auxquelles il suffit de penser pour croire qu'il est tout-puissant, qu'il est présent dans l'hostie, qu'il a fait et qu'il peut faire toutes sortes de merveilles? A ce propos, j'ai entendu blâmer un certain Frère Mineur par un Frère Prêcheur, lors de la guerre que Florence eut avec l'Église en 1376, pour avoir dit que le corps et le sang du Christ n'étaient pas présents dans l'hostie consacrée ; je vais dire ce que ce Capucin avait prêché dans Santa-Croce de [Florence, puisqu'un Inquisiteur des Dominicains voulut le faire passer pour hérétique; l'un et l'autre étaient Siciliens, je crois. Maître Niccola, de Sicile, très savant et très honorable homme, le plus savant peut-être qu'eut en son temps l’ordre des Frères Mineurs, prêchait qu'il faut reprendre ceux qui disent : Allons voir le corps du Christ, car aucun œil corporel, en cette vie, ne peut voir le corps du Christ; il faut dire : Allons voir sacramentellement le corps du Christ; parce que sacramentellement son corps humain, avec tous ses membres, est dans l’hostie, mais invisible à nos regards. Voilà ce qu'il disait, et il disait vrai. La question alla jusque par-devant Grégoire XI, qui condamna non pas l'opinion de maître Niccola, mais bien celle de l'Inquisiteur. J'ai tenu à raconter cela par amour pour la vérité, parce que les rapporteurs de mauvaise foi rapportent souvent des choses fausses. Il y a deux vers qui s'écrivent de la sorte ; Adoro Christum, quem credo esse istum; Adoro istum, quem credo esse Christum Un homme qui ne connaîtrait pas la logique dirait que le premier exprime la même croyance que le second, et il n'en est rien. Celui qui prononce le premier vers se sauve, parce qu'il commence par dire : Adoro Christum; l'autre commence par : Adoro istum... Cela se dit, parce que la messe peut être célébrée par quelqu'un qui n'est pas prêtre ou qui n'y prononce pas les paroles consacrées. SERMON XLVVendredi. — De la Passion de Notre-SeigneurEt inclinato capite tradidit spiritum.Joan. Cap. 19.
Quand le Christ pria son Père de lui épargner ce calice, si citait possible, cela provenait de ce qu'alors la sensualité et l'humanité enduraient passion en lui, quoique la Divinité lui donnât quelque rafraîchissement, sachant que par cette mort il rachetait l'espèce humaine. Et notez que Pilate s'y prit de quatorze manières pour faire que le Christ ne mourût pas; à la fin, la peur de César l'emporta. Notez-le : quand les Juifs dirent à Pilate qu'ils n'avaient pas de roi, que Jésus n'était pas leur roi, ils disaient la vérité; leur roi était le Démon et non pas le Christ; leurs descendants ne possèdent jusqu'à aujourd'hui aucune terre, aucun royaume qui soit à eux; ils sont deux ou trois par cité, voués aux rôles de valets ou de manœuvres. On pourrait bien dire qu'ils possèdent aujourd'hui un grand avantage sur les Chrétiens, car les Chrétiens grèvent leurs terres et les Juifs ne peuvent grever les leurs, puisqu'ils n'en possèdent pas. Notre-Seigneur fut crucifié; on ne sait pas au juste si la croix était préalablement fichée en terre et si on Ta dressé dessus; le plus grand nombre s'accordent à dire qu'il y fut cloué d'abord, par terre, la tête tournée au Levant, les pieds au Couchant, le bras droit étendu vers le Septentrion, le gauche vers le Midi ; c'était pour faire entendre que sa mort fut la rédemption vie tout le monde et de toutes les races humaines. La croix fut dressée avec notre benoît Seigneur dessus, le visage tourné vers le Couchant. Que le Lecteur le remarque: du côté du Couchant sont les Chrétiens et par derrière son visage, au Levant, sont les Infidèles. L’un de ses bras était étendu vers le Septentrion, l'autre vers le Midi ; c'était pour faire entendre que l’extrémité haute de la croix se dirigeait vers le ciel, c'est-à-dire vers la divinité; l'extrémité basse, fichée en terre, vers les enfers, pour en porter la nouvelle à ceux des Limbes, aux saints Pères et à tous les autres; les deux bras, pour l’annoncer à l'univers entier, là notez-le : quand le Seigneur sua sur la croix des gouttes de sang par tout le visage, il y en eut une telle quantité, que tout du long de la figure et du corps elles tombèrent par terre au pied île la croix; ce précieux sang fut le message par lequel ceux des Limbes apprirent que l’Ecriture était accomplie et que bientôt viendrait le Sauveur les tirer de cette prison. Dans le Crucifix, tel qu'on le représente depuis peu de temps, il n'y a que trois clous, les deux pieds étant superposés l'un à l'autre. Les anciens peintres, à Rome et dans les diverses autres parties du monde, figuraient chaque pied cloué séparément. L'antiquité mérite plus de créance, puisque les anciens avaient la tradition de plus anciens qu'eux, ceux-ci de plus anciens encore; je suis donc persuadé qu'il y avait quatre clous. Notez que lorsque Notre-Seigneur fut flagellé à la colonne, soit avec des cordes, soit avec des verges, il n'eut pas un os qui ne fût meurtri de coups; or, chaque corps possède cent quarante-deux os. Il y a des gens qui ont prêché, que le jour du Vendredi saint l'homme doit se réjouir, parce qu'en ce jour-là s'est effectuée notre Rédemption. Et moi je dis : bien que notre Rédemption doive être pour nous un motif d'allégresse, si nous songeons à notre Dieu, à l'affection qui le porta à mourir pour nous, il faudrait avoir un cœur de pierre pour se réjouir un jour pareil. Cela se voit bien dans l'Église de Dieu : il n'y a en ce jour ni chants, ni musique, ni sons de cloches, ni allégresse. On peut se faire une figure de la mort de Christ et voir comment seraient placées les bannières, puisqu'il est le Roi des Rois, en songeant à la façon dont on les place, pour honorer les Chevaliers et les Rois temporels. Il me semble qu'il devrait y avoir quatre bannières et quatre personnes pour les porter. C'est pourquoi je dis qu'à la mort de ce Roi moururent aussi l'Art, la Nature, la Morale et l'Écriture. Marie et Jean l'Evangéliste sanglotent ; survient l'Art, qui voit leurs larmes et dit : Quelles tristes nouvelles! Quoi! votre Roi est mort? L'Art fait venir Dédale, qui est le Chevalier de l'Art, maître es arts libéraux et es arts mécaniques. Dédale arrive, se saisit d'une bannière et crie, avec des larmes : O Grammaire, tu as perdu le Verbe adjectif et substantif avec tout le reste; perdu le Verbe, tu n'es plus Grammaire. Adonc, pleurez, grammairiens ! Il crie : O Logique, tu discernais le vrai du faux; maintenant tu as perdu la suprême vérité; adonc, pleurez, logiciens ! Il crie : O Musique, tu as perdu le chant; il n'y a plus personne qui chante, tout le monde pleure; adonc, pleurez, musiciens ! Il crie : O Arithmétique, tu as perdu les nombres et l'abacus, puisque tu as perdu l'alpha et l'oméga, qui sont le commencement et la fin. Le commencement est le chiffre un; perdu le chiffre un, jamais tu ne pourras composer de nombres qui aient un commencement et une fin; adonc, pleurez, arithméticiens! Il crie : O Rhétorique, toi qui avec ton beau parler riche en couleur, persuadais aux âmes ce que tu voulais, tu as perdu ta source. Qui fut meilleur orateur que le Christ ? Par ses douces paroles et ses enseignements, que de gens il convertissait, que de miracles il faisait ! Adonc, pleurez, rhétoriciens! Il crie: O Géométrie, toi qui avec tort compas mesurais justement toutes choses, tu as perdu celui qui mesurait le ciel et la terre et toutes les autres choses; comment t'y prendras-tu pour mesurer? Adonc, pleurez, géomètres! Il crie : O Astrologie, toi qui connais le cours du ciel et des planètes, tu as perdu celui qui dirigeait le ciel, les planètes et les autres étoiles, et donnait la règle à tous leurs mouvements. Comment pourrais-tu astrologuer davantage? Adonc, pleurez, astrologues! Puis il se tourne vers les gens de métier et crie : O tisseurs de laine, qui fartes des draps pour les Rois et pour les Barons, regardez le Roi des Rois, quel vêtement lui a été donné pour la mort! Le Roi des Rois est mort, morts sont tous les autres Rois, morte votre propre industrie! Vous ne pourrez jamais plus vendre de drap. Adonc, pleurez, tisseurs de laine! Il crie aux tailleurs : Votre industrie est morte, puisqu'aujourd'hui tous les points du vêtement du Christ sont décousus et défaits. Adonc, pleurez. Il crie aux cordonniers: Votre industrie est morte, car le Christ tiré de la prison et mené au supplice était déchaux : il n'avait pas d'escarpins. Qui donc en portera ? Adonc pleurez. Il crie aux forgerons : Votre industrie est morte, car c'est avec le marteau et les clous que le Christ a été attaché sur la croix, lui qui était la vie par excellence, Donc vous êtes morts, vous et votre métier; adonc, pleurez. Et sic de singulis. En exhalant ces plaintes, Dédale fixe la bannière sur l'un des coins du monument. La seconde personne qui se présente est la Nature. Quelles tristes nouvelles! Quoi ! Votre Roi est mort ? Elle fait venir son Chevalier. Qui est-ce? Maître Aristote. Aristote prend la bannière et crie : O Saturne, toi dont l'influence rend l’homme paresseux et lourd, pourquoi n'as-tu pas rendu les Juifs paresseux et mal entrain à la mort du Christ? Pourquoi as-tu consenti à ce que sous ta sphère mourût le Fils de Dieu ? O Jupiter, toi donc l'influence rend l'homme joyeux et gourmand, pourquoi as-tu donné tant de joie aux Juifs à vouloir la mort du Christ? Pourquoi ont-ils eu tant de faim et de gloutonnerie de sa mort? O Mars, toi dont l'influence rend l'homme envieux et batailleur, pourquoi as-tu donné tant d'envie aux Juifs qu'ils prirent les armes contre le Christ et le tuèrent? O Soleil, toi dont l'influence rend l'homme avare, comment as-tu eu le cœur de donner tant d'avarice à Judas qu'il livrât le Christ pour trente deniers? Et les Juifs, par avarice, le dépouillèrent et partagèrent ses vêtements ! O Vénus, toi dont l'influence rend l'homme luxurieux, combien de fois les Juifs voulurent-ils accuser calomnieusement de luxure le Fils de Dieu, en voyant à ses pieds la Madeleine et d'autres? O Mercure, toi dont l'influence rend l'homme orgueilleux, comment as-tu souffert de mettre tant d'orgueil dans le cœur des Juifs que, gonflant les joues, ils s'écriaient : Prophétise! et Crucifige, crucifige! Avec leur orgueil, ne réussirent-ils pas enfin à ce que Pilate le crucifiât? O Lune, toi dont l'influence rend l'homme pusillanime et de peu de courage, comment as-tu donné aux Juifs tant de mobilité, que le Dimanche ils vinrent, les palmes à la main, au-devant du Christ, en criant : Benedictus qui venit in nomine Domini, et le Vendredi le déchirèrent avec les lances, les clous et les épines? Et encore, Lune, tu as obscurci le souverain Soleil, de sorte que toi et les autres planètes, vous en restez mortes et aveugles. Donc, pleure. Puis il se tourne vers les Éléments : Air, comment as-tu souffert que les maudits Juifs l'aient mis à mort? Que ne les plongeais-tu dans les ténèbres ? Tu es mort ; adonc, pleure. O Terre, que ne t'es-tu entr'ouverte ? Feu, que ne les as-tu brûlés? Eau, que ne les as-tu noyés? Vous êtes tous morts, pleurez ! Il semble que les planètes et les éléments se soient repentis, car à la mort du Christ le Soleil et la Lune s'obscurcirent, les Cieux gémirent: il y eut des ténèbres, des tremblements de terre et autres miracles. Puis, avec la bannière, Aristote va se placer sur l'autre angle du monument. En troisième lieu se présente la Morale : Quelles tristes nouvelles! Quoi! votre Roi est mort ? Elle fait venir Salomon, son Chevalier sage et de bonne morale. Salomon prend la bannière et crie aux quatre Vertus cardinales : O Justice, comment t'es-tu laissé offenser de la sorte par ces Juifs injustes, en relâchant Barrabas, criminel digne de mort, pour crucifier le Christ, le Juste ? Adonc, pleure, Justice ! O Prudence, tu es morte; comment t'es-tu laissé bafouer par ces fous de Juifs criant: Prophétise! Prophétise? Adonc, pleure, Prudence! O Courage, tu es mort ; comment t'es-tu laissé bafouer par cette tourbe capricieuse et mobile qui criait : Si tu es Christus, descende de Cruce! Et ils disaient encore: Tu prétendais qu'après avoir détruit le Temple, tu le rebâtirais en trois jours ; que ne descends-tu de la Croix? Il n'y eut que Forbas, le larron, qui lui dit : Si tu es le Christ, sauve-moi avec toi. Adonc, pleure, Courage ! O Tempérance, tu es morte ; tu avais beau parler humblement, les Juifs te donnaient des soufflets, te jetaient des ordures et te faisaient endurer tant d'autres tourments. Adonc, pleure, Tempérance ! Puis, avec la bannière, Salomon va se placer au troisième angle du monument. En quatrième lieu se présente l'Écriture : Quelles tristes nouvelles! Quoi! votre Roi des Rois est mort ? Elle fait venir son Chevalier. C'aurait dû être Saint Jean l'Évangéliste, mais il était cousin du Christ. Comme il fondait en larmes, qu'il avait autre chose à faire et que d'ailleurs il était parent, ce fut Saint Paul, maître en théologie, ainsi qu'il a été appelé par le Christ. Il prend la quatrième bannière et crie aux trois Vertus théologales : O Foi, à quoi en es-tu réduite ? Tu es morte, puisque la Foi suprême est morte et que de ses propres disciples elle a été abandonnée ; elle n'est restée ferme qu'en Marie, et, dit-on, aussi en Saint Jean, sans qu'on l'affirme. Que dirai-je donc de Dismas, le larron crucifié avec lui, et qu'il n'avait jamais enseigné ? Il eut plus de foi en ce dernier moment, sur la croix, que n'en eurent les Saints ; Pierre et les autres l'avaient perdue. Espérance, tu es morte! Nous avions espoir en la vie, et la vie est morte. Quelle espérance eut donc Judas, qui se pendit? Pilate qui se tua, n'en pouvait avoir.: ils Pavaient tuée tous les deux. Adonc, pleure, Espérance. O Charité, ils sont morts, et l'amour et la charité et celui qui les inspirait ! Où désormais trouverons-nous amour et charité? O Juifs, où sont-ils, votre amour et votre charité? O Juifs pleins de fausseté, où sont les miséricordes qu'il a faites à tant d'entre vous, pour les sauver ? Est-ce là sa récompense? Pleurez donc. Ainsi, en figure, ce benoît corps est honoré de quatre bannières, avec leurs Princes et Chevaliers susdits. Et notez qu'il n'y eut jamais race plus perverse que celle qui crucifia le Christ, après tant de miracles, tant de repas dans le désert, tant de gens ressuscites, illuminés. Plus il faisait de bien, plus ils cherchaient sa mort, et comme un voleur ils le crucifièrent entre deux voleurs. Et pourtant, ils avaient eu la manne, douce au delà de toute douceur : notez que cette manne était, suivant les uns, une sorte de pâte au miel cuite avec de l'huile; suivant d'autres, de la pâte feuilletée avec de la graisse. Quoi qu'il en soit, c'était comme des massepains qui pleuvaient. Eux, ils lui donnèrent à boire du fiel, de la chaux et du vinaigre! Il pardonnait à la coupable adultère, et il est mort sans péché. Ainsi de toutes choses; ils l'en ont récompensé par le contraire. Quand l'épouse du mari reste veuve, elle se coupe les cheveux, se revêt de noir; elle dispose le mari dans la salle, sur un grabat, par terre, pour que les autres femmes en prennent compassion avec elle; puis elle se lamente et pleure. Ces préparatifs achevés, elle fait venir toute la famille pour baiser la main au mort. Cette épouse du Christ, c'est véritablement notre sainte Mère Église, restée veuve par la mort du Christ ; ainsi chaque année, en ce jour-là, elle se coupe les cheveux, ce qui se figure par les autels dépouillés, comme si on leur coupait la chevelure. Elle se revêt de noir : ce jour-là, l'office se dit avec des chasubles noires, et avec des chasubles noires il doit se dire ; par dessus tout, elle place le mari sur un grabat, par terre. Ainsi l'Église de Dieu par ses lamentations, ses oraisons et ses dévotions, manifeste son deuil, bannissant l'allégresse, et la musique et le son des cloches et toute espèce de fête. La famille va baiser la main au mort : ainsi les hommes religieux, leurs enfants et toute leur maison vont baiser le Christ en croix, sur un tapis, comme cela se voit le Vendredi saint, etc.
FIN
|