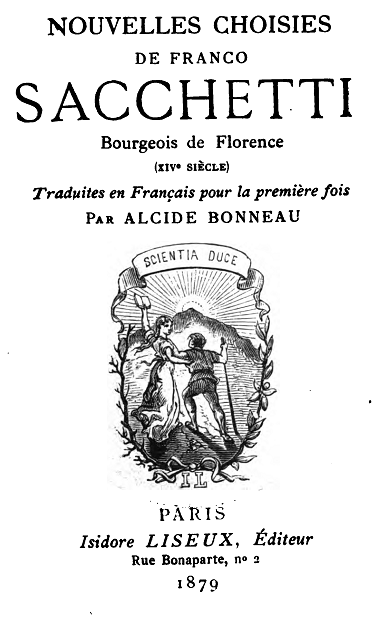
FRANCO SACCHETTI
NOUVELLES CHOISIES
CLI-CXLIX
Œuvre numérisée par Marc Szwajcer
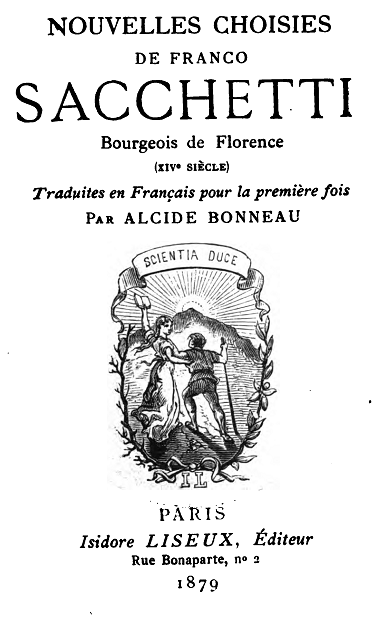
CLI-CXLIX
Œuvre numérisée par Marc Szwajcer
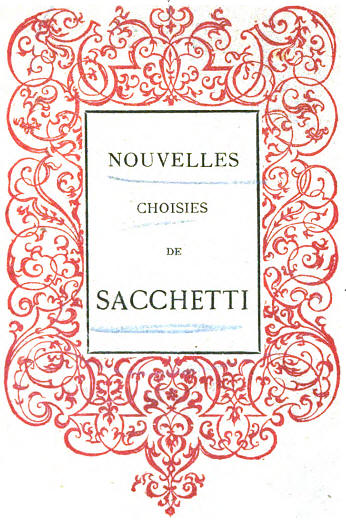
|
NOUVELLES CHOISIESDE FRANCO SACCHETTI
précédentNOUVELLE CLIFazio, de Pise, veut faire l'astrologue et le sorcier, vis-à-vis d'une multitude de bonnes gens; Franco Sacchetti lui ferme la bouche en lui posant des questions de telle nature, qu'il ne vient pas à bout d'y répondre.
Pour sûr, c'est bien là ce qui se passe. Tous ces gens qui s'en vont écarquillant les yeux, passant la nuit sur les toits, comme les chattes, examinent si bien le ciel, qu'ils en perdent la terre et restent des gueux à bâton. Ainsi, à l'aide d'arguments nouveaux, je confondis le Pisan Fazio. Quelques bonnes gens me demandèrent si j'avais trouvé dans un livre les raisons à l'aidé desquelles je venais de battre Fazio; je leur répondis que oui; que je les avais trouvées dans un livre que je portais toujours sur moi, intitulé le Cerbacone. Ils en furent satisfaits et demeurèrent émerveillés.
NOUVELLE CLVIIMessire Francesco de Casale, seigneur de Cortone, emmène Pedro Alonzo pour lui montrer le corps de Saint Ugolin; Pedro Alonço se recommande au Saint d'une manière toute nouvelle, persiste dans sa façon de voir et quitte Messire Francesco.
Si on lui répondait : — A tes propres dépens ; il ne manquait pas d'ajouter : — Je suis un tout petit mangeur ; un peu de viande me suffit ; mais si on lui disait : — Aux dépens d'un tel; — Je suis un fort grand mangeur, répliquait-il, et il me faut beaucoup de viande. Il avait encore d'autres mots dans ce genre-là. Un jour ce Pedro Alonzo se trouvant avec le susdit Seigneur, celui-ci se mit à lui vanter beaucoup certaines reliques qu'il y avait dans la ville, entre autres le corps de Sainte Marguerite. — Voilà une belle relique, dit Pedro, si l'on songe à ce que fut la Sainte. — Ce n'est pas celle-là, reprit le Seigneur, c'est une autre Sainte Marguerite, qui était du pays. — Cela peut bien être, dit Pedro ; il me semble en effet que partout où ont régné des Princes, il y a quantité de corps de Saints, et spécialement des martyrs. — Sur ma foi, répliqua le Seigneur, il y en a ici bien d'autres ; il y a surtout un corps de Saint Ugolin, la plus vénérable relique que tu aies vue de ta vie ; je veux que nous allions la p voir demain matin. Tu n'as qu'à t'y recommander, et pour sûr, Pedro, il a fait assez de miracles; si ce que tu demandes est licite, il t'en fera la grâce. — Je veux bien, Monseigneur, dit Pedro, et même je vous en prie. Le lendemain matin, Messire Francesco sortit avec Pedro et tous deux se rendirent à l'église où était le corps en question ; ils pénétrèrent dans une chapelle et les clercs le tirèrent soit de Tau-tel, soit d'une armoire, enveloppé, comme c'est l'usage, de toutes sortes de voiles et de draperies d'or, et le découvrirent peu à peu ; le Prince était à genoux devant, et Pedro de même, à côté de lui. Lorsque le corps entier fut à nu et qu'on le vit tout noir, horrible, avec ses os qui perçaient la chair : — Approche, Pedro, dit le Prince, et recommande-toi à lui. Pedro, à cette invitation d'approcher, sentit tous ses cheveux se hérisser sur sa tête; il s'approcha néanmoins, pour obéir, et se mit à faire le signe de la Sainte Croix en s'écriant : — Messire Saint Ugolin, je vous en prie pour l'amour de Dieu, ne me faites ni bien ni mal. Il répéta par trois fois ces paroles, en se signant continuellement. Le Prince le regardant, stupéfait, lui dit : — Pedro, aurais-tu peur des Saints ? — Monseigneur, répondit Pedro, jamais je n'ai eu si peur. Ils se relevèrent, et après avoir fait de nouveau le signe de la croix, sortirent. En chemin, tout en causant, le Prince dit : Tu m'as bien surpris avec ta contenance et tes paroles, devant le vénérable corps de ce Saint. — Monseigneur, répondit Pedro, je n'ai jamais eu frayeur pareille; c'est le corps le plus noir que j'aie jamais vu, et si les corps des Saints sont si épouvantables, que doivent être ceux des damnés? Ma foi, je ne puis m'empêcher de vous le dire : le monde est plein de nouveautés, et chacun aime ce qui est nouveau, quia omnia nova placent; votre Saint Ugolin peut avoir été un saint homme, mais je ne troquerais pas mon corps contre le sien. Dans le catalogue des Bienheureux, je n'ai jamais vu de Saint Ugolin, et je ne sais trop ce qu'il a été. Si vous avez pour lui de la piété et de la dévotion, adorez-le; pour moi, je ne suis pas prêt de l'adorer : il me tarde mille ans de m'en aller à la grâce de Dieu, que j'adore. Vous, adorez votre Saint Ugolin, mais faites voir son corps le moins possible; quant à moi, je ne m'en soucie et je compte bien ne le revoir jamais. Messire Francesco, après l'avoir laissé dire, s'écria : — Pour sûr, Pedro, c'est une des plus belles reliques du monde, mais tu ne la connais pas. — Cela peut bien être, qu'elle vous paraisse belle, répondit Pedro; peut-être aussi me l'avez-vous montrée pour me chasser d'ici ; je veux m'en aller, car elle m'a fait grand’ peur, une peur telle, que je vous dis adieu ; faites votre deuil de moi, tant qu'il y aura à Cortone ce corps de Saint Ugolin. Monté à cheval, il dit au Prince : Restez avec Saint Ugolin ; je m'en vais sans lui. — Puisque tu veux partir, Pedro, répliqua le Prince, eh bien, va-t'en avec Saint Ugolin. — Monseigneur, dit Pedro, si vous le dites encore, je suis capable de ne plus savoir si je dois rester ou m'en aller; et donnant de l'éperon à son cheval, après avoir répété au Prince : Restez avec Saint Ugolin, il s'éloigna. Il en arrive ainsi par le monde ; les Princes et tous les autres mortels sont si infatués de nouveautés, que, s'ils le pouvaient, ils changeraient le gouvernement du ciel, comme ils changent si souvent celui des pays. Nous avons les Saints canonisés, et nous en cherchons d'autres, dont nous ne savons pas même s'ils existent. Nous avons Notre-Seigneur Jésus-Christ, sa Mère, les Apôtres et les autres grands Saints du Paradis, et nous courons à Saint Barduccio. D'une part nous dirons que quiconque meurt excommunié, son corps reste intact, sans se corrompre ; et d'autre part nous réputerons qu'un cadavre qui ne se corrompt pas est un corps saint. Cette idolâtrie va si loin, qu'on abandonne les Saints véritables pour les Saints de contrebande, devant les images desquels on place plus de cierges et d'ex voto en cire que devant Notre-Seigneur. Ainsi on quitte la route ancienne pour la nouvelle, et les Religieux souvent en sont cause : ils répandent le bruit qu'un corps enterré dans leur église a fait des miracles, et ils l'exhibent en peinture, afin d'en tirer, non de l'eau pour leur moulin, mais de la cire et de l'argent ; la foi devient ce qu'elle peut.
NOUVELLE CLXVCarmignano, de Fortune, décide d'une façon singulière la valeur d'un coup au jeu de trictrac, en passant par hasard dans la rue; ce coup pourtant ne pouvait être jugé% si on ne l'avait pas vu jouer.
Cette Nouvelle me fait souvenir de la manière dont va le monde aujourd'hui en ce pays, et le plus faible le sait bien, quand il a à faire à plus fort. Loin qu'on lui donne raison, il ne trouve personne qui ouvre pour lui la bouche ou qui veuille décider contre l'homme puissant. Dans les pays qui prétendent se gouverner en République, cette iniquité sévit encore davantage, et la preuve c'est qu'un procès y durera huit ou dix ans ; lorsque en si long temps il n'est pas jugé, chacun peut penser, comme Car-mignano, que la plus forte partie cherche des délais pour ne pas payer. Ne voit-on pas, en justice, tous les pauvres diables et les chétifs exécuter la sentence ? Les puissants n'entendent pas de cette oreille: NOUVELLE CLXXXIIIGallina Attaviani donne un bon repas à un étranger, le croyant un grand maître es arts. Le repas fait, il s'aperçoit du contraire ; il a perdu sa dépense et reste tout confus.
Le lendemain venu, Renauld se présenta à la boutique de Gallina, et l’on se mit à dîner. Comme c'est l'usage, tout le monde faisait grand accueil à l'étranger et demandait à Gallina qui c'était. — Je n'en sais rien, répondait Gallina, mais autant que je puis voir, c'est un grand maître es arts, et, avant de quitter la table, je lui demanderai quelle est sa partie. On mangea, le dîner prit fin, et comme on apportait à laver les mains, Gallina dit : Vous devez être un grand maître, à Montpellier ; eh ! Dieu vous garde, dites-moi donc-quel est votre profession ou votre métier ? — Ma foi, répondit Renauld, je suis barbouilleur de pots. Nous appelons barbouiller, peindre dans le genre de ce qui se voit là-dessus, et pots ce que vous autres vous nommez des vases à boire. En entendant ces explications, Gallina se dit : — Bon, j'ai fait déjà dépense bien à raison ! Si je continue de la sorte, je pourrai me mettre à faire des pots de terre, comme ce garçon-là, et laisser de côté l'orfèvrerie. Les autres qui étaient à dîner étouffaient de l’envie qu'ils avaient de rire. Tous levés de table, Guerrieri de Rossi, l'un des convives, prit Gallina par la main et lui dit : — Il t'est arrivé ce matin la meilleure histoire que j'aie jamais vue arriver à personne. Ne regrette pas la dépense que tu as faite, quoique ce garçon soit un barbouilleur de pots. Tu t'appelles Gallina (poule) et il s'appelle Renauld (renard). Quand as-tu vu que le renard s'approche de la poule pour autre chose que pour la croquer? Heureusement, le hasard t'a bien servi en ce que tu lui as donnera manger d'assez bonnes choses, grâce à quoi tu en as réchappé. Congédie-le donc le plus tôt que tu pourras et laisse-le aller barbouiller des pots. — Guerrieri , dit Gallina, tu plaisantés toujours; mais ce m'est tout un. — Et moi ce m'est tout autre, reprit Guerrieri; cette lamproie est la meilleure chose que j'aie encore mangée. On rit longtemps de l'histoire sur la place du Pont. Renauld et Gallina s'en allèrent du côté de la boutique, et, quelques jours après, Renauld s'en retourna à Montpellier barbouiller des pots.
NOUVELLE CXCILe peintre Bonamico, réveillé tous les matins de bonne heure pour travailler par Tafo, son maître, à l’idée de mettre dans la chambre des escarbots avec des bouts de chandelle allumés au derrière. Tafo croit que ce sont des diables.
Encore tout épouvanté, il se lève et appelle Bonamico. As-tu vu cette nuit la même chose que moi ? lui de-mande-t-il.— Je n'ai vu quoi que ce fut, répond Bonamico, je dormais, et je n'ai pas ouvert l'œil. Je m'étonne que vous ne m'ayez pas appelé pour travailler à la chandelle, comme de coutume. — Travailler! reprend Tafo; j'ai vu plus de cent diables dans ma chambre, et j'en ai eu la plus grande frayeur que j'aie jamais éprouvée ; cette nuit, bien loin d'avoir l'idée de peindre, je ne savais pas moi-même où j'en étais. Pour Dieu, je t'en prie, mon cher Bonamico, tâche donc de nous trouver quelque autre maison à louer; sortons d'ici, car je ne veux pas y rester davantage. Je suis vieux, et si je passais trois nuits comme celle que je viens de passer, je ne vivrais pas jusqu'à la quatrième. Entendant son maître parler de la sorte, Bonamico lui dit : — Il me semble surprenant que, couchant tout près de vous, comme je fais, je n'aie ni vu ni entendu rien de tout cela. Il arrive souvent la nuit qu'on croit voir un tas de choses qui ne sont pas; souvent on rêve, on s'imagine que c'est vrai, et ce n'est qu'un songe. Ne vous dépêchez pas tant de vouloir changer de maison, faites l’expérience d'une autre nuit. Je suis près de vous et je me tiendrai prêt, s'il arrive quelque chose, à voir ce qu'il y aura à faire. Bonamico en dit tant, que Tafo consentit, quoique à grand-peine, et rentré le soir à la maison, il ne faisait que regarder en l'air, comme un homme frappé de terreur. Il se mit au lit, mais resta toute la nuit au guet sans dormir, à lever la tête, puis à la cacher sous les draps, sans penser le moins du monde à réveiller Bonamico pour peindre à la chandelle ; il songeait plutôt à l'appeler à son secours, s'il apercevait ce qu'il avait vu la nuit précédente. Bonamico, qui comprenait bien tout, eut néanmoins peur qu'il ne le réveillât pour travailler dès le matin, et lâcha par la fente de la porte trois escarbots avec leurs bouts de bougie. Dès que Tafo les aperçut, il s'enfonça sous la couverture en se recommandant à Dieu, en se vouant à lui, et récitant une foule de prières, sans oser appeler Bonamico. Celui-ci, la farce jouée, se remit à dormir et attendit ce que Tafo aurait à lui dire le matin. Le matin venu, Tafo, hasardant le nez hors des draps, vit qu'il faisait jour, se leva tout engourdi, et d'une voix tremblante appela Bonamico.— Quelle heure est-il? demanda Bonamico, faisant mine de se réveiller. — J'ai compté cette nuit toutes les heures, dit Taib, car je n'ai pas fermé l'œil. — Comment ? dit Bonamico. — A cause de ces diables, répondit Tafo; quoiqu'il n'en soit pas venu autant que l'autre nuit. Tu ne me ramèneras plus ici; sortons, allons-nous-en; je ne suis pas près de revenir dans cette maison. Bonamico eut beau lui dire que, le soir arrivé, il l'y ramènerait tout de même, il ne le décida qu'en lui donnant à entendre que si un prêtre dûment consacré couchait avec lui, les diables n'auraient plus le pouvoir de venir au logis. Tafo s'en fut trouver le Curé de sa paroisse, et le pria de venir souper et coucher avec lui; il lui en dit le motif. Tout en devisant là-dessus, ils rejoignirent Bonamico, et tous les trois rentrèrent à la maison. Le prêtre, s'apercevant que Tafo était comme hors de lui, tant il avait peur, lui dit : Ne craignez rien; je sais tant et tant d'oraisons, que si ce logis était plein de diables, je les ferais sauver à toutes jambes. — J'ai souvent entendu dire, suggéra Bonamico, que les plus grands ennemis de Dieu sont les diables ; si cela est, ils doivent être aussi les grands ennemis des peintres, qui le représentent si souvent, lui et les autres Saints; à l'aide de leurs œuvres se fortifie la foi catholique, qui peut-être péricliterait, si les tableaux, dont le but est d'inciter à la dévotion, n'existaient pas. Cela étant, quand la nuit, moment où les démons ont le plus de pouvoir, ils entendent qu'on se lève pour travailler à la chandelle et faire ces peintures qui leur causent tant de colère et tant de douleur, ils accourent à grand fracas troubler cette besogne détestée. — Dieu m'assiste, dit le Curé, ce raisonnement me plaît beaucoup; mais les choses prouvées sont plus sûres; et se tournant vers Tafo : Vous n'avez pas tant besoin de gagner de l'argent, qu'il vous faille, si ce que dit Bonamico est vrai, vous lever la nuit pour peindre ; faites-en l'expérience une nuit ou deux ; je coucherai avec vous, ne vous levez pas, ne travaillez pas à la chandelle, et nous verrons comment iront les choses. Ce fut une affaire convenue; toutes les nuits que le prêtre vint coucher, les escarbots ne se montrèrent nullement : nos gens en conclurent que la raison donnée par Bonamico était claire et manifeste, et Tafo fut bien quinze nuits sans appeler Bonamico. pour travailler. Une fois rassuré, poussé par le désir du gain, Tafo, une belle nuit, se remit à réveiller Bonamico : il lui fallait achever un tableau pour l'abbé de Bonsollazzo. Bonamico, voyant recommencer le jeu, prit de nouveau des escarbots, et la nuit suivante les lâcha par la chambre à l’heure accoutumée. A cette vue, Tafo se fourre dans les draps, tout en peine et murmurant en lui-même : Allons, va, Tafo, va travailler; et le prêtre qui n'est plus là ! Vierge Marie, secourez-moi, et un tas d'autres paroles, jusqu'à ce que le jour vînt. Une fois levés, lui et Bonamico, Tafo lui dit que les diables sont revenus. — Voilà ce qui montre clairement, dit Bonamico, qu'il en est bien comme je le disais, quand le Curé était là. — Allons revoir le Curé, répondit Tafo. Ils le rencontrèrent et lui dirent ce qui était arrivé. Là-dessus le prêtre affirma que Bonamico avait deviné juste, et il notifia la chose à ses paroissiens comme tout à fait indubitable : si bien que personne, Tafo ni les autres peintres, n'osa plus désormais se lever pour travailler à la chandelle. L'histoire se divulgua, si bien que l'on ne parlait plus d'autre chose ; Bonamico, en homme de sainte vie, fut réputé avoir connu, par inspiration divine ou par révélation, la véritable raison de ces apparitions d'esprits dans le logis du peintre. Cela fut cause qu'on le considéra désormais davantage, et grâce à ce renom, d'élève il devint maître. Il se sépara de Tafo; peu de temps après, il ouvrit un atelier pour son propre compte, délibérant de s'appartenir et de pouvoir dormir tout son soûl. Tafo loua une autre maison pour y passer le reste de ses jours, et fit le vœu de ne jamais peindre à la chandelle, jamais de sa vie, de peur de tomber entre les mains des escarbots. NOUVELLE CXCVIMessire Rubaconte, Podestat de Florence, rend quatre belles et curieuses sentences en faveur de Begnai.
La seconde fois, Fane d'un paysan était tombé par terre et ne pouvait se relever; le paysan le tirait par devant, il pria Begnai d'en faire autant par derrière. Begnai prit l'âne par la queue et tira de toutes ses forces : la queue lui resta dans la main. Le maître de l'âne, s'estimant lésé, recourut au Podestat et fit citer Begnai. Le Podestat, mis au courant de l'affaire et entendant Begnai alléguer qu'il croyait la queue de l'âne plus solidement attachée, étouffait de rire. Le maître de l'âne s'écriait : Je ne t'ai pas dit de lui arracher la queue. — Bonhomme, jugea le Podestat, remmène ton âne à la maison ; quoiqu'il n'ait plus de queue, il portera le bât tout aussi bien. — Et comment se garantira-t-il des mouches ? demandait le pauvre homme. Le Podestat décida qu'il devait emmener l'âne, ou bien, s'il l'aimait mieux, Begnai le garderait jusqu'à ce qu'il eût réussi à lui remettre la queue, puis le lui rendrait. Begnai fut libéré, et le paysan jugea préférable de s'en retourner chez lui, avec son baudet sans queue. La troisième affaire vint de ce que Begnai trouva une bourse avec quatre cents florins dedans. Celui qui l'avait perdue la cherchait partout, Begnai la lui rend; l’homme lui fait une querelle et prétend qu'il lui manque cent florins. — Je t'ai donné la bourse telle que je l'ai trouvée, dit Begnai. L'affaire est portée devant le Podestat, qui, la cause entendue, dit au demandeur : — Est-il supposable que si cet homme avait eu envie de mal faire, il aurait de son propre gré opéré la restitution? — N'importe, répondit l'homme ; il y avait cinq cents florins. — Eh bien alors, dit le Podestat, je veux que Begnai garde cette bourse de quatre cents florins, puisqu'il y en avait cinq cents dans la tienne ; trouve celle des cinq cents florins. Tu n'auras l'autre que si tu te trouves satisfait de la reprendre telle quelle, et si tu promets sincèrement de restituer les quatre cents florins, au cas où ils appartiendraient à un autre. L'homme prit la bourse et stipula la promesse ; Begnai fut laissé libre. Le quatrième et dernier différend eut lieu sur la fin des fonctions du Podestat. Voici à quelle occasion : Begnai allait à cheval à la foire de Prato ; quand il fut à Peretola, il rencontra d'autres cavaliers, avec des femmes, et se joignit à eux. Son cheval, assez mal commode, se mit à vouloir grimper sur un autre, monté par une femme qui était enceinte ; la femme tomba par terre et se blessa. Son mari et ses frères portèrent plainte au Podestat; Begnai fut mandé, il comparut et dit qu'il n'y avait pas de sa faute, que c'était celle de son cheval, un animal qu'il ne connaissait pas et à qui il n'avait jamais parlé. — Foi de Dieu, Begnai, dit le Podestat, tu dois être un grand malfaiteur, car j'ai continuellement à régler tes procès. Puis se tournant vers les parties de la dame en question : Que demandez-vous ? leur dit-il. — Messire le Podestat, dirent ces gens, vous paraît-il convenable que cet homme ait fait avorter cette dame ? Vous l'avez entendu, répondit le Podestat ; il dit qu'il n'y a pas eu de sa faute; les chevaux sont des bêtes brutes. Qu'y a-t-il à foire ? — Et nous, dirent-ils, le moyen, s'il vous plaît, que la dame en question redevienne enceinte, comme elle Tétait? — Voici ce que je propose pour terminer le différend, dit le Podestat : Menez cette dame chez Begnai ; il la gardera jusqu'à ce qu'elle soit enceinte comme avant. La sentence rendue, nos gens s'en retournèrent et ne menèrent pas la femme chez Begnai, qui fut relâché. Venu le temps où les Syndics entraient en charge, le Podestat reçut assez de plaintes, au sujet des affaires de Begnai, dans lesquelles on prétendait qu'il n'avait suivi ni la loi ni les statuts de l'État. Le Podestat répondit : La meilleure loi qu'on puisse appliquer, c'est celle que suggèrent l'équité et le discernement. La loi dit : Quiconque est homicide mérite la mort; mais il y a bien des différences d'un homicide à un autre; il y en a qui, bien loin de mériter la peine capitale, seraient dignes de récompense ; d'autres, au contraire, mériteraient mille morts. Il faut donc trouver moyen que la loi ne soit pas toujours appliquée à la lettre ; ce moyen, c'est de s'en remettre à quelque magistrat éclairé. Je ne me flatte pas d'en être un, mais j'ai jugé en conscience et suivant l'équité. Les Syndics, après avoir pris connaissance des sentences portées par lui, et spécialement de celles qui regardaient Begnai, furent tous d'avis que loin d'avoir mérité un blâme, il devait recevoir de la République une distinction extraordinaire. Ils en délibérèrent avec les Prieurs, et, sur leur conseil, votèrent audit Podestat une bannière et un bouclier d'honneur, de la part du peuple de Florence. Ce fut le premier présent fait à nos Podestats. Plût à Dieu que ces récompenses se donnassent aujourd'hui aussi discrètement que par le temps passé. Elles servaient alors à rémunérer la vertu ; aujourd'hui, on les décerne par amitié ou par complaisance.
NOUVELLE CXCVIIIRien qu'avec les yeux de l'esprit, un Aveugle d'Orvieto à qui il a été dérobé cent florins, s'ingénie de telle sorte, que le voleur les remet où il les avait pris.
Trois jours ne s'étaient pas écoulés que l'Aveugle eut la fantaisie de savoir si son trésor était toujours où il l'avait enfoui ; il prit son temps, alla droit au pavé sous lequel il l'avait déposé, le souleva, chercha la bourse ne trouva rien, et manqua du coup tomber en défaillance; cependant il replaça la dalle telle qu'elle était auparavant et rentra chez lui, en grande tristesse. Là, songeant qu'en un instant il avait perdu une somme amassée peu à peu, en longues années, il lui vint à l'esprit une idée subtile, comme les aveugles en ont souvent. Dès le lendemain matin il appela un fils qu'il avait, gamin de neuf ans, et lui dit : Viens, mène-moi à l'église. L'enfant obéit à son père ; mais ayant de sortir de la maison, celui-ci le prit à part dans la chambre et lui dit : Approche, mon enfant ; tu viendras avec moi à l'église, tu ne me quitteras pas; tu resteras assis près de moi, sur le seuil de la porte, et tu regarderas bien attentivement tous ceux qui viendront à passer, hommes ou femmes. Rappelle-toi bien si quelqu'un me fixe plus que les autres, se met à rire ou laisse échapper quelque geste à mon adresse, et retiens qui c'est. Sauras-tu faire cela? —Oui, répondit-il. Le gamin bien endoctriné, l'Aveugle et lui se rendirent à l'église et se placèrent à leur poste accoutumé. L'enfant, attentif à ce que lui avait recommandé son père, resta la matinée entière à regarder dans les yeux de tout le monde et enfin s'aperçut que ce Juccio, en passant, avait fixé l'Aveugle et souri en le regardant. L'heure venue de s'en retourner à la maison pour dîner, avant même d'être au haut de l'escalier, l'Aveugle interrogea son fils : N'as-tu rien vu de ce dont je t'ai parlé, mon enfant? lui demanda-t-il. — Non, père, si ce n'est que j'en ai remarqué un qui vous regardait fixement et souriait. — Qui est-ce ? — Je ne sais comment il s'appelle, mais je sais bien que c'est un charcutier et qu'il demeure dans le voisinage, près des Capucins. — Saurais-tu me mener à sa boutique et me dire si tu le vois demanda le père. L'enfant répondit que oui. L'Aveugle, sans tarder davantage, dit à l'enfant : Mène-moi vite et si tu le vois, dis-le moi; pendant que je serai à parler avec lui, tu resteras dehors et tu m'attendras. L'enfant guida l'Aveugle jusqu'à ce qu'il eut rencontré l'homme en question, installé dans sa boutique et en train de vendre des fromages ; il le dit à son père et le mena tout près de lui. L'Aveugle n'eut pas plutôt entendu parler l'homme avec ses pratiques, qu'il le reconnut pour un certain Juccio, dont il avait fait la connaissance autrefois, avant de perdre la vue; et, entrant en conversation, il lui dit qu'il voulait l'entretenir tout seul, à l'écart. Juccio, soupçonnant quelque chose, le conduisît dans une chambre du fond, au rez-de-chaussée, et lui dit : Cola, quelle bonne nouvelle y a-t-il ? — Mon frère, répondit Cola, je viens à toi en toute confiance et grande amitié. Comme tu le sais, il y a longtemps que j'ai perdu la vue et, restant pauvre, avec beaucoup de famille, il m'a fallu vivre en demandant l'aumône. Par la grâce de Dieu, par la charité des gens d'Orvieto et de toi-même, je me trouve posséder deux cents florins; j'en ai cent quelque part, à ma disposition ; les autres, je les ai donnés en garde à certains de mes parents, et je les aurai sous huit jours. Maintenant, si tu voyais moyen de prendre ces deux cents florins et de m'en faire pour l'amour du bon Dieu telle petite rente que tu jugerais convenable, pour subsister moi et mes enfants, j'en serais bien aise, parce qu'en ce pays il n'y a personne à qui je me fierais plus qu'à toi. Je ne veux point que l’on passe de cela aucun écrit, qu'on en dise ni qu'on en sache rien. Je te supplie donc par-dessus tout, quel que soit le parti que tu prennes, de ne souffler mot de la chose ; car, tu le sais bien, si l’on apprenait que je possède cette somme-là, toutes les aumônes que l'on me fait viendraient à me manquer. Juccio, l'entendant parler de la sorte et s'imaginant pouvoir encore prendre à l’hameçon les cent, autres florins, dit à Cola de bonnes paroles, le pria de lui conserver sa confiance et lui fit promettre de revenir le lendemain, qu'il lui rendrait réponse. L'Aveugle partit. Juccio, saisissant le bon moment, le plus tôt qu'il put s'en fut à l'église avec la bourse à laquelle il n'avait pas encore touché, et la replaça sous cette dalle où il l'avait prise. Il pensait bien que les cent florins que Cola disait avoir à sa disposition n'étaient autres que ces cent florins cachés sous la pierre; il les y remettait pour ne pas manquer l'autre centaine. De son côté, Cola se dit que ces paroles de Juccio : Demain, je te rendrai réponse, donnaient tout lieu de croire que pour avoir les cent florins, avant de donner réponse il voulait reporter les autres à leur place. Il se rendit ce même jour à l'église, prit garde de ne pas être aperçu, leva le pavé et dessous trouva la bourse. Il la cacha aussitôt sur lui, replaça la dalle, sans grande précaution, et rentra à la maison, sûr de passer une bonne nuit. Le lendemain matin, il s'en fut voir ce que lui dirait Juccio. Dès que celui-ci l'aperçut, il courut à sa rencontre : Où va mon ami Cola ? lui demanda-t-il. — Je viens te voir. Quand ils furent dans la chambre du fond, Juccio lui dit : — La grande confiance que tu as en moi me force à me mettre en quatre pour faire ce que tu me demandes. Tâche d'avoir les deux cents florins ; d'ici huit jours, je compte faire un gros achat de viandes salées et de fromages secs, je gagnerai pas mal d'argent et je t'en donnerai une bonne part. — Dieu le veuille, répondit Cola; je vais aller aujourd'hui même chercher mes cent florins, peut-être aurai-je aussi les autres, et je te les apporterai tout de suite. Après, fais-moi tout le bien que tu pourras. — Que Dieu te conduise, dit Juccio ; et reviens vite. J'ai délibéré de faire cet achat, parce que Messire Gomez rassemble pour l'Église une grande quantité de gens d'armes ; je crois qu'il y en aura beaucoup ici, et les soldats sont on ne peut plus friands de ces deux denrées. Va donc, hâte-toi ; j'espère faire de bons profits, pour ton compte et pour le mien. Cola sortit, mais non avec l'intention que lui supposait Juccio : l'aveugle aveuglait le clairvoyant. Le lendemain arrivé, Cola revint, la mine allongée, trouver Juccio qui fut à sa rencontre avec un gros rire, dès qu'il l'aperçut, et lui dit : Je te souhaite le bonjour, Cola. — Je me contenterais d'un jour ordinaire, sans en demander un bon, répondit Cola. — Qu'est-ce que cela signifie? — Mon malheur, dit Cola. t J'avais caché quelque part cent florins et je ne les retrouve plus : on me les a volés; pour mes parents, chez qui j'avais placé les cent autres en dépôt, par petites sommes, les uns me répondent qu'ils n'ont rien, les autres me disent pis, si bien que je n'ai plus qu'à serrer les poings, tant j'enrage. — Voilà bien ma chance, dit Juccio; je crois gagner gros et je vais perdre cent florins ou plus. Le pis, c'est que j'ai presque opéré l'achat en question, et que si celui qui m'a vendu la marchandise entend que le marché tienne, je ne sais pas comment payer. — J'en suis bien chagrin pour toi, répondit Cola, et. encore plus pour moi, qui reste dans une situation à vivre mal aisément; il va falloir me remettre à amasser un nouveau capital. Mais si Dieu me fait la grâce d'avoir jamais un p peu d'argent, je ne le cacherai plus dans un trou et je ne me fierai à le donner en garde à personne, quand ce serait mon père. En l'entendant, Juccio se demanda s'il ne pourrait pas rattraper quelque chose des cent florins qu'il lui semblait avoir perdus. — Ces cent florins que tes parents ont en dépôt, lui dit-il, si tu pouvais les ravoir et me les donner, je tâcherais d'en emprunter cent autres, pour que mon marché tînt; de cette façon, il pourrait bien arriver qu'avant peu de temps tu te retrouvasses deux cents florins dans la bourse. — Mon bon Juccio, reprit l'Aveugle, si je voulais déclarer les cent florins que me détiennent mes parents, je n'aurais qu'à les réclamer, et il me serait fait justice. Mais je ne veux pas en dire un mot, par la raison que si on le savait, je perdrais mes aumônes. Ainsi donc, je les regarde comme perdus, si toutefois Dieu ne les a pas déjà rappelés à lui. N'espère plus rien de moi, puisque la Fortune en a décidé de la sorte. Mais si malheureux que je reste voyant, la bonne disposition où tu étais de me faire riche, je me tiens pour avoir reçu de toi deux cents florins et les posséder dans ma bourse, comme si tu me les avais donnés, puisqu'il n'y a aucunement de ta faute. Je veux pourtant faire une chose ; je me ferai tirer la bonne aventure par un de mes amis, pour voir s'il pourrait me dire qui m'a volé; si cela me réussit, je reviendrai te voir. Adieu ; je n'entends pas coucher ici. — Va donc, lui dit Juccio ; ingénie-toi de retrouver et de ravoir ton argent, par tous les moyens. Si tu réussis, tu sais où je demeure, au cas où tu aurais besoin de rien. Tranquillise-toi du mieux que tu pourras et Dieu te conduise! Ainsi finit l'achat du fromage sec et de la viande salée, achat qui n'eut jamais lieu. L'Aveugle rattrapa son argent et se désopila en lui-même un bon bout de temps. Par sainte Lucie, s'écria-t-il, Juccio y a vu moins clair que moi. C'était bien vrai : l'Aveugle avait fait mordre à l'hameçon le clairvoyant, en amorçant avec cent florins pour ravoir les autres. Il n'y a pas lieu de s'en étonner, car les aveugles sont de plus subtil entendement que les autres. La vue, en se portant sur une chose ou sur une autre, distrait l’intelligence, ce dont on pourrait donner beaucoup de preuves; je me contenterai d'en alléguer une toute petite. Supposez deux personnes qui causent ensemble : l'une d'elles étant au milieu de sa phrase, une femme viendra à passer, tel ou tel accident à se produire ; notre causeur suspend sa phrase, s'arrête, et, voulant poursuivre, il dit à l'autre : Qu'est-ce que je disais donc? Cela suffit à montrer combien la vue distrait l'esprit et empêche la suite dans les idées. C'est pour cela que le philosophe Démocrite se creva les yeux, afin d'avoir l'intelligence plus nette. De son côté, Juccio se lamentait, comme s'il avait réellement perdu cent florins. C'est bien fait pour moi, se disait-il ; j'avais trouvé cent florins, j'en ai voulu cent autres. Mon maître me le disait toujours : Mieux vaut en main un pinson qu'une grive dans le buisson, Je ne m'en suis pas assez souvenu : j'ai perdu le pinson et je n'ai pas eu la grive; un aveugle m'a pris au piège. Vraiment, il a eu cent yeux, aussi bien que les cent florins, pour me Jouer de la sorte. C'est bien fait pour moi; les cent florins ne me suffisaient pas, l'avarice me poussa à en vouloir cent de plus. Prends, Juccio, que tu aies acheté le lard salé; il est on ne peut plus vrai que j'ai acheté cent florins le lard de l’Aveugle, et c'est le plus salé dont j'aie jamais fait emplette. Il ne put de longtemps digérer la chose, et si on lui demandait : — Qu'est-ce que tu as donc ? il répondait qu'il avait perdu cent florins en salaisons. Ce fut bien fait pour lui: qui veut tout perd tout, et le trompeur souvent reste en arrière du trompé.
|