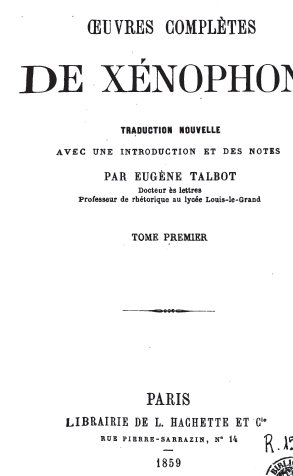
XENOPHON
ŒUVRES COMPLETES
INTRODUCTION.
Traduction française · Eugène TALBOT.

|
ŒUVRES COMPLÈTES
DE XÉNOPHON
-------------
TYPOGRAPHIE DE CH. LAHURE ET Cie Imprimeurs du Sénat et de la Cour de Cassation rue de Vaugirard, 9
------------- ŒUVRES COMPLÈTES
DE XÉNOPHON
TRADUCTION NOUVELLE AVEC UNE INTRODUCTION ET DES NOTES PAR EUGÈNE TALBOT Docteur es lettres Professeur de rhétorique au lycée Louis-Ie-Grand TOME PREMIER
-------------------- PARIS LIBRAIRIE DE L. HACHETTE ET Cie RUE PIERRE-SARRAZIN, N" 14 ---- 1859 AU GENERAL ALLARD PRÉSIDENT DE LA SECTION DE LA GUERRE ET DE LA MAR1NE AU CONSEIL D’ÉTAT HOMMAGE DE RESPECT ET DE DÉVOUEMENT
EUGÈNE TALBOT L’histoire et la géographie ne nous ont pas conservé le nom de toutes les tribus ni de tous les bourgs disséminés autour d’Athènes. Il est pourtant plusieurs de ces localités dont le souvenir n’a point complètement péri. Ce sont celles qui ont donné naissance à quelques-uns des hommes illustres que nous appelons communément Athéniens, et qui étaient, en effet, citoyens d’Athènes, soit par origine, soit par adoption, en vertu de la confédération établie, dès l’antiquité la plus reculée, entre les différents dèmes ou villages de la Diacrie, de la Plaine et de la Paralie. Ainsi le nom des villages d’Halime, d’Alopèce et de Péanée traversera les âges, grâce au souvenir de Thucydide, de Socrate et de Démosthène. Il en est de même du petit bourg d’Erchios, compris dans le district de la tribu Égéide : la mémoire de Xénophon le sauvera de l’oubli. On ignore le nom de la mère de Xénophon ; son père s’appelait Gryllus : c’est tout ce qu’on en sait. On peut croire, d’après les goûts champêtres de son fils, que c’était un de ces propriétaires cultivateurs, qui se plaisaient, comme tous les Athéniens, à exploiter leurs terres, leurs ruches ou leurs plants de vignes et d’oliviers, soit sur le penchant méridional du Parnès, soit sur les bords du Céphise, et qui ne venaient à la ville que pour les affaires extraordinaires, et sur la convocation officielle des hérauts. L’époque de la naissance de Xénophon n’est établie par aucun texte : aussi les savants en ont-ils longuement discuté la date. Il résulte de leurs recherches et de leurs ii observations contradictoires qu’on peut la fixer à la quatrième année de la 83e olympiade, 445 avant Jésus-Christ. La première éducation de Xénophon fut vraisemblablement celle de tous les jeunes Athéniens. Apprendre par cœur les poèmes d’Homère, les sentences de Solon, de Théognis et de Phocylide, étudier les éléments de la grammaire, les mathématiques et les principes de la stratégie; se former, sous la direction des pédotribes, aux exercices de la gymnastique et de la natation, monter à cheval, s’endurcir le corps et étendre à une distance merveilleuse la portée de la vue par une pratique passionnée et intelligente de la chasse, parcourir, suivi de ses chiens et de ses garde-filets, l’immense forêt d’oliviers qui couvrait le Pédion, asile des essaims d’oiseaux que le printemps ramène d’Asie ; remonter vers les plaines accidentées, vers les coteaux boisés et giboyeux du nord de l’Attique, ou bien s’enfoncer sous les chênes et les sapins du Brilesse, pour y lutter contre les loups et les ours : telles étaient, selon toute apparence, les occupations de Xénophon adolescent, avant qu’il liât connaissance avec Socrate. Voici comment, suivant Diogène de Laërte, s’établit cette relation. Un jour, Socrate, rencontrant le jeune Xénophon dans une rue étroite, lui barre le passage avec son bâton et lui demande où est le marché aux vivres. Lorsque celui-ci a satisfait à cette question, il lui demande où les hommes se forment à la vertu. Xénophon hésite : « Suis-moi donc, lui dit-il, je te l’apprendrai; » et depuis ce temps, il le compte au nombre de ses disciples et de ses amis. Les dispositions naturelles de Xénophon ne pouvaient trouver une meilleure direction philosophique : le jugement, la raison, le bon sens répandus comme une douce lumière sur toutes les œuvres qui le recommandent à la postérité, trouvaient, sans aucun doute, leur satisfaction et leur développement dans cet enseignement simple et familier, fondé sur l’observation, la réflexion et la connaissance pratique de l’intelligence et du cœur de l’homme. iii Un des plaisirs les plus vifs des Athéniens étant de se promener ou de se reposer durant les belles journées, à l’ombre des platanes qui bordaient les rives de l’Illyssus, du Cépbise ou de l’Eridan, il entrait dans le règlement de la police athénienne, surtout à l’époque de la guerre du Péloponnèse, de maintenir la paix et l’ordre dans les campagnes de l’Attique, au moyen de la milice des adolescents, espèce d’école militaire, où servaient les jeunes gens qui n’étaient pas encore assez robustes pour faire partie des armées de la république. Ces garde-frontières, ou péripoles, étaient enrôlés à dix-huit ans, et quittaient à vingt ans leur service. Ils avaient à surveiller soit les montagnes et les vallées, où les brigands, aussi bien que les ennemis, pouvaient se cacher dans une foule de grottes et d’excavations propres aux embuscades, soit les petites baies et les criques, où les corsaires pouvaient faire des descentes durant la nuit. C’est dans cette milice intérieure que Xénophon fit ses premières armes. A vingt ans, incorporé dans les troupes de la république, il assiste au combat livré sous les murs de Délium. Le général athénien Hippocrate s’était emparé de cette place et retranché dans le temple d’Apollon converti en forteresse. L’armée thébaine vient y attaquer les Athéniens, qui sont défaits dans une sortie et perdent mille hoplites. La déroute est générale. Xénophon, dont le cheval a été tué, gît blessé par terre. Socrate l’aperçoit, le prend sur ses épaules, le porte pendant plusieurs stades, jusqu’à ce qu’ils soient hors de l’atteinte des ennemis, et sauve ainsi la vie de l’élève, dont la reconnaissance devait nous conserver de son maître un portrait immortel. Moins heureux dans un autre combat, s’il faut en croire quelques biographes, il fut fait prisonnier par les Béotiens, et reçut alors, dit Philostrate, des leçons du sophiste Prodicus de Céos. Rendu à la liberté, il fréquenta, suivant Photius, l’école du rhéteur Isocrate, et fit, selon Athénée, un voyage en Sicile, à la cour de Denys l’Ancien. Mais ce qui paraît plus certain, c’est qu’il servit dans plusieurs campagnes de la guerre du Péloponnèse, où se forma son iv expérience militaire. On peut croire également qu’il composa, vers cette époque, quelques-uns de ses premiers écrits, tels que le Banquet, Hiéron, et notamment les Revenus, que la critique allemande a raison d’attribuer, selon nous, à la jeunesse de notre auteur. C’est encore vers le même temps qu’il publia, suivant Diogène de Laërte, l’ouvrage de Thucydide, la Guerre du Péloponnèse, qu’il ne tenait qu’à lui de supprimer. Il faut savoir gré, j’en conviens, à Xénophon de cet acte de probité littéraire; mais le fait est loin d’être fondé sur des preuves authentiques, et, sans les énumérer toutes, il semble bien difficile à croire qu’il n’existât qu’une seule copie du manuscrit de Thucydide. Peut-être serait-il plus vraisemblable que les héritiers de Thucydide, ou Thucydide lui-même, à son lit de mort, eût fait remettre son œuvre à Xénophon, comme un legs qu’il lui laissait le soin de corriger, d’achever et de publier. Mais alors même, quoique l’acte de Xénophon soit tout entier à son honneur, on se demande si c’est louer dignement un homme, que de le féliciter de ne s’être pas rendu coupable d’un odieux abus de confiance. A l’école de Socrate, Xénophon s’était lié d’amitié avec un jeune Béotien, nommé Proxène, disciple du rhéteur Gorgias de Léontium et fort avant dans les bonnes grâces de Cyrus le jeune, fils du roi de Perse Darius II, surnommé Nothus. Proxène, qui était alors à la cour de Sardes, écrit à son ami, pour l’inviter à venir partager la faveur de Cyrus. La perspective d’un voyage en Orient, les promesses séduisantes d’une vie d’agitation et d’aventures, faite pour sourire à un esprit et à un corps amis du mouvement et de l’activité, peut-être aussi le dégoût que lui inspirent les rivalités jalouses et sanglantes des républiques de la Grèce, déterminent Xénophon à se rendre à l’appel de Proxène. Aussi ne demande-t-il conseil à Socrate qu’avec le projet bien arrêté d’aller en Asie. Socrate, craignant que Xénophon ne se rende suspect aux Athéniens, en se liant avec Cyrus, qui avait aidé les Lacédémoniens dans leur guerre contre Athènes, engage son ami à con- v sulter l’oracle de Delphes. Xénophon obéit ; mais, au lieu de s’enquérir s’il doit, ou non, embrasser la cause de Cyrus, il ne consulte le dieu que sur les moyens d’accomplir son voyage. Socrate, tout en le blâmant un peu de ce subterfuge, lui conseille de partir, et Xénophon va rejoindre Proxène, qui le présente à Gyrus, dont il gagne la confiance et l’amitié. On peut lire dans l’Expédition de Cyrus le récit des faits qui se passent en Asie durant le séjour de Xénophon, la lutte de Gyrus le jeune et de son frère Artaxerxés ; la marche de l’armée perse et des quinze mille volontaires grecs à travers la Phrygie, la Lycaonie et la Cilicie ; la bataille de Cunaxa ; les perfidies de Tissapherne ; l’énergie et l’héroïsme de Xénophon, élu général après le meurtre de Cléarque et des autres stratèges ; les épisodes émouvants de la retraite des Dix mille; enfin le retour presque inespéré des Grecs dans leur patrie. Quand Xénophon revient à Athènes, il n’y trouve plus son maître bien-aimé : les accusateurs du grand philosophe ont triomphé : Socrate a bu la ciguë. Xénophon s’élève de toute la force de son dévouement et de son indignation contre cette sentence inique. Il écrit l’Apologie et les Mémoires, protestation éloquente de la justice et de l’affection en faveur de la vertu persécutée parla jalousie et parle mensonge. Mais si cette courageuse défense fait honneur au caractère noble et généreux de Xénophon devant la postérité, elle le rend suspect à ses concitoyens. Gomme le craignait Socrate, l’amitié dont l’avait honoré Cyrus ne fait qu’irriter contre lui l’esprit inquiet et défiant des Athéniens, alliés du roi Artaxerxés, et, en dernier lieu, sa liaison étroite avec Agésilas, roi de Sparte, achève de le perdre. On l’accuse de laconisme, c’est-à-dire d’attachement à Lacédémone, et on le condamne à l’exil. Et de fait, il n’est point étonnant que Xénophon, cœur droit, nature loyale et franche, ait été pris de dégoût à la vue des déportements de la démagogie athénienne, et que, fidèle aux doctrines de Socrate, il se soit montré plus prêt, avec ses amis à voir la véritable cité grecque dans l’aristocratie vi guerrière et disciplinée de Sparte, que dans sa propre ville, si divisée, si effrénée, si turbulente. Il part, emmenant avec lui sa femme Philésia et ses deux jeunes enfants, Gryllus et Diodore, auxquels leur tendresse fraternelle avait fait donner le surnom de Dioscures, passe quelque temps auprès d’Agésilas, que la guerre contre les Thébains avait rappelé en Grèce, assiste à la bataille de Coronée, accompagne Agésilas à Sparte, et se fixe définitivement à Scillonte, où les Lacédémoniens lui font présent, avec le droit de proxénie, d’un domaine considérable. Scillonte était une petite ville, à vingt stades d’Olympie, et l’habitation de Xénophon était faite pour plaire à un ami de la vie rustique, ainsi que des travaux et des exercices champêtres. Voici, du reste, le tableau gracieux qu’en a tracé, d’après Xénophon lui-même, l’auteur du Voyage d’Anacharsis : « Auprès du temple consacré à Diane, s’élève un verger qui donne diverses espèces de fruits. Le Sélinus, petite rivière abondante en poisson, promène avec lenteur ses eaux limpides au pied d’une riche colline, à travers des prairies où paissent tranquillement les animaux destinés aux sacrifices. Au dedans, au dehors de la terre sacrée, des bois distribués dans la plaine ou sur les montagnes servent de retraite aux chevreuils, aux cerfs et aux sangliers. » Tel était l’heureux séjour où vint s’abriter, contre les rigueurs de l’exil, l’âge mûr de Xénophon, et dans lequel devait s’écouler sa longue vieillesse, partagée entre les soins de la religion et le culte des dieux, les labeurs de l’intelligence, les occupations de l’agriculteur et du chasseur, les joies de la famille et les diversions de l’hospitalité. Les biographes ne sont point d’accord sur le lieu où Xénophon termina sa carrière. Selon Pausanias et Plutarque, son tombeau existait à Scillonte; mais, suivant Diogène de Laërte, les Éléens étant venus attaquer Scillonte, et la ville étant tombée en leur pouvoir, faute d’avoir été secourue à temps par les Lacédémoniens, les fils de Xénophon se sauvèrent à Lépréum, avec un petit nombre de serviteurs. Quant à lui, obligé de se cacher d’abord vii en Élide, il alla rejoindre ses enfants à Lépréum et se mit en sûreté avec eux à Corinthe. L’abbé Barthélémy concilie ces deux assertions, en supposant qu’après avoir fait un court séjour à Corinthe, Xénophon revint à Scillonte, y passa les dernières années de sa vie, et y fixa ses jours, bien que les Athéniens, sur la demande de ceux mêmes qui avaient provoqué son bannissement, l’eussent rappelé après trente ans d’exil. Parvenu à l’âge de quatre-vingt-dix ans, il mourut, après une vie dignement remplie, l’an 354 avant Jésus-Christ. Ni la numismatique ni la plastique ne nous a conservé les traits de Xénophon, et les portraits placés par quelques éditeurs en tête de ses œuvres ne sont que des figures de fantaisie. On sait pourtant par Diogène de Laërte qu’il était, comme Critias, comme Alcibiade, d’une beauté si remarquable, qu’on ne saurait trouver d’expression pour la dépeindre. De là peut-être les insinuations malveillantes d’Aristippe sur les relations de Xénophon avec Clinias. Les documents précis nous font défaut pour démontrer la fausseté calomnieuse de cette imputation ; mais, si l’induction est permise dans une matière aussi délicate, les œuvres de Xénophon ne nous offrent-elles pas de nombreux passages qui témoignent hautement de la pureté de ses mœurs? et n’est-on pas en droit d’affirmer que la beauté physique, dont il était un des types privilégiés, n’était que le reflet de la beauté morale qui rayonne dans ses ouvrages ? Des deux fils de Xénophon, Gryllus et Diodore, le dernier seul survécut à son père. Élevés à Sparte, ou tout au moins soumis à l’éducation Spartiate, ils prirent part à l’expédition contre les Thébains, qui se termina par la bataille de Mantinée. Diodore revint sans avoir rien fait de remarquable ; mais Gryllus, qui servait dans la cavalerie, mourut glorieusement, après avoir blessé Épaminondas. On dit qu’au moment où l’on vint annoncer à Xénophon Ja mort de sort fils, il faisait un sacrifice, une couronne sur la tête. A cette nouvelle, il ôte sa couronne, en signe de deuil; mais il la reprend quand on lui dit que viii Gryllus est mort avec gloire. On prétend aussi qu’il ne versa pas une larme, et se contenta de dire : « Je savais que mon fils était mortel. » Résignation héroïque, soumission touchante aux décrets de la Providence, pressentiment de cette obéissance chrétienne, qui dit avec Job . « Dieu me l’a donné, Dieu me l’a ôté: que son saint nom soit béni ! » Telle est la vie de Xénophon. C’était, comme le fait observer Diogène de Laërte, un homme remarquable à tous égards : grand amateur de chevaux, passionné pour la chasse, habile tacticien, rempli de piété, sacrificateur zélé, versé dans la connaissance des choses saintes, scrupuleux imitateur de Socrate. Un examen approfondi de ses ouvrages va nous faire connaître encore plus intimement l’écrivain d’élite qui, par un don rare et précieux de la nature, eut, sans parler de son talent d’orateur, de publiciiste et d’économiste, la triple gloire d’être tout ensemble philosophe, général, historien. Pour procéder avec méthode dans cette revue analytique, nous distribuerons les écrits de Xénophon en cinq classes : 1° Ouvrages de philosophie morale; 2° Traités didactiques ; 3° Œuvres historiques ; 4° Opuscules politiques et économiques ; 5° Lettres ; et nous en examinerons successivement chaque division. I Les cinq ouvrages philosophiques de Xénophon sont les Mémoires sur Socrate, de l’Économie, l’Apologie de Socrate, le Banquet et Hiéron. On pourrait y joindre l’Éducation de Cyrus ou Cyropédie; mais, comme le cadre général et quelques-uns des personnages sont historiques, nous en parlerons en son lieu. Les quatre premiers de ces ouvrages sont exclusivement consacrés au récit de différents traits de la vie de Socrate et à l’exposé de ses doctrines : c’est Socrate reproduit au ix vif par un crayon fidèle, qu’anime une admiration sincère, une affection filiale et dévouée. Tandis que Platon, entraîné par la force irrésistible de son génie, emporte la pensée de son maître vers ces hauteurs célestes, d’où Cicéron félicitait Socrate d’avoir fait descendre la philosophie, Xénophon se contente de le suivre dans des régions plus voisines de la terre, plus accessibles à l’humanité. Platon, si je puis parler ainsi, part de Socrate pour s’élever à l’idéal : l’idéal de Xénophon, c’est Socrate lui-même. Aussi, comme il s’étudie à rendre non-seulement les contours généraux, mais encore les linéaments les plus fins, les lignes les plus déliées de cette physionomie souriante, parfois railleuse, où s’épanouit, en dépit de la laideur, l’enjouement aimable du bon sens et l’inaltérable sérénité d’une bonne conscience ! Ce n’est pas le philosophe que nous voyons, c’est l’homme : il vit, il parle, mais, avant tout, il instruit : nul autre soin ne l’occupe ni ne le détourne : son enseignement fait partie de son existence; il dirige, il corrige, il éclaire, il réforme ; le juste, le vrai, la perfection morale, telle qu’il est donné à l’homme de la poursuivre et de l’atteindre ici- bas, voilà le fond de toutes ses pensées, la matière de tous ses entretiens. Jamais il ne se perd dans les profondeurs do la métaphysique; jamais il ne se laisse ravir aux séductions d’une imagination brillante : non qu’il dédaigne la poésie avec son cortège d’ingénieuses fictions et son harmonieux langage ; mais ce ne sont point les ailes du poète qu’il envie et qu’il emprunte : le vers n’est à ses yeux qu’une forme plus arrêtée, qu’une expression plus puissante de la vérité morale. En général, il ne demande à Homère que des sentences, et il cite de préférence Selon et Théognis. Ainsi, la véritable vocation de Socrate, c’est l’instruction de ses semblables. Déclaré le plus sage des hommes par l’oracle de Delphes, il ne garde point, comme un avare, ses trésors de sagesse et de raison ; il les répand au dehors ; il communique à tous les découvertes psychologiques, les règles de bien vivre que lui suggère l’habitude constante x de la méditation, ou que lui révèle cette vue spontanée de la conscience, cette sorte d’intuition mystérieuse, qu’on appelle son démon familier. L’enseignement de Socrate se trouvant donc tourné vers un but éminemment pratique, on ne doit point s’étonner des procédés didactiques qu’il emploie. Bien qu’il n’échappe pas toujours au reproche de subtilité, et qu’il tombe parfois dans les distinctions raffinées qu’il combattait à outrance chez les sophistes, son système, ou plutôt sa méthode, arme future de Ramus et de Descartes pour attaquer la scolastique, est toute d’expérience et d’application. Pour lui la théorie ne cesse jamais d’être subordonnée aux exigences impérieuses de l’action et de la vie quotidienne. Aussi n’écrit-il rien : il cause, il discute en plein air, sur l’agora, dans les palestres, sous les portiques, dans l’atelier du peintre Parrhasius, du statuaire Cliton, de l’armurier Pistias, dans l’échoppe du cordonnier Simon, et jusque dans le boudoir d’une courtisane : admirables entretiens, inimitables causeries où se déploient cette abondance de parole vive, animée, pleine de laisser-aller et de raison, cette finesse de raillerie, cette élégance de manières, cette urbanité délicate que les anciens avaient appelée atticisme, comme un fruit naturel du seul terroir d’Athènes. Mais ne croyons point que, sous ces dehors d’une conversation abandonnée et familière, il ne se cache un enseignement fécond et solide. Socrate ne pratique point pour lui seul la maxime inscrite en lettres d’or sur le temple d’Apollon : « Connais-toi toi-même! » Accoucheur des esprits, suivant sa propre parole, son expérience se plaît à leur venir en aide dans l’enfantement de leurs pensées, et il les initie a la découverte et à la production logique et suivie de ces vérités, dont tous les hommes ont en eux le germe, et que la plupart sont si malhabiles à dégager des ténèbres de leur intelligence. Il éveille, en quelque manière, les idées assoupies de son interlocuteur; il affecte d’être ignorant comme lui, pour le faire remonter par degrés à des principes certains, à des notions nécessaires et évidentes ; il fait naître le doute dans son âme, xi mais pour relever ensuite ses défaillances et fixer ses irrésolutions. Partant presque toujours des idées les plus vulgaires, il procède par questions successives, affirmant qu’il ne sait rien, suppliant celui qu’il interroge de lui apprendre ce qu’il ignore, et arrivant par cette méthode, qui a reçu le nom d’ironie socratique, non-seulement a faire penser ses élèves, mais à les conduire par la réflexion à l’intelligence et à la pratique du vrai, du juste et du bien. Faire sortir le général du particulier, l’abstrait du concret, en empruntant ses comparaisons et ses images à la vie réelle, à l’ordre des faits et des idées le plus voisin des habitudes communes, tirer des suggestions de la conscience les idées qui y sont virtuellement contenues ; mais, avant tout, apprendre à l’homme à se connaître pour devenir meilleur; subordonner les sciences, l’observation de la nature et de ses phénomènes, les arts eux-mêmes, au perfectionnement moral de l’humanité, voilà la doctrine appliquée de Socrate, telle que nous le montre Xénophon dans ses Mémoires. Noble et vénérable figure, dont l’originalité et la grandeur, exprimées par la main respectueuse de son disciple, nous frappent plus encore lorsque nous la rapprochons des philosophes qui se sont peints eux-mêmes dans leurs écrits. Ainsi, pour n’en prendre qu’un exemple, le plus saisissant de tous, les Pensées de Marc Aurèle nous révèlent, comme les Mémoires de Xénophon, une âme belle, énergique, aussi complètement développée dans le bien que le comporte la doctrine austère de Zenon. Mais quel est le dernier terme auquel aspire l’empereur philosophe? Un seul mot l’indique : se détacher. Vivre, par conséquent, en dehors des liens de la famille, de la société; se placer le plus loin possible de ses semblables, afin que rien ne trouble la résignation calme et résolue qui convient au vrai sage; se retrancher dans sa conscience comme dans le seul asile où n’arrivent ni les passions, ni les échos d’un monde corrompu; en un mot, suivant ses propres paroles, passer le jour au milieu des hommes comme un berger xii dans sa cabane sur le haut d’une colline : c’est là le vœu de Marc Aurèle, et c’est là que le conduit, je ne dis pas seulement son stoïcisme, mais la logique même de sa vertu. De quel nom, cependant, faut-il appeler cet excès de constance qui se plaît à concentrer tout en elle, à fuir comme un obstacle, presque comme un crime, l’expansion de la tendresse, le commerce de la vie sociale, ces relations enfin que la Providence, en donnant à l’homme la volonté et la parole, lui impose, afin qu’il exerce sa raison et qu’il pratique ses devoirs? Nous n’hésitons point à dire que c’est de l’égoïsme; et, lorsque je compare Marc Aurèle à Socrate, je ne sais quelle douce sympathie m’attire vers le philosophe, dont la patience affectueuse ne se lasse point de ramener ses semblables, par le charme d’une ingénieuse conversation, aux principes communs et à l’utilité générale du bon sens et de la vertu. Telle est, en effet, la différence immense qui sépare l’auteur des Pensées et le héros des Mémoires : la vertu de Socrate, ainsi que l’ont fait observer d’éminents penseurs, résulte du développement parallèle et complet du principe matériel et du principe idéal qui fait l’essence même de l’homme ; la vertu de Marc Aurèle résulte de la prédominance du principe idéal sur le principe matériel. C’est dire assez que l’une est fondée sur la vraie connaissance de l’homme, et par conséquent utile à l’humanité, l’autre sur une pure abstraction, et par conséquent utile au seul individu. Si nous nous demandons maintenant quels sont, en les embrassant d’un coup d’œil général, les enseignements spéciaux contenus dans les Mémoires sur Socrate, il est facile de voir que Xénophon y représente son maître s’ef- forçant d’apprendre aux hommes l’art de bien vivre. Or, quel est le but que l’homme doit tout d’abord se proposer dans la vie ? C’est la recherche constante et en toutes choses de ce qui est bon et de ce qui est beau. Rien de plus simple que cette théorie, rien de plus net et de plus précis que les applications qui en dérivent, et qui sont la matière même des entretiens où Socrate exposé, avec toute la justesse de sa raison et toute la finesse de xiii son esprit, toutes les grâces de son langage, les devoirs de l’homme envers lui-même, envers ses semblables, et envers la divinité. Ici, notre philosophe démontre à Aristodème, par des raisonnements dont Cicéron, Fénelon et Bossuet n’ont pas dédaigné la valeur, l’existence de Dieu et l’action conservatrice de sa providence. Là il persifle le sophiste Antiphon, qui lui reproche sa frugalité, sa simplicité et la gratuité de ses leçons. Ailleurs, il réconcilie deux frères, Chéréphon et Chérécrate, et expose à ce dernier les avantages et les douceurs de l’amitié fraternelle. Plus loin, il engage Diodore à se faire un ami sûr, en secourant Hermogène dans la pauvreté; ou bien il explique à Aristarque comment il vaut mieux exercer un métier que d’être à charge aux siens ou de vivre dans l’oisiveté et dans la misère. S’agit-il des devoirs d’un général, il montre qu’il en sait aussi long sur ce point que les soi-disant professeurs de tactique. Faut-il former quelques-uns de ses élèves à la carrière politique, il donne des conseils de la plus haute importance et de la plus juste application à Glaucon et au jeune Périclès. Des artistes le consultent-ils sur le but, sur les procédés mêmes de leur profession, il leur indique des ressources de conception ou de mise en œuvre, auxquelles ils n’ont point songé. Enfin a-t-il à former ses disciples à la sagesse, à la tempérance, au courage, à la justice, il leur montre, par son propre exemple, comment on arrive à la perfection morale, et il leur raconte, d’après le sage Prodicus, le bel apologue d’Hercule entre le Vice et la Vertu. La conclusion de tous ces faits, c’est l’injustice de la condamnation de Socrate et la fausseté des deux chefs d’accusation formulés contre lui. Gar, en premier lieu, loin d’avoir négligé les dieux d’Athènes, et d’avoir introduit des divinités nouvelles, il a toujours, et partout, enseigné le respect et pratiqué les cérémonies de la religion nationale ; en second lieu, bien loin de corrompre la jeunesse, il a employé tout son esprit, usé de toute son influence, consacré toute sa vie à la rendre meilleure, dévouée à son pays et instruite à faire le bien. xiv Tel nous apparaît Socrate dans les Mémoires de Xénophon, si pieux, comme le dit notre auteur, qu’il ne fait rien sans l’assentiment des dieux ; si juste, qu’il ne causa jamais le moindre tort à personne, et qu’il rendit les plus grands services à ceux qui le fréquentaient ; si tempérant, qu’il ne préféra jamais l’agréable à l’honnête ; si prudent, qu’il ne se trompait jamais dans l’appréciation du bien et du mal ; mais suffisant à l’intelligence de toutes ces notions, capable de les expliquer et de les définir, habile à juger les gens, à les tourner sans cesse vers le bien; en un mot, suivant le jugement de Herder, » digne par sa méthode, par ses mœurs, par la culture morale qu’il se donna et qu’il ne cessa d’appliquer aux autres, plus que tout cela par l’exemple de sa mort, de servir à jamais de modèle au genre humain. » Le traité de l’Économie fait suite aux Mémoires: c’est encore une série de dialogues où Socrate joue le principal personnage. On peut diviser ce traité en deux parties. Dans la première, Socrate discourt avec Critobule sur les principes de l’économie, qu’il définit l’art de bien gouverner sa maison. Seulement, il ne borne pas le sens du mot maison à celui d’habitation où l’on réside : il a grand soin de faire observer que la maison comprend ce qu’on possède au dedans ou au dehors de l’habitation. De la sorte, tout ce qu’on peut avoir, y compris même ses ennemis, suivant la fine remarque de Socrate, compose un ensemble de valeurs, dont le bon économe doit tirer parti. Or, pour que l’exploitation du fonds soit parfaite et fructueuse, la qualité essentielle du bon économe, c’est l’ordre, sous toutes ses formes, dans toutes ses applications. Et d’abord, il ne faut dans le chef de la maison, ni dans la maison même, rien d’inutile, rien qui ne tourne au bien commun : par conséquent, ni passions qui tyrannisent le cœur, ni maîtresses qui détruisent à la fois la santé et l’âme, ni même argent, si l’on ne sait pas s’en servir. Avec les mêmes biens, avec les mêmes ressources, deux hommes peuvent arriver l’un a la fortune, l’autre à la ruine : toute la différence est dans la gestion. Mais la ges- xv tion, qu’est-ce autre chose que l’ordre qui raisonne, qui combine et qui agit, soit par le chef lui-même, soit par un auxiliaire intelligent et dévoué? Et quel est l’auxiliaire naturel du chef de maison, sinon la femme? D’où celte réflexion de Socrate, toujours vraie, toujours actuelle, après plus de deux mille ans écoulés : « Je pense qu’une bonne maîtresse de maison est tout à fait de moitié avec le mari pour le bien commun. C’est le mari le plus souvent qui, par son activité, fait entrer le bien dans le ménage, et c’est la femme qui, presque toujours, est chargée de l’employer aux dépenses : si l’emploi est bien fait, la maison prospère ; l’est-il mal, elle tombe en décadence. » Mais où s’exercent particulièrement ces vertus du père et de la mère de famille ? En quel endroit règne vraiment l’économie? Où peut-elle, si l’on peut dire, s’épanouir dans- sa fleur et dans sa liberté? A la campagne, loin du tumulte, du luxe et de la dépravation des villes, au sein de cette vie agricole, de ces labeurs rustiques, où l’âme se trempe plus vigoureusement, où le cœur conserve mieux sa candeur primitive, sous la double influence du ciel ouvert et du travail continu. Quelles ravissantes peintures, quelles fraîches images Xénophon fait alors passer sous nos yeux ! Comme on voit qu’il a savouré le bonheur calme et pur de cette existence champêtre, où s’est écoulée sa jeunesse, et dans laquelle, après une vie d’aventures et de déboires, sa vieillesse devait retrouver la douceur d’un long repos. « Est-il, dit Socrate avec un sentiment d’estime que Rousseau reproduit dans son Emile, est-il un art qui, mieux que l’agriculture, rende apte à courir, à lancer, à sauter ; qui paye d’un plus grand retour ceux qui l’exercent ; qui offre plus de charmes à ceux qui s’y livrent ; qui tende plus généreusement les bras à qui vient lui demander ce qu’il lui faut ; qui fasse à ses hôtes un accueil plus généreux? En hiver, où trouver mieux un bon feu contre le froid ou pour les étuves qu’à la campagne ? En été, où chercher une eau, une brise, un ombrage plus frais qu’aux champs? Quel art offre à la divinité des prémices plus dignes d’elle, ou célèbre des fêtes xvi plus splendides ? En est-il qui soit plus agréable aux serviteurs, plus délicieux pour l’époux, plus désirable pour les enfants, plus libéral pour les amis ? Ce n’est pas tout : la terre enseigne d’elle-même la justice à ceux qui sont en état de l’apprendre, car ceux qui s’appliquent le plus à la cultiver, elle leur rend le plus de bienfaits. On a dit une grande vérité, que l’agriculture est la mère et la nourrice des autres arts : dès que l’agriculture va bien, tous les autres arts fleurissent avec elle ; mais partout où la terre demeure en friche, tous les autres arts s’éteignent et sur terre et sur mer. «Quelle grâce ingénue dans ce tableau, et aussi pour dernier trait quelle réflexion sensée, pratique, d’une éternelle vérité ! C’est le mot profond d’un homme d’État, de Sully, terminant une description dont se sont inspirés l’esprit de Cicéron et la muse de Virgile. La seconde partie du traité de l’Économie se compose de l’entretien de Socrate avec Ischomachus, surnommé le beau et le bon, et il en raconte les divers incidents à Critobule, afin de confirmer par l’exemple ce qu’ils ont établi en théorie. C’est, sans contredit, l’un des morceaux les plus remarquables de l’antiquité. Nulle part la morale païenne ne- s’est élevée à une pureté et à une délicatesse de sentiments aussi ravissante, et tout ensemble à des prescriptions aussi nettes, aussi précises sur les devoirs respectifs de l’homme et de la femme, associés par une vue spéciale de la Providence pour l’accomplissement de ses desseins : nulle part l’union conjugale bénie par les dieux, comme germe de la société civile, n’a été considérée avec plus de justesse et de respect, sous le double rapport de l’utilité et de la sainteté du lien. On croit entendre, en lisant le discours d’Ischomachus à sa jeune femme, quelqu’une de ces allocutions à la fois graves et touchantes, que les ministres de la religion adressent à des époux chrétiens : c’est la raison parée de toutes les grâces de la sensibilité et de la tendresse. Remarquons avec quelle convenance exquise les conseils d’Ischomachus, les leçons un peu sévères du chef de famille ne commencent à se faire entendre que quand une douce familiarité, une inti- xvii mité chaste et confiante s’est établie entre lui et sa femme. Il craindrait d’effrayer, en lui plaçant trop tôt sous les yeux l’étendue et la variété de ses devoirs, cette nature timide encore et sans expérience. Mais dès qu’il la voit prête à bien apprendre ce qui peut le mieux assurer leur bonheur commun, il offre un sacrifice aux dieux, prie le ciel de lui accorder la faveur de bien l’instruire, et trace un tableau attrayant et fidèle des fonctions respectives de l’épouse et de l’époux. Et d’abord, ce qui frappe le plus dans cette peinture, c’est de voir Xénophon établir entre eux une égalité complète. A ses yeux, la femme n’est point la première esclave de l’homme, elle en est la compagne : « Dès aujourd’hui, lui dit Ischomachus, cette maison nous est commune; tout ce que j’ai, je le mets en commun, et toi, tu as déjà mis en commun tout ce que tu as apporté. Il ne s’agit plus de compter lequel de nous deux a fourni plus que l’autre, mais il faut bien se pénétrer de ceci, c’est que celui de nous deux qui gérera le mieux le bien commun, fera l’apport le plus précieux. * Cependant, comme l’égalité n’exclut en rien la diversité de la fonction et de la tâche, chacun des deux époux a ses occupations nettement tracées et définies. A l’homme le travail du dehors, la vie en plein air, le défrichement, les semailles, les plantations, l’élève des troupeaux, la surveillance des esclaves. A la femme, le travail du dedans, la vie intérieure, la garde des provisions, la préparation des laines, le tissage des habits, la nourriture et l’éducation des enfants. C’est la mère abeille, présidant à la confection des cellules, veillant à ce que la construction en soit régulière et prompte, prenant soin des essaims qui viennent d’éclore, ou, quand les petites abeilles sont une fois élevées et capables de travailler à leur tour, envoyant en colonie avec un chef toute cette jeune postérité. Mais ce qui n’est pas moins digne de remarque, c’est que l’auteur grec, en plaçant ainsi les époux sur un pied d’égalité parfaite devant le travail et les devoirs qui leur incombent à tous deux, ne se contente pas d’assigner k leur association un but d’utilité, une idée xviii d’intérêt. L’utilité, l’intérêt, ne sont-ils pas les ressorts les plus mobiles des relations humaines? Le caprice, la passion un avantage plus direct ou plus puissant suffisent à les briser ou à les transposer. Xénophon va donc plus loin, il voit plus haut. «La loi, dit Ischomachus, ratifie l’intention qu’ont eue les dieux en unissant l’homme et la femme. Comme la nature d’aucun d’eux n’est parfaite en tout point, cela fait qu’ils ont besoin l’un de l’autre, et leur union est d’autant plus utile que ce qui manque à l’un, l’autre peut le suppléer. Mais si la divinité les associe en vue des enfants, la loi les associe en vue du ménage. C’est elle qui déclare honnête tout ce qui résulte des facultés accordées par le ciel à l’un et à l’autre ; et si l’un ou l’autre agit contrairement aux desseins de la divinité, ce désordre n’échappe point aux regards des dieux, qui punissent la négligence et l’infraction aux devoirs. » La divinité, la loi, tels sont aux yeux de Xénophon les garants immuables de l’union conjugale, telles sont encore de nos jours les sauvegardes de notre mariage civil et religieux. Aussi, quelle heureuse perspective pour les époux qui, en rivalisant de zèle et de courage, observent fidèlement la loi et se conforment respectueusement à la volonté du ciel ! Quel espoir semble étendre son sourire sur toute leur existence! Ils vieillissent, mais ni leur tendresse ni leur estime réciproque ne s’altèrent : l’homme même s’incline avec une sorte de vénération devant la mère de ses enfants, devant la maîtresse de maison, dont le soin et la vigilance ont conservé, accru sa richesse. « Le charme le plus doux, lui dit Ischomachus, ce sera lorsque, devenue meilleure que moi, tu m’auras rendu ton serviteur ; quand, loin de craindre que l’âge, en arrivant, ne te fasse perdre de ta considération dans ton ménage, tu auras l’assurance qu’en vieillissant tu deviens pour moi une compagne meilleure encore, pour tes enfants une meilleure ménagère et pour ta maison une maîtresse plus honorée. Car la beauté et la bonté ne dépendent point de la jeunesse : ce sont les vertus qui les font croître dans la vie aux yeux des hommes. » xix De ces idées générales, de ces leçons, dont la sagesse s’applique à la gestion commune du ménage, Xénophon passe aux détails, qui en assurent l’exécution et le succès. Or, la règle essentielle des chefs de la famille, la qualité qui domine et qui dirige l’emploi de toutes les autres, c’est toujours l’ordre. Aussi voyons-nous Ischomachus insister longuement sur la distribution méthodique et régulière de tous les objets et ustensiles de la maison, sur la place qui doit leur être affectée, et multiplier les comparaisons les plus vives, les images les plus frappantes, pour graver dans l’esprit de sa jeune femme la nécessité d’une organisation systématique et permanente. * Rien n’est plus beau, dit-il entre autres choses, rien n’est plus utile pour l’homme que l’ordre. Un chœur est une réunion d’hommes. Que chacun prétende y faire ce qu’il lui plaît, quelle confusion ! quel spectacle désagréable ! Mais si tous exécutent avec ensemble les mouvements et les chants, quel charme pour les yeux et pour les oreilles ! » Une fois la maison organisée, les deux époux s’y livrent chacun aux occupations qui leur sont propres. Et comme il faut avant tout, que la femme se montre moleste dans son extérieur et simple dans ses vêtements, Ischomachus, trouvant un jour la sienne couverte de céruse afin de paraître plus blanche, et de rouge pour se donner un faux incarnat, avec des chaussures élevées afin d’ajouter à sa taille, lui fait observer que tout cet artifice, toute cette enluminure ne fait que la rendre laide, et que le meilleur moyen non-seulement de paraître, mais d’être vraiment belle, c’est de vaquer aux soins domestiques et aux devoirs de la maternité. Quant aux fonctions qui sont plus spécialement dans les attributs de l’époux, Ischomachus s’étend, avec une f certaine complaisance et en homme expérimenté, sur les diverses occupations et les exercices multipliés qui remplissent ses journées; promenades et visites matinales, surveillance des ouvriers, maniement du cheval, travaux et soins agricoles, éducation pratique et morale des contremaîtres; puis, passant encore des leçons générales aux xx applications et aux procédés techniques, il démontre, dans un exposé lumineux, qu’il n’y a point la moindre difficulté aux finesses qu’attribuent à l’agriculture ceux qui en dissertent merveilleusement en paroles, mais qui dans le t’ait n’y entendent rien. Cicéron, Virgile, Pline l’Ancien, Columelle, et peut-être aussi le vieux Caton, ce rude ami de la vie champêtre, sont venus tour à tour emprunter à Xénophon des idées, des observations, des conseils, pour les transmettre aux laboureurs et aux fermiers de l’Italie. Et l’on ne doit point s’étonner de voir tour à tour ces éminents esprits se faire, en quelque manière, les disciples ’jc l’économiste grec. Nous nous sommes convaincu, en consultant des agronomes distingués, que la justesse de ses remarques, la vérité constante de ses procédés industriels, peuvent être encore d’une utilité positive et immédiate aux cultivateurs de notre époque. Comparée au livre admirable de Platon, l’Apologie de Socrate de Xénophon semble froide et décolorée. On n’y trouve qu’un léger souvenir, une image lointaine de cette ironie vive, amère, mais toujours contenue, dont Platon arme la défense éloquente de son maître. L’Apologie de Platon, ainsi que le fait remarquer Denys d’Halicarnasse dans sa Rhétorique, se divise en trois parties distinctes, qui forment comme les trois actes de ce dramatique monologue. Suivant l’ordre usité dans les jugements athéniens, la première partie contient la réfutation que Socrate oppose à ses accusateurs; dans la seconde, reconnu coupable par les juges, il discute la peine qui doit lui être infligée; dans la troisième, condamné à mort, il expose ses idées sur le passage de l’âme à une vie meilleure. L’Apologie de Xénophon n’offre rien de semblable ; l’auteur le dit lui-même. « Je ne me suis point préoccupé de rapporter tous les détails du procès : il m’a suffi de faire voir que Socrate avait attaché la plus grande importance à démontrer qu’il n’avait jamais été impie envers les dieux, ni injuste envers les hommes, mais qu’il ne pensait pas devoir s’abaisser à des supplications pour échapper à la mort ; qu’au contraire il était persuadé, dès xxi lors, que le temps était venu de mourir. » Tout le plaidoyer de Xénophon est subordonné à cette idée. Aussi, nul déploiement d’éloquence : rien de passionné et de saisissant ; quelques paroles brèves, nettes, dédaigneuses, mais dépourvues de ce persiflage mesuré, dont Platon flagelle l’iniquité des juges de Socrate, en leur imprimant un stigmate indélébile: point de mouvements entraînants, point de traits oratoires. Par exemple, la dernière phrase de l’Apologie de Platon est un admirable résumé de toute son œuvre, une opposition noble et frappante de la situation morale de Socrate et de celle de ses juges : « Mais il est temps de nous séparer, moi, pour aller mourir, et vous, pour aller vivre : à qui de nous est réservé le meilleur sort, c’est un secret pour tous, excepté pour Dieu. » Dans Xénophon, rien de pareil. Disons pourtant que le silence même de Socrate a je ne sais quoi de digne, d’imposant, de flétrissant pour ses ennemis. «Après avoir ainsi parlé, il sortit sans que rien en lui démentît son langage ; ses yeux, son attitude, sa démarche, conservant la môme sérénité. » Cette majesté, cet inaltérable sang-froid dans le maintien d’un homme déclaré coupable et frappé d’une sentence de mort, n’est-elle pas comme la condamnation vivante de ceux qui l’ont condamné ? L’intention de Xénophon, en écrivant son Banquet, est clairement exprimée par les premières lignes de ce dialogue : « Oui, selon moi, dit-il, non-seulement les actions des hommes beaux et bons sont dignes de mémoire, mais encore leurs simples amusements. » Nous avons donc sous les yeux l’esquisse finement exprimée d’une de ces conversations spirituelles, pleines de laisser-aller et de badinage, où s’abandonnait, sans arrière-pensée et sans fiel, la verve caustique et malicieuse de Socrate. Nous croyons inutile d’examiner si cet opuscule, le plus charmant et le plus ingénieux des petits traités de Xénophon, a été composé en concurrence de celui de Platon, ou si c’est Platon qui a voulu rivaliser avec notre auteur. Cette question a donné lieu, nous le savons, à d’intéressantes controverses; mais, comme la solution n’en est xxii point définitive, et que la priorité de l’un ou de l’autre écrivain n’est pas suffisamment établie, mieux vaut, selon nous, prendre l’œuvre telle qu’elle est, et la juger sans comparaison. Voyons d’abord quel est le cadre de ce tableau, dessiné par un témoin qui semble encore sous le charme de ce qu’il vient de voir et d’entendre. C’est la salle à manger de Callias, fils d’Hipponicus, un des plus riches citoyens d’Athènes. Quant aux personnages qui figurent en scène, c’est, avant tous les autres, le jeune Autolycus, fils de Lycon, qui vient de remporter le prix du pancrace et dont Callias est vivement épris ; puis Socrate, Critobule, Hermogène, Nicératus, Charmide et le célèbre Antisthène, le fondateur de la secte cynique. L’occasion du banquet est toute naturelle : Callias a conduit Autolycus au spectacle d’une course de chevaux, et il donne ensuite un grand repas pour fêter son ami et pour régaler ses intimes. Le commencement du festin est froid, guindé. Autolycus est si beau, que la contemplation de ses traits semble absorber toutes les facultés des convives, et qu’ils sont comme muets de ravissement. L’arrivée du bouffon Philippe fait une sorte de diversion joyeuse à ce début glacial. Ses plaisanteries, d’abord impuissantes, finissent par dérider les visages. On retire les tables, on fait les libations, on chante le péan, et l’entrée d’un Syracusain, suivi d’une excellente joueuse de flûte, d’une "danseuse merveilleuse pour ces tours, d’un garçon fort joli, jouant de la cithare et dansant à ravir, enlève décidément les esprits et les tourne à la joie. Socrate, le verre en main, est le premier à provoquer ses amis : « Buvons, dit-il, c’est mon sentiment. Le vin, en arrosant nos esprits, endort les chagrins, comme la mandragore assoupit les hommes; quanta la joie, il l’éveille comme l’huile la flamme. Selon moi, le corps de l’homme éprouve ce qui arrive aux végétaux dans la terre. Si la divinité arrose trop les semences, elles ne peuvent lever ni se prêter au souffle de la brise ; si elles ont juste de quoi boire, elles lèvent, se développent, fleurissent et arrivent à point. De même, si nous buvons trop xxiii d’un coup, bientôt notre corps et notre âme chancellent, et nous perdons haleine; mais si nos esclaves nous versent souvent dans de petites coupes, le vin ne nous inspire pas la violence de l’ivresse, et nous descendons aux douceurs de l’enjouement. » Aimable épicurisme de buveurs, leçon de modération dans le plaisir même, dont se souvient Horace, et que n’a point oubliée Béranger ! Lancée sur cette pente de l’esprit et du rire, la conversation s’engage vive, rapide, et surtout paradoxale, comme il convient après boire. Ainsi Callias se croit le talent de rendre les hommes meilleurs; Nicératus se vante de savoir par cœur l’Iliade tout entière,- ainsi que l’Odyssée; Critobule est fier de sa beauté ; Antisthène, de sa richesse; Charmide, de sa pauvreté; Hermogène, du nombre et de la constance de ses amis; Lycon, de son fils : Philippe loue sa profession de bouffon, et le Syracusain la sottise humaine, qui le fait vivre de ses marionnettes. Mais le plus singulier paradoxe, c’est celui de Socrate, qui, se faisant un visage plein de gravité, dit à Callias que le métier dont il tire sa gloire est celui d’entremetteur. Aussi, malgré tout ce qu’il y a de gracieux et de charmant dans les raisonnements que produit chaque convive pour soutenir son opinion, propos semés d’interruptions piquantes, de digressions où pétille le sel attique, il n’est personne qui ne soit curieux de voir comment Socrate se tirera du pas étrange où il s’est engagé. On devine sans peine qu’il en sort à sa louange, et que le gros mot dont a usé sa moquerie masquait la profession généreuse, utile et chaste, où s’est employée toute sa vie, qui fut d’unir entre eux les hommes par les liens d’une sympathie née d’une estime réciproque et du sentiment de leurs devoirs. La discussion, qui s’établit ensuite entre Critobule et Socrate, n’a pas seulement le mérite de fixer nettement la théorie judicieuse de l’école socratique en matière de beauté, elle nous aide à reconstruire, parla réunion des traits épars qu’elle nous présentera physionomie, d’ailleurs si populaire, du grand philosophe. Nous trouvons là ses yeux à fleur de tête, son regard de taureau, pour parler avec Rabelais xxiv son nez camus, ses lèvres épaisses, sa bouche énorme, sa tête chauve, tout le masque enfin des Silènes, auxquels Alcibiade le compare également dans le Banquet de Platon. De la question relative à la beauté physique le chemin est facile à une discussion sur l’amour : nos convives s’y laissent entraîner sans peine, et nous entendons Socrate exposer des idées tout à fait analogues à celles que Platon a placées dans la bouche de Phèdre et de Pausanias. Le fond de cette doctrine c’est que des deux Vénus, la Vénus Uranie et la Vénus Pandème, la première seule, vu sa nature céleste, est digne des belles âmes et des beaux naturels : la seconde ravale l’homme jusqu’à la brute : l’amour qu’inspire l’une, ne s’adressant qu’au corps, est bas et rampant comme un mendiant qui vous obsède ; celui qui naît de l’autre, se dirigeant par des principes de sagesse et d’honneur, ne peut avoir rien de honteux. Une scène de ballet, appropriée aux idées que la dernière matière de l’entretien a remuées dans les âmes, termine gracieusement le banquet. C’est une représentation mimique des amours d’Ariadne et de Bacchus, reproduite par Xénophon avec une vivacité et une chaleur d’expression si pénétrante, qu’elle justifie pleinement les transports passionnés de ceux qui en sont spectateurs. Nous n’ignorons pas que cette dernière partie de l’œuvre de Xénophon a été critiquée par des moralistes, dont la sévérité s’est sentie blessée par l’excessive liberté des images. Je ne prétends point me faire ici l’apologiste à outrance de l’auteur que je traduis, mais je crois devoir rappeler que la doctrine et les tableaux qu’il expose ne s’adressent qu’à des hommes faits, à des lecteurs judicieux et prudents, qui, se transportant par la pensée au milieu des idées antiques, ne s’arrêtent point à la surface des faits, niais en pénètrent le sens et en saisissent l’intention mprale. C’est ainsi que l’entend Montaigne, lorsqu’il dit : « Quant à la philosophie, en la partie où elle traicte de l’homme et de ses debvoirs et offices, c’a esté le jugement commun de touts les sages; que pour la douceur de sa conversation, elle ne debvoit estre refusée ny aux fes- xxv tins, ny aux jeux ; et Platon l’ayant invitée à son Convive, nous veoyons comme elle entretient l’assistance, d’une façon molle et accommodée au temps et au lieu, quoyque ce soit de ses plus haults discours et plus salutaires. » Et de même, à qui Racine adresse-t-il sa traduction du Banquet de Platon? A l’abbesse de Fontevrault, qui l’avait traduit la première, et qui avait prié le grand poète d’en revoir le style. Le dialogue intitulé Hiéron est un parallèle entre la vie du tyran et celle de l’homme privé. Le poète Simonide étant venu rendre visite à Hiéron l’ancien, frère de Gélon, tyran de Syracuse, ils s’entretiennent tous deux des différentes conditions de la vie ; et Simonide demandant à son hôte si, après avoir été simple particulier, il préfère, maintenant qu’il est tyran, sa condition actuelle, Hiéron lui en trace le tableau sous les couleurs les plus sombres. Au lieu des douceurs de l’amitié, il ne connaît que les défiances et les soupçons de la tyrannie : il est toujours gêné au milieu des richesses, obligé de s’appuyer sur des étrangers, de peur d’être trahi, assassiné par ses sujets. Et cependant, bien que la tyrannie soit un mal insupportable, il y a danger pour lui à s’en dessaisir. Telle est la vie d’Hiéron, tels sont les maux qui l’accablent. Simonide ne les croit point incurables ; et comme il en est dont la guérison dépend du caractère et de la volonté d’Hiéron lui-même, il lui démontre que, dans sa condition nouvelle, il peut encore être heureux, s’il tourne tous ses efforts, s’il emploie toutes ses richesses à faire le bonheur de la ville sur laquelle s’exerce son pouvoir absolu. II Les traités didactiques de Xénophon sont au nombre de trois : de l’Équitation, le Commandant de cavalerie, de la Chasse. Quoique un peu de notre propre expérience, jointe à la xxvi lecture attentive des ouvrages modernes et à la conversation des hommes versés dans ces matières, nous ait instruit du sujet propre à chacun de ces trois traités de Xénophon, nous hésitons à formuler sur ces œuvres spéciales un jugement qui semble trop décisif. Nous pouvons dire cependant qu’aux yeux des connaisseurs le traité de l’Équitation paraît, en ce moment encore, un des meilleurs écrits de ce genre. C’est un ouvrage méthodique, clair et tracé de main de maître. L’auteur y résume les principes d’un nommé Simon d’Athènes, qui avait écrit sur le même sujet, et y développe d’autres connaissances, bien supérieures à celles de son devancier. Il commence par mettre le cavalier en présence du vendeur, et, après l’avoir prévenu de se tenir sur ses gardes, il lui indique la manière de juger l’animal avec calme et précision, lui enseigne, après l’achat, l’éducation qu’il doit donner au poulain, et comment il le jugera dressé; puis il entre dans le détail des soins qu’exige le cheval et expose les devoirs du bon palefrenier. Ces premiers points expliqués, il prescrit comment on doit se mettre à cheval pour conduire l’animal avec aisance, et nous trouvons là des principes de tenue et de souplesse que d’excellents écuyers recommandent encore aujourd’hui, Quant aux moyens à employer pour partir au pas, se lancer au trot, au galop, reculer, tourner à droite, à gauche, arrêter, repartir, ils étaient considérés, dès cette époque, comme si naturels à l’homme de cheval, que Xénophon effleure à peine la théorie de ces mouvements et de ces allures. Mais comme il compte sur la pratique pour apprendre au cavalier et à son cheval tout ce qu’il faut faire, il ne leur épargne aucun exercice : gravir les montagnes, les descendre, franchir les haies et les fossés, galoper sur un terrain plat, sur un terrain inégal, afin que le cavalier apprenne par l’expérience quand il doit porter le corps en arrière ou en avant, soutenir, élever ou rendre la main qui tient les rênes. L’équitation ancienne, jugée d’après l’ouvrage de Xénophon, est donc l’enseignement que donne l’expérience, c’est-à-dire une école pratique, d’où se sont produites les xxvii premières vérités équestres qui ont guidé pendant longtemps l’école théorique, et dont une partie sert encore de nos jours. Le traité intitulé le Commandant de cavalerie est une suite toute naturelle de celui de l’Équitation. Une des grandes préoccupations de Xénophon semble avoir été d’organiser à Athènes, soit sous son commandement, soit sous les ordres de son fils Gryllus, une cavalerie bien montée, parfaitement disciplinée et en mesure de rendre de notables services à son pays. Nous savons quel’absence totale ou le mauvais état de cette milice était un des côtés faibles du système militaire des Athéniens. Tout entiers à la marine ils s’appliquaient surtout à former de bonnes troupes navales et une bonne infanterie. Xénophon, qui avait éprouvé, dans la retraite des Dix mille, l’utilité incontestable que peut offrir un corps de cavaliers convenablement équipés, n’épargna ni les conseils, ni, selon toute apparence, les moyens d’exécution, pour créer quelques escadrons d’élite, rompus au maniement du cheval et à toutes les manœuvres équestres. Après avoir insisté sur l’urgence de ce besoin dans les Revenus, dans les Mémoires et dans la Cypropédie, il stimule plus vivement encore l’attention et le zèle de ses concitoyens dans l’œuvre spéciale qui nous occupe en ce moment. Le plan et la distribution de l’ouvrage sont d’une extrême simplicité. Xénophon commence par donner une idée générale des devoirs du commandant de cavalerie, en insistant tout particulièrement sur le respect dû aux dieux; puis il enseigne comment on doit appliquer aux manœuvres militaires les principes de l’équitation et les exercices du manège. En conséquence, il traite de l’ordonnance des escadrons, des évolutions appropriées aux jours de fête et aux voltiges de l’hippodrome, des marches qu’on doit faire en temps de guerre et des divers moyens détromper l’ennemi. Sous ce rapport, il n’est pas sans intérêt de voir quelles étaient les doctrines des Grecs en matière de stratagèmes. «Rien, dit Xénophon, n’est si utile en guerre que la ruse. Les enfants eux-mêmes, quand ils jouent à xxviii pair ou non, parviennent à tromper en faisant croire qu’ils ont plus, quand ils ont moins, et moins, quand ils ont plus. Comment des hommes faits, avec de la réflexion, ne pourraient-ils pas inventer semblables ruses ? Qu’on se rappelle les succès remportés à la guerre, on verra que les plus nombreux et les plus brillants sont dus à la ruse. On ne doit donc pas se mêler de commander, ou bien, indépendamment des autres dispositions, il faut demander aux dieux le savoir-faire et inventer à votre tour. » Ces instructions données, Xénophon revient à ce qui est particulier au commandant lui-même. Il lui indique les moyens de se concilier l’affection sans compromettre son autorité, lui fait un devoir sacré du respect des dieux, de la prévoyance et de la vigilance. Et comme Athènes était alors en guerre avec Thèbes, il adresse au chef des cavaliers de sa patrie des recommandations toutes particulières, motivées par les circonstances actuelles. Après quoi, il conclut à ce que, pour porter à mille le nombre des cavaliers athéniens, on admette sur-le-champ deux cents métèques, c’est-à-dire des étrangers ayant droit de domicile, à l’exemple de Sparte, dont la cavalerie n’a commencé à se distinguer que quand elle s’est décidée à cette mesure. Une observation remarquable, qui frappe tout d’abord et dès les premiers mots de ce traité, c’est l’ordre exprès, donné et renouvelé à plusieurs reprises par Xénophon, de ne rien entreprendre sans le conseil et l’assistance des dieux. Cette pensée religieuse et naïvement sincère répand une teinte touchante sur ce livre consacré à des prescriptions techniques et à des pratiques de métier. Elle fait songer à Froissart qui, au commencement de ses Chroniques, « requiert au Sauveur de tout le monde, qui de néant créa toutes choses, qu’il veuille créer et mettre en lui sens et entendement si vertueux que ce livre par lui commencé il le puisse continuer et persévérer, » et qui, quelques lignes plus bas, invoque le secours « de Dieu et de la benoîte vierge Marie, dont tout confort et avancement viennent. » Les dernières paroles de Xénophon expliquent, du reste, fort nettement sa pensée. « Si quelqu’un s’étonne, dit-il, xxix de voir tant de fois écrits dans cet ouvrage les mots: « avec l’aide des dieux, » qu’il sache que sa surprise diminuera, s’il s’est trouvé souvent en danger, et s’il réfléchit qu’en temps de guerre on se tend réciproquement des pièges, dont on prévoit rarement l’issue. Or, en pareille occurrence, on ne peut prendre meilleur conseil de personne que des dieux. Ils savent tout et le communiquent à qui bon leur semble par l’intermédiaire des victimes, des oiseaux, des voix et des songes : seulement, il est naturel qu’ils conseillent surtout ceux qui les consultent dans le besoin sur ce qu’ils doivent faire, et qui, dans le succès, les honorent autant qu’il est possible d’honorer les dieux. » Il y a deux manières d’entendre et de pratiquer la chasse. Rousseau les a parfaitement caractérisées toutes deux dans ces lignes si vraies, si pittoresques. « Je me souviens, dit-il, des battements de cœur qu’éprouvait mon père au vol de la première perdrix, et des transports de joie avec lesquels il trouvait le lièvre qu’il avait cherché tout le jour. Oui, je soutiens que seul, avec son chien, chargé de son fusil, de son carnier, de son fourniment, de sa petite proie, il revenait le soir, rendu de fatigue et déchiré des ronces, plus content de sa journée que tous nos chasseurs de ruelle qui, sur un bon cheval, suivis de vingt fusils chargés, ne font qu’en changer, tirer et tuer autour d’eux, sans art, sans gloire, et presque sans exercice. » En d’autres termes, il y a des amateurs et des chasseurs. Xénophon était un vrai chasseur. Il avait pris son art au sérieux, il en avait étudié les procédés, les ruses, les finesses ; et ce sont ces remarques, ces observations, qu’il a consignées dans son traité. Un autre écrivain grec, Arrien, général, historien et chasseur comme Xénophon, auquel Suidas le compare et qu’il semble, en effet, avoir pris pour modèle, a écrit également un traité de chasse, qui ne manque ni d’intérêt ni de renseignements curieux ; mais Xénophon nous paraît l’emporter sur Arrien par la netteté de ses recommandations et par le charme de ses tableaux. Le plan de Xénophon est tout simple, et le poète Oppien xxx a eu raison de le suivre, dans les vers qu’il a consacrés au même sujet. Après avoir débuté par quelques mots sur l’origine de la chasse, qui, selon lui, est une invention des dieux, il fait l’éloge des héros qui s’y sont adonnés ; et il invite les jeunes gens à ne pas mépriser un exercice qui doit les rendre bons soldats. C’est une remarque qui n’a point échappé à Buffon, qui appelle également la chasse une école de la guerre. Entrant ensuite dans la partie technologique de son traité, il dit quelles doivent être les qualités physiques et morales du chasseur, et il indique les différentes espèces de filets à employer pour les diverses espèces d’animaux. Puis, comme le compagnon naturel, l’auxiliaire indispensable du chasseur est le chien, Xénophon insiste sur les deux races de chiens connues des Grecs, et il en signale les défauts et les qualités. Il trace alors un portrait fort remarquable de bon chien de chasse et enseigne les moyens d’en faire l’éducation et de le mener aux champs. Après le chien vient le gibier : de là de précieux détails sur le lièvre, sur sa complexion, ses habitudes, la chasse qu’on lui fait en été ou en hiver. C’est la partie la plus développée de tout l’ouvrage. Aussi, l’auteur glisse-t-il avec une certaine rapidité sur la chasse aux faons, aux cerfs et aux sangliers, et ne donne-t-il que quelques conseils pratiques sur celles des lions, des léopards et autres bêtes dangereuses. Les derniers chapitres du livre de Xénophon sont très- remarquables. Lorsque Rousseau, craignant pour son Émile la première fougue de la jeunesse, l’entraînement désordonné des sens, cherche à son élève « une occupation nouvelle, qui l’intéresse par sa nouveauté, qui le tienne en haleine, qui lui plaise, qui l’applique, qui l’exerce ; une occupation dont il se passionne, et à laquelle il soit tout entier, » il ne voit que la chasse qui lui paraisse réunir toutes ces conditions. C’est, de même, la chasse qui semble à Xénophon le meilleur moyen d’arracher la jeunesse de son temps à la fausse éducation des sophistes. « Nos ancêtres, dit-il, convaincus que la chasse était la source de xxxi leurs succès sur les ennemis, la firent entrer dans l’éducation de la jeunesse. Ils voyaient que c’était le seul plaisir qui procurât les plus grands biens aux jeunes gens, puisqu’il les rendait tempérants, justes, instruits de la réalité. Ils comprenaient qu’ils devaient à la chasse leurs succès militaires ; que co plaisir, bien différent des voluptés honteuses, que l’on n’a pas besoin d’apprendre, n’écarte point les jeunes gens des études honnêtes, auxquelles ils voudraient se livrer. C’est une pépinière de bons soldats, de bons généraux : car les hommes qui, par le travail, éloignent de leur âme et de leur corps la honte et la débauche et développent en eux l’amour de la vertu, ceux- là seuls sont les vrais citoyens ; ils ne tolèrent jamais une injustice faite à leur patrie, ni un dommage à leur pays. » III Les quatre œuvres historiques de Xénophon sont l’Histoire grecque, l’Expédition de Cyrus, l’Éducation de Cyrus ou Cyropédie, en tenant compte des réserves que nous avons déjà faites, et la Vie d’Agésilas. L’antiquité, tout d’une voix, s’est accordée pour louer le mérite de Xénophon comme historien, et les modernes ont souscrit à cet éloge. On ne peut douter, en effet, de la fidélité consciencieuse avec laquelle il raconte les faits qu’il a vus ou puisés à des sources dignes de foi : les témoignages de Cicéron, de Quintilien et de Lucien sont formels à cet égard. Aux yeux surtout de ce dernier, Xénophon est l’historien par excellence, à cause de la rectitude de son jugement et de la sincérité de son caractère. Cependant ce serait nier l’évidence que de ne pas convenir qu’il a parfois un sentiment d’hostilité contre Athènes, et d’inclination en faveur de Sparte, dans plusieurs parties de ses récits, notamment dans son Histoire grecque, appelée aussi Helléniques, et qui est, il faut le dire, le moins remarquable de ses travaux d’historien. xxxii Cet ouvrage, destiné à faire suite à celui de Thucydide, embrasse la période qui s’étend depuis la victoire navale des Athéniens, auprès de Cyzique, l’an 411 avant Jésus- Christ, jusqu’à la bataille de Mantinée, livrée l’an 362 : c’est un espace de près de cinquante ans. On ne trouve, dans l’exposé des faits, ni la grâce ingénue d’Hérodote, ni la vigueur, le nerf, la profondeur de Thucydide. Il semble que le talent de Xénophon, avant tout philosophe et moraliste, ait quelque chose de froid et de languissant, dès qu’il cesse de se répandre, comme Socrate, son maître, en conversations philosophiques et morales. On dirait que son feu l’abandonne, qu’il cesse de se passionner du moment qu’il n’est plus en présence de ce qui est actuel, pratique, propre à diriger et à instruire. Il lui faut la rapidité concise du dialogue ou la carrière du discours familier : il lui faut des événements auxquels il ait pris part, comme dans l’Expédition de Cyrus, ou que son imagination puisse modifier, sinon créer, à sa guise, comme dans la Cyropédie, pour que sa pensée se déploie dans toute sa franchise et toute sa liberté. C’est ainsi que nous nous expliquons l’infériorité relative des Helléniques et le silence de Xénophon sur certains faits et sur certains hommes qu’il a peut-être craint de présenter mal sur la scène de l’histoire, faute de les trouver utiles ou de les estimer. On y rencontre cependant de fort beaux passages, et nous sommes convaincus que bien des gens n’ont dit du mal des Helléniques que pour ne les avoir point lues. Je doute qu’on trouve chez Hérodote ou chez Thucydide un épisode qui émeuve plus vivement que le récit de la lutte suprême, désespérée, de Théramène contre Critias. Ce n’est pas une page de l’histoire grecque, c’est quelqu’une des scènes de notre révolution: Robespierre abandonnant Danton, pour le livrer au bourreau, Saint-Just dénonçant Camille Desmoulins, qui lui dispute chèrement sa vie. Les Trente ont inauguré dans Thèbes un régime de terreur et de sang. Théramène, quelque temps leur complice, finit par être enrayé de tant d’excès : il veut se détacher de leur parti, et il fait opposition au gouvernement xxxiii même qu’il a fondé. Alors Critias, entrant dans le conseil, suivi de ses sicaires, qui ont caché des poignards sous leur aisselle : « Citoyens conseillers, s’écrie-t-il, si quelqu’un de vous pense qu’il y a eu plus de morts que les circonstances ne l’exigeaient, qu’il songe que partout, dans les révolutions, il en est de même, et que ceux qui ont établi l’oligarchie doivent avoir nécessairement un grand nombre d’ennemis dans une ville, qui non-seulement est la plus peuplée de toutes les cités de la Grèce, mais encore dans laquelle le peuple a vécu depuis si longtemps en liberté. Pour nous, qui connaissons tout ce qu’il y a de mauvais dans la démocratie..., si nous voyons quelque part un ennemi de l’oligarchie, nous mettons tout en œuvre pour nous en débarrasser. Mais il nous parait plus juste encore que celui de nous-mêmes qui gênerait le gouvernement actuel, en porte la peine. Maintenant donc, nous nous sommes aperçus que Théramène, ici présent, cherche de son mieux à nous perdre, vous et nous. La vérité de ce que je dis, vous la reconnaîtrez en réfléchissant que personne plus que lui ne blâme ce qui se fait, et ne s’oppose à nos plans, quand nous voulons nous débarrasser de quelque démagogue. S’il avait pensé de la sorte dès le début, il serait notre ennemi ; mais du moins on aurait tort de le considérer comme un pervers. Seulement c’est lui qui le premier.... a voulu renverser la démocratie, c’est lui qui nous a le plus vivement engagés à punir les premiers accusés amenés devant vous; et maintenant que nous sommes, vous et nous, les ennemis déclarés du peuple, il n’approuve plus ce qui se fait, afin de se mettre lui-même à l’abri et de nous laisser responsables de ce qui s’est passé. » Critias énumère alors les griefs que ses collègues et lui sont en droit de reprocher à Théramène, dont il flétrit la versatilité, en lui jetant à la face son surnom de Cothurne; puis, revenant sur les nécessités sanglantes du gouvernement oligarchique: «Certainement, dit-il, toutes les révolutions sont meurtrières, et toi-même, Théramène, par ta facilité à changer de parti, tu t’es rendu complice de la xxxiv mort de la plupart des oligarques immolés par le peuple, et d’un plus grand nombre de démocrates condamnés par l’aristocratie.... Un, homme que nous voyons uniquement occupé à satisfaire son ambition, sans se soucier de l’honneur ni de ses amis, comment pourriez-vous l’épargner?... S’il échappe, il augmentera le nombre et l’audace de vos adversaires; tandis que, s’il périt, tous ceux qui sont dans la ville ou au dehors verront trancher leurs espérances. » Cette attaque, si directe, si brusque, ne trouve pas Thé- ramène au dépourvu. Rompu à toutes les souplesses de la vie diplomatique, aussi bien qu’aux luttes de la tribune, il s’apprête à défendre énergiquement sa vie, discute avec une grande habileté toutes les charges entassées contre lui par son accusateur, et s’étudie à faire retomber sur Critias tout l’odieux du redoutable système qu’il a pratiqué jadis, mais que maintenant il répudie; puis, arrivant aux questions toutes personnelles : « Tu m’appelles Cothurne, s’é- crie-t-il, sous prétexte que j’essaye de m’ajuster aux deux partis; mais celui qui ne s’attache à aucun, celui-là, au nom des dieux, comment faut-il l’appeler? Or, sous la démocratie, on te regardait comme le plus grand ennemi du peuple; et maintenant, sous l’aristocratie, tu es devenu le plus terrible adversaire des honnêtes gens. Quant à moi, Critias, je fais une guerre continuelle à ceux qui croient que la démocratie n’est vraiment bonne que quand les esclaves et ceux qui, par pauvreté, vendraient l’État pour une drachme, prennent part au pouvoir, et je combats sans relâche ceux qui croient qu’il ne peut y avoir d’oligarchie véritablement bonne que quand ils voient la ville soumise à la tyrannie d’un petit nombre.... Si tu peux dire, Critias, quand tu m’as vu, soit avec le peuple, soit avec la tyrannie, essayer d’enlever le gouvernement aux honnêtes gens, parle; car si j’étais convaincu, soit de méditer aujourd’hui ce crime, soit de l’avoir accompli jadis, je conviens que je mérite de perdre la vie dans les derniers supplices. » Ces paroles, pleines d’adresse et de vigueur, font effet sur le conseil. Critias, craignant que Théramène ne soit xxxv absous, si l’on délibère, s’avance, confère un instant avec les Trente, sort et ordonne aux gens armés de poignards de venir se placer en face du conseil, auprès des barres ; puis il rentre et dit : « Pour moi, conseillers, je crois que le devoir d’un bon président est de ne pas permettre que ses amis soient trompés. C’est donc ce que je vais faire. Les gens qui sont debout devant vous déclarent qu’ils ne souffriront pas que nous relâchions un homme qui travaille ouvertement à renverser l’oligarchie. Les nouvelles lois portent qu’aucun citoyen du nombre des trois mille ne pourra subir la peine de mort sans votre approbation, mais que les Trente sont maîtres de condamner ceux qui ne sont pas sur la liste. D’accord avec tous mes collègues, j’efface de cette liste Théramène, ici présent ; et, ajoute-t-il, nous le condamnons à mort. » En entendant ces mots, Théramène s’élance vers l’autel de Vesta : « Et moi, citoyens, s’écrie-t-il, je vous supplie de m’accorder la plus légitime demande : c’est qu’il ne soit pas permis à Critias d’effacer ni moi ni aucun de vous a son gré, mais qu’on nous juge, vous et moi, d’après la loi relative aux gens inscrits sur la liste. Je n’ignore point, j’en atteste les dieux, que cet autel me sera inutile; toutefois je veux dévoiler non-seulement l’injustice criante de ces gens-là envers les hommes, mais leur impiété sans bornes envers les dieux. Cependant, honnêtes citoyens, je m’étonne si vous ne vous secourez pas vous-mêmes, sachant bien que mon nom n’est pas plus difficile à effacer que celui de chacun de vous. » Vains efforts, lutte inutile ! Le héraut des Trente ordonne aux Onze de se saisir de Théramène ; ils entrent avec leurs valets, ayant à leur tête Satyrus, le plus audacieux et le plus impudent d’eux tous. Critias leur dit : « Nous vous livrons Théramène que voici, condamné selon la loi. Saisissez-le, et, après l’avoir conduit où il faut, faites ce que les Onze ont a faire. » A peine a-t-il dit ces mots, que Satyrus arrache Théramène de l’autel, avec l’aide de ses valets. Théramène se défend, crie, appelle à l’aide. Le conseil ne remue pas. Théramène est jeté en prison, forcé de xxxvi boire la ciguë. Mais retrouvant à ses derniers instants, comme plusieurs condamnés héroïques de nos luttes révolutionnaires, toute la sérénité et jusqu’à l’enjouement de son esprit, il dit en versant à terre le reste du poison, comme s’il jouait aux cottabes : « Voilà pour le beau Critias ! » Nous pouvons nous tromper ; mais il nous semble que ce n’est point là le récit d’un historien médiocre. L’intérêt en est vif, puissant, continu : il y a là de la passion, de l’éloquence dans les discours, et le tableau qui le termine, après avoir ravi l’admiration de Cicéron, n’est point indigne de la nôtre. La narration du combat naval des îles Arginuses, la mise en accusation des généraux athéniens condamnés à mort pour n’avoir pas pu ensevelir leurs compatriotes, les débats judiciaires qui en sont la conséquence, l’habileté d’Euryptolème à défendre les accusés, la fermeté de Socrate qui cherche à disputer à Callixène les victimes d’une jalousie soupçonneuse, tout cela compose un ensemble de nature à captiver et à remuer le lecteur. Nous en dirons autant du récit de la conjuration de Cinadon : il est complet, achevé, dans sa brièveté sommaire, et il jette un jour curieux, vu la rareté de documents semblables, sur le malaise moral, sur l’irritation politique de certains esprits, de certaines fractions de cette république de Sparte, que les habitudes classiques nous font regarder comme courbée sous l’inexorable niveau d’une législation acceptée ou subie, sans contrôle et sans résistance, par tous les citoyens. Il faut encore ranger parmi les passages vraiment attachants l’histoire de Cléonyme, fils de Spodrias, obtenant la grâce de son père par l’entremise d’Archidamas, fils d’Agésilas ; l’exposé des moyens dont se sert le tyran Jason pour assurer son autorité despotique sur toute la Thessalie ; l’énumération des manœuvres navales d’Iphicrate; la discussion soulevée dans le conseil des Athéniens au sujet de leur alliance projetée avec Sparte contre Thèbes; et, dans cette discussion, les deux discours du Phliasien Proclès, véritables chefs-d’œuvre de bon sens et de raison pratique; le chapitre consacré à l’éloge de la ville de Phlionte, si héroïque xxxvii de courage et de dévouement à ses alliés; et enfin le récit de la bataille de Mantinée, qui est comme le couronnement de tout l’ouvrage. Mais il est surtout une remarque qu’il convient de faire, en forme de réponse à ceux qui se plaignent que l’œuvre de Xénophon manque tout à fait d’idée générale et d’unité : c’est que cette absence de suite n’est qu’apparente, et qu’en y regardant de plus près on trouve, entre les divers événements dont se compose la trame de cette histoire, un enchaînement, un lien qui n’a point échappé à la sagacité de l’un des derniers traducteurs des Helléniques. Xénophon, d’ailleurs, a fort nettement exposé sa pensée à cet égard. « On pourrait citer, dit-il, dans l’histoire des Grecs et dans celle des barbares, nombre de faits qui prouvent que les dieux tiennent compte des religieux et des impies. » N’est-ce pas là une préoccupation morale, une pensée dominante et dirigeante, à laquelle sont subordonnés, dans l’esprit de l’écrivain, les événements qu’il raconte, et cette sorte de foi n’imprime-t-elle pas à son histoire le caractère particulier d’une croyance sincère à une intervention providentielle dans la vie des nations, qui s’agitent sous le regard de la divinité ? Cependant, tout en rendant justice à la valeur méconnue ou dédaignée de l’Histoire grecque, nous reconnaissons volontiers que le véritable, le grand ouvrage historique de Xénophon, c’est l’Anabase, ou, pour parler un langage plus intelligible à des lecteurs français, l’Expédition de Cyrus, suivie de la Retraite des Dix mille. Cher à Scipion l’Africain et à d’autres éminents capitaines, ce livre, ainsi que l’a fait observer avec justesse un de ses traducteurs les plus intelligents, le comte de La Luzerne, est le plus ancien journal militaire qui nous soit parvenu. Il contient les détails d’une entreprise audacieuse, et nous transmet surtout ceux de la retraite la plus étonnante et la plus célèbre dont il soit parlé dans les annales du monde antique. Mais ce qui captive principalement dans cette histoire, c’est que le même homme qui écrit est un des principaux auteurs du drame dont il déroule à nos yeux les diverses péripéties. xxxviii Or, c’est une remarque de Fénelon, mise en lumière et en circulation par le meilleur éditeur de sa Lettre à l’Académie : « En tout art et en toute science, où il s’agit de la pratique, ceux qui n’ont qu’une pure spéculation ne sauraient bien écrire. » Rien n’est plus sensé que cette observation, appliquée à la Retraite des Dix mille; et les Commentaires de César, les Histoires de Tacite, la Chronique de Villehardouin, les Mémoires de Joinville et le Mémorial de Sainte-Hélène viennent en confirmer la justesse. Mais à cette première condition, requise chez l’auteur d’un excellent ouvrage d’histoire, s’ajoutait chez Xénophon la qualité essentielle, souveraine, pour bien écrire : il avait plus de quarante ans, c’est-à-dire l’âge où se sont exécutées en littérature, dans les arts, dans la politique, toutes les œuvres grandes, fortes, et qui durent. Tout imbu des doctrines de Socrate, et façonné par son exemple, il apportait à l’observation des faits, aussi bien qu’à l’action, un esprit droit, une imagination vive, un cœur généreux, un corps énergique et préparé aux rades travaux. C’est, en effet, l’alliance de ces dons heureux de la nature, développés par l’exercice, et dont la diversité ne trouble point l’harmonie, qui fait du livre de Xénophon la lecture la plus ravissante et en même temps la plus instructive. Rapportons-nous-en, à cet égard, au jugement d’un ancien qui avait étudié à fond les œuvres de Xénophon, qui eu a reproduit souvent dans ses œuvres le style et les idées, et qui joignait au talent oratoire le don plus rare du sentiment et de l’émotion vraie : je veux parler de Dion Chrysostome. Voici ce qu’il dit de son auteur de prédilection, de son modèle favori : « Xénophon, à lui seul, parmi les anciens, peut, selon moi, suffire à un homme public. Un général d’armée en guerre, un homme à la tête de l’État, un orateur à l’assemblée populaire, au sénat, au tribunal, veut-il parler comme il convient non-seulement à un rhéteur, mais à un homme public et investi d’un grand pouvoir, dans ces différentes positions, l’étude la meilleure, à mon sens, et la plus utile, c’est la lecture de Xénophon. Les pensées, en effet, sont claires, simples, intelligibles xxxix pour tous; la forme du récit est agréable, charmante, persuasive, remplie de vraisemblance, de grâce et de vivacité; ce n’est pas seulement de la force, c’est de la magie. Lisez avec attention le livre de l’Anabase : de tous les genres de discours que vous pourrez avoir à prononcer, vous n’en trouverez aucun qui n’y soit traité, qui ne puisse servir de règle à quiconque voudrait suivre et imiter ce modèle. Un homme public a-t-il besoin de rendre le courage à des esprits fortement abattus? Xénophon lui en donne, à diverses reprises, le moyen et l’exemple. Est-il besoin d’exhortations, de consolations? Il n’est pas un homme, comprenant le grec, qui restât insensible à celles qu’il emploie. Aussi mon âme s’émeut et quelquefois même je pleure, quand je lis les discours prononcés dans de si grandes circonstances. Faut-il parler avec prudence à des esprits arrogants et fiers, sans s’exposer à de mauvais traitements de la part d’hommes emportés, et sans se plier à une servitude honteuse, et condescendre en tout à leur volonté? On en trouve encore chez lui des exemples. Le secret de s’adresser avec discrétion, soit aux chefs, loin de la foule, soit au gros de l’armée; de tenir une sorte de langage royal; de tromper ses ennemis pour leur faire du mal, et ses amis dans leur intérêt; de dire la vérité d’une manière agréable et vraisemblable a des hommes effrayés sans motif; de donner des conseils pour qu’on ne se fie pas à la légère aux paroles des puissants; d’indiquer les moyens qu’ont les puissants pour en imposer, les stratagèmes à l’aide desquels on trompe à la guerre ou l’on se fait tromper : tout cela surabonde dans cette œuvre. Selon moi, les discours qu’il a mêlés à son récit ne lui ont pas été transmis par ouï-dire; il ne les a pas inventés, mais il les a faits lui-même, il les a prononcés, et c’est ce qui leur donne un tel air de vérité dans tous ses ouvrages, et surtout dans celui que je viens de dire. Soyez donc sûr que vous ne vous repentirez jamais d’avoir lu Xénophon; mais, soit au sénat, soit dans l’assemblée publique, vous le verrez venir vous tendre la main, si vous l’avez lu avec soin et avec zèle. » xl On ne peut rien ajouter à cet éloge, né d’une admiration qui va jusqu’aux larmes. Il faut dire cependant que Dion, ayant en vue de -former un orateur, ne loue guère de Xénophon que son éloquence, et laisse un peu dans l’ombre les autres mérites de notre historien. En effet, sans parler de sa modestie, de sa persévérance, de sa piété, de son héroïsme, quel admirable talent de peintre, quelle vérité naïve dans ses caractères, dans ses portraits, dans ses récits! Est-il rien de plus attachant que la narration de la bataille de Cunaxa, rien qui soit en même temps plus précis, plus net, plus rapide et plus détaillé? « Plusieurs historiens, dit Plutarque, ont raconté cette bataille ; mais Xénophon, entre autres, la décrit si vivement qu’on croit y assister et non la lire, et qu’il passionne ses lecteurs comme s’ils étaient au milieu du péril, tant il la rend avec vérité et énergie. » Est-il un épisode historique qui offre plus d’intérêt que celui des pourparlers qui s’établissent entre Artaxerxés, Tïssapherne et les chefs de l’armée grecque, Cléarque, notamment, qui se montre partout si fier et si digne, un vrai soldat? Avec quelle admirable vérité sont décrites les alertes, les alarmes, les terreurs soudaines, puis les espérances, les joies, toutes les alternatives enfin, par lesquelles passe cette foule impressionnable et mobile d’Arcadiens, d’Achéens et de Thraces, que l’appât du gain, le désir des aventures ou quelque peine judiciaire a entraînés loin de leur patrie à la solde de Cyrus! Gomme le pince.au rude et sévère de Salvator Rosa trouverait à s’exercer au milieu de cette collection de condottieri, pour ne pas dire de bannis et d’outlaws, dont Xénophon reproduit au vrai les physionomies, les mœurs, les passions multiples et changeantes! Combien il a besoin de tout le flegme, de toute la raison, de toute l’adressé d’un disciple de Socrate, pour imposer à ces natures brusques et sauvages, au moment où le meurtre de Cléarque et des autres stratèges le crée chef improvisé de cette multitude sans guide, sans ressources, en proie au découragement, presque sans espoir. Il se montre, du reste, à la hauteur de ce xli rôle difficile, épineux, plein de menaces et de périls. L? portrait qu’il a tracé d’un général dans ses Mémoires sur Socrate, c’est lui-même, à celte heure solennelle de sa vie, c’est en lui qu’il en a pris le modèle, et, si quelques traits en sont outrés, s’il érige en qualités des défauts qui peuvent blesser notre délicatesse, qu’on songe aux hommes qu’il avait à conduire, et l’on s’étonnera moins que ce Duguesclin des temps antiques nous esquisse plutôt la figure d’un chef de malandrins que celle d’un capitaine de troupes régulières et disciplinées. « Il faut, dit-il, que le général sache se procurer tout le matériel de la guerre et fournir de tout le soldat ; qu’il soit fécond en expédients, entreprenant, soigneux, patient, entendu, indulgent et sévère, franc et rusé, cauteleux et agissant à la dérobée, prodigue et rapace, libéral et cupide, réservé et résolu. » Et ce qu’il dit, il le met en pratique; il agit comme il se peint. Mais aussi dans quelles circonstances! Jamais spectacle, avant 1812, n’a été donné aux hommes, plus émouvant, plus dramatique que cette retraite, dont le parcours est de plus de deux mille kilomètres à travers des pays pour la plupart inconnus des Perses eux-mêmes, et cela, malgré les déserts, les montagnes, les fleuves, les neiges, la disette, les peuplades sauvages. Certes, nous admirons l’héroïsme de cette troupe sans cesse harcelée par les ennemis, par le besoin, par la maladie, par le froid ! Mais quel acteur nous étonne et nous touche plus que Xénophon lui-même? Quelle sérénité! quelle énergie ! quelle résolution au milieu des souffrances et des privations de toute espèce, jusqu’au moment où, pour couronner l’œuvre, il nous pénètre d’une émotion profonde en nous disant l’enthousiasme des Grecs lorsque, parvenus au mont Théchès, ils découvrent à l’horizon la vaste étendue du Pont-Euxin ! C’est un cri de délivrance et de salut. Us vont enfin s’embarquer, c’est-à-dire échapper à la mort. Avant peu, comme ils le disent dans leur pittoresque langage, ils vont arriver en Grèce après tant de travaux et de douleurs, semblables à Ulysse, étendus sur le tillac et dormant ! Citons ce beau passage : « Quand les premiers xlii ont gravi jusqu’au sommet et aperçu la mer, ce sont de grands cris. En les entendant, Xénophon et l’arrière-garde s’imaginent que l’avant-garde est attaquée par de nouveaux ennemis.... Cependant les cris augmentent à mesure que l’on approche : de nouveaux soldats se joignent incessamment, au pas de course, à ceux qui crient : plus le nombre croît, plus les cris redoublent, et il semble à Xénophon qu’il se passe là quelque chose d’extraordinaire. Il monte à cheval, prend avec lui Lycius et les cavaliers, et accourt à l’aide. Mais aussitôt ils entendent les soldats crier : Mer! mer ! et se féliciter les uns les autres. Alors tout le monde accourt, arrière-garde, équipages, chevaux. Arrivés tous au sommet de la montagne, on s’embrasse, soldats, stratèges et lochages, les yeux en larmes. Et tout à coup, sans qu’on sache de qui vient l’ordre, les soldats apportent des pierres et élèvent un grand tertre, qu’ils recouvrent d’armes enlevées à l’ennemi. » Là pourtant ne se trouve point encore le terme de leurs souffrances : ce n’est qu’à travers mille dangers qu’ils arrivent aux bords mêmes de l’Euxin, à la colonie grecque de Trébizonde, où l’amiral lacédémonien Anaxibius les transporte de l’autre côté de l’Hellespont. Quant à Xénophon, il ne croit sa mission finie que quand il s’est assuré du sort de tous les soldats, jusqu’au dernier, et qu’il a remis au Spartiate Thimbron les débris de son armée. L’embarras que nous avons éprouvé à donner une place précise à l’Éducation de Cyrus, ou, si l’on veut, à la Cyropédie, nous l’a fait ranger parmi les œuvres historiques de Xénophon ; mais nous n’hésitons point, sur la foi des autorités les plus respectables, à considérer cet ouvrage comme un cadre ingénieux de fictions revêtues de quelques noms propres, comme une histoire imaginaire, destinée à faire agréer un enseignement philosophique et moral, en un mot, comme un roman de vertu. Le Cyrus de l’auteur grec n’est pas beaucoup plus réel que celui de Mlle de Scudéry : c’est un héros idéal, un type de fantaisie. N’espérons retrouver dans Xénophon ni le Koresc ou Kiresc du Schah-Nameh, ni le fils de Cambysie et xliii 4e Mandane, le conquérant dont parlent Hérodote et Ctésias. Les doutes de Cicéron, d’Aulu-Gelle, d’Ausone, de Vives, de Scaliger et d’Érasme sur la réalité de la Cyropédie, ont été confirmés par la science de Fréret et par le bon sens érudit de l’abbé Fraguier. Cyrus n’est plus ce vainqueur étonnant, rapide, impétueux, qu’admirent Bossuet et Rollin, ni ce guerrier sauvage plein de passions et de vices, emporté par l’ambition, la cupidité, la violence, l’injustice, la colère, tel que nous le représentent les historiens grecs; c’est un modèle de désintéressement, de justice, de douceur et d’humanité. Fréret fait observer avec une grande justesse que «Xénophon, instruit des vrais principes de la morale, et jugeant des actions des princes, non par les maximes de la politique et par ce qu’on appelle raison d’État, mais par les principes de l’équité naturelle, qui décide du mérite et des actions des hommes, sans aucun égard pour les conditions, aime mieux manquer, dans son livre, à la vérité de l’histoire qu’aux principes de la morale. » L’abbé Fraguier va plus loin : à ses yeux, la Cyropédie est une œuvre dans le genre de Télémaque. Cette observation, reproduite et développée depuis avec une rare élégance d’expression par M. Villemain, caractérise parfaitement l’œuvre de l’écrivain grec. C’est bien une épopée didactique et morale, un livre d’enseignement où se donnent rendez-vous et se fondent dans un ensemble harmonieux et attrayant tous les préceptes, toutes les théories, toutes les doctrines de Socrate, tirées du domaine de l’abstraction et produites au jour lumineux et perceptible de la réalité. L’esprit de Socrate y vit, y respire, y domine partout : je retrouve a chaque pas, presque a chaque phrase, sa rectitude de jugement, sa droiture de cœur, les grâces de son imagination, la gaieté doucement railleuse de sa parole. Oui, Cyrus, c’est Socrate qui agit et qui parle, et parfois aussi c’est Agésilas, c’est Xénophon lui-même, avec ses goûts, ses habitudes, ses occupations de chaque jour, ses plans de réforme économique et sociale. Nous lisons dans la Retraite des Dix mille que Xénophon, xliv arrivé aux environs de Sinope, et se voyant à la tête d’une foule d’hoplites, de peltastes, d’archers, de frondeurs, de cavaliers, qui, grâce à une longue expérience, étaient devenus d’excellents soldats, conçut et caressa quelque temps le projet de fonder une colonie, une ville grecque dans ces contrées. Ne serait-ce point la l’idée première de son Éducation de Cyrus? Ce dessein, qu’il n’a pu mettre à exécution en créant un établissement réel, positif, ne l’a-t-il pas accompli par la pensée, en bâtissant une cité selon ses rêves, comme la République de Platon, modèle de l’Utopie de Thomas Morus et de la Salente de Fénelon ? Pour exécuter cette idée il lui fallait un cadre : c’est à l’Orient, au pays des fictions, à la terre classique des fables, qu’il va le demander. Et, suivant la remarque ingénieuse de l’abbé Fraguier, « de même que l’auteur du roman de VAslrée a élu un lieu tranquille et délicieux, parce qu’il lui fallait une scène conforme au spectacle qu’il voulait représenter; ainsi, pour l’éducation dure et austère que Xénophon voulait inspirer aux hommes, il a choisi un pays rude et stérile, un peuple tout occupé de la chasse et des bestiaux. » Remarquons, en outre, avec un philosophe de notre époque, M. Ad. Garnier, que si Xénophon, ainsi que Platon, se plaît à glorifier la Perse, « l’ancienne antagoniste de la Grèce, et à lui prêter comme un mérite des mœurs qui se rapprochent des coutumes de Sparte, cette autre ennemie d’Athènes, c’est sans doute un héritage de la profonde antipathie de Socrate pour la démocratie anarchique de son pays et une preuve de l’estime que les deux disciples professaient, comme leur maître, pour le gouvernement aristocratique ou monarchique auquel l’éloignement leur permettait, d’ailleurs, de prêter une sorte de perfection idéale. » L’intention et le plan de la Cyropédie se trouvant ainsi déterminés, nous ne croyons point devoir insister sur les détails; nous y renvoyons les lecteurs. Il est pourtant une remarque que nous ne voulons pas négliger : c’est que dans les écrits que nous ont laissés les anciens, excepté chez deux poètes, Homère et Euripide, l’un dans les adieux xlv d’Hector et d’Andromaque au sixième chant de l’Iliade et Vautre dans la tragédie d’Alceste, les douces effusions de la tendresse conjugale, la sensibilité aimante et dévouée, se faisant forte et héroïque jusqu’à vouloir mourir, ne se produisent nulle part chez les prosateurs. Xénophon a le mérite d’avoir, à diverses reprises, exposé avec une grâce infinie, un charme exquis, et dont il paraît avoir seul le secret, ces sentiments purs et délicats de l’amour dans le mariage. Nous avons vu tout ce qu’il y a de ravissant dans l’entretien d’Ischomachus avec sa jeune femme. Où trouver un fait plus touchant que celui-ci? Xénophon suppose que Tigrane, fils du roi d’Arménie, fait prisonnier avec sa femme, a dit à Cyrus qu’il donnerait sa vie pour épargner l’esclavage à sa femme : Cyrus a renvoyé ses captifs sans rançon. « Après leur entretien, dit Xénophon, et les marques d’amitié, suites naturelles d’une réconciliation, ils montent sur leurs chariots avec leurs femmes et s’en retournent la joie dans le cœur. Arrivés à leur demeure, ils ne parlent que de Cyrus : l’un vante sa sagesse, l’autre sa valeur ; celui-ci sa douceur, celui-là sa beauté et sa taille. Là-dessus, Tigrane dit à sa femme : « Et toi, Arménienne, Cyrus t’a-t-il semblé beau? — Mais, par Jupiter, je ne l’ai point regardé. — Et qui regardais-tu ? dit Tigrane. — Par Jupiter, celui qui disait qu’il vendrait sa vie our m’empêcher d’être esclave! » « Ce dernier trait, dit M. Adolphe Garnier, est plein de grâce, et le roman moderne n’a rien inventé de plus délicat et de plus tendre, surtout entre mari et femme. » Il en est de même de l’amour d’Abradatas et de Panthéa : leur séparation, leurs adieux sont un chef-d’œuvre de sensibilité vive et profonde. Xénophon avait aimé. Mais c’est surtout lorsque le cadavre d’Abradatas, tué glorieusement dans la bataille livrée à Crésus, est rapporté à sa femme, que la scène devient pathétique, déchirante jusqu’à paraître réelle et vraie. « Dès que Cyrus aperçoit Panthéa, assise à terre et le corps de son mari gisant devant elle, il fond en larmes, et dit avec douleur : « Hélas ! âme bonne et fidèle, tu es xlvi partie, tu nous as quittés. » En même temps il prend la main du mort, mais cette main reste dans la sienne ; un Egyptien l’avait coupée d’un coup de hache. A cette vue Cyrus sent redoubler sa douleur. Panthéa jette des cris lamentables, reprend cette main à Cyrus, la baise et essaye de la rejoindre au bras : « Ah ! Cyrus, s’écrie-t-elle, voilà comme il est tout entier ! Mais à quoi te sert de le regretter? C’est à cause de moi, Cyrus, qu’il en est tenu là, et peut-être aussi à cause de toi ! Insensée ! je l’engageais continuellement à se montrer, par ses actions, digne de ton amitié : et lui, il ne songeait point au sort qui l’attendait, mais aux moyens de te servir. Et cependant il est mort sans reproche : et moi, qui lui donnais ces conseils « je vis et je suis assise près de lui. » « Durant tout ce temps, Cyrus fond en larmes sans prononcer une seule parole ; mais enfin rompant le silence : « Oui, femme, il a eu la fin la plus glorieuse ; il est mort vainqueur. Accepte ce que je te donne pour son corps. » Gobryas et Gadatas venaient d’apporter une grande quantité d’ornements précieux. « D’autres honneurs, continue Cyrus, sache-le bien, lui sont encore réservés : on lui «élèvera un tombeau digne de toi et de lui, et on immolera en son honneur les victimes qui conviennent à un brave. Pour toi, tu ne resteras point sans appui : j’honorerai ta sagesse et tes autres vertus ; je te donnerai quelqu’un qui te conduise, où que tu veuilles aller. Dis-moi seulement où tu désires qu’on te mène. » Panthéa lui répond : « Ne te mets pas en peine, Cyrus : je ne te cacherai point vers qui j’ai dessein d’aller. » « Après cet entretien, Cyrus se retire, prenant en pitié la femme privée d’un tel mari, le mari qui ne doit plus revoir une telle femme. Panthéa fait éloigner ses eunuques : « Afin, dit-elle, de m’abandonner, comme je veux, à ma » douleur. » Elle ordonne à sa nourrice seule de rester, et lui recommande, quand elle sera morte, de couvrir son corps et celui de son mari du même tapis. La nourrice essaye par ses supplications de la détourner de son dessein ; mais, voyant que ses instances ne font que l’irriter, xlvii elle s’assied en pleurant. Pauthéa, au même instant, tire un poignard, dont elle s’était depuis longtemps munie, se frappe, et posant la tête sur la poitrine de son mari, elle expire. La nourrice, poussant des cris douloureux, couvre les corps des deux époux, comme l’avait recommandé Panthéa. Bientôt Cyrus apprend l’acte de Panthéa ; il arrive tout bouleversé, pour voir s’il peut encore la secourir. Les eunuques, voyant ce qui s’est passé, tirent tous les trois leurs poignards, et se percent dans l’endroit même où elle leur avait ordonné de se tenir. Cyrus, après avoir assisté à ce triste spectacle, s’en va pénétré de douleur et d’admiration pour Panthéa. Par ses soins, on rend aux morts les honneurs funèbres avec une très-grande pompe, et il leur fait élever un vaste monument. On dit que ce monument, érigé aux deux époux et aux eunuques, existe encore aujourd’hui, que sur une colonne élevée sont les noms du mari et de la femme écrits en caractères syriens, et que sur trois colonnes plus basses, on lit encore celte inscription : Porte-sceptres. » Quelques critiques modernes d’un grand mérite ont contesté l’authenticité de l’Agésilas de Xénophon, bien que l’antiquité tout entière l’ait considéré comme une production de notre auteur. Il est fort difficile, selon nous, de trancher ces sortes de questions, où le pour et le contre se balancent souvent dans un parfait équilibre, et nous avons renvoyé, dans les notes qui accompagnent notre traduction, aux livres qui renferment les éléments de cette controverse. Quant à l’œuvre elle-même, on peut y voir la production d’une âme jeune, passionnée pour le bien, l’admirant dans un héros qu’elle croit la vertu vivante, et exprimant son enthousiasme naïf dans un style que la conviction émue ne préserve pas toujours de la recherche poétique ni de la prétention et de l’emphase familière aux rhéteurs. On y trouve cependant de beaux endroits ; et le récit de la bataille de Coronée, perdu, noyé pour ainsi dire dans l’Histoire grecque, s’y trouve reproduit dans un relief qui donne raison à l’éloge qu’en a fait Longin. IV xlviii Les opuscules politiques et économiques de Xénophon sont au nombre de trois, le Gouvernement des Lacédémoniens, le Gouvernement des Athéniens et les Revenus. Montesquieu a dit : « République de Platon pas plus idéale que celle de Sparte : » c’est un trait de lumière jeté sur l’œuvre de Xénophon. En effet, si son livre est le miroir fidèle de la société façonnée par Lycurgue, il faut convenir que de telles institutions et des vertus de cette espèce ne sont point de ce monde : l’auteur de l’Esprit des Lois a raison de les attribuer malicieusement à l’histoire fabuleuse des Sévarambes. Pour le dire franchement, une cité organisée comme Sparte n’a jamais pu subsister, ou si elle a vécu quelque temps, à la honte des hommes, on ne peut considérer cette existence éphémère que comme une sorte de phénomène, pour ne pas dire de monstre, que la sociabilité humaine a dû se hâter de combattre par la contradiction et par la résistance. Nous sommes donc plutôt porté à croire que Xénophon^en louant la législation, dont l’observance a fait, selon lui, le bonheur des Lacédémoniens, en exaltant Lycurgue comme la sagesse même, s’est proposé, avant tout, de critiquer la constitution d’Athènes, de même que Tacite n’a fait l’éloge des peuples de la Germanie que pour flétrir la corruption des Romains. Une législation, au frontispice de laquelle on trouve inscrit l’échange, sinon la promiscuité des femmes, un code qui autorise le plus hideux esclavage, ne peut produire que des effets désastreux. Rousseau appelle Sparte un couvent de soldats. D’accord; mais ne peut-on pas lui répondre avec Voltaire que c’était apparemment le couvent de Saint- Claude, «à cela près que les moines ne se permettaient point d’assassiner ni d’assommer leurs mainmortables? » Nous ajouterons même volontiers avec l’auteur du Dictionnaire philosophique, que l’existence de l’égalité ou de la xlix communauté de biens supposant celle d’un peuple esclave, si les Spartiates avaient de la vertu, c’était comme les voleurs de grand chemin, comme les inquisiteurs, comme toutes les classes d’hommes que l’habitude a familiarisés avec une espèce de crimes, au point de les commettre sans remords. » Ainsi Sparte, avec ses repas en commun, sa mise en commun de femmes, d’enfants, d’esclaves, de chiens, de chevaux et de vivres, avec sa forte discipline militaire, mais avec ses lois qui interdisent toute profession libérale et artistique, qui tuent tout sentiment affectueux et tendre, n’est, à nos yeux, qu’une machine à conquête et à rapine, dont les rouages et les ressorts sont habilement agencés pour détruire ou pour absorber à son profit; mais ce n’est pas une cité, encore moins une nation. Ma vive et respectueuse sympathie pour Xénophon ne le suit plus au delà des frontières de la Laconie. Le traité intitulé Gouvernement des Athéniens, dont plusieurs parties offrent de la ressemblance avec quelques passages de la Politique d’Aristote, nous ramène à des institutions plus humaines, ce qui ne veut pas dire parfaites, mais du moins plus possibles que celles de Sparte. Le grammairien Démétrius de Magnésie, l’ami d’Atticus, doutait de l’authenticité de ce traité ; la critique savante, la sagacité éclairée de Bœckh et de Weiske ont restitué cet opuscule à Xénophon. Seulement, il est difficile de croire que son ouvrage, tel qu’il nous est parvenu, ne soit point une satire rédigée contre Athènes, lorsqu’il était banni de son pays et qu’il trouvait sur le territoire de Sparte un accueil qui justifiait son affection pour la rivale de sa pairie. Telle est l’opinion de Weiske, et l’on ne peut douter, en lisant la dissertation qui la confirme, que cette œuvre, singulièrement défigurée, ne présente des lacunes, sinon des mutilations, qui en ont altéré le caractère et la rédaction primitive. En voici une rapide analyse. Après avoir esquissé d’un trait général le système du gouvernement d’Athènes, l’auteur blâme les Athéniens de leurs préventions injustes, de leur méchanceté envers leurs alliés, de leur faiblesse avec l leurs esclaves, et de la vénalité de la justice, surtout parmi les partisans outrés de la démocratie ; il insiste ensuite assez longuement sur la puissance maritime d’Athènes, dont il apprécie avec beaucoup de sens le bien et le mal; mais, après s’être montré plus bienveillant que sévère sur ce point, il se repent, en quelque sorte, de son indulgence, et retrouve dans sa pensée et dans son style des formes ironiques, acerbes, pour exprimer son jugement sur le caractère du peuple athénien. Le passage est curieux : « Quand le peuple, dit-il, fait des traités, il est toujours maître d’en rendre responsable celui-là seul qui a donné le conseil ou rédigé le décret, et de dire aux autres : « Je « n’étais pas là; je n’approuve pas la convention. » On fait une proposition à l’assemblée populaire. Si le peuple n’est pas de cet avis, il trouve mille prétextes pour ne pas faire ce qu’il ne veut pas. S’il résulte quelque malheur de ce que le peuple a décidé, le peuple accuse la minorité, dont l’opposition a tout perdu : si tout va bien, il s’en attribue uniquement la cause. « Les comédies et les brocards dirigés contre le peuple ne sont point permis, parce qu’on ne veut pas entendre dire du mal de soi ; mais on les autorise quand ils attaquent les particuliers, parce qu’on sait bien que le personnage de la comédie n’est d’ordinaire ni un homme du peuple ni un des derniers citoyens, mais un riche, un noble, un puissant, qu’il y a peu de pauvres ou de plébéiens traduits sur la scène, et que, s’il y en a, ce sont des brouillons, des gens qui cherchent à se mettre au-dessus du peuple : espèce d’hommes qu’on n’est pas fâché de voir tournés en ridicule par la comédie. « Je ne prétends donc pas que le peuple, à Athènes, ne sache pas distinguer le bon citoyen du mauvais ; mais le sachant, il éprouve de la sympathie pour ce dernier, si mauvais qu’il soit, parce qu’il en tire parti et avantage : quant au premier, il le déteste de préférence. Il croit, en effet, la vertu faite pour le malheur, et non pour le bonheur des gens. » Il faut, dans ces lignes, faire une assez large part au li ressentiment d’une âme aigrie ; cependant on ne peut disconvenir qu’il n’y ait un air frappant de vérité dans la peinture moqueuse des préférences jalouses et des exclusions injustes du peuple athénien. Toutefois ce n’est point complètement sa faute : cette malignité capricieuse et rancunière est une maladie inhérente à sa constitution. Montesquieu l’a signalé avec sa pénétration accoutumée : « Il y avait un grand vice, dit-il, dans les républiques anciennes : c’est que le peuple avait le droit d’y prendre des résolutions actives, et qui demandent quelque exécution, chose dont il est entièrement incapable. Il ne doit entrer dans le gouvernement que pour choisir ses représentants, ce qui, du moins, est à sa portée. » Si donc, dans la constitution lacédémonienne, l’individu est subordonné à la cité, dans le régime athénien, c’est la cité qui devient subordonnée à l’individu. Or, c’est cette prédominance de l’unité simple sur l’unité collective, qui déplaisait à Socrate, à Xénophon, à Platon, et même à leur ennemi personnel Aristophane; et ce qu’il y a d’étrange, c’est de voir justement des hommes en qui l’individualité s’accuse à nos regards dans sa plus grande force et dans sa plus puissante originalité, ne point dissimuler leur sympathie pour le système de gouvernement qui tendait le plus à l’effacer et à la faire disparaître. Résumons tout, du reste, par une réflexion de Herder : » A la fois guerrier et homme d’État, Xénophon indiqua dans la constitution d’Athènes des défauts qu’il n’eut pas le pouvoir de corriger. » L’opuscule intitulé des Revenus est, sans contredit, un des plus anciens traités de finance. Plusieurs érudits, et parmi eux le savant Letronne, attribuent cet ouvrage à la vieillesse la plus avancée de Xénophon ; d’après leurs calculs, il l’aurait écrit un an avant sa mort : ce serait son testament littéraire et patriotique. Entre autres arguments, on s’autorise de cette phrase : « Comment ne pas entreprendre sur-le-champ cette réforme, afin que, de notre vivant, nou6 voyions notre patrie tranquille et florissante ? » On la regarde comme le vœu d’un vieillard, qui va descendre dans la tombe. Après une lecture attentive de la lii dissertation placée par Weiske en tête de ce traité, nous ne pouvons nous rendre à l’opinion généralement reçue, et nous inclinons à celle du savant éditeur allemand, qui voit dans ce traité un ouvrage de la jeunesse de Xénophon. Outre les raisons dont il appuie son sentiment, la réflexion nous en a suggéré d’autres qui sont loin de l’infirmer. Et d’abord la phrase dont on argue ne prouve absolument rien en ce qui concerne l’âge de Xénophon. Il n’est pas nécessaire d’avoir quatre-vingt-neuf ans, pour souhaiter de voir, avant de mourir, la prospérité de sa patrie : c’est un souhait que Xénophon pouvait tout aussi bien faire, quand il en avait vingt-neuf. En second lieu, si l’on admet qu’il ait écrit ses Mémoires d’après des notes recueillies durant les entretiens de Socrate, comment oublier la conversation du grand philosophe avec le jeune Glaucon ? Citons-en quelques traits : « Voudrais-tu d’abord, lui dit Socrate, de la même manière que s’il s’agissait d’enrichir la maison d’un ami, t’efforcer d’enrichir la république? —Je le voudrais. — Le moyen de la rendre plus riche, n’est-ce pas de lui procurer de plus grands revenus ? — C’est tout naturel. — Dis- nous donc d’où se tirent aujourd’hui les revenus de l’État, et quel en est le chiffre? Il est évident que tu en as fait une étude, afin de pouvoir suppléer aux produits qui se trouveraient trop faibles et remplacer ceux qui viendraient à manquer. — Mais, par Jupiter, reprit Glaucon, je n’y ai jamais songé. — Puisque tu n’as pas songé à ce point, dis-nous au moins quelles sont les dépenses de la ville ; car il est certain que tu as l’intention de diminuer celles qui sont superflues. — Ma foi, je ne m’en suis pas non plus occupé. — Eh bien, remettons à un autre temps le projet d’enrichir l’État : comment, en effet, y songer avant de connaître les dépenses et les revenus? » Et plus loin : « Je sais, ajouta Socrate, que tu n’as pas été voir les mines d’argent, de sorte que tu ne peux pas dire pourquoi elles produisent moins qu’autrefois. — En effet, je n’y ai pas encore été. — On dit, ma foi, que l’air y est malsain; et conséquemment, si l’on vient à en délibérer, tu auras là liii une excuse suffisante. » Que ressort-il de ce passage? C’est que Socrate avait médité cette question des revenus et du rapport des mines; c’est qu’il en causait avec ses amis, avec ses disciples, avec Xénophon. Or, comme Socrate n’écrivait jamais et que Xénophon écrivait toujours la totalité, ou tout au moins le sommaire des causeries de son maître, pourquoi, afin de ne pas être pris à son tour au dépourvu, comme cet écervelé de Glaucon, sur des questions d’une aussi grave importance, n’aurait-il pas immédiatement rédigé en forme de livre les idées qu’il tenait de Socrate? Pourquoi, surtout, aurait-il attendu soixante-six ans avant de les formuler? Enfin, loin de respirer, comme le Gouvernement des Athéniens, une colère sourde contre la démocratie athénienne, le traité des Revenus est plein de patriotisme et de conseils qui tendent sincèrement à l’accroissement de la richesse nationale. Peut-on croire que Xénophon, qui refusa de rentrer dans sa patrie, après qu’on eut révoqué l’arrêt de son bannissement, se soit montré tout à coup si dévoué aux intérêts de son pays et qu’il ait fait un dernier appel aux forces de son intelligence, pour envoyer en toute hâte aux Athéniens un remède efficace contre l’imminence de leur ruine? Quoi qu’il en soit, le traité des Revenus offre à tous ceux qui s’intéressent aux questions économiques et financières des documents d’un très-grand prix. Comme pour répondre à l’une des demandes adressées par Socrate à Glaucon, Xénophon dit au début de son ouvrage : « Je me suis proposé d’examiner par quels moyens les citoyens pourraient subsister des ressources de leur propre pays, persuadé que, si ce projet réussissait, on mettrait un terme à leur pauvreté et aux soupçons des Grecs; et, en réfléchissant à l’objet que j’avais dans l’esprit, il m’a tout d’abord paru que notre pays est fait pour donner de forts revenus. » Cela posé, il parle en premier lieu du sol et du climat de l’Attique, qui abonde en produits de toute espèce, capables de nourrir non-seulement les habitants actuels, mais les étrangers qui voudraient y élire domicile. Augmenter le liv nombre des métèques ou domiciliés, est donc un des premiers moyens qui se présentent de produire de plus forts revenus. Le second moyen consiste à accorder des avantages aux marchands qui trafiquent avec Athènes. C’est, par exemple, de proposer au tribunal de commerce une prime proportionnée à l’expédition la plus prompte des affaires contentieuses et des litiges de commerce, de manière que les pilotes et les armateurs ne soient pas retenus par les embarras d’un procès, au moment de mettre h la voile. Il conviendrait également de faire bâtir pour les marins étrangers un plus grand nombre d’hôtelleries le long du port, ainsi que de vastes bazars de marchandises. Mais ce qui doit surtout être une source inépuisable de revenus, c’est l’exploitation des mines d’argent du Laurium. Xénophon demande qu’elles soient exploitées d’après un tout autre système que celui qui est présentement en vigueur, et il répond aux objections que peut soulever ce nouveau projet. Entre autres arguments, il est pour nous d’un intérêt presque actuel d’y trouver cette phrase : « Mais, dira-t-on, l’or n’est pas moins utile que l’argent. Je n’en disconviens pas ; je sais toutefois que l’or, en devenant commun, perd beaucoup de sa valeur et fait hausser le prix de l’argent, » N’est-il pas curieux de voir un Grec se préoccuper, il y a plus de vingt siècles, de cette question de la rareté relative de l’or ou de l’argent, dont la découverte des gisements aurifères du nouveau monde a fait un sujet de controverse entre nos publicistes, et à laquelle Montesquieu a consacré un chapitre spécial dans le vingt-huitième livre de l’Esprit des lois? La conviction de Xénophon est que sa patrie, tout en n’ayant que des minerais d’argent, est plus richement dotée, sous le rapport métallurgique, que les pays mêmes où l’or s’exploite, et, après quelques considérations sur la sécurité que donne la paix à l’industrie et aux travaux des mines, il conclut en suppliant ses concitoyens de mettre en pratique le système qu’il leur propose, et qu’il croit de nature à procurer à Athènes les plus grands avantages et le plus grand bonheur. V lv Le désir de ne rien omettre de ce qui porte le nom de Xénophon dans une traduction de ses Œuvres complètes, nous a engagé à y donner place aux Lettres qui lui sont attribuées. Il n’est pas douteux toutefois qu’elles ne soient apocryphes. On sait que les sophistes et les rhéteurs avaient l’habitude de donner à composer des lettres a leurs élèves sous le nom d’écrivains ou de personnages illustres : c’était un exercice d’école. Telles sont les lettres du Scythe Anacharsis, de Thémistocle, de Pythagore, de Socrate, de Platon, de Démosthène, de Diogène, d’Eschine, de Phalaris. Celles de Xénophon n’ont pas plus que les précédentes le caractère de l’authenticité. Cependant, comme elles ont été composées, selon toute apparence, à une époque où les traditions et les légendes relatives à l’écrivain dont elles empruntent le nom et le style se trouvaient plus récentes, plus voisines de son temps, elles peuvent offrir un certain intérêt pour l’histoire de la philosophie ou de la littérature. Ainsi, les lettres de Xénophon contiennent des allusions à la vie qu’il menait dans son exil, au peu de sympathie qu’il éprouvait, dit-on, pour Platon et pour ceux des disciples de Socrate qui altéraient, selon lui, la pureté des doctrines du maître, ou qui compromettaient leur dignité à la table des tyrans de Sicile. Elles nous donnent quelques détails sur la situation présumée de la famille de Socrate après la mort du grand philosophe. Enfin, deux d’entre elles sont une sorte de commentaire à la parole que Xénophon prononça, selon Diogène de Laërte, à la nouvelle de la mort de son fils. Il y a plus : on y trouve quelques phrases, qui ne manquent ni de justesse dans les idées ni d’élégance dans le style ; en sorte qu’elles ne sont point indignes de la réputation de l’éminent écrivain par lequel on prétend qu’elles ont été écrites. Tel est l’ensemble des œuvres de Xénophon. Tour à tour lvi philosophe, historien, capitaine, s’il ne brille au premier rang ni dans la philosophie, ni dans l’histoire, ni dans les armes, du moins l’harmonie qui préside au développement complet de son heureuse nature, je ne sais quel heureux mélange de génie à la fois aimable et sévère, simple et réfléchi, paisible et solide, idéaliste et pratique, lui assurent une gloire modeste et pure au milieu des grands hommes qu’a produits la civilisation grecque. Il mérite aussi une place à part, grâce aux charmes d’un style que les critiques les plus j udicieux de l’antiquité et du temps présent se sont accordés a louer, presque sans restriction. Denys d’Halicarnasse, Dion Chrysostome, Lucien, Longin, Hermogène, parmi les Grecs; Cicéron et Quintilien, parmi les Latins ; l’abbé Barthélémy, Sainte-Croix et Thomas, parmi les Français, ont tous vanté la douceur de sa diction, qu’ils comparent à celle du miel, la suavité de son langage, qu’ils disent pétri par les Grâces elles-mêmes, toutes les qualités enfin qui lui ont valu le nom d’Abeille attique. Hermogène, pénétrant davantage dans les détails de son style, se plaît à faire ressortir la sobriété élégante, la chaleur tempérée, le choix délicat d’images, l’habile tempérament de piquant et de doux, d’ingénieux et de naïf, et, par-dessus tout, la pureté et la correction parfaites, qui en composent le caractère. Il ne lui reproche que d’user en divers passages d’expressions empruntées à la poésie, et qu’un goût plus sévère aurait dû bannir de la contexture d’une prose, d’ailleurs si limpide et si douce. Nous ne pouvons rien ajouter à de tels éloges : la pratique journalière de Xénophon nous en a fait sentir toute la justesse. Cependant nous ne croyons pas inutile d’appeler l’attention des lecteurs sur une observation particulière que nous a suggérée une étude assidue, minutieuse, patiente de notre auteur. Ami de la simplicité, de ces jets naïfs et spontanés de la pensée, que Montaigne appelle de « braves formes de s’exprimer,» jamais Xénophon, sauf des exceptions très-rares, n’accorde rien à la parure, aux fleurs du langage. Chez lui, pas un seul effet de style, pas un trait décoché à la fin d’une phrase, pour faire im- lvii pression sur celui qui le lit. Il s’en garde, au contraire, avec une sorte de coquetterie. Bien avisé qui l’y prendra. Aucun chapitre de son Histoire grecque, de son Expédition de Cyrus, ne se termine par une sentence, une image préméditée. Ainsi, le récit, d’ailleurs si attachant, de la bataille de Cunaxa, finit de la manière la plus imprévue, comme certaines odes d’Horace. Après un éloge d’Artapatès, le plus dévoué des porte-sceptres de Cyrus, il dit que le roi vainqueur le fit tuer sur le cadavre de son maître, et il ajoute : « D’autres, prétendent qu’il s’égorgea lui-même, après avoir tiré son cimeterre, car il en avait un à poignée d’or, et il portait un collier, des bracelets et autres ornements, ainsi que les premiers des Perses : Cyrus l’avait en estime pour son dévouement et sa fidélité. » Celte citation est un exemple entre mille, comme les lecteurs studieux pourront s’en convaincre. Avec tant de qualités fortes et solides de l’esprit, rehaussées par les grâces charmantes du style, il aurait été bien extraordinaire que Xénophon n’eût pas tenté le bon vouloir et le zèle des traducteurs. Ils ne lui ont pas fait défaut, et le Manuel du libraire, de Brunet, en contient une liste nombreuse, où brillent les noms d’hommes infiniment honorables et d’une science profonde. N’est-ce pas alors, de notre part, une grande présomption d’essayer après eux une traduction nouvelle? Nous répondrons franchement, et sans fausse modestie, que nous ne le pensons pas. Une lecture suivie de l’auteur grec et de ses truchements nous a convaincu qu’il y avait plus qu’à glaner sur leurs traces dans le champ de l’interprétation : la moisson était presque toute à faire. Qu’«st-ce, en effet, qu’une traduction? Une copie exacte, fidèle, aussi parfaite que le permet la différence des procédés, c’est-à-dire des idiomes. Et quel est le premier mérite d’une copie? La ressemblance, la reproduction vraie de la physionomie du modèle. S’il en est ainsi, Xénophon n’a pas eu réellement et sérieusement tous les traducteurs que la patience de Brunet a énumérés dans sa nomenclature. L’un se contente de donner un sens approchant, une image quelconque de l’au- lviii teur, sans se douter que c’est avant tout le littéral, le texte même, avec son mouvement, son allure propre et jusqu’à ses défauts, qu’il faut saisir et fixer dans le moule français- L’autre, appliquant le système des phrases périodiques et ronflantes aux idées les plus simples, affuble les naïvetés de Cyrus enfant, des expressions les plus prétentieuses et.les plus guindées. Un autre, dans le traité de la Chasse, un livre tout technique et d’un aimable sans-façon dans le g style, craindrait de dire, en parlant des moyens de reconnaître les gîtes du lièvre : « Quand on voit les traces du lièvre mener à ces cachettes. » Cette tournure est trop terre à terre, tandis que celle-ci : « Lorsque ses pas tendent vers ces lieux, » lui paraît de beaucoup meilleure, sans doute à cause du profond demi-jour qui l’enveloppe. Mais à quoi bon insister sur cette critique et multiplier les exemples? Persuadé que la règle première, essentielle du traducteur, est la convenance du ton, c’est-à-dire l’attention la plus scrupuleuse a modeler son style sur celui de son auteur, nous avons fait de notre mieux pour échapper au défaut qui nous a choqué chez les autres. Nos lecteurs jugeront si nous avons réussi. Pour le texte, nous avons eu sous les yeux les éditions de Schneider, de Weiske et de Dindorf, qui contiennent l’ensemble des œuvres ; mais cela ne nous a point empêché de recourir aux éditions particulières de quelques traités, que nous avons mentionnées dans les notes. En un mot, nous n’avons voulu rien épargner pour que cette nouvelle traduction fût comme un remerciaient à l’accueil bienveillant que le public a daigné faire à notre traduction de Lucien. Les œuvres de l’historien philosophe n’ont pas, il faut l’avouer, cette verve étourdissante, cette raillerie piquante, inépuisable, de l’auteur des Dialogues, encore moins cette . malignité sceptique et irrévérencieuse, qui caresse nos instincts, notre humeur toujours un peu opposante ou jalouse, et qui trouve un écho dans le cœur même des plus tolérants : plaisir dont l’âpreté ne laisse pas d’avoir ses dangers. Mais, outre que l’esprit proprement dit est loin de manquer à Xénophon, il a des qualités solides et positives qui le lix recommandent aux lecteurs de notre époque. Nous avons vu que c’est un moraliste tout pratique, plein de bon sens et de justesse dans les idées, de sérieux dans les conseils, un élève de Socrate. Notre époque serait bien malheureuse, bien gâtée, si les œuvres d’un écrivain de cette trempe n’avaient aucune prise sur elle. Il s’adresse, en effet, à tous les âges, à tous les esprits, à toutes les conditions. L’homme d’État, l’agriculteur, le soldat, le penseur, l’artiste, l’écuyer, le chasseur, le chef de famille, trouvent chez lui des notions précises, des réflexions judicieuses, d’excellentes règles de conduite, une direction nette et intelligente, et tout cela présenté sous les formes les plus élégantes, les plus aimables. En faut-il davantage pour instruire et pour charmer à la fois les hommes dont le cœur et la raison sont capables de s’ouvrir aux salutaires influences d’un bon livre? Pour ma part, qu’il me soit permis de le dire, sans qu’on trouve cet emploi du moi trop haïssable, j’ai puisé dans l’élude assidue, dans le commerce intime de Xénophon, dans cette sorte de dialogue journalier qui s’établit entre l’auteur original et son copiste, un enseignement utile, une suite de leçons fortes et pénétrantes, dont j’ai cherché à profiter avec la loyauté d’un disciple confiant et docile, et je ne regrette ni les efforts que j’ai faits, ni le temps qu’ils m’ont coûté. Eugène Talbot. |