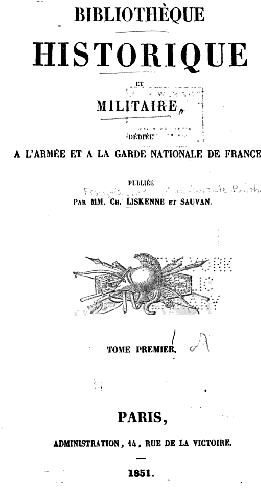
XENOPHON
CYROPÉDIE OU ÉDUCATION DE CYRUS. LIVRE I
Traduction française · J. B. GAIL.
Autre traduction (TALBOT) - autre traduction (CHAMBRY)
la traduction bilingue est celle de Talbot
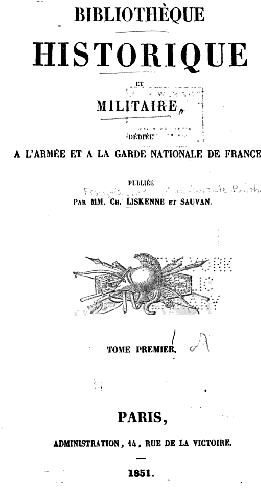
CYROPÉDIE OU ÉDUCATION DE CYRUS. LIVRE I
Autre traduction (TALBOT) - autre traduction (CHAMBRY)
la traduction bilingue est celle de Talbot
CYROPÉDIE OU ÉDUCATION DE CYRUS. LIVRE I
|
CHAPITRE
I J'observais un jour combien de démocraties ont été renversées par des hommes qui préféraient tout autre gouvernement, combien de monarchies et d'oligarchies ont été détruites par des factions populaires, combien d'ambitieux ont été dépouillés de la souveraine puissance qu'ils venaient d'usurper, et combien l'on admire le bonheur et l'habileté de ceux qui ont su s'y maintenir même peu de temps. Je considérais ensuite que dans les maisons des particuliers, composées les unes d'un nombreux domestique, les autres d'un petit nombre de serviteurs, les chefs ne savent pas commander, même à ce petit nombre. Je remarquais, d'un autre côté, que les bœufs, les chevaux se laissent conduire par ceux qui les soignent, qu'en général tous ceux qu'on appelle pasteurs, sont justement réputés maîtres des animaux confiés à leur garde. Je voyais que ces animaux leur obéissent plus volontiers que les hommes à ceux qui les gouvernent, car les troupeaux suivent le chemin que leur indique le berger, ils paissent dans les champs où il les mène, et respectent ceux qu'il leur interdit. Ils le laissent user à son gré du profit qu'ils lui rapportent. Jamais on ne vit un troupeau se révolter contre le pasteur, soit en cessant de lui obéir, soit en le privant de son revenu. S'ils sont méfiants, c'est pour tout autre que le maître qui les gouverne et qui vit à leurs dépens, tandis que les hommes ne s'élèvent contre personne avec plus de violence que contre ceux en qui ils aperçoivent le projet de dominer. Je concluais de ces réflexions qu'il n'est pas pour l'homme d'animal plus difficile à gouverner que l'homme. Mais quand je considérai que le Perse Cyrus maintint sous ses lois un grand nombre d'hommes, de cités, de nations, alors contraint de changer d'avis, je reconnus qu'il n'est ni impossible ni même difficile, avec de l'adresse, de commander à des hommes. En effet, on a vu des peuples éloignés des états de Cyrus, de plusieurs journées ou de plusieurs mois de chemin, qui ne l'avaient pas même vu ou qui désespéraient de le voir, reconnaître volontairement son empire. Aussi a‑t‑il éclipsé tous les souverains que la naissance ou le droit de conquête a placés sur le trône. Le roi des Scythes, maître d'un peuple nombreux, n'oserait tenter de reculer ses frontières. Il s'estime heureux de pouvoir contenir ses sujets naturels. On doit dire la même chose du roi de Thrace, du roi d'Illyrie, et de plusieurs autres rois, car on sait qu'il existe encore aujourd'hui en Europe des nations autonomes et indépendantes les unes des autres.
Cyrus voyant l'Asie peuplée de ces nations autonomes, se mit en campagne avec
une petite armée de Perses, et, secondé des Mèdes et des Hyrcaniens, il
subjugua les Syriens, les Assyriens, les Arabes, les habitants de la
Cappadoce, des deux Phrygies, les Lydiens, les Cariens, les Phéniciens, les
Babyloniens. Il assujettit la Bactriane, les Indes, la Cilicie, les Saces, les
Paphlagoniens, les Mariandyns, et tant d'autres nations qu'il serait trop long
de nommer. Il soumit aussi les Grecs asiatiques, puis, descendant vers la mer,
il conquit l'île de Chypre et l'Egypte. Ces peuples n'entendaient point sa
langue, ne s'entendaient point entre eux, et néanmoins telle fut la terreur
de son nom, dans cette immensité de pays qu'il parcourut, que tout trembla
devant lui, nul n'osa conspirer. Il gagna si bien l'affection de ses nouveaux
sujets, qu'ils aimaient à vivre sous sa dépendance. Enfin il soumit tant de
provinces, qu'il serait difficile de les parcourir toutes, partant de la
capitale et marchant vers le levant ou le couchant, vers le septentrion ou le
midi. Pénétré d'admiration pour ce grand homme, j'ai recherché son
origine, quel a été son caractère, quelle éducation l'a rendu supérieur
dans l'art de régner. Je vais donc essayer de raconter ce que j'en ai oui
dire et ce que j'en ai pu découvrir par moi‑même.
Le père de Cyrus était Cambyse, roi de Perse. Il descendait de la maison des Perséides, qui rapportent leur origine à Persée. Sa mère, appelée Mandane, était fille d'Astyage, roi des Mèdes. Les historiens et les poètes barbares nous disent que la nature, en douant Cyrus d'une figure agréable, lui avait donné une âme sensible et un amour si vif de l'étude et de la gloire, que, pour mériter des éloges, il n'y avait point de travaux qu'il n'entreprît, point de périls qu'il ne sût braver. Voilà ce que l'on s'accorde à nous raconter de sa physionomie et des belles qualités de son âme. Il fut élevé suivant les usages des Perses, qui, différents de la plupart des autres peuples, s'occupent, avant tout, de l'utilité publique. Ailleurs on laisse un père élever ses enfants à son gré. Arrivés à un certain âge, ils vivent eux‑mêmes comme il leur plaît. On leur défend seulement de dérober, de piller, de forcer les maisons, de maltraiter personne injustement, de séduire la femme d'autrui, de désobéir aux magistrats, et quiconque enfreint la loi dans quelqu'un de ces points, est puni. Mais les lois des Perses préviennent le mal et forment les citoyens de manière qu'ils ne soient jamais capables de bassesse ou de perversité. Voici en quoi elles consistent. Le palais du roi et les tribunaux sont bâtis dans une grande place qu'on nomme Eleuthère. On relègue ailleurs les marchands avec leurs marchandises, leurs clameurs et leur grossièreté, ils troubleraient le bel ordre qui règne dans les exercices. Cette place est divisée en quatre parties : la première est destinée pour les enfants, la seconde pour les adolescents, la troisième pour les hommes faits, la dernière pour ceux qui ont passé l'âge de porter les armes. La loi veut qu'ils se trouvent tous les jours, chacun dans leur quartier, les enfants et les hommes faits dès la pointe du jour, les anciens quand ils le peuvent commodément, excepté à certains jours où ils sont obligés de se présenter. Tous les adolescents passent la nuit autour des tribunaux avec leurs armes. On en excepte ceux d'entre eux qui sont mariés. Ils ne s'y rendent que d'après un avertissement. Cependant on n'approuve pas leurs fréquentes absences. Comme la nation des Perses est composée de douze tribus, chacune de ces quatre classes a douze chefs. Les enfants sont gouvernés par douze vieillards élus parmi ceux qu'on croit les plus propres à les bien élever, les adolescents, par ceux d'entre les hommes faits qui paraissent les plus capables de les former à la vertu, les hommes faits, par ceux de leur classe à qui l'on suppose le plus de talent pour exciter les autres à bien remplir leurs devoirs ordinaires, et à suivre les ordres du conseil suprême. Les anciens eux‑mêmes, de peur qu'ils ne manquent aux obligations que la loi leur impose, ont des surveillants choisis dans leur classe. Mais afin de rendre plus sensibles les soins qu'ils prennent pour former d'excellents citoyens, je vais exposer en détail ce que les lois exigent de chacune des classes.
Les enfants se rendent aux écoles pour apprendre la justice ; ils vous disent
qu'ils vont à ce genre d'étude comme on va chez nous s'instruire dans les
lettres. Leurs gouverneurs sont occupés, la plus grande partie du jour, à
juger leurs différends, car il s'en élève entre eux comme parmi les hommes
faits. Ils s'accusent de larcin, de rapine, de violence, de tromperie,
d'injures et de tous autres délits semblables. Une peine est prononcée tant
contre les coupables convaincus que contre ceux qui accusent injustement. On
connaît surtout d'un crime, source de tant de haines parmi les hommes, et
contre lequel il n'est point d'action en justice, l'ingratitude. Si l'on découvre
qu'un enfant qui a reçu un bon office n'est point reconnaissant quand il le
peut, on le punit rigoureusement, parce qu'on pense que les ingrats négligent
les dieux, leurs parents, leur patrie, leurs amis. L'impudence, compagne inséparable
de l'ingratitude, conduit effectivement à tous les vices.
Durant dix années, on leur fait passer les nuits, comme on vient de le dire,
auprès des tribunaux, autant pour la sûreté de la ville que pour s'assurer
de leur sagesse, car cet âge surtout a besoin d'être surveillé. Le jour ils
sont aux ordres des magistrats, pour ce qui peut intéresser la République,
et, s'il est nécessaire, ils se tiennent tous dans leur quartier. Mais
lorsque le roi sort pour la chasse, ce qui arrive plusieurs fois le mois, il
prend avec lui la moitié de ces jeunes gens. Chacun d'eux doit porter un arc,
un carquois plein de flèches, une épée avec le fourreau ou une hache, un
bouclier d'osier et deux javelots, l'un pour lancer, l'autre pour s'en servir
à la main, dans l'occasion. Si les Perses font de la chasse un exercice
public, où le roi marche à la tête de sa troupe, comme pour une expédition
militaire, où il agit lui‑même et veut que les autres agissent, c'est
qu'ils la regardent comme un véritable apprentissage du métier de la guerre.
En effet, la chasse accoutume à se lever matin, à supporter le froid, le
chaud. Elle endurcit à la fatigue des courses et des voyages. D'ailleurs, on
emploie nécessairement contre les animaux que l'on rencontre l'arc et le
javelot. Souvent même, elle aiguise le courage, car si une bête vigoureuse
s'avance impétueusement contre le chasseur, il faut qu'il sache à la fois et
la frapper à son approche et se garantir de ses attaques, en sorte qu'il
n'est rien de ce qui appartient à la guerre qu'on ne retrouve dans la chasse. Ceux des jeunes gens qui restent à la ville s'occupent de ce qu'ils ont appris durant les premières années, à tirer de l'arc, à lancer le javelot, et tous s'y livrent avec une égale émulation. Ces exercices se font quelquefois en public. Alors on propose des prix aux vainqueurs. Si l'une des tribus se distingue par un plus grand nombre de sujets courageux, adroits, obéissants, les citoyens louent et honorent non seulement leur gouverneur actuel, mais celui qui les a élevés dans l'enfance. Au reste, ces jeunes gens sont employés par les magistrats, soit à la garde des endroits qu'il faut surveiller, soit à la recherche des malfaiteurs et à la poursuite des brigands, soit enfin à des entreprises qui demandent vigueur et célérité. Telle est l'éducation des adolescents. Après dix années ainsi employées, ils entrent dans la classe des hommes faits, où ils demeurent vingt‑cinq ans de la manière que je vais dire. D'abord ils se tiennent toujours prêts, comme les adolescents, à l'ordre des magistrats, lorsque le service de la République exige des gens dont l'âge ait mûri l'esprit et n'ait pas encore affaibli le corps. S'il s'agit d'aller à la guerre, ceux qu'on a soumis aux degrés d'éducation dont j'ai parlé ne portent ni arc ni javelot. Ils n'ont que des armes à combattre de près, une cuirasse sur la poitrine, une épée ou une hache à la main droite, au bras gauche un bouclier semblable à celui avec lequel on peint aujourd'hui les Perses. C'est de cet ordre que l'on tire tous les magistrats, excepté ceux qui président à l'éducation des enfants. Au bout de vingt‑cinq ans, lorsqu'ils en ont cinquante accomplis, ils passent, dans la classe de ceux qu'on nomme anciens, et qui le sont réellement. Ceux‑ci ne portent point les armes hors de leur patrie. Ils restent, soit pour veiller aux intérêts communs, soit pour rendre la justice aux particuliers. Ils jugent les crimes capitaux et nomment à tous les emplois. Lorsqu'un adolescent ou un homme fait a violé quelque loi, il est dénoncé par le chef de sa tribu ou par tout autre. Les vieillards entendent l'accusation et dégradent l'accusé, flétrissure qui le rend infâme pour le reste de sa vie. Afin de donner une idée plus claire du gouvernement des Perses, je remonterai un peu plus haut. Ce que j'en ai déjà dit me dispense d'un long détail. On compte dans la Perse environ cent vingt mille hommes. Aucun d'eux n'est exclu par la loi, des charges ni des honneurs. Tous peuvent envoyer leurs enfants aux écoles publiques de justice. Cependant il n'y a que les citoyens en état de nourrir les leurs, sans travail, qui les y envoient, les autres les gardent chez eux. Elevé dans ces écoles, on est admissible à la classe des adolescents. Quiconque n'a pas reçu la première éducation en est exclu. Les adolescents qui ont fourni leur carrière complète peuvent prendre place parmi les hommes faits et être promus comme eux aux magistratures, aux dignités, mais ceux qui n'ont point passé par les deux premières classes n'entrent point dans la troisième. Cette classe conduit, quand on y a vécu sans reproche, à celle des anciens. Celle‑ci se trouve ainsi composée de personnages qui ont parcouru tous les degrés de la vertu.
Telle est la forme de gouvernement par laquelle les Perses croient parvenir à
se rendre meilleurs. Ils conservent encore aujourd'hui des usages qui
attestent et l'austérité de leur régime domestique et leurs continuels
efforts pour le maintenir. Par exemple, il est malhonnête parmi eux de se
permettre en société de cracher, de se moucher, de laisser échapper quelque
signe d'une mauvaise digestion. Il n'est pas moins indécent de s'écarter
pour satisfaire des besoins pressants. Or, sans une extrême sobriété, sans
la pratique des exercices qui consument les humeurs ou en détournent le
cours, leur serait‑il possible d'observer ces bienséances ! Voilà ce que j'avais à dire des Perses en général. Parlons à présent de Cyrus, puisque c'est son histoire que j'entreprends. Racontons ses actions, remontons à son enfance. Cyrus fut élevé, jusqu'à l'âge, de douze ans et un peu plus, suivant ces coutumes. Il l'emportait sur tous ceux de son âge, soit par sa facilité à saisir ce qu'on enseignait, soit par le courage et l'adresse à exécuter ce qu'il entreprenait. Lorsqu'il fut parvenu à l'âge que je viens de dire, Astyage invita Mandane à se rendre auprès de lui avec son fils, qu'il désirait voir sur ce qu'il avait ouï dire de sa beauté et de ses excellentes qualités. Mandane partit pour la cour de Médie, accompagnée de Cyrus. Dès l'abord, à peine reconnaît‑il qu'Astyage est père de Mandane, ce jeune prince, naturellement caressant, l'embrasse avec cet air familier d'un ancien camarade ou d'un ancien ami. Voyant ensuite qu'Astyage avait les yeux peints, le visage fardé et une chevelure artificielle (c'est la mode en Médie, ainsi que de porter des robes et des manteaux de pourpre, des colliers et des bracelets, au lieu que les Perses, encore aujourd'hui, quand ils ne sortent point de chez eux, sont aussi simples dans leurs habits que sobres dans leurs repas), voyant, dis‑je, la parure du prince, et le regardant avec attention : « Oh ! ma mère, que mon aïeul est beau ! ‑ Lequel, reprit la reine, trouves‑tu le plus beau de Cambyse ou d'Astyage ? ‑ Mon père est le plus beau des Perses et mon aïeul le plus beau des Mèdes que j'ai vus sur la route et à la cour. » Astyage, l'embrassant à son tour, le fit revêtir d'une robe magnifique et parer de colliers et de bracelets. Depuis ce moment, il ne sortait plus sans être accompagné de son petit‑fils monté comme lui sur un cheval dont le mors était d'or. Cyrus enfant et ami de l'éclat, flatté d'ailleurs des distinctions, prenait grand plaisir à la belle robe. Sa joie était extrême d'apprendre à monter à cheval, car il est rare de voir des chevaux en Perse, à cause de la difficulté de les élever et de s'en servir dans un pays de montagnes. Astyage soupait un jour avec sa fille et Cyrus, qu'il voulait disposer par la bonne chère à moins regretter la Perse. Sa table était couverte de sauces, de ragoûts et de mets de toute espèce : « O mon papa, s'écria Cyrus, que tu as de peine si tu es obligé de porter la main à chacun de ces plats et de goûter de tous ces mets ! - Eh quoi ! ce souper ne te semble‑t‑il pas meilleur que ceux de la Perse ? ‑ Non, nous avons en Perse une voie plus simple et plus courte pour apaiser la faim. Il ne nous faut que du pain et de la viande sans apprêt, au lieu que vous, qui tendez au même but, vous vous égarez çà et là, et vous n'arrivez qu'avec peine, même longtemps après nous.‑ Mais, mon fils, nous ne sommes pas fâchés de nous égarer ainsi. Tu connaîtras ce plaisir quand tu auras goûté de nos mets. ‑ Cependant, répliqua Cyrus, je vois que tu en es toi‑même dégoûté. ‑ À quoi le vois‑tu ? ‑ C'est que j'ai remarqué que quand tu as touché à ces ragoûts, tu essuies promptement tes mains avec une serviette, comme si tu étais fâché de les voir pleines de sauce, ce que tu ne fais pas quand tu n'as pris que du pain. ‑ Eh bien ! mon fils, use, si tu l'aimes mieux, de viandes sans apprêt, afin de retourner vigoureux dans ton pays. » En même temps il fit servir devant lui un grand nombre de plats, tant de venaison, que d'autres viandes. Alors Cyrus lui dit : « Toutes ces viandes, mon papa, me les donnes‑tu ? puis‑je en faire ce que je voudrai ? ‑ Oui, mon fils, oui, je te les donne. » Sur cette réponse, Cyrus prit les mets, qu'il distribua aux officiers de son grand‑père, en disant à l'un : « Je vous fais ce présent, parce que vous me montrez avec affection à monter à cheval », à un autre, « parce que vous m'avez donné un javelot, et je l'ai encore », à un troisième, « parce que vous servez fidèlement mon grand‑père », à un quatrième, « parce que vous révérez ma mère », et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il eût tout donné. « Et à mon échanson Sacas, que je considère beaucoup, pourquoi ne lui donnes‑tu rien ? » (Sacas était un très bel homme, chargé d'introduire chez Astyage les personnes qui avaient à lui parler, et de renvoyer celles qu'il ne croyait pas à propos de laisser entrer.) Au lieu de répondre, Cyrus, comme un enfant qui ne craint pas d'être indiscret, interroge brusquement son aïeul : « Pourquoi donc as‑tu tant de considération pour Sacas ? ‑ Ne vois‑tu pas, répliqua le roi, en plaisantant, avec quelle dextérité, avec quelle grâce il sert à boire ? » En effet les échansons des rois mèdes servent adroitement ; ils versent le vin avec une extrême propreté, tiennent la coupe de trois doigts seulement et la présentent à celui qui doit boire, de manière qu'il la prenne sans peine. « Eh bien ! dit Cyrus, commande, je te prie, à Sacas de me donner la coupe ; en te servant aussi bien que lui, je mériterai de te plaire ». Astyage y consent, Cyrus s'empare de la coupe, la rince avec grâce, comme il l'avait vu faire à l'échanson, puis composant son visage, prenant un air sérieux et un maintien grave, il la présente au roi, qui en rit beaucoup, ainsi que Mandane. Cyrus lui‑même, riant aux éclats, se jette au cou de son grand‑père, et dit en l'embrassant : « Sacas, te voilà perdu ; je t'enlèverai ta charge, j'en ferai mieux que toi les fonctions ; de plus, je ne boirai pas le vin. » Car lorsque les échansons des rois leur présentent la coupe, ils tirent, avec une cuiller, un peu de la liqueur qu'elle contient, ils la versent dans leur main gauche, et l'avalent. S'ils y avaient mêlé du poison, ils en seraient les premières victimes. Astyage continuant de plaisanter : « Pourquoi, mon fils, dit‑il à Cyrus, voulant imiter Sacas, n'as‑tu pas goûté le vin ? ‑ C'est qu'en vérité j'ai craint qu'on n'eût mis du poison dans le vase. Car, au festin que tu donnas à tes amis, le jour de ta naissance, je vis clairement que Sacas vous avait tous empoisonnés. ‑ Et comment vis‑tu cela ? ‑ C'est que je m'aperçus d'un dérangement considérable dans vos corps et dans vos esprits. Vous faisiez des choses que vous ne pardonneriez pas à des enfants comme moi. Vous criiez tous à la fois, vous ne vous entendiez pas. Vous chantiez ridiculement, et, sans écouter celui qui chantait, vous juriez qu'il chantait à merveille. Chacun de vous vantait sa force. Cependant, lorsqu'il fallut se lever pour danser, loin de faire des pas en cadence, vous ne pouviez même vous tenir fermes sur vos pieds. Tu avais oublié, toi, que tu étais roi, eux, qu'ils étaient sujets. J'appris, pour la première fois, que la liberté de parler consistait dans l'abus que vous faisiez alors de la parole ; car vous ne vous taisiez pas. ‑ Mais, mon fils, ton père ne s'enivre donc jamais ? ‑Non, jamais.‑ Comment fait‑il ? ‑ Quand il a bu, il cesse d'avoir soif, et c'est tout ce que la boisson opère en lui. Aussi n'a‑t‑il point, je pense, de Sacas pour échanson.- Mon fils, lui dit Mandane, tu en veux bien à Sacas ; pourquoi l'attaquer ainsi ? ‑ Parce que je le hais. Souvent, lorsque j'accours avec empressement pour voir le roi, ce méchant me refuse l'entrée. Grand‑papa, laisse‑moi, je te supplie, pour trois jours seulement, le maître absolu de Sacas. ‑ Comment userais‑tu de ton autorité sur lui ? ‑ Je me posterais, comme lui, à l'entrée de ton appartement, et lui dirais, quand il se présenterait pour le dîner : il n'est pas possible de se mettre à table. Le roi est en affaire. Quand il viendrait pour le souper : Le roi est au bain. Si la faim le pressait : Le roi est dans l'appartement des femmes. Enfin je lui rendrais l'impatience qu'il me cause en m'empêchant de te voir. » Cyrus égayait ainsi les soupers. Dans le cours de la journée, si son aïeul ou son oncle désirait quelque chose, on se fût difficilement montré plus empressé que lui, tant il avait à cœur de leur plaire. Lorsque Astyage vit Mandane se disposer à retourner en Perse, il la pria de lui laisser Cyrus. « Je ne souhaite rien tant, répondit‑elle, que de faire tout ce qui vous est agréable. Mais, je l'avoue, j'aurais de la peine à vous laisser mon fils malgré lui. » Sur quoi Astyage dit à Cyrus : « Mon fils, si tu demeures ici, Sacas ne t'empêchera plus d'entrer, quand tu voudras me voir, tu en seras le maître, et plus tu me feras de visites, plus je t'en saurai gré. Tu te serviras de mes chevaux, et d'autres encore, autant que tu en voudras, et quand tu nous quitteras, tu emmèneras ceux qui te plairont le plus. Tes repas, on te servira des mets simples, selon ton goût. Je te donne toutes les bêtes fauves qui sont actuellement dans mon parc. J'y en rassemblerai d'autres de toute espèce, et dès que tu sauras monter à cheval, tu les chasseras, tu les abattras à coups de flèche et de javelot, à l'exemple des hommes faits. Je te procurerai aussi des camarades pour jouer avec toi. Enfin, quelque chose que tu me demandes, tu ne seras pas refusé. »
Dès qu'Astyage eut cessé de parler, Mandane demanda à Cyrus, lequel il
aimait le mieux, de rester ou de s'en retourner. Il répondit aussitôt, sans
balancer, qu'il aimait mieux rester. « Eh ! Pourquoi, reprit Mandane ?
‑ C'est qu'en Perse, je suis reconnu pour le plus adroit de ceux de mon
âge à tirer de l'arc, à lancer le javelot, tandis qu'ici tous l'emportent
sur moi dans l'art de monter à cheval, ce qui m'afflige fort, je te l'avoue.
Or, si tu me laisses ici, et que j'apprenne à bien manier un cheval, j'espère
qu'à mon retour en Perse, je surpasserai ceux que l'on vante tant dans les
exercices à pied, et revenant en Médie, où je serai devenu le meilleur
cavalier, je m'efforcerai de servir mon aïeul à la guerre. ‑ Et la
justice, mon fils, comment l'étudieras‑tu ? tes maîtres sont en Perse.
‑ J'en connais à fond les principes. ‑ Qui t'en répond ? ‑
Le témoignage de mon maître. Il me trouvait déjà tellement instruit sur ce
point, qu'il m'avait établi juge de mes camarades. Un jour cependant je fus
puni très sévèrement, pour avoir mal jugé. Voici l'affaire. Un enfant déjà
grand, dont la robe était courte, ayant remarqué qu'un autre enfant plus
petit avait une longue robe, la lui ôta, s'en revêtit, et lui mit la sienne.
Juge de la contestation, je trouvai convenable que chacun d'eux eût la robe
qui allait le mieux à sa taille. Le maître me corrigea, et me dit que
lorsque j'aurais à prononcer sur la convenance, il faudrait juger comme
j'avais fait, mais puisqu'il s'agissait de décider à qui la robe
appartenait, il fallait examiner lequel devait rester possesseur de la robe ou
celui qui l'avait enlevée ou celui qui l'avait faite ou achetée. Rien de
juste, continuait‑il, que ce qui est conforme aux lois. Tout ce qui y déroge,
est violence. Il voulait donc qu'un juge ne suivît d'autre règle que la loi.
D'après ce principe, ma mère, je sais parfaitement ce qui est juste ; et si
j'ai encore besoin de leçons, Astyage que voici m'instruira. ‑ Mais,
mon fils, les mêmes choses ne sont pas réputées justes en Perse et chez les
Mèdes : par exemple, ici le roi s'est rendu maître absolu, et l'on croit
chez les Perses qu'il est de la justice de vivre égaux en droits. Ton père
le premier ne fait rien que conformément à la loi, ne reçoit rien
au‑delà de ce que la loi détermine. C'est elle, et non sa volonté,
qui règle sa puissance. Songe aux terribles châtiments qui t'accueilleraient
à ton retour en Perse, si tu apportais d'ici, au lieu de maximes royales, ces
maximes tyranniques, suivant lesquelles un seul veut avoir plus que tous les
autres ensemble. ‑ Mais Astyage m'apprendrait plutôt à me contenter de
peu, qu'à désirer beaucoup. Vois comme il accoutume les Mèdes à posséder
moins que lui. Sois donc assurée que ni moi ni personne ne le quitterons avec
des idées ambitieuses. » Tels étalent les propos de Cyrus. Enfin Mandane partit, et son fils resta en Médie, où il fut élevé. Il eut bientôt fait connaissance et formé des liaisons d'amitié avec les jeunes Mèdes. Il se concilia bientôt l'affection des pères, qu'il visitait quelquefois, et qui voyaient sa bienveillance pour leurs fils, de sorte que s'ils avaient quelque grâce à demander au roi, ils les chargeaient d'engager Cyrus à la solliciter. De son côté, Cyrus, généreux, et sensible à la gloire d'obliger, n'avait rien plus à cœur que d'obtenir ce qu'ils désiraient, et quelque chose qu'il demandât, Astyage ne pouvait se résoudre à le refuser. Dans le cours d'une maladie, son petit‑fils ne l'avait pas quitté. Il n'avait cessé de pleurer, et de montrer combien il craignait pour la vie de son aïeul. La nuit, Astyage avait‑il besoin de quelque chose, Cyrus s'en apercevait le premier, il était debout avant tous les autres, pour le servir dans ce qu'il croyait lui être agréable, ce qui lui avait entièrement gagné le cœur d'Astyage. Cyrus aimait peut‑être trop à parler, mais ce défaut venait en partie de son éducation. Son gouverneur l'obligeait de lui rendre compte de ce qu'il faisait, et d'interroger ses camarades, lorsqu'il jugeait leurs différends. D'ailleurs il questionnait beaucoup ceux avec qui il se trouvait. Lui faisait‑on des questions, la vivacité de son esprit lui fournissait de promptes reparties. La réunion de ces différentes causes l'avait rendu grand parleur. Mais comme dans les adolescents qui ont pris de bonne heure leur croissance, on remarque un certain air enfantin qui décèle leur âge, de même le babil de Cyrus annonçait, non la présomption, mais une simplicité naïve jointe au désir de plaire. Aussi aimait‑on mieux l'entendre parler beaucoup, que de le voir silencieux. Lorsqu'en croissant il eut atteint l'âge qui conduit à la puberté, il parla moins et d'un ton plus modéré. Il devint si timide, qu'il rougissait dès qu'il se trouvait avec de plus âgés que lui. Il ne cherchait plus, comme les jeunes chiens, à jouer indistinctement avec tous ceux qu'il rencontrait. Plus posé, il devint aussi tout à fait aimable dans la société. À l'égard des exercices où les jeunes gens se provoquent l'un l'autre, il défiait ses camarades, non dans ceux où il excellait, mais dans les choses où il connaissait leur supériorité, ajoutant qu'il l'emporterait sur eux. Ainsi, quoiqu'il ne fût pas encore ferme à cheval, il y montait le premier pour lancer le javelot ou tirer de l'arc, et il était le premier à rire de sa maladresse, quand il était vaincu. Comme, loin de se rebuter des exercices où il avait du désavantage, il s'y opiniâtrait au contraire pour acquérir ce qui lui manquait, il égala bientôt ceux de son âge dans l'aride l'équitation. Bientôt même, à force d'application, il les surpassa. En peu de temps il eut détruit toutes les bêtes du parc, en les forçant, en les tuant à coups de flèche ou de javelot, au point qu'Astyage ne savait plus où lui en trouver. Cyrus voyant que son aïeul, avec la meilleure volonté, ne pouvait lui procurer des bêtes fauves : « Pourquoi, grand‑papa, te donner tant de peine à m'en chercher ? Si tu me laissais aller à la chasse avec mon oncle, toutes celles que je verrais, je croirais que tu les élèves pour moi. » Il désirait passionnément de chasser hors du parc, mais il n'osait presser le roi comme dans son enfance. Déjà même il le visitait avec plus de réserve. Autrefois il se plaignait de ce que Sacas lui défendait l'entrée. Devenu depuis pour lui‑même un autre Sacas, il ne se présentait point qu'il ne sût si le moment était favorable. Il priait instamment Sacas, de l'avertir quand il était à propos ou non d'entrer, en sorte que Sacas, comme tous les autres, l'affectionnait extrêmement. Cependant Astyage s'apercevant qu'il brûlait de chasser hors du parc, lui permit d'accompagner son oncle, et lui donna des gardes à cheval, d'un âge mûr, qu'il chargea de lui faire éviter les lieux difficiles, et de le garantir de l'attaque des animaux féroces. Cyrus se hâta de demander à ceux qui l'accompagnaient, quelles étaient les bêtes dont l'approche est dangereuse, quelles étaient celles qu'on peut poursuivre sans crainte. « Il en a coûté la vie à plus d'un chasseur, répondirent‑ils, pour avoir vu de trop près les ours, les lions, les sangliers, les léopards : mais les cerfs, les chevreuils, les ânes, les brebis sauvages, ne font aucun mal. » Ils lui disaient encore, que les lieux escarpés n'étaient pas moins à craindre que les bêtes féroces, que d'affreux précipices avaient englouti des cavaliers avec leurs chevaux. Tandis que Cyrus écoutait avec attention, parut un cerf qui fuyait en bondissant. Aussitôt oubliant ce qu'on venait de lui dire, il le poursuit, il ne voit plus que la route que prend l'animal. Mais son cheval s'abat en sautant. Peu s'en faut que Cyrus ne se rompe le cou. Cependant il se retient quoique avec peine. Le cheval se relève ; Cyrus gagne la plaine, atteint le cerf qu'il perce de son dard. Grand et magnifique exploit ! Il s'en applaudissait, lorsque ses gardes l'ayant joint, le réprimandèrent, et lui dirent le danger qu'il avait couru. Ils ajoutèrent qu'ils en avertiraient le roi. Cyrus ayant mis pied à terre, se tenait debout devant eux, chagrin de cette réprimande, lorsque soudain il entend un cri. Hors de lui‑même, il saute sur son cheval, voit un sanglier venir droit à lui, court au‑devant, lui lance son dard avec tant de justesse, qu'il le frappe entre les yeux et l'étend mort. Son oncle blâme sa témérité, mais lui, pour toute réponse, le conjure de lui permettre de porter et de présenter sa chasse au roi. « Si jamais il apprenait que tu as couru ces bêtes, il ne le pardonnerait ni à toi ni à moi qui t'ai laissé faire. ‑ Qu'il me châtie comme il voudra, pourvu que je lui offre mon présent. Et toi‑même, mon oncle, punis‑moi si tu le veux, mais accorde‑moi la grâce que je te demande. ‑ Fais donc ce qui te plaît. Aussi bien, on dirait que tu es déjà notre roi. » Aussitôt, Cyrus fit enlever les deux bêtes, qu'il alla présenter à son aïeul, en lui disant que c'était pour lui qu'il avait chassé. Il ne lui montra pas les dards, mais il les mit encore tout sanglants dans un lieu où il crut qu'il les verrait. « Mon fils, lui dit Astyage, je reçois de bon cœur ton présent ; mais je n'avais pas un tel besoin de cerf et de sanglier, que tu dusses t'exposer au danger. ‑ Eh bien, grand‑papa, si tu n'en as pas besoin, abandonne‑les-moi, je t'en supplie ; je les partagerai entre mes camarades. ‑ Prends, mon fils, et donne non seulement ta chasse, mais encore tout ce que tu voudras, et à qui tu voudras. » Cyrus prit le gibier, et le distribuant à ses camarades : « O mes amis, leur dit‑il, comme nous perdions le temps à chasser dans le parc ! c'était, en quelque sorte, chasser des bêtes à qui l'on eût lié les jambes. Elles étaient emprisonnées dans un espace étroit, maigres et pelées, les unes boiteuses, les autres mutilées. Mais comme les animaux des montagnes et des champs sont beaux ! Qu'ils sont vigoureux ! Comme leur poil est lisse ! Les cerfs s'élançaient vers les nues aussi légers que des oiseaux, les sangliers allaient aux coups, avec cette intrépidité que l'on nous dépeint dans les hommes courageux. Ils sont d'ailleurs si gros, qu'il est impossible de les manquer. Oui, ces deux bêtes, quoique mortes, me paraissent plus belles que celles qu'on enferme vivantes dans le parc. Mais enfin, vos pareils ne vous laisseraient‑ils pas venir à la chasse ? ‑ Sans doute, si Astyage l'ordonnait. ‑ Qui lui en portera la parole ? ‑ Eh ! qui peut mieux que vous le persuader ? ‑ En vérité, je ne conçois pas quel homme je suis. Je n'ose plus ni parler à mon aïeul ni même le regarder en face, comme un autre. Pour peu que cet embarras augmente, je deviendrai tout à fait imbécile, stupide, tandis que dans mon enfance, je parlais plus qu'on ne voulait. ‑ Ce que vous dites là nous effraie ! Quoi, vous ne pourriez plus rien faire pour nous, et nous serions forcés de recourir à d'autres, lorsqu'il dépend de vous de nous servir ? » Ce propos piqua Cyrus. Il les quitta sans répliquer, et après s'être excité lui‑même à prendre de la hardiesse, et avoir réfléchi sur le moyen de faire consentir Astyage, sans le fâcher, à la demande de ses camarades et à la sienne, il entra et lui tint ce discours : « Seigneur, si un de tes esclaves s'était enfui, et que tu l'eusses repris, comment le traiterais‑tu ? ‑ Je le condamnerais à travailler chargé de chaînes. ‑ Et s'il revenait de lui‑même ? - J'ordonnerais qu'on le fouettât, afin qu'il ne retombât pas dans la même faute. Après quoi, je me servirais de lui comme auparavant. ‑ Prépare‑toi donc à me fouetter. Car j'ai le projet de m'enfuir avec mes camarades, pour aller à la chasse. ‑ Tu as bien fait de m'en prévenir. Je te défends de sortir du palais. Il serait beau que j'eusse enlevé à ma fille son enfant, pour en faire mon pourvoyeur. » Cyrus obéit, resta, mais triste, morne et sans proférer une parole. Astyage le voyant dans cet excès d'abattement, le mène à la chasse. Il avait rassemblé, outre les jeunes Mèdes, quantité de cavaliers et de fantassins, et ordonné qu'on lançât les bêtes fauves vers les lieux accessibles aux chevaux. Il y eut donc une grande chasse, où il parut avec une pompe royale. Il défendit à tous les chasseurs de frapper aucun animal, avant que Cyrus fût las d'en tuer. Mais le jeune prince le pria de lever cette défense : « Si tu veux, seigneur, que j'aie du plaisir, permets à tous mes camarades de poursuivre, et de disputer d'adresse entre eux. » Astyage le permit, et se plaça dans un endroit d'où il considérait les chasseurs, qui tantôt attaquaient les bêtes à l'envi, tantôt les poursuivaient et les atteignaient de leurs dards. Il aimait à voir Cyrus, ne pouvant se taire dans l'excès de sa joie, mais semblable à un chien courageux, redoublant ses cris aux approches de sa proie, encourageant les chasseurs, appelant chacun par son nom. Il se réjouissait de l'entendre plaisanter les uns sur leur maladresse, féliciter les autres de leurs succès, sans en être jaloux. Après la chasse, qui fut heureuse, Astyage s'en alla, mais il s'y était tellement diverti, qu'il y retourna, dans ses moments de loisir, accompagné de son petit‑fils, des jeunes Mèdes, par égard pour lui, et de beaucoup d'autres chasseurs. Cyrus passait ainsi la plus grande partie de son temps. Il divertissait et obligeait tout le monde, sans nuire à personne. Il avait quinze ou seize ans, lorsque le fils du roi d'Assyrie, qui était sur le point de se marier, voulut aussi faire une chasse. Ce prince, ayant ouï dire qu'il y avait quantité de bêtes fauves dans la partie des états de son père, qui avoisinait la Médie, où l'on n'avait point chassé pendant la guerre précédente, choisit ce canton. Pour la sûreté de sa personne, il prit avec lui des cavaliers et des peltastes, qui, des bois, devaient lancer le gibier dans la plaine. Arrivé auprès des forteresses défendues par des garnisons, il se fit préparer à souper, comme devant chasser le lendemain. Sur le soir, arrivèrent de la ville voisine, des cavaliers et des fantassins, pour relever la garde. La jonction de ces deux gardes, réunies à son escorte, lui parut former une grande armée. Aussitôt il prend la résolution d'aller piller la Médie. Cette expédition, selon lui plus honorable qu'une chasse, lui procurerait pour les sacrifices un plus grand nombre de victimes. Dès la pointe du jour il met son armée en mouvement. Il laisse son infanterie en bataille sur la frontière, et s'avance, à la tête de sa cavalerie, vers les forteresses des Mèdes. Pendant que plusieurs détachements se répandent dans la campagne, avec ordre d'enlever et d'amener tout ce qui s'offrirait à eux, il retient auprès de lui l'élite de ses gens, et s'arrête en présence des garnisons mèdes, pour empêcher toute sortie sur ses coureurs. Déjà ce plan s'exécute, lorsque Astyage apprend que l'ennemi est entré sur ses terres. Aussitôt il vole au secours de la frontière, avec ce qu'il avait de troupes, accompagné de son fils, qui rassemble à la hâte quelques cavaliers, en ordonnant aux autres de le joindre en diligence. A la vue des troupes assyriennes qui se présentaient rangées en bataille, et de leur cavalerie dans l'inaction, les Mèdes s'arrêtèrent aussi. Cependant Cyrus, témoin de l'ardeur générale à courir sur l'ennemi, ne put contenir la sienne. Son aïeul lui avait donné une très belle armure faite exprès pour lui, et qui allait bien à sa taille. Impatient d'en faire usage, il désespérait d'en voir arriver le moment. Il s'en revêt, monte à cheval, et joint le roi, qui, surpris et ne sachant qui l'avait engagé à venir, lui permet cependant de demeurer près de lui. « Seigneur, lui dit Cyrus, apercevant la cavalerie qui faisait face aux Mèdes, ces hommes immobiles sur leurs chevaux, sont‑ce des ennemis ? ‑ Assurément. ‑ Et ceux qui courent dans la plaine ? ‑ Encore. ‑ Par Jupiter quoi, des gens qui semblent si lâches et si mal montés, osent ainsi nous piller ! Il faut, avec quelques‑uns des nôtres, leur donner la chasse. ‑ Eh, mon fils, ne vois‑tu pas ce gros escadron rangé en bataille ? Si nous faisons un mouvement pour charger les pillards, il tombera sur nous, et nous coupera ; nous ne sommes point encore assez forts. ‑ Mais si tu restes à ton poste, avec les troupes fraîches qui vont arriver, ceux‑ci craindront, ils ne remueront pas, et les pillards voyant des détachements à leur poursuite, lâcheront prise. » Astyage trouva cette idée heureuse. Pénétré d'admiration pour sa présence d'esprit et sa prudence, il ordonne sur‑le‑champ à Cyaxare de marcher contre les coureurs, avec un escadron. « S'ils font un mouvement vers toi, dit‑il, j'en ferai un autre qui les forcera de porter sur moi leur attention. » Cyaxare prit l'élite de la cavalerie, et se mit en marche. Cyrus, qui n'attendait que ce signal, part en même temps. Bientôt il est à la tête de la troupe. Cyaxare et ses cavaliers le suivaient avec ardeur. A leur approche, les pillards abandonnèrent le butin, et fuirent, mais ils furent coupés par les soldats de Cyrus, qui, à son exemple, faisaient main basse sur ceux qu'ils atteignaient. Ceux qui s'étaient échappés en fuyant d'un autre côté, furent poursuivis sans relâche. On fit sur eux des prisonniers. Pour Cyrus, tel qu'un chien courageux, qui ne connaissant point le danger, attaque inconsidérément un sanglier, il ne songeait qu'à frapper l'ennemi, sans rien voir au‑delà. Les Assyriens voyant le danger des leurs, commencèrent à s'ébranler, espérant que la poursuite cesserait, dès qu'on les verrait fondre. Mais, bien loin de ralentir son ardeur, Cyrus poussait toujours plus avant. Transporté de joie, il appelait à grands cris Cyaxare, il pressait vivement l'ennemi. La déroute était générale. Cyaxare le suivait de près, sans doute dans la crainte des reproches de son père. Les autres suivaient aussi. Tous, en cette occasion, se montraient acharnés à la poursuite, même ceux qui eussent manqué de bravoure contre des adversaires en présence. Astyage, remarquant que ses cavaliers poursuivaient avec témérité, et que les Assyriens allaient à leur rencontre, serrés et rangés en bataille, fut alarmé pour Cyaxare et pour Cyrus, du danger qu'ils couraient, s'ils tombaient en désordre sur des troupes bien préparées à les recevoir. Il marcha droit à l'ennemi. Dès que les Assyriens s'aperçurent du mouvement d'Astyage, ils firent halte, le javelot à la main et l'arc bandé, ne doutant pas que les Mèdes ne s'arrêtassent, suivant leur coutume, à la portée du trait. Jusqu'alors, les combats des deux nations n'avaient été que de simples escarmouches. Elles s'approchaient, elles se provoquaient à coups de flèches, souvent des jours entiers. Mais les Assyriens voyant, d'un côté, leurs coureurs se replier sur le corps de l'armée, devant Cyrus qui leur donnait la chasse, de l'autre, Astyage déjà posté avec sa cavalerie à la portée de l'arc, ils se découragèrent et prirent la fuite. Ils furent poursuivis par les troupes réunies d'Astyage, qui firent un grand nombre de prisonniers. Tout ce qui tombait sous leur main, hommes, chevaux, était frappé. On tuait ce qui ne pouvait suivre. L'ennemi. fut poussé ainsi jusqu'au poste de l'infanterie assyrienne, où l'on s'arrêta, crainte de quelque embuscade. Astyage s'en retourna, glorieux de l'avantage de sa cavalerie, mais embarrassé de ce qu'il dirait à Cyrus, car s'il ne pouvait douter que le succès de la journée ne lui fût dû, il avait à lui reprocher son emportement dans l'action. Et de fait, pendant que l'armée se retirait, Cyrus resté seul sur le champ de bataille, le parcourait à cheval contemplant les morts. Ses gardes ne l'en arrachèrent qu'avec peine, pour le mener au roi. Cyrus, en approchant de son aïeul, tâchait de se cacher derrière eux, parce qu'il remarquait sur son visage un air de mécontentement. Voilà ce qui se passa chez les Mèdes. Le nom de Cyrus était dans toutes les bouches. Il devenait l'objet de tous les chants, le sujet de tous les entretiens. Astyage, qui auparavant le considérait, ne put dès lors se défendre de l'admirer. Quelle dut être la joie de Cambyse, en apprenant les exploits de son fils ! Au récit de tant d'actions d'un homme fait, il le rappela pour achever son cours d'éducation, suivant les usages des Perses. On prétend que Cyrus, pour ne point déplaire à son père et ne pas donner lieu aux reproches de ses compatriotes, déclara lui‑même qu'il voulait partir. Astyage, sentant qu'il fallait consentir à son départ, lui donna les chevaux qu'il voulut emmener, et le renvoya comblé de présents. A la tendre amitié qu'il avait pour lui, se joignit l'espoir qu'il serait un jour l'appui de ses amis, la terreur de ses ennemis. À son départ, les enfants, les jeunes gens, les hommes faits, les vieillards, Astyage lui‑même, tous à cheval, l'accompagnèrent. Tous revinrent en pleurant. Ce ne fut pas aussi sans beaucoup de larmes, que Cyrus se sépara d'eux. On assure qu'il distribua à ses jeunes amis une grande partie des présents d'Astyage, qu'il se dépouilla, entre autres, de sa robe médique, pour la donner à un de ses camarades, comme gage de son affection particulière. Ceux qui avaient accepté les présents, les renvoyèrent au roi, qui les fit remettre à Cyrus, mais tout fut renvoyé en Médie. « Si tu veux, écrivait‑il à son aïeul, que je retourne avec honneur dans tes états, permets que chacun garde le don que je lui ai fait. » Astyage se rendit au vœu de son petit‑fils. Je ne dois pas omettre une anecdote amoureuse. Au moment du départ de Cyrus, tous ses parents, près de le quitter, le baisèrent à la bouche, suivant un usage des Perses qui s'observe encore à présent, et prirent ainsi congé de lui. Un Mède distingué par son mérite, qui depuis longtemps était frappé de la beauté de Cyrus, venait de voir donner le baiser du départ. Il attendit que les parents se fussent retirés, puis s'approchant : « Cyrus, lui dit‑il, suis‑je le seul de tes parents que tu méconnaisses ? ‑ Es‑tu aussi mon parent ? ‑ Assurément. ‑ Voilà donc pourquoi tu me fixais. Je crois t'y avoir souvent surpris. ‑ Je désirais en effet de t'aborder. Mais, les dieux m'en sont témoins, je ne l'osais pas. ‑ Tu avais tort, puisque tu es mon parent. » Aussitôt il s'avança vers lui et l'embrassa. Alors le Mède satisfait lui demanda si c'était la coutume en Perse de saluer ainsi ses parents. « Oui, quand on se revoit après quelque absence ou que l'on se quitte. ‑ Tu dois donc m'embrasser encore une fois, car tu vois que je prends congé de toi. » Cyrus l'embrasse, le congédie et se retire. Ils n'avaient pas fait beaucoup de chemin, chacun de leur côté, lorsque le Mède revint sur ses pas, à bride abattue. * Aurais‑tu, lui cria Cyrus, en le voyant, oublié de me dire quelque chose ? ‑ Point du tout, je reviens après une absence. ‑ Oui, mon cher parent, mais qui est bien courte. ‑ Courte, reprit le Mède ! tu ne sais donc pas qu'un clin d'oeil, sans voir un prince si aimable, me paraît d'une bien longue durée ? »
À ce propos, Cyrus, dont les larmes coulaient encore, se mit à rire, et lui
dit en le quittant, de prendre courage, que dans peu de temps il serait de
retour, qu'alors il le verrait tout à son aise, sans cligner les yeux, s'il
le trouvait bon. Cyrus, de retour en Perse, passa encore une année dans la classe des enfants. Ses camarades le plaisantèrent d'abord sur la vie efféminée dont il avait sans doute contracté l'habitude en Médie, mais quand ils virent qu'il s'accommodait de leur nourriture, de leur boisson, et que, si à certains jours de fête on servait quelque mets plus délicat, loin de trouver sa portion trop modique, il en donnait aux autres, enfin lorsqu'ils eurent reconnu qu'à tous égards il leur était supérieur, ils le regardèrent avec admiration. Ce cours terminé, il entra dans la classe des adolescents, et s'y distingua de même par son application aux divers exercices, par sa patience, son respect pour les anciens, et sa soumission aux magistrats.
Cependant Astyage mourut. Cyaxare son fils, frère de la mère de Cyrus, prit
les rennes de la Médie. Dans le même temps, le roi d'Assyrie, après avoir
dompté la nombreuse nation des Syriens, assujetti le roi d'Arabie, soumis les
Hyrcaniens, investi la Bactriane, se persuada qu'il subjuguerait aisément
tous les peuples circonvoisins, s'il affaiblissait les Mèdes, qu'il regardait
comme les plus redoutables. Il dépêcha donc des ambassadeurs vers les
princes et les peuples ses tributaires, Crésus, roi de Lydie, le roi de
Cappadoce, les habitants des deux Phrygies, les Cariens, les Paphlagoniens,
les Indiens, les Ciliciens. Il les chargeait de répandre de mauvaises
impressions contre les Mèdes et les Perses, de représenter que ces deux
nations nombreuses et puissantes, étant amies, et unies par des mariages réciproques,
il était à craindre qu'elles ne parvinssent, si on ne les prévenait, à écraser
les autres en les attaquant successivement. Tous se liguèrent avec lui, les
uns entraînés par ces considérations, d'autres séduits par les présents
et l'or du roi d'Assyrie, prince assez riche pour prodiguer l'un et l'autre. Dès
que Cyaxare, fils d'Astyage, fut informé des desseins et des préparatifs de
la ligue, il ne négligea rien de son côté, pour se mettre en état de défense.
Il députa vers les Perses, et vers leur roi Cambyse son beau‑frère,
avec ordre exprès de voir Cyrus et de le prier, si les Perses donnaient des
troupes aux Mèdes, d'en solliciter le commandement. Telle était l'armée confiée à Cyrus. Dès qu'il eut été nommé, son premier sentiment fut pour les dieux. Il sacrifia sous d'heureux auspices, et prit ensuite ses deux cents homotimes, qui choisirent à leur tour quatre de leurs pareils. Puis les ayant, assemblés tous il leur tint ce discours : « Mes amis, ce n'est pas d'aujourd'hui que je vous connais. Je vous ai choisis, parce que je vous ai vus, depuis votre enfance, aussi constants à observer ce qui est regardé chez nous comme honnête, que fidèles à vous abstenir de ce qui ne l'est pas. Vous allez apprendre par quels motifs j'ai accepté le commandement, et pourquoi je vous assemble ici. Je sais que nos ancêtres nous valaient bien, qu'aucune vertu ne leur était étrangère, mais je ne puis voir quel bien en a résulté, soit pour eux, soit pour la République. Il me semble néanmoins qu'on ne pratique la vertu que pour jouir d'un meilleur sort que ceux qui la négligent. Celui qui se prive d'un plaisir présent, ne le fait pas dans le dessein de n'en goûter jamais aucun. C'est au contraire, afin de se préparer, par cette privation même, des jouissances plus vives pour un autre temps. Celui qui ambitionne de briller dans la carrière de l'éloquence, n'a pas pour but de haranguer sans cesse. Il espère qu'en acquérant le don de la persuasion, il sera un jour utile à la société. Il en est de même de celui qui se dévoue au métier des armes. Ce n'est pas pour combattre sans relâche, qu'il se livre à de pénibles exercices. Il se flatte que, devenu habile guerrier, il partagera avec sa patrie la gloire, les honneurs et la prospérité qui couronneront ses talents militaires. Si parmi ces hommes il s'en trouvait qui, après de longs travaux, eussent été prévenus par la vieillesse, sans avoir su tirer aucun profit de leurs peines, je les comparerais à un laboureur qui, jaloux de sa profession, sèmerait et planterait avec le plus grand soin, et qui ensuite, au lieu de récolter ses grains, de cueillir ses fruits dans la saison, les laisserait tomber à terre ou bien à un athlète, qui après s'être laborieusement exercé, et s'être mis en état de mériter le prix, finirait par ne pas entrer dans la lice, car il me semble qu'on pourrait aussi, sans injustice, taxer un tel homme de folie.
Amis, qu'un tel malheur ne nous arrive point et puisque la conscience nous dit
que nous avons, dès l'enfance, contracté l'habitude du courage et de la
vertu, marchons à l'ennemi, que je sais, pour l'avoir vu de près, être
incapable de tenir contre nous. On n'est point bon soldat, pour savoir tirer
de l'arc, lancer le javelot, ou manier un cheval si dans les grandes occasions
on se laisse vaincre par la fatigue et les veilles. Or les Assyriens, peuple
mou, ne peuvent ni soutenir les travaux ni résister au sommeil. On n'est pas
bon soldat, si, habile d'ailleurs, on n'a pas appris comment on doit se
conduire avec les alliés et avec les ennemis. Or il est clair qu'ils ignorent
cette science importante. Vous, au contraire, vous savez user de la nuit comme
les autres usent du jour, pour vous, le travail est la route du plaisir. La
faim vous sert d'assaisonnement. Vous buvez l'eau avec plus de volupté que
les lions même. Enfin vous avez pénétré vos aînés de cette noble
passion, qui fait les guerriers, puisque vous aimez la louange avant tout. Or
les hommes sensibles à la louange, vont au‑devant de ce qui la procure,
et supportent pour elle avec joie les fatigues et les dangers. Au reste, si je
vous parlais ainsi contre ma pensée, ce serait me tromper moi‑même,
puisque si vous me démentiez, le blâme de l'événement retomberait sur moi.
Mais non, mes espérances ne seront point trompées. J'en ai pour garants ma
propre expérience, votre attachement pour moi, et la démence de nos ennemis.
Marchons avec confiance. Nous ne craignons point le titre d'usurpateurs. Une
nation ennemie donne, par ses hostilités, le signal de la guerre, une nation
amie réclame notre secours. Est‑il rien de plus juste que de repousser
la violence, rien de plus beau que de servir ses amis ? Vous avez encore un
puissant motif de confiance, c'est que dans cette expédition, je n'ai point négligé
les dieux. Vous savez, vous avec qui j'ai vécu si longtemps, que dans les
petites comme dans les grandes entreprises, je commence toujours par les
implorer. Mais à quoi bon vous en dire davantage ? Choisissez les hommes que
l'état vous accorde. Faites vos préparatifs, et marchez vers la Médie. Je
vous suivrai de près. Il faut qu'auparavant je voie mon père. Instruit de l'état
des ennemis, je ferai tout pour assurer, avec l'aide des dieux, le succès de
nos armes. » Tous s'empressèrent d'exécuter ses ordres. Cyrus, de retour auprès de son père, implora Vesta, Jupiter et les autres divinités domestiques, puis il partit. Cambyse l'accompagna jusqu'à la frontière. Ils étaient à peine sortis du palais, que les éclairs brillèrent. On entendit quelques coups de tonnerre d'un augure favorable. À ces signes manifestes de la protection du grand Jupiter, ils continuèrent leur route, sans attendre d'autres présages.
« Mon fils, dit Cambyse à Cyrus en marchant, il est évident par les
sacrifices et par les signes célestes, que les Dieux nous sont propices. Je
pense que tu en es toi‑même convaincu, car je me suis appliqué à te
donner cette intelligence. Je voulais que tu connusses sans interprète leurs
volontés, que pour voir et pour entendre, tu n'eusses recours ni aux yeux, ni
aux oreilles des devins, qui, s'ils le voulaient, te tromperaient par une
fausse explication des prodiges, que, faute de devins, tu ne fusses pas
embarrassé à expliquer les signes, enfin, que possédant l'art divinatoire,
tu susses exécuter ce que les dieux te prescriraient. ‑ Mon père, répondit
Cyrus, je ferai de continuels efforts pour mériter, comme tu dis, que les
dieux ne nous envoient que des avertissements salutaires. Je me souviens de
t'avoir ouï dire un jour, qu'un moyen efficace de s'assurer leur protection,
c'était de ne pas attendre la détresse pour recourir à eux, mais de les
honorer surtout dans les temps de prospérité. Tu ajoutais qu'on en devait
agir ainsi à l'égard de ses amis. ‑ Ainsi, mon fils, tu implores les
dieux avec plus de confiance, parce que tu leur rends assidûment hommage. Tu
espères en obtenir des faveurs, parce que tu ne te reproches point de les
avoir négligés. ‑ Oui, mon père, je me persuade que je suis aimé des
dieux. ‑ Te le rappelles‑tu, mon fils ? Nous convenions encore,
qu'en quelque situation qu'ils nous placent, l'homme instruit agira toujours
mieux que l'ignorant, que l'homme actif fera plus que l'indolent, que l'homme
sage vivra plus heureux que l'imprudent, qu'enfin l'on ne doit solliciter les
faveurs des dieux, qu'en se montrant digne de les recevoir. ‑ Je me le
rappelle très bien, et j'étais forcé d'en convenir. Tu ajoutais encore,
qu'il n'est pas même permis de demander aux dieux de sortir victorieux d'un
combat à cheval, lorsqu'on n'a point appris l'équitation, de l'emporter sur
d'habiles archers, quand on ne sait pas tirer de l'arc, de gouverner sagement
un vaisseau, lorsqu'on ignore la manœuvre, d'avoir une abondante moisson,
quand on n'a point semé, d'échapper aux périls de la guerre, lorsqu'on ne
pourvoit pas à sa défense. Ces vœux, disais‑tu, sont contraires à
l'ordre établi par la divinité. Il est aussi juste qu'ils ne soient point
exaucés, qu'il l'est parmi nous que ceux qui forment une demande contraire à
la loi, essuient un refus.‑ Mon fils, as‑tu oublié ce que nous
disions encore, que si un citoyen qui se comporte en homme vertueux, et qui
par son industrie vit dans l'aisance avec sa famille, mérite des éloges, on
doit certainement de l'admiration à celui qui se trouvant chargé de
commander aux autres, sait pourvoir abondamment le devoir ! ‑ Je m'en
souviens à merveille. Il me
semblait, comme à toi, qu'il n'y a rien de plus difficile que de bien
gouverner, et je me confirme dans cette pensée, quand je réfléchis sur le
gouvernement en lui‑même. Mais lorsque je jette les yeux sur les autres
nations, et que je considère quels chefs elles ont à leur tête, surtout
quels ennemis nous avons à combattre, il me semble qu'il serait honteux de
les redouter, et de ne pas marcher avec assurance à leur rencontre. Tous, à
commencer par nos alliés que voici, s'imaginent que la différence du prince
à ses sujets, consiste en ce que le prince vit à plus grands frais, qu'il a
plus d'argent dans son trésor, qu'il dort plus longtemps et travaille moins.
Selon moi, au contraire, le prince doit se distinguer de ses sujets, non par
une vie plus oisive, mais par l'activité, la prévoyance, l'amour du travail.
‑ Mais, mon fils, il est des obstacles qui viennent, non des hommes,
mais des choses mêmes, et qu'il n'est pas facile de surmonter. Tu sens, par
exemple, que ton commandement expirerait bientôt, si ton armée manquait de
munitions.‑ Oui, mais
Cyaxare a dit qu'il en fournirait pour toutes les troupes qui partiraient
d'ici. ‑ Quoi ! tu pars plein de confiance dans les trésors de Cyaxare
? ‑ Assurément.‑ Connais‑tu bien l'état de ses finances ?
‑ Non, en vérité. ‑ Ainsi tu comptes sur ce que tu ne vois pas.
Sais‑tu donc que tu éprouveras une foule de besoins, qu'à présent même
tu es forcé de faire de grandes dépenses ? ‑ Je le sais. ‑ Mais,
si les fonds manquent à Cyaxare ou qu'il veuille manquer de parole, que
deviendra ton armée ? Sans doute, les affaires iront mal. ‑ De grâce,
mon père, si tu sais quelque moyen qui soit en mon pouvoir pour assurer la
subsistance d'une armée, enseigne‑le-moi, tandis que nous sommes encore
en pays ami. ‑ Quoi ! mon fils, tu me demandes quels sont les moyens
pour approvisionner une armée ? Mais qui est plus en état de les trouver,
que celui qui a la force en main ? Tu pars d'ici avec un corps d'infanterie,
que tu ne changerais pas contre un autre beaucoup plus nombreux ; et tu seras
joint par la cavalerie mède, dont on connaît la supériorité. Avec de
telles forces, quelle nation voisine ne s'empressera de te secourir ou pour
devenir ton amie ou pour éviter quelque malheur ? Prends si bien tes mesures
de concert avec Cyaxare, que jamais ton armée ne manque du nécessaire.
Occupe‑toi d'approvisionnements, ne fût‑ce que pour rendre tes
soldats industrieux, et surtout souviens‑toi de ne jamais attendre, pour
t'emplir tes magasins, que la nécessité t'y contraigne. C'est pendant
l'abondance qu'il faut se précautionner contre la disette. Tu obtiendras plus
aisément ce que tu demanderas, quand tu paraîtras n'être pas dans le
besoin. Cette prévoyance, mon fils, en prévenant les murmures des troupes,
te conciliera encore le respect des étrangers. Tes soldats, quand rien ne
leur manquera, marcheront de bon cœur, soit pour attaquer l'ennemi, soit pour
protéger un allié, et tes discours auront d'autant plus de poids, qu'on te
verra plus en état de faire du bien ou du mal. ‑ Mon père, une autre vérité
non moins constante, c'est que mes soldats ne me sauront aucun gré de ce
qu'ils vont recevoir, car ils savent à quelle condition les appelle Cyaxare,
au lieu que si je leur accorde quelque gratification, ils en seront flattés,
et mes libéralités m'assureront leur attachement. Un général qui, avec des
forces suffisantes, tant pour aider des amis qui le serviront à leur tour que
pour s'enrichir aux dépens de l'ennemi, négligerait de faire des largesses,
serait, à mon avis, aussi blâmable qu'un homme qui, possédant des terres,
et des esclaves pour les cultiver, laisserait ses champs en friche et sans
produit. Sois donc persuadé, mon père, que jamais en pays ami ou ennemi je
n'oublierai de pourvoir aux besoins des troupes. ‑ Te souviens‑tu,
mon fils, de quelques autres points qui semblaient commander notre attention ?
‑ Oh ! je n'ai point oublié ce jour où j'allai te demander de l'argent
pour payer le maître qui prétendait m'avoir appris la science d'un général
d'armée. En me comptant cet argent, tu me fis à peu près ces questions :
Mon fils, cet homme à qui tu portes le prix de ses leçons, t'en
a‑t‑il donné sur l'économie militaire ? car les soldats ont les
mêmes besoins que les serviteurs d'une maison. Je t'avouai de bonne foi que
mon maître ne m'en avait pas dit un seul mot.
Ensuite tu demandas s'il m'avait parlé des moyens d'entretenir la
vigueur et la santé, objets dont un général ne doit pas moins s'occuper que
des détails du commandement. T'ayant répondu que non, tu me demandas s'il
m'avait donné quelque méthode pour perfectionner les soldats aux exercices
militaires. - Non répondis‑je encore. - T'a‑t‑il,
repris‑tu, enseigné l'art de leur inspirer de l'ardeur ? Car en tout,
l'ardeur ou la nonchalance rend le succès bien différent. - Quand je t'eus
encore répondu non, tu voulus savoir s'il m'avait instruit à rendre le
soldat obéissant. Comme tu vis qu'il n'en avait rien fait, tu me demandas
enfin ce qu'il m'avait enseigné pour qu'il prétendît m'avoir formé à
l'art de commander une armée. Je te répliquai qu'il m'avait appris à la
ranger en bataille. Tu te mis à rire, puis, reprenant chacune de tes
questions, à quoi sert, me dis‑tu, de savoir ranger une armée en
bataille quand elle manque de subsistances, qu'elle est en proie aux maladies,
que les troupes ignorent les ruses de la guerre, qu'elles sont mal disciplinées
? Lorsque tu m'eus démontré que l'ordre de bataille n'est qu'une petite
partie de la science du général, je te demandai si tu pouvais m'enseigner
les autres. Tu me conseillas d'aller m'entretenir avec des militaires les plus
célèbres dans leur art et de les interroger sur chacun de ces objets. Depuis
ce moment j'ai fréquenté ceux que j'entends citer comme les plus expérimentés.
Quant aux vivres, je crois suffisants ceux que Cyaxare s'est engagé de nous
fournir. Pour ce qui concerne la santé, comme j'ai ouï dire et vu par
moi‑même que les généraux, à l'exemple des villes qui ont des médecins
pour les cas de maladie, en mènent toujours quelques‑uns à la suite de
l'armée pour traiter les soldats, je me suis occupé de cet objet dès le
moment de ma nomination, et je me flatte, mon père, que j'aurai avec moi les
plus habiles gens.‑ Semblables aux ouvriers, qui raccommodent les habits
déchirés, ces hommes dont tu parles, mon fils, ne réparent que la santé
des malades, mais il est un soin digne de toi, celui de prévenir les
maladies. - Mon père, que faire pour y réussir ? ‑ Lorsque tu te
proposeras de séjourner longtemps dans un pays, tu commenceras par choisir un
lieu sain pour camper. Avec de l'attention tu n'y seras pas trompé, car le
peuple répète sans cesse que l'air est salubre en tel endroit, malsain dans
tel autre. Pour en juger sûrement, examine la constitution physique des
habitants et la couleur de leur teint. Mais ce n'est pas assez de connaître
la nature du climat. Songe comment tu entretiens toi‑même ta santé. -
D'abord, je ne surcharge point mon estomac, ce qui est très nuisible, ensuite
j'aide ma digestion par l'exercice. Je crois ce régime excellent pour
conserver ma santé et me fortifier. ‑ Eh bien ! gouverne ainsi tes
soldats. ‑ Mon père, leur restera‑t‑il du temps pour les
exercices ? ‑ Il le faut, puisque cela est nécessaire. Une armée bien
tenue doit toujours s'occuper, soit à nuire à l'ennemi, soit à se procurer
quelque avantage, car s'il est malaisé de nourrir un seul homme oisif, et
plus encore, mon fils, une famille entière, rien de plus difficile que de
faire subsister dans l'inaction une armée composée d'un nombre infini de
bouches ; et qui entre ordinairement en campagne avec peu de vivres qu'elle ne
sait point économiser. Une armée ne doit donc jamais restera oisive. ‑
Ainsi, mon père, un général indolent, selon toi, ne vaut pas mieux qu'un
laboureur paresseux. ‑ Sans doute. Mais j'affirme qu'un général actif
saura, à moins que quelque dieu ne s'y oppose, approvisionner l'armée et y
entretenir la santé. ‑ A l'égard des manœuvres militaires, je pense,
mon père, que pour y former les soldats et les trouver tout exercés dans
l'occasion, il serait à propos d'établir des jeux où l'on proposerait des
prix aux vainqueurs. ‑ Excellente idée ! mon fils. En la suivant tu
verras tes troupes exécuter leurs évolutions avec cette précision que tu
remarques dans un chœur de danse ou de musique. - Des espérances flatteuses
ne seraient‑elles pas un bon moyen d'exciter l'ardeur des troupes ?
‑ Oui, mais ne ressemble pas au chasseur qui pour animer ses chiens les
rappellerait toujours du ton dont il leur parle quand il a vu la bête. Les
chiens d'abord accourent à sa voix, mais s'il les a trompés, ils finissent
par ne plus lui obéir, lors même qu'il découvre le gibier. Il en est de même
des espérances. Un homme qui aurait souvent donné de fausses promesses
finirait par ne plus persuader, lors même qu'il serait de bonne foi. Un général,
mon fils, ne doit rien avancer dont il ne soit parfaitement sûr, quoique le
contraire puisse quelquefois réussir. Il lui importe de réserver pour les
plus grands dangers des encouragements qui obtiennent une confiance
absolue.‑ En vérité, mon père, ce que tu dis est sage, et je le
mettrai volontiers en pratique. Quant à l'art de rendre les soldats dociles,
je crois n'y être pas étranger. Tu m'en as donné des leçons dès mon
enfance, en me pliant à l'obéissance et me confiant ensuite à des maîtres
qui m'ont fortifié dans cette habitude. Arrivé dans la classe des
adolescents, notre gouverneur
nous surveillait fortement sur ce point, et d'ailleurs la plupart des lois ne
semblent faites que pour enseigner à commander et à obéir. Après avoir
beaucoup réfléchi sur cette matière, je vois que le secret le plus efficace
pour porter à la subordination est de louer et de récompenser l'obéissance,
de punir au contraire et de noter d'infamie les rebelles. ‑ Oui bien,
pour obtenir une obéissance forcée, mais pour qu'elle soit volontaire, ce
qui est préférable, il est un chemin plus court. Les hommes se soumettent très
volontiers à celui qu'ils croient plus éclairé qu'eux‑mêmes sur
leurs propres intérêts. Entre mille exemples, vois avec quel empressement
les malades appellent le médecin qui leur ordonnera ce qu'ils doivent faire.
Vois comme dans un vaisseau tout l'équipage obéit au pilote, comme dans une
route le voyageur s'attache constamment à ceux qu'il croit savoir les chemins
mieux que lui. Mais si l'on pense que l'obéissance sera nuisible, point de châtiment
qui puisse contraindre, point de récompense qui encourage. Quel homme
recevrait un funeste bienfait ! ‑ Ainsi donc, mon père, selon toi, pour
avoir des hommes obéissants, rien de mieux que de passer dans leur esprit
pour être plus sage qu'eux. ‑ Assurément. ‑ Mais comment en peu
de temps donner de soi cette opinion ? ‑ Le moyen le plus simple de paraître
intelligent, c'est de l'être en effet. Quelques comparaisons te prouveront
que je dis vrai. Je suppose que tu veuilles sans talent passer pour bon
laboureur, pour bon écuyer, pour savant médecin, pour excellent joueur de flûte,
enfin, pour habile dans un genre quelconque, à combien d'artifices te
faudra‑t‑il recourir pour établir ta réputation En vain tu
gagnerais des prôneurs, en vain tu serais muni de ce qui convient à chacun
de ces arts. Si tu en imposais d'abord, bientôt la première épreuve
mettrait à découvert et ton imposture et ta sotte vanité. ‑ Mais
comment acquérir un fonds de connaissances dans une partie qui doit être
utile ? ‑ C'est, mon fils, en étudiant tout ce qui est à la portée de
l’esprit humain, comme tu as étudié la tactique. Dans ce qui est
au‑dessus des lumières et de la prévoyance humaine, tu surpasseras les
autres hommes en intelligence si tu consultes les dieux par l'organe des
devins, et si d'ailleurs tu exécutes ce que tu auras jugé le meilleur, car
jamais l'homme prudent ne se néglige sur ce point. Au reste, pour être aimé
de ceux que l'on commande, ce qui est de la plus haute importance, on tiendra
la même conduite que si l'on désirait se faire des amis, je veux dire qu'il
faut donner des preuves évidentes de son bon cœur. Je sais, mon fils, qu'on
ne peut pas, à cet égard, tout ce qu'on veut ! Du moins on se réjouit avec
eux du bien qui leur arrive, on s'afflige du malheur qu'ils éprouvent, on
s'empresse à les secourir dans leur infortune, on leur montre de l'inquiétude
sur les périls qui les menacent, on s'occupe du soin de les en garantir. Tu
leur dois sur tout ces marques d'attachement. Dans une campagne d'été, il
faut qu'on remarque le courage du chef à supporter l'ardeur du soleil. Il
faut en hiver, qu'il endure le plus de froid. Lorsqu'il s’agit de
travailler, qu'il se montre le plus laborieux, car tout cela gagne le cœur
des soldats. ‑ Ainsi, mon père, tu prétends qu'un général doit mieux
soutenir la fatigue que ceux qu'il commande. ‑ Oui, sans doute cependant
ne t'alarme pas. Sache, mon fils,
que les mêmes travaux n'affectent pas également le corps d'un général et
celui d'un simple soldat. Ils sont adoucis pour celui‑là, par
l'honneur, et par la certitude que pas une de ses actions ne reste ignorée.
‑ Mais, mon père, quand l'armée est fournie de munitions, que les
soldats sont sains, infatigables, exercés aux manœuvres
militaires, impatients de signaler leur bravoure, aimant mieux obéir
que se refuser au commandement, ne juges‑tu pas qu'il est à propos d'en
venir promptement aux mains avec l'ennemi ? ‑ Assurément, si l'on espère
le faire avec avantage. Autrement, plus je compterais sur ma valeur et celle
de mes troupes, plus je serais circonspect, par la raison que plus une chose
est précieuse, plus on est attentif à la mettre en sûreté. ‑
Et comment se procurer sur ses ennemis un avantage certain ? - La
question que tu me fais n'est pas des moins importantes, et ne se résout pas
sur‑le‑champ. Apprends, mon fils, que pour réussir, il faut
savoir tendre des pièges, dissimuler, ruser, tromper, dérober, piller, et
savoir tout cela mieux que l'ennemi. ‑ Par Hercule, s'écria Cyrus, en
riant aux éclats, quel homme tu veux que je devienne
‑ Un homme tel qu'il n'y en aura point de plus justes, de plus
ami des lois. ‑ Pourquoi donc nous enseigniez‑vous tout le
contraire dans l'enfance et dans l'adolescence ? ‑ On vous
l'enseignerait encore pour vivre avec vos concitoyens et vos amis. Mais ne
vous rappelez‑vous pas que pour nuire à l'ennemi, vous appreniez
quantité de moyens ? ‑ Moi, mon père, je n'en apprenais aucun. ‑
Pourquoi appreniez‑vous à tirer de l'arc, à lancer le javelot,
à pousser vers les toiles ou dans les pièges les sangliers et les cerfs ?
Pourquoi, au lieu d'attaquer de front les lions, les ours, les léopards,
cherchiez‑vous toujours à les combattre sans danger ? Ne vois‑tu
pas dans tout cela des ruses, des
tours d'adresse, des supercheries, des moyens d'avoir sur eux l'avantage ?
‑ Oui, contre les bêtes, mais je sais bien que quand je laissais voir
seulement l'intention de tromper un homme j'étais sévèrement puni. Je ne te dirai point comment il faut ranger une armée en bataille, régler sa marche de jour ou de nuit, dans des défilés ou dans de grandes routes, dans le plat pays ou dans les montagnes, comment il faut asseoir un camp, poser des sentinelles, soit pour la nuit, soit pour le jour, mener les troupes à l'ennemi ou ordonner la retraite, les conduire à l'attaque d'une place, approcher des murs ou s’en tenir éloigné, comment on assure le passage des bois, des rivières, quelles mesures on prend contre la cavalerie, les lanciers, les archers, quelle disposition tu feras, si l'ennemi vient à toi pendant que tu marches en colonne, quel mouvement tu dois faire, si tandis que tu marches en ordre de bataille, il se prépare à t'attaquer en queue ou en flanc, enfin, par quel moyen tu peux découvrir ses projets et lui cacher les tiens. Plus d'une fois je t'ai dit sur cela tout ce que je savais. D'ailleurs, tu n’as négligé aucun des militaires qui te paraissaient instruits, et tu as profité de leurs connaissances. Il ne s'agit plus, ce me semble que d'user à propos des moyens que tu jugeras convenables. Mais ce qui est bien important, apprends de moi, mon fils, à ne jamais, au mépris des auspices, exposer ta personne ou ton armée, persuadé que les hommes n'ont pour se conduire que des conjectures, et qu'ils ignorent quel projet doit tourner à leur avantage. Juges‑en par des exemples. Combien d'hommes, réputés habiles politiques, ont conseillé de porter la guerre à des ennemis qui ont écrasé le peuple séduit par un fatal conseil ! Combien, après avoir contribué à l'élévation d'un particulier, à l'agrandissement d'une République, ont vu leurs services payés des plus indignes traitements ! Les uns ont mieux aimé pour esclaves que pour amis, des gens avec qui ils pouvaient avoir un commerce réciproque de bons offices. L'amour propre offensé les en a punis. Les autres, non contents de jouir agréablement de leur portion de biens, jaloux de tout envahir, ont été dépouillés même de ce qui leur appartenait. D'autres, après avoir amassé de cet or, objet de tant de vœux, sont morts victimes de leur cupidité. Tant il est vrai que la prudence humaine ne sait pas mieux choisir que le hasard ! Mais les dieux, ô mon fils, qui tiennent à tous les temps, connaissent également le passé, le présent, et ce que doit amener. Chacun de ces termes avertissent les mortels qui les consultent et qu'ils regardent d'un oeil favorable de ce qu'il faut faire ou éviter. Qu'on ne s'étonne pas si tous les hommes n'obtiennent pas leurs faveurs : les dieux ne sont pas obligés de les accorder à ceux qu'il ne leur plaît pas de protéger. |