TACITE
ANNALES
LIVRE QUATORZIÈME.
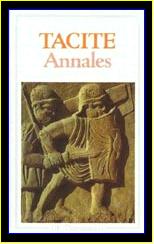
|
Ce livre renferme un espace d'environ quatre ans.
A. de
R. de J.
C.
consuls 59 A Rome Poppée contre Agrippine I. Sous le consulat de C. Vipstanus et de Fontéius, Néron ne différa plus le crime qu'il méditait depuis longtemps. Une longue possession de l'empire avait affermi son audace, et sa passion pour Poppée devenait chaque jour plus ardente. Cette femme, qui voyait dans la vie d'Agrippine un obstacle à son mariage et au divorce d'Octavie, accusait le prince et le raillait tour à tour, l'appelant un pupille, un esclave des volontés d'autrui, qui se croyait empereur et n'était pas même libre. "Car pourquoi différer leur union ? Sa figure déplaît apparemment, ou les triomphes de ses aïeux, ou sa fécondité et son amour sincère ? Ah! l'on craint qu'une épouse, du moins, ne révèle les plaintes du sénat offensé et la colère du peuple, soulevée contre l'orgueil et l'avarice d'une mère. Si Agrippine ne peut souffrir pour bru qu'une ennemie de son fils, que l'on rende Poppée à celui dont elle est la femme : elle ira, s'il le faut, aux extrémités du monde ; et, si la renommée lui apprend qu'on outrage l'empereur, elle ne verra pas sa honte, elle ne sera pas mêlée à ses périls." Ces traits, que les pleurs et l'art d'une amante rendaient plus pénétrants, on n'y opposait rien : tous désiraient l'abaissement d'Agrippine, et personne ne croyait que la haine d'un fils dût aller jamais jusqu'à tuer sa mère. L'inceste ? II. Cluvius rapporte qu'entraînée par l'ardeur de conserver le pouvoir, Agrippine en vint à ce point, qu'au milieu du jour, quand le vin et la bonne chère allumaient les sens de Néron, elle s'offrit plusieurs fois au jeune homme ivre, voluptueusement parée et prête à l'inceste. Déjà des baisers lascifs et des caresses, préludes du crime, étaient remarqués des courtisans, lorsque Sénèque chercha, dans les séductions d'une femme, un remède aux attaques de l'autre, et fit paraître l'affranchie Acté. Celle-ci, alarmée tout à la fois pour elle-même et pour l'honneur de Néron, l'avertit "qu'on parlait publiquement de ses amours incestueuses ; que sa mère en faisait trophée, et qu'un chef impur serait bientôt rejeté des soldats." Selon Fabius Rusticus, ce ne fut point Agrippine, mais Néron, qui conçut un criminel désir ; et la même affranchie eut l'adresse d'en empêcher le succès. Mais Cluvius est ici d'accord avec les autres écrivains, et l'opinion générale penche pour son récit ; soit qu'un si monstrueux dessein fût éclos en effet dans l'âme d'Agrippine, soit que ce raffinement inouï de débauche paraisse plus vraisemblable chez une femme que l'ambition mit, encore enfant, dans les bras de Lépide, que la même passion prostitua depuis aux plaisirs d'un Pallas, et que l'hymen de son oncle avait instruite à ne rougir d'aucune infamie. Comment tuer sa mère ? III. Néron évita donc de se trouver seul avec sa mère, et, quand elle partait pour ses jardins et pour ses campagnes de Tuscule et d'Antium, il la louait de songer au repos. Elle finit, en quelque lieu qu'elle fût, par lui peser tellement, qu'il résolut sa mort. Il n'hésitait plus que sur les moyens, le poison, le fer, ou tout autre. Le poison lui plut d'abord ; mais, si on le donnait à la table du prince, une fin trop semblable à celle de Britannicus ne pourrait être rejetée sur le hasard ; tenter la foi des serviteurs d'Agrippine paraissait difficile, parce que l'habitude du crime lui avait appris à se défier des traîtres ; enfin, par l'usage des antidotes, elle avait assuré sa vie contre l'empoisonnement. Le fer avait d'autres dangers : une mort sanglante ne pouvait être secrète, et Néron craignait que l'exécuteur choisi pour ce grand forfait ne méconnût ses ordres. Anicet offrit son industrie : cet affranchi, qui commandait la flotte de Misène, avait élevé l'enfance de Néron, et haïssait Agrippine autant qu'il en était haï. Il montre "que l'on peut disposer un vaisseau de telle manière, qu'une partie détachée artificiellement en pleine mer la submerge à l'improviste. Rien de plus fertile en hasards que la mer : quand Agrippine aura péri dans un naufrage, quel homme assez injuste imputera au crime le tort des vents et des flots ? Le prince donnera d'ailleurs à sa mémoire un temple, des autels, tous les honneurs où peut éclater la tendresse d'un fils." Le crime se fera sur la mer IV. Cette invention fut goûtée, et les circonstances la favorisaient. L'empereur célébrait à Baïes les fêtes de Minerve ; il y attire sa mère, à force de répéter qu'il faut souffrir l'humeur de ses parents, et apaiser les ressentiments de son coeur : discours calculés pour autoriser des bruits de réconciliation, qui seraient reçus d'Agrippine avec cette crédulité de la joie, si naturelle aux femmes. Agrippine venait d'Antium ; il alla au-devant d'elle le long du rivage, lui donna la main, l'embrassa et la conduisit à Baules (1) ; c'est le nom d'une maison de plaisance, située sur une pointe et baignée par la mer, entre le promontoire de Misène et le lac de Baïes (2). Un vaisseau plus orné que les autres attendait la mère du prince, comme si son fils eût voulu lui offrir encore cette distinction ; car elle montait ordinairement une trirème, et se servait des rameurs de la flotte : enfin, un repas où on l'avait invitée donnait le moyen d'envelopper le crime dans les ombres de la nuit. C'est une opinion assez accréditée que le secret fut trahi, et qu'Agrippine, avertie du complot et ne sachant si elle y devait croire, se rendit en litière à Baies. Là, les caresses de son fils dissipèrent ses craintes ; il la combla de prévenances, la fit place, à table au-dessus de lui. Des entretiens variés, où Néron affecta tour à tour la familiarité du jeune âge et toute la gravité d'une confidence auguste, prolongèrent le festin. Il la reconduisit à son départ, couvrant de baisers ses yeux et son sein ; soit qu'il voulût mettre le comble à sa dissimulation, soit que la vue d'une mère qui allait périr attendrit en ce dernier instant cette âme dénaturée. 1. Baules est une maison de campagne qui avait appartenu à l'orateur Hortensius. 2. La face des lieux ayant été changée par l'invasion de la mer, le lac de Baïes ne subsiste plus. Le navire coule V. Une nuit brillante d'étoiles, et dont la paix s'unissait au calme de la mer, semblait préparée par les dieux pour mettre le crime dans toute son évidence. Le navire n'avait pas encore fait beaucoup de chemin. Avec Agrippine étaient deux personnes de sa cour, Crépéréius Gallus et Acerronie. Le premier se tenait debout prés du gouvernail ; Acerronie, appuyée sur le pied du lit où reposait sa maîtresse, exaltait, avec l'effusion de la joie, le repentir du fils et le crédit recouvré par la mère. Tout à coup, à un signal donné, le plafond de la chambre s'écroule sous une charge énorme de plomb. Crépéréius écrasé reste sans vie. Agrippine et Acerronie sont défendues par les côtés du lit qui s'élevaient au-dessus d'elles, et qui se trouvèrent assez forts pour résister au poids. Cependant le vaisseau tardait à s'ouvrir, parce que, dans le désordre général, ceux qui n'étaient pas du complot embarrassaient les autres. Il vint à l'esprit des rameurs de peser tous du même côté, et de submerger ainsi le navire. Mais, dans ce dessein formé subitement, le concert ne fut point assez prompt ; et une partie, en faisant contre-poids, ménagea aux naufragés une chute plus douce. Acerronie eut l'imprudence de s'écrier "qu'elle était Agrippine, qu'on sauvât la mère du prince ;" et elle fut tuée à coups de crocs, de rames, et des autres instruments qui tombaient sous la main. Agrippine, qui gardait le silence, fut moins remarquée, et reçut cependant une blessure à l'épaule. Après avoir nagé quelque temps, elle rencontra des barques qui la conduisirent dans le lac Lucrin, d'où elle se fit porter à sa maison de campagne. Agrippine saine et sauve VI. Là, rapprochant toutes les circonstances, et la lettre perfide, et tant d'honneurs prodigués pour une telle fin, et ce naufrage près du port, ce vaisseau qui, sans être battu par les vents ni poussé contre un écueil, s'était rompu par le haut comme un édifice qui s'écroule ; songeant en même temps au meurtre d'Acerronie, et jetant les yeux sur sa propre blessure, elle comprit que le seul moyen d'échapper aux embûches était de ne pas les deviner. Elle envoya l'affranchi Agérinus annoncer à son fils "que la bonté des dieux et la fortune de l'empereur l'avaient sauvée d'un grand péril ; qu'elle le priait, tout effrayé qu'il pouvait être du danger de sa mère, de différer sa visite ; qu'elle avait en ce moment besoin de repos." Cependant, avec une sécurité affectée, elle fait panser sa blessure et prend soin de son corps. Elle ordonne qu'on recherche le testament d'Acerronie, et qu'on mette le scellé sur ses biens : en cela seulement elle ne dissimulait pas. Panique de Néron VII. Néron attendait qu'on lui apprît le succès du complot, lorsqu'il reçut la nouvelle qu'Agrippine s'était sauvée avec une légère blessure, et n'avait couru que ce qu'il fallait de danger pour ne pouvoir en méconnaître l'auteur. Éperdu, hors de lui même, il croit déjà la voir accourir avide de vengeance. "Elle allait armer ses esclaves, soulever les soldats, ou bien se, jeter dans les bras du sénat et du peuple, et leur dénoncer son naufrage, sa blessure, le meurtre de ses amis : quel appui restait-il au prince, si Burrus et Sénèque ne se prononçaient ?" Il les avait mandés dés le premier moment : on ignore si auparavant ils étaient instruits. Tous deux gardèrent un long silence, pour ne pas faire des remontrances vaines ; ou peut-être croyaient-ils les choses arrivées à cette extrémité, que, si l'on ne prévenait Agrippine, Néron était perdu. Enfin Sénèque, pour seule initiative, regarda Burrus et lui demanda s'il fallait ordonner le meurtre aux gens de guerre. Burrus répondit "que les prétoriens, attachés à toute la maison des Césars, et pleins du souvenir de Germanicus, n'oseraient armer leurs bras contre sa fille. Qu'Anicet achevât ce qu'il avait promis." Celui-ci se charge avec empressement de consommer le crime. A l'instant Néron s'écrie "que c'est en ce jour qu'il reçoit l'empire, et qu'il tient de son affranchi ce magnifique présent ; qu'Anicet parte au plus vite et emmène avec lui des hommes dévoués." De son côté, apprenant que l'envoyé d'Agrippine, Agérinus, demandait audience, il prépare aussitôt une scène accusatrice. Pendant qu'Agérinus expose son message, il jette une épée entre les jambes de cet homme ; ensuite il le fait garrotter comme un assassin pris en flagrant délit, afin de pouvoir feindre que sa mère avait attenté aux jours du prince, et que, honteuse de voir son crime découvert, elle s'en était punie par la mort. Mort d'Agrippine VIII. Cependant, au premier bruit du danger d'Agrippine, que l'on attribuait au hasard, chacun se précipite vers le rivage. Ceux-ci montent sur les digues ; ceux-là se jettent dans des barques ; d'autres s'avancent dans la mer, aussi loin qu'ils peuvent ; quelques-uns tendent les mains. Toute la côte retentit de plaintes, de voeux, du bruit confus de mille questions diverses, de mille réponses incertaines. Une foule immense était accourue avec des flambeaux : enfin l'on sut Agrippine vivante, et déjà on se disposait à la féliciter, quand la vue d'une troupe armée et menaçante dissipa ce concours. Anicet investit la maison, brise la porte, saisit les esclaves qu'il rencontre, et parvient à l'entrée de l'appartement. Il y trouva peu de monde ; presque tous, à son approche, avaient fui épouvantés. Dans la chambre, il n'y avait qu'une faible lumière, une seule esclave, et Agrippine, de plus en plus inquiète de ne voir venir personne de chez son fils, pas même Agérinus. La face des lieux subitement changée, cette solitude, ce tumulte soudain, tout lui présage le dernier des malheurs. Comme la suivante elle-même s'éloignait : "Et toi aussi, tu m'abandonnes," lui dit-elle : puis elle se retourne et voit Anicet, accompagné du triérarque Herculéus et d'Oloarite, centurion de la flotte. Elle lui dit "que, s'il était envoyé pour la visiter, il pouvait annoncer qu'elle était remise ; que, s'il venait pour un crime, elle en croyait son fils innocent ; que le prince n'avait point commandé un parricide." Les assassins environnent son lit, et le triérarque lui décharge le premier un coup de bâton sur la tête. Le centurion tirait son glaive pour lui donner la mort. "Frappe ici," s'écria-t-elle en lui montrant son ventre, et elle expira percée de plusieurs coups. Commentaire de Tacite IX. Voilà les faits sur lesquels on s'accorde. Néron contempla-t-il le corps inanimé de sa mère, en loua-t-il la beauté ? les uns l'affirment, les autres le nient. Elle fut brûlée la nuit même, sur un lit de table, sans la moindre pompe ; et, tant que Néron fut maître de l'empire, aucun tertre, aucune enceinte ne protégea sa cendre. Depuis, des serviteurs fidèles lui élevèrent un petit tombeau sur le chemin de Misène, prés de cette maison du dictateur César, qui, située à l'endroit le plus haut de la côte, domine au loin tout le golfe. Quand le bûcher fut allumé, un de ses affranchis, nommé Mnester, se perça d'un poignard, soit par attachement à sa maîtresse soit par crainte des bourreaux. Telle fut la fin d'Agrippine, fin dont bien des années auparavant elle avait cru et méprisé l'annonce. Un jour qu'elle consultait sur les destins de Néron, les astrologues lui répondirent qu'il régnerait et qu'il tuerait sa mère : "Qu'il me tue, dit-elle, pourvu qu'il règne." "Tistesse" de Néron X. C'est quand Néron eut consommé le crime qu'il en comprit la grandeur. Il passa le reste de la nuit dans un affreux délire : tantôt morne et silencieux, tantôt se relevant avec effroi, il attendait le retour de la lumière comme son dernier moment. L'adulation des centurions et des tribuns, par le conseil de Burrus, apporta le premier soulagement à son désespoir. Ils lui prenaient la main, le félicitaient d'avoir échappé au plus imprévu des dangers, aux complots d'une mère. Bientôt ses amis courent aux temples des dieux, et, l'exemple une fois donné, les villes de Campanie témoignent leur allégresse par des sacrifices et des députations. Néron, par une dissimulation contraire, affectait la douleur ; il semblait haïr des jours conservés à ce prix, et pleurer sur la mort de sa mère. Mais les lieux ne changent pas d'aspect comme l'homme de visage, et cette mer, ces rivages, toujours présents, importunaient ses regards. L'on crut même alors que le son d'une trompette avait retenti sur les coteaux voisins, et des gémissements, dit-on, furent entendus au tombeau d'Agrippine. Néron prit le parti de se retirer à Naples, et écrivit une lettre au sénat. Lettre de justification au sénat XI. "Un assassin, disait-il, Agérinus, affranchi d'Agrippine et l'un de ses plus intimes confidents, avait été surpris avec un poignard ; et elle-même, cédant au cri de sa conscience, s'était infligé la peine comme elle avait ordonné le crime." A cette accusation, il en ajoutait de plus anciennes. "Elle avait rêvé le partage de l'empire ; elle s'était flattée que les cohortes prétoriennes jureraient obéissance à une femme, et que le sénat et le peuple subiraient le même déshonneur. Trompée dans ses désirs, elle s'en était vengée sur les sénateurs, le peuple et les soldats, en s'opposant aux largesses du prince, et en amassant les dangers sur les plus illustres têtes. Avec quelle peine ne l'avait-il pas empêchée de forcer les portes du sénat, et de donner ses réponses aux nations étrangères !" Il remontait jusqu'au temps de Claude, dont il fit la satire indirecte, rejetant sur sa mère tous les crimes de ce règne, et attribuant sa mort à la fortune de Rome : car il parlait aussi du naufrage, sans songer qu'il n'y avait personne d'assez stupide pour le croire fortuit, ou pour s'imaginer qu'une femme, échappée des flots, eût envoyé un homme à travers les cohortes et les flottes de l'empereur, afin que seul, avec une épée, il brisât ce rempart. Aussi ce n'était plus sur Néron que tombait la censure publique ; sa barbarie était trop au-dessus de toute indignation : c'était sur Sénèque, auquel on reprochait d'avoir tracé dans ce discours un horrible aveu. Prodiges - Clémence de Néron XII. On vit toutefois parmi les grands une merveilleuse émulation de bassesse. Des actions de grâces sont ordonnées dans tous les temples ; et des jeux annuels ajoutés aux fêtes de. Minerve pour célébrer la découverte du complot. On vote à la, déesse une statue d'or, qui sera placée dans le sénat, et auprès de laquelle on verra l'image du prince ; enfin le jour où naquit Agrippine est mis au nombre des jours néfastes. Pétus Thraséas, qui laissait passer les adulations ordinaires sans autre protestation que le silence, ou une adhésion froidement exprimée, sortit alors du sénat, ce qui lui attira des dangers, sans que les autres en devinssent plus libres. Des prodiges nombreux furent vus dans ce temps, et n'eurent pas plus d'effet. Une femme accoucha d'un serpent ; une autre fut tuée par la foudre dans les bras de son mari ; le soleil s'éclipsa tout à coup ; et le feu du ciel tomba dans les quatorze quartiers de Rome. Mais ces phénomènes annonçaient si peu l'intervention des dieux, qu'on vit se prolonger encore bien des années le règne et les crimes de Néron. Au reste, pour faire à sa victime une mémoire plus odieuse, et prouver que sa clémence était plus grande depuis que sa mère n'y mettait plus obstacle, il rendit à leur patrie deux femmes du premier rang, Junie et Calpurnie, et deux anciens préteurs, Valérius Capito et Licinius Gabolus, tous bannis autrefois par Agrippine. Il permit aussi qu'on rapportât les cendres de Lollia Paullina, et qu'on lui élevât un tombeau. Il fit grâce à Iturius et à Calvisius, que lui-même avait relégués depuis peu. Quant à Silana, elle avait fini ses jours à Tarente : elle y était revenue d'un exil plus éloigné, lorsque Agrippine, dont la haine avait causé sa chute, chancelait à son tour ou s'était adoucie. Néron rentre à Rome XIII. Néron parcourait lentement les villes de Campanie, inquiet sur son retour à Rome, et craignant de n'y plus retrouver le dévouement du sénat et l'affection du peuple. Mais tous les pervers (et jamais cour n'en réunit davantage) l'assuraient "que le nom d'Agrippine était abhorré, et que sa mort avait redoublé pour lui l'enthousiasme populaire. Qu'il allât donc sans crainte, et qu'il essayât la vertu de sa présence auguste." Eux-mêmes demandent à le précéder, et trouvent un empressement qui passait leurs promesses, les tribus accourant au-devant de lui, le sénat en habits de fête, des troupes de femmes et d'enfants, rangées suivant l'âge et le sexe, et, sur tout son passage, des amphithéâtres qu'on avait dressés comme pour voir un triomphe. Fier et vainqueur de la servilité publique, Néron monta au Capitole, rendit grâce aux dieux, et s'abandonna au torrent de ses passions, mal réprimées jusqu'alors, mais dont l'ascendant d'une mère, quelle qu'elle fût, avait suspendu le débordement. Néron dans l'arène XIV. Il avait depuis longtemps à coeur de conduire un char dans la carrière ; et par une fantaisie non moins honteuse, on le voyait souvent, tenant une lyre, imiter à table les chants du théâtre. "Des rois, disait-il, d'anciens généraux l'avaient fait avant lui. Cet art était célébré par les poëtes et servait à honorer les dieux. Le chant n'était-il pas un attribut sacré d'Apollon ? et n'était-ce pas une lyre à la main que, dans les temples de Rome, aussi bien que dans les villes de la Grèce, on représentait ce dieu, l'un des plus grands de l'Olympe, le dieu des oracles ?" Déjà rien ne pouvait plus le retenir, quand Sénèque et Burrus résolurent de lui céder une victoire, pour éviter qu'il en remportât deux. On établit dans la vallée du Vatican une enceinte fermée où il pût guider un char sans se prodiguer aux regards de la foule : bientôt le peuple romain fut appelé à ce spectacle et applaudit avec transport, avide de plaisir, comme l'est toute multitude, et joyeux de retrouver ses penchants dans le prince. On avait cru que la publicité de la honte en amènerait le dégoût ; elle ne fut qu'un aiguillon nouveau : se croyant moins flétri, plus il en flétrirait d'autres, il dégrada les fils de plusieurs nobles familles, en traînant sur la scène leur indigence vénale. Tout morts qu'ils sont, je ne les nommerai pas, par respect pour leurs ancêtres : le plus déshonoré, après tout, est celui qui emploie son or à payer l'infamie plutôt qu'à la prévenir. Des chevaliers romains d'un nom connu descendirent même dans l'arène : il les engagea pour ce honteux service à force de présents ; mais les présents de qui peut commander ne sont-ils pas une véritable contrainte ? Les Juvénales XV. Cependant, pour ne pas se prostituer encore sur un théâtre public, il institua la fête des Juvénales (1). C’est ainsi qu'il appela des jeux nouveaux, où les citoyens s'enrôlèrent en foule. Ni la noblesse ni l'âge ne retinrent personne : on vit d'anciens magistrats exercer l'art d'un histrion grec ou latin, se plier à des gestes, moduler des chants indignes de leur sexe. Des femmes même, d'une haute naissance, étudièrent des rôles indécents. Dans le bois qu'Auguste avait planté autour de sa naumachie, furent construites des salles et des boutiques où tout ce qui peut irriter les désirs était à vendre. On y distribuait de l'argent, que chacun dépensait aussitôt, les gens honnêtes par nécessité, les débauchés par vaine gloire. De là une affreuse contagion de crimes et d'infamie ; et jamais plus de séductions qu'il n'en sortit de ce cloaque impur n'assaillirent une société dès longtemps corrompue. Les bons exemples maintiennent à peine les bonnes moeurs ; comment, dans cette publique émulation de vices, eût-on sauvé le moindre sentiment de pudicité, de modestie, d'honneur ? Enfin Néron monta lui-même sur la scène, touchant les cordes d'une lyre, et préludant avec une grâce étudiée. Ses courtisans étaient près de lui, et, avec eux, une cohorte de soldats, les centurions, les tribuns et Burrus, qui gémissaient tout en applaudissant. Alors fut créé ce corps de chevaliers romains qu'on appela les Augustans, tous vigoureux et brillants de jeunesse, attirés les uns par un esprit de licence, les autres par des vues ambitieuses. Le jour entendait leurs acclamations ; ils en faisaient retentir les nuits, cherchant à la voix, et à la beauté du prince des noms parmi les dieux : ils avaient à ce prix ce qu'on mérite par la vertu, les honneurs et l'illustration. 1. Suivant Dion, Néron institua ces jeux à l'occasion de la première barbe, dont il consacra les poils à Jupiter Capitolin, après les avoir fait enchâsser dans une boîte d'or. Néron poète XVI. Toutefois, afin que la gloire de l'empereur ne fût pas bornée aux arts de la scène, il ambitionna encore le nom de poëte. Il réunissait chez lui les jeunes gens qui avaient quelque talent pour les vers : là, chacun étant assis, leur tâche était de lier et d'assortir les morceaux que Néron avait apportés ou qu'il improvisait, et de remplir les mesures imparfaites, en conservant, bonnes ou mauvaises, ses propres expressions on s'en aperçoit au style de ces poésies, dénuées d'inspiration et de verve, et qui ne semblent pas couler d'une même source. Enfin il donnait aussi aux philosophes quelques moments après le repas ; et, remarquant l'opposition de leurs doctrines, il se plaisait à les mettre aux prises : car il s'en trouva plus d'un qui fut bien aise qu'on le vît, avec son maintien grave et son visage austère, servir aux passe-temps du maître. Emeutes à l'amphithéâtre XVII. Vers la même époque, une dispute légère fut suivie d'un horrible massacre entre les habitants de deux colonies romaines, Nucéria et Pompéi. Livinéius Régulus, que j'ai dit avoir été chassé du sénat, donnait un spectacle de gladiateurs. De ces railleries mutuelles où s'égaye la licence des petites villes, on en vint aux injures, puis aux pierres, enfin aux armes. La victoire resta aux Pompéiens, chez qui se donnait la fête. Beaucoup de Nucériens furent rapportés chez eux le corps tout mutilé ; un grand nombre pleuraient la mort d'un fils ou d'un père. Le prince renvoya le jugement dé cette affaire au sénat, et le sénat aux consuls. Le sénat, en ayant été saisi de nouveau, défendit pour dix ans à la ville de Pompéi ces sortes de réunions, et supprima les associations qui s'y étaient formées aux mépris des lois. Livinéius et les autres auteurs de la sédition furent punis de l’exil. Procès XVIII. Pédius Blésus perdit aussi le rang de sénateur, accusé par les Cyrénéens d'avoir violé le trésor d'Esculape, et cédé, dans la levée des soldats, à la double corruption de la brigue et de l'or. Le même peuple poursuivait Acilius Strabo ancien préteur, envoyé par Claude pour régler la propriété de plusieurs domaines possédés autrefois par le roi Apion (1), et que ce prince avait laissés, avec ses États, au peuple romain. Les propriétaires voisins les avaient envahis, et ils se prévalaient d'une usurpation longtemps tolérée, comme d'un titre légitime. En prononçant contre eux, le juge souleva les esprits contre lui-même. Le sénat répondit aux Cyrénéens qu'il ignorait les ordres de Claude, et qu'il fallait consulter le prince, Néron, approuvant le jugement d'Acilius, écrivit néanmoins que, par égard pour les alliés, il leur faisait don de ce qu'ils avaient usurpé. 1. Le roi Apion, descendant des Lagides, dernier souverain d'une partie de la Libye, avait légué ses États au peuple romain l'an de Rome 880. Les principales villes étaient Bérénice Ptolémaïs et Cyrène. Fin de carrière pour deux maîtres du barreau XIX. Bientôt après, deux hommes du premier rang, Domitius Afer et M. Servilius, terminèrent une carrière qui avait brillé de tout l'éclat des honneurs et de l'éloquence, Tous deux furent célèbres au barreau ; Servilius le devint doublement en écrivant l'histoire romaine, et il le fut encore par une élégance de moeurs à laquelle la vie toute différente de son rival de génie donnait un nouveau lustre. 60 les jeux quinquennaux XX. Sous le quatrième consulat de Néron, qui eut pour collègue Cornelius Cassus, des jeux quinquennaux, institués à Rome à l'imitation des combats de la Grèce, donnèrent lieu, comme toutes les nouveautés, à des réflexions diverses. Selon les uns, "Pompée lui-même avait encouru le blâme des vieillards en établissant un théâtre permanent ; car avant lui la scène et les gradins, érigés pour le besoin présent, ne duraient pas plus que les jeux et même, si l'on remontait plus haut, le peuple y assistait debout ; assis, on eût craint qu'il ne consumât des journées entières dans l'oisiveté du théâtre. Au moins fallait-il s'en tenir aux spectacles anciens, tels que les donnaient encore les préteurs, où nul citoyen n'était obligé de disputer le prix. Les moeurs de la patrie, altérées peu à peu, allaient périr entièrement par cette licence importée. Ainsi tout ce qui peut au monde recevoir et donner la corruption serait vu dans Rome ! ainsi dégénérerait, énervée par des habitudes étrangères, une jeunesse dont les gymnases, le désoeuvrement et d'infâmes amours se partageraient la vie ; et cela par la volonté du prince et du sénat, qui, non contents de tolérer le vice, en faisaient une loi. Que les grands de Rome allassent donc, sous le nom de poëtes et d'orateurs se dégrader sur la scène. Que leur restait-il à faire, sinon de jeter leurs vêtements, de prendre le ceste, et de renoncer, pour les combats de l'arène, à la guerre et aux armes ? En seraient-ils des augures plus savants et les chevaliers en rempliraient-ils mieux les nobles fonctions de juges, pour avoir entendu en connaisseurs des voix mélodieuses et des chants efféminés ? Les nuits mêmes étaient ajoutées aux heures du scandale, afin que pas un instant ne fût laissé à la pudeur, et que, dans ces confus rassemblements ce que le vice aurait convoité pendant le jour, il l'osât au milieu des ténèbres." XXI. C'était cette licence même qui plaisait au plus grand nombre, et cependant ils couvraient leur secrète pensée de prétextes honnêtes. "Nos ancêtres, disaient-ils, ne s'étaient pas refusé plus que nous le délassement des spectacles, et ils en avaient de conformes à leur fortune : c'est ainsi que des Étrusques ils avaient pris les histrions, des Thuriens (1) les courses de chevaux. Maîtres de la Grèce et de l'Asie, ils avaient donné plus de pompe à leurs jeux, sans qu'aucun Romain de naissance honnête se fût abaissé jusqu'aux arts de la scène, pendant les deux siècles écoulés depuis le triomphe de Mummius, qui le premier avait montré à Rome ces spectacles nouveaux. C'était au reste par économie qu'on avait bâti un théâtre fixe et durable, au lieu de ces constructions éphémères que chaque année voyait s'élever à grands frais. Plus de nécessité aux magistrats d'épuiser leur fortune à donner des spectacles grecs, plus de motifs aux cris du peuple pour en obtenir des magistrats, lorsque l'Etat ferait cette dépense. Les victoires des poëtes et des orateurs animeraient les talents et quel juge, enviant à son oreille un plaisir légitime, serait fâché d'assister à ces nobles exercices de l'esprit ? C'était à la joie, bien plus qu'à la licence, que l'on consacrait quelques nuits en cinq ans, nuits éclairées de tant de feux, qu'elles n'auraient plus d'ombres pour cacher le désordre." Il est certain que cette fête passa sans laisser après elle aucune éclatante flétrissure. Le peuple même ne se passionna pas un instant. C'est que les pantomimes, quoique rendus à la scène, n'étaient pas admis dans les jeux sacrés. Personne ne remporta le prix de l'éloquence ; mais Néron fut proclamé vainqueur. L'habillement grec, avec lequel beaucoup de personnes s'étaient montrées pendant la durée des fêtes, fut quitté aussitôt. 1. Thurium, bâtie après la destruction de Sybaris et non loin de ses ruines, était située entre les rivières de Crathis et de Sybaris, prés du golfe de Tarente. A la recherche d'un successeur XXII. Il parut dans ce temps une comète, présage, aux yeux du peuple, d'un règne qui va finir. A cette vue, comme si Néron eût été déjà renversé du trône, les pensées se tournèrent vers le choix de son successeur. Toutes les voix proclamaient Rubellius Plautus, qui par sa mère tirait sa noblesse de la famille des Jules. Attaché aux maximes antiques, Plautus avait un extérieur austère ; sa maison était chaste, sa vie retirée ; et plus il s'enveloppait d'une prudente obscurité, plus la renommée le mettait en lumière. Les conjectures non moins vaines auxquelles donna lieu un coup de tonnerre accrurent encore ces rumeurs : comme Néron soupait auprès des lacs Simbruins, dans le lieu nommé Sublaqueum (1), les mets furent atteints de la foudre, et la table fracassée ; or, cet événement étant arrivé sur les confins de Tibur, d'où Plautus tirait son origine paternelle, on en conclut que la volonté des dieux le destinait à l'empire. Il eut même des courtisans parmi ces hommes qu'une politique intéressée et souvent trompeuse hasarde les premiers au devant des fortunes naissantes. Néron alarmé écrivit à Plautus "de pourvoir au repos de la ville, et de se dérober à la méchanceté de ses diffamateurs ; qu'il avait en Asie des domaines héréditaires, où, loin des dangers et du trouble, il jouirait en paix de sa jeunesse." Plautus partit avec sa femme Antistia et quelques amis. A la même époque, une recherche indiscrète de plaisir valut à Néron infamie et péril : il avait nagé dans la fontaine d'où l'eau Marcia (2) est amenée à Rome, et l'on croyait qu'en y plongeant son corps il avait profané une source sacrée, et violé la sainteté du lieu. Une maladie qui vint à la suite parut un témoignage de la colère céleste.
1. Tacite, liv. XI, ch.
XI, a fait mention des monts Simbruins. Pline parle de trois lacs fort
agréables formés par l'Anio, ou Téveron, qui ont donné le nom au lieu
appelé Sublaqueum. A l'extérieur Corbulon en Arménie XXIII. Cependant Corbulon, qui venait de raser Artaxate, voulut profiter d'une première impression de terreur pour s'emparer de Tigranocerte, afin de redoubler l'effroi des ennemis en détruisant cette ville, ou de s'acquérir, en la conservant, un renom de clémence. Il y marcha donc, mais d'une marche inoffensive, pour ne pas porter le désespoir devant lui, et toutefois sans négliger les soins de la prudence, à cause de l'humeur changeante de ces peuples, lents et craintifs à l'aspect du danger, toujours prêts à l'heure de la trahison. Les barbares, chacun selon son caractère, se présentent en suppliants, ou abandonnent leurs hameaux et fuient loin des routes pratiquées. Il y en eut même qui se cachèrent dans des cavernes avec ce qu'ils avaient de plus cher. Le général romain, ménageant habilement sa conduite, faisait grâce aux prières, poursuivait la fuite avec rapidité. Impitoyable pour ceux qui occupaient des retraites souterraines, il leur ferma toutes les issues avec des sarments et des broussailles, et les brilla dans leurs repaires. Comme il longeait les frontières des Mardes (1), cette nation, exercée au brigandage et défendue par des monts inaccessibles, le harcela de ses incursions. Il envoya les Ibériens ravager leur pays, et l'audace de cet ennemi fut punie aux dépens d'un sang étranger. 1. Au pied des monts Gordyens. Prise de Tigranocerte XXIV. Mais si Corbulon et son armée ne perdaient rien par le combat, toute leur vigueur pliait sous le faix des travaux et de la misère. Réduits pour unique nourriture à la chair des bestiaux, le manque d'eau, un été brillant, de longues marches, mettaient le comble à leurs souffrances, que la seule patience du général adoucissait un peu : car lui-même endurait plus de maux que le dernier des soldats. On arriva ensuite dans des lieux cultivés, et l'on fit la moisson. De deux forteresses où les Arméniens s'étaient réfugiés, l'une fut prise d'assaut ; celle qui repoussa la première attaque fut forcée par un siège. On passa de là dans le pays des Taurannites, où Corbulon sortit heureusement d'un péril inattendu. Un barbare de distinction, surpris non loin de sa tente avec un poignard et mis à la torture, s'avoua l'auteur d'une conspiration, dont il découvrit le plan et les complices. Les traîtres qui, sous le masque de l'amitié, tramaient un assassinat, furent convaincus et punis. Bientôt après, Tigranocerte annonça par une députation que ses portes étaient ouvertes, et qu'elle était prête à recevoir des ordres. En même temps elle envoyait une couronne d'or, gage d'hospitalité. Corbulon reçut les députés avec honneur et n'ôta rien à la ville, dans l'espoir qu'une obéissance plus zélée serait lé prix de ce bienfait. XXV. Mais la citadelle, où se tenait enfermée une jeunesse intrépide, ne fut pas réduite sans combat. Ils affrontèrent au pied de leurs murs les hasards d'une bataille, et, repoussés derrière les remparts, ils ne cédèrent qu'à l'extrémité, lorsque déjà l'on forçait la place. Ces succès étaient facilités par la guerre d'Hyrcanie, qui occupait les Parthes. Les Hyrcaniens avaient même envoyé vers l'empereur pour lui demander son alliance, faisant valoir, comme une preuve de leur amitié, l'occupation qu'ils donnaient à Vologèse. A leur retour, les députés risquaient d'être surpris, de l'autre côté de l'Euphrate par les détachements de l'ennemi : Corbulon leur donna une escorte et les fit accompagner jusqu'aux bords de la mer Rouge, d'où, en évitant les frontières des Parthes, ils retournèrent dans leur patrie. Rome installe Tigranes comme roi d'Arménie XXVI. Tiridate essayait de pénétrer en Arménie par le pays des Mèdes. Le général détache aussitôt le lieutenant Vérulanus avec les auxiliaires, le suit rapidement à la tête des légions, et force le barbare de fuir au loin et de renoncer à ses projets de guerre. Enfin, ayant désolé par le fer et la flamme ceux qu'il savait animer, à cause du roi, de sentiments hostiles, il était en pleine possession de l'Arménie, lorsque parut Tigranes, choisi par Néron pour souverain de cette contrée. Tigranes, né d'un sang illustre en Cappadoce, était petit-fils du roi Archélaüs ; mais retenu longtemps comme otage à Rome, il en avait rapporté l'esprit lâche et rampant d'un esclave. Il ne fut pas reçu sans opposition. Les Arsacides régnaient encore dans quelques âmes ; mais le plus grand nombre, révolté de l'orgueil des Parthes, préférait un roi donné par les Romains. On laissa auprès de Tigranes un détachement de mille légionnaires, trois cohortes alliées et deux ailes de cavalerie ; et, afin qu'il maintînt plus facilement son pouvoir naissant, on soumit aux rois Pharasmane, Polémon, Aristobule et Antiochus, les parties de l'Arménie voisines de leurs États. Corbulon se retira dans la Syrie, privée de gouverneur par la mort de Quadratus, et confiée à ses soins. Tremblement de terre à Laocidée - Vétérans à Tarente XXVII. La même année, un tremblement de terre renversa Laodicée (1) l'une des cités les plus célèbres de l'Asie : elle se releva par elle-même et sans notre concours. En Italie, l'ancienne ville de Pouzzoles obtint de Néron les droits et le surnom de colonie romaine. Des vétérans furent désignés pour habiter Antium et Tarente, et ne remédièrent point à la dépopulation de ces villes : ils se dispersèrent presque tous, et chacun regagna la province où il avait achevé son service. Étrangers d'ailleurs à l'usage de se marier et d'élever des enfants, ils ne laissaient dans leurs maisons désertes aucune postérité. Car ce n'étaient plus ces légions que jadis on établissait tout entières, tribuns, centurions, soldats de mêmes manipules, et qui, unies d'esprit et de coeur, ne tardaient pas à former une cité : c'étaient des hommes inconnus entre eux, tirés de différents corps, sans chef, sans affection mutuelle, qui tous venaient comme d'un autre monde, et dont le soudain assemblage formait une multitude plutôt qu'une colonie. 1. Laodicée de Phrygie, dont le nom subsiste encore dans celui de Ladik. Mesures diverses XXVIII. L'élection des préteurs, ordinairement abandonnée au sénat, fut agitée par des brigues plus vives que de coutume : le prince y ramena la paix, en mettant à la tête d'une légion trois candidats qui excédaient le nombre des charges. Il releva la dignité des sénateurs, en ordonnant que ceux qui, des juges particuliers, appelleraient au sénat, consigneraient la même somme que ceux qui appelaient à César. Auparavant, les appels à cet ordre étaient libres et francs de toute amende. A la fin de l’année, Vibius Sécundus, chevalier romain. accusé de concussion par les Maures, fut condamné et chassé d'Italie. Le crédit de son frère Crispus le sauva seul d'une peine plus sévère.
61 En Bretagne XXIX. Sous le consulat de Césonius Pétus et de Pétronius Turpilianus, l’empire essuya en Bretagne un sanglant désastre. J'ai déjà dit que le lieutenant Aulus Didius s'était contenté d'y maintenir nos conquêtes. Véranius, son successeur, fit quelques incursions chez les Silures, et, surpris par la mort, il ne put porter la guerre plus loin. Cet homme, à qui la renommée attribua toute sa vie une austère indépendance, laissa voir, dans les derniers mots de son testament, l'esprit d'un courtisan : il y prodiguait mille flatteries à Néron, ajoutant que, s'il eût vécu encore deux années, il lui aurait soumis la province tout entière. Après lui, les Bretons eurent pour gouverneur Suétonius Paullinus, que ses talents militaires et la voix publique, qui ne laisse jamais le mérite sans rival, donnaient pour émule à Corbulon. Lui-même songeait à l'Arménie reconquise, et brûlait d'égaler un exploit si glorieux en domptant les rebelles. L'île de Mona (1), déjà forte par sa population, était encore le repaire des transfuges : il se dispose à l’attaquer, et construit des navires dont la carène fût assez plate pour aborder sur une plage basse et sans rives certaines. Ils servirent à passer les fantassins ; la cavalerie suivit à gué ou à la nage, selon la profondeur des eaux. 1. Anglesey. XXX. L'ennemi bordait le rivage : à travers ses bataillons épais et hérissés de fer, couraient, semblables aux Furies, des femmes échevelées, en vêtements lugubres, agitant des torches ardentes ; et des druides, rangés à l'entour, levaient les mains vers le ciel avec d'horribles prières. Une vue si nouvelle étonna les courages, au point que les soldats, comme si leurs membres eussent été glacés, s'offraient immobiles aux coups de l'ennemi. Rassurés enfin par les exhortations du général, et s'excitant eux-mêmes à ne pas trembler devant un troupeau fanatique de femmes et d'insensés, ils marchent en avant, terrassent ce qu'ils rencontrent, et enveloppent les barbares de leurs propres flammes. On laissa garnison chez les vaincus, et l'on coupa les bois consacrés à leurs atroces superstitions ; car ils prenaient pour un culte pieux d'arroser les autels du sang des prisonniers, et de consulter les dieux dans des entrailles humaines. Au milieu de ces travaux, Suétonius apprit que la province venait tout à coup de se révolter. XXXI. Le roi des Icéniens, Prasutagus, célèbre par de longues années d'opulence, avait nommé l’empereur son héritier, conjointement avec ses deux filles. Il croyait que cette déférence mettrait à l'abri de l’injure son royaume et sa maison. Elle eut un effet tout contraire : son royaume, en proie à des centurions, sa maison, livrée à des esclaves, furent ravagés comme une conquête. Pour premier outrage, sa femme Boadicée est battue de verges, ses filles déshonorées : bientôt, comme si tout le pays eût été donné en présent aux ravisseurs, les principaux de la nation sont dépouillés des biens de leurs aïeux, et jusqu'aux parents du roi sont mis en esclavage. Soulevés par ces affronts et par la crainte de maux plus terribles (car ils venaient d'être réduits à l'état de province), les Icéniens courent aux armes et entraînent dans leur révolte les Trinobantes(1) et d'autres peuples, qui, n'étant pas encore brisés à la servitude, avaient secrètement conjuré de s'en affranchir. L'objet de leur haine la plus violente étaient les vétérans, dont une colonie, récemment conduite à Camulodunum, chassait les habitants de leurs maisons, les dépossédait de leurs terres, en les traitant de captifs et d'esclaves, tandis que les gens de guerre, par une sympathie d'état et l'espoir de la même licence, protégeaient cet abus de la force. Le temple élevé à Claude offensait aussi les regards, comme le siège et la forteresse d'une éternelle domination ; et ce culte nouveau engloutissait la fortune de ceux qu'on choisissait pour en être les ministres. Enfin il ne paraissait pas difficile de détruire une colonie qui n'avait point de remparts, objet auquel nos généraux avaient négligé de pourvoir, occupés qu'ils étaient de l'agréable avant de songer à l'utile. 1. Les Trinobantes habitaient entre les Icéniens au nord et la Tamise au sud : maintenant les comtés de Middlesex et d'Essex. XXXII. Dans ces conjonctures, une statue de la Victoire, érigée à Camulodunum, tomba sans cause apparente et se trouva tournée en arrière, comme si elle fuyait devant l'ennemi. Des femmes agitées d'une fureur prophétique annonçaient une ruine prochaine. Le bruit de voix étrangères entendu dans la salle du conseil, le théâtre retentissant de hurlements plaintifs, l'image d'une ville renversée vue dans les flots de la Tamise, l'Océan couleur de bang, et des simulacres de cadavres humains abandonnés par le reflux, tous ces prodiges que l'on racontait remplissaient les vétérans de terreur et les Bretons d'espérance. Comme Suétonius était trop éloigné, on demanda du secours au procurateur Catus Décianus. Il n'envoya pas plus de deux cents hommes mal armés, et la colonie n'avait qu'un faible détachement de soldats. On comptait sur les fortifications du temple, et d'ailleurs de secrets complices de la rébellion jetaient le désordre dans les conseils ; aussi on ne s'entoura ni de fossés ni de palissades, on n'éloigna point les vieillards et les femmes pour n'opposer à l'ennemi que des guerriers. La ville, aussi mal gardée qu'en pleine paix, est envahie subitement par une nuée de barbares. Tout fut en un instant pillé ou mis en cendres ; le temple seul, où s'étaient ralliés les soldats, soutint un siège et fut emporté le second jour. Pétilius Cérialis, lieutenant de la neuvième légion, arrivait au secours ; les Bretons victorieux vont au-devant de lui et battent cette légion. Ce qu'il y avait d'infanterie fut massacré ; Cérialis, avec la cavalerie, se sauva dans son camp et fut protégé par ses retranchements. Alarmé de cette défaite et haï de la province, que son avarice avait poussée à la guerre, le procurateur Catus se retira précipitamment dans la Gaule. XXXIII. Mais Suétonius, avec un courage admirable, perce au travers des ennemis, et va droit à Londinium, ville qui, sans être décorée du nom de colonie, était l'abord et le centre d'un commerce immense. Il délibéra s'il choisirait ce lieu pour théâtre de la guerre. Mais, voyant le peu de soldats qui était aux environs et la terrible leçon qu'avait reçue la témérité de Cérialis, il résolut de sacrifier une ville pour sauver la province. En vain les habitants en larmes imploraient sa protection ; inflexible à leurs gémissements, il donne le signal du départ, et emmène avec l’armée ceux qui veulent la suivre. Tout ce que retint la faiblesse du sexe, ou la caducité de l'âge, ou l'attrait du séjour, tout fut massacré par l'ennemi. Le municipe de Vérulam (1) éprouva le même sort ; car les Bretons laissaient de côté les forts et les postes militaires, courant, dans la joie du pillage et l'oubli de tout le reste, aux lieux qui promettaient les plus riches dépouilles et le moins de résistance. On calcula que soixante-dix mille citoyens ou alliés avaient péri dans les endroits que j'ai nommés. Faire des prisonniers, les vendre, enfin tout trafic de guerre, eût été long pour ces barbares : les gibets, les croix, le fer, le feu, servaient mieux leur fureur ; on eût dit qu'ils s'attendaient à l'expier un jour, et qu'ils vengeaient par avance leurs propres supplices. 1. Ancienne ville, dont l'illustration a été renouvelée par le titre de baron de Vérulam, donné au célèbre chancelier Bacon. C'est aujourd'hui Saint-Albans, dans le comté d'Hertford. XXXIV. Suétonius réunit à la quatorzième légion les vexillaires de la vingtième et ce qu'il y avait d'auxiliaires dans le voisinage. Il avait environ dix mille hommes armés, lorsque, sans temporiser davantage, il se dispose au combat. Il choisit une gorge étroite et fermée par un bois, bien sûr auparavant qu'il n'avait d'ennemis qu'en face, et que la plaine, unie et découverte, ne cachait point d'embûches. C'est là qu'il s'établit, la légion au centre et les rangs serrés, les troupes légères rangées à l'entour, la cavalerie ramassée sur les ailes. Quant aux Bretons, leurs bandes à pied et à cheval se croisaient et voltigeaient tumultueusement, plus nombreuses qu'en aucune autre bataille, et animées d'une audace si présomptueuse, que, afin d'avoir jusqu'aux femmes pour témoins de la victoire, elles les avaient traînées à leur suite, et placées sur des chariots qui bordaient l'extrémité de la plaine. Boadicée XXXV. Boadicée, montée sur un char, ayant devant elle ses deux filles, parcourait l'une après l'autre ces nations rassemblées, en protestant "que, tout accoutumés qu'étaient les Bretons à marcher à l'ennemi conduits par leurs reines, elle ne venait pas, fière de ses nobles aïeux, réclamer son royaume et ses richesses ; elle venait, comme une simple femme, venger sa liberté ravie, son corps déchiré de verges, l'honneur de ses filles indignement flétri. La convoitise romaine, des biens, était passée aux corps, et ni la vieillesse ni l'enfance n'échappaient à ses souillures. Mais les dieux secondaient enfin une juste vengeance : une légion, qui avait osé combattre, était tombée tout entière ; le reste des ennemis se tenait caché dans son camp, ou ne songeait qu'à la fuite. Ils ne soutiendraient pas le bruit même et le cri de guerre, encore moins le choc et les coups d'une si grande armée. Qu'on réfléchît avec elle au nombre des combattants et aux causes de la guerre, on verrait qu'il fallait vaincre en ce lieu ou bien y périr. Femme, c'était là sa résolution : les hommes pouvaient choisir la vie et l'esclavage." XXXVI. Suétonius ne se taisait pas non plus en ce moment décisif. Plein de confiance dans la valeur de ses troupes, il les exhortait cependant, il les conjurait "de mépriser ce vain fracas et ces menaces impuissantes de l'armée barbare : on y voyait plus de femmes que de soldats ; cette multitude sans courage et sans armes lâcherait pied sitôt qu'elle reconnaîtrait, tant de fois vaincue, le fer et l'intrépidité de ses vainqueurs. Beaucoup de légions fussent-elles réunies, c'était encore un petit nombre de guerriers qui gagnait les batailles ; et ce serait pour eux un surcroît d'honneur d'avoir prouvé qu'une poignée de braves valait une grande armée. Ils devaient seulement se tenir serrés, lancer leurs javelines, puis, frappant de l'épée et du bouclier, massacrer sans trêve ni relâche, et ne pas s'occuper du butin : la victoire livrerait tout en leurs mains." Telle fut l'ardeur qui éclatait à chacune de ces paroles, et l'air dont balançaient déjà leurs redoutables javelines ces vieux soldats éprouvés dans cent batailles, que Suétonius, assuré du succès, donna aussitôt le signal du combat. XXXVII. Immobile d'abord, et se faisant un rempart de la gorge étroite où elle était postée, la légion attendit que l'ennemi s'approchât, pour lui envoyer des coups plus sûrs. Quand elle eut épuisé ses traits, elle s'avança rapidement en forme de coin. Les auxiliaires chargent en même temps, et les cavaliers, leurs lances en avant, rompent et abattent ce qui résiste encore. Le reste fuyait ou plutôt essayait de fuir à travers la haie de chariots qui fermait les passages. Le soldat n'épargna pas môme les femmes ; et jusqu'aux bêtes de somme tombèrent sous les traits et grossirent les monceaux de cadavres. Cette journée fut glorieuse et comparable à nos anciennes victoires : quelques-uns rapportent qu'il n'y périt guère moins de quatre-vingt mille Bretons. Quatre cents soldats environ furent tués de notre côté ; il n'y eut pas beaucoup de blessés. Boadicée finit sa vie par le poison. Quand Pénius Postumus, préfet de camp de la deuxième légion, apprit le succès de la quatorzième et de la vingtième, désespéré d'avoir privé la sienne d'une gloire pareille en se refusant, contre les lois de la discipline, aux ordres du général, il se perça de son épée. XXXVIII. Toute l'armée fut ensuite réunie et tenue sous la tente, pour éteindre les derniers restes de la guerre. L'empereur la renforça en envoyant de Germanie deux mille légionnaires, huit cohortes alliées et mille chevaux. Les soldats légionnaires servirent à compléter la neuvième légion ; les cohortes et la cavalerie furent placées dans des cantonnements nouveaux, et toutes les nations qui s'étaient montrées indécises ou ennemies en furent punies par le fer et la flamme. Mais aucun fléau ne les désolait autant que la famine : comme elles avaient compté sur nos magasins, tous les âges s'étaient tournés vers la guerre, sans qu'on se mît en peine d'ensemencer les champs. Toutefois ces peuples opiniâtres tardaient à déposer les armes, parce que Julius Classicianus, successeur de Catus et ennemi du général, opposait au bien public ses haines particulières. Il faisait débiter qu'il fallait prendre un nouveau chef, qui, n'ayant ni la colère d'un ennemi ni l'orgueil d'un vainqueur, userait de clémence envers la soumission. En même temps il écrivait à Rome que la lutte ne finirait jamais tant que Suétonius ne serait pas remplacé, attribuant les revers à sa mauvaise conduite et les succès à la fortune de l'empire. XXXIX. Néron envoya l'affranchi Polyclète pour reconnaître l'état de la Bretagne : il avait un grand espoir que son ascendant rétablirait la concorde entre le général et le procurateur, et que même il ramènerait à la paix les esprits rebelles des barbares. Polyclète ne manqua pas d e traîner au delà de l'Océan ce cortège immense dont il avait foulé l'Italie et la Gaule, et de marcher redoutable à nos soldats eux-mêmes : mais il fut la risée des Bretons ; la liberté vivait encore dans leurs âmes, et ils ne connaissaient pas alors cette puissance des affranchis. Leur étonnement était grand de voir le général et l'armée qui venaient d'achever une guerre si terrible obéir à des esclaves. Au reste, l'état des choses fut présenté à Néron sous un jour favorable, et Suétonius laissé à la tête des affaires. Depuis, ayant perdu sur le rivage quelques navires avec leurs rameurs, il reçut ordre, comme si la guerre eût encore duré, de remettre l'armée à Pétronius Turpilianus, déjà sorti du consulat. Celui-ci, sans provoquer l'ennemi ni en être inquiété, décora du nom de paix sa molle inaction. A Rome Deux crimes XL. La même année, deux crimes fameux signalèrent à Rome l'audace d'un sénateur et celle d'un esclave. Il y avait un ancien préteur, nommé Domitius Balbus, riche, sans enfants, et qu'une longue vieillesse livrait aux pièges de la cupidité. Un de ses parents, Valérius Fabianus, destiné à la carrière des honneurs, lui supposa un testament, de concert avec Vinicius Rufinus et Térentius Lentinus, chevaliers romains. Ceux-ci mirent dans le complot Antonius Primus (1) et Asinius Marcellus, le premier d'une audace à tout entreprendre, le second brillant du lustre de son bisaïeul Asinius Pollio, et jusqu'alors estimé pour ses moeurs, si ce n'est qu'il regardait la pauvreté comme le dernier des maux. Fabianus fit sceller l'acte faux par ceux que je viens de dire et par d'autres d'un rang moins élevé, et il en fut convaincu devant le sénat. Lui et Antonius furent condamnés, avec Rufinus et Térentius, aux peines de la loi Cornélia (2). Quant à Marcellus, la mémoire de ses ancêtres et les prières de César le sauvèrent du châtiment plutôt que de l'infamie.
1. C'est ce même Antonius
qui joue un si grand rôle dans la guerre entre Vitellius et Vespasien. Condamnation LI. Le même jour vit frapper aussi Pompéius Élianus, jeune homme qui avait été questeur, et qu'on jugea instruit des bassesses de Fabianus. Le séjour de l'Italie, ainsi que de l'Espagne, où il était né, lui fut interdit. Valérius Ponticus subit la même flétrissure, parce que, afin de soustraire les coupables à la justice du préfet de Rome, il les avait déférés au préteur, couvrant d'un prétendu respect des lois une collusion ménagée pour éluder leur vengeance. Il fut ajouté au sénatus-consulte que quiconque aurait acheté ou vendu de telles connivences serait soumis aux mêmes peines que le calomniateur condamné par un jugement public (1) Ces peines étaient l'infamie, le talion, l'exil, la relégation dans une île, ou l'exclusion de l'ordre auquel on appartenait. Faut-il supplicier tous les esclaves lors d'un crime ? XLII. Peu de temps après, le préfet de Rome Pédanius Sécundus fut tué par un de ses esclaves, soit qu'il eût refusé de l'affranchir après être convenu du prix de sa liberté, soit que l'esclave, jaloux de ses droits sur le complice d'un vil amour, ne pût souffrir son maître pour rival. Lorsque, d'après un ancien usage, il fut question de conduire au supplice tous les esclaves qui avaient habité sous le même toit, la pitié du peuple, émue en faveur de tant d'innocents, éclata par des rassemblement qui allèrent jusqu'à la sédition. Dans le sénat même un parti repoussait avec chaleur cette excessive sévérité, tandis que la plupart ne voulaient aucun changement. Parmi ces derniers, C. Cassius, quand son tour d'opiner fut venu, prononça ce discours : XLIII. "Souvent, pères conscrits, j'ai vu soumettre à vos délibérations des demandes qui allaient à contredire par des règlements nouveaux les principes et les lois de nos pères, et je ne les ai pas combattues. Non que je doutasse qu'en toutes choses la prévoyance des anciens n'eût été mieux inspirée que la nôtre, et qu'innover dans ses décrets, ce ne fût changer le bien en mal ; mais je craignais que trop d'attachement` aux coutumes antiques ne fût attribué au désir de relever la science que je cultive ; et de plus, je ne voulais pas affaiblir, par une opposition habituelle, l'autorité que peuvent avoir mes paroles, afin de la trouver entière au moment où la république aurait besoin de conseils. Ce moment est venu, aujourd'hui qu'un consulaire est assassiné dans ses foyers, par la trahison d'un esclave, trahison que pas un des autres n'a ni prévenue ni révélée, quoique aucune attaque n'eût encore ébranlé le sénatus-consulte qui les menaçait tous du dernier supplice. Décrétez maintenant l'impunité : qui de nous trouvera dans sa dignité de maître une sauvegarde que le préfet de Rome n'a pas trouvée dans sa place ? qui s'assurera en de nombreux serviteurs, lorsque quatre cents n'ont pas sauvé Pédanius ? A qui porteront secours des esclaves que déjà la crainte de la mort n'intéresse pas à nos dangers ? Dira-t-on, ce que plusieurs n'ont pas rougi de feindre, que le meurtrier avait des injures à venger ? Apparemment il avait hérité de son père l'argent de sa rançon, ou l'esclave qu'on lui enlevait était un bien de ses aïeux ! Faisons plus : prononçons que, s'il a tué son maître, il en avait le droit. XLIV. Veut-on argumenter sur des questions résolues par de plus sages que nous? Eh ! bien, si nous avions celle-ci à décider pour la première fois, croyez-vous qu'un esclave ait conçu le dessein d'assassiner son maître, sans qu'il lui soit échappé quelque parole menaçante, sans qu'une seule indiscrétion ait trahi sa pensée ? Je veux qu'il l'ait enveloppée de secret, que personne ne l'ait vu aiguiser son poignard : pourra-t-il traverser les gardes de nuit, ouvrir la chambre, y porter de la lumière, consommer le meurtre, à l'insu de tout le monde ? Mille indices toujours précèdent le crime. Si nos esclaves le révèlent, nous pourrons vivre seuls au milieu d'un grand nombre, sûrs de notre vie parmi des gens inquiets pour la leur ; enfin, entourés d'assassins, si nous devons périr, ce ne sera pas sans vengeance. Nos ancêtres redoutèrent toujours l'esprit de l'esclavage, alors même que, né dans le champ ou sous le toit de son maître, l'esclave apprenait à le chérir en recevant le jour. Mais depuis que nous comptons les nôtres par nations (1), dont chacune a ses moeurs et ses dieux, non, ce vil et confus assemblage ne sera jamais contenu que par la crainte. Quelques innocents périront. Eh ! lorsqu'on décime une armée qui a fui, le sort ne peut-il pas condamner môme un brave à expirer sous le bâton ? Tout grand exemple est mêlé d'injustice, et le mal de quelques-uns est racheté par l'avantage de tous." 1. Les troupes immenses d'esclaves que possédaient quelques Romains étaient divisées selon leur pays, leur couleur, leur âge : c'est-à-dire qu'on mettait respectivement ensemble les Thraces, les Phrygiens, les Africains, etc. XLV. A cet avis de Cassius, que personne n'osa combattre individuellement, cent voix confuses répondaient en plaignant le nombre, l'âge, le sexe de ces malheureux, et, pour la plupart, leur incontestable innocence. Le parti qui voulait le supplice prévalut cependant. Mais la multitude attroupée, et qui s'armait déjà de pierres et de torches, arrêtait l'exécution. Le prince réprimanda le peuple par un édit, et borda de troupes tout le chemin par où les condamnés furent conduits à la mort. Cingonius Varro avait proposé d'étendre la punition aux affranchis qui demeuraient sous le même toit, et de les déporter hors de l'Italie. Le prince s'y opposa, pour ne pas aggraver par de nouvelles rigueurs un usage ancien que la pitié n'avait pas adouci. Autres accusations XLVI. Sous les mêmes consuls, Tarquitius Priscus, accusé par les Bithyniens, fut condamné aux peines de la concussion ; à la grande joie des sénateurs, qui se souvenaient de l'avoir vu accuser lui-même son proconsul Statilius Taurus. Il y eut dans les Gaules un recensement des biens. Q. Volusius et Sextius Africanus, qui le firent avec Trébellius Maximus, étaient divisés par des prétentions de naissance. Pendant qu'ils se disputaient le premier rang, leurs communs dédains y placèrent Trébellius. Mort de Memmius Régulus XLVII. La même année, mourut Memmius Régulus, dont le crédit, le caractère, la renommée, eurent autant d'éclat qu'il est permis d'en avoir sous l'ombre du trône impérial. Un jour, Néron, malade et entouré de flatteurs qui lui disaient que c'en était fait de l'empire si le destin ne préservait ses jours, répondit qu'un appui restait à la république. On lui demanda lequel : "C'est, dit-il, Memmius Régulus." Régulus survécut cependant, protégé par le silence de sa vie : il n'était d'ailleurs ni d'une maison anciennement illustre, ni d'une opulence à tenter les envieux. Néron fit cette année la dédicace d'un gymnase, et, par une libéralité toute grecque, il fournit l'huile aux chevaliers et aux sénateurs. 62 A Rome Lèse-majesté XLVIII. Sous le consulat de P. Marius et de L. Asinius, le préteur Antistius, qui, étant tribun du peuple, s'était signalé, comme je l'ai dit, par l'abus de son pouvoir, composa des vers injurieux pour le prince, et les lut devant de nombreux convives, à un souper chez Ostorius Scapula. Aussitôt il fut accusé de lèse-majesté par Cossutianus Capito, qui, à la prière de Tigelli, son beau-père, avait recouvré depuis peu le rang de sénateur. C'était la première fois que la loi de majesté fût remise en vigueur ; on croyait môme que le but de ce procès était moins la perte de l'accusé que la gloire du prince, et que, lorsque Antistius aurait été condamné par le sénat, Néron userait de sa puissance tribunitienne pour le sauver de la mort. Appelé en témoignage, Ostorius déclara n'avoir rien entendu : on crut de préférence les témoins qui accusaient. Junius Marullus, désigné consul, opina pour que le coupable fût destitué de la préture, et mis à mort suivant la coutume de nos ancêtres. Chacun approuvant cet avis, Thraséas se lève à son tour, et, après un hommage éclatant rendu à César, et une vive censure d'Antistius, il ajoute : "que, sous un si bon prince, et quand le sénat n'est enchaîné par aucune nécessité, ses arrêts ne doivent pas ordonner tout ce que le criminel mériterait de souffrir ; que le bourreau et le lacet fatal sont depuis longtemps oubliés ; qu'il existe des châtiments établis par les lois, et qu'on peut infliger des peines qui n'attestent pas la cruauté des juges et la honte du siècle. Oui, relégué dans une île et dépouillé de ses biens, plus Antistius y traînera longtemps sa coupable existence, plus il sentira cruellement ses misères privées, sans cesser d'être un grand exemple de la clémence publique." XLIX. La liberté de Thraséas arracha les autres à leur asservissement, et, le consul ayant autorisé le partage, tous passèrent du côté de ce grand homme, excepté quelques flatteurs, entre lesquels A. Vitellius (1) se distingua par l'empressement de sa bassesse, attaquant de ses invectives les plus gens de bien, et, comme font les lâches ; restant muet à la première réponse. Toutefois les consuls, n'osant rédiger le décret du sénat, écrivirent au prince le voeu de cet ordre. Néron balança d'abord entre la honte et la colère : enfin il répondit "que, sans être provoqué par aucune injure, Antistius s'était permis contre le prince les paroles les plus outrageantes ; que vengeance en avait été demandée au sénat ; qu'il eût été juste de proportionner la peine à la grandeur du crime ; mais que, résolu par avance d'arrêter l'effet de la sévérité, il ne s'opposerait pas à la clémence ; qu'ils prononçassent ce qu'ils voudraient ; qu'au nombre de leurs pouvoirs était même celui d'absoudre." Cette lettre, où chaque mot décelait une âme offensée, fut lue sans que les consuls changeassent rien à la délibération, ou que Thraséas renonçât à son avis, ou que les autres désavouassent ce qu'ils avaient approuvé. Les uns craignaient qu'on ne leur prêtât l'intention de rendre le prince odieux ; la plupart se confiaient en leur nombre ; Thraséas ne consultait que la fermeté de son âme et les intérêts de sa gloire. 1. Celui même qui fut empereur. L. Une accusation du même genre causa la ruine de Fabricius Véiento. Il avait composé, sous le nom de Codicille, un livre rempli d'invectives contre les sénateurs et les prêtres. L'accusateur, Talius Géminus, lui reprochait encore d'avoir trafiqué des faveurs du prince, et vendu le droit de parvenir aux honneurs ; circonstance qui décida Néron à évoquer à lui cette affaire. Véiento fut convaincu et chassé d'Italie. L'ouvrage, condamné aux flammes, fut recherché et lu avidement, tant qu'il y eut péril à se le procurer ; dès que tout le monde put t'avoir, il tomba dans l'oubli. Mort de Burrus LI. Cependant l'État perdait ses appuis à mesure que ses maux s'aggravaient. Burrus cessa de vivre ; par la maladie ou par le poison, c'est ce qu'on ne put savoir. Une enflure au dedans de la gorge, qui, s'accroissant peu à peu, lui ôta la vie avec la respiration, semblait annoncer une mort naturelle ; mais on assurait plus généralement qu'une main guidée par Néron lui avait, sous le nom de remède, humecté le palais de sucs meurtriers. Burrus, ajoute-t-on, s'aperçut de ce crime ; et, Néron étant venu le visiter, il détourna les yeux, et, pour toute réponse à ses questions, lui dit qu'il se trouvait bien. Cette grande perte excita des regrets, que nourrirent longtemps le souvenir des vertus de Burrus et le choix de ses successeurs, l'un d'une probité molle et nonchalante, l'autre ardent pour le crime et tout souillé d'adultères ; car le prince avait donné deux chefs aux cohortes prétoriennes, Fénius Rufus, désigné par la faveur populaire à cause de son désintéressement dans l'administration des vivres, et Sophonius Tigellinus, qui avait pour titres l'impureté de ses moeurs et une longue infamie. Leur destinée répondit à leur caractère : Tigellin fut tout-puissant sur l'esprit de Néron, et confident de ses débauches les plus secrètes ; Fénius, estimé du peuple et des soldats, en eut moins de droits aux bonnes grâces du maître. Attaques contre Sénèque LII. La mort de Burrus brisa la puissance de Sénèque : le parti de la vertu était affaibli d'un de ses chefs, et Néron d'ailleurs penchait pour les méchants. Ceux-ci commencent l'attaque par mille imputations diverses. Selon eux, "Sénèque, dont les immenses richesses excédaient la mesure d'une condition privée, travaillait à s'enrichir encore ; il recherchait une ambitieuse popularité ; bientôt il surpasserait l'empereur par l'agrément de ses jardins et la magnificence de ses maisons de campagne." Ils lui reprochaient encore de s'arroger à lui seul la gloire de l'éloquence, de faire des vers plus fréquemment, depuis que Néron avait pris le goût de la poésie. "Censeur injuste et public des amusements du prince, il lui refuse le mérite de bien conduire un char ; il rit de ses accents, toutes les fois qu'il chante. Quand donc tout ce qui se fait de glorieux dans l'État cessera-t-il de paraître inspiré par cet homme ? Certes, l'enfance de Néron est finie, et l'âge de la force est venu pour lui. Qu'il s'affranchisse d'une odieuse discipline : n'a-t-il pas d'autres maîtres, et d'assez grands, ses aïeux ? " LIII. Sénèque, averti, par quelques hommes encore sensibles à l'honneur, des crimes qu'on lui prêtait, voyant d'ailleurs le prince repousser de plus en plus son intimité, demande un entretien, et, l'ayant obtenu, il parle ainsi : "Il y a quatorze ans, César, que je fus placé auprès du berceau de ta future grandeur ; il y en a huit que tu règnes. Pendant ce temps, tu as accumulé sur moi tant d'honneurs et de richesses, qu'il ne manque rien à ma félicité que d'avoir des bornes. Je citerai de grands exemples, et je les prendrai non dans mon rang, mais dans le tien. Ton trisaïeul Auguste permit que M. Agrippa se retirât à Mitylène, et que Mécène, sans quitter Rome, s'y reposât comme dans une lointaine retraite. L'un, compagnon de ses guerres, l'autre, éprouvé à Rome par des travaux de toute espèce, avaient reçu des récompenses, magnifiques saris doute, mais achetées par d'immenses services. Moi, quels titres ai-je apportés à ta munificence, si ce n'est des études nourries, pour ainsi dire, dans l'ombre, et qui empruntent tout leur éclat de ce que je parais avoir dirigé les essais de ta jeunesse, prix déjà si haut de si faibles talents ? Mais toi, César, tu mas environné d'un crédit sans bornes, de richesses infinies, au point que souvent je me dis à moi-même : Qui ? moi, né simple chevalier, au fond d'une province (1), je suis compté parmi les premiers de l'État ! ma nouveauté s'est fait jour entre tant de noms décorés d'une longue illustration ! Où est cette philosophie si bornée dans ses désirs ? est-ce elle qui embellit ces jardins, qui promène son faste dans ces maisons de plaisance, qui possède ces vastes domaines, ces inépuisables revenus ? Une seule excuse se présente : je n'ai pas dû repousser tes bienfaits. 1. Sénèque était né à Cordoue, en Espagne, d'une famille de chevaliers. LIV. Mais nous avons tous deux comblé la mesure, toi de ce qu'un prince peut donner à son ami, moi de ce qu'un ami peut recevoir de son prince. Plus de bontés irriteraient l'envie : je sais qu'elle rampe, avec le reste des choses humaines, bien au-dessous de ta grandeur ; mais elle pèse sur moi ; c'est moi qu'il faut soulager. Soldat épuisé de travaux ou voyageur fatigué de la route, je demanderais un appui : de même, en ce chemin de la vie, où, vieux et succombant aux moindres soins, je ne puis porter plus loin le fardeau de mes richesses, j'implore une main secourable. Ordonne qu'elles soient régies par tes intendants, reçues dans ton domaine impérial. Je ne me réduirai pas ainsi à la pauvreté ; je déposerai des biens dont l'éclat m'importune, et tout le temps que me ravit le soin de ces jardins et de ces terres, je le rendrai à mon esprit. La force surabonde en toi, et de longues années ont assuré dans tes mains le gouvernail de l'empire. Nous, tes vieux amis, nous pouvons maintenant acquitter notre dette par le repos. Cela même doit tourner à ta gloire, que tu aies élevé aux grandeurs des hommes capables de soutenir la médiocrité." LV. Néron lui répondit à peu près ainsi : "Si je réplique sur-le-champ à un discours préparé, c'est un premier avantage que je te dois, puisque tu m'as appris à parler également, que le sujet fût prévu ou qu'il ne le fût pas. Mon trisaïeul Auguste, après les grands travaux d'Agrippa et de Mécène, leur permit le repos ; mais il était d'un âge dont l'autorité mettait cette faveur, quelle qu'elle fût, à l'abri de la censure ; et cependant il ne dépouilla ni l'un ni l'autre des récompenses qu'ils avaient reçues de lui. Ils les avaient méritées par la guerre et les périls ! c'est que la jeunesse d'Auguste se passa dans les périls et la guerre. Certes, ton bras et ton épée ne m'auraient pas manqué non plus, si j'avais eu les armes à la main. Mais tu as fait ce que les temps demandaient : tes lumières, tes conseils, tes préceptes, ont formé mon enfance, cultivé ma jeunesse. Et les biens dont tu m'as enrichi dureront impérissables, tant que durera ma vie : ceux que tu tiens de moi, jardins, trésors, maisons de campagne, sont sujets aux caprices du sort ; et, tout grands qu'ils paraissent, combien d'hommes, fort au-dessous de ton mérite, en ont possédé davantage ! J'ai honte de citer des affranchis qui étalent une tout autre opulence. Je rougis même que, le premier dans mon coeur, tu ne sois pas encore au-dessus de tous par la fortune. LVI. "Mais ton âge plein de vigueur suffit toujours et aux travaux, et aux jouissances que les travaux procurent ; et moi je fais mes premiers pas dans la carrière du gouvernement. Sans doute tu ne te mets pas au-dessous de Vitellius, qui fut trois fois consul, ni moi au-dessous de Claude ; et cependant Volusius a plus acquis de biens par de longues épargnes, que ne peut t'en donner ma générosité. Tu sais combien la pente de la jeunesse est glissante ; si elle m'entraîne, sois près de moi pour me retenir. Soutiens cette raison que as ornée ; gouverne ma force avec plus de soin que jamais. Ce n'est pas ta modération, si tu renonces à tes biens, ni ton amour du repos, si tu quittes le prince, c'est mon avarice, c'est la crainte supposée de ma cruauté, qui seront dans toutes les bouches : mais dût la voix publique célébrer ton désintéressement, jamais il ne sera digne d'un sage de sacrifier à sa gloire la réputation d'un ami." A ces paroles, il ajoute des embrassements et des baisers; formé par la nature, exercé par l'habitude à voiler sa haine sous d'insidieuses caresses. Sénèque lui rendit grâce, conclusion ordinaire des entretiens avec les puissances; mais il changea les habitudes d'une faveur qui n'était plus. Il écarte cette foule qui s'empressait à le visiter; il évite qu'on lui fasse cortège, se montre peu dans la ville, alléguant tour à tour qu'une santé faible ou des études philosophiques le retenaient chez lui. Intrigues de Tigellin LVII. Sénèque abattu, il ne fut pas difficile d'ébranler Fénius : son crime était l'amitié d'Agrippine. Tigellin devenait donc plus fort de jour en jour. Persuadé que ses vices, unique fondement de son crédit, seraient mieux reçus du prince, si une société de crimes resserrait leur union, il épie ses défiances ; et, s'étant assuré qu'il ne craignait personne autant que Plautus et Sylla, relégués depuis peu, Plautus en Asie, et Sylla dans la Gaule narbonnaise, il lui parle de leur naissance, de leur séjour auprès des armées, l'un d'Orient, l'autre de Germanie. A l'en croire, "il ne nourrit pas, lui, comme faisait Burrus, de doubles espérances ; la sûreté de Néron est tout ce qui l'occupe. Le prince a contre les complots du dedans une sauvegarde telle quelle, sa présence ; mais les gouvernements lointains, quel moyen de les réprimer ? Le nom de Sylla, ce nom dictatorial, tient la Gaule attentive ; et un petit-fils de Drusus porte au milieu de l'Asie une illustration qui ne la rend pas moins suspecte. Sylla est pauvre, ce qui accroît son audace ; il feint l'indolence, en attendant l'heure de tenter les hasards. Plautus, maître d'une grande fortune, n'affecte pas même le désir du repos. Il se pare d'une ambitieuse imitation des vieux Romains. II prend jusqu'à l'arrogance des stoïciens, et l'esprit d'une secte qui fait des intrigants et des séditieux." On ne perdit pas un moment : en six jours, des meurtriers sont rendus à Marseille, et avant le premier soupçon, le moindre bruit du danger, Sylla est tué en se mettant à table. Sa tête, rapportée à Néron, excita ses railleries ; il la trouva blanchie avant le temps. Mort de Plautus LVIII. La mort de Plautus ne put être préparée avec, le même secret : plus de personnes s'intéressaient à sa conservation ; et la distance des lieux, les délais d'un long voyage de terre et de mer, donnèrent l'éveil à la renommée. On supposa qu'il s'était rendu auprès de Corbulon, qui avait alors de grandes armées sous son commandement, et qui était un des premiers menacés, si la gloire et l'innocence étaient des arrêts de mort. On ajoutait que l'Asie avait pris les armes en faveur du jeune homme, que le nombre ou la résolution avait manqué aux soldats envoyés pour consommer le crime, et que, n'ayant pu exécuter leurs ordres, ils avaient embrassé les intérêts nouveaux. Ces fictions, comme tous les bruits publics, étaient grossies par une oisive crédulité. Au reste, un affranchi de Plautus, favorisé par les vents, prévint les meurtriers, et lui apporta les paroles d'Antistius, son beau-père : il lui disait "de ne pas abandonner lâchement sa vie ; qu'un secours lui restait, la haine du tyran et l'intérêt qui s'attache à un grand nom ; que les gens de bien viendraient à lui ; qu'il appellerait les audacieux ; qu'en attendant aucune ressource n'était à dédaigner ; que, s'il repoussait soixante soldats (c'est le nombre qui était en route), il faudrait du temps pour que la nouvelle en fût portée à Néron, pour qu'une autre troupe passât la mer, et que sa résistance, aidée par mille événements, pouvait devenir une guerre ; qu'enfin, ou cette résolution le sauverait, ou le courage ne lui attirerait pas un danger de plus que la faiblesse. " LIX. Ces raisons ne décidèrent point Plautus : soit qu'il ne comptât sur aucun secours, exilé et sans armes ; soit ennui de vivre entre l'espoir et la crainte ; soit amour de sa femme et de ses enfants, qui trouveraient peut-être Néron plus exorable, lorsqu'aucune alarme n'aurait troublé son repos. Quelques-uns rapportent qu'un autre message de son beau-père lui annonça qu'il n'avait rien à craindre ; et que deux philosophes, le Grec Céranus, et Musonius, Toscan d'origine, lui conseillèrent d'attendre courageusement la mort, plutôt que de mener une vie précaire et agitée. Il est certain qu'on le trouva, au milieu du jour, nu et se livrant à des exercices du corps. C'est en cet état que le centurion le tua, en présence de l'eunuque Pélagon, qui, par l'ordre du prince, commandait au chef et aux soldats, comme le ministre d'un roi à des satellites. La tête de Plautus fut apportée à Rome. "Eh ! bien, dit le prince en la voyant (et je cite ses propres paroles), Néron doit être rassuré : que ne hâte-t-il les noces de Poppée, retardées jusqu'ici par toutes ces terreurs, et le renvoi d'Octavie, cette épouse sage, il est vrai, mais que le nom de son père et l'attachement du peuple lui rendent insupportable ? " Il envoya une lettre au sénat, où, sans rien avouer du meurtre de Sylla et de Plautus, il les peignait comme des esprits turbulents, ajoutant qu'il veillait avec soin au salut de la république. On décréta que des actions de grâces auraient lieu dans les temples, et que Sylla et Plautus seraient chassés du sénat ; dérision toutefois plus insultante que funeste. Néron répudie Octavie et épouse Poppée LX. Néron n'eut pas plus tôt reçu le décret du sénat, que, voyant tous ses crimes érigés en vertus, il chasse Octavie sous prétexte de stérilité ; ensuite il s'unit à Poppée. Cette femme, longtemps sa concubine, et toute-puissante sur l’esprit d'un amant devenu son époux, suborne un des gens d'Octavie, afin qu'il l'accuse d'aimer un esclave : on choisit, pour en faire le coupable, un joueur de flûte, natif d'Alexandrie, nommé Eucérus. Les femmes d'Octavie furent mises à la question, et quelques-unes, vaincues par les tourments, avouèrent un fait qui n'était pas ; mais la plupart soutinrent constamment l'innocence de leur maîtresse. Une d'elles, pressée par Tigellin, lui répondit qu'il n'y avait rien sur le corps d'Octavie qui ne fût plus chaste que sa bouche. Octavie est éloignée cependant, comme par un simple divorce, et reçoit, don sinistre, la maison de Burrus et les terres de Plautus. Bientôt elle est reléguée en Campanie, où des soldats furent chargés de sa garde. De là beaucoup de murmures ; et, parmi le peuple, dont la politique est moins fine, et l'humble fortune sujette à moins de périls, ces murmures n'étaient pas secrets. Néron s'en émut ; et, par crainte bien plus que par repentir, il rappela son épouse Octavie. Poppée attaquée se défend LXI. Alors, ivre de joie, la multitude monte au Capitole et adore enfin la justice des dieux ; elle renverse les statues de Poppée ; elle porte sur ses épaules les images d'Octavie, les couvre de fleurs, les place dans le Forum et dans les temples. Elle célèbre même les louanges du prince et demande qu'il s'offre aux hommages publics. Déjà elle remplissait jusqu'au palais de son affluence et de ses clameurs, lorsque des pelotons de soldats sortent avec des fouets ou la pointe du fer en avant, et la chassent en désordre. On rétablit ce que la sédition avait déplacé, et les honneurs de Poppée sont remis dans tout leur éclat. Cette femme, dont la haine, toujours acharnée, était encore aigrie par la peur de voir ou la violence du peuple éclater plus terrible, ou Néron, cédant au voeu populaire, changer de sentiments, se jette à ses genoux, et s'écrie "qu'elle n'en est plus à défendre son hymen, qui pourtant lui est plus cher que la vie ; mais que sa vie même est menacée par les clients et les esclaves d'Octavie, dont la troupe séditieuse, usurpant le nom de peuple, a osé en pleine paix ce qui se ferait à peine dans la guerre ; que c'est contre le prince qu'on a pris les armes ; qu'un chef seul a manqué, et que, la révolution commencée, ce chef se trouvera bientôt : qu'elle quitte seulement la Campanie et vienne droit à Rome, celle qui, absente, excite à son gré les soulèvements ! Mais Poppée elle-même, quel est donc son crime ? qui a-t-elle offensé ? Est-ce parce qu'elle donnerait aux Césars des héritiers de leur sang, que le peuple romain veut voir plutôt les rejetons d'un musicien d'Égypte assis sur le trône impérial ? Ah ! que le prince, si la raison d'État le commande, appelle de gré plutôt que de force une dominatrice, ou qu'il assure son repos par une juste vengeance ! Des remèdes doux ont calmé les premiers mouvements ; mais, si les factieux désespèrent qu'Octavie soit la femme de Néron, ils sauront bien lui donner un époux." Anicet prétend qu'il est l'amant d'Octavie LXII. Ce langage artificieux, et calculé pour produire la terreur et la colère, effraya tout à la fois et enflamma le prince. Mais un esclave était mal choisi pour asseoir les soupçons, et d'ailleurs l'interrogatoire des femmes les avait détruits. On résolut donc de chercher l'aveu d'un homme auquel on pût attribuer aussi le projet d'un changement dans l'État. On trouva propre à ce dessein celui par qui Néron avait tué sa mère, Anicet, qui commandait, comme je l'ai dit, la flotte de Misène. Peu de faveur, puis beaucoup de haine, avait suivi son crime ; c'est le sort de qui prote son bras aux forfaits d'autrui : sa vue est un muet reproche. Néron fait venir Anicet et lui rappelle son premier service : "lui seul avait sauvé la vie du prince des complots de sa mère ; le moment était venu de mériter une reconnaissance non moins grande, en le délivrant d'une épouse ennemie. Ni sa main ni son épée n'avaient rien à faire ; qu'il s'avouât seulement l'amant d'Octavie." Il lui promet des récompenses, secrètes d'abord, mais abondantes, des retraites délicieuses, ou, s'il nie, la mort. Cet homme, pervers par nature, et à qui ses premiers crimes rendaient les autres faciles, ment au delà de ce qu'on exigeait, et se reconnaît coupable devant plusieurs favoris, dont le prince avait formé une sorte de conseil. Relégué en Sardaigne, il y soutint, sans éprouver l'indigence, un exil que termina sa mort. Exil d'Octavie LXIII. Cependant Néron annonce par un édit, que, dans l'espoir de s'assurer de la flotte, Octavie en a séduit le commandant ; et, sans penser à la stérilité dont il l'accusait naguère, il ajoute que, honteuse de ses désordres, elle en a fait périr le fruit dans son sein. Il a, dit-il, acquis la preuve de ces crimes ; et il confine Octavie dans l'île de Pandataria. Jamais exilée ne tira plus de larmes des yeux témoins de son infortune. Quelques-uns se rappelaient encore Agrippine, bannie par Tibère ; la mémoire plus récente de Julie, chassée par Claude, remplissait toutes les âmes. Toutefois, l'une et l'autre avaient atteint la force de l'âge ; elles avaient vu quelques beaux jours, et le souvenir d'un passé plus heureux adoucissait les rigueurs de leur fortune présente. Mais Octavie, le jour de ses noces fut pour elle un jour funèbre : elle entrait dans une maison où elle ne devait trouver que sujets de deuil, un père, puis un frère, empoisonnés coup sur coup, une esclave plus puissante que sa maîtresse, Poppée ne remplaçant une épouse que pour la perdre, enfin une accusation plus affreuse que le trépas. Mort d'Octavie LXIV. Ainsi une faible femme, dans la vingtième année de son âge, entourée de centurions et de soldats, et déjà retranchée de la vie par le pressentiment de ses maux, ne se reposait pourtant pas encore dans la paix de la mort. Quelques jours s'écoulèrent, et elle reçut l'ordre de mourir. En vain elle s'écrie qu'elle n'est plus qu'une veuve, que la soeur du prince (1) ; en vain elle atteste les Germanicus, leurs communs aïeul (2), et jusqu'au nom d'Agrippine, du vivant de laquelle, épouse malheureuse, elle avait du moins échappé au trépas : on la lie étroitement, et on lui ouvre les veines des bras et des jambes. Comme le sang, glacé par la frayeur, coulait trop lentement, on la mit dans un bain très-chaud, dont la vapeur l'étouffa ; et, par une cruauté plus atroce encore, sa tête ayant été coupée et apportée à Rome, Poppée en soutint la vue. Des offrandes pour les temples furent décrétées à cette occasion ; et je le remarque, afin que ceux qui connaîtront, par mes récits ou par d'autres, l'histoire de ces temps déplorables, sachent d'avance que, autant le prince ordonna d'exils ou d'assassinats, autant de fois on rendit grâce aux dieux, et que ce qui annonçait jadis nos succès signalait alors les malheurs publics. Je ne tairai pas cependant les sénatus-consultes que distinguerait quelque adulation neuve, ou une servilité poussée au dernier terme.
1. Octavie était fille de
Claude par la nature, Néron fils par l'adoption. Répudiée comme épouse, elle
n'était donc plus que la soeur du prince Assassinat de deux affranchis LXV. La même année Néron, à ce que l'on crut, tua par le poison ses principaux affranchis, Doryphore, pour s'être opposé à l'hymen de Poppée, Pallas, parce que sa longue vieillesse retenait sans fin des trésors immenses. Romanus avait secrètement accusé Sénèque de liaisons suspectes avec Pilon ; mais Sénèque rejeta victorieusement l'accusation sur son auteur. Pison conçut des craintes ; et de là naquit plus tard une conspiration redoutable, mais malheureuse, contre le prince.
|