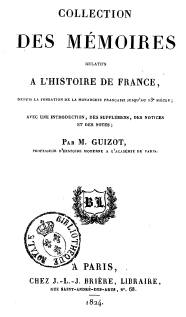
RAIMOND D'AGILES
HISTOIRE DES FRANCS QUI ONT PRIS JÉRUSALEM : PARTIE I
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
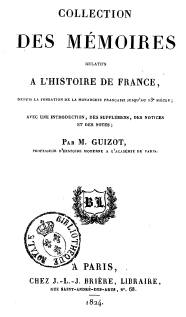
RAIMOND D'AGILES
HISTOIRE DES FRANCS QUI ONT PRIS JÉRUSALEM : PARTIE I
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
Par
CHAPELAIN DU COMTE RAIMOND DE TOULOUSE.
Guillaume de Tyr écrivait l'histoire des croisades quatre-vingts ans après leur explosion, au milieu des revers et presque sur les ruines du royaume chrétien qu'elles avaient fondé. Albert d'Aix répétait les récits des premiers croisés de retour en Occident, s'associant avec l'Europe entière à leurs sentiments et à leur gloire, bien qu'il fût demeuré étranger à leurs aventures. Raimond d'Agiles raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a fait, ce qu'ont vu et fait son prince et ses compagnons. Chanoine de la cathédrale du Puy en Velay, lorsqu'en 1095 Urbain II vint prêcher à Clermont la croisade, et probablement jeune encore, puisqu'il n'était que diacre, il accompagna son évêque, le célèbre Adhémar, fut ordonné prêtre dans le cours de l'expédition, devint chapelain de Raimond, comte de Toulouse, et prit, pendant la route même, en 1097 au plus tard, de concert avec Pons de Balazun ou Balazu, l'un des plus braves chevaliers du comte, la résolution d'écrire tout ce qui se passerait sous ses yen Aussi un manuscrit de l'ouvrage, qui se trouvait à Londres, porte-t-il le nom de Pons de Balazun ; mais il suffit de le lire pour reconnaître que Raimond d'Agiles en est le véritable auteur. Il écrivait probablement, à chaque station, ce qu'il avait observé ou ce que lui rapportait Pons, mêlé de plus près aux événements. Pons mourut au siège d'Archas, entre février et mai de l'année 1099, et Raimond n'en continua pas moins son travail, il te conduisit jusqu'au différend qui s'éleva, après la prise de Jérusalem, entre le roi Godefroi et le comte Raymond, au sujet de la Tour de David, c'est-à-dire jusques vers la fin de juillet 1099. La plupart des érudits s'accordent à croire que les deux fragments qui le prolongent un peu au-delà de cette époque, et contiennent le récit de la bataille d'Ascalon, ont été ajoutés après coup par une main étrangère. Raimond d'Agiles quitta Jérusalem avant le 14 août 1099, pour aller à Jéricho avec quelques autres croises ; ils passèrent le Jourdain sur un bateau d'osier, n'en trouvant aucun autre pour cette petite traversée ; et, de ce moment, rien ne nous apprend quel fut le sort de l'historien, ni s'il revint en Europe ou mourut en Palestine. La brusque conclusion de son ouvrage donne quelque vraisemblance à cette dernière conjecture.[1]
Le comte de Toulouse et les croisés de sa suite en sont, comme on peut s'y attendre, le principal objet ; mais il n'en est que plus authentique et d'un intérêt plus pressant. Tous les écrivains de cette époque nous font connaître, avec plus ou moins d'étendue, les événements généraux de la croisade. Raimond d'Agiles est un de ceux qui, en racontant certains faits avec tous les détails qu'il a lui-même recueillis au moment et sur le lieu, nous ont transmis, des idées et des mœurs des croisés, le tableau le plus vivant et le plus vrai ; la narration judicieuse de Guillaume de Tyr ne peint pas aussi fidèlement l'état de l'imagination des hommes dans cette grande aventure, que ces innombrables visions, songes, pressentiments, miracles, dont le chanoine du Puy nous a si scrupuleusement conservé le souvenir.
L'ouvrage est dédié à l'évêque de Viviers, Léger, qui fut plus tard légat du Saint-Siège. Pons de Balazun était du diocèse de Viviers. Il n'en existe aucune autre édition que celle qui se trouve dans les Gesta Dei per Francos de Bongars.
F. G.
A mon seigneur l'évêque du Vivarais, et à tous les hommes orthodoxes, Pons de Balazun et Raimond, chanoine du Puy, salut et participation à tous nos travaux !
Nous avons jugé nécessaire de faire connaître à vous et à tous les hommes d'au-delà des Alpes les grandes choses que Dieu a faites, et qu'il ne cesse de faire tous les jours avec nous, selon les témoignages ordinaires de son amour ; et nous l'avons résolu surtout parce que les hommes lâches et timides qui se retirent de nous font tous leurs efforts pour substituer des faussetés à la vérité. Que celui qui aura vu par là leur apostasie évite leurs discours et leur société ; car l’armée de Dieu quoiqu'elle ait été frappée de la verge du Seigneur en punition de ses péchés, est cependant, par l'effet de sa miséricorde, victorieuse de tout le paganisme. Mais comme, parmi les nôtres, les uns sont venus par l'Esclavonie, les autres par la Hongrie, d'autres par la Lombardie, d'autres par mer, il serait trop ennuyeux pour nous d'écrire ce qui se rapporte à chacun en particulier : c'est pourquoi, laissant les autres de côté, nous nous occuperons seulement de raconter ce qui concerne le comte de Saint-Gilles, l'évêque du Puy et leur armée.
Ceux-ci donc étant entrés en Esclavonie rencontrèrent dans leur route toutes sortes de difficultés, principalement à cause de la saison d'hiver qui régnait alors. L'Esclavonie est une contrée déserte, montagneuse, dépourvue de chemins, dans laquelle nous ne vîmes, durant trois semaines, ni animaux, ni oiseaux. Les habitants de ce pays sont tellement sauvages et grossiers qu'ils ne voulurent entretenir avec nous aucune relation de commerce, ni nous fournir des guides, fuyant de leurs bourgs et de leurs châteaux, ils massacraient, comme des troupeaux, les hommes faibles, les vieilles femmes, les pauvres et les malades qui ne suivaient l'armée que de loin, à cause de leurs infirmités, comme s'ils leur eussent fait beaucoup de mal. Il n'était pas facile à nos chevaliers de poursuivre ces brigands qui ne portaient point d'armes, et connaissaient bien les localités à travers les précipices des montagnes, et dans l'épaisseur des forets : aussi les avaient-ils sans cesse sur le dos, et ne pouvant jamais combattre, ils ne pouvaient cependant demeurer jamais tranquilles.
N'omettons pas de rapporter ici un exploit glorieux du comte. S'étant trouvé une fois, avec quelques-uns de ses chevaliers, enveloppé par les Esclavons, il s'élança sur eux avec impétuosité, et leur enleva même six hommes ; mais alors les Esclavons le menacèrent avec beaucoup plus de violence, et le comte, se voyant forcé de suivre la marche de l'armée, donna l'ordre d'arracher les yeux à ses prisonniers, de couper les pieds aux uns, le nez et les mains aux autres, afin de pouvoir, tandis que leurs compagnons seraient épouvantés de ce spectacle, et préoccupés de leur douleur, prendre la fuite lui-même, et se sauver plus sûrement avec ses chevaliers. Ce fut ainsi que le comte échappa, par la grâce de Dieu, à la mort qui le menaçait, et aux difficultés de sa position.
Il serait difficile de dire combien le comte déploya de vaillance et de sagesse dans ces circonstances. Nous demeurâmes environ quarante jours dans l'Esclavonie, marchant toujours à travers des brouillards tellement épais que nous pouvions, pour ainsi dire, les toucher et les pousser devant nous en faisant le moindre mouvement. Pendant ce temps, le comte, combattant constamment sur les derrières, était toujours occupé à défendre le peuple, et n'arrivait jamais le premier mais toujours le dernier au gîte ; tandis que les uns y étaient rendus à midi, d'autres le soir, le comte très souvent n'y arrivait qu'au milieu de la nuit, ou même au chant du coq. Enfin, à l'aide de la miséricorde de Dieu, des efforts du comte et de la sagesse de l'évêque, l'armée traversa si bien le pays que nous ne perdîmes pas un seul homme, soit de faim, soit en bataille rangée. Dieu a voulu, je pense, que son armée passât à travers l'Esclavonie, dans l'intention que ces hommes sauvages, qui ne le connaissent point, voyant le courage et la patience de ses chevaliers, en viennent tôt ou tard à renoncer à leur férocité, ou demeurent sans excuse au jour du jugement. Enfin, à la suite de beaucoup de fatigues et de périls, nous arrivâmes à Scodra, auprès du roi des Esclavons. Le comte eut fréquemment des communications fraternelles avec lui, et lui fit beaucoup de présents, afin que l'armée pût acheter et chercher en sécurité tout ce dont elle avait besoin. Mais ce fut une erreur : nous eûmes à nous repentir d'avoir demandé la paix ; car, pendant ce temps, les Esclavons, se livrant à leurs fureurs accoutumées, massacrèrent nos hommes, et enlevèrent tout ce qu'ils purent à ceux qui n'avaient, point d'armes. Nous cherchâmes alors le moyen de fuir, et non de nous venger. Voilà tout ce que j'ai à dire sur l'Esclavonie.
Nous arrivâmes à Durazzo, et nous crûmes être dans notre patrie, regardant l'empereur Alexis et les siens comme des frères et des coopérateurs ; mais ceux-ci, devenant cruels comme des lions, attaquèrent des hommes paisibles, qui ne songeaient à rien moins qu'à se servir de leurs armes ; ils les massacrèrent dans les lieux cachés, dans les forêts, dans les villages éloignés du camp, et se livrèrent à toutes sortes de fureurs durant toute la nuit. Tandis qu'ils faisaient ainsi rage, leur chef cependant promettait la paix, et pendant la trêve même on massacra. Pons Renaud et on blessa mortellement. Pierre son frère, tous deux princes d'une grande noblesse. Et quoique nous eussions trouvé l'occasion de nous venger, nous aimâmes mieux poursuivre notre route que punir ces offenses, et nous nous remîmes en marche. Nous reçûmes en chemin des lettres dans lesquelles l'empereur ne parlait que de paix, de fraternité, et même, pour ainsi dire, d'adoption filiale ; mais ce n'étaient là que des paroles, car, en avant et en arrière, à droite et à gauche de nous, les Turcs, les Comans, les Uses, les Pincenaires et les Bulgares nous tendaient sans cesse des embûches. Un jour, pendant que nous étions dans une vallée de la Pélagonie, l'évêque du Puy s'était un peu éloigné de l'armée, cherchant un emplacement convenable pour y camper ; il fut pris par des Pincenaires qui le renversèrent de dessus sa mule, le dépouillèrent et le frappèrent fortement à la tête. Mais comme un si grand prélat était encore nécessaire au peuple de Dieu, sa vie fut préservée par la miséricorde du Seigneur. L'un des Pincenaires lui demandait de l'or et : le défendait contre les autres ; pendant ce temps la nouvelle de cet événement se répandit dans le camp, et l'évêque s'échappa, tandis que ses ennemis différaient et que ses amis s'élançaient pour le délivrer.
Lorsque nous fûmes arrivés, à travers des pièges semblables, à un certain château qu'on appelle Bucinat, le comte fut informé que les Pincenaires voulaient attaquer notre armée dans ; les défilés d'une montagne ; il se cacha avec quelques chevaliers, tomba sur les Pincenaires à l'improviste, leur tua beaucoup d'hommes et mit les autres en fuite. Dans le même temps on recevait des messages pacifiques de l'empereur, et nous étions entourés de toutes parts d'ennemis que nous suscitaient ses artifices. Lorsque nous fûmes arrivés à Thessalonique, l'évêque tomba malade et demeura dans cette ville avec un petit nombre d'hommes. Après cela nous nous rendîmes dans une ville nommée Rossa ; et comme il devint évident que les habitants se disposaient à nous faire beaucoup de mal, nous en vînmes à nous lasser un peu de notre patience accoutumée. Nous prîmes donc les armes, les premiers remparts furent renversés, on enleva un immense butin, la ville se rendit, nous y transportâmes nos bannières et nous repartîmes, après avoir proclamé Toulouse, qui était le cri de ralliement du comte. Nous arrivâmes à une autre ville nommée Rodosto : là les chevaliers à la solde de l'empereur ayant voulu agir contre nous pour venger leurs compagnons, un grand nombre d'entre eux furent tués, et nous enlevâmes quelque butin. Là aussi revinrent vers nous les députés que nous avions envoyés en avant auprès de l'empereur, ils avaient reçu de lui de l'argent, et nous promirent toutes sortes de prospérités auprès de ce souverain. En un mot, les paroles des députés de l'empereur et des autres firent tant, que le comte laissa son armée et partit avec un petit nombre d'hommes et sans armes, pour se rendre en hâte auprès de l'empereur. Ces députés avaient dit que Boémond, le duc Godefroi, le comte de Flandre et les autres princes, suppliaient le comte de venir le plus promptement possible traiter avec l'empereur, au sujet de l'expédition de Jérusalem, afin que ce dernier prît la croix et se mît à la tête de l'armée de Dieu ; qu'il avait dit à ce sujet qu'il réglerait avec le comte tout ce qui se rapportait à lui-même, aux autres et aux détails du voyage ; ils avaient ajouté que la guerre était imminente, et serait peut-être fatale s'ils étaient privés du crédit d'un si grand homme ; qu'en conséquence, le comte devait se hâter de partir, suivi seulement de quelques-uns des siens, afin qu'on n'eût plus de retard à essuyer lorsque son armée serait arrivée et qu'il aurait lui-même réglé toutes choses avec l'empereur. Enfin le comte céda et fut entraîné cette seule fois à quitter son camp et à se porter en avant de son armée, et ce fut ainsi qu'il arriva à Constantinople tout désarmé.
Les événements que j'ai racontés jusqu'à présent ne laissaient pas de me donner, à moi qui écris, quelque mouvement de joie a raison de leurs heureux résultats, et maintenant je suis accablé d'amertume et de douleur à tel point que je me repens d'avoir entrepris un récit que j'ai cependant fait vœu de conduire jusqu'au bout. Que dois-je dire et par où faut-il commencer ? Parlerai-je de l'artificieuse et détestable perfidie de l'empereur ? Dirai-je la fuite honteuse de notre armée et le désespoir inconcevable auquel elle s'abandonna ? En racontant la mort de tant de princes illustres, élèverai-je un monument de douleur éternelle ? Que ceux qui voudront connaître de tels détails les demandent à d'autres plutôt qu'à nous. Voici la seule chose véritablement mémorable que je croie ne devoir point passer sous silence : c'est que, tandis que tous les nôtres méditaient d'abandonner le camp, de prendre la fuite, de quitter leurs compagnons, de renoncer à toutes les choses qu'ils avaient transportées de pays si lointains, des pénitences et des jeûnes salutaires leur rendirent enfin tant d'énergie et de force, que le souvenir seul de leur désespoir et des projets de fuite qu'ils avaient auparavant formés les accablait de la plus profonde douleur. Qu'il vous suffise de ce que je viens de dire.
Le comte donc ayant été accueilli très honorablement par l'empereur et ses princes, l'empereur lui demanda de lui rendre hommage et de lui prêter serment, comme tous les autres princes avaient fait. Le comte répondit qu'il n'était pas venu pour reconnaître un autre seigneur ni pour combattre pour un autre que celui pour lequel il avait renoncé à sa patrie et à ses biens ; que ce qu'il ferait toutefois, si l'empereur allait à Jérusalem avec une armée, serait de mettre sous sa foi sa personne, tous les siens et tout ce qu'il possédait. Mais l'empereur s'excusa, disant qu'il redoutait le Allemands, les Hongrois, les Comans et les autres nations sauvages qui dévastaient son empire, s'il allait lui-même faire ce voyage avec les pèlerins.
Cependant le comte, informe de la mort et de la fuite de quelques-uns des siens, se crut trahi et fit faire des représentations à l'empereur Alexis, au sujet de cette trahison, par quelques-uns des princes de notre armée. Alexis répondit qu'il avait ignoré que les nôtres eussent commis des dévastations dans ses Etats, et que les siens eussent reçu toutes sortes d'insultes ; que ce dont le comte se plaignait se réduisait à ce fait, que son armée, tandis qu'elle dévastait, selon son usage, les campagnes et les châteaux, avait pris la fuite lorsqu'elle avait vu paraître une armée de l'empereur ; que cependant il donnerait satisfaction au comte. En effet, il lui livra Boémond en otage. On en vint ensuite à un jugement, et le comte fut forcé, au mépris de la justice, de relâcher son otage.
Pendant ce temps notre armée arriva à Constantinople, et ensuite l'évêque nous rejoignit avec son frère qu'il avait laissé malade à Durazzo. Alexis envoya messages sur messages, et promit de donner beaucoup de choses au comte s'il voulait lui rendre hommage, ainsi qu'il en avait été requis, et comme avaient fait.les autres princes. Le comte ne cessait de méditer sur les moyens de se venger des insultes faites ; aux siens, et de rejeter un si grand déshonneur loin de lui et de tous ses hommes. Mais le duc de Lorraine, le comte de Flandre et les autres princes détestaient ces projets, disant qu'il était insensé de combattre des Chrétiens lorsqu'on était menacé par les Turcs. Boémond s'engagea à porter secours à l'empereur, si le comte faisait quelque tentative contre celui-ci, ou s'il différait plus longtemps de lui rendre hommage et de prêter serment. Ayant donc pris conseil des siens, le comte jura de n'enlever la vie ou l'honneur à Alexis, ni par lui ni par tout autre ; et lorsqu'on l'interpella au sujet de l'hommage, il répondit qu'il n'en ferait rien, au péril même de sa tête : aussi Alexis ne lui fit-il que peu de présents.
Nous traversâmes ensuite la mer, et nous arrivâmes à Nicée. Le duc Boémond et les autres princes, s'étaient portés en avant du comte et travaillaient déjà au siège. La ville de Nicée est extrêmement fortifiée par la nature aussi bien que par l’art. Elle a, du côté de l'occident, un lac très grand qui baigne ses murailles, et, sur les trois autres côtés, un fossé toujours rempli par les eaux de quelques petits ruisseaux. En outre elle est entourée de murs tellement élevés, qu'elle n'a à redouter ni les assauts des hommes ni les efforts des machines : les tours sont très rapprochées et leurs meurtrières si bien disposées en face les unes des autres, que nul ne peut s'avancer sans courir de grands dangers, et que ceux qui voudraient se porter plus près, ne pouvant eux-mêmes faire aucun mal, sont facilement écrasés du haut de ces mêmes tours.
Cette ville, telle que je viens de le dire, fut assiégée par Boémond du côté du nord, le duc et les Allemands vers l'orient, le comte et l'évêque du Puy vers le midi, car le comte de Normandie n'était pas encore avec nous. Voici le seul fait que nous croyons ne devoir pas passer sous silence. Tandis que le comte voulait prendre position avec les siens, les Turcs, descendant des montagnes en deux corps, vinrent attaquer notre armée tandis que l'un de leurs corps combattrait le duc et les Allemands du côté de l'orient, ils avaient le projet que l'autre corps, entrant dans la ville par le côté du midi, et sortant par une autre porte, vînt assaillir les nôtres et les rejeter facilement hors de leur camp au moment où ils ne s'attendraient point à une pareille entreprise. Mais Dieu, qui a coutume de renverser les conseils des impies, déjoua complètement les projets de ceux-ci, en envoyant, comme à point nommé, le comte, qui cherchait à prendre sa position au moment où le corps des Turcs était presque sur le point d'entrer dans la ville : dès le premier choc, le comte les mit en fuite, leur tua beaucoup de monde et poursuivit les autres jusque sur les hauteurs de la montagne : l'autre corps turc, qui voulut aller attaquer les Allemands, fut pareillement mis en fuite et écrasé.
Après cela on construisit des machines, on attaqua les murailles, mais le tout en pure perte ; car les murailles étaient extrêmement fortes et en outre vigoureusement défendues par les flèches et les machines des ennemis. On combattit donc durant cinq semaines sans aucun résultat. Enfin, par la volonté de Dieu, quelques hommes de la maison du comte et de l'évêque s'étant avancés, non sans péril, vers la tour située à l'angle qui fait face au midi, formèrent de vive force une tortue, commencèrent à miner l'une des tours, et, après l'avoir minée, la renversèrent. La ville même eût été prise par ce moyen, si les ténèbres de la nuit n'y eussent porté obstacle. Pendant la nuit, les assiégés relevèrent la muraille et rendirent inutiles nos travaux de la veille. Cependant la ville fut tellement frappée de terreur qu'elle se trouva enfin forcée à se rendre. Ce qui y contribua aussi fut qu'on avait établi sur le lac des navires de l'empereur que l'on avait transportés d'abord par terre. Ne comptant plus, par ces divers motifs, recevoir désormais aucun secours, voyant que l'armée des Francs s'augmentait de jour en jour, et n'osant se confier en leurs forces, les habitants se rendirent à Alexis. A cette époque, le comte de Normandie était arrivé. Alexis avait promis aux princes et au peuple Francs de leur abandonner l'or et l'argent, les chevaux et les effets de toute espèce qui se trouveraient dans la ville, d'y fonder un couvent latin et un hôpital pour les pauvres Francs, et en outre de faire, sur ses propres fonds, de si grandes largesses à chaque homme de l'armée que tous voudraient combattre toujours pour lui. Comptant sur sa fidélité à tenir ses engagements, les Francs consentirent à la reddition de la ville. Alexis, dès qu'elle fut remise en son pouvoir, témoigna sa reconnaissance à l'armée, de telle manière qu'aussi longtemps qu'il vivra le peuple sera fondé à le maudire et à le proclamer traître.
Nous apprîmes à cette époque que Pierre l'ermite, qui était arrivé à Constantinople longtemps avant nos armées, suivi d'une nombreuse multitude, avait été également trahi par l'empereur. Pierre ne connaissait pas du tout les localités et ignorait l'art de la guerre ; l'empereur le força à passer la mer et le livra ainsi aux Turcs. Ceux de Nicée, voyant cette multitude incapable de combattre, la détruisirent sans peine comme sans retard, et tuèrent environ soixante mille hommes. Le reste se réfugia dans une forteresse et échappa ainsi au glaive des Turcs. Devenus audacieux et fiers à la suite de ces succès, les Turcs envoyèrent les armes et les prisonniers qu'ils avaient enlevés aux nobles de leur nation et de celle des Sarrasins, et écrivirent chez les peuples et dans les villes éloignées que les Francs n'avaient aucune valeur à la guerre.
Nous partîmes de la ville de Nicée pour entrer en Romanie. Le second jour, Boémond et quelques autres princes se séparèrent imprudemment du comte, de l'évêque et du duc. Le troisième jour de son départ, comme Boémond se disposait à dresser ses tentes, il rencontra cent cinquante mille Turcs qui s'avançaient pour le combattre. Tandis qu'il formait ses rangs selon l'occurrence, et se préparait pour la bataille, il perdit beaucoup d'hommes de son armée qui ne suivaient que de loin. En même temps il manda au comte et au duc, qui étaient alors à deux milles de distance, de venir à son secours. Dès que le messager de Boémond fut arrivé dans notre camp, tous s'empressèrent à l’envi de prendre leurs armes, de monter sur leurs chevaux et de se mettre en route. Soliman et ceux qui étaient avec lui, ayant appris que notre armée, c'est-à-dire celle de l'évêque, du duc et du comte, s'avançait pour combattre la leur, désespérèrent de remporter la victoire, et prirent aussitôt la faite, en sorte que celui qui venait d'enlever des prisonniers et un grand nombre de tentes dans le camp de Boémond, abandonna toutes les siennes, cédant à la puissance de Dieu. On rapporte, à cette occasion, un miracle remarquable, mais que nous n'avons pas vu nous-mêmes, savoir, que deux chevaliers, couverts d'armes toutes brillantes et ayant d'admirables figures, marchèrent en avant de notre armée, menaçant les ennemis, et ne leur laissant en aucune façon la possibilité de combattre, et que, lorsque les Turcs voulaient les repousser avec leurs lances, ils les trouvaient toujours invulnérables. Ce que nous disons ici, nous l'avons appris de ceux des Turcs qui, méprisant la société des leurs, s'attachèrent à nous. Mais ce que nous pouvons certifier par notre propre témoignage, c'est que, durant le premier et le second jour, nous rencontrâmes sur toute la route les chevaux des ennemis, morts ainsi que leurs maîtres. Ceux-ci donc ayant été battus et dispersés, nous traversâmes la Romanie paisiblement et joyeusement, et nous arrivâmes à Antioche. Le comte cependant ralentit un peu la marche de son armée par suite de la maladie qu'il essuya. Et quoique nous sachions très bien que les incrédules trouveront ceci désagréable, nous ne devons point dissimuler ce que fit la clémence divine en cette occasion. Il y avait dans notre armée un certain comte de Saxe qui vint trouver le comte Raimond, et s'annonça comme envoyé par Saint-Gilles, assurant avoir été invité à deux reprises à dire au comte : Sois tranquille, tu ne mourras pas de cette maladie ; j'ai obtenu de Dieu un délai, et je serai toujours avec toi. Le comte était assez disposé à le croire, et cependant il fut tellement accablé par le mal, qu'on le déposa de son lit sur la terre, ayant à peine un souffle de vie. Aussi l'évêque de la ville d'Orange lui dit l'office comme s'il était déjà mort, mais la clémence divine, qui l'avait fait chef de son armée, l'enleva soudainement au trépas et lui rendit la santé.
Lorsque nous nous approchâmes d'Antioche, il y avait plusieurs princes qui n'étaient pas d'avis de l'assiéger, soit parce que l'hiver s'avançait, soit parce que l'armée était alors dispersée dans les châteaux, et que d'ailleurs les chaleurs de l'été l'avaient fort affaiblie. Ils disaient donc qu'il fallait attendre les forces de l'empereur, et l'armée qu'on annonçait devoir arriver de France, et voulaient qu'on prît des cantonnements d'hiver jusqu'au printemps. Les autres princes, parmi lesquels était, le comte, disaient au contraire que nous étions venus par l'inspiration de Dieu ; que sa miséricorde nous avait déjà fait conquérir Nicée, ville très forte, que nous avions, par sa clémence, remporté la victoire sur les Turcs, garanti notre sécurité, maintenu la paix et la concorde dans notre armée ; qu'il fallait, en conséquence, nous en remettre pour nous tous à Dieu même ; qu'enfin nous ne devions redouter ni les rois, ni les princes des rois, ni les lieux, ni le temps, puisque le Seigneur nous avait déjà sauvés de plus grands périls. Nous nous rendîmes donc à Antioche, et dressâmes notre camp tellement près de la ville que très souvent, du haut de leurs tours, les ennemis blessaient nos hommes et nos chevaux sous les tentes même.
Et puisque l'occasion se présente de parler de la ville d'Antioche, il nous paraît nécessaire de dire quelque chose de la position de cette ville afin que ceux qui n'ont.pas vu les lieux puissent comprendre plus facilement la suite des combats et des assauts qui y furent livrés.
Au milieu des montagnes du Liban est une plaine que le voyageur ne peut franchir qu'en une journée dans sa largeur, et en une journée et demie dans sa longueur. Elle est bornée à l'occident par un marais, à l'orient par un fleuve qui en entoure une partie et court ensuite vers le pied des montagnes situées au midi de cette même plaine, de telle sorte qu'il n'y a plus aucun passage entre le fleuve et les montagnes : de là les eaux s'écoulent dans la mer Méditerranée, laquelle est assez voisine d'Antioche. Dans l'un des défilés que forme le fleuve, lorsque déjà il coule au pied des montagnes, est située la ville d'Antioche. Le fleuve descend donc de l'occident le long de la muraille inférieure, et n'est séparé de la ville que par un espace de terrain de la portée d'une flèche. La ville ainsi située s'élève vers l'orient, et enferme, dans son enceinte, les sommités de trois montagnes. Celle de ces montagnes qui la borne vers le nord est séparée des deux autres par un très grand précipice ; en sorte qu'il n'y a aucun moyen, ou du moins que des moyens extrêmement difficiles, de communiquer de celle-là aux autres. Au sommet de la montagne septentrionale est un château, et, sur le milieu de la même montagne, un autre château appelé Colax en langue grecque : sur la troisième montagne on ne voit que des tours. La ville occupe en longueur un espace de deux milles, et est tellement garnie de murailles, de tours et d'ouvrages avancés, qu'elle n'a à redouter ni les efforts des machines, ni les assauts des hommes, dut tout le genre humain se réunir contre elle,
Cette ville fortifiée ainsi que nous venons de le dire, l'armée des Francs l'assiégea du côté du nord. Quoiqu'elle comptât trois cent mille hommes portant les armes, elle n'entreprit point de livrer assaut à la place, et se borna à établir son camp tout auprès. Il y avait dans l'intérieur de la ville deux mille très bons chevaliers, quatre ou cinq mille chevaliers soldés, et dix mille hommes de pied, et même plus. Les murailles, d'ailleurs très élevées, étaient en outre défendues par un fossé et des marais ; en sorte, que les portes étant bien gardées, tout le reste pouvait demeurer en sécurité.
Au commencement, et lorsque nous arrivâmes, nous prîmes nos positions fort imprudemment ; les ennemis, s'ils en eussent eu connaissance, auraient très bien pu nous en enlever quelques-unes, car on ne prit aucun soin, dans notre armée, d'établir des sentinelles, et l’on n'observa jamais un mode régulier de campement. En outre, comme tous les châteaux du pays, ainsi que les villes voisines, se rendirent aux nôtres, soit par l'effet de la terreur qu'inspirait notre armée, soit par suite de leur désir d'échapper à la servitude des Turcs, il en résulta que nos forces furent extrêmement dispersées, car chacun cherchait à faire prévaloir son intérêt particulier, et ne songeait nullement à l'intérêt public. Ceux des nôtres qui demeurèrent dans le camp avaient des vivres en grande abondance, si bien qu'on ne prenait d'un bœuf que les cuisses, le haut des épaules, quelques-uns, mais en fort petit nombre, la poitrine ; et quant au grain et au vin, on ne saurait dire avec quelle extrême facilité on s'en procurait.
Tandis que les choses se passaient ainsi dans le camp, les ennemis se cachaient dans l'intérieur de la ville ; en sorte qu'on ne voyait personne sur les remparts, si ce n'est les hommes de garde. Ayant appris que les nôtres allaient ouvertement et sans armes dévaster les maisons de campagne et les champs, des ennemis venus, je ne sais si c'est d'Antioche ou d'une autre ville située à deux journées de marche, et nommée Alep, commencèrent à tuer ceux des nôtres qu'ils rencontraient marchant sans précaution et sans armes. Ceci ne tarda pas à diminuer un peu l'extrême abondance qu'il y avait dans notre camp, et de leur côté les ennemis, massacrant et pillant sans obstacle, affluèrent sur les routes avec une nouvelle ardeur. Lorsque ces faits furent publiquement connus dans le camp, Boémond fut élu pour marcher contre les ennemis, les comtes de Flandre et de Normandie partirent avec lui ; mais ils ne purent entraîner à leur suite que cent cinquante Chevaliers, et si un sentiment de pudeur ne les eût retenus, ils seraient revenus sur leurs pas, à raison de la faiblesse de leur escorte. Partant cependant sous la conduite de Dieu, ils rencontrèrent les ennemis, les poursuivirent, les précipitèrent dans le fleuve, et, ayant remporté la victoire, ils rentrèrent dans le camp comblés de joie, et chargés de dépouilles.
Dans le même temps, des navires Génois abordèrent sur le rivage à dix milles de distance de notre camp, au lieu appelé le port de Saint-Siméon.
Déjà cependant les ennemis s'accoutumant peu à peu à sortir de la ville, allaient tuer les écuyers ou les paysans qui paissaient les chevaux ou les bœufs au-delà du fleuve, et ensuite ils ramenaient dans la place le butin qu'ils avaient enlevé. Nous avions dressé nos tentes sur les bords du fleuve, et fait un pont avec des bateaux que nous avions trouvés en ce lieu. Mais la ville avait aussi un pont situé à peu près sur l'angle inférieur du côté de l'occident, et il y avait en face de nous un monticule sur lequel étaient deux mosquées, et de petits casais pour les sépultures. Nous donnons ces détails, afin que l'on comprenne plus aisément les événements qui se passèrent de ce côté. Ainsi que nous l'avons dit, les ennemis prirent peu à peu plus d'assurance, et les nôtres, sortant du camp avec intrépidité, ne craignirent pas non plus d'aller les attaquer, quoiqu'ils se trouvassent fort souvent inférieurs en nombre. Les Turcs étaient fréquemment battus et mis en fuite ; cependant ils revenaient aussitôt à la charge, soit parce qu'ils avaient des chevaux très agiles, qu'eux-mêmes étaient fort dégagés, et ne portaient d'autres armes que leurs flèches, soit parce qu'ils avaient toujours l'espoir de pouvoir se réfugier sur le pont dont nous avons déjà parlé, et la ressource de lancer leurs flèches de loin, et du haut de leur monticule, car leur pont était à peu près à un mille de distance du nôtre. On s'attaquait sans relâche dans la plaine qui séparait ces deux ponts, et l'on s'y battait tous les jours. Au commencement du siège, le comte et l'évêque du Puy avaient campé sur les bords du fleuve, et, se trouvant ainsi plus rapprochés des ennemis, ils étaient plus fréquemment exposés à leurs attaques, lien résulta qu'à la suite de ces combats continuels, tous les hommes perdirent leurs chevaux, car les Turcs ne savent pas faire la guerre avec les lances ou les épées ; ils combattent de loin avec leurs flèches, et sont ainsi également redoutables, soit lorsqu'ils fuient, soit lorsqu'ils poursuivent.
Dans le troisième mois du siège, et lorsque déjà les denrées se vendaient plus cher, Boémond et le comte de Flandre furent choisis pour aller avec l'armée chercher des vivres, et le comte et l'évêque du Puy demeurèrent pour garder le camp ; car le comte de Normandie se trouvait absent en ce moment, et le duc était fort malade. Les ennemis, informés de ces nouvelles, recommencèrent leurs attaques accoutumées. Le comte se vit donc forcé de marcher contre eux : selon son usage, ayant rangé ses hommes de pied en bataille, il s'avança lui-même avec quelques chevaliers à la poursuite des assaillants, leur prit et leur tua deux hommes à la descente même du monticule, et força ainsi les autres à rentrer tous sur leur pont. Dès que nos hommes de pied eurent vu ce mouvement de retraite, ils abandonnèrent leurs positions et leurs signaux de reconnaissance, et accoururent pêle-mêle jusqu'auprès du pont. Là, s'étant établis comme s'ils eussent été en parfaite sûreté, ils se mirent à lancer des pierres et des traits sur ceux qui défendaient le pont ; mais en même temps les Turcs, ayant formé un corps, s'avancèrent par le pont et par un gué situé au-dessous, pour marcher contre les nôtres. Sur ces entrefaites, nos chevaliers s'étaient lancés, dans la direction de notre pont, à la poursuite d'un cheval dont ils avaient démonté le cavalier. A cette vue les gens de pied croyant que les chevaliers avaient pris la fuite devant leurs ennemis, se mirent aussi à tourner le dos à ceux-ci, et les Turcs, les poursuivirent sans relâche et tuèrent quelques hommes. Les chevaliers Français voulurent tenter de résister et de défendre leurs compagnons ; mais enveloppés par cette multitude d'hommes de pied qui s'accrochaient en fuyant à leurs armes, à la crinière ou à la queue de leurs chevaux, les uns étaient renversés par terre, les autres, pour sauver leurs compagnons, prenaient la fuite. Pendant ce temps les ennemis poursuivaient leurs avantages, sans relâche comme sans pitié, massacrant les vivants, dépouillant les morts. Quant aux nôtres, ils ne se bornèrent pas à abandonner leurs armes, à prendre la fuite, à oublier tout sentiment d'honneur, plusieurs se précipitèrent dans les eaux du fleuve, pour être écrasés sous les pierres ou les flèches des ennemis, ou engloutis par les flots. Celui que sa force ou son habileté à la nage seconda, franchit la distance en suivant le fleuve, et arriva au camp pour se réunir à ses compagnons. Les autres poursuivirent leur fuite depuis le pont des ennemis jusqu'à notre pont. Il périt en cette rencontre au moins quinze de nos chevaliers, et environ vingt hommes de pied. Là succomba un très noble jeune homme, Bernard Raimond, originaire de Béziers.
Que les serviteurs de Dieu ne nous accusent point et ne s'irritent point contre nous, si nous racontons aussi ouvertement la honte de notre armée ; car Dieu, qui voulut ainsi frapper et ramener à des sentiments de repentance les hommes coupables d'adultère et de pillage, réjouit dans le même temps ceux de notre armée qui étaient allés faire une expédition au dehors. Un bruit sorti de notre camp annonça à Boémond et à ses compagnons que toutes choses nous prospéraient, et que le comte avait remporté une noble victoire. Cette nouvelle releva singulièrement leur courage. Tandis que Boémond était occupé à attaquer une maison de campagne, il entendit tout-à-coup, parmi quelques-uns de ses paysans, des cris et un mouvement de fuite. Des chevaliers qu'il envoya à leur rencontre virent de loin arriver une armée de Turcs et d'Arabes. Parmi ceux qui s'étaient portés en avant pour reconnaître la cause de ce mouvement de retraite et des cris qu'on avait entendus, étaient le comte de Flandre, et avec lui quelques Provençaux, car tous les hommes de la Bourgogne, de l'Auvergne, de la Gascogne et les Goths étaient également appelés Provençaux, les autres étaient les Français : on avait adopté ces dénominations dans l'armée, car parmi les ennemis nous étions tous appelés Francs. Le comte de Flandre donc, comme nous avons dit, jugeant qu'il serait honteux d'aller faire un rapport sur l'approche des ennemis plutôt que de les attaquer, s'élança avec impétuosité dans les rangs des Turcs ; ceux-ci n'étant point accoutumés à combattre avec le glaive, cherchèrent leur salut dans la fuite, et le comte ne remit son épée dans le fourreau qu'après avoir tué cent de ses ennemis. Comme il retournait vainqueur auprès de Boémond, il vit douze mille Turcs qui marchaient sur ses traces, et vers une colline située à sa gauche, il vit en même temps surgir une multitude innombrable d'hommes de pied. Alors ayant délibéré avec les autres chefs, et prenant un nouveau renfort, il attaqua vigoureusement les ennemis. Boémond le suivit de loin avec le reste de l'armée, et veilla à la sûreté des troupes qui marchaient sur les derrières ; car les Turcs sont dans l'usage, quand même ils se trouvent inférieurs en nombre, de chercher toujours à envelopper leurs adversaires, et dans cette occasion aussi ils firent tous leurs efforts pour y parvenir ; mais Boémond déjoua cette manœuvre par sa sagesse, Les Turcs et les Arabes qui marchaient contre le comte de Flandre prirent la fuite dès qu'ils eurent reconnu qu'il n'y avait pas moyen de combattre de loin avec leurs flèches, et qu'il faudrait en venir aux mains de près et avec le glaive. Le comte les poursuivit jusqu'à deux milles en avant, et vous eussiez vu, sur toute cette longueur, la terre jonchée de corps renversés, comme les champs sont jonchés de gerbes après la moisson. Ainsi furent battues et mises en fuite ces bandes ennemies, dont Boémond eut à soutenir les attaques. Quant à cette foule innombrable d'hommes de pied dont nous avons parlé ci-dessus, ils prirent la fuite à travers un pays où les chevaux ne pouvaient les suivre. Si l'on ne devait blâmer la témérité de cette assertion, j'oserais presque élever ce combat au-dessus des combats des Macchabées. Si le Macchabée détruisit une armée de quarante-huit mille ennemis avec trois mille hommes, ici plus de soixante mille ennemis furent mis en fuite par quatre cents chevaliers. Mais, sans prétendre dénigrer le Macchabée, ni exalter la valeur de nos chevaliers, bornons-nous à dire que Dieu fut admirable par le bras du Macchabée, et plus admirable encore par le bras des nôtres. Il est remarquable qu'après que les ennemis eurent été battus, le courage des nôtres diminua, et qu'ils n'osèrent se mettre à la poursuite de ceux qu'ils voyaient s'enfuir en désordre. Notre armée étant donc rentrée victorieuse, mais sans provisions, bientôt il y eut dans le camp une disette telle que deux sous suffisaient à peine pour fournir du pain à un homme pendant un jour, et que toutes les autres denrées étaient vendues " tout aussi cher. Les pauvres commencèrent donc à partir ; beaucoup de riches, redoutant la pauvreté, partirent également ; et ceux qui demeuraient au camp par attachement à leurs devoirs voyaient avec douleur leurs chevaux dépérir de jour en jour, par suite de la famine ; car il y avait peu de paille, et le foin était tellement cher que sept ou huit sous ne suffisaient pas pour la nourriture d'un cheval pendant la nuit.
L'armée fut menacée d'une autre calamité. Boémond qui s'était illustré dans son expédition déclara qu'il voulait s'en aller, attendu qu'il n'était venu que pour l'honneur, et qu'il voyait dépérir chaque jour ses hommes et ses chevaux, ajoutant qu'il n'était pas riche, et que sa fortune particulière ne lui permettait pas de demeurer aussi longtemps à ce siège. Dans la suite nous découvrîmes qu'il n'avait dit tout cela que par l'effet de son ambition, qui lui faisait désirer ardemment de devenir prince de la ville d'Antioche.
Au commencement de janvier, il y eut un grand tremblement de terre, et nous vîmes dans le ciel un phénomène assez remarquable. A la première veille de la nuit, le ciel parut extrêmement rouge, comme si l'aurore eût paru pour annoncer la prochaine venue du jour. Et quoique Dieu employât ce moyen pour châtier son armée, afin que nous fussions attentifs à la lumière qui brillait ainsi au milieu des ténèbres, quelques hommes cependant demeurèrent aveugles et enfoncés dans le précipice, au point de ne renoncer nullement à leur esprit de luxure et de rapine. L'évêque prescrivit à cette époque un jeûne de trois jours, invita le peuple à faire des processions, des prières et des aumônes, et ordonna aux prêtres de dire des messes et des prières, et aux clercs de chanter des psaumes. Le Seigneur, dans sa bonté, se souvint de sa miséricorde, et différa sa vengeance sur ses enfants, pour que l'orgueil de leurs adversaires n'en fût point accru. Il y avait dans notre armée un homme de la maison de l'empereur, qu'Alexis nous avait donné en sa place, qui se nommait Tatin, n'avait point de nez et était dépourvu de tout courage. J'avais presque oublié d'en parler, et, certes, il aurait bien dû demeurer à jamais en oubli. Cet homme soufflait tous les jours aux oreilles des princes le conseil de se retirer dans les châteaux des environs, et de combattre de là la ville d'Antioche, soit par de fréquents assauts, soit en dressant des embûches. Lorsque le comte fut instruit de ces détails par le bruit public (car il avait été malade depuis le jour où il s'était vu forcé de prendre la fuite vers le pont), il convoqua les princes avec l'évêque du Puy ; et, après avoir tenu conseil, il leur donna cinq cents marcs d'argent, sous la condition que si quelqu'un de ses chevaliers venait à perdre son cheval, on le lui remplaçât avec cette somme de cinq cents marcs, et avec les autres ressources qui avaient été réunies en association de fraternité. Cette alliance de confraternité fut infiniment utile en ce temps-là, parce que les pauvres de notre armée, qui voulaient passer de l'autre côté du fleuve pour aller chercher des fourrages, avaient à redouter sans cesse les attaques des ennemis, et en outre, parce qu'il n'y avait qu'un bien petit nombre de chevaliers qui voulussent marcher à la rencontre des Turcs, n'ayant que des chevaux très faibles et toujours affamés, et même en fort petite quantité, puisque dans toute l'armée du comte et de l’évêque, on n'en pouvait trouver qu'une centaine au plus. Boémond et les autres princes se" trouvaient dans la même situation. A la suite de cet arrangement, nos chevaliers ne redoutèrent plus de se porter à la rencontre des ennemis, surtout ceux qui n'avaient que de mauvais chevaux ou des chevaux fatigués, sachant que s'ils les perdaient, on leur en donnerait de meilleurs.
Un autre événement qui arriva à cette époque fut que tous les princes, à l'exception du comte, promirent à Boémond de lui livrer la ville lorsqu'elle serait prise. En concluant ce traité, Boémond et les autres princes jurèrent entre eux de ne pas renoncer au siège d'Antioche durant sept années consécutives, si elle n'était prise avant ce terme.
Pendant que ces choses se passaient dans notre camp, la renommée annonça l'arrivée d'une armée de l'empereur, composée, disait-on, de beaucoup de peuples divers, tels que Esclavons, Pincenaires, Comans et Turcopoles : on appelle Turcopoles des hommes qui ont été élevés chez les Turcs, ou qui sont nés d'une mère chrétienne et d'un père turc. Mais ces peuples qui nous avaient fait beaucoup de mal pendant notre voyage, disaient qu'ils redoutaient extrêmement de s'associer avec nous. Toutes ces nouvelles, du reste, avaient été fabriquées par Tatin, au nez coupé, qui les débitait afin de pouvoir faire lui-même sa retraite. Après avoir non seulement répandu tous ces bruits, mais en outre fait les plus grandes dépenses, trahi ses compagnons et s'être parjuré lui-même, Tatin s'échappa enfin par la fuite, cédant encore à Boémond doux ou trois villes, Tursolt, Mamistra et Adena. Ayant acheté à ce prix une honte éternelle pour lui et pour les siens, il feignit de se mettre en route, comme pour aller rejoindre l'armée de l'empereur, et, abandonnant ses tentes et les gens de sa maison, il partit ; avec la malédiction de Dieu.
En ce même temps, on nous annonça que le due d'Alep, conduisant une grande armée du Khorasan, s'avançait pour porter secours à la ville d'Antioche. A cette occasion on tint conseil dans la maison de l'évêque, et l'on y résolut que les hommes de pied garderaient le camp, et que les chevaliers en sortiraient pour marcher à la rencontre des ennemis ; car on disait que beaucoup d'hommes de notre armée peu accoutumés à la guerre et timides, s'ils voyaient une forte armée de Turcs, donneraient des exemples de frayeur, beaucoup plus que de courage. Les chevaliers donc étant partis de nuit (afin que ceux qui demeuraient dans la ville ne pussent s'en apercevoir, et en donner avis à ceux qui venaient à leur secours), allèrent se cacher à deux lieues loin de notre camp, au milieu de quelques monticules. Le matin étant venu, les ennemis parurent en même temps que le soleil. Que ceux qui ont fait tous leurs efforts pour dénigrer notre armée écoutent mon récit, je les en supplie instamment, afin qu'apprenant combien Dieu a signalé sa miséricorde envers nous, ils s'attachent fermement à lui donner satisfaction dans l'affliction de la pénitence. Les chevaliers s'étant donc formés en six corps, Dieu les multiplia au point que ceux qui, avant de s'être rangés en bataille, paraissaient faire une troupe de sept cents hommes tout au plus, étaient, à la suite de ces dispositions, plus de deux mille, au dire des hommes de tout rang. Est-il besoin de parler de leur courage ? On entendait tous ces chevaliers entonner des chants guerriers, comme si le combat qui s'approchait n'eût été pour eux qu'une partie de plaisir. Or, il arriva que la bataille se livra dans un lieu où le marais et le fleuve ne sont qu'à un mille de distance, et cette circonstance fit que les ennemis ne purent s'étendre au loin ni chercher à envelopper les nôtres selon leur usage. Dieu qui nous avait donné tous les autres avantages, fit aussi rencontrer à nos chevaliers marchant au combat sis vallons consécutifs, ils en sortirent au bout d'une heure, et ayant atteint la plaine, lorsque le soleil brillait de tout son éclat, couverts de leurs armes et de leurs boucliers, ils engagèrent la bataille. D'abord ils commencèrent par s'avancer peu à peu, tandis que les Turcs voltigeaient de tous côtés, lançaient des flèches, et cependant faisaient un mouvement de retraite. Les nôtres les laissèrent faire ainsi, jusqu'à ce que ceux des Turcs qui étaient en avant se fussent réunis à ceux qui occupaient les dernières lignes ; car, ainsi que nous l'avons appris ensuite par leurs transfuges, les Turcs n'étaient pas moins de vingt-huit mille hommes dans cette rencontre. Lorsque leur premier corps se fut rallié à ceux qui marchaient derrière, les Francs se lancèrent sur eux, invoquant leur Dieu, et sans le moindre retard, le Seigneur fort et puissant dan les combats,[2] fut présent pour protéger ses enfants et renverser ses ennemis. Les Francs les poursuivirent donc jusqu'à un château extrêmement fortifié, et situé à dix milles du champ de bataille. Les gardiens de ce château ayant vu fuir leurs compagnons, y mirent aussitôt le feu et prirent également la fuite. Cet événement mit le comble aux transports de joie que ressentaient les nôtres, et l'incendie de ce château fut pour eux comme une seconde victoire.
Ce même jour on combattit pareillement dans notre camp, en sorte qu'il n'y eut aucun point dans les environs de la ville ou la guerre ne se fit. Les ennemis avaient pris leurs arrangements pour que nous fussions attaqués à l'improviste sur nos derrières, par ceux qui venaient à leur secours, tandis que de leur côté les assiégés viendraient nous assaillir avec la plus grande vigueur. Mais Dieu qui donna la victoire à nos chevaliers combattit aussi avec nos hommes de pied, et nous remportâmes en un jour sur les assiégés un triomphe aussi grand qu'était grande la gloire que nos chevaliers avaient acquise sur leurs alliés. Maîtres de la victoire, et chargés de dépouilles, les nôtres rapportèrent au camp les têtes des hommes qu'ils avaient tués, et afin de jeter la terreur chez nos ennemis, et de leur offrir un témoignage de la défaite de leurs auxiliaires, les têtes, portées dans le camp, furent dressées sur des pieux, ce qui fut fait certainement par une disposition particulière de Pieu, comme vous pourrez vous en convaincre bientôt. En effet, les ennemis nous ayant enlevé naguère la bannière de la bienheureuse Marie, toujours vierge, l'avaient enfoncée en terre par la pointe, comme pour nous faire honte ; et ce que j'ai raconté fut fait afin que, voyant les têtes de leurs compagnons dressées, en l'air, ils renonçassent à nous insulter ainsi.
Il y avait à cette époque dans notre camp des députés du roi de Babylone, qui, voyant les miracles que Dieu faisait par ses serviteurs, glorifièrent Jésus, fils de la Vierge Marie, qui foulait aux pieds les hommes les plus puissants par les bras de ses pauvres. Ces députés nous promirent les faveurs et la bienveillance de leur roi, et nous racontèrent en outre tous les bienfaits de ce roi envers les Chrétiens d'Egypte et nos pèlerins. On les renvoya avec des députés de notre camp, chargés de conclure un traité de bonne amitié avec leur roi.
Dans le même temps, nos princes jugèrent convenable de construire un fort sur la colline qui s'élevait au dessus des tentes de Boémond, afin que les ennemis, s'ils voulaient de nouveau marcher sur nous, ne pussent en aucune façon attaquer notre camp. En effet, lorsque ce fort, eut été construit, notre camp fut extrêmement bien fortifié, et nous nous trouvâmes comme dans une ville, autant par l'effet de l'art que par la nature. Nous avions à l'orient ce nouveau fort, au midi les murailles de la ville et le marais, qui tout en défendant les murailles défendait aussi notre camp, de sorte que les gens de la ville ne pouvaient venir nous combattre qu'en sortant par leurs portes ; à l'occident était le fleuve, et au nord un ancien fossé qui descendait du haut de la montagne, et se prolongeait jusqu'au fleuve. Le peuple désira en outre que l’on construisît un autre fort sur le monticule qui dominait au dessus du pont de la ville d'Antioche ; enfin, on fit aussi dans le camp des machines destinées à l'attaque de la place ; mais ces derniers travaux furent tout-à-fait inutiles.
Dans le cinquième mois du siège, les. Turcs voyant que nos navires arrivaient de tous côtés à notre port pour nous apporter des provisions, commencèrent à attaquer le chemin de la mer, et à massacrer ceux qui transportaient des vivres. D'abord nos princes le supportèrent pendant quelque temps, et les Turcs, encouragés dans leur crime par l'impunité et l'espoir du butin, s'y livrèrent avec ardeur jour et nuit. Enfin on résolut de construire un fort auprès du pont de la ville. Mais comme plusieurs des nôtres s'étaient rendus au port, le comte et Boémond furent choisis pour les aller chercher, les ramener, et rapporter en même temps des râteaux et tous les instruments nécessaires pour creuser le fossé de la nouvelle forteresse.
Dès qu'on sut dans la ville que le comte et Boémond venaient de s'absenter, les assiégés recommencèrent leurs attaques ordinaires. Les nôtres s'avancèrent imprudemment et sans ordre, et furent honteusement, battus et mis en fuite. Le quatrième jour le comte et Boémond revenant du port, suivis d'une très grande multitude furent surpris par les Turcs, au moment où ils étaient eux-mêmes en grand désordre, se croyant d'ailleurs en parfaite sécurité. Mais pourquoi ajouterais-je d'autres paroles ? On en vint bientôt aux mains, et les nôtres tournèrent le dos. Nous perdîmes en cette rencontre au moins trois cents hommes, et nous ne saurions dire tout ce qui nous fut enlevé de butin et d'armes. Tandis que nous nous sauvions, comme un troupeau, à travers les montagnes et les précipices, massacrés ou tombant de tous côtés, ceux du camp se mirent en marche pour venir à la rencontre des ennemis qui par là se trouvèrent forcés de renoncer à poursuivre les fuyards. Ainsi donc, ô Seigneur Dieu ! dans leur camp les Chrétiens furent vaincus, et en dehors du camp les deux plus grands princes de votre armée furent également vaincus ! Nous réfugierons-nous vers le camp, ou ceux du camp viendront-ils vers nous ? Levez-vous, Seigneur, et aidez-nous à cause de votre nom ! Que si l'on eût dit dans le camp que les princes venaient d'être vaincus, ou si le hasard nous eût fait savoir que ceux du camp avaient fui devant l'ennemi, nous aurions tous également pris la fuite.
Mais le Seigneur se leva pour nous secourir dans ces circonstances, et inspira à ceux qu'il avait d'abord laissé fuir, le courage de recommencer les premiers le combat. Cassien,[3] qui était gouverneur de la ville, voyant le butin enlevé sur les nôtres, la victoire des siens, et le courage que manifestaient encore quelques-uns des nôtres, fit aussitôt sortir tous ses chevaliers et ses hommes de pied, et, séduit par l'espoir de la victoire, il ordonna de fermer les portes de la ville sur les siens, annonça à ses chevaliers qu'il fallait vaincre ou mourir. Pendant ce temps, les nôtres s'avancèrent peu à peu, selon les ordres qu'ils recevaient, et de leur côté les Turcs voltigeaient çà et là, lançaient des flèches et s'engageaient témérairement. Les nôtres cependant prenaient patience, jusqu'à ce qu'il leur fût possible de s'élancer sur une masse plu serrée, et ne laissaient pas de se porter en avant. Dans notre camp on n'entendait de toutes parts que des cris de douleur qui s'élevaient vers Dieu, et l'abondance des larmes qu'on versait vous eût fait juger que la miséricorde du Seigneur allait descendre sur les nôtres. Déjà on était au point de pouvoir combattre de près, lorsqu'Isoard de Die, très noble chevalier Provençal, marchant avec cent cinquante hommes de pied, invoquant Dieu en fléchissant le genou, encouragea ses compagnons, leur disant : En avant, chevaliers du Christ ! Aussitôt il s'élance sur les ennemis, et tous les autres corps les attaquent en même temps. L'orgueil de l'ennemi est confondu, la porte se trouve fermée, le pont est étroit et le fleuve très large. Mais pourquoi plus de paroles ? Les ennemis en déroute sont renversés, massacrés, écrasés à coup de pierres dans les eaux du fleuve, et d'aucun côté ils ne trouvent de moyen de retraite. Si Cassien n'eût fait ouvrir en ce moment la porte du pont, en ce jour même nous eussions eu la paix avec Antioche. J'ai entendu dire à beaucoup d'hommes qui assistèrent à ce combat que trente Turcs, et même davantage, se précipitèrent dans le fleuve du haut du pont.
Le duc de Lorraine s'illustra beaucoup dans cette action. Il alla s'emparer du pont avant les ennemis, et, étant monté sur une élévation, il fendait en deux ceux qui venaient à lui. Après avoir célébré leur victoire par mille cris de joie, les nôtres rentrèrent dans leur camp chargés de dépouilles et emmenant beaucoup de chevaux, il arriva en cette rencontre un fait mémorable, et plût au ciel que ceux qui nous accompagnent de leurs vœux eussent, pu en être témoins ! Un chevalier turc qui redoutait la mort, s'étant précipité avec son cheval dans les profondeurs du fleuve, fut saisi par plusieurs hommes de sa race, sépare de son cheval, et enseveli au milieu des ondes avec tous ceux qui l'avaient entraîné.
C'était un charme de voir quelques-uns de nos pauvres rentrant dans le camp à la suite de cette victoire. Les uns parcouraient les tentes conduisant plusieurs chevaux et montrant à leurs compagnons ce qui devait les soulager dans leur détresse ; d'autres, couverts de deux ou trois vêtements de soie, glorifiaient Dieu qui leur donnait la victoire et ces présents ; d'autres, portant en main trois ou quatre boucliers, les produisaient joyeusement en témoignage de leur triomphe. Mais, tandis qu'en, nous faisant voir ces différents objets, ils nous donnaient des preuves certaines de leur victoire, ils ne purent nous fournir de renseignements précis sur le nombre d'hommes qu'ils avaient tués, car cette victoire avait été remportée pendant la nuit, en sorte que les têtes des morts ne furent pas transportées dans le camp. Le lendemain, tandis que l’on travaillait à construire la redoute en avant du pont, on trouva quelques corps de Turcs dans un fossé, car ce monticule servait de cimetière aux Sarrasins. Excités à cette vue, les pauvres brisèrent tous les sépulcres et déterrèrent les Turcs, en sorte que nul ne conserva plus aucun doute sur l'étendue de la victoire. On compta environ quinze cents cadavres, et je ne parle pas ici de ceux qui furent ensevelis dans la ville ou précipités dans le fleuve. Mais comme la puanteur de ces cadavres aurait fait mal à ceux qui travaillaient à la construction du fort, on les traîna et on les jeta dans les eaux. Les matelots qui avaient été mis en fuite ou blessés lors de la déroute du comte et de Boémond, frappés de terreur, hésitaient encore à croire à cette victoire. Mais lorsqu'ils virent cette multitude de corps morts, semblables pour ainsi dire à des convalescents, ils se mirent aussi à glorifier Dieu qui a coutume de châtier et de réjouir en même temps ses enfants. Ainsi, par les dispensations du Seigneur, il arriva que ceux qui avaient livré les conducteurs des vivres aux bêtes féroces et aux oiseaux de proie, après les avoir massacrés sur les bords de la mer et sur les rives du fleuve, furent eux-mêmes, et dans les mêmes lieux, livrés aussi aux bêtes féroces et aux oiseaux de proie. Cette victoire ayant été bien connue et bien célébrée, et la nouvelle redoute se trouvant, aussi terminée, la ville d'Antioche fut dès lors assiégée du côté du nord et du midi.
On rechercha alors lequel parmi les princes pourrait se charger d'aller hors du camp prendre la défense du nouveau fort ; car une chose faite en commun est souvent négligée par tous, chacun se fiant sur un autre du soin qu'il devrait prendre. Tandis que quelques-uns des princes sollicitaient les suffrages des autres pour être chargés de cette défense, comme s'il se fût agi d'une récompense à obtenir, le comte, malgré l'avis des siens, s'empara de ce poste, tant pour se justifier du reproche de paresse et d'avarice, que pour montrer à ceux qui demeuraient dans l'engourdissement le moyen de se distinguer par la valeur et la sagesse. Durant tout l'été précédent, le comte avait été accablé d'une maladie grave et très longue ; durant tout l'hiver, il avait été encore fatigué et amolli à tel point que l’on avait dit qu'il n'était prêt ni à combattre ni à répandre des largesses, et quoiqu'il fît beaucoup, comme on croyait qu'il pouvait faire davantage, on ne lui en tenait aucun compte. Il rencontra donc des difficultés qui furent une épreuve pour ses vertus et encourut la jalousie de tous les pèlerins, au point qu'il fut presque sur le point de se séparer de ses compagnons.
Cependant, et tandis que le comte s'occupait négligemment de la défense du fort, croyant que les ennemis, accablés la plupart de fatigue, ne manqueraient pas de prendre la fuite, il se trouva un matin, et dès le point du jour, enveloppé de tous côtés. Alors éclata un nouveau témoignage de la protection divine, puisque soixante hommes des nôtres soutinrent le combat contre sept mille Sarrasins ; ce qui est d'autant plus miraculeux, que les jours précédents des torrents de pluie avaient trempé la terre et comblé le fossé creusé autour du nouveau fort. Ainsi les ennemis ne furent point arrêtés par l'impossibilité de s'avancer, mais par la seule puissance de Dieu. Je crois ne devoir point passer sous silence la brillante valeur de quelques-uns de nos chevaliers. Surpris par les ennemis, tandis qu'ils veillaient au passage de leur pont, ces chevaliers n'eurent pas le temps de se rejeter dans le fort qui était éloigné du pont à la distance du trait d'une flèche environ. Ils se formèrent donc en groupe au milieu de la multitude de leurs ennemis, parvinrent, en marchant ainsi, jusque vers l'angle d'une maison voisine, et là ils soutinrent vaillamment, et sans se laisser effrayer, l'attaque des ennemis et les nuées de floches et de pierres qui pleuvaient sur eux de tous côtés. Cependant le bruit du combat attira les nôtres hors du camp, le fort fut délivré de ceux, qui l'attaquaient, et, quoique les Turcs eussent renoncé à leur entreprise, dès qu'ils virent de loin les nôtres venir au secours de leurs frères, quoiqu'ils se trouvassent très près de leur pont, les derniers d'entre eux n'en furent pas moins tués. On répara le fossé et les murailles du fort, et les conducteurs de vivres purent de nouveau aller au port et en revenir en toute sécurité. Les sentiments de haine auxquels le comte avait été en Lutte se calmèrent à tel point que tous les Chrétiens en vinrent à l'appeler le père et le sauveur de l'armée, et, depuis ce temps, la réputation du comte s'agrandit, parce que seul il supportait tout l'effort des ennemis.
Le pont et la porte de la ville se trouvant ainsi assiégés, les Turcs commencèrent à sortir par une autre porte qui fait face au midi et est située tout près du fleuve, et ils envoyaient leurs chevaux vers un lieu retiré où se trouvaient d'excellents pâturages entre les montagnes et le fleuve. Cette position ayant été reconnue par les nôtres, un soir ils arrivèrent auprès des pâturages après avoir tourné la ville à travers des passages difficiles dans la montagne ; d'autres en même temps traversèrent le fleuve au gué, et ils allèrent ensemble enlever deux mille chevaux, sans compter les mulets et les mules qui furent repris sur les ennemis ; ceux-ci nous avaient enlevé, l'hiver précédent, un grand nombre de mulets sur la route de la mer on reprit ces animaux au moment dont je parle, ils furent reconnus par leurs anciens maîtres et rendus à ces derniers.
Après cette affaire, Tancrède fortifia un certain couvent situé au-delà du fleuve, le comte lui donna pour cela cent marcs d'argent, et quelques-uns des autres princes chacun ce qu'il put, car cet ouvrage gêna beaucoup les ennemis. Et je prie que l’on remarque, à cette occasion, que moins nous étions nombreux, plus la grâce de Dieu nous rendait forts.
Cependant on vit bientôt arriver très fréquemment des messagers venant annoncer qu'il arrivait des secours aux ennemis. Ces nouvelles ne nous venaient pas seulement des Arméniens et des Grecs, ceux-là même qui habitaient dans la ville nous rapportaient les mêmes faits. Comme les Turcs avaient occupé Antioche pendant quatorze ans de suite, ils avaient, dans leur besoin de se faire des domestiques, rendu Turcs les jeunes gens arméniens et grecs, et leur avaient donné des femmes, et ceux-ci cependant, dès qu'ils trouvaient l'occasion de prendre la fuite, venaient auprès de nous avec leurs chevaux et leurs armes. Lorsque cette nouvelle de l'arrivée des auxiliaires de nos ennemis se fut répandue, beaucoup d'hommes timides parmi les nôtres commencèrent, à prendre la fuite, ainsi que les marchands arméniens. Dans le même temps, les braves chevaliers, dispersés de tous côtés dans les châteaux, revinrent au camp et se mirent en devoir d'acheter des armes, de les préparer et de les remettre en bon état. Ainsi donc, tandis que les fanfarons désappointés s'échappaient loin de l'armée, et que les hommes courageux, toujours prêts à braver tous les périls avec leurs frères et pour leurs frères, venaient au contraire s'y réunir, un de ces hommes devenus Turcs, qui habitait dans la ville, manda à nos princes, par l'intervention de Boémond, qu'il nous livrerait la place. Les princes donc, après avoir tenu conseil, envoyèrent Boémond, le duc de Lorraine et le comte de Flandre pour voir ce qu'il y avait à faire. Ils arrivèrent au milieu de la nuit vers l'une des tours de la ville et alors celui qui devait la leur livrer leur envoya son messager qui dit : Attendez que la lampe soit passée, car il y avait trois ou quatre hommes portant des lampes qui parcouraient toute la nuit les remparts pour entretenir et ranimer l'attention des hommes de garde. Après cela les nôtres, s'étant approchés de la muraille et ayant dressé leur échelle, commencèrent à monter. Le premier fut un Français nommé Foulcher, frère de Budelle de Chartres, qui s'élança avec intrépidité ; le comte de Flandre le suivit, et invita alors Boémond et le duc à monter ; et au moment où tous se hâtaient, chacun cherchant à passer avant les autres, l'échelle se rompit. Alors ceux qui étaient déjà montés descendirent dans l'intérieur de la ville et allèrent ouvrir une petite porte bâtarde ; tous les nôtres y entrèrent en même temps et ne firent prisonnier aucun de ceux qu'ils rencontrèrent. Lorsque l'aurore commença à paraître, ils poussèrent de grands cris ; à ce bruit toute la ville tomba dans la consternation, et les femmes et les petits enfants se mirent à pleurer. Ceux des nôtres qui étaient dans la redoute du comte, se trouvant plus rapprochés, furent tous réveillés à ces cris, et se dirent les uns aux autres : Voilà les auxiliaires qui arrivent ; à quoi d'autres de leurs compagnons répondirent : Ce ne sont pas là les cris de gens qui se réjouissent. Cependant le jour commençant à blanchir, on vit paraître nos bannières sur la colline située au midi de la ville. Les habitants furent remplis de trouble en voyant les nôtres au dessus d'eux et sur la montagne ; les uns cherchèrent à fuir par les portes, d'autres se lancèrent dans les précipices, nul ne fit de résistance, car le Seigneur les avait frappés de vertige. Ce fut pendant longtemps un spectacle bien agréable pour nous de voir que ceux qui avaient si longtemps gardé Antioche contre nous ne pussent pas même en ce moment s'échapper de la ville ; car si quelques-uns d'entre eux osèrent essayer de prendre la fuite, ils ne purent du moins parvenir à éviter la mort. Il arriva alors un incident qui fut pour nous bien agréable et vraiment délicieux. Quelques Turcs qui fuyaient à travers les précipices qui séparent la montagne de celle du nord, et cherchaient à se sauver, rencontrèrent quelques-uns des nôtres ; forcés de rétrograder, les Turcs furent repoussés et mis de nouveau en fuite avec tant d'impétuosité que tous s'abîmèrent dans les précipices. Ce fut pour nous une véritable joie de les voir ainsi tomber ; mais nous avons à regretter plus de trois cents chevaux qui périrent dans la même rencontre.
Nous ne saurions dire combien de Sarrasins et de Turcs furent tués, et il y aurait de la cruauté à raconter les diverses manières dont ils moururent ou furent précipités. Il nous serait impossible aussi de dire tout ce qu'on enleva de butin dans l'intérieur de la ville d'Antioche ; imaginez en tout ce que vous voudrez, et évaluez encore au-delà. Ceux de nos ennemis qui occupaient le fort du milieu de la montagne, voyant que leurs compagnons étaient morts, et que les nôtres renonçaient à attaquer leur fort, se maintinrent dans leur position. Cassien étant sorti par une fausse porte fut pris et décapité par des paysans arméniens, qui vinrent nous présenter sa tête : ce qui arriva, je pense, par l’effet d'une disposition particulière de Dieu, car Cassien avait fait trancher la tête à beaucoup d'hommes de la même nation. La ville d'Antioche fut prise le troisième jour de juin, et l'on avait commencé à en faire le siège vers le vingt-deuxième jour d'octobre.
Tandis que les nôtres renonçaient à poursuivre J'attaque du fort supérieur, pour reconnaître et compter tout le butin qu'ils avaient enlevé, tandis qu'ils faisaient de splendides et superbes festins, en faisant danser devant eux les femmes des païens, oubliant entièrement Dieu qui les avait comblés de si grands bienfaits, le huitième jour du même mois de juin, ils se trouvèrent eux-mêmes assiégés par les Gentils, et ceux qui avaient pendant si longtemps bloqué les Turcs d'Antioche, à l'aide de la miséricorde de Dieu, furent à leur tour, par suite de ses dispensations, également bloqués par les Turcs, et, afin que nous fussions plus effrayés, la citadelle dont nous avons parlé, qui est comme le boulevard de la ville, se trouvait toujours entre les mains des ennemis. Poussés donc par la crainte qu'ils éprouvaient, les nôtres entreprirent alors le siège de cette forteresse.
Dès le moment de son arrivée, Corbaran,[4] seigneur des Turcs, s'attendant à combattre sans retard, dressa ses tentes non loin de la ville, et à deux milles de distance environ ; puis ayant formé son armée, il s'avança jusque vers le pont. Dès le premier jour, les nôtres avaient fortifié la redoute du comte, craignant, si l'on en venait à un engagement, que les ennemis qui occupaient la citadelle intérieure, ne parvinssent à se rendre maîtres de la place, ou, si nous abandonnions le fort situé en avant du pont, et si les ennemis venaient à l'occuper, que ceux-ci ne leur enlevassent la possibilité de combattre et de sortir de la ville.
Il y avait dans l'armée un chevalier très illustre, et chéri de tout le monde, Roger de Barneville ; s'étant mis à la poursuite de l'armée des ennemis au moment où ils s'enfuyaient, il fut pris par eux et décapité. Tous les nôtres furent alors saisis de douleur et de crainte, et beaucoup en vinrent jusqu'à désespérer de pouvoir jamais se sauver. Repoussés une première et une seconde fois, les Turcs, le troisième jour, attaquèrent la redoute, et l'on combattit sur ce point avec une telle vigueur, que l'on dut croire que la puissance de Dieu nous avait seule mis en état de défendre le fort, et de résister aux ennemis. En effet, au moment où ils se disposaient déjà à franchir le fossé et à renverser la muraille, ils furent saisis de je ne sais quel mouvement de frayeur qui les fit retourner précipitamment et prendre la fuite. Après qu'ils eurent parcouru un peu de terrain, voyant qu'il n'y avait nul motif à leur retraite, et s'accusant de ce retard, ils revinrent à l'assaut, et attaquèrent plus vigoureusement encore, comme pour se laver de la honte de leur fuite ; on combattit donc de nouveau, et longtemps, avec le plus grand acharnement ; mais enfin, ce jour-là, les ennemis rentrèrent dans leur camp. Le jour suivant ils revinrent devant la redoute avec de plus grandes forces ; mais les nôtres mirent le feu à leurs ouvrages, et se retirèrent dans l'intérieur de la ville.
Les Francs, cependant, éprouvaient de plus vives craintes, et les ennemis, au contraire, prenaient plus de confiance, car nous ne possédions plus rien en dehors de la ville, et nos adversaires demeuraient toujours maîtres de la citadelle, qui en est comme la tête. Les Turcs, plus rassurés, résolurent de s'avancer sur nous, en passant par la citadelle. Les nôtres se confiant en leur bonne position, et ayant occupé une éminence, marchèrent à l'ennemi, et le battirent dès le premier choc, mais bientôt oubliant de combattre, et ardents à rechercher le butin, ils ne tardèrent pas à être mis honteusement en fuite, je dis honteusement, car plus de cent hommes furent étouffés à la porte même de la ville, et il périt un plus grand nombre de chevaux. Les Turcs étant donc entrés dans la citadelle voulurent dès lors descendre dans la ville par ce côté. Il y avait entre la citadelle qu'ils occupaient et notre colline une vallée peu spacieuse, au milieu de laquelle était une citerne et une petite plaine. On ne pouvait descendre dans la ville qu'en traversant notre colline. Les ennemis donc mirent tous leurs soins et déployèrent les plus grands efforts pour nous expulser du passage qui conduisait à la ville, et l’on combattit sur ce point depuis le matin jusqu'au soir avec une vigueur telle qu'on n'a jamais vu rien de semblable. Il arriva là une chose horrible pour les nôtres, et presque inconcevable, c'est qu'ils s'endormirent au milieu d'une grêle de flèches, de pierres et de traits qu'on ne cessait de lancer, et parmi un grand nombre de morts. Si vous me demandez quelle fut l'issue de ce combat, sachez que la nuit survint : or, cette même nuit, et lorsque les nôtres eussent dû mettre leurs espérances en la miséricorde de Dieu, beaucoup d'entre eux, au contraire, commencèrent à désespérer, et s'empressèrent à se lancer avec des cordes du haut des murailles en bas ; d'autres, quittant le combat et rentrant dans la ville, annonçaient à tout le monde que le moment était venu où tous les Chrétiens perdraient la vie, et pour augmenter les craintes, tandis que leurs frères s'encourageaient les uns les autres à combattre vigoureusement, ces mêmes hommes poursuivaient leur fuite.
Mais, comme nous l'avons dit, tandis que les nôtres étaient ainsi en désordre, et s'abandonnaient au désespoir, la clémence divine apparut, et après avoir châtié ses enfants livrés à la débauche, voici le moyen qu'elle employa pour les consoler de leur extrême tristesse.
Après la prise de la ville d'Antioche, le Seigneur, déployant sa puissance et sa bonté, fit choix d'un pauvre paysan, né Provençal, par lequel il nous rendit la force à tous, et adressa les paroles suivantes au comte et à l'évêque du Puy : André, apôtre de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, m'a invite, par quatre fois, et ordonné de venir à vous, et de vous livrer, après la prise de la ville, la lance par laquelle notre Sauveur a eu le flanc percé. Or, aujourd'hui, comme j'étais parti avec les autres pour aller combattre en dehors de la ville, j'ai été, en revenant, renversé par deux cavaliers, et presque écrasé : triste et succombant à ïà fatigue, je me suis assis sur une pierre, la douleur et la crainte me faisaient chanceler ; alors a paru devant moi le bienheureux André avec un sien compagnon, et il m'a adressé de vives menaces, si je ne m'empressais de vous livrer la lance. Alors le comte et l’évêque du Puy lui demandèrent de leur rapporter en détail la révélation qu'il avait eue, et la vision de l'apôtre, et il leur répondit : Lors du tremblement de terre qui eut lieu près d'Antioche, tandis que l'armée des Francs l'assiégeait, je fus saisi d'une si grande frayeur que je ne pus dire que ces mots : Dieu, aide-moi. C'était au milieu de la nuit ; j'étais couché, et n'avais dans ma cabane personne dont la société me rassurât. Comme ce saisissement dont j'ai parlé se prolongeait toujours et allait croissant, deux hommes parurent devant moi, portant le vêtement le plus brillant : l'un était plus âgé, avait des cheveux gris et blancs, des yeux noirs et bien adaptés à sa physionomie, une barbe blanche, large et très longue, et une taille moyenne. L'autre était plus jeune, plus grand et plus beau de forme que ne sont les enfants des hommes. Le plus vieux me dit : Que fais-tu ? Et moi je tremblais de tous mes membres, parce que je savais que personne n'était auprès de moi. Je lui répondis : Qui es-tu ? Et il me dit : Lève-toi, ne crains rien, et écoute ce que je vais te dire : je suis André l'apôtre. Rassemble l'évêque du Puy, le comte de Saint-Gilles et Pierre Raimond d'Hautpoul, et alors tu leur diras : Pourquoi l’évêque néglige-t-il de prêcher, d'avertir et de bénir le peuple avec la croix qu'il porte sur lui ? Cela serait cependant fort utile, et il ajouta : Viens, et je te montrerai la lance de noire Père Jésus-Christ que tu donneras au comte, car Dieu la lui a destinée depuis le moment qu'il est né. Je me levai donc, et le suivis dans la ville, ne portant aucun autre vêtement que ma chemise. Et il m'introduisit par la porte du nord dans l'église du bienheureux Pierre, dont les Sarrasins avaient fait une mosquée. Il y avait dans l'église deux lampes qui répandaient autant de lumière que s'il eût fait jour en plein midi ; il me dit : Attends ici ; et il m'ordonna de m'appuyer sur la colonne qui était la plus proche des marches par lesquelles on monte à l'autel du côté du midi, et son compagnon se tint loin devant les marches de l'autel. Étant alors entré sous terre, saint André en retira la lance, la remît entre mes mains, et me dit : Voici la lance qui a percé le flanc d'où est sorti le salut du monde entier, et comme je la tenais en main, versant des larmes de joie, je lui dis : Seigneur, si vous le voulez, je la porterai et la remettrai au comte et il me répondit : Tu le feras sans le moindre retard, aussitôt après que la ville sera prise ; alors tu viendras avec douze hommes, et tu la chercheras en ce lieu d'où je l'ai tirée, et où je vais la renfermer. Et il la renferma. Ces choses faites, il me ramena par dessus les murailles de la ville dans ma maison, et ils se retirèrent de moi. Alors réfléchissant en moi-même sur ma pauvreté et sur votre grandeur, je craignis de me rendre auprès de vous. Après ce temps, comme j'étais allé vers un château situé auprès de Roha pour chercher des vivres ; le premier jour du carême et au premier chant du coq, le bienheureux André m'apparut avec les mêmes habits, et le compagnon qui l'avait suivi la première fois, et une grande clarté remplit ma maison, et il me dit : Veilles-tu ? Étant ainsi réveillé, je lui répondis : Non, mon Seigneur, je ne dors pas. Et il me dit : As-tu dit ce que je t'ai depuis longtemps prescrit de dire ? Et je répondis : Seigneur, ne vous ai-je pas prié de leur envoyer un autre que moi ? car, tremblant dans ma pauvreté, je n'ai pas osé aller à eux. Et il me dit : Ne sais-tu pas pourquoi Dieu vous a amenés ici, combien il vous chérit, et comment il vous a spécialement élus ? A cause qu'on l'a méprisé, et pour venger les siens, il vous a fait venir ici. Il vous chérit tellement que les saints qui sont déjà dans le repos, connaissant par avance la grâce de ses dispensations divines, voudraient être eux-mêmes en chair, et s'unir à vos efforts. Dieu vous a élus parmi toutes les nations comme les épis de froment sont triés au milieu de l'avoine, car vous êtes supérieurs en mérites et en grâce à tous ceux qui sont venus avant et qui viendront après vous, comme l'or est supérieur en valeur à l'argent. Après cela ils se retirèrent, et je fus accablé d'une telle maladie, que je perdis l'usage de la vue, et que je disposai, dans ma pauvreté, de mes petites ressources. Alors je commençai à réfléchir en moite même, et à penser que ces maux m'étaient justement survenus à cause de ma négligence pour la vision de l'apôtre. M'étant donc rassuré, je revins auprès des assiégeons. Mais là, considérant de nouveau mon extrême pauvreté, je craignis encore, si je me rendais auprès de vous, d'être traité par vous d'homme affamé, et qui ne ferait de tels rapports que pour obtenir de quoi vivre, et cette fois encore je me tus. Cependant, un certain temps s'étant écoulé, comme je me trouvais au port de Saint-Siméon, et que j'étais couché sous une tente avec mon seigneur Guillaume Pierre, le bienheureux André se présenta suivi du même compagnon, et avec le même vêtement que j'avais vu auparavant, et me parla ainsi : Pourquoi n'as-tu pas dit à l'évêque, au comte et aux autres ce que je t'avais ordonné de dire ? Et je répondis : Ne vous ai-je pas prié, Seigneur, d'envoyer en ma place un autre qui fût plus sage que moi, et que l'on voulût entendre ? Déplus, les Turcs sont sur la route, et ils tuent ceux qui vont et viennent. Et saint André me dit : Ne crains rien, car ils ne te feront point de mal. Tu diras en outre au comte que lorsqu'il sera arrivé auprès du fleuve Jourdain, il ne s'y baigne point, mais qu'il passe en bateau ; et lorsqu'il aura passé, revêtu de sa chemise et de son justaucorps de lin, qu'il se fasse asperger avec les eaux du fleuve, et lorsque ses vêtements seront séchés, qu'il les dépose et les conserve avec la lance du Seigneur. Et mon seigneur Guillaume Pierre entendit ces choses, quoiqu'il ne vît point l’apôtre. M'étant donc rassuré, je retournai à l'armée, et lorsque je voulus vous rapporter tout cela, je ne pus vous réunir tous. Je partis donc pour le port de Mamistra ; là, ayant voulu m'embarquer pour aller dans l'île de Chypre chercher des vivres, le bienheureux André m'adressa les plus fortes menaces, si je ne retournais au plus tôt, et ne vous rapportais ce qui m'avait été prescrit. Je réfléchis alors en moi-même comment je retournerais au camp ; car ce port était éloigné de notre armée de trois journées de marche environ, et je me mis à pleurer amèrement, ne voyant aucun moyen de m'en retourner. Alors, invité par mes compagnons et mon Seigneur, je m'embarquai, et nous nous mîmes en route pour aller dans l'île de Chypre ; mais lorsque nous eûmes navigué toute la journée, et jusqu'au coucher du soleil par un bon vent et à l'aide des rames, il s'éleva tout à coup une tempête, et en une heure ou deux nous rentrâmes dans le port que nous avions quitté. Là j'essuyai une maladie très grave. Lorsque la ville d'Antioche a été prise, je suis venu vers vous, et maintenant, si cela vous plaît, assurez-vous de la vérité de mes paroles.
L’évêque pensa que ce n'étaient là que de vaines paroles ; mais le comte y crut tout aussitôt, et confia à Raimond, son chapelain, la garde de celui qui avait fait ce rapport.
La nuit suivante notre Seigneur Jésus-Christ apparut à un certain prêtre nommé Etienne, qui versait des larmes sur sa mort et sur celle de ses compagnons, qu'il regardait comme prochaine et assurée ; car il avait été effrayé par quelques hommes, qui, descendant de la citadelle, avaient dit que les Turcs venaient de la montagne dans la ville, et que les nôtres étaient vaincus et fuyaient. En conséquence, le prêtre, voulant prendre Dieu à témoin de sa mort, entra dans l'église de la bienheureuse Marie, toujours vierge, et s'étant confessé et ayant reçu l'absolution, il se mit à chanter des psaumes avec quelques-uns de ses compagnons. Les autres s'étant endormis, et lui seul demeurant éveillé, lorsqu'il eut, dit : Seigneur, qui habitera dans vos tabernacles, ou qui se reposera sur votre sainte montagne[5] ? un homme, d'une beauté supérieure à toute autre beauté, se présenta devant lui, et lui dit : Homme, quelle est cette nation qui est entrée dans la ville ? Et le prêtre dit : Des Chrétiens. Et il lui dit : Quels Chrétiens ? Et le prêtre : Des hommes qui croient au Christ né de la Vierge, qui a souffert sur la croix, qui est mort, qui a été enseveli, qui est ressuscité le troisième jour, et qui est monté aux cieux. Et l'homme dit alors : S'ils sont Chrétiens, pourquoi redoutent-ils cette multitude de païens ? Et il ajouta : Me reconnais-tu ? Et le prêtre répondit : Je ne vous connais pas, Seigneur, mais je vous vois plus beau que tous les autres. Et l'homme dit : Regarde-moi très attentivement. Et le prêtre l'ayant regardé fixement et avec attention, vit s'élever au-dessus de sa tête la figure d'une croix beaucoup plus brillante que le soleil. Et le prêtre dit à l'homme qui l'interrogeait sur son compte : Seigneur, nous reconnaissons pour les images de notre Seigneur Jésus-Christ celles qui nous présentent une ressemblance avec la vôtre. Et le Seigneur lui répondit : Tu as bien dit, parce que je le suis en effet. N'est-il pas écrit de moi que je suis le Seigneur fort et puissant, le Seigneur puissant dans les combats ? Et quel est le Seigneur dans l'armée ? Et le prêtre répondit ; Seigneur, il n'y a jamais eu ici un seul seigneur ; mais on se confie à l'évêque plus qu'à tout autre. Et le Seigneur dit alors : Tu diras ceci à l'évêque : ce peuple en se conduisant mal m'a éloigné de lui, et c'est pourquoi tu lui diras : voici ce que dit le Seigneur, convertissez-vous à moi et je reviendrai avons. Et lorsqu'ils auront commencé de combattre, qu'ils disent : nos ennemis se sont rassemblés et ils, se glorifient dans leur puissance : écrasez leurs force ces, dispersez-les, Seigneur, car nul ne combat pour nous, si ce n'est vous, ô notre Dieu. Et tu leur diras encore ceci : si vous faites ce que je vous commande, d'ici à cinq jours j'aurai compassion de vous. Et tandis qu'il disait ces choses, une femme, dont le visage était brillant d'une manière extraordinaire, s'avança, et fixant ses regards sur le Seigneur, elle lui dit : Seigneur, que dites-vous à cet homme ? Et le Seigneur lui répondit : Madame, je lui demande quelle est cette nation qui est entrée dans la ville ? Et la femme dit : O mon Seigneur, ce sont ceux pour lesquels je vous supplie si instamment. Et comme le prêtre poussait son compagnon qui dormait auprès de lui, afin d'avoir un témoin d'une si merveilleuse vision, ceux qu'il avait vus disparurent de devant ses yeux. Le matin venu, le prêtre monta sur la montagne où nos princes résidaient en face de la citadelle des Turcs, à l'exception du duc, lequel gardait la forteresse située sur la montagne du septentrion. Le prêtre ayant donc convoqué une assemblée rapporta ces paroles à nos princes ; pour en démontrer la vérité, il jura sur la croix, et pour convaincre les incrédules, il offrit de passer par l'épreuve du feu, ou de se précipiter du haut d'une tour. Alors les princes jurèrent de ne fuir loin d'Antioche et de n'en sortir que du consentement de tout le monde, car le peuplé croyait, en ces circonstances, que les princes avaient résolu de fuir vers le port. Par là, un grand nombre de gens furent rassurés. La nuit, précédente il y en avait très peu qui fussent demeurés fermes dans leur foi, et qui n'eussent voulu prendre la fuite, en sorte que si l'évêque et Boémond n'eussent fermé les portes de la ville, il en serait demeuré en effet un fort petit nombre. Malgré cela, un seigneur Guillaume se sauva avec son frère, suivi de beaucoup d'autres hommes, laïques et clercs. Il arriva à beaucoup d'entre eux, après s'être échappés de la ville, non sans de grands dangers, de tomber entre les mains des Turcs, et d'être exposés par là à de plus grands périls.
En ce même temps, nous eûmes encore par nos frères beaucoup d'autres révélations, et nous vîmes dans le ciel un signe miraculeux. Au milieu de la nuit une très grande étoile s'arrêta au-dessus de la ville ; et peu après s'étant divisée en trois branches, elle tomba sur le camp des Turcs.
Les nôtres donc s'étant un peu rassurés attendirent le cinquième jour que le prêtre leur avait annoncé. Le lendemain, après avoir fait les préparatifs nécessaires avec l'homme qui avait parlé de la lance, ayant fait sortir tout le monde de l'église du bienheureux Pierre, nous commençâmes à faire une fouille. Parmi les douze hommes désignés, il y avait l'évêque d'Orange, Raimond chapelain du comte, qui écrit cette histoire, le comte lui-même, Pons de Balazun et Ferrand de Thouars. Après qu'ils eurent creusé depuis le matin jusqu'au soir, vers le soir quelques-uns commencèrent à désespérer de trouver la lance. Le comte s'était retiré pour aller veiller à la garde d'un fort ; et à sa place, ainsi qu'à la place de ceux qui s'étaient fatigués à travailler, nous en faisions venir d'autres, afin que l'ouvrage fût poussé avec vigueur. Le jeune homme qui avait parlé de la lance, voyant que nous nous fatiguions, ôta sa ceinture et ses souliers, et descendit en chemise dans la fosse, nous suppliant d'implorer Dieu, afin qu'il nous livrât la lance, pour rendre le courage à son peuple et assurer la victoire. Enfin, par la grâce de sa miséricorde, le Seigneur nous montra sa lance ; et moi qui écris ceci, au moment où l'on ne voyait encore que la pointe paraître au dessus de la terre, je la baisai. Je ne saurais dire quels transports de joie remplirent alors toute la ville. La lance fut trouvée le 14 juin.
La seconde nuit le bienheureux André apparut au jeune homme par lequel il nous avait fait retrouver la lance, et lui dit : Voici, Dieu a donné au comte ce qu'il n'a jamais voulu donner, à aucun autre, et l'a institué porte-bannière de son armée, pourvu toutefois qu'il persévère dans son amour. Et comme le jeune homme, lui demandait miséricorde pour le peuple, saint André lui répondit qu'en vérité le Seigneur aurait compassion de son peuple. Et comme le jeune homme lui demandait encore quel était ce compagnon qu'il avait toujours vu avec lui, le bienheureux André lui dit : Approche et baise son pied. Aussitôt, s'empressant de s'approcher, il vit sur son pied une plaie toute fraîche et saignante, comme si elle eût été faite tout récemment. Et comme il hésitait à s'avancer davantage à cause de cette blessure et de ce sang, saint André lui dit : Voilà le père qui a été percé pour nous sur la croix, et c'est de là que vient cette plaie. Le Seigneur ordonne en outre que vous célébriez désormais ce jour où il vous a livré sa lance. Mais comme elle a été découverte le soir, et que ce même jour n'a pu être célébré, la semaine prochaine, à l'octave, vous ferez une grande solennité, et tous les ans, par la suite, vous la renouvellerez le jour même de la découverte de cette lance. Tu leur diras encore ceci, qu'ils aient à se conduire ainsi que le prescrit l'épître de mon frère Pierre qui se lit aujourd'hui, et cette épître est celle-ci : Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu.[6] Que tous les jours les clercs chantent devant la lance cette hymne : Lustra sex quœ jam peracta ; et lorsqu'ils auront dit : Agnus in crucis levatur immolandus stipite y qu'ils fléchissent les genoux et qu'ils finissent leur hymne. Lorsque l'évêque d'Orange et moi nous demandâmes à ce jeune homme s'il connaissait les lettres, il nous répondit je ne les connais pas, pensant que, s'il disait les connaître, nous ne le croirions pas. Dans le fait, il savait quelque chose, mais en ce moment il était tellement ignorant que non seulement il ne pouvait pas lire, mais qu'il ne se souvenait pas même de ce qu'il avait appris, si ce n'est du Pater noster, du Credo in Deum, du Magnificat, du Gloria in excelsis Deo, et du Benedictus Dominus Deus Israël. Tout le reste il l'avait oublié, comme s'il ne l'avait jamais appris, et, malgré la peine extrême qu'il se donna par la suite, il ne put rappeler que très peu de chose à sa mémoire.
Dans ce même temps la famine était si grande dans la ville, qu'une tête de cheval dont on avait enlevé la langue se vendait deux ou trois sons, les entrailles d'une chèvre cinq sous, une poule huit ou neuf sous. Parlerai-je du pain, dont on n'avait pas assez avec cinq sous pour apaiser la faim d'un homme ? Mais ces prix, n'étaient ni surprenants ni fâcheux pour ceux qui payaient toutes choses si cher, puisqu'ils avaient en abondance de l'or, de l'argent et de riches vêtements, et cette cherté provenait principalement de ce que les chevaliers manquaient de courage. On cueillait sur les arbres les figues avant qu'elles fussent mûres, on les faisait cuire et on les vendait fort cher. On faisait cuire aussi de la même manière des cuirs de bœufs et de chevaux, et d'autres cuirs depuis longtemps mis de côté, et on les vendait également fort cher, de sorte que chacun pouvait en manger pour deux sous. La plupart des chevaliers n'avaient pour vivre que leurs chevaux, et cependant, espérant en la miséricorde de Dieu, ils ne voulaient pas encore les tuer. Tels étaient les maux qui accablaient les assiégés, et beaucoup d'autres encore qu'il serait trop difficile d'énumérer. Il y avait encore un autre malheur assez grand, c'est que quelques-uns des nôtres fuyaient auprès des Turcs et leur apprenaient l'extrême misère qui régnait dans la ville, en sorte que les Turcs, encouragés par ces rapports et d'autres circonstances, nous pressaient d'autant plus violemment. Une fois, vers le milieu du jour, trente Turcs environ montèrent sur l’une de nos tours et firent une horrible frayeur aux nôtres. Ceux-ci cependant combattirent en raison du péril, et, avec l'assistance de Dieu, ils tuèrent quelques-uns de leurs ennemis et précipitèrent les autres du haut du rempart. À cette occasion, tous promirent d'obéir à Boémond jusqu'à quinze jours après l'issue de la bataille, afin qu'il veillât lui-même à la garde de la ville et fit toutes ses dispositions pour le combat ; car, à cette époque, le comte et l'évêque étaient fort malades, et le comte Etienne, que les autres princes avaient élu pour dictateur avant la prise de la ville, ayant appris que l'on combattrait encore, avait pris la fuite.
Mais, ainsi que nous l'avons dit, tandis que les nôtres se voyaient ainsi vaincus, écrasés et accablés de tourments, le Ciel vint à leur secours, et le bienheureux André leur enseigna, par l'intermédiaire du jeune homme qui déjà avait dévoilé l'existence de la lance, comment ils devaient se conduire avant et pendant la bataille. Vous avez tous gravement péché, dit-il, et c'est pourquoi vous êtes humiliés. Vous avez crié au Seigneur, et le Seigneur vous a exaucés. Et maintenant que chacun s'en remette à Dieu de ses péchés, et fasse cinq aumônes à raison des cinq plaies du Seigneur. S'il ne peut les faire, qu'il dise cinq fois Pater noster, etc. ; et cela fait, et selon la résolution que les princes auront arrêtée pour la bataille, entreprenez-la au nom du Seigneur, soit de jour, soit de nuit, car le bras du Seigneur sera avec vous. Si quelqu'un doute de la victoire, qu'on lui ouvre les portes, qu'il aille auprès des Turcs, et il verra comment leur Dieu saura le sauver. Si quelqu'un refuse de combattre, qu'il soit comme Judas qui trahit le Seigneur, abandonna les apôtres et vendit son Seigneur aux : Juifs. Qu’ils combattent avec confiance pour le bienheureux Pierre tous ceux qui tiennent pour certain qu'il lui a promis qu'il ressusciterait le troisième jour et qu'il lui apparaîtrait ; qu'ils combattent aussi parce que ce territoire appartient à la juridiction du bienheureux Pierre et non à celle des Païens. Que votre cri de ralliement soit Dieu nous aide, et en vérité Dieu vous aidera. Tous vos frères qui sont morts depuis le commencement de cette expédition seront aussi avec vous dans cette bataille. Chargez-vous de vaincre la dixième partie de vos ennemis, et vos frères, par la puissance de Dieu, combattront et vaincront les neuf autres dixièmes. Ne différez donc pas de faire la guerre, car, si vous ne faites ce que je dis, le Seigneur vous amènera d'un autre côté autant d'ennemis qu'il vous en est venu d'un seul côté, et vous tiendra ainsi enfermés jusqu'à ce que les uns aient mangé les autres. Sachez donc maintenant qu'ils sont arrivés ces jours que le Seigneur a annoncés à la bienheureuse Marie, toujours vierge, et à ses apôtres, en leur promettant qu'il élèvera le royaume des Chrétiens, et qu'il rejettera et foulera aux pieds celui des Païens ; et gardez-vous de vous détourner pour aller dans leurs tentes chercher de l'or et de l'argent.
Dieu, qui avait ordonné que ces paroles nous fussent annoncées par son apôtre, voulut alors dans sa puissance que les cœurs de tous fussent fortifiés, en sorte que chacun semblait déjà, dans sa foi et son espérance, avoir triomphé de tous ses ennemis. Ils s'encourageaient donc les uns les autres, et, en s'exhortant ainsi, ils recueillaient leurs forces pour combattre. Le peuple même, qui les jours précédents avait paru consumé de misère et de frayeur, en vint bientôt à se répandre en injures contre les princes sur le retard qu'ils mettaient à combattre. Enfin le jour ayant été fixé, les nôtres envoyèrent d'abord Pierre l'Ermite auprès de Corbaran, chef des Turcs, afin qu'il renonçât à assiéger la ville, parce qu'elle appartenait à la juridiction du bienheureux Pierre et des Chrétiens. Mais lui répondit fièrement qu'à tort ou à raison il voulait se rendre maître des Francs et de la ville. Et Pierre l'Ermite ne voulant pas s'incliner devant lui, il le força à lui adresser la parole en suppliant.
On demanda en ce moment lequel des princes défendrait la ville contre ceux qui occupaient la citadelle, tandis que les autres sortiraient pour aller combattre. Les nôtres élevèrent alors sur le revers de la montagne, en face des ennemis, un mur en chaux et des retranchements ; ils les garnirent d'un grand nombre de pierriers, et y laissèrent le comte Raimond, qui était alors malade à la mort, avec deux cents hommes.
Le jour du combat étant venu, dès le matin tous communièrent et se donnèrent à Dieu, soit pour la mort, si telle était sa volonté, soit pour l'honneur de l'Église romaine et de la race des Francs. Quant au combat, ils réglèrent que l'on formerait deux doubles rangs des gens du comte et de l'évêque, que les hommes de pied marcheraient devant les chevaliers, et se porteraient en avant ou s'arrêteraient, suivant les ordres de leurs princes ; il en fut ordonné de même pour les gens de Boémond et de Tancrède, pour les gens du comte de Normandie et les Français, pour les gens du duc et les Bourguignons. Les hérauts allèrent dans toute la ville criant à haute voix que chaque homme eût à se réunir aux princes de son pays. On régla en outre que Hugues le Grand, le comte de Flandre et le comte de Normandie marcheraient les premiers au combat, après eux le duc, après le duc l'évêque, et qu'enfin Boémond s'avancerait à leur suite. Chacun donc se rallia à sa bannière et aux hommes de son pays, en dessous de la ville et devant la porte du pont. O combien heureux le peuple qui a le Seigneur pour son Dieu[7] ! O combien heureux le peuple que Dieu a élu ! O combien la face de cette armée était changée de tristesse en joie ! Les jours précédents les princes, les nobles et les hommes du peuple de cette armée s'en allaient aux églises, à travers les placés de la ville, pour implorer le secours de Dieu, marchant pieds nus, pleurant, se frappant la poitrine et tellement tristes que le père, s'il rencontrait le fils, ou le frère son frère, ne lui rendait pas son salut, on ne le regardait même pas. Maintenant vous les eussiez vus au contraire remplis d'ardeur faire sortir leurs chevaux, secouer leurs armes, brandir leurs lances, impatiens de tout, repos et ne pouvant demeurer un instant sans témoigner leur allégresse par leurs actions ou leurs paroles. Mais pourquoi de plus longs discours ? Ils eurent enfin la faculté de sortir, et les dispositions qui avaient été arrêtées par les princes furent régulièrement exécutées.
Pendant ce temps le chef des Turcs, Corbaran, jouait aux échecs dans sa tente. Ayant appris que les Chrétiens s'avançaient pour combattre, et l'esprit troublé d'une nouvelle à laquelle il ne s'attendait nullement, il appela un certain Turc nommé Miredalin, qui s'était enfui d'Antioche, homme noble et bien connu de nous par ses exploits de chevalier, et lui dit ; Qu'est-ce donc ? Ne m'avais-tu pas dit que les Francs étaient en petit nombre et ne viendraient pas me combattre ? Et Miredalin répondit : Je n'ai pas dit qu'ils ne viendraient pas combattre ; mais attends, je vais les voir, et je te dirai s'il te sera facile de les vaincre. Déjà notre troisième ligne s'avançait, et lorsqu'il eut vu la disposition de nos troupes, Miredalin dit à Corbaran : Certes, ces hommes peuvent être tués, mais ils ne peuvent être mis en fuite. Et alors, Corbaran lui dit : Nuls d'entre eux ne pourront donc être repoussés ? Et, Miredalin répondit : Non, ils ne céderont pas de la largeur d'une semelle, dût toute la race des Païens s'élancer sur eux. Alors Corbaran, quoique troublé, forma contre nous des corps nombreux de guerriers ; et tandis qu'ils eussent pu, dès le principe, nous empêcher de sortir de la ville, alors ils nous laissèrent avancer paisiblement. Les nôtres cependant dirigèrent leurs corps vers les montagnes, en prenant garde à ne pas être enveloppés sur leurs derrières. Or, ces montagnes étaient éloignées du pont de deux grands milles environ. Nous nous avançâmes donc sur un vaste espace, comme les clercs ont coutume, de marcher dans les processions, et en vérité c'était bien pour nous une procession, car les prêtres et beaucoup de moines, revêtus de leurs étoles blanches, marchaient en avant de nos chevaliers, invoquant par, leurs chants l'assistance de Dieu et le patronage des saints. De leur côté les ennemis voulurent nous attaquer et nous lancèrent des flèches. Corbaran, en outre, manda à nos princes qu'il était prêt à faire maintenant ce que naguère il avait refusé, savoir : Que cinq ou dix Turcs combattissent contre autant de Francs, sous la condition que ceux dont les chevaliers seraient vaincus se retireraient paisiblement devant les autres. A cela, les nôtres répondirent : Vous ne l'avez pas voulu, lorsque nous l'avons voulu ; maintenant donc que nous nous sommes préparés au combat, que chacun combatte selon son droit.
Lorsque nous eûmes occupé toute la plaine, ainsi que nous l'avons dit, un certain corps de Turcs, qui était demeuré derrière nous, vint attaquer nos hommes de pied, mais ceux-ci ayant formé le cercle soutinrent vigoureusement le choc des ennemis. Les Turcs ne pouvant en aucune façon parvenir à les repousser, allumèrent du feu tout autour d'eux, afin que ceux qui ne redoutaient pas le glaive fussent du moins atteints par le feu, et par ce moyen ils les forcèrent à se retirer, car il y avait en ce lieu beaucoup de foin qui était fort sec.
Tandis que nos corps d'armée sortaient de la ville, les prêtres demeuraient sur les remparts, les pieds nus, revêtus de leurs habits sacerdotaux, et invoquant Dieu, afin qu'il défendît son peuple et confirmât, dans cette bataille, par la victoire des Francs, les témoignages qu'il a scellés de son sang. Dans cet espace de terrain que nous traversâmes depuis le pont jusqu'aux montagnes, nous eûmes à faire de grands efforts, parce que les ennemis voulaient nous envelopper ; et quoique pendant ce temps leurs corps d'armée les plus nombreux pesassent sur nous, qui faisions partie du corps d'armée de l'évêque, cependant, grâce au secours de la lance du Seigneur qui était là, ils ne nous blessèrent personne, et ne nous lancèrent pas même de flèches. Je vis ces choses, moi qui parle, et je portais en ce lieu la lance du Seigneur. Que si quelqu'un prétend qu'Héraclius, vice-comte et porte-bannière de l'évêque, fut blessé dans ce combat qu'il sache qu'il avait remis sa bannière à un autre et quitté notre corps.
Lorsque tous les hommes propres au combat furent sortis de la ville, il parut au milieu de nous cinq nouveaux corps d'armée. Car, ainsi que je l'ai déjà dit, nos princes n'avaient formé que huit corps ; et il s'en trouva treize en dehors de la ville. Il n'y a qu'une seule chose véritablement mémorable que nous ne devions point passer sous silence. Lorsque nous commençâmes à sortir pour aller combattre, le Seigneur envoya sur toute son armée une pluie divine, pluie fine, mais tellement agréable, que quiconque en était atteint se sentait rempli de toute grâce et de toute force, méprisait les ennemis et marchait, comme s'il eût toujours été nourri au milieu des délices des rois. Chose non moins admirable, il en arriva tout autant à nos chevaux ; car quel est l'homme à qui son cheval ait manqué, si ce n'est après l'issue du combat, quoiqu'aucun d'eux depuis sept jours n’eut mangé autre chose que des écorces et des feuilles d'arbre ? En outre, le Seigneur multiplia tellement notre armée, que nous qui avant le combat étions moins nombreux que les ennemis, nous nous trouvâmes, durant le combat, bien plus nombreux. Les nôtres donc s'étant avancés, et ayant pris leurs positions, il ne nous fut pas même permis de livrer combat, car les ennemis prirent soudain la fuite, et les nôtres les poursuivirent jusqu'au coucher du soleil. Le Seigneur opéra admirablement, tant sur les hommes que sur les chevaux ; car les hommes ne se laissèrent point détourner du combat par leur avidité, et ces chevaux affamés, que leurs maîtres avaient conduits au combat presque sans les faire manger, poursuivirent bientôt après, avec une extrême légèreté, les chevaux des Turcs, tous gras et très habiles à la course.
Ce ne fut pas la seule joie que le Seigneur voulut nous, accorder. Les Turcs qui avaient fortifié la citadelle de la ville, voyant les leurs précipiter leur fuite, perdirent eux-mêmes toute espérance, et les.uns.se rendirent aux nôtres, en obtenant seulement grâce pour la vie, tandis que les autres se hâtèrent de fuir. Quoique la bataille eut été conduite avec tant d'ardeur d'un côté et tant de timidité de l'autre, les ennemis cependant ne perdirent qu'un petit nombre de leurs chevaliers ; mais parmi leurs hommes de pied à peine s'en échappât-il un seul. Toutes leurs tentes furent enlevées, ainsi que beaucoup d'or et d'argent et de riches dépouilles, et l'on prit en outre des vivres, des troupeaux et des chameaux en quantités qui ne pouvaient être mesurées ni comptées. Là se renouvela pour nous, l'événement de Samarie, au sujet de la mesure de fleur de froment et d'orge qui était vendue au prix d'une statère. Ces choses se passèrent la veille de la fête des apôtres Pierre et Paul, intercesseurs auxquels, cette victoire de l'Église pèlerine des Francs fut accordée par notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et demeura avec ses serviteurs, Dieu favorable aux siècles des siècles. Amen.
A la suite de cette victoire, il arriva que nos princes, Boémond, le comte, le duc et le comte de Flandre prirent en commun possession de la citadelle de la ville ; mais Boémond s'empara des tours plus élevées, éprouvant déjà les passions qui devaient enfanter l'iniquité. En conséquence, il expulsa de vive force du château les hommes du duc, du comte de Flandre et du comte de Saint-Gilles, disant qu'il avait juré au Turc qui lui avait livré la ville qu'il serait seul à la posséder. Après cela, et comme il avait fait impunément cette première tentative, il en vint à demander les citadelles de la ville et les portes, que le comte, l’évêque et le duc avaient gardées depuis le moment où nous avions été assiégés. Tous lui cédèrent à l'exception du comte. Celui-ci, quoiqu'il fût malade, ne voulût livrer la porte du pont, ni aux prières, ni aux promesses, ni aux menaces de Boémond.
Et ce ne fut pas seulement parmi nos princes que la discorde s'éleva à cette époque, elle rompit aussi les liens qui unissaient le peuple, en sorte qu'il y eut bien peu d'hommes qui n'eussent des démêlés avec leurs compagnons ou leurs domestiques, pour des affaires de larcin ou de vol à force ouverte ; et cependant il n'y avait dans la ville aucun juge qui pût ou voulût juger ces différends, et ce genre d'injustice fut poussé par chacun aussi loin qu'il lui fut possible. Le comte et l’évêque étaient gravement malades pendant ce temps, et ne pouvaient protéger personne contre de telles insultes.
Mais pourquoi nous arrêter plus longtemps à ces détails ? Amollis par l'oisiveté et les richesses, les nôtres, au mépris des ordres de Dieu, différèrent jusqu'au commencement de novembre de poursuivre le voyage qu'ils avaient entrepris. Au premier moment après la fuite des Turcs, les villes des Sarrasins étaient tellement consternées et frappées de terreur que si nos Francs fussent alors montés à cheval, il n'y eût pas eu une de ces villes, jusqu'à la cité de Jérusalem, qui eût osé, à ce que nous croyons, lancer contre eux une pierre.
Pendant ce temps, le seigneur Adhémar, évêque du Puy, aimé de Dieu et des hommes, cher à tous et en toutes choses, se rendit en paix dans le sein du Seigneur, le premier jour d'août. Tous les Chrétiens qui se trouvaient rassemblés en éprouvèrent une douleur si grande, que nous qui avons entrepris d'écrire tout ceci, à raison de la grandeur des événements, nous n'avons jamais pu mesurer l'étendue de cette affliction. On reconnut plus évidemment encore combien il avait été utile à l'armée de Dieu et à ses princes, lorsqu'on vit après sa mort ceux-ci se diviser entre eux, Boémond retourner dans la Romanie, et le duc de Lorraine partir pour se diriger vers Roha.
Après que l'évêque eut été enseveli à Antioche, dans l'église du bienheureux Pierre, et la seconde nuit, le Seigneur Jésus apparut, avec le bienheureux André et ce même évêque, à ce Pierre Barthélemi, qui avait révélé l'existence de la lance dans la chapelle du comte, où ladite lance était déposée. L'évêque lui adressa la parole, disant : Grâces soient rendues à Dieu, à tous mes frères et à Boémond, qui m'ont délivré de l'enfer ; car j'ai péché gravement, après que la lance du Seigneur a été découverte. C'est pourquoi j'ai été conduit dans l'enfer, et là j'ai été flagellé très rudement, et ma tête et mon visage ont été brûlés, ainsi que tu peux le voir ; et mon âme est demeurée en ce lieu, depuis l'heure où elle est sortie de son corps, jusqu'à celle où ce misérable corps qui m'appartenait a été livré à la poudre. Le Seigneur m'a rendu, au milieu même des flammes de l'incendie, ce vêtement que tu vois, parce que je l'avais donné à un pauvre pour l'amour de Dieu, lorsque je reçus l'ordination d'évêque ; et quoique la géhenne déployât ses fureurs, quoique les ministres du Tartare fissent contre moi des efforts insensés, ils n'ont pu cependant me faire aucun mal intérieurement. De toutes les choses que j'ai apportées de ma patrie, aucune ne m'a été aussi utile que cette chandelle, que mes amis ont présentée à l'offrande pour l'amour de moi, et ces trois deniers que j'avais aussi offerts devant la lance : ces objets ont relevé mes forces, lorsque j'éprouvais une faim mortelle, en m'avançant pour sortir de l'enfer. Mon seigneur Boémond a dit qu'il transporterait mon corps à Jérusalem : que ce soit un effet de sa bonté de ne pas me changer de place, parce qu'il y a encore ici quelque chose du sang du Seigneur, auquel il m'a associé. Mais s'il doute des choses que je te dis, qu'il ouvre mon sépulcre, et il verra ma tête et mon visage brûlés. J'ai confié ma famille à mon seigneur le comte ; qu'il lui fasse du bien, afin que Dieu lui fasse miséricorde et accomplisse ce qu'il lui a promis. Que mes frères ne s'affligent point si ma vie est finie, car jamais je ne leur ai été aussi utile que je le serai, s'ils veulent observer les commandements de Dieu. En effet, j'habiterai avec eux, et tous mes frères, dont la vie est finie comme la mienne, habiteront aussi avec eux, et je leur apparaîtrai et je les consolerai beaucoup mieux que je n'ai fait jusqu'ici. Et vous mes frères, souvenez-vous des peines de l'enfer, qui sont si rudes et si horribles. Servez donc le Seigneur, qui peut vous délivrer de ces peines et de tous les autres maux. Oh ! combien est heureusement né celui qui ignorera les peines de l'enfer ! Le Sauveur pourra faire cette grâce à ceux qui auront observe ses commandements. Ce qui demeurera de cette chandelle ce matin, conserve-le. Que le comte élise, avec ceux qu'il voudra choisir lui-même, un évêque pour me remplacer ; car il ne serait pas juste qu'après ma mort la bienheureuse Marie, toujours vierge, n'eût pas d'évêque : que l'un de mes pallium soit donné par vous à l'église du bienheureux André. Et le bienheureux André lui adressa ses remerciements.
Après cela le bienheureux André, s'avançant de plus près, parla en ces termes : Que tous écoutent ce que Dieu dit par ma bouche, disant : Souviens-toi, comte, du don que le Seigneur t'a accordé ; ce que tu fais, fais-le en son nom, afin que le Seigneur dirigé tes actions et tes paroles, et exauce tes prières. La première cité que le Seigneur nous a accordée, à savoir celle de Nicée s'est détournée de lui ; le Seigneur nous a donné cette ville et l'a enlevée à nos ennemis, et ensuite il n'y a pas été connu ; et si quelqu'un y a invoqué le nom du Seigneur, il a été battu de verges, et les œuvres de Dieu n'y ont point été pratiquées. Mais, dans sa bonté, le Seigneur n'a pas voulu vous abandonner sans vous accorder ce que vous avez demandé, et plus même que vous n'avez osé demander. Il vous a donné cette lance qui a frappé de plaies son corps, d'où a coulé le sang de notre rédemption. Et Dieu ne vous a point donné de faire de cette ville-ci comme vous avez fait de l'autre ville, et vous pouvez voir qu'en raison de vos mérites Dieu ne vous l’a point donnée. Le Seigneur te prescrit, ô comte, de t'enquérir lequel voudra se faire seigneur de cette ville au dessus des autres, et tu lui demanderas quelle domination il prétend y exercer à cause du Seigneur. Que si toi et tes autres frères, à qui Dieu a donné cette ville, vous apprenez qu'il soit fidèle et qu'il veuille observer ou rendre la justice, qu'il la possède. S'il ne veut pas observer ou rendre la justice, et s'il veut la posséder par sa seule puissance, toi et tes frères demandez conseil à Dieu, et Dieu vous donnera conseil ; et les hommes qui suivent la bonne voie ou qui aiment Dieu, ne te manqueront point. Mais que ceux qui ne veulent pas suivre la bonne voie retournent auprès !de celui qui n'aura pas voulu observer la justice, et ils verront comment Dieu les sauvera. Ils recevront la malédiction de la part de Dieu et de sa mère, telle que Lucifer l'a reçue lorsqu'il est tombé du ciel. Et vous, si vous êtes tous d'accord, demandez conseil par la prière, et Dieu vous donnera conseil. Si la concorde règne entre vous, tenez conseil pour élire un patriarche qui soit de votre loi. Les hommes qui seront venus à vous de la captivité pour suivre votre loi, ne le laissez point, aller ; mais ceux qui se seront prononcés dans le Khorasan pour adorer le Dieu des Turcs, ne les recevez point ; traitez-les comme des Turcs, envoyez-en deux ou trois en prison, et ceux-là vous feront connaître les autres. Après que ces choses auront été faites par vous, demandez conseil au Seigneur sur l'expédition pour laquelle vous êtes venus, et il vous conseillera bien. Jérusalem est près de vous, à dix journées démarche ; mais si vous ne voulez pas observer les choses susdites, de dix années vous n'irez pas à Jérusalem. Et, après dix années, je rétablirai les infidèles en honneur, et cent d'entre eux prévaudront contre mille d'entre vous. Et vous, hommes du Christ, adressez au Seigneur la demande que les apôtres lui adressèrent, et comme il leur a donné, de même il vous donnera aussi à vous. Vous, comte Boémond, allez à l'église du bienheureux André, et il vous donnera le meilleur conseil devant Dieu ; et ce que Dieu aura mis dans votre cœur, faites-le ; et comme le bienheureux André vous a visités, visitez-le aussi et faites que vos frères le visitent. Que la concorde soit entre vous, comte et Boémond, ainsi que l'amour de Dieu, et du prochain. Si vous vous accordez bien ensemble, nulle chose ne pourra vous diviser. Il convient d'abord que vous fassiez connaître la justice que vous devez rendre. Autant il y aura d'hommes dans chaque évêché, que tous produisent leurs richesses, qu'ils assistent les pauvres de leur pays autant qu'ils le pourront et qu'il sera, nécessaire. D'ailleurs faites toutes choses ainsi que vous en serez tombés d'accord ; et ceux qui ne voudront pas observer cette règle de justice et toutes les autres, contraignez-les à le faire. Et si quelqu'un veut posséder une autre ville de celles que Dieu vous donnera, faites qu'il se conduise selon ce qui est dit ci-dessus, et s'il, ne veut pas le faire, que le comte et les enfants de Dieu le battent de verges. Ces choses furent d'abord reçues avec foi et ensuite oubliées, car les uns dirent : Rendons la ville à l'empereur, et les autres ne le voulurent pas. Au milieu de ces discordes et des troubles qui les suivirent, les intérêts des pauvres furent mis de côté, et quant au conseil que les princes devaient aller demander auprès de saint André, il n'en fut rien fait.
Sur ces entrefaites, les Turcs d'Alep assiégèrent un certain château. Les Turcs qui y étaient enfermés, affligés de cet événement, mandèrent au duc, qui se trouvait dans le pays, de venir prendre possession de ce château, disant que, dans la suite, ils ne voulaient avoir pour seigneur qu'un homme de la race des Francs. C'est pourquoi le duc retourna à Antioche et adressa d'instantes prières au comte, qui s'était déjà relevé de sa maladie, et qui avait lui-même convoqué ses chevaliers et ses hommes de pied pour aller, dans l'intérêt des pauvres, recueillir du butin. Le duc supplia donc le comte de porter secours aux Turcs qui réclamaient l'assistance de Dieu pour la gloire de la race des Francs et pour l'amour de Dieu et de lui-même, ajoutant qu'après la destruction des machines des Turcs assiégeants, les Turcs assiégés voulaient embrasser la croix. A la suite de ces prières et d'autres semblables, le comte partit avec le duc. Mais lorsque ces choses furent connues aux Turcs, ils levèrent le siège. Lorsque notre armée fut arrivée à Hasarth, le duc reçut des otages du château, en garantie de sa fidélité future, et le comte retourna à Antioche, non sans que son armée essuyât de grandes pertes. Alors le comte rassembla de nouveau ses chevaliers, afin de conduire dans les campagnes ses pauvres, que la famine et l'ennui consumaient dans Antioche.
En ce temps saint André apparut à Pierre Barthélémy dans la tente où habitaient l'évêque d'Agde, Raimond le chapelain du comte, et un autre chapelain nommé Simon. Celui-ci entendant les autres qui parlaient entre eux, savoir saint André et Pierre Barthélemi, couvrit sa tête, et, selon qu'il le rapporta lui-même, entendit beaucoup de choses ; mais il ne se souvint que de ceci : Seigneur, je dirai ceci, dit l'évêque d'Agde ; je ne sais si ce fut en songe ou non : un vieillard se présenta devant moi revêtu d'une étole blanche, tenant dans ses mains la lance du Seigneur, et me dit : Crois-tu que cette lance soit celle de Jésus-Christ ? Et je répondis : Je le crois, Seigneur ; et après qu'il m'eut fait la même question, une seconde et une troisième fois, je dis ; En vérité, je crois, Seigneur, que cette lance est celle qui tira le sang du flanc de notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous sommes tous rachetés. Et après cela l'évêque me poussa vivement, moi Raimond, qui dormais à côté de lui, et m'étant alors éveillé, je vis un éclat extraordinaire ; et, comme si mon cœur eût été frappé d'une grâce particulière, je me mis à demander à ceux qui étaient près de moi s'ils n'éprouvaient pas quelque chose, comme au milieu d'une grande agitation populaire ; et tous les autres se mirent à dire : Nullement. Mais Pierre, à qui la révélation avait été faite, lorsque nous l'interrogeâmes à l'envi les uns des autres sur ce que nous venons de rapporter, nous répondit : Ce n'est pas sans raison que vous voyez ici un éclat tout-à-fait agréable ; car le père, de qui procède toute grâce, a séjourné longuement ici. Et comme nous lui demandâmes de nous faire connaître les choses qui lui avaient été dites, il nous dit ceci au comte et à nous : Cette nuit le Seigneur et le bienheureux André sont venus ici sous la forme qu'ils ont coutume de revêtir, et suivis d'un troisième qui était petit de taille, revêtu d'habits de lin et portant une barbe très long gue. Et le bienheureux André m'a adressé beaucoup de menaces, parce que j'avais abandonné, dans un lieu indigne, les reliques de son propre corps retrouvées à Antioche dans son église même, et il m'a dit : Lorsque je fus précipité du haut d'une certaine montagne par les infidèles, je me cassai deux doigts ; et, après ma mort, un homme les prit et les porta à Antioche ; et toi, lorsque tu les as retrouvés, tu n'en as pris aucun soin, tu as souffert que l'un te fût ravi, et tu as abandonné l'autre d'une manière indigne. Et alors il me montra sa main, à laquelle il manquait deux doigts. Après cela, ô comte, il m'a porté beaucoup de plaintes contre toi ; car, après avoir reçu le don vénérable que le Seigneur n'a accordé à nul autre, tu ne crains pas de pécher gravement et méchamment en présence du Seigneur C'est pourquoi le Seigneur a fait devant toi le miracle que voici. Lorsqu'il y a cinq jours, tu as présenté à l'offrande un cierge assez grand pour qu'il eût pu durer trois jours et autant de nuits, il n'a rendu cependant aucune clarté, et, se fondant tout de suite, il est tombé en terre. Et cette nuit, au contraire, tu as offert un cierge tellement petit qu'il pouvait durer à peine jusqu'au chant du coq ; maintenant il est jour, le cierge dure encore, et le tiers même n'en est pas consumé. C'est pourquoi le Seigneur te commande : N'entreprends rien sans avoir fait d'abord pénitence : autrement, et quelque chose que tu fasses, tu tomberas en terre comme un cierge fondu. Que si tu fais pénitence, quelque chose que tu entreprennes au nom du Seigneur, Dieu l'achèvera et la consommera ; et comme tu vois durer, ce petit cierge, le Seigneur fera grand tout ce que tu auras entrepris, quoique ce soit d'abord petit. Et comme le comte se défendit alors d'avoir aussi gravement péché, Pierre lui raconta son péché, et le comte se confessa et fit pénitence. Et alors Pierre dit de nouveau au comte : Le bienheureux André se plaint, ô comte, de tes conseillers, parce qu'ils te conseillent sciemment beaucoup de mal. C'est pourquoi il t'ordonne de ne pas admettre ces hommes à tes conseils, s'ils ne jurent auparavant de ne plus te conseiller le mal sciemment. Écoute encore ceci, comte : le Seigneur te mande de ne pas faire de nouveaux retards, parce que tu ne recevras aucun secours avant que Jérusalem ait été prise. Lorsque tu seras près de, Jérusalem, que chacun de vous descende de cheval à deux lieues. Si vous vous conduisez ainsi, le Seigneur vous donnera sa Cité. Après cela saint André me rendit à moi-même mille actions de grâces, parce que j'avais fait consacrer dans Antioche l'église qui avait été construite en son nom. Saint André me dit ces choses et d'autres encore, dont ce n'est pas ici l'occasion de parler ; ensuite ils disparurent lui et ses compagnons.
Le comte se rendit donc en Syrie avec la foule des pauvres et un petit nombre de chevaliers, et assiégea vigoureusement la première ville, des Sarrasins qu'il rencontra, nommée Albar : il tua là plusieurs milliers de Sarrasins, et plusieurs autres milliers furent ramenés et vendus à Antioche. Ceux qui se rendirent à lui dans le cours du siège et par la crainte de la mort, il leur permit de s'en aller, en liberté. Ayant ensuite tenu conseil avec ses chapelains et ses princes, il élut un prêtre pour évêque d'une manière fort convenable et honorable pour celui-ci. En effet, après qu'il eut convoqué tous ceux qui étaient avec lui, un de ses chapelains monta sur un mur et fît connaître à toute l'assemblée les intentions du comte. Le peuple ayant vivement insisté pour que cette élection fût faite, le même chapelain demanda de nouveau s'il y avait quelqu'un dans le clergé qui réunit les suffrages du peuple, et qui, résistant aux Païens, autant qu'il lui serait possible, pût servir à la fois en ce lieu Dieu et ses frères. Comme tous gardaient le silence, nous appelâmes alors un certain Pierre, né à Narbonne, nous mîmes sous ses yeux le fardeau de l'épiscopat, lui demandant de ne point hésiter à l'accepter pour l'amour de Dieu et de ses frères, s'il était dans de telles dispositions qu'il aimât mieux mourir que d'abandonner cette ville. Celui-ci s'étant déclaré animé de ces dispositions, le peuple le loua beaucoup tout d'une voix, et rendit mille actions de grâces à Dieu qui voulait avoir un évêque romain dans l'Église d'Orient pour administrer son peuple. Le comte concéda alors à l'évêque la moitié de la ville et de tout son territoire. Cette ville d'Albar était située au-delà d'Antioche et à deux journées de marche.
Mais déjà le commencement de novembre approchait, époque à laquelle tous les princes avaient promis de se rassembler à Antioche pour se remettre en route et reprendre leur expédition. Le comte ayant laissé à Albar son armée, l'évêque qu'il avait élu, un grand nombre de prisonniers et des richesses considérables, fruit du butin, retourna à Antioche avec beaucoup de joie. Tous les princes s'y étaient pareillement rendus, à l'exception de Baudouin frère du duc. Ce Baudouin s'étant dirigé vers l'Euphrate avant la prise d'Antioche, avait pris possession de Roha, ville très riche et très célèbre, et remporté de grands avantages sur les Turcs dans une infinité de combats.
Avant de passer à raconter d'autres événements, je crois ne devoir point omettre de rapporter un fait qui concerne le duc de Lorraine. Celui-ci donc, tandis qu'il se rendait à cette époque à Antioche, suivi de douze chevaliers, vit tout à coup paraître devant lui cent quarante Turcs. Prenant aussitôt les armes, et encourageant ses chevaliers par ses discours, il s'élança vigoureusement sur les ennemis. Les Turcs voyant les Francs plus disposés à chercher la mort dans le combattue leur salut dans la fuite, quelques-uns descendirent de cheval, afin que les autres combattissent avec plus de sécurité, sachant que leurs compagnons ne quitteraient point le champ de bataille, puisqu'ils se dessaisissaient de leurs chevaux. Le combat s'engagea donc avec beaucoup d'acharnement et dura longtemps, mais enfin les chevaliers du duc s'encourageant les uns les autres, et parce qu'ils faisaient entre eux le nombre des apôtres, et parce qu'ils regardaient leur seigneur comme le vicaire du Christ, s'élancèrent avec intrépidité au milieu de l'escadron des Turcs. Dieu accorda au duc une si grande victoire qu'il tua au moins trente de ses ennemis, et leur enleva autant de prisonniers ; puis il poursuivit les autres jusque dans les marais et sur les bords du fleuve, et força les uns à se tuer, les autres à se précipiter dans les eaux. A la suite de ce brillant succès, le duc se rendit à Antioche, faisant porter les têtes des morts par ceux des Turcs qu'il menait vivants à sa suite, ce qui fut pour les nôtres un grand sujet de joie.
Tous les princes s'étant rassemblés dans l'église du bienheureux Pierre, commencèrent à s'occuper entre eux de la continuation de notre voyage. Alors quelques-uns, qui possédaient des châteaux et des revenus dans la ville d'Antioche, dirent : Que fera-t-on d'Antioche ? Qui la gardera ? L'empereur ne viendra pas ; car ayant appris que les Turcs nous assiégeaient, et ne se confiant ni en sa puissance, ni en la multitude d'hommes qu'il avait avec lui, il s'est enfui. L'attendrons-nous donc encore ? Certes il ne viendra pas à notre secours celui qui a forcé nos frères à s'en retourner, lorsqu'ils venaient à nous comme auxiliaires de Dieu. Si nous abandonnons cette ville, et que les Turcs s'en emparent, la fin sera pire que le commencement. Que tous donc la concèdent à Boémond, parce qu'il est sage, qu'il saura très bien la conserver, et que son nom est grand parmi les païens. Mais le comte Raimond et d'autres répondirent à cela : Nous avons juré à l'empereur sur la croix du Seigneur, sur la couronne d'épinés, et sur beaucoup d'autres saintes reliques, de ne retenir, contre sa volonté, aucune des villes, aucun des châteaux qui font partie de son Empire. Ainsi les uns parlant contre les autres, de cette manière et de beaucoup d'autres encore, la discorde se mit entre nos princes, si bien qu'ils furent sur le point de prendre les armes. Le duc et le comte de Flandre mettaient fort peu d'intérêt à l'affaire d'Antioche ; mais, quoiqu'ils voulussent bien que Boémond en prît possession, ils n'osaient cependant approuver ses prétentions, craignant de s'exposer à la honte d'un parjure. Par suite de ces contestations, on différa de s'occuper du voyage, et de diverses autres choses qui eussent tourné à l'avantage de l'expédition et des pauvres. Lorsque le peuple s'en fut aperçu, chacun commença à dire à son voisin, et bientôt ouvertement et à tout le inonde : Puisque les princes, soit par crainte, soit par suite des serments qu'ils ont faits à l’empereur, ne veulent pas nous conduire à Jérusalem, choisissons parmi les chevaliers un homme fort, que nous servirons fidèlement, et avec lequel nous puissions être en sûreté ; et si la grâce de Dieu est avec nous, rendons-nous à Jérusalem, sous la conduite de ce même chevalier. Quoi donc ? Ne suffit-il pas à nos princes que nous soyons demeurés ici pendant un an, et que deux cent mille hommes armés y aient succombé ? Que ceux qui le veulent reçoivent l'or de l'empereur, que ceux qui le veulent reçoivent les revenus d'Antioche. Quant à nous, remettons-nous en route sous la conduite du Christ, pour lequel nous sommes venus. Périssent misérablement tous ceux qui veulent demeurer à Antioche, comme ont péri naguère ses habitants ! Que si ce grand procès élevé à l'occasion d'Antioche dure plus longtemps, renversons ses murailles, et cette paix qui unissait les princes entre eux avant que la ville fût prise, les réunira de nouveau après sa destruction. Autrement, et avant que n, ms soyons entièrement détruits ici par la famine et par l'ennui, hâtons-nous de retourner chacun dans notre pays. Ces discours et d'autres semblables amenèrent enfin une paix mal plâtrée entre Boémond et le comte, et le jour ayant été fixé, on ordonna au peuple de se préparer pour suivre la route, objet de ses vœux.
Les préparatifs nécessaires ayant été faits au jour fixé, le comte de Saint-Gilles et le comte de Flandre se rendirent en Syrie, et là ils assiégèrent d'abord Marrah, ville très riche et très peuplée, située à huit milles d'Albar. Les citoyens de Marrah étaient très orgueilleux, parce que dans une certaine circonstance ils avaient tué, en un combat, un grand nombre des nôtres ; ils maudissaient notre armée, se répandaient contre elle en injures, et afin de nous provoquer plus vivement, ils plaçaient des croix sur leurs murailles, et les accablaient de toutes sortes d'insultes. Par ces motifs, dès le second jour de notre arrivée, nous les attaquâmes avec tant d'ardeur, que si nous eussions eu quatre échelles de plus, la ville se fût trouvée prise, mais comme nous n'en avions que deux, qui même étaient trop courtes et trop faibles, nous n'osâmes pas monter dessus ; il fut résolu alors que l'on construirait des machines et des claies, afin de pouvoir attaquer et renverser les murailles, et que l'on abattrait les chaussées pour combler les fossés. Sur ces entrefaites, Boémond arriva avec son armée, et assiégea la ville d'un autre côté. Quoique les dispositions dont je viens de parler ne fussent, point terminées, nous résolûmes, à peu près sur les instigations de Boémond, qui n'avait pas assisté au premier assaut, de livrer une nouvelle attaque en comblant le fossé ; mais cette entreprise fut inutile, et le combat même tourna à notre désavantage, plus encore que le précédent. En outre, il survint une si grande disette dans l'armée que vous eussiez vu, chose vraiment déplorable à rapporter, plus de dix mille hommes se répandre dans les champs comme des troupeaux, creuser dans la terre pour voir s'ils ne pourraient y trouver par hasard quelques grains de froment, d'orge, de fèves, ou de tout autre légume. Dans le même temps, et quoiqu'on préparât les machines dent j'ai parlé, pour livrer des assauts, quelques-uns des nôtres, voyant la misère du peuple et l'extrême audace des Sarrasins, désespérèrent de, la miséricorde de Dieu, et prirent la fuite.
Mais Dieu, qui prend soin de ses serviteurs, ne différa pas davantage d'avoir compassion de son peuple qu'il vit livré aux plus affreuses tribulations. C'est pourquoi il employa les bienheureux apôtres Pierre et André pour nous faire connaître sa volonté et les moyens d'apaiser la terrible colère qu'il avait contre nous. Ceux-ci donc, venant dans la chapelle du comte au milieu de la nuit, éveillèrent Pierre à qui ils avaient déjà fait voir la lance. Pierre aussitôt, les voyant cou verts de vêtements difformes et très sales, et ayant au près de lui les coffres dans lesquels étaient enfermées les reliques, crut que c'étaient des pauvres qui venaient cherchera enlever quelque chose dans sa tente. Saint André portait une vieille tunique déchirée sur les épaules ; sur l'un des trous de l'épaule gauche une pièce avait été recousue, sur l'épaule droite il n'y avait rien, et en outre il était fort mal chaussé. Le bien heureux Pierre n'avait qu'une chemise grossière et très longue qui lui descendait jusqu'aux talons. Alors Pierre Barthélemi leur dit : Qui êtes-vous, seigneurs, ou que demandez-vous ? Et le bienheureux Pierre répondit : Nous sommes les envoyés de Dieu. Je suis Pierre, et celui-ci est André. Mais nous avons voulu t'apparaître sous cette forme, afin que tu connusses quels grands avantages obtient celui qui sert Dieu en toute dévotion. Sous ces traits et sous ces habits, tels que tu nous vois, nous approchons de Dieu, et voici ce que nous devenons. A peine avait-il dit qu'ils devinrent tels qu'on ne pouvait rien voir de plus éclatant et de plus beau. Pierre qui voyait ces choses, effrayé de cet éclat subit, tomba sur la terre comme un homme mort ; et, couvert de sueur dans son angoisse, il inonda la natte sur laquelle il était tombé. Le bienheureux Pierre le relevant alors, lui dit : Tu es tombé bien vite. Et celui-ci répondit : Oui, seigneur. Et le bienheureux Pierre reprit : Ainsi tomberont tous ceux qui vivent dans l'incrédulité ou dans la transgression des ordres de Dieu. Mais s'ils se repentent de leurs méfaits, s'ils élèvent leur voix vers Dieu, le Seigneur les relèvera, comme je t'ai relevé après que tu es tombé ; et de même que ta sueur est retombée sur la natte et y est demeurée, de même Dieu enlève les péchés de ceux qui croient à lui. Dis-moi comment se trouve l'armée ? Et Pierre répondit : Certes, seigneur, elle est frappée d'une grande terreur par la famine et par toutes sortes de misères. Et le bienheureux Pierre reprit : En vérité, ils doivent être dans une grande terreur ceux qui ont abandonné le Dieu tout-puissant, et ne se souviennent pas des périls auxquels il les a arrachés, pour lui en rendre quelques actions de grâces. En effet, lorsque vous étiez tous vaincus et humiliés dans les murs d'Antioche, parce que vous avez crié au Seigneur, tellement que nous qui étions dans le ciel nous vous avons tous entendus, le Seigneur vous a exaucés et vous a envoyé sa lance comme un gage de victoire, et ensuite il vous a fait merveilleusement et glorieusement triompher de vos ennemis qui vous avaient assiégés. Et maintenant comment vous croyez-vous en sûreté, vous qui avez offensé Dieu si gravement ? Quelles hautes montagnes ou quels autres pourraient vous protéger ? Fussiez-vous dans un lieu élevé et bien fortifié, y eussiez-vous en abondance toutes les choses nécessaires à la vie, là même vous ne pourriez vivre en sécurité, puisque cent mille adversaires menaceraient chacun de vous. Parmi vous règnent le meurtre, les rapines et le larcin ; il n'y a point de justice, il y a beaucoup d'adultères, tandis qu'il serait très agréable à Dieu que chacun de vous prît une femme. La justice avant tout, ainsi l'ordonne le Seigneur : lorsqu'un individu quelconque aura fait violence à un pauvre, que tout ce qui se trouve dans la maison de l'oppresseur soit publiquement vendu. Quant aux dîmes, je vous dis que si vous les rendez, tout ce qui vous sera nécessaire, le Seigneur est prêt à vous le donner, et cette ville, il vous la donnera aussi, par un effet de sa miséricorde et non pointa cause de vos mérites. Le matin, lorsque Pierre eut rapporté ces choses au comte, J'évêque d'Orange et celui d'Albar convoquèrent le peuple, et nous lui exposâmes ce que nous venons de raconter. Séduits par l'espoir de prendre bientôt la ville, les fidèles offrirent de grandes aumônes et des prières au Dieu tout-puissant, afin qu'il délivrât le peuple de ses pauvres pour l'amour seul de son nom. Après cela on fabriqua promptement des échelles, on construisit une tour en bois, on tressa des claies, et au jour fixé on commença le combat. Cependant ceux qui étaient enfermés dans la ville, tandis que les nôtres travaillaient à miner les murailles, lançaient pêle-mêle sur eux des pierres, des traits, des feux, des Lois, des ruches remplies d'abeilles et de la chaux. Mais, par la puissance et la miséricorde de Dieu, il n'y eut aucun des nôtres, ou du moins un très petit nombre qui en fussent blessés. Cependant les nôtres attaquèrent hardiment les murailles avec leurs pierriers et dressèrent leurs échelles. Le combat dura depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, et avec tant d'ardeur que nul ne prit un seul moment de repos, et que le soir encore on était incertain qui remporterait la victoire. Enfin tous les nôtres élevèrent ensemble leurs voix vers le Seigneur, afin qu'il se montrât favorable à son peuple et qu'il accomplit les promesses de ses apôtres. Aussitôt le Seigneur fut présent et nous donna la ville selon les paroles des apôtres. Guilfert de Tours monta avant tous les autres ; un grand nombre d'hommes le suivirent et s'emparèrent des remparts et de quelques-unes des tours de la ville. La nuit survint alors et mit un terme au combat. Les Sarrasins cependant occupaient encore quelques tours et une partie de la ville. C'est pourquoi les chevaliers, comptant qu'ils ne se rendraient que le lendemain matin, veillèrent en dehors des murs de la ville, afin qu'aucun d'eux ne se sauvât secrètement. Mais ceux à qui leur vie était moins précieuse, et que leurs longs jeûnes avaient accoutumés à n'en faire aucun cas, ne craignirent pas d'attaquer les Sarrasins au milieu même des ténèbres de la nuit, en sorte que les pauvres enlevèrent ainsi tout, le butin de la ville et s'emparèrent des maisons. Le matin venu, les chevaliers rentrèrent dans la ville et ne trouvèrent plus que peu de chose à prendre pour eux-mêmes. Les Sarrasins, pendant ce temps, s'étaient enfermés dans des cavernes souterraines, et l'on n'en voyait point, ou seulement un bien petit nombre. Les nôtres, après avoir enlevé tout ce qu'ils trouvèrent sur là terre, crurent que tout le reste était enfermé avec les Sarrasins, et parcoururent les cavernes en allumant des feux et faisant de la fumée de soufre ; et comme cependant ils ne trouvaient pas beaucoup de choses à enlever, tous les Sarrasins qu'ils pouvaient saisir, ils les accablaient de coups jusqu'à la mort pour en obtenir leurs dépouilles. Il arriva à quelques-uns des nôtres, tandis qu'ils conduisaient des Sarrasins dans la ville pour chercher du butin, que ceux-ci les conduisirent auprès de quelques puits et s'y précipitèrent tout à coup, aimant mieux chercher la mort la plus prompte que découvrir leurs propriétés ou même quelque chose que ce fût. Aussi tous subirent-ils la mort, et ensuite ils furent jetés dans les fossés de la ville et en dehors des remparts. Ainsi donc on ne trouva pas beaucoup de richesses à enlever dans cette ville.
Sur ces entrefaites, il s'éleva une querelle entre les hommes de Boémond et ceux du comte, parce que les chevaliers de Boémond avaient peu travaillé à l'assaut et avaient cependant occupé le plus grand nombre des tours et possédaient la plus grande partie des prisonniers. Et Dieu avait fait en cela une chose vraiment admirable. Avant la prise de Marrah, et lorsque nous exposions au peuple ; ainsi que nous l'avons rapporté, les ordres des saints apôtres Pierre et André, Boémond et ses compagnons se moquaient de nous. Aussi lui et ceux qui étaient avec lui, loin d'être utiles dans le combat, nous furent plutôt nuisibles. Mais comme ils avaient en même temps la plus grosse part du butin, quelques hommes de la maison du comte en étaient extrêmement indignés. Les seigneurs eux-mêmes ne s'accordaient pas mieux entre eux, parce que le comte voulait donner la ville à l'évêque d'Albar, et que Boémond ne voulait pas remettre certaines tours qui s'étaient livrées à lui, disant : Tant que le comte ne me remettra pas les tours d'Antioche, je ne consentirai à rien.
Cependant les chevaliers et le peuple en vinrent bientôt à demander quand il plairait aux princes de se remettre en route. Quoique notre voyage fût entrepris depuis bien longtemps, il nous semblait tous les jours que nous ne faisions que le commencer, puisqu'il n'était point encore terminé. Boémond disait qu'il fallait remettre jusqu'à Pâques, et nous étions alors au temps de la Nativité du Seigneur. En outre beaucoup des nôtres étaient désespérés, parce qu'il y avait très peu de chevaux dans l'armée, que le duc était absent, et qu'un grand nombre de chevaliers s'étaient rendus auprès de Baudouin à Roha. C'est pourquoi il en partit encore beaucoup d'autres. Enfin l'évêque d'Albar et quelques nobles se rassemblèrent avec le peuple des pauvres et appelèrent le comte. Lorsque l'évêque eut fini son discours, les chevaliers et tout le peuple se prosternèrent devant le comte, et le supplièrent, en versant beaucoup de larmes, de se faire le conducteur et le seigneur de l'armée, lui à qui le Seigneur avait confié sa lance, ajoutant qu'il n'avait reçu la lance du Seigneur qu'afin que, si les autres princes venaient à manquer, lui-même s'appuyant sur ce grand bienfait du Seigneur, ne redoutât point de se porter en avant avec le peuple en toute sécurité. Qu'autrement, il n'avait qu'à remettre la lance au peuple, et que le peuple irait bien à Jérusalem, sous la conduite même du Seigneur. Or le comte hésitait encore à cause de l'absence des autres princes, craignant, s'il voulait fixer un jour à lui tout seul, que les autres, par jalousie, ne voulussent pas le suivre. Mais enfin le comte fut vaincu par les larmes des pauvres, et désigna le quinzième jour pour celui du départ. Mais aussitôt Boémond, indigné, ordonna de proclamer dans la ville que le cinquième ou le sixième jour serait celui où l’on se remettrait en route, et, après cela, il retourna à Antioche. Le comte chercha alors avec l'évêque comment il pourrait conserver la ville, et quels hommes et combien d'hommes il pourrait y laisser pour la garder.
Cependant le comte manda au duc de Lorraine et aux autres princes qui notaient point venus à Marrah qu'ils eussent à se réunir en un lieu convenu, afin que tous ensemble pussent s'occuper des choses qui seraient utiles pour le voyage et pour le peuple de Dieu. Ils se réunirent donc à Roha, située à peu près à moitié chemin entre Antioche et Marrah. Mais là, tous les princes, après avoir eu une conférence, se trouvèrent encore plus mal ensemble, car tous se refusaient à poursuivre le voyage, et à cause d'eux un grand nombre d'autres le refusaient aussi. Le comte voulut alors donner au duc dix mille sons, autant au comte Robert de Normandie, six mille au comte de Flandre, cinq mille à Tancrède et aux autres princes, tant qu'ils étaient. Pendant ce temps les pauvres qui étaient demeurés à Marrah, ayant appris que le comte voulait laisser beaucoup de chevaliers et d'hommes de pied de son armée dans cette ville, pour veiller à sa défense, se dirent entre eux : Quoi donc, des contestations au sujet d'Antioche ! des contestations au sujet de Marrah ! en tout lieu que Dieu nous aura donné, y aura-t-il donc des contestations entre les princes, en sorte que l'armée du Seigneur soit de jour en jour réduite ? Certes, il n'y aura plus désormais de procès à l'occasion de cette ville-ci. Venez, renversons ses murailles ; rétablissons la paix entre les princes, et rendons la sécurité au comte, il ne perdra plus cette ville. Alors les faibles et les infirmes se levant de dessus leurs couchettes, et s'appuyant sur des bâtons, se rendirent vers les murailles, et là, ces pierres que trois ou quatre paires de bœufs n'auraient tirées qu'avec beaucoup de peine, un homme épuisé par la faim les poussait sans efforts au pied des remparts, et les faisait rouler au loin. L'évêque d'Albar et les gens de la maison du comte parcouraient la ville, se plaignant de ces désordres, et défendant de continuer, mais dès que les gardiens avaient passé, les autres qui s'étaient cachés, ou avaient fui à l'apparition de l'évêque et de ses compagnons, revenaient aussitôt, et recommençaient leur travail de destruction. Ceux qui n'osaient s'y livrer pendant le jour, ou ne le pouvaient à cause de la surveillance, y employaient toute la nuit, et à peine se trouva-t-il, dans le peuple un homme trop faible ou trop infirme pour ne pas s'adonner à cette œuvre.
Dans ce même temps, l'armée souffrait d'une si grande famine, que le peuple dévorait avec avidité un grand nombre de cadavres Sarrasins déjà tout puants, et qui avaient demeuré deux semaines, et même plus, dans les fossés de la ville. Ce spectacle jeta l'épouvante chez beaucoup de gens, tant de notre race que de celle des étrangers, Aussi, parmi les nôtres, un grand nombre s'en retournaient désespérant du succès du voyage, s'il ne venait de nouveaux secours de la race des Francs. De leur côté, les Sarrasins et les Turcs disaient entre eux : Qui donc pourra résister à ce peuple, tellement obstiné et cruel que, pendant un an, ni la famine, ni le glaive, ni aucun autre péri], n'ont pu le faire renoncer au siège d'Antioche, et que maintenant il se nourrit de la chair humaine ? Tels étaient les propos, et d'antres du même genre, que les païens tenaient sans cesse sur notre compte ; car Dieu nous avait rendus un objet de terreur à toutes les nations, mais nous ne le savions pas.
Le comte, cependant, revenu à Marrah après sa conférence avec les princes, fut saisi d'une grande colère contre le peuple, au sujet de la destruction des murailles ; mais lorsqu'on lui eut rapporté que l'évêque, non plus que les autres princes, n'avaient pu réussir à détourner le peuple de son entreprise, soit en menaçant, soit en frappant, il reconnut sur-le-champ l'effet de la volonté divine, et donna l’ordre de renverser de fond en comble ces murailles. En même temps la famine augmentait de jour en jour. Comme le moment assigné pour le départ était près d'arriver, nous ordonnâmes que le peuple présentât ses aumônes et ses prières à Dieu pour le succès du voyage. Le comte voyant qu'aucun des princes les plus considérables ne venait se réunir à lui, et que le peuple dépérissait de plus en plus, donna l’ordre de le conduire dans les campagnes pour chercher des vivres, et lui-même se porta en avant avec ses chevaliers : mais cette résolution ne fut point agréable à quelques-uns de ses familiers, qui disaient : Il y a dans l'armée tout au plus trois cents chevaliers ; d'ailleurs le nombre des hommes armés n'est pas considérable : les uns iront-ils à l'expédition tandis que les autres demeureront ici dans cette ville détruite, et qui n'a plus de fortifications ? Et ils blâmaient l'excessive légèreté du comte. Celui-ci cependant partit dans l'intérêt des pauvres, se rendit maître de beaucoup de châteaux, fit un grand nombre de prisonniers, et enleva un riche butin. Tandis qu'il revenait victorieux et se livrant aux transports de la joie après avoir tué beaucoup de Sarrasins, six ou sept de nos pauvres furent pris et tués par les païens, et tous, lorsqu'ils furent morts, se trouvèrent avoir des croix sur l'épaule droite. Le comte et ceux qui étaient avec lui ayant vu cela, rendirent toutes sortes d'actions de grâces au Dieu tout-puissant qui s'était souvenu de ses pauvres, et tous furent infiniment fortifiés par cette pensée. Aussi, et afin de donner satisfaction à ceux qui étaient demeurés à Marrah pour garder les bagages, les nôtres transportèrent un de ces hommes qui respirait encore, et nous vîmes en lui une chose vraiment admirable. A peine cet homme avait-il dans tout son corps un point où son âme pût encore demeurer cachée, et cependant il vécut sept ou huit jours sans prendre de nourriture, prenant à témoin Jésus devant lequel il allait paraître en jugement, et affirmant, sans hésitation, que Dieu était l'auteur de la croix qu'il portait. Ainsi fortifiés par le produit du butin et par cette apparition de la croix, les nôtres déposèrent leurs dépouilles dans un certain château qui s'appelait. Capharda, situé sur la route, à quatre lieues de Marrah ; et comme ils avaient laissé leurs compagnons dans cette ville, ils y retournèrent avec le comte, au jour fixé, et après que l'on eut brûlé la ville on se remit en route. Le comte marcha en avant pieds nus, avec ses clercs et l'évêque d'Albar, tous implorant la miséricorde de Dieu et la protection des saints. Tancrède nous suivit avec quarante chevaliers, et beaucoup d'hommes de pied. Lorsque les nobles rois de cette terre d'Arabie eurent appris notre marche, ils envoyèrent présenter à nos comtes leurs supplications et beaucoup de présents, disant qu'ils voulaient, dès ce moment et par la suite, devenir leurs tributaires, qu'ils apporteraient des vivres gratis, et feraient le commerce avec nous. Ayant donc reçu leurs serments pour gage de sécurité, et des otages pour nous conduire, nous poursuivîmes notre marche. Le roi de Césarée nous donna des guides, qui, dès le premier jour, nous dirigèrent mal, à ce qu'il nous parut ; car nous trouvâmes, au lieu où nous nous arrêtâmes, une grande disette de toutes choses, excepté d'eau. Le second jour ces mêmes guides nous firent entrer imprudemment dans une certaine vallée où les troupeaux du roi et de toute la contrée s'étaient réfugiés par suite de la frayeur que nous inspirions car le roi avait su, longtemps auparavant, que nous arriverions dans son pays, et donné l'ordre à tous les Sarrasins de fuir devant nous. S'il leur eût prescrit au contraire de venir à notre rencontre, ils n'en auraient rien fait. Ce même jour Raimond de l'Isle et ses compagnons prirent un Sarrasin porteur de lettres du roi à tous les gens du pays pour leur ordonner de fuir devant nous. Lorsque ces choses furent connues du roi, il dit : Je vais en effet prescrit à tous mes hommes de fuir, autant qu'ils le pourraient, devant la face des Francs ; mais ceux-ci sont venus à eux : je vois que Dieu a élu cette race, c'est pourquoi qu'elle fasse tout ce qu'elle voudra, je ne lui serai point contraire. Alors ce roi lui-même bénit Dieu qui pourvoit abondamment aux besoins de ceux qui le craignent. Voyant une abondance si subite et si complète, nos chevaliers et un grand nombre d'hommes forts parmi le menu peuple, prenant alors tout leur argent, se rendirent à Césarée et à Camela pour acheter de beaux chevaux arabes, disant : Puisque Dieu prend soin de notre nourriture, nous, prenons soin de ses pauvres et de ses chevaliers. Et par ce moyen il arriva que nous eûmes jusqu'à mille chevaux de trait excellents. De jour en jour nos pauvres recouvraient la santé, nos chevaliers se rassuraient et prenaient des forces, et ainsi notre armée se multipliait. Plus nous nous portions en avant, et plus Dieu nous accordait de plus grands bienfaits. Quoique nous eussions toutes choses en suffisance, quelques hommes parvinrent à engager le comte à se détourner un peu de sa route, comme pour aller à Gibel, ville située sur les bords de la mer ; mais Tancrède et plusieurs autres hommes braves et forts empêchèrent l'exécution de ce projet en disant : Dieu a visité le peuple.de ses pauvres, et nous, devons-nous nous détourner de notre route ? Qu'il nous suffise de nos fatigues passées devant Antioche, des combats et du froid, de la famine et de toutes les misères que nous avons eu à supporter. Voulez-vous donc conquérir le monde à vous seuls ? Détruirons-nous tous les habitants du monde ? Voici, de cent mille chevaliers, à peine nous en reste-t-il mille ; de deux cent mille hommes de pied armes et plus, maintenant il n'y a pas plus de cinq mille hommes armés, attendrons-nous que nous soyons tous anéantis ? Viendra-t-il d'autres hommes de notre pays, parce qu'ils apprendront que nous avons pris Antioche et Gibel, et que les autres villes des Sarrasins sont à nous ? Allons à Jérusalem pour laquelle nous sommes venus, et en vérité Dieu nous la donnera. Et alors, par le seul effet de la crainte que l'on aura de ceux qui viendront de notre pays et des autres pays, les autres villes, telles que Gibel, Tripoli, Tyr et Accon, qui se trouvent sur notre route, seront abandonnées par les habitants.
Tandis que nous nous portions toujours plus avant, des Turcs et des Arabes marchaient à la suite de notre armée, et massacraient et dépouillaient ceux de nos pauvres qui, dans leur faiblesse, ne pouvaient marcher aussi vite, et demeuraient en arrière. Après que de pareils accidents furent arrivés une première et une seconde fois, le jour suivant le comte se plaça dans une embuscade, jusqu'à ce que toute l'armée eût défilé. Les ennemis, encouragés par l'impunité et par l'espoir du butin, marchèrent à sa suite, selon leur coutume, mais lorsqu'ils eurent dépassé le lieu de l'embuscade, les nôtres sortirent tout à coup de leur retraite avec le comte, attaquèrent les escadrons ennemis, les mirent en désordre et les massacrèrent ; puis ils leur enlevèrent leurs meilleurs chevaux, qui furent ramenés par eux à notre armée, au milieu des plus grands transports de joie. Après cela on ne vit plus les ennemis s'avancer à notre suite, car le comte marchait toujours derrière les hommes faibles, avec une troupe de chevaliers bien armés. Les autres chevaliers, également bien armés, se portaient fréquemment en avant de l'armée, avec le comte de Normandie, Tancrède et l'évêque d'Albar, afin que les ennemis ne pussent nous inquiéter par leurs attaques imprévues, en avant ou en arrière de nous. Le comte n'ayant qu'un petit nombre de chevaliers, lorsqu'il partit de Marrah, avait demandé à l'évêque d’Albar de laisse une garde dans cette ville, et de marcher avec lui. L'évêque donc y laissa sept chevaliers et trente hommes de pied avec Guillaume Pierre, de Similiac, l'un de ses chevaliers, homme fidèle et dévoué à Dieu, qui fit si bien prospérer les affaires de l'évêque, avec l'aide du Seigneur, qu'en peu de temps il en décupla la valeur, et qu'il eut bientôt avec lui soixante et dix hommes de pied au lieu de trente, et soixante chevaliers et même plus.
En ce temps, on tint conseil au sujet de la route que nous avions à suivre, et l'on résolut de quitter celle qui conduit à Damas, et de se diriger vers les bords de la mer, afin que, si les navires que nous avions laissés dans le port d'Antioche venaient nous rejoindre, nous pussions, par leur intermédiaire, entretenir des relations de commerce avec File de Chypre et les autres îles. Tandis que nous poursuivions notre route, ainsi qu'il avait été arrêté, les habitants du pays quittaient leurs villes, leurs châteaux, leurs campagnes, y laissant toutes sortes de richesses. Ayant donc tourné de grandes montagnes, nous arrivions dans une certaine vallée extrêmement fertile, lorsque certains paysans, fiers de leur multitude et des fortifications de leur château, ne voulurent ni envoyer auprès de nous pour demander la paix, ni nous abandonner leur fort. Ils attaquèrent même nos écuyers et des hommes de pied, qui n'avaient pas d'armes et parcouraient les campagnes pour chercher des vivres, et en ayant tué quelques-uns, ils envoyèrent leurs dépouilles dans leur citadelle. Remplis d’indignation, les nôtres se dirigèrent vers ce château, et les paysans n'hésitèrent point à se porter à leur rencontre jusqu'au pied de la montagne, sur laquelle il était situé. Alors les nôtres ayant tenu conseil formèrent leurs corps d'hommes de pied et de chevaliers, et, s'avançant par trois côtés à la fois, ils gravirent sur le revers de la montagne, poussant les paysans devant eux et les forçant à se retirer. Les Sarrasins étaient trente mille environ, et leur château se trouvait placé sur la pente d'une montagne très élevée, en sorte que lorsqu'ils le voulaient, ils se réfugiaient dans l'intérieur de ce château, tandis que d'autres occupant des points plus élevés, résistaient pendant quelque temps aux nôtres. Enfin nous nous mîmes à proférer notre cri de ralliement accoutumé dans les grandes occasions, Dieu nous aide, Dieu nous aide ! et nos ennemis en furent tellement troublés, qu'une centaine d'entre eux tombèrent morts à la porte même du château, sans avoir reçu aucune blessure, et par le seul effet de leur frayeur et de la foule qui se précipitait sur eux. Il y avait en dehors du château une grande quantité de bœufs, de chameaux et de moutons, et notre peuple s'occupait à les enlever. Tandis que le comte continuait à combattre avec quelques chevaliers, nos pauvres s'étant emparés du butin commencèrent à revenir l'un après l'autre, d'abord les hommes, de pied, et ensuite les chevaliers plébéiens. Nos tentes avaient été dressées loin du château, et à dix milles environ. Le comte, sur ces entrefaites, ordonna que les chevaliers et les hommes de pied prissent position. Les Sarrasins, tant ceux qui s !étaient portés sur la montagne la plu élevée, que ceux qui occupaient le château, voyant alors que la plupart des nôtres s'étaient retirés, commencèrent à chercher les moyens de se réunir, et le comte sans y prendre garde, se trouva bientôt presque entièrement abandonné par ses chevaliers. La partie de la montagne sur laquelle se trouvait le château était roide et couverte de pierres, et il n'y avait qu'un sentier escarpé, le long duquel les chevaux pouvaient tout au plus marcher à la suite l'un de l'autre. Embarrassé au milieu de ces difficultés, le comte continua à s'avancer avec ceux qui le suivaient, comme pour se porter vers ceux qui étaient descendus du haut de la montagne, et leur livrer combat, et ceux-ci ne doutèrent pas que le comte ne les eût bientôt rejoints. Mais alors les nôtres rebroussèrent chemin, et se remirent à descendre vers la vallée, se croyant presque en sûreté. Trompés dans leur attente, et voyant les nôtres descendre tranquillement, les Sarrasins, tant ceux du haut de la montagne que ceux du château, s'élancèrent en même temps sur les nôtres ; et, dans cette occurrence, quelques-uns des nôtres sautèrent à bas de leurs chevaux, d'autres se jetèrent dans les précipices et n'échappèrent à la mort qu'à travers les plus grands périls ; quelques-uns succombèrent en combattant vigoureusement. La seule chose que nous sachions positivement, c'est que jamais le comte ne s'est trouvé dans un plus grand danger. Irrité contre lui-même et contre les siens, il rejoignit l'armée, convoqua le conseil, et se plaignit vivement de ceux des chevaliers qui s'en étaient allés sans en avoir obtenu la permission, et l'avaient ainsi exposé à là mort. Tous promirent alors de ne point abandonner le siège de ce château, jusqu'à ce qu'il pût être renversé de fond en comble par la grâce de Dieu ; Mais Dieu qui les conduisait, afin qu'ils ne fussent point retenus par de viles occupations, répandit l'épouvante durant là nuit parmi les habitants du château, à tel point qu'ils prirent précipitamment la fuite, sans se donner même le temps d'ensevelir leurs morts. Le matin, lorsque nous y fûmes arrivés, nous ne trouvâmes plus que des dépouilles, et le fort était entièrement vide d'habitants.
Nous avions en ce temps-là auprès de nous des députés de l'émir de Camela, du roi de Babylone et du roi de Tripoli. Ceux-ci ayant vu l'extrême audace et la force des nôtres, demandèrent au comte la permission de s'en aller, promettant très positivement de revenir. Ils partirent donc avec quelques-uns de nos hommes et revinrent peu après avec de grands présents et beaucoup de chevaux. Le siège de ce château, qui jusqu'alors n'avait pu être pris par personne, avait répandu la terreur dans toute la contrée. Aussi les habitants du pays adressèrent-ils au comte des supplications et de riches présents, lui demandant avec de vives instances de leur envoyer ses bannières et son sceau, jusqu'au moment où il pourrait faire prendre possession de leurs villes et de leurs châteaux.
Il était en effet d'usage dans notre armée, dès que la bannière d'un Franc était arborée sur une ville ou sur un château, que nul autre de la même race n'allât l'attaquer. En conséquence, le roi de Tripoli fit dresser les bannières du comte dans ses châteaux. Le nom de ce dernier était si fameux qu'il ne se trouvait inférieur à nul autre. Nos chevaliers envoyés à Tripoli y ayant vu des richesses royales, un pays abondant en toutes choses, une ville extrêmement peuplée, persuadèrent au comte d'aller assiéger le château d'Archas, place très forte et inexpugnable, disant qu'au bout de quatre ou cinq jours il recevrait du roi de Tripoli tout l'or et l'argent qu'il pourrait désirer. Conformément aux intentions de ces chevaliers, nous allâmes donc assiéger ce fort devant lequel nos hommes les plus braves eurent à supporter plus de fatigues que jamais. Nous y perdîmes en outre tant et de si illustres chevaliers, que le récit seul en est déplorable. Là fut tué le seigneur Pons de Balazun par une pierre lancée d'une machine. Je le recommande aux prières de tous les hommes orthodoxes, particulièrement de ceux d'au-delà des Alpes, et de vous, vénérable pontife du Vivarais, pour qui j'ai entrepris d'écrire tout ceci. Maintenant ce qui m'en reste à rapporter, je continuerai à l'écrire sous l'inspiration de Dieu qui a fait toutes ces choses, avec la même constance qui m'a animé jusqu'à présent. Je prie donc et je supplie instamment tous ceux qui l'entendront de croire que les choses sont telles que je.les dirai. Que si je cherche à écrire quelque chose au-delà de ce qui a été cru ou vu, ou si j'ai fait quelque supposition en haine de qui que ce soit, que Dieu me frappe de toutes les plaies de l'enfer et m’efface du livre de vie ; car, quoique j'ignore une foule d'autres choses, je sais du moins ceci, qu'ayant été promu au sacerdoce durant le pèlerinage du Seigneur, je dois bien plutôt obéir à Dieu, en attestant la vérité, que chercher à capter les dons de tout autre en forgeant des mensonges. Mon très chéri Pons de Balazun mourut donc, ainsi que je l'ai déjà dit, dans le sein du Seigneur, devant le château d'Archas : mais comme, selon les paroles de l'Apôtre, la charité ne périt jamais[8] je veux continuer mon ouvrage dans les mêmes sentiments de charité, et que Dieu me soit en aide.
Quelque temps après que nous eûmes commencé ce siège, nos navires arrivèrent d'Antioche et de Laodicée avec beaucoup d'autres navires de Vénitiens et de Grecs, tous portant du froment, du vin, de l'orge, de la viande de porc et beaucoup d'autres marchandises. Mais comme la citadelle d'Archas était située à un mille de la mer, et que les matelots ne surent où aborder, ils s'en retournèrent dans le port de Laodicée et dans celui de Tortose. Cette ville de Tortose, extrêmement bien fortifiée, garnie de murailles et d'ouvrages avancés, et remplie de toutes sortes de richesses, avait été abandonnée par ses habitants Sarrasins, dans la frayeur qu'ils avaient conçue de notre armée, car Dieu avait répandu une si grande terreur parmi les Sarrasins et les Arabes de ce pays, qu'ils croyaient que nous pouvions toutes choses et que nous voulions les exterminer. Ceci s'était passé avant que nous eussions commencé le siège d'Archas.
Cependant Dieu ne voulut point faire prospérer ce siège, parce que nous l'avions entrepris contre la justice et dans d'autres vues que pour l'amour de lui ; en conséquence, il nous envoya toutes sortes d'adversités. Et il est remarquable que, tandis que, dans les autres combats ou assauts, nous étions tous toujours prêts ; au combat et bien disposés, ici, au contraire, tous se trouvaient lâchés, ou leurs efforts ne produisaient aucun résultat. Si quelques-uns voulaient tenter quelque entreprise avec plus d'ardeur, ils étaient eux-mêmes blessés ou leurs projets déjoués. Là Anselme de Ribourgemont partit glorieusement pour une autre vie. S'étant levé le matin, il appela les prêtres auprès de lui, se confessa.de ses omissions et de ses péchés, et demanda miséricorde à Dieu et aux prêtres, annonçant à ceux-ci que la fin de sa vie était proche. Et comme les prêtres s'étonnaient de ses paroles, parce qu'ils le voyaient sain et bien portant, il leur dit : Ne vous étonnez pas, mais écoutez-moi plutôt. Cette nuit j'ai vu le Seigneur Engelram de Saint-Paul qui a été tué à Marrah, et je l'ai vu non point en songe, mais étant éveillé. Et je lui ai dit : Qu'est-ce donc ? vous étiez mort, et voici maintenant vous vivez ! Et il m'a répondu : Certes ils ne meurent point ceux qui ont terminé leur vie au service du Christ. Et comme je lui demandais de nouveau d'où lui était venue son excessive beauté, il me répondit : Tu ne dois point t'étonner de ma beauté, parce que j'habite une très belle maison. Et aussitôt il me montra dans le ciel une maison tellement belle, que je ne crois pas qu'il y ait rien de plus beau. Et comme je demeurais frappé de stupeur en voyant l'éclat de cette maison, il me dit encore : On t'en prépare une beaucoup plus belle d'ici à demain. Et à ces mots il disparut.
Il arriva ce même jour, après qu'il eut raconté ces choses à plusieurs personnes, qu'Anselme se mit en marche pour aller combattre les Sarrasins. Ceux-ci sortant en cachette de leur fort, avaient coutume de s'avancer jusque vers nos tentes pour chercher à nous enlever quelque chose ou à faire du mal à quelqu'un des nôtres. Ce jour-là le combat s'étant engagé vivement des deux parts, Anselme, après avoir résisté avec vigueur, fut frappé à la tête par une pierre lancée d'une machine, et sortit ainsi de ce monde pour aller habiter le lieu que Dieu lui avait préparé. Nous reçûmes alors un député du roi de Babylone qui nous renvoyait en même temps tous ceux que nous lui avions adressés, après les avoir retenus captifs pendant un an, dans l'incertitude où il était s'il ferait la paix avec nous ou avec les Turcs. Nous avions voulu traiter avec lui et convenir que s'il nous prêtait secours pour prendre Jérusalem, ou s'il nous livrait cette ville avec ses dépendances, nous lui rendrions toutes les villes que les Turcs lui avaient enlevées à mesure que nous les prendrions, et que nous partagerions avec lui toutes les villes des Turcs qui ne faisaient pas partie de son royaume, si nous pouvions avec son secours parvenir à nous en rendre maîtres. Les Turcs, de leur côté, et selon ce qui nous a été rapporté, avaient voulu convenir avec lui que s'il marchait contre nous, ils adoreraient Ali que lui-même adore, et qui est de la race de Mahomet, qu'en outre ils adopteraient sa monnaie, lui paieraient tribut, et feraient en outre beaucoup d'autres choses, dont je ne sais pas positivement le détail. Le roi de Babylone savait, pour ce qui nous concerne, que nous étions peu nombreux, et que l'empereur Alexis était notre mortel ennemi ; car, à la suite de la bataille que nous livrâmes à ce même roi de Babylone auprès d'Ascalon, nous trouvâmes dans sa tente même des lettres que l'empereur Alexis lui avait écrites sur notre compte ; et tels étaient les motifs pour lesquels il avait retenu nos députés captifs pendant un an dans les murs de Babylone. Mais ensuite, ayant appris que nous étions entrés sur son territoire, et que nous dévastions les habitations des campagnes et les champs, il nous manda que nous eussions à nous rendre sans armes à Jérusalem, par troupes de deux ou trois cents, et à en repartir après avoir adoré le Seigneur. Mais nous nous moquâmes de ses propositions, espérant en la miséricorde de Dieu, et nous le menaçâmes, s'il ne nous livrait Jérusalem sans condition, de détruire sa ville de Babylone. A cette époque, en effet, un de ses émirs occupait Jérusalem. Lorsque ce roi eut appris que les Turcs avaient été vaincus par nous devant Antioche, il assiégea Jérusalem, sachant que les Turcs, tant de fois battus et mis en fuite par nous, ne viendraient pas s'opposer à son entreprise. Enfin, après avoir donné de très beaux présents à ceux qui la défendaient, il prit possession de la ville de Jérusalem, et offrit des cierges et de L'encens au sépulcre du Seigneur et sur le mont Calvaire.
Je reviens maintenant au siège d'Archas. Tandis que notre armée faisait les plus grands efforts devant cette place, ainsi que je l'ai déjà dit, nous fûmes informés que le pape des Turcs s'avançait pour nous combattre ; et comme il était de la race de Mahomet, qu'il traînait à sa suite des peuples innombrables, on nous ordonna donc aussitôt de nous préparer pour le combat. On envoya l'évêque d'Albar au duc et au comte de Flandre qui avaient mis le siège devant Gibel, château situé sur les bords de la mer, à peu près à égale distance d'Antioche et d'Archas et à deux journées de marche de chacune de ces villes. Ces princes ayant reçu notre message, abandonnèrent leur siège et vinrent en hâte nous rejoindre. On apprit cependant la fausseté de la nouvelle qu'on nous avait rapportée, et l'on sut que les Sarrasins l'avaient inventée, afin de nous effrayer par de telles menaces et de procurer quelques instants de repos à ceux qui étaient assiégés dans Archas. Les armées ainsi réunies, ceux de l'armée du comte eurent à montrer leurs beaux chevaux arabes et les richesses que Dieu leur avait accordées dans le pays des Sarrasins, parce qu'ils s'étaient exposés à la mort pour l'amour de lui, et les autres ne pouvaient montrer que leur pauvreté, On prêcha alors que le peuple eût à donner la dîme de toutes les choses qu'il avait prises, parce qu'il y avait dans l'armée beaucoup de pauvres et de malades, et l'on prescrivit que le quart de ces dîmes fût donné par eux à ceux de leurs prêtres qui leur disaient la messe, le second quart aux évêques, et le reste en deux portions à Pierre l'Ermite, que l'on avait préposé au soin des pauvres, tant du clergé que du peuple : c'est pourquoi il devait recevoir deux portions, dont l’une était affectée aux pauvres du clergé, et l'autre aux pauvres du peuple. Ainsi Dieu enrichissait notre armée en chevaux, en mulets, en chameaux et en toutes les choses nécessaires à la vie, au point que nous-mêmes en étions tout étonnés et frappés de stupeur. Mais cette extrême abondance fit naître les querelles et l'orgueil parmi les princes, si bien que ceux qui chérissaient Dieu du fond de leur cœur, désiraient pour nous la pauvreté et les chances terribles de la guerre.
[1] Histoire littéraire de la France, par les Bénédictins, t. viii, p. 622-628.
[2] Psaume 23, v. 8.
[3] Ou Accien, ou Darsien.
[4] Kerbogha. Guillaume de Tyr le nomme Corbogath.
[5] Psaume 4, v. 1.
[6] Première Epître de Saint-Pierre, ch. V, v. 6.
[7] Psaume 143, v. 15.
[8] Ier Épître de saint Paul aux Corinthiens, chap. xiii, v. 8.