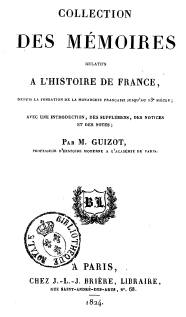
GUILLAUME DE PUY-LAURENS
L’HISTOIRE DE L’EXPÉDITION DES FRANÇAIS CONTRE LES ALBIGEOIS.
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
|
|
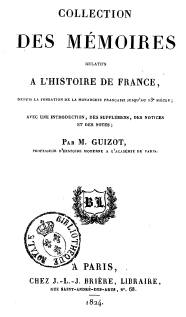
GUILLAUME DE PUY-LAURENS
L’HISTOIRE DE L’EXPÉDITION DES FRANÇAIS CONTRE LES ALBIGEOIS.
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
COLLECTION
DES MÉMOIRES
RELATIFS
A L'HISTOIRE DE FRANCE,
depuis la fondation de la monarchie française jusqu'au 13e siècle
AVEC UNE INTRODUCTION DES SUPPLÉMENS, DES NOTICES ET DES NOTES;
Par M. GUIZOT,
PROFESSEUR D'HISTOIRE MODERNE A L’ACADÉMIE DE PARIS.

A PARIS,
CHEZ J.-L.-J. BRIÈRE, LIBRAIRE,
RUE SAINT-ANDRÉ-DES-ARTS, N°. 68.
1824.
.
DE
CONTENANT
L’HISTOIRE DE L’EXPÉDITION DES FRANÇAIS
CONTRE LES ALBIGEOIS.
Comme, parmi les faits qui se sont passés depuis un siècle environ, il faut, entre tous ceux qui ont eu lieu de ce côté-ci des mers en Europe, tenir pour grandement digne de mémoire l’entreprise formée pour la défense de la foi catholique et l’extirpation de l’hérétique méchanceté dans la province de Narbonne et d’Arles, dans les diocèses de Rodez, de Cahors, d’Agen, et certaines autres terres du seigneur comte de Toulouse, au-delà du Rhône, laquelle on sait avoir à peine pris fin après un laps de soixante-dix années; j’ai fait dessein de laisser par écrit à la postérité quelques-unes des choses que j’ai vues moi-même, ou recueillies de près, afin que puissent les grands, moyens et petits, comprendre, par ce qui s’est passé, les jugements dont Dieu voulut frapper ces malheureuses contrées à cause des péchés du peuple. Et, bien que j’aie dit les péchés du peuple, je n’en exclus point la négligence des prélats et des princes, pour qu’à l’avenir ils prennent garde que l’ennemi ne jette derechef l’ivraie sur la bonne semence, maintenant que le champ a été, par si grand labeur, rendu à saine culture, avec de si prodigieuses dépenses, et après si large effusion de sang humain.
En effet, durant que dormaient jadis ceux qui auraient dû veiller, le vieil ennemi introduisit secrètement en ces pays misérables des hommes, fils de perdition, ayant de vrai quelque apparence de piété, mais en abjurant au fond la virtuelle essence, desquels les discours, comme un chancre qui gagne de proche en proche, infectèrent et séduisirent un grand nombre, tellement que personne ne se tenant sur la muraille pour s’opposer, en faveur de la foi, à qui l’assaillait, les hérétiques tirèrent si bon parti de leurs efforts, qu’ils commencèrent à avoir par les villes et bourgs des lieux où s’héberger, des champs et des vignes et très amples maisons où ils prêchaient publiquement et prônaient les hérésies à leurs adeptes. Or, il y en avait qui étaient Ariens, d’autres Manichéens d’autres même Vaudois ou Lyonnais; lesquels, bien que dissidents entre eus, conspiraient tous néanmoins, pour la ruine des âmes, contre la foi catholique (et disputaient ces Vaudois très subtilement contre les autres; d’où vient qu’en haine de ceux-là, ceux-ci étaient admis par des prêtres imbéciles); si bien que toute cette terre, réprouvée qu’elle était, et tout près de la malédiction, ne poussait guère plus qu’épines et chardons, ravisseurs et routiers, larrons, homicides, adultères et usuriers manifestes.
D’abondant, les capelans[1] étaient auprès des laïques en si grand mépris, que leur nom était par plusieurs employé en jurement, comme s’ils eussent été juifs. Ainsi, de même qu’on dit: j’aimerais mieux être juif; ainsi, disait-on: J’aimerais mieux être capelan que faire telle ou telle chose. Les clercs aussi, quand ils paraissaient en public, cachaient la petite tonsure qu’ils portent près du front avec les cheveux du derrière de la tête; d’autant que les hommes d’armes n’offraient que rarement leurs fils à la cléricature, mais présentaient aux églises, dont alors ils percevaient les dîmes, les enfants de leurs vassaux; et les évêques recevaient aux saints ordres ceux qu’ils pouvaient trouver, suivant les circonstances du temps. Davantage, les hommes d’armes eux-mêmes, méprisant toute domination, au gré de leur bon plaisir, adhéraient, sans que nul l’empêchât, à telle ou telle secte hérétique; et les hérétiques étaient en si grande révérence qu’ils avaient des cimetières où ils enterraient publiquement ceux qu’ils avaient pervertis, en recevant lits garnis et vêtements, et legs plus abondants que les gens d’Eglise: voire n’étaient-ils astreints à guet et gardes, ni tailles. Enfin, si quelque homme de guerre, marchant avec eux, était pris par des ennemis, il ne lui arrivait point mal.
Ainsi donc, par leur moyen, Satan possédait en repos la majeure partie de ce pays comme un sien domicile, car les ténèbres s’y étaient logées, la nuit d’ignorance le couvrait; et s’y promenaient librement les bêtes de la forêt du diable.
Un religieux, savoir saint Bernard, abbé de Clairvaux, homme illustré de mœurs et docte dans les lettres, enflamme du zèle de la foi, visita jadis les contrées que travaillait le mal d’une si grande infidélité, et crut bon de venir vite au château de Vertfeuil où verdissaient en ce temps les rejetons d’une nombreuse noblesse et multitude vulgaire, comprenant que, s’il pouvait éteindre l’hérétique perversité dans ce lieu où elle s’était fort répandue, il lui serait plus facile de prévaloir ailleurs contre elle. Comme donc il eut commencé de prêcher dans l’église contre ceux qui en ce lieu étaient les plus considérables, ils sortirent de l’église et le peuple les suivit: mais le saint homme, sortant après eux, se prit à débiter sur la place publique la parole de Dieu: les nobles alors se cachèrent de toutes parts dans leurs maisons, et lui de continuer à prêcher le menu peuple qui l’entourait. Sur quoi, les autres faisant tapage et frappant sur les portes, de façon que la foule ne pouvait entendre sa voix, et de la sorte arrêtant la parole divine, lui pour lors, ayant secoué la poussière de ses pieds en témoignage contre eux, et comme pour leur déclarer qu’ils n’étaient que poussière et qu’ils retourneraient en poussière, se départit du milieu d’eux, et regardant la ville, il la maudit en disant: « Vertfeuil, que Dieu te dessèche ! » Chose qu’il annonçait sur de manifestes indices; car en ce temps (ainsi que le rapporte un vieux récit) il y avait dans ce château cent chevaliers à demeure, ayant armes, bannières et chevaux, et s’entretenant à leurs propres frais, non aux frais d’autrui; lesquels dès ce moment furent maintes et maintes fois assaillis par misère et gens de guerre, si bien que la grêle fréquente, la stérilité, guerre ou sédition ne leur permirent de prendre repos, même pour un peu. Moi-même, en mon enfance, ai vu le noble homme dom Isarn Nebulat, anciennement principal seigneur de Vertfeuil, et qu’on disait vieillard centenaire, vivre très pauvrement à Toulouse, et se contenter d’un seul roussin. Au demeurant, comment et combien fut-il, par le jugement de Dieu, sévi contre plusieurs seigneurs du même château qui faillirent à sa cause, c’est ce que montre l’évidence même des choses, puisque la malédiction du saint personnage ne put être arrêtée dans ses effets jusqu’à ce que le comte de Montfort ayant donné Vertfeuil au vénérable père dom Foulques, évêque de Toulouse, elle commença dès lors à être petit à petit adoucie, après l’expulsion des seigneurs du lieu, ainsi qu’il se verra plus tard.
A ce propos, je parlerai de cet autre château voisin, ayant nom Lavaur, où le diable s’était, par le moyen des hérétiques, assuré domicile, et dont il avait fait une synagogue de Satan, lequel, en l’an de l’Incarnation dû Seigneur 1170[2] fut assiégé par un certain cardinal[3] envoyé par le pontife Romain, qui força les hérétiques dudit lieu de se rendre à lui. Deux d’entre eux, et c’étaient les principaux furent convertis à la foi catholique, et placés par ce cardinal pour être chanoines, savoir l’un qui s’appelait Bernard Raimond, dans l’église cathédrale de Saint-Étienne de Toulouse, et l’autre dans le monastère de Saint-Sernin; et il me souvient qu’en mon enfance j’entendais appeler celui qui avait été dans l’église cathédrale Bernard Raimond l’Arien toutes fois qu’il était fait mention de lui; je sais même l’avoir vu. Or, ces choses se passèrent longtemps avant que l’armée des croisés arrivât à Béziers (à cause de quoi j’ai cru devoir les rapporter comme faits préparatoires); d’ailleurs la justice de Dieu ne s’endormit point sur la méchanceté des gens de Lavaur peu de temps avant la venue des croisés, alors que Bonfils, l’un des seigneurs de ce château, tua par trahison dans sa chambre, afin de se l’acquérir tout entier, deux siens neveux, enfants d’un feu frère à lui, qu’il avait fait venir sous prétexte d’une feinte maladie, et leur promettant de leur donner des figues de la primeur. En effet, frustré dans le même jour de son méchant dessein, il reçut le talion avec le coup de la mort.
Néanmoins, et malgré ce que j’ai dit plus haut, la fièvre d’hérésie ne baissait point, voire alla-t-elle s’accroissant et gagnant en plusieurs autres lieux (comme le montreront les chapitres suivants) et les fléaux de la vengeance divine suivirent ses progrès à la trace.
Au demeurant, pour amener par ordre le récit que je me propose, je crois devoir commencer la série des faits survenus de nos jours par les comtes toulousains, selon ce qu’en retient notre mémoire lesquels comtes furent en les susdits pays seigneurs principaux, et dont la négligence ou la faute augmenta le mal qui s’y était déclaré, ainsi qu’on le peut conclure de circonstances dont plaise à Dieu que je n’omette aucune ou du moins bon nombre. Si auraient-ils dû mettre tous leurs soins à couper net ce mal (qui peut-être naquit peu à peu quand il se tenait encore caché), du moment que sous leur domination il eut levé la tête et se fut montré au grand jour.
Avant d’aborder mon sujet, et pour qu’on comprenne bien jusqu’à quel point étaient parvenus le péril et le mépris de l’autorité des prélats en ce temps où quiconque pouvait impunément choisir une secte quelconque, je rapporterai ce que j’ai entendu raconter au vénérable père dom Guillaume, évêque d’Albi, de solennelle mémoire. Il disait donc qu’il lui était arrivé autrefois que, s’étant livré au sommeil, il rêvait, et lui paraissait être assis près de Guillaume Pierre de Bérens, lequel était son parent, et se trouvait malade, ainsi qu’il lui semblait. En face de son lit était un four ardent, vers lequel ledit malade faisait mine d’aller; et interpellé par le prélat qui s’y opposait, mais sans pouvoir l’en empêcher, il sortait de sa couche en rampant pour entrer dans le four. Durant que l’évêque était dans l’agonie d’une telle vision, voilà qu’on vient tout-à-coup frapper à la porte de la chambre à coucher où il dormait, et les gens envoyés de nuit vers le prélat lui annoncent que ledit Guillaume est par hasard tombé malade, et qu’il réclame sa présence. Sur-le-champ il se mit en route, et fit hâte, pressé qu’il était par ce qu’il avait vu en songe, d’autant qu’il ignorait auparavant que l’autre fût malade; étant arrivé après trois lieues de marche, il le trouva en très méchant état, s’assit près de son lit, et entre autres raisons du désir que Guillaume avait eu de le voir, fut par lui consulté pour savoir s’il laisserait, à deux fils qu’il avait, son héritage indivis ou non. A quoi le prélat ayant répondu qu’il était plus sûr de partager la succession, de peur que l’un ou l’autre ne revendiquât l’héritage tout entier, s’il restait indivis, le malade acquiesça à cet avis. Telles et autres choses de ce genre ayant enfin été ordonnées, l’évêque demanda audit Guillaume ce qu’il voulait qui fût fait de lui, et s’il désirait être enterré dans le couvent de Gaillac, dans celui de Candeil, ou dans l’église d’Albi. D’abord il répondit qu’il ne se mît point en peine sur ce point, qu’il s’était déjà déterminé à cet égard puis, l’évêque insistant néanmoins pour savoir dans lequel de ces trois endroits il avait choisi le lieu de sa sépulture, il dit qu’il voulait être transporté chez les Bononiens ou Bonosiens, c’est-à-dire chez les hérétiques. Enfin, sur ce que le pontife s’efforçait de l’en dissuader, et lui rappelait qu’il ne pouvait faire une telle chose: Ne vous fatiguez pas davantage, reprit le malade, car si je ne pouvais faire autrement, je courrais à eux en me traînant à quatre pattes. A ces mots, l’évêque l’abandonna comme un homme abandonné de Dieu, d’autant que, malgré son saint caractère, il ne pouvait l’empêcher de faire ce qu’il avait dit. Voilà jusqu’où était parvenue la dépravation hérétique, si bien que l’autorité pontificale ne la pouvait plus réprimer, même dans un parent et un sujet.
Au sujet de l’apostasie dudit Guillaume de Bérens, ce même prélat usa par la suite, ainsi que je lui ai entendu raconter, d’une parabole bien pressante contre l’hérésiarque maître Sicard dit le Célérier, lequel résidait publiquement à Lombers. En effet, un jour qu’il se trouvait dans ce château, les chevaliers et les bourgeois insistèrent auprès de lui pour qu’il daignât avoir un colloque avec leur hérésiarque, et sur ce qu’il leur dit que cette conférence pourrait être inutile, vu que l’hérétique, endurci dans son erreur, ne reviendrait pas facilement à la vérité, ils ne l’en pressèrent pas moins d’entrer en dispute avec lui en leur présence. L’évêque considérant qu’en s’y refusant davantage, ils attribueraient son refus bien plus à la crainte qu’au susdit motif, il consentit à leurs instances; puis s’étant joints, lui et l’hérésiarque, il commença, et lui dit: « Sicard, vous êtes mon paroissien, puisque vous résidez dans mon diocèse; vous me devez donc rendre raison de votre foi; et quand je vous interrogerai, vous devez simplement répondre à mes questions oui ou non. » A quoi l’autre ayant répliqué par la promesse de faire comme on lui demandait: Croyez-vous, lui dit l’évêque, qu’Abel tué par Caïn son frère, Noé enlevé au déluge, Abraham, Moïse, David et les autres prophètes, aient été sauvés avant la venue du Seigneur? —Non, répondit l’hérésiarque avec assurance. Item, le prélat lui ayant demandé s’il croyait que Guillaume Pierre de Bérens, mort dernièrement, fût sauvé, il affirma nettement qu’il l’était, parce qu’il était mort hérétique. Sur ce je dis, reprit l’évêque, qu’il vous est arrivé, Sicard, comme à Guillaume du bourg de Saint Marcel dans notre terre, alors à son retour de sa terre avec le titre de médecin, il déclara que de deux malades qui lui furent présentés, l’un mourrait la nuit suivante et l’autre réchapperait: ce qu’il disait à cause des symptômes qu’il avait vus dans chacun d’eux. Mais comme l’issue fut tout le contraire de ce qu’il avait annoncé, si bien que le condamné guérit, et que l’autre vint à mourir. « Je reconnais, dit le médecin, que j’ai lu tout à rebours, c’est pourquoi je retournerai à l’étude pour relire en droit sens ce que j’ai lu de travers. Pareillement, Sicard, je vous dirai qu’il vous est advenu de lire nos livres à rebours, vous qui condamnez ceux à qui l’écriture et Dieu lui-même rendent témoignage, et qui accordez le salut à un homme qui, si longtemps qu’il a vécu, a fait sa coutume de rapines et de maléfices. Il vous faut donc avant tout lire à droite ce que vous avez lu à gauche jusqu’ici. » Ces mots dits, l’évêque se retira; l’hérésiarque resta muet et confus avec ses croyants, sans pourtant que l’autorité du pontife pût l’empêcher de résider comme par le passé dans sa demeure ordinaire.
Il est tenu pour certain que cet illustre personnage, Raimond, comte de Toulouse, figura en l’an du Seigneur 1098, à la prise d’Antioche, plus à celle de Jérusalem, en l’an du Seigneur 1099; après quoi il assiégea lui-même Tripoli, élevant près de cette ville et sur le bord de la mer, un château qu’on nomme le mont Pèlerin, afin de la battre plus facilement. Durant ce siège, il mourut au service de Jésus-Christ, l’an du Seigneur 1101;[4] son fils Bertrand continua l’entreprise; et sept ans après qu’elle eut été commencée, il reçut Tripoli à composition, en présence et avec le secours du roi de Jérusalem.
Or, il avait un frère cadet, ayant nom Alphonse, lequel, étant retenu captif dans Orange, fut délivré, l’an du Seigneur 1133,[5][6] qui fut homme d’audace, plein de vaillance, et grand de renom; celui-là épousa Constance, fille de Louis, illustre roi de France, dont il eut Raimond, en l’an du Seigneur 1156, puis deux autres fils, savoir, Taillefer et Baudouin ou Baudoyn. Lui-même mourut, et fut enterré à Nîmes dans le cloître de l’église cathédrale, l’an du Seigneur 1194, et de l’âge de son fils aîné le trente-troisième ; lequel, du vivant de son père, avait pris pour femme Béatrix, sœur de Trencavel, vicomte de Béziers, et en eut une fille, qu’il donna en mariage au roi de Navarre (à celui qui gît en l’église de l’hospice de Roncevaux); puis à Pierre Bermond de Sauves, lorsqu’elle fut répudiée du vivant dudit comte son père. Ce dit comte, en l’an du Seigneur 1196,[7] épousa l’illustre dame Jeanne, sœur de Richard, roi d’Angleterre, après la mort de Guillaume, roi de Sicile, son premier mari; laquelle lui donna le dernier comte, le seigneur Raimond, l’an du Seigneur 1196, dont elle accoucha à Beaucaire, au diocèse d’Arles. Sitôt ses relevailles faites, femme qu’elle était pleine de courage et de zèle, et sensible aux injures de son mari, qu’avaient offensé un grand nombre de gens puissants et de chevaliers, elle assiégea le château de Casser, appartenant aux seigneurs de Saint-Félix, et le pressa vivement; mais cela lui servit de peu, vu que quelques-uns des siens fournissaient traîtreusement et en secret des armes aux assiégés, et autres choses nécessaires. Sur quoi elle leva le siège, et même il lui fut à peine possible de sortir du camp, à ce point que les traîtres y ayant mis le feu, les flammes la suivaient et se précipitaient après elle. Outrée d’une telle injure, elle faisait diligence pour joindre son frère, le roi Richard, et lui porter sa plainte; mais l’ayant trouvé morts alors qu’elle-même était enceinte derechef, elle succomba sous le poids d’une double douleur, et fut ensevelie aux pieds de sa mère, Eléonore, reine d’Angleterre, et près de son frère Richard, lequel gisait aux pieds du roi Henri, son père, dans l’église de Fontevrault. Richard et Jeanne sa sœur moururent dans l’an du Seigneur 1199; quant audit comte Raimond, après le décès de Jeanne, il épousa, en l’an du Seigneur 1200, la sœur de Pierre, roi d’Aragon, nommée Éléonore, dont le père Bernard Bérenger, roi d’Aragon, avait trépassé à Perpignan, l’an du Seigneur 1196.[8]
Davantage, à une époque précédente, savoir, l’an du Seigneur 1188, le dixième jour de septembre, à la sixième heure, il y eut une éclipse de soleil grandement terrible et obscure.
En ce temps-là, dom Fulcrand était évêque de Toulouse; et je ne puis rapporter de lui que peu de choses, ayant ouï dire que peu de choses il a faites, sinon, ainsi que je l’ai appris de ses contemporains, qu’il vivait comme un bourgeois, dans le logis épiscopal, du peu de revenus qu’il touchait de ses métairies et de son four; car il ne percevait rien des dîmes que possédaient alors les chevaliers ou les monastères, et les prémices étaient aux capelans qui les prenaient, comme il suit, quand les dîmes étaient payées en grains: le laboureur mettait dans ses granges neuf quarteaux, puis divisait le dixième, et donnait pour prémices au capelan un fond d’un quarteau, retourné et comble, ce qu’il répétait pour chaque quarteau de la dîme; en sorte que trois fonds de quarteau faisaient un quarteau; et si le décimateur en avait trois, le capelan en prenait un; mais l’évêque n’en recevait aucune portion. Bien plus, s’il voulait sortir de la ville pour visiter les paroisses, il lui fallait implorer une escorte des seigneurs sur les terres de qui il se disposait à passer; pour quoi l’on pouvait peut-être croire que le comte n’était pas accusé à tort de ne point pourvoir à la sûreté de sou évêque. Il semblait excusable, sinon en tout, en cela du moins qu’il ne pouvait maintenir la paix dans ses domaines, pour autant que ses vassaux ne lui laissaient pas de trêve, et si peu qu’il faisait venir à lui des routiers d’Espagne, auxquels il donnait licence de courir librement sur ses terres. Même serait-ce peut-être vouloir beaucoup qu’il eût extirpé, sans le consentement de ceux qui s’opposaient à lui, les hérétiques déjà moult enracinés dans le pays. Mais cette excuse n’était pas non plus suffisante, puisqu’il aurait pu pour un tel dessein trouver les bons avis et secours qu’on lui refusait pour autre chose. Au demeurant, soit simplicité, soit négligence, on pouvait dire de lui ce qu’on lit dans l’Écriture: « j’ai passé par le champ de l’homme paresseux, et voilà que les orties l’ont rempli tout entier. » Je veux parler des hérétiques, gent en effet inutile et dévorante, dont les progrès pouvaient aussi par aventure être en grande partie rejetés sur les prélats, en tant qu’il leur était du moins loisible d’aboyer, de réprimander et de mordre.
Dom Fulcrand, évêque, étant mort vers l’année 1201,[9] on choisit pour son successeur Raimond de Rabastens, archidiacre d’Agen. Mais pour autant que tout d’abord il se jeta dans le vice de simonie, la bénédiction lui manqua à la fin; et lorsque, aussi pauvre que son prédécesseur, il eut consumé ses métairies et engagé ses forts en plaidant et combattant inutilement durant près de trois années contre Raimond de Beaupuy, son vassal, il fut finalement condamné par le siège apostolique à être dépossédé de l’épiscopat.
Comme donc il fut à la connaissance du siège apostolique que ces contrées étaient travaillées du mal, tant de l’hérésie que d’une incroyable rapine et d’une misérable infamie, le souverain pontife y envoya vers le même temps pour légat frère Pierre de Castelnau, de l’Ordre de Cîteaux, homme prudent et discret, lui donnant pour collègue maître Raoul, personne lettrée et de bonnes mœurs; lesquels avertirent le comte de Toulouse d’expulser les hérétiques et routiers de ses terres, et d’y maintenir la paix; à quoi même ils le lièrent par serment. Il arriva dans le même temps que, par l’inspiration de Dieu, le vénérable homme et religieux, dom Foulques, abbé de Florèges, ou Toronet, de l’Ordre de Cîteaux, fut élu évêque de Toulouse. Or, quand ledit légat, qui le connaissait très bien, apprit sa promotion, malade qu’il était et gisant dans son lit, il éleva les mains vers le ciel, et rendit grâces à Dieu de ce qu’il donnait un tel homme à l’église de Toulouse.
Foulques entra pour la première fois dans son église le jour de la fête de Sainte Agathe, qui était un dimanche de carême; et après qu’il eut prié, se tournant vers le peuple, il commença un sermon sur l’évangile de ce jour: Celui qui sème est sorti pour semer la semence; ce qui s’accordait parfaitement avec son début, savoir, que personne ne devait plus douter qu’il ne fût envoyé, comme un autre Elisée, pour ressusciter l’évêché de Toulouse. C’est en l’an de grâce 1205 qu’il arriva en cette ville.[10] J’ai dit ressusciter l’évêché, car il était mort; et le mot ne doit étonner. Je lui ai entendu dire, à lui Foulques, et cela même dans un sermon, que quand il y entra, il ne trouva, de la terre au ciel, rien qu’il pût toucher présentement, si ce n’est quatre-vingt-seize sous toulousains, et en outre qu’il n’osait envoyer sans escorte à l’abreuvoir commun du fleuve, quatre mulets qu’il avait amenés, mais qu’ils buvaient l’eau d’un puits creusé en dedans de sa maison.
Lui-même était pressé par les créanciers qui le sommaient de paraître devant les capitouls. Au dehors, les Ariens, les Manichéens, les hérétiques et Vaudois avaient rempli tout le pays; car le Seigneur, qui, au temps de la primitive Église, ne fit point choix de nobles ou de puissants selon la chair pour détruire les plus forts empêchements, mais bien de ce qu’il y a de plus faible au monde, le Seigneur ordonnait peut-être qu’un pauvre évêque viendrait marchant à pied, pour chasser l’hérétique corruption.
Dans ce temps-là aussi, le Seigneur Dieu, qui conserve des flèches de choix dans le carquois de sa providence, tira d’Espagne deux athlètes d’élite pour les employer à ce grand ouvrage; je veux dire dom Diègue, évêque d’Osma, et ce religieux, Dominique, depuis déclaré saint, son compagnon et chanoine régulier de son église. Ces deux personnages donc mettant la main à la grande œuvre, après s’être adjoint des abbés de l’Ordre de Cîteaux, et autres gens de bien, commencèrent en toute humilité, abstinence et patience, à attaquer la superstition des hérétiques, qui se glorifiaient de la puissance de Satan; ils se vendaient de château en château aux disputes convenues, non point suivis d’un pompeux cortège, ou d’une multitude de gens à cheval, mais par le sentier des piétons, les pieds nus et déchaux. Une des premières rencontres eut lieu à Vertfeuil, à laquelle affluèrent un grand nombre d’hérésiarques, savoir: Pons Jourdain, Arnaud d’Arifat, et autres. En icelle, après force objections de part et d’autre, ils en vinrent à ce passage de saint Jean où Dieu dit: Nul ne monte au ciel, etc.; et sur ce que l’évêque d’Osma leur demandait comment ils l’interprétaient, l’un d’eux répondit que Jésus, qui parlait, s’appelait le fils de l’homme qui est dans le ciel. Votre sens est donc, reprit l’évêque, que celui qui est dans le ciel, et dont il s’appelle le fils, est un homme? Eux ayant dit qu’ils l’entendaient ainsi, il ajouta: Or ça, le Seigneur disant par la bouche d’Isaïe: Le ciel est mon siège, et la terre l’escabeau de mes pieds, il suit de ce que l’homme siégeant dans le ciel touche de ses pieds la terre, que la longueur de ses jambes est de tout l’espace entre la terre et le ciel ? Sur quoi, les autres avouant qu’il en était ainsi: « Dieu vous maudisse ! répondit aussitôt l’évêque, car vous êtes de grossiers hérétiques: je pensais que vous aviez quelque subtilité. » Alors ils se perdirent dans leurs efforts pour trouver à ces paroles des subterfuges et évasions, par la susdite ambiguïté, en effet, les Chrétiens catholiques prouvaient que Dieu et homme est celui qui descendit du ciel pour devenir homme et pourtant était dans le ciel, d’où il était descendu en tant que Dieu.
Il y eut une autre dispute à Pamiers, dans laquelle la sœur de Bernard Roger, comte de Foix, soutenait ouvertement les hérétiques, si bien que frère Etienne de Nîmes: Allez dame, lui dit-il, filez votre quenouille, il ne vous appartient pas de parler en débats de cette sorte. Là, on disputa contre les Vaudois, en présence de maître Arnaud de Campragnan, pour lors clerc séculier, lequel fut choisi pour arbitre par les deux parties, et dont l’arrêt étant qu’ils avaient eu le dessous, quelques-uns d’entre eux revinrent au cœur de l’église, approchèrent le siège apostolique, et furent récusa pénitence, avec permission, ainsi que je l’ai ouï dire, de vivre à la façon des réguliers: parmi ceux-ci, le principal était Durand de Huesca, qui composa certains écrits contre les hérétiques; ils vécurent plusieurs années en la susdite façon dans quelque endroit de la Catalogne; mais ensuite apostasièrent peu à peu. Quant aux autres hérétiques, ils furent convaincus, même au jugement de nos ennemis; et, à ce proposée dirai que j’ai entendu raconter à dom Foulques, évêque, que Pons d’Adhémar de Rodelle, chevalier plein de sagacité, lui disait en ce temps: Nous n’aurions pu croire en aucune manière que Rome eût tant d’efficaces raisons contre ces gens-ci. — Est-ce, répondit l’évêque, que vous ne voyez pas combien leurs objections ont peu de force? — Si fait, reprit l’autre. — Pourquoi donc, ajouta Foulques, ne les expulsez-vous et chassez de vos terres ? — Nous ne le pouvons, dit-il, nous avons été nourris avec eux, nous avons parmi eux des gens de nos proches, et nous les voyons vivre honnêtement.
C’est ainsi que la fausseté, par la seule apparence d’une vie pure, enlevait à la vérité les esprits mal avisés.
Parmi les autres disputes que les prédicateurs soutinrent en divers lieux contre les hérétiques, la plus solennelle fut à Mont-Réal, en 1207; dans laquelle figurèrent nos susdits athlètes, et le vénérable personnage Pierre de Castelnau, légat, ensemble son collègue, maître Raoul, et plusieurs autres gens de bien; et du côté adverse, l’hérésiarque Arnaud d’Othon, Guillebert de Castres, Benoît de Termes, Paul Jourdain, et autres à force, dont les noms ne sont point écrits dans le livre de vie. On controversa par écrit durant plusieurs jours par-devant certains arbitres choisis d’accord, savoir Bernard de Villeneuve et Bernard d’Arsens, chevaliers, plus Bernard de Got et Arnauld de la Rivière, bourgeois, auxquels quatre Tune et l’autre partie remit ses écritures. Du côté des hérétiques, le fond de la dispute fut qu’Arnaud d’Othon appela l’église romaine (qu’avait défendue l’évêque d’Osma), au rebours d’Église sainte et d’épouse du Christ, l’église du diable et doctrine des démons, disant qu’elle était cette Babylone que Jean nommait dans l’apocalypse la mère des fornications et abominations, la saoule du sang des saints et martyrs de Jésus-Christ; soutenant que son ordination n’était sainte ni bonne, ni établie par le seigneur Jésus, et que le Christ ni les apôtres n’avaient jamais dispose la messe telle qu’elle est aujourd’hui; à quoi l’évêque s’offrit de prouver le contraire par les autorités du Nouveau Testament. O douleur! qu’à ce point de vil abaissement fût arrivé l’état de l’église et de la foi catholique parmi des Chrétiens, qu’il fallût répondre à tant d’outrages sous l’arrêt de personnes laïques !
Les écrits donc leur ayant été remis de part et d’autre, avec pouvoir de décider, les juges, en ayant voulu délibérer, se séparèrent sans achever la besogne. Dans la suite des temps, je demandai à Bernard de Villeneuve ce qu’on avait fait de ces écrits, et si la dispute avait été jugée; lequel Bernard me répondit que rien n’avait été décidé, vu que les pièces d’écriture s’étaient perdues à l’arrivée des croisés, quand les gens de Mont-Réal et autres prirent tous la fuite, il me dit cependant que cent cinquante hérétiques environ, ayant ouï ce qui s’était dit d’un et d’autre côté, s’étaient convertis à la vraie foi: pour moi, je soupçonne que quelques-uns de ses collègues, favorables aux hérétiques, auront supprimé lesdits écrits, de même que peu après dom Pierre de Castelnau, légat, passa au Seigneur par le glaive des impies, non sans que le comte de Toulouse ait été grandement soupçonné d’avoir fait la chose. Il faut rejeter les juges et les princes eux-mêmes capables de tels actes.
Deux ans s’étant donc passés et plus dans ce pieux labeur, sans pouvoir éteindre par telle manière l’hérétique embrasement, les benoîts athlètes de Dieu, considérant que la chose avait besoin d’une plus haute sagesse, furent obligés d’en appeler au siège apostolique. Au demeurant, pour maintenir l’entreprise de la prédication, par inspiration divine, on pourvut à l’établissement de prêcheurs à perpétuité, et pour cette fin principalement, l’Ordre des Prêcheurs fut institué sous le béat évêque dom Foulques. Leur porte-enseigne, le bienheureux Dominique, en accepta à la fois la direction et la fatigue. Mais il n’entre pas dans mon récit d’en dire davantage à ce sujet, d’autant que, par l’histoire de sa vie et l’évidente propagation générale dudit ordre, il est déjà manifeste (qu’on y consente ou non) et vrai sans nul douté, selon ce que dit le saint apôtre, qu’il a fallu des hérésies dans nos temps ou dans nos contrées pour que le bienheureux ordre s’étendît et fructifiât, non pas seulement chez nous, mais bien par le monde entier.
Le péril où étaient ces pays ayant donc été déclaré au saint Siège, alors occupé par le souverain pontife pape Innocent in, un légat fut envoyé, savoir dom Arnaud Amaury, abbé de Cîteaux, homme de grande religion et prévoyance, afin de pourvoir à un état de choses sur lequel on ne pouvait plus s’abuser. En outre, vu que l’hérésie s’était, par l’adhésion des principaux du pays, accrue à tel point qu’elle pouvait encore plus aisément faire mouvoir des armées qu’échauffer l’esprit de ses zélateurs, il fut envoyé en France, où guerroyer pour le Seigneur est chose d’habitude, devers le roi et les barons, et tandis que des prédicateurs d’un rang moins élevé et pris dans le peuple, mais gens à ce capables, s’employaient à prêcher contre les hérétiques, par l’autorisation apostolique, l’indulgence accordée d’ordinaire à ceux qui vont outre-mer au secours de la Terre Sainte.
Pour ne rien omettre des choses accessoires qui semblent se rapporter au présent ouvrage, en sorte que j’ai cru devoir les entremêler aux solennelles affaires dont je traite, je mets ici que, l’an du Seigneur 1204, Pierre, roi d’Aragon, prit pour femme dame Marie, fille de Guillaume de Montpellier, dont il avait répudié la mère, ayant nom Grécie, et nièce d’Emmanuel, empereur de Constantinople; ce qu’il fit pour autant que par elle il ambitionnait de devenir maître de Montpellier. Bernard, comte de Comminges, l’avait eue pour femme avant lui, et l’avait répudiée après en avoir eu deux filles, dont l’une fut mariée à Sanche de Barre, et l’autre à Centulle, comte d’Astarac. Après l’avoir gardée quelque temps sans qu’elle lui donnât de progéniture, le roi la renvoya, mais se réconcilia par la suite avec elle, grâce aux exhortations des prélats, et l’ayant approchée la première nuit qu’elle vint en son camp, elle devint grosse de ce Jacques qui règne maintenant, et étant retournée à Montpellier, elle le mit au monde en cette ville. Derechef répudiée par le roi son époux, elle plaidait avec lui en cour de Rome, et là mourut en renom de piété. Ledit roi Jacques est né l’an du Seigneur 1208.
Je rapporterai aussi qu’avant ce temps, Baudouin, frère du comte de Toulouse, né et élevé en France, vint vers son frère pour demeurer près de lui; mais n’en ayant pas été reconnu et accueilli comme il l’espérait, il revint promptement en France, et obtint des barons et prélats, qui avaient connaissance de sa naissance et nourriture, des lettres scellées, par lesquelles ils attestaient qu’il était fils de dame Constance, mère du susdit comte, et sœur du roi de France Louis. A son retour, le comte voyant qu’il ne pouvait plus le rejeter, le retint près de lui, mais sans apanage: toutefois il le chargea de la conduite d’une guerre qu’il avait en Provence avec les princes des Baux. Baudouin s’y comporta bravement, battit les ennemis en rase campagne, et supporta de telles fatigues qu’il en cracha longtemps le sang, n’y put-il cependant gagner les bonnes grâces de son frère jusqu’à obtenir qu’il lui assignât quelque domaine. On verra plus tard de quelle manière il fut traité.
Le comte, apprenant qu’on prêchait en France la croisade contre ses domaines, vint trouver son cousin, Philippe, roi de France, pour avoir son avis sur l’imminente situation de ses affaires; et en ayant reçu de pacifiques exhortations, il alla, contre sa défense, vers l’empereur Othon, ennemi du roi, ce qui lui valût sa haine. De retour chez lui, il vint, sans faire mine de résistance, au devant de l’armée des croisés, où se trouvaient ses cousins, Pierre, comte d’Auxerre, et Robert de Courtenay, ensemble beaucoup d’autres grands personnages, auxquels sa venue fut agréable. En entrant sur son territoire, les croisés durent d’abord assiéger la cité de Béziers, dont les habitants, en punition de leurs péchés, abandonnés de la sagesse divine, et assez osés que de résister orgueilleusement à ceux qu’ils auraient dû prévenir par un pacifique empressement, ne purent repousser la première attaque du vulgaire de l’armée, et s’enfuirent, à l’abri des églises, devant la foule qui escaladait leurs murs et s’en emparait. Poursuivis l’épée dans les reins jusque dans l’église de Sainte Marie Madeleine, dont ce jour-là était la fête, il en fut fait un grand carnage à milliers, l’an du Seigneur 1209. On publia à cette époque que Dieu avait tiré cette vengeance de ceux qui, à pareil jour, avaient jadis tué par trahison leur seigneur Trencavel, bien que du reste on rapportât contre eux d’indicibles accusations au sujet de la souillure d’hérésie et de mille blasphèmes.
Étant donc maîtres de la cité de Béziers, les susdits seigneurs chevaliers dirigent leurs enseignes vers Carcassonne, et le vicomte Roger, accablé d’effroi, obtient pouvait été tué tout de bon. Pours lors, entre les prélats et les barons, et par l’entremise du légat, il fut question de décider lequel méritait d’obtenir le pays conquis, et qui poursuivrait la conquête; et comme les premiers personnages de l’armée eurent refusé l’offre qui leur en avait été faite, Dieu trouva le dévot et vaillant Simon, comte de Montfort, qui, vaincu enfin par les prières répétées des prélats et des barons, accepta ce qu’il avait d’abord refusé à l’exemple des autres, disant que la cause de Dieu ne souffrirait jamais faute d’un champion.
Cependant les natifs des terres voisines, frappés de terreur, fuyaient de toutes parts, délaissant villes et forts, si ce n’est que les châteaux de Cabaret, de Minerve et de Termes faisaient résistance; et contre eux on dirigea beaucoup d’efforts au même instant et pendant tout l’hiver, jusqu’au commencement de l’été suivant. D’ailleurs, durant ce temps, la parole de Dieu ne demeura enchaînée, car ceux qui en avaient reçu mission prêchaient toujours la croisade.
Or donc, le vénérable père Foulques, évêque, ayant en grand souci que tous ses citoyens de Toulouse ne manquassent point à profiter de l’indulgence qui était accordée aux étrangers, et voulant par un tel acte de dévotion les attacher à l’église, et par leur moyen abattre plus facilement l’hérétique méchanceté, aussi bien qu’éteindre la fureur de l’usure, réussit, avec l’aide de Dieu et l’appui du légat, à instituer à Toulouse une grande confrérie, dont il revêtit tous les frères du signe puissant de la croix, et dans laquelle entra presque toute la cité, à l’exception d’un petit nombre, plus quelques-uns même du faubourg, il les lia tous à l’église par la foi du serment, préposant à ladite confrérie, en qualité de baillis, Aimeri de Castelnau, dit Cofa, son frère Arnaud, ces deux-ci chevaliers, Pierre de Saint Roman, et Arnaud Bernard, dit Endurât, tous hommes vaillants, discrets et puissants; si bien que, Dieu aidant, la confrérie prévalut à tel point que les usuriers étaient contraints de répondre en leur présence à ceux qui les dénonçaient, et de donner satisfaction de leur mal vouloir; sinon on courait en armes détruire et piller les maisons des contumaces. Sur quoi, quelques-uns pour se défendre se retranchèrent à l’abri de tours fortifiées, et même une grande division éclata entre les gens de la ville et les gens du bourg, de telle sorte que ceux-ci établirent par contre une autre confrérie, unie par le lien du serment; et les choses étaient arrangées en façon que celle-ci s’appelait la confrérie blanche, l’autre la confrérie noire, lesquelles avec armes et bannières, voire souvent à cheval, en venaient aux mains; car le Seigneur était venu, par ledit évêque son serviteur, apporter entre eux, non point une paix funeste, mais un glaive salutaire.
En l’an 1210 de l’Incarnation du Seigneur, des traités et conditions de paix ayant été conclus et arrêtés entre le roi d’Aragon d’une part, lequel était principal seigneur de Carcassonne, sous la suzeraineté du roi de France, et le comte de Montfort d’autre part, ledit roi donna pour gage de leur féale observation à ce dit comte de Carcassonne son fils Jacques, encore enfant. En outre, les prélats et principaux de l’armée formèrent le dessein d’assiéger le château de Lavaur, au diocèse de Toulouse, où l’on disait renfermés, grand nombre d’hérétiques; et leur devenait cette entreprise bien licite, par la négligence du comte de Toulouse, lequel on trouvait désobéissant et relâché sur le point de purger ses terres des hérétiques et routiers. Déjà même il ne marchait plus avec les croisés comme au commencement, parce qu’ils avaient résolu de pénétrer sur son territoire, outre qu’il se disposait à leur résister, munissant et fortifiant ses citadelles et châteaux.
Ce fut alors que Baudouin, son frère, lui demanda Castelnaudary, qui était la première place sur le passage des pèlerins, lui promettant de la mettre en bon état de guerre et la défendre; mais le comte n’y voulut consentir. Toutefois, il lui donna le château de Montferrand à munir et à garder, et lui promit d’aller à son secours s’il venait à être attaqué. L’armée cependant marcha en hâte au siège de Lavaur, qu’Aimeri, seigneur de Mont-Réal et de Lauriac, frère de noble femme Guiraude, dame dudit château, s’était chargé de défendre à cause de sa sœur, pensant que la force des murailles qui le fermaient et l’enceignaient de toutes parts le rendait inexpugnable au courage même de ceux qui voudraient s’y risquer, outre que le comte de Toulouse s’était engagé à lever une armée, au cas où les croisés viendraient devant la place. Davantage, il y avait au dedans quantité d’hérétiques, non pas seulement de ceux qui y demeuraient d’habitude, mais beaucoup encore qui s’y étaient rendus de loin, dans l’espérance que plusieurs y seraient frappés, desquels ils se saisiraient pouf avoir leur argent, ainsi que je le tiens d’une personne bien instruite de ceci; car à l’aide de mots convenus, ils trafiquaient de tout, et même de leurs croyants, comme l’a prédit l’apôtre saint Pierre. Ce fut donc à ce château que s’attacha l’armée bénie de Dieu, l’entourant de tous côtés, au moyen d’un pont de bois jeté sur le fleuve, qui permettait la communication d’une rive à l’autre, et ne laissant jour ni nuit aucun repos aux assiégés, qu’elle harcelait sans cesse à l’aide de pierriers, de grosses balistes, et autres machines de siège.
Cependant les confrères de Toulouse furent requis par le légat et par leur évêque, de venir à l’armée porter aide et secours à la cause de la foi et de la paix. Sur quoi, prenant armes et provisions, ils se réunirent sur la place de Mont-Aigon formant une grande troupe, afin de se consulter et décider par quelle porte ils sortiraient pour se rendre à l’armée. Lors le comte vint au milieu d’eux, et leur interdît par menaces et prières d’aller au secours de ses ennemis, mais eux ne voulurent l’entendre, aimant mieux garder le serment prêté au légat; et venant à la porte de Saint-Étienne, ils se disposaient à la dépasser, quand ils y trouvèrent ledit comte, qui, mettant ses bras sur les barres, et protestant qu’ils les lui briseraient plutôt, empêcha ainsi leur départ. Finalement, pensant bien qu’à quelque porte qu’ils se présentassent de ce côté, il en ferait autant, ils tournèrent brusquement (ce qu’il n’avait pas prévu) leurs enseignes vers les ponts de la Garonne, la traversèrent, et retournant plus bas par un gué, ils arrivèrent à l’armée devant le château de Lavaur, d’où les apercevant de loin, les assiégés pensèrent que c’était le comte qui venait à leur secours. Mais quand ils les virent dresser leurs tentes dans le camp des assiégeants, à l’aspect de ce renfort d’ennemis, ils perdirent confiance; et sentant qu’ils ne pouvaient se défendre, d’autant que les machines de guerre avaient dépouillé leurs murailles de toutes leurs défenses, ils donnèrent des otages, et se rendirent à discrétion aux croisés. Avant la fin du siège, le comte de Foix était tombé sur de nouveaux pèlerins qui arrivaient sans défiance à l’armée, et en avait égorgé une grande quantité dans le bois.
Le comte Simon s’étant donc emparé du château qui lui avait été livré à discrétion, fit pendre à un gibet le susdit Aimeri, noble notable, plus un petit nombre de chevaliers; les autres nobles, avec quelques-uns qui s’étaient mêlés à eux dans l’espoir qu’on épargnerait les chevaliers, au nombre d’environ quatre-vingts, furent livrés au glaive; enfin quelques trois cents hérétiques croyants, brûlés en ce monde, furent ainsi livrés par lui au feu éternel, et la dame du château, Guiraude, précipitée dans un puits, y fut comblée de pierres; quant au vulgaire, il fut conservé sous condition.
Ayant achevé ce qui pressait en cet endroit, l’armée de Dieu vint en hâte vers un château nommé Casser, et l’ayant attaqué et pris, elle y brûla environ soixante hérétiques qu’on y trouva. De là, passant au château de Mont-Ferrand, que Baudouin, frère du comte de Toulouse, avait fortifié, elle en forma le siège; et comme ce comte ne lui portait aucun secours, ainsi qu’il l’avait promis, Baudouin, forcé par des attaques continuelles, fut reçu à la paix de l’église, qu’il s’obligea par serment de défendre désormais. Ensuite, on combattit tout l’hiver pour conquérir encore du pays: quant aux frères de la confrérie de Toulouse, ayant été renvoyés chez eux, le comte se les attacha à force de soins et de peines, et rétablit la concorde entre les deux partis, si bien que tous alors travaillaient avec ardeur à fortifier et munir leur ville contre les étrangers, et le légat lança sur eux tous une sentence d’excommunication. Ce fut vers ce temps-là, que Raimond, fils dudit comte, épousa doña Sancie, scieur de Pierre, roi d’Aragon, auquel le comte fit un don simulé de la ville de Toulouse, afin qu’il parût avoir un prétexté plausible de la défendre. Or, l’année suivante (de l’Incarnation du Seigneur nu), l’armée des croisés, dans laquelle se trouvait un grand nombre d’Allemands, assiégea cette ville; et plaçant son camp et ses tentes en face du faubourg et la meilleure portion de la ville, elle la fatigua de fréquent assauts; mais non moins fatiguée par la résistance des assiégés, elle leva le siège; puis leur quarantaine étant achevée, les pèlerins retournèrent chez eux, après avoir causé un grand dommage aux citoyens de Toulouse en leurs moissons, vignobles, et autres objets à eux.
Après leur retraite, le comte de Toulouse sortit en force de Toulouse, et vint assiéger le comte de Montfort dans Castelnaudary, qu’il attaqua après avoir dressé ses machines. Or il arriva un jour qu’au moment où quelques chevaliers de Montfort lui apportaient des vivres du diocèse de Carcassonne, le comte de Foix, suivi d’un grand nombre d’hommes armés, courut à leur rencontre, et engagea un grand combat avec eux en pleine campagne; ce qui ayant été incontinent annoncé au comte, après avoir pourvu à la défense du château, il sortit, à la vue de toute l’armée, avec soixante chevaliers au plus pour aller au secours des siens, qui étaient déjà presque défaits; de façon qu’arrivé dans la plaine, il n’en trouva plus qu’un petit nombre qui fût en selle et résistât encore. Pour lui, se ruant comme un lion sur les ennemis, qui, voyant qu’il les attaquait en personne, cherchèrent leur salut dans la fuite, il les poursuivit vivement, l’épée dans les reins, fît çà et là un grand carnage, et rentra dans le château avec la victoire. Ce fut au plus fort de ce combat, que Guillaume Cat, chevalier de Mont-Real, que le comte avait en sa familiarité à cause du compérage qui existait entre eux, passa traîtreusement au parti de Satan, contre ledit comte, ignorant que les accidents et succès de la guerre sont variables, et qu’il devait cette fois en arriver autrement qu’il ne l’espérait. Sa félonie fut cause que le comte depuis ce moment n’en détesta que plus fort l’alliance des chevaliers de notre langue.[11] Cependant le comte de Toulouse, confondu de cette victoire, et affaibli par la ruine de ses complices, brûla les machines, leva le siège pendant la nuit, et se retira dans ses foyers.
Vers ce temps, le roi d’Aragon vint à Toulouse, et y mit pour son lieutenant un chevalier nommé Guillaume de l’échelle, et sous lui un nommé Burguet, surnommé de Samaros, lequel resta chez les citoyens de Toulouse. Le roi retourna ensuite en Espagne, parce que Miramôlin, roi d’Afrique, avait déclaré la guerre aux Chrétiens; sur quoi le seigneur Arnaud Amaury, qui en ce temps était déjà archevêque de Narbonne, se prépara avec cent chevaliers français à. y prendre part; et cinq rois s’étant en outre réunis pour livrer bataille, ils remportèrent, Dieu aidant, une victoire qui, selon le bruit public, coûta environ cent mille hommes aux Sarrasins; puis, aussitôt après, savoir en l’an du Seigneur 1212, ils s’emparèrent de la ville de Calatrava, le roi des Sarrasins fuyant honteusement devant eux. Cependant le comte Simon ne prenait nul repos, et n’en laissait aucun à ses ennemis, les pressant et attaquant partout où ils pouvaient se montrer. Ainsi, l’an du Seigneur 1213, au commencement de l’été, il mit dans un certain fort ayant nom le Pujol, auprès de Toulouse, une garnison de gens d’armes, afin d’inquiéter les Toulousains quand ils sortiraient pour faire la moisson. Mais le comte de Toulouse les assiégea, et les attaquant à grand effort de machines, les força de se rendre, moyennant qu’ils auraient la vie sauve. Parmi eux se trouvait Roger des Issarts, chevalier français, lequel avait été blessé à la tête d’un coup de dard. Or voici de quelle manière on leur tint cette promesse: s’étant retirés dans une tour, et ne songeant plus à se défendre, d’autant qu’on leur offrait sûreté, parce que le bruit courait chez les assiégeants que Gui de Montfort arrivait à leur secours, Roger Bernard, fils du comte de Foix, et quelques autres chevaliers vinrent ensemble à cette tour, leur ordonnèrent de l’ouvrir en leur faisant des serments, pourvu qu’ils en livrassent l’entrée: et sur ce que les autres s’y refusaient par peur d’être égorgés, on leur promit, après les avoir menacés de mort s’ils persistaient, qu’on leur laisserait la vie sauve, comme nous l’avons dit, et, ce sur la parole du comte et des principaux de Toulouse, nonobstant quoi le brave chevalier Simon de Saxe fut égorgé sur l’heure par la populace de l’armée. Quant au reste, ayant été conduits à Toulouse, ils furent massacrés quelques jours après dans les prisons par le peuple, de même que tous ceux qui avaient été faits prisonniers en d’autres lieux, et traînés hors de la ville comme des charognes: ce qui porta bientôt grandement malheur à toute la gent toulousaine, comme la suite le fera voir. J’oubliais de dire que celui d’entre eux qui fut tué d’abord dans le premier feu de l’émeute avait été arraché hors de l’église de Saint-Saturnin, où il s’était réfugié, si bien que la boucherie commença par une violation des immunités et libertés de l’église: mais, comme je l’ai déjà dit, il en arriva mal à un grand nombre.
En effet, dans ce même temps, le roi d’Aragon, qui avait été heureux contre les Sarrasins, voulut éprouver aussi sa fortune contre les Chrétiens. Il vint donc à Toulouse vers la fin de l’été, et s’étant consulté avec les comtes, les grands et les citoyens de la ville, il en sortit en force, et vint assiéger le château de Muret, où le comte Simon avait établi une garnison qui gênait fort la ville de Toulouse. Là, il fut joint par un grand concours des pays d’Alentour, qui servit à grossir son armée. Ce qu’ayant appris, le comte de Montfort vola de suite au secours des siens. Or, voici ce que j’ai entendu dire il y a plusieurs années au vénérable dom Maurin, abbé de Pamiers, homme digne de foi et estimable de tout point, lequel, n’étant encore que sacristain, avait la garde du château de Pamiers: étant sorti jusqu’à Bolbone au devant du comte, et apprenant de sa bouche qu’il venait pour secourir les assiégés, et même pour combattre les assiégeants, s’ils l’attendaient dans la plaine, il lui répondit: Vous avez peu de monde eu égard au nombre de vos ennemis, parmi lesquels est le roi d’Aragon, homme très expert et éprouvé dans les armes, ayant avec lui les comtes et une grande armée; la partie ne serait donc pas égale si vous vous engagiez avec si peu de forces contre le roi et si copieuse multitude. Mais le comte, à ces mots, tirant une lettre de son aumônière: Lisez, dit-il, cette lettre; et le sacristain y trouva que le roi d’Aragon l’adressait à une certaine noble dame, épouse d’un noble du diocèse toulousain, lui persuadant que c’était pour l’amour d’elle qu’il venait chasser les Français de son pays, et lui débitant autres pareilles sornettes. Et comme le sacristain, après avoir lu, eut répondu au comte : Que voulez-vous dire par là ? — Ce que je veux dire ! s’écria Simon; c’est que Dieu me soit en aide autant que je crains peu un homme qui vient pour une femme bouleverser les affaires de Dieu. Ainsi disant, il renferma promptement cette lettre dans sa bourse. Et peut-être était-ce quelque domestique ou secrétaire de la susdite noble dame, qui en avait fait une copie pour le comte, comme d’une chose digne de remarque, et celui-ci la portait avec lui en témoignage devant le Seigneur contre celui qui, comme un efféminé, ne croyait ou ne craignait pas que, même par la confiance en Dieu, on pût lui résister.
Le comte et les siens, continuant leur route, entrèrent donc à Muret; et quand ils passèrent sur le pont, les ennemis auraient pu à leur aise, s’ils l’avaient Voulu, les compter à un homme près. Là, après que furent entrés les vénérables Pères qui l’accompagnaient, savoir Foulques, évêque de Toulouse, Gui, évêque de Carcassonne, et Bédèse, évêque d’Agde, ils se mirent, vu les vicissitudes de la guerre, à négocier, pour obtenir paix ou trêve; mais comme le roi ne voulut accepter ni l’une ni l’autre, si ce n’est à des conditions honteuses et dommageables au parti de l’église, le comte Simon, présumant que s’il abandonnait ce château aux ennemis, tout le pays se soulèverait contre lui pour se joindre à eux, en sorte que ses périls nouveaux seraient pires que les premiers, et considérant d’Ailleurs qu’il défendait la cause de Dieu et de la foi, tandis que les autres marchaient au rebours, et étaient entravés dans les liens de l’excommunication, crut préférable de s’exposer au péril un seul jour, que d’Accroître l’audace de ses ennemis par la lenteur et l’inaction. Quoi plus? Les athlètes du crucifix choisirent pour combattre le jour prochain de l’exaltation de la sainte Croix; et lors, s’étant confessés de leurs péchés, et ayant entendu l’office divin comme à l’ordinaire, nourris du pain salutaire de l’autel, et réconfortés par un sobre repas, ils revêtent leurs armes, et se préparent à en venir aux mains. Or, au moment où le comte allait monter à cheval, la sangle de sa selle s’étant rompue, il remit pied à terre, et on la raccommoda aussitôt; mais lorsqu’il monta derechef, son cheval le frappa d’un coup de tête au front avec tant de force, qu’il demeura quelque temps tout abasourdi, de sorte que s’il eût eu foi, comme beaucoup usent de le faire, à ces devins vagabonds qui courent le pays, il aurait eu à craindre que quelque chose de sinistre ne lui advînt du combat.
Bref, on décida de ne point sortir directement sur l’armée des assiégeants, afin de ne pas exposer les chevaux à une grêle de traits, et l’on marcha par la porte du côté de l’orient, tandis que leur camp était au contraire à l’occident, de sorte que, ne devinant pas leur dessein, les ennemis crurent d’abord qu’ils prenaient la fuite, jusqu’à ce que s’étant avancés un peu dans ce sens, ils traversèrent enfin un ruisseau, et revinrent en plaine sur l’ennemi. Il y avait là, avec le comte de Montfort, Gui, son frère, Baudouin, frère du comte de Toulouse, Guillaume des Barres, Alain de Roussy, et beaucoup d’autres au nombre d’environ mille hommes en armes.
Le roi d’Aragon se prépara donc au combat, bien que le comte de Toulouse conseillât au contraire qu’ils restassent dans leur camp, afin d’Accabler à coups de traits et javelots la chevalerie des assiégés, de pouvoir les aborder plus sûrement après les avoir ainsi affaiblis, et de les tailler ensuite plus aisément en pièces, ou de les mettre en fuite, d’autant qu’ils ne pouvaient tenir dans le château, faute de vivres; ce à quoi le roi ne voulut pas entendre, attribuant ce conseil à la crainte, et le taxant de lâcheté. Ainsi, ayant rangé son armée en bataille, il engagea la mêlée, et la première attaque fut confiée au comte de Foix, suivi des Catalans et d’une multitude de gens de guerre. De l’autre côté, comme je le tiens du seigneur Raimond, dernier comte de Toulouse (lequel, alors incapable de combattre, à cause de son âge, avait été conduit hors du camp sur un cheval de main, au sommet d’une hauteur d’où il pouvait voir l’engagement), de l’autre côté, dis-je, le comte Simon s’avança avec les siens rangés en trois corps, selon l’ordre et usage de la discipline militaire, comme il la savait, de façon que les derniers rangs hâtant leur course chargèrent tout en même temps que les premiers, connaissant bien qu’un choc donné d’ensemble enfante la victoire; et ils culbutèrent tellement leurs ennemis du premier coup, qu’ils les chassèrent devant eux de la plaine comme le vent fait la poussière de la surface du sol, les fuyards se jetant comme ils purent derrière les derniers rangs de leur armée. Puis les vainqueurs tournant alors du côté où se trouvait le roi, dont ils avaient distingué la bannière, ils se ruèrent vers lui d’une telle violence, que le choc des armes et le bruit des coups étaient portés par l’air jusqu’au lieu où était celui dont je tiens ce récit, non moins que si c’eût été une forêt qui tombât sous une multitude de haches. Là fut tué le roi avec un grand nombre des principaux seigneurs de l’Aragon, qui périrent autour de lui. Le reste prit la fuite, et fut tué à foison tout en courant. Les comtes, de Toulouse et de Foix eux-mêmes ne durent, ainsi que d’autres, leur salut qu’à une prompte retraite.
Cependant le peuple de Toulouse, retranché dans, le camp derrière des chariots et autres équipages, ignorait encore à qui appartenait la victoire, jusqu’à ce qu’enfin reconnaissant les enseignes de ceux qui ramenaient battant les fuyards, ils coururent pêle-mêle vers un navire qu’ils avaient au bord de la Garonne: ceux qui purent y entrer se sauvèrent, les autres furent noyés ou périrent par le glaive au milieu des champs, si bien que le nombre des morts a éténd","serif"; color:black">Durant qu’on égorgeait ainsi çà et là le peuple dans la plaine, il ne manqua pas de gens qui lui reprochaient sa conduite envers les prisonniers qu’il avait naguère massacrés à Toulouse. Au demeurant, plusieurs ayant été pris dans le combat et conservés, moururent en prison, ou se rachetèrent à prix d’argent, ni se trouva-t-il qu’il eût péri un seul homme du côté de l’église. Voilà, dans cette bataille, ce que valurent son orgueil et ses débordements à ce roi qui avait toujours eu du bonheur contre les Sarrasins, et que l’amour paternel ne put même en rien détourner de ses desseins insensés, car il avait remis son fils ès mains de son ennemi pour otage du traité entre eux conclu, et celui-ci, s’il l’eût voulu, aurait pu aussi maison qui n’eût un mort à pleurer, ou qui n’eût à croire quelqu’un des siens tué ou pris pour le moins. La cause de tout ce mal fut que le peuple entrant en folie par trop grande audace, tous coururent aux armes, poussés de la même fureur, se confiant dans les forces humaines, et non en la divine protection, tandis que leurs adversaires, pleins de leur foi en Dieu, étaient par leur petit nombre préservés d’une telle présomption, et célébrant en toute dévotion la fête de la sainte Croix, ils vainquirent en ce jour les adversaires de cette même croix, comme de dignes champions du Seigneur qu’ils étaient. Même, retournés en triomphe dans leur camp, ils rendirent grâces au Seigneur Jésus-Christ de ce que, par ses mérites, il leur avait fait vaincre, malgré leur faible nombre, une telle multitude et si grande.
Il arriva peu de temps après, que Baudouin, frère du comte de Toulouse, étant allé dans l’Agenais, sur les terres que le comte lui avait octroyées, il vint en un château nommé l’Olme, où il fut par quelques gens vendu traîtreusement, pris pendant la nuit reposant dans son lit, et livré au comte son frère, lequel, après l’avoir tenu prisonnier pendant plusieurs jours à Montauban, se laissant aller au méchant conseil de Roger Bernard, fils du comte de Foix, de Bernard de Portelles, Catalan, et certains autres, pour venger le roi d’Aragon, qui avait péri dans la bataille, condamna son frère à être pendu, sans lui laisser qu’à peine la liberté d’Avoir un prêtre pour se confesser. Après quoi, les frères Templiers ayant demandé et obtenu son corps, ils le descendirent de l’arbre auquel il avait été attaché, puis, à Ville-Dieu, en leur château, lui donnèrent, près de l’église, la sépulture ecclésiastique. Du reste, le comte aggrava beaucoup son mal renom par ce fratricide, d’autant qu’il aurait dû au moins lui épargner la honte de la potence, ne fût-ce que pour n’avoir pas à en rejeter l’opprobre sur lui-même, et qu’il aurait pu le faire périr d’une autre mort moins ignominieuse: mais d’Ailleurs, le juste, quel que soit le genre de son trépas, sera admis en lieu de rafraîchissement. Finalement, ce prince, tenu par son serment de rester fidèle à l’église, ne pouvait s’y soustraire en ce moment extrême, lors surtout que son frère ne lui avait jamais permis de bien espérer de lui à tel titre, mais, l’avait au contraire exposé aux plus grands périls. Vers ce temps, l’illustre Philippe, roi de France, fit prisonniers, en bataille rangée, les comtes de Flandre et de Boulogne, et dans les lieux mêmes qu’ils convoitaient et se fussent partagés si la fortune les avait secondés, il les fit garder et charger de fers. En même temps, Louis, son fils marchant contre le roi Jean d’Angleterre, en la province d’Aquitaine, le mit en fuite et le chassa loin devant lui.
Postérieurement à tout ceci, et après la mort du roi d’Aragon, maître Pierre de Bénévent, cardinal, fut envoyé par le souverain pontife pour mettre fin, par la paix et avec l’aide de Dieu, aux efforts de la guerre, et en sa présence, le comte et les citoyens de Toulouse s’obligèrent par serment à déférer aux mandat et jussions du saint Père. De plus, outre le château de Narbonne qui lui fut livré, les gens de la ville et du faubourg donnèrent des otages, qui devaient rester à Arles, en Provence; sur quoi, le légat confia la garde et tenance dudit château à l’évêque de Toulouse, au nom de l’église romaine. Quant au comte de Toulouse, son fils et leurs femmes, ils vinrent demeurer en la maison de David de Roaix.
Dans le même temps, le comte de Foix livra son château de Foix à ce même légat, pour gage de son obéissance aux mandats apostoliques, et le légat en remit la garde à l’abbé de Saint-Thibéri, au nom de l’église romaine, lequel abbé y mit son neveu Bérenger pour châtelain. Plusieurs jours après, le comte de Toulouse sortit de la ville pour aller chercher près de qui il pourrait travailler à la cause, et son fils se rendit en Angleterre, vers le roi, son cousin, afin de se consulter avec lui. On avait alors conclu une trêve en préambule à la paix qui devait suivre, pendant laquelle il était permis aux soldats de parcourir le pays, sans toutefois entrer dans les places, et de voyager, non sur des coursiers, mais sur des roussins, avec un seul éperon et sans armes. Et je rapporterai ici un fait que j’ai entendu raconter en ce temps, savoir que Raimond de Recaud, homme libre et chevalier, qui avait été des conseillers les plus intimes du comte de Toulouse, alla trouver Foulques, évêque de Toulouse, et lui demanda la maison des Hospitaliers, dite La Maynaderie, afin d’y cloîtrer ses jours en l’honneur de Dieu, sur quoi l’évêque lui répondit, en parabole, qu’après avoir tué le comte par ses conseils, et étant celui à l’occasion duquel il avait presque tout fait, il s’efforçait maintenant d’obtenir le bénéfice en question, à l’instar de ce fou qui ayant tué un homme d’un coup de pierre à la tête, se présenta avec les pauvres pour prendre part aux aumônes qu’on distribuait pour le défunt, et qui s’étant assis à son rang, et voyant passer outre, sans lui donner comme aux autres, le distributeur, s’écria: « Ne me donnerez-vous donc rien, à moi qui ai tout fait? » Ce fut ainsi que l’évêque crut devoir repousser sa demande par une similitude et celle histoire ne fut pas peu répandue dans le temps.
Le souverain pontife, Innocent III, pape, convoqua pour lors un concile général de toutes les nations, lequel se tint à Rome, l’an du Seigneur 1215. Là furent présents le comte de Toulouse et son fils, qui revint d’Angleterre avec un certain trafiquant, lequel se donnait l’air d’être à son service, le comte de Foix, pour sa part, et Pierre Bernard, du chef de la fille aînée du comte de Toulouse, qu’il avait épousée, demandant que, si le pays leur devait être rendu, il lui fût octroyé par droit de primogéniture, d’autre part était Gui, frère du comte de Montfort à qui tout le territoire fut adjugé, à l’exclusion formelle du comte de Toulouse. De plus, le château de Narbonne fut livré audit comte, il reçut le serment des citoyens et des bourgeois de Toulouse, fut nommé lui-même et tenu pour comte de Toulouse, et les notaires dressaient les actes publics en sou nom. Lors il fit abattre les remparts de la cité et les murailles du faubourg, combler les fossés et démolir les tours des maisons fortifiées dans l’intérieur de la ville, afin qu’on n’osât plus se rebeller contre lui, et finalement enlever les chaînes des carrefours. Quant au château Narbonnais, lequel en ce temps était très fort dans toute sa hauteur, comme il l’est encore aujourd’hui, il le fit déblayer et ouvrir par une porte vers l’orient, afin d’y pouvoir entrer quand il le voudrait à l’insu ou contre le gré des habitants, et fit creuser entre la ville et le château de grands fossés bordés de hautes palissades. Ensemble, il donna la comtesse de Bigorre à son fils Gui, pour fortifier sa comté du côté de la Gascogne ; et les otages qui avaient été livrés au légat par les citoyens de Toulouse eurent la liberté de retourner chez eux.
Après le susdit concile général, le comte Raimond se retira en Espagne, et son fils alla en Provence où leurs femmes avaient déjà passé, après que le comte Simon fût venu à Toulouse: là il fut reçu par les citoyens d’Avignon; pareillement, le pays Venaissin se donna à lui, si bien qu’il suscita encore la guerre au comte de Montfort. Or, tout ceci nous engage bien à réfléchir sur l’exécution des jugements divins! de telle manière les travaux entrepris pour la défense de la foi catholique et l’extirpation de l’hérétique perversité, commencés en premier lieu par la douceur de la prédication, puis continués par la rigueur de la justice séculière, enfin amenés presqu’à leur terme, furent, par le Seigneur, mis en tel point qu’il fallut recommencer sur nouveaux frais, comme si rien n’eût été fait; et qu’à l’instant où il pensait avoir consommé son œuvre, l’homme fut forcé de la reprendre par le bout. Mais la tournure qu’avaient prise les choses explique clairement la raison de ce jugement de Dieu, car de même que quand les Hébreux, une fois au sein de la Terre Promise, s’enorgueillirent de la protection divine, le Seigneur permit, à cause de leur ingratitude, que les Égyptiens vinssent les attaquer, et qu’ils fussent tout entourés de nations qui les molestaient, pour leur apprendre à se contenir en humilité, de même encore que l’ange de Satan fut envoyé par lui à l’apôtre avec l’aiguillon de la chair, afin qu’il ne s’enflât point trop par la grandeur des révélations qui lui étaient accordées, infligeant ainsi aux uns la peine de leurs fautes et maintenant les autres dans l’exercice de la vertu; de même, pour ce qui regarde les affaires des croisés, placées en si bon état, Dieu se servit de ses décrets ordinaires. En effet, lorsque le comte Simon, homme en tout bien louable, eut, avec l’aide du Seigneur, acquis tout le pays, et après qu’il l’eut partagé entre les grands et les siens chevaliers, ceux-ci commencèrent à le régir, non plus dans une fin conforme au principe de la conquête, ne songeant plus déjà aux choses du Christ, mais aux leurs, et se faisant esclaves de leurs désirs en avarice et volupté. Et parce qu’avec le bras de Dieu, un seul avait mis en fuite quasi mille ennemis, et deux dix mille, attribuant ce triomphe à leurs propres forces et non aux forces divines, ils mettaient peu ou point de soin à rechercher et à contenir les hérétiques. C’est pourquoi le Seigneur les abreuva ensuite au calice de sa colère, laquelle n’était point encore jusqu’au fond tarie, en la façon que les chapitres suivants le feront voir.
Voici donc que le fils du comte, si souvent cité, ayant été reçu par les citoyens d’Avignon et les peuples du Venaissin, d’accord avec les habitants de Beaucaire, entra dans leur ville, suivi d’une forte troupe, et assiégea la garnison du château, de toutes parts, tant par terre que par eau, sur le Rhône; de telle sorte qu’elle ne pouvait sortir, et que nul ne pouvait pénétrer jusqu’à elle. Cependant le comte Simon accourut en hâte avec son armée, et à son tour assiégea les assiégeants; mais les défenseurs du fort, ayant mangé jusqu’à leurs chevaux, et man quant de toutes choses, le livrèrent aux ennemis, moyennant la vie sauve, et le comte, voyant qu’il n’avançait à rien, leva le siège et se retira. Or ceci fut cause que bien des gens qui se cachaient commencèrent à lever les cornes, et que plusieurs villes et bourgs s’étant ligues entre eux, s’unirent à ses ennemis. Même les citoyens de Toulouse, dont les otages étaient revenus depuis longtemps, dédaignant, comme je l’ai souvent dit, dans leur orgueil, de se soumettre à leurs maîtres, montraient quelque désobéissance, et ne supportaient qu’impatiemment un joug qui gênait leur liberté accoutumée; pour quoi le comte Simon, craignant que, s’il ne les réprimait tout de suite, ils ne s’enflassent encore plus, se décida à leur courir sus à main armée, et à châtier rigoureusement leur superbe.
L’an du Seigneur 1216, s’étant donc avancé avec une troupe nombreuse de gens d’Armes, il envahit la cité de Toulouse, après y avoir mis le feu en plusieurs endroits, afin que les citoyens, frappés d’épouvante par le double fléau du fer ensemble et dit feu, en fussent plus aisément accablés; mais ceux-ci, du contraire, opposant la force à la force, et ayant jeté des poutres et des tonneaux en travers sur les places à l’encontre des assaillants, repoussèrent leur attaque, et, travaillant toute la nuit, les combattirent sans relâche en même temps que l’incendie. Enfin, le jour se levant, le vénérable père dom Foulques, évêque, accompagné de quelques gardes, à cause des périls qu’il allait braver, traita de la paix et du rétablissement de la concorde entre les deux partis; sur quoi on vit alors comme l’argent émousse la pointe des épées. En effet, le comte Simon était épuisé par les dépenses qu’il avait faites au siège de Beaucaire, et les deniers lui manquaient entièrement; si bien que quelques personnes, soupçonnant qu’il en était ainsi, lui persuadèrent, sous couleur de son propre avantage, de recevoir, pour la rançon de la cité et du faubourg, trente mille marcs d’Argent que les assiégés pouvaient payer de reste pour obtenir son pardon. Il se rendit donc à ce conseil d’Achitopel, et, aveuglé par l’argent, il ne sentit pas le danger; car ceux qui lui donnaient cet avis savaient bien que, pour prélever cette somme on commettrait beaucoup de vexations à l’égard de tous et de chacun en particulier, ce qui les conduirait forcément à rechercher leur première liberté et à rappeler leur ancien seigneur. De fait, la taille ayant été répartie entre les gens de la ville pour ce qu’ils devaient solder, on les contraignait durement et sans relâche à s’acquitter: on marquait les maisons pour venir arracher la rançon promise, et nombre d’autres sévices avaient lieu qu’il serait long de raconter par le menu, lesquels faisaient gémir le peuple de sa servitude. Pendant ce temps on négociait secrètement avec le vieux comte, qui errait en Espagne, sur les moyens qu’il prendrait pour rentrer dans Toulouse et accomplir ce qu’il désirait.
Ainsi donc l’an du Seigneur 1217, pendant que le comte Simon était occupé à une longue guerre contre Adhémar de Poitiers, au-delà du Rhône, le comte de Toulouse, reconnaissant l’occasion favorable, avec les comtes de Comminges et de Pailhas,[12] plus un petit nombre de chevaliers, passa les Pyrénées et fit son entrée dans Toulouse au mois de septembre, non par le pont, mais à gué, au dessous du passage. Ce qui n’ayant été su que d’un petit nombre de gens, fit plaisir aux uns et déplut aux autres, qui pesaient l’avenir dans la balance du passé; d’où vint que quelques-uns se retirèrent au château Narbonnais, auprès des Français, et quelques autres également se réfugièrent dans la maison de l’évêque, dans le cloître Saint-Étienne et dans le monastère de Saint Sernin, lesquels, par menaces et par caresses, le comte fit venir vers lui quelques jours après. De son côté, le comte Gui, qui était dans le pays, tenta d’étouffer par les armes l’émeute encore récente; mais il fut repoussé et ne put accomplir son dessein. Cependant, tandis que ces nouvelles étaient portées au comte, qui pour lors tenait le château de Crest assiégé, les citoyens de Toulouse commencèrent à entourer leur ville de pals et pieux, de grandes poutres et de fossés, du côté du château Narbonnais, à partir du créneau, dit de Toret, et transversalement jusqu’à celui de Saint-Jacques. Quant au comte Simon, survenant avec le seigneur cardinal Bertrand, lequel avait été député légat par le souverain pontife Honoré, il attaqua Toulouse avec des forces considérables; mais cette fois il ne put rien faire, car les habitants se battirent vaillamment. Puis on éleva des deux côtés des machines qui lançaient de part et d’autre de gros quartiers de pierres et des cailloux. Sur ces entrefaites, le légat envoya le seigneur évêque de Toulouse en France pour y prêcher la croisade, en compagnie d’autres personnes qui avaient reçu la même mission, parmi lesquelles était Jacques de Vitry, homme de grande honnêteté, éloquence et science, qui fut depuis évêque d’Acre, et postérieurement cardinal du sacré collège. Et à son sujet j’ai ouï dire au seigneur évêque de Toulouse qu’il tenait de lui que saint Saturnin, premier prélat de cette ville, lui avait apparu en songe, lui enjoignant de prêcher contre son peuple; ce que l’évêque rapportait avoir reçu pour réponse sur ce qu’il lui avait demandé s’il savait qu’autrefois il y eût eu à Toulouse un pontife du nom de Saturnin. Or, dans cette prédication il donna le signe de la croix à beaucoup de gens qui vinrent audit siège de Toulouse le printemps suivant, et avec lesquels l’évêque lui-même rejoignit l’armée. C’est alors que le comte Simon lui fit aumône à toujours, pour lui et les évêques de Toulouse ses successeurs, du château de Vertfeuil avec tous les bourgs et forts qui relevaient de cette seigneurie (et étaient lesdits forts au nombre de près de vingt), ne se réservant aucun droit, sinon que dans le cas où il aurait bataille rangée à livrer sur son territoire, l’évêque serait tenu d’y envoyer un chevalier armé de toutes pièces. Comme donc les assiégeants et assiégés eurent passe; tout l’hiver à combattre tant avec des machines qu’avec d’autres engins de guerre, le comte Simon, renforcé par les pèlerins nouveaux venus, redoubla de sorties et de courses autour de la ville. Mais comme les habitants l’arrêtaient par des barrières, et que leurs fossés le gênaient grandement, on résolut enfin de construire une machine de bois appelée chat, qui servirait à porter de la terre et autres matériaux pour combler ces fossés, afin qu’étant remplis, on pût marcher en avant de pied ferme, combattre de près, briser les palissades et sauter dans la ville. Or était le comte atteint de langueur et d’ennui, amoindri par tant de coûts et tout épuisé; ni supportait-il patiemment l’aiguillon dont le légat le poignait chaque jour, pour autant qu’il était paresseux et relâché; d’où vient, comme on le disait, qu’il priait le Seigneur de lui donner la paix, en le guérissant, par la mort, de tant de souffrances. Et comme un jour il fut entré dans la susdite machine, savoir le lendemain de la nativité de saint Jean-Baptiste,[13] une pierre lancée par un mangonneau des ennemis lui tomba sur la tête, et il expira tout fracassé du coup. Ce que les assiégés ayant su le jour même, poussant des cris de triomphe, ils ne cachèrent pas combien ils en ressentaient de joie, tandis que dans l’armée la tristesse était grande. De fait, dans la ville ils étaient en vive angoisse, par peur d’un prochain assaut, outre qu’ils n’avaient de vivres qu’en petite quantité, et que, l’été venu, ils pouvaient craindre de ne pas faire la moisson. Mais voilà que celui qui répandait la terreur depuis la mer Méditerranée jusqu’à la mer Britannique, tombe sous un seul coup de pierre; si bien que par cette chute celui qui jusqu’alors était resté debout fut renversé, et que, le vaillant étant mort, le courage fut abattu dans le cœur des sujets. Davantage, je dirai que plus tard j’ai entendu le comte de Toulouse, qui est décédé dernièrement, vanter merveilleusement en Simon, quoiqu’il eût été son, ennemi, la constance, la prévoyance, la vaillance et toutes les qualités qui conviennent à un prince. Déjà lors le Seigneur donnait à voir qu’on s’était écarté de ses voies. On commandait avec orgueil à des gens qui ne voulaient pas obéir, et l’on ne s’inquiétait plus de purger les contrées de la perversité hérétique, à quelle fin tout avait été entrepris.
Le comte Simon étant mort, son fils, Amaury, son successeur et héritier, leva le siège, abandonnant aussi le château Narbonnais, qu’il ne pouvait garder, et il emporta à Carcassonne le corps de son père, après Ravoir fait embaumer, selon l’usage en France. Or donc le pays chancelant par suite de ces événements imprévus, très peu de jours après, Castelnau, dit d’Arri,[14] se rendit au comte de Toulouse: sur quoi le comte Amaury ne perdit pas de temps; et, rassemblant ses forces, il vint l’assiéger, et dressa ses machines contre la place, défendue et soutenue par le fils du comte de Toulouse. Et il advint un jour que Gui, comte de Bigorre, frère du comte Amaury, fut jeté bas dans un assaut, et, percé de coups, rendit l’âme. Son corps, décemment enfermé dans un cercueil couvert de pourpre, fut remis à son frère, et l’on se battit depuis la fin de l’été jusqu’à celle de l’hiver. Il arriva dans cette saison même que Foucaud et Jean de Brigier, tous deux frères, hommes vaillants et belliqueux, s’étant détachés de l’armée avec plusieurs autres, allèrent butiner sur les confins de Toulouse, coururent le pays avec bien grande audace, et ramassèrent quantité de prises. Lesquels furent poursuivis par Raimond, qui était à Toulouse; et atteints auprès de Basiége, ou ils étaient arrêtés, ils auraient pu échapper sans dommage, s’ils avaient voulu abandonner leur proie; mais ils trouvèrent le combat en rase campagne comme ils le cherchaient et dès le commencement de l’action, entourés, tout chargés qu’ils étaient de leur armure de fer, par les lanciers et arbalétriers montés sur des chevaux sans bardes, ils souffrirent beaucoup de cette attaque jusqu’à l’arrivée de ceux qui suivaient en force plus régulière. Pour lors les Français se ruèrent sur eux tout d’abord, les principaux en avant; et en ayant tué plusieurs, ils se sauvèrent, grâces à la vitesse de leurs coursiers. Le seigneur Sicard de Montaut fut relevé du champ de bataille par des amis à lui qui se trouvaient la, et dérobé à l’ennemi. Mais Foucaud et Jean, son frère, furent pris et gardés vivants avec quelques autres, pour être échangés contre les prisonniers déjà faits ou que l’on pouvait faire par la suite. Jean fut donc retenu dans Aniort pour Bernard Othon, lequel avait été pris à cette époque; et quant à Foucaud, il fut mis en prison dans le château Narbonnais. Finalement, ayant levé le siège, le comte Amaury s’éloigna au printemps de Castelnaudary, fort ennuyé et sans argent.
rendirent prisonniers, lui remirent la ville, et furent conduits à Puy-Laurens pour y être gardés tout le temps que ceux qui étaient prisonniers de l’autre côté seraient tenus en chartre. Ayant quitté Marmande, le seigneur Louis marcha vite à Toulouse par le plus court chemin, et son armée était bien considérable, car aussi loin que se prolonge le circuit du faubourg, plus une partie de la cité, et jusqu’au-delà de la Garonne, son camp s’étendait de toutes parts. Pendant plusieurs jours, il attaqua les assiégés avec ses machines et par de vigoureux assauts. Ne fut absent de ce siège le seigneur légat Bertrand, lequel avait cette entreprise à cœur. Bref, le prince Louis, ayant achevé le temps de son pèlerinage, se retira avec ses troupes, et retourna en France après avoir fait peu de chose, à cause de la puissante et valeureuse résistance des ennemis. Auparavant, il brûla ses machines, et l’on rendit de part et d’autre les personnages et chevaliers susnommés qui avaient été pris.
Après la retraite des Français, la guerre s’alluma avec plus de fureur, et plusieurs châteaux se rendirent au comte de Toulouse. Il advint l’hiver suivant que Foucaud de Brigier, et Jean, son frère, avec plusieurs autres chevaliers, coururent derechef par le même pays qu’ils avaient déjà pillé une fois, et y firent beaucoup de butin. Sur quoi le fils du comte de Toulouse venant encore sur eux, les vainquit, se saisit de leur personne, et fit porter à Toulouse, comme un présent agréable, les têtes des deux frères, qu’on y plaça en spectacle sur des pals; ce qui fut par plusieurs attribué à la vengeance divine, car ce Foucaud était un homme très cruel et plein d’orgueil, qui s’était, disait-on, fait une règle de mettre à mort tout prisonnier de guerre qui ne lui paierait pas cent sous d’or, lui faisant endurer les tortures de la faim dans une fosse souterraine, et voulant, quand on l’apportait ou moribond ou mort, qu’il fût jeté dans un égout. Même on raconta alors, et on dit encore qu’en partant pour cette dernière course, il fit mener à la potence deux misérables qu’il tenait en prison, savoir le père et le fils; et bien plus, qu’il força le père de hausser son enfant au gibet, après quoi il partit aussitôt pour son expédition, mais ne revint plus, étant récompensé par le Seigneur suivant ses mérites. Au demeurant, on ne doit ni ne peut raconter à quelles infamies se livraient les serviteurs de Dieu; la plupart avaient des concubines et les entretenaient publiquement; ils enlevaient de vive force les femmes d’autrui, et commettaient impunément ces méfaits et mille autres de ce genre. Or ce n’était bien sûr dans l’esprit qui les avait amenés qu’ils en agissaient ainsi; la fin ne répondait pas au commencement, et ils n’offraient pas en sacrifice la queue avec la tête de la victime. Somme toute, ils n’étaient ni chauds ni froids; mais parce qu’ils étaient tièdes, le Seigneur commença à les vomir de sa bouche, et à les chasser du pays qu’ils avaient conquis par son secours l’année suivante (la 1220e de l’Incarnation du Seigneur), la même où naquit Jeanne, fille du comte de Toulouse, un grand nombre de châteaux se rendirent à lui; et le château de Lavaur ayant été assiégé et pris, sa garnison fut égorgée, à l’exception de quelques-uns, qui se sauvèrent à la nage sur les terres de Sicard, vicomte de Lautrec, et échappèrent, grâces à sa femme, qui leur voulait du bien. Le château de Puy-Laurens ayant été assiégé du côté du bourg, fut livré, après qu’on eût donné sauvegarde à la dame Ermengarde, femme de feu Foucaud, à ses enfants et à toute la garnison, jusqu’à leur sortie du territoire conquis. Enfin, le château de Montréal fut attaqué et pris, son seigneur, Alain de Roucy, ayant été tué, et il se passa encore beaucoup d’autres événements durant cette époque qu’il serait prolixe de raconter, mais d’où il appert que le Seigneur était offensé et irrité contre ceux qui s’étaient laissés choir, sinon en considération de leurs ennemis, en haine pourtant de leur propre conduite. Or tout ceci se passait l’an du Seigneur 1220 et 1221.
L’année suivante de l’Incarnation 1222, le comte de Toulouse mourut frappé de mort subite,[15] de telle sorte qu’il ne put rien dire, mais ayant encore, comme on l’a dit, mémoire et pleine connaissance, il tendit les mains vers dom Jourdain, abbé de Saint Sernin, qui accourait près de lui, faisant geste de dévotion, puis, les frères hospitaliers de Saint-Jean étant survenus, qui posèrent sur lui un poêle avec la croix, il la baisa, et tout à coup il expira. Son corps fut porté dans leur maison; pourtant il ne fut point enseveli, attendu qu’il était excommunié; et on le garde encore aujourd’hui, comme on le voit, privé de sépulture, car son fils, par la suite des temps, après qu’il eut fait la paix avec l’église et le roi de France, eut beau produire des témoins devant le Siège apostolique, à l’effet de prouver qu’il avait donné signes de repentance, il ne put en aucune façon obtenir qu’il fût enseveli. La même année, Bernard Roger,[16] comte de Foix, mourut au siège du château de Mirepoix, non d’une blessure, mais d’un large ulcère. Or, l’année précédente, le vénérable père Conrad, de l’Ordre de Cîteaux, cardinal en l’église romaine, évêque de Porto, avait été député légat du Siège apostolique, lequel, apprenant que le jeune comte de Toulouse assiégeait le château de Penne en Agenais, de concert avec le comte Amaury, et après avoir réuni une forte troupe, alla au secours dudit château, passant par Albi et son diocèse, suivi de l’évêque de Limoges, et autres prélats en grand nombre; ils détruisirent le fort de Lescure, prirent, chemin faisant, la Bastide de Dieudonné d’Alaman, avec la garnison qui s’y trouvait: quant à ceux qui assiégeaient Penne, ils se retirèrent à leur approche. Du temps du même légat des trêves eurent lieu; et dans l’espoir d’Arriver à conclure la paix, deux conférences furent permises pour en traiter; savoir, l’une à Saint-Flour, ville d’Auvergne, et l’autre à Sens, métropole de la Bourgogne: mais autant en emporta le vent, parce que les péchés des Ammorhéens n’avaient pas encore comblé la mesure, et afin que par un jugement de Dieu alors secret, mais ensuite devenu manifeste, les choses n’en demeurassent pas là. En ce même temps, il se disait que le comte de Toulouse devait épouser la sœur du comte Amaury et un jour que le Toulousain (longtemps après la mort de son père) était venu à Carcassonne sous la garantie de la trêve, et qu’il y passa une nuit auprès du comte Amaury, facétieux comme il était parfois, il fit courir le bruit parmi ses compagnons, lesquels couchaient hors du château, que son hôte le retenait prisonnier; sur quoi ceux-ci, stupéfaits et bien effrayés prirent la fuite, courant toujours, jusqu’il ce qu’on leur eût appris que ce n’était qu’un jeu; et les deux comtes prirent entre eux grand soûlas de cette plaisante aventure. Au demeurant, la trêve expirée, ils recommencèrent à guerroyer, et les comtes de Toulouse et de Foix vinrent assiéger Carcassonne, car Bernard Roger, comte de Foix, avait la curatelle de Trencavel, fils du feu vicomte de Béziers, lequel alors pouvait bien avoir seize ans, ou environ; puis, après avoir tenu longtemps cette ville investie, dégoûtés et fatigués de leurs attaques infructueuses, ils en levèrent le siège. Le pays cependant tournait à eux, et le comte Amaury ne pouvait le garder, et n’avait pas assez d’argent pour entretenir des hommes de guerre et les retenir; si bien que certains chevaliers français, au nombre, comme on le dit alors, d’à peu près soixante, se départirent pour retourner en France. Or le comte de Toulouse étant venu à leur rencontre au-delà de Béziers, et iceux lui ayant livré leurs armes et leurs chevaux, à condition qu’il leur permettrait de se retirer sur des palefrois en sûreté et sans autre rançon, lui, cependant, les réputant déjà chose sienne, ne voulut consentir à cet arrangement. Sur quoi, nos Français, aimant mieux tenter une dernière fortune que de se laisser vaincre honteusement et garrotter, prirent les armes élurent l’un d’entre eux pour chef du combat, auquel ils obéiraient en tout; et, sachant bien qu’un choc donné d’ensemble enfante la victoire, ils se ramassent en une seule troupe, et, faisant filer en avant leurs valets et botes de somme, ils soutiennent d’abord les attaques redoublées des assaillants, jusqu’à ce qu’enfin, trouvant leur belle, ils font volte-face, fondent sur l’ennemi, le mettent en fuite, le poursuivent vigoureusement, en tuent un grand nombre, parmi lesquels Bernard d’Audiguier, vaillant chevalier du comtat d’Avignon, qui portait les armes du comte; et pensant avoir tué le comte lui-même, vainqueurs, malgré leur petit nombre, de cette multitude çà et là dispersée, ils se retirent dans la ville. De là ils vinrent glorieusement en France, faisant honneur aux armes françaises, et bien dignes en effet d’honneur et de gloire. Deux ans environ s’étant écoulés de la sorte au milieu des événements divers de la guerre, le comte Amaury, décidé par l’inconstance des gens de ses terres, et voyant que de jour en jour ils tournaient du côté des ennemis, résigna ses domaines à l’illustre roi de France, Louis, et le fit son successeur à tous ses droits;[17] ce que le père dudit roi, Philippe, trépassé en l’an du Seigneur 1223, n’avait jamais voulu accepter. A ce sujet, je rapporterai ce que disait l’évêque dom Foulques, qui assurait l’avoir entendu de la propre bouche dudit roi Philippe, lequel, durant sa vie, comme s’il eût présagé l’avenir: Je sais, disait-il, qu’après ma mort, les clercs feront tous leurs efforts pour que mon fils Louis se mêle de l’affaire des Albigeois; mais attendu qu’il est de faible et de débile santé, il ne pourra supporter cette fatigue, il mourra bientôt, et alors le royaume restera aux mains d’une femme et d’enfants, si bien qu’il ne chômera de dangers. Ce qu’il disait ainsi advint en partie par la volonté de la divine providence. En effet, le cardinal diacre, Romain de Saint-Ange, homme de distinction grande, agréable à Dieu et aux hommes, suffisamment propre au maniement de telles affaires, étant survenu avec le titre de légat, induisit, par l’aide de Dieu, le roi Louis d’embrasser l’entreprise restée imparfaite sous la conduite des autres, et qu’il lui était réservé de mener à terme. A ce le roi consentit, dévoué qu’il était à Dieu, et tout magnanime, et il accepta la cession à lui faite par le comte Amaury, en lui conférant l’office de la connétablie de France, d’autant qu’il le connaissait pour un homme sage non moins que vaillant et expert en guerre.[18]
En ce temps là mourut Bernard, comte de Comminges.[19]
L’an du Seigneur 1226, au printemps (époque où d’ordinaire les rois se mettent en campagne), ce roi béni de Dieu, le seigneur Louis, suivi d’une magnifique armée, décorée du signe de la croix, et incessamment accompagné du légat, se dirigea vers Lyon; ce qu’il fit à cause des commodités d’un pays plat pour le passage des chariots, et des facilités que la navigation du Rhône prête au transport des troupes. Au devant de lui accouraient les consuls des villes et bourgs qui appartenaient au comte de Toulouse, les forteresses lui étaient livrées, et on remettait des otages à sa discrétion. Même les citoyens d’Avignon, après lui en avoir donné, vinrent à sa rencontre; puis, lorsque le roi et le légat y furent arrivés, la veille de la Pentecôte, et qu’une bonne partie de l’armée avait déjà traversé le pont, il advint, comme je crois, par divin jugement, que ces mêmes habitants, saisis de crainte, alors que la crainte n’était pas raisonnable, et tremblant d’être expulsés s’ils souffraient que beaucoup de monde entrât par la ville, fermèrent leurs portes, permettant néanmoins le passage au roi avec un petit nombre des siens, si mieux n’aimait passer sous une roche par un très étroit chemin. Ce que le roi voyant lui être aussi (dangereux qu’insultant, il n’y voulut consentir, à moins de trouver libre entrée par la ville; de telle façon que les gens d’Avignon persistant dans leur résistance, le roi fit halte, ordonna de dresser les tentes, de tracer le camp suivant l’Ordre de guerre; et ayant élevé des pierriers et autres instruments de siège, commença à battre vivement la place, tandis que de leur côté les habitants, opposant machines à machines, se défendaient vaillamment.
Peu auparavant[20] avait trépassé le vénérable père dom Arnaud Amaury, archevêque de Narbonne, auquel succéda dom Pierre d’Ameil, archidiacre majeur de la même église, puis déclaré archevêque. Ce dit prélat, envoyé en avant dans ces entrefaites par le légat et le roi, les précéda, et, promettant la paix au nom de l’église et dudit prince, rallia à eux tant les châteaux et bonnes villes que leurs seigneurs, et tous les nobles et populations, presque sans nulle exception, depuis le haut pays jusqu’aux portes de Toulouse, de ce côté-ci du fleuve et vers la côte orientale; lesquels jurèrent d’Adhérer au roi et à l’église. Voire même les citoyens de Carcassonne apportèrent à Louis, dans son camp, les clefs de leur ville. Davantage, Roger Bernard, comte de Foix, demanda la paix; mais cette fois il ne l’obtint telle qu’il l’avait voulue.
Cependant les gens d’Avignon, dont le Seigneur avait résolu d’humilier par cette voie la superbe, après avoir résisté trois mois, et se voyant les plus faibles, rendirent, sauf certaines conditions, leur ville au légat et au roi, et furent punis par la ruine de leurs murailles et autres châtiments. De son côté, l’armée, par diverses maladies, avait perdu beaucoup de monde; ni fut-ce une petite grâce que la ville capitulât de bonne heure, car quinze jours à peine s’étaient écoulés depuis le départ des assiégeants, que la Durance fit irruption hors de son lit, et à tel point s’enfla qu’elle inonda la plaine où le camp du roi avait été placé, si bien que l’armée n’eût pu s’y tenir. Au départ du roi bon nombre des siens s’en retournèrent en France.
Quant au roi, il se dirigea vers Béziers et Carcassonne, toujours accompagné du légat; et ne trouvèrent-ils en défaut dom Foulques, évêque de Toulouse, lequel, tandis qu’ils furent à l’armée ou en route, fit tant qu’à sa magnificence personne ne pouvait se douter qu’il fût banni de chez lui. En effet, le roi ayant passé avec le légat, du côté de Pamiers, le prélat, fidèle à ses largesses ordinaires, lui envoya, avant son entrée dans le diocèse de Toulouse, de copieuses offrandes de pain, de vin et de viande. Et son renom de vertu et l’éclat des travaux qu’il avait soufferts pour la foi le rendaient à tous vénérable.
Durant son séjour à Pamiers, le roi, par le conseil du cardinal, régla quantité de choses en l’honneur de Dieu et de la liberté ecclésiastique, et surtout sévit, par un statut nécessaire autant que profitable, contre les contempteurs des clefs de l’église, duquel il est fait mention dans le concile de Narbonne, tenu bientôt après dans le carême suivant, et qui commence par ces mots; Felicis recordationis.
A leur sortie de Pamiers, passant par Beaupuy, où ils couchèrent, le roi et le légat vinrent à Castelnaudary, de là à Puy-Laurens, où ils couchèrent pareillement, puis à Lavaur. Ils en partirent pour se rendre à Albi, après avoir laissé le pays à la garde du seigneur Imbert de Beaujeu, vaillant homme de guerre et tout dispos à bien travailler, ayant avec lui une forte troupe. Enfin ils suivirent leur route par l’auvergne; mais, prévenu par une maladie dont il était, comme on l’a dit depuis, atteint secrètement, le roi, par la volonté de Dieu, accomplit à Montpensier le cours de la vie de ce monde, et meurt en automne.[21] Or était son dessein, s’il avait vécu, de retourner dans ces contrées au printemps suivant.
Sa maladie était de telle nature, disait-on, qu’elle aurait pu céder à l’usage d’une femme. Si bien, comme je l’ai recueilli d’un personnage digne de foi, que le noble homme, Archambaud de Bourbon, lequel se trouvait à la suite du roi, ayant appris que ce prince pouvait se bien trouver des embrassements d’une jeune fille, il fit, par ses chambellans, introduire de jour dans sa chambre et pendant qu’il dormait, une pucelle choisie, belle, de bonne maison, et à qui on avait fait la leçon sur la manière dont elle s’offrirait; au roi, lui disant qu’elle ne venait point par envie de débauche, mais, pour alléger le mal dont elle avait ouï parler. En s’éveillant, le roi, à la vue de cette femme, qui tâchait de pénétrer jusqu’à lui, lui demanda qui elle était et comment elle était entrée, sur quoi elle lui déclara, suivant qu’on le lui avait enseigné, à quelle fin elle était venue. Il n’en sera point ainsi, jeune fille, lui dit le saint roi; je ne pécherai mortellement de quelque façon que ce soit ; puis ayant fait appeler ledit seigneur Archambaud, il lui ordonna de la marier honorablement. Ainsi ce prince, non moins fait par ses vertus que par son titre pour régir les autres, se régissait lui-même avec une vertu si grande, qu’il ne voulut, au prix d’un péché, éviter, s’il se pouvait, la mort corporelle.
Louis, son fils aîné, lui succéda à la couronne. Il avait quatorze ans quand il commença à régner, et, eu égard à son âge, rappelait les mœurs et les qualités de son père. Il arriva donc ce que son aïeul Philippe craignait, comme je l’ai dit plus haut, que le royaume resta au pouvoir d’une femme et d’un enfant; mais bien que maintes et maintes nouveautés aient paru dans les premiers temps du jeune roi, on vit bien cependant que Dieu prenait en main la cause du royaume, principalement les affaires dont il est ici question, ainsi que les chapitres suivants le montreront jusqu’à évidence.
Dans la même année que ci-dessus, durant l’hiver suivant, une garnison placée dans le château de Hauterive fut attaquée par le comte de Toulouse, et se rendit à lui, moyennant la vie sauve, avant que les secours fussent arrives. Là, mourut d’un coup de carreau Etienne de Ferréol, homme noble du diocèse d’Agen et du parti dudit comte. Vers le même temps, on gardait un autre château, ayant nom Bécède, que le seigneur Humbert assiégea l’été suivant, lorsqu’on comptait déjà l’an 1227 du Seigneur, et dans lequel le comte de Toulouse avait mis en garnison les vaillants personnages Pons de Villeneuve, Olivier de Termes et maints autres gens de guerre. Or à l’armée se trouvaient l’archevêque de Narbonne et l’évêque de Toulouse, lequel, un jour qu’il passait avec plusieurs autres autour de la ville, fut à grands cris appelé par ces infidèles l’évêque des diables. « Entendez-vous, lui dirent ceux de sa suite, comme ils vous appellent l’évêque des diables? —Certes, reprit-il, et ils disent vrai, car ils sont les diables, et moi je suis leur évêque. »
Au demeurant, ledit château, vivement battu par les machines, fut pris, et un bon nombre, tant chevaliers que piétons, s’étant sauvé de nuit, le reste périt, partie par l’épée, partie par la potence. Les enfants et les femmes furent endoctrinés par le pieux évêque quant aux hérétiques, Guiraud de la Motte, leur diacre, et ses compagnons furent consumés par le feu des bûchers.
L’hiver suivant, le château de Saint-Paul se rendit au comte de Toulouse, davantage, vers le temps de Pâques, il recouvra Castel Sarrazin, après avoir assiégé et enfermé la garnison dans le faîte du château; et bien que l’on se hâtât d’y porter des secours, à l’aide des gens du pays et des autres forces qu’on avait sous la main (car le seigneur Gui de Montfort, blessé par une flèche, était mort à Vareilles quelque temps auparavant[22]), on ne put parvenir jusqu’aux assiégés. A l’extérieur, le comte de Toulouse les avait enfermés au moyen d’un grand retranchement muni de fortifications qui faisaient face à toute attaque, soit du dedans, soit du dehors. Là se réunirent l’archevêque de Narbonne, les évêques de Toulouse et de Carcassonne, et le seigneur Humbert de Beaujeu, le quel, après la prise de Bécède, s’était retiré dans ses domaines; à temps accourut aussi l’archevêque de Béziers, après avoir rassemblé une troupe de gens de guerre. En ce moment, l’évêque de Toulouse séjournait non loin dudit lieu, de l’avis des prélats et des barons, savoir à Villedieu, laquelle appartient aux Templiers; et, comme ceux qui étaient venus les premiers au secours de Castel Sarrazin, ayant d’abord trouvé cette place sur leur chemin, n’avaient pu s’y faire recevoir jusqu’à ce que, sur la garantie du prélat, le frère dom Gui de Bruciac, chevalier prudent, et commandeur de ladite commanderie, y eût admis les Français et leur eût vendu les vivres sans lesquels l’armée ne pouvait se suffire à elle-même, ledit évêque y demeurait, tant pour se reposer, que pour veiller à sa garde. Or, il advint que douze jeunes gens de la ville s’assemblèrent, et firent serment de la livrer, ainsi que l’évêque, au comte de Toulouse. Mais ledit commandant ayant été instruit de leur complot par un bailli à lui, auquel ils l’avaient révélé, faute de pouvoir agir sans son aide, il les fit saisir, mettre au cachot, et les força de tout avouer. Quant au prélat, il conseilla au frère Gui, et le pria, homme pieux qu’il était et portant pour les malheureux des entrailles de miséricorde, de leur faire grâce et les faire sortir sans retard de la ville, vu qu’il ne pourrait lès empêcher d’être pendus, lorsque l’armée arriverait; et il fut fait comme il avaition et là fut pris le noble homme Othon de Terride, avec Othon de Linière et autres chevaliers. Au demeurant, ceux qui étaient renfermés dans le fort de Castel Sarrazin, n’ayant plus rien à manger, le livrèrent aux ennemis, moyennant la vie sauve. En même temps il était question d’Assiéger sur l’heure le château de Saint-Paul, et à cette fin les croisés vinrent à Lavaur.
Mais ce qui était plus urgent, savoir le démantèlement de la cité de Toulouse fut arrêté, en l’an du Seigneur 1227.[23] On abandonna donc le premier projet susdit, toutes les forces furent réunies, et jointes par les prélats de Gascogne, qui arrivaient de toutes parts, l’archevêque d’Auch et celui de Bordeaux, ainsi que certains archevêques et barons, avec leurs gens, revêtus du signe de la croix, se dirigèrent sur Toulouse, aux environs de la Nativité de saint Jean, dressèrent leur camp dans ce lieu, vers l’orient, qu’on nomme le Puits d’Amaury, et commencèrent à démolir les mantelets du côté le plus élevé de la ville; puis les ayant jetés bas dans cette première partie, ils transportèrent leurs tentes au lieu qu’on appelle Montaudran, et accablèrent les ennemis d’un triple travail et dommage. En effet, ils employaient une troupe nombreuse à couper les moissons; plus, d’autres, qui détruisaient les tours et les remparts des forts à coups de pioches de fer; item, enfin un grand nombre qui travaillaient sans relâche à démanteler les remparts. Or ceux-ci observaient chaque jour l’Ordre suivant. Dès l’aurore, après avoir entendu la messe, ils prenaient un léger repas, puis, précédés des arbalétriers, et suivis des bataillons préparés au combat, ils arrivaient jusqu’aux mantelets les plus rapprochés de la ville, presque avant que les habitants fussent encore éveilles; et partant de là, ils revenaient sur leurs pas, la face tournée vers le camp, ruinant lesdits mantelets, et accompagnés petit à petit par les gens de guerre.
C’est dans cet ordre qu’ils opéraient chaque jour, jusqu’à ce qu’après trois mois environ, la besogne fut quasi entièrement achevée. Je me rappelle ce que disait le pieux évêque, tandis que nos travailleurs s’éloignaient de la ville comme en fuyant: Nous triomphons par merveille de nos ennemis en leur tournant le dos. En effet, c’était les engager à conversion et à humilité que de leur enlever ce dont ils avaient coutume de s’enorgueillir, de même qu’on ôte à un malade, pour son bien, ce qui pourrait lui nuire par excès. C’est dans ce sentiment que ce père, plein de compassion, agissait envers ses enfants, lui qui, comme un imitateur de Dieu, ne voulait pas la mort des pécheurs, mais leur conversion et leur vie. En tout, ce qu’on faisait se rapportait beaucoup à ce dessein de l’évêque et autres semblables personnages, savoir, que tout ce dommage donnât intelligence à l’adverse partie, et de plus saines pensées: ce qui s’ensuivit dans le fait, ainsi qu’on va le voir.
Cette, expédition terminée, les prélats, barons, chevaliers et gens de Gascogne s’en retournèrent chez eux quant aux autres, ils montèrent en force vers Pamiers, jusqu’au Pas de la Barre, envahissant les terres du comte de Foix, et dressant leurs tentes dans une plaine près du lieu qu’on nomme Saint Jean des Vierges; ils y passèrent plusieurs nuits, puis, ayant laissé garnison là où besoin était, ils revinrent sur leurs pas.
Cependant le vénérable abbé de Grandselve, dom Élie Guarin, survint de France, offrant, au nom du légat, la paix aux Toulousains, qui, fatigués des nombreuses vexations qu’ils avaient eu à supporter, consentirent à traiter. La trêve donc étant déclarée, des conférences eurent lieu aux environs de Basiége; l’on convint de se montrer en France, et le premier endroit indiqué fut à Meaux, en Brie, au territoire du comte de Champagne. Là se trouvèrent, tant invités que spontanément, l’archevêque, et ses suffragants, de la province de Narbonne; plus, le comte de Toulouse et autres personnages enfin, des citoyens de Toulouse, lesquels sont nommés dans le traité de paix ou autres pièces qui s’y rapportent. Le légat y fut aussi présent avec maints prélats convoqués à cet effet, et l’on y demeura plusieurs jours pour s’entendre sur la manière de conclure l’affaire. Ensuite ils vinrent ensemble à Paris, afin que le tout fût accompli en présence du roi; et les conditions ayant été entièrement arrêtées et scellées, le comte fut réconcilié à l’église la veille de Pâques;[24] en même temps ceux qui étaient avec lui furent déliés de la sentence d’excommunication. Et c’était pitié que de voir un si grand homme, lequel, par si grand espace de temps, avait pu résister à tant et de si grandes nations, conduit nu en chemise, bras et pieds découverts, jusqu’à l’autel. Étaient présents deux cardinaux de l’église romaine, un légat, celui de France, et un autre au royaume d’Angleterre, savoir l’évêque de Porto.
Quant à la teneur du traité, c’est ce que je n’ai pas besoin de transcrire ici, vu qu’elle a été publiée, et que plusieurs l’ont mise par écrit. Mais je ne veux pas manquer de dire que, quand le royaume tomba dans les mains d’une femme et d’enfants, ce que le roi Philippe, leur aïeul, redoutait après la mort de son fils, n’arriva que par la volonté d’en haut et la bonté du Roi des cieux, protecteur des Français. En effet, pour premiers auspices du règne du jeune prince, Dieu voulut à tel point honorer son enfance à l’occasion d’une si longue guerre avec le susdit comte, que, de plusieurs clauses contenues au traité, chacune eût été à elle seule suffisante en guise de rançon, pour le cas où le roi aurait rencontré ledit comte en champ de bataille et l’aurait fait prisonnier, comme, par exemple, qu’il ne pourrait laisser a aucun héritier de lui, Toulouse et l’évêché toulousain, qui ne lui étaient accordés que sa vie durant, et que nul de ses héritiers ou de ceux de sa fille n’y pourrait prétendre aucun droit, à moins qu’il ne descendît de la propre mille ou du frère du roi, item, qu’il aurait pour peine de passer cinq ans outre mer, item, qu’il s’obligeait à payer vingt-sept mille marcs d’Argent; item, qu’il cédait pleinement au roi et abandonnait à l’église, toute autre terre que l’évêché de Toulouse, à l’orient et au-delà du Rhône. Je ne parle pas des autres charges auxquelles il se soumit, et telles, qu’eût-il été prisonnier, il en semblerait bien grièvement muleté; en sorte que le tout, aussi bien que tout ce qui fut fait par la suite, paraît venir, non de l’homme, mais de Dieu même. Je me rappelle aussi que le repos ayant été rendu au royaume de ce côté, le roi d’Angleterre et le comte de Bretagne, qui l’attaquaient d’un autre, furent, grâce à la protection divine, repousses par les forces du roi enfant; et que le comte, ayant remisa son fils le comté qu’il tenait de sa mère, dut partir outre mer, pour y rester cinq ans. Pareillement la révolte des gens qui soutenaient Philippe, comte de Boulogne, aspirant au trône, s’éteignit par la mort dudit Philippe; enfin, Thibaut, comte de Champagne, sentit qu’il lui serait dommageable de regimber contre l’aiguillon; et le tout advint afin que les rois des Français, quels qu’ils soient, sachent qu’il est juste d’embrasser la cause de Dieu, d’autant qu’il embrasse la leur de telle sorte.
A cela j’ajouterai que le comte de Foix, qui jadis avait demandé la paix au père dudit roi, pour son compte et sans son seigneur, le comte de Toulouse, et ne l’avait point obtenue telle qu’il la désirait, resta en état de guerre, le roi ayant cédé par le traité au comte de Toulouse le pays qui avait été conquis jusqu’au Pas de la Barre, lequel il occupa et y mit ses baillis jusqu’à ce que par la suite des temps, et après que le comte de Foix eût composé avec le roi, moyennant mille livres de revenu, que ce prince lui donna en terres, ledit comte de Toulouse remit le susdit pays, à partir du Pas de la Barre à ce même comte de Foix, pour le tenir en commande, sauf à le rendre sans délai quand il en serait requis; et il l’a conservé sa vie durant jusqu’à ce jour.
Après la paix, conclue à Paris vers la fin de l’année, la cité de Toulouse fut, l’année suivante (du Seigneur 1229), et au mois de juillet, réconciliée à l’église par maître Pierre de Colmieu, faisant fonctions de légat, avant que le comte fût revenu de France; lequel, de son propre gré, resta à Paris dans la prison du roi, jusqu’à la destruction des murs de Toulouse, des châteaux et faubourgs, selon qu’il avait été convenu, et que sa fille, Jeanne, âgée de neuf ans, eût été remise à Carcassonne, ès mains des envoyés royaux, la même qui fut depuis épousée par Alphonse, frère du roi, comte de Poitou. Finalement, le susdit comte ayant été fait chevalier par le seigneur roi le jour de la Pentecôte, et ayant accompli sur-le-champ les conditions du traité, il revint dans ses domaines, et quelques jours après il fut suivi par le légat envoyé pour veiller à la démolition des châteaux forts, et arrêter les croisés qui, si la paix ne fût intervenue, seraient arrivés en armes pour continuer la guerre. Le même légat célébra à Toulouse, au commencement de l’automne, un concile où se trouvèrent les archevêques de Narbonne, d’Auch, de Bordeaux, et force évêques et autres prélats. Là parurent aussi le comte de Toulouse et les autres comtes, hors celui de Foix; les barons, le sénéchal de Carcassonne et les consuls de Toulouse, au nombre de deux, savoir un pour la cité et un pour le faubourg; lesquels jurèrent les clauses du traité au nom de la généralité, et tant le comte que les autres l’approuvèrent et en firent autant, de même que plus tard tout le pays.
D’ailleurs, le légat, homme prudent et circonspect, ne voulant point sembler omettre rien de ce qui touchait à l’affaire présente, ordonna qu’inquisition fût faite contre les suspects d’hérésie, et dans ce dessein, Guillaume de Solier, lequel avait été ministre hérétique et s’était volontairement éloigné de la perdition, fut rétabli en bonne renommée, afin que son témoignage valût contre ceux au sujet de qui il savait la vérité. Or cette inquisition fut réglée de telle sorte que chaque évêque présent eût à examiner les témoins que l’évêque de Toulouse produisait, à lui remettre, pour être conservés, leurs dires rédigés par écrit, et qu’ainsi ils pussent en peu de temps expédier grand nombre d’Affaires. Puis, après qu’on eut appelé et ouï gens réputés fidèles et bons catholiques, on procéda sur le champ à citer en témoignage quelques uns de ceux qui étaient suspects. Mais eux, se doutant du coup, s’engagèrent d’Avance mutuellement à ne rien dire qui pût nuire aux autres ce qui fut assez prouvé par le fait, puis qu’aucun des leurs appelés en témoignage n’avoua rien. Pourtant, il y en eut quelques-uns qui, usant de plus saine résolution, vinrent tout d’abord et avant les autres, se soumirent au légat ou se livrèrent à lui, et trouvèrent ainsi une miséricorde dont se rendirent indignes ceux qui avaient la tête dure, et qui, contraints ensuite, et comme traînés par force, subirent de rudes pénitences. Il y en eut encore, mais en petit nombre, qui dirent vouloir se défendre juridiquement, et demandèrent qu’on leur fit connaître les noms des témoins qui avaient dépose contre eux, observant qu’ils pouvaient être des ennemis capitaux, auxquels il ne fallait pas accorder croyance; et ceux-là suivirent le légat jusqu’à Montpellier, en insistant toujours. Sur quoi le légat, présumant qu’ils ne requéraient ceci que pour tuer ceux qu’ils sauraient avoir déposé spécialement contre eux, il éluda adroitement leurs instances, et leur montra seulement le nom de tous les témoins ouïs dans l’inquisition toute entière, pour qu’ils vissent s’ils y reconnaîtraient leurs ennemis. Ainsi donc se voyant pris, et ne pouvant reconnaître ceux qu’ils disaient leur en vouloir, puisqu’ils ignoraient qui les avait accusés, ces gens se désistèrent du litige commencé, et finalement se soumirent à la volonté du légat. Quant à lui, passant le Rhône, il vint tenir un autre concile à Orange, ville cisalpine, avec les archevêques, évêques et prélats, et étant au château de Mornas, il remit les lettres des pénitences par lui ordonnées contre les suspects, signalés en suite de l’inquisition, à l’évêque de Toulouse, qui à son retour les publia dans l’église de Saint-Jacques où ils furent assemblés.
Dans ce temps-la, André de Calvet, vaillant chevalier et sénéchal du roi, fut surpris et tué par certains ennemis dans le bois qu’on nomme Centenaire. Pour ce qui est du légat, il emporta à Rome toutes les pièces de la susdite inquisition, de peur que si elle venait à tomber dans les mains de malveillants, elle ne fût une cause abondante de meurtres sur la personne des témoins qui avaient déposé contre telles gens; et, néanmoins, après son départ, quelques-uns d’entre eux, de même qu’un grand nombre de persécuteurs des hérétiques, furent égorgés sur de simples soupçons. Pour quels faits et autres semblables, qui de ce temps furent commis par ces ministres du diable, les croyants, le comte de Toulouse fut maintes et maintes fois accusé de crasse négligence, tant auprès du Siège apostolique, que du roi de France, et même réprimandé, comme on le verra plus bas. Or, tout ceci provenait de ceux qui voulaient ramener l’éruption diurne nouvelle guerre, et revenir aux maux passés, pour qu’à la faveur du trouble, ils pussent exercer leurs rapines ordinaires et favoriser les hérétiques de ceux enfin qui feignaient d’aimer le comte et ouvraient le précipice sous ses pas. D’où vint que les enfants de Bélial s’élancèrent des abîmes où ils se tenaient cachés, ruinant les dîmes de l’évêque, poursuivant ses clercs et infestant son domaine. Et à ce sujet, pour remonter quelque peu plus haut, je dirai, à la gloire dudit évêque, qu’il se montra grandement libéral pendant la tenue du concile de Toulouse, bien qu’il eût, cet été là, recueilli à peine quelque chose, envoyant aux prélats des présents de pain, de vin, et autres objets, non point dans des corbeilles à la main ou dans de simples fioles, mais bien dans des paniers et barriques. Pareillement il s’acquittait, comme il disait, par un doux échange, envers les étrangers qui l’avaient vu chercher un refuge sur leurs terres et l’avaient honorablement traité. Enfin une famine étant survenue après le départ des pèlerins, lesquels avaient dévasté les récoltes, le pieux évêque en fut tellement affecté, que non seulement il faisait des distributions quotidiennes à tous les mendiants qui se présentaient, mais qu’il nourrissait même les pauvres honteux, qu’il allait dépister jusque dans leur logis. C’est pourtant en ce temps-là que les pervers l’allaient molestant; sur quoi il interpella un jour le comte: Je sais, dit-il, que l’an passé (car c’est en l’an du Seigneur 1230 qu’il parlait ainsi), j’ai, grâces à Dieu et à vous, recueilli assez paisiblement mes dîmes, quant au trouble qu’on me suscite maintenant, il n’y a pas de doute qu’il faut vous l’attribuer. Mais ne doutez pas non plus que je ne puisse fermer les yeux sur tout ceci, moi qui suis prêt, selon mon usage, à m’exiler encore. Un an s’est écoulé depuis le temps où j’étais mieux en exil que dans mon évêché. Sur quoi, quand il se fut retiré, le comte répéta ses paroles, savoir qu’il allait s’éloigner de nouveau. Mais il nous faut maintenant retourner à notre sujet.
L’an du Seigneur 1280, sur l’avis des prélats, le vénérable père dom Clarin, évêque de Carcassonne, approcha le Siège apostolique, et obtint que l’évêque de Tournai, homme de grande vertu et prévoyance, serait envoyé comme légat pour veiller à l’achèvement des affaires de la foi et de la paix jurée. A son arrivée, ce dit prélat assigna le comte, pour réformer les choses qu’on disait contraires au traité naguère conclu à Paris; pour quoi fut un jour indiqué à Castelnaudary, dans l’église de Pierre Blanche, à tous ceux qui auraient un grief ou plusieurs à exposer; afin qu’en fût remise la note par écrit au comte, qui de son côte s’engagea à tout réparer, autant qu’il serait en lui.
Vers ce temps-là l’évêque composa avec les anciens seigneurs et chevaliers de Vertfeuil, vu qu’il n’était aisé, pour lui ni pour ses clercs, de soutenir la guerre que certains bandits lui faisaient, peut-être par le conseil et avec l’approbation de plus grands personnages; en sorte qu’il était obligé, par crainte de leurs entreprises, démener avec lui des hommes armés, tandis que les autres jouissaient en repos de la paix récemment conclue. N’oublions pas, au demeurant, de dire qu’il reçut du comte reconnaissance et hommage pour le château de Fanjaux.
Cependant l’évêque, autant qu’il le pouvait, vaquait à son office, réglant les églises, visitant le peuple et les néophytes. Lorsqu’il eut bien disposé toutes choses, ressuscité son évêché qui, avant lui, était quasi mort, et tiré des mains des laïques les dîmes nécessaires à l’entretien et à l’existence honorable de ses successeurs, lui qui en arrivant n’avait pas trouvé pour vivre cent sous toulousains, il acheva son dernier jour, en la fête de Noël, l’an 1231 du Seigneur, qui voulut enfin récompenser son serviteur selon ses mérites.
Ledit révérend évêque ayant été enseveli dans le couvent de Grandselve, de l’Ordre de Cîteaux, quelques jours après on élut le vénérable homme frère Raimond, prieur provincial de l’Ordre des Prêcheurs, en Provence, à l’évêché de Toulouse, de l’accord unanime du chapitre général de l’église, laquelle élection soumise au légat fut par lui approuvée sur-le-champ. Or je sais un homme auquel son vénérable prédécesseur, non moins soigneux pendant sa vie de l’avenir que du présent, et désireux d’avoir un successeur zélé pour les choses auxquelles il avait travaillé lui-même sans pouvoir y mettre la dernière main avait, fait mention du dit frère Raimond, qu’il connaissait et avait souvent eu près de lui, comme d’un homme qui lui paraissait propre à le remplacer; d’où je pressentis, après l’élection, que c’était lui-même qui l’avait obtenue du Seigneur; et cette grâce même a été fixité à l’église de Toulouse, qu’en comptant dom Foulques, trois évêques, au souvenir de la génération présente, ont été élus successivement sans opposition de la part du chapitre, afin que ce pays, déjà assez troublé d’autre manière, n’eût encore à souffrir plus grièvement faute de pasteurs, et des suites d’une dissension dans le chapitre du diocèse. Ayant donc été élu le jour de Saint-Benoît, il fut consacré le dimanche de carême où l’on chante à l’office Laetare Jérusalem ! Et le dimanche suivant, jour de la Passion du Seigneur, il fit son entrée dans son église, cette même année 1231, en procession solennelle du clergé et du peuple.
Ledit évêque commença au point où son prédécesseur avait été arrêté, en poursuivant vivement les hérétiques, défendant courageusement les droits ecclésiastiques, et en amenant le comte, tantôt par la vigueur, tantôt par la douceur, à tout le bien qu’il pouvait en tirer. L’an du Seigneur 1232, l’évêque et le comte passèrent une nuit à chercher ensemble dans les montagnes certains hérétiques qu’on leur avait indiqués; ensuite de quoi Dieu leur livra, dans le nombre des hommes et des femmes, dix neuf de leurs ministres, parmi lesquels fut pris Pagan de Bécède, jadis seigneur dudit château. Néanmoins le comte, selon le vent qui soufflait sur lui, de chaud qu’il était, devenait tiède et paresseux à poursuivre l’affaire de la foi et de la paix, de façon que parfois on lui trouvait moins de ferveur pour le bien de l’une et de l’autre, Aussi le susdit légat, ayant rassemblé près de lui le vénérable archevêque de Narbonne et plusieurs des évêques ses suffragants, le cita devant le roi, qui lui-même Pavait assigné, au sujet de plusieurs articles du traité de Paris qu’il avait observé moins fidèlement qu’il ne convenait et qu’il n’aurait dû le faire. Finalement, il fut arrêté que le comte arrangerait toutes choses sur le rapport de l’évêque de Toulouse et d’un chevalier que le roi nommerait pour y aviser avec le prélat; lequel, après la conférence de Melun, revint le premier, et régla les articles de réformation. Après lui fut envoyé le seigneur Gilles de Flageac, chevalier prudent et discret, qui, chemin faisant, passa en Provence pour voir, de l’Ordre du roi, la fille aînée du comte, sa future femme; à son arrivée à Toulouse, tous lesdits articles furent présentés au comte de Toulouse: de là il forma ses statuts, qu’il publia dans le cloître de Saint-Étienne de Toulouse, en assemblée générale, en présence du légat, de plusieurs barons et du sénéchal de Carcassonne, lequel les approuva, les prenant même pour les observer dans sa sénéchaussée, et il les remit scellés audit chevalier, afin qu’il les portât en France: le tout fut fait l’an du Seigneur 1233.[25]
Dans la même année, en la nuit de la Circoncision du Sauveur, un hiver non moins rigoureux que continu se déclara avec toutes ses horreurs; en sorte que les semences furent gelées jusqu’à la racine.
Dans le même temps, frère Pierre, prieur des frères Prêcheurs de Barcelone, revenant du chapitre général tenu à Bologne, traversa le diocèse et la ville de Toulouse, où il parut comme un homme puissant en œuvres et en paroles; et Dieu faisait par lui choses merveilleuses sur les malades.
Item, vers ce temps-là, le seigneur légat célébra un concile à Béziers, et fit du mieux qu’il put pour rétablir la paix entre les comtes de Toulouse et de Provence, use, et le firent leur seigneur, pour qu’il s’emparât de leur ville, au détriment desdits comte et évêque. Il y marcha donc en force, fit reculer l’ennemi, qui ne voulut même pas l’attendre, et dès lors il y tint toute sa vie un lieutenant à lui, en tirant pour revenu, non ce qu’il voulait, mais seulement ce qu’il plaisait aux habitants, qui déjà avaient oublié leurs dangers, et dont maintes et maintes fois il lui fallut éprouver l’inconstance.
La légation de l’évêque de Tournai, le souverain pontife confia aux frères de l’Ordre des Prêcheurs l’inquisition à faire contre les hérétiques, et à cette fin furent délégués frères Pierre Cellani et Guillaume Arnaud, qui citèrent quelques hérétiques de Toulouse qu’ils pensaient pouvoir plus facilement convaincre, et les signalèrent comme hérétiques reconnus, puis, en cette façon, l’inquisition commença peu à peu à atteindre certaines gens plus considérables. Il ensuivit que quelques-uns, gens de grosse fortune, entreprirent de mettre obstacle à l’office des inquisiteurs, ce qui profila à tel point en mal, et prévalut de telle sorte, que les frères ainsi que l’évêque furent contraints de quitter la ville, et que même le couvent tout entier des frères Prêcheurs fut jeté dehors d’un seul coup;[26] quant à ce qu’on fit éprouver aux chanoines de l’église et à leurs gens, je le veux taire par révérence pour la ville, dont un peu de mauvais levain corrompit dans ce moment et en cette occasion la masse entière, bien que bonne en soi. En ce même temps, l’évêque de Tournai ayant été déchargé du fardeau de ses fonctions, il fut remplacé par le vénérable seigneur Jean, archevêque de Vienne, sur quoi, si l’on a lu ce que le souverain pontife, le seigneur pape Grégoire ix, lui écrivit au sujet de ce qui précède, on connaîtra toute la vérité. Quant au susdit évêque, malgré la fièvre quarte dont il était affligé, il ne tarda point à approcher le Siège apostolique, et à révéler le mal au souverain pontife. Au demeurant, nombre de choses furent réglées par la sollicitude du nouveau légat, afin que l’inquisition courût plus librement, établissant que ceux qui voudraient dans un délai de grâce dire toute la vérité sur eux-mêmes et les autres, en jurant de ne plus récidiver à l’avenir, n’auraient rien à craindre pour leur personne ou leurs biens, et devenaient des pénitents à supporter. Même, attendu que les frères Prêcheurs étaient craints comme trop rigides, on leur adjoignit un collègue de l’Ordre des frères Mineurs, lequel devait tempérer leur rigueur par sa mansuétude; davantage, il fut ajouté par grâce que les inquisiteurs se transporteraient dans les diverses villes du pays, et là entendraient les habitants, afin qu’ils ne semblassent pouvoir se plaindre du méchef qu’ils éprouveraient en allant à des lieux (éloignés de leur territoire. Comme il fut fait ainsi, et les inquisiteurs arrivés à Castelnaudary ayant appelé devant eux hommes et femmes du voisinage, ils les trouvèrent presque tous tellement liés entre eux qu’on ne pouvait en extorquer une vérité, ou si peu que rien. Pour quoi, tout à coup et à l’improviste, ils se transportèrent à Puy-Laurens, où nul concert n’avait encore été formé, et là ils trouvèrent qu’on avouait passablement, jusqu’à ce qu’une lettre, obtenue n’importe comment des magistrats municipaux, vint retenir longtemps l’inquisition en suspens.
Cependant, dans la suite des temps, l’archevêque de Vienne fut rappelé de ses fonctions, et le souverain pontife envoya à sa place un légat a latere, savoir l’évêque de Préneste, cardinal de l’église romaine.
L’an du Seigneur 1239, le troisième jour de juin, le samedi de la semaine, à six heures il y eut une éclipse de soleil; une autre pareillement dans la même année, le jour de la Saint-Jacques. Cette fois le soleil fut obscurci plus que quand il pâlit vers le soir, mais non point comme la fois précédente, car alors l’obscurité était telle que les étoiles paraissaient.
L’année suivante (an du Seigneur 1240), le comte de Toulouse, ayant réuni une nombreuse armée, pénétra en été dans la Camargue, et s’en fut contre la cité du comte d’Arles, auprès de Trinquetaille, en deçà du Rhône, et la guerre dura presque toute la saison, tant par l’attaque et la défense des remparts, au moyen des machines, pierriers et autres instruments de siège, que par des combats livrés sur le fleuve. Les Marseillais étaient venus au secours du comte de Toulouse, comme étant leur seigneur.
En ce même temps, Trencavel, fils de l’ancien vicomte de Béziers, de concert avec les notables seigneurs Olivier de Termes, Bernard d’Orzals, Bernard Hugues de Serrelongue, Bernard de Villeneuve, Hugues de Romegous, son neveu, et Jourdain de Saissac, envahit les terres du seigneur roi, dans les diocèses de Narbonne et de Carcassonne; même bon nombre de châteaux tournèrent à lui, Montréal, Montolieu, Saissac, Limoux, Azillan, Laurac, et tout autant qu’il en voulut, dans ce premier moment d’élan et d’effroi. De l’autre côté, entrèrent à Carcassonne les vénérables pères archevêque de Narbonne et évêque de Toulouse, plus les barons de la contrée et plusieurs clercs du pays avec leurs gens et effets, se confiant dans la sécurité que leur inspiraient également la ville et le faubourg; en effet, l’évêque de Toulouse y descendait souvent, prêchant les bourgeois, et les réconfortant et prémunissant contre la défection envers l’église et le roi qui ne souffriraient, comme ils pouvaient le savoir, que pareille chose durât longtemps. Durant ces exhortations, la ville se remplissait des moissons et des vendanges, les murs étaient fortifiés par des travaux en bois, les machines étaient dressées, on préparait tout pour le combat. Cependant quelques gens du faubourg se rendirent secrètement avec les ennemis, s’offrant à les y introduire. En même temps le comte de Toulouse revenait de la Camargue qu’il avait dévastée, et a son arrivée à Penautier, près de Carcassonne, il y fut joint par le sénéchal du roi, qui sortit pour l’interpeller de chasser du pays les ennemis dudit seigneur roi. Sur sa réponse qu’à ce sujet il tiendrait conseil à Toulouse, chacun retourna chez soi.
Peu de jours après, l’évêque de Toulouse, dont la langue gracieuse avait toute efficacité pour adoucir les haines, descendit avec le sénéchal dans le faubourg, réunit les bourgeois et le peuple dans l’église de la bienheureuse Marie, et là, sur l’autel de la Vierge glorieuse, il les lia tous par serment, sur le corps du Christ, les reliques des saints et les très sacrés Évangiles, à tenir pour l’église, le roi, ceux qui étaient dans la ville, et à les défendre. Pub, le jour suivant, fête de la Nativité de la bienheureuse Marie, ayant reçu des lettres du roi par le même envoyé que les bourgeois lui avaient député, les prélats et notables seigneurs, enfermés dans la ville, les montrèrent avec un grand appareil de joie.
Mais, dans la nuit même, il arriva que les ennemis du roi et de l’église furent introduits dans le faubourg et accueillis nonobstant les serments; même il en fut prêté alors de tout contraires. Nombre de clercs qui se trouvaient dans le faubourg se réfugièrent dans l’église, lesquels, bien qu’ils eussent reçu du prince lui-même et sous la garantie de son seing, licence d’aller vers Narbonne avec promesse de sûreté, furent, à leur sortie, assaillis par ces réprouvés et égorgés traîtreusement au nombre de trente, outre ceux qui, en plus grande quantité, furent tués près de la porte. Ensuite, se prenant à miner à l’instar des taupes, les assiégeants s’efforcèrent de pénétrer dans la ville; mais les nôtres ayant marché à leur rencontre, pareillement sous terre, les forcèrent, par blessures, fumée et chaux vive, à abandonner ce travail. Je n’omettrai pas de rapporter que Bernard Arnaud, Guillaume le Fort et les autres seigneurs du château de Penautier, bien que le jour précédent ils eussent juré au sénéchal qu’ils viendraient à lui pour défendre la ville, le lendemain désavouèrent leur promesse et se joignirent aux ennemis, aveuglés qu’ils étaient par leur propre malice, comme méchantes gens qu’ils étaient, ne voyant pas ce que leur fidélité aurait pu leur valoir ni ce que leur trahison pourrait leur coûter.
Dans la première attaque, les assiégeants, ayant pris un moulin défendu par une vieille et mince palissade, tuèrent les jeunes gens qui s’y trouvaient. Durant le siège, le combat eut toujours lieu de très près et avec d’autant plus de danger que les maisons du faubourg étaient presque attenantes à la ville, en sorte que les ennemis pouvaient, à couvert, lui faire beaucoup de mal avec leurs balistes et ouvrir des mines sans qu’on s’en aperçût. Au demeurant, ils étaient traités de la même manière à grands coups de pierres et de machines.
On combattit ainsi environ un mois, après quoi, des secours arrivant de France, les ennemis n’osèrent les attendre, et, ayant mis le feu en plu sieurs endroits du faubourg, ils l’abandonnèrent aux Français, pour se retirer à l’instant dans Montréal, où ils furent à leur tour assiégés par l’armée qui les y avait suivis. Là, après qu’on se fut battu pendant nombre de jours, les comtes de Toulouse et de Foix arrivèrent enfin, parlèrent de paix, et les assiégés, sortant du château avec armures et montures, l’abandonnèrent ainsi que les habitants. Déjà la saison était si rigoureuse qu’il eût été dangereux pour l’armée d’hiverner en tel endroit.
Plus tard, le comte et l’évêque de Toulouse partirent pour France, et il leur fut ordonné par le légat, le seigneur évêque de Préneste, de se rendre au concile que le souverain pontife avait convoqué. Ainsi, l’an du Seigneur 1241 étant déjà ouvert, et le légat étant parti devant, bien que les évêques ne fussent point encore retournés chez eux, ils vinrent à Lunel, d’où le prélat s’en fut sans le comte, lequel tardait un peu à cause d’une conférence avec le roi d’Aragon; et passant par Beaucaire, il rencontra certains évêques du royaume de France qui s’en retournaient, parce qu’ils n’avaient pu trouver de navire pour s’embarquer, et n’avaient osé cheminer par terre, en crainte de l’empereur Frédéric qui, soupçonnant que le susdit concile était convoqué contre lui, avait tendu des embûches à tout venant, sur terre comme sur mer. Il leur semblait donc encore plus supportable de s’arrêter que de s’exposer à des périls manifestes; mais l’évêque ne s’en effrayant pas, se rendit vite à Aix, ville métropole de Provence, où il trouva l’archevêque de Tolède, celui de Séville et l’évêque de Ségovie, lesquels savaient déjà que le légat, avec tous les prélats qui se trouvaient à Nice, était parti de ce port. Pour lors les évêques arrêtèrent d’Aller à Marseille, et de s’y embarquer sitôt que le temps le permettrait; car, pour l’archevêque, ayant horreur de la mer, il voulut essayer s’il pourrait obtenir un sauf-conduit pour voyager par terre; si bien que s’étant séparés, et chacun prenant la route qu’il avait choisie, les prélats vinrent à Marseille, comme ils l’avaient résolu entre eux, et là, tandis qu’ils attendaient, après l’arrivée du comte, que le temps favorisât leur départ, et le bruit se succédant de jour en jour que l’empereur avait mis des galères en embuscade, la triste nouvelle leur vint comme un coup de foudre, que les prélats avaient été pris en mer, et qu’un grand nombre avait péri. Lors, le comte et l’évêque retournèrent à Montpellier, où ils trouvèrent le roi d’Aragon, et, s’abouchant ledit roi et le comte de Provence, commencèrent à traiter du mariage entre celui de Toulouse et Sancie, troisième fille du Provençal, après les deux qu’avaient épousées les rois de France et d’Angleterre, mais comme on ne pouvait le conclure à cause de la femme du Toulousain, Dona Sancie, encore vivante, laquelle avait été depuis longtemps abandonnée par son mari, on procéda au divorce en présence de juges dès longtemps délégués par le souverain pontife, savoir, l’évêque d’Albi et le prévôt de Saint-Sauve, et comme il fut prouvé que le père du dit comte l’avait tenue sur les fonts baptismaux, la sentence de divorce fut prononcée devant un grand nombre d’évêques dans un lieu nommé la Vergne, entre Beaucaire et Tarascon, sans que la susdite dame s’y opposât, à ce induite par ses neveux, le roi d’Aragon et le comte de Provence, lequel comptait pour le second mariage, destiné à affermir la paix entre son gendre et lui, demander dispense de l’empêchement qui sortait du cousinage des deux parties. Toutefois l’évêque de Toulouse, bien qu’il fût à Beaucaire, et malgré les instances du comte Raimond, avec lequel il était arrivé, ne voulut participer à cette sentence, pour autant qu’il avait en suspicion Je témoignage des témoins produits; lequel refus venant à être connu du roi de France, du comte de Poitou et de la dame Jeanne sa femme, ils lui en surent grand gré. Au demeurant, ce refus ne préjudicia point au comte, comme on le vit clairement par la suite.
Dans le même temps, le quatrième jour de mai, mourut Roger Bernard, comte de Foix, dont le fils, Roger, vint à Lunel, avec dom Maurin, abbé de Pamiers, vers le susdit comte son seigneur, qu’il pria de daigner solliciter de l’abbé qu’il le reçût en la même tenance que chacun de ses prédécesseurs, à lui comte de Foix, lorsqu’ils vivaient: ce que fit le comte de Toulouse, nonobstant que l’abbé la lui eût offerte pour lui-même, s’il voulait l’accepter. Mais il la refusa eh considération de l’autre, le servit auprès de l’abbé, et même écrivit en France à son sujet. A cette occasion, il advint que le nouveau comte de Foix reconnut que son père avait reçu en commande, dudit comte de Toulouse, son seigneur, toute la terre qu’il tenait dans l’évêché de Toulouse, à partir du Pas de la Barre, confessant qu’il l’avait au infime titre, et promettant par serment qu’il la rendrait à son bon plaisir.
Ensuite il fut procédé à une conférence entre le roi d’Aragon et le comte de Provence, touchant le mariage entre la fille de celui-ci et le comte de Toulouse, et dans la ville d’Aix furent nommés des ambassadeurs extraordinaires vers le souverain pontife, porteurs de lettres scellées desdits princes, concernant là dispense nécessaire pour ce mariage. Mais, chemin faisant, ils apprirent à Pise que le pape était mort, en sorte que la négociation fut réduite à rien, et la demoiselle fut donnée à Richard, roi d’Allemagne, frère du roi d’Angleterre. Bientôt après, le comte de Toulouse rechercha en autre mariage la fille du comte de la Marche ce qui fut empêché par l’appréhension qu’il ne se trouvât cousinage entre eux.
Dans ces entrefaites, des traités furent entamés entre lesdits comtes de Toulouse et de la Marche et le roi d’Angleterre, pour faire la guerre au roi de France, avec le secours de plusieurs autres seigneurs, afin que, harcelé de plusieurs côtés à là fois, il suffit moins à se défendre. Sur quoi le comte de Toulouse tint conseil secret avec les grands de ses domaines, parmi lesquels, au premier rang, était le comte de Foix, qui fut d’avis affirmatif, et qui, après lui avoir juré de l’aider en toute guerre contre le roi, lui remit par écrit note de son avis et de sa promesse.
Avant ceci, avait trépassé à Lantar, Bernard, comte de Comminges, saisi, pendant qu’il dînait, de mort subite, en la fête de saint André, l’apôtre, l’an du Seigneur 1241. Quant à ce dont je viens de toucher quelques mots, il commença à en être question quatre mois après, l’Incarnation étant déjà passée, c’est à dire au mois d’avril et dans l’année 1242.
En ce temps, frère Guillaume Arnaud et frère Etienne son collègue, inquisiteurs de l’Ordre des Prêcheurs et de celui des Mineurs, ensemble les frères à eux associés, et l’archidiacre de Lézat, plus le prieur d’Avignonnet, poursuivant d’accord les affaires de la foi contre les hérétiques, furent dans le palais même du comte atrocement égorgés, en la nuit de l’ascension du Seigneur, par des ennemis de Dieu et de la religion, laquelle atrocité détourna quelques-uns de la guerre dans laquelle ils voulaient tremper contre le roi.
Adhérèrent au comte le seigneur Amaury, vicomte de Narbonne (qui, dès l’origine de la guerre, vainquit plusieurs chevaliers du parti du roi, parmi lesquels succomba Paul de Pierre Ganges), plus Bernard de Gaucelin, seigneur de Lunel, Pons d’Olargues, Bérenger de Puy-Serguier, et certains autres du diocèse de Béziers, outre nombre de seigneurs encore; item les gens d’Albi et le vicomte de Lautrec, d’autres aussi, mais par feinte, et jusqu’à ce qu’ils le vissent bien enchevêtré irrévocablement et enfoncé à n’en pouvoir bouger d’où il advint que l’évêque de Toulouse, voyant que le comte de Comminges, Jourdain de l’Isle, Bernard, comte d’Armagnac, Antoine, vicomte de Lomagne, et nombre de nobles attachés de cœur au comte, risquaient, par leur fidélité, de partager sa ruine, il entreprit, avec sou assentiment, de faire la paix avec le soigneur roi.
Or, on trouva que le comte de Foix, nonobstant la promesse qu’il avait faite au comte ensuite du conseil par lui donné, composait sans lui avec ledit seigneur roi; par quoi il obtint de se joindre à lui contre le comte, afin que lui et tous ses successeurs, ainsi que tout le pays qu’il tenait alors de Raimond, même en commande, fussent exemptés à perpétuité du joug du Toulousain; par suite, il défia le comte lui-même au château de Penne, en Agenais, qu’il assiégeait.
Cependant le prélat parvint, auprès du seigneur roi, qui attaquait les domaines du comte de la marche, à ce que la paix fût traitée entre lui, l’évêque et le comte de Toulouse, et pour cette cause le roi envoya promptement en ces quartiers, du côté de Cahors, des forces suffisantes. Puis, d’un autre côté, il fit partir le vénérable père dom Hugues, évêque de Clermont, et le noble homme, seigneur Humbert de Beaujeu, avec un plus grand nombre de chevaliers. En même temps, par l’entremise de l’évêque de Toulouse, et au moyen du discret personnage le seigneur Raimond, prévôt de cette ville, qu’il députa vers le roi, deux chevaliers, hommes vaillants et sages, furent délégués par ledit roi, savoir, Jean dit le Jay, et Ferri Pâté, pour recevoir sûretés des conditions entre eux convenues, lesquels s’étant réunis près d’Aizonne, le comte d’une part, et l’évêque de Clermont avec le seigneur Humbert de Beaujeu de l’autre, outre les nouveaux venus, et après qu’une trêve eut été conclue, on prit jour pour comparaître devant le roi, et pour lieu fut indiqué Lorris en Gâtinais, où, avec l’aide de Dieu, la paix fut enfin rétablie. Et il ne convenait pas au roi d’insister beaucoup à l’égard du comte, qu’il suffisait de détacher du reste pour détruire jusqu’aux dernières traces de guerre ou de rébellion. Davantage, bien que quelques-uns aient reproché à la dame reine Blanche, mère du roi, de paraître trop favorable à son parent de Toulouse, il n’était vrai ni vraisemblable qu’elle l’aimât mieux que ses enfants et à leur préjudice; seulement elle agissait en femme prudente et discrète, faisant en sorte d’Acquérir de ce côté, et d’Assurer la paix au royaume.
Quant au comte, il ne lui eût été sûr de s’appuyer sur un roseau pour résister au roi, d’autant que le prévôt toulousain avait trouvé en cour une députation des grands du royaume venant voir si le comte parviendrait à faire sa paix avec le roi; lesquels, s’ils eussent aperçu qu’il n’en serait point ainsi, se fussent incontinent déclarés ses ennemis, et même ne restaient ainsi en suspens jusqu’à ce qu’ils sussent à quoi s’en tenir, que par crainte que le traité conclu, on ne se repentît alors de ce qu’on leur aurait d’abord accordé.
La paix donc étant rétablie à Lorris, le comte revint chez lui, où il fit justice de certaines gens qu’on disait avoir trempé dans le meurtre des inquisiteurs à Avignon et, et, une fois pris, il les condamna à être pendus.
Bientôt après, dans le printemps de l’année du Seigneur 1243, le comte Raimond alla en cour de Rome; et là, près de l’empereur, il séjourna un an ou environ, et obtint la restitution du pays Venaissin. Dans le même temps, le seigneur évêque de Toulouse vint à Rome, où il avait été appelé et dans l’intervalle, le vénérable seigneur Pierre d’Ameil, archevêque de Narbonne, dom Durand, évêque d’Albi, et le, sénéchal de Carcassonne, assiégèrent le château, de. Montségur, au diocèse de Toulouse, où s’étaient impatronisés par usurpation et fraude, et que retenaient depuis, longtemps les deux puissants seigneurs Pierre de Mirepoix et Raimond de Peyrèle. Là était le public refuge de tous les malfaiteurs, de tous les hérétiques, et comme la synagogue de Satan, à cause de la force de ce château, qui, situé sur un très haut rocher, paraissait inexpugnable. Les assiégeants s’y étant donc présentés, après qu’ils y furent restés longtemps sans profiter à grand chose, s’on s’avisa d’envoyer, des valets agiles et ayant pleine connaissance dudit lieu avec des hommes d’Armes qui se préparèrent à gravir de nuit par des précipices horribles; et ayant atteint, sous la conduite de Dieu, un poste fortifié, placé à un angle de la montagne, ils égorgèrent à l’instant les sentinelle, s’emparèrent du fort, et passèrent au fil de l’épée tout ce qu’ils y trouvèrent. Puis, à la venue du jour, comme s’ils eussent été égaux au reste des assiégés, plus nombreux qu’eux pourtant, ils commencèrent à les attaquer vigoureusement. De fait, en regardant l’affreux chemin par lequel ils avaient grimpé de nuit, ils n’eussent jamais osé s’y risquer de jour; mais l’ennemi étant de la sorte enfermé par en haut, il devint plus facile à ceux de l’armée de monter ensuite; et comme on leur laissa de repos ni jour ni nuit, ces infidèles, ne pouvant résister aux attaques dt-size:12.0pt;font-family:"Garamond","serif";color:black"> lesquels, tant hommes que femmes; étaient au nombre de deux cents ou environ. Or, était parmi eux Bertrand Martin, qu’ils avaient fait leur évêque; et tous ayant refusé de se convertir comme on les y invitait, ils furent enfermés dans une clôture faite de pals et de pieux, et brûlés là ils passèrent au feu du Tartare. Pour ce qui est du château, il fut rendu au maréchal de Mirepoix, à qui il appartenait avant.
L’an du Seigneur 1244, en automne, le comte de Toulouse étant de retour chez lui, tint en cette ville une grande cour le jour de Noël, dans laquelle deux cents personnes ou environ reçurent la ceinture de chevalerie, entre autres, et des principaux, le comte de Comminges, Pierre, vicomte de Lautrec, Gui de Séverac, Sicard d’Alaman, Jourdain de l’île, Bernard de la Tour, et plusieurs autres. Or fut cette cour bien somptueuse et pompeuse.
D’autre part, le souverain pontife, seigneur pape Innocent iv, était venu à Lyon, où le comte de Toulouse, à son retour de France, vint le visiter en carême, puis retourna en France. Dans la même année, avant la Noël, le roi, qui avait été malade presque à la mort, se croisa pour outre mer, et l’année suivante (du Seigneur 1245), vers le commencement de l’été, le seigneur pape célébra un concile en la susdite ville avec les prélats cisalpins et autres du royaume de France, plus ceux d’Espagne. Là, il déposa de l’empire, par sentence définitive, le seigneur Frédéric.
Furent présents au dit concile le seigneur Baudouin, empereur de Constantinople, et les comtes de Toulouse et de Provence, lesquels, en présence du pape, traitèrent du mariage entre le Toulousain et la dernière fille du Provençal, moyennant que le souverain pontife donnerait dispense pour l’empêchement du parentage entre eux. Mais étant retournés chez eux, le comte de Provence mourut peu de jours après, avant la conclusion de ce mariage; et pour lors le comte de Toulouse put avoir une preuve de plus qu’il ne vaut rien de différer les choses commencées. En effet, ayant appris cette mort par un courrier que lui envoya le seigneur Raimond Gaucelin, et qui ne mit qu’un jour à le joindre, il revint en hâte suivi de peu de monde, et n’amenant avec lui nuls chevaliers, car en cette façon le lui avait conseillé ledit Raimond, auquel pareillement l’avaient ainsi persuadé Romieu[28] et Albert,[29] chevaliers de la maison du feu comte de Provence, qui voulant user de ruse envers le Toulousain, songeaient à l’empêcher d’employer la force, jusqu’à ce qu’ils eussent mené à terme ce qu’ils préparaient secrètement d’un autre côté, savoir, le mariage de la demoiselle avec le seigneur Charles, frère du roi, comme l’effet le montra ensuite. Il faudrait trop revenir en arrière pour dire par ordre combien de rencontres et conférences curent lieu avec le comte de Savoie, oncle de la pucelle, et les barons du pays; les Provençaux parlant toujours au comte comme d’effusion de cœur, tant et si bien que cinq mois, se passèrent ainsi sans qu’ils la laissassent voit même au roi d’Aragon, qu’ils soupçonnaient d’être favorable au Toulousain, bien qu’elle fût à Aix, et que le souverain pontife ne procédât aux dispenses, de ce empêché par des envoyés que la reine de France et les rois d’Allemagne et d’Angleterre lui avaient députés ad hoc. Finalement, pour achever en peu de mots, l’ambassadeur que ledit comte adressait à la reine de France pour qu’elle agréât et même approuvât ce dont il avait été question avec le père de la demoiselle, rencontra, chemin faisant, le seigneur Charles, qui venait en hâte pour l’épouser. Que dirais-je? Déjà l’on avait pu présumer par choses antécédentes qu’il ne plaisait à Dieu que le dernier comte de Toulouse se mariât, ou eût plus de lignée qu’il n’en avait: en outre, on parlait pour lors d’un mariage en Espagne qui ne lui eût point été honorable, et n’eût point rempli son objet; même le bruit en courait partout, mais ne se fondant sur rien, il s’apaisa. Or voici quelle en fut l’occasion, et elle n’était pas mince: lorsqu’il alla en Espagne après son départ de Provence, il arriva un jour qu’étant entré dans l’église de Saint-Jacques pour entendre la messe, et là, se trouvant une certaine noble dame en pèlerinage, les pèlerins de France et autres présents s’imaginèrent que c’était la femme avec laquelle on disait qu’il avait contracté épousailles; si bien qu’à leur retour ils répandaient partout qu’ils avaient vu la cérémonie nuptiale. Et ceci se passait l’an du Seigneur 1246.
L’année suivante 1247, le comte vint en France et s’y croisa; à son retour se croisèrent aussi en grand nombre les barons, chevaliers, citoyens, bourgeois et autres gens d’autres lieux. Pour lui, il prépara tout pour le passage et le reste, en grand détail, sans se relâcher cependant des efforts qu’il faisait de tout son pouvoir pour ne pas laisser avant son départ outremer le corps de son père sans sépulture, ayant depuis longtemps obtenu du Siège apostolique des juges pour s’enquérir des signes de pénitence que le l’eu comte avait, disait-on, donnés dans les derniers moments de son agonie. A ce sujet, il se laissa persuader par quelqu’un qu’il avait envoyé en cour de Rome avec une procuration à l’effet de gagner ce point, que le pape l’avait accordé, moyennant toutefois que le toi de France interposerait ses prières: sur quoi ayant député quelques autres vers ledit roi avec lettres de sa part et sollicitations, pour qu’il daignât prier le pape en sa faveur, ce prince, lors de son arrivée à Lyon, parla tout doucement au souverain pontife du fait en question: mais les choses ne se trouvèrent pas telles qu’on l’avait fait croire au comte, et pourtant le trompeur avait reçu de riches présents; et c’est ainsi que les grands sont joués parfois par des menteurs. Lorsque le second envoyé en toucha quelque chose au pape, il en fut lui-même surpris, et dit qu’il n’avait point du tout fait cette concession, ajoutant qu’on pourrait, si le comte le désirait, reprendre cette question par le bout; ce que ledit procurateur ne voulut essayer, n’ayant pas l’Ordre du comte; et réellement, quand il revint à son logis, il y trouva une lettre nouvellement arrivée, qui lui prescrivait, en cas où le premier rapport serait faux, de ne point recommencer sur nouveaux frais. A donc, pour quelque faute que ce fût, ce dit comte, peut-être par la volonté de Dieu, ne put ni se marier comme il le voulait, ni obtenir sépulture pour son père.
L’an du Seigneur 1248, le roi s’écartant de Lyon, en attendant qu’il se mît en roule pour outre mer, vint assiéger un certain château sur le Rhône, ayant nom la Roche,[30] pour ce que Roger de Clorège, son seigneur, faisait prélever des péages sur, tous les pèlerins qui allaient au secours de la Terre Sainte, et peu de jours après le roi le reçut à composition, jusqu’à ce que pleine satisfaction fût donnée de l’injure faite aux croisés. Ensuite il descendit vers la mer, sur la plage qu’on appelle Aigues-Mortes, où le comte de Toulouse vint à lui, et d’où il partit pour Nîmes, après avoir eu une conférence avec le roi; puis se rendit à Marseille. Là, après y avoir longtemps séjourné, et bien qu’on lui eût amené un fort navire des rivages de la mer Britannique par le détroit de Maroc, il lui fallut rester encore, vu que les approches de l’hiver rendaient la navigation périlleuse: ce qu’il fit, de l’avis des prélats et des grands à sa suite. Pour ce qui est du roi, il toucha au port de l’île de Chypre, où il hiverna; finalement, au printemps de l’an du Seigneur 1249, il se remit en mer avec son armée, et, arrivé à Damiette, il trouva les bords du Nil couverts d’une multitude de Sarrasins qui défendaient sur ce point les abords de la terre; mais, repoussés à coups d’arbalètes, et se réfugiant dans la ville, ils laissèrent le pays ouvert aux débarquants, puis furent d’une si grande terreur terrifiés, que, par l’aide de Dieu, ils abandonnèrent la ville elle-même, quoique bien garnie et toute pleine de victuailles, si bien que l’avant-garde des troupes royales fut, en y arrivant, tout étonnée de la trouver sans défenseurs, au rebours de ce qu’on avait présumé. Lors vint après eux le roi avec toute l’armée, et il fit son entrée dans cette ville déserte.
Quant au comte de Toulouse, resté en France tout l’hiver, il alla en Espagne au printemps, et à son entrée dans le royaume de Castille, Alphonse, fils aîné du roi, étant venu au devant de lui jusqu’à Logroño, il s’y tint conférence entre eux, et, revenant en ses quartiers après quinze jours environ qu’il resta en compagnie de ce prince, le comte fut, chemin faisant, malade durant quelques autres jours. En ce même temps le vicomte de Lomagne, qui jadis avait épousé la nièce dudit comte, déclina son amitié, et se rangea du parti de son rival, Simon de Montfort, comte de Leicester, qui pour lors avait l’administration de la Gascogne au nom du roi d’Angleterre. En ce même temps aussi ledit comte Raimond fit brûler auprès d’Agen, dans un lieu dit Berlaiges, quatre-vingts hérétiques croyants, lesquels, dans une procédure faite en sa présence, s’étaient confessés ou avaient été convaincus d’hérésie. Bientôt après, sur la nouvelle que le seigneur Alphonse, comte de Poitiers, frère du roi, suivi de madame Jeanne, sa femme, propre fille de Raimond, arrivait, se rendant en Afrique, le comte de Toulouse vint les trouver à Aigues-Mortes, et y conféra avec eux de ses affaires. De là retournant à Millau, il y fut saisi de la fièvre, et, poussant jusqu’au bourg nommé Pris, proche Rodez, il s’alita, fit confession de ses péchés au fameux ermite frère Guillaume Albéroni, et des mains de l’évêque d’Albi, qui l’avait rejoint le premier, reçut l’eucharistie dévotement et en esprit d’humilité, comme il apparaissait par signes extérieurs. En effet, lorsque le corps du Christ notre Sauveur entra, il se leva, bien que très faible, vint au devant jusqu’au milieu de la maison, et communia les genoux en terre, non dans son lit. Ensuite se réunirent auprès de lui les évêques de Toulouse, d’Agen, de Cahors, de Rodez et d’Albi, plus les grands, maints chevaliers de ses domaines et les consuls de Toulouse, desquels tous l’avis était qu’il descendît vers cette ville; mais, conduit de la sorte par je ne sais quel sentiment, il se fit, contre le vœu universel, rapporter à Millau, où la maladie l’avait atteint, et là, ayant fixé le lieu de sa sépulture dans le monastère de Fontevrault, aux pieds de sa mère, disposé de ses biens, et reçu l’extrême-onction, il acheva sa dernière journée le vingt-septième jour de septembre, l’an du Seigneur 1249, et de son âge le cinquante et unième. Quant à ce que j’ai dit qu’il se fit reporter dans la susdite ville, malgré l’avis de tous, conduit à ce faire par je ne sais quel esprit, il semble que ce soit une preuve certaine d’un jugement divin, afin que, puisqu’il devait être enlevé du milieu de ses vassaux, ses restes, en descendant de la haute partie de ses états à l’orient vers la basse à l’occident, vu qu’il était le dernier de la lignée des comtes de Toulouse, reçussent, en traversant tout son pays, les regrets de tous sur la mort de leur seigneur. Finalement, son corps ayant été embaumé, mis en bière, et gardé avec grand soin, puis transporté par Albi, Gaillac, Rabastens et Toulouse, vers le pays Agenais, sur la Garonne, fut d’abord déposé dans le couvent des moines de l’Ordre de Fontevrault, dit le Paradis, et de là, après y être resté l’hiver, conduit au printemps suivant à Fontevrault même, pour y être enseveli, comme il l’avait indiqué. Et c’était pitié, avant comme ensuite, que de voir ces peuples se lamenter, pleurer leur seigneur naturel, n’attendre absolument personne autre de sa race, comme si ainsi l’eût voulu le Seigneur Jésus-Christ, pour qu’il fût manifeste à tous que Dieu, en lui enlevant un maître généreux, avait châtié le pays entier à cause des péchés de la souillure hérétique. Cette même année, le comte de la Marche mourut à Damiette.
L’année suivante du Seigneur 1250, le roi de France sortit de Damiette avec son armée contre le soudan de Babylone, en suivant le lit du Nil, et son approche fit si grand peur aux Sarrasins, qu’ils n’osaient se commettre à en venir aux mains avec lui, mais, du plus qu’ils pouvaient, fermaient voies et passages pour qu’il ne pût arriver jusqu’à eux. Pour lors, le comte d’Artois, Robert, frère du roi, ayant fait une première attaque qui lui réussit, et, pensant que du même élan la suite répondrait au début, poussa outre, malgré l’avis des frères Templiers, et s’empara d’un certain bourg nommé Al-Mansour. Mais les Chrétiens s’y tenant mal sur leurs gardes, les Sarrasins les assaillirent en grande multitude, et en tuèrent beaucoup, parmi lesquels le comte d’Artois fut perdu, et oncques ne se retrouva. En outre, une maladie contagieuse tomba sur l’armée, laquelle commençait par des douleurs de mâchoire, de dents et de jambes; la mort suivait en peu de jours, si fréquente qu’on ne pouvait suffire à enterrer les cadavres, et que, pour faire le guet, soit de nuit, soit de jour, il fallait que les cuisiniers et autres valets, non habitués à chevaucher, prissent armes et montures de leurs maîtres malades. A donc, contraint par telle nécessité, le roi fut obligé de renoncer à son entreprise: ce que sachant les Sarrasins, ils le poursuivirent avec ardeur, le prirent enfermé dans un certain lieu avec ses deux frères, les comtes d’Anjou et de Poitou, coururent sur le dos du reste, en tuèrent un grand nombre dans la fuite, et en firent plusieurs prisonniers. Or, par quel jugement de Dieu advint telle chose? C’est ce que la fragilité humaine n’ose définir; mais, frappant à la fois et guérissant, dans sa colère, elle se rappelle la miséricorde divine. En effet, le roi et ses frères furent relâchés à des conditions tolérables, vu la circonstance; Damiette fut rendu, et aussi les captifs qui purent se trouver.
La même année mourut Frédéric, jadis empereur, et déposé depuis dans le concile de Lyon par le seigneur pape Innocent iv, comme il a été dit plus haut, lequel, étant sur sa fin, reconnut son erreur, et défendit qu’on lui rendît les honneurs funèbres dus aux empereurs, ni ne voulut même qu’on le pleurât, pour ce qu’il avait été désobéissant et rebelle à l’église. Mais son fils Mainfroi,[31] à qui n’appartenait directement son héritage, s’arrogea, au moyen de la tutelle ou curatelle de Conradin, fils d’un fils décédé du susdit Frédéric, le royaume de Sicile avec la principauté de Pouille et de Calabre, et, plaçant le diadème sur sa tête, se porta pour roi et prince, imitant ainsi la désobéissance et rébellion paternelles; car le seigneur pape innocent, après son départ de Lyon, le poursuivait comme usurpateur du trône et indigne d’y monter. Ledit seigneur pape mourut l’an de l’Incarnation 1254, en la fête de sainte Luce, martyre et lui succéda le seigneur pape Alexandre iv, après la mort duquel le seigneur Urbain, élu souverain pontife, travaillant tant qu’il vécut, de toute sollicitude et grand zèle, à empêcher que le mal ne s’enracinât davantage, et même à l’extirper, suscita un adversaire audit Mainfroi, tout fier de sa malice, afin de terrasser cet ennemi de Dieu, et invita lui-même et induisit l’illustre personnage Charles, comte d’Anjou et de Provence, pour qu’à l’exemple de ses ancêtres et de la race bénie des princes dont il descendait, il vînt attaquer ce rebelle à l’église ; Mainfroi, lequel servait de manteau et de refuge à tous les infidèles ou malintentionnés qui désiraient se sauver dans ses domaines, villes et forteresses. A donc, l’apparition d’une comète qui, vers le milieu du mois de juin, l’an du Seigneur 1254,[32] avait commencé à se faire voir à la tombée de la nuit du côté de l’occident, vint présager le changement des maux précédents et les biens qui devaient suivre; laquelle comète, quelques jours après, sur la fin des nuits, parut du côté de l’orient, étendant quantité de rayons vers la plage occidentale, et son cours dura jusque environ le terme du mois de septembre, en quel temps le susdit pape lui-même fut enlevé de ce monde, et lui succéda le seigneur pape Clément iv, sous le pontificat de qui les choses préparées par son prédécesseur furent mises à exécution. En effet, ledit comte Charles, comme un vrai fils d’obédience, vivement touché des injures faites à la liberté de l’église, ou même à sa dignité, vint d’une puissance et force divines, et, ne tenant compte des embûches qu’on lui avait dressées par mer, s’embarqua au printemps, vint à Rome, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dans les mains duquel sont tous les droits des royaumes, l’an de ce même Seigneur 1265; et, y ayant été investi du titre de sénateur, y séjourna tout l’été, après avoir laissé derrière lui un ordre, sanctionné par la grâce de l’illustre roi, son frère, pour qu’une armée vînt le joindre de France et de la Provence. Il fut donc couronné roi de Sicile par quelques cardinaux envoyés ad hoc par le souverain pontife, en la fête de l’épiphanie. Puis, ses auxiliaires étant venus librement jusqu’à lui, à travers l’Italie, il sortit, nonobstant l’âpreté de l’hiver, pour combattre son ennemi et celui de l’église; et après avoir pris par miracle le château jusqu’alors inexpugnable de San Germano, suivant toujours Mainfroi qui l’attirait adroitement dans le fin fond de ses États, pour accabler plus sûrement son armée harassée de fatigue, de besoin, et investie de toutes parts, il le trouva devant la ville de Bénévent, préparé au combat; sur quoi, le roi ne différant même pas l’attaque jusqu’au lendemain, et sachant bien qu’il en a souvent coûté cher pour avoir tardé d’achever choses entreprises, ayant rangé ses troupes en bataille, et invoqué le nom du Sauveur, engagea l’affaire, mit en un instant le désordre dans les rangs ennemis, et les passa au fil de l’épée. Mainfroi lui-même fut, bien qu’inconnu, tué dans la mêlée avec les autres et son cadavre, après deux jours de recherches, fut trouvé parmi la foule des morts. Or cette victoire fut remportée le 26 février, même année que ci-dessus.[33] Elle leva tout obstacle à la prise de la susdite ville de Bénévent, dont le roi s’empara sans coup férir, et où il fit transporter ceux des siens qui avaient besoin de repos: puis on ensevelit le corps de Mainfroi.
Mais pour que, selon le jugement de Dieu, il n’y eût point de racine d’amertume qui ne fût coupée, et les Romains ayant élu pour sénateur Henri, frère germain du roi de Castille, Conradin, fils de feu Conrad, lequel était fils lui-même de Frédéric, vint par la suite, peut-être à l’instigation des rivaux du nouveau roi, se porter contre lui, et, quittant secrètement l’Allemagne sans qu’on en soupçonnât rien, poussé par l’espoir que tout le pays se lèverait à son approche et marcherait à sa suite, il arriva dans Rome, où il fut reçu en grand honneur par le sénateur et bon nombre de grands de la ville, et d’où il sortit, secouru par le susdit Henri et belle multitude de Romains, pour attaquer le roi de Sicile. Les deux armées s’étant donc rencontrées et rangées en bataille dans la plaine de Saint-Valentin, en vinrent aux mains avec acharnement. Mais, Dieu aidant les siens d’en haut, cette race de bien méchantes gens fut mise en fuite; le sénateur et Conradin eux-mêmes, échappés du combat, grâces à la vitesse de leurs chevaux, avec nombre d’autres grands personnages, se dispersèrent à travers champs; ni cependant purent-ils se cacher; et, découverts par la volonté du Seigneur, qui livre les impies, ils furent conduits dans les prisons du roi. Or, en cette bataille il se fit un bien plus grand carnage des ennemis de Dieu que dans celle de Bénévent. Postérieurement, Charles Fit trancher la tête, non sans jugement des experts en lois, au susdit Conradin, au duc d’Autriche et à leurs autres complices; et dès lors le pays se tint coi devant lui. Davantage, le peuple infidèle de Lucera,[34] lequel s’était embrasé des feux de la rébellion, après nombre de vexations par lui commises et supportées, venant aux pieds du roi, et prosterné contre terre, obtint seulement la vie, qu’il implorait de sa clémence; et, portant courroies au cou en signe de servitude, avec autres sortes de révérences, il fut reçu en esclavage par ledit prince, auquel il livra, pour en faire à son bon plaisir, son château, sa ville, tous ses biens, et même ces faux Chrétiens et félons qui avaient donné les mains à cette seconde révolte. Bref, cette terre, où les infidèles avaient coutume de se réfugier pour y fomenter leur propre malice, fut par la dextre d’en haut changée en telle manière que les fidèles de nos contrées, se soumettant au roi, y accoururent pour s’enrichir. Et fut cette bataille contre Conradin donnée la veille de la fête du bienheureux Barthélemy, l’an du Seigneur 1262.[35] Cette même année, la veille de la fête du bienheureux André, apôtre, le seigneur Clément iv, pape, après que la paix eut été en ces quartiers accordée à l’église par le divin maître, suivit le chemin que suit toute chair; et l’année d’ensuite 1269, 27 juillet, on termina ce que j’ai dit plus haut à l’égard du méchant et infidèle peuple de Lucera.
D’autre part, et pour revenir sur certains événements omis ci-dessus, l’an du Seigneur 1264, année de la mm du pape Urbain, après le décours de la comète, la discorde éclata entre le roi d’Angleterre et la majeure partie des barons de son royaume, entre les quels on comptait dans les principaux Simon de Montfort, comte de Leicester, homme sage, vaillant et belliqueux, pour ce que ledit roi avait enfreint certains statuts, certaines coutumes et autres choses observées dans les anciens temps pour le bon état du royaume, lesquelles il avait, lui, très mal suivies, sur quoi on courut d’un et d’autre côté aux armes, et le parti du roi ayant eu le dessous dans une bataille, il fut pris avec son frère Richard, roi d’Allemagne, et son fils aîné Edouard. Mais il advint par la suite que ledit Edouard, lequel était tenu en garde franche, se promenant un jour avec ses surveillants, monta sur un cheval qu’on lui avait envoyé sur le soir, se sauva, grâces à sa vitesse, et, nombre de jours après, tua dans un combat son vainqueur et son ennemi avec plusieurs autres. Davantage, l’année suivante, de l’Incarnation du Seigneur 1265, Jacques, roi d’Aragon, attaqua Murcie, ville aux Sarrasins, jadis au roi de Castille, et s’en empara. En cette même année, l’illustre roi de France Louis se croisa contre les Sarrasins, avec nombre de princes, chevaliers et gens du peuple. Item, l’an du Seigneur 12a le ciel pour suivre une génisse, s’il est vrai que la chose fut telle qu’on la rapportait publiquement.
L’année suivante, du Seigneur 1270, l’illustre roi de France, ses trois fils, Philippe, Jean, comte de Nevers, Pierre, et le seigneur Alphonse, son frère, comte de Poitiers et de Toulouse, ensemble les comtes d’Artois, de Bretagne, et plusieurs autres comtes et princes, plus le roi de Navarre, gendre du roi, avec plusieurs chevaliers et gens du peuple à ce rassemblés, entreprirent l’exécution du grand dessein, vinrent à la mer, et, ayant réuni des navires des pays maritimes sur la plage dite Aigues-Mortes, s’embarquèrent au commencement de juillet. Dans le même mois, aux environs de la Sainte Marie-Madelaine, ils descendirent, après avoir repoussé les Sarrasins qui défendaient le rivage, au port de Carthage, près la cité de Tunis, et les chevaliers s’étant avancés, prirent Carthage à l’instant même, puis assirent leurs tentes autour de Tunis. Les ennemis n’en devinrent que plus ardents, ils vinrent en grand nombre camper en face hors de leurs remparts, si bien que de fréquentes attaques eurent lieu sur tous les points entre les deux armées. Mais comme les croisés furent demeurés là un mois, ou environ, ce serviteur de Dieu, le béni roi de France fut, par un secret jugement du Seigneur, enlevé au jour de ce monde, en la veille de la Saint-Barthélemy. Or, à peine était-il mort qu’arriva son frère,[36] le roi de Sicile, et l’armée resta en cet endroit jusque vers la fin de novembre. Pour lors il fut débattu entre les rois et princes sur ce qu’il convenait faire en telle conjoncture; et bien qu’on pensât généralement que la ville pourrait être emportée de force (ce qui au surplus ne pouvait s’obtenir sans grand péril), il s’agissait de savoir ce qu’une fois prise on en ferait. En effet, si on la gardait, comme il ne faut pas moins de vigueur pour défendre une conquête que pour s’en saisir, et que pourtant l’armée n’y pouvait hiverner, attendu qu’elle ne pouvait se procurer des vivres, que l’hiver ne permettait pas d’Amener par mer, on voyait qu’en y laissant une garnison, elle serait assiégée par les gens du pays, et que la suite pourrait bien être pire encore que le présent. D’un autre côté, si on ne la gardait pas, ou qu’on la ruinât, le temps qu’on emploierait à la détruire aurait son danger, et l’armée ne pourrait, durant la mauvaise saison, se rembarquer librement. Oh prit donc le meilleur parti d’extorquer de l’or aux barbares pour le remboursement des dépenses déjà faites, de rendre le roi de Tunis tributaire de celui de Sicile, et, moyennant telles et autres conditions, de ne rien entreprendre de nouveau. Ainsi trêve étant faite, les croisés s’en retournèrent et se dirigèrent sur Trapani, en Sicile, où, comme ils arrivaient au port, la flotté n’eut pas une mince perte à supporter, un grand nombre de vaisseaux ayant été brisés par la violence des vents, et quantité des moindres gens ayant été submergés. Davantage, en revenant, le roi (le Navarre, sa femme, et celle de Philippe, nouveau roi de France, moururent; lequel Philippe avait déjà perdu son frère Jean, comte de Nevers, au camp devant Tunis, où trépassa pareillement le seigneur Philippe de Montfort. Et l’année suivante, à Savone, ville de mer, le seigneur Alphonse, comte de Toulouse et de Poitiers, plus sa femme, madame Jeanne, fille du feu comte toulousain, moururent aussi en un court espace de temps; si bien que, si l’on entretenait quelque espoir d’un héritier futur à la comté de Toulouse, il fut alors totalement enlevé et ravi, puisque cette lignée tout entière fut par là détruite et rasée de terre. Par suite, ses droits et domaines sur le susdit comté ont passé es mains de l’illustre roi de France, auquel en était dévolue la propriété directe. Finalement, l’année précédente, de l’Incarnation 1270, le 19 octobre, était trépassé le seigneur frère Raimond, évêque de Toulouse, l’an 39e de son épiscopat; auquel, après qu’on l’eut enseveli chez les Prêcheurs, dont il avait jadis embrassé l’Ordre, fut élu pour successeur le seigneur Bertrand de l’Isle, prévôt de la même église, de l’accord unanime du chapitre. Celui-ci, confirmé à Narbonne, promu à la prêtrise en son église de Toulouse le samedi veille de la Saint-Thomas, consacré évêque le dimanche fête du dit saint, célébra en cette qualité sa première messe, très peu de jours après, en celui de la Nativité du Seigneur. Cette même année, en carême, Henri, fils de Richard, roi d’Allemagne, fut tué à Viterbe dans une église par les fils de feu Simon de Montfort, en vengeance de leur père. En quel temps vaquait le Siège apostolique, et ce depuis deux ans et neuf mois qu’était mort le seigneur pape Clément, jusqu’à l’élection au pontificat, l’an du Seigneur le 1or jour de septembre, du vénérable homme Thibaut, archidiacre de Liège, qui pour lors était outre mer, en compagnie du seigneur Edouard, fils aîné du seigneur roi d’Angleterre. Item, ce dit-on, et le 15 du mois d’Août, Philippe fut oint roi de France et couronné à la grande liesse de son peuple.
Pour premiers auspices de son règne, s’offrit à lui l’occasion de faire jugement et justice; car, l’année suivante (du Seigneur 1271),[37] il y eut un combat entre Arnaud Bernard d’Armagnac (frère du vénérable père l’archevêque d’Auch et du seigneur Guiraud, comte d’Armagnac) et Guiraud de Casaubon, seigneur du château de Haut Puy; en quel combat ledit Arnaud Bernard et quelques chevaliers, ses compagnons, furent tués. Sur quoi Bernard[38] de Casaubon, sachant bien que cette mort devait tourner à mal pour lui et les siens, par le fait de la multitude des amis et parents dudit Arnaud Bernard, se remit lui-même en la prison ou geôle du sénéchal du seigneur roi de France, et lui livra sa terre, pour que le roi fît de lui ce qu’il devrait, au cas où se présenterait quelque accusateur, à moins qu’il ne pût valablement se laver de la mort dudit personnage au jugement de la cour, et pour que ses domaines fussent confisqués au profit dudit seigneur roi. Or, comme il eut été de la sorte reçu en prison, sa terre en garde et pouvoir du prince, et sa bannière du château de Haut Puy livrée pour sûreté, il arriva néanmoins, et nonobstant inhibition des officiers royaux, que le comte de Foix, Roger Bernard, avec Guiraud d’Armagnac et une multitude de gens armés, vint courir contre ledit château, l’attaqua, le prit, et le détruisit, non sans grand carnage de monde. Ce qui étant connu du roi, lequel, non pour cette cause, mais pour visiter les pays de Poitou et de Toulouse à lui donnés par Dieu, venait en ces quartiers, le comte de Foix, cité pour comparaître en justice, en amendement de l’injure qu’il avait faite au roi, et due réparation de plusieurs autres offenses à lui imputées, n’agréa pas, comme il le devait, à comparaître, retenu qu’il était par l’état de prévention qui pesait sur lui; ainsi, usant de méchant conseil, il résolut de se fortifier dans ses États, et d’opposer aux Français la force de son bras, d’autant qu’il avait, comme il lui semblait, maints châteaux inexpugnables au sommet des montagnes. Bien plus, pour que rien ne manquât à la colère royale, il força à la fuite, après avoir pris quelques-uns de ses compagnons, et retenant ses bêtes de somme, le sénéchal du roi, qui passait sur ses terres, mais sans rien tenter contre lui; ce qu’ayant en horreur les seigneurs et bourgeois de Saverdun, ils lui interdirent l’entrée de leur château. Pour ce qui est du sénéchal, ne songeant point à dissimuler l’outrage tait à son maître, et réunissant une grande armée sur les lieux, il entra en force sur le territoire dudit comte; et, mettant garnisons dans les plus fortes places, il le saisit jusqu’au Pas de la Barre. Même, s’il ne se fût, de l’avis de quelques-uns, abstenu de passer outre, il aurait pu s’emparer du reste en majeure partie.
Le roi, en apprenant tout ceci, et se doutant que ledit comte de Foix se confiait en ses châteaux dans la montagne, outre qu’il requerrait peut-être des secours au-delà des mers, agit avec sagesse et prévoyance, de peur qu’on n’en vînt à le mépriser, s’il ne réprimait l’audace de ces tentatives contre les premiers temps de son règne. Il appela donc à lui les forces de son royaume, arriva à Toulouse, y entra le 28 de mai, au milieu des plus vifs transports de joie; puis, y étant resté sept jours, jusqu’à la venue de son armée, et en attendant qu’on eût aplani la roideur des routes et élargi les défilés, il en sortit le neuvième jour avec un grand appareil de chariots, de machines, de troupes, trouva en marchant sur Pamiers le roi d’Aragon, son gendre, qui était venu au devant de lui, suivi du seigneur Gaston de Béarn, gendre lui-même du susdit comte, et tint conférence avec eux. Or, l’issue en advint que le comte de Foix, voyant qu’il ne pouvait résister au roi, remit à sa discrétion soi et sa terre; si bien que ledit seigneur le mit sous bonne garde, et finalement acquit ses domaines, qu’il tient aujourd’hui. Sur quoi, pour n’en pas dire davantage, je dis et crois qu’il a été fait ainsi, soit à cause des offenses du feu comte, son père, ou des siennes, soit pour que la justice du seigneur Dieu fût reconnue, le pécheur étant saisi au milieu de ses œuvres. Au demeurant, après avoir été longtemps retenu dans la prison du roi, ledit comte fut délivré sur les instances du roi d’Aragon, gendre dudit seigneur.
FIN DE LA CHRONIQUE DE GUILLAUME DE PUY-LAURENS.
[1] Capelan ou chapelain : c’est ainsi que, dans le midi, le peuple appelle encore en général les prêtres.
[2] En 1181.
[3] Le cardinal de Saint-Chrysogone.
[4] Le 28 février 1105.
[5] En 1123.
[6] En 1197.
[7] Raimond V.
[8] Le père d’Éléonore était Alphonse II, roi d’Aragon.
[9] En septembre 1200.
[10] En 1206.
[11] Nostrae linguae : langue d’oc.
[12] Comes Paleariorum, comté de la Marche d’Espagne.
[13] Le 25 juin 1218.
[14] Castelnaudary.
[15] Au mois d’août.
[16] Raimond Roger et non Bernard Roger, son fils, qui lui succéda.
[17] En février 1224.
[18] Amaury ne fut nommé connétable que plusieurs années après.
[19] En février 1226.
[20] Le 29 septembre 1225.
[21] Le 8 novembre 1226.
[22] 31 janvier 1228.
[23] En 1228.
[24] Le 12 avril 1229.
[25] En février 1234.
[26] En novembre 1235.
[27] On donnait ce nom aux hérétiques les plus affermis et les plus avancés dans leur croyance, et qu’on appelait aussi parfaits; les autres, considérés comme des disciples ou néophytes, étaient dits les croyants.
[28] De Villeneuve.
[29] De Tarascon.
[30] La Roche de Gluin.
[31] Manfred.
[32] Le 7 décembre ; la fête de la sainte Luce est le 13 décembre.
[33] En 1266 et non en 1265.
[34] Colonie de Sarrasins.
[35] En 1268.
[36] Charles Ier d’Anjou, roi de Naples, jeune frère de Saint Louis.
[37] En 1272.
[38] Deux lignes plus haut il l’appelle Guiraud.