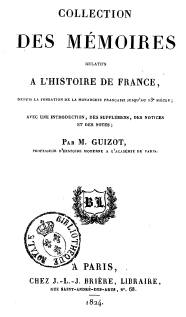
Grégoire de Tours
Notice
texte numérisé et mis en page par François-Dominique FOURNIER
COLLECTION
DES MÉMOIRES
RELATIFS
A L'HISTOIRE DE FRANCE,
depuis la fondation de la monarchie française jusqu'au 13e siècle
AVEC UNE INTRODUCTION DES SUPPLÉMENS, DES NOTICES ET DES NOTES;
Par M. GUIZOT,
PROFESSEUR D'HISTOIRE MODERNE A L’ACADÉMIE DE PARIS.
.
Du cinquième au douzième siècle, le clergé presque seul a écrit l’histoire. C’est que seul qui savait écrire, a-t-on dit. Il y en a encore une autre raison, et plus puissante peut-être. L’idée même de l’histoire ne subsistait, à cette époque, que dans l’esprit des ecclésiastiques ; eux seuls s’inquiétaient du passé et de l’avenir. Pour les barbares brutaux et ignorants, pour l’ancienne population désolée et avilie, le présent était tout ; de grossiers plaisirs ou d’affreuses misères absorbaient le temps et les pensées ; comment ces hommes auraient-ils songé à recueillir les souvenirs de leurs ancêtres, à transmettre les leurs à leurs descendants ? Leur vue ne se portait point au-delà de leur existence personnelle ; ils vivaient concentrés dans la passion, l’intérêt, la souffrance ou le péril du moment. On a tort de croire que, dans les premiers temps surtout, le clergé seul sût écrire ; la civilisation romaine n’avait pas disparu tout à coup ; il restait, dans les cités, des laïques naguères riches, puissants, lettrés, d’illustres sénateurs, comme les appelle Grégoire de Tours. Mais ceux-là même tombèrent bientôt dans le plus étroit, le plus apathique égoïsme. A l’aspect de leur pays ravagé, de leurs monuments détruits, de leurs propriétés enlevées, au milieu de cette instabilité violente et de cette dévastation sauvage, tout sentiment un peu élevé, toute idée un peu étendue s’évanouit ; tout intérêt pour le passé ou l’avenir cessa : ceux qui étaient vieux et usés crurent à la fin du monde ; ceux qui étaient jeunes et actifs prirent parti, les uns dans l’Église, les autres parmi les barbares eux-mêmes. Le clergé seul, confiant en ses croyances et investi de quelque force, continua de mettre un grand prix à ses souvenirs, à ses espérances et comme seul il avait des pensées qui ne se renfermaient pas dans le présent, seul il prit plaisir à raconter à d’autres générations ce qui se passait sous ses yeux.
De tous les monuments qu’il nous a transmis sur ce long et sombre chaos, le plus important est, à coup sûr, l’Histoire ecclésiastique des Francs de Grégoire de Tours ; titre singulier[i] et qui révèle le secret de l’état social à cette époque. Ce n’est pas l’histoire distincte de l’Église, ce n’est pas non plus l’histoire civile et politique seule qu’a voulu retracer l’écrivain ; l’une et l’autre se sont offertes en même temps à sa pensée, et tellement unies, qu’il n’a pas cru pouvoir les séparer. Le clergé et les Francs, c’était alors en effet toute la société, la seule du moins qui prît vraiment part aux événements et pût prétendre à une histoire. Le reste de la population vivait et mourait misérable, inactif, ignoré.
L’origine de Grégoire de Tours semblait le vouer à l’Église ; la famille de sa grand’mère Léocadie, l’une des plus considérables du Berry, avait donné au christianisme Vettius Epagatus, l’un des premiers et des plus illustres martyrs des Gaules ; son père Florentius et sa mère Armentaria descendaient l’un et l’autre de S. Grégoire, évêque de Langres ; il avait pour grand oncle Saint Nicet[ii], évêque de Lyon, et pour oncle Saint Gal, évêque de Clermont ; tous les souvenirs de ses ancêtres se rattachaient aux épreuves ou aux triomphes de la foi ; et, lorsqu’il naquit en Auvergne le 30 novembre 539, sa famille y était depuis longtemps distinguée par les grandeurs religieuses et mondaines. La naissance d’un frère nommé Pierre et d’une sœur dont on ignore le nom, avait précédé la sienne ; mais soit que la renommée qu’il acquit plus tard ait rejailli sur son enfance, soit qu’en effet on eût remarqué en lui de bonne heure un penchant peu commun pour l’étude et la piété, tout indique qu’il fut, dès ses jeunes ans, l’objet de la prédilection et des espérances de tous ses parents. Il reçut en naissant les noms de George et de Florentius, son grand père et son père, et les a inscrits lui-même en tête de ses ouvrages ; ce fut seulement lorsqu’il parvint à l’évêché de Tours, que, d’après l’usage du temps, il prit le nom du plus illustre de ses ancêtres, Saint Grégoire, évêque de Langres, son bisaïeul. Son père mourut peu après sa naissance ; mais sa mère, femme d’un mérite distingué, à ce qu’il paraît, se voua avec passion à l’éducation d’un fils dont la faible complexion alarmait chaque jour sa tendresse, et dont les dispositions précoces promettaient à son orgueil maternel les plus douces joies. Les familles romaines n’avaient pas encore perdu tout souvenir d’un temps, non plus heureux pour le peuple en général, mais moins barbare et qui laissait quelque éclat aux anciennes grandeurs ; elles mettaient encore du prix à la science, aux lettres, à la gloire polie et humaine. L’Église seule leur offrait quelques moyens d’y parvenir. Le jeune Grégoire fut confié aux soins de son oncle Saint Gal, alors évêque d’Auvergne ; son grand oncle, Saint Nicet, évêque de Lyon, s’occupa aussi de ses progrès et de son avenir. Saint Avite, successeur de Saint Gal, lui porta la même affection. Saint Odon, abbé de Cluni, au dixième siècle, et qui a écrit sa vie, raconte avec complaisance les marques de dévotion fervente que donnait Grégoire encore enfant, et les miracles opérés en faveur de sa santé sur le tombeau de Saint Hillide. Mais il semble que la guérison ne fut jamais que momentanée ; car, dans un nouvel accès de maladie, le jeune homme, déjà ordonné diacre, se fit transporter à Tours, sur le tombeau de Saint Martin, alors la gloire des Gaules et l’objet de sa vénération particulière. Dans ce voyage, les citoyens de Tours le prirent en grande estime ; son esprit était animé, son caractère doux, son instruction plus étendue que celle de la plupart des prêtres, et il l’avait dirigée avec ardeur vers les sciences sacrées : Je ne m’occupe point, dit-il lui-même, de la fuite de Saturne, ni de la colère de Junon, ni des adultères de Jupiter ; je méprise toutes ces choses qui tombent en ruines, et m’applique bien plutôt aux choses divines, aux miracles de l’Évangile. Le peuple partageait ce sentiment ; c’était celui des meilleurs hommes de l’époque, de tous ceux qui conservaient quelque énergie morale, quelque goût vraiment actif pour le développement intellectuel, et lorsque le jeune Florentius retourna en Auvergne après avoir été guéri par l’intervention de Saint Martin, il laissa le peuple comme le clergé de Tours pleins d’admiration pour la sainteté de son langage, de sa vie et de son savoir.
Il en reçut bientôt la preuve la plus éclatante. En 575, pendant un voyage qu’il fit, on ne sait pourquoi, à la cour de Sigebert roi d’Austrasie, auquel appartenait l’Auvergne, Euphronius, évêque de Tours, vint à mourir ; et d’une voix unanime, dit le biographe, le clergé et le peuple élurent à sa place Grégoire absent et âgé seulement de trente-quatre ans. Des députés partirent aussitôt pour aller solliciter du roi Sigebert la confirmation de ce choix. Grégoire hésita ; l’abbé de Cluni l’affirme du moins : sa jeunesse et sa mauvaise santé l’effrayaient ; mais Sigebert et la reine Brunehault joignirent leurs sollicitations à celles des députés ; il accepta, fut sacré par Egidius (Gilles), évêque de Reims, le 22 août 573, et partit aussitôt pour son évêché.
C’est dans les monuments du siècle, et surtout dans Grégoire de Tours lui-même, qu’il faut apprendre ce qu’était alors l’existence d’un évêque, quel éclat, quel pouvoir, mais aussi quels travaux et quels périls y étaient attachés. Tandis que la force avide et brutale errait incessamment sur le territoire, réduisant les pauvres à la servitude, les riches à la pauvreté, détruisant aujourd’hui les grandeurs qu’elle avait créées hier, livrant toutes choses aux hasards d’une lutte toujours imminente et toujours imprévue, c’était dans quelques cités fameuses, près du tombeau de leurs saints, dans le sanctuaire de leurs églises, que se réfugiaient les malheureux de toute condition, de toute origine, le Romain dépouillé de ses domaines, le Franc poursuivi par la colère d’un roi ou la vengeance d’un ennemi, des bandes de laboureurs fuyant devant des bandes de barbares, toute une population qui n’avait plus ni lois à réclamer, ni magistrats à invoquer, qui ne trouvait plus nulle part, pour son repos et sa vie, sûreté ni protection. Dans les églises seulement quelque ombre de droit subsistait encore et la force se sentait saisie de quelque respect. Les évêques n’avaient, pour défendre cet unique asile des faibles, que l’autorité de leur mission, de leur langage, de leurs censures ; il fallait qu’au nom seul de la foi, ils réprimassent des vainqueurs féroces ou rendissent quelque énergie à de misérables vaincus. Chaque jour ils éprouvaient l’insuffisance de ces moyens ; leur richesse excitait l’envie, leur résistance, le courroux ; de fréquentes attaques, de grossiers outrages venaient les menacer ou les interrompre dans les cérémonies saintes ; le sang coulait dans les églises, souvent celui de leurs prêtres, même le leur. Enfin ils exerçaient la seule magistrature morale qui demeurât debout au milieu de la société bouleversée, magistrature, à coup sûr, la plus périlleuse qui fût jamais.
Beaucoup d’évêques étaient fort loin de se montrer dignes d’une situation si difficile et si haute ; il n’est aucun désordre, aucun crime dont on ne rencontre, dans l’histoire du clergé de cette époque, d’effroyables exemples. Mais Grégoire de Tours fut de ceux qui s’en scandalisaient et quelquefois les reprenaient vertement. Je ne redirai point ici les événements de sa vie religieuse et politique ; il les a racontés dans son histoire. On y verra que, soit qu’il s’agit de défendre ou le clergé en général, ou lui-même, ou les privilèges de son église, ou les proscrits qui s’y étaient réfugiés, soit qu’il fût appelé à maintenir ou à rétablir la paix dans sa ville, soit qu’il intervînt comme négociateur tour à tour employé par les divers rois Francs, il ne manqua ni de prudence ni de courage. On s’est étonné de sa superstition, de sa crédulité, de son ignorance, de son ardeur contre les hérétiques ; il faut bien plutôt s’étonner de ce qu’il ne s’est point attribué à lui-même le don des miracles qu’il accordait à tant d’autres, de ses efforts pour s’instruire, de la douceur qu’il témoigna souvent, même aux brigands qui avaient pillé son église et aux Ariens ou aux Juifs que ses arguments n’avaient pas convertis. Peu d’ecclésiastiques de son temps, il est aisé de s’en convaincre, avaient une dévotion, je ne dirai pas aussi éclairée, mais moins aveugle, et tenaient, en ce qui touchait à l’Église, une conduite aussi modérée. On lui a reproché la confusion de son histoire, les fables absurdes dont elle est semée, sa partialité pour les rois orthodoxes, quels que soient leurs forfaits, et tous ces reproches sont légitimes ; mais il n’est aucun de ses contemporains qui ne les mérite encore davantage, aucun qui, à tout prendre, ait agi avec autant de droiture, étudié avec autant de soin, et donné, dans ses écrits et sa vie, autant de preuves de bon sens, de justice et d’humanité.
Aussi obtint-il constamment, dans le cours de son épiscopat, l’affection du peuple de Tours et la considération des rois Barbares. Il faut bien se servir des termes qui répondent aux sentiments qu’éprouvaient alors les hommes, et qu’ils ont employés eux-mêmes, quelque emphatiques qu’ils nous paraissent aujourd’hui. Grégoire de Tours fut vénéré comme un des plus saints évêques, et admiré comme une des lumières de l’Église. Le voyage que, selon l’abbé de Cluni, il fit à Rome, en 592 ou 594, pour voir le pape Saint Grégoire le Grand, est fort douteux, car il n’en a parlé nulle part ; mais le récit du biographe n’en prouve pas moins quel éclat conservaient encore au dixième siècle son nom et sa mémoire. Arrivé devant le pontife, dit-il, il s’agenouilla et se mit en prières ; le pontife, qui était d’un sage et profond esprit, admirait en lui-même les secrètes dispensations de Dieu qui avait déposé, dans un corps si petit et si chétif, tant de grâces divines. L’évêque , intérieurement averti, par la volonté d’en haut, de la pensée du pontife, se leva, et le regardant d’un air tranquille : c’est le Seigneur qui nous a faits, dit-il, et non pas nous-même ; il est le même dans les grands et dans les petits. Le saint pape, voyant qu’il répondait ainsi à son idée, le prit encore en plus grande vénération, et eut tant à cœur d’illustrer le siège de Tours qu’il lui fit présent d’une chaire d’or qu’on conserve encore dans cette église.
Grégoire était en effet de très petite taille et sa mauvaise santé dura toute sa vie. Deux mois après son élévation à l’épiscopat, il fut atteint d’une maladie si grave que sa mère, malade elle-même et qui s’était retirée en Bourgogne, se hâta d’accourir, malgré les fatigues et les périls du voyage, auprès de son fils chéri. L’intervention de Saint Martin réussit seule à guérir le nouvel évêque, qui bien des fois encore fut obligé d’y avoir recours. Enfin, le 17 novembre 593 [iii], les miracles même devinrent inefficaces ; l’évêque de Tours mourut à 54 ans, après 20 ans et quelques mois d’épiscopat, et fut élevé au nombre des saints.
Il laissait, en mourant, de nombreux ouvrages dont il avait pris soin de dresser lui-même la liste, et qui, à l’exception de quatre, sont parvenus jusqu’à nous ; en voici la liste et le sujet :
1°. L’Histoire Ecclésiastique des Francs.
2°. Un traité de la Gloire des Martyrs, recueil de légendes en cent sept chapitres, consacré au récit des miracles des martyrs.
3°. Un traité des Miracles de Saint Julien, martyr à Brioude en Auvergne, en cinquante chapitres.
4°. Un traité de la Gloire des Confesseurs, en cent douze chapitres.
5°. Un traité des Miracles de Saint Martin de Tours, en quatre livres.
6°. Un recueil intitulé, Vies des Pères, en vingt chapitres, et qui contient l’histoire de vingt-deux saints ou saintes de l’Église gallicane.
7°. Un traité des Miracles de Saint André, sur l’authenticité duquel on a élevé quelques doutes qui paraissent mal fondés.
Les ouvrages perdus sont :
1°. Un Commentaire sur les Psaumes.
2°. Un traité sur les Offices de l’Église.
3°. Une préface que Grégoire de Tours avait mise en tête d’un traité des Messes de Sidoine Apollinaire.
4°. Une traduction latine du martyre des sept Dormans.
Enfin on a attribué à Grégoire de Tours plusieurs écrits qui ne sont pas de lui.
De tous ces ouvrages, et malgré quelques faits ou quelques détails sur l’esprit et les moeurs du temps, épars dans les recueils de légendes, l’histoire ecclésiastique des Francs est le seul qui soit demeuré pour nous important et curieux. Tout porte à croire que cg, fut le dernier travail de l’auteur ; son récit s’étend jusqu’en 591, époque voisine de sa mort, et presque tous ses autres ouvrages y sont cités, tandis que l’histoire des Francs ne l’est dans aucun. Elle est divisée en dix livres. Le premier, résumé absurde et confus de l’histoire ancienne et universelle du monde, serait aussi dépourvu d’intérêt que de vérité chronologique s’il ne contenait quelques détails sur l’établissement du christianisme dans les Gaules ; détails de peu de valeur, il est vrai, quant à l’histoire des événements, mais qui peignent naïvement, et quelquefois avec charme, l’état des esprits et des moeurs ; peu d’anecdotes de ce temps sont plus touchantes, plus poétiques même que celle des deux Amans : ce livre finit à la mort de Saint Martin de Tours, en 397. Le second livre s’étend de la mort de Saint Martin à celle de Clovis Ier, c’est-à-dire, de l’an 397 à l’an 511. Le troisième, de la mort de Clovis Ier à celle de Théodebert Ier, roi d’Australie, de l’an 511 à l’an 547. Le quatrième, de la mort de Théodebert Ier à celle de Sigebert Ier, roi d’Austrasie, de l’an 547 à l’an 575. Le cinquième comprend les cinq premières années du règne de Childebert Ier, roi d’Australie, de l’an 575 à l’an 580. Le sixième finit, à la mort de Chilpéric, en 584. Le septième est consacré à l’année 585. Le huitième commence au voyage que fit le roi Gontran à Orléans, au mois de juillet 585, et finit à la mort de Leuvigild, roi d’Espagne, en 586. Le neuvième s’étend de l’an 587 à l’an 589. Le dixième enfin s’arrête à la mort de Saint Yrieix, abbé en Limousin, c’est-à-dire, au mois d’août 591 [iv]. L’ouvrage entier comprend ainsi, à partir de la mort de Saint Martin, un espace de cent soixante-quatorze ans ; les cinquante-deux dernières années sont celles auxquelles l’historien avait assisté.
Tout indique qu’il écrivit son histoire à deux reprises différentes ; plusieurs manuscrits ne contiennent que les six premiers livres, et ce sont les seuls que connût Fédégaire lorsque dans le siècle suivant, il entreprit un abrégé des chroniqueurs qui l’avaient précédé. Il est donc probable que les quatre derniers livres furent composés après la publication des premiers ; peut-être même ne furent-ils répandus qu’après la mort de l’auteur. Cependant, leur authenticité n’est pas moins certaine.
Imprimée pour la première fois à Paris, en 1561, l’Histoire des Francs l’a été fort souvent depuis ; je ne dirai rien des nombreux travaux d’érudition et de critique dont elle a été l’objet ; ils ont été reproduits et résumés avec le plus grand soin dans l’édition qui fait partie du Recueil des historiens des Gaules et de la France, et dont nous avons adopté le texte. Deux traductions françaises de l’ouvrage de Grégoire de Tours ont été publiées, l’une, en 1610, par Claude Bonnet, avocat au parlement de Grenoble, l’autre, en 1688, par l’abbé de Marolles. Elles sont l’une et l’autre extrêmement fautives, et la première est souvent plus inintelligible que l’original.
La meilleure ou plutôt la seule bonne édition des oeuvres complètes de Grégoire de Tours est celle que publia dom Ruinart, en 1699, in-folio. La préface est pleine de savantes recherches.
Les deux dissertations les plus complètes et les plus exactes sur la vie et les écrits de notre historien sont : 1° celle qui se trouve dans le tome 3e de l’Histoire littéraire de la France, par les Bénédictins (page 372 - 397 ) ; 2° un mémoire de M. Lévesque de La Ravalière dans la Collection des mémoires de l’Académie des Inscriptions et Belles-lettres, tome 26, page 598 - 637.
François Guizot
[i] Un assez grand nombre de manuscrits portent pour titre Historia Francorum, ou Gesta Francorum ; quelques-uns même simplement Chronicæ ; mais les plus anciens sont intitulés Historia ecclesiastica Francorum, et le début du second livre indique clairement que tel est en effet le titre que Grégoire de Tours a dû donner à son ouvrage.
[ii] Ou Saint Nizier.
[iii] Selon M. Lévesque de La Ravalière, et 595 selon dom Ruinart.
[iv] Malgré l’enchaînement chronologique des dix livres de l’Histoire des Francs, il s’en faut beaucoup que les événements y soient bien classés et toujours rapportés à leur vrai temps ; il y règne au contraire une extrême confusion, et l’on rencontre sans cesse, dans chaque livre, des récits qui devraient appartenir aux livres antérieurs ou postérieurs.