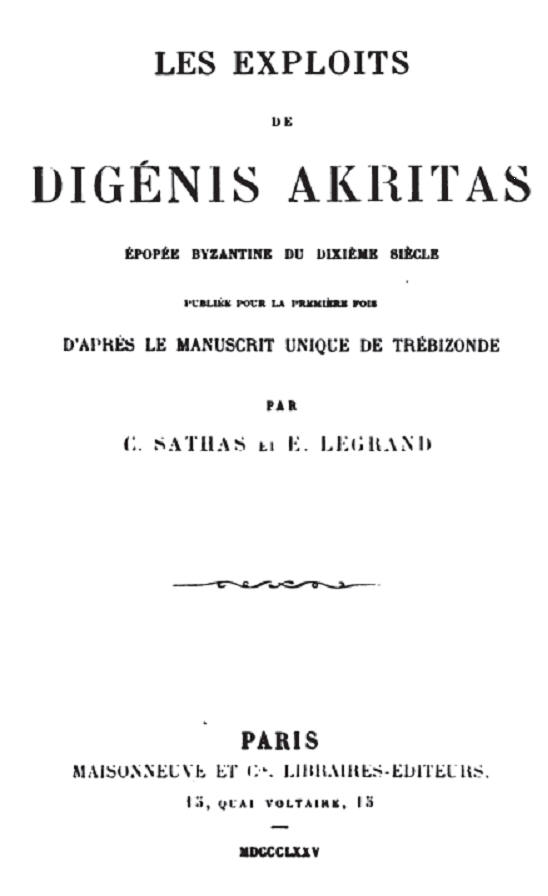
ANONYME
LES EXPLOITS DE DIGÉNIS AKRITAS
Livres VII à X
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
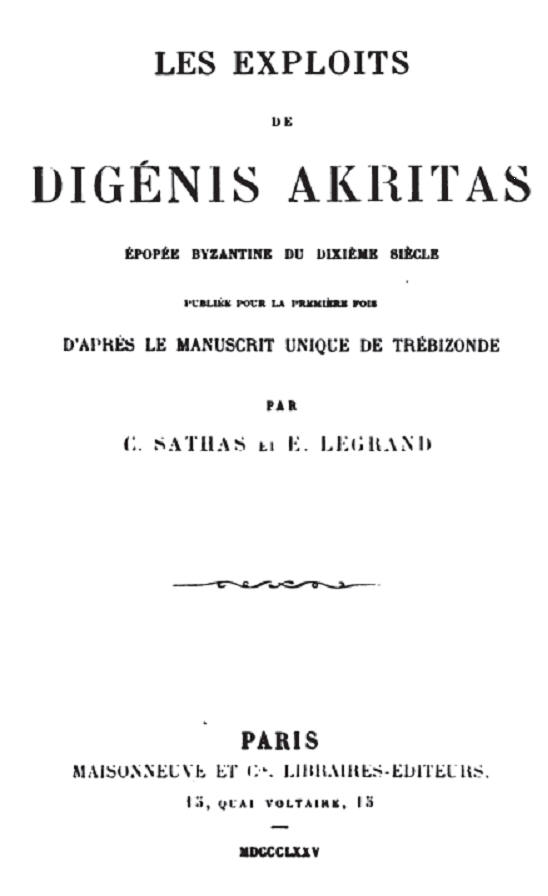
ANONYME
LES EXPLOITS DE DIGÉNIS AKRITAS
Livres VII à X
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
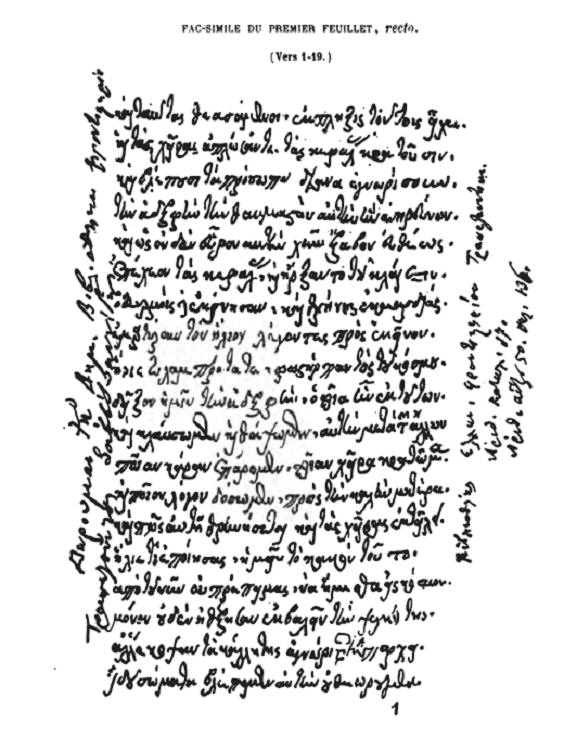
Le septième et présent livre contient le récit développé des nombreux exploits du vaillant Akritas, tel qu'il le narra lui-même à ses amis intimes. Il y expose ses victoires et ses combats relatifs à Philopappos, ainsi que ceux contre Maximo, la fameuse Amazone.
Qui voudrait chanter le roi des mois ? De tous les mois mai est le roi ; il est le plus bel ornement de toute la terre ; l'œil de toutes les plantes, l'éclat des fleurs, la fleur étincelante des prés charmants; et le merveilleux amour qui s'en exhale excite aux plaisirs d'Aphrodite. Par ses fleurs brillantes, ses violettes et ses roses, il fait de la terre la rivale du ciel. Alors l'amour se manifeste à ses servants, et tout ami de la volupté s'abandonne à la joie.
Dans ce merveilleux et très doux mois, je voulus changer de campement, seul avec la ravissante fille du général Ducas, à cause du charme de cet admirable mois de mai, de l'éclosion des fleurs, de la joie universelle, et à cause aussi de l'isolement de ma charmante bien-aimée.
Nous étant donc rendus dans une prairie magnifique, j'y dressai ma tente et mon lit. Autour de ma tente, je semai toutes sortes de plantes, émaillant ainsi le sol de fleurs éclatantes. Le spectacle qui s'offrait à la vue était des plus réjouissants : c'étaient des bosquets très touffus, d'immenses quantités d'arbres dont les rameaux entrelaçaient leurs frondaisons luxuriantes. Le parfum des fruits rivalisait avec celui des fleurs, les vignes s'enroulaient autour de la plupart des arbres, des roseaux s'élevaient à une grande hauteur. Le sol était diapré de fleurs charmantes ; le beau narcisse y poussait avec les violettes et les roses. Une onde fraîche jaillissait au milieu de la prairie et sillonnait ce lieu dans tous les sens. Il y avait près de la source de profonds réservoirs d'eau, où se miraient les fleurs et les arbres ; dans l'un l'eau était naturelle, et dans l'autre blanchâtre. Le bois était peuplé de plusieurs espèces d'oiseaux, tels que paons apprivoisés, perroquets et cygnes ; les perroquets vivaient suspendus aux branches, et les cygnes sur les eaux. Les paons faisaient avec leurs plumes la roue parmi les fleurs, avec lesquelles ils rivalisaient d'éclat. Les autres oiseaux, en possession de leur liberté, se jouaient, perchés sur les branches d'arbres, et faisaient entendre des chants plus harmonieux que ceux des sirènes, d'autres enfin étalaient fièrement les magnificences de leur plumage.
Mais la rayonnante beauté de la noble jouvencelle brillait d'un plus vif éclat que celle des paons et de toutes les fleurs. Son visage resplendissait comme le soleil, et ses joues vermeilles et fleuries étaient pareilles à des roses parfumées. De même que la rose attire l'odorat, ainsi la jouvencelle attirait et captivait les yeux au point que l'on ne pouvait se détacher de sa vue. Ses lèvres ressemblaient à des fleurs aux nuances rosées, lorsque commence à s'entrouvrir leur calice. Ses boucles flottantes descendaient jusqu'à terre et lui faisaient une délicieuse parure de rayons dorés ; partout régnait une ineffable allégresse.
De gâteaux aussi nombreux que variés se dégageait un fumet odorant, et la brise était douce et pleine des senteurs embaumées du musc, de la casse, du camphre, de l'ambre et de l'aloès.
Tels étaient les agréments que présentait ce jardin.
A l'heure de midi, je me laissai aller au sommeil, tandis que la jouvencelle m'aspergeait d'eau de roses et que les rossignols mêlaient leurs chants à ceux des autres oiseaux.
La jeune fille, étant altérée, se rendit à la source et, tandis qu'elle prenait plaisir à s'y baigner les pieds, un dragon, qui avait emprunté les traits d'un bel adolescent, se présenta à elle, voulant la séduire. Mais la jouvencelle, sachant qui il était, lui dit ces paroles : « Renonce à ton dessein, monstre ; je ne me laisse pas séduire. Celui qui m'aime a veillé et il vient de s'endormir, mais, s'il se réveille et te trouve, mieux vaudrait pour toi n'être pas né ! » Cependant le dragon, ayant cyniquement bondi sur la jeune fille, essayait de lui faire violence, mais elle poussa aussitôt un cri et m'appela : « Réveille-toi, mon maître, tu perds ta belle ! » Sa voix ayant retenti dans mon cœur, je m'élançai promptement et j'aperçus le téméraire, car la source se trouvait vis-à-vis de moi dans un endroit découvert. Je saisis mon épée et je me trouvai à la source. Il me semblait qu'en ce moment mes pieds avaient des ailes. Le dragon m'offrit alors le spectacle terrifiant de trois têtes énormes, au lieu d'une, et vomissant de deux côtés des flammes et des éclairs. Le bruit de tonnerre qu'il faisait en remuant de place était tel que la terre et les arbres semblaient ébranlés; réunissant ses têtes sur un corps énorme, la croupe terminée par une queue pointue, il étalait sa masse effroyable et se disposait à fondre sur moi avec toute son impétuosité. Mais, considérant comme rien ce que je voyais, je levai, Dieu aidant, mon épée en l'air, je m'élançai sur le monstre et j'abattis la tête de ce terrible et épouvantable dragon. Il tomba étendu à terre vraiment mort et agita sa queue de haut en bas dans une dernière convulsion. J'essuyai mon épée et je la remis au fourreau. J'appelai mes gens qui étaient éloignés, et aussitôt arrivés, je leur ordonnai d'enlever le monstre et de le jeter loin de ma tente ; ce qui fut ponctuellement exécuté sans retard. Mes hommes retournèrent dans leurs tentes, et, moi, je me couchai sur mon lit pour dormir Le lieu où je prenais mon sommeil m'était très agréable.
Délivrée des obsessions du dragon, et au souvenir de l'apparition et de la prompte mort de ce monstre, la jouvencelle riait d'un rire inextinguible.
A mon réveil, la jeune fille s'étant rendue sous un arbre, un lion terrible sortit du marécage et, lui aussi, se disposait à s'élancer sur elle. Elle poussa un cri et m'appela à son secours.
Je saute vite de mon lit, je saisis ma massue et, la tenant dans mes mains, je fonds sur la bête, je l'atteins et je lui en assène un coup ; sa peau ne fut pas endommagée, mais je trouvai les os fracassés. Sur un nouvel ordre, mes serviteurs jetèrent le lion loin de ma tente. Quant à moi, prenant par la main l'illustre jouvencelle, je regagnai paisiblement notre couche avec elle. La jeune fille me suppliait et me disait, en me serrant dans ses bras et en me couvrant de baisers : « Mon jeune dindon, jouis de ta beauté et de cette vaillance que Dieu t'a donnée plus grande qu'à tout autre. Joue de ta lyre pour ranimer mon esprit abattu, car la peur des monstres m'a enlevé toute énergie. »
Et moi, ayant détaché ma lyre de la cheville, j'en tirais des accords et la jouvencelle chantait, rendant grâces à l'Amour de lui avoir donné un charmant dindon. Et elle disait cela en m'embrassant et sans craindre personne Et sa chanson commençait par les paroles que voici : « O ma rose, fleur superbement épanouie, ma pomme parfumée, lumière de mes pensées, lumière de mes yeux, consolation de mon âme, volupté de mon corps, je remercie mon créateur, le créateur de toutes choses. Et moi, son indigne créature, j'adore sa bonté, à lui qui m'a donné en ce monde un époux rempli de vaillance et qui triomphe de tous. »
Tandis que la jeune fille chantait ceci et beaucoup d'autres choses encore, je frappais ma lyre avec une plume d'oiseau, et les accords de cet instrument formaient avec la voix de la jouvencelle un doux concert, que répétait l'écho des montagnes.
Et voilà que trois cents beaux apélates apparurent, tous armés. Ils descendaient de la montagne, attirés par le son de ma lyre et le chant de la jouvencelle. Ils étaient tous venus rapidement et avec grande joie, et, à la distance de nous d'un mille environ, ils faisaient des signes d'approbation à la jeune fille. Mais, quand ils furent près de moi et qu'ils virent la charmante jouvencelle, leurs âmes furent blessées par sa beauté, comme par un trait, et tous brûlèrent d'un amour aussi grand, aussi immense que peut le comporter cette passion. A eux tous, ils formaient, à parler exactement, une troupe d'environ trois cents hommes, armés jusqu'aux dents; et ils espéraient, me voyant seul, m'accabler de leurs paroles : « Abandonne la jouvencelle, disaient-ils, sauve-toi toi-même, sinon la mort sera le châtiment de ta désobéissance. »
Ils ne savaient pas encore qui je suis ; mais la jouvencelle, radieuse fille du soleil, voyant soudain ces gens armés, tous à cheval, crut à leurs paroles, et, grandement effrayée, elle se couvrit le visage de son voile et courut dans la tente, en proie à une vive terreur ; puis elle me dit : « Mon maître, ô mon âme, je ne puis parler, la peur a complètement paralysé ma voix ; nous allons être séparés, et je ne me soutiens plus moi-même. » Et, moi, je lui dis : « O mon âme, cesse de penser en ton esprit, comme si tu ne me connaissais pas ; car ceux que le divin Roi, le créateur de toutes choses, a unis, des myriades d'hommes ne sauraient les séparer. »
Je pris aussitôt ma massue et mon bouclier à main, et, du sommet de la colline, je me ruai sur eux, comme un aigle sur les perdrix. Ils vinrent à ma rencontre et commencèrent à frapper ; les coups qu'ils m'assénaient tombaient drus. Mais tous les apélates qu'atteignit ma massue, il ne leur resta pas un souffle de vie. J'en rejoignis beaucoup qui voulaient fuir (car jamais un cheval ne m'a vaincu à la course; et, si je vous le dis, ce n'est pas pour en tirer vanité, mais afin que vous connaissiez les dons du créateur). Quelques-uns s'échappèrent et s'enfuirent dans les bois, mais je les eus bientôt tous mis à mort. Ayant fait l'un d'eux prisonnier, je cherchai à savoir par lui quels étaient ces jeunes gens audacieux et fous. Et, ayant tiré de cet homme des renseignements précis, je le tuai aussi, tant j'étais enflammé de colère. Ensuite je jetai ma massue et mon bouclier à poignée, et, en secouant mes manches, je me rendis dans ma tente.
La jouvencelle, me voyant resté seul, vint à ma rencontre, remplie de joie, el, de ses deux mains, elle m'aspergeait d'eau de roses, m'embrassant la main droite et me souhaitant une longue vie. Sur …
« Et ils tombèrent dans la fosse creusée par eux. »
En entendant cela, ils se regardaient les uns les autres, remuant les lèvres et murmurant ceci : « Ne serait-ce point Digénis, qu'on appelle Akritas ? Mettons-le donc à l'épreuve, afin de nous en assurer. »
Et le chef me dit : « Comment pouvons-nous croire que, seul, sans armes et à pied, comme tu le dis, tu as osé engager le combat avec eux ? Car ceux que nous cherchons étaient au nombre de trois cents hommes, tous apélates, qui ont fait leurs preuves en bataille rangée. Mais, si tu dis la vérité, prouve-le par tes actes. Prends parmi nous un pallikare à ton choix et bats-toi en duel avec lui. De cette façon, nous saurons promptement à quoi nous en tenir. »
Pour moi, je me mis à sourire et je leur répliquai : « Je suis fils unique et je vis seul, mais, depuis que j'ai commencé à guerroyer, je n'ai encore attaqué personne isolément. »
« Un jour, dans une de mes expéditions, je montai à cheval et me rendis dans la plaine. En Mésopotamie, je fis la rencontre d'un jouvenceau bien dispos, de belle tournure, plein de bravoure, auquel il me plut de prendre son cheval. Ce jeune homme portait alternativement ses regards sur son coursier et sur moi-même. Très vaillant et très alerte, il fit un léger écart et m'asséna un coup de sa massue, et de ce coup il m'enleva la mienne, sur laquelle il traça avec du sang des lettres formant une missive qui commençait par ces mots : « Ne te chagrine pas, Akritas, et bannis de ton cœur toute tristesse. Je suis ton serviteur, le lion Ankylas. C'est pour toi que je suis venu, je n'avais pas autre chose à faire ; j'ai accompli mon dessein et ton vœu également, Akritas. Raconte donc à tous les apélates qu'Ankylas t'a donné un grand coup de massue et que ce brave ne t'a pas tout-à-fait tué. »
« Voilà ce que m'écrivit le célèbre Ankylas, et je vais vous raconter le châtiment que je lui infligeai. Je m'élance sur mon cheval, je reprends ma massue, et je retourne dans ma tente, en proie à une violente douleur ; à l'aide des étriers, je descends de mon merveilleux cheval gris, et je lis ce qui était écrit avec du sang sur ma massue. Le souci de ma vengeance m'obsédait continuellement.
« J'attendis donc une année, dévoré par le chagrin, et, après que l'année fut arrivée à sa fin, je résolus à part moi de payer à l'illustre et vaillant Ankylas la dette du coup de massue, ainsi que celle de la lettre.
« Je m'élance sur le dos de mon admirable bai brun, le cheval qui avait toujours ma confiance dans mes prouesses. Je prends mon bouclier, ma lyre et ma massue simple, puis je pars pour la lutte.
« Arrivé près de la demeure d'Ankylas, je frappai sur ma lyre et je me mis à chanter. Je chantai comme un rossignol, remplissant tout le monde d'admiration, et ma chanson débutait par ces paroles : « Dans ces vallons, dans ces défilés, dans ces endroits rocheux, les nobles et vaillants hommes donnent aux braves de bons coups de massue ; l'un d'eux m'a prêté un violent coup de massue ; c'est une dette qui me tourmente beaucoup, et avec justice. Je veux la payer intégralement, et je suis venu ici pour m'en acquitter. »
« Ankylas, ayant entendu mes paroles à son adresse, et rempli, comme à son habitude, d'une excessive confiance en lui-même, excita son cheval et fondit sur moi. J'excitai pareillement mon bai brun, et je commençai à frapper Ankylas. Je lui assénai un léger coup de massue sur le front, et aussitôt il demeura sans voix et tomba de cheval. Ayant incontinent mis pied à terre, je prends le jouvenceau pour le relever, mais il poussa un soupir et expira sur-le-champ.
« Et c'est toi, Philopappos, qui me parles de la sorte ? Allez, mettez pied à terre, venez trois contre un ; et. à moins peut-être que vous n'ayez honte, venez avec vos chevaux, et vous apprendrez par mes actes qui je suis ; et, si bon vous semble, commençons sur l'heure à combattre. »
Je parlai ainsi, puis je me levai, je pris ma massue, mon bouclier muni d'une poignée, car j'avais là ces armes ; ensuite, m'étant un peu avancé, je leur dis d'une voix forte : « A vos ordres, seigneurs, je suis prêt. »
Le premier d'entre eux me répondit : « Nous n'agirons pas comme tu le dis ; nous n'avons pas pour principe de marcher trois contre un, nous qui avons l'assurance de vaincre chacun des milliers d'hommes. Car, tu as entendu parler de moi, je suis Philopappos ; celui-ci est Joannikios, et le troisième est Cinnamos. Nous aurions honte de combattre un seul adversaire ; mais choisis entre nous celui que tu voudras, et alors nous connaîtrons toute la vérité. »
Et moi, je lui répliquai : « Venez donc le premier. »
Philopappos descendit aussitôt de son cheval, et, l'épée en main, farouche, il s'avança vers moi, comme un aspic, dans l'espoir de m'effrayer, rugissant connue un lion, sifflant comme un dragon. Son attaque fut vraiment très courageuse ; il me porta un bon coup d'épée sur mon bouclier, dont la poignée seule me resta dans la main. Les deux témoins de la lutte s'écrièrent : « Philopappos, ajoutes-y encore le coup du vieillard ! »
Et, comme il voulait lever de nouveau son épée, je lis un léger mouvement de retraite et je le frappai d'un coup de massue à la tête, dont pas un seul os ne fût demeuré intact s'il ne se l'était entièrement couverte avec son bouclier. Mais le vieillard, étourdi et fort effrayé, et mugissant comme un bœuf, tomba étendu par terre. A cette vue, les autres fondirent sur moi de toutes leurs forces, a cheval, et cela sans en avoir honte, comme ils s'étaient vantés auparavant.
Les voyant s'élancer, je saisis le bouclier des mains du vieillard et je cours sur eux. Un engagement ayant lieu ainsi qu'un combat acharné, ils tombèrent tous deux sur moi comme des chiens courageux.
Cinnamos m'attaqua par derrière afin de m'éviter. Mais à porter les coups et à les parer, je trouve que Joannikios fit preuve d'une valeur hors ligne, et j'ai vu des combattants vraiment habiles.
Je criai ceci à la jouvencelle : « Voici les gens qui veulent en venir aux mains avec moi. »
Je veillais à ce que Joannikios ne me frappât point à la dérobée, mais aucun des deux illustres et vaillants guerriers ne réussit à m'approcher, car, lorsque je brandissais ma massue, ils fuyaient comme des brebis à la vue du loup. Mais ils revinrent encore, comme des chiens aboyants, et cela dura ainsi une grande heure.
La jouvencelle se rendait compte du danger, et se tenait éloignée, mais de façon à voir ce qui se passait autour de moi. Quand elle vit les deux apélates m'entourer comme des chiens, elle me lança cette parole encourageante : « Du courage, mon bien-aimé ! » Ce mot de ma femme chérie me redonna des forces.
Je frappai légèrement Joannikios au bras droit au-dessus du coude ; les os furent fracassés, et le bras retomba tout entier ; lui-même fut précipité de son cheval à quelques pas devant moi, et son épée roula à terre. Vaincu par la douleur que lui causait la fracture de son bras, il s'appuya sur un rocher. A cette vue, Cinnamos frappa son cheval, et, transporté de colère, il fondit sur moi, brandissant le bras pour me donner un coup d'épée.
Je donnai un bon coup de massue sur la tête de sa jument, et elle tomba devant moi avec son cavalier. Et moi, je criai à Cinnamos : « Ne tombe pas, mais relève-toi ! Je ne veux pas te frapper gisant à terre. Mais ramasse-toi, et reviens de nouveau, si tu veux. »
Vite il se relève, saute à cheval, prend sa lance, se retourne fièrement, et se met aussitôt au galop pour venir me donner un coup de lance. Je tenais ma petite massue, je lui en assène un coup et je le renverse de sa jument avec la selle, et son bras retomba à terre.
Aussitôt que Philopappos les vit ainsi traités, il me dit : « Mon bon jouvenceau, cesse le combat et fais la paix. Bien plus, si tu veux recevoir un conseil de moi, prends le commandement de tous les apélates. Tous ici se tiennent à tes ordres comme de bons serviteurs. Nous nous empresserons d'exécuter ce qu'il te plaira de nous commander. »
Ayant entendu cela, j'eus pitié des autres, de Joannikios comme de Cinnamos, et je lui dis, avec un sourire ironique : « Tu es éveillé et tu me racontes des songes, Philopappos! Mais, puisque ta vieillesse est venue à résipiscence, lève-toi, prends tes compagnons et va où tu voudras, maintenant que tes yeux ont été témoins de mes actions, et crois ceux qui te diront que les gens que vous cherchez ont été impitoyablement rayés du nombre des vivants. Je ne brigue pas le commandement, mais je veux vivre seul, puisque je suis l'unique fils de mes parents. C'est à vous autres qu'il convient d'exercer l'autorité, et aussi de vous prêter un mutuel secours dans ce qui est de votre domaine, c'est à vous de faire des incursions. Et, si vous voulez me mettre souvent à l'épreuve... »
« Je suis dans ma cinquante-deuxième année, et j'ai parcouru beaucoup de villes et de nombreuses provinces ; mais toutes les femmes sont vaincues [en beauté par l'épouse de Digénis], ainsi qu'une pléiade d'étoiles, quand le soleil darde ses rayons. Toutes celles que j'ai vues auparavant possédaient, je crois, l'éclat des étoiles, mais la belle qui m'est inopinément apparue en ce jour est plus resplendissante que le soleil. Du courage donc, charmant jouvenceau, du courage, dès maintenant la belle est ta femme. Mais si vous m'écoutez et si vous voulez mon avis, ne souffrons point qu'il prenne cette habitude, et ne laissons pas son audace impunie ; mais allumons des fanaux, réunissons-nous et donnons-lui la récompense qu'il mérite, car je suis persuadé, mes enfants, qu'il ne nous exterminera pas tous. »
Ils montèrent à la vigie afin d’opérer le rassemblement, et tinrent toute la nuit des torches allumées ; mais pas un apélate ne les aperçut, de sorte que, après trois nuits de fatigues, absolument aucun de ceux qu'on attendait n'était présent. Les gens de Philopappos commentèrent alors à murmurer : « Pourquoi, valeureux vieillard, nous avoir imposé une pareille besogne ? Ne t'avons-nous pas prouvé notre vaillance par les exploits que nous avons accomplis sous tes yeux en tant de combats? N'as-tu pas été bien étonné que, nous les invincibles dont tu avais coutume de voir les prouesses extraordinaires, nous ayons été vaincus par lui, comme des gens sans expérience des combats? Tu ne croiras rien de ce que nous disons, si nous ne sommes pas tués par lui. Mais, si tu le permets, écoute un conseil de tes enfants. Après tant de fatigues, il nous faut vaincre ; va donc trouver notre parente Maximo, prie-la de nous prêter secours, afin que nous fondions sur Akritas, la nuit, à l'improviste, et que, cerné, il ne puisse monter à cheval. Peut-être paralyserons-nous ainsi son audacieuse vaillance, mais si, par hasard, il est à cheval, nous fuirons de nouveau, afin qu'il ne nous tue pas tous. »
Ces conseils plurent beaucoup au vieillard ; il monta aussitôt à cheval pour aller trouver Maximo. Cette femme descendait, ainsi que je l'ai appris, de ces vaillantes Amazones que le roi Alexandre avait amenées du pays des Brahmanes. Elle possédait la très grande énergie de sa race et passait sa vie à combattre.
Arrivé auprès de Maximo, Philopappos la salua humblement : « Comment vas-tu? » lui demanda-t-il. Celle-ci lui répondit : « Je me porte bien, grâce à Dieu. Et toi, mon très cher, comment te portes-tu, toi et tes enfants? Pour quel motif es-tu venu sans eux auprès de moi? » Le vieillard lui répondit, en déguisant la vérité : « Ma dame, mes enfants chéris se portent parfaitement, Dieu merci. Ils se sont rendus aux frontières, où ils s'efforcent d'exterminer totalement les irréguliers. Une fois séparé d'eux, et désirant prendre du repos, je me mis à la recherche de quelque bonne aubaine, avec la faveur et la protection de Dieu. Mais, comme il m'était impossible de rester dans Une inaction complète, je montai à cheval, après le départ de mes enfants chéris, et je me mis à parcourir seul les frontières, surveillant les passages par crainte des ennemis.
Parvenu à la route appelée Trosis, j'aperçus sur ma gauche, dans une prairie touffue, une jeune fille plus précieuse que l'or; jamais mes yeux n'avaient vu pareil gibier. Splendidement belle d'une beauté dépourvue d'artifices, une grâce ineffable brillait dans ses yeux, sa taille était un chef-d'œuvre sorti des mains de Dieu, et, comme une vivante image, elle charmait tous les cœurs. J'ai appris qu'elle est fille de Ducas, et (je prends pour garant de mes paroles ton cher Joannikios, cet homme d'or, ce héros) elle a été, j'ignore comment, épousée par l'homme qui se divertit maintenant avec elle dans la prairie. Et, si tu as quelque-souci de ta parenté avec ce brave Joannikios, mets-toi pour lui à l'œuvre, ne recule pas même devant les veilles, prouve ton affection par tes actes, ma dame. Car quiconque prend volontiers part aux chagrins de la per-° sonne qu'il aime, celui-là est un vrai parent, un vrai ami. »
Philopappos, en adressant à Maxinio ces paroles flatteuses, réussit entièrement à la convaincre et n'eut pas de peine à circonvenir la sagesse d'une femme.
Après avoir entendu Philoppapos, Maximo appela aussitôt avec joie Mélémendzis, son premier pallikare, le capitaine de ses apélates.
Elle ne lui demanda pas à qui appartenait la jouvencelle mais souriante et gaie elle lui dit : « Sais-tu que notre ami Philopappos a récemment trouvé aux frontières un gibier magnifique et qu'il nous invite à partir afin de partager la joie et les délices qu'il va en retirer ? Va donc, rassemble tous les apélates, choisis entre mille les cent plus vaillants parmi ceux qui ont fait leurs preuves dans les affaires les plus difficiles. Ne néglige pas en quoi que ce soit ce que ta maîtresse te commande ; monte ce soir même à la vigie, allume les fanaux, réunis nos gens et choisis parmi eux les cent plus braves. »
Après les avoir pris avec lui, Mélémendzis se rendit auprès de Maximo ; celle-ci leur donna des armes, et, accompagnée de Philopappos, de Mélémendzis et des apélates, elle vint vers moi.
Quand ils furent arrivés au sommet de la colline, le vieillard donna le mot d'ordre à ses amis et fit allumer les fanaux durant la nuit, afin de réunir les hommes de Cinnamos, qui, avec le jour, se joignirent aux siens.
Maximo les accueillit avec de grandes démonstrations de joie, car elle les honorait comme parents et comme alliés.
Ils s'avancèrent jusqu'au bord du fleuve, et Philopappos leur tint ce langage : « Ma dame, l'endroit où j'ai vu la jouvencelle est excessivement resserré et d'un accès très difficile ; si nous nous mettons tous en route, nous allons faire beaucoup de bruit et être reconnus par l'homme qui veille sur la jouvencelle ; et, avant que nous soyons près d'eux, ils vont se cacher dans la forêt, et il me semble, ma dame, qu'il nous sera alors impossible d'atteindre notre gibier, et de cette façon nous nous serons donné une peine inutile. Mais, si tu veux, nous n'irons que deux ou trois ensemble à la recherche de l'endroit où se trouve la jouvencelle ; nous resterons deux pour la surveiller, et le troisième retournera vers vous et vous l'indiquera ; ensuite vous reviendrez avec lui, en prenant beaucoup de précautions. »
Maximo répondit ainsi au vieillard : « Je te confie le commandement comme à un chef habile et prudent ; fais donc ce que tu voudras, tous t'obéiront. »
Puis, après réflexion, il prit avec lui Mélémendzis et Cinnamos, et ils s'avancèrent rapidement vers moi. Il enjoignit aux autres de demeurer là où ils étaient, jusqu'à ce qu'on les avertît de se montrer.
Je me trouvais alors par hasard à mon poste d'observation, tenant mon cheval par la bride et assis sur le rocher. J'observais entièrement leur attaque, car je pensais bien qu'ils allaient fondre sur moi ; je me prépare moi-même à la résistance, en amenant des chevaux éprouvés et en apportant des armes. Je portais un vêtement de Bagdad, et un magnifique manteau long en soie violette. Je montai sur Un cheval gris, je me rendis à ma vigie, et de là j'observai leur plan d'attaque.
Philopappos m'aperçut et, me montrant de la main, dit à Mélémendzis : « Vois-tu au sommet de cette colline cet homme assis sur un rocher? C'est, sache-le, celui qui possède la jouvencelle. Ne nous en approchons pas maintenant, mais cherchons où se trouve la jeune fille, afin que, comme nous l'avons dit, nous sachions comment avancer. Car il est seul, mais il est brave. Je connais sa vaillance ; et, bien qu'il soit tout seul, ce n'est pas une raison pour t'aventurer à descendre. »
Cinnamos confirma aussi ces paroles et il ajouta : « Que tout se passe comme tu l'as dit! »
Mais Mélémendzis ne se rangea pas à leur avis, et il lui fit cette réponse présomptueuse et hautaine : « Ne me dis pas de ces choses-là, Philopappos ; je n'ai jamais pris conseil de mille hommes, et c'est d'un seul que vous me dites... »
Les uns descendirent sur les bords du fleuve, les autres se dispersèrent, à la recherche d'un gué. Ils marchaient sur deux rangs, et Maximo au milieu d'eux. Et celle-ci se retourna et dit à Philopappos : « Dis-moi, Philopappos, où est le possesseur de la jouvencelle ? »
« Le voici, » dit-il, en me désignant de la main.
Et Maximo : « Où sont ses soldats? demanda-t-elle. Ne sait-il pas que c'est pour lui que nous sommes venus ici, qu'il est sans inquiétude et n'a pas amené ses gens ? »
« Il n'a pas de soldats, reprit Philopappos ; il erre seul avec la jouvencelle, confiant dans son courage et sa grande audace, et ignorant ce qui va lui arriver. Bien qu'il soit seul, ne marche pas seule contre lui. »
Et Maximo répondit : « O vieillard trois fois maudit, c'est pour un seul homme que tu nous as mis en besogne, mes gens et moi? Pour un homme vers lequel j'irai seule, et à qui, pleine de confiance en Dieu, je couperai la tête et vous la rapporterai ? »
Après avoir ainsi parlé avec colère, elle s'élança pour traverser le fleuve ; et moi, je lui dis avec courage et audace : « Ne passe pas, Maximo, pour venir vers moi. C'est aux hommes seulement qu'il convient d'aller vers les femmes ; j'irai donc vers toi, comme la justice l'exige. »
Aussitôt j'anime mon cheval de la voix et j'entre dans le fleuve ; l'eau était profonde, et mon coursier nageait ; mais il y avait peu d'eau sur l'autre rive du fleuve, et Maximo, armée, s'y tenait, observant vaillamment mon attaque.
Quand je m'aperçus que mon cheval avait pris terre, je l'excitai aussitôt de la voix et je saisis mon épée. Alors Maximo se rapproche de moi et me frappe d'un coup de lance ; mes armes étaient solides, sa lance vola en éclats. Maximo bondit pour faire volte-face et tirer son épée ; et, moi, brandissant la mienne, j'usais de ménagements envers elle.
Mais aussitôt je décapitai sa jument, dont le cadavre s'affaissa péniblement à terre. Maximo recula, saisie de frayeur, et, tombant à mes genoux, elle me dit : « Akritas, ne me tue pas ! » J'eus compassion d'une femme si merveilleusement belle, et, l'ayant laissée là, je me dirigeai vers les autres combattants.
Ses hommes, voyant que je l'avais ainsi renversée, m'entourèrent, comme des aigles leur proie ; puis, m'ayant poussé au milieu d'eux, ils me frappaient de tous côtés, les uns à coups d'épée avec les deux mains, les autres à coups de lance. Mais je rougis de dire comment je les couvris tous de confusion, de peur que, mes chers amis, vous ne croyiez que je me vante (car l'homme qui raconte ses exploits est considéré comme un vaniteux par ceux qui l'entendent ; mais, moi, ce n'est pas par jactance que je vous raconte ceci ; non, par celui qui donne force et intelligence aux sages, ce que je vais vous dire est la pure vérité ; c'est pourquoi, vous qui m'écoutez, je compte sur votre pardon), oui, je rougis de dire comment je couvris de honte tous ces guerriers armés de pied en cap et revêtus de cuirasses.
Lorsqu'ils furent près de moi, je me mis à les accabler de coups ; ils venaient eux-mêmes pour me frapper avant d'avoir éprouvé qui j'étais. Lorsque j'eus blessé tous ceux qui m'attaquaient et que je les eus renversés et pourfendus avec leurs chevaux, les autres, les voyant tomber soudainement à terre, reconnurent alors à mes œuvres qui j'étais et furent convaincus qu'il n'y avait plus pour eux de salut que dans la fuite.
Mais j'avais vite fait d'atteindre ceux qui fuyaient, et ces gens, complètement impuissants à me résister, mettaient pied à terre, jetaient leurs armes devant moi, puis se sauvaient dans les bois, comme de chétifs passereaux.
J'avais de bonnes et solides armes, et, grâce à Dieu, je fus préservé de toute blessure en ce combat ; leur audace n'obtint pas un résultat bien important. J'eus promptement éteint la feinte hardiesse de cette attaque de brigands, ainsi qu'un feu en plein air. Protégé par Dieu et ses saints, je les exterminai sans pitié, après les avoir complètement vaincus. Je ne fis usage contre eux ni de ma lance, ni de ma massue, mais je tirai mon épée et je leur en donnai des coups à deux mains. Ceux que j'atteignais, je les fauchais comme l'herbe ; ils tombaient à terre, privés de voix; d'autres roulaient sur eux, et ils s'entre-heurtaient et expiraient cruellement écrasés.
Dans l'engagement qui eut lieu alors, peu furent préservés des blessures du combat. Ces cinq vaillants guerriers.
Philopappos, Cinnamos, Joannikios, l'illustre Léandre et Mélémendzis, méditèrent un dessein hostile à mon retour. Ces chefs voulaient m'empêcher de passer sur l'autre rive et espéraient me tuer en m'enveloppant au milieu d'eux, car ils pensaient, mais à tort, que le combat m'avait fatigué. Et moi, qui les avais vus de loin se préparer et attendre mon arrivée, j'excitai mon cheval et me dirigeai sur eux.
Quand les cinq guerriers me virent hâter le pas de leur côté, ils brandirent leurs lances et m'en portèrent des coups de toute leur force. Mes armes étaient solides, brave était le combattant, et le dessein des cinq guerriers échoua. Je fendais tout de ma main avec mon épée.
Mais Léandre, qui n'avait pas encore l'expérience de ma valeur, osa tirer son épée. Il marcha contre moi et s'élança pour me frapper à la tête ; mais, moi, je me hâtai de lui asséner un coup de massue, et il tomba dans le ileuve avec son cheval. Je ne sais s'il y périt, ou s'il est encore vivant.
Les quatre autres, voyant Léandre ainsi traité, tournèrent le dos et s'enfuirent de toutes leurs forces sans oser jeter un regard en arrière. Alors je leur criai ceci : « Attendez un peu, ô guerriers d'élite fameux entre tous, attendez, car à des braves tels que vous il ne sied pas de fuir, mais d'attendre résolument l'issue du combat. Quant à toi, Philopappos, tu fais bien de fuir, étant un vieillard sans vergogne et un lâche dans les combats ; mais, ces solides jouvenceaux, ces guerriers expérimentés, je m'étonne qu'ils fuient aussi vite que des enfants. »
Et, les voyant fuir sans se retourner, j'excitai mon cheval, afin de les atteindre. Mélémendzis s'élança et revint sur moi, mais je lui assénai un coup de massue entre les deux épaules, et il tomba, avec la selle, de dessus sa jument harassée de fatigue.
Les autres s'éloignèrent, sans qu'il me fût possible de les rejoindre, et je leur criai aussi haut que je pus : « Fuyez donc, fuyez, bons petits pallikares, et souvenez-vous du seul Basile Akritas ! »
Je ne les poursuivis pas, par pitié pour leur échec, car j'ai toujours eu compassion des gens qui fuient. Il faut vaincre, mais aimer ses ennemis et ne pas abuser de la victoire. Je revins donc sur mes pas en marchant tranquillement. Arrivé près de Maximo, je lui dis ceci : « Femme présomptueuse à l'excès, trop confiante en ta force, va-t'en, rassemble ceux qui ont pu fuir, et, seule avec eux, fais des prouesses où tu voudras. Puisse ta défaite t'apprendre à n'être pas vaniteuse, car Dieu est l'ennemi de tous les orgueilleux. »
Mais Maximo, courant à ma rencontre, joignit dignement les mains et, inclinant avec distinction la tête jusqu'à terre : « J'ai appris, dit-elle, que tu es le plus brave de tous ; ta puissance est inconcevable, et jamais preux des anciens jours ne posséda une humanité pareille à la tienne, car, dès que tu m'as eu renversée, tu pouvais me tuer, mais tu m'as épargnée, comme un homme puissant et grand en miséricorde. »
Maximo m'entoura ensuite de ses bras et, me couvrant les pieds de baisers, elle me dit : « Bénis soient le père et la mère qui t'ont engendré, le ventre qui t'a porté, les mamelles qui t'ont nourri, car je n'ai jamais vu d'homme pareil à toi. Je te prie, ô mon maître, de m'octroyer une autre demande, afin que tu connaisses plus exactement mon expérience dans les combats. Laisse-moi partir et monter à cheval, et, au matin, je reviendrai dans le présent endroit, afin de me mesurer avec toi dans un combat singulier. »
« Avec plaisir, dis-je promptement à Maximo, va où tu voudras; tu me retrouveras ici. Bien plus, amène avec toi tes autres apélates, et tu les éprouveras tous, afin de savoir quels sont les plus braves et d'être à ce sujet complètement tranquille. »
Prenant ensuite un des chevaux emmenés par moi, je le lui amenai et la fis monter dessus. Après cela, je repassai le fleuve, et Maximo retourna chez elle, pleine de reconnaissance envers moi, à ce qu'il me semblait.
J'entrai dans ma tente, je déposai mes armes, je me revêtis d'une admirable tunique très légère ; je mis aussi un bonnet rouge, en poil de chameau frisé. Je montai sur un cheval alezan, au front étoile, et qui déployait dans les prouesses un merveilleux instinct. Je pris mon épée, mon bouclier, ma lance bleue, et, le soir déjà venu, je traversai le fleuve. Cela fit que je ne pus me rendre près de la jouvencelle, mais je lui dépêchai ses deux valets de chambre. Nous avions à notre service quelques personnes qui habitaient loin de notre tente, mais pas toutes en commun ; les hommes étaient à part, et les femmes vivaient séparément de leur côté.
Ayant, comme je l'ai dit, repassé le fleuve Euphrate, je pénétrai aussitôt dans une délicieuse prairie, et je donnai à mon cheval une nuit de repos. Je me levai à l'aube ; je montai à cheval, et je retournai dans la plaine, où je me tins dans l'expectative.
Le jour venait de paraître et le soleil dardait ses rayons sur les sommets, quand Maximo, seule, apparut dans la plaine; Elle montait un cheval blanc comme la neige ; les sabots de ce coursier étaient tous les quatre teints avec la cochenille. Elle portait une cuirasse solide et très merveilleuse, et, par-dessus cette cuirasse, une robe précieuse, admirable, enrichie de perles ; elle avait à la main une lance arabe artistement travaillée, bleue, dorée, une épée pendait à sa ceinture et un yatagan à sa selle. Elle tenait un boucher d'argent, doré tout autour, avec un lion en or massif et en pierreries au centre. Maximo venait engager le combat singulier. Je m'empressai de me rendre à su rencontre.
Nous étant approchés, nous échangeâmes un salut. Ensuite, excitant nos chevaux, nous nous nous séparâmes ; puis, après une petite heure de courses par monts et par vaux, une rencontre à la lance eut lieu, dans laquelle nous ne fûmes renversés ni l'un ni l'autre. Nous étant aussitôt séparés, nous tirâmes nos épées, et nous fondîmes l'un sur l'autre en frappant avec acharnement. Je ménageais beaucoup cette femme, mes chers amis, car c'est un déshonneur pour un homme non seulement de tuer les femmes, mais de n'oser engager le combat avec elles. Maximo jouissait alors d'une grande réputation de vaillance, c'est pourquoi elle en vint aux mains avec moi.
L'ayant frappée aux doigts de la main droite, l'épée qu'elle tenait tomba à terre, et, saisie elle-même d'un très grand effroi, elle se prit à trembler. Et, moi, je lui criai : « Pourquoi trembles-tu, Maximo ? J'ai compassion de ton sexe et de la beauté dont tu es remplie ; mais, afin que tu saches plus certainement par mes actes quel homme je suis, je te donnerai une preuve de ma force sur ton cheval. » Aussitôt, mes amis, je déchargeai un coup d'épée de haut en bas, sans y mettre toute ma force, sur les reins de l'animal, je les lui abattis et le fendis par le milieu du corps.
Maximo, tout épouvantée, bondit en arrière ; puis, m'implorant ardemment, elle m'adressait force supplications : « Aie pitié, mon maître, de ton inutile servante, qui est demeurée incrédule et n'a pas été persuadée par tes actes et l'incroyable valeur que tu tiens de Dieu. Aie pitié, seigneur, de mon grand égarement, écoute ma prière et exauce le vœu de mon humble cœur. Dès le commencement, j'ai juré au maître de toutes choses de ne jamais m'approcher d'un homme, de ne pas souiller ma virginité, avant le jour où l'un d'eux m'aurait complètement vaincue et se serait trouvé supérieur à moi en vaillance. Je suis restée fidèle à mon serment jusqu'à l'heure pré-i sente, et j'ai fui les purs désirs de ma chair. »
« Tu ne mourras point, Maximo, lui répondis-je, mais ce que tu me dis est impossible. J'ai une épouse légitime, noble et belle, dont je n'ai jamais osé négliger l'amour. Allons à l'ombre des arbres et, là, je t'apprendrai tout ce qui me concerne. »
Nous allâmes nous étendre sous les arbres, près du fleuve ; Maximo lava sa main et appliqua sur la plaie une plante efficace pour les blessures, et que nous avons l'habitude de porter avec nous dans les combats.
Maximo se débarrassa ensuite du vêtement qu'elle portait sur sa cuirasse, car il faisait une chaleur excessive ; elle avait une robe aussi fine qu'une toile d'araignée, et tous ses membres brillaient au travers comme des rayons ; ses seins, pareils à des pommes, s'arrondissaient magnifiquement.
Mon âme fut blessée, caria jeune fille était belle et, comme un miroir, me laissait entrevoir toutes ses formes. Je descendis de cheval, et, accourant vers moi, elle m'adressa ces paroles : « Réjouis-toi, mon maître, je suis réellement devenue ton esclave par les hasards du combat. » Et elle me baisait tendrement la main droite. Quand le feu de la concupiscence fut allumé en moi, je ne savais quoi devenir, j'étais tout en flammes. Je faisais tous mes efforts pour éviter le péché, et je me disais intérieurement, en m'accusant moi-même : « O démon, pourquoi es-tu amoureux de tout ce qui t'est étranger, puisque tu possèdes une source limpide et cachée? »
Voilà ce que je me disais à moi-même, mes amis, mais Maximo attisait davantage encore mon amour, on me décochant dans les oreilles les plus douces paroles. Elle était jeune et jolie, charmante et vierge, mon esprit succomba à ses criminels désirs. Une honteuse union ayant été consommée, je quittai ensuite Maximo, et, en prenant congé d'elle, je lui adressai comme consolation les paroles suivantes : « Retire-toi en paix, jouvencelle, et ne m'oublie pas. »
Je montai ensuite à cheval et je repassai le fleuve.
Quant à Maximo, elle lava au bord de l'eau sa virginité, et fut vivement affligée de mon départ.
Revenu ensuite près de ma bien-aimée, je descendis de cheval et je la couvris de baisers. « Tu as-vu, lui dis^je, ô mon âme, le vengeur que tu possèdes et quelle protection le créateur t'a accordée ! »
Mais la jouvencelle, qui avait au cœur un sentiment de jalousie, me fit cette réponse : « Je te remercie de tout, mon maître ; mais il est une chose qui me ronge, c'est ton audacieux retard près de Maximo, car je ne sais ce que tu as fait avec elle. Il y a un Dieu qui connaît les actions cachées, et qui te pardonnera ce péché, cher époux ; mais garde-toi, jeune homme, de commettre une nouvelle faute et d'encourir le châtiment du Dieu qui sait rendre justice. Quant à moi, j'ai mis en lui mes espérances. Il te protégera et sauvera ton âme, et il daignera m'accorder la jouissance de tes toutes charmantes beautés durant de longues et heureuses années, ô mon très aimable dindon ! »
Cependant je la trompai par des paroles persuasives, en lui narrant, depuis le commencement, comment je m'étais battu avec Maximo et comment je l'avais blessée à la main droite ; je dis en outre qu'il s'était produit une abondante hémorragie, qui eût peut-être occasionné la mort de Maximo si, ému de compassion pour son sexe et sa faiblesse naturelle, je n'eusse promptement mis pied à terre pour l'arroser d'eau. « J'ai lavé aussi sa blessure, ajoutai-je, et je lui ai bandé la main; voilà pourquoi je suis en retard, ma pomme parfumée, car je ne veux pas qu'on me fasse l'injure de m'appeler assassin de femmes. »
Quand la jouvencelle eut entendu mon récit, elle éprouva du soulagement, car elle considérait comme vrai tout ce que je lui avais dit.
Maintenant que nous avons terminé les récits de Digénis Akritas et raconté les exploits qu'il narra lui-même à ses amis intimes, maintenant que nous les avons mis par écrit en mémoire de sa mort et exposés à tous par amitié, revenons au sujet des autres livres d'Akritas.
L'illustre Basile Digénis Akritas, la rose charmante ut bien fleurie de la Cappadoce, la couronne de la vaillance, la plus haute expression de l'audace, le jeune homme beau, ravissant et valeureux entre tous, après avoir soumis avec bravoure toutes les frontières, s'être emparé de beaucoup de villes et de provinces appartenant aux rebelles et être devenu fameux dans le monde entier, se plut à habiter sur le fleuve Euphrate. Il n'est pas de fleuve plus beau que celui-ci ; il prend sa source dans le paradis terrestre, d'où il tire son agréable et merveilleux parfum; son eau est aussi très douce à boire.
Akritas détourna le cours des eaux de ce fleuve et fit un jardin d'une beauté ravissante. Un bosquet planté d'arbres verdoyants s'offrait aux regards ; autour de ce bosquet régnait un mur d'une grande hauteur, construit avec solidité et élégance, et couvert de plaques de cuivre qui brillaient du plus vif éclat. Il y avait quatre côtés à ce beau, merveilleux et ravissant jardin. En dehors du mur s'élevait, dans un emplacement réservé, une infinie multitude d'arbres dont les branches mariaient leurs pousses les unes aux autres ; les pétales et les luxuriantes frondaisons formaient une voûte par leurs mutuels enlacements. Sous les arbres, des rangées de plates-bandes étaient couvertes d'une infinité de plantes agréables ; sur les unes s'élevaient des rosiers, des pommiers sur les autres. Le narcisse y étalait ses fleurs charmantes, et, au milieu des violettes et des roses, l'eau coulait avec les fleurs. Des échalas carrés se dressaient magnifiquement. Une foule innombrable d'oiseaux vivaient dans le bois ; les oiseaux domestiques, perroquets et cygnes, cherchaient leur nourriture, les premiers sur les branches, les seconds dans les eaux. Les autres enfin, jouissant de leur liberté, prenaient leurs ébats sur la cime des arbres, ceux-ci doués d'une voix aussi mélodieuse que celle des Sirènes, ceux-là ne se distinguant que par leur brillant plumage.
Tels étaient les agréments de ce jardin, qui faisait les délices d'Akritas et de sa bien-aimée.
Akritas construisit une magnifique maison au milieu du jardin. Je suis impuissant à en décrire la beauté et l'heureuse disposition ; chaque pierre était polie avec un art si merveilleux que la surface ne se pouvait apercevoir. Cette maison était bâtie en très belles pierres, placées de façon à former, par la variété de leurs nuances, une sorte de bigarrure charmante. Il y avait sur le devant un pavillon à quatre étages dont l'intérieur était tout revêtu d'or et le pourtour argenté; il était surmonté de trois coupoles, qui s'élevaient à une très grande hauteur.
Les dimensions de la porte de devant étaient des plus vastes; elle avait vingt-quatre coudées d'élévation, et sa beauté surpassait de beaucoup celle de l'or.
À l'intérieur de cette maison en était construite une autre, haute de vingt-deux coudées, entièrement revêtue de bronze et toute ruisselante de royales pierreries. Les ouvriers avaient poli les pierres d'une façon si parfaite qu'elles ressemblaient au lin et à la pourpre de nos vêtements. Toutes les chambres hautes étaient incrustées d'or, et la toiture était un ouvrage de mosaïque des plus merveilleux. L'intérieur de cette habitation magnifique était enrichi de pierres précieuses ; autour des fenêtres, émaillées d'or pur, serpentaient des branches de vigne d'or chargées de grappes. Toutes les colonnes, revêtues d'or, brillaient d'un si vif éclat que les toits semblaient d'or à ceux qui les voyaient. Bien plus, quand brillaient les rayons du soleil, l'or répandait une étincelante clarté qui égayait les visages de toutes les personnes présentes. Le célèbre Akritas, après avoir exécuté ces travaux, bâtit une grande tour fort belle, d'une hauteur extraordinaire et d'une merveilleuse architecture. Carrée à partir de terre, sa base était décorée d'ime multitude de pierreries ; par en haut, elle était octogone et percée de belles fenêtres. Elle était si élevée que du sommet on découvrait comme un tapis de neige par toute la Syrie jusqu'à Babylone ; et quand, de loin, on apercevait le dôme de la maison, sa blancheur le faisait aussi supposer couvert de neige.
Dans l'intérieur, Akritas fit une chambre haute en forme de croix et magnifiquement décorée sur chacun de ses côtés. Il y avait dans la tour un escalier en limaçon dont les nombreux degrés conduisaient à cette chambre haute. Akritas construisit aussi des socles hauts de cinq coudées et les plaça dans cette pièce pour supporter les colonnes, et sur chacun d'eux il posa quatre très grandes plinthes en argent, du poids d'un talent. Il orna la voûte de pierreries et de perles, et recouvrit tout avec de l'or pur. Il embellit de magnifiques pierres précieuses le parvis de la maison, et il plaça au centre une très grande pierre ronde dont la lumière éclairait tout le monde durant la nuit. Les portes furent revêtues d'or de chaque côté ; il fit des fenêtres émaillées de pierreries ; en dehors de la chambre haute, il établit des galeries, où il n'entrait pour matériaux que de l'airain et de la brique, et exécuta ainsi un travail digne des plus magnifiques éloges. Le tout formait un ensemble imposant et sévère. Cette construction était de forme carrée comme la tour, et ornée de mosaïques.
Il peignit là tous les vaillants hommes qui ont existé depuis le commencement du monde.
Il représenta d'abord le combat de Samson contre les Philistins, la façon merveilleuse dont il tua un lion de ses mains et des milliers d'hommes avec une mâchoire ; la trahison de Dalila ; comment on creva les yeux à Samson, comment il fut la risée des princes ; enfin le châtiment qu'il infligea aux Philistins, et la dernière action d'éclat qu'il accomplit dans un temple un jour de fête, en se tuant lui-même avec les Philistins.
On y voyait ensuite David placé entre deux lignes de bataille, entouré d'armes de toute espèce, mais ne tenant à la main qu'une fronde et des projectiles. Là, c'était Goliath, avec sa haute stature, son air farouche, sa force prodigieuse, bardé de fer de la tête aux pieds, tenant à la main un javelot dirigé contre David, enfin si artistement exécuté qu'il semblait une statue en fer massif.
Puis venait David, lançant à Goliath une pierre ronde, le renversant soudain à terre, courant précipitamment sur lui, lui prenant son épée, lui tranchant la tête et remportant la victoire,
C'était ensuite la jalousie de Saul, la fuite du très doux David, les mille embûches qu'on lui dresse, la vengeance de Dieu, la royauté de David, sa guerre contre les Philistins, ainsi que les autres événements importants du Livre des Rois.
On voyait ensuite l'inaction d'Achille, les guerres de la fable; les très cruelles épreuves de deux époux infortunés, Aldelaga et Olopé, leurs merveilleuses aventures, l'audace déployée contre Cinnamos; Bellérophon tuant la Chimère, qui vomit le feu; la défaite de Darius, les grandes victoires du terrible et courageux Alexandre, la reine Candace, enfin tout ce que l'on connaît des exploits du roi Alexandre; les miracles de Moïse, les plaies d'Egypte, la sortie des Juifs, ce peuple méchant et ingrat; la colère de Dieu, les prières de son serviteur, et les glorieux faits d'armes de Josué, fils de Navi.
Telles étaient, et beaucoup d'autres encore, les peintures des deux salles, toutes exécutées en mosaïque et en or par Akritas. Elles faisaient à qui les voyait un plaisir extrême, à cause de leurs vastes dimensions en hauteur et en largeur. Les pierres précieuses dont le parvis était constellé jetaient une si vive clarté qu'elles excitaient l'admiration universelle et que, tant elles étaient belles, elles faisaient l'effet d'une onde limpide cristallisée.
Akritas passait agréablement la saison d'été dans cet endroit, en compagnie de sa toute belle jouvencelle, cette créature ravissante qui a emporté avec elle dans la tombe la beauté féminine.
Grâce à une machine de son invention, Akritas faisait jaillir l'eau à une si grande hauteur que tous ceux qui en étaient témoins admiraient la force avec laquelle les jets s'élevaient en l'air.
Dans l'enceinte de la forteresse, l'illustre Digénis Akritas planta des arbres fruitiers ; il y disposa d'une façon merveilleuse et admirable une belle et vaste vigne et la remplit de fleurs de toutes sortes. Le souffle des vents, les senteurs des arbres, la brise douce et chargée de parfums, faisaient de ce lieu merveilleux un séjour de délices.
Après que le très vaillant Akritas eut exécuté toutes ces choses, il bâtit au centre un temple magnifique, sous le vocable de saint Théodore martyr. Il fit ensuite une table plaquée d'argent et des vases précieux en or massif. Et il coulait d'heureux jours, comme en paradis, contemplant une prairie plus charmante que les fleurs de ses jardins, c'est-à-dire la beauté et la taille admirable de la jouvencelle.
Mais que nul de mes auditeurs ne s'étonne d'une telle richesse, car je dois dire que tous les grands princes et les satrapes lui faisaient des cadeaux et des dons nombreux ; tous les gouverneurs de la Romanie lui témoignaient leur gratitude par de merveilleux présents ; l'empereur lui-même envoyait chaque jour à l'illustre Akritas les plus grands cadeaux.
Nul, parmi les Grecs, Sarrasins, Perses et Tarsiotes, qui fréquentaient alors toutes les routes de cette contrée, n'osa jamais s'aventurer par là, que le célèbre Akritas ne lui en eût donné la permission. Celui qui se disposait à parcourir cette route y passait sans crainte, en portant le sceau d'Akritas, mais celui qui ne le portait pas ne tardait point à tomber sous les coups des apélates. Or les apélates obéissaient à Akritas, et, pleins de crainte pour son autorité, ils ressemblaient à des serviteurs rois et à des maîtres esclaves.
Digénis vivait ainsi à l'abri de tout événement fâcheux, lorsqu'il apprit que son père était atteint d'une maladie dangereuse. Il se hâta donc de se rendre en Cappadoce ; arrivé près de la maison paternelle, il rencontra tout le monde pleurant son père, et il apprit vraiment qu'il se mourait. Alors, jetant loin de lui son manteau, il saute à bas de son cheval, entre dans la maison, entoure de ses bras le corps et prononce ces paroles désolées : « Lève-toi, mon père, regarde ton fils unique, dis-lui une douce parole ; adresse-moi des conseils, ne me dédaigne pas par ton silence. Pourquoi ne réponds-tu pas à ton enfant chéri, ô mon père ? Ta voix si douce est muette pour moi ! Où est la lumière de tes yeux? Ou est ta belle prestance? Qui a-enchaîné tes mains? Qui t'a enlevé ta force? Qui a paralysé tes pieds si rapides à la course? Qui a fait évanouir, ô mon père, l'amour infini que tu avais pour moi ? O cruelle infortune, ô douleur amère ! Dans les souffrances et la tristesse, tu as rendu l'âme, en m'appelant par mon nom et en me demandant jusqu'à la mort. O mon bienheureux père, je n'ai eu que pendant une heure bien courte la joie de voir la vie briller dans tes yeux, d'entendre ta voix et ta suprême prière, car tu as rendu le dernier soupir entre mes bras. Au jour d'aujourd'hui, mon père, je vais te fermer les yeux de mes propres mains, et me voici maintenant le plus malheureux, le plus infortuné de tous les hommes. La douleur infinie de ta mort me blesse les entrailles; mieux vaudrait pour moi être mort que de te voir en un pareil état. »
Telles furent, et beaucoup d'autres encore, les lamentations de Digénis ; les pierres elles-mêmes gémirent, et si immense fut la douleur, si grande la lamentation, que l'on entendait de loin le tumulte et les cris.
Akritas, accompagné de sa mère, se rendit sur les bords de l'Euphrate, avec le corps du très glorieux émir son père, et, après le chant des hymnes funèbres et les cérémonies des funérailles, le cadavre fut enseveli avec une pompe magnifique, qui frappa tout le monde d'admiration. Le corps fut déposé dans l'enceinte du temple.
Akritas, agissant en fils sage, plein d'amour et de respect pour sa mère, ne la laissa pas retourner dans sa maison, mais il la conduisit dans sa propre demeure, puis, après lui avoir adressé des paroles de consolation, il remercia Dieu, qui doit être glorifié en toutes choses, et il chanta un hymne d'actions de grâces, « car, disait-il en consolant sa mère, le créateur de toutes choses connaît toutes choses. »
La fortune paternelle était pour Akritas la source d'un revenu considérable; à la mort de l'émir, il hérita de toutes ses richesses, et chaque jour il y puisait de l'or qu'il donnait aux pauvres comme une aumône de la part de son père.
Il ne laissa pas dans le deuil sa mère devenue veuve ; mais, après les funérailles de son père, en fils affectueux et plein d'amour pour sa mère, et, à vrai dire, guidé par un sentiment honorable, il la prit avec lui dans son splendide et magnifique palais ; elle y vécut heureuse avec son fils et sa bru ; c'était vraiment la mère qui se réjouit de ses enfants.
Akritas possédait en outre le revenu des biens du célèbre général, biens qui composaient la dot de sa femme et dont il retirait chaque année onze mille livres d'or.
Il était donc immensément riche en or et en argent, en esclaves, en bétail et en tout le reste. Sa fortune dépassait celle de tous les princes de la terre. Il vivait heureux avec son épouse ; une seule chose lui rendait sans cesse l'âme triste, c'était le manque d'enfants, privation cruelle, comme le savent tous ceux qui ont passé par cette sorte d'épreuve. Pour en obtenir, il ne cessait de supplier Dieu, passant des nuits dans les veilles à chanter des hymnes. Il fut cependant déçu dans ses espérances, mais même de cela il remerciait Dieu, et attribuait cette privation à ses péchés.
Vivant ainsi honorablement, Digénis Akritas devint le type des princes, le modèle des braves, un maître de sagesse, et se rendit illustre par sa modestie. Il fut, plus que personne au monde, plein de déférence pour les actions des princes, soumis vis-à-vis des empereurs, et rempli de charité pour tous. Il était l'ardent défenseur des siens, et il ne se fâchait jamais avant d'avoir pris des informations. Il aimait beaucoup à vivre tranquille, et c'est pour cette raison qu'il ne permit jamais à aucun de ses serviteurs de partager avec lui sa demeure, mais ses gens se tenaient éloignés, faisant leur service respectif, les cuisiniers préparant chaque jour le rôti, les domestiques apportant les ustensiles de table, et les boulangers, les pains.
Quand Akritas se mettait à table, il agitait une sonnette, et tout le monde se retirait ; et, au signal de cette sonnette, l'échanson apportait le vin et faisait seul le service ; ce domestique était un tout petit garçon, et un coup de sonnette lui indiquait ce dont il était besoin.
Akritas arrivait aussitôt avec la jouvencelle, et tous deux prenaient place sur le lit ; peu après venait la charmante mère de l'illustre et vaillant Digénis Akritas. Ils se levaient humblement par respect pour elle, et elle s'asseyait seule sur un fauteuil.
Mais, comme tout ce qui est charmant finit avec la vie et que toute gloire humaine passe comme un songe, il nous faut mentionner la mort de la mère d'Akritas et terminer ce très honorable récit.
L'illustre Akritas, ayant donc fixé son séjour sur les bords de l'Euphrate, ce fleuve ravissant et magnifique, planta en cet endroit un charmant jardin. Auparavant, il bâtit une maison et au milieu éleva une tour, édifice glorieux, grandiose et puissamment fortifié. Il construisit ensuite un bain splendide. Akritas vivait heureux dans ce palais avec la jouvencelle, la séduisante fille du général. Il bâtit dans sa résidence une charmante et admirable chapelle, et la plaça sous le vocable de saint Théodore ; c'est là qu'il inhuma son bienheureux père, le noble émir, après l'avoir déposé dans un cercueil d'argent enrichi d'or. Et il traitait sa mère avec tout le dévouement et les honneurs dus à son rang.
Au bout de quelque temps, la mère d'Akritas vint aussi à mourir. Après l'avoir beaucoup pleurée et avoir couvert de baisers ses glorieux restes, il l'ensevelit dans le tombeau de son père. Une foule de parents et d'amis assistaient à la cérémonie, et grande fut leur affliction quand ils virent Akritas se lamenter et adresser ces paroles à sa mère :
« Qui nous a séparés, ô ma très douce mère? Qui vient de trancher la racine de ma vie ? Qui a éteint ma lumière, que je n'y puis plus voir? Qui m'a dépouillé soudainement de l'affection maternelle? Dis-moi une très douce parole, ô ma mère bien-aimée ; hâte-toi de m'apprendre qui t'a fait captive, et je donnerai pour te racheter la plus considérable rançon. Hélas ! ma mère toute chérie, lumière de mes yeux, quand reverrai-je ton visage et entendrai-je ta voix? O tombeau très cruel, quel trésor tu me tiens caché ! Quelle fleur de ma vie tu as moissonnée, dis-moi? Tu as assombri mon âme, tu as obscurci ma lumière, en me ravissant soudain la mère qui m'a nourri. »
Ayant dit ces choses et beaucoup d'autres encore, Akritas, baigné de pleurs, associa tout le monde à ses gémissements et à ses larmes jusqu'à l'accomplissement du neuvième jour. Il célébra ensuite un magnifique service funèbre et offrit aux invités un splendide festin, puis il distribua aux indigents une immense quantité d'or et les renvoya chez eux chargés de présents.
Telle fut la seconde douleur qu'éprouva l'illustre Akritas ; alors il eut le cœur blessé d'un glaive, car il avait toujours eu pour sa mère une extrême affection ; et lui, dont la vie n'avait cessé d'être joyeuse et sans chagrin, il fut alors accablé sous le poids de la tristesse.
Cependant, même de cette épreuve, il rendit grâces à Dieu. Puis, ramenant son âme à la gaieté, il prenait plaisir à contempler la charmante jouvencelle. Ni prince, ni parent, ni serviteur, personne, sauf l'échanson d'Akritas, ce beau, gracieux et charmant adolescent dont il a été question dans le huitième livre, ne vit jamais cette noble jouvencelle, incomparablement belle, avec laquelle vécut dans la joie Digénis Akritas, le vainqueur de tous les vaillants apélates, la terreur du monde entier, l'orgueil des empereurs, la gloire des Grecs, l'élite des braves, l'audacieux gardien des frontières, le type de la sagesse, l'honneur des vertus, le généreux distributeur de largesses, le pacificateur de la Romanie.
Avant cet illustre héros, la nation sarrasine faisait des incursions en Romanie et causait de grands dommages dans la Charsiane, à Héraclée, à Amorium et à Iconium ; elle les étendait jusqu'en Cappadoce, à Ancyre, à la très belle Smyrne, et aux provinces voisines de la mer. Chosroès fut le premier chef de ces [fils d'Agar]. Ce roi, ayant bouleversé presque tout l'Orient, s'avança jusqu'à Byzance, dans le dessein de s'en rendre maître ; avec lui était Ambron, le grand sultan, le Tarsiote, bisaïeul d'Akritas (cet Ambron engendra l'aïeule d'Akritas, la mère de l'émir, qui s'appelait Spathia ; de celle-ci naquit le père d'Akritas, le merveilleux émir, si habile dans les combats ; l'émir s'appelait Mousour avant d'être baptisé, et, avec le baptême, il reçut le nom de Jean) ; ce fut ce vaillant Tarsiote qui causa tant de dam à la Romanie et avec lui, dans un combat naval, les infortunés maréchaux de Chosroès, le Khagan et Sarbaros, qui conduisirent des prisonniers dans toute la Syrie. Vint ensuite Mousour, le fils du Tarsiote, et puis Garoès, le grand émir, jusqu'auquel les choses ne cessèrent de se passer de la plus terrible façon. Enfin, par la puissance de Dieu, le seul ami des hommes, qui a toujours eu pitié du peuple chrétien, les meurtres et les guerres eurent un terme. Et, comme il a été dit précédemment, l'émir conserva jusqu'à la mort sa croyance intacte, et habita en Cappadoce avec son épouse. Il engendra l'illustre et glorieux Akritas, et depuis lors la Romanie se montre fière d'avoir subjugué et complètement défait ses ennemis. Car, du moment où le très excellent et valeureux Akritas commença à faire seul des prouesses en Syrie, aucun apélate n'osa se présenter devant lui, et partout régnèrent la paix et la tranquillité, de sorte que tout le monde en glorifiait Dieu. Car cet illustre héros avait soumis les apélates qui occupent les redoutables défilés et les frontières, et on le craignait plus qu'eux. Si quelqu'un s'avisait de commettre un acte d'indiscipline, il disparaissait du nombre des vivants Akritas soumit ces bandes d'une si terrible façon qu'il les obligea de payer un tribut annuel à l'empereur, et que, d'ennemies qu'elles étaient, elles devinrent ses vassales.
Là où retentissait le nom de Digénis Akritas, on était saisi d'épouvante et de terreur, et ce nom glorieux faisait régner partout la paix et la tranquillité.
Ayant appris ses exploits, l'illustre empereur Nicéphore, ce grand conquérant qui gouverna l'empire grec avec tant de sagesse, envoyait chaque jour à Digénis un très grand et très riche présent. Quand Akritas eut terminé toutes ses prouesses, subjugué villes et provinces, complètement réduit tous les rebelles et qu'il fut devenu fameux dans le monde entier, il se bâtit une maison sur le fleuve Euphrate, comme on l'a raconté dans le huitième et précédent livre. Ce fut là qu'il prit son repos, au sein de la joie, en compagnie de sa très glorieuse bien-aimée, honoré, suivant son mérite, par un grand nombre d'illustres princes, ses voisins.
Voici le dixième livre d'Akritas ; consacré aux derniers moments de ce héros, il nous raconte son trépas et celui de sa bien-aimée, les pleurs que tout le monde versa sur eux, enfin les dignes et glorieuses funérailles que toutes les nations leur firent, à lui et à son épouse.
Commençons le récit du trépas de Digénis, dont l'autre nom était Akritas, récit fécond en gémissements, en larmes et en tristesse.
Puisque tout ce qu'il y a de charmant en ce monde trompeur devient la proie de la mort et la pâture du tombeau, puisque, richesse et gloire, tout passe comme un songe, survint aussi le trépas de Digénis Akritas. Plaçons donc dans le dixième livre la fin de ce héros; car, bien qu'il fût plus brave que personne au monde, et fameux pour son courage et toutes ses autres qualités, quoiqu'il eût été un puissant vainqueur et un valeureux guerrier, il tomba victime de la mort, et la nouvelle de son décès sera pour tous ceux qui l'apprendront le sujet d'une immense douleur. Puisque telle est l'éternelle volonté de Dieu, une pareille fin était inévitable.
Digénis Akritas fut atteint d'une très cruelle maladie ; il se coucha sur un lit magnifique, garni de couvertures dorées ; il fit venir beaucoup de médecins des plus illustres, qui essayèrent de tous les remèdes de la science, sans pouvoir lui être de quelque utilité.
Le mardi, jour pernicieux et néfaste, le médecin se rendit près de lui, mais Akritas le renvoya et prédit sa mort. Alors les médecins lui dirent en gémissant : « O tout charmant Basile, voici l'heure de ton trépas. Désormais tu n'as plus d'armes ; où est ton courage infini, ton audace inouïe, ton immense pouvoir et les richesses dont lu étais fier? Personne ne peut maintenant te secourir contre la mort. Tes mains, qui ont accompli tant d'exploits, sont sans vigueur, tes pieds sont paralysés, eux qui parcouraient les chemins. Un instant encore et ton âme abandonne ton corps, et la tombe va se refermer sur toi, homme puissant ! »
Akritas donna l'ordre de chasser tous les médecins, et il appela près de lui l'amoureuse jouvencelle, car elle se tenait enfermée dans les appartements du devant. Il la fit asseoir vis-à-vis de lui, et, versant d'abondantes larmes, il commença à lui parler ainsi en tête-à-tête.
Tristes et suprêmes volontés de Digénis Akritas. « Écoute, ma douce lumière, et rassasie-toi de me regarder, car bientôt tu ne verras plus celui qui t'aime tant. Je vais, en me reportant au commencement, te faire le récit complet de nos aventures. Sais-tu, te souvient-il, ô mon âme, ô ma lumière, ô mon cœur, lorsque je me rendis près de toi, et que je t'enlevai du splendide palais de ton père, ô ma dame? Les sentinelles de ton père ne m'effrayèrent pas ; je tuai les soldats qui voulaient me saisir et je les précipitai dans le tombeau, quoique je fusse seul. Ensuite, jeune fille, je désarçonnai tes frères ; puis, ma bien-aimée, je rendis à ton père les honneurs dus à son rang, et j'obtins son pardon et sa bénédiction. Il me promit et me donna une dot considérable ; je ne retournai pas avec lui dans sa maison, comme il m'y engageait, mais j'abandonnai tout et je te préférai, toi, dont. ...»
La fin du poème manque.