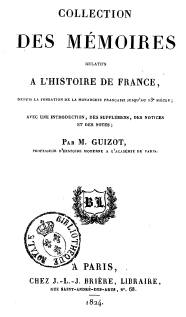
ANONYMES
HISTOIRE DE LA GUERRE DES ALBIGEOIS
(suite)
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
COLLECTION
DES MÉMOIRES
RELATIFS
A L'HISTOIRE DE FRANCE,
depuis la fondation de la monarchie française jusqu'au 13e siècle
AVEC UNE INTRODUCTION DES SUPPLÉMENS, DES NOTICES ET DES NOTES;
Par M. GUIZOT,
PROFESSEUR D'HISTOIRE MODERNE A L’ACADÉMIE DE PARIS.

A PARIS,
CHEZ J.-L.-J. BRIÈRE, LIBRAIRE,
RUE SAINT-ANDRÉ-DES-ARTS, N°. 68.
1824.
.
Nous réunissons dans une seule notice les trois Chroniques que contient ce volume; elles traitent des mêmes événements; aucun renseignement ne nous reste sur leurs auteurs, et le nom même de deux d'entre eux n'est pas connu. Elles n'en ont pas moins d'importance et d'intérêt.
La première, sans contredit la plus curieuse comme la plus longue, est écrite en langue romane, dans le dialecte languedocien, à peu près semblable au patois qu'on parle encore aujourd'hui à Toulouse et dans les environs. Elle a été publiée par dom Vaisselle, dans les Preuves de l'histoire générale de Languedoc, et il y a joint, pour aider à l'intelligence du texte, un petit glossaire fort incomplet. Catel, dans son Histoire des comtes de Toulouse, en avait déjà donné quelques fragments. Elle comprend les événements survenus dans la guerre contre les Albigeois entre les années 1202 et 1219, à l'exception d'une lacune considérable, malheureusement placée à l'époque de la mort de Simon de Montfort, et qui se rencontre également dans les deux manuscrits qu'on en a découverts. Dom Vaisselle pense que l'auteur vivait au commencement du xive siècle, et. il en donne pour preuves : 1° le nom de Languedoc employé par l'auteur pour désigner la province de Toulouse, et qui ne fut en usage que vers cette époque; 2° un passage du traité de paix de l'an 1229, placé à la fin de l'ouvrage et qui paraît être du même écrivain, où il est fait mention du grand-maître de Rhodes qui ne fut prise par les chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem qu'en 1309 ; 3° enfin un autre passage qui semble indiquer qu'il y avait alors un évêque dans la ville de Castres, érigée en évêché seulement en 1317. Ces preuves ne me paraissent pas concluantes. Le mot de Languedoc a sûrement été employé dans la province même longtemps avant qu'il fût devenu d'un usage assez général pour être considéré comme son nom par les érudits. Le traité de l'an 1229 ne fait point partie de la chronique; aussi n'avons-nous pas cru devoir le traduire; il se trouve seulement copié à la suite, et après une lacune de dix ans, car elle s'arrête en 1219. Le dernier argument seul est de quelque poids; l'évêque de Castres est en effet indiqué par le chroniqueur; mais on rencontre, dans les écrivains de ces temps de désordre, de nombreux exemples d'évêques attribués à des villes qui n'ont été régulièrement instituées en évêchés que beaucoup plus tard. Le ton même de l'ouvrage, les détails qu'il contient et que l'auteur semble avoir vus en personne ou recueillis de témoins oculaires, enfin la vivacité de ses propres sentiments et la chaleur de son récit me portent à croire qu'il était contemporain, ou du moins très rapproché des événements qu'il raconte. Quoi qu'il en soit, son ouvrage est, avec celui de Pierre de Vaulx-Cernay, le document le plus instructif et le plus curieux qui nous reste sur cette tragique expédition. Le chroniqueur, bien que catholique et opposé aux hérétiques, est attaché au comte de Toulouse et déteste les cruautés et les perfidies des croisés ; il est instruit, et avec grand détail, de faits importants que les autres historiens ne font qu'indiquer, notamment de tout ce qui se rapporte au séjour du comte Raimond à Rome en 1215, et au siège de Beaucaire en 1216. Enfin sa narration est naïve, animée et attachante, surtout dans la dernière partie.
Guillaume de Puy-Laurens vivait à la fin du xiiie siècle et fut chapelain du comte Raimond VII; on ne sait rien de plus sur son compte. Sa Chronique, qui remonte aux premiers temps de l’hérésie albigeoise et ne s'arrête qu'en 1272, n'est pas dépourvue d'intérêt; l'auteur ne craint point de parler en son propre nom et d'exprimer ses jugements ou ses idées, chose assez rare parmi les chroniqueurs ; il rapporte d'ailleurs quelques faits que les autres écrivains du temps ont omis; et, malgré son aversion pour les hérétiques, il aspire à l'impartialité. Sa chronologie est confuse et pleine d'erreurs, surtout lorsqu'il veut parler des événements généraux de l'Europe. Les manuscrits qui restent de cette chronique sont de plus fort incorrects, et ni Catel ni Duchesne, qui l'ont insérée, l'un dans son Histoire des comtes de Toulouse, l'autre dans sa Collection des historiens Français, n'ont pris le moindre soin pour rectifier le texte dont l'intelligence est quelquefois difficile.
La troisième des Chroniques que nous publions ici a pour titre complet : Des Gestes glorieux des Français et de leurs divers combats vaillamment soutenus en divers lieux, contre les ennemis tant de la foi orthodoxe que de la France même, de l'an de Notre-Seigneur 1202 à l’an 1311. Elle est communément désignée sous le nom de Chronique de Simon, comte de Montfort. Plus courte, moins complète et plus surchargée d'erreurs que les précédentes, elle a cependant été imprimée trois fois et traduite en français par Jean Fournier, de Montauban; cette traduction publiée en 1562, in-8°, à Toulouse, est très fautive. Le texte de Duchesne, qui a servi à la nôtre, n'est pas moins incorrect que celui de la Chronique de Guillaume de Puy Laurens. Catel a attribué les Gestes glorieux des Français à Pierre V, évêque de Lodève, qui vivait encore en 1312.
F. G.
Comme entre toutes les choses qu’a formées le Créateur, il a premièrement créé et formé les, intelligences, l’intelligence est angélique et humaine; angélique, pour songer et méditer sur les choses divines, humaine, pour qu’elle s’exerce avec grand travail et étude, et même découvre les choses desquelles on n’a jamais eu aucune notion. Ladite intelligence est sujette à déchoir quand la nature s’affaiblit. Avoir souvenir de tout est une chose plus divine qu’humaine, comme le dit la loi. A ce défaut de l’humanité ont voulu suppléer et pourvoir les bons et sages docteurs du temps passé, comme veulent y suppléer et pourvoir ceux du temps présent, qui, avec grande étude et travail, ont rédigé et rédigent par écrit, en leurs œuvres, les actions tant bonnes que mauvaises, afin qu’elles servent d’exemple aux médians et de consolation aux bons: c’est aussi pourquoi beaucoup de gens et docteurs ont réduit en ouvrage les faits qui se sont passés en beaucoup de royaumes monarchies et provinces, villes et cités de grand renom mais ils n’ont point fait mention des grands faits d’armes et combats subis par la très grande, très renommée et très noble cité de Toulouse, et les monarchies de Languedoc et de Provence, et autres provinces et monarchies circonvoisines, et notamment de ce qui s’est fait depuis l’an 1202, auquel temps régnait pour pontife à Rome Innocent IIIe du nom, qui occupa ce siège durant dix-huit ans, quatre mois et vingt-quatre jours, Philippe Dieudonné étant alors roi de France, et le comte Raimond étant comte de Béziers et de Carcassonne. Il y avait aussi un nommé le comte de Montfort, et un frère Arnaud, abbé de Cîteaux, légat dudit saint Père, et aussi le glorieux monseigneur saint Dominique, premier fondateur de l’Ordre des Prêcheurs, dont le couvent fut dans ladite ville de Toulouse. Il y eut entre ces princes de grandes et Mortelles guerres, comme il sera dit ci-après, moyennant la grâce de Dieu et du Saint-Esprit, de la Vierge Marie et des saints et saintes du paradis.
Et pour en venir à la véritable narration et intention de l’auteur, il se trouva que l’an dont j’ai parlé, fut très grande l’hérésie qui régnait dans le pays de Béziers, Carcassonne, le Lauraguais et autres, tant que c’était grande pitié, et le saint Père de Rome en fût averti et assuré; pour y donner ordre et y pourvoir, il manda à toute l’église militante, comme ses cardinaux, évêques, archevêques et autres prélats, tous généralement, de venir vers lui à Rome, pour tenir conseil avec lui sur ce cas, afin de Voir comment on devait se gouverner et procéder afin d’abattre et chasser cette hérésie. En ce conseil se trouvèrent tous lesdits prélats, ainsi que le leur avait mandé le saint Père et en ce temps régnait en France Philippe II, quand l’abbé de Cîteaux fut fait légat pour aller contre les hérétiques. l’histoire et le livre rapportent qu’en la délibération du concile tenu à Rome par ledit saint Père et lesdits prélats, il fut dit et arrêté que ledit abbé de Cîteaux dont on a fait mention ci-dessus, lequel était un grand clerc, serait envoyé en ces pays, et ledit saint Père le fit son légat pour cette affaire, avec autant de puissance que si ledit saint Père y eût été en sa propre personne, et cela pour qu’il vînt réduire et ramener lesdits pays et leurs habitants à bon port et à bonne vie.
Cette décision fut donc apprise et déclarée audit abbé, et lui fut baillé par lettres le pouvoir de légat; aussitôt qu’il eut toutes ces dépêches, il partit de Rome accompagné d’un beau cortège de prélats que lui donna ledit saint Père pour l’accompagner en tout et partout. C’étaient les archevêques de Narbonne et l’évêque de Maguelonne et ceux de Barcelone, de Lérida et de Toulouse, et plusieurs autres qui partirent avec lui de Rome; le saint Père lui donna aussi pour le servir une quantité d’autres gens, tant gentilshommes que autres, parmi lesquels était un grand et noble homme appelé Pierre de Castelnau, lequel était son maître d’hôtel; et voyageant tant de nuit que de jour ils arrivèrent à Saint-Gilles en Provence où se tenait alors le comte Raimond.
Quand le légat eut demeuré à Saint-Gilles un certain nombre de jours, il arriva que Pierre de Castelnau, ci-dessus nommé, eut, sur le sujet de ladite hérésie, quelques paroles et disputes avec un serviteur et gentilhomme du comte Raimond; et leur dispute alla si loin qu’à la fin ledit gentilhomme, serviteur du comte Raimond, donna d’une épée à travers le corps à Pierre de Castelnau, et le tua et fit mourir, lequel événement et meurtre fut cause d’un grand mal, comme on le dira ci-après. Pierre de Castelnau fut enseveli dans le cimetière de Saint-Gilles, et le légat fui ainsi que toute sa compagnie, très marri et courroucé de ce meurtre et homicide.
Or l’histoire dit que quand le gentilhomme eut commis ledit meurtre, il s’enfuit à Beaucaire, vers ses parents et amis; car si le comte Raimond eût pu l’avoir, il en eût fait faire une telle justice et punition que ledit légat eût été content; car ledit comte Raimond était si courroucé et fâché de ce meurtre comme ayant été fait par un homme à lui, que jamais il ne fut si courroucé de chose au monde.
Quand le légat vit qu’on avait ainsi tué cet homme à lui, il manda incontinent le cas au saint Père, et comment cela s’était fait et d’où était venue la querelle; et quand le saint Père apprit la nouvelle de ce meurtre, il en fut si courroucé et mal content qu’il fit incontinent partir des lettres pour ordonner la croisade, afin de prendre vengeance de cette action, et aussi pour forcer ces hérétiques à rentrer dans le bon chemin.
Quand le légat eut reçut les dites lettres et pouvoirs pour ordonner la croisade, il partit de Saint-Gilles avec toute sa suite sans aucun délai, ainsi que le lui mandait le saint Père, et ne prit pas même en partant congé du comte Raimond. Il tira vers son abbaye de Cîteaux, et quand il y fut arrivé, il convoqua un chapitre général, ordonna que tous les moines, abbés et princes dépendrons de son abbaye vinssent incontinent et sans délai audit chapitre. Ils y furent tous arrivés en peu de temps, et le légat tint le chapitre pour y prêcher et dénoncer ladite croisade contre les hérétiques et leurs alliés.
La croisade étant donc prêchée et dénoncée comme on l’a dit ci-dessus, il s’y croisa tant de gens que personne ne le saurait nombrer ni estimer, et cela à cause des grands pardons et des absolutions que le légat avait donnés à tous ceux qui se croiseraient pour aller contre les hérétiques; entre autres se croisa le duc de Bourgogne d’alors, avec tous ses gens, et aussi se croisèrent le comte de Nevers, le comte de Saint-Pol, le comte d’Auxerre, le comte de Genève, le comte de Poitiers, le comte de Forez, et d’autres grands seigneurs, et tous, ainsi que tous leurs gens croisés avec eux, se rendirent devers le légat, si bien armés et si bien montés qu’on ne le saurait dire.
Les nouvelles de la croisade arrivèrent au comte Raimond, qui en fut fort ébahi, et non sans cause, car il se doutait de ce que voulait faire le légat à cause du meurtre dont j’ai parlé. Étant donc averti, comme on l’a dit, que le légat avait assemblé un grand concile à Aubenas en Vivarais, le comte Raimond prit avec lui pour se rendre à Aubenas une belle et noble compagnie, entre laquelle était son neveu le vicomte de Béziers; ce qu’il fit pour aller démontrer audit conseil que si on le voulait accuser du meurtre ou de l’hérésie, il en était innocent en tout et pour tout, et n’en avait point eu connaissance.
Quand le comte Raimond fut arrivé à Aubenas avec sa compagnie, il y trouva sa seigneurie le légat, et le concile. Le comte Raimond alla donc vers, le concile et vers sa Seigneurie, présenter ses raisons touchant le meurtre et aussi touchant l’hérésie, et montra comme il en était innocent en tout et pour tout, et que le légat s’en devait informer et enquérir avant de lui faire aucune insulte, mal ni outrage; qu’il était et se tenait vrai serviteur de l’église; qu’il voulait pour elle vivre et mourir; que si un homme à lui avait commis ce meurtre, il n’en était cause ni coupable, ainsi qu’on le pourrait reconnaître.
Quand le concile eut entendu et écouté bien et au long tout ce que le comte Raimond eut voulu dire et exposer, ils lui firent réponse que le légat ni le concile n’y pouvaient rien faire, mais qu’il s’en allât à Rome devers le saint Père, car il n’y avait rien à faire avec le légat, et qu’il ne pouvait se réconcilier autrement.
Quand le comte Raimond eut ouï cette réponse, il en fut si mal content qu’il ne s’en pouvait consoler; il partit d’Aubenas avec toute sa compagnie, et tira droit vers Arles: alors le vicomte de Béziers, neveu, comme je l’ai dit, du comte Raimond, et qui était aussi allé à Aubenas, commença à dire au comte Raimond, son oncle, que, d’après la réponse que lui avait faite le légat, il était d’avis qu’ils mandassent leurs parents, amis et sujets, et que tous leurs gens arrivassent pour leur donner aide et secours contre le légat et son armée, et qu’ils missent de bonnes garnisons dans toutes leurs terres et places, afin de se garder et défendre au cas que le légat et son armée leur voulussent venir sus pour leur faire outrage et les chasser. Le comte Raimond refusa absolument ce que lui proposait le vicomte de Béziers, puis se départit de son neveu, et s’en alla droit à Arles. Le vicomte demeura fort courroucé et fâché contre son oncle le comte Raimond, pour avoir refusé de faire ce qu’il voulait; ce qui fut cause que le vicomte commença à faire la guerre au comte son oncle.
Lorsque le comte Raimond fut arrivé à Arles, il se mit à songer en lui-même, pour voir de quelle manière il se pourrait gouverner en cette affaire, car son neveu, le vicomte de Béziers, avait commencé à lui faire la guerre; et d’autre part, il pensait à la réponse que lui avaient faite le légat et son concile. Toutes ces choses le mettaient en grand souci, et non sans raison; il ne savait bonnement comment se conduire ni que faire, mais, après qu’il eut songé et rêvé à son affaire, il avisa et délibéra d’envoyer devers l’archevêque d’Auch et l’abbé de Condom et le prieur de l’hôpital, et aussi vers le seigneur de Rabastens, en Bigorre, lesquels étaient tous ses grands amis et alliés il leur envoya ses messagers avec des lettres, où il leur mandait qu’au vu desdites lettres, ils vinssent incontinent devers lui à Arles; et, ayant vu les lettres incontinent et sans aucun délai, ils se mirent en chemin, et allèrent à Arles devers le comte Raimond, ainsi qu’il le leur avait mandé. Or l’histoire dit que lorsqu’ils furent tous venus et arrivés à Arles devers le comte Raimond, il leur dit et exposa toute son affaire, ainsi que les choses s’étaient passées et dites, tant le meurtre commis par un homme à lui sur la personne de Pierre de Castelnau, serviteur du légat, que la guerre que commençait à lui faire son neveu, le vicomte de Béziers, et cela, par la raison qu’il ne voulait pas s’allier avec lui pour faire la guerre au légat et à son armée; et d’autre part, il leur dit la réponse que le légat et son conseil lui avaient faite à Aubenas, quand il s’était voulu purger et justifier, tant du meurtre que de l’hérésie dont on l’accusait, et dont il était pur et innocent; mais que le légat et son concile ne l’avaient point voulu admettre à se justifier ni à prouver ses sentiments, et qu’ils l’avaient envoyé au pape et à son conseil, disant qu’il ne ferait rien avec eux, mais qu’il s’en allât à Rome, comme on l’a dit. C’est pour cela, dit-il, que je vous ai envoyé chercher, parce que je veux que vous autres alliez devers le saint Père, lui remontrer tout mon cass en propre personne; et je resterai ici pour résister à la folie de mon neveu, le vicomte de Béziers, et aussi pour donner ordre à mon affaire, en cas que le légat voulût venir attaquer ma terre et mes gens.
Quand tout cela fut fait et dit en la façon et manière qu’on a dite ci-dessus, ceux dont j’ai parlé quittèrent le comte Raimond, pour aller à Rome vers notre saint père le Pape, accompagnés d’une belle et bonne suite que leur donna le comte Raimond, tant de gentilshommes que d’autres, ils allèrent droit à Rome, et firent tant qu’ils y arrivèrent ; et quand ils furent arrivés et se furent reposés, ils se retirèrent par devers le saint Père et son conseil, remirent leurs lettres audit saint Père, et firent auprès de lui leur ambassade et message, ainsi qu’ils en avaient été chargés par le comte Raimond auprès de leur seigneur le pape et son conseil. Ils furent bien et dûment écoutés par ledit saint Père et son conseil en tout ce qu’ils voulurent dire et proposer, et il leur fut répondu par le saint Père et son conseil, touchant les lettres qu’ils avaient apportées du comte Raimond, et aussi sur ce qu’ils avaient dit et proposé, qu’on leur ferait plus tard réponse sur le tout, ainsi qu’on le devrait et qu’il appartiendrait.
La cause fut, comme on l’a dit, portée au conseil par le saint Père: le tout fut débattu et bien remanié, et le conseil dit et déclara aux ambassadeurs que le Pape et son conseil consentaient à prendre à merci le comte Raimond, attendu que, de son bon vouloir, il était venu se soumettre à l’église, selon son ordonnance, pour faire tout ce qui serait contre lui porté et ordonné, et qu’ainsi le saint Père et son conseil l’avaient admis et admettaient à prouver son innocence, afin que lui fût donnée et baillée son absolution, à condition qu’il baillerait et mettrait entre les mains de l’église les châteaux les plus forts et les meilleurs qu’il aurait en sa terre, jusqu’à ce qu’il fût justifié et déchargé de l’acte qui lui était imputé, ce que les ambassadeurs acceptèrent et consentirent au nom de leur seigneur le comte Raimond, le tout en la forme et manière que le saint Père l’avait dit et ordonné; et le saint Père donna aux ambassadeurs pour prendre possession et seigneurie desdites places et châteaux, un nommé le seigneur Milon, qui s’en vint pour cela avec eux.
Quand les ambassadeurs eurent fait tout ce qu’ils voulaient faire, et eurent reçu leur absolution et raccommodement, ils se mirent en chemin, partirent de Rome, et voyagèrent tant qu’ils arrivèrent à Arles. Le comte les y attendait ; les ambassadeurs vinrent trouver le comte, accompagnés du seigneur Milon, envoyé par le saint Père pour prendre possession des châteaux et places, ainsi qu’il était convenu entre eux. Les ambassadeurs dirent et exposèrent au comte, en présence du seigneur Milon, tout ce qu’ils avaient fait et dit auprès du saint. Père, et lui baillèrent son absolution et les conditions telles qu’on les a vues ci-dessus. De quoi le comte Raimond fut très joyeux et allègre, et aussi remercia les ambassadeurs de la peine qu’ils avaient prise, fit également grand accueil et grand chère au seigneur Milon, le recevant et traitant comme si c’eût été le saint Père en propre personne.
Or l’histoire dit que quand le seigneur Milon eut séjourné un temps à Arles, une certaine maladie le prit, dont il alla de vie à trépas. Il fut fort regretté par le comte Raimond et ses gens, car s’il eût vécu, ni le comte ni ses gens n’auraient éprouvé les tribulations et ruine qu’ils eurent ensuite, comme il sera dit en son lieu.
Quand donc le comte vit que le seigneur Milon était allé de vie à trépas, il prit les lettres, le traité et l’absolution, et s’en alla devant le légat et son armée. Le légat était alors dans la ville de Montpellier, le comte Raimond lui montra son traité et son absolution, dont ledit légat ne fut pas, du moins à ce qu’il parut, fort joyeux ni content. Il dit donc au comte Raimond qu’il le conduisît dans le pays du vicomte de Béziers, car il le voulait prendre et détruire, parce qu’il était plein d’hérétiques et de routiers; ce que fît le comte Raimond pour être toujours obéissant à l’église; et à compter de ce moment, il conduisit toujours le légat et son armée par le pays de Béziers, ainsi qu’il sera raconté plus amplement, et en eut à la fin mauvais guerdon et récompense, comme on le dira ensuite. Quand tout cela eut été fait en la façon et manière qu’on vient de dire, le vicomte de Béziers ayant appris que le comte Raimond avait fait son traité et accord avec le saint père le Pape, et que ledit comte était et allait avec le légat et le conduisait avec son armée à travers sa terre, il vint bien accompagné à Montpellier, où était alors encore le légat; et arrivé dans cette ville, se retira devers le légat et son conseil, lui exposa et remontra tout son cas, disant qu’il n’avait ni ne voulait avoir coulpe ni tort envers l’église: que si ses gens et officiers avaient recelé et soutenu quelques hérétiques ou autres dans ses terres, il en était innocent et non coupable, que c’était à eux à payer et satisfaire, et non pas à lui, vu son intention; et que c’était toujours les mêmes officiers qui avaient gouverné ses terres jusqu’à l’heure présente. Il pria donc et supplia le légat et son conseil de le vouloir prendre à merci, car il était serviteur de l’église, pour laquelle il était résolu de vivre et mourir envers et contre tous.
Quand le légat et le concile eurent écouté bien au long le vicomte et tout ce qu’il voulut dire et proposer comme on vient de le voir, le légat lui répondit qu’il n’y avait pas à lui parler de tout cela, ni à s’excuser, mais qu’il] s’en tirât du mieux qu’il pourrait ou saurait, car il ne ferait rien avec lui: c’est que le légat voulait un grand mal au vicomte de Béziers. Et quand le vicomte et ceux de ses gens qui l’avaient accompagné eurent ouï cette réponse, ils furent grandement courroucés et mal contents, et s’en retournèrent à Béziers. Le vicomte, lorsqu’il fut à Béziers, assembla tout son conseil, tant des gens de la ville que de ses amis et des seigneurs auxquels il était allié en ce temps; et les ayant assemblés, il leur exposa tout ce que le légat avait fait et dit. Tous ceux qui étaient présents au conseil dirent et conclurent qu’il fallait que le vicomte mandât incontinent ses amis, alliés et sujets, et qu’au vu de la présente, chacun vînt équipé, en armes et avec toutes ses forces, pour lui donner secours, et défendre sa terre et vicomte, que le légat et son armée lui voulaient venir prendre, saisir et piller.
Quand le conseil eut donc ainsi dit et conclu comme on vient de le rapporter, le vicomte fit faire des lettres à tous ses amis et alliés, pour leur mander et les prier que chacun lui vînt donner aide et secours pour défendre sa terre. Ils vinrent aussitôt qu’ils eurent ouï et vu le mandement du vicomte de Béziers; et il était venu tant de gens au secours de Béziers, que ceux qui les voyaient disaient qu’il y en avait pour combattre le monde tout entier, et d’autre part la ville était si forte qu’elle était quasi comme imprenable. Le vicomte fut grandement joyeux et content du secours et des gens qui lui arrivaient; aussi mit-il de grandes et bonnes garnisons dans tous les châteaux et places de sa vicomte, pour la défendre et garder; et quand il eut, ainsi qu’on l’a dit, mis ses garnisons et donné ordre à toute son affaire, ainsi que le doit faire un sage et vaillant homme, bien qu’il fût grand jour, il prit une quantité de gens des plus vaillants qu’il sût trier et choisir, et s’en alla demeurer et s’établir en la cité de Carcassonne, car elle lui parut la plus forte ville de sa vicomte et seigneurie, et laissa à Béziers une bonne et grande garnison: et quand la garnison et les habitants de Béziers virent que leur seigneur les avait ainsi laissés et s’en était allé à Carcassonne, ils furent très marris et courroucés, non sans raison, se doutant de ce qui devait leur arriver.
Or l’histoire et le livre racontent que pendant tout ceci, le légat fit partir et marcher l’armée qu’il avait préparée à Montpellier, et qu’il envoya cette armée droit à Béziers parce qu’il fut informé que le vicomte y avait mis une grande garnison de gens pour la défendre et garder. Quand donc l’évêque de Béziers qui était avec le légat et sa suite, ainsi que les autres prélats, vit et comprit que le légat venait, décidé ainsi que son armée à prendre et détruire Béziers, dont il était pasteur et évêque, comme homme sage et attaché aux intérêts des habitants de Béziers, il s’en vint droit au légat, le priant et suppliant qu’il voulût avoir pitié du pauvre peuple qui était dans Béziers, vu que comme on l’en avait informé, leur seigneur les avait laissés et abandonnés, et qu’il lui plût de lui donner congé et licence d’aller vers ledit Béziers, afin de montrer aux habitants et gens qui étaient dedans le grand danger qu’ils couraient; auquel l’évêque, comme il était homme sage et grand clerc, le légat consentit pour l’amour de lui, à lui donner congé pour aller à Béziers, et faire comme il voudrait. Quand l’évêque eut ainsi congé, il vint en petite compagnie devers Béziers, où les habitants le reçurent. Il fit venir les habitants et autres dans l’église de Saint-Nazaire, et là, après plusieurs paroles, il leur dit et exposa le grand danger où ils étaient, et comment leur seigneur, qui les devait protéger et défendre, les avait abandonnés, s’était allé mettre dans la cité de Carcassonne, et les avait laissés là en grand danger de leurs personnes et de leurs biens; il leur donnait donc pour avis et leur conseillait de remettre leur ville au légat, leur promettant qu’ils ne perdraient rien de ce qu’ils avaient, pas seulement la valeur d’un denier, et s’engageant à les dédommager des pertes qu’ils pourraient faire. Il les en pria très affectueusement, car autrement, disait-il, ils étaient en grand danger, eux et leur ville.
Quand ledit évêque eut dit et démontré aux habitants tout ce que je viens de rapporter, ils lui répondirent tous d’une voix, qu’avant de se rendre et donner au légat et à son armée, ils mangeraient plutôt leurs enfants, car ils avaient une ville bonne et forte, étaient d’ailleurs beaucoup de gens pour la défendre, et que de plus, leur seigneur leur donnerait secours s’il était besoin; qu’ils n’avaient donc point l’intention de se rendre, et que personne ne leur en parlât plus en rien ni pour rien.
Lors donc que l’évêque eut entendu la réponse des habitants et leur volonté, il sortit de Béziers, très fâché et affligé, voyant le grand danger où il les laissait, et la perte et dommage qui devait s’ensuivre s’ils étaient pris par force, s’en étant retourné vers le légat et son armée, il leur dit en quelle résolution il avait trouvé les habitants de Béziers, et que par remontrance ni exhortation il n’en avait rien pu obtenir, et qu’ils étaient grandement obstinés dans leur malice et perversité. Quand le légat eut ouï cette réponse rapportée par l’évêque, si auparavant il était plein de colère et de mauvaise volonté contre la ville, il le fut davantage; il jura qu’il ne laisserait à Béziers pierre sur pierre, ferait tout mettre à feu et à sang, tant hommes que femmes et petits enfants, et n’en recevrait pas un seul à merci; ce qu’il fit, comme il sera dit tout au long ci-après.
Pendant que tout cela se faisait et traitait, il s’était levé au pays d’Agen une autre armée de croisés qui avait pour chef et principaux commandants le comte Gui d’Auvergne, le vicomte de Turenne, l’évêque de Limoges, l’évêque de Bazas, l’archevêque de Bordeaux, l’évêque de Cahors, l’évêque d’Agen, et aussi Bertrand de Cardaillac, et de Gordon, seigneur de Castelnau de Montratier, qui conduisait tous les gens du Quercy. Cette armée marcha vers le Puy Laroque, assiégea cette place et enfin la prit et démolit, car il n’y avait personne pour la défendre et la garder; quand ils eurent, comme je l’ai dit, détruit le Puy Laroque, ils marchèrent vers une autre place forte et imprenable, appelée Chasseneuil: c’était un fort château où était une bonne et grosse garnison de vaillants hommes, ainsi qu’ils le montrèrent bien, ne se laissant ébahir de rien. Cette garnison était composée de Gascons. Les assiégeants vinrent l’ancien château, mais les Gascons qui étaient dedans les firent retourner à grands coups de traits, dont ils savaient bien s’aider et se défendre, et force fut auxdits seigneurs, surtout au comte Gui, principal chef de cette armée, de traiter avec ces Gascons qui tenaient la place de Chasseneuil, et de convenir que leur capitaine, appelé de son nom Seguin de Bologne, et tous ses compagnons sortiraient de la place vie et bagues sauves, et s’en iraient où il leur plairait d’aller; tous les autres seigneurs, tant prélats que autres, furent grandement courroucés contre le comte Gui, parce qu’il avait fait cet accommodement sans les appeler ni les consulter, comme il était raison de le faire.
Quand le château fut pris et rendu, et que les Gascons s’en furent allés et eurent vidé la place, les seigneurs dont on a parlé y entrèrent avec une partie de leur armée, et firent brûler beaucoup d’hommes et de femmes, parce que, ni pour prédication ni pour avertissement, ils ne voulaient renoncer à leurs folies et erreurs; et après cela l’armée reprit sa route, et marcha droit vers le légat pour se joindre à lui et lui donner secours. Tandis que cette armée marchait pour se joindre à celle du légat, se formait vers le Puy une autre grande armée plus forte que la première, dont était chef et commandant l’évêque du Puy. Elle vint, après plusieurs marches, attaquer Gaussade et le bourg Saint-Antonin, dont l’évêque tira une grande somme d’argent pour les laisser tranquilles; ce qu’il fit et en fut fort blâmé: pendant que tout cela se faisait, quelques mauvais garnements s’en allèrent à ceux qui gardaient le château de Villemur, leur dire que toute l’armée venait pour leur donner assaut et les prendre, et qu’on avait délibéré de faire de cette place comme des autres qu’on avait mises à feu et à sang sans y recevoir à merci aucune âme vivante. Les gens de Villemur eurent à cette nouvelle si grande peur et frayeur, qu’ils résolurent entre eux d’abandonner la place et d’y mettre le feu partout, ce qui fut fait. Un lundi donc à la nuit, au moment où la lune commençait à luire, on mit le feu au château et à la place de Villemur; et ce fut grande pitié et dommage de brûler et perdre une telle place, car l’armée n’avait pas l’intention d’aller à Villemur, mais cheminait et avançait tant qu’elle pouvait pour aller joindre les autres armées, marcher vers ledit légat, et lui donner secours pour prendre Béziers.
Pour suivre le fil de l’histoire commencée, je retourne au légat et à son armée. Quand ils se furent tous réunis, ce fut la plus grande et plus incroyable chose que jamais on ait vue; car de toutes les parties du monde il était venu des gens pour gagner le pardon. Le guide et conducteur de cette armée était, comme on l’a dit, le comte Raimond, parce qu’il connaissait le pays. Il la conduisit ainsi sur la vicomté de Béziers. Quand donc toutes ces armées furent, comme je l’ai dit, assemblées, elles se mirent en route pour aller tout droit à Béziers, et lorsqu’elles y furent arrivées, on mit le siège tout à l’entour l’armée des assiégeants était si nombreuse, il y avait tant de pavillons et de tentes, qu’il semblait que le monde tout entier s’y fût réuni. Ceux de la ville de Béziers commençaient à s’en ébahir grandement, car ils avaient pris pour railleries les avertissements qu’était venu leur donner leur évêque. Ce qui les ébahissait le plus, c’était que leur seigneur les eût abandonnés, comme on l’a dit ci-dessus; en sorte qu’ils n’avaient ni chef ni seigneur, ce qui était la cause de leur ébahissement; mais il était tard pour s’en repentir. Voyant donc que force leur était de se défendre ou de mourir, ils prirent courage entré eux, et allèrent s’armer chacun du mieux qu’il pût; quand ils furent armés, ils sortirent pour attaquer les assiégeants, et en sortant rencontrèrent un des croisés qui était venu courir jusque sur le pont de Béziers. Ils se jetèrent sur lui et le précipitèrent tout mort du pont dans la rivière. Quand l’armée des assiégeants le vit ainsi mort, et jeté du pont en bas, elle commença à se mettre en mouvement, tellement qu’elle faisait trembler la terre, et marcha droit à Béziers pour attaquer les ennemis qui venaient d’en sortir. Quand ceux de Béziers virent tout ce grand monde qui venait contre eux, ils se retirèrent dans leur ville, fermèrent et barricadèrent leurs portes, et montèrent sur la muraille pour se défendre. Les assiégeants avancèrent et donnèrent tellement l’assaut, qu’ils entrèrent dans les fossés malgré tous les efforts de ceux de la ville. Les uns se mirent donc à porter des échelles, les autres des planches pour faire des échafauds, et les autres, à coups de pics, à miner et rompre les murailles. Ils firent tant les uns et les autres qu’ils entrèrent dans la ville de Béziers malgré toute la défense et résistance des gens de la ville. Là se fit le plus grand massacre qui se fût jamais fait dans le monde entier; car on n’épargna ni Vieux ni jeunes, pas même les enfants qui tétaient: on les tuait et faisait mourir. Voyant cela, ceux die la ville se retirèrent, ceux qui le purent, tant hommes que femmes, dans la grande église de Saint-Nazaire: les prêtres de cette église devaient faire tinter les cloches quand tout le monde serait mort; mais il n’y eut ni son ni cloche, car ni prêtre vêtu de ses habits, ni clerc ne resta en vie; tout fut passé au fil de l’épée, pas un seul n’en échappa. Ce meurtre et tuerie furent la plus grande pitié qu’on ait depuis vue ni entendue. La ville fut pillée, on mit le feu partout, tellement que tout fut dévasté et brûlé, comme on le voit encore à présent, et qu’il n’y demeura chose vivante. Ce fut une cruelle vengeance, vu que le comte n’était pas hérétique ni de la secte. A cette destruction furent le duc de Bourgogne, le comte de Saint-Pol, le comte Pierre d’Auxerre, le comte de Genève, appelé Gui le Comte, le seigneur d’Anduze, appelé Pierre Vermont; et aussi y étaient les Provençaux, les Allemands, les Lombards; il y avait des gens de toutes les nations du monde, lesquels y étaient venus plus de trois cent mille, comme on l’a dit, à cause du pardon.
Quand tout cela fut fait, l’armée, non contente de la destruction de Béziers, marcha droit à Carcassonne où était pour lors le vicomte, fort marri et affligé de la destruction de Béziers. Ce fut vers la Madeleine que l’armée arriva un mardi soir, bannières déployées, devant carcassonne. On mit autour de la ville un camp de siège, grand et respectable; et le lendemain matin le vicomte, étant dans la ville, monta sur la plus haute tour avec ceux de ses barons qui étaient avec lui, et de là se mit à regarder l’armée des assiégeants, dont il fut ébahi, voyant tout ce qu’il y avait de monde, et ce qui en arrivait toujours pour donner secours au légat. Quand le vicomte eut regardé quelque temps l’armée assiégeante, et ce qu’il y avait de monde, il serait sorti pour aller l’attaquer, si ses gens avaient voulu le croire et suivre: car il était vaillant, quoique jeune, comme on l’a dit ci-dessus.
Un de ses hommes, lequel était sage et vaillant, et s’appelait Pierre Roger, seigneur de Cabaret, place forte, lui dit: Seigneur vicomte, si vous me voulez croire, d’après mon conseil, vous ne ferez pas ainsi, mais tout autrement; mon idée est de demeurer dans la ville pour ne les pas attirer; en cas qu’ils approchent nous songerons alors à nous défendre et à leur montrer que nous ne les craignons guère, car je pense qu’ils voudront nous ôter l’eau et emporter les fossés: s’ils font ainsi, je suis d’avis que nous sortions contre eux, et que chacun se montre comme il le doit, pour défendre notre droit et querelle, laquelle est bonne et juste; d’ailleurs nous avons de braves gens tous tant qu’ils sont, c’est pourquoi nous ne devons craindre en rien nos ennemis. Tous donc s’accordèrent à ce qu’avait dit Pierre Roger, et chacun alla chez soi apprêter son harnais et tout ce dont il aurait besoin en cas de nécessité; et la nuit on fît bonne garde par la ville et sur la muraille, où le vicomte était en personne, armé et accoutré comme un des plus petits.
Quand vint le lendemain matin, toute l’armée des assiégeants se mit en mouvement, et faisait un tel bruit qu’il semblait que ce fût la fin du monde. A ce bruit, les gens de la cité montèrent sur les murailles, bien armés et accoutrés comme gens accoutumés à cette affaire; et lorsqu’ils virent leurs ennemis qui, venaient, apportant fagots et bagages pour aplanir et combler les fossés de ladite ville afin de lui donner l’assaut, voyant tous ces préparatifs et aussi le courage et la valeur de leurs ennemis, ils se mirent en belle ordonnance, et sortirent de la ville contre les ennemis, non pas comme des enfants, mais comme gens vaillants et courageux, décidés à se défendre jusqu’à la mort, et ils attaquèrent et frappèrent de telle sorte qu’il en tombait de chaque côté beaucoup de morts et de blessés, ils tombaient de telle façon que jamais ils ne se levèrent ni bougèrent de l’endroit, car chacun se montrait vaillant et s’attachait à emporter la victoire sur son ennemi, et ils firent si bien qu’on ne savait qui avait du meilleur; qui les aurait vus à cette heure les uns et les autres aurait dit que le monde entier allait prendre fin, car le vicomte faisait de son corps les plus grands faits d’armes que jamais homme puisse faire; et quand ses gens voyaient son maintien et de portement, le plus couard en prenait courage de frapper et se mettre en avant: ils frappèrent et combattirent tellement que les ennemis reculèrent, ayant plus perdu que gagné à leur assaut; et n’eût été la nuit qui les vint surprendre, ils auraient en cette escarmouche pris fin les uns et les autres, car depuis le matin jusqu’au soir, ils n’avaient cessé de combattre: c’est pourquoi, d’un côté comme de l’autre, ils avaient bon besoin de repos. Ils se retirèrent donc chacun de son côté, les uns vers le camp, les autres vers la cité, sans savoir qui, pour cette fois, avait eu dans l’escarmouche du meilleur ou du pire.
Quand ceux de l’armée des assiégeants se furent retirés et désarmés, ils reconnurent qu’ils avaient fait une grande perte, et délibérèrent entre eux que, vu le grand mal et dommage qu’ils avaient reçu de ceux de la ville, ils iraient le lendemain pour en prendre vengeance, détruire tout le faubourg de Carcassonne, mettre le feu partout, brûler jusqu’au pied de la ville, et en même temps lui ôter l’eau; ce qui fut fait comme ils l’avaient dit, et fut grand dommage et destruction pour ledit faubourg, lequel en fut tout brûlé et démoli. Ils resserrèrent tellement le siège de la ville, qu’il n’est pas possible de le croire ; ils firent dresser des pierriers et des calabres pour tirer contre la ville, et c’était grande pitié de voir le mal qu’y faisaient incessamment ces engins la nuit comme le jour. Cela se passait à la fin du mois d’août 1209.
Pendant que ceci se passait, il fut dit et raconté au roi d’Aragon que le légat et son armée avaient, pris et détruit Béziers, tout brûlé et démoli, tué les hommes, les femmes et les enfants, sans épargner une créature vivante; et que, pour le présent, ils tenaient le vicomte de Béziers assiégé dans Carcassonne, tellement qu’il n’était pas possible d’en sortir. Quand le roi d’Aragon eut entendu tout ceci, il fut grandement affligé de ce fait et de cette destruction, car le vicomte était son allié et son grand ami. C’est pourquoi il partit tout incontinent de son pays avec une belle et bonn-size: 12.0pt;font-family:"Garamond","serif""> beaux à voir. Le roi et le comte Raimond étaient beaux-frères, carie comte avait pour femme la sœur du roi d’Aragon. Quand le roi se fut un peu reposé, il alla devers le légat et les autres seigneurs, qui lui firent, à sa venue, grand honneur et accueil. Le roi leur commença à dire et montrer qu’il n’était pas venu dans l’intention de faire la guerre contre les uns ni les autres, mais seulement de voir s’il pourrait mettre entre eux la paix et le bon accord, ce pourquoi il venait supplier grandement les prélats et seigneurs qui lui donnaient assistance, qu’ils voulussent prendre, le vicomte à merci, et lui accorder de bonnes conditions, car, en raison de sa jeunesse, il leur devait bien suffire du grand mal qu’ils lui avaient fait à Béziers et aussi à Carcassonne.
Quand le roi eut dit ce qu’il voulait dire et proposer, et que le légat et les seigneurs qui étaient présents eurent entendu ses paroles et son vouloir, on lui demanda pour réponse s’il avait parlé au vicomte, et si celui-ci lui avait donné charge de dire ce qu’il venait de leur dire et proposer. Le roi leur répondit que, quant à lui, il n’avait point encore parlé au vicomte, et ne l’avait point vu, car il voulait d’abord savoir leur intention et vouloir. On lui dit qu’avant de lui faire réponse il fallait savoir le vouloir du vicomte et de ses gens; qu’il allât donc lui parler dans la ville, et que, pour l’amour du roi, ils feraient en partie ce qu’il voudrait. Le roi quitta donc le légat et ses gens, et s’en alla dans la ville trouver le vicomte. Quand le vicomte sut que le roi voulait lui parler, il fit abaisser les ponts, ouvrir les portes, et vint au-devant du roi avec la plupart de ses barons et chevaliers. Ils accueillirent mutuellement avec la plus grande chère qu’on vit jamais deux hommes se faire, et entrèrent dans la ville; quand ils furent en leur logis, le roi commença à parler au vicomte de son affaire, et lui dit comment il en avait parlé au légat et aux autres barons et seigneurs, car il était venu pour cela tout exprès et sans autre motif qui le pressât, aussitôt qu’il avait su la nouvelle, pour parler de son affaire au légat et aux seigneurs, bien qu’il n’eût pas pu encore s’entretenir avec lui, et le légat et les seigneurs l’avaient envoyé à lui pour voir quels traités et conditions il voudrait faire avec eux. Quand le vicomte eut entendu tout ce que le roi lui voulut dire, il le remercia grandement de ce qu’il avait pris tant de peine pour lui et ses gens, que de venir de son pays jusque là; et après tous les remerciements, il continua: Seigneur, je ne saurais que faire ni que dire, mais s’il se peut trouver quelque bon accommodement à conclure avec le légat et ses gens, je vous prierai fort que ce soit votre plaisir d’en traiter, et cela en la forme et manière qu’il plaira à votre seigneurie; je tiendrai tout pour bon, sans aucune contradiction, car je vois bien qu’à la longue nous ne pourrons tenir ni résister. Il y a dans cette ville tant de gens du pays, hommes, femmes et enfants, que je n’en saurais dire le nombre; ils meurent tous les jours par troupes: s’il n’y avait que moi et mes gens, je vous jure, seigneur, que jamais je ne me rendrais au légat et à son armée, et me laisserais plutôt mourir de malefaim: mais ce peuple enfermé ici, comme je vous l’ai dit, me contraint d’avoir compassion de lui; c’est pourquoi je vous prie, seigneur, que vous veuilliez agir ainsi que vous avez commencé, car je mets en vos mains moi, mes gens et mon affaire; faites-en, seigneur, comme des vôtres, je m’en remets du tout à vous.
Quand le roi eut parlé et discuté bien au long avec le vicomte, il sortit de la ville et s’en retourna au camp, vers les seigneurs et le légat, lesquels étaient tous réunis dans la tente du légat, pour attendre le roi et la réponse qu’il leur devait apporter du vicomte. Le roi arrivé vers eux, leur, commença à dire et à montrer comment le vicomte voulait consentir à un accommodement raisonnable, les priant d’avoir compassion de lui, vu que c’était un jeune enfant que jamais il n’avait été pour rien dans l’hérésie, n’y avait en rien consenti et n’avait donné aux hérétiques ni secours ni faveurs, mais se tenait pour vrai catholique et serviteur de l’église; que si ses officiers l’avaient, comme on dit, soutenue sans sa permission et à son insu, on devait aucunement l’en absoudre; d’ailleurs il leur pouvait suffire de la ruine de Béziers, et aussi de celle du faubourg de Carcassonne, et ainsi devaient le recevoir à merci, pourvu qu’il se soumît; que si le légat ou son armée avaient reçu quelque mal ou dommage, il offrait d’y satisfaire au dire des seigneurs et barons.
Quand donc le roi eut dit et montré bien au long tout ceci au légat et barons, et plus encore que je n’en ai touché par écrit, ils se regardèrent les uns les autres, et entrèrent en conseil sur ce que le roi leur avait dit et montré. Après avoir bien débattu l’affaire entre eux, ils firent venir le roi; et le légat lui répondit en son nom et celui de tous, et lui dit que lui, les seigneurs et les barons consentaient pour l’amour de lui et de sa noblesse, et parce qu’il avait pris tant de peine pour cette affaire, que le vicomte sortît avec douze autres seulement, selon qu’il les voudrait choisir pour emmener avec lui, et auxquels on laisserait tous leurs chevaux, armes et bagages; quant à tout le reste, il fallait qu’il le leur laissât pour en faire à leur plaisir et volonté; on ne ferait point d’autre accommodement, et s’il refusait celui-là, il n’en aurait point du tout.
Quand le roi eut ouï cette réponse, il leur dit qu’avant de rien faire ni conclure, il voulait retourner vers le vicomte, pour lui dire et montrer tout ce qu’on vient de rapporter, et qu’il n’y aurait ensuite aucune paix pour lui; à quoi consentirent le légat et les seigneurs. Il retourna donc devers le vicomte dans la ville, lui dit et montra tout ce qui s’était fait et dit avec le légat et les barons, lui déclara les conditions, et lui dit que, s’il les refusait, il n’en aurait jamais d’autres à espérer. Quand le vicomte eut ouï la réponse et les conditions du légat, sans prendre ni demander autre conseil à qui que ce fût au monde, il dit et répondit au roi qu’avant de faire ce que lui mandaient le légat et les seigneurs, il se laisserait écorcher tout vif plutôt que de laisser seulement le plus petit ni le plus misérable des siens; qu’ils s’étaient tous mis en danger pour lui, et que jamais telle lâcheté ne lui serait reprochée et mise devant la face; car il aimait mieux mourir et défendre son droit et sa querelle. Quand le roi eut entendu la réponse, il le loua bien plus qu’il n’aurait fait s’il eût accepté les conditions, et lui dit qu’il songeât à se bien défendre, il dit aussi à tous ses gens qui avaient ouï la réponse du vicomte et les conditions qu’il aurait pu avoir s’il avait voulu, qu’il prenait le bon parti, car qui se défend bien trouve à la fin bonne composition. Le roi sortit donc de la ville et prit congé du vicomte car il voulait s’en retourner en son pays, puisqu’il n’avait pu faire ni achever entre eux aucun accommodement, dont il était fort fâché et affligé. Il revint vers le légat et les barons leur rendre la réponse du vicomte telle qu’il la lui avait faite. Il prit donc congé du légat et seigneurs qui étaient là présents, les remercia fort du bon accueil qu’ils lui avaient fait, et le légat et les barons l’accompagnèrent un grand bout de chemin, ainsi qu’il appartenait à un tel seigneur.
Quand le roi s’en fut allé, tous les assiégeants s’armèrent et se préparèrent pour aller donner l’assaut à la ville, et cela avec un très grand bruit, ainsi qu’on avait coutume de faire alors. Ceux de la ville, lorsqu’ils entendirent ce bruit, sans être ébahis de rien, s’armèrent et s’accoutrèrent incontinent. Une partie se mit sur les murs et tours, chacun au poste qui lui était ordonné, et chacun avec un courage non d’homme, mais de lion; car ils aimaient autant mourir en se défendant, que d’être pris par le légat et ses gens, et ainsi il n’y avait homme à cette heure dans la cité qui désirât rien plus au monde que d’être sur les murs; car il le fallait bien.
Les assiégeants vinrent donc, apportant grande quantité de fagots et autres bois pour remplir et combler les fossés et escalader la ville, mais lorsqu’ils furent arrivés aux fossés, et commencèrent à donner l’assaut, ceux de la ville les reçurent si bien à coups de traits et de grosses pierres, et aussi avec des eaux bouillantes, qu’il ne demeura dans les fossés que des morts et des blessés; car ceux de dedans la ville se défendaient comme gens perdus et désespérés, aimant autant mourir que vivre. Les assiégeants furent donc forcés de recuit avec grande perte et dommage pour cette fois; car il y eut beaucoup de gens tués et blessés à cet assaut, dont ils ne se purent plus aider, et il n’était pas possible au légat et à son armée de prendre aucunement cette ville par force ou par assaut; car il était aussi arrivé que Charlemagne avant ceci l’avait assiégée pendant sept ans sans y pouvoir rien faire, et avait été forcé de lever le siège et s’en aller; mais Dieu montra alors sa puissance; une des tours s’inclina vers Charlemagne, ainsi qu’on peut le voir même à présent, et la ville fut prise. Il n’était pas possible au légat ni à son armée de la prendre par force ou par assaut; mais une chose tourmentait fort ceux qui étaient dedans, l’eau leur manquait et s’était tarie à cause de la grande chaleur et sécheresse qu’il faisait, en sorte que ceux qui étaient dedans mouraient de soif. Par là il s’éleva dans la cité une telle contagion que c’était pitié de le voir.
Le légat voyant donc que par assaut ou autrement il ne pouvait prendre la ville, songea en lui-même et imagina, ce qui fut une grande ruse, d’envoyer un de ses gens vers le vicomte, dans ladite ville, pour parlementer avec lui de quelque accommodement, et aussi pour savoir en quel état ils étaient dans la cité; ce qui fut fait. Le personnage envoyé vers le vicomte était homme entendu et d’un parler propre à bien faire ces choses. Il alla droit à la cité, demandant qu’on le fit s’entretenir avec le vicomte pour affaire à son avantage; ce qui fut fait. Incontinent que le vicomte sut qu’il y avait dehors et au pied de la porte un gentilhomme et seigneur accompagné de bien trente autres, tous gentilshommes à la mine, il vint et sortit sur la barrière de la ville, bien accompagné, atout hasard, de trois cents hommes bien en point et bien armés. Lorsqu’il fut sorti, le seigneur envoyé par le légat et ses gens lui fit grand accueil et salut; et les salutations faites des deux côtés, ledit seigneur se prit à dire au vicomte qu’il plaignait grandement sa fortune et sa situation, et que, de vrai et pour certain, il lui jurait et affirmait qu’il était son propre parent, de son sang et très proche; ce pourquoi il était mal content et fâché de ce qui lui arrivait, et qu’il voudrait et serait d’opinion qu’il fit quelque bon accommodement avec le légat; mais que toutefois il lui conseillait que, s’il savait lieu d’où il pût avoir aide et secours, il en fit venir promptement; car le légat et les barons étaient grandement de mauvais vouloir contre lui, et avaient grand désir de le détruire; que cependant il ferait ce qu’il pourrait pour l’accommoder avec eux. Telles furent les trompeuses et cauteleuses paroles dudit seigneur et gentilhomme. Le vicomte y donna foi et confiance, comme je vais le dire au long; en quoi il fit une folie.
Or l’histoire dit que le gentilhomme persuada et flatta tellement le vicomte par ses feintes et cauteleuses paroles, que le vicomte lui dit que, s’il voulait prendre tant de peine pour lui, il lui mettrait toute son affaire entre les mains, et s’en rapporterait du tout à lui pour faire comme bon lui semblerait, car le vicomte était grandement ébahi de voir l’état où on se trouvait dans la cité; ce pourquoi il était contraint de faire ainsi qu’il le disait: Si les seigneurs et princes, dit-il, me voulaient donner sûreté pour que je pusse leur aller parler à leur camp et leur exposer les choses telles qu’elles sont, il me semble que nous serions tous d’accord. Et l’autre lui répondit: Seigneur vicomte, quoique je n’en aie pas créance ni pouvoir, je vous promets et jure, par ma foi de noble et de gentilhomme, que si vous voulez venir au camp, comme vous me l’avez dit, et que vous ne vous accommodiez pas, je vous mènerai et ramènerai sain et sauf, et ne sera nul danger pour votre personne ni vos biens. IL le promit et jura de cette manière; en sorte que le vicomte y consentit, dont ce fut à lui grande folie, et à l’autre grande perfidie de trahir ainsi le vicomte, comme il sera dit ci-après.
Ainsi donc, sans autre délibération, le vicomte, après avoir parlé avec ses gens de la ville, se mit en chemin en belle et noble compagnie, s’en alla au camp, et entra dans la tente du légat, où étaient à cette heure assemblés tous les princes et seigneurs. Chacun d’eux de sa part s’ébahit et s’émerveilla grandement de le voir. Le vicomte les salua tous fort honorablement, ainsi qu’il le savait bien faire. La salutation faite et rendue, le vicomte commença à exposer son affaire de point en point, et comment il n’avait jamais été, non plus que ses prédécesseurs, de la congrégation des hérétiques, et que jamais lui ni les siens ne les avaient retirés, ni ne s’étaient associés à leur affaire et folie, mais avaient toujours été obéissants à la sainte Église et à ses mandements, et l’étaient encore; que s’il y avait quelque faute de faite pour le présent, la coulpe en était à ses officiers auxquels son père avait en mourant laisse la garde et le gouvernement du pays; qu’il n’avait jamais fait ni connu aucune chose pourquoi on le dût ainsi ruiner et déposséder de son héritage, ni lui faire une guerre telle qu’on la lui faisait, et qu’il consentait volontiers à se mettre lui et sa terre entre les mains de l’église, et qu’on le voulût ouïr en ses défenses et contredits.
Quand le vicomte eut fini son discours et tout ce qu’il voulut dire, le légat tira à part lesdits princes et seigneurs, lesquels étaient innocents et n’avaient point connaissance de la trahison. il fut dit et convenu que le vicomte demeurerait prisonnier jusqu’à ce que la ville fût remise et rendue entre leurs mains, dont le vicomte et les gens qui l’accompagnaient furent grandement marris, et non sans raison. Le vicomte fut donné en garde à une quantité de gens du duc de Bourgogne, afin qu’ils le tinssent bien et sûrement; ce qui fut fait, et quand on apprit dans la cité cette nouvelle que leur seigneur était pris et détenu entre les mains du légat et des princes, il n’est pas besoin de demander si chacun fut ébahi et pris de peur, on délibéra donc de s’en aller et d’abandonner la ville et cité, et ainsi fut fait. Quand vint la nuit, qui put fuir s’enfuit, les uns vers Toulouse, les autres en Aragon, les autres en Espagne, qui put s’en aller s’en alla, tant qu’il ne demeura pas dans la ville seulement un homme ou une femme, mais tous quittèrent et désemparèrent la ville et cité, laissant tout ce qu’ils avaient sans en rien emporter; car ils aimaient bien mieux sauver leur vie et leur corps que leurs biens, et c’était assez gagner que de vivre. Voilà de quelle manière la ville fut abandonnée et désemparée, et le vicomte pris.
Quand tout cela fut arrivé comme on l’a dit, quelqu’un des gens du légat crut s’apercevoir le lendemain qu’il n’y avait plus en la cité ni hommes ni femmes, car tous s’en étaient allés par un chemin souterrain qu’ils avaient en ladite cité, et qui allait aboutir aux tours de Cabardès, à trois lieues de là, et c’était en cette manière qu’ils s’étaient sauvés. Quand donc celui que j’ai dit eut regardé et vu de dessus les murailles et tours, et n’eut vu personne, après avoir fait tout le tour de la ville, il vint au légat et aux princes, et leur dit ce qui était, et comment, autant qu’il le pouvait savoir, il n’y avait plus personne dans la ville. Quand les seigneurs eurent ouï ceci, ils pensèrent que ceux du dedans voulaient les tromper et leur tendre quelque piège. Ils firent donc armer une grande quantité de gens, leur firent apporter aux uns des fagots, aux autres des échafauds; et quand ils furent arrivés, ils vinrent droit à la porte, et firent semblant de vouloir la briser pour entrer dedans, et bien la pouvaient-ils briser sans crainte, car il n’y avait personne dedans pour la défendre; quand ils virent que personne ne faisait mine de se défendre, ils y allèrent tout de bon et entrèrent. Ils ne trouvèrent ni hommes ni femmes à qui parler, mais de grandes richesses. Ils allèrent donc dire aux légat et seigneurs que la ville était prise et qu’ils n’y avaient trouvé âme vivante, dont ils s’émerveillaient grandement par où ils pouvaient s’en être allés, vu que le siège était mis étroitement tout à l’entour, et qu’à moins de faire un trou en terre nul ne pouvait sortir de la cité sans être pris; mais enfin quand les seigneurs furent arrivés dans la ville, ils cherchèrent tant qu’ils trouvèrent l’endroit par où on s’en était allé; ce dont le légat et ses gens furent mal contents, car ils avaient résolu d’en faire de même qu’à Béziers. Le légat voyant que la ville avait été pillée par les premiers qui étaient entrés dedans, fit à tous commandement, sous peine de malédiction, que, sans retenir la valeur d’un denier, chacun apportât dans la grande église ce qu’il avait pris et pillé; et aussitôt qu’on ouït proférer cette malédiction chacun rendit ce qu’il avait pris, et le rapporta dans l’église, où il se trouva de grandes richesses quand tout y fut, comme on l’a dit, rassemblé et ramassé.
Tout cela fait comme on vient de le dire, le légat fit lever le siège, plier les tentes et pavillons, et ils entrèrent dans la ville, menant avec eux le vicomte, qu’ils enfermèrent dans une tour, la plus forte et la plus sûre qui fût dans la cité, et le gardèrent étroitement. Quand toutes les places d’alentour surent la paix de Carcassonne, elles s’en ébahirent et vinrent au légat et aux seigneurs pour se rendre et mettre en leur sujétion: ainsi firent Montréal et Fanjaux, par le moyen d’un nommé Pierre, Aragonais, qui était du pays, et alla trouver le légat et ses gens; et le légat tira de ces places de grosses rançons en argent. Quand Montréal et Fanjaux se furent mis entre les mains du légat, il assembla son conseil à Carcassonne, où étaient tous les princes et seigneurs. Dès qu’ils furent assemblés en conseil, le légat leur dit et montra comment ils avaient pris tout le pays et la vicomte de Béziers, comment ils tenaient en prison le vicomte, pour en faire à leur plaisir et volonté, et qu’il était nécessaire que quelqu’un d’eux se chargeât d’en prendre la seigneurie et gouvernement, ajoutant que tout ce qui avait été pris dans la cité serait à celui qui en prendrait la charge et seigneurie, pour en faire et donner à son plaisir comme bon lui semblerait. Le légat adressa donc la parole au duc de Bourgogne, pour voir s’il voudrait s’en charger. Le duc de Bourgogne refusa, disant qu’il avait bien assez de terres et seigneuries sans prendre celle-là, et sans déposséder le vicomte; car il lui semblait qu’ils lui avaient fait assez de mal sans lui ôter son héritage. Le légat s’adressa lors au comte de Nevers, et lui offrit la terre et seigneurie, comme il l’avait offerte au duc de Bourgogne, le priant de la vouloir prendre et accepter. Le comté de Nevers lui fit la même réponse que le duc de Bourgogne, disant qu’il avait assez de terres et seigneuries sans prendre celles des autres. Il l’offrit au comte de Saint-Pol quand ceux que j’ai dits l’eurent refusée. Le comte de Saint-Pol lui fit semblable réponse, duquel refus le légat fut très mal content envers lesdits seigneurs; mais il n’y pouvait que faire: il n’osait prendre avec eux bruit ni querelle pour cela, car lesdits seigneurs et princes savaient bien qu’on avait fait au vicomte grand tort et trahison, et ils étaient courroucés en leur courage de ce tort et de cette trahison qu’avait faits le légat, ainsi qu’ils le montrèrent ensuite, comme il sera dit; mais le légat était opiniâtre, et voulait, comme je l’ai ait, grand mal au vicomte, et le montra bien aussi par les effets. Quand donc les seigneurs eurent refusé, ce dont le légat fut, ainsi qu’on l’a vu, fort mal content, il ne sut plus que faire ni à qui offrir la seigneurie, car il n’avait plus en son armée aucun autre homme de marque. Il l’offrit donc à un seigneur dit le comte de Montfort, qui avait été autrefois contre les Turcs, et à qui il l’offrit le dernier; lequel comte de Montfort la désirait et la prit. Il se nommait de son nom Simon, il l’accepta à condition que tous les autres princes et seigneurs y consentiraient, et lui promettraient de lui donner aide et secours s’il en avait besoin, lorsqu’ils en seraient par lui requis. Ils promirent tous de le faire, et le comte de Montfort fut mis en possession de la, terre et vicomte; tous les sujets qui s’y trouvaient alors lui firent hommage, et quand le comte de Montfort eut pris possession, les princes et seigneurs prirent congé du légat et de lui, pour s’en retourner chacun en son pays avec tous leurs gens. Quand le légat et le comte de Montfort virent que tous les seigneurs et princes s’en allaient et les quittaient, ils en eurent grande fâcherie, particulièrement le comte de Montfort, qui se repentit bien d’avoir pris la seigneurie, comme il l’avait fait, puisque les seigneurs et l’armée le laissaient et s’en retournaient chacun dans son pays, hors quelques gentilshommes et autres, au nombre de quatre mille cinq cents, tant Bourguignons qu’allemands, et autres gens de par delà, qui lui demeurèrent engagés. Voyant cela, le comte de Montfort fit venir ceux qui étaient demeurés avec lui, et aussi ceux du pays, dont il avait beaucoup à son service et à lui, entre autres un nommé Verles d’Encontre,[1] homme sage et vaillant, qui était de son parti et de sa terre, auquel il donna une grande quantité de gens pour aller mettre bonne garnison par toutes les places et châteaux de la vicomté de Béziers, ainsi que besoin y serait, lui donnant pouvoir et seigneurie sur toute la vicomté. Il donna ordre aussi aux affaires du reste du pays plus éloigné qui s’était donné à lui, comme Limoges, et y envoya un autre sage et vaillant homme de son pays, appelé Lambert de Creichi, qu’il fit capitaine et gouverneur de toute cette terre et seigneurie de Limoges. Il donna ordre pareillement à toutes les autres terres et seigneuries, et les pourvut de bonnes garnisons pour les garder et défendre, ainsi qu’il appartenait et était besoin en telle affaire. Quant à lui, il se tint en la cité de Carcassonne, comme la place la plus forte et la meilleure de toutes. On lui laissa en cette ville le vicomte prisonnier, pour en faire à sa volonté et à son plaisir. Il le tint en sûre garde, sans le laisser jamais sortir de la tour ni parler à âme vivante, sinon à ceux qui le gardaient.
Or l’histoire dit qu’au bout de quelque temps le vicomte fut fort malade de dysenterie, de laquelle maladie il alla de vie à trépas, et mourut prisonnier, comme on l’a dit. Il fut bruit dans tout le pays que le comte de Montfort l’avait fait mourir, mais cela n’est pas, car il mourut, comme on l’a dit, de dysenterie, et avant qu’il mourût et allât à Dieu il fit son devoir comme un véritable chrétien, et l’évêque de Carcassonne, qui était pour lors dans la ville, l’ouït en confession, et lui administra tous les sacrements de sainte mère Église. Lorsqu’il fut mort, le comte de Montfort le fit porter à la grande église bien honnêtement accoutré, ainsi qu’il appartenait à un tel personnage, et Je visage tout découvert, afin que tout le monde le vît et reconnût; et il manda par tout le pays dont le vicomte avait été autrefois seigneur, que chacun le vînt voir et lui rendît l’honneur qu’il lui devait. La chose ouïe par le peuple et les sujets du vicomte, il fut grandement plaint et pleuré de plusieurs, et ils vinrent à Carcassonne pour voir leur seigneur mort, et lui rendre tout l’honneur qu’ils étaient tenus de lui rendre. Ce fut une chose fort lamentable et piteuse à voir que la douleur que témoignait le peuple pour ce que le vicomte était ainsi mort en prison, et pour la manière dont il était mort.
Or l’histoire véridique nous apprend que, quand tout ceci fut arrivé comme on l’a dit, et que le vicomte de Montfort vit qu’il était sans contestation seigneur de la terre et vicomte, il commença à se méconnaître et voulut s’élever encore davantage; par le conseil du légat, il envoya à Toulouse des lettres et messages au comte Raimond et aux habitants de cette ville, pour savoir s’ils se voulaient accommoder avec lui, car autrement il avait résolu de lui courir sus, à lui et à sa terre. Le comte Raimond ayant reçu les messagers du co’entendait point faire d’autre accommodement avec le légat que celui qu’il avait fait auparavant avec le saint Père; que les messagers pouvaient donc bien s’en retourner avec cette réponse vers leur seigneur et le légat, car il était décidé à aller à Rome vers le saint Père, puisque le légat et le comte de Montfort voulaient, comme ils lui avaient mandé, le vexer et prendre sa terre. On a dit souvent qu’à mauvais service revient tel guerdon, et c’est ce qui arriva au comte Raimond, après qu’il eut pris peine et travail pour le légat et son armée car ce fut là le retour qu’il en eut en fin de cause.
Quand le légat et le comte de Montfort eurent ouï la réponse que le comte Raimond avait faite aux messagers et qu’il s’en voulait aller à Rome, ils furent mal contents, et envoyèrent devers le comte Raimond un autre message, disant que, pour ce qu’ils lui avaient mandé, il n’était pas nécessaire d’aller à Rome devant le saint Père, ni de prendre tant de peine, mais qu’il s’en vînt vers eux, et qu’il ferait autant avec eux que s’il allait à Rome. A ce second message le comte répondit qu’il voulait aller au saint Père pour lui montrer la grande perte que lui voulaient faire éprouver le légat et le comte de Montfort, et qu’il la voulait aussi montrer au roi Philippe, qui régnait alors en France, et aussi à l’empereur et qu’il voulait aller montrer à tous les seigneurs les torts et griefs qu’on lui faisait, et quand le légat et le comte de Montfort eurent ouï ce que je viens de dire, ils en furent grandement marris et fâchés.
Quand donc le comte de Montfort vit, ainsi qu’on l’a dit, que le comte Raimond était déterminé à aller vers le saint Père pour son affaire, comme il voulait aussi faire un accommodement avec le comte de Foix, auquel il avait mandé la même chose, cet accommodement fut que le comte de Fois lui donnerait en otage un de ses enfants, le plus jeune de tous, jusqu’à ce qu’il se fût justifié de ce que le comte de Montfort et le légat lui imputaient touchant l’hérésie, mais cet arrangement ne dura guère, ainsi qu’il sera dit ci-après.
Le comte de Montfort avait un vaillant homme, lequel était seigneur de Pépieux, et s’appelait de son nom Guiraud, lequel alla trouver le comte Raimond, et se mit avec lui. La cause en fut qu’un de ceux que le comte de Montfort avait amenés avec lui dans ce pays avait tué au seigneur de Pépieux un homme que celui-ci aimait grandement. C’est pourquoi ledit seigneur de Pépieux alla prendre un des plus forts châteaux qu’eût le comte de Montfort sur toute la seigneurie de Béziers, le pilla, tua ceux qui étaient dedans, et puis y mit le feu tellement qu’il fut brûlé, et qu’il n’y demeura chose au monde qui ne fût consumée et démolie jusqu’à terre; ce qui fut un grand dommage et perte, causés par le meurtre que j’ai dit. Le comte de Montfort avait fait prendre le gentilhomme qui avait commis le meurtre, et l’avait fait mettre en terre dans une fosse, le faisant ainsi mourir de cruelle et malemort, quoique ce gentilhomme fût de grande marque et lignage. Le sire de Pépieux devait donc s’en contenter; et comme le comte de Montfort lui avait fait justice de son homme, et qu’il ne s’en était pas contenté, le comte Raimond ne le voulut point prendre ni recevoir, mais lui dit qu’il fit du mieux qu’il pourrait, car il ne voulait prendre ni secourir sa querelle.
Quand le comte de Montfort sut que Pépieux lui avait, comme on l’a dit, pris et brûle son château et tué ses gens, il fut si courroucé et irrité que jamais il ne l’avait été autant qu’il le fut alors contre ledit Pépieux; mais il n’y pouvait que faire alors, en sorte qu’il laissa la chose en suspens jusqu’à un autre moment.
Or l’histoire dit que le comte de Montfort avait une place forte en laquelle il avait mis une grosse et grande garnison de ses gens, desquels était capitaine un nommé Bouchard. Ce Bouchard avait en garde ladite place appelée Saissac, et avec lui étaient soixante hommes, tous du pays de France. Bouchard était vaillant homme et entreprenant, et le comte Raimond avait une autre belle place plus forte que Saissac, où il avait aussi son capitaine avec bonne et grosse garnison, car depuis ce que lui avaient mandé le comte de Montfort et le légat, le comte Raimond avait pourvu toutes ses places et châteaux de grosses et bonnes garnisons. Cette place, appelée le château de Cabaret, était assez près de Saissac. Le comte Raimond y avait pour capitaine un nommé Pierre Roger. Un jour, au fort de l’hiver, Bouchard et ses gens délibérèrent d’aller prendre le château de Cabaret, pensant qu’à cette époque personne ne serait sur ses gardes. Ayant donc décidé leur entreprise, ils s’armèrent et montèrent à cheval le plus secrètement qu’ils purent; mais, dit l’histoire, le capitaine de Cabaret était sorti de sa place pour s’ébattre quelque peu, sans penser à cette affaire, ni qu’il vînt des gens pour l’attaquer les gens de Cabaret pouvaient bien être quarante bien armés et bien montes, comme l’étaient les autres, mais, comme je l’ai dit, sans songer à mal, et seulement pour s’ébattre. Bouchard étant donc arrivé sur les gens de Cabaret, croyait les prendre sans obstacle, mais quand ceux de Cabaret virent l’affaire, sans s’ébahir, comme vaillants hommes qu’ils étaient, ils frappèrent sur leurs ennemis, si bien qu’ils les défirent tous, tuèrent et blessèrent, et qu’il ne s’en sauva qu’un seul. Ils prirent Bouchard, leur capitaine, et le menèrent prisonnier à Cabaret, où ils le mirent au fond d’une tour, les fers aux pieds. C’était au grand cœur de l’hiver. Celui qui s’était échappé s’en alla droit au comte de Montfort, lequel était à cette heure en la cité de Carcassonne. Il lui conta toute l’affaire comme elle s’était passée, et comment personne de leur compagnie n’était échappé, si ce n’était lui, car leur capitaine avait été fait prisonnier, et tous les autres tués ou blessés. Le comte de Montfort pensa mourir de douleur quand il sut comment le fait était allé, et il en fut plein de fâcherie et mal content; mais il n’y pouvait rien faire à cette heure, à cause de l’hiver, et il fallait attendre le printemps. Pendant ce temps le comte de Montfort manda par message au légat toute l’affaire et ce qui était arrivé, afin qu’il voulût assembler une croisade au printemps pour venir tirer vengeance de ce que lui avaient fait les gens de Cabaret qui tenaient pour le comte Raimond. L’histoire dit que, pendant que tout cela se faisait à l’insu du comte Raimond, il avait déjà pris son chemin pour s’en aller à Rome vers le saint Père, ainsi qu’on l’a dit, en belle et noble compagnie, dans laquelle était un des capitouls de Toulouse, pour mieux certifier la chose comme elle était, et ce que voulait faire le comte de Montfort avec le légat. Mais premièrement le comte Raimond délibéra de passer en France vers le roi Philippe et les autres princes, pour leur dire le grand tort et outrage que le comte de Montfort lui voulait faire ainsi que le légat.
Il fit tant qu’il arriva en France avec toute sa suite.[2] Il trouva le roi Philippe en compagnie du duc de Bourgogne, du comte de Nevers, de la comtesse de Champagne et autres seigneurs et princes; tous firent bonne chère au comte Raimond et à sa compagnie, surtout la comtesse de Champagne. Le comte Raimond leur dit et montra à tous ce que lui voulaient faire le légat et le comte de Montfort. Quand ils eurent ouï bien au long tout ce que leur avait à dire le comte Raimond, et comment il s’en allait de là à Rome pour se plaindre et montrer la violence que lui voulaient faire le légat et le comte de Montfort, malgré tous les traités faits et passés avec lui, tous lesdits seigneurs et princes furent grandement courroucés contre le légat et le comte de Montfort. Quand le comte Raimond eut un temps séjourné avec le roi et les princes, il prit congé d’eux, tant du roi que des autres, pour s’en aller à Rome, et lesdits princes et seigneurs, le roi lui-même, chacun pour sa part, en écrivirent au saint Père en faveur du comte Raimond, comme si c’eût été leur propre affaire. Il partit et alla vers Rome, et fit tant qu’il y arriva. Quand il y eut demeuré quelques jours, il vint devers le saint Père, avec qui étaient alors beaucoup de cardinaux et autres gens, lesquels reçurent fort honorablement le comte Raimond, qui leur montra le grand tort que le légat et le comte de Montfort lui voulaient faire, malgré tous les traités faits et passés entre eux, Et voici, dit le comte Raimond, un des capitouls de Toulouse qui vous le certifiera mieux pour véritable. Le saint Père ayant donc ouï les plaintes et griefs du comte Raimond et du capitoul, en fut très fâché et marri, vu qu’il lui avait donné auparavant son absolution et s’était accommodé avec lui. Il prit donc le comte Raimond par la main, l’ouït en confession, et quand il l’eut ouï en confession, lui donna encore une fois son absolution en présence de tous les cardinaux et autres, lui fit adorer et baiser la sainte Véronique, et lui donna de nouveau ses lettres de paix et d’absolution.
Quand le comte eut séjourné un certain temps à Rome, il s’en voulut partir et retourner en ses terres; il alla prendre congé du saint Père et des autres. Le saint Père lui donna congé, et, en partant, lui fit don d’un très beau et riche manteau et d’un anneau précieux et de grande valeur qu’il portait à son doigt. Le comte Raimond et sa compagnie firent tant qu’ils arrivèrent à Toulouse, dont tout le peuple fut joyeux et plein d’allégresse, et aussi tout le pays, lorsqu’on sut qu’il était venu et arrivé à Toulouse. Lors donc qu’il eut séjourné un certain nombre de jours, il assembla son conseil et le peuple de Toulouse, leur dit et montra tout ce qu’avait fait avec lui le saint Père, et leur fit voir à tous l’absolution et les lettres de paix qu’il lui avait de nouveau données et confirmées. Il leur fit voir aussi le manteau et l’anneau que le saint Père lui avait donnés à son départ.
Lorsque le peuple eut entendu tout cela, et vu les nouvelles lettres et absolution, il commença à louer Dieu du tout, et il s’éleva dans la ville une telle joie et allégresse qu’on n’en avait jamais vu de pareille, car il leur semblait que Dieu les avait délivrés de tous dangers et maux. Mais cette joie ne dura guère, ainsi qu’on le dira bientôt.
Quand tout ceci se fut passé comme il vient de le dire, le comte Raimond, après avoir séjourné un temps à Toulouse, s’en partit pour aller faire voir par le pays et dans ses villes l’absolution et le traité qu’il avait de nouveau obtenus du saint Père; après l’avoir fait voir, il retourna à Toulouse, et prenant avec lui une noble compagnie, en laquelle était le capitoul qui était allé avec lui à Rome, comme on l’a dit, il s’en alla droit au légat pour lui montrer ce qu’avait fait le saint Père. Quand le légat et le comte de Montfort, qui était avec lui, eurent entendu et vu ceci, ils furent grandement marris et ébahis; mais par semblant montrèrent en être très joyeux et contents; ce qui était le contraire, ainsi qu’ils le firent voir, comme il sera dit. Le légat et le comte de Montfort firent démonstration d’être bons amis et intimes avec le comte Raimond, lui promirent de l’aider dorénavant envers et contre tous, dont le comte Raimond et ses sujets furent grandement réjouis et contents.
Or l’histoire dit qu’en ce temps, pendant que tout ceci se passait, il se trouvait y avoir à Toulouse un évêque, appelé Foulques, lequel élût un très mauvais homme, ainsi qu’il le montra bien à la ville de Toulouse. Cet évêque alla vers le légat, et fit tant, perfas et nefas, qu’il engagea le légat et le comte de Montfort à venir un jour à Toulouse pour se festoyer avec le comte Raimond; et quand le comte eut pendant un certain nombre de jours festoyé le comte de Montfort dans Toulouse, ledit évêque convint avec eux de grande trahison, ainsi qu’il le montra à la fin.
Quand donc le légat eut séjourné dans Toulouse un certain temps avec le comte de Montfort et sa compagnie, ledit évêque montra au comte Raimond de grandes marques d’amour, pensant toujours à la mauvaiseté et à la déception qu’il lui voulait faire, et par un grand artifice, persuada tant le comte Raimond à force de belles paroles, qu’à la fin il lui vint dire: Seigneur, vous voyez le grand amour et amitié qu’il y a à présent entre vous, le légat et le comte de Montfort; je vous promets bien que si aucun voulait à cette heure vous faire mal et déplaisir, ils y mettraient corps et biens pour vous défendre vous et votre pays. Il me semble, seigneur, que pour les entretenir en l’amitié qu’ils ont à présent, si vous bailliez le château de Narbonnois au légat pour y faire sa demeure, vous et la ville n’en seriez que mieux. Le comte Raimond ayant ouï ceci sans penser à aucun mal, ainsi que le faisait le maudit évêque, et sans demander conseil ni avis à ses gens, bailla et délivra, selon la volonté de l’évêque, le château de Narbonnois au comte de Montfort; de quoi il se repentit trop tard; mais, comme on le dit volontiers et en langage ordinaire, qui seul se conseille, seul se repent ; ce qui arriva au comte Raimond; car pour avoir livré le château à la persuasion du dit évêque, il en coûta la vie à plus de mille hommes, sans compter le reste, ce qui fut un grand péché que fit là l’évêque de Toulouse.
Quand le légat eut entre ses mains la seigneurie du château de Narbonnois, il y mit bonne garnison de ses gens pour le garder et défendre si besoin en était, dont tout le peuple de Toulouse, grand et petit, eut grand courroux et déplaisir, voyant que le comte Raimond avait livré de cette manière le château au légat et au comte de Montfort; car ce château faisait toute la défense de la ville et le lieu de refuge du peuple. Le comte Raimond avait agi quasi comme ne sachant ce qu’il faisait et disait; mais l’évêque l’avait tellement enjôlé et abusé par ses paroles, qu’il avait fait cela sans penser au mal qui lui en devait revenir, comme il sera dit en son lieu.
L histoire dit qu’en ce temps le roi d’Aragon vint deçà les monts à Portet, où étaient pour lors le légat et le comte de Montfort, pour traiter plusieurs affaires. Ils parlèrent longtemps ensemble, mais rien ne fut conclu sur ceci, et le roi d’Aragon s’en retourna dans son pays et royaume. Alors étaient avec Le légat et le comte de Montfort l’évêque de Toulouse et celui de Marseille, qui leur conseillaient tous les jours de prendre et saisir toutes les places, villes et châteaux qu’ils pourraient, afin de tenir le monde en crainte et sujétion, et pour en venir à leur but et intention; sous couleur de l’hérésie, ils pillaient et détruisaient le pauvre pays, tant que c’était grande pitié de voir tout le mal et dommage qu’ils faisaient.
Le légat et le comte de Montfort se mirent donc en route avec tous leurs gens, devers Agen et Saint-Bausile, pour prendre quelques places s’ils le pouvaient; mais les gens du pays ne firent pas grand cas d’eux et n’en eurent pas grand peur; pour cette fois ils furent forcés de s’en retourner sans avoir fait ce qu’ils voulaient, et c’était ainsi qu’ils allaient et venaient, mangeant et détruisant le pauvre peuple. Ils tirèrent droit à Carcassonne, où incontinent après leur arrivée ils délibérèrent, puisque là d’où ils venaient ils n’avaient rien pu faire d’avantageux, d’aller mettre le siège devant le château de Minerve, beau et fort château s’il y en avait en ce temps dans tous les défilés qui conduisent en Espagne. Ce château était commandé par un nommé Guiraud de Minerve, homme sage et vaillant; il était situé en un lieu fort élevé et sur une roche comme imprenable. Le légat et le comte de Montfort firent conduire devant maints calabres et pierriers pour tirer contre le château; mais les gens du château se défendaient bien et vaillamment toujours sans rien perdre, faisant un grand dommage au légat et au comte de Montfort, et leur tuant et blessant presque tous les jours du monde; mais enfin on les resserra tant qu’ils ne pouvaient plus sortir, ni faire entrer les choses dont ils avaient besoin l’eau leur manqua à cause des grandes chaleurs qu’il faisait, et tous les jours il en mourait de soif dans la place. Elle fut donc prise, et le légat et le comte de Montfort y firent brûler beaucoup d’hommes et de femmes, car ceux-ci ne se voulaient retirer ni désister de leur folie et de l’erreur où ils étaient alors.
Quand le comte de Montfort et le légat eurent fait tout ce qu’on vient de lire, ils s’en vinrent droit à Penautier, où le comte manda à la comtesse sa femme, laquelle était dans la cité de Carcassonne, qu’au vu des présentes, elle vînt devers lui audit Penautier. Quand la comtesse eut ouï la volonté de son seigneur, comme dame sage elle prit incontinent une belle et noble compagnie tant d’hommes que de demoiselles, et alla devers son seigneur à Penautier, où il était à cette heure, et elle eut grande réception et honneur de chacun; ayant demeuré quelques jours avec son seigneur, elle retourna à Carcassonne avec sa compagnie, et quand elle fut retournée en la cité, le comte et le légat délibérèrent d’aller mettre le siège devant le château de Termes, pour le prendre s’ils pouvaient. Ils firent apprêter et préparer tout ce qui leur était nécessaire. Mais une chose qui chagrinait fort le comte de Montfort, c’était de laisser la cité de Carcassonne sans aucune garde ni garnison. Il fut donc dit et déclaré qu’il y laisserait des hommes pour la garder et défendre s’il était besoin; ce qui fut fait, et la charge et garde en furent données à un vaillant homme, auquel le comte de Montfort se fiait grandement: il s’appelait Verles d’Encontre. Le comte de Montfort lui bailla une noble compagnie pour garder la ville et cité. Lorsque Verles d’Encontre voulut quitter le comte pour s’en aller dans la cité, ainsi qu’il en avait pris la charge, le comte lui dit qu’aussitôt après son arrivée en la cité il fît charger tous ses engins, calabres, mangonneaux et autres, pour les lui envoyer au siège de Termes, et lui donna des lettres pour les porter à la comtesse. Quand le comte de Montfort eut dit à Verles tout ce qu’il avait à lui dire, et lui eut donné ses lettres pour la comtesse, celui-ci prit sa route avec les gens que le comte lui avait donnés pour garder la cité; et quand ils furent arrivés, Verles donna à la comtesse ses lettres, et celle-ci fit incontinent charger force charrettes pour porter à Termes l’artillerie et les engins, ainsi que le lui commandait son seigneur le comte de Montfort. Pendant que Verles faisait charger les charrettes, un espion du capitaine de Cabaret, qui avait tout vu, partit promptement de Carcassonne pour aller trouver le capitaine, à qui il dit et conta comment Verles avait fait charger l’artillerie sur les charrettes pour la faire conduire à Termes. Le capitaine de Cabaret, ayant ouï le récit de l’espion, fit armer bien trois cents hommes des meilleurs qu’il eût dans la place, et quand la nuit fut venue, afin que personne ne les aperçût, il sortit avec eux de Cabaret, et s’en alla s’embusquer et tenir sur le chemin par où devaient venir les charrettes, afin de les surprendre, ainsi que les gens qui les conduisaient. Quand vint le lendemain, Verles fit partir de bon matin l’artillerie pour aller droit à Termes, et quand elle partit, il avisa, comme homme sage, vaillant et expérimenté en telles affaires, de faire aller devant une quantité de gens bien armés et bien montés pour découvrir si par hasard il n’y avait pas quelque embuscade sur le chemin. Il laissa les autres auprès de l’artillerie. Quand donc ceux qui allaient devant vinrent à l’endroit où était l’embuscade, et l’eurent aperçue, ceux de l’embuscade, voyant qu’ils étaient découverts et qu’on approchait d’eux, sortirent de leur cachette et s’en allèrent droit vers les autres pour les attaquer, mais ceux-ci s’en allèrent reculant jusqu’à ce qu’ils fussent près de ceux qui conduisaient l’artillerie, commençant pourtant à frapper en se retirant sur ceux de l’embuscade, et tous se battaient de telle sorte que, si quelqu’un des gens de Verles n’eût été lui dire que ceux de Cabaret étaient sortis sur ses gens, les avaient presque tous tués et pris l’artillerie, et qu’ils y avaient mis le feu, ceux de Cabaret n’en eussent pas laissé un, et tous auraient été tués ou pris; mais sitôt que Verles eut ouï la nouvelle, il fit arriver qui il put, s’arma lui-même, et alla promptement au secours de ses gens qu’il trouva combattant contre ses ennemis dans un pré sur la rive de l’Aude. Verles se fourra au plus fort des ennemis avec ses gens qui étaient tous frais, et frappa tellement de côté et d’autre qu’il en demeura beaucoup sur la place morts ou blessés et couverts de coups. A la fin, il fallut que Pierre Roger et tous ses gens se sauvassent comme chacun put, à cause de la grande multitude de gens qui venaient vers eux du côté de Carcassonne et quand Pierre Roger, capitaine de Cabaret, se fut retiré, comme on l’a dit, Verles d’Encontre fit rentrer l’artillerie dans la cité de Carcassonne, afin de l’envoyer sous meilleure et plus sûre escorte. Quatre ou cinq jours après, Verles fit armer et équiper une bonne compagnie d’hommes courageux, qu’il donna à conduire et à commander à un vaillant homme qu’il avait avec lui dans la cité. Il leur remit l’artillerie pour la conduire à Termes. Ils se mirent en chemin, allèrent droit à Termes, et y conduisirent l’artillerie bien et sûrement sans être attaqués et sans mauvaise rencontre.
Quand le gentilhomme qui la conduisait fut arrivé à Termes, il vint devant son seigneur, le comte de Montfort, et lui présenta l’artillerie. Le comte de Montfort se prit à lui demander pourquoi on avait tant tardé à la lui envoyer: le gentilhomme lui dit la chose comme elle était arrivée de point en point, comment Pierre Roger Tétait venu assaillir sur le chemin, comment Verles étant arrivé de la ville avait déconfit les ennemis et les avait mis en fuite; de quoi le comte fut plus joyeux, que si on lui avait donné la première ville du monde. Le comte dit et raconta toute l’histoire au légat et à tous ceux qui étaient au siège, et tous louèrent Verles d’Encontre de l’exploit qu’il avait fait, dont le légat et les autres se réjouirent grandement. Il y avait à ce siège tant de gens que personne ne le saurait dire ni imaginer; mais avec tout cela, ceux qui étaient dans Termes ne les prisaient ni craignaient guère, car il y avait de vaillantes gens, et forts aux armes, qui se défendaient bien et courageusement; il n’était pas de jour que les assiégés ne sortissent du château pour escarmoucher et combattre, remportant souvent plusieurs enseignes et étendards, et ils se maintenaient et défendaient tellement que le comte de Montfort perdait des hommes considérables, dont il était en grande fâcherie, voyant qu’il ne pouvait prendre cette place et l’avoir à son plaisir. Et il ne l’aurait jamais prise, si ceux qui étaient dedans ne l’eussent désemparée et abandonnée, ainsi qu’il sera dit ci-après.
L’histoire dit qu’il se mit dans le château de Termes une grande et terrible maladie, dont tous les jours il mourait du monde sans fin, tant que c’était grande pitié de voir tout ce qui mourait. Cette maladie était venue parce que l’eau leur avait manqué et s’était tarie, tellement qu’ils n’en avaient pas une goutte; mais pour du vin et autres vivres ils en avaient assez. Il plut un jour, et l’eau tomba en si grande quantité que ceux de la place en remplirent ce qu’ils avaient de citernes, et en mirent dans un grand nombre de vaisseaux; puis ils se prirent à faire ribote de cette eau, et à s’en servir pour faire le potage et apprêter le pain, d’où il s’engendra dans le château une dysenterie telle qu’il n’était aucun d’eux qui, lorsqu’il en était atteint, pût en échapper sans mourir. Un seul en guérit, dont furent fort étonnés ceux du château, non sans raison, car il en mourait tous les jours à foison et sans cesser. Voyant donc la maladie et mortalité qui s’étaient mises dans le château, ceux qui se trouvaient encore allègres et sale, sans que les assiégeants s’en aperçussent; et quand ils eurent dépassé le camp qui les tenait enfermés, ils s’en allèrent en Catalogne; car la plupart d’entre eux étaient Catalans.
Quand ils furent hors de la place, comme on l’a dit, le capitaine, appelé Raimond de Termes, se souvint de quelques effets à lui qui étaient restés dans la place, et retourna pour les chercher; mais aucun des siens ne voulut l’accompagner, et ils firent sagement, et le capitaine fit grande folie d’y retourner, car il lui en coûta le corps et la vie. Comme il se fut mis en route pour retourner, les assiégeants venaient de s’apercevoir que ceux du château s’en étaient allés à leur insu, et ils étaient grandement courroucés et marris de les avoir ainsi perdus. Allant donc et revenant du château au camp, ils rencontrèrent le capitaine tout seul, lequel fut pris et saisi incontinent, et mené au comte de Montfort et aux seigneurs qui étaient avec lui. Le comte fut fort joyeux quand il tint prisonnier devant lui ce capitaine qui lui avait fait tant de mal durant le siège.
Quand donc le comte de Montfort sut tout ce qui s’était passé, vit que la place était vide et sans aucune défense, et le capitaine prisonnier entre ses mains, il s’en alla incontinent avec une grande troupe de gens bien armés et bien équipés vers la place qu’il trouva sans aucune défense ni garde, et en laquelle il entra à son plaisir et sans aucune contradiction, car il n’y avait plus aucun homme, mais seulement une grande quantité de femmes du pays qui s’y étaient retirées avec tout ce qu’elles possédaient. Le comte de Montfort les fit prendre et mettre en lieu sûr, leur donnant de bons, et, honnêtes gardes afin qu’il ne leur fût fait aucun outrage ni déshonneur, et ce fut chose bien faite au comte de Montfort de garder ainsi l’honneur de ces femmes. Après cela, il fit mettre le capitaine Raimond de Termes au fond d’une tour, avec beaucoup de fers aux pieds, et le fit étroitement garder et surveiller. Quand tout le pays d’alentour apprit que Termes était pris et le capitaine prisonnier, comme on l’a dit, plusieurs autres places et châteaux furent abandonnés par les routiers et hérétiques, dont un grand nombre furent pris en s’enfuyant, et brûlés sans pitié ni miséricorde; et, pendant tout ceci, les gens du comte de Montfort prirent un fort château, nommé Alby; ceux qui étaient dedans, ayant ouï dire que Termes était pris, avaient incontinent abandonné la place et s’en étaient allés, dont le comte de Montfort fut très fort content et joyeux, car tout le pays après cela se mit en son pouvoir et en sa main.
Quand tout cela fut fait, le légat manda au comte Raimond que tout incontinent il vînt par devers lui en son concile, qui se tenait à Saint-Gilles en Provence. Le légat, à l’instigation de l’évêque de Toulouse, qui ne cessait de chercher à faire mal, avait assemblé en ce lieu un grand concile contre le comte Raimond pour lui ôter sa terre, nonobstant tous les accommodements qu’on a dits et rapportés. Le comte Raimond y alla comme vrai fidèle et obéissant à l’église, et s’y trouva, n’imaginant pas ce qu’ils voulaient faire. On débattit au long en ce conseil l’affaire pour laquelle il était assemblé. Les uns accusèrent et chargèrent le comte Raimond, les autres le justifièrent, alléguant son accommodement et l’absolution qu’il avait eue du saint Père, et aussi qu’il s’était présenté et se présentait encore comme vrai fidèle, obéissant à l’église, et qu’on ne lui devait pas chercher querelle comme la lui cherchait le légat; que cela était chose mal faite, vu ce qu’il lui en coûtait; et que d’autre part, il avait remis au légat, de son bon gré, vouloir et volonté, le château de Narbonnais de Toulouse, qui était la plus forte place de tout le pays; et que ceci vu et considéré, le légat n’avait cause ni raison de le molester et le perdre, ainsi qu’il le faisait ou voulait faire. Il arriva par là que le concile se sépara pour cette fois sans rien faire; et le comte Raimond, averti de ce qui s’était passe, fit incontinent trousser et charger son bagage, et se mit en chemin pour retourner vers Toulouse, afin d’y donner ordre de pourvoir à toutes choses, car il voyait bien ce que le légat prétendait faire contre tout droit et raison, c’est-à-dire lui prendre malicieusement sa terre, ainsi qu’il en avait délibéré. Comme le comte Raimond s’en retournait vers Toulouse, il trouva et rencontra à Narbonne le roi d’Aragon, son beau-frère, qui venait vers lui pour le voir; et après qu’ils eurent parlé ensemble et se furent festoyés un certain nombre de jours, ils se départirent, et le roi s’en retourna en son pays, bien dolent et plein de fâcherie de ce que son frère lui avait dit et raconté du légat, et de ce qu’il lui voulait faire. Quand donc le légat fut averti que le comte Raimond s’en était allé, il lui manda par un autre messager que tout incontinent et sans retard il eût à se trouver à Arles, où le concile devait se réunir; et le légat manda aussi au roi d’Aragon qu’il eût à s’y trouver sans y contredire, afin de voir et ouïr ce qui serait décidé et ordonné dudit Raimond. Quand le comte Raimond eut vu et entendu le messager qui était de nouveau venu vers lui de par le légat pour lui ordonner de se rendre incontinent et sans retard à Arles pour ouïr ce qui serait dit et déclaré contre lui, il se mit encore une fois en chemin pour aller trouver le légat et se rendre à Arles, toujours comme vrai fidèle, obéissant à l’église; mais quelque obéissance qu’il montrât, toujours le maudit évêque de Toulouse ne cessait de chercher son mal et sa perte; donnant toujours à entendre que tout son pays était plein d’hérétiques, principalement Toulouse et c’était à cause de cela et de ces discours que le pauvre comte Raimond était, si fort persécuté et mal mené qu’on le raconte ici.
Or l’histoire dit que quand le comte Raimond fut arrivé à Arles, il trouva le roi d’Aragon déjà venu et arrivé. Il ne faut pas demander s’ils se firent bonne chère. Quand ils eurent demeuré un jour ou deux, ils allèrent se présenter au légat, lequel leur ordonna qu’ils eussent à ne point partir ni bouger d’Arles sans congé de lui ni de son concile, tant le roi que le comte Raimond, puis les renvoya et leur ordonna de se retirer en leur logis jusqu’à ce qu’il les mandât. Il fut tant procédé en ce concile, qui n’était assemblé que pour l’affaire du comte Raimond, que l’on y résolut ce qu’on va voir, et la résolution fut portée et envoyée au comte Raimond par un député du concile. Ils n’avaient osé la déclarer en audience publique, de crainte d’un soulèvement du peuple, car ils savaient bien que cette résolution était contre Dieu et la conscience. Elle contenait ce qui suit:
Premièrement, que le comte donnera congé incontinent à tous ceux qui sont venus lui porter aide et secours, ou viendront lui en porter, et les renverra tous sans en retenir seulement un seul;
Item, qu’il sera obéissant à l’église, fera réparation de tous les maux et dommages qu’elle a reçus, et lui sera soumis tant qu’il vivra, sans aucune contradiction,
Item, que dans tout son pays il ne se mangera que de deux espèces de viandes;
Item, que le comte Raimond chassera et rejettera hors de ses terres tous les hérétiques et leurs alliés,
Item, que ledit comte baillera et délivrera entre les mains desdits légat et comte de Montfort, pour en faire à leur volonté et plaisir, tous et chacun de ceux qu’ils lui diront et déclareront, et cela dans le terme d’un an;
Item, que dans toutes ses terres, qui que ce soit, tant noble qu’homme de bas lieu, ne portera aucun vêtement de prix, mais rien que de mauvaises capes noires;
Item, qu’il fera abattre et démolir en son pays jusqu’à ras de terre, et sans en rien laisser, tous les châteaux et places de défense;
Item, qu’aucun des gentilshommes ou nobles de ce pays ne pourra habiter dans aucune ville ou place, mais vivront tous dehors aux champs comme vilains ou paysans;
Item, que dans toutes ses terres il ne se paiera aucun péage, si ce n’est ceux qu’on avait accoutumé de payer et lever par les anciens usages.
Item, que chaque chef de maison paiera chaque année quatre deniers toulousains au légat, ou à ceux qu’il aura chargés de les lever;
Item, que le comte fera rendre tout ce qui lui sera rentré des revenus de sa terre, et tous les profits qu’il en aura eus;
Item, que quand le comte de Montfort ira et chevauchera par ses terres ou pays, ou aussi quelqu’un de ses gens, tant petits que grands, on ne lui demandera rien pour ce qu’il prendra, ni ne lui résistera en quoi que ce soit;
Item, que quand le comte Raimond aura fait et accompli tout ce que dessus, il s’en ira delà la mer pour faire la guerre aux Turcs et Infidèles dans l’ordre de Saint-Jean, sans jamais en revenir que le légat ne le lui ait mandé;
Item, que quand il aura fait et accompli tout ce que dessus, toutes ses terres et seigneuries lui seront rendues et livrées par le légat ou le comte de Montfort, quand il leur plaira.
Quand le comte Raimond eut vu et entendu ces conditions, il se prit à rire du grand divertissement qu’il en eut, et les montra à son beau-frère le roi d’Aragon, qui lui dit: Vous en avez pour votre compte. Le comte Raimond donc, sans prendre ni demander congé du légat et du concile, partit d’Arles, prit la route de Toulouse, et le roi s’en alla aussi dans son pays. Dès que le comte Raimond fut arrivé à Toulouse, il fit incontinent une assemblée générale de la ville, tant les petits que les plus grands, et leur dit et montra à tous les conditions du légat, et les leur fit ouïr en plein auditoire, en sorte que tout le monde les entendît mot à mot, et sans qu’il y manquât rien, pas un mot seulement. Quand ces conditions eurent été lues et déclarées, et que le peuple les eut aussi bien entendues, il n’est pas besoin de demander s’ils furent tous courroucés et marris: chacun disait qu’avant d’y consentir il se laisserait écorcher tout vif; et quand le comte Raimond les entendit parler et dire ainsi, et vit d’autre part leur volonté, il fut grandement joyeux et content d’eux.
Tout ceci fait, le comte Raimond, leur seigneur naturel, leur dit qu’il voulait aller à Montauban, Castel Sarrazin, et autres places qui tenaient pour lui, leur dire et montrer ces conditions pour demander et voir ce qu’ils voudraient faire. Il leur dit de tenir bonne garde et songer à leur affaire, afin de ne se pas laisser surprendre, et qu’en peu de temps il reviendrait vers eux. Il partit donc de Toulouse, et s’en alla à Montauban, et quand il y fut, dit aux gens de Montauban et leur déclara les conditions comme il l’avait fait à ceux de Toulouse.
Quand ils eurent entendu ces conditions, chacun d’eux lui dit et déclara que, plutôt que de faire telle chose ou d’y consentir, ils mangeraient leurs enfants; qu’ils avaient bon courage pour se défendre et garder du légat et de ses gens; que seulement le comte voulût tenir leur ville et y mettre garnison, dont le comte Raimond, quand il vit leur volonté, fut très joyeux, et leur en sut très bon gré.
Le comte Raimond voyant le vouloir et les bonnes dispositions de ses sujets, s’en retourna vers Toulouse; de là il écrivit à tous ses amis, alliés et sujets, que chacun voulût lui donner conseil et secours pour garder et défendre sa terre que lui voulaient ôter le légat et le comte de Montfort, et d’où ils le voulaient chasser, comme il le leur mandait tout au long, car il devinait bien ce que feraient le légat et le comte de Montfort, d’autant que toujours l’évêque de Toulouse les envenimait au lieu de les apaiser.
Quand les seigneurs à qui le comte Raimond avait écrit virent et entendirent ce que le légat et le comte de Montfort voulaient faire audit comte Raimond, lequel était grandement aimé et allié de tout le monde, les Basques et les gens de Béarn, et ceux de Comminges vinrent à son appel, et aussi le comte de Foix et les gens du pays de Carcassonne, car il y en avait encore beaucoup, et vint aussi Savary de Mauléon, lesquels arrivèrent amenant beaucoup de monde pour assister le comte Raimond.
C était à l’entrée du carême que le comte Raimond rassemblait tant de monde. Or l’histoire dit que, pendant que le comte faisait ce qu’on vient de dire, le légat envoya vers le pays de France l’évêque de Toulouse, pour prêcher la croisade contre le comte Raimond, qui s’était, disait-il, révolté contre l’église, et avait reçu en ses terres, tous les hérétiques du pays, avec lesquels il voulait faire une grande guerre contre l’église et le légat, ainsi qu’il avait déjà commencé, et avait tué et fait mourir une grande quantité des gens de l’église, ce qu’ayant ouï, quelques seigneurs se croisèrent incontinent pour venir contre le comte Raimond, ainsi que l’avait prêché l’évêque qui, de par le légat et le saint Père, donnait à tous ceux qui se croiseraient l’absolution de tous leurs péchés. Lors se croisèrent le comte d’Auxerre, Robert de Courtenay, et l’évêque de Paris. Ils s’en vinrent vers l’évêque avec une grande armée de gens qu’ils, avaient levés, et tirent tant qu’ils arrivèrent à la cité de Carcassonne avec l’évêque, qui les menait et conduisait, vers le légat et le comte de Montfort, auprès desquels ils furent très bien venus.
Quand Pierre Roger, capitaine de Cabaret, qui tenait en ses prisons le seigneur Bouchard, vit tant de gens venir au comte de Montfort, et aussi que le comte avait tout le pays en son pouvoir, il commença à s’ébahir et avoir peur. Il s’avisa donc qu’il tenait et avait tenu longuement prisonnier ledit Bouchard, et pensa que par son moyen il ferait sa paix et son traité avec le légat et le comte de Montfort, ce qu’il fit; ainsi donc, sans avoir recours à aucun autre, Pierre Roger, capitaine de Cabaret, fit venir Bouchard devant lui, et lui parla en cette manière: Seigneur Bouchard, vous savez que vous êtes depuis longtemps prisonnier sans que jamais homme au monde vous ait secouru ni assisté en chose que ce soit, et vous pourriez y être toute votre vie. Toutefois je me suis imaginé que vous et moi nous pourrions être grandement en la grâce et amitié du légat et du comte de Montfort, c’est à savoir que je remettrai entre vos mains la place et le château pour les tenir au nom du légat et du comte de Montfort, pourvu que vous fassiez avec moi un accord et traité à cette fin que je ne perde rien du mien, et je leur promettrai de les bien servir envers et contre tous. Ce que Bouchard promit de faire en la forme et manière que Pierre Roger lui avait proposée. Tous deux promirent et jurèrent d’observer ledit accord, et incontinent Pierre Roger fit ôter les fers des pieds de Bouchard, qui les avait portés tant qu’il était demeuré prisonnier; lui fit faire la barbe, le fit habiller bien et honnêtement, et l’envoya bien monté et bien accompagné vers le légat, à Carcassonne, où était toute l’armée. Quand le comte vit Bouchard de cette manière, il en fut ébahi, et lui demanda comment il était sorti de Cabaret, Bouchard lui conta toute l’affaire comme elle s’était passée, le comte de Montfort en fut très joyeux et content, et en sut beaucoup de gré à Pierre Roger. Bouchard dit au comte de Montfort: Seigneur, j’ai promis et juré au capitaine que rien du sien ne lui serait ôté, que tout ce qui s’était fait jusqu’ici lui serait pardonné, et qu’il serait pris à votre service; et il m’a promis aussi que, toutes et quantes fois que vous le voudrez, il vous baillera et livrera la place et le château sans aucun refus ainsi avons-nous juré de tenir l’un à l’autre, et d’être dorénavant bons amis. Le légat et le comte de Montfort furent bien contents de faire et ratifier ces conventions en la forme et manière arrêtée entre Bouchard et le capitaine. On en fit les lettres qui furent signées et scellées du seing et sceau du légat et du comte de Montfort. Elles furent envoyées par un écuyer à Pierre Roger, capitaine de Cabaret. Ils lui mandèrent qu’ils allaient venir, dont Pierre Roger fut bien joyeux et content, et fit de grands préparatifs, tant de vivres que d’autres choses nécessaires, pour les recevoir. Le légat et le comte de Montfort partirent donc avec tous les autres seigneurs de l’armée, et allèrent droit à Cabaret pour en prendre possession. Le capitaine les reçut fort honorablement, et les mit dans la place, baillant au légat les clefs de tout le château, comme chef et seigneur de tout, dont le légat et le comte de Montfort le remercièrent bien grandement; et on mit dans la place une bonne et forte garnison pour la garder et la défendre s’il était besoin.
Tout ceci fait, comme on vient de le dire, beaucoup d’autres places se rendirent et se mirent, ainsi que presque tout le pays, entre les mains du légat et du comte de Montfort. Le légat s’en vint donc avec toute son armée devers Lavaur pour s’en emparer. Cette cité appartenait alors à une dame appelée Guiraude, qui avait un frère, homme vaillant et hardi, appelé Aymeri (Amaury), seigneur de Mont-Réal et de Laurac-le-Grand ; mais le légat et le comte de Montfort lui avaient enlevé et pris ces deux places, et lui avaient tué tous ses hommes, si ce n’est un petit nombre qui lui était demeuré: ce pourquoi Aymeri s’était retiré à Lavaur, devers sa sœur, avec une grande et bonne troupe qu’il avait formée. Le légat et le comte de Montfort arrivèrent donc devant Lavaur avec toute leur armée et y mirent le siège, car la ville était forte et grande, et bien entourée de fossés profonds ; ce pourquoi le légat fut obligé de mettre le siège à l’entour. Mais il y avait dedans de bons et vaillants hommes, qui se défendaient bien contre le légat et son armée, lesquels tinrent le siège plus de six mois sans avancer le moins du monde, car alors les vivres étaient si rares qu’on n’en pouvait trouver pour argent, parce que les gens de Toulouse tenaient les passages fermés, tellement que les assiégeants ne pouvaient guère tirer du pays, et qu’ils souffraient beaucoup de mal de faim, et, comme on l’a dit, Aymeri était dans Lavaur.
Or l’histoire dit que, pendant que le siège était devant Lavaur, une grande armée d’Allemands, qui était bien de six mille hommes, arriva pour donner secours au légat et au comte de Montfort. Ils s’allèrent loger à Mont-Joyre ou à l’entour, les uns près, des autres, car ils marchaient serrés, étant en pays ennemi. Quelqu’un qui avait vu et épié lesdits Allemands s’en vint à Toulouse, où était pour lors le comte Raimond avec un grand corps de seigneurs et de gens, et ou était aussi le comte de Foix, homme vaillant et entreprenant, ainsi qu’il le fit voir: l’espion s’alla adresser au comte de Foix, et lui dit comment il avait vu les Allemands qui s’étaient logés à Mont-Joyre. Quand le comte de Foix eut ouï l’espion, incontinent et sans autre demeure il fit aller ses gens, par une belle nuit, à Mont-Joyre; et comme ils marchaient, les gens du pays, quand ils surent ce que c’était, se mirent avec le comte de Foix pour aller défaire les Allemands. Ils vinrent donc s’embusquer dans la forêt que les Allemands devaient traverser pour aller à Lavaur; et, comme on l’avait entendu dire, le lendemain matin, au soleil levant, les Allemands délogèrent et tirèrent droit vers Lavaur, en passant par ladite forêt; mais ils n’avaient guère fait de chemin que le comte de Foix et tous ses gens tombèrent sur eux, et commencèrent de telle sorte à frapper sur lesdits Allemands, qu’il ne s’en échappa qu’un seul; tous les autres furent tués, blessés ou pris, et le comte de Foix et les gens du pays y gagnèrent de grandes richesses. Quand ce fut fait, le comte de Foix tira droit à Mongiscard avec le butin qu’il avait fait, et les gens du pays s’en retournèrent chacun en son endroit. Celui des Allemands qui s’était échappé, et ce fut une grande chose qu’il ne s’en pût sauver qu’un seul, s’en alla au siège de Lavaur, devers le légat et le comte de Montfort, leur dire et raconter la grande déconfiture qui leur était survenue à Mont-Joyre par le comte de Foix et ses gens, et que si on n’allait promptement leur donner secours, tout était perdu ou tué; ce qu’ayant ouï le légat et le comte de Montfor??est les morts et les blessés, et c’était une grande pitié que de voir un tel massacre de gens. Le comte de Montfort fut très désespéré quand il vit ce qu’avait fait le comte de Foix. Il fit charger sur force charrettes ceux qui étaient blessés, et non pas morts, et les fit porter au siège pour les faire panser et guérir, mais beaucoup en moururent, et le comte de Montfort demeura à Mont-Joyre pour faire enterrer les morts, afin que les bêtes ne les mangeassent pas.
Tout ceci fait, comme on l’a dit, le comte de Montfort s’en retourna au siège avec ses gens, si marri et courroucé qu’il ne le pouvait être davantage, et lorsqu’il fut arrivé au siège, il fit incontinent apprêter ses gens pour donner l’assaut à la ville, afin de se venger de ce que le comte de Foix lui avait fait à Mont-Joyre, ce qui fut environ la fête de la Sainte-Croix de mai. Tous les gens étant prêts, le comte de Montfort fit préparer la guate, ce qui était un engin pour lancer des pierres et abattre des murailles. Il la fit incontinent amener et tirer dans les fossés, et fit commencer à donner l’assaut, qui fut très âpre. Ils se mirent les uns à miner les murailles et les tours, les autres à escalader pour entrer dedans, et firent tellement qu’ils entrèrent à toute force et s’emparèrent de la ville, nonobstant la défense que firent ceux qui étaient dedans, car il y avait de bons et vaillants hommes; et il en coûta beaucoup de gens au comte de Montfort avant qu’ils pussent entrer. Quand ils furent dedans et eurent pris la ville, ils firent une telle tuerie, un tel carnage, tant d’hommes que de femmes et de petits enfants, qu’ils ne laissèrent rien à mettre à mort, tant ils étaient courroucés de ce qui s’était fait à Mont-Joyre. Mais un noble homme, ainsi qu’il le montra bien, lorsqu’il vit cette tuerie, alla vers le comte de Montfort, et lui demanda qu’il lui voulût donner les dames qui s’étaient sauvées en un certain Heu avec leurs petits enfants, et le comte les lui donna pour en faire à son plaisir et volonté; lors ledit seigneur, comme noble homme qu’il était, alla prendre toutes ces femmes, tant vieilles que jeunes, et les donna en garde à une quantité de gens, leur défendant, sous peine de mort, de causer déshonneur à aucune d’elles, vieille ni jeune, et leur ordonnant qu’ils les gardassent bien et honnêtement de tout mal et dommage: ce qui fut fait.
Le comte de Montfort fit prendre bien quarante hommes des plus apparents de la ville, et les fit tous brûler hors la ville. Il fit prendre aussi Aymeri, frère de dame Guiraude, dame de Lavaur, et avec lui bien quarante chevaliers et gentilshommes, qu’il fit tous pendre et étrangler sur un gibet qu’il fit faire devant Lavaur, et il en fit faire un plus haut que tous les autres, auquel il fit attacher et pendre Aymeri, comme le plus grande tous ensuite il fit prendre la dame de Lavaur, la fit descendre toute vive dans un puits, et fit jeter sur elle tant de cailloux qu’elle en fat toute couverte, et la fit ainsi mourir de malemort dans le puits. Quand tout ceci fut fait, et que tous ceux qui étaient dans Lavaur furent tués ou morts, sans qu’il en restât un seul en vie pour échantillon, ce qui fut un plus grand massacre que celui de Mont-Joyre, le seigneur qui avait demande les dames et les avait baillées en garde à ses gens leur donna congé de s’en aller là où il leur plairait, sans leur faire mal ni vilainie; ce qui fut une grande action de noblesse et courtoisie faite par ce seigneur à ces femmes. Toute la ville fut pillée sans y rien laisser, et on y trouva une grande richesse. Il y ait en la compagnie du comte de Montfort un homme riche et puissant, qui s’appelait de son nom Raimond de Salvagnac; il était de Cahors: c’était un marchand qui avait fourni de for les sommes d’argent, en sorte que le comte lui était redevable de très grosses sommes; il lui donna en paiement toute la dépouille de Lavaur, d’où il eut une très grande et inestimable richesse.
Or l’histoire dit que quand tout ceci fut fait, comme je l’ai rapporté, le comte de Montfort prit tout le pays, places et châteaux d’alentour, dont il eut maintes et immenses richesses. Il alla droit au château de Montferrand, que tenait le frère du comte Raimond, appelé Baudouin, lequel était homme vaillant et hardi. La place n’était pas des plus fortes; il fit mettre le siège devant, et donna ensuite l’assaut pour la prendre s’il pouvait, mais le comte Baudouin, ni ceux qui étaient dedans, ne s’ébahirent de leur assaut ni de leur siège; mais ils se munirent et préparèrent bien pour défendre le château; on nommait ceux qui étaient avec le comte Baudouin dans la place: c’étaient le vicomte de Monclar, et un autre gentilhomme appelé Pierre, et Ponce Leroux de Toulouse, et Hugues Dubreuil, et Saint-Spasse, Raimond de Périgord, et autres, au nombre de quatorze seulement; mais c’étaient des hommes vaillants, ainsi qu’ils le montrèrent au comte de Montfort et à ses gens. Le comte (il donc mener, pour donner l’assaut, des calabres, pierriers, et autres engins pour abattre le château, et on commença à donner l’assaut; ils étaient plus de quatorze mille hommes; mais ceux de dedans se défendirent tellement qu’ils leur brisèrent et rompirent tous leurs pierriers et trébuchets, en telle sorte que ces engins ne furent plus jamais en état de servir. Ils firent tellement reculer les assiégeants hors des fossés où ils étaient entrés, qu’il en demeura beaucoup sur la place de cette première attaque, si bien qu’ils n’eurent plus envie de les assaillir. Quand le comte de Montfort vit qu’ils lui avaient ainsi rompu et brisé ses engins, lui avaient tué ses gens et les avaient repoussés de l’assaut, il fut grandement ébahi, considérant que la place n’était pas des plus fortes. Il s’informa donc de ceux qui étaient dedans; il lui fut dit que le frère du comte Raimond était capitaine de la place, et Montfort imagina qu’il n’était pas possible qu’il n’eût avec lui de vaillantes gens pour se défendre. Il manda donc au comte Baudouin, capitaine de la place, que, sur sa parole et foi de gentilhomme, il vînt lui parler. Baudouin, ayant ouï cette parole, sortit du château avec un de ses gens seulement, laissant les autres dedans et vint droit au camp et au logement du comte de Montfort; celui-ci le reçut honnêtement et gracieusement; les salutations faites de part et d’autre, le comte de Montfort se prit à dire au comte Baudouin qu’ils avaient tous grande compassion de lui, ainsi que des gens qui étaient avec lui dans la place, car il lui semblait que son frère ne l’aimait guère, vu la place où il l’avait mis ainsi que ses compagnons; qu’il faisait bien voir qu’il les voulait faire mourir, car ladite place n’était pas forte ni de défense; que d’après tout cela, il serait obligé de se rendre à la fin, vu que tout le reste du pays, les places et les châteaux étaient tous entre ses mains, à lui comte de Montfort; qu’il consentait à ce que le comte Baudouin, et les gens qu’il avait avec lui dans le château s’en allassent vie et bagues sauves, pourvu que le comte Baudouin promît et jurât que jamais il ne s’armerait contre le comte de Montfort, et n’irait contre lui ni directement ni indirectement: et le comte de Montfort lui promit que s’il voulait se ranger et tenir avec lui, il lui donnerait des terres et seigneuries pour s’entretenir selon son état, et lui ferait part de tout ce qu’il gagnerait; ce que le comte de Montfort taisait pour avoir meilleur prétexte d’attaquer le comte Raimond. Quand le comte de Montfort eut dit et exposé tout ceci, le comte Baudouin consentit de taire en tout selon que lui avait dit et proposé le comte de Montfort, et de lui bailler et délivrer la place et château; ils jurèrent et promirent des deux côtés ce qui était convenu. Le comte Baudouin bailla donc et délivra la place au comte de Montfort, s’en alla avec tous ses gens devers son frère le comte Raimond, et lui conta la chose ainsi qu’elle s’était passée. Quand le comte Raimond eut ouï cette affaire, il en eut si grande fâcherie que, s’il eût perdu toute sa terre, il n’eût pas été si marri ou courroucé; il leur dit donc qu’ils s’en allassent où ils voudraient et s’ôtassent de devant lui, et dit à son frère qu’il ne vînt ni ne se trouvât plus en lieu où il serait, que jamais il ne voudrait plus rien de lui puisqu’il s’était allié et accordé avec son ennemi mortel, et, ce qui était le pire, lui avait fait serment de fidélité. Après avoir dit ces choses à son frère, le comte Raimond s’en alla si courroucé et mal content que nul n’osait se montrer devant lui. Le comte Baudouin s’en alla à Bruniquel, qui appartenait à son frère, le comte de Montfort tira vers Rabastens, Gaillac, Montagut, qui se rendirent et donnèrent à lui; se rendirent également Lagarde, Puicelsi, Laguépie, Saint-Antonin: tout le pays se mit entre les mains et sous la domination du comte de Montfort. L’évêque d’Albi fut cause de toute cette soumission du pays, car il avait grandement travaillé pour le comte de Montfort, le pays étant tout plein d’hérétiques, Montfort voulut aller mettre le siège devant Bruniquel pour le prendre, mais le comte Baudouin vint devers lui et son armée, et demanda cette place à Montfort, car il n’avait pas d’autre lieu pour se retirer et demeurer Montfort la lui donna et octroya pour en faire à son plaisir et commandement.
Or l’histoire dit que pendant que toutes ces choses se passaient, vint et arriva le comte de Bar avec une grande armée qu’il amenait pour donner secours au légat et au comte de Montfort. Le comte de Bar arriva et se logea à Mongiscard. Le comte de Montfort alla à Mongiscard trouver le comte de Bar, en belle et noble compagnie, le reçut, et après avoir séjourné à Mongiscard quatre ou cinq jours, ils en partirent et allèrent droit à l’autre armée, qui était, comme on l’a dit, au pays albigeois; lorsqu’ils l’eurent rejointe, ils tinrent conseil, comme on l’a dit, au pays albigeois, et décidèrent qu’ils viendraient mettre le siège devant Toulouse pour prendre la ville et en chasser le comte Raimond, car le légat et le comte de Montfort ne cherchaient qu’à avoir la guerre avec le comte Raimond, de quoi il était bien averti, et s’était pourvu de bonne heure de monde, parce qu’il lui fallait se défendre contre le légat et le comte de Montfort.
Le légat, les comtes de Montfort et de Bar, et d’autres, ayant parlé et délibéré ensemble en leur conseil, firent sans aucune demeure ce qu’ils avaient résolu; pendant qu’ils se préparaient et se mettaient en chemin, un espion, qui les avait vu faire, vint promptement à Toulouse devers le comte Raimond, auquel il dit et déclara tout ce qu’il avait vu et ouï, comment l’armée venait pour prendre Toulouse, et qu’ils pouvaient bien être près de Montaudran, car ils venaient par ce côté, afin de n’être pas aperçus. Quand donc le comte Raimond et les comtes de Foix et de Comminges, et beaucoup d’autres, eurent ouï ainsi parler le messager, ils en eurent grande joie, car ils ne désiraient autre chose que de se battre avec leurs ennemis; chacun donc, ainsi qu’il fut ordonné, s’arma et accoutra, et quand ils furent armés et accoutrés, ils se trouvèrent bien cinq cents chevaliers tous bien pourvus d’armes offensives et défensives, et bien montés, sans compter les autres gens de pied, tant de la commune de Toulouse que du dehors, dont il y avait un nombre infini, si bien qu’il paraissait que tous les gens du monde y fussent assemblés. Il sortit donc de Toulouse une belle compagnie en noble ordonnance, bien rangée et serrée, tant les gens de pied que de cheval, et marchèrent droit à Montaudran, bannières déployées; quand ils furent arrivés à Montaudran, ils se jetèrent sur ce point, les uns d’un côté, les autres d’un autre, et s’attaquèrent tellement pour l’emporter qu’il en passa beaucoup par le tranchant de l’épée, tant d’un parti que de l’autre, et qu’on ne savait qui avait du meilleur ou du pire. Quand le comte Raimond vit ce qui venait et arrivait continuellement de monde au comte de Montfort, il commença à faire retirer ses hommes dans le meilleur ordre qu’il fut possible, et ils reculèrent vers la ville toujours frappant et se battant, quand ils se virent près de la ville, ils se retournèrent contre leurs ennemis, et frappèrent si bien sur eux qu’en cet endroit ils en tuèrent bien vingt-trois; le fils du comte de Montfort, appelé Bernard, y fut pris: on le conduisit dans la ville de Toulouse, et on en tira une grande rançon et richesse; cette prise faite, ils se retirèrent dans la ville de Toulouse; et quand le comte de Montfort ouït dire que son fils avait été pris et conduit à Toulouse, il pensa enrager de colère et de tristesse. Voyant aussi que ceux de Toulouse avaient tué en se retirant beaucoup de ses gens, de grande colère et courroux il fit mettre le siège devant Toulouse; après avoir mis le siège, il tint conseil avec le comte de Bar et le légat, et le comte de Châlons qui était aussi venu à son secours, et ils délibérèrent d’aller donner l’assaut à la ville de Toulouse pour voir s’ils la pourraient prendre et conquérir. Ceux de la ville ne s’en ébahirent guère, mais ils munirent bien leur ville, ainsi qu’il était nécessaire en telle occasion, et chacun se mit en défense, car ils étaient gens vaillants à la défense s’il y en avait au monde, ainsi qu’ils le montrèrent bien au comte de Montfort et à ses gens. On dit volontiers que tel pense venger sa honte qui l’accroît: c’est ce qui arriva au comte de Montfort et à ses gens. Ils vinrent donc à couvert sous de grands boucliers de cuir bouilli, et commencèrent à donner l’assaut âprement et sans être ébahis; mais ceux de la ville, comme des loups enragés de faim, sortirent bien armés et en bonne ordonnance, et vinrent frapper sur leurs ennemis, tellement que de première arrivée ils en tuèrent plus de deux cents, en blessèrent autant et plus, prirent cinq de leurs boucliers de cuir bouilli, et les firent grandement reculer au-delà du camp de siège; le comte de Foix eut son cheval tué entre ses jambes on lui tua aussi un homme vaillant et hardi appelé Raimon et de Castelbon, qui fut fort regretté de tous ceux de la ville, car c’était un homme sage et vaillant. Ils se retirèrent pour cette fois chacun de son côté, car la nuit les surprit; et quand le comte de Montfort vit qu’ils l’avaient ainsi rejeté hors de son camp et lui avaient tué ses gens, il en fut fort mal content et courroucé; mais il n’y pouvait que faire. Quand il vit qu’il ne se pouvait venger de ceux de la ville, il fit armer une grande quantité de ses gens pour aller abîmer et détruire toutes les vignes et tous les blés alors sur terre, et ce fut grande pitié de voir le mal qu’ils firent aux blés et aux vignes, car ils mirent tout à sac, et firent rompre et couper les vignes pour en faire de gros fagots, afin de combler les fossés de la ville.
Fendant que tout cela se passait, il y avait dans la ville un nommé Hugues d’Alfar, lequel était sénéchal d’Agénois, et aussi y était un de ses frères appelé Pierre d’Arsis; ils avaient en leur compagnie beaucoup de gens vaillants; quand ils virent que les ennemis gâtaient ainsi et détruisaient les vignes et les blés, ils s’armèrent tous et s’en vinrent pour sortir sur eux. Le comte Raimond en étant averti vint à la porte par où ils voulaient sortir, et se mit en courroux de ce qu’ils voulaient ainsi sortir sur les ennemis, car il avait peur qu’ils ne le voulussent trahir. Quand ceux de la ville virent ceci, ils vinrent armés, accoutrés et bien montés, se joindre au sénéchal; et que le voulût ou non le comté Raimond, ils sortirent de la ville en bon ordre et bien serrés, et s’en allèrent attaquer le camp des assiégeants, de telle façon et manière qu’ils semblaient plutôt des diables sortis d’enfer que non pas des hommes. Ils rencontrèrent en arrivant un des gens du comte de Montfort, appelé Eustache de Canits, vaillant homme et fort aimé du comte de Montfort, et ils le tuèrent, et ils commencèrent à frapper de mieux en mieux, tellement que rien ne demeurait devant eux, que tous étaient tués ou blessés, et que c’était grande pitié de voir le carnage qu’ils faisaient des gens du comte de Montfort; et quand le comte de Foix vit que ses compatriotes se comportaient si bien et si vaillamment, il fit armer tout son monde, comme Béarnais, Navarrins et autres, tous braves hommes, sortit de la ville avec eux tous, et s’en alla joindre les autres qui se battaient. Quand ils furent tous rassemblés il leur prit encore plus grand courage que devant, et s’ils avaient bien frappé d’abord, ils allèrent bien mieux encore quand ils virent le secours que leur amenait le comte de Foix, et tous ensemble ils firent de sorte que tout était tue ou blessé, et que c’était grande pitié de voir comment il les menaient. Quand les gens qu’avait amenés le comte de Bar virent cette déconfiture, ils commencèrent à crier tant qu’ils purent: A Bar! A Bar! Afin qu’on leur donnât secours; ceux qui étaient allés aux vignes et blés commencèrent d’arriver, et toute l’armée aussi se mit en mouvement quand elle entendit le bruit et le cri qu’avaient faits les gens du comte de Bar. Ceux de la ville voyant venir tant de monde, se contentèrent pour cette fois de ce qu’ils avaient fait dans cette sortie, et commencèrent à se retirer dans la ville avec ce qu’ils avaient pris et gagné. Quand le comte de Montfort vit le grand mal et dommage que lui avaient fait et lui faisaient tous les jours ceux de Toulouse, en lui tuant et blessant ses gens, il en fut à moitié désespéré d’autant qu’il n’y pouvait apporter remède; et d’autre part la disette était si grande au siège, qu’il n’était personne qui la pût supporter, car on payait deux sols un petit pain de ceux dont un homme aurait bien mangé cinq ou six à un repas sans être trop repu ni rassasié.
Voyant donc tout cela, et qu’ils ne pouvaient tirer vengeance de ceux de la ville, ils délibérèrent de lever le siège et de s’en aller détruire toute la comté de Foix sans y laisser chose au monde; mais avant de lever le siège ils allèrent achever de détruire toutes les vignes et blés qui étaient demeurés sur pied, afin que ceux de la ville ne s’en pussent aider ni servir; quand ils l’eurent fait, ils levèrent le siège et plièrent bagage à leur grande confusion et déshonneur et avec grande perte de leurs gens, et allèrent droit à la comté de Foix, parce que le comte de Foix, qui était dans la ville de Toulouse avec le comte Raimond, leur avait fait beaucoup de mal, tant au siège qu’à Mont-Joyre. Quand le siège fut levé, comme on l’a dit, le comte de Châlons prit congé du légat et des autres pour s’en retourner en son pays, car il voyait bien que le légat et le comte de Montfort n’avaient point bonne cause ni querelle pour manger le monde ainsi qu’ils le faisaient; ce qu’il leur montra bien et dûment, exhortant le légat et le comte de Montfort à faire quelque bon traité avec les seigneurs qui étaient dans la ville. Le comte de Bar les en pria aussi. Ils étaient quasi tous d’accord de faire quelque bon traité, car chacun s’ennuyait de demeurer tant de temps de la sorte sans avoir aucun repos. d’autre part ils voyaient tous les jours mourir beaucoup de leurs gens, et quelques-uns savaient bien qu’ils n’avaient pas trop bonne querelle ni bon droit pour détruire ainsi le pays haut et bas, comme ils le faisaient. Le comte de Montfort et le légat se seraient volontiers accommodés, n’eût été le maudit évêque de Toulouse qui toujours empêchait l’accommodement, disant que toute la ville de Toulouse et les terres du comte Raimond étaient remplis d’hérétiques; ce qui fut cause d’une grande destruction de gens et un grand péché et méfait audit évêque, car la plus grande partie des seigneurs et barons de l’armée voulaient bien que l’accommodement se fît, et il leur pesait fort de demeurer plus longtemps ainsi, vu que telle guerre n’était ni juste ni raisonnable. Le comte de Châlons prit donc congé, de tous les seigneurs et barons et s’en retourna dans son pays.
L’armée tira vers la comté de: Foix, où elle fit de grands maux et ravages, car partout où elle passait elle ne laissait rien de ce qui était sur terre, mais détruisait et gâtait tout et quand elle eut séjourné un temps dans la comté de Foix, elle fut obligée d’en partir, car l’hiver était venu et commençaient les grands froids; force lui fut de s’en retourner et de laisser la comté, car elle n’y pouvait plus tenir ni demeurer à cause du grand froid qu’il y faisait.
Ils se retirèrent donc comme on vient de le dire: le légat vers Rocamadour avec une partie de l’année, et le comte de Montfort vers la cité de Carcassonne avec une autre partie. Comme le légat s’en allait à Rocamadour, il passa à travers le pays qui est en avant de Casser, près Saint Félix de Caraman. Là il fut averti par quelques-uns qu’il y avait dans une tour quatre-vingts ou cent hérétiques que les gens de Roqueville y avaient mis pour la garder et la sauver. Le légat alla avec ses gens donner l’assaut à cette tour, la prit ainsi que ceux qui étaient dedans, les fit tous brûler, et fit abattre et raser la tour ainsi que tout le bourg de Casser, sans y rien laisser. Quand il eut ainsi fait, il se retira à Rocamadour, et y passa tout l’hiver sans en bouger ni mouvoir.
Le printemps venu le comte de Montfort partit de Carcassonne et se rendit à Rocamadour pour aller chercher le légat et l’armée. Quand ils eurent séjourné un temps à Rocamadour, ils en partirent et vinrent à Gaillac et à Lavaur, mais le légat se sépara du comte de Montfort et passa à Albi et à Saissac, tandis que le comte passait, comme on l’a dit, à Gaillac et à Lavaur, et de là à Carcassonne pour y attendre le légat, car il voulait aller en Provence, ainsi qu’ils en avaient délibéré entre eux à Rocamadour.
Or l’histoire dit que pendant tout ceci et pendant que le légat allait et revenait, le comte Raimond fut averti, et que, ne pouvant savoir où les autres devaient aller frapper, il voulut se tenir prêt, afin qu’ils ne le surprissent pas au dépourvu et sans secours. Il manda donc à tous ses amis, alliés et sujets, que chacun lui voulût venir donner secours pour garder ses terres et la cité de Toulouse, car le légat et le comte de Montfort avaient de nouveau fait marcher leur armée et s’étaient mis aux champs, sans qu’on pût prévoir où ils voulaient s’attaquer; mais qu’il se doutait bien qu’ils voulaient venir sur lui, comme ils avaient fait l’autre fois; qu’il les priait donc de venir le plus tôt qu’ils pourraient. Quand ils eurent ouï le message du comte Raimond et vu les lettres, ils se mirent en chemin pour venir devers lui à Toulouse où demeurait et les attendait le comte Raimond, si grand fut le nombre des gens qui vinrent et arrivèrent pour donner secours au comte Raimond, que personne ne les saurait nombrer; et entre autres vint à son secours un nommé Savary de Mauléon, homme vaillant et sage, avec une belle et bonne compagnie de Gascons et autres gens fort adroits et vaillants; lequel Savary fut très bien accueilli par le comte Raimond et les autres seigneurs qui étaient avec lui; et quand tous ses gens furent réunis, ils se trouvèrent bien plus de deux mille en bon état et bien armés. Lorsqu’ils furent assemblés, ainsi qu’on l’a dit, ils délibérèrent entre eux, voyant que le comte de Montfort ni le légat ne venaient sur eux, d’aller assiéger le comte dans Carcassonne. Le comte Raimond fit donc charger une grande quantité de charrettes et de botes de somme de vivres et autres choses dont il avait besoin au siège. Il fit d’autre part charger des calabres, pierriers, trébuchets et toutes sortes d’engins, pour tirer contre la ville de Carcassonne, si elle ne voulait pas se rendre; puis ils se mirent en chemin, et tirèrent droit vers Carcassonne.
Le comte de Montfort fut averti de tout ceci, et que le comté Raimond avait la plus grande armée qu’on eût jamais vue, dont il fut fort ébahi, et non sans cause; d’autre part il sut que le comte Raimond faisait apporter une grande quantité d’engins pour battre et renverser les murs de Carcassonne. Il manda donc par tout le pays, et aussi aux garnisons, qu’il fallait que chacun se retirât devers lui à Carcassonne, et qu’il y avait grande hâte. Il manda aussi tous ses amis et alliés, lesquels vinrent devers lui; et quand ils furent tous assemblés à Carcassonne, ils tinrent conseil sur cette affaire, pour savoir s’ils devaient attendre le comte et son armée dans Carcassonne, ou ce qu’ils devaient faire; et il demanda que chacun voulût le conseiller et lui dire son avis. Un sage et vaillant homme, appelé Hugues de Lastic, lui répondit et lui dit: Seigneur, mon opinion n’est pas que vous vous teniez ici renfermé; mais, si vous me voulez croire, vous irez là dehors vers Fanjaux, les attendre et demeurer avec tous vos gens au plus petit et faible château que vous ayez dans ces quartiers. Cette opinion sembla bonne au comte de Montfort et à tous les autres, pour montrer qu’ils ne craignaient guère le comte Raimond, et fut fait ainsi que l’avait dit le seigneur de Lastic. Le comte de Montfort fit incontinent préparer et armer tous ses gens, et les fit marcher en belle ordonnance vers Castelnaudary, comme la place la plus faible qu’il eût en ce temps dans toute sa terre et seigneurie, et là il attendit avec tous ses gens l’arrivée de ses ennemis.
vingt hommes bien armés et bien montés, et vaillantes gens; tous vinrent trouver le comte de Montfort à Castelnaudary. Tandis qu’ils s’assemblaient, était venue au comte de Montfort une autre compagnie de gens bien armés et accoutrés, que lui amenaient l’évêque de Cahors et celui de Castres, lesquels venaient avec une bonne et grande armée soutenir le comte de Montfort.
Tandis que tous ces gens venaient ou se préparaient à venir, un messager arriva au comte de Foix, qui était au siège avec le comte Raimond, et lui dit comment il arrivait au comte de Montfort, vers le pays de Carcassonne, une grande quantité de vivres. Quand il eut ouï ce messager, il s’arma incontinent sans rien dire à personne, fit armer la plus grande partie de ses gens, et alla s’embusquer entre les Bordes et Castelnaudary pour y attendre ces vivres qui devaient passer. Comme on sut dans le camp que le comte de Foix s’en était allé pour enlever les vivres, la plupart des assiégeants s’armèrent et allèrent après lui car chacun désirait d’être en sa compagnie, parce qu’il était le plus entreprenant de tous et le plus aventureux, en sorte qu’il ne demeura que peu de monde au siège, car il n’y restait que Savary de Mauléon.
Or l’histoire dit que pendant que le comte de Foix s’était allé mettre en embuscade avec tous ses gens, le seigneur Bouchard venait de Lavaur avec tous les siens; quand il fut près de Castelnaudary, il mit ses gens en bon ordre, et les fit marcher bien armés et bien serrés, et l’œil au guet; car, comme il était sage et vaillant homme, il se doutait de ce qui lui pouvait arriver, et il se fit précéder par ses éclaireurs pour découvrir s’il y avait par là quelqu’un d’embusqué. Lorsque les éclaireurs furent arrivés près de l’embuscade, l’ayant aperçue, ils reculèrent vers la compagnie et le capitaine, et dirent à Bouchard qu’ils avaient vu cette embuscade, que la troupe était forte, et ils lui dirent aussi où elle était. Bouchard ayant ouï ceci, fit serrer encore plus ses gens, leur dit et montra qu’il n’y avait pas de remède, sinon de bien faire tous tant qu’ils étaient, et de se défendre du mieux qu’ils pourraient, de ne s’en pas inquiéter, et d’avoir bon courage. Quand le comte de Foix vit et reconnut qu’il était découvert, il sortit de son embuscade avec tous ses gens, et s’en alla tomber droit sur Bouchard et les siens, en telle sorte et manière que qui l’aurait vu aurait dit que le monde allait prendre fin, tous tombaient tellement, les uns morts, les autres blessés, que c’était grande pitié de les voir, car le comte de Foix ne cessa d’abattre et tuer gens; aussi tous ceux qui le voyaient venir lui faisaient place, car ils ne pouvaient endurer ni supporter la grande frayeur qu’il leur faisait, vu que c’était un des plus vaillants hommes qui se pût trouver alors dans tout le monde: c’est pourquoi chacun le voulait fuir, et il fit tellement que Bouchard fut forcé de se retirer le mieux qu’il put ou sut, avec ce qu’il avait sauvé ou conservé de gens, quoiqu’on lui en eût tué ou blessé beaucoup. Après cela, le comte de Foix, non content de ce qu’il avait fait à Bouchard et à tous ses gens, alla attaquer une grande compagnie de croisés français en garnison aux Bordes, elle premier arrivé, Guiraud de Pépieux, rencontrant un des croisés, gentilhomme et vaillant homme, lui donna un tel coup de lance qu’il le perça d’outre en outre; et quand il eut donné ce coup de lance, il commença à crier: Foix ! Foix ! Toulouse! et à les frapper de telle sorte qu’il les mena tuant et blessant. Mais le comte de Montfort, ayant appris comment le comte de Foix lui tuait ses gens aux Bordes, y envoya Bouchard avec une grande compagnie pour les secourir contre ledit comte, qui, lorsqu’il sut qu’un grand secours arrivait aux ennemis du côté de Castelnaudary, laissa les gens des Bordes, et alla contre le secours ; et ils se ruèrent en telle façon les uns sur les autres, que de l’une et l’autre part il n’y avait pas un coup qui tombât à faux. Mais à la fin, Bouchard, capitaine du secours, fut forcé de s’enfuir, car autrement il serait demeuré sur la place. Le fils du châtelain de Lavaur y fut tué, ainsi que la plupart des gens de la troupe.
Quand donc Martin d’Algais, dont on a parlé ci-dessus, et l’évêque de Cahors, qui étaient avec le secours, eurent vu ceci, ils se mirent à fuir sans frapper un seul coup, et aussi vite qu’ils pouvaient, tellement qu’ils allèrent sans s’arrêter jusqu’à Fanjaux, et ainsi le champ de bataille demeura au comte de Foix. Quand les gens dudit comte virent que les ennemis s’étaient enfuis, ils voulurent dépouiller ceux qui étaient restés morts et blessés sur la place, et ce fut bien pour leur malheur et mésaventure; car tandis qu’ils s’occupaient ainsi au pillage, Bouchard, ayant rassemblé quelques-uns de ceux qui s’étaient enfuis, vint attaquer les pillards, tellement que la plupart d’entre eux demeurèrent morts sur la place pour faire compagnie aux autres. Pendant que Bouchard faisait ce carnage des gens du comte de Foix, survint le comte de Montfort avec un grand et puissant secours; et qui les eût tous vus alors donner et recevoir aurait bien pu dire qu’il n’avait jamais vu mieux faire, car des deux côtés ils se tuaient sans avoir merci les uns des autres, et tellement qu’on ne savait qui avait du meilleur ou du pire; toutefois y demeurèrent trois fils du châtelain de Lavaur, qui n’en avait pas d’autres; c’étaient des hommes très vaillants, tellement qu’on disait que, dans toute la troupe du comte de Montfort, il n’y en avait pas de pareils à ces trois; et qui aurait vu alors les coups que portait le comte de Foix l’aurait bien dit chevalier sans reproche, car jamais Roland ni Olivier n’accomplirent en un jour plus de faits d’armes qu’il n’en fit alors. A force de frapper son épée se rompit entre ses mains, et alors arriva son fils, chevalier vaillant et hardi autant ou plus que son père, qui lui amenait un grand secours: il s’appelait Roger Bernard. Quand il fut arrivé, il demanda qui avait du meilleur; et s’étant mis avec tous ses gens dans l’endroit de la plus grande presse, ils frappèrent de telle sorte qu’ils tuèrent et blessèrent ce qu’il y avait d’ennemis autour d’eux, et les firent reculer un grand bout de chemin. Roger Bernard avait en sa compagnie un nommé le chevalier Porrade, et Sicard de Puy-Laurens et un autre appelé Lagrue, lesquels étaient vaillants hommes s’il en fut dans tout le monde, et on ne connaissait point leurs pareils: la nuit les ayant surpris, ils furent forcés de se retirer chacun en son quartier, les uns à Castelnaudary, les autres à leur camp. Quand le comte de Foix fut arrivé audit camp, il trouva qu’on pliait les tentes et pavillons comme s’ils étaient tous tués, alors il se prit à demander pourquoi on levait le camp; et quand le comte Raimond l’ouït et le vit, il dit à Savary de Mauléon qu’on, cessât de détendre les tentes et pavillons, et que chacun s’enfermât dans le camp; lequel était bien garni de fossés et entouré de charrettes et autres bagages, en sorte qu’il valait quasi une citadelle. Chacun des assiégeants s’arma donc et se mit en point, car ils pensaient que le comte de Montfort viendrait pour se venger, comptant que tous ces gens qui avaient combattu tout le jour seraient désarmés et se voudraient reposer, et que le camp ne serait pas très gardé cette nuit-là; mais il fut bien frustré de son attente et entreprise, car personne ne s’était désarmé; ils avaient fait au contraire bien armer tous ceux qui étaient dans le camp avec le comte Raimond; ainsi tous étaient en armes, grands et petits, et tous à leur poste, car ils se doutaient bien de ce que ferait le comte de Montfort, croyant les prendre au dépourvu. Quand vint l’heure du premier somme de la nuit, le comte de Montfort sortit de Castelnaudary avec tous ses gens, et vint attaquer le camp, pensant que tout le monde y était endormi, et criant Montfort! Comme s’ils eussent déjà tout pris et tué; mais les gens du camp les accueillirent si bien à leur arrivée, que tel était venu qui ne s’en est jamais retourné; et ils se mirent aussi à crier: Toulouse! Foix! Comminges! Et firent en sorte et reçurent de telle manière leurs ennemis, que qui put s’en retourner s’en retourna vers Castelnaudary et de là où il put, car ils les accompagnèrent jusqu’aux portes de Castelnaudary. Quand tout ceci fut fait, et que chacun fut retiré, on avisa que tout incontinent on pliât tentes et pavillons, et que toute l’armée allât droit à Puy-Laurens et autres villes pour les recouvrer, car si on ne les reprenait alors on ne les reprendrait jamais; ainsi fut fait qu’il avait été dit. Les bagages furent plies et troussés sans bruit, et l’on tira droit vers Puy-Laurens, dans lequel on entra malgré toutes les défenses de la garnison; et quand tout le pays apprit que le comte Raimond était dans Puy-Laurens, tous vinrent se rendre à lui, comme Gaillac, Rabastens, la Guépie, Saint-Antonin, Lagarde, Puy-Gelsi, et toutes les autres places et villes d’alentour. En cette manière fut réduit tout le pays, et rendu au comte Raimond, excepté Bruniquel, car le comte Raimond n’y voulut point aller à cause qu’il était tenu par son frère, qui était, comme on Fa dit, du parti du comte de Montfort.
Quand tout le pays fut rendu et remis au comte Raimond la nouvelle vint au comte de Montfort que le comte Raimond avait pris et recouvré tout le pays, et avait par toutes les places, tant grandes que petites, laissé de bonnes et grosses garnisons de ses gens, dont le comte de Montfort fut bien dolent et courroucé. Sur ce il fît armer tous ses gens, et les fit mettre en marche pour venir recouvrer le pays s’il pouvait, et vint droit à Cahusac qu’il prit et recouvra. Il y manda et fit venir le comte Baudouin qui était alors à Bruniquel, et lui fit dire que sans délai il vînt vers lui à Cahusac avec tout ce qu’il pourrait avoir et ramasser de monde. Le comte Baudouin, ayant ouï ce commandement, vint à Cahusac devers le comte de Montfort, et quand il y fut arrivé, et eut séjourné sept ou huit jours, ce qui se trouvait aux environs de l’Epiphanie,[3] ils partirent de Cahusac et s’en allèrent droit à Saint Marcel pour y mettre le siège. Quand ils furent arrivés à Saint Marcel ils y mirent le siège, en quoi ils firent une grande folie, car ce siège coûta au comte de Montfort une grande dépense, et ne lui profita guère, car il le continua jusqu’aux fêtes de Pâques, et alors le leva avec grande perte et dommage, attendu qu’il y avait dans ledit Saint Marcel une bonne garnison de gens vaillants, qui se défendaient bien, ainsi qu’ils le montrèrent à cette fois. d’autre part, la place était forte, et les vivres fort chers au siège, c’est pourquoi le comte de Montfort fut obligé de le lever.
Or il faut que vous sachiez que, tandis que le comte de Montfort allait et venait de cette manière, le comte Raimond et les comtes de Foix et de Comminges et autres seigneurs étaient à Montauban et Mirabel, et par le pays à l’entour. Il arriva alors une grande armée de croisés du pays d’Allemagne, et aussi de Lombardie et d’Auvergne, qui venait pour donner secours au comte de Montfort; de laquelle armée les gens du pays commencèrent à s’ébahir tellement que la plupart laissaient leurs habitations pour s’enfuir à Toulouse ou Montauban, car c’étaient les deux principales villes qu’eût alors le comte Raimond, et aussi les plus fortes de défense. Quand ceux qui étaient en garnison dans les places et châteaux virent que les gens du pays s’enfuyaient de cette manière, abandonnant leurs biens et habitations, ils en furent grandement ébahis, et chacun laissait et désemparait les garnisons et les places pour se sauver, chacun du mieux qu’il pouvait, comme on l’a dit, les uns vers Toulouse, et les autres vers Mon tau ban; en telle sorte que le comte de Montfort recouvra une autre fois tout le pays et prit Saint Marcel, car la garnison l’avait laissé et désemparé: le comte de Montfort le fit abattre et raser tellement qu’il n’y demeura pierre sur pierre.
Tout ceci fait, ils tirèrent vers Saint Antonin, où ils entrèrent, et tuèrent en entrant bien trente hommes des plus, apparents de la ville, pillèrent et dépouillèrent toute la ville, le couvent, les prêtres et les clercs, et enlevèrent tout sans y laisser chose au monde. Ils emmenèrent prisonnier le capitaine dudit Saint-Antonin, nommé Adémar, Jourdain, et aussi le vicomte de Pons, et beaucoup d’autres avec eux. Le comte de Montfort laissa en garnison dans la ville le comte Baudouin avec beaucoup de gens qu’il lui donna pour la garder et défendre: ensuite toute l’armée et le comte de Montfort marchèrent vers Penne pour y mettre le siège; et quand ils furent arrivés devant la ville, ils firent dresser des pierriers, calabres et autres engins pour assiéger la place, car elle était forte et imprenable. Le capitaine de cette place était un nommé Hugues d’Alfar, homme très vaillant et hardi, du pays d’Aragon; et aussi était avec lui dans ladite place un nommé d’Ausas de Meynadier, et Bernard Bour, et Gérard de Monsabès, et beaucoup d’autres, tous gens vaillants et hardis. Le siège fut mis à l’ascension, il tint jusqu’à la fin des septembre, et aurait tenu jusqu’au jour du jugement si l’eau ne se fût séchée et tarie dans la place; ce qui leur fut un grand mal et dommage; et d’autre part venait et arrivait tant de monde au siège, que personne ne le saurait dire ni compter, car il y vint le frère du comte de Montfort, appelé le comte Gui, avec une grande compagnie et armée, et avec lui vinrent aussi le chantre de Paris, Foucault de Bresses,[4] et beaucoup d’autres seigneurs et barons. Ce pourquoi force fut au capitaine d’Alfar, et à ceux qui étaient avec lui, de rendre la place, car ils n’avaient pas plus de nouvelles du comte Raimond que s’il eût été mort ou englouti dans un abîme. Ils eurent vie et bagues sauves, et purent s’en aller ou il leur plairait. Le comte de Montfort étant donc entré dans cette place, il y mit une bonne et grosse garnison pour la garder, et fit lever le siège, Après la prise de Penne, le comte de Montfort fit marcher son armée à un château près de la mer, appelé le château de Biron, dont était capitaine un nommé Pierre Algais, lequel Algais s’était retourné vers le comte Raimond, et avait abandonné son seigneur, le comte de Montfort. Le château fut enfin pris par force, ainsi qu’Algais, que le comte de Montfort fit pendre et étrangler à un gibet, qu’il fit faire exprès, et le château fut donné en garde à Arnaud de Montaigu, vaillant homme.
Tout ceci fait, le comte de Montfort et toute son armée vinrent mettre le siège à Moissac pour le prendre, et quand ils furent devant Moissac, la comtesse de Montfort vint devers son seigneur, le comte de Montfort, car grand temps était qu’elle ne l’avait vu. La comtesse amena une belle et bonne compagnie de gens bien en point et bien armés, au nombre de quinze mille, que menait et conduisait le comte Baudouin, frère du comte Raimond. Quand les gens de Moissac virent venir un si grand secours au comte de Montfort, ils s’en ébahirent grandement et se seraient volontiers accommodés, s’ils l’avaient pu, avec le comte de Montfort; mais les hommes d’armes qui étaient dedans les en empêchaient. Ceux de Castel Sarrasin et d’Agen avaient trouvé manière de s’accommoder avec le comte de Montfort, car ils comptaient bien que, si le comte Raimond pouvait en venir à ses fins, ils seraient bientôt revenus à lui. Le comte de Montfort tint conseil pour décider ce qu’on ferait, et si on donnerait l’assaut à la ville de Moissac. Le conseil décida que l’assaut serait donné incontinent, et on fit commencer les approches. Quand ceux qui étaient dans Moissac virent venir l’armée pour leur donner assaut, chacun s’arma et se mit en point; quand ils furent armés, ils sortirent en bon ordre et serrés, et vinrent attaquer les ennemis avec telle vigueur et puissance que, dans cette sortie, ils tuèrent et blessèrent beaucoup des assiégeants, et firent en sorte qu’ils les contraignirent de reculer de l’assaut. En cette occasion fut tué un gentil écuyer de la compagnie du comte Baudouin, lequel fut fort regretté. Quand ils se furent retirés, et que le comte de Montfort vit le grand dommage que lui avaient fait les gens de Moissac, il fut fort courroucé, et de la grande colère qu’il en eut, fit dresser des pierriers et calabres et un boso[5] pour tirer contre Moissac, afin d’en abattre les murailles; il fit tirer ses engins jour et nuit sans s’arrêter. Quand ceux de dedans virent en quelle façon il les attaquait, ils s’armèrent une autre fois et firent une sortie sur leurs ennemis, car ils aimaient mieux mourir en combattant vaillamment en plaine, qu’enfermés dans la ville. Ils allèrent donc une autre fois attaquer leurs ennemis, et firent en sorte qu’ils les obligèrent grandement à reculer, mirent le feu aux engins, en sorte qu’il n’en resta pas un seul petit, mais tous furent brûlés. Quand le comte de Montfort vit comment ils lui avaient brûlé ses engins et tué ses gens, il en fut à moitié désespéré, et, du grand courroux qu’il en eut, il se mit au plus épais contre les ennemis et les alla frapper, car il était homme vaillant et hardi, et commençait à faire merveille de son corps quand son cheval fut tué entre ses jambes, et il allait être pris, sans le grand secours qu’on lui vint donner, et il en avait bon besoin. Là fut pris par ceux de Moissac un neveu de l’archevêque, qui était en la compagnie du comte de Montfort; ils le tuèrent ensuite, ce qui fut grand dommage, et il en fut fait une grande vengeance, ainsi qu’on le dira. Chacun se retira de son côté, car ils étaient fort las et en désarroi, et on donna ordre de faire enterrer ceux qui étaient morts en cette sortie et de faire aussi guérir et panser les blessés.
Pendant que tout ceci se passait, venait devers Cahors un grand secours au comte de Montfort et quand le comte de Foix, qui était à Montauban, apprit la venue de ce secours, il sortit hors de la ville, et alla au-devant avec une grande quantité de gens qu’il avait fait armer. Il courut, sur eux et commença à frapper de telle sorte qu’ils furent contraints de se retirer en quelque lieu fortifié, et mandèrent, à Moissac, au comte de Montfort ce qui leur arrivait. Quand il sut l’état où se trouvaient ceux qui venaient lui donner secours, il fit promptement armer une grande quantité de gens, et les donna au comte Baudouin pour les conduire et aller soutenir les autres; quand le comte de Foix sut et vit qu’il venait de Moissac un si grand secours, il se retira devers Montauban; et le comte Baudouin étant allé à l’endroit où s’étaient réfugiés les autres, il les mena à Moissac.
(suite)
[1] Ou Guillaume de Contres.
[2] En septembre 1209.
[3] En 1211.
[4] Ou de Brigier
[5] Probablement une machine de guerre du genre du bélier, et dont le nom est dérivé de bos, bœuf.