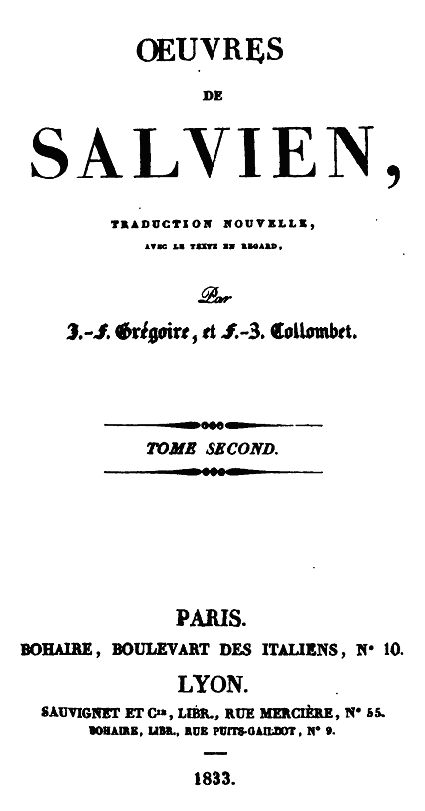
SALVIEN
DE LA PROVIDENCE ET DU JUSTE JUGEMENT DE DIEU EN CE MONDE.
LIVRE IV
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
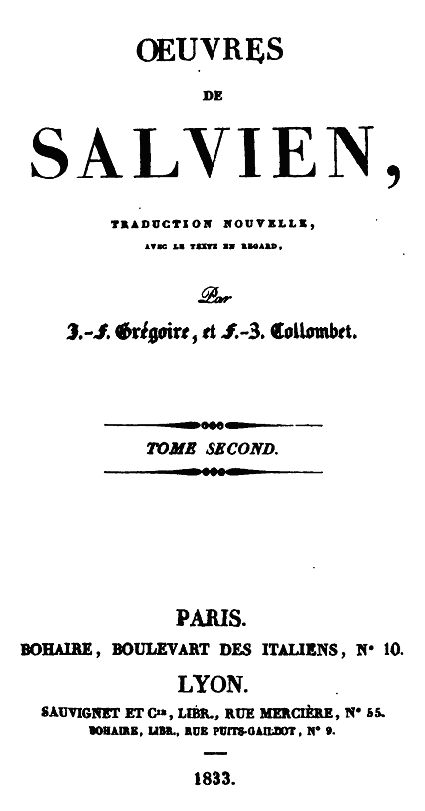
LIVRE IV
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
SALVIEN, PRÊTRE,
LIBER QUARTUS.
I. Disceditur itaque ab illa quam supra diximus Christiani nominis praerogativa, ut putemus, quia simus cunctis gentibus religiosiores, debere nos esse etiam fortiores. Nam cum, ut diximus, hoc sit hominis Christiani fides, fideliter Christum credere, et hoc sit Christum fideliter credere, Christi mandata servare, fit absque dubio ut nec fidem habeat qui infidelis est, nec Christum credat qui Christi mandata conculcat; ac per hoc totum in id revolvitur, ut qui Christiani nominis opus non agit, Christianus non esse videatur. Nomen enim sine actu atque officio suo, nihil est. Nam, sicut ait quidam in scriptis suis, quid est aliud principatus sine meritorum sublimitate, nisi honoris titulus sine homine; aut quid est dignitas in indigno, nisi ornamentum in luto? Itaque ut iisdem verbis etiam nos utamur, quid est aliud sanctum vocabulum sine merito, nisi ornamentum in luto? sicut etiam per divinas litteras sacer sermo testatus est dicens: Circulus aureus in naribus suis, mulier pulchra et fatua (Prov. XI, 22). Et in nobis itaque Christianum vocabulum quasi aureum decus est: quo si indigne utimur, fit ut sues cum ornamento esse videamur. Denique qui vult plenus scire vocabula nihil esse sine rebus, respiciat quomodo innumerabiles populi, cessantibus meritis, etiam nomina perdiderunt. Duodecim Hebraeorum tribus, cum electae quondam a Deo essent, duo nomina sacrosancta acceperunt. Populus enim Dei et Israel appellatae sunt. Sic quippe legimus: Audi, populus meus, et loquar; Israel, et testificabor tibi (Psal. LXXX, 9). Ergo Judaei aliquando utrumque, nunc neutrum. Nam nec Dei populus dici potest qui cultum Dei jam olim reliquit, nec videns Deum qui Dei Filium denegavit, sicut scriptum est: Israel vero me non cognovit, et populus meus me non intellexit (Isai. I, 3). Propter quod etiam alibi Deus noster de Judaeorum plebe loquitur ad prophetam dicens: Voca nomen ejus, Non dilecta (Ose. I; 9; Rom. IX, 25). Et iterum ad Judaeos ipsos: Vos non estis populus meus, et ego non sum Deus vester (Ibid., 9). Cur autem hoc de eis diceret, ipse alibi evidenter ostendit. Sic quippe ait: Dereliquerunt venam aquarum viventium, Dominum (Jer. XVII, 13). Et iterum: Verbum, inquit, Domini projecerunt, et sapientia nulla est in illis. Quod quidem timeo ne non magis tunc de eis dici potuerit, quam de nobis nunc dici possit: quia nec verbis Dominicis obtemperamus, et qui verbis Domini non obsequimur, sapientiam profecto in nobis penitus non habemus. Nisi fortasse credimus sapienter nos Deum spernere, et hoc ipsum quod Christi mandata contemnimus, summam prudentiam judicamus. Est quidem causa cur hoc ita existimare credamur. Nam tanto consensu omnes peccata sequimur, quasi summi consilii conspiratione peccemus. Quae cum ita sint, quae ratio est ut ipsi nos falsa opinione fallamus, existimantes scilicet quia Christiani esse dicamur, quod opitulari nobis inter mala quae agimus nomen bonum possit, cum Spiritus sanctus nec fidem quidem dicat hominibus Christianis sine operibus bonis posse prodesse. Et utique multo plus est fidem habere quam nomen: quia nomen est vocabulum hominis, fides autem fructus est mentis. Et tamen hunc ipsum fidei fructum infructuosum Apostolus sine operibus bonis esse testatur dicens: Fides sine operibus mortua est (Jac. II, 17). Et iterum: Sicut enim corpus sine spiritu, sic fides sine ope ribus mortua est (Ibid., 26). Addit quoque asperiora quaedam ad confundendos eos qui sibi praesumptione Christianae fidei blandiuntur. II. Sed dicet aliquis: Tu fidem habes, et ego opera habeo. Ostende mihi sine operibus fidem tuam, et ego ostendam tibi ex operibus fidem meam (Ibid., 18). Quo utique hoc indicat, actus bonos Christianae fidei quasi testes esse: quia Christianus nisi opera bona fecerit, fidem suam penitus approbare non possit, ac per hoc quod probare non valeat quia sit, sic omnino habendum esse quasi non sit. Nam quam pro nullo hoc habendum existimaret, in subditis statim ipse demonstrat dicens ad Christianum: Tu credis quia unus est Deus. Bene facis. Et daemones credunt, et contremiscunt (Ibid., 19). Consideremus quid voluerit hoc loco Apostolus dicere; nec irascamur divinis testimoniis, sed acquiescamus; nec contradicamus, sed proficiamus. Tu credis, inquit ad Christianum sermo divinus, quod Deus unus est. Bene facis. Et daemones credunt, et contremiscunt. Nunquid erravit Apostolus, ut hominis Christiani fidem daemoni compararet? Non utique. Sed ostendere illud volens quod supra dictum est, quia sine operibus bonis nihil sibi per fidei supercilium usurpare deberet, idcirco ait et a daemonibus Deum credi: scilicet ut sicut daemones, cum Deum credant, tamen in perversitate perdurant, ita et quosdam homines quasi credulitatem daemoniacam habere, qui cum se Deum credere asserant, tamen a malo opere non cessant. Subjungit autem ad pudorem et condemnationem hominum peccatorum, non credere solum daemones Dei nomen, sed etiam timere et contremiscere: hoc est dicere: Quid tibi blandiris, o homo, quisquis es, credulitate, quae sine timore atque obsequio Dei nulla est? aliquid plus daemones habent. Tu enim unam rem habes tantummodo, illi duas. Tu credulitatem habes, non habes timorem; illi credulitatem habent pariter et timorem. Quid miraris ergo si caedimur? Quid miraris si castigamur, si in jus hostium tradimur, si infirmiores omnibus sumus? Sive miseriae nostrae, sive infirmitates, sive eversiones, sive captivitates et pene improbae servitutes, testimonia sunt mali servi et boni domini. Quomodo mali servi? quia patior, scilicet vel ex parte, quod mereor. Quomodo boni domini? quia ostendit quid mereamur, etsi non inrogat quae mereamur. Clementissima enim ac benignissima castigatione mavult nos corrigere quam perire. Nos siquidem, quantum ad crimina nostra pertinet, lethalibus suppliciis digni sumus. Sed ille plus misericordiae tribuens quam severitati, mavult nos clementis censurae temperamento emendare, quam plaga justae coercitionis occidere. Ingratum nobis esse quod caedimur, satis certus sum; sed quid miramur si peccantes nos Deus verberat, cum ipsi peccantes servulos verberemus? Injusti judices sumus: homunculos nos flagellari a Deo nolumus, cum ipsi conditionis nostrae homines flagellemus. Sed nec miror quod tam iniqui in hac re sumus. Natura in nobis et nequitia servilis est. Volumus delinquere, et nolumus verberari. Ipsi in nobis mores sunt qui in servulis nostris: omnes volumus impune peccare. Denique, si mentior, cunctos consulo. Nego ullum esse, quamlibet magni criminis reum, qui se acquiescat debere torqueri. Hinc ergo cognosci potest quam inique ac pravissime aliis severissimi sumus, nobis indulgentissimi; aliis asperi, nobis remissi. In eodem crimine punimus alios, nos absolvimus. Intolerabilis prorsus et contumaciae et praesumptionis. Nec agnoscere volumus in nobis reatum, et audemus de aliis usurpare judicium. Quid esse injustius nobis aut quid perversius potest? Id ipsum scelus in nobis probabile esse ducimus, quod in aliis severissime vindicamus. Et ideo non sine causa ad nos Apostolus clamat: Propter quod inexcusabilis es, o homo omnis qui judicas. In quo enim alium judicas, te ipsum condemnas; eadem enim agis quae judicas (Rom. II, 1). III. Sed non eadem, inquit aliquis ex divitibus, non eadem nos agimus quae servi agunt. Ex servis enim fures ac fugitivi sunt, ex servis gulae ac ventri jugiter servientes. Verum est esse haec vitia servorum. Sed plura tamen sunt ac majora dominorum, quamvis non omnium. Excipiendi enim quidam sunt, sed paucissimi: quos ideo non nomino, ne non tam eos nominando laudare, quam alios non nominando videar publicare. Ac primum servi, si fures sunt, ad furandum forsitan egestate coguntur: quia etiamsi eis stipendia usitata praestentur, consuetudini haec magis quam sufficientiae satisfaciunt; et ita implent canonem quod non explent satietatem; ac per hoc culpam ipsam inopia minus culpabilem facit, quia excusabilis furti reus est qui ad furtum cogi videtur invitus. Nam et Scriptura ecclesiastica quasi subexcusare quodammodo miserorum omnium noxas videtur dicens: Non grandis est culpae cum quis furatus fuerit: furatur enim ut esurientem impleat animam (Prov. VI, 30). In Salomone. Furatur ut expleat animam suam, ac per hoc non satis a nobis accusandi sunt qui divino sermone excusantur. Quod autem de furtis servorum dicimus, hoc etiam de fuga; immo hoc rectius de fuga, quia ad fugam servos non miseriae tantum, sed etiam supplicia compellunt. Pavent quippe actores, pavent silentiarios, pavent procuratores: prope ut inter istos omnes nullorum minus servi sint quam dominorum suorum: ab omnibus caeduntur, ab omnibus conteruntur. Quid amplius dici potest? Multi servorum ad dominos suos confugiunt, dum conservos timent. Unde illorum fugam non tam ad eos debemus referre qui fugiunt, quam ad eos qui fugere compellunt. Vim patiuntur infelicissimi. Famulari optant, et fugere coguntur. Discedere a servitio dominorum suorum omnino nolunt, et conservorum suorum crudelitate non permittuntur ut serviant. Mendaces quoque esse dicuntur. Ad mendacium nihilominus atrocitate praesentis supplicii coarctantur. Siquidem dum tormentis se volunt eximere, mentiuntur. Quid autem mirum est si positus in metu servus mentiri mavult quam flagellari? Accusantur etiam gulae et ventris avidi. Nec hoc novum est. Magis desiderat saturitatem, qui famem saepe toleravit. Sed esto, non perferat famem panis. famem certe perfert deliciarum; et ideo ignoscendum est si avidius expetit quod ei jugiter deest. Tu vero nobilis, tu vero dives, qui immanibus bonis affluis, qui hoc ipso Deum sanctis operibus honorare plus debes quod beneficiis illius sine cessatione perfrueris; videamus si actus, non dico sanctos, sed vel innoxios habes. Et quis, ut superius dixi, divitum, praeter paucos, non cunctis criminibus infectus est? Et quod paucos excipio, utinam plures atque omnes excipi liceret. Salus erat omnium, innocentia plurimorum. Neque ego nunc de ullo dico, nisi de eo tantum qui in se id quod dico esse cognoscit. Si enim extra conscientiam suam sunt quaecumque dico, nequaquam ad injuriam ejus spectant cuncta quae dico. Si autem in se esse novit quae loquor, non a mea sibi hoc lingua dici aestimet, sed a conscientia sua. Ac primum ut de vitiis servilibus dicam, si fugitivus est servus, fugitivus es etiam tu dives ac nobilis. Omnes enim Dominum suum fugiunt, qui legem Domini derelinquunt. Quid ergo, dives, culpas in servo? hoc facis quod et ille. Ille fugitivus est domini sui, et tu tui. Sed hoc culpabilior tu quam ille, quia ille fugit forsitan malum dominum, et tu bonum. Incontinentiam quoque ventris in servo arguis. In illo rara est per indigentiam, in te quotidiana per copiam. Vides ergo apostolica sententia te potissimum verberari, immo te solum, quia in quo alium judicas, temetipsum condemnas. Eadem enim agis quae judicas: immo non eadem, sed majora multo ac nequiora. In illo quippe etiam infrequentem ventris intemperantiam punis, et tu assidua cruditate distenderis. Furtum quoque, ut putas, servile vitium est. Et tu furtum, dives, facis, quando a Deo vetita praesumis: omnes siquidem furta faciunt, qui inlicita committunt. IV. Sed quid ego tam minute et quasi allegorice de hoc loquor, cum facinoribus apertissimis non furta tantum divitum, sed latrocinia comprobentur? Quotus quisque enim juxta divitem non pauper aut actu aut statu est? Siquidem pervasionibus praepotentum aut sua homines imbecilli, aut etiam se ipsos cum suis pariter amittunt. Ut non immerito de utriusque personis sacer sermo testatus sit dicens: Venatio leonis, onager in eremo: sic pascua sunt divitum pauperes (Eccli. XIII, 23). Quamvis tyrannidem hanc non pauperes tantum, sed pene universitas patiatur generis humani. Quid est enim aliud dignitas sublimium quam proscriptio civitatum, aut quid aliud quorumdam quos taceo, praefectura quam praeda? Nulla siquidem major pauperculorum est depopulatio, quam potestas. Ad hoc enim honor a paucis emitur, ut cunctorum vastatione solvatur. Quo quid esse indignius, quid iniquius potest? Reddunt miseri dignitatum pretia quas non emunt. Commercium nesciunt, et solutionem sciunt. Ut pauci illustrentur, mundus evertitur. Unius honor, orbis excidium est. Denique sciunt hoc Hispaniae, quibus solum nomen relictum est. Sciunt Africae, quae fuerunt. Sciunt Galliae devastatae, sed non ab omnibus, et ideo in paucissimis adhuc angulis vel tenuem spiritum agentes, quia eas interdum paucorum integritas aluit, quas multorum rapina vacuavit. V. Sed evagati longius sumus, dolore compulsi. Ergo, ut ad superiora redeamus, quid est in quo non servilibus vitiis etiam nobiles polluantur, nisi forte ideo quia illa quae in servis peccata puniunt, ipsi quasi licita committunt? Denique ad has pervasiones, quas, ut supra dixi, nobiles agunt, servus nec aspirare permittitur. Quamvis mentiar. Quidam enim ex servis nobiles facti, aut paria aut majora fecerunt. Sed hoc tamen imputari servis nequaquam potest, quod quibusdam servilis conditio tam feliciter cessit. Homicidia quoque in servis rara sunt, terrore ac metu mortis; in divitibus assidua, spe ac fiducia impunitatis. Nisi forte iniqui sumus, hoc quod divites faciunt ad peccatum referendo, quia illi cum occidunt servulos suos, jus putant esse, non crimen. Nec hoc solum, sed eodem privilegio etiam in exercendo impudicitiae coeno abutuntur. Quotus enim quisque est divitum connubii sacramenta conservans, quem non libidinis furor rapiat in praeceps, cui non domus ac familia sua scortum sit, et qui non, in quamcumque personam cupiditatis improbae calor traxerit, mentis sequatur insaniam? secundum illud scilicet quod de talibus dicit sermo divinus: Equi insanientes in feminas facti sunt (Jer. V, 8). Quid enim aliud quam de se dictum hoc probat, qui totum pervadere vult concubitu quidquid concupierit aspectu? Nam de concubinis quippiam dici forsitan etiam injustum esse videatur, quia hoc in comparatione supra dictorum flagitiorum quasi genus est castitatis, uxoribus paucis esse contentum, et intra certum conjugum numerum frenos libidinum continere. Conjugum dixi, quia ad tantam res impudentiam venit, ut ancillas suas multi uxores putent. Atque utinam sicut putantur esse quasi conjuges, ita solae haberentur uxores! Illud magis tetrum ac detestabile, quod quidam matrimonia honorata sortiti, alias sibi rursum servilis status conjuges sumunt, deformantes sancti connubii honorem per degeneris contubernii vilitatem, non erubescentes maritos se fieri ancillarum suarum, praecipitantes fastigia nobilium matrimoniorum in cubilia obscena servarum: digni prorsus etiam illarum statu, quarum se putant dignos esse consortio. VI. Non dubito ex iis plurimos qui aut sunt nobiles, aut videri nobiles volunt, superbe et aspernanter accipere, quod dum consideramus haec talia quae locuti sumus, minus flagitiosos diximus servos quosdam esse quam dominos. Sed cum hoc ego non de omnibus, sed de his qui tales sunt praedicaverim, nullus irasci omnino debet qui nequaquam se talem esse cognoscit; ne hoc ipso quod irascitur, de coetu ipsorum esse videatur. Quin potius quicumque ex nobilibus haec male horrent, irasci talibus debent, quod facinoribus sordidissimis nobilitatis nomen infament: quia licet hi qui tales sunt omnem gravent populum Christianum, specialiter tamen illos sordibus suis polluunt, quorum pars esse dicuntur. Diximus itaque nobiles quosdam esse servis deteriores. Diximus utique et improbabiliter diximus, nisi quod diximus comprobamus. Ecce enim ab hoc scelere vel maximo prope omnis servorum numerus immunis est. Numquid enim aliquid ex servis turbas concubinarum habet, numquid multarum uxorum labe polluitur, et canum vel suum more tantas putat conjuges suas esse, quantas potuerit libidini subjugare? Sed responderi videlicet ad haec potest, quod facere servis ista non liceat. Nam profecto facerent, si liceret. Credo. Sed quae fieri non video, quasi facta habere non possum. Quamlibet enim in eis improbae mentes, quamlibet male cupidates sint, nullus pro eo quod non admittit scelere punitur. Malos esse servos ac detestabiles satis certum est. Sed hoc utique ingenui ac nobiles magis exsecrandi, si in statu honestiore pejores sunt. Quo fit ut ad illum perveniri exitum rei hujus necesse sit, non ut servi sint a reatu nequitiae suae absolvendi, sed ut plurimi divites magis sint servorum comparatione damnandi. Nam illud latrocinium ac scelus quis digne eloqui possit, quod cum Romana respublica vel jam mortua, vel certe extremum spiritum agens, in ea parte qua adhuc vivere videtur, tributorum vinculis quasi praedonum manibus strangulata moriatur, inveniuntur tamen plurimi divitum quorum tributa pauperes ferunt? hoc est, inveniuntur plurimi divitum quorum tributa pauperes necant. Et quod inveniri dicimus plurimos, timeo ne verius diceremus omnes. Tam pauci enim mali hujus expertes sunt, si tamen ulli sunt, ut in ea parte qua multos diximus, omnes pene divites reperire possimus. Ecce enim remedia pridem nonnullis urbibus data quid aliud egerunt quam ut divites cunctos immunes redderent, miserorum tributa cumularent; illis ut demerentur vectigalia vetera, istis ut adderentur nova; illos ut decessio etiam minimarum functionum locupletaret, istos ut accessio maximarum affligeret; illi ut eorum quae leviter ferebant imminutione ditescerent, isti ut eorum quae jam ferre non poterant multiplicatione morerentur; ac sic remedium illud alios injustissime erigeret, alios injustissime necaret; aliis esset sceleratissimum praemium, aliis sceleratissimum venenum: Unde advertimus quod nihil esse et divitibus sceleratius potest, qui remediis suis pauperes perimunt, et nihil pauperibus infelicius quos etiam illa quae pro remedio cunctis dantur occidunt. VII. Jam vero illud quale, quam sanctum, quod si quis ex nobilibus converti ad Deum coeperit, statim honorem nobilitatis amittit? Aut quantus in Christiano populo honor Christi est, ubi religio ignobilem facit? Statim enim ut quis melior esse tentaverit, deterioris abjectione calcatur; ac per hoc omnes quodammodo mali esse coguntur, ne viles habeantur. Et ideo non sine causa Apostolus clamat: Saeculum totum in malo positum est (I Joan. V, 19). Et verum est. Merito enim totum esse in malo dicitur, ubi boni locum habere non possunt. Siquidem ita totum iniquitatibus plenum est, ut aut mali sint qui sunt in illo, aut qui boni sunt, multorum persecutione crucientur. Itaque, ut diximus, si honoratior quispiam religioni se applicuerit, illico honoratus esse desistit. Ubi enim quis mutaverit vestem, mutat protinus dignitatem; si fuerit sublimis, fit despicabilis; si fuerit splendidissimus, fit vilissimus; si fuerit totus honoris, fit totus injuriae. Et mirantur mundani quidam et infideles, si offensam Dei aut iracundiam perferunt, qui Deum in sanctis omnibus persequuntur? Perversa enim sunt et in diversum cuncta mutata. Si bonus est quispiam, quasi malus spernitur, si malus est, quasi bonus honoratur. Nihil itaque mirum est si deteriora quotidie patimur, qui deteriores quotidie sumus. Et nova enim quotidie homines mala faciunt, et vetera non relinquunt. Surgunt recentia crimina, nec repudiantur antiqua. VIII. Quis ergo est causationis locus? Quamlibet aspera et adversa patiamur, minora patimur quam meremur. Quid querimur quod dure agat nobiscum Deus? Multo nos cum Deo durius agimus. Exacerbamus quippe eum impuritatibus nostris, et ad puniendos nos trahimus invitum. Cumque ejus naturae sit mens Dei atque majestas, ut nulla iracundiae passione moveatur, tanta tamen in nobis peccatorum exacerbatio est, ut per nos cogatur irasci. Vim, ut ita dixerim, facimus pietati suae, ac manus quodammodo afferimus misericordiae suae. Cumque ejus benignitatis sit ut velit nobis jugiter parcere, cogitur malis nostris scelera quae admittimus vindicare. Ac sicut illi solent qui munitissimas urbes obsident, aut firmissimas arces urbium capere et subruere conantur, omnibus absque dubio eas et telorum et machinarum generibus oppugnant, ita nos ad expugnandam misericordiam Dei omni peccatorum immanium scelere, quasi omni telorum genere pugnamus et injuriosum nobis Deum existimamus, cum ipsi injuriosissimi Deo simus. Omnis siquidem Christianorum omnium culpa, divinitatis injuria est. Nam cum illa quae facere a Deo vetamur admittimus, vetantis jussa calcamus; ac per hoc impie in calamitatibus nostris severitatem divinam accusamus. Nos quippe nobis accusandi sumus. Nam cum ea quibus torqueamur admittimus, ipsi tormentorum nostrorum auctores sumus. Quid ergo de poenarum acerbitate querimur? Unusquisque nostrum ipse se punit. Et ideo illud propheticum ad nos dicitur: Ecce omnes vos ignem accenditis, et vires praebetis flammae: ingredimini in lucem ignis vestri et flammae quam accendistis (Isai. L, 2). Totum namque humanum genus hoc ordine in poenam aeternam ruit, quo Scriptura memoravit. Primum enim ignem accendit, postea vires ignibus praebet, postremo flammam ingreditur quam paravit. Quando igitur primum sibi homo aeternum accendit ignem? Scilicet cum primum peccare incipit. Quando autem vires ignibus praebet? Cum utique peccatis peccata cumularit. Quando vero ignem aeternum introibit? Quando inremediabilem jam malorum omnium summam crescentium delictorum nimietate compleverit, sicut Salvator noster ad Judaeorum principes ait: Implete mensuram patrum vestrorum, serpentes, progenies viperarum (Matth. XXIII, 32, 33). Non longe a plenitudine peccatorum erant, quibus ipse dicebat Dominus ut peccata complerent. Ideo absque dubio, ut quia digni jam salute non essent, implerent iniquitatum numerum quo perirent. Unde etiam cum lex vetus peccata Amorrhaeorum completa esse memorasset, sic locutos esse ad sanctum Loth angelos refert: Omnes qui tui sunt, educ de urbe hac. Delebimus enim locum istum, eo quod increverit clamor eorum coram Domino, qui misit nos ut perdamus illos (Gen. XIX, 12, 13). Diu profecto flagitiosissimus ille populus ignem illum accenderat quo peribat. Et ideo completis iniquitatibus suis, arsit flammis criminum suorum. Tam male enim de Deo meruit, ut gehennam quae in futuro judicio erit, etiam in hoc saeculo sustineret. IX. Sed nulli sunt, inquit aliquis, illorum exitu digni, quia nulli illorum impuritatibus comparandi. Verum fortasse istud sit. Attamen quid facimus, quod Salvator ipse omnes qui Evangelium suum spreverint, pejores esse memoravit? Denique ad Capharnaum sic ait: Si in Sodomis factae fuissent virtutes quae factae sunt in te, forsitan mansissent usque in hunc diem. Verumtamen dico vobis, quia terrae Sodomorum remissius erit in die judicii quam tibi (Matth. XI, 23, 24). Si Sodomitas minus esse dicit damnabiles quam cunctos Evangelia negligentes, certissima ergo ratio est qua et nos, qui in plurimis Evangelia negligimus, pejus timere aliquid debeamus; praesertim cum usitatis jam et quasi familiaribus malis contenti esse nolimus. Non sufficiunt enim multis consuetudinarii reatus, non sufficiunt lites, non calumniae, non rapinae, non sufficiunt vinolentiae, non sufficiunt comessationes, non sufficiunt falsitates, non sufficiunt perjuria, non sufficiunt adulteria, non sufficiunt homicidia, non sufficiunt denique cuncta ista, etsi atrocitate inhumanissima, re tamen ipsa ad humanas injurias pertinentia, nisi blasphemas furiosarum mentium manus injiciant etiam in Deum. Posuerunt enim, sicut de impiis scriptum est, Posuerunt in coelum os suum, et lingua eorum transiit supra terram, et dixerunt: Quomodo scibit Deus, et si est scientia in excelso (Psal. LXXII, 9, 11)? Et illud: Non videbit nec intelliget Deus Jacob (Psal. XCIII, 7). Ad quos utique tales rectissime propheticum illud referri potest: Dixit insipiens in corde suo: Non est Deus (Psal. LII, 1). Nam qui nihil aspici a Deo affirmant, prope est ut cui aspectum adimunt, etiam substantiam tollant, et quem dicunt omnino nil cernere, dicant etiam omnino non esse. Et quidem licet nullum admodum malum facinus ratione subsistat, quia rationi non possunt scelera conjungi, nullum tamen est, ut puto, vel inrationabilius vel insanius. Quid enim tam furiosum est quam ut aliquis, cum Deum creatorem rerum omnium non neget, gubernatorem neget, et cum factorem esse fateatur, dicat negligere quae fecit? Quasi vero haec ei faciendorum omnium cura fuerit, ut negligeret quae fecisset. Ego autem in tantum eum curam creaturarum suarum habere dico, ut probem priusquam etiam crearet habuisse. Res quippe ipsa hoc evidenter ostendit. Nihil enim fecerat, nisi curam faciendi habuisset ante quam faceret, praesertim cum etiam in ipso humano genere nullus sit ferme hominum tam hebes qui ad hoc aliquid agat atque perficiat, ut perfecta non curet. Nam et qui agrum excolit, ad hoc colit ut culta conservet. Et qui vineam plantat, ad hoc plantat ut plantata custodiat. Et qui initia gregum praeparat, ad hoc parat ut curam multiplicandis gregibus impendat. Et qui domum aedificat vel fundamentum locat, etsi necdum habitationem paratam habet, jam tamen ipsa quae adhuc facere molitur, spe futurae habitationis amplectitur. Et quid de homine hoc loquar, cum etiam minima animalium genera futurarum rerum affectu omnia agant? Formicae in subterraneis latibulis varia frugum genera condentes, ad hoc cuncta contrahunt ac reponunt, quia affectu vitae suae diligunt quae recondunt. Apes, cum fundamina favis ponunt, vel cum e floribus natos legunt, qua causa vel thymum jam nisi studio et cupiditate mellis, vel flosculos quosdam nisi futurae sobolis charitate sectantur? Deus ergo, qui etiam minimis animantibus hunc affectum proprii operis inseruit, se tantummodo solum creaturarum suarum amore privavit, praesertim cum omnis in nos rerum bonarum amor ex illius bono amore descenderit? Ipse est enim fons et origo cunctorum, et quia in in ipso, ut scriptum est, et vivimus et movemur et sumus (Act. XVII, 28), ab ipso utique affectum omnem quo pignora nostra amamus, accepimus. Totus namque mundus et totum humanum genus pignus est Creatoris sui. Et ideo ex hoc ipso affectu quo amare nos fecit pignora nostra, intelligere nos voluit quantum ipse amaret pignora sua. Sicut enim, ut legimus, invisibilia ejus per ea quae facta sunt intellecta conspiciuntur (Rom. I, 20), ita amorem erga nos suum per eum quem nobis erga nostros dedit amorem, voluit intelligi. Et sicut omnem, ut scriptum est, paternitatem in coelo et in terra a se ipso voluit nominari (Ephes. III, 15), sic a nobis patris in se affectum voluit agnosci. Et quid dicam patris? immo potius plus quam patris. Probat quippe hoc vox Salvatoris in Evangelio dicentis: Sic enim dilexit Deus hunc mundum, ut Filium suum unicum daret pro mundi vita (Joan. III, 16). Sed et Apostolus dicit: Deus, inquit, Filio suo non pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit illum. Quomodo non etiam cum illo nobis omnia donavit (Rom. VIII, 32)? X. Hoc est ergo illud quod supra dixi, quia plus nos amat Deus quam filium pater. Evidens quippe res est quod super affectum filiorum nos Deus diligit, qui propter nos filio suo non pepercit. Et quid plus? Addo, et hoc filio justo, et hoc filio unigenito, et hoc filio Deo. Et quid dici amplius potest? Et hoc pro nobis, id est, pro malis, pro iniquis, pro impiissimis. Quis aestimare hunc erga nos Dei amorem queat, nisi quod justitia Dei tanta est, ut in eum aliquid injustum cadere non possit? Nam quantum ad rationem humanam pertinet, injustam rem homo quilibet fecerat, si pro pessimis servis filium bonum fecisset occidi. Sed utique hoc magis inaestimabilis pietas et hoc magis mirabilis. Dei virtus est, quod ita intelligi ab homine magnitudo justitiae suae non potest, ut quantum ad imbecillitatem humanam pertinet, pene injustitiae speciem magnitudo justitiae habere videatur. Et ideo Apostolus, ad indicandam nobis aliquatenus divinae misericordiae immensitatem, sic ait: Ut quid enim Christus, cum adhuc impii essemus, secundum tempus pro impiis mortuus est? Vix enim pro justo quis moritur (Rom. V, 6, 7). Ostendit profecto nobis una hac sententia pietatem Dei. Nam si vix ullus pro summa justitia mortem suscipit, probavit Christus quantum praestiterit pro nostra iniquitate moriendo. Sed cur hoc fecerit Dominus, statim in subditis docet dicens: Commendat autem suam charitatem Deus in nobis. Nam si cum adhuc peccatores essemus, Christus pro nobis mortuus est, multo magis igitur justificati nunc in sanguine ipsius, salvi erimus ab ira per ipsum (Ibid. 8, 9). Hoc ipso ergo commendat, quia pro impiis mortuus est. Majoris enim pretii est beneficium, quod praestatur indignis. Idcirco itaque ait: Commendat suam charitatem Deus in nobis. Quomodo commendat? Scilicet quia non merentibus praestat. Si enim sanctis et bene meritis praestitisset, non videbatur quae non debuerat praestitisse, sed quae debuerat reddidisse. Quid ergo nos pro his omnibus retribuimus, vel potius quid retribuere debemus? Primum scilicet illud quod beatissimus propheta ei debere se et redditurum esse testatur dicens: Quid retribuam Domino pro omnibus quae retribuit mihi? Calicem salutaris accipiam, et nomen Domini invocabo (Psal. CXV, 12, 13). Prima ergo haec retributio est, ut mortem morte reddamus, ac pro eo qui mortuus est pro nobis, nos moriamur omnes; tametsi minoris multo pretii mors nostra est quam sua. Quo fit ut etiam si mortem suscipiamus, debitum tamen non exsolvamus. Sed tamen quia majus referre non possumus, totum reddere videmur, si totum quod possumus reddere curamus. Itaque prima, ut dixi, haec retributio est. Secunda autem, ut si debitum morte non solvimus, vel amore solvamus. Nam ipse Salvator ideo, ut ait Apostolus, moriendo pro nobis commendare voluit omnibus charitatem suam, ut nos ad reddendam pietatem tantae vicissitudinis pietatis suae traheret exemplo. Et sicut illas naturae admirabiles gemmas ferunt, quae ferro propius admotae durissimum licet chalybem affectu quasi spirante suspendunt, ita etiam ille, id est, summa et clarissima regnorum coelestium gemma, hoc scilicet voluit ut dum se licet durissimis nobis descendens de coelo propius adjungeret, affectui suo nos quasi amoris sui manibus admoveret, ut agnoscentes utique dona sua ac beneficia, intelligeremus quid nos pro Domino tam bono facere conveniret, cum ille pro malis servis tanta fecisset, et compleretur hoc quod Apostolus dicit, ut mortificaremur charitate illius tota die, et neque tribulatio, neque angustia, neque persecutio, neque fames, neque nuditas, neque gladius posset nos separare a charitate Dei, quae est in Christo Jesu Domino nostro (Rom. VIII, 36). XI. Cum ergo haec a nobis deberi Domino satis certum sit, videamus quid pro his cunctis reddimus; quaeve demus. Quid scilicet nisi totum illud quod supra diximus, quidquid indecens, quidquid indignum, quidquid ad injuriam Dei pertinens, actus improbos, mores flagitiosos, ebrietates, comessationes, cruentas manus, foeditates libidinis, rapidas cupiditates, et quidquid illud est quod plus potest conscientia habere quam sermo. Quae enim, inquit Apostolus, in occulto fiunt ab eis, turpe est etiam dicere (Ephes. V, 12). Nec solum hoc. Nam hoc vetus est, et tam praesentium temporum quam praeteritorum: Illud gravius et lugubrius, quod peccatis veteribus nova addimus, nec solum nova, sed quaedam paganica ac prodigiosa et in ecclesiis Dei ante non visa; jactantes scilicet profanas in Deum voces, et contumeliose blasphemantes, dicentes Deum incuriosum, Deum non intendentem, Deum negligentem, Deum non gubernantem, ac per hoc et immisericordem et impraestabilem, inhumanum, asperum, durum. Nam qui non respiciens et incuriosus et negligens esse dicitur, quid superest nisi ut asper et durus et inhumanus esse dicatur? O caecam impudentiam! o sacrilegam temeritatem! Non sufficit enim nobis quod peccatis innumerabilibus involuti, rei in omnibus Deo sumus, nisi etiam accusatores Dei simus. Et quae, rogo, homini spes erit, qui ipsum accusat judicem judicandus? XII. Si ergo, inquiunt, respicit res humanas Deus, si curat, si diligit, si gubernat, cur nos infirmiores omnibus gentibus et miseriores esse permittit? Cur vinci a barbaris patitur? Cur juri hostium subjugari? Brevissime, ut jam ante dixi, ideo nos perferre haec mala patitur, quia meremur ut ista patiamur. Respiciamus enim ad turpitudines, ad flagitia, ad scelera illa Romanae plebis quae supra diximus, et intelligemus si protectionem mereri possumus, cum in tanta impuritate vivamus. Itaque quia hoc argumento plurimi non respici res humanas a Deo dicunt, quod miseri, quod imbecilles simus, quid meremur? Si enim in tantis vitiis, in tanta improbitate viventes, fortissimos, florentissimos beatissimosque esse pateretur, suspicio fortasse aliqua esse poterat quod non respiceret scelera Romanorum Deus, qui tam malos, tam perditos, beatos esse pateretur. Cum vero tam vitiosos, tam improbos, infirmos et miserrimo esse jubeat, evidentissime patet, et aspici nos a Deo et judicari, quia hoc patimur quod meremur. Sed mereri nos absque dubio non putamus; et hinc est quod magis rei et criminosi sumus, quia non agnoscimus quod meremur. Maxima quippe accusatrix hominum noxiorum est usurpatrix innocentiae arrogantia. Inter multos siquidem eorumdem criminum reos nullus est criminosior quam qui se putat non criminosum. Itaque et nos hoc solum malis nostris addere possumus, ut nos innoxios judicemus. Sed esto (inquit aliquis peccator et malignissimus) certe, quod negari non potest, meliores barbaris sumus; et hoc utique ipso manifestum est quod non respicit res humanas Deus, quia cum meliores simus, deterioribus subjugamur. An meliores simus barbaris, jam videbimus. Certe, quod non est dubium, meliores esse debemus. Et hoc ipso utique deteriores sumus, si meliores non sumus, qui meliores esse debemus. Criminosior enim culpa est, ubi honestior status. Si honoratior est persona peccantis, peccati quoque major invidia. Furtum in omni quidem est homine malum facinus; sed damnabilius absque dubio senator furatur aliqua quam infima persona Cunctis fornicatio interdicitur; sed gravius multo est si de clero aliquis quam si de populo fornicetur. Ita et nos qui Christiani et catholici esse dicimur, si simile aliquid barbarorum impuritatibus facimus, gravius erramus. Atrocius enim sub sancti nominis professione peccamus. Ubi sublimior est praerogativa, major est culpa. Ipsa enim errores nostros religio quam profitemur, accusat. Criminosior est ejus impudicitia, qui promiserit castitatem. Foedius inebriatur, sobrietatem fronte praetendens. Nihil est philosopho turpius vitia obscena sectanti, quia praeter eam deformitatem quam vitia in se habent, sapientiae nomine plus notatur. Et nos igitur in omni humano genere philosophiam Christianam professi sumus, ac per hoc deteriores nos cunctis gentibus credi atque haberi necesse est, quia sub tam magnae professionis nomine vivimus, et positi in religione peccamus. XIII. Sed scio plurimis intolerabile videri, si barbaris deteriores esse dicamur. Et quid facimus quod causae nostrae hoc nihil proficit, si intolerabile id nobis esse videatur? Immo causam nostram hoc magis aggravat, si deteriores simus, et meliores nos esse credamus. Qui enim, inquit Apostolus, se existimat aliquid esse, cum nihil sit, se ipsum seducit. Opus autem suum probet homo (Gal. VI, 3, 4). Operi ergo nostro debemus credere, non opinioni; rationi, non libidini; veritati, non voluntati. Igitur quia non ferendum quidam existimant, ut deteriores aut non multo etiam meliores barbaris judicemur, videamus aut quomodo meliores simus, aut quibus barbaris. Duo enim genera in omni gente omnium barbarorum sunt, id est, aut haereticorum, aut paganorum. His ergo omnibus, quantum ad legem divinam pertinet, dico nos sine comparatione meliores; quantum autem ad vitam et vitae acta, doleo ac plango esse pejores. Quamvis id ipsum tamen, ut ante jam diximus, non de omni penitus Romani populi universitate dicamus. Excipio enim primum omnes religiosos, deinde nonnullos etiam saeculares religiosis pares, aut si id nimis grande est, aliqua tamen religiosis honestorum actuum probitate consimiles; caeteros vero aut omnes, aut pene omnes, magis reos esse quam barbaros. Hoc est autem deteriorem esse, magis reum esse. Itaque quia nonnulli inrationabile atque absurdum arbitrantur, ut aut deteriores aut non multum etiam meliores barbaris judicemur, videamus, ut dixi, aut quomodo, aut quibus barbaris. Ego enim praeter eos tantummodo Romanorum quos paulo ante nominavi, caeteros aut omnes, aut pene omnes, majoris reatus dico et criminosioris vitae esse quam barbaros. Irasceris forsitan qui haec legis, et condemnas insuper quae legis. Non refugio censuram tuam. Condemna, si mentior; condemna, si non probavero; condemna, si id quod assero, non etiam Scripturas sacras dixisse monstravero. Igitur qui meliores nos multo cunctis quae sunt in mundo gentibus judicamus, nec ipse, qui Romanos dico in plurimis deteriores, abnego in quibusdam esse meliores. Vita enim, ut dixi, et peccatis sumus deteriores; lege autem catholica sine comparatione meliores. Sed illud considerandum est, quia quod lex bona est, nostrum non est; quod autem male vivimus, nostrum est. Et nihil utique nobis prodest quod lex est bona, si vita nostra et conversatio non est bona. Lex enim bona, muneris est Christi; vita autem non bona, criminis nostri. Immo hoc magis culpabiles sumus, si legem bonam colimus, et mali cultores sumus. Quin potius nec cultores, si mali: quia cultor dici non potest malus cultor. Neque enim colit qui rem sanctam sancte non colit, ac per hoc accusatrix nostri est lex ipsa quam colimus. XIV. Remota ergo legis praerogativa, quae nos aut nihil omnino adjuvat, aut etiam justa animadversione condemnat, vitam barbarorum atque nostrorum, studia, mores, vitia comparemus. Injusti sunt barbari, et nos hoc sumus; avari sunt barbari, et nos hoc sumus; infideles sunt barbari, et nos hoc sumus; cupidi sunt barbari, et hoc nos sumus; impudici sunt barbari, et nos hoc sumus; omnium denique improbitatum atque impuritatum pleni sunt barbari, et nos hoc sumus. Sed responderi fortasse possit: Ergo si pares vitiositate barbaris sumus, cur non sumus etiam viribus pares? Cum enim similis sit improbitas atque idem reatus, aut tam fortes deberemus esse nos quam sunt illi, aut certe tam invalidi quam nos sumus, illi esse deberent. Verum est, ac per hoc superest ut illi nocentiores sint qui infirmiores. Quomodo hoc probamus? Scilicet quia, ut superius locuti sumus, omnia ex judicio Deum facere monstravimus. Si enim, ut scriptum est, in omni loco oculi Domini speculantur bonos et malos (Prov. XV, 3), et juxta Apostolum, judicium Dei est secundum veritatem in omnes malos (Rom. II, 2), videmus nos qui non desinimus mala agere, ex judicio justi Dei poenas malitiae sustinere. Sed eadem, inquis, mala etiam barbari agunt, et tamen non sunt tam miseri quam nos sumus. Hoc ergo interest, quod etsi eadem agant barbari quae nos agimus, nos tamen majore offensione peccamus. Possunt enim nostra et barbarorum vitia esse paria; sed in his tamen vitiis necesse est peccata nostra esse graviora. Nam cum omnes, ut ante jam diximus, barbari aut pagani sint aut haeretici, ut de paganis, quia prior illorum error est, prius dicam, gens Saxonum fera est, Francorum infidelis, Gepidarum inhumana, Chunorum impudica; omnium denique gentium barbarorum vita, vitiositas. Sed numquid eumdem reatum habent illorum vitia quem nostra, numquid tam criminosa est Chunorum impudicitia quam nostra, numquid tam accusabilis Francorum perfidia quam nostra, aut tam reprehensibilis ebrietas Alani quam ebrietas Christiani, aut tam damnabilis rapacitas Albani quam rapacitas Christiani? Si fallat Chunus vel Gepida, quid mirum est, qui culpam penitus falsitatis ignorat? Si pejeret Francus, quid novi faciet, qui perjurium ipsum sermonis genus putat esse, non criminis? Et quid mirum si hoc barbari ita credunt, qui legem et Deum nesciunt, cum major fere Romani nominis portio ita existimet, quae peccare se novit? Nam ut de alio hominum genere non dicam, consideremus solas negotiatorum et siricorum omnium turbas, quae majorem ferme civitatum universarum partem occupaverunt, si aliud est vita istorum omnium quam meditatio doli et tritura mendacii, aut si non perire admodum verba aestimant quae nihil loquentibus prosunt. Tantus apud hos Dei honor est prohibens etiam jusjurandum, ut singularem existiment fructum omnium perjurium. Quid ergo mirum barbaros fallere, qui falsitatis crimen ignorant? Nihil enim contemptu agunt coelestium praeceptorum, praecepta Domini nescientes, quia non facit aliquid contra legem legis ignarus. Noster ergo hic peculiariter reatus est qui legem divinam legimus, et legalia semper scripta violamus, qui Deum nosse nos dicimus, et jussa illius ac praecepta calcamus; ac per hoc cum eum spernamus quem coli a nobis credimus atque jactamus, id ipsum quod cultus Dei videtur, injuria est. XV. Denique, ut de peccatis aliis nihil dicam, quis est omnino hominum saecularium, praeter paucos, qui non ad hoc semper Christi nomen in ore habeat ut pejeret? Unde etiam pervulgatum hoc fere et apud nobiles et apud ignobiles sacramentum est: Per Christum quia hoc facio, Per Christum quia hoc ago, Per Christum quia nihil aliud dicturus sum, Per Christum quia nil aliud acturus sum. Et quid plura? In id penitus deducta res est ut, sicut de paganis barbaris prius diximus, Christi nomen non videatur jam sacramentum esse, sed sermo. Nam in tantum apud plurimos nomen hoc parvi penditur, ut numquam minus cogitent quippiam facere quam cum se jurant per Christum esse facturos. Et cum scriptum sit: Non nominabis nomen Domini Dei tui in vanum (Exod. XX, 7), in id reverentia Christi decidit, ut inter caeteras saeculi vanitates nihil jam pene vanius quam Christi nomen esse videatur. Denique multi non otiosas tantummodo res et aniles, sed etiam scelera quaedam se jurant per Christi nomen esse facturos. Hic enim loquendi usus est talibus: Per Christum quia tollo illud, Per Christum quia caedo illum, Per Christum quia occido illum. Ad hoc res recidit, ut cum per Christi nomen juraverint, putent se scelera etiam religiose esse facturos. Denique quid mihi ipsi evenerit dicam. Cum ante aliquantulum tempus, victus prece cujusdam pauperis, praepotentiori cuidam supplicarem, obsecrans ne homini misero et egestuoso rem ac substantiam suam tolleret, ne subsidium et stipem quo paupertas illius nitebatur, auferret; tum ille, qui ejus rebus siti rabida inhiaverat, ac praedam jam spe et cupiditate ardentissima devoraverat, respiciens ac vibrans in os meum truces oculos, utpote qui tolli sibi a me putaret quidquid ipse alteri non tulisset, nequaquam hoc quod peterem facere se posse respondit: quasi vero jussu aut scripto id sacro faceret quod penitus praeterire non posset. Cumque ego causam qua hoc fieri non valeret quaererem, dixit rem violentissimam, et cui contradici penitus non deberet. Juravi, inquit, per Christum res illius a me esse tollendas. Vide ergo an possim vel debeam non efficere, quod etiam interposito Christi nomine me dixi esse facturum. Tum ego, (quid enim amplius facerem, cui res tam justa obtendebatur et sancta?) audita religiosissimi sceleris ratione, discessi. XVI. Hic nunc interrogo omnes qui sanae mentis sunt: Quis umquam crederet usque in hanc contumeliam Dei progressuram esse humanae cupiditatis audaciam, ut id ipsum in quo Christi injuriam faciunt, dicant se ob Christi nomen esse facturos? O inaestimabile facinus et prodigiosum! Quid non ausae sint improbae mentes! Armant se ad latrocinandum per Christi nomen, auctorem quodammodo sui sceleris Deum faciunt! et cum interdictor ac vindex malorum omnium Christus sit, dicunt se scelus quod agunt agere pro Christo. Et de hostili iniquitate conquerimur, et paganicam barbariem pejerare causamur! Quanto minore peccato illi per daemonia pejerant, quam nos per Christum! Quanto minoris criminis res est Jovis nomen ludificare, quam Christi! Ibi homo est mortuus, per quem juratur; hic Deus vivus, qui pejeratur. Ibi nec homo ullus; hic Deus summus. Hic cum maximi sacramenti sit dejeratio, necesse est maximi sit reatus et pejeratio; ibi cum prope nullum sit juramentum, nullum constat esse perjurium. Nam cum Deus non sit per quem juratur, non est perjurium cum pejeratur. Denique qui vult scire quam verum sit, audiat beatum apostolum Paulum ipsa haec quae nos dicimus praedicantem. Sic quippe ait: Scimus autem quoniam quaecumque lex loquitur, his qui in lege sunt loquitur (Rom III, 19). Et iterum: Ubi, inquit, non est lex, nec praevaricatio (Rom. IV, 15). Duabus his sententiis duas evidenter exposuit partes generis humani, extra legem positos, et in lege viventes. Qui sunt igitur nunc in lege positi? Qui scilicet nisi Christiani, sicut ipse Apostolus fuit, qui de se ait: Sine lege Dei non sum, sed in lege sum Christi (I Cor. IX, 21). Qui igitur sine lege Christi? Qui nisi pagani homines, legem dominicam nescientes? Et ideo de his dicit: Ubi non est lex, nec praevaricatio. Quo uno utique ostendit Christianos tantum, cum peccaverint, legis praevaricatores esse; paganos autem qui legem nesciunt, sine praevaricatione peccare, quia nullus potest ejus rei praevaricator esse quam nescit. Nos ergo tantum praevaricatores divinae legis, qui, ut scriptum est (Rom. II, 21, seqq.), legem legimus, et non facimus eam; ac per hoc nihil est aliud scientia nostra quam culpa, qui ad hoc tantummodo legem novimus ut majore offensione peccemus: quia quod lectione et corde novimus, libidine ac despectione calcamus. Et ideo rectissime apostolicum illud ad omnem dicitur Christianum: Qui in lege gloriaris, per praevaricationem legis Deum inhonoras. Nomen enim Dei per vos blasphematur inter gentes (Ibid., XXIII, 24). Cujus ergo criminis rei sint Christiani, ex hoc uno intelligi potest, quia Dei nomen infamant. Et cum scriptum sit nobis ut omnia faciamus in gloriam Dei (I Cor. X, 31), nos e diverso cuncta in Dei facimus injuriam. Cumque ipse Salvator noster ad nos quotidie clamet: Sic luceat lux vestra coram hominibus, ut videant filii hominum opera vestra bona, et magnificent Patrem vestrum qui in coelis est (Matth. V, 16), nos ita vivimus econtrario ut filii hominum videant opera nostra mala et blasphement Patrem nostrum qui est in coelis. XVII. Quae cum ita sint, magna videlicet nobis praerogativa de nomine Christianitatis blandiri possumus, qui ita agimus ac vivimus ut hoc ipsum quod Christianus populus esse dicimur, opprobrium Christi esse videamur. At e diverso in paganis quid horum simile quae dicimus? Numquid dici de Chunis potest: Ecce quales sunt qui Christiani esse dicuntur? Numquid de Saxonibus aut Francis: Ecce quae faciunt qui se asserunt Christi esse cultores? Numquid propter Maurorum efferos mores lex sacrosancta culpatur? Numquid Scytharum aut Gepidarum inhumanissimi ritus in maledictum atque blasphemiam nomen Domini Salvatoris inducunt? Numquid dici de ullis istorum potest: Ubi est lex catholica quam credunt? Ubi sunt pietatis et castitatis praecepta quae discunt? Evangelia legunt, et impudici sunt; apostolos audiunt, et inebriantur; Christum sequuntur, et rapiunt; vitam improbam agunt, et probam legem habere se dicunt. Numquid haec de ulla istarum gentium dici queunt? Non utique. De nobis quippe omnia ista dicuntur. In nobis Christus patitur opprobium, in nobis patitur lex Christiana maledictum. De nobis enim dicitur illud quod supra diximus: Ecce quales sunt qui Christum colunt. Falsum plane illud est quod aiunt se bona discere, quod jactant se sanctae legis praecepta retinere. Si enim bona discerent, boni essent. Talis profecto secta est, quales et sectatores. Hoc sunt absque dubio quod docentur. Apparet itaque et prophetas quos habent impuritatem docere, et apostolos quos legunt nefaria sanxisse, et Evangelia quibus imbuuntur, haec quae ipsi faciunt praedicare. Postremo sancta a Christianis fierent, si Christus sancta docuisset. Aestimari itaque de cultoribus suis potest ille qui colitur. Quomodo enim bonus magister est, cujus tam malos videmus esse discipulos? Ex ipso enim Christiani sunt, ipsum audiunt, ipsum legunt. Promptum est omnibus Christi intelligere doctrinam. Vide Christianos quid agant, et evidenter potes de Christo scire quid doceat. Denique quam prave ac nefarie pagani semper de sacris Dominicis opinati sint, docent persecutorum immanium cruentissimae quaestiones, qui in sacrificiis Christianis nihil aliud quam impura quaedam fieri atque abominanda credebant. Siquidem etiam initia ipsa nostrae religionis non nisi a duobus maximis facinoribus oriri arbitrabantur: primum scilicet homicidio: deinde, quod homicidio est gravius, incestu; nec homicidio solum et incestu, sed, quod sceleratius quidem est, incestu ipso et homicidio; incestu matrum sacrosanctarum et homicidio innocentium parvulorum, quos non occidi tantum a Christianis, sed, quod magis abominandum est, etiam vorari existimabant; et haec omnia ad placandum Deum, quasi ullo facinore magis possit offendi; ad purgandum piaculum, quasi ullum aliud majus esset; ad commendandum sacrificium, quasi ullam rem Dominus magis possit horrere; ad promerendam vitam aeternam, quasi vero etiam si possit his rebus accipi, tanti esset ad eam per scelera tam immania perveniri. XVIII. Intelligere ergo possumus aut quales esse pagani crediderint Christianos, qui talibus sacrificiis Deum colerent, aut qualem sollicitent Deum ipsum, qui haec sacra docuisset. Et hoc cur ita? Cur utique nisi ob eos qui Christiani esse dicuntur et non sunt, qui per flagitia ac turpitudines suas nomen religionis infamant, qui, ut scriptum est, ore fatentur se nosse Deum, factis autem negant, cum sint abominabiles et increduli, ad omne autem opus bonum reprobi (Tit. I, 16), per quos, ut legimus, via veritatis blasphematur (II Petr. II, 2), et sacrosanctum Domini Dei nomen sacrilegorum hominum maledictione violatur. Quam gravis autem ac singularis piaculi malum sit nomen Divinitatis in blasphemiam gentium dare, etiam David beatissimi edocemur exemplo, qui cum suffragio justitiarum suarum aeternam pro offensionibus suis poenam per unam tantum confessionem meruerit evadere, hujus tamen criminis veniam nec per poenitentiam patrocinantem potuit impetrare. Nam cum ei errores proprios confitenti Nathan propheta dixisset: Transtulit Deus peccatum tuum: non morieris, subdidit statim: Verumtamen quia blasphemare fecisti inimicos Domini propter verbum hoc, filius qui ex te natus est morietur (II Reg. XII, 13, 14). Et quid post haec? Deposito scilicet diademate, projectis gemmis, exutis purpuris, remoto omni splendore regiae dignitatis, cum pro his omnibus solitarius, gemens, clusus, sacco squalidus, fletu madidus, cinere sordidatus, vitam parvuli sui tot lamentationum suffragiis peteret, et piissimum Deum tanta precum ambitione pulsaret, sic rogans et obsecrans obtinere non potuit; cum tamen, quod fortissimum petentibus adjumentum est, impetraturum se quod sic a Deo peteret credidisset. Ex quo intelligi potest quod nullum penitus majoris piaculi crimen est, quam blasphemandi causam gentibus dare. Quicumque enim sine blasphemia aliorum graviter erraverit, sibi tantum affert damnationem. Qui autem alios blasphemare fecerit, multos secum praecipitat in mortem, et necesse erit ut sit pro tantis reus quantos secum traxerit in reatum. Nec solum hoc, sed quicumque peccator ita peccat ut alios tamen peccato suo blasphemare non faciat, peccatum suum ipsi obest tantummodo quod peccaverit, sacrosanctum autem Dei nomen sacrilega blasphemantium maledictione non laedit. Qui vero blasphemare alios peccans fecerit, necesse est peccatum hujus supra criminis humani esse mensuram, quia per convicia plurimorum inaestimabilem Deo facit injuriam. XIX. Hoc autem, ut dixi, malum peculiariter tantum Christianorum est, quia per eos tantummodo blasphematur Deus, qui bona discunt et mala faciunt; qui, ut scriptum est, Deum verbis confitentur et factis negant (Tit. I, 16); qui, ut idem apostolus ait, acquiescunt legi et sciunt voluntatem ejus, et probant quae potiora sunt; qui habent formam scientiae et veritatis in lege; qui praedicant non furandum, et furantur; qui legunt non moechandum, et moechantur; qui in lege gloriantur, et per praevaricationem legis Deum inhonorant (Rom. II, 17, seqq.). Et ideo hoc ipso Christiani deteriores sunt, qui meliores esse deberent. Non enim probant quod profitentur, et impugnant professionem suam moribus suis: magis enim damnabilis est malitia quam titulus bonitatis accusat, et reatus impii est pium nomen. Unde etiam Salvator in Apocalypsi ad tepidum Christianum ait: Utinam aut calidus esses aut frigidus! Nunc autem, quia tepidus es, incipiam te evomere ex ore meo (Apoc. III, 15, 16). Omnem Christianum Dominus fide ac spiritu jubet esse ferventem. Sic enim scriptum est: Ut simus spiritu ferventes, Domino servientes (Rom. XII, 11): In hoc ergo fervore spiritus fidei religiosae ardor ostenditur, de quo ardore qui plurimum habet, fervens esse agnoscitur fidelis; qui nihil omnino habet, frigidus esse intelligitur et paganus; qui vero inter utrumque vel neutrum est, tepidus atque exosus est Domino Christianus: et ideo ad eum dicitur: Utinam aut calidus esses aut frigidus! Nunc autem, quia tepidus es, incipiam te evomere ex ore meo; hoc est dicere: Utinam aut calorem et fidem haberes bonorum Christianorum, aut certe frigus et ignorantiam paganorum! Aut enim fides te calida Deo insinuaret, aut certe ad praesens adhuc legis ignorantia aliquatenus excusaret. Nunc autem quia Christum jam agnovisti, et negligis quem agnovisti, qui susceptus es quasi intra os Dei per fidei agnitionem, projicieris per teporem; quod quidem etiam beatus apostolus Petrus evidenter exposuit dicens de vitiosis ac tepidis, id est, male viventibus Christianis: Melius erat illis non cognoscere veritatem quam cognoscentibus retrorsum reflecti a tradito sibi mandato. Contigit illis res veri proverbii: Canis reversus ad suum vomitum, et sus lota in volutabro luti (II Petr. II, 21, 22). Quod ut evidenter de his dictum intelligamus qui sub Christiano nomine in sordibus mundi atque impuritatibus vivunt, audi quid de eisdem in eodem loco dicat: Si enim, inquit, refugientes coinquinationes mundi in agnitionem Domini nostri et conservatoris Jesu Christi, his rursus impliciti superantur, facta sunt illis norissima pejora prioribus (II Petr. II, 20). Quod quidem et beatus apostolus Paulus in eumdem modum dicit: Circumcisio quidem prodest, si legem custodias. Si autem praevaricator legis sis, circumcisio tua praeputium facta est (Rom. II, 25). Circumcisionem autem Christianitatem intelligendam ipse evidentissime docet dicens: Nos enim sumus circumcisio, qui spiritu Deo servimus, et non in carne confidimus (Philipp. III, 3). Ac per hoc videmus quod malos Christianos paganis comparat; nec comparat tantum, sed pene postponit, dicens: Si autem praeputium justitias legis custodiat, nonne praeputium illius in circumcisionem reputabitur? Et judicabit id quod ex natura est praeputium, legem consummans, te qui per litteram et circumcisionem praevaricator legis es (Rom. II, 26, 27). Ac per hoc intelligimus, ut supra dixi, culpabiliores nos multo esse, qui legem Dei habemus et spernimus, quam illos qui nec habent omnino nec norunt. Nemo enim ignota contemnit. Concupiscentiam quippe nesciebam, Apostolus inquit, nisi lex diceret: Non concupisces (Rom. VII, 7). Neque enim praevaricantur a lege quam non habent: quia, ut scriptum est, Ubi non est lex, nec praevaricatio (Rom. IV, 15). Ac per hoc si non praevaricantur a lege quam non habent, ergo nec contemnunt legis scita quae non habent: quia nemo, ut dixi, potest despicere quod nescit. Nos ergo et contemptores pariter et praevaricatores sumus, ac per hoc paganis deteriores, quia illi non norunt Dei mandata, nos novimus; illi ea non habent, nos habemus; illi inaudita non faciunt, nos lecta calcamus. Et ideo apud illos ignorantia est, apud nos praevaricatio; quia minoris criminis reatus est legem nescire quam spernere.
|
LIVRE QUATRIÈME.Argument. Porter le nom de chrétien, sans remplir les devoirs qu'il impose, c'est le déshonorer. — Exemple des Juifs applicable aux chrétiens. — La foi sans les œuvres. — Les tribulations sont à notre égard des preuves de la bonté divine. — Les esclaves infidèles sont moins coupables envers leurs maîtres que les chrétiens envers Dieu. — Conduite injuste et violente des grands et des nobles. — Les riches s'imaginent que les biens leur donnaient le droit de commettre les crimes les plus énormes. — Ils font peser les impôts sur les pauvres. — Ils détournent de la vertu par leurs railleries. Si Dieu nous châtie, nos péchés le forcent à cela. — Les Chrétiens sont, pour ainsi dire, plus coupables que les habitants de Sodome. — Nier la Providence de Dieu, c'est nier son existence. — Preuves que la Providence tirées de la conduite des hommes et de certains animaux. — L'amour de Dieu est tout paternel. — Mystère de l'Incarnation ; nous ne payons ce bienfait que d'ingratitude. — Les adversités des justes ne prouvent rien contre la Providence. — La sainteté de la vocation augmente l'énormité de la faute. — Les Chrétiens plus vicieux que les Païens. — Le parjure est très commun. — Exemple. — Les Chrétiens pèchent contre une loi qu'ils connaissent, les Païens contre une loi qu'ils ignorent — Calomnies contre la religion occasionnées par la vie irrégulière des Chrétiens. — Gravité du scandale. — Dieu a les tièdes en horreur. — Récapitulation. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Livre Quatrième.
On s'éloigne donc de cette prérogative du nom chrétien, dont nous avons parlé, et l'on pense qu'étant plus religieux que les autres peuples, nous devons être plus heureux aussi. Nous l'avons déjà dit, la foi d'un chrétien, c'est croire fidèlement au Christ ; et croire fidèlement au Christ, c'est observer ses commandements, d'où il devient manifeste qu'on n'a pas la foi quand on est infidèle, et qu'on ne croit pas au Christ, quand on foule aux pieds ses commandements. Et toujours il faut en revenir là, que ne point pratiquer les obligations du christianisme, c'est, en quelque façon, n'être pas chrétien. Car le nom, sans les actes qu'il impose, n'est plus rien. Car, comme l'a dit quelqu'un dans ses écrits, une principauté sans un mérite supérieur, qu'est-ce autre chose qu'un titre honorifique sans application ? Une dignité dans un homme sans talent, qu'est-ce autre chose qu'une pierre précieuse jetée dans la boue ? Pour appliquer ces paroles à notre sujet, un nom saint sans vertus, qu'est-ce autre chose qu'une pierre précieuse jetée dans la boue ? La parole sacrée l'atteste aussi dans les livres divins quand elle dit : La beauté à une femme sans pudeur est comme un collier d’or au cou de l’animal immonde. Le titre de chrétien est pour nous comme un ornement précieux ; si nous en faisons mauvais usage, nous ressemblons à des animaux immondes affublés d'une parure d'or. Enfin, si vous voulez vous convaincre encore plus que les titres ne sont rien sans les choses, considérez combien de peuples ont vu s'éteindre leurs noms, dès qu'ils ont dégénéré de leur ancienne vertu. Les douze tribus d'Israël ayant été choisies de Dieu reçurent deux noms saints, elles furent appelées Le peuple de Dieu, et Israël. Nous lisons : Ecoute, mon peuple, et je parlerai ; Israël, je te rendrai témoignage. Les Juifs avaient donc autrefois ces deux titres ; aujourd'hui ils n'ont ni l'un ni l'autre. Car, elle ne doit plus être appelée peuple de Dieu, la nation qui, depuis longtemps, a abandonné son culte ; ni voyant Dieu, puisqu'elle a renié le fils de Dieu, selon qu'il est écrit : Israël m'a méconnu ; mon peuple ne m'a pas compris. C'est aussi pour cela que le Seigneur parlant du peuple Juif au prophète, s'exprime en ces termes : Nomme-le non aimé. Puis, aux Juifs eux-mêmes : Vous n'êtes plus mon peuple, et je ne serai plus votre Dieu. La raison qui lui fait dire cela, il l'indique ailleurs d'une manière évidente : Ils ont abandonné la source des eaux vives, le Seigneur. Et encore : Ils ont rejeté la parole du Seigneur, et ils n’ont plus aucune sagesse. Je crains bien que ce reproche ne nous convienne mieux à nous aujourd'hui, qu'il ne convenait alors aux Juifs, parce que nous n'obtempérons pas aux paroles du Seigneur ; notre désobéissance prouve assez que nous sommes sans sagesse. A moins, par hasard, que nous ne prétendions qu'il y a de la sagesse à mépriser Dieu, et que c'est le comble de la prudence, de dédaigner les commandements du Christ. On pourrait croire, sans doute, que nous sommes dans cette opinion. Nous poursuivons tous le mal avec tant d'accord, que nous semblons pêcher par une sorte de conspiration publique. Qu'elle est donc la raison pour laquelle nous nous trompons nous-mêmes, follement persuadés que notre titre de Chrétien peut nous être de quelque secours au milieu de nos désordres, puisque l'esprit saint assure que la foi sans les bonnes œuvres est inutile au chrétien ? Et certes, avoir là foi, c'est quelque chose de plus que de porter le nom seulement. Le nom est une dénomination extérieure ; mais la foi est un acte de l'esprit. Et l'Apôtre cependant nous certifie que cette même foi sans les bonnes œuvres, est une foi stérile : ha foi qui n'a pas les œuvres, c'est une foi morte. Et encore : Comme le corps est mort lorsqu'il est sans âme, ainsi la foi est morte lorsqu'elle est sans œuvres. Il ajoute à cela des paroles bien plus fortes pour confondre ceux qui se flattent d'une vaine présomption de foi. Quelqu'un pourra donc dire : Vous avez la foi, et moi, j’ai les œuvres ; montrez-moi votre foi sans les œuvres, et moi je vous montrerai ma foi par mes œuvres. Il indiqué par-là que les actions vertueuses servent, pour ainsi dire, de témoignage à la foi chrétienne ; un chrétien, s'il ne fait de bonnes œuvres, ne saurait prouver qu'il a la foi ; et dès lors qu'il ne peut en donner aucune preuve, on doit la regarder comme n’existant pas ; car il montre aussitôt par les paroles suivantes combien cette foi lui semble nulle, quand il dit au Chrétien : Vous croyez qu’il y a un Dieu, vous faites bien ; mais les démons croient et ils tremblent. Examinons ce que l'apôtre a voulu dire en cet endroit ; ne nous irritons point contre les divins témoignages, mais montrons-nous-y dociles ; ne les affaiblissons pas par nos contradictions ; mais cherchons à en tirer profit. Vous croyez qu’il y a un Dieu, vous faites bien ; mais les démons croient et ils tremblent. Est-ce que l'Apôtre s'est trompé en comparant la foi d’un chrétien à celle d'un démon ? Non certes. Mais voulant prouver ce que nous avons dit plus haut, que le chrétien ne doit rien attendre d'une foi orgueilleuse, séparée des bonnes œuvres, il nous assure que les démons croient a Dieu ; et comme ils n'en demeurent pas moins dans leur perversité, il nous fait entendre par-là que certains hommes croient, en quelque sorte, à la manière des démons, puisque en se flattant de croire à Dieu ils ne s'éloignent pas du vice. Il ajoute pour confondre et condamner le pécheur, que les démons non seulement croient à Dieu, mais encore qu'ils craignent et tremblent. C'est comme s'il disait : Pourquoi vous flatter, ô hommes qui que vous soyez, d'une foi qui est nulle sans la crainte et l'obéissance ? Les démons ont quelque chose de plus. Vous n'avez qu'une chose, ils en ont deux. Vous avez la foi sans avoir la crainte ; ils ont, eux, et la foi et la crainte. Pourquoi donc vous étonner si nous sommes frappés ? Pourquoi vous étonner si nous sommes châtiés, si nous devenons la proie de nos ennemis, si nous sommes plus faibles que le reste des hommes ? Ces misères, ces infirmités, ces renversements de fortune, ces captivités, ces rudes esclavages : tout cela témoigne d'un mauvais serviteur et d'un bon maître. Comment d'un mauvais serviteur ? Parce que je souffre du moins en partie ce que je mérite. Comment d'un bon maître ? Parce qu'il nous fait voir ce que nous méritons, sans nous l'infliger toutefois. Car il aime mieux, par un châtiment plein de clémence et de bonté, nous corriger que de nous faire périr. Quant à ce qui concerne nos fautes, nous sommes dignes des supplices éternels ; mais lui, donnant plus à la miséricorde qu'à la sévérité, il aime mieux nous réformer par une réprimande toute de clémence et de ménagement, que de nous perdre par une punition juste et toute de rigueur. Qu'il ne soit pas agréable pour nous d'être frappés, c'est ce dont je suis bien convaincu. Pourquoi nous étonner si Dieu nous châtie dans nos péchés, lorsque nous-mêmes nous châtions nos esclaves dans leurs fautes ? Nous sommes des juges iniques ; nous, hommes méprisables, nous ne voulons point être flagellés de Dieu, et nous flagellons nos égaux. Je ne suis plus étonné de cette partialité. La nature, la malice, tout en nous tient de l'esclave. Nous voulons faillir, et nous ne voulons point être frappés. Nos mœurs sont celles de nos esclaves ; tous, nous voulons pécher avec impunité. Si je mens, j'en appelle à tout le monde. Je défie qu'il y ait un homme, si criminel qu'il soit, qui s'avoue digne d'être puni. Il est aisé de connaître par-là notre injustice et notre perversité ; toujours sévères pour les autres, toujours indulgents pour nous ; austères pour autrui relâchés pour nous mêmes. Les mêmes fautes, nous les punissons dans les autres, nous les absolvons en nous. Quelle insolence ! quelle insupportable prévention ! Nous ne voulons point reconnaître nos fautes, et nous voulons juger les autres. Quoi de plus inique, quoi de plus dépravé que nous ? Le même crime, nous croyons qu’on doit nous le passer, et nous le punissons, sévèrement dans les autres. Ce n'est donc pas sans cause que l’Apôtre nous crie : C’est pourquoi, ô homme, qui que vous soyez, qui condamnez les autres, vous êtes inexcusable, puisque vous faites les mêmes choses que ce que vous condamnez, vous-mêmes. Mais, dit un riche, notre conduite n'est point celle de nos esclaves. Parmi eux, il en est qui dérobent, qui s’enfuient ; il en est qui sont asservis à leur ventre et à la bonne chère. À la vérité, ce sont là les vices des esclaves ; mais des vices plus nombreux et plus grands déshonorent les maîtres ; non pas tous, sans doute, car il en faut excepter quelques-uns, mais assez peu. Je ne les nommerai pas dans la crainte de paraître vouloir moins louer les uns en les nommant, que montrer les autres au grand jour en ne les nommant point. Et d'abord, les esclaves, s'ils dérobent, sont forcés peut-être à le faire par indigence ; car, bien que vous leur donniez le salaire accoutumé, vous satisfaites plutôt à l'usage qu'à leur nécessité, et vous suivez la taxe, en ne contentant pas leur besoin. Et, ainsi la pauvreté rend la faute moins criminelle, parce qu'il est excusable de voler, celui qui y semble porté malgré lui. Car les livres ecclésiastiques semblent en quelque sorte excuser les fautes des malheureux, quand ils disent : Ce n’est pas toujours un grand crime de voler, car on ne dérobe souvent que pour rassasier sa faim. On dérobe pour rassasier sa faim ; n'accusons donc pas si facilement ceux que la parole divine excuse. Ce que nous disons des larcins, il faut le dire aussi de la fuite des esclaves, et à bien plus juste titre encore ; car ce n'est pas la misère seulement, mais encore la crainte des supplices qui les y force. Ils redoutent les intendants, ils redoutent les inspecteurs, ils redoutent les hommes d'affaires ; et, parmi tous ces surveillants impitoyables, ils ne sont les serviteurs de personne, moins que de leurs maîtres. Tout le monde les frappe, tout le monde les foule aux pieds. Qu'ajouter de plus ? Un grand nombre d'esclaves cherchent un asile auprès de leurs maîtres par la crainte de leurs compagnons de servitude. Ainsi, leur fuite, nous devons l'imputer moins à eux qui fuient, qu'à ceux qui les réduisent à cette nécessité. Ils souffrent violence, les infortunés : Ils voudraient, servir, et on les contraint de fuir, ils ne voudraient point abandonner la maison de leurs maîtres, et la cruauté de leurs compagnons de servitude ne leur permet point d'y demeurer. On les accuse aussi de mensonge ; mais ne serait-ce pas l'atrocité du supplice présent à leurs regards qui les y poussent ? Car ils mentent, pour se soustraire aux tortures. Qu'y a-t-il d'étonnant si un esclave, tremblant de crainte, aime beaucoup mieux mentir que de se laisser déchirer de coups ? On les accuse encore de gourmandise et de gloutonnerie. Et qu’y a-t-il là de nouveau ? On est bien plus avide de se rassasier, lorsqu'on a souvent enduré la faim. Ce n'est pas le pain qui leur manque, je le crois, mais ils manquent du moins de ce qui flatte le goût. — aussi faut-il leur pardonner, s'ils désirent avec trop d'ardeur ce dont ils furent toujours privés. Mais vous, noble, mais vous, riche, qui regorgez de biens, qui devez d'autant plus honorer Dieu par des œuvres saintes qu'il vous comble sans cesse de ses bienfaits, voyons si votre conduite est, je ne dis pas sainte, mais du moins innocente. Et parmi les riches, à part un petit nombre, comme je l’ai déjà dit, quel est celui qui n'est pas souillé de tous les crimes ? J'en excepté peu ; plût au ciel qu'il me tût permis d'en excepter davantage, de tous les excepter ! L'innocence du grand nombre serait le salut de tous. Je ne parle de personne en particulier, je ne m'adresse qu'à ceux qui reconnaissent en eux-mêmes les vices que je signale. Si quelqu'un ne sent pas ces reproches dans sa conscience, mes paroles ne peuvent l'outrager. Au contraire, trouve-t-il au fond du cœur qu'il est coupable, c'est au langage de sa conscience qu'il doit s'en prendre, et non pas au mien. Et d'abord, pour en revenir aux vices des esclaves, s'ils sont fugitifs, ne l'êtes-vous pas aussi, vous, riches et nobles ? Car ils fuient la maison de leur maître, tous ceux qui abandonnent la loi du Seigneur. Qu'avez-vous. donc, riches, à blâmer dans votre esclave ? Vous faites ce qu'il fait. Il fuit son maître, vous fuyez le vôtre. Mais ce qui vous rend plus coupable que lui, c'est que peut-être il fuit un mauvais maître, et que vous, vous en fuyez un bon. Vous condamnez aussi la gourmandise dans votre esclave. Chez lui, elle est rare, à cause de 1 ses besoins ; chez vous, elle est quotidienne à cause de votre abondance. Vous voyez donc que la répréhension de l'Apôtre s'adresse à vous principalement ; je dis plus, à vous seuls, parce qu'en jugeant les autres, vous vous condamnez vous même ; car vous faites les mêmes choses que vous condamnez. Ajoutons encore que vos excès sont bien plus grands, bien plus coupables. Vous punissez une intempérance assez peu fréquente, et chaque jour vous vous gorgez de vivres. Le larcin aussi, comme vous le dites, est un vice familier aux esclaves. Et vous, riches, vous commettez un vol, quand vous désobéissez à Dieu. Car c'est faire un larcin que de transgresser un ordre. Mais pourquoi arrêter à des détails minutieux ; et parler comme en allégorie, lorsque des crimes notoires viennent révéler non seulement les larcins, mais encore les brigandages des riches ? Car, quel est le pauvre qui, voisin d'un riche, n'est pas ou inquiété par lui, ou entièrement dépouillé ? Dans les envahissements des grands, les hommes sans, appui perdent à-la-fois et leurs biens et leur liberté. Ce n'est donc pas sans raison que les pages sacrées s'expriment ainsi, en parlant des uns et des autres : L’onagre est la proie du lion dans le désert, ainsi les pauvres sont la proie des riches. Et cette tyrannie ne pèse pas sur les pauvres seulement, elle se fait sentir à l’universalité presque du genre humain. Car, l’élévation des grands, qu’est-ce autre chose que la proscription des cités ; et le gouvernement de certaines personnes que je ne nommerai point, qu'est-ce autre chose qu'un brigandage ? Il n'est pas de plus grand fléau pour le pauvre que le pouvoir. Quelques hommes achètent les honneurs pour les payer ensuite par la ruine de tous, Quoi de plus révoltant ? quoi de plus inique. ? Les malheureux donnent le prix des dignités qu'ils n'ont point achetées. Etrangers à ce négoce, ils n'y participent que de leur argent. Pour l'illustration de quelques personnes le monde est renversé. La gloire d'un seul est la ruine de l'univers. Au reste, les Espagnes le savent ; elles à qui l’on n’a laissé que le nom. L'Afrique le sait ; elle qui fut. Les Gaules le savent, elles qui ont été dévastées non par tous, car elles conservent encore en quelques endroits un léger souffle de vie parce qu’elles furent nourries plus d'une fois par l'intégrité de quelques gouverneurs, après avoir été dépouillées par la rapacité des autres. Mais nous nous sommes trop écartés, emportés par la douleur. Pour en revenir donc à notre sujet, quels sont les vices des esclaves dont les nobles ne se souillent eux-mêmes ? à moins, par hasard, qu'ils ne regardent comme permis à eux ce qu'ils punissent dans leurs serviteurs. Ces envahissements des nobles, un esclave ne peut pas même y aspirer. Je me trompe ; quelques esclaves anoblis se sont livrés aux mêmes crimes et à de plus grands encore. Ces excès toutefois ne doivent pas être imputés aux esclaves en général, parce qu'il s'en est trouvé que leur condition a élevés à la fortune. Les homicides aussi sont rares chez les esclaves, par la crainte et la terreur de la mort ; chez les riches, ils sont continuels, par l'espoir et l'assurance de l'impunité. A moins peut-être que ce ne soit une injustice de notre part de regarder comme coupable la conduite des riches, parce qu'ils se persuadent que le meurtre de leurs serviteurs est un droit et non point un crime. Il y a plus, ils abusent aussi du même privilège en se livrant à de honteuses turpitudes. Où est le riche qui garde les serments du mariage, qui ne se laisse point emporter par la fureur de la passion, qui ne fait point de sa maison un foyer de débauche, et qui ne suit point la folie de son cœur, vers quelque objet que l'entraîne l'ardeur de ses infâmes désirs ? selon ces paroles des saintes Ecritures : Ils sont devenus comme des chevaux qui courent après les cavales. Ne prouve-t-il pas qu'on parle de lui, l'homme qui veut assouvir sa brutalité sur tout ce que ses regards convoitent ? Car, parler des concubines semblerait peut être une injustice ; en comparaison des vices que nous avons signalés, c'est une sorte de chasteté de se borner à quelques femmes, et de mettre un frein à sa débauche en s'arrêtant à un certain nombre d'épouses. J'ai dit d'épouses, car on en est venu à ce degré d'impudence, que la plupart donnent ce nom à de viles esclaves. Et plût à Dieu que les regardant comme des femmes légitimes, ils s'en tinssent à elles seules ! Ce qu'il y a de plus hideux et de plus révoltant, c'est de voir des hommes, après un mariage honorable, aller chercher de nouvelles épouses dans une condition servile, flétrissant ainsi là gloire d'une sainte union par la bassesse d'une indigne alliance, ne rougissant point de devenir les époux de leurs servantes, avilissant la hauteur d'un illustre mariage dans la couche obscène d'une esclave, bien dignes assurément de la condition de celles dont ils ne dédaignent pas les embrassements. Je ne doute pas que la plupart de ces hommes qui sont nobles, ou qui veulent le paraître, ne reçoivent mes paroles avec un orgueilleux dédain, quand je retrace ces désordres, quand je peins certains esclaves moins criminels que les maîtres. Comme je ne parle pas de tous, mais seulement de ceux qui sont coupables, l'on ne doit pas s'irriter, si l'on se reconnaît innocent ; car on donnerait lieu de croire par là qu'on appartient à cette classe d'hommes vicieux. Au contraire, les nobles qui ont ces désordres en horreur, doivent s'élever contre ceux qui déshonorent la noblesse par des actions infamantes ; car, bien que des hommes de ce genre pèsent déjà par leur vie sur tout le peuple chrétien, leurs turpitudes néanmoins deviennent plus spécialement l'opprobre de ceux qui les comptent dans leurs rangs. J'ai donc avancé que certains nobles sont pires que leurs esclaves. Je l'ai avancé, mais on ne me croira point, si je n'en apporte des preuves. Voilà que presque tous les esclaves sont exempts de ce vice honteux. Et en effet, quel est celui d'entre eux qui entretient une foule de concubines, qui se dégrade et s'avilit au milieu de nombreuses courtisanes, et qui, dans ses cyniques et immondes passions, regarde comme ses femmes toutes celles qu'il peut soumettre à sa brutalité ? Mais on va répondre à cela que les esclaves n'ont pas la facilité de tomber dans ces dérèglements, qu'ils le feraient sans doute s'ils le pouvaient. — Je le crois, mais ce que je ne vois pas arriver, je ne puis le prendre comme un fait. Quelque mauvais que soient leurs esprits, quelque vicieux que soient leurs penchants, toujours est-il qu'on ne punit personne pour un crime qu'il n'a pas commis. Que les esclaves soient vicieux et détestables, on le sait trop bien. Mais les grands et les nobles sont plus détestables encore, si, dans une condition élevée, ils se montrent pires que leurs serviteurs. Aussi faut-il nécessairement en venir à cette conclusion, que les esclaves ne doivent point, sans doute, être absous de leurs fautes, mais que la plupart des riches, comparés à eux, sont bien plus condamnables. Et qui pourrait dignement raconter les forfaits et les brigandages de nos jours ? Lorsque la République Romaine, déjà morte, ou du moins) exhalant un dernier souffle, expire dans ces restes malheureux en qui elle semble vivre encore, étranglée par des impôts oppressifs comme sous un bras assassin, il se rencontre cependant des riches qui font peser leurs tributs sur les pauvres ; c'est-à-dire, qu'il se rencontre des riches dont les tributs écrasent les pauvres. Et ce que je dis d'un certain nombre, je crains bien qu'on ne puisse le dire de tous, avec plus de vérité. Car il en est si peu, si toutefois il en est, qui soient à l'abri de cette accusation, qu'au lieu de là restreindre à la plupart des riches, comme nous l'avons fait, on devrait l'étendre à tous. Ces remèdes apportés, naguère aux maux de quelques villes, qu'ont-ils produit autre chose, sinon d'exempter tous les riches, et d'accumuler les impôts sur les pauvres ; d'ôter à ceux-là les anciens tributs, d'en ajouter de nouveaux à ceux-ci ; d'enrichir les premiers par la diminution des moindres charges, d'écraser les seconds par l'augmentation des plus fortes ; d'engraisser les uns, en adoucissant ce qu'ils supportaient sans peine, d'épuiser les autres, en aggravant ce qu'ils ne pouvaient plus supporter. Et ainsi, ce remède inutile n'a fait que grandir les riches, et tuer les pauvres ; devenant pour les uns le plus coupable soulagement, pour les autres le poison le plus funeste. Par là nous voyons la scélératesse des riches qui font périr les pauvres avec leurs remèdes, et le malheur des pauvres qui trouvent la mort dans ce qui devrait être un remède pour tous. Et puis, quelle piété ! quelle sainteté ! Si quelque grand veut se convertir a Dieu, le voilà tout aussitôt déchu de sa noblesse. Et, parmi le peuple chrétien, quel honneur pour le Christ, puisque sa religion engendre l'opprobre ! Car si quelqu'un s'efforce de devenir meilleur, les hommes pervers le méprisent, le foulent aux pieds ; et ainsi, c'est pour tout le monde une sorte de nécessité de rester dans la vie pour ne pas se dégrader. L'Apôtre a donc bien raison de s'écrier : Tout le monde est sous l’empire du mal. Et c'est vrai. Car on peut dire que tout le monde est sous l'empire du mal, puisque les gens de bien ne peuvent y trouver place. Il est si plein d'iniquités, que ceux qui l'habitent sont livrés au crime, ou que les gens de bien sont en butte à toutes les persécutions. Ainsi, comme nous l'avons dit, si quelque nomme distingué s'attache à la vertu, il perd aussitôt la considération publique. Car changer de vêtement, c'est se dégrader de sa dignité. Etiez-vous élevé, vous devenez méprisable. Etiez-vous dans l'éclat, vous tombez dans l'avilissement. Etiez-vous entouré d'honneurs, vous êtes accablé d'outrages. Et après cela, des hommes mondains et infidèles s'étonneraient de ressentir le poids de la colère divine, lorsqu'ils persécutent Dieu dans tous ses saints ! Tout est perverti, tout est renversé ; si l'on est homme de bien, l'on est méprisé comme le serait le méchant ; si l'on est méchant, l'on est honoré comme le serait l'homme de bien. Il n'y a donc rien d'étonnant si nous souffrons chaque jour davantage, a mesure que nous devenons plus pervers. Les hommes, chaque jour, commettent de nouveaux crimes, sans abandonner les anciens. De nouveaux désordres s'élèvent, les anciens restent toujours. Qu'avons-nous donc à prétexter ? Quelque rudes, quelque poignantes que soient nos souffrances, elles sont au dessous de ce que nous méritons. Pourquoi nous plaindre de ce que Dieu en agit si durement envers nous ? Nous en agissons bien plus durement envers lui. Nous l'aigrissons par nos impuretés, et, malgré lui, nous l'entraînons à nous punir. Et quoiqu'il entre dans l'essence et la majesté de Dieu d'être inaccessible à tout ressentiment de colère, nos péchés cependant l'irritent si fort, que nous armons nous-mêmes son courroux. Nous faisons, pour ainsi dire, violence à sa bonté, et nous détruisons, en quelque sorte, sa miséricorde. Disposé qu'il est à nous pardonner toujours, il se voit forcé par notre conduite à se venger de nos crimes. Semblables à ceux qui assiégeant des villes fortes, qui cherchant à prendre et à renverser de formidables citadelles, les attaquent avec toute espèce d'armes, toute espèce de machines ; pour vaincre la miséricorde de Dieu, nous employons comme des armes nos crimes monstrueux, nos forfaits de tout genre. Et nous croyons le ciel injuste à notre égard, quand c'est nous-mêmes qui le sommes envers Dieu ! Une faute, dans des chrétiens, c'est un outrage à la divinité. Car lorsque nous faisons ce que Dieu nous défend, nous foulons aux pieds ses ordres, et par conséquent c'est être impie que d'accuser, dans nos calamités, la sévérité divine. C'est nous-mêmes que nous devrions accuser. Quand nous faisons ce qui sera la cause de nos châtiments, nous devenons les auteurs de nos propres souffrances. Pourquoi se plaindre alors de la rigueur des peines ? Chacun de nous se punit lui-même. De là vient que le Prophète nous dit : Vous allumez le feu, vous attisez les flammes. Marchez à la lueur de votre feu et des flammes que vous avez excitées. Tous les hommes se précipitent dans la peine éternelle, en suivant les degrés que l'Ecriture vient de tracer. D'abord ils allument le feu, puis ils l'attisent ; enfin ils marchent a là lueur des flammes qu'ils ont préparées. Quand donc allument-ils d'abord pour eux les feux éternels ? — Lorsqu'ils commencent à pécher ? — Et quand est-ce qu'ils l'attisent ? — Lorsqu'ils entassent crimes sur crimes. — Mais quand est-ce qu'ils entreront dans ces feux éternels ? — Lorsqu'ils auront atteint le terme irrémédiable de tous ces forfaits, par l’énormité de leurs fautes toujours croissantes, ainsi que le Sauveur le déclare aux princes du peuple juif : Remplissez donc la mesure de vos pères, — Serpents, race de vipères. Ils n'étaient pas loin de la plénitude des crimes, ces hommes auxquels le Seigneur lui-même disait de combler la mesure de leurs péchés. Et cela, sans doute afin que, n'étant déjà plus dignes de salut, ils remplissent le nombre de leurs iniquités, pour périr ensuite. Ainsi, l'ancienne loi racontant que l'iniquité des Amorrhéens était montée au dernier degré, fait parler eu ces termes les anges au saint homme Loth : Tous ceux qui sont à toi, fais-les sortir de cette ville. — Car nous détruirons ce lieu, parce que leur cri s'est élevé devant le Seigneur, qui nous a envoyés pour les perdre. Il y avait longtemps, certes, que ce peuple infâme travaillait à allumer le feu par lequel il allait périr. Et voilà pourquoi, ses iniquités une fois portées à l’excès, il fut consumé par les flammes qu'avaient allumées ses propres crimes. Il avait si mal mérité de Dieu, que la géhenne du jugement futur, il l'éprouva même dès cette vie. Mais il n'est personne, dira-t-on, qui soit digne d'une telle fin, parce que personne aussi n'a égalé les impudicités des Sodomites. Cela pourrait bien être vrai. Mais ignorons-nous que le Sauveur lui-même regarde comme pires encore ceux qui méprisent son Evangile ? Enfin, il dit à Capharnaüm : Si les miracles qui ont été faits en toi avaient été faits autrefois en Sodome, peut-être aurait elle subsisté jusqu'à ce jour. — Cependant, Je te le dis, au dernier Jour, la terre de Sodome sera traitée moins rigoureusement que toi. S'il trouve les Sodomites moins condamnables que les contempteurs des Evangiles, nous qui méprisons les Evangiles en plusieurs points, nous avons grand sujet d'appréhender quelque chose de pire ; d'autant plus que nous ne voulons pas nous contenter des crimes communs et familiers. Pour la plupart, c'est peu des vices ordinaires, c'est peu des procès, des calomnies, des rapines, c'est peu de l'ivresse, c'est peu des festins dissolus, c'est peu des fourberies, c'est peu des parjures, c'est peu des adultères, c'est peu des homicides, c'est peu enfin des crimes de ce genre qui, tout éloignés qu'ils sont, par leur noirceur, de la dignité humaine, n'attaquent toutefois que des hommes ; c'est peu de tout cela, si, dans une fureur insensée, on n'élève encore contre Dieu des mains blasphématrices. Il est écrit des impies : Ils opposent leur bouche au ciel, et leur langue parcourt la terre. — Et ils ont dit : Dieu nous verra-t-il ? le très Haut en a-t-il connaissance ? Et encore : Le Seigneur ne nous verra pas ; le Dieu de Jacob n'en aura pas connaissance. On peut très bien rapporter, à ces hommes les paroles du Prophète : L'insensé a dit en son cœur : Il n’y a point de Dieu. Car, affirmer que Dieu ne regarde rien, c'est presque lui refuser l'être, en lui étant la Providence ; prétendre qu'il ne voit rien, c'est presque dire qu'il n'existe pas. Et quoiqu'il n'y ait aucun crime qui subsiste avec la raison, parce qu'il n'en est point qui puisse sympathiser avec elle, l'on ne saurait trouver cependant, je pense, rien fie plus déraisonnable, rien de plus insensé que ce blasphème. N'est-ce pas une espèce de fureur, quand on admet que Dieu a créé toutes choses, de nier qu'il les gouverne ; et quand on avoue qu'il les a faites, de prétendre qu'il néglige son ouvrage ? Comme s'il ne se fût proposé d'autre but en formant le monde, que de l'abandonner ensuite ! Le soin qu'il prend des créatures me semble si grand, au contraire, que je veux prouver qu'il s'occupait d'elles même avant de leur donner l'être. C'est ce que prouve évidemment le fait seul de la création. Car il n'eût rien créé, s'il n'y avait songé d'abord avant de se mettre à l'œuvre. Dans tout le genre humain, il n'est personne qui soit assez stupide pour entreprendre et achever un ouvrage dans la vue de le négliger ensuite. Celui qui cultive son champ, ne le cultive que pour le conserver après l'avoir fertilisé. Celui qui plante une vigne, ne la plante que pour la conserver toujours. Celui qui se forme un troupeau, ne le forme que pour l'accroître par ses soins. Celui qui bâtit une maison, ou qui jette des fondements, bien qu'il n'y ait point encore une habitation prête, n'embrasse pourtant les travaux qu'il se propose d'exécuter ensuite que dans l'espoir de se préparer une demeure future. Et pourquoi parler de l'homme seulement, puisque les plus petits animaux n'agissent que dans la sollicitude de l'avenir ? Les fourmis qui cachent dans leurs retraites souterraines toute espèce de provisions, ne les recueillent et ne les mettent en dépôt, que par cet amour de la vie qui les leur fait conserver. Lorsque les abeilles posent les fondements de leurs ruches, ou lorsqu'elles recueillent leurs petits sur les fleurs, par quel motif vont elles sucer le thym, si ce n'est par le désir et l'ambition de produire du miel ? Et pourquoi parcourent-elles certaines fleurs, si ce n'est par amour d'une postérité future ? Quoi ! Dieu a donné aux plus petits animaux cette affection de leurs propres ouvrages, et il se dépouillerait seul de l'amour de ses créatures, lui dont la bonté a mis en nous cet amour des bonnes choses ! Car il est la source et l'origine de tout ; et parce que c'est en lui, comme il est écrit, que nous avons la vie, le mouvement et l’être, c'est de lui que nous tenons aussi cette propension qui nous fait chérir nos enfants. Tout l'univers et tout le genre humain sont les enfants du Créateur ; et voilà pourquoi l'affection qu'il fait naître en nos cœurs pour tout ce qui nous est cher, doit nous faire sentir combien il aime, lui aussi, la grande famille humaine. Car, de même que les perfections invisibles de Dieu deviennent visibles par la connaissance que ses ouvrages nous en donnent, ainsi a-t-il voulu nous faire comprendre son amour envers nous, par celui qu'il nous a donné pour les nôtres. Et comme, au langage de l'Ecriture, toute paternité découle de lui dans le ciel et sur la terre, il veut que nous reconnaissions en lui l'affection d'un père. Et que dis-je, d'un père ? il est quelque chose de plus. C'est ce que prouvent ces paroles du Sauveur, dans l'Evangile : Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique pour le sauver. L'Apôtre ne dit-il pas aussi : Si Dieu na pas épargné son propre fils et s’il l’a livré à la mort pour nous tous, que ne nous donnera-t-il point, après nous l’avoir donné ? C'est donc là ce que j'ai dit, que Dieu nous aime plus qu'un père n'aime son fils. Car il est bien évident que Dieu nous chérit au-delà d'une affection paternelle, lui qui n'a pas épargné pour nous son propre fils. Et quoi de plus ? J'ajouterai : Un fils innocent, un fils unique, un fils Dieu. Et que peut-on dire encore ? Il ne l'a point épargné pour nous, c'est-à-dire pour des méchants, pour des impies, pour des hommes souillés d'iniquités. Qui pourrait apprécier cet amour de Dieu envers nous, si l'on ne savait que sa justice est si grande qu'il ne saurait rien faire d'injuste ? Car, à en juger par la raison humaine, un homme ferait une chose injuste, s'il livrait à la mort un bon fils pour de médians serviteurs. Mais, la bonté de Dieu est d'autant plus inappréciable, sa puissance est d'autant plus étonnante, que la grandeur de sa justice ne saurait être comprise de l'homme, et qu'à en juger par la faiblesse humaine, elle semblerait renfermer presque une sorte d'injustice. Et voilà pourquoi l'Apôtre, voulant nous faire connaître jusqu'à un certain point l'immensité de la divine miséricorde, s'exprime ainsi : En effet, pourquoi lorsque nous étions encore, dans les langueurs du péché Jésus-Christ est-il mort dans le temps marqué, pour des impies comme nous ? — Car à peine quelqu’un voudrait-il mourir pour un juste. Et certes, ce passage nous montre seul, toute la bonté de Dieu. Car, si personne ne donne sa vie, pas même pour la plus haute vertu, le Christ, en mourant pour nos iniquités, a montré toute la grandeur de ses bienfaits. Mais la raison qui a fait agir le Seigneur, l’Apôtre nous l'apprend aussitôt dans les paroles suivantes : Dieu a fait éclater son amour envers nous, en ce que, lors même que nous étions encore pécheurs, — Jésus-Christ est mort pour nous. Maintenant donc que nous sommes justifiés par son sang, nous serons, à plus forte raison, délivrés par lui de la colère de Dieu. Dieu fait donc éclater son amour, en cela qu'il meurt pour des impies. Car un bienfait a plus de prix, quand on l'accorde à des personnes indignes. De là vient que l'Apôtre a dit : Dieu fait éclater son amour envers nous. Et comment le fait-il éclater ? sans doute, en l'accordant à ceux qui ne le méritent pas. S'il eût accordé cette faveur à des hommes saints et bien méritants, il ne paraîtrait point avoir donné ce qu'il ne devait pas, mais plutôt avoir rendu ce qu'il devait. Que rendons-nous donc, ou du moins que devons-nous rendre pour ces insignes faveurs ? D'abord ce que le bienheureux Prophète reconnaissait devoir et promettait de rendre, quand il disait : Que rendrai-je au Seigneur, pour tous les biens dont il m'a comblé ? —Je recevrai le calice du salut, et j’invoquerai le nom du Seigneur. Le premier mouvement de cette reconnaissance est donc de donner vie pour vie, et de mourir tous pour celui qui lui-même est mort pour nous, quoique notre mort ait bien moins de prix que la sienne. Et ainsi, en recevant la mort, nous n'acquitterions pas entièrement notre dette. Cependant, parce que nous n'avons rien de plus à donner, nous semblons payer tout, en rendant tout ce que nous pouvons rendre. Voilà donc, comme je l'ai dit, le premier mouvement de cette reconnaissance. Le second, c'est de payer notre dette, au moins par notre amour, si nous ne le faisons par le sacrifice de notre vie. Car le Sauveur, comme dit l'Apôtre, a voulu faire éclater son amour aux yeux de tous, en donnant sa vie pour nous, afin de nous entraîner, par son exemple, à payer sa tendresse de réciprocité. Et de même que ces pierres merveilleuses, quand on les met en contact avec le fer, le tiennent suspendu, si dur qu'il puisse être, par un amour en quelque sorte vivant ; ainsi le Sauveur, c'est-à-dire, cette pierre souveraine et éclatante des célestes royaumes, en descendant du ciel pour se rapprocher de nous, malgré notre dureté, a voulu nous attirer à lui comme par les mains de son amour, afin sans doute que reconnaissant et ses dons et ses bienfaits nous comprissions ce qu'il convient de faire pour un si bon maître, lui qui a tant fait pour de si méchants serviteurs, afin que nous fussions livrés tous les jours à la mort à cause de lui, suivant les paroles de l'Apôtre, et que ni l'affliction, ni les angoisses, ni les persécutions, ni la faim, ni la nudité, ni le glaive ne pût jamais nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Comme il est incontestable que nous devons à Dieu toutes ces choses, voyons maintenant ce que nous lui rendons, ou ce que nous lui donnons en échange de tout cela. Ce que nous lui rendons ! N'est-ce pas, comme nous l'avons dit plus haut, tout ce qu'il y a d'indécent, tout ce qu'il y a d'indigne, tout ce qui peut l'outrager ; des actions criminelles, des mœurs dépravées, de fréquentes ivresses, des festins dissolus, des mains ensanglantées, de honteuses débauches, des cupidités furibondes, tous ces crimes enfin, que l'imagination peut concevoir, mais que le discours ne peut rendre. Car, dit l'Apôtre, ce que ces personnes font en secret, la pudeur ne permet pas même de le nommer. Ce n'est pas tout, car ceci n'est point nouveau, mais des temps passés aussi bien que des temps présents. Chose plus grave et plus déplorable, aux péchés anciens, nous en ajoutons de nouveaux ; et, non seulement des péchés nouveaux, mais encore des crimes monstrueux, dignes des païens et qu'on n'avait point vus jusque-là dans les églises. Nous élevons contre le ciel des paroles audacieuses et d'outrageants blasphèmes ; nous prétendons que Dieu se met peu en peine des choses de la terre, qu'il n'écoute pas nos prières, qu'il néglige le monde, qu'il ne le gouverne pas, et par-là qu'il est sans miséricorde, inaccessible à nos vœux, inhumain, plein de rigueur et de dureté. Car, lorsqu'on l'accuse d'inattention, d'incurie et de négligence, que reste-t-il à faire, sinon de le taxer de rigueur, de dureté et d'inhumanité ? O aveugle impudence ! ô témérité sacrilège ? non contents de nous jeter dans des prévarications sans nombre, de nous rendra coupables de mille excès envers Dieu, nous devenons encore les censeurs de la Divinité. Et, je le demande, quel espoir peut-il rester à l'homme qui s'érige en accusateur de son propre juge ? Si Dieu, disent les impies, regarde les choses humaines, s'il prend soin de ses créatures, s'il les aime, s'il les gouverne, pourquoi donc permet-il que nous soyons plus faibles et plus malheureux que tous les autres peuples ? pourquoi nous laisse-t-il vaincre par les barbares ? pourquoi nous laisse-t-il passer au pouvoir de nos ennemis ? Je réponds brièvement, comme je l'ai déjà fait : Dieu permet que nous souffrions tous ces maux, parce que nous avons mérité de les souffrir. Jetons-les, yeux sur les turpitudes, les crimes et les forfaits du peuple romain, et nous verrons si nous pouvons mériter protection, en vivant dans une si grande impureté. A ceux donc qui se servent de nos malheurs et de notre faiblesse comme d'un argument contre la Providence, je puis leur demander : Que méritons-nous ? car si Dieu permettait que des hommes, vivant au milieu de tant de vices et de tant de désordres, fussent puissants, florissants et heureux, l'on pourrait peut-être soupçonner qu'il ne voit point les crimes des Romains, quand il les laisse dans la prospérité, eux si méchants et si dépravés. Mais lorsqu'il rend faibles et misérables des hommes si vicieux et si corrompus, il est bien clair que Dieu nous voit et nous juge, parce que nous souffrons ce que nous avons mérité. Nous sommes loin, sans doute, de croire que nous méritions toutes ces calamités, et de là vient que nous sommes plus criminels, parce que nous ne reconnaissons pas ce que nous méritons. Ce qui accuse surtout l'homme coupable, c'est l'arrogante présomption qui veut usurper l'innocence. Parmi tous ceux qui ont à se reprocher les mêmes fautes, nul n'est plus condamnable que celui qui ne croit point l'être. Aussi, nous pouvons ajouter encore, à nos autres péchés, celui de nous regarder comme innocents. Mais soit, dira quelque impie, et le plus grand ; du moins, on ne peut le contester, nous valons mieux que les barbares ; et par-là même il devient manifeste que Dieu ne regarde point les choses humaines, puisque nous sommes assujettis à de plus méchants que nous. Nous valons mieux que les barbares ! c'est ce que nous allons voir. Il est incontestable, au moins, que nous devons être meilleurs qu'eux. Et certes, c'est être pire que de n'être pas meilleur qu'un autre, quand on est obligé de l'être. Plus l'état est relevé, plus la faute est odieuse, plus la dignité est grande, plus aussi le crime est énorme ; le vol, sans doute, est une méchante action dans tout homme, mais un sénateur qui dérobe est bien plus condamnable assurément qu'une personne de basse condition. La fornication est défendue à tout le monde, mais elle est bien plus grave dans un clerc que dans un homme du peuple. Nous, de même, qui sommes appelés Chrétiens et Catholiques, si nous commettons quelque chose de semblable aux impuretés des barbares, nous péchons plus grièvement. Le crime est plus atroce, quand on professe un nom saint. Plus la prérogative est sublime, plus la faute est énorme. La religion que nous professons accuse elle-même nos écarts. L'impudicité est plus coupable en celui qui a promis d'être chaste. Il est plus honteux de s'enivrer pour celui qui porte la tempérance sur son front. Rien de plus hideux qu'un philosophe livré à des vices obscènes ; car, outre la difformité que les vices ont en eux, le nom de sage les fait remarquer encore plus. Et nous qui avons professé, dans tout le genre humain, la philosophie chrétienne, il faut nécessairement que nous soyons jugés et regardés comme plus corrompus que tous les autres peuples, parce que vivant dans une profession si haute, nous péchons au sein même de la religion. Je sais que plusieurs ne peuvent supporter d'être mis au-dessous des barbares. Et qu'importe à notre cause, si cela nous paraît insupportable ? Au contraire, nous croire meilleurs que nous ne sommes, c'est faire tort à notre cause. Car si quelqu'un, dit l'Apôtre, s’imagine être quelque chose, il se trompe lui-même, parce qu'il n'est rien. — Or, que chacun examine bien ses propres actions. Nous devons donc nous en rapporter à nos œuvres, et non à l'opinion ; à la raison, et non à la passion ; à la vérité, et non au penchant de la volonté. Mais puisqu'il est des personnes qui ne peuvent souffrir qu'on les rabaisse au dessous des barbares, ni même qu'on ne les élève pas de beaucoup au dessus d'eux, voyons donc comment nous sommes meilleurs, et de quels barbares il s'agit. Parmi les barbares, il en est de deux sortes : des hérétiques et des païens. Pour ce qui concerne la doctrine divine, nous avons sans doute tout l'avantage ; pour ce qui regarde la vie et les mœurs y je le dis avec une vive douleur, nous sommes loin de les valoir. Je ne prétends point cependant, comme je l'ai déjà dit, appliquer ces paroles à l'universalité du peuple romain. J'en excepte d'abord tous les religieux, puis, quelques personnes du siècle, qui ne leur cèdent en rien, ou si c'est trop, qui leur ressemblent par une certaine probité de vie. Quant aux autres, je les considère tous ou presque tous comme inférieurs aux barbares. Or, être inférieur, c'est être pire. Mais, puisqu'il est des personnes qui regardent comme déraisonnable et absurde d'être abaissés au dessous des barbares, ou même de n'être pas élevés de beaucoup au dessus d'eux, voyons donc, ainsi que je l'ai dit, comment nous sommes meilleurs, et de quels barbares il s'agit. Pour moi, si vous exceptez ce petit nombre de Romains dont je viens de parler, je prétends que les autres mènent tous, ou presque tous, une vie plus coupable et plus criminelle que les barbares. Vous vous irritez peut-être, vous qui lisez cela, et vous condamnez même ce que vous lisez. Je ne recule point devant votre censure. Condamnez-moi, si je mens ; condamnez-moi, si je manque de preuves ; condamnez-moi, si je ne montre pas que les saintes Ecritures ont établi ce que j'avance. Nous croyons valoir beaucoup mieux que tous les peuples de la terre, et moi-même qui affirme que les Romains leur sont inférieurs sous bien des rapports, je ne nie pas qu'ils ne leur soient supérieurs à certains égards. Comme je l'ai déjà dit, nous leur sommes inférieurs par notre vie et nos désordres ; nous leur sommes incomparablement supérieurs par la doctrine catholique. Mais il faut le remarquer, si notre doctrine est bonne, cela ne vient pas de nous ; et si nous vivons mal, c'est notre ouvrage. Et certes, il ne nous sert à rien que votre doctrine soit bonne, si votre vie, si votre conduite ne l'est pas. Une bonne doctrine, c'est un présent du Christ ; une vie mauvaise, c'est l'œuvre de notre malice. Ce n'est pas tout ; nous sommes bien plus coupables, si, professant une bonne doctrine, nous en sommes d'infidèles observateurs. Encore même, n'en sommes-nous pas les observateurs, si nous vivons mal, parce qu'un observateur infidèle ne peut être appelé observateur. Car ce n'est pas observer que de ne point observer saintement une chose sainte. Et ainsi, la loi que nous professons devient elle-même notre accusatrice. Laissant donc de côté ces prérogatives de notre doctrine, ou qui nous sont tout-à-fait inutiles, ou qui sont même pour nous un juste sujet de condamnation, comparons notre vie, nos penchants, nos mœurs et nos vices avec ceux des barbares. Ils sont injustes, nous le sommes aussi ; ils sont avares, nous le sommes aussi ; ils sont perfides, nous le sommes aussi ; ils sont pleins de cupidité, nous le sommes aussi ; ils sont impudiques, nous le sommes aussi ; en un mot, ils sont livrés à toute sorte de désordres et d'impuretés, nous le sommes aussi. Quelqu'un pourra me répondre peut-être : Si nous égalons les barbares en dépravation, pourquoi aussi ne les égalons-nous pas en puissance ? Puisque de part et d'autre les vices et les dérèglements sont.les mêmes, nous devrions être aussi puissants qu'eux, ou du moins ils devraient être aussi faibles que nous. Je l'avoue, et il s'ensuit que les plus faibles sont les plus coupables. Quelle en est la preuve ? C'est que Dieu fait tout avec justice, comme nous l'avons montré plus haut. Car si les yeux de l'Eternel sont en tous lieux, observant les bons et les médians, si Dieu, au dire de l'Apôtre, condamne selon sa vérité tous les méchants, nous, qui ne cessons de nous livrer au désordre, c'est donc par un jugement équitable de Dieu que nous portons la peine de notre malice. Mais, direz-vous, les barbares aussi s'abandonnent aux mêmes désordres, et pourtant ils sont moins malheureux que nous. — Il y a donc cette différence que, si les barbares commettent les mêmes crimes que nous, nous péchons pourtant plus grièvement. Car nos vices et ceux des barbares peuvent être égaux, mais nos offenses sont nécessairement plus graves. Tous les barbares, comme nous l'avons déjà dit, étant ou païens ou hérétique», je parlerai d'abord des païens dont les égarements sont antérieurs. La race des Saxons est cruelle, les Francs sont perfides, les Gépides inhumains, les Huns impudiques, enfin, dans la conduite de toutes ces nations barbares, domine un vice particulier ; mais, leurs défauts ont-ils le même degré de malice que les nôtres ? L'impudicité des Huns est-elle aussi criminelle que la nôtre ? La perfidie des Francs est-elle aussi blâmable que la nôtre ? L'intempérance des Alains est-elle aussi répréhensible que celle des Chrétiens ? La rapacité des Albanais est-elle aussi condamnable que celle des Chrétiens ? Si le Hun ou le Gépide use de fourberie, qu'y a-t-il là d'étonnant, lui qui ignore tout-à-fait que la fourberie est un crime ? Si le Franc se parjure, que fait-il de si étrange, lui qui regarde le parjure comme un discours ordinaire, et non comme un crime ? Et quelle merveille, si des barbares sont dans cette opinion, lorsque la majeure partie du nom romain pense de même, elle qui sait bien qu'elle pèche ? Car, pour ne pas parler des autres classes d'hommes, attachons-nous à considérer les négociants et ces vendeurs d’étoffes ; précieuses dont la foule inonde presque toutes nos cités. A quoi passent-ils leur vie, si ce n'est à méditer de nouvelles ruses, à inventer des mensonges ? Ne regardent-ils pas comme perdues toutes les paroles qui ne peuvent leur rapporter aucun gain ? La gloire de Dieu qui défend le serment a tant d'empire sur eux, qu'ils regardent le parjure comme le seul moyen de réussir en toutes choses ! Qu'y a-t-il donc d'étonnant, si les barbares usent de fourberie, eux qui ne savent pas que la fourberie est un crime ? Leur conduite n'est point un mépris des préceptes célestes, puisqu'ils ne les connaissent pas. Car, il n'agit pas contre la loi, celui qui l'ignore. Voilà donc ce qui constitue spécialement notre péché, nous lisons la loi divine et nous violons les saintes ordonnances. Nous prétendons connaître Dieu, et nous foulons aux pieds ses préceptes et ses commandements. Et ainsi, lorsque nous méprisons celui que nous nous vantons d'honorer, ce qui nous paraît un culte n'est qu'un, outrage fait à Dieu. Enfin, pour ne rien dire des autres péchés, parmi les hommes du siècle, si l'on en excepte un petit nombre, quel est celui qui n'a pas toujours à la bouche le nom du Christ, afin d'appuyer ses parjures ? De là vient que cette espèce de serment est devenu vulgaire, soit dans la noblesse, soit dans le peuple : Par le Christ, je fais cela ; Par le Christ, j'en agis de la sorte ; Par le Christ, je ne dirai rien autre chose ; Par le Christ, je ne ferai rien autre chose. Et quoi de plus ? la chose en est venue là, que le nom du Christ ne semble plus être un serment, mais un mot ordinaire, comme déjà nous l'avons dit des barbares païens. La plupart estiment si peu ce nom sacré, que jamais ils ne songent moins à faire une chose, que lorsqu'ils jurent par le Christ de l'exécuter. Et quoiqu'il soit écrit : Tu ne prendras point le nom du Seigneur ton Dieu en vain, le respect pour le Christ est porté si haut que, parmi toutes les vanités du siècle, rien ne semble plus vain que le nom du Christ. Ce ne sont point seulement des choses oiseuses et frivoles, mais encore des crimes qu'on jure par le nom du Christ, de mettre à exécution. Telle est la formule ordinaire : Par le Christ, je lui enlèverai son bien ; Par le Christ, je le frapperai ; Par le Christ, je le tuerai. Il en résulte alors, qu'après avoir juré par le nom du Christ, l'on se fait un point de religion de commettre même des crimes. Mais je vais raconter ce qui m'est arrivé à moi-même. Il y a quelque temps, pour condescendre aux instances d'un homme pauvre, je suppliais un homme riche et puissant, et le conjurais de ne pas dépouiller ce malheureux, dans son indigence, du modeste héritage qui le faisait subsister, de ne point lui enlever ces dernières ressources dont il soutenait sa pauvreté. Le riche, qui dans sa soif ambitieuse avait convoité cette proie, et qui la dévorait déjà dans l'ardeur de l'espérance et de la cupidité, me lança des regards terribles, comme s'il eut pensé que je lui ravissais tout ce qu'il n'aurait pas enlevé lui-même à autrui, et me répondit qu'il lui était impossible de m'accorder ce que je lui demandais, me faisant comprendre qu'il agissait en vertu d'un précepte et d'un engagement sacré qu'il ne pouvait violer. Je l'interrogeai sur le motif de son refus, il me dit une chose très forte assurément et qui ne devait pas souffrir de contradiction. — J'ai juré par le Christ de dépouiller cet homme-là. Voyez donc si je puis ou si je dois me dispenser d'exécuter ce que j'ai promis d'accomplir, au nom même du Christ. — Moi alors, (que faire devant un prétexte si juste et si saint ?) ayant appris la raison d'un crime si religieux, je me retirai. Je le demande ici à tous ceux dont l'esprit est sain : Qui pourrait croire jamais que l'audace de l'humaine cupidité en viendrait jusqu'à ce degré d'insulte envers Dieu, de soutenir qu'on fera pour le nom du Christ, les choses même qui l'outragent le plus ? O crime monstrueux et inconcevable ! De quoi n'est point capable la perversité du cœur ? On s'anime au brigandage par le nom du Christ, on le fait, en quelque sorte auteur de son crime ; tandis qu'il défend et punit le mal, c'est pour l'honorer, dit-on, qu'on accomplit les plus grands forfaits. Et nous osons nous plaindre de l'injustice de nos ennemis ! nous osons alléguer les parjures des barbares païens ! Combien ils sont moins coupables en se parjurant par les démons, que nous en nous parjurant par le Christ ! Combien c'est une chose moins criminelle de se jouer du nom de Jupiter, que de celui du Christ ! Là, c'est un homme mort, que celui par lequel on jure. Ici, c'est un Dieu vivant, que celui par lequel on se parjure. Là, il n'y a pas même un homme ; ici, il y a un Dieu souverain. Ici, comme le serment est redoutable, le parjure aussi doit être une faute grave. Là, comme il n'y a presque pas de serment, il n'y a pas non plus de parjure. Car celui par lequel on jure n'étant pas Dieu, il n'y a pas de parjure à violer son serment. Enfin, si vous voulez vous convaincre de la vérité de cela, écoutez le bienheureux apôtre Paul proclamant ce que nous disons nous-mêmes. C'est ainsi qu'il s'exprime : Nous savons que toutes les paroles de la loi s’adressent à ceux qui sont sous la loi. Et encore : Là où il n'y a point de loi, il n'y a point de prévarication. Dans ces deux passages l'Apôtre distingue évidemment deux parties du genre humain ; ceux qui sont placés hors de la loi, et ceux qui vivent sous la loi. Or, quels sont ceux qui vivent sous la loi ? Quels peuvent-ils être si ce n'est les Chrétiens, comme l'Apôtre ? Il dit de lui-même : Je ne suis pas sans la loi de Dieu, ayant celle de Jésus-Christ. Quels sont donc ceux qui vivent sous la loi du Christ ? Quels peuvent-ils être, si ce n'est les païens, qui ne connaissent pas la loi du Seigneur ? Et c'est pour cela qu'il dit en parlant d'eux : Là où il n'y a point de loi, il n'y a point de prévarication. Ces paroles montrent que les seuls Chrétiens sont prévaricateurs de la loi, lorsqu'ils pèchent, et que les païens qui ne la connaissent pas, pèchent, il est vrai, sans être cependant prévaricateurs. Car, nul ne peut être prévaricateur d'une loi qu'il ne connut jamais. Nous sommes donc les seuls prévaricateurs de la loi divine, nous qui lisons la loi et ne la pratiquons pas. Et par-là, notre science devient notre condamnation, puisque nous ne connaissons la loi que pour pécher encore plus grièvement ; car, les choses que nous lisons, que nous avons dans l'esprit, nous les foulons dédaigneusement aux pieds, emportés par la passion. C'est donc avec justice qu'on peut adresser à tout Chrétien le reproche de l'Apôtre : Vous qui vous glorifiez d'avoir la loi, vous déshonorez Dieu par la violation de la loi. Car vous êtes cause que le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations. Par cela même que les Chrétiens déshonorent le nom de Dieu, on peut comprendre l'énormité de leur crime. Il nous est prescrit de tout faire pour la gloire de Dieu ; nous, au contraire, nous cherchons à le déshonorer en tout. Notre Sauveur nous crie chaque jour : Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et au ils glorifient votre Père, qui est dans les deux ; et nous, nous vivons de manière à ce que les fils des hommes voient nos actions mauvaises, et blasphèment notre Père qui est dans les cieux. Après cela, nous pouvons bien, sans doute, nous flatter de la noble prérogative du nom de Chrétien, nous qui agissons et vivons de telle sorte, que ce nom-là même semble devenir l'opprobre du Christ. Chez les Païens, au contraire, que voyons-nous de semblable ? Peut-on dire des Huns : Voilà comment ils sont, les hommes qui se disent Chrétiens ? Peut-on dire des Saxons ou des Francs : Voilà ce qu'ils font, les hommes qui se donnent pour être les adorateurs du Christ ? Blâme-t-on la loi sainte pour les mœurs féroces des Maures ? Les rites inhumains des Scythes ou des Gépides portent-ils à maudire et à blasphémer le nom du Sauveur ? Peut-on dire d'aucun de ces peuples : Où est la loi catholique objet de leur croyance ? Où sont les préceptes de piété et de chasteté qu'ils apprennent ? Ils lisent les Evangiles et ils sont impudiques. Ils entendent les Apôtres, et ils s'enivrent ; ils suivent le Christ, et ils dérobent ; ils mènent une vie mauvaise, et ils prétendent posséder une loi bonne ? Peut-on dire cela de quelqu'une de ces nations ? Non, certes. Car c'est de nous que l'on dit toutes ces choses. En nous, le Christ souffre l'opprobre ; en nous, la loi chrétienne souffre malédiction, car c'est de nous que l'on dit tout ce dont nous avons parlé : Voilà comment ils sont, les hommes qui adorent le Christ ? Ils trompent, lorsqu'ils se glorifient d'apprendre de bonnes choses, lorsqu'ils se vantent de suivre les maximes d'une loi sainte. S'ils apprenaient de bonnes choses, ils seraient bons. Telle secte, tels sectateurs. Ils sont sans doute ce qu'on les fait. Il paraît donc que leurs Prophètes enseignent l'impureté, que leurs Apôtres sanctionnent le crime, que leurs Evangiles prêchent ce qu'ils font. En un mot, les actions du Chrétien seraient saintes, si le Christ avait enseigné la sainteté. Par ceux qui l'honorent, on peut juger de celui qui est honoré. Comment serait-il un bon maître, celui dont nous voyons les disciples si méchants ? Car les Chrétiens viennent du Christ, ils l'écoutent, ils le lisent. Il est facile à tout le monde de connaître sa doctrine. Voyez ce que font les Chrétiens, et vous saurez ce que le Christ enseigne. Enfin, rien ne prouve mieux l'opinion perverse et coupable des païens touchant les sacrifices du Seigneur, que les sanglantes recherches de ces persécuteurs féroces qui ne voyaient dans les sacrifices chrétiens que des impuretés et des abominations. Ils croyaient même que notre religion tirait son origine de deux grands crimes, d'abord l'homicide, puis, ce qui est plus grave encore, l'inceste. Et non seulement l'homicide et l'inceste, mais ce qui est plus impie encore, l'inceste et l'homicide à la fois : l'inceste, en la personne des mères que la nature a rendues sacrées ; l'homicide, en la personne de petits enfants innocents, qu'ils croyaient non seulement immolés, mais ce qui est bien plus abominable encore, dévorés même par les Chrétiens. Et tout cela, pour apaiser Dieu, comme s'il était un forfait qui pût l'offenser davantage ; pour expier leurs crimes, comme si ce dernier n'était pas le plus grand de tous ; pour faire agréer leur sacrifice, comme s'il était quelque chose que le Seigneur ait plus en abomination ; pour mériter la vie éternelle, comme s'il valait la peine d'y parvenir par des forfaits aussi atroces, quand bien même ils pourraient y conduire ! Par-là, nous pouvons comprendre quelle idée les infidèles se formaient des Chrétiens qui honoraient Dieu par de tels sacrifices, ou quelle opinion injurieuse ils avaient de ce même Dieu qui avait enseigné ces mystères. Et pourquoi cela ? pourquoi ! Si ce n'est à cause de ces hommes qui portent le titre de Chrétiens, et qui ne le sont pas ; qui, par leurs crimes et leurs turpitudes, déshonorent le nom de la religion ; qui, suivant l'Ecriture, font profession de connaître Dieu, mais le renoncent par leurs actions, étant abominables et rebelles, et incapables de toute bonne œuvre ; qui font blasphémer, comme dit encore l'Ecriture, contre la voie de la vérité et qui exposent le nom saint du Seigneur Dieu aux malédictions outrageantes des hommes sacrilèges. Or, ce qu'il y a de grave et de spécial dans le crime de ceux qui livrent aux blasphèmes des nations le nom de la divinité, c'est ce que nous apprenons par l'exemple du bienheureux David. Le suffrage de ses justices antérieures lui avait valu d'échapper, par un seul aveu, à la peine éternelle que méritaient ses offenses ; et cependant, malgré la pénitence qui plaidait pour lui, il ne put obtenir le pardon de son scandale. Car, après que David eut confessé sa faute, le prophète Nathan lui dit : Le Seigneur a transféré ton péché ; tu ne mourras pas ; mais il ajoute aussitôt : Cependant, parce que tu as fait blasphémer les ennemis du Seigneur, le fils qui t'est né mourra de mort. Qu'arriva-t-il ensuite ? David dépose le diadème, il rejette l'or et les pierres précieuses, il dépouille la pourpre, il écarte tout ornement de splendeur royale, et, loin de tout cet appareil, lorsque solitaire, gémissant, dans la retraite, couvert d'un sac informe, baigné de pleurs, défiguré sous la cendre, il demandait la vie de son enfant par la voix éloquente de tant de lamentations, qu'il cherchait à émouvoir le Dieu plein de tendresse par de si ardentes prières, ses vives obsécrations ne purent néanmoins le faire exaucer ; et pourtant, ce qui est d'an merveilleux secours dans les supplications, il espérait obtenir la faveur qu'il réclamait ainsi de Dieu. D'où l’on peut conclure qu'il n'est point de plus grand crime que de donner aux nations infidèles l'occasion de blasphémer. Car, commettre une faute grave sans qu'il en résulte de scandale pour autrui, c'est ne damner que soi. Mais celui qui fait blasphémer les autres, précipite bien des âmes avec lui dans la mort éternelle, et il sera nécessairement responsable de tous ceux qu'il aura entraînés au crime. Et ce n'est pas tout ; quiconque pèche sans faire blasphémer les autres par son péché, n'est chargé que du crime qu'il a commis, car il ne livre pas le nom saint de Dieu aux malédictions sacrilèges des blasphémateurs. Mais celui qui fait blasphémer les autres, outrepasse les bornes des crimes ordinaires, parce qu'il outrage Dieu d'une manière inconcevable en donnant lieu à de nombreux sarcasmes. Ce péché, comme je l'ai déjà dit, est particulier aux Chrétiens, puisqu'ils sont les seuls par qui Dieu est blasphémé, eux qui apprennent des choses bonnes et qui en font de mauvaises ; qui, suivant le langage de l'Ecriture, confessent Dieu de bouche, et le renoncent par leurs actions ; qui, au dire de l'Apôtre, se conforment à la loi, connaissent sa volonté, et savent discerner ce qui est le meilleur ; qui possèdent, dans la loi, la règle de la science et de la vérité ; qui prêchent qu'il ne faut pas dérober, et qui dérobent ; qui lisent qu'il ne faut point commettre d'adultère, et qui commettent des adultères ; qui se glorifient d'avoir la loi, et qui déshonorent Dieu par la violation de la loi. Et voilà pourquoi les Chrétiens sont d'autant plus condamnables qu'ils devraient être meilleurs. Car leur conduite ne confirme point leur doctrine, et leurs mœurs démentent leur profession. Cette malice mérite une condamnation bien plus sévère, qui trouve son accusateur dans un titre honorable ; un nom saint devient un crime dans un impie. De là vient que, dans l'Apocalypse, le Sauveur dit à un homme tiède : Plût à Dieu que tu fusses froid ou chaud ! — Mais parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Le Seigneur ordonne à tout chrétien d'être fervent en esprit et en foi, car c'est ainsi qu'il est écrit : Soyez fervents en esprit, c'est le Seigneur que vous servez. L'ardeur de la foi religieuse se manifeste donc dans cette ferveur de l'esprit. Celui qui a le plus de cette ardeur, se montre fervent et fidèle ; celui qui n'en a pas du tout, se fait connaître comme un homme froid et infidèle. Mais celui qui flotte entre la froideur et la ferveur, est un homme tiède et abominable aux yeux du Seigneur. C'est pour cela qu'on lui adresse ces paroles : Plût à Dieu que tu fusses froid ou chaud ; mais parce que tu es tiède je te vomirai de ma bouche. Ce qui revient à dire : Plût à Dieu que tu eusses la chaleur et la foi des bons Chrétiens, ou du moins la froideur et l'ignorance des païens ; car alors une foi brûlante pourrait t'unir à Dieu, ou du moins, l'ignorance de la loi t'excuserait en quelque sorte pour le présent. Maintenant, parce que tu as connu le Christ, et que tu le négliges après l'avoir connu, toi qui as été admis, pour ainsi dire, dans le sein de Dieu par le mérite de ta foi, tu en seras rejeté à cause de ta tiédeur. Le bienheureux apôtre Pierre expose clairement cette vérité, lorsqu'il parle ainsi des hommes tièdes et vicieux, c'est-à-dire, des Chrétiens qui vivent mal : Il eût mieux valu pour eux qu'ils n'eussent point connu la vérité, que de retourner en arrière après l'avoir connue, et d'abandonner la loi sainte qui leur avait été donnée. —Mais il leur est arrivé ce que dit un proverbe très véritable : Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi ; et, le pourceau lavé s'est roulé de nouveau dans la boue. Voulez-vous vous convaincre qu'il est ici question de ceux qui, sous le nom de Chrétiens, vivent dans les infamies et les impuretés du siècle, écoutez ces autres paroles du même Apôtre : Si ceux qui, par la connaissance de Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur, s'étaient retirés de la corruption du monde, se laissent vaincre en s'y engageant de nouveau, leur dernier état devient pire que le premier. C'est ce que dit encore de la même manière le bienheureux apôtre Paul : Ce n’est pas que la circoncision ne soit utile, si vous accomplissez la loi ; mais si vous la violez, tout circoncis que vous êtes, vous devenez incirconcis. Il nous apprend lui-même que par la circoncision l'on doit entendre le christianisme. Car, dit-il c'est nous qui sommes les vrais circoncis, nous qui servons Dieu en esprit, sans nous confier à la chair. Par-là nous voyons qu'il compare aux païens les mauvais Chrétiens ; il ne compare pas seulement, il met presque les derniers au-dessous des premiers, lorsqu'il dit : Si donc un homme incirconcis garde les ordonnances de la loi, n'est-il pas vrai que tout incirconcis qu'il est, il sera considéré comme circoncis ? — Et celui qui étant naturellement incirconcis accomplit la loi, vous condamnera, vous qui avez la lettre de la loi et la circoncision êtes transgresseurs de la loi. D'où l'on peut conclure comme je l'ai déjà dit, que nous sommes beaucoup plus coupables, nous qui possédons la loi divine et la méprisons, que ceux qui ne la possédèrent ni ne la connurent jamais. Car, on ne saurait mépriser ce qu'on ne connaît point. Je n'aurais point connu la convoitise, dit l'Apôtre, si la loi n’avait dit : Vous ne convoiterez point. L'on ne transgresse point une loi qu'on n'a pas ; parce que, suivant l'Ecriture, là ou il n’y a point de loi, il n'y a point non plus de prévarication. Ainsi donc, si l'on ne peut transgresser une loi qu'on n'a pas, on ne saurait transgresser non plus des préceptes qu'on ignore ; car, personne ne méprise ce qu'il ne connaît pas. Nous sommes donc tout à la fois et contempteurs et prévaricateurs, et par-là bien au-dessous des païens. Ils ne connaissent point les commandements de Dieu, nous les connaissons ; ils n'ont point sa loi, nous la possédons ; s'ils ne suivent pas les divins préceptes, c'est qu'ils ne les ont point entendus, et nous, après les avoir lus, nous les foulons aux pieds. Et ainsi, chez eux c'est ignorance ; chez nous c'est prévarication, car il est bien moins criminel d'ignorer la loi que de la mépriser.
|