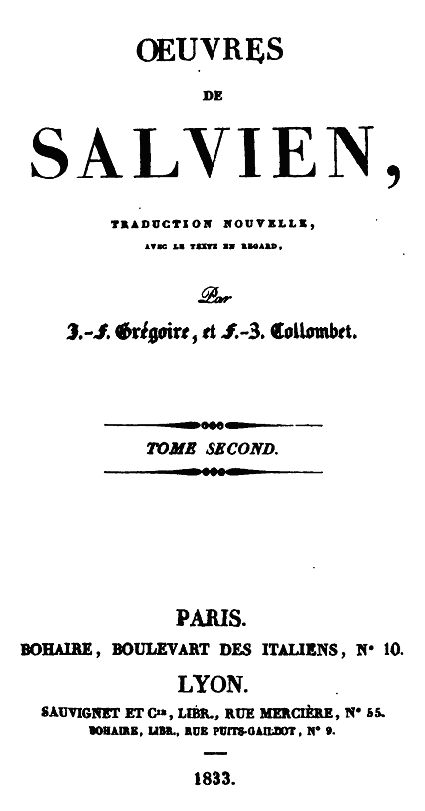
SALVIEN
INTRODUCTION.
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
Alors que Rome, celte ville maîtresse, fatiguée de conquêtes et lasse de triomphes, se reposait bercée mollement par les douceurs d'une paix universelle; alors qu'elle convoquait en son sein tout ce qu'il y avait dans l'empire de poètes à la suave harmonie, d'orateurs aux paroles dorées , de philosophes aux vastes conceptions, et qu'elle dispensait au génie ces palmes jusque-là réservées au courage ; alors que le monde romain, oublieux des antiques vertus, se plongeait dans les enivrements des voluptés, dans les séductions du luxe, dans les impudences du vice, que la morale s'en allait expirante, que les Socrates passaient inaperçus, que leurs voix mouraient sans écho, perdues dans ce fracas assourdissant de passions, dans ses longues acclamations de plaisir; que les peuples courbés sous l'esclavage, traînaient péniblement leurs chaînes parfois recouvertes de fleurs, mais plus souvent ensanglantées, et que le sage soulevant avec douleur ses yeux vers le ciel, regardait l'Orient, croisait ses bras et attendait! — Dans ce bouleversement de toutes choses, un Dieu-homme naissait, prêchait et mourait en un coin de l'Asie, et ses disciples, enflammés d'une héroïque ardeur, tentaient de régénérer la face du monde, préparaient l'émancipation des peuples, embrassaient dans leur gigantesque ambition les terres encore ignorées, et, voyageurs audacieux, marchaient à la conquête de Rome, sans autres armes qu'une croix de bois, sans autres auxiliaires qu'une morale austère et rebutante.
Voyez-les, ces pèlerins du ciel ! voyez comme ils affrontent tous les dangers, comme ils terrassent toutes les contradictions, comme ils relèvent toutes les espérances, comme ils consolent toutes les infortunes , comme ils captivent toutes les attentions , comme ils s'insinuent dans tous les cœurs, comme ils enchaînent toutes les intelligences! — La grande cité les avait vus passer, et elle avait souri ! Les puissants avaient à peine laissé tomber un regard de dédain sur ces hommes aux dehors si vulgaires, le peuple les avait aperçus, et indifférent, il était retourné à ses spectacles, à ses jeux! — Mais voilà que leurs paroles ont retenti, et Rome s'est émue! L'univers a entendu, et il s'est troublé ! L'Asie soulevant sa paupière mourante, a cru voir la lumière, et s'est prise d'amour pour elle! La Grèce, abjurant ses fables antiques et reniant son Olympe, a salué le Dieu inconnu! La vieille Italie a retrouvé son âge d'or, les Gaules ont échangé leurs superstitions druidiques contre le symbole chrétien ; les nations amassées aux froides régions du Nord, ont accueilli dans leurs bras amoureusement entr'ouverts la Croix qui s'avançait resplendissante; dans tous les cœurs s'est fait sentir une vaste sympathie pour l'humanité ; l'esclave a repris son rang d'homme; l'œuvre de régénération universelle a été commencée, et le signe du Christ a plané sur le monde, étendard sublime à l'ombre duquel sont venus se rallier les sectateurs de l'Évangile! Tel est le tableau merveilleux que présente à nos regards le spectacle de la prédication apostolique. Sans doute, le doigt de Dieu était là; sans doute, les prodiges opérés par les disciples du Christ frappaient les imaginations confondues et arrachaient la conviction ; sans doute, la beauté de la morale évangélique, les vertus des premiers chrétiens, ce je ne sais quoi de céleste et de divin qui respire dans les enseignements des Apôtres : tout cela pouvait bien entraîner quelques ames déjà façonnées par la philosophie. Mais que plus tard, lorsque l'intervention du ciel était moins fréquente, le même spectacle ait été donné au monde, que la richesse ait dédaigné ses trésors, que la volupté ait abjuré ses joies, que l'opulence ait échangé son luxe contre la pauvreté du Christ, que la philosophie ait embrassé la folie de la croix , que le savoir orgueilleux se soit laissé prendre à la simplicité des Evangiles, oh! voilà, certes, qui doit étonner. Elle avait un étrange ascendant, cette éloquence qui surmontait à la fois tant d'obstacles! Jadis les philosophes avaient régné sans contestation; nulles difficultés n'entravaient leur marche; achever l'édifice commencé par leurs devanciers, c'était là toute leur œuvre. Mais les Pères, à leur apparition première , virent autour d'eux se dresser tout armés de nombreux contradicteurs, et, semblables à ces Juifs nouveaux-venus de Babylone, il leur fallait combattre d'une main, édifier de l'autre. C'est donc en quelque sorte sous ce double rapport d'apologistes et de législateurs que nous pouvons les considérer; dans cet examen , les premiers siècles de l'Eglise viennent se dérouler au spectateur émerveillé. Elle lui apparaît d'abord cachée dans l'ombre, puis grandissant tout-à-coup, enveloppant l'univers de ses réseaux invisibles, et enfantant de vigoureux génies; toujours attaquée, toujours triomphante, siégeant enfin sur les ruines du vieux paganisme, on la voit se lever belle de son passé, majestueuse de son avenir, sauver l'Europe jetée en proie à d'innombrables essaims de Barbares, et ressusciter le culte sacré des lettres, des arts et des sciences.
Le christianisme, fort et puissant, jetait »u loin des racines profondes; toutefois, il n'était point encore cet arbre gigantesque dont l'ombre hospitalière devait plus tard abriter l'univers; mais lorsque, fécondé par une rosée céleste, il commençait à prendre de rapides accroissements, voilà que le sol gronde et s'agite, que le fer menace ses racines, que la flamme pétille autour de lui. Tentatives inutiles! les rameaux émondés reverdissent plus vigoureux et plus vivaces, le tronc défiant la cognée, se dresse plus majestueux et plus fier, l'arbre fixé dans les profondeurs de la terre, élève un front sublime vers le ciel, et atteste l'impuissance des tonnerres et des foudres.
D'où venaient donc à la religion du Christ, ces persécutions et ces attaques? — Le judaïsme recueillant ses débris épars, la philosophie cherchant à rajeunir le paganisme décrépit, les sectes nées au sein même de l'Eglise : tels furent les ennemis que les Pères eurent à désarmer et à vaincre.
Les Juifs déicides avaient subi l'arrêt de la céleste vengeance , des malheurs inouïs avaient pesé sur eux, et Jérusalem les avait vomis de son enceinte. Elle était tombée, la ville superbe qui tuait les Prophètes et versait le sang du Juste, elle était tombée avec son temple, avec ses palais, et il n'était pas demeuré pierre sur pierre, ainsi que l'avait annoncé l'oracle de vérité. Forcés d'abandonner des lieux tout fumans encore de la foudre, les Juifs s'éloignèrent à regret d'une patrie marquée par tant de désastres et qu'ils ne devaient plus habiter jamais; indociles à de si terribles leçons, ils emportaient avec eux ces rêves d'une domination universelle, cette attente d'un Messie conquérant, ces chimères d'une félicité terrestre; parfois ils se retournaient pour contempler encore les débris de leur cité, mais une irrésistible puissance semblait les pousser vers l'exil. Ils voyaient les peuples se détourner à leur passage, les cœurs se resserrer pour eux, et le glaive romain précipiter leur marche. La plupart promenèrent sur tout le globe leurs infortunes et leurs espérances; quelques-uns se fixèrent dans les lieux où jadis leurs ancêtres avaient été captifs; d'autres s'arrêtèrent sur les rives de la mer Rouge, vénérable retraite des Esséniens. D'autres adoucissant l'exil par l'étude des livres sacrés, fondèrent l'école de Tibériade et commencèrent à réduire en système ces rêveries cabalistiques, empruntées aux doctrines de l'Orient.
Mais, au milieu de leurs vastes douleurs, ce qui venait ajouter encore à l'amertume de leurs pensées, c'était de voir se propager avec une effrayante rapidité un culte odieux dont l'influence était si funeste à eux tous; devoir glorifié parmi les peuples ce novateur que leurs pères avaient flétri d'un infâme supplice; de voir Jéhovah, le Dieu de Sion, réserver aux disciples du Christ toutes les faveurs dont il était jadis si prodigue, pour eux la nation choisie, pour eux les fils d'Abraham et d'Israël !
Alors des torrents de haine bouillonnaient dans leurs cœurs, des pensées de vengeance fermentaient dans leurs âmes ; ils vouaient aux atrocités de la mort ces Chrétiens nouveaux-venus qui semblaient les déposséder de leurs droits antiques et les déshériter des magnifiques promesses du Sinaï; ils applaudissaient aux persécutions dirigées contre ces importuns rivaux; ils s'enivraient du spectacle de leurs supplices, ils se délectaient à voir couler leur sang, irrités de n'en avoir pu tarir la source au sommet de Golgotha; et plus d'une fois des mains juives allumèrent le bûcher, aiguisèrent l'épée, préparèrent les tortures qui devaient assurer le triomphe à de nombreux martyrs et enfanter une nouvelle race de Chrétiens.
Les siècles ont emporté la plupart des livres écrits en haine du christianisme, l'histoire non plus n'a pas transmis jusqu'à nous les attaques des Juifs contre le Christ et son culte; toutefois, l'on peut conjecturer que, au milieu de cette agitation des puissances terrestres , quand les princes s'épuisaient en efforts superflus, quand les nations frémissaient, quand les peuples méditaient de vains complots, l'on peut conjecturer que les Juifs vinrent grossir, eux aussi, cette ligue universelle. Quelques ouvrages des Pères, datés de cette époque, semblent confirmer cette opinion; car il n'est pas à présumer que, harcelés déjà de toutes parts, les orateurs chrétiens si tolérants alors et si inoffensifs, eussent provoqué sans cause des adversaires paisibles et silencieux. Ah! qui nous eût donné d'assister à une de ces controverses privées qui parfois devaient s'engager entre les deux sectes rivales! — D'un côté, le Juif, tout fier de son passé, se reportant par le souvenir aux jours glorieux de ses pères, et déroulant dans sa pensée les grandes œuvres de Jéhovah, puis contemplant d'un œil sombre et mélancolique les lieux où avait été sa patrie, et comme l'Archange déchu , soulevant contre le ciel un front cicatrisé par la foudre. — D'un autre côté, le Chrétien né d'hier et comptant partout des frères, le Chrétien paraissant dans l'arène plein d'une humilité douce et d'une modestie sans fard, portant sur le front l'assurance de la victoire, et semblant en quelque sorte entrevoir dans l'avenir les triomphes réservés à la cause du Christ : — sur les traits du Juif, vous lisez le courroux voilé par l'ironie ; sur les traits du Chrétien respire je ne sais quoi de sympathiquement débonnaire; —le premier se fie à des livres qu'il n'entend plus, et qui sont contre lui; — le second s'appuie sur des prodiges récents encore et que le monde ne saurait contester; — le premier s'est fait le champion d'une cause qui a vécu son âge et qui s'en va mourante; — le second s'érige en défenseur d'une croyance toute palpitante de jeunesse et qui déjà touche à sa virilité, immortelle qu'elle doit être à jamais. — Ce qu'il salue de ses adorations et de sa foi, le Chrétien, c'est un astre qui se lève dans sa pompe radieuse pour éclairer un jour sans fin ; — ce qu'il voudrait ressusciter, le Juif, c'est un soleil plus qu'à demi voilé par de noires ténèbres, c'est une lumière éclipsée qui ne laisse plus entrevoir dans un terne horizon que de pâles et lugubres reflets!
Une fois l'astre éteint, ils n'en ont pas moins poursuivi leur route au milieu des ténèbres; ils ont traversé en tout sens le monde épouvanté. Ils marchaient à l'aventure, là où les conduisaient leurs pas errants; semblables à ces malades que le sommeil ne saurait enchaîner, ils allaient, voyageurs endormis, à travers les générations qui s'agitaient bruyantes, sans pouvoir les distraire d'un rêve si longtemps continué! Parfois leurs yeux entr'ouverts semblaient se détourner d'une vision importune : c'était la croix, spectre effrayant, qui leur apparaissait terrible ; on les voyait tâtonner et chercher, mais à peine saisi, le fantôme disparaissait comme une ombre, et puis ils trébuchaient lourdement, objets de pitié et d'effroi; d'une main agitée s'empressaient-ils d'effacer de leur front une sentence indélébile? soudain les caractères tracés par un doigt immortel reparaissaient tout sanglants et désignaient leur crime aux peuples consternés ! — Ainsi ont-ils marché depuis que l'éloquence chrétienne les a terrassés pour jamais; ainsi marcheront-ils jusqu'au jour où, leurs yeux se dessillant à la lumière, ils viendront grossir le bercail du Christ pour adorer ce qu'ils n'avaient cessé de blasphémer et de maudire. Et ce n'étaient là encore que les moindres ennemis du christianisme : du milieu de cette société païenne surgissait une nouvelle philosophie qui rattachait les lambeaux du passé à ses rêveries à elle, et tentait de retarder quelques heures la longue agonie du paganisme. On ne retrouvait plus là ni le haut génie du divin Pythagore, ni la douce morale du tolérant Socrate, ni les sublimes enseignements du sage Platon, ni les vertus élevées de l'austère Portique ; c'était un mélange confus de toutes les doctrines, un assemblage informe de toutes les traditions, un bizarre amalgame d'erreurs et de vérités. Jaloux du merveilleux accroissement que prenait chaque jour l'Évangile , ces philosophes de la veille osaient contester à la morale évangélique l'antiquité de ses doctrines. Ils ignoraient ou feignaient d'ignorer que la révélation du Christ n'est autre chose que le complément, ou, si l'on aime mieux, le développement des révélations faites à l'humanité en des âges divers. Pour détruire, ou tout au moins pour contrebalancer la force qu'une si vénérable origine prétait aux dogmes catholiques, ils essayèrent de relever le culte de Jupiter abattu par le ridicule, et de le montrer s'appuyant, lui aussi, sur la sanction des siècles. Ils transformèrent en symboles mystérieux toutes ces bizarres divinités du paganisme, ils détournèrent à leur profit toutes les vieilles traditions, ils interprétèrent à leur guise tous les oracles obscurs de Dodone ou d'Ephèse, ils déterrèrent tous les secrets impénétrables des premiers temps, pour en faire jaillir un témoignage en leur faveur ; ils voulaient ainsi élever édifice contre édifice, opposer principe à principe, et ruiner sans retour le christianisme qui les épouvantait si fort.
Leurs noms pouvaient imposer aux esprits vulgaires.
— C'était Plotin , génie ami des hautes et sublimes contemplations; il s'était frayé une route nouvelle dans les vastes champs de la métaphysique, et, le premier, au sein de la décadence, il avait ressuscité cette fureur de philosophie jadis si commune dans la Grèce discoureuse.
— C'était Jamblique, dont l'esprit voué aux aberrations du mysticisme, rêvait profondément des mystères de la nature cachée sous les symboles égyptiens, et ne cherchait la vérité que sous le voile de l'allégorie ; d'autant plus dangereux , qu'il était plus inoffensif, d'autant plus difficile à terrasser, que ses armes semblaient plus innocentes.
— C'était Celse l'apostat : chrétien d'abord, il s'était ensuite épris de la nouvelle philosophie, et il était devenu l'un des plus fougueux adversaires du christianisme; le temps nous a conservé sa redoutable polémique. Ses objections portent d'autant mieux que, aune éloquence vigoureuse et rapide, il unissait une connaissance approfondie du culte qu'il avait renié; il ne fallait rien moins pour le réduire au silence, que le vaste génie d'Origène, prodige de savoir qui se trouvait là, placé par la Providence, comme un rempart contre les ennemis de l'Eglise.
— C'était Apollonius, bizarre parodie du Christ; au dire de Philostrate son panégyriste, au dire des philosophes contemporains, il aurait rempli l'Orient de son nom et de ses miracles, mais à n'écouter qu'une saine critique, bien loin d'en faire un thaumaturge rival de Jésus-Christ, on pourrait aller même jusqu'à révoquer en doute son existence.
— C'était enfin les Libanius, les Maxime, et mille autres philosophes plus ou moins connus , plus ou moins accrédités, qui par différents moyens cherchaient à anéantir le christianisme, pour y substituer leurs folles pensées et leurs extravagantes rêveries.
Ils s'adressaient à toutes les passions, savaient employer tous les ressorts, toucher à toutes les cordes sensibles.
Celui-ci évoquait la vieille Rome tout éplorée et regrettant ses dieux évanouis; il rappelait ces temps antiques où le culte de Jupiter étalait dans la ville souveraine ses augustes solennités et ses pompes triomphales, il plaidait la cause de ces divinités usées et cherchait à réveiller en leur faveur le patriotisme assoupi des Romains; puis, après une longue énumération de héros, de conquêtes , de vertus et de nobles exemples, il demandait insolemment ce que pouvait enfanter de semblable la secte nouvelle avec ses dogmes étrangers et ses bizarres superstitions.
Celui-là cherchait à capter les intelligences ennemies de tout frein ; il réclamait à haute voix l'affranchissement de la raison que le christianisme voulait asservir à d'absurdes croyances, il ridiculisait ces dogmes sévères que l'Evangile imposait à la foi, et, dans son rationalisme orgueilleux, il en appelait à la dignité de l'homme de tout ce qui lui semblait, à lui, une violation des droits les plus sacrés.
Un autre, adulateur insidieux, représentait les Chrétiens comme des conspirateurs obscurs, espèce île société à part qui s'isolait des intérêts publics, qui abjurait les souvenirs de la patrie, qui ne portait qu'avec impatience le joug des empereurs, et qui marchait à la conquête d'un avenir merveilleux, dont la réalisation tendait à effacer du monde et l'empire et la gloire de Rome. Plusieurs allaient jusqu'à transformer en une sorte de puissance magique le christianisme, qui chaque jour leur enlevait des adeptes; quelques-uns ne voyaient dans le courage héroïque des martyrs qu'un sombre fanatisme plus capable d'inspirer l'horreur que d'émouvoir la pitié; d'autres attribuaient à je ne sais quelle apathie ces abnégations sublimes, ces renoncements surhumains que le stoïcisme n'avait pas même soupçonnés.
A tant d'inculpations diverses , les fidèles n'opposaient qu'un héroïque silence ou le spectacle plus héroïque encore de leurs vertus : soldats invincibles, ils se montraient aussi courageux dans les combats qu'intrépides dans les supplices ; c'étaient les légions chrétiennes qui seules retraçaient la valeur des antiques Romains, et qui retardaient encore la chute de l'empire tout prêt à s'écrouler sous les attaques redoublées des Barbares; citoyens irréprochables, ils payaient par des bienfaits les outrages qui leur étaient prodigués; ils apparaissaient comme des consolateurs au milieu des calamités, comme des anges de paix au sein des discordes publiques ; les empereurs n'avaient pas de sujets plus fidèles, la patrie pas de plus fermes soutiens, les lois pas d'observateurs plus exacts; ils faisaient des vœux pour la prospérité de l'empire qui les eût voulu rejeter de son sein, pour le salut des maîtres qui les proscrivaient chaque jour, pour l'agrandissement de Rome qui les repoussait comme de coupables agitateurs. —Voilà pour le peuple chrétien.
Et les apologistes se présentaient en foule, désireux d'accepter le défi proposé ; ils faisaient servir à la défense de l'Evangile tout ce que la philosophie avait de plus grave, tout ce que l'antiquité présentait de plus respectable, tout ce que l'histoire offrait de plus riche, tout ce que les mythes cachaient de plus profond; avec le flambeau d'une érudition imposante, ils remontaient les âges passés pour y chercher, par de longues et pénibles investigations, les dogmes catholiques altérés par le mensonge ; ils mettaient à nu toutes les turpitudes des dieux païens, et puis ils se prenaient à rire de ces divinités prétendues; sous leur plume savante, on voyait le catholicisme dérouler ses titres d'ancienneté, et traverser les siècles , là , défiguré par l'orgueil , ici, jetant comme en témoignage de vie des lueurs brillantes, dans la personne des sages en qui il s'était incarné pour arriver à son entier développement. Leur éloquence avait quelque chose d'entraînant et de persuasif qu'on ne retrouvait pas dans leurs antagonistes superbes ; avec eux s'étaient révélées au monde une nouvelle littérature et une philosophie nouvelle. — Voilà pour les orateurs chrétiens.
Et le christianisme poursuivait sa marche gigantesque, balayant les vieilles institutions, entraînant dans sa course les idées et les mœurs, plantant son étendard sur les temples écroulés, et promenant par toute la terre son lumineux flambeau. Les oracles devinrent muets , les sanctuaires furent abandonnés, les dieux tombaient en discrédit, la philosophie ne compta plus qu'un petit nombre de sectateurs, et l'univers s'étonna de se trouver chrétien.
Dès lors une marche nouvelle est imprimée au christianisme; libre d'ennemis extérieurs, il va, comme la vieille Rome, en rencontrer de nouveaux pullulant dans ses entrailles; mais, impérissable qu'il est, on le verra triompher encore de ces attaques; il trouvera dans ses Hilaire, dans ses Augustin, dans ses Jérôme, des guerriers plus invincibles, certes, que les Pompée, les Marins et les Sylla; les hérésies n'apparaîtront que pour ajouter à sa gloire; des combats sans fin , mais aussi des victoires éclatantes s'apprêtent pour la tribune catholique.
Des hauteurs de l'histoire, tâchons d'embrasser d'un rapide coup-d'œil cette foule immense d'adversaires armés contre l'Eglise.
Au premier rang se trouvent les Gnostiques ; ils marchent le front haut et le regard superbe; il y a dans leur tournure d'esprit et dans les maximes qu'ils débitent quelque chose de prestigieux qui pourrait imposer; ils respirent je ne sais quoi d'antique et d'oriental comme ces sages qui peuplent les rives du Gange, qui méditent sous le ciel de la Chaldée, ou qui rêvent dans les sanctuaires de la mystérieuse Egypte. Ils tentent d'allier avec la grave austérité du christianisme les hautes et larges doctrines de la sagesse asiatique. Ce qui les préoccupe, c'est l'origine des choses humaines, c'est l'essence de cet être impénétrable aux regards, mais accessible en quelque sorte à la pensée de l'homme, c'est le règne d'un principe de mal perpétuellement en opposition avec un principe de bien ; ils s'agitent autour de cette énigme insoluble, ils vous bâtissent là-dessus mille systèmes plus ou moins ingénieux, plus ou moins concluais; ils vous jettent des paroles ambitieuses; ils Tous parlent d''émanations successives, de générations incréées, de plérômes infinis. A force de sonder ces mystères, leurs pensées se sont égarées dans un vague ténébreux, ils sont descendus dans la profondeur de l'abîme, et déjà leur audace ne connaît plus de bornes.
Les Evangiles sont mutilés, les Ecritures tronquées, les faits de l'histoire judaïque attribués à de mauvais génies, les miracles du Christ expliqués conséquemment à ces dogmes subversifs de toute saine critique. La superstition vient se glisser, elle aussi, parmi ces orgueilleux philosophes : ici, ce sont des talismans qui ont une vertu secrète; là, des nombres qui ont une influence mystérieuse ; ailleurs , des paroles qui possèdent un pouvoir merveilleux. De ce libertinage d'esprit à la licence des mœurs, la distance est étroite. Bientôt d'infâmes désordres font rougir la nature, l'inceste et l'adultère se propagent, des principes inouïs jusqu'alors sont audacieusement proclamés, la folie et le dévergondage vont toujours croissant ; c'en est fait de toute raison , de toute morale parmi ces impudents novateurs.
Flétris à la face du jour, par l'éloquence chrétienne d'abord et puis ensuite par la voix publique, ils ne laisseront pas de propager encore leurs mystères de honte; on les verra se ranimer au sein de la société catholique, ils enfantèrent plus tard les Pauliciens d'Espagne , les Marichéens d'Orient, les Albigeois de France, les Vaudois Lyonnais; à presque toutes les sectes ils péteront quelques-unes de leurs étranges rêveries, mais ils finiront, comme tout ce qui tient de l'homme, par être effacés de la terre pour faire place i d'autres erreurs qui, disparaissant à leur tour, céderont le terrain au catholicisme envahisseur lu monde et des intelligences.
Tel est le caractère des premières hérésies. A la naissance de l'Eglise , la philosophie païenne s'était agitée pour remuer l'empire; elle avait imprimé son caractère à l'époque: aussi, dans ces siècles de transition, tout porte un cachet philosophique. Les novateurs apparaissent sous une livrée philosophique, les apologistes donnent à leurs écrits une teinte philosophique, et voilà ce qui les justifie du reproche de Platonisme qui leur a été jeté par les ennemis de l'Eglise. Les sectes postérieures se présentent aussi toutes plus ou moins empreintes des idées en vogue dans les siècles où elles apparurent, toutes plus ou moins liées avec les opinions de l'âge qui les enfanta.
Ainsi, quand la pensée catholique est abandonnée à elle seule, lorsque Constantin vient imposer aux croyances son religieux despotisme, on voit s'élever — Arius, dont les sectateurs troublent pendant bien des années l'empire et le monde catholique, — les Nestoriens, qui divisent l'Orient et se propagent dans toute l'étendue de l'Asie,— les Monothélites , qui ne cherchent à éviter un écueil que pour aller se briser contre un écueil non moins redoutable, — les Pélagiens, qui se partagent en une foule de sectes plus ou moins fanatiques, — les Iconoclastes, qui remplissent Constantinople de leurs sacrilèges profanations. Depuis que la société chrétienne est proclamée , les sectaires se renferment dans ce qui est du ressort de l'Eglise, les excursions philosophiques sont mises de côté, ou, si l'on donne quelque chose à la métaphysique, c'est pour rendre accessibles à l'intelligence les mystères abstraits qu'on essaie de discuter et d'éclaircir. Des siècles d'ignorance surgissent, et l'Eglise seule jette quelques lueurs, au milieu des ténèbres qui envahissent le monde.
Et puis, quand Charlemagne, ce brillant météore au sein de la nuit des âges, quand Charlemagne de ses mains impériales arrête les générations qui se ruent dans la barbarie, quand il promène en Europe le flambeau des lumières, la philosophie prend un nouvel essor, les langues savantes redeviennent en honneur , la grammaire trouve place dans le cercle des études, l'astronomie et la musique sont tirées de l'oubli, une vaste impulsion est donnée aux sciences abstraites. Le mouvement une fois imprimé poursuit son œuvre réformatrice, malgré des interruptions passagères; quelques rayons partent de l'Espagne où règne un peuple ami des arts; l'Asie explorée par les Croisades, vient prêter son influence aux tentatives de régénération européenne; Aristote réapparaît, et la scolastique est enfantée.
Voilà le travail intellectuel jusqu'à la renaissance. Comme on le voit, les lettres proprement dites entrent pour peu de chose dans ce renouvellement social; tous les regards sont tournés vers la philosophie, elle est le fondement sur lequel repose tout l'édifice intellectuel du moyen âge, à elle seule doivent être attribuées toutes les innovations scientifiques et religieuses d'alors. C'est donc sous ses étendards que viennent se ranger et les Godescal, et les Amalaire, et les Hincmar, et les Béranger, et les Gilbert de la Porée, et cet Abeilard plus célèbre encore par sa vie romanesque que par les erreurs qu'il accrédita.
Des génies vastes et puissants siègent sur le trône de Rome, la suprématie pontificale, quoique avouée de tout temps, est proclamée bien plus hautement encore ; des pontifes hardis et entreprenants viennent à rêver une théocratie universelle, institution sublime, mais qui ne pouvait qu'imparfaitement se réaliser dans notre belliqueuse et remuante Europe du moyen âge. Sans doute, la foi religieuse était vivace alors et avait " ses racines au cœur de la société, sans doute, on n'avait point encore paré du nom de philosophie ce mépris qui s'attaque aux choses saintes et à Dieu; mais les vertus évangéliques étaient tout aussi rares qu'aujourd'hui, les lumières s'étaient réfugiées dans les cloîtres, et le reste de la société n'avait plus que l'ignorance en partage, la raison demeurait sans culture, et par-là, devenait incapable de sentir tout ce qu'il y avait de grandeur et d'utilité réelle dans cette vaste centralisation du pouvoir. Maintenant, au contraire, que la raison s'illumine chaque jour et que le siècle travaille courageusement à la recherche du positif et du vrai, on conserve néanmoins pour tout ce qui tient de la religion une sorte d'indifférence inconciliable avec la marche générale des idées. Voilà pourquoi ce système de Théocratie, renouvelé de nos jours par le premier écrivain de l'époque, fait sourire les esprits étroits qui se cramponnent aveuglément au passé. Pour nous qui croyons à l'avenir, qui avons foi au perfectionnement de la société, aux progrès du christianisme, à la future amélioration de toutes choses, nous espérons que ces idées se réaliseront un jour, alors que les intelligences épuisées de mensonges , viendront étancher leur soif de vérité aux sources du catholicisme, alors que les peuples, fatigués de tyrannies, désenchantés de systèmes, ne voudront plus d'autre roi que celui de qui relèvent toutes les puissances de la terre.
Mais enfin, les prétentions des Papes n'obtinrent pas dès l'abord une adhésion générale; les rois, dans leurs pensées orgueilleuses, se levèrent contre un pouvoir qui s'érigeait en arbitre souverain; des guerres interminables ensanglantèrent l'Italie; au fracas des armes d'une part, et des foudres pontificales de l'autre vinrent se mêler des voix audacieuses, et, malgré tous les avantages qui pouvaient résulter de cette unité de puissance, les novateurs s'autorisèrent de quelques abus pour crier à la révolte, pour émeuter les peuples et les rois contre le souverain de l'Eglise.
Ainsi donc, le signal était donné. Soudain l'on voit s'élancer de toutes parts de nombreux et redoutables sectaires. Tous prennent pour texte la puissance des Papes. Mais en vain ils essaient de saper le catholicisme par la base, il survivra à leur défaite, il les verra surgir un à un, se ruer avec rage contre ses remparts à jamais indestructibles, s'épuiser en efforts ridicules, en clameurs furibondes, et puis refluer lentement comme la vague impuissante qui vient battre l'impassible rocher.
Un premier cri part du fond de l'Angleterre (1); sourd d'abord et en quelque sorte imperceptible, il trouve plus tard un écho dans la Bohême (2) ; l'Europe s'arrête et semble prêter l'oreille : c'est qu'elle a cru distinguer des clameurs de bataille ; mais voilà qu'une grande licence s'est emparée des esprits, vous diriez que les intelligences se sentent à l'étroit et comme emprisonnées dans les limites du catholicisme; voici venir Luther, ce géant de la Réforme! — Du sein de la brumeuse Germanie, il se lève, fantôme sombre et terrible! Il promène autour de lui des regards où brille une joie féroce; il voit l'Europe dans une de ces crises sociales, dans une de ces inquiétudes vagues qui semblent présager de longs ébranlements, Rome lui apparaît comme la prostituée de l'Apocalypse, les rois lui semblent lassés de ce qu'ils appellent le despotisme pontifical; il croit l'heure venue pour ébaucher son œuvre, et le voilà qui se dresse armé de toutes pièces; cette souveraineté de la raison que redemandaient jadis les adversaires de l'Eglise, il la proclame, lui, fils du christianisme! Voilà que de fanatiques partisans se rangent sous ses drapeaux (3), la moderne Rome devient le but de leurs attaques, le catholicisme semble se briser et se dissoudre; — c'est l'Angleterre qui, se détachant de l'édifice, croule avec fracas comme un vieux pan de muraille; — c'est l'Allemagne qui s'entr'ouvre en mille scissures hideuses par où l'œil plonge dans le chaos de l'abîme; — c'est la France qui retentit de clameurs furibondes et qui voit ses fils s'entr'égorger au nom du ciel; partout surgissent d'impétueux tribuns qui viennent ajouter' à la confusion générale, et déjà la Réforme en est venue à se déchirer les entrailles à elle-même. — Accourt le XVIIIe siècle avec sa moqueuse philosophie et son hideux athéisme; il porte au catholicisme de rudes coups, mais celui-ci puise dans ses blessures des forces nouvelles; un instant on a cru voir se relever de leur poussière les Néron, les Domitien, les Galérius avec leurs tortures atroces et leurs victimes sans nombre; un instant l'abomination de la désolation a été vue dans le lieu saint, un instant les portes de l'enfer ont semblé prévaloir contre l'Eglise, mais, au souffle de la Providence, les nuages ont fui, et l'astre du catholicisme a jeté une nouvelle lumière!
— Ainsi donc, les ennemis de l'Eglise ont été forcés de confesser sa puissance; elle a terrassé le judaïsme, les philosophes et les hérésies, et avec quelles armes ? avec des armes pacifiques, l'éloquence de ses apologistes.
Qu'avaient-ils donc de si prestigieux, ces orateurs chrétiens? Vit-on jamais les Cicéron, les Desmosthène exercer une telle influence? C'est que les uns effleuraient seulement les oreilles de l'imagination, tandis que les Basile, les Grégoire, les Athanase sondaient toutes les routes du cœur et soulevaient des questions de la plus haute importance.
On les désigna quelquefois sous le nom vénérable de Pères ; c'est que, semblables à cet antique sénat de Rome qui retraçait comme une réunion de rois à l'ambassadeur de Pyrrhus, ils apparaissent , eux aussi, comme les augustes représentants de la république chrétienne : ce sont eux qui proclamèrent des lois, eux qui défendaient les intérêts des peuples, eux qui veillèrent au maintien de la saine morale, eux qui vengèrent l'honneur du christianisme, eux qui les premiers, du haut de la tribune sainte, firent entendre aux grands le langage d'une austère vérité, aux philosophes le langage d'une grave raison , aux opprimés le langage d'une généreuse indépendance.
On les voyait partout où il y avait quelques dangers à courir, quelque noble entreprise à tenter; s'agissait-il de plaider, devant les empereurs ou les magistrats de Rome, la cause de l'innocence et de la justice, de clore la bouche à une philosophie impudente, de signaler les fatales erreurs et les hérésies astucieuses, d'anéantir les abus et les superstitions que le paganisme avait laissées derrière lui dans sa fuite, d'ouvrir au monde une voie large à la civilisation, d'imprimer à l'humanité une vaste impulsion pour la science et la vertu, ils se levaient dans leur courage, et soudain mille idées généreuses circulaient dans la société sous la forme de lettres, de traités, de discours, de dialogues et même de poèmes; ils vivifiaient leurs écrits de tout ce qu'il y avait de brûlant dans leurs âmes ; leurs pensées s'élançaient palpitantes de vie, leurs inspirations débordaient en chants mystérieux et sublimes, ils avaient la véritable éloquence, celle du cœur; et leurs noms étaient cités avec orgueil, et leur éloge volait de bouche en bouche, et la voix publique les plaçait au dessus de leurs contemporains ; mais s'agissait-il desceller de leur sang des croyances profondément incarnées en eux, alors ils redevenaient simples fidèles, ils confortaient de leurs exemples, dans les supplices, ceux qu'ils avaient éclairés par leur éloquence et guidés par leurs vertus.
Outre les charmes de la vérité, on retrouvait encore dans leur diction quelque chose d'attrayant et d'irrésistible ; ils avaient leurs Platons , leurs Démosthènes, leurs Tacites et même leurs Luciens (4). Au milieu de la décadence, quand l'empire croulait de toutes parts, quand la barbarie était aux prises avec la civilisation, ils furent les seuls qui conservèrent les habitudes de la littérature et des saines doctrines; ils apparaissaient à leurs dominateurs comme des êtres surnaturels : saint Loup arrêta la fureur d'Attila, saint Léon sauva la ville de Rome ; le code espagnol, sous le règne des Visigoths, offre des traces de justice et d'humanité qu'il ne faut pas chercher ailleurs, et c'est aux conciles assemblés fréquemment à cette époque que la civilisation s'en trouve redevable. Les philosophes qu'ils eurent à combattre, les hérétiques qu'ils eurent à désarmer étaient des adversaires bien redoutables, certes, par leur influence et leur crédit; les erreurs dont ces derniers se proclamaient les champions sympathisaient toutes plus ou moins avec quelque opinion de l'époque; il fallait donc effacer les talents par de plus grands talents encore, et faire refluer les opinions par d'autres opinions plus larges et plus généreuses. Ils s'inspiraient des pensées religieuses, source féconde en graves raisonnements et en mouvements pathétiques. Et comment eussent-ils manqué d'inspirations brûlantes, lorsque, aux premiers siècles de l'Eglise, ils n'avaient pour auditeurs que ces fervents et enthousiastes chrétiens, qui, chaque jour étaient prêts à mourir, ou qui même avaient bravé la mort plus d'une fois déjà ; lorsque, au sein des catacombes, se dérobant aux images de séduction, loin des voluptés de Rome qui s'ébattait comme une courtisane et demandait les chrétiens avec des cris de rage, ils parlaient de renoncement, d'abnégation et de croix à des hommes d'une trempe peu ordinaire, à des hommes accoutumés aux pensées hautes et sérieuses, dégagés des soins de la terre, et s'élançant sur les ailes de l'espérance jusque dans les tabernacles éternels: lorsque, après un jour de persécution, devant un corps tout sanglant, au milieu des autres martyrs dont les restes vénérés étaient là comme une éloquente prédication, à la lueur des flambeaux qui éclairaient ces pompeuses cérémonies, en présence d'une foule qui devait bientôt, elle aussi, figurer sur les amphithéâtres, ils avaient à prononcer l'éloge funèbre de ceux qui venaient de rendre témoignage à la foi? Ah! quelles paroles de flamme sortaient alors de leurs bouches! quel impétueux élan transportait leur auditoire! quel pathétique animé remuait tous les cœurs! quels généreux mouvements circulaient dans la pieuse assemblée ! Le silence d'abord et puis des larmes saintes, et puis des serments réitérés, tel était l'effet de cette mystérieuse et furtive allocution !
C'étaient là les beaux jours de l'éloquence ! Qu'on ne me parle plus de Périclès, de Cicéron, de Démosthène! que me fait, à moi, ce froid rhéteur qui s'en vient là, devant de froides cendres, au milieu d'une assemblée froide et distraite, me jeter quelques phrases froidement compassées et arrangées d'avance ? que me fait, à moi, ce philosophe orgueilleux qui me débite quelques vagues déclamations contre le luxe, quand toutes ses vertus , à lui, ne sont qu'un manteau dont il voile ses vices infâmes et ses turpitudes secrètes? que me fait, à moi, cet orateur qui s'exténue à remuer l'indolence de ses concitoyens, quand il n'a pas rougi, lui, de fuir lâchement des combats ? que me fait, à moi, ce beau parleur de Rome qui flagelle l'ambitieux Antoine de sa molle et flasque éloquence, quand toute sa vie, à lui, ne m'offre qu'un long rêve d'ambition et d'amour-propre? Ah! rendez-moi les Bouche-d'Or, les Tertullien, les Cyprien , les Grégoire. A eux il sied de célébrer les triomphes des martyrs, de flétrir le luxe des femmes, de ranimer le courage des faibles et de châtier les tyran s! Ont-ils pâli devant l'appareil des supplices, ont-ils approché de leurs lèvres la coupe des voluptés, ont-ils balancé devant les séductions, ont-ils abandonné leur poste à l'heure du danger? Toi, rhéteur, tu ne me jettes que des mots; eux, ils me donnent des exemples! Tes périodes sonores ne font que m'effleurer; eux, ils me remuent et me transportent. Veux-tu me toucher aussi, laisse-là tes prétentions oratoires, et offre-moi dans ta personne un modèle que je puisse imiter! Et puis, si vous le voulez, mettons les œuvres dans la balance : dites-moi donc ce qu'ils ont fait de si merveilleux, les orateurs de Rome ou d'Athènes; citez-moi un seul homme que le verbiage d'Isocrate ou de Cicéron ait jamais rendu meilleur; montrez-moi des sociétés régénérées, des nations entières entraînées, subjuguées comme par un ascendant irrésistible ; moi, l'histoire en main, je pourrais vous les peindre ces hommes que vous ne rougissez pas de vouer à un dédaigneux et insultant oubli, je pourrais vous les peindre s'associant par l'éloquence à tout ce qu'il y eut jamais dans l'humanité d'efforts utiles ou d'élans généreux, apparaissant au milieu des crises sociales, comme les sauveurs de la civilisation , revendiquant ces hautes et larges pensées dont vous êtes si fiers, et réclamant leur part de coopération à cet avenir de merveilles dont vous croyez entrevoir déjà l'aurore. — Je vous le demande, où en était l'Europe avant l'éloquence chrétienne? et même, une fois le monde romain reconquis sur les Barbares, où en était l'Allemagne aujourd'hui si grande en savoir et en philosophie? où en était la Pologne si prodigieuse toujours et naguère encore si imposante? où en était l'Amérique si avancée maintenant qu'elle semble marcher en tête de notre vieille Europe? où en sont les peuples chez qui la voix de l'Evangile n'a point encore retenti ou bien a cessé de se faire entendre? Et si l'Asie, si l'Afrique elle-même paraît enfin secouer son long sommeil de mort, à quoi faut-il l'attribuer, sinon aux germes de vie que déposa l'éloquence chrétienne dans ce sol inerte et abâtardi? Si le catholicisme semble refleurir de nos jours et reprendre racine au cœur de la génération présente, encore une fois, c'est à la même cause qu'il faut attribuer ce mouvement salutaire, c'est que l'éloquence chrétienne a des ressources admirables pour arriver au cœur et des armes puissantes pour opérer la conviction. Quel autre a su mieux qu'elle nous parler de l'Etre inénarrable et soulever le voile qui dérobait aux regards les divins attributs ? Quel autre avait de plus hauts mystères à raconter, de plus nobles exemples à redire? quel autre avait de plus sublimes espérances à proclamer, de plus larges enseignements à répandre, de plus hautes maximes à propager ? quel autre avait mieux sondé la nature humaine, mieux étudié ses penchants, mieux approfondi ses besoins, mieux connu la portée de ses désirs? quel autre enfin s'était proposé un but plus généreux, celui d'inculquer à l'homme cet admirable précepte : Aime tes semblables !
Honneur donc à ces génies qui se sont faits les échos du Verbe et les continuateurs de son œuvre! honneur à ces héros de la parole qui combattirent les abus, qui fondèrent l'empire de la vérité, qui vainquirent les royaumes par la foi, qui assurèrent le triomphe de la raison et acheminèrent le monde vers une voie de perfectionnement! Gloire au christianisme qui féconda leurs pensées et jeta dans leurs âmes les germes de cette éloquence si pleine de vie, de mouvement et de chaleur !
Voilà quelles hautes et consolantes pensées ont nourri bien souvent notre jeunesse triste et orageuse. La littérature classique nous paraissait froide et vieillie , celle de notre âge trop dévergondée, trop dénuée de sentiment et de foi. On le sait bien, c'est le caractère de l'époque où nous sommes qui marque la littérature de ce sceau de fatalisme et de désespoir. Après quarante années d'une révolution qui avait promis de réédifier l'Europe, et qui n'a su que faire des ruines, les esprits, revenus des décevantes promesses de la philosophie, ayant perdu leur foi en ce guide trompeur qui les a égarés d'erreur en erreur et d'abîme en abîme, s'arrêtent éperdus et tremblants au milieu d'immenses débris, et sur les tronçons des trônes, des institutions, des mœurs et des empires, ils se prennent à désespérer de l'humanité.
S'il était permis de rapprocher deux époques qui, malgré les siècles qui les séparent, ont leur analogie, ne pourrait-on pas dire qu'il y a une sorte de ressemblance entre la destruction matérielle du vieux monde romain et la destruction morale qui a bouleversé le monde moderne jusque dans ses fondements? En écoutant ce long gémissement, ce cri de désolation que pousse notre littérature , ne vous semble-t-il point être revenu à ce jour de misère ou au milieu des invasions de Barbares qui, maîtres de dix-sept provinces des Gaules, chassaient devant eux comme un troupeau, sénateurs et matrones, maîtres et esclaves , hommes et femmes , jeunes garçons et jeunes filles? Un captif, poète et chrétien, cheminant derrière les chariots et les armes, demandait au ciel, « pourquoi la terre était déserte, pourquoi les villes détruites, pourquoi les champs sans culture, pourquoi Dieu avait laissé envelopper dans la ruine générale et ses saintes églises et tant de jeunes enfants, dont l'âge était incapable de pécher (5). » Ne vous rappelez-vous point saint Jérôme peignant les cités dévastées, les hommes égorgés, les animaux eux-mêmes disparaissant du sol, et la terre se couvrant d'épaisses forêts et de ronces? Ne croyez-vous pas entendre le cantique de ces exilés que Gildas nous montre, dans son histoire, gagnant les contrées d'outremer, et chantant avec de grands gémissements sous les voiles : « Tu nous as, ô Dieu! livrés comme des brebis pour un festin, tu nous as dispersés parmi les nations! » Dans ce temps-là , comme dans le nôtre, toute voix qui s'élevait était pleine de tristesse, toute parole était une lamentation. Les Bretons écrivaient à Aétius une lettre qui portait cette suscription mélancolique : « A Aétius, trois fois consul, le gémissement de la Bretagne. » Et du haut de sa chaire, saint Augustin s'écriait, en parlant du sac de Rome : «D'horribles nouvelles se sont répandues, carnage, incendie, rapine, extermination. Nous gémissons, nous pleurons, et nous ne pouvons être consolés! » C'est que la grande époque de destruction matérielle doit avoir avec la grande époque de destruction morale, une mystérieuse, mais réelle analogie ; c'est que les esprits sont sous le poids des événements qui les entourent, c'est que voyant une seconde fois le monde emporté dans des régions inconnues, ils ne trouvent plus que des accents tristes et des pensées sombres comme la situation. Et ne nous plaignons pas trop de cet état de notre littérature. Le désespoir est plus près qu'on ne croit du repentir, le fatalisme de la croyance : ces deux nuances sont la transition de la philosophie à la religion.
Animés par ces considérations, nous nous mîmes à feuilleter les Pères, et nous y trouvâmes ce que nous cherchions inutilement ailleurs. Nous ne saurions peindre tout ce que nous ont procuré de plaisir ces lectures faites en commun, dans les longues soirées d'hiver, près d'un foyer ami, à l'heure où la pensée est plus mystérieuse, plus expansive. Salvien nous parut celui de tous qui avait le plus de rapport avec notre époque de crise et de transition; nous commençâmes à le traduire, et voici que nous l'abandonnons au public.
Salvien dit clairement qu'il était né dans les Gaules (6), mais on ne trouve rien de bien précis, ni pour l'année ni pour le lieu de sa naissance ; seulement, la suite de sa vie fait voir qu'il doit être né quelques années avant la fin du IVe siècle, ce que Tillemont (7) rapporte à l'an 390. On peut inférer aussi de ses ouvrages qu'il était de Cologne, et issu d'une famille qui tenait un rang considérable dans les Gaules. Si la ville de Trêves ne fut point la patrie de Salvien, comme cela est manifeste par ses œuvres, on conjecture du moins avec vraisemblance qu'il y fut élevé, ou qu'il y fit dans sa jeunesse une assez longue résidence; les écoles de cette ville étaient encore célèbres à la fin du IVe siècle. Salvien fit de grands progrès dans les lettres et dans les sciences cultivées à cette époque. Il était très-jeune quand il épousa Falladia, fille d'Ypatius, que son père avait formée aux croyances du paganisme. De ce mariage naquit une fille nommée Anspiciola. Ypatius était engagé dans les ténèbres de l'idolâtrie, dont il sortit néanmoins pour suivre les lumières de l'Evangile. Peut-être Palladia était-elle d'abord païenne elle-même, comme son père, mais elle eut depuis le bonheur d'embrasser la religion de Jésus-Christ et de garder la continence. Car, Salvien ne se contentant pas d'être simplement chrétien , voulut aspirer encore à la perfection du christianisme. Frappé sans doute de l'exemple admirable de saint Paulin et de Thérasie, qui depuis peu avait fait tant de bruit dans l'Eglise, et de celui de saint Eucher et de Galla, que Salvien avait alors sous les yeux, il proposa à Palladie de les imiter. Palladie fut docile, et consentit à devenir la sœur de celui dont elle était l'épouse.
Le nouveau genre de vie des deux jeunes époux irrita Ypatius, quoique déjà chrétien, par la considération peut-être que la continence qu'ils venaient d'embrasser, tendait à l'extinction de sa race. On ne saurait dire si ce fut pour se dérober à sa colère, ou pour vivre dans la solitude, ou bien à cause des incursions des Barbares qui ravageaient les Gaules dès 407, que Salvien et Palladie s'en allèrent dans un pays éloigné d'Ypatius. Ils y vécurent près de sept ans entiers, sans y recevoir une seule lettre de lui, quoiqu'il ne lui eussent donné aucun sujet de mécontentement. Salvien, pour l'apaiser, lui écrivit une lettre que le temps nous a conservée : c'est un chef-d'œuvre de la plus pathétique éloquence. Cherchez dans les lettres de Cicéron à ses Amis, dans ces lettres de Pline si péniblement élaborées pour la gloire et la postérité, vous ne trouverez jamais rien qui vaille ces paroles si douces et si pénétrantes.
Salvien écrivit avec sa femme; ce fut dans la vue de certifier à Ypatius qu'ils étaient ensemble, afin qu'il n'eût rien à craindre de ce côté-là.
« Nous ignorons, dit-il, si vous êtes également irrités contre nous, mais dans la conjoncture présente, nous ne saurions être divisés. Notre crainte à tous deux est la même, quoique l'offense ne soit pas la même néanmoins; car, ne « fussiez-vous pas irrités peut-être contre tous deux, l'affection mutuelle qui nous unit fait cependant que, l'un de nous étant regardé comme coupable, l'autre aussi ne peut s'empêcher d'éprouver de la tristesse en pensant à la faute. — Parents chéris , parents vénérables, souffrez de grâce, que nous vous interrogions. Des enfants si aimants, peuvent-ils donc n'être pas aimés? —Que notre conversion vous ait irrité, lorsque vous étiez, encore païen, nous n'en avons pas été surpris; la dissimilitude de goût dut faire supporter alors la différence de volontés. — Aujourd'hui, il en est bien autrement. Depuis que vous avez embrassé le culte de Dieu , vous avez prononcé en ma faveur. Pourquoi vous fâcher contre moi si je cherche à perfectionner en mon cœur une religion que vous avez déjà commencé d'approuver en vous-même. —Avez-vous d'autres motifs de plainte, je suis loin de dire que je n'ai pu vous offenser; mais à présent que votre colère vient de ce que je parais aimer le Christ, pardonnez ce que je vais dire. Je réclame, à la vérité, votre indulgence, mais je ne puis avouer que c'est mal, ce que j'ai fait. » Salvien s'adressant ensuite à sa femme : « Toi maintenant, ô tendre et vénérable sœur, remplis et ton rôle et le mien. Prie, toi, afin que j'obtienne. Demande, toi, afin que tous deux nous gagnions notre cause. Conjure-les donc, et dis-leur en suppliante : Qu'ai-je fait? qu'ai-je mérité? Pardonnez, quoi que ce puisse être. Je réclame indulgence, sans connaître ma faute. Jamais, comme vous le savez, je ne vous offensai ni par manque de respect, ni par insoumission ; jamais je ne vous blessai d'une parole amère; jamais je ne vous outrageai d'un regard insolent; par vous j'ai été livrée à un homme; par vous, engagée à un mari. — Vous m'ordonnâtes, s'il m'en souvient bien , d'être avant toutes choses, soumise à mon époux. Il m'a en« traînée dans sa religion, il m'a invitée à la continence. Pardonnez ; j'ai cru qu'il serait honteux de résister; la chose m'a paru honnête, pudique et sainte. — Je me jette à vos genoux, parents bien-aimés; moi, votre Palladie, votre chérie, votre petite reine; moi avec qui vous badiniez en m'adressant jadis, dans votre indulgence affectueuse, ces termes de caresse. — La voilà celle par qui vous advinrent pour la première fois et les noms de parents, et les joies d'aïeuls. »
Salvien ajoute qu'il va parler au nom de sa fille.
« Nous ne vous offrons point une enfant inconnue, mais un gage domestique. C'est une triste et malheureuse condition que la sienne, puisqu'elle n'a commencé de connaître ses aïeuls que depuis la disgrâce de ses parents. Prenez pitié de son innocence; laissez-vous fléchir aux droits du sang; elle est déjà contrainte en quelque sorte de supplier pour les siens, elle qui ne sait pas ce que c'est qu'une faute. »
On ignore quel fut le succès de cette lettre; et depuis ce temps-là l'histoire ne dit plus rien ni d'Ypatius, ni de Quieta, ni de Palladie, ni même d'Auspiciole (8). Quant à Salvien, il vendit ses biens dont il distribua le prix aux pauvres, et embrassa la vie religieuse. On croit qu'il vint chercher un asile à l'abbaye de Lerins (9), vers 420. Pendant le temps qu'il y demeurait, il donna des leçons de littérature aux deux fils de saint Eucher, évêque de Lyon, avec lequel il s'était lié d'une étroite amitié (10). Il quitta la solitude de Lerins vers 426, et s'établit à Marseille, où il fut ordonné prêtre (11). Ses talents et sa piété l'avaient déjà rendu célèbre, en 430, comme on le voit par un passage de l'Oraison funèbre de saint Honorat (12). Consulté par les prélats les plus illustres des Gaules et honoré de leur confiance , Salvien composa sur leur demande, une foule d'Homélies et d'Instructions, qui lui valurent le glorieux surnom de maître des évêques; mais c'est par erreur qu'on a cru qu'il avait occupé lui-même la chaire épiscopale. La modestie, la douceur, la patience et l'inépuisable charité de Salvien lui ont mérité les éloges de ses contemporains. Il mourut, toujours selon Tillemont, vers 484, dans un âge très-avancé.
Ce qui rend aujourd'hui plus célèbre la mémoire de Salvien, ce sont les écrits qu'il a laissés à la postérité. Mais de tous ceux qu'il a composés, il ne nous en reste que trois, qui ont été fort estimés dans tous les temps.
Le premier, dans l'ordre chronologique, est le traité Contre l'Avarice, «pur essai de morale religieuse (13)», divisé en quatre livres, et dédié à l'Eglise universelle, à laquelle il adresse la parole. La liberté avec laquelle il y parle, lui fit cacher son nom sous celui de Timothée. Il en apporte d'autres raisons dans une lettre écrite à Salonius, et semble vouloir se faire un mérite de modestie, de ce qui paraît n'avoir été qu'un effet de sa prudence.
Dans le premier livre, il déplore d'abord la corruption générale répandue dans tout le christianisme; il dit à l'Eglise que sa fécondité l'a affaiblie, et que la foi est diminuée à proportion qu'elle s'est répandue. Il réfute ensuite les prétextes dont on se sert pour excuser l'avarice, et surtout celui qu'apportent les pères, qui n'amassent, disent-ils, que pour leurs enfants. Il montre que Dieu ne nous a donné que l'usage et l'administration des richesses, pour nous fournir l'occasion de faire de bonnes œuvres, qu'on doit s'en servir, pour expier les péchés par l'aumône ; qu'il serait téméraire de promettre le pardon à ceux qui remettent leur pénitence à l'heure de la mort, mais aussi qu'il y aurait de la cruauté à les détourner de tenter ce dernier remède; qu'ainsi le pécheur ne pouvant alors faire autre chose, il doit du moins offrir à Dieu ses biens avec larmes et componction. L'auteur avertit cependant que ce serait une étrange folie de commettre des péchés dans l'espoir de les expier ensuite par l'aumône, et de se flatter qu'on sera sauvé, non parce qu'on est bon, mais parce qu'on est riche ; comme si Dieu cherchait plutôt l'argent que les mœurs, ou qu'il fût semblable à ces juges corrompus, qui font, pour ainsi dire, un trafic des péchés des hommes.
Dans le second livre, Salvien prouve que l'obligation de faire l'aumône s'étend aussi aux justes, ne fût-ce que pour témoigner à Dieu leur reconnaissance des bienfaits qu'ils en ont reçus. En les parcourant, ces bienfaits, il s'exprime dans les termes les plus précis et les plus énergiques sur la mort de Jésus-Christ pour tous les hommes, et sur la réalité de son corps dans l'Eucharistie. « Le Christ, dit-il, a souffert pour tous les hommes, comme pour chacun d'eux ; il s'est livré pour tous les hommes, comme pour chacun d'eux.»—Et touchant le sacrement de nos autels : — « Les Juifs mangèrent la manne, nous sommes nourris du Christ ; les Juifs avaient la chair des oiseaux, nous avons « le corps de Dieu ; ils avaient la rosée céleste, nous avons le Dieu du Ciel (14). » Les plus artificieuses chicanes, et la mauvaise foi la plus marquée pourraient-elles éluder ou affaiblir ce témoignage de la foi de nos pères?
Salvien montre que les veuves chrétiennes, les vierges consacrées à Dieu, et particulièrement les Religieux, sont obligés de se détacher des biens de la terre, et d'en faire l'aumône, parce que, s'ils croient n'avoir pas de péchés à racheter, ils ont du moins le ciel à acquérir. Il ne s'explique pas avec moins de force sur les obligations des ecclésiastiques. « Tout ce qu'on a dit « déjà les regarde plus spécialement sans doute, « eux qui doivent servir d'exemple aux autres, « et les surpasser en vertu, comme ils les sur« passent en dignité. Rien de plus honteux que « d'être recommandable par l'élévation du rang, « et méprisable par la bassesse des mœurs. Car, « une principauté sans un mérite supérieur, « qu'est-ce autre chose qu'un titre honorifique sans application ? une dignité sans talents, qu'est-ce autre chose qu'une pierre précieuse jetée dans la boue (15) ? » Après avoir montré quel désintéressement le Seigneur exige des lévites de la nouvelle loi, il se plaint de ce que les évêques et les clercs ne se contentent pas d'avoir été riches, s'ils n'enrichissent en mourant leurs héritiers.
Dans les deux livres suivants, Salvien combat particulièrement ceux qui dans leurs testaments oublient les pauvres, sous prétexte qu'ils ont des enfants, ce qui lui paraît cependant eu quelque sorte excusable. Mais il déclame avec force contre ceux qui laissent leurs biens à des étrangers ou à des personnes riches. Il dit que, en certaines occasions, non-seulement on peut, mais on doit laisser ses biens à ses héritiers; par exemple, lorsqu'ils sont pauvres et gens de bien. Il se plaint de ce que les pères ne laissent pas à leurs enfants religieux une portion de leurs biens égale à celle de leurs autres enfants. « Vous dites : Qu'est-il besoin de laisser à des fils qui sont dans l'état religieux une égale part d'héritage ? Je réponds : c'est afin qu'ils remlissent leurs devoirs de religion , afin que l'Église s'enrichisse avec les biens des religieux, afin qu'ils donnent, afin qu'ils fassent des largesses, afin que tous ceux qui n'ont pas, reçoivent de leur abondance; puis, si telle est leur foi, leur perfection , afin qu'ils aient pour ne plus avoir bientôt, plus heureux de se dépouiller après avoir possédé. Pourquoi, je le demande, parents inhumains, leur imposer la nécessité de l'indigence la plus indigne ? Reposez-vous d'un tel soin sur la religion à laquelle vous avez confié vos enfants. On a bien plus de mérite à se faire pauvre soi-même. Qu'il leur soit libre, nous vous le demandons, de se faire pauvres de plein gré ; ils doivent embrasser la pauvreté, mais non pas y être contraints. Et s'ils y sont contraints, qu'ils la supportent par piété, mais qu'elle ne leur de« vienne pas une sorte de tourment infligé par condamnation. Pourquoi les jeter en dehors des droits du sang et de la nature (16)?»
Salvien condamne aussi l'usage assez commun de quelques pères, qui ne laissent à leurs enfants religieux , que l'usufruit des biens qu'ils leur assignaient, donnant le fonds à leurs autres enfants séculiers, de peur que les religieux n'en disposassent. On voit par ces plaintes de Salvien, que l'état religieux n'excluait pas encore du droit de succéder, et n'ôtait pas le pouvoir d'administrer ses biens et d'en disposer. Encore longtemps après, nous trouvons de saints abbés qui font des testaments pour léguer leurs biens.
Le principal ouvrage de Salvien, et le second dans l'ordre des temps, est un traité Du gouvernement de Dieu, ou comme Gennade l'intitule, suivant l'explication que l'auteur en donne lui-même, Du juste Jugement de Dieu en ce monde; mais il est plus connu encore sous le titre, De la Providence. — Les malheurs presque continuels dont l'empire était affligé depuis près de cinquante ans, et surtout les derniers ravages des Huns et des Vandales parurent ébranler la foi de quelques personnes dans les Gaules. Bien des gens, au lieu de s'en prendre à leurs péchés, s'en prenaient au Seigneur, qui les punissait. Ils murmuraient contre sa Providence, et quelques-uns en prenaient occasion de la révoquer en doute. A défaut de raisons, les impies s'autorisent des plus faibles apparences, pour tâcher de justifier leur incrédulité. Salvien entreprit donc de défendre la Providence par un grand ouvrage divisé en huit livres, qu'il dédia à l'évêque Salonius, son élève. Il y met en œuvre les plus solides raisons et les plus brillans tours de l'éloquence pour confondre l'impiété. Après avoir dit, dans la préface, qu'il n'est point de ces auteurs qui consultent plutôt leur propre renommée que l'intérêt d'autrui, et qui s'efforcent moins d'être utiles et salutaires que de paraître habiles et diserts, il établit la Providence dans le premier livre par la raison et les exemples; et dans le second, il la prouve par les témoignages des saintes Ecritures.
En commençant le troisième livre, il se propose cette grande question : pourquoi, si Dieu gouverne le monde, les Barbares sont-ils plus heureux que les Chrétiens, et les méchants souvent dans la prospérité et dans la grandeur, tandis que les gens de bien languissent dans l'affliction et dans le mépris ?Salvien emploie les six derniers livres à satisfaire à cette objection. Il dit d'abord qu'il pourrait se contenter de répondre : « Je suis homme, je ne le comprends pas. Je n'ose pénétrer les secrets de Dieu ; je crains de l'entreprendre, car c'est une témérité sacrilège de vouloir aller plus avant que Dieu ne le permet. Il a dit qu'il fait et règle toutes choses ; que ce soit assez pour vous (17). » Puis il ajoute que les chrétiens ne devraient chercher d'autres raisons de leurs souffrances que celle qu'en donne l'Apôtre : « Nous sommes destinés aux persécutions (18). »
Mais, comme plusieurs ne goûtaient pas une maxime si élevée, et croyaient que les biens terrestres devaient être la récompense de leur foi, il dévoile les fausses vertus et les vices honteux de la plupart des chrétiens de son temps, et il fait voir avec une éloquence digne du sujet, que toutes les calamités publiques étaient de justes châtiments des péchés qui régnaient alors. Pour le démontrer, il parcourt les conditions diverses et les provinces; et il fait une peinture si vive des désordres auxquels on s'abandonnait, que l'indignation contre les auteurs de ces crimes, ne laisse presque plus de place à la compassion pour leurs misères.
On objectait que les Chrétiens étaient encore meilleurs que les nations idolâtres, qui les avaient subjugués; Salvien répond que les péchés, ont un caractère particulier de malice dans une profession aussi sainte que le christianisme, et, tout en reconnaissant que les peuples dont Dieu s'était servi pour punir les Chrétiens, étaient sujets à de grands vices, il fait ainsi leur portrait : «La race des Saxons est cruelle, les Francs sont perfides, les Gépides inhumains, les Huns impudiques; enfin, dans la conduite de toutes ces nations barbares, ce domine un vice particulier, mais leurs défauts ont-ils le même degré de malice que les nôtres? L'impudicité des Huns est-elle aussi criminelle que la nôtre? La perfidie des Francs est-elle aussi blâmable que la nôtre? L'intempérance des Alains est-elle aussi répréhensible que celle des « Chrétiens? La rapacité des Albanois est-elle aussi condamnable que celle des Chrétiens? Si le Hun ou le Gépide use de fourberie, qu'y a-t-il là d'étonnant, lui qui ignore tout-à-fait que la « fourberie est un crime? Si le Franc se parjure , que fait-il de si étrange, lui qui regarde le par« jure comme un discours ordinaire, et non comme un crime (19)? »
Il montre ensuite que les mœurs des Barbares hérétiques qui avaient ravagé l'empire , étaient beaucoup plus régulières que celles des Romains (20). Il loue particulièrement la chasteté des Goths et des Vandales, qui avaient horreur des impudicités que l'on voyait régner surtout en Afrique et dans l'Aquitaine. «Rougissez, peuples Romains, rougissez de votre vie. Il n'est presque pas de villes sans lieux de prostitution , il n'en est point qui soient exemptes de turpitudes, si ce n'est les cités seulement où les Barbares ont établi leur domination. Et nous nous étonnons de nos malheurs, nous qui sommes si impurs! Nous nous étonnons d'être surpassés en force par nos ennemis, lorsqu'ils nous surpassent en vertus! .
« Nous nous étonnons de ce qu'ils possèdent nos biens, ceux qui ont nos vices enhorreur ! Ce n'est point à la force naturelle de leurs corps qu'ils sont redevables de leurs victoires, ce n'est point à la faiblesse de notre nature que nous devons nos défaites. Qu'on se le persuade bien , qu'on ne remonte point à une autre cause; ce qui nous a vaincus, c'est le dérèglement de nos mœurs (21). »
En parcourant les désordres des différents états, Salvien n'épargne ni les ecclésiastiques, ni les religieux. Mais c'est surtout quand il parle contre les spectacles que son éloquence grandit et s'élève, qu'il est vif, impétueux, ardent et passionné. Les Pères de l'Eglise grecque et latine ont traité souvent le même sujet, mais aucun d'eux, ce me semble, n'est supérieur à Salvien. Je me contenterai de reproduire ici un seul passage; il s'agit de la ville de Trèves, prise et saccagée quatre fois par les Barbares. Or, les habitants de cette malheureuse cité, dans ce désastre immense, demandaient aux empereurs le droit d'ouvrir le théâtre et le cirque, afin de recommencer les jeux, interrompus par la présence et l'invasion de l'ennemi. C'est à ce propos que Salvien s'écrie :
« Des cirques, habitants de Trèves, voilà donc ce que vous demandez, et cela quand vous avez passé par les dévastations et les saccagements, et cela, après les désastres, après le sang, après les supplices, après la captivité, après tous les a malheurs d'une ville tant de fois renversée ! quoi de plus déplorable qu'une telle folie ! quoi de plus douloureux qu'une telle démence! Je l'avoue, je vous ai regardé comme bien dignes de pitié, lorsque vous avez eu votre ville détruite; mais je vous trouve bien plus à plaindre, lorsque vous demandez des spectacles. Car, je pensais que dans ces désastres vous n'aviez perdu que vos biens et vos fortunes, j'ignorais que vous y aviez perdu aussi le sens et l'intelligence. Vous voulez donc des théâtres, vous demandez donc un cirque à vos princes? Pour quelle situation, je vous prie, pour quel peuple , pour quelle ville? pour une ville en cendre et anéantie, pour un peuple captif et massacré qui n'est plus ou qui pleure; dont les débris, s'il en est toutefois, ne sont qu'un spectacle d'infortune; pour un peuple abîmé dans la tristesse, épuisé par les larmes, abattu par des pertes douloureuses, devant lequel vous ne savez dire de qui le sort est le plus déplorable, des morts ou des vivants; car l'infortune de ceux qui restent est si grande, qu'elle surpasse le malheur de ceux qui ne sont plus.
« Tu demandes donc des jeux publics, habitant de Trêves? Où les célébrer de grâce? sur les bûchers et les cendres, sur les ossements et le sang des citoyens égorgés? quelle partie de la ville ne présente encore l'aspect de ces maux? où ne trouve-t-on point de sang répandu? où ne trouve-t-on point des cadavres gisants? où ne trouve-t-on point des membres déchirés et et en lambeaux? Partout le spectacle d'une ville prise, partout l'horreur de la captivité, partout l'image de la mort. Ils sont étendus, les restes infortunés du peuple sur les tombeaux de leurs morts, et toi, tu demandes des jeux! La ville est noire d'incendie, et toi, tu te fais un visage de fête! tout pleure, et toi, tu es joyeux ! Ce n'est pas tout, tu provoques Dieu par des plaisirs infâmes, et tu irrites la colère divine par de criminelles superstitions. Je ne m'étonne plus, certes, non, je ne m'étonne plus qu'il te soit arrivé tant de malheurs consécutifs ; car, puisque trois renversements n'avaient pu te corriger, tu as mérite de périr au quatrième (22). »
Cette quatrième ruine de Trêves arriva en 455; ainsi, le livre De la Providence ne fut pas achevé plus tôt. Quant au traité de l'Avarice, on croit qu'il fut écrit vers l'an 440; il est au moins certain qu'il le fut avant l'ouvrage sur la Providence, où il se trouve cité sans le nom de son auteur (23).
Le troisième et dernier écrit qui nous reste de Salvien, est un recueil de neuf lettres adressées à diverses personnes, mais qui ne sont apparemment que la moindre partie de celles qu'il a écrites durant le cours d'une longue vie. Gennade (24) en marque un volume entier, qui sans doute contenait plus de neuf lettres. Celles que nous avons sont toutes écrites avec beaucoup d'élégance , et donnent bien lieu de regretter la perte des autres.
Salvien avait encore composé un Traité de l'avantage de la virginité, — un poème ( Hexameron) sur la création, — un Commentaire sur le livre de l'Ecclésiastique ou celui de l'Ecclésiaste, — et enfin des Homélies dont Gennade avoue qu'il ne sait pas le nombre.
Le style de Salvien est étudié et poli, mais net et clair; il serait difficile de trouver un discours plus orné, plus coulant , plus diversifié , plus agréable. La physionomie de ce Père nous semble grave, sérieuse et mélancolique ; les grandes catastrophes dont il fut témoin durent aisément faire naitre en lui cette empreinte particulière. Ce qui le rend intéressant, c'est le zèle qu'il fait paraître pour la gloire de Dieu et pour le salut des hommes. Il n'est rien qu'il ne mette en œuvre afin de leur rendre la vertu aimable, de les détourner du vice et de les ramener à la piété. Il les presse par des témoignages empruntés à l'Ecriture et quelquefois aux auteurs profanes, par la vue de leur propre intérêt et par les motifs de reconnaissance envers le Créateur. Les raisonnements qu'il oppose aux vains prétextes des impies sont solides, et plus d'une fois nous nous sommes pris d'admiration en face de la logique forte et puissante qu'il déploie avec tant de magnificence. Le côté faible de Salvien ,1e défaut réel de son génie, c'est la diffusion, mais en certains endroits seulement, et lorsqu'il est trop plein de son sujet. Il vous prend alors sa pensée, la tourne et la retourne, sans pouvoir la vêtir d'autres termes, la rendre différente d'elle-même. C'est à effaroucher le traducteur le plus intrépide.
Quoiqu'il en soit de cette observation, il y a tant de richesses dans ses ouvrages, tant de pages savantes et magnifiques; le traité de la Providence en particulier, est si « remarquable comme tableau « de l'état social et des mœurs de l'époque (25) » où il vivait , que Salvien sera toujours placé au rang des hommes qui ont le plus honoré et l'Eglise de Jésus-Christ et l'empire des lettres.
Et néanmoins des écrits aussi importants que les siens manquaient en librairie depuis un siècle; la dernière édition qui en ait été donnée est de 1684. Nous avons donc cru faire chose louable et utile, en venant les offrir, imprimés avec soin, à un public, léger peut-être, insoucieux, et qui n'aura cure ni de notre zèle, ni de nos veilles, ni même de notre argent. Mais, nous le savons, à côté des indifférents, il se cache quelques âmes privilégiées, quelques hommes d'un autre âge, quelques Nodiers, qui apprécient tout ce qui se fait dans l'intérêt des lettres : c'est auprès de ceux-là que nous espérons avoir accès ; un encouragement de leur part sera toute notre récompense.
Nous avons suivi, dans notre version, ce système de scrupuleuse et élégante fidélité, que les Lamennais et les Villemain ont essayé avec un si rare bonheur; nous avons cherché à reproduire, autant qu'il était en nous, toute la mâle énergie , toute la profondeur, tout le pathétique d'un père de l'Eglise, appelé à si juste titre, le Jérémie du Ve siècle. Avons-nous atteint notre but? — Sub judice lis est.
Les quelques pages d'introduction qui précèdent la vie de Salvien n'auraient pas été écrites, si elles n'étaient le manifeste et l'exposé d'une pensée qui nous préoccupe. Nous avons le dessein ferme et arrêté de traduire plus tard, et de livrer à l'impression les Pères de l'Église les plus remarquables comme apologistes, comme orateurs , comme moralistes, comme savants, comme poètes. C'est ainsi que nous donnerons successivement, Vincent de Lerins, Sidoine Apollinaire (26), les Lettres de Saint Jérôme, celles de Saint Cyprien, la Cité de Dieu, les Stromates, les beaux Traités de Tertullien, etc., toujours en suivant la ligne que nous avons adoptée pour un premier travail.
(F.-Z. C.)
LYON, 18 Septembre 1833.
Adversus Avaritiam libri quatuor. — Ce Traité fut publié, pour la première fois, par Jean Sichard, dans l’Antidotum; Bâle, 1528. Il en existe une édition, Trêves, 1609, in 4°, avec des notes de Jean Macherentini.
Le recueil des œuvres de Salvien a été publié, pour la première fois, par J.-Alex. Brassicanus; Bâle, Froben, 1530, in fol. Le véritable nom de cet éditeur est Kolbulger; il naquit à Wirtemberg, en 1500, mourut à Vienne, 1539 ; — Quoiqu’il ait composé ou publié un assez grand nombre d’ouvrages, il n’a point d’article dans la Biographie universelle, mais Niceron lui a consacré quelques pages dans le tome XXXII de ses Mémoires. Il y avait justice, car Brassicanus a découvert plusieurs manuscrits enfouis dans diverses bibliothèques, et il en a été le premier éditeur (28). Dans la Préface de son Salvien, il rend compte à l’évêque Stadion d’un voyage qu’il fit en Hongrie; il y donne des détails fort curieux sur la bibliothèque fondée à Bude par le roi Matthias Corvinus. La description qu’il en fait peut nous donner une idée de la joie ou plutôt de l’enthousiasme qu’éprouvaient les savants de ce temps-là, quand ils se trouvaient au milieu de pareils trésors. — Inspexi libros omnes, s’écrie-t-il; sed quid libros dico, quot libros, tot etiam thesauros istic inspexi, Dii immortales, quamque jucundum hoc spectaculum fuisse quis credat ! Tunc certe non in bibliotheca, sed in Jovis gremio, quod aiunt, mihi esse videbar. — La Préface et les Scholies de Brassicanus ont été reproduites dans plusieurs autres éditions de Salvien.
Celle de Rome, Paul Manuce, 1564, in fol., est rare et recherchée. On fait encore quelque cas des éditions publiées par Pithou, Paris, 1580, in 8°, et par Conrad Ritterbus, Aldtorf, 1611, même format; mais la plus belle et la meilleure de toutes
[5] est celle qu’a donnée Baluze, et dans laquelle il a réuni les opuscules de saint Vincent de Lérins, Paris 1684, in 8°. Il ne faut pas croire néanmoins qu’elle soit irréprochable; nous l’avons presque toujours suivie pour notre traduction, et nous y avons trouvé bien des fautes de tout genre.— Du vray Jugement et Providence divine, à S. Salonie euesque de Vienne. Livres VIII. traduicts du Latin de S. Salvian euesque de Marseille, par Nicolas de Baufremont Baron de Senescey. A Lyon, par Guillaume Rouille, 1575, in 8°.
Nous empruntons à Du Verdier ce titre que M. Barbier donne ainsi dans ses Anonymes, n° 18070:
Traité de la Providence, traduit du Latin de Salvien, par B. B. D. S. (Beaufremont de Senescey). Lyon, Rouillé, 1575, in 8°.
Nicolas de Beaufremont, ou de Bauffrernont, grand prévôt de France sous Charles IX et Henri III, mourut en 1582, dans son château de Senescey. — Le baron de Senescey est le premier traducteur connu de Salvien; François de Belleforest qui florissait vers le même temps, a traduit aussi le Traité de la Providence, mais il ne paraît pas que sa version dont on conserve le manuscrit à la Bibliothèque royale ait été jamais imprimée. Voyez Bern. de Montfaucon, Bibl. bibl. mss, p. 794.
— Les Livres de la Providence de Dieu, traduits du Latin de Salvien, évêque de Marseille, par Pierre Du Ryer. Paris, Sommaville, 1634, in 8°.
La traduction de Du Ryer est précédée d’une épître à M. l’abbé de Tillières qui, suivant l’usage de MM. les faiseurs d’épîtres, est le plus grand homme que l’on ait jamais vu. « Lorsque je nous regarde, lui dit Du Ryer, sans tache parmi la corruption du siècle, je pense voir un rayon de soleil qui ne se souille pas davantage en s’étendant dessus la fange, qu’en reluisant dessus les fleurs. Du Ryer juge lui-même sa traduction en peu de mots, et assez bien, suivant moi. C’est un Français que je tâche à faire parler français, et que je veux rendre profitable à tout son pays; je sais bien que l’on pourrait le faire mieux parler que je n’ai fait, mais je me suis efforcé, suivant son dessein, de faire plutôt voir ses bons préceptes que de faire entendre de belles paroles. Un discours est, ce me semble, assez beau lorsqu’il est bon. Ces deux citations doivent vous suffire pour apprécier le travail de Du Ryer, dont vous avez d’ailleurs sous les mains une foule d’autres traductions (29). »
— Les Œuvres de Salvian evesque de Marseille contenant les huit livres de la Providence, les quatre livres contre l’Avarice avec plusieurs epistres traduites avec des notes, par Pierre Gorse; Paris, Gaspar. Maturas: 1655, in 4°.
— Nouvelle traduction des Œuvres de Salvien, et du Traité de Vincent de Lérins contre les Hérésies par le P. B... (Bonnet) prêtre de l’Oratoire; Paris, Valleyre, 1700, 2 vol. in 12. — Avec un titre rafraîchi. Paris, chez Simon Bernard, 1702.
Les auteurs du Journal des Sçavans s’expriment ainsi en rendant compte de cette traduction : « Tous ceux qui ont quelque connaissance des bons auteurs savent combien celui-ci (Salvien) est estimable. Il serait difficile d’en trouver un plus élégant, plus poli, plus utile, plus agréable, et dont les ouvrages soient plus du goût du siècle où nous vivons. Les portraits, les descriptions et les satires dont il est plein, sont fort à la mode. La traduction de ses livres est d’autant plus difficile que le plus grand agrément qu’il y ait, consistant dans l’arrangement et dans le choix des termes, dans le tour et dans la délicatesse des expressions, et dans la manière vive et noble de s’énoncer, il arrive rarement qu’un traducteur puisse atteindre dans ces sortes d’ouvrages à la beauté de l’original, etc. Les Sçavans critiques portent ensuite un jugement sur la traduction du P. Bonnet et sur celle de Drouet de Maupertuis. Ce dernier, disent-ils, ne s’est pas si fort attaché à la lettre (que le premier), mais il écrit avec beaucoup de délicatesse. Il a si bien pris le caractère de Salvien, et imité si parfaitement son style, que sa version ne se fait pas lire moins agréablement que le latin de Salvien.
C’est une décision singulière que celle-là !... Dans un âge de fortes études, dans un siècle où l’on étudiait, où l’on entendait très bien les auteurs latins, je suis étonné de voir des savants formuler un jugement faux en tout point. — Le P. Bonnet s’attache si peu à la lettre, qu’il prend la liberté d’abréger ou de supprimer, dans Salvien, ce qui n’a pas assez d’importance à ses yeux. Sa version fourmille de contresens, et n’a pas le mérite d’être écrite en français. M. Weiss, dans la Biographie universelle (art. Salvien), dit qu’elle est estimée; cela se peut, mais à coup sûr, elle n’est pas estimable (30).
Néanmoins, elle vaut encore mieux que celle de Maupertuis. Je ne connais rien de burlesque et de risible comme la paraphrase plate et insipide de ce misérable traducteur; il ne cesse de battre les champs, de mettre du sien dans l’auteur qu’il a sous les yeux, de supprimer à droite et à gauche. Les endroits les plus simples de Salvien, il lui arrive souvent de ne pas les entendre.
Après tout, si ces deux versions ne nous ont été d’aucune utilité, au moins, elles ont eu cela de bon, qu’elles nous ont donné parfois quelques minutes d’un rire franc et joyeux.
C’est le plus grand éloge qu’il nous soit possible d’en faire. Nous sommes sans jalousie de métier!
— Salvien, de la Providence, traduction nouvelle (par Jean-Baptiste de Drouet de Maupertuy); Paris, Guerin, 1701, in 12. — Traduction du traité du même sur l’Aumône; Bourges, 1714. Drouet de Maupertuy, ou de Maupertuis, naquit à Paris en 1650, et mourut à St Germain en Laye, en 1730.
— Œuvres de Salvien, prêtre de Marseille, contenant ses Lettres et ses Traités sur l’esprit d’intérêt et sur la Providence, traduites en français par le R. P***. (Mareuil) de la compagnie de Jésus. Paris, Delespine, 1734, in-12. — Il nous a été impossible de nous procurer la traduction du P. Mareuil; il nous serait donc impossible d’en parler, même avec le Journal des Savants; nous présumons, au reste, qu’elle peut aller de pair avec celle de Bonnet.
III.
TRADUCTIONS ITALIENNES.
— Libro di Salviano Vescovo di Marsiglia contra gli
Spettacoli ed altre vanità del mondo, tradotto da S. Carlo Borromeo. In
Milano, 1579 , in-12.
Voyez sur cette traduction, Argetati, Bibtioteca de' Votgarizzatori, article
SALVIANO , et l'Hist. litt. de France , T. II. P. 527.
— Trattato di Salviano Marsiliense della Providenza, in latino , in itatiano,
ed in francese, In Avignone , appresso Giov. Robby , 1703, in-4°. — La
traduction italienne est de l'abbé Guido Ronsart, et la française de J.-B.
de Maupertuy.
N. B. Pour ce travail sur les éditions et les traductions de Salvien, nous
devons beaucoup à M. A. Péricaud, bibliothécaire de la ville de Lyon; qu'il
nous soit permis de consigner ici l'expression de notre gratitude.
(1) Wiclef.
(2) Hus.
(3) Mélanchton, etc.
(4) Hermias.
(5) Chateaubriand , Études historiques, t. II. p. 235.
(6) De Gubernatione, t.1, livre vi, p. 368 de notre édition.
(7) Hist. Ecc., t. xvi, p. 182.
(8) Hist. litt. de la. France, t. ii , p. 518. — Hist. gén. des auteurs sacrés et eccl. par Dom Remi Ceillier, t. XV, p. 48.
(9) Située dans une petite île de ce nom, sur les côtes de Provence, à deux lieues d'Antibes. — C'est aujourd'hui Saint-Honorat.
(10) Biogr. aniv. art. Salvien , par M. Weiss. — Histoire de l'église gallicane, par le P. Longueval, t. ii, p. 96.
(11) GENNAD. Vir. ill. c. 67.
(12) Hilar. in Serm. de s. Honor. — Eucheh. Epist. ad Salon.
(13) Guizot, Cours d'Hist. mod.,t. i, p. 163.
(14) Livre II, p. 189.
(15) Livre II, p. 215.
(16) Livre III, p. 267.
(17) Livre III , p. 117.
(18)Thess. Epit. 1ere, iii. 3.
(19) Livre iv, p. 229.
(20) II nomme ainsi les peuples soumis à l'empire Romain.
(21) Livre vii , p. 93.
(22) Livre VI, p. 379.
(23) Hist. litt. de France; t. ii, p. 522. - Dupin, Bibliothèque des auteurs ecclésiastiques, t. v, p. 516.
(24) Vir. ill. c. 67.
(25) Guizot, Cours d'hist. mod., t. i, p. 163.
(26) Je me trouvais dernièrement chez M. Charles Nodier: Je vous engage beaucoup à traduire Sidoine, me disait-il avec ce ton de douce bienveillance qui le caractérise. Puis, il formulait un jugement exquis sur le talent et la manière de cet écrivain. — Sidoine sera traduit, nous l'espérons, et dédié au savant littérateur.
(28) Voy. G. Peignet, Choix de testament anciens et modernes, t. II. p. 248.
(29) Ce jugement est extrait d'une lettre de M. Weiss, Bibliothécaire de la ville de Besançon.
(30) Nous sommes à nous expliquer comment M. l'abbé Guillon, dans sa Bibliothèque choisie des Pères, cite Bonnet, au lieu de traduire lui-même ; nu ouvrage ainsi fait, est un ouvrage à refaire.
[5] Ch. Nodier, Bibliothèque sacrée,
p. 240. — Notre savant bibliographe était distrait, sans doute,
lorsqu’il a qualifié de seconde édition celle de 1684; c’est la
troisième. Les deux autres datent de 1663 et 1669.