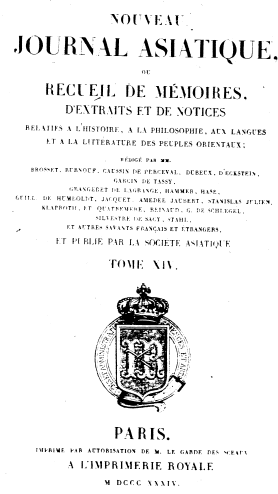
Ibn al-Qounfoud ou Qunfud
LA FARÉSIADE : extrait 3
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
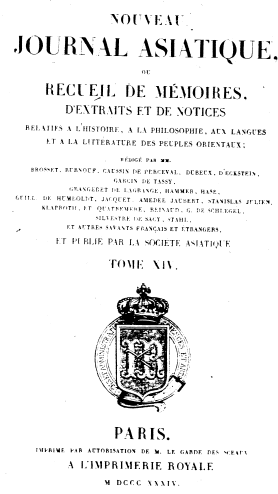
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
extraits du Journal Asiatique de 1848 à 1852
TROISIÈME EXTRAIT DE
OU
COMMENCEMENT DE LA DYNASTIE DES BENI-HAFSS;
TRADUIT EN FRANÇAIS ET ACCOMPAGNÉ DE NOTES,
PAR M. CHERBONNEAU.
L'histoire de Constantine, distraite du royaume de Tunis, dans lequel elle était enclavée pendant les vie, viie et viiie siècles de l'hégire, apportait des matériaux trop importants à la science et à l'histoire politique du monde, pour ne pas mériter une sérieuse attention. C'est ce qu'El-Khatib ben Konfoud sut comprendre. Il nous a laissé un livre qui traite spécialement la question berbère, de 515 à 805, et dont je soumets un troisième extrait à nos lecteurs.
Le plaisir qu'on éprouve à étudier un pays va toujours croissant et vous rend ambitieux. Entraîné par la curiosité d'abord, et puis par le besoin de compléter la monographie de Constantine, j'ai pris à tâche de réunir autant que possible les manuscrits arabes qui formeront la chaîne des siècles à partir de l'invasion musulmane. Le résultat de ma persévérance a été de grouper autour de moi une quinzaine de volumes , la plupart inconnus en Europe.
J'aurais ignoré beaucoup de faits et méconnu des hommes célèbres du Maghreb, si mon savant ami le capitaine de Neveu ne s'était pas empressé de me communiquer son exemplaire du Tekmilet-ed-Dihadj.
L'émir Abou Yahia Zakaria, fils d'El-Lahiani (1) et descendant direct d'Abou Mohammed Abd-el-Ouahed, qui était fils du vénérable cheikh Abou Hafss, monta sur le trône. Il fut salué khalife par une acclamation unanime (2), au mois de redjeb, l'an 711 (de J. C. 1311). A son retour du Hedjaz, où il venait d'accomplir le saint pèlerinage, il s'était fixé pendant quelque temps à Tripoli. Il quitta cette ville pour se rendre à Tunis (3); son premier ministre (cheikh daulet-ho) fut le cheikh Abou-Mohammed-el-Mezdouri (4). Il le maintint dans ses fonctions jusqu'au moment où l'émir Khaled fut pris et tué dans la capitale de l'Ifrikia.
L'émir Abou-Yahia-Zakaria était un homme lettré. Il sut, pendant une période d'environ neuf ans, se faire une juste réputation de bienfaisance et d'habileté dans l'administration (5). Il fut secondé (6) par Abou-Mohammed Abd-Allah et-Tidjâni, Ibn el-Khabbaz, et d'autres personnages non moins illustres. Bientôt son règne paisible fut troublé par l'entrée à Tunis du glorieux prince qu'il avait plu au Seigneur d'investir de l'autorité et de la force. Ce prince était Abou-Zakaria, fils de l'émir Abou-Ishak, fils de l'émir Abou-Zakaria, fils du roi Abou-Mohammed Abd-el-Ouahed, fils du cheikh Abou-Hafss. Constantine était sa patrie. Il y avait été élevé et y avait fait ses études : aussi cette ville devint-elle sa résidence favorite. Lorsqu'il fit son entrée triomphale dans Tunis, au mois de chaabân de l'année 717 (de J. C. 1317) (7), l'émir Zakaria-ben-el-Lahiâni quitta la capitale et chercha son salut dans la fuite. Mais le vainqueur n'eut pas lui-même le bonheur d'y rester plus de sept jours. Une révolte des Arabes le força de retourner à Constantine, où il ne s'occupa qu'à lever des troupes et à préparer une nouvelle expédition contre Tunis. Les astres furent consultés par un savant astrologue qui, d'après ses calculs, fixa le départ à quelques mois de là. Lorsque le moment fut arrivé, la flotte, qui était à l'ancre dans le port de Collo, cingla vers l'Ifrikia. Ben-el-Lahiâni, que les chances de la guerre avaient ramené à Tunis, se sauva à la première nouvelle de l'approche de l'émir, sans attendre le combat.
Ce fut un mercredi, le 7 de rebi second , l'an 718 (de J. C. 1318), que Abou-Yahia-abou-Becr, le noble descendant des princes orthodoxes, surnommé El-Motewakkel-âla-Allah, fit son entrée triomphale dans le capitale des Beni-Hafss. Ce jour-là, on renouvela pour lui la cérémonie de l'investiture. Tunis devint sa résidence; il n'en sortit que pour aller défendre ses états contre Ibn Abou-Amrân, et pour lutter pendant plus de dix années contre El-Abdel-Ouâdi (8). Avant cette époque, il avait eu déjà une lutte à soutenir. Quoi qu'il en soit, heureux ou malheureux, pas un des combats qu'il livra à El-Abdel-Ouâdi ne se termina sans qu'il ajoutât un nouveau fleuron à sa gloire et qu'il affermît sa renommée. Il trouva toujours dans son cœur de la pitié pour ceux qui l'avaient offensé en action ou en paroles, et le pardon pour ses ennemis.
On a de lui des poésies remarquables, qu'il composa dans ses jours de mauvaise fortune.
C'était un homme d'un beau physique, à la taille bien proportionnée, plein de courage, et vénéré autant pour ses bonnes œuvres que pour son zèle à s'entourer de magistrats éclairés et d'hommes d'une piété reconnue. Nul prince avant lui n'avait été aussi modeste et en même temps aussi magnanime. Chéri des grands, chéri du peuple, on le vit plus d'une fois récompenser ceux qui lui avaient fait du mal.
Voici une anecdote que je tiens de la bouche du savant docteur Abou Abd-Allah el-Heskouri (et non El-Beskouri, comme d'autres manuscrits le disent). Dans une déroute désastreuse où les gens de l'arrière-garde avaient seuls pu conserver leurs chevaux, l'émir fut forcé de se sauver à pied. Un individu s'élança sur lui, lui arracha ses habits et ne lui laissa que son seroual (culotte large). Vint le jour où tous deux se rencontrèrent face à face, mais dans une situation bien différente. L'homme ne savait plus que devenir, tant son âme était troublée. L'émir s'efforça de le rassurer. Il le traita avec égards, et ne laissa pas de lui prouver, par des paroles empreintes d'une douceur incroyable, qu'il lui pardonnait l'injure d'autrefois. Il alla même jusqu'à lui faire accepter des présents. On rapporte qu'un vieillard, témoin de cette scène, accosta l'individu et lui dit : « Que ne lui as-tu pris sa culotte? ta récompense serait double. » Cet acte est un des traits singuliers de la clémence des rois.
Après le désastre dont nous avons parlé plus haut, lorsque Abou-Yahia revenait à Constantine à pied , les habitants se portèrent à sa rencontre, et, touchés jusqu'aux larmes de sa misère, le supplièrent d'accepter tout ce qu'ils possédaient. Mais il les remercia du fond de son cœur. Dans cet intervalle, les Abdel-Ouâdi devenus maîtres de Tunis, s'y maintinrent quelque temps et mirent le siège devant Constantine, dernier refuge de l'émir. Le siège dura six mois. Abou Yahia ayant déclaré qu'il sortirait de la ville et irait chercher son salut dans une autre, ses compatriotes, résolus à faire une résistance désespérée , le conjurèrent de rester tranquille au milieu d'eux. En effet, comme s'il eût été indifférent à la lutte, il demeura dans la plus complète inaction, ne s'inquiétant pas même des opérations de la défense ; il ne sortait de son palais que lorsqu'il se rendait au sélâm (9), qui est situé à côté de Babel-Ouâdi (la porte de la rivière) (10), pour voir le combat. Un jour l'attaque fut si vigoureuse, que les assiégeants se suspendaient déjà aux remparts avec leurs mains. La provision de pierres qui servaient de projectiles était épuisée. Le cheikh Khalf Allah-ben-el-Haçan-ben-el-Konfoud vit le danger. « Des pierres, s'écria-t-il! apportez des pierres! un dirhem pour une pierre ! » En moins d'un instant, une somme considérable fut distribuée. Le sultan avait entendu cet appel généreux ; il félicita le cheikh. Bientôt après il fit lui-même une sortie à la tête des troupes et repoussa l'ennemi jusqu'aux frontières de la province.
On peut citer plusieurs faits à la louange de ce prince. Sa nourrice fut appelée à intercéder auprès de lui en mainte circonstance. Quand elle voulait obtenir une grâce, elle entrait dans sa chambre tenant en main un de ses seins nu. A cette vue, le prince baissait les yeux et disait : « Qu'on fasse ce qu'elle demande. »
Toutes les fois que Abou-Yahia apercevait un homme en prison, il le faisait mettre en liberté sur le champ.
Il avait eu pour professeur un cadi de notre ville (Constantine), le docte cheikh Abou-Ali-Omar-el-Djebaïli (11). C'est auprès de lui qu'il avait appris le Koran. Lorsque son petit-fils Aboul-Abbas-Ahmed vint le voir à Tunis et se présenta au palais pour lui rendre hommage, il portait en évidence sur son épaule droite le martinet avec lequel le khalife avait été corrigé au temps de ses premières études.
La vue de cet objet réveilla dans le cœur de celui-ci des souvenirs si émouvants, qu'il ordonna immédiatement qu'on accomplît les désirs du jeune prince.
S'il est une charité qui honore Abou-Yahia, c'est d'avoir consacré comme habous (12) aux deux principales mosquées de Constantine (13) le quart des dons pieux légués en faveur de la Mekke et de Médine.
Aussitôt que le sultan soupçonnait un homme de complicité avec un ennemi de sa personne, au lieu de le laisser exposé à la persécution, il lui faisait un rempart de sa clémence.
Nous tenons l'anecdote et les remarques suivantes de Abou-Ali-Baçan-el-Merrâkechi, savant médecin de notre ville. Un jour, dit-il, j'allai faire une visite au sultan. Je le trouvai étendu sur son doukkan, qui était situé en dehors de la ville et lui servait de lieu de repos. Il était extrêmement affaibli par une blessure grave qu'il avait reçue dans un combat contre Abd-el-Ouâdi. Près de lui se tenaient le docte médecin Ibn Hamza et son fils le caïd Abou Abd-Allah el-Hakim. On lisait sur leurs visages le chagrin mêlé d'effroi que leur avait causée l'inspection de cette plaie horrible. Le sultan prit la parole et leur dit : « Je ne survivrai pas longtemps à cette souffrance. D'ailleurs Sidi Yakoub-ben-Amrân m'a promis que je mourrais de ma belle mort. »
Ce Yakoub-ben-Amrân n'est autre que le père de mon aïeul maternel Yousef ben-Yakoub-el-Melâri; il est certain qu'il fit cette prédiction au sultan, le jour de son avènement, comme on le verra plus loin.
Mais revenons au récit du médecin Abou-Ali-Haçanel-Merrâkechi. Dès que les assistants se furent retirés, ajouta-t-il, nous restâmes seuls le sultan et moi. Il me dit : « Ibn Endâress est sans contredit l'Avicenne de son siècle, et Ibn Hamza l'émir de notre maison. Mais toutes les fois que Ibn Endâress me prescrira quelque remède, fais-moi le plaisir de l'examiner avec soin, parce que je le soupçonne d'être encore tout dévoué à Ibn el-Lahiâni. »
Cependant, chaque fois que le célèbre médecin entrait dans l'appartement du sultan, celui-ci lui offrait un coussin de son serir (sopha), afin de rendre hommage à la science.
Abou-Yahia fut proclamé souverain la première fois à Constantine, après la mort de son frère Abou el-Baka-Khaled, en l'année 711 (de J. C. 1311). Il avait alors vingt ans.
Bougie avait pour gouverneur, à cette époque, Ibn Khallouf-es-Sanhadji. Pour s'emparer de cette principauté, il l'exila auprès d'Ibn Omar, son ennemi le plus redoutable. L'expédient réussit. A son arrivée, le malheureux fut pris et mis à mort.
Au commencement de ce règne, un nouveau travail fut exécuté pour la délimitation du royaume, et les frontières furent déterminées par des colonnes milliaires.
Lors de son couronnement à Constantine, Abou Yahia convoqua pour cette solennité les docteurs de la loi et les hommes recommandables par leur piété. Il plaça l'administration des affaires de l'Etat entre les mains de son premier hâdjeb, le doyen des légistes , Ahou-Abd-er-Rahman-Yakoub-ben-Omar. C'est le jour même de la cérémonie que mon bisaïeul maternel Yakoub-ben-Amran-el-bou-Ioucefi, qui était venu de Thâra, pour y assister, posa la main sur l'épaule du sultan en lui disant : « Ton règne sera long, je l'espère; et tu mourras de ta belle mort. « Ravi de joie par cette prophétie, Abou-Yahia le pria de lui choisir un surnom parmi ceux qu'avaient pris les khalifes. Il en avait écrit lui-même une longue liste. Après l'avoir examinée, le cheikh lui proposa la devise El-Motawakkel-âla-Allah (celui qui met sa confiance en Dieu). Pour lui exprimer sa reconnaissance, le sultan ordonna qu'on distribuât la valeur de mille dinars aux pauvres de sa suite. Un des fils du cheikh reçut la somme sans en prévenir son père. Lorsque les visiteurs furent sortis du palais, le cheikh dit à son monde : « Quel piège nous dresse-t-on sur la route? » Le jeune homme, se croyant découvert, avoua tout. « Va rendre cet argent à Ibn Omar, lui ordonna son père, et dis-lui : « Voilà le cadeau d'hospitalité que vous offrent les pauvres. »
Toutes les fois que ce vénérable cheikh obtenait la faveur d'entrer à la cour, le sultan faisait pour le recevoir les mêmes ablutions que pour la prière. Il ne lui arriva jamais de lui refuser l'entrée du palais à lui ou à ses enfants. Il engagea les princes qui devaient lui survivre, par des lettres qui sont aujourd'hui entre mes mains, à prier Dieu pour lui sur la tombe du marabout.
Le sultan connaissait de vue tous les habitants de Constantine. Il demandait de leurs nouvelles en les désignant chacun par leur nom. Quand il en rencontrait un ou plusieurs voyageant à cheval, il les priait instamment de ne pas mettre pied à terre pour lui rendre hommage.
Il sut imprimer un mouvement régulier aux fonctions publiques. Chaque affaire était remise entre les mains des administrateurs compétents; chaque personne occupait l'emploi qui convenait spécialement à son mérite. Il ne conféra les charges judiciaires qu'à ceux que l'opinion publique lui désigna comme dignes de les occuper, et ne délivra jamais un diplôme sans s'appuyer de la décision du conseil d'Etat. Son hadjeb était le chef suprême de l'administration; et comme le poste était important et difficile, il eut de nombreux caïds et de nombreux hadjebs.
Le premier qui fut appelé aux fonctions de hadjeb fut le jurisconsulte Abou-Omar; le dernier fut le cheikh, le doyen Abou-Mohammed-Abd-Allah, fils du cheikh Aboul-Abbas-Ahmed-ben-Taféradjin (14) de Tinmal, qui avait été vizir. Entre ces deux dignitaires, il y eut une série d'environ douze hadjebs. Ce fut en l'année 744 (de J. C. 1343), que le cheikh Abou-Mohammed succéda au caïd Abou-Abd-Allah ben-el-Hakim, qui était devenu hadjeb après avoir été caïd. Lui-même il eut pour successeur le légiste Ben abd-el-Aziz (15), qui fut remplacé par le docteur Abou Abd-Allah Mohammed ben Seïd-en-Nâs (16). Ce dernier fut mis à mort et brûlé publiquement pour diffamation. Le feu ayant épargné sa main droite, on la rejeta plusieurs fois dans les flammes; mais elle demeura intacte. Ce fait est authentique. On attribue ce phénomène aux aumônes nombreuses du cheikh et à ce qu'il s'était appliqué pendant sa vie à copier des livres de piété. Quoi qu'il en soit, Dieu sait la vérité.
Le prince des croyants ne prit à son service que les katebs du plus grand mérite, tels que les Ibn Aboul-Fadel, les Ibn Robbab, les Ibn Omar et les Ibn el-Hâdjeb. Ce qui fait surtout son éloge, c'est qu'il eut la prévoyance d'établir ses cinq enfants chacun à la tête d'une principauté. L'émir Abou-Zakaria eut Bougie; son fils bien-aimé, l'émir vertueux et accompli Abou-Abd-Allah-Mohammed reçut l'apanage de Constantine; El-Fadel fut gouverneur de Bône; Khaled prit le commandement d'El-Mahdia ; et Aboul-Fârès devint commandant supérieur de Souça. Il entoura ces jeunes princes d'officiers distingués et de caïds expérimentés.
L'émir Abou-Abd-Allah était remarquable par la vivacité de son esprit. Il joignait à une belle intelligence, la science, la modestie, la bonté, la générosité, et surtout la majesté d'un roi. Doué d'une imagination facile, il improvisait des poésies. Son écriture eût fait envie aux plus habiles calligraphes. Sa société empruntait un charme irrésistible à l'aménité de son caractère et à l'enjouement de sa conversation…. (Il y a ici une lacune dans les trois manuscrits que j'ai sous les yeux). Politique sage et éclairé, il sut faire respecter les droits de ses sujets et de ses caïds. En un mot, son gouvernement marchait avec une telle régularité, qu'on l'eût pris pour un royaume indépendant. L'émir Abou Abd-Allah naquit à Constantine, comme nous l'avons dit. Il y fit ses études, y passa toute sa jeunesse et s'y créa de nombreux amis.
Un jour qu'il avait envie d'aller voir son père, le commandeur des croyants, il partit pour Tunis en l'année 734 (de J. C. 1333) à la tête d'une armée parfaitement équipée. Mais le sultan, qui désapprouvait ce voyage, lui expédiait chaque jour des lettres pour l'inviter à retourner sur ses pas. Trop fier (17) pour se soumettre aux ordres de son père, le prince trouva un prétexte pour continuer sa marche vers la capitale. En arrivant, il fit planter ses tentes sous les murs et envoya demander au roi la permission d'entrer en ville. Oubliant qu'il lui avait ordonné de renoncer à son voyage, son père lui permit d'entrer, mais sans suite, à Tunis. Abou-Abd-Allah, ému jusqu'aux larmes, se présenta devant lui et se prosterna la face contre terre. Le roi le rassura et lui dit à plusieurs reprises : « Comment te portes-tu, Mohammed? Mohammed, mon fils chéri?» Après cette réception affectueuse, il donna des ordres pour qu'on introduisît également dans son palais les grands personnages de sa suite. Le premier qui entra fut le caïd En-Nebil; puis vinrent trois docteurs, le cadi Abou-Ali-Haçan-ben-Aboul-Kacem-ben-Badis (18), le cheikh Abou-Ali-Haçan-ben-Khalf-Allah ben el-Konfoud (19), et le juriste fameux Abou Ali Haçan ben Ah' el-Merrakechi, qui exerçait la médecine. Le sultan s'informa de la santé de chacun personnellement. Ensuite arriva le célèbre kateb Abou-Ishak-Ibrahim-ben-el-Hadjadje (20), natif de Grenade en Andalous; puis la foule des caïds, des courtisans et des cavaliers de distinction. Pendant cette cérémonie, le prince Abou-Abd-Allah se tenait debout dans la salle, et nommait à son père tous les personnages qui se présentaient. Quand la visite fut terminée, le sultan engagea les assistants à s'asseoir. Un instant après il se leva, posa une main sur l'épaule de son fils et passa avec lui dans un autre appartement où ils eurent un entretien plein de cordialité. Il fit venir aussi son hadjeb, le jurisconsulte Ben-Abd-el-Aziz et lui dit : « Tu veilleras à satisfaire tous les désirs de Mohammed pendant son séjour à Tunis et tu signeras avec son sceau. »
Tant que l'émir Abou-Abd-Allah demeura à Tunis, il dirigea toutes les affaires par le ministère du hadjeb Ben-Abd-el-Aziz. Cependant, il arrivait quelquefois au khalife de le consulter pour la distribution des largesses aux personnes qui lui étaient dévouées ; et lorsque le jeune prince approuvait un don, il doublait la somme. Ainsi, quand il portait sur la liste un dinar, le khalife en donnait deux. Cette espèce d'interrègne ne dura que quelque temps. Ahou-Abd-Allah emporta dans sa ville bienaimée de Constantine le souvenir de l'excellent accueil dont il avait été l'objet. Il continua de s'y populariser et jouit pendant cinq ans de l'affection de ses sujets. Mais ce bonheur devait avoir un terme. Une mort prématurée l'enleva à ses amis et plongea Constantine dans les ténèbres de la tristesse. Il mourut de consomption, à l'âge de trente ans. On était dans l'année 739 (de J. C. 1338). La ville entière prit le deuil. Le bouffon du prince jeta ses habits et se plongea tout entier dans la cuve d'un teinturier. Ainsi barbouillé de la tête aux pieds, il courut à la casbah (21) : mais on ne l'y laissa pas entrer.
Les héritiers de Abou-Abd-Allah étaient au nombre de sept, tous mâles. Chacun d'eux reçut en partage la succession qui lui était assignée dans le testament rédigé par feu mon père El-Khatib……………………. (Les trois manuscrits présentent encore une lacune en cet endroit.) La fortune laissée par le prince se trouvait parfaitement assise (22); elle s'élevait, diton, à trente mille pièces d'or.
Son fils aîné Aboul-Abbas-Ahmed, qui n'était encore qu'un enfant de onze ans, partit seul de sa famille pour Tunis. Il se rendit à la cour du khalife son grand-père, dans le but de lui demander pour lui et pour ses six frères l'apanage de Constantine. L'accueil qu'il reçut fut signalé par toutes sortes de gracieusetés et de prévenances. Il revint dans son pays après avoir obtenu l'objet de ses vœux. Quant au sultan, il ne cessa pas, pendant les dernières années de sa vie, de s'intéresser aux affaires de Constantine; sa haute sollicitude s'adressa même plus d'une fois au Mezouar (23) chargé de l'éducation de ses petits-fils, pour connaître l'état de leur fortune particulière. Ce fut au mois de redjeb de l'année 747 (de J. C. 1346) qu'il paya sa dette à Dieu. L'histoire n'a pas dédaigné d'enregistrer les circonstances qui précédèrent sa mort. Depuis quelque temps il s'était retiré dans son grand jardin de plaisance pour s'y reposer du souci des affaires publiques. Un jour le cadi Abou-Abd-Allah-ben-Abd-es-Selâm-el-Hawâri qui doit une partie de sa célébrité à son commentaire du livre d'Ibn el-Hâdjeb, vint, selon la coutume des cadis de Tunis dans cette circonstance solennelle, lui présenter la note officielle de l'apparition de la lune de redjeb pour l'année 747 (de J. C. 1346). A la première lecture, il ne put s'empêcher de s'écrier : « Il n'y a de Dieu que Dieu. Eh quoi! redjeb est commencé! Nous sommes dans le mois de redjeb! » Sa voix émue répéta plusieurs fois ces paroles; puis il se leva, fit un acte de contrition et s'humilia devant Dieu, le très-haut et le généreux. Après qu'il eut achevé sa prière , il dit aux personnages qui l'entouraient : « C'est dans ce mois-ci que je mourrai. »
J'ignore si le sultan tenait ce pronostic du cheikh qui lui avait posé la main sur l'épaule le jour de son investiture, ou de tout autre. Quoi qu'il en soit, il monta à cheval et traversa les différents quartiers de la ville, le visage découvert. A partir de ce jour, il ne se montra plus que très-rarement. Sa piété s'exerçait à distribuer des aumônes. Enfin, il rentra à la casbah pour ne plus en sortir. Deux jours après, se sentant une démangeaison à l'épaule, il pria une de ses sœurs d'y regarder. Celle-ci examina l'endroit où il s'était gratté, et aperçut un petit bouton ; puis le bouton devint rouge et détermina une fièvre violente. Malgré son état, le prince trouva le courage de s'occuper des affaires du royaume. Il mourut, comme je l'ai dit précédemment, dans le mois de redjeb. Son fils l'émir Abou-Hafss-Omar, fils du commandeur des croyants Abou Yahia ben Abou Zakaria, descendant des émirs orthodoxes (Er-Râchedin), monta sur le trône (24).
(1) MM. Pellissier et Rémusat ont commis deux erreurs graves au sujet de ce nom propre ; ils en ont fait deux personnages différents. A la page 236, ligne 19 du VIIe volume de l'Exploration scientifique de l'Algérie, ils écrivent Djiani; plus loin, à la page 238, l. 9 , ils appellent le même prince El-H’iani; enfin, à la page 240, ligne 6, ils le font reparaître sous le nom d'El-Djiani. Cependant, Er-Raïni-el-Kaîrouani, auteur du Kitab-el-Mouness-fi-Akhbar-Ifrikia ou Touness, donne El-Lahiâni. Je trouve la même leçon dans l'Anonyme de Constantine, fol. 173 recto, ligne 1. Ibn Chemmâ, dans l’Adilla-el-Beïna en-Nourânia-âla-Mefâkrer-ed-Daula-el-Hafsia, fol. 27 recto, ligne 1, et fol. 26 recto, ligne 13, écrit aussi El Lahiâni. Enfin Ez-Zerkechi tombe d'accord sur ce point avec les auteurs précédents. (Cf. l'excellent article de M. Alph. Rousseau, Journal asiat. avril-mai 1849, p. 296 et 314.)
(2) Au dire de Mohammed-ben-Abi-er-Raïni-el-Kaïrouâni (p. 109, l. 13, de mon exemplaire), il fut proclamé khalife à Mohammadia. C'est aussi ce que nous apprend l'Anonyme de Constantine, fol. 176 verso, l. 5. — Les traducteurs de l'Histoire d'Afrique ont imprimé 721 au lieu de 711, qui est la véritable date de son avènement. (Voy. Exploration scientifique de Y Algérie, p. 236, l. 24, et p. 237, l. 14.)
(3) Le premier acte de ce prince fut de passer en revue les troupes à Râss-el-Tâbîa, entre l'enceinte de Tunis et le Bardô. Il fit rayer des contrôles ceux qui n'étaient pas d'une origine kabyle bien avérée. (Cf. l'Anonyme de Constantine, fol. 176 verso, ligne 9.)
On a souvent cherché à expliquer l'étymologie du mot kabyle, employé par tous les auteurs arabes du Maghreb, et devenu le nom spécial de certaines populations de l'Algérie. M. le général Daumas s'est ingénié à nous offrir les trois racines : kuebila, tribu; kabel, il a accepté, kobel, devant (voir la Grande Kabylie, p. 5 et 6) ; mais il ne s'est prononcé pour aucune d'elles. Je pense qu'il n'aurait pas hésité, s'il avait eu connaissance du passage suivant, que j'extrais du Kitab-el-Mouness-fi-Akhbar-Ifrikïa-ou-Touness, fol. 82, l. 10.
« Les Berbères sont d’innombrables tribus qui habitent, pour la plupart, le désert vers le sud. Il faut six mois de marche pour traverser leur pays en longueur, et quatre pour le parcourir dans sa largeur. Ils ne connaissent ni le labourage, ni l'ensemencement des terres, ni les fruits, et se nourrissent de dattes et de lait aigre. Il y en a qui n'ont jamais mangé de viande. Pour ce qui est de la religion, ils se conforment à la Sunna et au préceptes des disciples de Mahomet. II est probable que ce sont eux qu'on désigne aujourd'hui par le nom de Toâreks. »
(4) Il faut croire que mes deux exemplaires de la Farésia ou Farésiade sont incorrects ; car celui de mon ami M. Brosselard s'accorde avec l'Anonyme de Constantine (fol. 176 recto, l. 31) et le Kitab-el-Mouness (fol. 109, l. 12), pour appeler ce cheikh El-Mezdouri. La leçon d'Ibn Chemmâ s'éloigne tellement de l'orthographe indiquée par les autres historiens, que nous devons la rejeter. De El-Mezdouri, il a fait El-Mezdioufi (voir fol. 25 recto, l. 9 et 12).
(5) Les copistes paraissent avoir été embarrassés en cet endroit…. A partir de cet endroit, l'exemplaire de M. Brosselard ne m'est plus d'aucun secours.
(6) Mes deux manuscrits sont en désaccord sur le mot qui commence la phrase.
(7) C'est en l'année 1817 que l'on voit reparaître la faculté de l'exportation du blé, avec la clause du prix régulateur, dans un traité avec les Vénitiens. (Voir Exploration scientifique de l'Algérie, t. VI, p. 219).
(8) Ibn Chemmâ , ainsi que son compilateur El-Kaïrouâni , parlent avec plus de détails des guerres qui eurent lieu sous ce règne. Ils mentionnent surtout le siège de Tunis par les Arabes, en 743 (de J. C. 1342). C'est dans l'Anonyme de Constantine que le récit est le plus circonstancié. J'aurai plus tard l'occasion de le publier.
(9) A Constantine, on appelle selâm, la galerie intérieure d'une maison construite entre le rez-de-chaussée et le premier étage, par exemple celle du palais de Salah-bey (aujourd'hui l'hôpital civil). Ce mot manque dans les dictionnaires.
Il devait y avoir près des remparts un bâtiment élevé, dont le selâm dominait la campagne; à moins que ce nom n'ait servi autrefois à désigner la tour carrée, de construction romaine, qui s'élève sur le bord du rocher, entre la porte dite Bab-el-djedid (aujourd'hui condamnée), et la pointe de Tabia. Cette tour s'appelle de nos jours Bordj-Açouss.
(10) La porte Bab-el-Oued (suivant la prononciation moderne), se trouvait entre Bab-el-Djedid et Bab-el-Djâbia. Elle a été démolie par les Français et remplacée par la porte Valée.
(11) Un de mes manuscrits écrit El-Djebâli.
(12) Pour l'explication du mot habous, consultez l'ouvrage de mon savant ami le capitaine de Neveu, intitulé: Les Khouans, ordres religieux chez les musulmans de l'Algérie. Paris, 1816, edit. alter, p. 118.
(13) Les deux principales mosquées de Constantine, sous la dynastie des Hafsides, étaient Djama' el-Casba et Djama' el-Kebir. La première a été convertie en magasin par le génie militaire. L'autre est encore affectée au culte ; mais elle a perdu de son importance depuis que Husseïn-Bey, en 1156 (de J. C. 1743), et Salah-Bey, en 1191 (de J. C. 1777), ont fait bâtir les mosquées de Sidi-l-Akhdar, et de Sidi-l-Kettani.
Djama'-l-Kebir est située entre la place dite El-Betha et le marché aux cuirs. L'intendance de cette mosquée a appartenu pendant plusieurs siècles aux Ben-Lefgoun, dans la famille desquels s'est maintenue, jusqu'à l'arrivée des Français, la dignité do cheikh-el-islam ( souverain pontife).
En visitant ce vaste temple, qui forme une presqu'île dans le quartier où il s'élève, j'ai remarqué que le sanctuaire avait dû être construit sur les ruines d'un ancien temple grec. Ce qui me porte à avancer cette assertion, c'est que la toiture est soutenue par environ quarante colonnes de pierre d'une architecture qui rappelle le goût byzantin, et dont la plus petite n'a pas moins de soixante centimètres de diamètre sur quatre mètres de hauteur. Les six colonnes, disposées de chaque côté du mihrab, sont surmontées de chapiteaux de l'ordre corinthien, dont la sculpture élégante a presque entièrement disparu sous la croûte épaisse de chaux que les musulmans ont l'habitude de prodiguer aux monuments, sous prétexte de les blanchir. Le chapiteau de celle qui est à gauche a été fouillé et nettoyé récemment par ordre de l'architecte de la province. Son feuillage délicat, ainsi que les ornements qui l'accompagnent, révèlent l'habileté des artistes qui furent employés par Constantin à la reconstruction de la colonie Sittienne.
Quant à la date de l'édifice musulman, elle est postérieure au sixième siècle, comme le prouve une inscription arabe gravée très grossièrement, et sans points diacritiques, sur une pierre noirâtre, qui fait partie des premières assises de la galerie occidentale. En voici la copie :
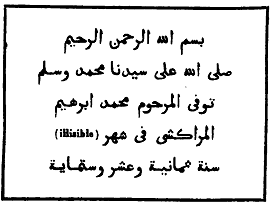
Au nom de Dieu clément et miséricordieux ! que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur notre seigneur Mahomet! Ci-gît Mohammed Ibrahim el-Merrâkechi (le Marocain), mort dans le mois (illisible) de l'année 618. »
C'est en 1848 que j'eus le bonheur de découvrir cette inscription sous la couche de chaux qui en laissait à peine soupçonner l'existence. Je la fis gratter avec soin, au grand contentement des fidèles musulmans. Mais cette année, lorsque pour rédiger cette notice, je me suis rendu à Djama' el-Kebir, je n'ai plus trouvé qu'un plâtrage tout neuf appliqué sur mon épitaphe. On venait de construire à côté une cloison destinée à séparer la salle de la prière des galeries adjacentes. Il est à espérer que le caïd El-Bled rendra à la lumière une date aussi précieuse.
Djama' el-Kebir a été bâtie par un émir Hafside, un siècle environ après la restauration de la mosquée de la Casbah, qui est due elle-même à un prince de cette famille. Un cadi de la ville, descendant de l'illustre famille des Badis, m'a affirmé que les anciens registres des habous attestent qu'à cette époque, c'est-à dire au commencement du viiie siècle de l'hégire, le revenu des donations pieuses était affecté principalement aux deux mosquées en question.
L'inscription ci-dessus n'est pas la seule que l'on trouve à Djama' el-Kebir. Il en existe une autre d'une époque plus reculée. Elle occupe toute la surface d'une pierre enclavée transversalement dans le pan occidental du minaret, à deux mètres soixante et dix centimètres du sol. Quelques lésions semblables à des trous faits par des balles de fusil, ne l'ont que légèrement endommagée. Je crois devoir la citer à cause de l'enseignement qu'elle offre aux conquérants modernes de la Numidie. Un barbare (berbère) devient questeur, édile et citoyen romain! Depuis, il est vrai, Mahomet a paru sur la terre; mais la conquête morale du pays n'en sera que plus glorieuse. Voici l'inscription latine :
CONCORDIAE
COLONIARVM
CIRTENSIVM
SACRVM.
C. IVLIVS. C. FIL. QVIR.
BARBARVS QVAEST.
AED. STATVAM QVAM
OB HONOREM
AEDILITATIS POLLI
CITVS EST SVA PECV
NIA POSVIT
D. D. D.
On a trouvé l'an dernier à Lambaesa, près de Batna, une statue tronquée avec la légende : GENIO COLONIARVM CIRTENSIVM. Ce document prouve que Lambaesa faisait partie de la grande fédération Cirtensienne.
(14) Taferadjin est une altération du mot berbère tifraguine, pluriel du substantif féminin tafragt, qui lui-même est le diminutif d'afrag, au pluriel ifraguen, cour d'un douar, d'une maison, synonyme de merah. Je dois cette note à mon ami M. Brosselard , auteur du dictionnaire berbère. M'est-il permis de rapprocher le nom de Takfarinas de celui de Taferadjin ou Tafradjin?
(15) Le juriste Aboul-Kacem-ibn-Abd-el-Aïn-el-Gassâni, ne remplit pas longtemps les fonctions de chambellan, car il mourut en 744 de l'hégire, comme nous l'apprend Ibn Chemma dans l'Adilla-el-Beïna-en-Nourânîa, fol. 27, rect. l. 5.
(16) Ahmed-Baba le Tombouctien, qui florissait au xe siècle de l'hégire, a rédigé dans son Tekmilet-ed-Dibadj, fol. 63 verso, I. 7, la biographie d'un Mohammed ben-Seïd en-Nâss, qui parut dans l’Ifrikia sous le règne d'El-Mostansser, et mourut en 607 de l'hégire. Ce Mohammed-ben-Seïd-en-Nâss eut un fils nommé Aboul-Abbas-Ahmed-ben-Seïd-en-Nâss, dont la mort trafique a été racontée par M. Alph. Rousseau dans son important extrait d'El-Zerkeschi sur la dynastie des Beni-Hafss (cf. Journ. asiat. avril-mai 1849, p. 288). Le docteur mis en scène par El-Khatib doit être le fils de ce dernier.
(17)
J'avais étudié de toutes les manières le mot
 reproduit
par les deux copistes, sans pouvoir obtenir un sens raisonnable; et, à mon grand
regret, je me voyais forcé de renoncer à la traduction de ce passage, lorsque,
pendant la correction des épreuves , j'ai acquis la certitude que l'exemplaire
du capitaine Boissonnet remplaçait
reproduit
par les deux copistes, sans pouvoir obtenir un sens raisonnable; et, à mon grand
regret, je me voyais forcé de renoncer à la traduction de ce passage, lorsque,
pendant la correction des épreuves , j'ai acquis la certitude que l'exemplaire
du capitaine Boissonnet remplaçait
 par
par
 «
fière, hautaine », attribut de « âme ».
«
fière, hautaine », attribut de « âme ».
(18) El-Abdéri dans son itinéraire, fait mention du cadi constantinois Abou-Ali-Haçan-ben-Aboul-Kacem-ben-Badis. Le docteur tombouctien Ahmed-Baba nous a transmis sa biographie dans le Tekmilet-ed-Dibadj. Les Ben-Badis forment une des plus anciennes familles de Constantine. On y compte une succession de quarante docteurs, arbaïn rezza, comme disent les gens du pays. Le dernier est Sil-Mekki-ben-Badis, suppléant du cadi du bureau arabe.
(19) Le Tekmilet-ed-Dibadj donne au fol. 9 verso, l. 15, la biographie d'Ahmed-ben-Haçan-ben-Ali-ben-el-Khatib-ben-Konfoud, né en 740 à Constantine. Je n'hésite pas à le regarder comme le fils du cheikh Abou-AH-Haçan-ben-Khalf-Allah-ben-el-Konfoud.
(20) Je trouve dans le Tekmilet, fol. 17 verso, l. 17, un personnage appelé Ibrahim-ben-el-Hadj, qui vécut dans l'Ifrikia à la même époque et fit deux fois le pèlerinage. Il prit du service auprès du sultan Abou-E'unân, puis il retourna en Espagne, où il mourut l'an 758. Mes deux manuscrits donnent, peut-être à tort, El-Hadjadje. L'exemplaire de M. Brosselard offre une lacune considérable pour ce règne.
(21) Nous avons vu dans le précédent extrait de la Farésiade, que l'émir Abou-Hafess avait fait construire un palais dans l'enceinte de la casbah de Constantine, en l'année 683.
(22) La phrase qui suit cette lacune est incorrecte et inintelligible dans les deux manuscrits.
(23) M. Dozy nous apprend, dans le Journal asiatique, p. 163 (mai 1844), que le Mezouar, à la cour des Mérinides, était chargé de garder la porte du prince et de le soustraire à l'importunité du public ». Cette assertion est d'autant plus probable que mezouar, paraît être dérivé du verbe « visiter, faire une visite ». Cependant il nous importe de profiter de la note suivante qui m'a été communiquée par M. Brosselard, l'homme le plus savant en langue berbère. Mezouar est un mot de la langue kabyle qui signifie primus, premier. El-Khatib l'a arabisé en retranchant l'élif initial qui est le caractère du singulier masculin. C'est ainsi que du mot amoqrân, grand, les Arabes ont fait moqrân. et moqrâni. »
(24) On lit dans El-Mouness-fi-Akhbar-Ifrikia-ou-Touness, fol. 1 r. l. 1 et 2 : ....« Après avoir désigné son fils Aboul-Abbas pour son successeur. Le jeune prince se trouvait dans le Belad-el-Djerid, lors de la mort de son père. Ses frères étaient à la tète de leurs principautés, à l'exception d'Abou-Hafez-Omar, qui restait à Tunis, et s'empara du trône.» Et plus loin, l. 7 : « Ce fut Taferadjin qui le poussa à usurper la souveraineté, au mépris des dispositions du sultan Abou-Yahia en faveur d'Aboul-Abbas. »
El-Raïni-el-Kaïrouâni a copié textuellement ce passage dans l'ouvrage d'Ibn Chemmâ'. (Cf. l'Adilla, fol. 27 verso, l. 3 et suiv.)